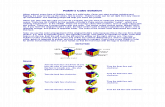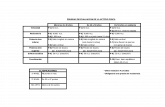bibliothquedel124ecol
-
Upload
francophilus-verus -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of bibliothquedel124ecol
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
1/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
2/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
3/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
4/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
5/202
BIBLIOTHQUEDE l'cole
DES HAUTES TUDESPUBLIER SOUS t.ES AUSPICES
DU iMIMSTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SCIENCES PHILOLOGIQUES ET HISTORIQUES
CENT-VINGT-QUATRIEME FASCICULEANNALES DE LfUSTOIRE DE FRANCE A l'POQUE CAROLINOIENNE
CHARLES LE SIMPLE, PAR AUGUSTE ECKEL
PARISLIBRAIRIE EMILE BOUILLON, DITEUR
67, RUE DE RICHELIEU, AU PREMIEK1899
Tous droits rservs.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
6/202
I il
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
7/202
ANNALES DE LHISTOIRE DE FRANGE A L'POQL'E CAROLINGIENNE
CHARLES LE SDIPLE
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
8/202
CHARTRES. IMPRIMERIE DURAND, RUE FULBERT.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
9/202
ANNALES DE L'HISTOIRE DE FRANCEA l'poque carolingienne
CHARLES LE SIMPLEAuguste ECKEL
ARCHIVISTE -PALOGRAPHE, LVE DIPLM DE l'COLDES HAUTES TUDES
PARISLIBRAIRIE EMILE BOUILLON, EDITEUR67, HUE DE lUCIIELIEU, AU IMlEMIEll
1899Tons droits rservs
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
10/202
Digitized by the Internet Archivein 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/bibliothquedel124ecol
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
11/202
Sur l'avis de M. A. Giry, directeur adjoint des conf-rences d'histoire, et de MM. G. Monod et F. Lot, com-missaires responsables, le prsent mmoire a valu M. EcKEL le titre 'lve diplm de fEcole pratique desHautes Etudes.
Paris, le 29 mars 1899.
Le Prsident de la Section,Sign : G. Monod.
Les Commissaires responsables,Sign : G. Monod, F. Lot.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
12/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
13/202
A LA MEMOIRE
DE MON RF:GRETTE MAITRE
ARTHUR GIRY
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
14/202
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
15/202
INTRODUCTION
Le rgne de Charles le Simple, qui fait l'objet de ce tra-vail, n'a t tudi encore que d'une faon insuffisante. Ce-pendant plusieurs jalons sont dj poss. Le commencementet la fin en ont t exposs, l'un dans l'excellente monographieque mon confrre, M. Ed. Favre, vient de consacrer danscette collection, Eudes, l'autre, dans une bonne thse alle-mande de M. Wolderaar Lippert, sur Raoul de Bourgogne.La prsente tude a pour objet de combler la lacune existantentre la mort d'Eudes et le couronnement de Raoul. Venantaprs MM. Favre et Lippert, j'ai du ncessairement courterquelque peu les priodes dj traites en dtail, et cela d'au-tant plus, qu'une monographie du rgne de Raoul doit prendreplace prochainement ct de celles dj publies dans laprsente collection.La conqute de la Lorraine et l'tablissement demeure
fixe des Normands de la Seine en Neustrie, sont les vne-ments les plus importants de cette priode ; j'ai essay de lesexposer le plus clairement possible, malgr l'insuffisance et lapauvret des sources, et en documentant mon rcit de manire ne hasarder aucune affirmation qui ne ft appuye d'untexte. De cette faon seulement, on arrive faire le dpartentre les faits connus et prouvs, et les hypothses plus oumoins plausibles qu'on est amen prsenter pour expliquercertains faits dont les raisons nous chappent ou pour com-bler des lacunes qui interrompent la suite des vnements.
Les sources o j'ai puis sont numres la fin de cetteEcKiCL. Charles le Simple, b.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
16/202
VIII INTRODUCTIONintroduction. Il ne me reste plus ajouter grand'chose auxtudes qu'ont faites MM. Favre et Lot des sources de l'his-toire de France aux ix* et x sicles ; mes confrres ont con-sult, en grande partie, les mmes auteurs que moi et je nepourrais gure que rpter ce qu'ils en ont dj dit.
Les deux principales sources narratives du rgne de Charlesle Simple sont les Annales de Sauit-Vaast et les Annales deFlodoard. Les premires, composes par un auteur inconnu,s'tendent de 874 900 et les secondes dbutent en 911) pouraller jusqu'en 966. Les unes et les autres ont une valeur inap-prciable pour l'histoire de cette poque, tant par l'abondanceque par la sret de leurs informations. On doit y ajouteryHistoire de l'Eglise de Reims de Flodoard. Ce dernier, cha-noine et archiviste de cette glise, a mis en uvre les nom-breux matriaux qu'il avait sous la main, notamment leschartes et diplmes dposs dans les archives dont la gardelui tait confie. Il a mme reproduit en entier un certainnombre de documents diplomatiques ; l'histoire des pontificatsde Foulques, de Herv et de Sulfe est tout particulirementriche en citations de ce genre.Nous avons dit que les Annales de Saint-Vaast s'arrtaient
en 900 et que celles de Flodoard dbutaient en 919. Entre cesdeux dates s'tend un laps de temps pour lequel les sourcesannalistiques font presque compltement dfaut. Pour la partieorientale du royaume de France et spcialement pour la Lor-raine, nous possdons l'importante Chronique de Rginon dePriim, qui va jusqu'en 906, continue jusqu'en 967 par unmoine inconnu de Saint-Maximin de Trves. Si prcieuse quesoit pour nous cette Chronique, elle ne saurait suppler l'ab-sence d'autres annales dtailles ; car ses mentions concernantle centre de la France sont extrmement rares et d'une sretchronologique douteuse. L'histoire de la Lorraine j est traiteavec beaucoup de dtail et de prcision, l'auteur ayant tml personnellement aux luttes qui ont dchir ce pays lafin du ix sicle; mais, la crainte de ses adversaires semblel'avoir empch de s'exprimer avec franchise sur beaucoupd'vnements et une lacune importante en 892 montre quecette crainte tait justifie.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
17/202
INTRODUCTION ixIl ne reste plus citer, comme ouvrages importants, que
VHistoire de Richer et VHistoire des ducs de Normandie deDudon de Saint-Quentin. En ce qui concerne Richer, je nepuis que m'associer aux conclusions de M. Lot\ Dudonest une source encore bien moins sre. Son ouvrage com-pos presque uniquement d'aprs les rcits du comte Raould'Ivry, frre du duc Richard I , a un caractre pour ainsidire officieux . Ce n'est pas l'histoire des ducs de Nor-mandie telle qu'elle a t en ralit, mais telle que soninspirateur aurait voulu qu'elle eut t. C'est ce qu'il ne fautpas perdre de vue dans bien des circonstances, notammenten ce qui concerne l'histoire du mariage de RoUon avec unefille de Charles le Simple. Le comte d'Ivry a substitu ici laralit des faits ralit qu'il connaissait peut-tre unefiction destine rehausser la gloire de la maison ducale. Onpourrait dire sans trop d'exagration que quand Dudon s'esttromp, c'est qu'il l'a bien voulu, ou plutt c'est qu'o?i a bienvoulu qu'il se trompe. Quand, au contraire, les intrts de lamaison ducale de Normandie ne sont pas en jeu, son rcit peutdevenir parfois vridique et il devient possible d'en extrairenombre de renseignements utiles. Son style ampoul et lemanque presque complet de donnes chronologiques prcisesproduisent une obscurit qu'il n'est pas toujours ais de dis-siper.
Il n'y a pas lieu de parler des continuateurs et abrviateursde Dudon de Saint Quentin ; Guillaume de Jumiges, OrdericVital, Hugues de Fleury, etc., n'ajoutent rien d'important aurcit du doyen de Saint-Quentin.
Les autres chroniques ou annales qui, la plupart du temps,n'ont qu'un caractre purement local, offrent peu de dtailsconcernant l'histoire gnrale, mais on y peut glaner utile-ment, surtout pour l'histoire des invasions normandes ; citonsen particulier ce point de vue les chroniques bourguignonnesde Bze et de Saint-Bnigne de Dijon et le Chronicon episco-poriim Autissiodorensium , puis YHistoria Francorum Seno-7iensis de Hugues de Fleury et le Cartulaire de Saint-Pre
1. /.('.s' ticniiers Caroh'mjfciis, introduction, p. wii.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
18/202
X INTRODUCTIONde Chartres. On ne peut gure mentionner, en outre, que leCartulaire de Saint-Bertin, de Folcuin, et, pour l'histoire dela Lorraine, les Annales de Fulde, mais qui s'arrtent ds901.
Il me semble inutile de passer en revue les ouvrages mo-dernes dans lesquels il est question du rgne de Charles leSimple ; qu'il me suffise de mentionner la seule monographiequi existe de ce rgne, VEtude sur le rgne de Charles leSimple de M. Ad. Borgnet (mmoire prsent l'Acadmieroyale de Bruxelles le 4 mars 1843). L'auteur s'est proposde rhabiliter la mmoire de Charles le Simple et de prouverl'injustice de divers surnoms [simplex, stultus, hebes, etc.)qui ont t donns ce prince. Ce travail n'est pas sansvaleur, quoique M. Borgnet semble s'tre laiss entraner unpeu trop loin dans son essai de rhabilitation.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
19/202
BIBLIOGRAPHIE
I
A. SOURCES NARRATIVESAbbo, Dp hnllls Parhkican urbis contra Xortnannoa lihri III
(d. Pertz, Mon. Gcrm. hlsf. Scrij^t., III, p. 776-805; et d. Ta-RANXE. I*ans, 1834, in-8, avec traduction).Adhmar de Chabannes, Chronicon Aquitaniciim et Francicum, ouEistoviaruia libri III (d. J. Chavanox, Paris, 1897. Collectionde te.rtes poio' servir Vetude et l'enseignement de l'histoirefasc. 20).
Aimoin, Miracirla Si/ncti Bencdicti, 1. 11 et III (d. de Cert.mx.Paris. 1858, in-8. Socicl de Vllistoire de France).The anglo-saxon chronicle (Od. B. Thorpe, avec traduction an-glaise. Londres, 1861, 2 vol. in-8. Ueru7n britannicariim mediiaevi scriptores).Annales Alamannici (d. Pertz, Mon. Gerra. hist. Script., I,p. 22-30. 40-44 et 47-60).Annales S. Benigni Divionensis (d. Waitz, Mon. Germ.hist. Script., V, p. 37-50).Annales Bertiniani (d. Pertz, Mon. Gerin. Jiist. Script., I,p. 419-515 ; et d. Dehaisnes, Paris, 1871, in-8, Socit de l'Histoirede France).Annales Besuenses (d. Pertz, Mon. G^rm. Iiist. Script., Il,p. 247-250).Annales Blandinienses (d. Bethmaxx, Mon. Germ. iiist.Script., V, p. 20).Annales S. Columbae Senonenses (d. Pertz, Mon. Germ.iiist. Script., I, p. 102-109).Annales Einsidlenses (('d. Pertz, Mon. Germ. hist. Script , 111,p. 141).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
20/202
XII BIBLIOGRAPllIEAnnales Elnonenses majores et minores (Mon. Gcrm, hist.
Sc)'i2:)t., V, p. 10 et 17).Annales Floriacenses (Mon. (TPvm.hist. Script., 11, p. 25i-255).Annales Floriacenses brves (Mon. Germ. hist. Script., III,
p. 87).Annales Fuldenses (d. Pertz, Mon. Genn. hist. Script., 1,p. S'iS-Mb; et d. Kurze, Script, rcrura german. in usuni scho-J:tr)/m, 1891, in-8).Annales S. Germani minores (Mon. Germ. hist. Script., IV,p. 3).Annales S. Germani Parisiensis (Mon. Gcrm. hist. Script.,III, p. 166-168).Annales Laubienses et Leodienses (Mon. Grcrm. hist. Script.,IV. p. 8-35).Annales Lobienses (Mon. Gcrm. Jiist. Script., XIll, p. 224-235).Annales Masciacenses (Mon. Germ. hist. Script., III, p. 169).Annales S. Maximini Trevirensis (Mon . Germ. Jdst. Script.,IV, p. 6-7).Annales S. Medardi Suessionensis (Hist. de France, IX,p. 56; X, p. 291 ; et d. Waitz, Mon. Ger)n. Jiist. Script., XXVI,p. 518-522).Annales S. Quintini Veromandensis (d. Bkthmann, Mon.Germ. liist. Script., XVI, p. 507-508).Annales Sangallenses (d. Ildefonsvon Ar\,Mo)i. Germ.tiist.Sr)'i2jt. , 1. p. 55).Annales Vedastini (d. Peiitz, Mon. Germ. Iiist. Scrip>t., II,p. 196-209; et d. Dehaisxes, Paris, 1871, in-8, Socit de t'His-toire de France).Annales Xantenses (d. Pertz, Mon. Germ. Jiist. Script., 11,p. 217-235).Aubry de Trois-Fontaines, chronicon (Hist. de France, IX. p. 57-67; et d. Sgheffer-Boichorst, Mon. Gei'm. }tist. Script.., XXIII,p. 631-950).Chronicon Andegavense (Hist. de France, X, p. 271).Chronicon S. Benigni Divionensis (d. Boiigaud et Garnier,Analecta Divionensia, p. 1-228. Dijon, 1875, in-8.Chronicon Bertinianum. seu Sithiense, voy. Jean d'YpREs.Chronicon Besuense (Hist. de Fram-e, IX, p. 20; et d. Bougaidet Garxier, Analecta Divionensia, p. 231-503. Dijon, 1875, in-8).Chronicon britannicum (Hist. de Fra>ice, IX, p. 88).Chronicon S. Columbae Senonensis (Hist. de France, IX,p. 40 : ot d. Di i;t-, Bibt. Jiist. de VYonne, I, p. 214).Chronicon S. Florentii Salmuriensis (Hist. de France, IX,p. 55; et d. Marghegay et Mabille, Chroniques des cytisesd'Anjou, p. 181-195, Socit de l'Histoire de France).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
21/202
lilBLIOGRAPIIIE xiiiChronicon de gestis Normannorum in Francia (d. Pertz,Mon. Gpvm. hisf. Scr'q^t., I, p. 532-536).Chronicon Leodiense brve. Voy. Xofae Aurcacvallrnses.Chronicon Malleacense (Hisf. de France, IX, p. 8).Chronicon S. Maxentii Fictavensis (Hi.^t. de France, IX, p. 8;
X, p. 231; et d. Marche(4ay et Mabille, Cla^oniques des glisesd'Anjou , p. 351-433, Socit de l'Histoire de France).Chronicon Medianimonasterii (Mon. Germ. hist. Scrixd-, IV,p. 89).Chronicon S. Michaelis in periculo maris (d. Labbe, Xovabibl. liljror. mamiser., I, p. 350).Chronicon S. Ptri Vivi. Voy. Glarius.Chronicon Remense brve (Hisf. de France, IX, p. 39; X,p. 271).Chronicon Saxonicum (Hist. de France, VIII, p. 22'i).Chronicon Sithiense. \o\. Jean d'YpRES.Chronicon S. Stephani Cadomensis (d. Dughesne, Hist. Xor-inannorum script, antiqxi, p. 1015-1021. Paris, 1691, in-fol.).Chronicon Tornacense (Hisf. de France, ^'lII, p. 285).Chronicon Turonense magnum (d. Salmox, Recueil de chro-niques de Touraine, p. 64-161).Chronicon Virdunense. Voy. Hugues de Flavigny.
Clarius, moine de Saint-Pierre de Sens, Chronicon (Hist. de France,IX, p. 32 : X, p. 222 ; et d. Duru, BiU. h ist. de V Yonne, II, p. 449-550).Concile de Tros/y (Labbe et Cossart, Concilia, IX, col. 521).
Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis prinwruni Nonnan-7iiae ducutn (d. Jules Lair, Caen, 1865, in-4. Mmoires de laSocit des Antiquaires de Normandie, t. XXllI).
Erchenbald, Yersus de episcopis Argenforatensibus (d. Bohmer,Fontes rerum german., III, p. 2. Stuttgart, 1843-1868, in-4).'Erchempert, Hystoriola Langobardorum, Beneventum degentium(Mon. Germ. hist. Script., III, p. 240-262).
Flodoard, Annales (d. Pertz, Mon. Germ. hist. Scrip)f., III, p. 402:el d. Baxdeville. Reims, 1855, in-8, avec traduction).
Flodoard, Historia ecclesia' liemensis (d. Sirmond. Paris, 1611,in-8; et d. Lejeune. Reims, 1854, 2 vol. in-8, avec traduction).
Folcuin, Gesta abIjatumS. Bertini Sithiensiiim(. Holder-Egger,Mon. Germ. hist. Script., XIII, p. 600-673; et d. Benj. Gurard,dans les Documents indits, sous le titre de Cartulaire de Saint-Bertin).
Folcuin, (Jesta abbatum Lobiensium (d. Pertz, Mon. Germ. hist.Script., IV, p. 52-74).Fragmentum historie Francise (d. Dughesne, lierum fran-corum script, coactanr'i, III, p. 334).Qenealogia comitum Flandrise. N'oy. W'itger,
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
22/202
XIV niBLIOGRAPIlIEGenealogia Francorum imperatorum et regum. (Mon. Genn.
hist. Script., IX, p. 303).Gesta episcoporum Autissiodorensium (d. Duru, BibJ. hist.de VYonn
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
23/202
iiiHLinr,n.\PiiiE xvOrderic Vital, Historia eccleslastica (d. Duchesxe, Hist. Xovman-norum script, antiqui, p. 321-925; et d. A. Le Prvost. Paris.
1838-1855, 5 vol. in-8, Sorif de l'Histoire de France').Pactuin reguii Caroli et Henrici (d. Ducheske. Hist. Fran-corum script, coaetanei, II, p. 587 ; Hist. de France, iX, p. 323;
et d. Pertz, Mon. Germ. Jiisf. Lcgcs, I, p. 567).JPoenitentia injuncta his qui bello Suessionico inter Ka-
rolum. et Robertuni reges interfuerunt (d. Ducheske.Hist. FrancoruDi script, coaetanei, II, p. 588 ; et Hist. de France,IX, p. 32 i).
Raoul Glaber, Historiarum libri V (Hist. de France, X, p. 1-63;Mon. Germ. lust. Script, VU, p. 52; et d. Maurice Prou. Paris,1886, in-8, Coilection de textes pour servir l'tude et l'ensei-finement do l'histoire, fasc. 1).
Rginon, abb de Pruin, C7
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
24/202
UlCLIUGRArilIE
B. CARTULAIRES. RECUEILS DE CHARTES ET CATALOGUESD'ACTESAlsatia diplomatica, publ. par Schoepflix. Mannhoim, 1772-
1775, 2 vol. in-fol.Achrives administratives de Reims, pubL par P. Vauix.IViris, 18o9-18i8. 5 vol. in-4 (Documents indite).Archives lgislatives de Reims, publ. par P. Varix. Paris,18ii. 2
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
25/202
BlliLIOGRAI'lIIt; xviiMabille (E.), La pancarte noire de S. -Martin de Tours. Paris et
Tours, 1866, in-8.Miraeus-Foppens, Opra diplomatica. Louvain, 1723-1748, 3 vol. in-
fol. lievue des Opra diploinatica de Miraeus, par Ed. Lkglay.Bruxelles, 1856, in-8.Mittelrheinisches Urkundenbuch, publ. par II. Beyer. Co-bloiitz, 1860-1875, 3 vol. in-8.Monuments histoi^iques. Cartons des Rois, publ. par J.Iahdif. Paris, 1866, in-4 (Arrliives de VEmpire, Inventaires etDocuments).Niederrheinisches Urkundenbuch, publ. par Th. -J. Lacomblet.Diisseldorf, 18i0-1858, 4 vol. in-'i.
Recueil des historiens des Gaules et de la France, publ.par D. Martin Bouquet et ses continuateurs. Tome IX (Paris, 1757,in-lol. BipJoniata imperatorum et regum.
Wauters (Alph.), TalAe chronologique des chartes et diplmes im-prims concernant l'Histoire de la Belgique, tome I. Bru.\elles,1866, in-4.
II
OXJVRA.IVJEItSArbois de Jubainville (H. d'), Histoire des ducs et comtes de Cham-
pagne. Troyes, 1859-1865, 7 vol. in-8.Note sur trois chartes carlovingiennes conserves aux
archives du dpartement de la Meurthe (Journal de la Socitd'archologie lorraine, anne 1852, p, 154).
Babelon (E.), Les derniers Carolingiens, d'adirs Riclier et d'autressources originales. Paris, 1878, in-12.Bardot (G.), Hemarques sur un passage de Richer (livre I*^ , eh. 22
24). (Bibliothque de la Facult des lettres de Lgon, t. VII.Paris, 1890, in-8).
Barthlmy (Anatole de), Les origines de la maison de France(Revue des questions iiistoriques, tome A 11, anne 1873, p. 108-14'0.
Barthlmy (Edouard de), Dioese ancien de Chdlonssur-Marne.C.liauinont, 1861, 2 vol. in-8.Beauvois (E.), Compte rendu de Stecnstrup, tudes prVuninaircspour servir l'iiistoire des Normands et de leurs invasions(Revue historique, tome IV, anne 1877, p. 424-430).
Borgnet (A.), tude sur le rgne de Charles le Simple (M/noiresdr l'A(:admie rogale de Bru.:rclles, tome W\\. anne 1843).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
26/202
XTiii BIBLIOGRAPHIEBourgeois (E.), Hugues l'Abb, margrave de Neustric et archi-
chapeJaln de France la fin du IX sicle. Caen, 1885, in-8.Brabant (le P. Firmin), tude sur Renier / au Long-Col et la Lo-tharingie son poque (Mmoires couronns de VAcadmie deBelgique, tome XXXI, tirage part. Bruxelles, 1880, in 8).
Bruel (Alexandre), lude sur la chronologie des rois de France etde Bourgogne au.v IX'' et X'^ sicles (Bibl. de Vc. des Chartes,tome XLI, anne 1880, p. 5-45 et 329-374).
Calmet (Dom), Histoire de Lorraine. Nancy, 1745-1757, 7 vol. in-fol.(le tome 1'=').
Capefigue (B.), Essai sur les invasions mariliines des Normandsdans les Gaules. Paris, 1823, in-8.Dndliker et Mller, Liutprand von Cremona (CiiDixOKH, Vnter-suchungen liber mittlere GescIiicJtte, tome 1. Leipzig, 1870,
in-8).Depping, Histoire des expditions maritiaics des Xormands, nou\.
d. Paris, 1843. in-8.Desmichels (C.-O.), Histoire gnrale du moyen ge, 2*= dit. Paris,
1837, 2 vol. in-8.Deville (Achille), Lissertation sur l'tendue des terres concdes
Rollon par le trait de Saint-Clair-sur-Epte (Mmoires de laSocit des Antiquaires de Normandie, tome VII, annes 1831-1833, p. 47-69).Dissertation sur la inort de Rollon, Wniwn, 1841. in-8. (T/-a-
vau.v de l'Acad. de Rouen).Digot, Histoire de Lorraine. Nancy, 1866, 7 vol. in-8 (le tome I).Drapeyron (Ludovic), E.^sai sur la sparation de la France et de
l'Allonagie aux /X et X sicles. Paris, 1870, in-8.Dournel (Jules), Histoire gnrale de Pronne, 1879, in-8.Dmmler (Ernst), Geschichte des oslfrUnkischen Reiches, 2 d.
Leipzig, 1888, 3 vol. in-8.Gesta Berengarii imperatoris. Beitragc zur GescJiichte Ita-
liens im Anfange des X. Jahrhunderts. Halle, 1871.Zur Kritih Dudo's von Saint-Quentin (Forschungen zurdeulschen Geschichte, tome VI, anne 1866, p. 361-390).Duret (Joseph), Chronologie der l'pstp zu Anfang des X.Jaiirhunderts (Ktjpp, GeschicJitsbllIfr aus der Schiceiz,tome II. Lucerne, 1856, p. 271-298).Dussieux (L.), Essai iiistorique sur les invasions des Hongrois enEi/rojje et spcialetnenl en France, 2 d. Paris, 1879.Favre (Ed.), Eudes, comte de Paris et roi de France (882-898). Paris,1893, in-8 (99^ fascicule de la Bibliothque de l'cole pratiquedes Hautes-tudes).
Flibien (Dom) et Lobineau (Dom), Histoire de la ville de Paris.Paris, 1725, 5 vol. in-fol.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
27/202
BIBLIOGRAPHIE xixFreeman (Edward), The hlstory of the Norman conquest ofEngland,
ils causes and Us resuUs, 3 d. Oxford, 1877, in-8 (le tome l).Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'an-
cienne France. Tome VI : Les transforiuations de la royautpendant l'poque carolingienne, publ. par C. Jullian. Paris,1892. in-8.
Gallia christiana, nouvelle dilion coninience par les Bndiclins etcontinue par M. Haurau sous les auspices de l'Acadmie desInscriptions. Paris, 1715-1865, 16 vol. in fol.
Gfrbrer (Aug.-Frd.), Geschichte der ost-und icestf'rdnhischenCarolinger vont Tode Liidioigs des Fronivien bis zu)n EndeConrads I (8^0-918). Fribourg-en-Brisgau, 1848, 2 vol. in-8.
Giesebrecht, GescJiiclite der deutscJien Kaiserzeit, 5e d., tome I.l.eipzig, 1881, in-8.Grandidier (abb), Histoire de l'glise de Strasbourg. Strasbourg,
1778, 2 vol. in-4.Guizot, Histoire de la civilisation en France, 15 d. Paris, 1884,
in-12 (tome 111, 12
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
28/202
XX niBLIOGRAPIIIRLpinois (E. de 1'), Histoire de Cfuirtres. Chartres, 1854-1858, 2 vol.
in-8.Licquet (Thodore), Histoire do Normandie. Rouen, 1835, 2 vol. in-8.Lippert (Woldemar), Geschlchte des irestfrdnJiischcn lieiches
unfer Kunifi Rudolf. Leipzig, 1885, in-8.Lobineau (Dom), Histoire de Bretagne. Paris, 1707, 2 vol. in-fol.Lons (Friedrich), Ble Yorfahren Hugo Capets im Kampfe mit den
letzlcn K(n-oliniern um den icestfr'dnkischcn Thron. I Theil.Deulsch-(aone, 1870, in-i (Programme de gymnase).
Longnon (Auguste), Raoul de Cambrai (Introduction historique).Paris, 1882, in-8 (Socit des anciens textes).
Atlas historique de la France, livraisons 1 3. Paris, 1884-1889,in-'.
Lot (Ferdinand), Les derniers Carolingiens. Lothaire, Louis V,CJiarles de Lorraine (9i-99\). Paris, 1891, in-8 (87^ fascicule dela Bibliothque de l'cole pratique des Hautes-tudes).
Mabille (Emile), Les invasions des Nortnands et les prgrinationsdu corps de saint Martin (BibliotJ>que de l'cole des Chartes,anne 1869, p. 149-194 et 425-460).Introduction aux chroniques des comtes d'Anjou. Paris, 1871,
in-8 {Socit de l'Histoire de France).Le rorjaume d'Aquitaine et ses marches sous les Carlovin-
giens. Toulouse, 1870, in-4 (Extrait du tome II de la nouvelle di-tion de VHisfoire gnrale de Languedoc).
Mabillon (Dom Jean), Annales ordinis sancti Benedicii. Paris, 1668-1702, 6 vol. in-fol.
Marlot (Dom Guillaume), Histoire de la ville, cit et universit deReims. Reims, 1843-1846, 4 vol. in-4.
Martin (Henri), Histoire de France , i*^^ .^a.v\%, 1854, in-8 (le tome II).Monod (Gabriel), Compte rendu de : E. Mourin, Les comtes de Paris(Revue critique, 1873, tome II, p. 268).Bu rle de l'opposition des races et des nationalits dans ladissolution de l'empire carolingien. Paris, 1895. (Annuaire del'cole pratici^ie des Hautes-tudes, 1896.)
Mourin (Ernest), Les comtes de Paris. Histoire de l'avnement dela troisime race. Paris, 1869, in-8.
OUeris, Examen critique de la lettre de M. Aug. Thierry sur l'ex-pulsion de la seconde dynastie franlie. (Uermont-Ferrand etParis, 1863, in-8.
Paul-mile, De rbus geslis Francorum. Paris, 1539, in-fol.Peign-Delacour, Les Xormayids dans le Xoyonnais. Noyon, 1868,
in-8.Petersen, Die Raubzge der Normannen in Westfranken vonder
Mitte des IX. Jahrhunderts bis zur Niederlassung Rollo's.Luckau, 1873, in-8 (Programme de gymnase).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
29/202
BIBLIOGRAPHIE xxiPlancher (Dom), Histoire gnrale et parlicidire de Bourgogne.
Dijon, 1739-1781, 4 vol. in-fol.Ranke (Leopold von), Weltr/eschicftte, tome VI, 2 partie. Berlin, 1885,
in-8.Richter (G), et Kohi (H.), An?ialen des deutschen Reiches hn Mlttel-
alter, tomes 11 et III. Halle, 1887-1890, in-8.Sachy (Eusbe de), Essai sur l'histoire de Pronne. Paris, 1866,
in-8.Schoepflin, Alsatia ilhisirata. Colmar, 1751-1761, 2 vol. in-fol.Steenstrup (Johannes), tudes prliminaires pour servir l'his-
toire des Normands et de leurs invasions, traduites du danoispar l'auteur (Bulletin de la Socit des Antiquaires de Nor-mandie, tome X. Caen, 1882, p. 185-418).
Strobel, Vaterlandische GescJiichte des Elsasses, 2^ d. Strasbourg,1851, 6 vol. in-8 (le tome I).
Stumpf (K.-F.), Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. undxn. .lahrfiunderts, 3 vol. Innsbruck, 1865, in-8 (le tome l).Thierry (Augustin), Lettre douzime sur l'Histoire de France et
sur l'expulsion de la seconde dynastie franke. Paris, 1820(Lettres sur l'histoire de France, d. de 1867, p. 139-155).
Vaisste (Dom) et Devic (Dom), Histoire gnrale de Languedoc,nouvelle dition. Toulouse, 1872-1889, 14 vol. in 4.
Varin (P)., De l'influence des questions de race sous les derniersCarolingiens. Paris, 1838. in-8 (Thse de doctorat soutenue enSorbonne le 23 octobre 1838).
Waitz (Georg), Jahrbiicher des deutschen Reiches unler KiinigHeinrich I, 3^ d. Leipzig, 1885, in-8.
Ueber das Herhommen des Markgrafen ^yido von Spoleto(Forschungen zur deutschen Geschichte, tome lll, anne 1863,p. 149-154).
Ueber die Quellen zur Geschichte der Begrilndung der 7ior-mannischen Herrschaft in Frankreich (GdttingerNacJirichten,anne 1866, p. 72 et 73).Warnkoenig, Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte. Tubingue,1835-1839, 5 vol. in-8.
Warnkoenig et Grard, Histoire des Carolingiens. Bruxelles, 1862,2 vol. iu-8.
Wattenbach (Wilhelm), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-alicr, f>' d. Berlin, 1885-1886, 2 vol. in-8.Wenning (V.), Ueber die Bestrehungen der franzsischen Ku-nige des X. Jahrhunderts Lothringen fur Frankreich zugeioinnen. Hanau, 1884, in-4 (Programuie du gymnase).
Wittich (Karl), Die Entstehung des Het^zogthums Lothringen. Goe\.-tingue, 1862, in-8.Richer liber die Herzoge Giselbert von Lotlo-ingen und
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
30/202
XXII BIBLIOGRAPHIEHeinrlch von Sachsen (Forschungen zur cleutschen GeschicUe,tome III, anne 1863, p. 107141).
Wiistenfeld (Th.), Veber die Herzoge von Spoleto aus dem Hanseder Guidonen (Forschungen znr deutschen Geschidite, tomem, anne 1863, p. 383-434).Zeller (Jules), Histoire d'Allemagne. Paris, 1872-1891, 7 vol. in-8
(le tome 11).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
31/202
CHARLES LE SIMPLE
CHAPITRE PREMIER.CHARLES III AVANT SON AVNEMENT ET SON RGNE JUSQU'A LA MORT
D'EUDES 1 (879-898).
Lorsque Louis le Bgue mourut, Compigne, le 10 avril879 ^ il laissait de sa premire femme, Ansgarde, deux fils.Louis III et Carloman, qui lui succdrent au trne. Louisavait pous jadis leur mre sans le consentement de Charlesle Chauve qui, dans la suite et aprs la naissance des deuKjeunes princes, fit casser ce mariage et donna son fils pourfemme Adlade, sur de Wilfrid, abb de Flavigny enBourgogne, et-petite-fille du comte Bgon^ La validit deces deux mariages a donn lieu de nombreuses discussionsde la part des contemporains ; en effet, si d'un ct l'unionde Louis avec Ansgarde avait t contracte contre la volont
1
.
Cette partie de l'histoire de Charles-le-Simple ayant fait l'objetdes derniers chapitres de l'ouvrage de M. Ed. Favre, Eudes, comte deParis et roi de France, nous y renvoyons le lecteur et nous ne reve-nons sur cette priode que dans la mesure qui nous a paru ncessairepour faire bien comprendre les vnements de la suite du rgne.2. Ann. Bertiniani, 879; Chron. S. Colombae Senonensis, 879.3. Ann. Bertin., 862; Flodoard, IHst. eccles. Bemensis, III, 19; R-ginon, 878. Le mariage de Louis le Bgue avec Adlade a d avoir
lieu entre 872 et 877; cf. Kaickstein. Gesch. des franzus. Knifjthumsunler den ersten Kopetingern, p. 471, qui mentionne deux diplmes,l'un de Charles le Chauve, de 872 environ, l'autre de Louis le Bgue,du 1 janvier 879, Hist. de France, t. VIII, p. 642 et IX, p. 414. Ausujet de la famille d'Adlade, voy. Mabillon, Ann. bened., Ul, 221 ;Gallia christ., W , 457; Historiens de France, IX, p. 551 (diplme deCharles III pour Saint-Maur-des-Fosss); Simson, Jahrhi'her desdeutschen Beiches imter Lndwig dem Frommcn. I, p. 11 et 76; Kaick-stein, ouvr. cit., p. 470-472.
Ecki:l. C/iarles le Simple. 1
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
32/202
2 CIIAI'.l.F.S III AVANT SoN AVKNF.MKNT. [879]du roi. de l'autre le second mariage pouvait tre galementtax d'irrgularit, puisque Ansgarde vivait encore l'poqueoii il fut conclu et que Louis ne s'tait spar de sa premirefemme que parce qu'il y avait t contraint.On voit que les raisons ne manquaient pas aux adversairesde la maison carolingienne pour suspecter la lgitimit desenfants de Louis le Bgue. C'est ce qui explique les troublesqui suivirent l'avnement des deux jeunes rois. Gozlin, abbde Saint-Gerraain-des-Prs, de Saint-Denis et de Saint-Amand. fit valoir cette prtendue illgitimit, pour appeleren France Louis II, fils de Louis le Germanique ; mais cetteentreprise choua, grce surtout l'intervention de Huguesl'Abb'.A la mort de son mari, Adlade tait enceinte, et cinq moisplus tard, le 17 septembre 879, elle donna naissance un filsqui devait tre Charles IIP. Les partisans d'Eudes ne man-qurent pas, dans la suite, d'accuser Charles de btardise,afin de donner l'usurpation du comte de Paris l'apparencedu droit. Aussi verrons-nous plus tard l'archevque de Reimsse croire oblig de rfuter les doutes levs sur la lgitimitde la naissance de son pupille ^ Il est bon d'ajouter qu'on netrouve dans les chroniqueurs contemporains aucun cho deces bruits et qu'aprs la mort d'Eudes, toute trace de cesaccusations disparait compltement'\
Cependant, Louis III et Carloman, quoique encore fortjeunes Louis avait seize ans la mort de son pre et Car-loman n'en avait que treize se montraient pleins d'activit
1. Bourgeois. Hugues VAhhi'. p. 28. Cependant la clironique de R-.ffinon et les annales de Saint-Iertin ne contiennent rien qui puissefaire supposer que l'union de Louis le Bgue avec .\nsgarde ait tillgitime; au contraire, Rginon (Chron.. 878) fait mme ressortir lahaute naissance d'.Ansgarde: Habuit autem [Ludovicus], cura adhucjuvenilis aetatis flore poUeret, quandam nobilem puellam nomineAnsgardsibi conjugii foedere copulatam.
2. Ann. Vedastini, 879; Rginon. 878. Charles a lui-mme mentionnla date du jour de sa naissance dans un diplme du 28 mai 917 pourlabbaye de Saint-Denis (Hisl. de Fr., IX, p. 531): ut in die nativi- tatis nostrae, quae est missa S. Lamberti . La Saint -Lambert tombele 17 septembre.
3. Flod.. Ilist. eccl. Bem.. iV. 5 (Lettre de Foulques Arnoul).4. L auteur du C/ironicon Turonensc. bien postrieur, il est vrai, auxvnements qu il rapporte, puisqu'il vivait au xnF sicle, dit queLouis 111 et Carloman sont ns ex concubina , tandis que Charles III
serait n ex lgitima uxore . Mon. Genn. hisl. Script., XXV.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
33/202
[S79-884] rjlAP.LKS I.K r.ROS, l'.ol UK FIIANCE. 3et (le rsolution; ils essayrent la fois de rsister vigoureu-sement aux Normands et de dfendre leurs droits contre lesprtentions de leurs parents et contre les empitements desgrands seigneurs, La victoire de Louis III Saucourt enVimeu, le 3 aot 881, et celle de Carloman Avaux, l'annesuivante', ainsi que les efforts des deux frres pour empcherl'usurpateur Boson de se maintenir dans sa nouvelle dignit,prouvent qu'ils n'entendaient pas se renfermer dans cetteinaction que l'on a tant de fois, et tort, reproche auxderniers Carolingiens. Malheureusement, ils moururent lafleur de l'ge : Louis, le 25 aoit 882 , et Carloman, le 12 d-cembre 884 \De la branche franaise de la famille Carolingienne ne sur-vivait que le jeune Charles, g alors de cinq ans et trois mois.On ne parat pas avoir song mettre cet enfant sur le trnedans un moment aussi critique. Cependant il existait des hom-mes qui auraient t capables de protger et de dfendre leroyaume pendant la minorit du roi: Hugues l'Abb, qui avaitsi vaillamment second Louis III et Carloman, et Eudes, quiallait s'illustrer la dfense de Paris, eussent t les soutiensnaturels du trne de Charles. Mais, en prsence du pril nor-mand, peut-tre aussi cause de la validit discutable dumariage de Louis le Bgue avec Adlade, on prfra s'adresserau dernier rejeton de la branche allemande, Charles le Gros-, lesentiment encore vivace de l'unit de l'empire carolingienpouvait galement inspirer ce choix. Hugues l'Abb et lesautres seigneurs francs envoyrent une ambassade l'empereurpour lui offrir la couronne\De tous les descendants de Charlemagne, Charles-Ie-Grosest certainement celui qui montra le plus d'incapacit; pourl'Allemagne comme pour la France, son rgne fut une longuesuite de malheurs ^ L'nergie avec laquelle les habitants despays envahis ou menacs savaient lutter contre les Normands,
1. Ann. Vedast., 881 et 882.2. Rginon, 883.3. Necrologium S. Hemigii; cf. Dmmler, Geschirhie des ostfrdn-kisrhen Beir/ics, III. 232, note 1; Richter, Annalen der deutschen Ge-schichte im Millelalter, II, 2 partie, p. 485, note e.4. Ann. VedasI.. 884; Rginon, 881.5. Ds l'avnement de Charles le Gros, le continuateur souabe d'Er-chempert se laisse aller aux plus tristes rflexions sur le sort de l'Em-pire {Mon. Germ. hist. Script., II, 330).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
34/202
4 CHARLES III AVANT SON AVNEMENT. [884-887]quand ils avaient leur tte des chefs tels que Hugues l'Abb,l'vque Gozlin et le comte Eudes, atteste pourtant qu'il yavait encore dans le royaume des hommes capables de rsisteraux incursions des pirates ^
L'accusation la plus grave qu'on ait porte contre Charlesle Gros, c'est de s'tre montr pusillanime et lche devantles Normands, surtout en n'osant pas les attaquer sous lesmurs de Paris ^ Il est peut-tre permis de se demanders'il n'avait pas plutt t condamn l'impuissance par lamaladie dont il souffrait depuis longtemps ; des chroniqueursrapportent, en effet, que, ds son enfance, Charles avait tsujet de frquents et violents maux de tte, ainsi qu' desattaques d'pilepsie et des crises nerveuses accompagnesd'hallucinations ^La dposition de Charles le Gros, en novembre 887 *, fut lesignal d'une dislocation complte, et cette fois dfinitive, del'empire carolingien. Dans un passage assez curieux, imit,du reste, de Justin, le chroniqueur Rginon de Prm attribuele dmembrement de l'empire deux causes : la rivalit desdivers seigneurs qui se firent proclamer rois et qui ne vou-lurent pas se subordonner l'un d'eux, et le dsir des popu-lations de voir leur tte un souverain national '\ Cette der-
1. Necrol. Aulissiodorense, ap. Martne et Durand, Amplissimacollectio, VI. p. 704; Ann. Vedast., 886; Ann. Fuld., 886: Interea Hugo et Gozilin, abbates et duces praecipui Galliae regionis, in quibusomnis spes Gallorum contra Nordmannosposita erat, defuncti sunt.
2. C'est ainsi que Henri Martin {Hist. de France, H, p. 477) dit delui : L'empereur Karle le Gros, me lche, intelligence obtuse, tait digne de soutenir la comparaison avec les plus dgrads des rois fainants.
3. Voyez p. ex. le rcit dtaill d'une attaque qu'eut Charles le Grosen 873, dans les annales de Fulde, de Saint-Bertin et de Xanten.4. Annal. Fnldenses. 887; Rginon, 887.5. Post cujus(il s'agit de Charles le Gros) mortem rgna que ejus
ditioni paruerant, veluti lgitime destituta herede, in partes a sua compage resolvuntur et jam non naturalem dominum pre.stolantur. seJ unumquodque de suis visceribus regem sibi creari disponit. Quae causa magnos bellorum motus excitavit, non quia principes Francorum deessent qui nobilitate, fortitudine et sapientia regnis imperare possent, sed quia inter ipsos aequalitasgenerositatis, digni- tatis ac potentiae discordiam augebat, neraine tantum ceteros pre- cellente, ut ejus dominio reliqui se submittere dignarentur. Multos enim idoneos principes ad regni gubernacula moderanda Francia genuisset, nisi fortunaeosaemulatione virtutis in perniciem mutuam armasset (Rginon, 888). Cf. Justin (Hist. Philipp., XIII, 1 in
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
35/202
[887] DMEMBRKMENT DE LEMI'IRE. 5nire raison a surtout t dveloppe par Augustin Thierryqui, comme on sait, a attribu la chute des Carolingiensuniquement des antipathies de races \ Cette explication estloin d'tre suffisante. Guizot et, aprs lui, Joseph Yarin^01Ieris*et Fustel de Coulanges^ l'ont pleinement dmontr.Guizot fait remarquer avec raison que si la dcomposition del'empire en royaumes peut tre attribue une influence derace, il est impossible d'apercevoir cette influence dans ladcomposition des royaumes en fiefs, suite de la premire ;pour lui, il trouve la solution du problme dans le peu derelations qui existaient et qui pouvaient exister entre les di-verses parties de l'empire, ainsi que dans l'absence de toutintrt gnral et dans la rpugnance des hommes d'alors(( pour toute association, pour tout gouvernement uniqueet tendu .
Cette apprciation ne parait pas tout fait juste. L'empireromain a vcu quatre cents ans avec cette mme difficult derelations entre ses diffrentes parties, avec cette mmeabsence d'intrts gnraux, avec cette mme rpugnancepour toute association. Il semble que la vraie cause du d-membrement de l'empire carolingien soit exprime dans lesparoles mmes de Rginon : L'galit de leur naissance,fine) : nisi fortuna eas aemulatione virtutis in perniciem mutuam armasset, et c. 2 in fine: inter ipsos vero aequalitas discordiam augebat nernine tantum ceteros excedente, ut ei aliquis se submit- teret . Ce passage avait dj t relev par Muratori {Script, rerumItolicavum. II. 1'' partie, p. 389, note 10; cf. aussi Dmmier, Gesta Be-renf/an'i imperaloris. Beilrdge zur Geschichle Italiens ira Anfanf/e desX. Jahrhunderts,^. 15, note 3; Trog, Rudolf I und Rudolf il vonHochburr/und, p. 23 et 24.
1. Lettres sur l'histoire de France, lettre XII. Il est assez curieuxqu'Augustin Thierry ne semble pas avoir eu connaissance de ce pas-sage de Rginon et' qu'il n ait pas cit l'appui de sa thse au moinsces quelques paroles trs caractristiques: unumquodque de suis visceribus regem sibi creari disponit . Voir aussi, en ce qui con-cerne l'influence des races: Ci. Monod. Du rle de Vopposition des rareset des nationalits dans la dissolution de l'empire carolinfjien (Annuairede VEcole pratique des Hautes-tudes, 1896).
2. Histoire de la civilisalion en France, leon XXIV , t. II, p.253-258.
3. De l'influence des questions de races sous les derniers Karolin-giens. Paris, 1838, in-S .
4. Examen critique de la lettre de M. Augustin Thierry sur l'expul-sion de la seconde dynastie franke. Clermont, 1863, in-8.
5. Histoire des institutions politiques et administratives de la Fran-ce. Les transformations de ta royaut (1892), p. 616 et suiv.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
36/202
6 CHARLES III AVANT SOX AVNEMENT. [887] de leurs dignits et de leur puissance augmentait leur discorde, et plus loin : Le sort les amena, pour leur malheur mutuel, se combattre, pousss par le besoin de mesurer leurs forces. Ce furent, au fond, l'ambition per-sonnelle et Tgosme des divers seigneurs qui occasionnrentce dmembrement ; ajoutez cela les incursions des Nor-mands qui facilitrent singulirement les usurpations, si ellesne les provoqurent pas directement en annihilant presqueentirement, dans certaines contres, l'action du pouvoircentral. Il ne faut pas oublier non plus les luttes intestines,les rivalits, les jalousies qui clatrent trop souvent au seinmme de la famille carolingienne'.En outre, l'absence d'une centralisation suffisante n a pasd tre sans influence sur les destines de l'empire caro-lingien. L'empereur possdait, il est vrai, en principe du moins,une puissance absolue ; comme le Csar romain, il tait la(( lex animata ; du fond de son palais, il promulguait sescapitulaires qui avaient force de loi dans l'empire tout entier;ses missi , sans cesse en tourne, rappelaient aux comtesqu'ils n'taient (|Uo les agents du matre, et celui-ci ne sefaisait pas faute de le leur prouver parla rvocation des fonc-tionnaires indociles. Mais l'empire carolingien n'avait pas decapitale fixe. Aix-la-Chapelle pouvait bien passer pour unecapitale de l'empire ; mais elle tait loin d'tre, l'instar deRome, un centre puissant d'attraction. Rome, qui avait grandipeu peu et fini par englober tous les pays riverains de laMditerrane, constituait comme le cur qui recevait le sangde ce corps immense qui s'appelait l'empire romain et lerefoulait jusqu'aux extrmits les plus loignes. C'est ce quia manqu l'empire carolingien et c'est aussi ce qui a d enhter la dissolution.
Si des sentiments de nationalit peuvent avoir eu quelquepart d'influence dans le dmembrement de l'empire carolin-gien, il faudrait l'entendre au sens de sentiments purementrgionaux et locaux; autrement n'aurait-on pas vu, danschacun de ces tats, les grands seigneurs soutenir plus ner-
1. Voyez W'arnlinig et Grard. Ilisloire des CarolinQiens, II, p.192-194. 198. Les auteurs disent non sans raison (ibid.. p. 198) : Sui-te vant nous, la premire de toutes les causes politiques de ce dsastre
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
37/202
[887] DMEMIUMliNT 1>K LKMI'IIU:. 7giquement leur roi national ? L'histoire de tous les princescarolingiens, partir de la seconde moiti du ix sicle,montre au contraire que, s'ils n'ont pas russi faire rgnerl'ordre et pacifier le pays, c'est que leurs grands feudatairestenaient avant tout rester matres chez eux et enlevaientainsi au souverain presque tous ses moyen d'action. Le rgnede Charles III en est une preuve clatante'.De tous les tats qui sortirent du dmembrement de l'em-pire, la Germanie seule resta fidle la famille de Char-lemagne. Arnoul, la vrit, n'tait qu'un btard ; maisson nergie, son activit, le rendaient certainement dignede la couronne-, et dans ces temps troubls, o il fallaitavant tout un bras vigoureux pour maintenir les Nor-mands d'un ct et les Slaves de l'autre, on ne devait pasregarder de trop prs la lgitimit de la naissance. Dureste Charles Martel aussi avait t un btard ^A la mort de Charles le Gros, on ne se soucia pas, enFrance, d'imiter l'exemple des Allemands en proclamant
1. Richer (I. I, c. 4) fait un tableau saisissant de l'tat de la Francependant les premires annes du rgne de Charles III et attribue lesmisres de cette poque l'ambition effrne des grands. Ob cujus [scil. Karoli] infantiam, cum regnorum principes nimia rerum cu- pidine sese praeire contenderent. quisque. ut poterat, rem dilatabat. Xemo rgis provectum, nemo regni tutelam quaerebat. Alina ad- quirere summum cuique erat. Nec rem suam provehere videbatur, qui alieni aliquid non addebat. Unde et omnium concordia in sum- mam discordiam relapsa est. Ilinc direpsiones. hinc incendia, hinc rerum pervasiones exarsere.
2. Rginon (C/u'ON. 880) fait un bel loge d'Arnoul : Post cujus [scil. Karoli] decessum, variante fortuna, rerum gloria quae supra vota fluxerat, eodem quoaccesscrat modo coepitpaulatim diffluere, donec deticientibus non modo regnis, sed etiam ipsa regia stirpe. partim immatura aetate pereunte, partim sterilitate conjugum marcescente, hic [scil. .\rnulfus] solus de tam numerosa regum posteritate idoneus inveniretur qui imperii Francorurn sceptra susciperet; quod in sub- sequentibus suo in loco lucidius apparebit.
3. Il est intressant de voir comment, d un ct, Arnoul chercha se faire pardonner sa naissance illgitime par une foule de donationsaux glises et ses fidles dans les premires annes qui suivirent sonavnement (pour Tanne 888, on ne trouve pas moins de quarantediplmes, et trenle-et-un pour 889: cf. Bhmer-Mhlbacher, Begcstaim/ierii i. n ^ 1721-1792), tandis que, de l'autre, les annales de Fulde.(|ui ont un caractre officiel assez prononc(cf.\\'attenl:)ach, Drutsc/i/andsGesrlnc/ttsquellen im Millelallev. I. p. 211-216), traitent avec mpris les roitelets qui poussent dans les diverses parties de l'empireaprs la mort de Charles le Gros : lUo [scil, Arnulfo] diu morante [ Hatisbonne], multi reguli in Europa vel regno Karoli, sui patruelis, excrevere {Ann. Fuld., 888).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
38/202
8 CiIARLl::s III AVANT SON AVNEMENT. [887-888]Arnoul. On ne tenait probablement pas recommencer l'ex-prience faite avec un Carolingien allemand ; elle avait tropmal russi. Unanime pour repousser la royaut d'Arnoul, ontait loin d'tre d'accord sur la personne du futur souverain.Comme en 884, il ne pouvait gure tre question du jeuneCharles qui n'avait pas alors plus de huit ans, Eudes, levaillant dfenseur de Paris contre les Normands, et Guy II,duc de Spolte, descendant d'une ancienne famille aastrasienneallie aux Carolingiens, furent les seuls comptiteurs en pr-sence.
Quelques seigneurs francs, la tte desquels se trouvaientl'archevque de Reims, Foulques, et son neveu Rampon,appelrent Guy, et cela probablement avant la dposition del'empereur ' ; mais ils ne tardrent pas s'apercevoir du peude chances de succs de leur candidat, de sorte que celui-ci,ds son arrive en France, se trouva presque entirementisol. Couronn Langres parTvque Gilon, il poussa jusquevers Metz, en croire le rcit quelque peu fabuleux de Liut-prand, mais une parcimonie excessive lui aurait alin lesquelques fidles qui s'taient attachs sa fortune. Au coursde cette expdition, il reut la nouvelle du couronnementd'Eudes, et, sentant bien ds lors que son adversaire avaitplus de chances de russir, il abandonna son entreprise etretourna en Italie .
Six semaines aprs la mort de Charles le Gros, le 29 f-vrier 888, Eudes fut couronn Compigne par Gautier,archevque de Sens^; ses partisans se composaient presqueexclusivement de ses vassaux du comt de Paris et des sei-gneurs des pays entre la Seine et la Loire. La plupart de cesterritoires lui appartenant titre de fiefs, il n'y pouvait ren-
1. Les annales de Saint-Vaast mentionnent la candidature de Guyds la fin de Tanne 887.2. Ann. Vedast., 887, 888; Liutprand, Antapodosis, I, 16. Au sujet
de la famille de Guy de Spolte, voyez deux articles dans les Forschun-yen zur deutschen Geschichte, t. III (iS6'i), l'un de G. Waitz, Ueberdas Herkommen des Markfp'afen Wido oon Spoleto, (p. 149 154) etl'autre, beaucoup plus dvelopp, de Th. Wiistent'eld, Ueber dieHerzfjc von Spoleto, {ibid.. p. 385 432) et i. IX (1869), p. 414 et suiv.,puis Favre, Eudes, p. 80 et 81.
3. Mon. Germ. Leges, I, p. 554; Ann. Vedast., 888; Ann. S. Germaniminor. {Mon. Germ. Script., IV, p. -3). Voir aussi Favre, ouvr. cit.,p. 89 et 90.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
39/202
[888] AVNEMIiiNT D'ELDES. 9contrer aucune rsistance srieuse *. Les autres grands feu-dataires, Baudouin II de Flandre, Herbert de A^ermandois etson frre Ppin, comte de Senlis, Richard de Bourgogne,Ramnulf II d'Aquitaine et Guillaume le Pieux d'Auvergne,ne se soumirent pas sans rpugnance et sans arrire-pense celui qui, la veille encore, tait leur gal. L'archevque deReims prit tout d'abord ouvertement parti contre Eudes etse tourna du ct d'ArnouI. Avait-il prsents l'esprit, commele croit le chroniqueur Jean d'Ypres au xiv'' sicle, les ana-thmes lancs jadis par le pape Etienne II contre ceux desFrancs qui deviendraient infidles au sang des fils de Ppinle Bref ? Le rcit des annales de Saint-Vaast permet de sup-poser que Foulques, imbu des traditions du droit des Caro-lingiens au trne de France, offrit le pouvoir au monarque alle-mand comme lui tant d en l'absence d'un autre membre decette famille en tat de le prendre en main\ Mais Arnoul, quine se souciait pas d'entamer avec Eudes une lutte dont l'issuetait certainement douteuse, rpondit par un refus absolu ;il prfra traiter et engager le nouveau roi reconnatre sa suze-rainet. Eudes ne voulut ou ne put s'y refuser et eut,c Worms,avec le roi de Germanie, une entrevue dans laquelle il re-connut la suprmatie d'Arnoul. L'archevque de Reims dutfaire sa soumission \
Revenons au fils do Louis le Bgue. Nous ne possdonsaucun renseignement sur ses premires annes. Richer nousapprend que Foulques avait lev le jeune prince ds sa plustendre enfance''; mais on sait les renseignements qu'il donnesujets caution, surtout en ce qui concerne des faits appar-
1. Voir les judicieuses observations de J. Varin {De Vinfluence desquestions de races sous les derniers Karolinfjiens, p. 17) et de Des-michels {Histoire gnrale du moyen ge, 2 d., t. II, p. 591).2. Voir Clausula de Pippino {Ilist. de France, V, p. 9).3. Ann. Vedast., 888: ... contulerunt se ad Arnulfum regem uti
veniret in Franciam et regnum .sibi debitum reciperet )>. Voir aussiFlodoard, Bist. coles. Rem., IV, 5 (lettre de Foulques Arnoul).4. Ann. Vedast., 888; Ann. Fuldenses, 888: .\bbo, De bellis Pari-
siacae xirbis, II, v. 491 et suiv. La soumission de l'archevque deReims n'avait pas t volontaire. Flod., Ilist. cries. Hem., IV, 5 : ... unde... coactus sit ejus hominis, videlicet OdoniSjdominatum acci- pre, qui ab .stirpe regia existens alienus, regali tyrannice abusus fuerit potestate. ciijus et invitus hactenus dominium sustinuerit (lettre de Foulques Arnoul). Voir sur l'entrevue de Worms,Favre, Eudes, p. 104-105 et 109-116.
5. Richer, I, 16: J>'ulcoj qui regem a cunabulis educaverat .
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
40/202
10 CHARLES m AVANT SON AVNEMENT. [889]tenant une poque relativement recule^ D'un autre ct,une chronique du xiii^ sicle dit que Charles avait t confiaux soins de Hugues l'Abb, qui avait t dj le tuteur deLouis III et de Carloman'; il semble donc peu prs impossiblede se prononcer avec certitude.La premire mention du jeune Charles se rencontre en juin889. A cette date, il tait g de dix ans environ et on le trouveauprs de Ramnulf II, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine\On peut supposer non sans vraisemblance que l'archevquede Reims avait envoy Charles dans le midi afin de mieuxle soustraire aux prils qui pouvaient le menacer. Eudes s'taitavanc vers l'Aquitaine avec une arme peu nombreuse dansl'intention d'amener ce pays lui faire sa soumission; Ram-nulf se prsenta devant lui Orlans accompagn du jeuneCharles, fit au roi quelques promesses, probablement assez va-gues, et lui jura, en mme temps, qu'il n'aurait rien craindre dela part de l'enfant confi ses soins. Puis Eudes se retira\ Lercit de l'annaliste de Saint-Vaast nous montre que Ramnulfne s'est pas soumis Eudes sans restrictions: Juravit quae digna fuerunt , rien de plus. Le fait mme que le roi neput ou n'osa pas s'emparer de la personne de Charles prouveassez que la soumission du duc d'Aquitaine tait loin d'trecomplte^ Ramnulf mourut peu de temps aprs^ et il semble
1. On sait que Richer fait de Charles III le fils de Carloman, donc lepetit-fils de Louis le Bgue (I, 4) ; il faut avouer que le moine deSaint-Hmi aurait d mieux connatre la famille laquelle il tait siattach.2. Cht'on. Turonense {Ilislor. de France, IX, 46): [Karolus^ quem Hugo abbas fere per octo annos servavit. Cf. aussi Kalckstein, Kape-tinger, p. 80.
3. An. Vedofif.. 889. Ce Ramnulf tait fils de Ramnulf I% blessmortellement Bi'issarthe. en 866, o prit galement Robert le Fort,pre d'Eudes (Rginon. 867).4. Ann. Vedast . 889; Ann. Fuld., 888: Ann. Besueases. 889. Cf. aussiKalckstein, Kapeli7if/e)\ p. 59, et Favre, Eudes, p. 123.5. Les annales de Fnlde (ad a. 887) disent que Ramnulf avait eu
l'intention de se faire proclamer roi : Deinceps Ramnulfus seregem haberi statuit. OUeris (Examen rriliqne de la lettre de ^L AugustinTlderrij sur l'expulsion de la seconde dynastie franke, p. 6. note 3) adonc tort de dire que le chroniqueur Hermann Contraclus de Reichenau,qui vivait au xi^ sicle, est le seul qui fasse mention de ce fait. Onpeut rapprocher de ce passage une charte de Guillaume Firebrace,qui s'intitule : dux totius monarchiae .\quitanorum (Giry, Manuelde diptorn.. p. 325).
6. Probablement avant le 10 octobre 890; cf. Chronicon S. MaxentiiPiclo.vensis, ap. Marchegayet .Mabille, Chroniques des glises d'Anjou,
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
41/202
[SS9-S93] IIOSTIIJTK DliS GUANDS CONTP.I-: KLDES. ilprobable que le jeune prince retourna alors auprs de l'arche-vque de Reims.
L'impitoyable rpression de la rvolte de Gaucher, parent(lu roi', auquel celui-ci fit trancher la tte, loin d'affermir lapuissance d'Eudes, lui avait plutt t nuisible. Les grandsseigneurs, qui tendaient avant tout l'indpendance et dontla plupart n'avaient accept ({u' contre-cur et dfautd'autre chef la suprmatie du comte de Paris, s'indignrentde ce que celui-ci et os porter la main sur un des leurs etaffirmer avec tant d'nergie les droits de sa couronne. Lesgrands, mcontents, s'agitrent. Ansery qui, par l'influenced'Eudes, avait t nomm vque de Paris la place del'hroque Gozlln, fut, ce qu'il semble, en butte des tra-casseries de la part du roi et s'en plaignit vivement l'arche-vque de Reims en prsence des comtes de Vcrmandois etd'Arras; de plus, les fils de Geoffroy, comte du Maine, avaientcharg l'vque de Paris de demander conseil Foulques ausujet des perscutions que le roi leur faisait subir ^ A cetteoccasion. Foulques dut sans doute agiter de nouveau la ques-tion des droits des Carolingiens, et cette fois, Charles eut plusde succs. Le jeune prince, alors g de treize ans, auraitexprim amrement ses regrets de ne pas tre en possessionde la couronne qui lui revenait de droit''. Beaucoup de grands,Richard de Bourgogne, Guillaume d'Aquitaine% Adhmar dePoitiers et Ppin, comte de Senlis, frre d'Herbert de Ver-raandois% paraissent avoir favoris l'ambition du jeune Caro-p. 371. Voir aussi un diplme mentionn par Mabille Pancarte noirede S. Martin, p. 68, dat de Tan de l'incai'nation 891 et de la troisimeanne du rgne d'Eudes, par lequel Ebles, fils le Ramnulfe, confirmeune donation faite par son pre Saint-Martin de Tours.
1. Les annales de Saint-Vaast rappellent consobrinns et Rginonnepos. Gfriirer, Gcscfuc/ite der ost- tind ireslf'ran/iischen Karoliriger,\\,p. 329, suppose que Gaucher tait d'accord avec le parti carolingien ;c'est possible, mais on n'en trouve aucune preuve. Voy. Favre, Eudes.p. 143 et 144.
2. Flod., Ilist. eccles. Rem.. iV, 5 (lettre de Foulques Arnoul).3. Richer. ///.s/., I, 12 (o il faut naturellement corriger Terreur
rjuindennis) : Jam enim quindennis de regni amissione apud amicos et domesticos gravissime conquerebatur, regiiumque paternum re- petere multo conatu moliebatur.
4. Guillaume, comte d'Auvergne, tait devenu duc d'Aquitaine aprsla mort de Ramnulf II, et la mme poque Adhmar s'tait empardu comt de Poitiers.
). Rginon a donc raison de dire (ad a. 892): Francorum pi'inci- pes ex permaxima parte ab eo [scil. Odonej deficiunt.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
42/202
12 CHARLES III AVANT SON AVNOIENT, [893]lingien: quant Baudouin de Flandre, il semble s'tre tenu l'cart cause de son animosit contre Tarchevque de Reimsau sujet de l'abbaye de Saint-Bertin\Les conjurs estimrent qu'il serait prudent d'loignerEudes afin d'tre mieux mme d'excuter leurs projets.Dans un plaid tenu Verberie en septembre 892 , ilspersuadrent le roi de passer l'hiver en Aquitaine, tant pourpermettre la Neustrie de se remettre un peu des maux dela guerre que pour aller combattre les frres de Ramnulf quivenaient de se rvolter\ Eudes, ne souponnant aucune tra-hison, donna dans le pige et se mit en route. Mais au milieudes luttes qu'il eut soutenir contre divers seigneurs aquitains ^,il apprit tout coup que Charles venait d'tre couronn Reims le dimanche 28 janvier 893, par Foulques, assistdes vques de Laon, de Chlons et de Throuanne, et enprsence d'un grand nombre de seigneurs des pays entre laSeine et la Meuse^Dans la Neustria, dans la rgion entre la Seine et la Loire,1. Aucun texte ne le mentionne. Ce que dit Kalckstein (Capelin-
ger, p. 79): Balduin von Flanderii und Rudolf von Cambray werden natiirlich zugestimmt haben , ne me parait donc gure fond.
2. Voir un diplme d'Eudes du 30 septembre 892 pour l'abbaye deMontiramey {Hisl. de France, IX, p. 459). A cette poque, Ansery,vque de Paris, tait de nouveau rconcili avec le roi, puisqu'ilfigure comme chancelier la place d'Ebles, un des frres de Ram-nulf II. Cf. Kalckstein, Capelinger, p. 78, et Favre, Eudes, p. 151.
3. Ces rvoltes successives, d'abord celle de Gaucher, puis celle desfrres de Ramnulf, n'auraient-elles pas t fomentes par les partisansdu jeune Charles?4. Voir Kalckstein, Capelinger, p. 78 et 79; Favre, Eudes, p. 146-149.
5. Ann. VedasL. 893. Voyez Kalckstein, Capelinger. p. 80. Richer(1. I, ch. 12). et, ce qui est plus important, cinq diplmes de Charle^^,n * 46, 64, 69, 77 et 84 du Recueil des Ilisloriens de France men-tionnent cette date du 28 janvier : anniversaria inunctionis nostrae quae est V . kal. Febrarii (n 64). Dans les n 69 et 77, il estajout que c'tait lors de la Sainte Agns ; il aurait mieux valu dire : l'octave de la Sainte-Agns, puisque cette fte tombe le 21 jan-vier. La date exacte se trouve dans un diplme du 9 octobre 918 (R. deLasteyrie, Carlulaire gnral de Paris, n 61): Dies unctionis nos- trce... qui est octavae sanctae Agnetis virginis Il est remarquerque dans le texte de Richer, le chiffre des calendes est eifac. Richermentionne galement, comme ayant assist la crmonie, les arche-vques de Trves, de Mayenceet de Cologne, avec leurs suffragants.Cela est tout fait invraisemblable ; car ces trois provinces taient situesdans la Lorraine, et ce pays tait alors sous la domination d'ArnouI.Il est galement douteux que Didon, vque de Laon, ait t prsent;sa conduite vis--vis de Gaucher, auquel il refusa la spulture (Flod.,Hisl. eccles. Rem., IV, 6), fait supposer le contraire.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
43/202
[893] COURONNEMENT DE CHARLES III. 13Charles n'a d compter que peu de partisans \ ce qui s'ex-plique facilement, puisque c'taient l des pays placs plusdirectement sous l'autorit d'Eudes en qualit de comte deParis et de duc des Francs*; cependant on peut supposer queles fils de Godefroy, comte du Maine, que nous avons vu plushaut se plaindre Foulques de la conduite du roi leurgard, avaient embrass la cause de Charles. Au nord de laSeine, on ne peut citer que l'vque de Beauvais, Honor,qui ait refus de se rendre l'appel de son mtropolitain,malgr les pressantes sollicitations de ce dernier \ En gnral,le nombre des partisans du jeune Carolingien a d tre fortconsidrable; car Rginon, qui pourtant ne peut gure tresuspect de partialit en faveur de Charles, dit expressmentque la plus grande partie des seigneurs francs abandonnrentEudes \
Tous les grands feudataires avaient successivement jurfidlit au fils de Robert le Fort l'poque de son second cou-ronnement Reims. Les voiL qui, pour la plupart, se dtachentde lui pour se rallier au parti carolingien ; sous peu, nous allonsles voir se retourner du ct d'Eudes. La fidlit, ce mot quirevient chaque instant dans les textes, tait pour ainsi direinconnue des hommes de ce temps; presque nulle part, on nerencontre chez ces rudes batailleurs un attachement sincre,un dvouement lovai la personne d'un souverain. Le roi,
1. Richer, 1. I, c. 12: Et ex Celtica quidem paucissimi ejus partes sequebantur. Eu gard la partialit manifeste de Richer enversCharles, ce tmoignage n'est pas sans valeur quoiqu'il soit affaibli,d'un autre ct, par le texte de Rginon.
2. Duc des Francs et non duc de France; car il n'a jamais exist deterritoire appel duch de France. Voyez l'excellent article de M. Ana-tole de Barthlmy dans la Revue des questions hisloriques. t. VII,p. 108-14'i, et spcialement p. 132-138. On sait que les derniers mairesdu palais portaient galement le titre de duces Francorum. Cependantun passage de Flodoard (ann. ad a. 943) porte bien ducalus Franciac( Hugo dux tiliam rgis ex lavacro sancto suscepit et rex ei ducatum Franciae delegavit ). Mais peut-tre ducalus ne dsigne-t-il que lafonction et non un territoire dfini qui, en effet, semble n'avoir jamaisexist. Voyez galement ce sujet Favre, Eudes, appendice III: Leducdes Francs, p. 227-229.3. Flod., Ilist. eccles. Rem., IV, 6.
4. Rginon, 892 : Odone rege in Aquitania commorante Francorum principes ex permaxima parte ab eo deficiunt. Au sujet des relationsde Rginon avec Charles 111, voyez un trs intressant article deJ. Harttung (von Pflugk-Harttung) Ueber Regino von Priim dans lesForscInuKjcn zur dcutschen Geschichle, t. XVllI, 1878, p. 363-367.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
44/202
14 CIlAlil.i:^ m AVANT SON AVKNFMKNT. [893]trahi et abandonn chaque instant par ses vassaux, estrduit l'impuissance.
Lorsque Eudes apprit qu'un rival s'tait lev contre luidans la personne de ce mme enfant au sujet duquel il avaitreu, quatre ans auparavant, les serments de Ramnulfd'Aquitaine, il se hta de s'assurer de la neutralit des seigneursdu Midi', puis revint vers le Nord ; il exhorta les grands quil'avaient abandonn revenir lui en leur rappelant lesserments qu'ils lui avaient prts lors de son couronnement.Cette simple exhortation sufht-elle ? Dans tous les cas, lesgrands feudataires qui venaient de quitter Eudes en violantleurs engagements ne se firent pas scrupule de les violer uneseconde fois pour revenir lui\ Aussi, lorsque Eudes parutdans le Nord, il ne rencontra aucune rsistance srieuse etfora son adversaire s'enfuir hors du royaumeOn ne sait o se rfugia le jeune prtendant. Peut-tre enLorraine, auprs de Renier au Long-Col ou du fils d'Arnoul,Zwentibold, (jui venait de recevoir quelques domaines dans ce
1. Guillaume d'Aquitaine parait avoir hsit assez longiempsavant de se prononcer entre les deux comptiteurs, {'ne charte dumois de novembre 893 par laquelle Ava, sur de Guillaume, cde son frre le domaine de Cluny. est date anno primo certantibus duobus regibus de regno, Odone videlicet et Karolo (Bruel, Re-cueil des Charles (le Cliiny, t. 1
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
45/202
[893] GUERRE ENTRE CHARLES ET EUDES. 15pavs'? Je pencherais plus volontiers pour la Bourgogne,attendu que le roi de Germanie qui venait de quitter la Lor-raine, s'tait montr hostile la cause carolingienne en confis-quant les biens de l'glise de Reims sis dans ses tats-; d'unautre ct, le duc Richard parat n'avoir jamais abandonncompltement le parti de Charles, ce qui aurait permis cedernier de chercher un refuge chez lui. De fait, nous ne pos-sdons pas de texte qui nous permette de nous prononcer dansTun ou dans l'autre sens.
Eudes, de son ct, prit l'offensive en dtruisant le chteaud'Epernay, qui appartenait l'archevque de Reims, puis mitle sige devant cette dernire ville dans l'espoir de frapperla rbellion au cur. On peut mme supposer, la maniredont les faits sont raconts par Flodoard. que Eudes etArnoul agirent de concert dans cette circonstance. MaisCharles reparut en septembre et fora Eudes lever le sige;puis, aprs divers pourparlers, on finit par conclure une trvequi devait durer jusqu'au jour de Pques (31 mars) de l'annesuivante (894)1Pendant que cet armistice accordait un peu de repos auxdeux adversaires. Foulques, qui se trouvait de nouveau Reims avec Charles, chercha intresser le pape et Arnoul la cause de son protg.La correspondance de l'archevque, analyse en dtail par
Flodoard dans son Histoire de l'glise de Reims ^ est de laplus grande importance pour l'histoire de cette poque etnous apprend bien des choses sur les rapports de Foulquesavec presque tous les grands personnages de son temps.
L'archevque de Reims nous y apparat, l'instar de sonillustre prdcesseur Hincmar, comme un politique aussi sou-cieux des intrts de l'tat que de ceux de l'glise, mais
1. Mourin (Ilist. des comtes de Paris, p. 79) et Kalckstein (Cape-tinger, p. 86) tiennent pour cette hypothse.2. Aun. Fulden-
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
46/202
16 CHAULES III AVANT SON AVNEMENT. [893-894]avant tout profondment dvou son jeune matre auquel iln'pargne ni les conseils, ni mme les reproches les plus vifs.Il crit au pape, au roi de Germanie, d'autres encore, pourleur recommander Charles et les difier sur les droits du jeuneCarolingien au trne de France. Malheureusement les datesnous font absolument dfaut; ce n'est qu' l'aide de conjec-tures et de raisonnements que nous parvenons fixer l'poqueapproximative c laquelle quelques-unes de ces lettres ont dtre crites, et pour un temps o les textes sont si peu nom-breux, c'est l un moyen bien hardi de vouloir fixer des faitsou des dates*.Le pape Formose semble seul avoir rpondu srieusement l'appel de l'archevque. Mais les affaires d'Italie absorbaient
trop l'esprit du pontife pour lui permettre de s'occuper avecune grande nergie de celles de la France ; aussi son inter-vention se borna quelques lettres aux deux adversairespour leur recommander la paix. Quant au roi de Germanie,il laissa sans rponse une longue lettre que Foulques luiavait crite pour le supplier de se prononcer en faveur deCharles. Celui-ci se trouvait donc rduit ses propres forces,de sorte que, lors de la reprise des hostilits, assigdans Reims par son rival, il n'eut d'autre ressource que des'enfuir secrtement de la ville. Il se rendit Worms, oArnoul tenait alors un plaid. Arnoul le reut fort gracieuse-ment et lui concda le rojaume de ses pres ; joignant l'action la parole, il fit accompagner le Carolingien par un corpsde troupes afin de l'aider coml)attre son rival''.
Il me semble difficile d'admettre que ce fut par pure sym-pathie pour Charles qu'Arnoul viola ainsi le trait d'amiticonclu avec Eudes ; il tait beaucoup trop proccup de ses
1. Nous pouvons pourtant affirmer que la premire lettre Arnoul(ch. 5) doit tre de latin de l'anne 89;J; elle est de peu postrieureau couronnement de Charles. Une autre lettre, adresse au pape For-mose (ch. 3), dans laquelle l'archevque de Reims parle du sige desa ville archipiscopale par Eudes et du retour offensif de Charles,doit appartenir la mme poque, ainsi qu'il ressort de la comparai-son avec les annales de Saint-Vaast.
2. C'est l'poque des guerres entre Arnoul et Guy de Spolte et ducouronnement du roi de Germanie Rome en 894.3. Ann. Vedast., 894; .Ann. Fuldensefi. 894; Ann. Blandinienses, 894;Rginon, 893. Voir aussi deux diplmes d'Arnoul dats de Worms du
5 et du 13 juin 894 (Bohmer-Mhlbacher, n 1847 et 1849). Favre,Eudes, p. 168.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
47/202
[S9i-80:.] INTF.RVKNTION D'ARXOUL. 17propres intrts pour s'abandonner une politique de senti-ment. Ce qu'il voulait avant tout, c'tait affaiblir les deuxrivaux en entretenant la guerre civile, afin de lui permettre lui, Arnoul, d'intervenir quand l'occasion lui en sembleraitfavorable. C'est pourquoi sa politique devait consister soutenirtoujours le plus faible, de sorte qu'aucun des deux compti-teurs ne put devenir entirement matre de la situation. Ceque le roi de Germanie ne prvoyait pas dans ses calculs,c'tait l'union future d'Eudes et de Charles, l'hommage prt ce dernier, aprs la mort de son rival, par tous les sei-gneurs franais et l'invasion de la Lorraine par Charles,en 899.Tout d'abord, le plan d'Arnoul ne russit pas compltement ;car les chefs de l'arme de secours, prtextant l'amiti quiles unissait Eudes, abandonnrent le jeune Carolingien ets'en retournrent chez eux. Il ne resta plus Charles d'autreressource que de fuir de nouveau. Mieux inspir cette fois,il se rendit en Bourgogne auprs de Richard le Justicier qui,serable-t-il, ne cessa jamais de se montrer favorable sacause \A la suite de nombreux brigandages commis par le particarolingien rduit aux abois, des dvastations et des misresdont souffrait tout le pays, Arnoul, se posant en mdiateurentre les deux rivaux, les cita devant lui, Worras, afin derendre la paix et la tranquillit au royaume de l'ouest . Ondissuada Charles d'entreprendre ce voyage, soit qu'on craigntque la route travers la France ne ft pas assez sre, soitqu'on n'ost trop se fier la parole du roi de Germanie ; onse borna lui envoyer une dputation, la tte de laquellese trouvait l'archevque de Reiras. Eudes se prsenta doncseul et n'eut pas de peine obtenir tout ce qu'il dsirait^ Qu'on
1. Ann. Vedast., 894; Rginon, 893; Favre, Eudes, p. 168.2. Ann. Vedast., 895.3. Ann. Vedast.. 895: Rex vero illum cum honoro excepit atque
cum leticia ad sua remisit. Rginon, 895: Odo... ad Arnulfum(f venit. a quo honoritice susceptus est, omnibus impetratis pro quibus venerat. Voir aussi Favre. Eudes, p. 173. Je ne comprends vraimentpas comment Gfrrer (Gesc/i. der ost- und ircstfrdnkisclien Carolinger,t. II, p. 354 et 355) a pu dire qu'Arnoul avait reconnu la fois Eudeset Charles: Denn nachdem Cari und Odo im Angesicht der Stnde (?) as Theilkonige Franziens anerkannt worden waren... , etc. Ocela se trouve-t-il? Quel auteur parle d'un tel arrangement fait enprsence des dputs (?) de la Germanie? Dans la prface du premier
EcKEL. Charles le >imple. 2
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
48/202
18 CHARLES III AVANT SON AVKNEMENT. [870-895]n'oublie pas qu'Anioul avait, une premire fois, reconnuEudes ds le dbut du rgne de celui-ci, qu'il s'tait tournensuite vers Charles ; le voil qui viole une seconde fois sesengagements pour reconnatre de nouveau le fils de Robertle Fort. A son retour de Worms, Eudes rencontra l'am-bassade de son rival ; on en vint aux mains et cette dernirefut compltement dfaite et dpouille des nombreux cadeauxqu'elle devait prsenter Arnoul\ Qui sait si ce dernier n'etpas derechef reconnu le Carolingien dans le cas o Foulquesserait arriv Worms avec les prsents qu'il tait charg delui remettre de la part de son matre.
Rduit fuir une fois de plus, Charles alla implorer le secoursde Zwentibold, fils naturel d'Arnoul, que ce dernier venait defaire nommer roi de Lorraine. Eu gard au caractre de ceprince, on a lieu de s'tonner de la rsolution prise, par leparti carolingien, un tel alli tant de fort peu de valeur etpouvant mme, selon les circonstances, devenir trs dange-reux. Mais cet appel un prince lorrain, ce rapprochemententre les Carolingiens franais et lorrains, eut des rsultatsdont nous allons bientt pouvoir apprcier l'importance. Pourcela, il faut que nous revenions rapidement sur l'histoire dela Lorraine, et que nous signalions les phases par lesquellesson histoire a successivement pass.Le trait de Mersen, du 8 aot 870, en partageant la Lor-raine entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, avaitmis un terme provisoire l'existence d'un tat indpendantentre la France et l'Allemagne^ Aprs la mort de Louis leBgue, un parti de mcontents, leur tte Gozlin, abb deSaint-Germain-des-Prs, et Conrad, comte de Paris, ayantappel en France Louis III, roi de Germanie, afin de lui offrirla couronne la place des fils du roi dfunt, Hugues l'Abbet les seigneurs rests fidles la branche franaise de la
volume, Gfrorer dit avoir reconnu la ncessit d'interprter les faitsrapports par les sources, afin d'arriver une connaissance pluscomplte de l'histoire d'une poque. .Je suis parfaitement de son avis;mais je crois qu'il est assez tmraire de vouloir interprter et expliquerdes faits qui ne sont mentionns nulle part. C'est l de Tinvention etnon de l'interprtation.
1. Ann. Vedast., 895; Ann. Fiildenses, 895; Rginon, 895; cf. Favre,Eudes, p. 172-173, 175.2. Ann. Bertiniani, 870; Rginon, 870. Voir le texte du trait dans
les Monum. German. Leg. Sect. n, Capularia, t. Il, p. 193.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
49/202
[879-893] LA LORRAINF. 19famille carolingienne se virent forcs, pour loigner l'intrus,de cder au roi d'outre-Rhin la partie de la Lorraine attribue la France \ Une seconde invasion de Louis, l'anne suivante,ne russit pas mieux et le roi de Germanie signa Ribemontavec les deux fils de Louis le Bgue un trait qui lui assuraitla possession de la moiti occidentale de la Lorraine*.
Cette cession tait, au fond, une violation flagrante dutrait de Mersen et l'on peut aisment croire que les rois deFrance supportrent impatiemment cette annexion que rienne justifiait. Nanmoins on ne voit pas que Louis III et Car-loman et, aprs eux, Eudes aient fait quoi que ce soit pourrentrer en possession de cette partie de la Lorraine ; il estvrai que les incursions des Normands et les rvoltes perp-tuelles des seigneurs ne leur en laissaient gure le loisir. Lesrois d'Allemagne, de leur cot, cherchrent consolider au-tant que possible leur nouvelle conqute. Mais les Lorrains,comme du reste aussi d'autres peuples englobs dans leroyaume de la Francia orientalis, visaient une indpendanceau moins relative ; leur position sur les confins de deux paysdevait rendre ce peuple de race mle, moiti franais etmoiti allemand, ce dsir plus violent encore^ Arnoul le re-connut et voulut donner quelque satisfaction ces tendancessparatistes cq crant une sorte de vice-royaut au profit deson fils naturel Zwentibold*. Il semble que ce fut surtout lanaissance de Louis l'Enfant, la fin de l'anne 893, qui dcida
1. Ann. Vedasl., 879; Ann. Berlin.. 879. La femme de Louis IILLiutgarde de Saxe, ne se montra pas satisfaite de cet arrangement etaurait bien voulu voir son mari s'emparer du royaume de France toutentier: Audiens autem hoc, uxor illius satis' moleste tulit, dicens quia si illa cum eo venisset, totuni istud regnum haberet (Ann.Berlin.. I. c.)
2. Ann. Bi-rt.. 880.3. Diimmler {Gesch. des o.'itfriink. Reiches. t. III, p. 38 ) convientque la Lorraine a toujours montr des tendances se sparer du restedu royaume oriental: ... da es ... stets am lebhaftesten ein Streben
nach .\bsonderung kundgegeben batte. 4. Ce nom, dans les diplmes originaux, est crit Zuente-bolchus ou Zuentebulchus . Il a. du reste, t crit de toutes lesfaons, probablement en raison de sa raret: c'est ainsi que. dans lesNotae Aiireaeval/enses seu chronicon Leodiense brve (Mon. Germ.
hi.'il. Script., t. XVI, p. 682), on ne trouve pas moins de trois formesdiffrentes et aussi singulires les unes que les autres: Ceinderbol-dus , Xenderboldus et Kindiboldus . i>on origine est le slave Sviatopolk .
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
50/202
20 CHARLES III AVANT SON AVNEMENT. [893-890]Arnou] agir ainsi, puisque de ce fait tout espoir de succ-der au royaume avait cess pour le btard.Ds le mois de fvrier 893, pendant un sjour qu'il fit en
Lorraine, Arnoul avait prpar les voies son fils an.L'anne prcdente, un des seigneurs les plus influents dupays, Mgingaud, avait t assassin* ; le roi concda Zwen-tibold une partie des fiefs ou bnfices autrefois possds parlui, et notamment la riche et puissante abbaj^e de Saint-Maxi-min, Trves . Le btard prenait ainsi pied en Lorraine,En mme temps, Arnoul cherchait se concilier les bonnesgrces du clerg lorrain par une srie de donations et de res-titutions, dans lesquels il avait soin de faire intervenirZwentibold ; les vques de Toul, de Verdun et de Cambrai,ainsi que le chapitre de la cathdrale de Trves, se trouvaientau nombre de ceux que la munificence royale avait distingus''.Dans une dite tenue Worms, en mai 894, dite laquelleil reconnut, comme nous l'avons vu plus haut^, le jeune Charlesen qualit de roi de France, Arnoul crut pouvoir proposeraux seigneurs laques et ecclsiastiques de la Lorraine lanomination de son fils naturel. Mais ce fut en vain ; ils refu-srent de reconnatre Zwentibold pour leur roi, malgr leslibralits d'Arnoul envers le clerg ^
Cependant le roi de Germanie n'tait pas homme aban-donner ainsi ses projets. L'anne suivante (895), au mois demai, un synode d'vques lorrains s'assembla Tribur, oArnoul se rendit galement. Il combla les prlats d'attentionset leur promit son concours empress dans l'uvre de rel-vement qu'ils entreprenaient en ce qui concerne les murs etla discipline ecclsiastiques ^ Ces prvenances finirent par
1. Il fut plus tard vnr comme saint: voy. Vita S. Mengoldi(Acta Sanctorum, fvrier, t. II, p 191-196). Cf. au.ssi Rginon, 892.2. Rginon, 892. Voir aussi Wittich, Jjie Enlslehung des Ilerzog-thums Lotiu-inyen, p. 25, note 2.o. Voir une srie de diplmes d'Arnoul analyss dans Bhmer-Muehlbacher, n ^ 1833, 1834, etc.4. Voir plus haut, p. 16.5. Rginon, 894: ... sed minime optimates praed'icti regni ea vice
assensum praebuerunt. 6. Les actes de ce synode ont t publis dans les Monum. German.Leg., Secl. n, Capitularia, t. II, p. 196. Dmmler (Gesch. des oslfrnk.Reiches, t. III, p. 408 et 409) suppose avec beaucoup de vraisemblanceque ce fut au synode de Tribur qu'Arnoul s'attacha davantage les v-ques lorrains pour les gagner ses projets.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
51/202
[89:)-898] ZWKNTIP.nLI), liOI DE LORRAINE. 21porter leurs fruits. Lorsque vers la fin de ce mme mois demai, une seconde dite se runit AVorms, Zwentibold, duconsentement unanime des grands, fut proclam roi de Lor-raine en prsence d'Eudes qu'Arnoul avait appel conjointe-ment avec son rival pour dcider entre eux\ Ces attentionsrptes d'Arnoul pour le clerg lorrain font supposer quec'est lui principalement qui a d s'opposer l'lection deZwentibold, probablement en raison de sa naissance illgi-time . D'un autre ct, on arais l'opinion fort plausible queRenier au Long-Col, comte de Hesbaye, que nous verronsbientt arriver une situation prpondrante en Lorraine, ad tre un des plus chauds promoteurs de cette lection' ; laconfiance que le jeune roi ne tarda pas tmoigner Renierdonne cette hypothse une grande vraisemblance.
Les opinions sont partages en ce qui concerne les rapportsdu nouveau roi de Lorraine avec son pre. 11 est certainqu'Arnoul ne pouvait pas se dsintresser absolument desaffaires de cette marche occidentale de l'Allemagne et, eneffet, nous le voyons intervenir en 898 dans la nominationd'un comte de la Frise, pays tout particulirement exposaux ravages des Normands''. Mais dans tous les cas, cettesorte de suzerainet ne semble pas s'tre exerce biensouvent, et Zwentibold, tout en ne prenant aucune part auxexpditions organises par son pre, fit, dans l'ouest, la guerrepour son propre compte, tantt pour l'un, tantt pour l'autre
1. An7i. Vedasl.,S9o; Ann. Fiddemes, 895; Ann. Blandinionses, 895;Ann. Laubienses, 895; Ann. Alamannici, 895; Rginon, 895. Le com-mencement du rgne de Zwentibold est certainement po.strieur aul'i mai 895, poque laquelle Arnoul se trouvait encore Tribur(lUihmer-Mhlbacher. n 1857) et antrieur au 30 mai, date du premierdiplme du nouveau roi (Ibid., n 190'i).
2. C'est l l'opinion fort plausible du P. Brabant (lude sur R-gnier /
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
52/202
22 CHAULKS 111 AVANT SON AVNEMRNT. fS05]des deux comptiteurs au trne de France. Cette indpen-dance presque complte dut tre trs prjudiciable auxintrts de l'Allemagne ; il est vident qu'aprs la mortd'Arnoul, le dernier vestige de la subordination de son b-tard au nouveau roi n'aurait pas tard disparatre compl-tement si Zwentibold n'avait pas t tu ds l'anne 900 dansla guerre qu'il eut soutenir contre ses propres sujets.M. Diimmler juge trs svrement cette nouvelle uvred'Arnoul dont il attribue l'ide uniquement l'affection aveugledu roi pour son fils naturel, affection que le caractre de cedernier ne justifiait, du reste, en aucune faon'.A peine tabli sur son nouveau trne, Zwentibold se lanadans une aventure o son incapacit jointe un manqueabsolu de loyaut, son caractre inconstant et brouillon, sesintrigues perfides purent se donner libre carrire. C'est ceprince que s'adressrent les partisans de Charles le Simpleen lui promettant, pour prix de son intervention, la cessiond'une portion du territoire franais'. C'tait de mauvaise po-litique, et la faiblesse dans laquelle se trouva alors le particarolingien ne peut suffire excuser ce projet. Zwenti-bold accepta avec empressement, et Rginon dit, peut-trenon sans raison, que les secours qu'il envoya Charles nefurent qu'un prtexte pour s'immiscer dans les affaires de laFrance afin d'agrandir ses propres domaines ^ On a prtendugalement que le roi de Lorraine aurait agi en cela de con-cert avec son pre afin de semer la discorde en France*. Jene crois pas cette opinion fonde, car nous ne voyons pasqu'Arnoul, aprs la retraite de Zwentibold, ait rien fait pourle secourir. En gnral, partir de la reconnaissance duRobertien en 895, Arnoul semble s'tre dsintress absolu-ment de la rivalit entre Charles et Eudes. Faut-il attribuercette neutralit aux afi aires d'Italie qui l'absorbaient alors, ou la maladie dont il souffrait? On ne saurait se prononcer '.
1. Dmmler (Gesch. des ostfrdnk. Reiches, t. III, p. 410 : Gewiss nicht Erwaegungen des Gemeinwohis, nur eine demselben nach- theilige Liebe fiir den Erstgebornen, trieben Arnolf an, ihn ohne Rcksicht auf seine Befahigung mit der Knigskrone zu schmcken, weder zum Segen fur ihn selbstnoch fur das gesaramte Reich.
2. Ann. Vedast., 895. Favre, Eudes, p. 175 et 176.3. Rginon, 895.4. Borgnet, lude sur le rgne de Charles le Simple, p. 18.5. Afin. Fuldensi's. 896. \'oir aussi Richter, Annalen der deutschen
Geschichte im Mitlelaller, t. H, 2 partie, p. 518-521.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
53/202
[895-896] ACCOHD ENTIIK CriARLF'S ET KIDES. 23Quoi qu'il en ait t, l'expdition de Zwentibold ne fut
point couronne de succs. Il ne put parvenir s'emparer deLaon, mais, donnant suite ses projets ambitieux, il sparadu parti de son adversaire le comte de Flandre et son frreRaoul ; on assure mme qu'il cherchait faire prir Charles \
Cette nouvelle trahison laissait le Carolingien, une fois deplus, sans ressources et sans espoir. Ses amis et partisansprirent enfin une rsolution laquelle ils auraient d s'arrterdepuis longtemps dj pour viter d'tre berns si impu-demment par Arnoul et son fils : ils s'adressrent leur ad-versaire, Eudes lui-mme, le priant de concder Charlesune partie quelconque du royaume et de faire la paix avec lui.Eudes y consentit et s'avana vers l'est au-devant de Charles.Ds que Zwentibold eut connaissance de cet accord qui djouaitses combinaisons, il se hta de rentrer dans son royaume .
Cependant les comtes Herbert de Vermandois et Effroy,envoys par Charles pour traiter avec son rival, furent reuspar ce dernier Arras o il s'tait rendu pour forcer le comtede Flandre et son frre, que nous avons vu se rallier Zwen-tibold, lui faire leur soumission. On dcida de convoquerles fidles de Charles une runion qui devait avoir lieuaprs Pques (4 avril) de l'anne suivante, afin d'viter laguerre pendant la mauvaise saison ^ Dans les premiersmois de l'anne 896, il semble que l'accord projet entre lesdeux rivaux ait t subitement rompu. 11 nous est peu prsimpossible de savoir lequel des deux a manqu sa parole ;pourtant, en examinant les sources de trs prs, on voit quec'est Eudes qui a du reprendre roff ensive '. Mais la brivetdsesprante des documents ne nous laisse mme pas devinerles raisons qui ont motiv cette manire d'agir. On voit seule-ment que les seigneurs du parti carolingien ont t dpouillspar Eudes de toutes leurs possessions ; seule, la ville deReims n'tait pas encore entre ses mains.
1. Aun. Vedast.,89D: Rginon, 895. Voir aussi Favre, ouvr. cit., p.176-177. Parmi les seigneurs que Zwentibold dtacha du parti deCharles, les annales de Saint-Vaast nomment galement un certainRenier qu'on a voulu identifier avec Renier au Long-Col. Je ne voispas trop comment ce Lorrain pouvait abandonner un prince dont iln'tait pas le vassal; son suzerain tait Zwentibold.
2. Ann. Vedast., 895.3. Ann. Vedast., 895. Favre, ouvr. cit.. p. 181-182.4. Ami. V'erfrts^, 896 (au commencement).
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
54/202
24 CHARLES 111 AVANT Sl)N AVhlNEMENT. [896]Malgr cette reprise des hostilits, plusieurs runions eu-
rent lieu dans le courant de l'anne 896 entre Eudes et lesfidles de Charles ; une de ces confrences fut surprise parune attaque inopine du comte Raoul ; et c'est la suite decela, nous dit l'annaliste de Saint-Vaast, que Herbert de Ver-mandois et le comte Erchanger se soumirent Eudes \ Il neresta donc presque plus personne auprs du jeune Carolin-gien, mais un coup plus sensible lui tait encore rserv.Tandis qu'Eudes guerroyait contre le comte, de Flandre, sesvassaux bloquaient dans Reims l'archevque Foulques. S'em-parrent-ils de la ville ? On ne sait ; ce qu'il y a de certainc'est que le prlat fut forc de faire sa soumission Eudes .Charles, dsespr de cette dernire dfection et ne sachantplus o se rfugier, gagna la Lorraine et se rendit auprs deZ^ventibold^ On ne s'explique vraiment pas pourquoi le Ca-rolingien a recherch plusieurs reprises l'aide et l'assis-tance du fils d'Arnoul, de cet cervel qui ne songeait qu's'agrandir aux dpens de ses voisins, et dont les mauvaisesintentions vis--vis de Charles devaient pourtant tre connuesde ce dernier.Zwentibold ne sut rien faire de mieux que d'aller ravager
les possessions de l'glise de Reims, en quoi il rendit un fortmauvais service Charles. Foulques s'en plaignit amrementau pape*; mais il semble que le roi de Lorraine ait commisces dprdations sans l'assentiment de son alli, puisque dansles lettres de l'archevque au souverain pontife, il n'est pasquestion de Charles ''. Ce dernier se trouvait dans une situa-tion extrmement critique ; car Zwentibold, loin de le sou-tenir srieusement, ne faisait que nuire sa cause. Ne sa-chant plus o se rfugier, le malheureux prince, abandonnde tous, ft appel aux Normands qui, sous la conduite de leurchef Hunede, avaient remont la Seine, puis aprs tre
1. A7in. Vedast., 896. Favre, Eudes, p. 185.2. Ann. Vedast., 896. Cette soumission ne se fit pas sans rsistance,
comme l'indique l'expression licet invitus , employe par l'annaliste.3. Le 25 juillet 896, Charles dlivrait Gondreville (Meurthe-et-Moselle) un diplme en faveur du prieur de Salonne. Arch. dpart,de Meurthe-et-.Moselle, G, 469; Journal de la Socit d'archologielorraine, t. I , p. 161 (article de M. d'Arbois de Jubainville).4. Voir sa lettre: Flodoard, Hist. eccles. Remens., IV, 4.5. C'est ce que suppose avec beaucoup de raison v. Kalckstein, Ca-pelinger, p. 101, note 2.
-
5/26/2018 bibliothquedel124ecol
55/202
^896-897] NOUVEL ACGOUD KNTRI': CIIARLKS ET EUDES. 25passs sur les bords de l'Oise, s'taient retranchs prs deChoisy-au-Bac, sur l'Aisne, sans rencontrer de rsistance, etde l, avaient pouss jusque vers la Meuse ^ Une lettre lo-quente de Foulques le fit renoncer son projet d'alliance ^Charles n'tait pas le premier Carolingien qui se fut mis enrelations avec les Normands; le sort de Ppin, fils de Charlesle Chauve, lui aura sans doute donn rflchir et il aban-donna son entreprise.
Peut-tre cette tentative d'alliance avec les Normands n'a-t-elle t que le prlude de celle de 911, qui aboutit si heu-reusement, et il est remarquer qu'en 897, comme quatorzeans plus tard, Charles a pris soin de faire baptiser le chefnormand avant d'entamer avec lui des ngociations srieuses.
Pour cette fois, il cda aux instances de Foulques et en-tama de nouveaux pourpalers avec Eudes ; on peut mmesupposer que c'est l'archevque qui engagea Charles se rap-procher de nouveau de son rival et qu'il profita de ce qu'iltait rconcih avec ce dernier pour off rir sa mdiation etobtenir pour le Carolingien des conditions moins onreuses ^Les annales de Saint-Vaast mentionnent ce second rappro-chement des deux comptiteurs avec des expressions fortanalogues celles dont elles s'taient servies pour parler dela premire tentative d'union, en 895 ; les deux fois, les par-tisans de Charles demandent ce que l'on concde leurseigneur une partie quelconque du royaume \ On ne peut doncpas prtendre qu'en 897, le parti carolingien se soit montrplus humble, qu'il n'ait rien revendiqu, qu'il n'ait rien exiget n'ait fait appel qu' la piti d'Eudes ; rien dans les textes nevient confirmer cette supposition .
1. Aiin. Vedast., 896, 897. Voir Favre, Eudes, p. 187.2. Flodoard, Ilist. eccles. Ftemens., IV, 5. Voir plus loin, p. 62.3. Voyez Kalckstein, Capelinger, p. 103.4. A7in. Vedast., 897 : a ... partem aliquam ei ex paterne regno. 5. Mourin, Ilist. des comtes de Paris, p. 91 et 92. M. Favre (Eudes,comte de Paris et roi de France, p. 190) insiste sur le caractre dsa-
vantageux, mme Immiliant qu'aurait eu pour Charles