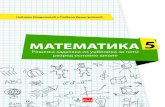w w B1 - klett.rs · Sommaire IntroductIon 5 Module 1 IL VAUT MIEUX ALLER CHEZ LE BOULANGER QUE...
-
Upload
truongkhanh -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of w w B1 - klett.rs · Sommaire IntroductIon 5 Module 1 IL VAUT MIEUX ALLER CHEZ LE BOULANGER QUE...
Мари Жозе Лопез • Жан Тјери ле Буњек • Корина Бријан • Гај Луис
Et toi ? 4Француски језик за 8. разред основне школеПриручник за наставникеЧетврта година учења
Друго издање
Ауторка адаптације: Данијела МилошевићЛектура: Мари ЈелићПрелом српског издања: Срђан Попадић
Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 БеоградТел.: 011/3348-384, факс: 011/[email protected], www.klett.rs
За издавача: Гордана Кнежевић ОрлићГлавни уредник: Александар РајковићУредник: Милан ПртењакШтампа: Newpress, СмедеревоТираж: 300 примерака
© оригинално издање: Les Éditions Didier, Paris 2009 © српско издање: Издавачка кућа „Klett” д.о.о., 2015.
Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.
ISBN 978-86-7762-490-3
CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд
371.3::811.133.1(035)
ET toi? [4] : [француски језик за 8. разред основне школе] : четврта година учења : приручник за наставнике B1 / Мари Жозе Лопез ... [и. др.] ; [ауторка адаптације Данијела Милошевић]. - 2. изд. - Београд : Klett, 2015 (Смедерево : Newpress). - 175 стр. : граф. прикази ; 27 cm
Тираж 500.
ISBN 978-86-7762-490-31. Лопез, Мари Жозе, 1969- [аутор]a) Француски језик - Настава - Методика - Приручници COBISS.SR-ID 216856588
SommaireIntroductIon 5
Module1 IL VAUT MIEUX ALLER CHEZ LE BOULANGER QUE CHEZ LE MÉDECIN 9
Séquence1 – Quand la santé va, tout va ! 10testd’évaluation 16Séquence2 – L’appétit vient en mangeant 18testd’évaluation 25Séquence3–Ventre affamé n’a point d’oreille 27testd’évaluation 34
Module2 êTRE LIBRES ET ÉGAUX 41
Séquence4–Au jour le jour 42testd’évaluation 49Séquence5– L’école est une chance 51testd’évaluation 56Séquence6–Un pour tous, tous pour un 58testd’évaluation 66
Module3 CONSTATER PAR SOI-MêME 73
Séquence7–Les amis de mes amis sont mes amis 74testd’évaluation 82Séquence8–Être ado 84testd’évaluation 90Séquence9–Voyages, voyages 92testd’évaluation 98
Module4 VOULOIR, C’EST POUVOIR 107
Séquence10–De la discussion jaillit la lumière 108testd’évaluation 116Séquence11–Qui ne risque rien n’a rien 118testd’évaluation 128Séquence12–Il n'y a que le premier pas qui coûte 130testd’évaluation 134
Corrigés deSactIvItéSdephonétIque 141
Corrigés dudelf 149
corrIgéS du cahier d’exercices 156
corrIgéSettranScrIptIonS des tests d’évaluation 167
( 3
( 5
1 - Organisation générale1 - 1
Les thèmes retenus sont très proches du quotidien et des centres d’intérêt des jeunes adolescents. Ils s’inscrivent dans l’actualité et rendent compte de la diversité de leur environnement socioculturel.
1 - 2
Nous avons privilégié le niveau de langue des jeunes adolescents. Nous tenions à ce que la langue utilisée dans le manuel se rapproche le plus de la réalité. Mais, notre objectif est qu’ils puissent adapter la langue à la situation de communication dans laquelle ils se trouveront.
1 - 3
Les documents utilisés s’inspirent tous de la réalité. Les supports écrits supposent tous une lecture, c’est-à-dire construire du sens. Les supports oraux, quant à eux, tiennent compte des spécificités de l’oral et mettent ainsi les apprenants dans la même situation qu’un francophone habitant la France.
Nos démarches visent à aider les apprenants à construire du sens. 2 - Une perspective actionnelleLa perspective ici privilégiée est l’approche actionnelle. Nous considérons donc les apprenants comme des acteurs sociaux qui vont interagir et auront à accomplir des tâches, pas seulement lin-guistiques, dans une situation sociale particulière (contexte) et dans un domaine particulier. C’est ce que nous appelons projet. Il s’agit pour l’apprenant de mobiliser stratégiquement ses compé-
tences (aussi bien en réception qu’en production).
Nous entendons par compétences générales :
– les savoirs ➝ apprentissage à la fois empirique et formel ;
– les savoir-faire ➝ d’ordre plus procédural, comme inscrits dans notre cerveau et notre corps ;
– savoir-être ➝ caractéristiques individuelles de type psychologique, ont à voir avec l’identité et sont donc soumises à la fois à des variations et des changements, particulièrement chez les jeunes. Ces savoir-être sont également inscrits dans des pratiques culturelles et peuvent donc devenir des objectifs ;
– les savoir-apprendre ➝ ils mobilisent à la fois les savoir-être, les savoirs et les savoir-faire. Les savoir-apprendre varient en fonction du domaine, de la tâche. L’apprenant développera d’autant ses savoir-apprendre que les expériences seront diversifiées et non répétitives. Suivant la nature de la tâche l’apprenant procédera à des pondérations (entre les différents savoirs).
Nous entendons par compétences à communiquer langagièrement :
– la compétence linguistique ➝ savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe, à la phoné tique. Cette compétence à avoir avec l’aspect cognitif de l’apprentissage. Ces savoirs peuvent être explicitables ou non ;
IntroductionIntroduction
6 )
IntroductionIntroduction
– la compétence sociolinguistique ➝ est en relation avec les paramètres socioculturels de la communication ;– la compétence pragmatique ➝ est en relation avec l’aspect fonctionnel de la langue et les actes de parole. Elle renvoie aussi à la maîtrise du discours, sa cohésion et sa cohérence.
Les activités langagières :
– les activités de réception (orales ou écrites), de production (orales ou écrites) ou d’inter-
action.
Les domaines :
– les activités langagières s’inscrivent, en ce qui concerne les enfants, dans les domaines public,
éducationnel et personnel.
Les tâches, ou projets :
– Ils supposent l’investissement de toutes les compétences et dans la mesure où elles ne sont pas automatisées, elles requièrent la mise en place de stratégies. La relation entre projet et stratégies dépend de la nature de celui-ci.
3 - MéthodologieLes présupposés théoriques de notre méthode s’inspirent des apports du Cadre européen com-
mun de référence. Pédagogiquement nous nous situons dans le principe de la découverte et de la
construction de sens. Nous élaborons nos démarches à partir des objectifs et organisons celles-ci en tenant compte de l’axe comprendre / s’exercer / produire (réception / production / interaction). Nous privilégions toujours le parcours qui va du sens vers la forme dans le cadre d’une progression spiralaire.Nous insistons sur la nécessité pédagogique de toujours faire expliquer les règles, les systèmes, par les apprenants. Les tableaux « Les mots de… », « Les expressions pour… » et « Pour communiquer et structurer » viennent confirmer ce qu’ils auront déduit. Le passage par la langue maternelle n’est pas obligatoire mais peut parfois aider au renforcement.Le traitement du lexique fait l’objet d’un travail systématique. Ici aussi nous privilégions les inter-actions qui permettent de construire le sens et de le vérifier. Notre démarche ne vise pas seulement l’acquisition des savoir-faire et des savoirs, elle participe aussi de la mise en place de savoir-apprendre.
3 - 1 Les objectifs
Nous avons choisi nos supports en fonction à la fois des activités langagières (réception/produc-tion) et des objectifs qu’ils permettent d’atteindre dans la perspective de la réalisation du projet. Ils se décomposent en objectifs fonctionnel(s) (ou pragmatiques), linguistiques (lexique, syntaxe, phonétique) et socioculturel(s).
( 7
IntroductionIntroduction
3 - 2 Comprendre / conceptualiser / s’exercer / produire
Comprendre (réception)
On peut commencer par une phase de sensibilisation et notamment en utilisant le support iconique (sans le texte), ou les indices sonores dans le cadre d’un document audio. Ou bien on fait faire directement les activités proposées. Celles-ci respectent le parcours de compréhension (identification, compréhension globale, compréhension finalisée) permettant de dégager le corpus à partir duquel le fait grammatical sera dégagé. Les tableaux « Les mots de… », « Les expressions pour… » et « Pour communiquer et structurer » arrivent en fin de parcours et per-mettent de fixer la structure, la règle. Celle-ci se construit peu à peu, au fur et à mesure des différents repérages. Des données culturelles sur la société française sont apportées aux élèves grâce aux encadrés « Culture et compagnie » qui peuvent être abordés à différents moments de la phase de compréhension.
Conceptualiser
À l’issue de la compréhension du document, les énoncés sont dégagés. Le professeur amènera les élèves à observer et par un guidage approprié aidera les élèves à repérer, regrouper, discriminer,
classer, afin de leur permettre d’énoncer les premiers principes du point linguistique abordé et de les conduire à une réflexion sur le fonctionnement de la langue. Le tableau de grammaire permet la mise au point finale.
S’exercer
Sous forme d’exercices de vérification à la suite des tableaux, aussi bien fonctionnels que grammaticaux.Dans le cahier d’exercices : exercices à la fois sur les objectifs fonctionnels et linguistiques. Ils sont variés (au niveau des compétences générales) et respectent l’axe mis en œuvre dans la phase de compréhension (utilisation/morphosyntaxe).
Produire
Des productions (plus ou moins divergentes) sont prévues à chaque séquence. Rappelons que le projet est la phase de production la plus importante. C’est vers le projet que tend tout le parcours du module.
4 - Les supportsLes thèmes choisis sont en relation avec les domaines d’utilisation. L’organisation à l’intérieur du module, de la séquence se construit de manière arborescente (thèmes et sous-thèmes). Indépendamment des domaines et de leurs thèmes, notre choix s’est fait en fonction de l’analyse des besoins, des motivations et des caractéristiques de nos jeunes apprenants.
4 - 1 Les documents oraux (activité de réception)
Chaque document relève d’un domaine. Les personnages s’engagent toujours dans un vrai acte de communication.
8 )
IntroductionIntroduction
Bien sûr nous avons également privilégié la dimension ludique (voire poétique) de la langue. Les supports oraux font toujours l’objet d’un travail d’écoute. Il convient de faire cacher la transcription. Le travail à partir de l’écoute/lecture simultanées est préconisé dans la phase de compré hension plus finalisée. Il est parfois intéressant de donner une (ou deux) consigne(s) de compré hension avant la première écoute. Cela leur rend le travail plus facile ; les apprenants sont plus actifs, plus concernés. Une fois familiarisés avec ces modalités de travail, les élèves se sentent à la fois impliqués, aidés et encouragés.Il est très important de finir le travail de compréhension par une dernière écoute, livre ouvert, pendant laquelle l’élève écoute en associant la graphie à ce qu’il entend.
Nous privilégions toujours le principe de compréhension orale/production orale (en continu ou en interaction).
4 - 2 Les documents écrits (activité de réception visuelle)
Tout comme pour les supports oraux « l’entrée » dans le document se fait toujours par une approche
globale : identification, aspect fonctionnel, formes grammaticales récurrentes. Cette démarche exclut la linéarité (texte décomposé en phrases et celles-ci en mots). L’objectif est la compréhension de l’aspect pragmatique du texte (compétence pragmatique). Par ailleurs, nous déconseillons, lors du travail de compréhension, la lecture oralisée. En revanche, chacun doit disposer du temps de lecture silencieuse qui lui est nécessaire.
5 - Les modalités de travailBeaucoup d’activités (repérages par exemple) et d’exercices sont à faire par 2 ou 3. D’autres sont à faire individuellement, avant de comparer avec son voisin.Il est toujours important que les mises en commun (les corrections) en grand groupe soient un moment d’échanges entre les élèves ainsi qu’entre les élèves et le professeur. Par son écoute et ses feed-back il permettra à tous de trouver une place dans cet espace commun qu’est la classe.
6 - L’auto-évaluationLes pages « contrat » en début de module fournissent les critères pour l’auto-évaluation. À l’issue du module, l’élève se positionne (sur une échelle simplifiée correspondant à « en cours d’acqui sition », « acquis » et « non acquis »). Ce curriculum ainsi constitué permet à l’apprenant de mieux situer ses compétences. L’auto-évaluation implique l’élève dans son apprentissage en lui faisant prendre conscience de ses points forts et de ses points faibles. Ceci se traduit par plus de motivation.
7 - Les tests d’évaluation type DELF B1Des tests d’évaluation reprenant les savoir-faire et les outils linguistiques étudiés sont proposés, dans le guide pédagogique, à la fin de chaque séquence pour permettre aux élèves de s’entraîner à la validation de leurs compétences.
10 )
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : peut compren-dre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou radio-diffusés, dont le sujet intéresse à titre personnel et la langue standard clairement articulée.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale :– peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
Objectifs Communication
– Poser des questions (sur un problème médical).
– Répondre positivement ou négativement.
Linguistique
– Grammaire Les articulateurs logiques: mais, cependant, et, de plus.
– Lexique La médecine. Les soins.
– Phonétique Groupe et rythme.
Socioculturel
– Les ados et la médecine.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Faire observer les photos et demander : « Qui vous voyez ? Que font-ils ? ». (Des jeunes qui s’occupent de leurs yeux : le garçon est en train de mettre une lentille et la fille se démaquille.)
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1 Quand la santé va, tout va !
attentIon leS Yeux
•pages 8 et 9PhiliPPe (animateur radio) : Vous êtes sur Radio Ados, il est 18 heures, l’heure de retrouver Manu pour son émission Quoi de neuf, Docteur ? Salut Manu !Manu (animateur radio 2) : Salut, Philippe, merci. Salut à tous ! Cette semaine, le thème de l’émission, c’est la vue ! Vous avez des questions, des doutes, des problèmes avec votre vue... N’hésitez pas à nous appeler ; ce soir, un spécialiste des yeux pour vous répondre, l’ophtalmologiste Michel Girouin. Bonjour, docteur !Docteur Girouin : Bonjour, Philippe !Manu : Alors, la première question, c’est moi qui vous la pose, un ophtalmologiste, ou ophtalmo, c’est plus facile ! qu’est-ce que c’est exactement ?Docteur Girouin : Eh bien, un ophtalmologiste est un médecin spécialiste de la vue. Il étudie et soigne les yeux.Manu : Je crois que Valentine est en ligne... Bonsoir, Valentine ! Tu as une question pour le docteur Girouin.Valentine : Oui, bonsoir ! Est-ce que la conjonctivite est une maladie ?Docteur Girouin : Oui ! Tout à fait ! C’est une maladie des yeux très fréquente. Mais elle reste très souvent bénigne, sans gravité et on arrive à la soigner.Manu : Bonsoir, tu nous entends ?Victoire : Oui, ma question concerne le maquillage. J’ai des lentilles, est-ce que je peux me maquiller quand je les porte ?Docteur Girouin : Oui (hésitation) mais attention aux maquillages. Certains peuvent favoriser des infections oculaires. Mieux vaut acheter ses produits en pharmacie, et surtout bien se démaquilleravant de se coucher !Manu : Bien ! On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans quelques minutes pour d’autres questions sur les yeux et la vue en général. À tout de suite !
( 11
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1– Demander : « À votre avis l’émission parle de quoi ? »(L’émission parle des yeux, des problèmes et des maladies aux yeux.)
compréhension globale
Activité 1 • page 8
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Les apprenants font l’activité indivi-duellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e).
– Demander : « Quel est le nom de la radio et le nom de l’émission ? ».(Radio Ados / « Quoi de neuf docteur ? »).
– Demander : « On entend combien de personnes et qui sont-elles ? ».(Six personnes : deux animateurs [Philippe et Manu], un ophtalmologiste [le docteur Girouin], trois adolescents [Valentine, Émile, Victoire]).
Activité 2 • page 8
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement une deuxième fois.
a. Lire la question en grand groupe et y répondre.
b. Lire la question et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Mettre en com-mun, en grand groupe, à l’oral.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants de relever les termes qui expriment une idée d’opposition dans les phrases 2 et 3. (Mais et cependant.)– Leur demander de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et struc-turer : Organiser le discOurs (1) / exprimer l’opposition et reformuler la règle.
Corrigé
1. Vrai. / 2. Faux. / 3. Vrai. / 4. Faux.
Activité 1
Corrigé
a. Les yeux, la vue.
b. Valentine : « La conjonctivite est-elle une maladie ? »Victoire : « Peut-on se maquiller avec des lentilles ? »Manu : « Un ophtalmologiste, qu'est-ce que c'est ? »
Activité 2
12 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
Activité 3 • page 9
Déroulement (10 min)
Compétences travaillées : compréhensions orale et écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Les apprenants notent les réponses individuellement puis vérifient, par deux, en lisant le dialogue. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Leur demander de prendre connaissance de l’encadré les mOts de… la médecine.
exercice
Activité 4 • page 9
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Production orale
Activité 5 • page 9
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler en sous-groupes. Pour la mise en commun, chaque groupe joue la scène devant la classe. Les autres prennent des notes sur les points positifs et les points négatifs de la production : l’interrogation, les expressions pour répondre et le lexique médical. Après la passation, interroger la classe sur ce qui a été remarqué et procéder à des corrections, si nécessaire.
Corrigé
MédecinUn ophtalmologiste.Un médecin spécialiste.Il étudie.Il soigne.Un docteur.MaladieUne maladie des yeux.Bénigne.Contagieuse.Être transmise.La contagion.Les infections oculaires.Les yeuxLa vue.La conjonctivite.La myopie.Les lentilles.
Activité 3
Corrigé
Pédiatre ➝ Il soigne les enfants.
Pneumologue ➝ Il soigne les poumons.
Pharmacien ➝ Il vend les médicaments.
Dentiste ➝ Il soigne les dents.
Oto-rhino-laryngologiste (ORL) ➝ Il soigne la gorge, le nez, les oreilles.
Dermatologue ➝ Il soigne la peau, mais aussi les cheveux et les ongles.
Activité 4
( 13
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
les ados : laura et ludo
•pages 10 et 11
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extra-poler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habituels ou non, en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
Objectifs Communication
– Comprendre une BD sur les problèmes de peau (français familier).
– Exprimer la douleur.
Linguistique
– Lexique La douleur.
Quelques expressions familières.
– Phonétique Groupe et rythme.
Socioculturel
La BD « Les ADOS Laura et Ludo ».
sensibilisation
Déroulement (3 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander : «Quel était le 4e conseil de base de médecine.com pour soigner l’acné ?». (Ne pas « tripoter » les boutons.)– Demander aux apprenants d’expliciter. (Ne pas toucher, percer, éclater…)– Demander : « Vous vous souvenez pourquoi il ne faut pas tripoter les boutons ? » (Parce qu’il y a un risque de surinfection et ça peut laisser un trou dans la peau.)
14 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1compréhension globale
Déroulement (1 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Faire identifier le document. (C’est une planche de bande dessinée [BD].)
Activité 1 • page 11
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants observer la BD. Poser les questions de l’activité en grand groupe.
Activité 2 • page 11
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Mise en commun, en grand groupe, à l’oral.
compréhension finalisée
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants de justifier leurs réponses. (Ludo n’est pas content du résul-tat : il trouve qu’il ressemble à Elephantman. Il trouve que la serviette est trop chaude : il dit que ça brûle. Laura pose un masque à Ludo : elle dit « je te pose un masque ». Elle trouve Ludo laid avec ses boutons : elle dit « beurk ». Elle retire les points noirs de Ludo : elle dit « je vais faire sortir tout ça », elle perce les boutons de Ludo, il a mal, elle lui dit qu’il est douillet. Laura propose à Ludo de lui faire un soin de visage : elle lui propose de lui enlever ses boutons et points noirs, de lui faire un masque apaisant comme ça il aura une peau nickel. Ludo trouve que la crème fait mal : il dit que ça pique.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré au fait !
Corrigé
L’histoire se passe chez des adolescents (Laura et Ludo), dans la salle de bain. Laura soigne l’acné de Ludo.
Activité 1
Corrigé
Ludo n’est pas content du résultat. ➝ vignette 9.Ludo trouve que la serviette est trop chaude. ➝ vignette 4.Laura pose un masque à Ludo. ➝ vignette 7.Laura trouve Ludo laid avec ses boutons. ➝ vignette 1.Laura retire les points noirs de Ludo. ➝ vignettes 5 et 6Laura propose à Ludo de lui faire un soin de visage. ➝ vignettes 2 et 3.Ludo trouve que la crème fait mal. ➝ vignette 8.
Activité 2
( 15
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
Activité 3 • page 11
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
a. Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Pour la mise en com-mun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
b.Procéder comme pour a.
Activité 4 • page 11
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
a. Lire la première consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Pour la mise en commun en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
b.Lire la seconde consigne et faire l’activité.
Production orale
Activité 5 • page 11
Déroulement (30 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Pour la mise en commun en grand groupe, quelques groupes jouent devant la classe. Demander aux autres élèves de prendre des notes sur la position du corps, la gestuelle, le ton et l’effet comique de chaque groupe pour en rendre compte après la passation.
Corrigé
a. Beaucoup de ➝ plein deSuperbe, parfaite ➝ nickelJe ne suis pas ➝ ch’uis pasTu es ➝ t’esUne fille ➝ une nana
b. On a mal ➝ aïe !, ouille !On trouve quelque chose laid ou mauvais ➝ beurk !On veut de l’aide (SOS) ➝ au secours !
Activité 3
Corrigé
a. Ça pique : C, D, F.Ça brûle : A, B, E.
b. Ça pique : une fourchette, une araignée, un scorpion…Ça brûle : un four, une casserole sur le feu, une allumette allumée…
Activité 4
16 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un dialogue.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.1. Clémence demande à Aude comment elle va. /1Vrai w Faux w On ne sait pas w
2. Clémence ne va pas très bien. /1Vrai w Faux w On ne sait pas w
3. Clémence est allée voir : (2 réponses) /2w un dermatologuew un généralistew un dentistew un ophtalmologiste
4. Clémence est heureuse car elle va porter des lunettes. /1Vrai w Faux w
5. Qui dit quoi ? /4
Clémence Aude
Les lunettes donnent un air intelligent
Les lunettes doublent le nombre d’yeux
Les lunettes permettent d’avoir des yeux encore plus beaux
Les lunettes sont un accessoire de mode
6. Clémence va aussi porter un appareil dentaire /1Vrai w Faux w On ne sait pas w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Quand l’hygiène a des effets négatifs !
D’après une étude récente, les enfants européens souffriraient de plus en plus d’eczéma. Elle affecterait entre 12% et 20% des jeunes, selon les pays européens. Cette maladie se manifeste par un dessèchement de la peau, des rougeurs et des irritations.Or, les scientifiques constatent que cette maladie de peau n’est pas fréquente dans les pays pauvres, où les enfants vivent dans des conditions d’hygiène moins développées. Les enfants des pays riches, en étant moins exposés aux microbes, développeraient moins d’infections et leur système immunitaire serait moins bien entraîné à se protéger et à se défendre contre les maladies. L’eczéma serait une des manifestations de ce mauvais fonctionnement en relation avec un niveau d’hygiène très élevé.Les chercheurs ont constaté que les enfants européens qui ont des animaux ou vivent à la campagne sont moins touchés par l’eczéma car ils ont été plus exposés aux microbes.Conclusion : être propre oui, mais pas trop !
( 17
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
test d’évaluation type DELF B11. D’où vient cet article ? /1……………………………………………………
2. Il parle : /1w d’une maladie oculairew d’une maladie dermatologiquew d’une maladie osseuse
3. La moitié des jeunes en Europe souffrent de cette maladie. /1Vrai w Faux w
4. Quels sont les trois symptômes de cette maladie ? /31 : …………………………….2 : …………………………….3 : …………………………….
5. L’eczéma affecte surtout les jeunes des pays riches. /1Vrai w Faux w
6. L’eczéma est dû à : /1w une hygiène très élevée w une exposition aux microbes dans l’enfance w aux animaux
7. Le système immunitaire c’est : /2w une hygiène très développée w une protection contre les microbes w une maladie des enfants des pays riches
Production écrite : /10
Lis le mail et réponds à Jerry pour lui donner des conseils sur ce qu’il faut faire et ne pas faire. (50 mots)
Exercice en interaction : /10
Tu dois simuler un dialogue avec le professeur ou un(e) camarade afin de résoudre une situation de la vie quotidienne.
Sujet : Un(e) camarade à toi souffre d’un problème d’eczéma : tu lui dis ce que tu as appris sur cette maladie de peau et lui donne quelques conseils.
Salut ThierryComment vas-tu ? Je suis très heureux que tu sois mon correspondant et j’ai vraiment apprécié de te rencontrer.J’ai besoin de ton aide : comme tu l’as sûrement remarqué, j’ai un problème d’acné. Toi, tu n’as pas de bouton ! Explique-moi comment tu fais, s’il te plaît…
Jerry
18 )18 )
Comprendre une interaction entre locuteurs natifs : peut généralement sui-vre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa présence.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habituels ou non, en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
qu’eSt-ce qu’on mange ?
•pages 12 et 13
Objectifs Communication
– Commander à la cantine, au restaurant.
– Proposer/demander quelque chose à quelqu’un.
– Exprimer la quantité.
Linguistique
– Grammaire L’expression de la quantité : les adjectifs numéraux et partitifs, les adverbes de quantité.
Le pronom en.
– Lexique La nourriture.
Les repas.
La composition des menus.
– Phonétique L’accent d’insistance.
Socioculturel
– Les ados et l’alimentation.
– La cantine.
– Les repas.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Nicolas : Agathe, qu’est-ce qu’il y a à manger aujourd’hui ? J’ai faim !AGathe : Tu n’as pas vu le menu ? Du steak avec des frites ou des haricots verts.Nicolas : Ah ! encore des haricots verts ! Je déteste la cantine ! Le cuisinier : Bonjour ! Qu’est-ce que vous prenez aujourd’hui ?AGathe : Bonjour, monsieur ! Un steak avec des haricots verts, s’il vous plaît.Le cuisinier : Et toi ?Nicolas : Moi, pas de haricots verts, je n’en veux pas ! Je voudrais des frites avec mon steak.Le cuisinier : Bon un steak-frites, voilà !Nicolas : Euh... je peux en avoir un peu plus, s’il vous plaît ?Le cuisinier : Eh bien ! Tu as de l’appétit quand il y a des frites ! Ça va, là ?Nicolas : Je peux en avoir encore un peu ?Le cuisinier : Tu en as assez, ça suffit !Nicolas : Pff... Et comme dessert, je vais prendre une mousse au chocolat.AGathe : Moi, je préfère un fruit, je prends une pomme. Dis donc, il n’est pas très équilibré ton repas, c’est pas bon pour la santé !Nicolas : Arrête ! On dirait ma mère !AGathe : Il y a deux places à la table de Marie, on y va ?Nicolas : Oh, oui ! Salut, Marie ! Bon appétit !Marie : Salut, Nicolas ! Merci ! Bon appétit à toi aussi ! Ouh ! tu as beaucoup de frites, tu m’en donnes ?Nicolas : Euh...
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2 L’appétit vient en mangeant
( 19
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
( 19
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2– Faire observer la photo et demander : « Qui vous voyez ? Où sont-ils ? Que font-ils ? ». (Des collégiens avec des plateaux à la cantine choisissent leurs plats. Il y en a un qui montre un plat de frites. Une personne les sert.)– Demander : « Il y a une cantine dans votre collège/lycée ? Vous y mangez ? Vous trouvez que la nourriture est bonne ? ». (Réponses libres.)
compréhension globale
Activité 1 • page 12
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. – Demander : « Vous avez entendu combien de personnes et qui ? » (Quatre personnes. Nicolas et Agathe, deux collégiens, une troisième collégienne (Marie) et la personne qui sert : le cuisinier).
1.Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.
2.Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.
Activité 2 • page 12
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Les apprenants font l’activité a. individuellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Mise en commun en grand groupe, à l’oral.– Lire la consigne b. et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant demande à des élèves de venir au tableau entourer les mots qu’il aura au préalable écrits.– Demander : « Que dit Nicolas à Agathe quand il arrive à la cantine ? ». (Il lui demande ce qu’il y a à manger et il dit qu’il a faim.)– Demander : « Que dit Agathe à Nicolas sur l’eau ? ». (Que l’eau c’est très bien quand on a soif.)– Demander : « Que se disent les collégiens avant de commencer à manger ? ». (Bon appétit.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré les mOts des… repas.
Corrigé
1.À la cantine du collège.
2.À midi.
Activité 1
Corrigé
a. Sur le plateau d’Agathe : B / E / D / F.Sur le plateau de Nicolas : A / G / C / F.
b.En vert : A, B.En rouge : E, F.En noir : C, D.
Activité 2
20 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2compréhension finalisée
Activité 3 • page 12
Déroulement (20 min)
Compétences travaillées : compréhensions orale et écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement de manière séquencée pour que les élèves aient le temps de noter les phrases. Ils travaillent individuellement puis comparent avec leur voisin(e) en vérifiant dans le dialogue. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Demander de relever les mots qui expriment la quantité dans ces phrases et les entou-rer au tableau. (« un peu plus », « un peu », « assez », « beaucoup »)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : exprimer la quantité (rappel) et reformuler les règles.– Demander : « Dans les questions de Nicolas, la réponse du cuisinier et la question de Marie, quel mot nous permet de savoir qu’il parle des frites ? » (« Les frites » est rem-placé par en.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : indiquer la quantité / le pronom en et reformuler les règles.– Demander de lire le dialogue et de relever les expressions pour commander et celles pour demander quelque chose. (Pour commander : Qu’est ce que vous prenez aujourd’hui ?– Un steak avec des haricots verts, s’il vous plaît.– Je voudrais des frites avec mon steak.– Je peux en avoir un peu plus, s’il vous plaît ?– Je vais prendre une mousse au chocolat.– Je prends une pomme.Pour demander : Tu m’en donnes ?)– Demander aux apprenants de prendre connaissance des encadrés les expressiOns pOur commander à la cantine, au restaurant et les expressiOns pOur proposer/demander quelque chose à quelqu’un et reformuler les règles d’utilisation des expressions.
exercice
Activité 4 • page 13
Déroulement (15 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants travailler par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Corrigé
a. Vrai : Je peux en avoir un peu plus s’il vous plaît ?Je peux en avoir encore un peu ?
b.Le cuisinier lui ajoute des frites une seule fois (Je peux en avoir encore un peu ? / Tu en as assez, ça suffit !).
c.Vrai : Tu as beaucoup de frites, tu m’en donnes ?
Activité 3
Corrigé
1. Oui, j’en veux.2. Non, je n’en veux pas.3. Oui, j’en veux plus.4. Oui, je vous en donne.
Activité 4
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
( 21
Production orale
Activité 5 • page 13
Déroulement (5 min)
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement.
Activité 6 • page 13
Déroulement (25 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en sous-groupes de trois et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants travailler en sous-groupes : ils choisissent leur repas, et mettent en place le dialogue. Pour la mise en commun, demander à quelques groupes de jouer devant la classe. Les autres prennent des notes sur les points positifs et les points négatifs de la production : le choix du menu, les expressions pour commander, l’utilisation de « en ». Après la passation, interroger la classe sur ce qui a été remarqué et procéder à des corrections si nécessaire.
Lire pour s’informer et discuter : – peut reconnaître les points significatifs d’un article direct et non complexe sur un sujet familier ;– peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un pro-blème ;– peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habi-tuels ou non, en relation avec ses intérêts ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
la crISe d'ado au menu
•pages 14 et 15
22 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2Objectifs
Communication
– Comprendre une campagne institutionnelle sur la santé et l’alimentation. (1. site internet)
– Donner une limite.
– Organiser le discours (3) : exprimer l’opposition/la concession.
Linguistique
– Grammaire Les articulateurs logiques : pourtant, or, contrairement à
Le pronom en.
– Lexique La nourriture.
Les repas.
La composition des menus.
– Phonétique L’accent d’insistance.
Socioculturel
– Les ados et l’alimentation.
– Les règles d’une alimentation équilibrée.
– Les repas.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Qui décide ce que vous mangez : vous ou vos parents ? Votre régime ali-mentaire crée-t-il des disputes entre vous et vos parents ? Pourquoi ? » (Réponses libres.)
compréhension globale
Déroulement (2 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
Faire identifier le document. (C’est une page web.)
Activité 1 • page 14
Déroulement (3 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de répondre aux deux questions de l’activité.
Corrigé
C’est une page du site mangerbouger.fr. Son thème est l’alimentation des adolescents.
Activité 1
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
( 23
Activité 2 • page 14
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux, en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants lire individuellement. Ils font ensuite l’activité et comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Mettre en commun en grand groupe, à l’oral.
Activité 3 • page 14
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en com-mun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Activité 4 • page 14
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Poser la question et laisser les apprenants rechercher l’information par deux.– Demander : « Quelle est la différence ? »– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Les mots des... fruits et légumes.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue.
– Demander : « Est-ce que tout le monde sait que c’est bon pour la santé de manger des fruits et légumes surgelés ou en conserve ? ». (Non, le texte dit « contrairement aux idées reçues ».)– Demander : « Qu’est-ce qu’il y a entre les idées reçues et la réalité ? ». (Les idées reçues sont le contraire de la réalité, c’est une opposition.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : Organiser le discOurs (3) / exprimer l’opposition et la concession et reformuler la règle.
Corrigé
1. Aux ados et aux parents.2. Des conseils.
Activité 2
Corrigé
Les repas de la journée :– le matin ➝ le petit déjeuner ;– le midi ➝ le déjeuner ;– l’après-midi ➝ le goûter ;– le soir ➝ le dîner.
Activité 3
24 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
Production orale
Activité 5 • page 15
Déroulement (25 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Ils font l’activité en interaction et prennent des notes pour retransmettre à la classe ce que l’autre répond.
Activité 6 • page 15
Déroulement (30 min)
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de travailler en sous-groupes. Ils font d’abord l’enquête au sein de leur sous-groupe. Puis, les sous-groupes s’inter-rogent mutuellement. Chaque sous-groupe est alors en possession des résultats de toute la classe et peut faire un tableau pour les présenter. Pour la mise en commun, en grand groupe, chaque groupe présente les résultats trouvés.– Il est possible de demander aux apprenants, au moment de l’enquête, de différencier les réponses des filles et celles des garçons.
Exemple de tableau :
Garçons Filles Ensemble
Mangent au minimum 5 fruits et légumes par jour.
Mangent moins de 5 fruits et légumes par jour.
Mangent des fruits au petit déjeuner.
Mangent des légumes au petit déjeuner.
Les deux fruits et les deux légumes préférés de la classe :
Les deux fruits et les deux légumes les moins aimés dans la classe :
Production écrite
Déroulement (25 min)
Modalités : individuellement ou par deux.
On peut ensuite demander aux apprenants de rédiger un article pour présenter l’enquête et ses résultats par deux en classe ou individuellement en dehors de la classe.
( 25( 25
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 3 ou 4 minutes Préparation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un reportage radio.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. Ce reportage annonce une action pour une alimentation saine. /1Vrai w Faux w
2. La Fraîch’attitude dure : /1w un jourw une semainew un mois
3. Cette campagne incite à consommer quels aliments ? /2………………………………………
4. En plus de la dégustation de fruits et légumes, qu’est-ce qui est proposé par cet événement ? /21. ………………………………………2. ………………………………………
5. La Fraîch’attitude c’est : /1w boire du soda et manger des barres chocolatées w acheter des plats cuisinés w manger des fruits et légumes frais
6. Les publicités de l’industrie alimentaire défendent une alimentation saine. /1Vrai w Faux w
7. Le reportage parle de deux autres campagnes en plus de la Fraîch’attitude. /1Vrai w Faux w
8. La Fraîch’attitude s’adresse : /1w aux enfantsw aux parentsw aux enfants et aux parents
Compréhension de l’écrit : /10
Lis la présentation suivante puis réponds aux ques-tions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
SemaineFraich’attitudeLa semaine Fraîch’attitude, qui mobilise des
professionnels de l’alimentation et de la restauration, des municipalités et des écoles, vous propose de redécouvrir le plaisir de cuisiner pour
réconcilier le goût, la convivialité et la santé.
Participez à la semaine Fraîch’attitude pour :– redécouvrir les fruits et légumes frais
– apprécier leur diversité, le plaisir de les savourer et de les cuisiner
– lutter contre l’obésité– contribuer à l’amélioration des comportements
alimentaires des enfants et des plus grands.
26 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2
test d’évaluation type DELF B1
Avoir la Fraîch’attitude c’est :– un état d’esprit, qui associe le plaisir de manger
et la santé, mais ce n’est absolument pas un régime
– composer la moitié de son repas avec des fruits et légumes frais.
– le matin, associer des fruits aux tartines et produits laitiers
– le midi et le soir, commencer le repas par des crudités ou une soupe, accompagner la viande ou le poisson de légumes, prendre un fruit en dessert.
Source : http://www.fraichattitude.com/
1. La semaine Fraîch’attitude a lieu en France : /1w en automnew en hiverw au printempsw en été
2. Qui se mobilise pour cet événement ? /31. ………………………………………2. ………………………………………3. ………………………………………
3. Pour avoir la Fraîch’attitude, il faut : /31. faire un régimeVrai w Faux w
2. composer la majorité de son repas avec des fruitsVrai w Faux w
3. manger des fruits à chaque repasVrai w Faux w
4. Quels conseils sont donnés pour : /3– le petit-déjeuner : …………………………………….………………………………………………………– le déjeuner et le dîner : ……………………………………………………………………………………
Production écrite : /10
En vacances en France, tu as participé à la semaine Fraîch’attitude. Écris une carte postale à tes parents pour leur raconter ce que tu as fait et ce que tu en penses. (40 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu dégages le thème soulevé par le document et tu présentes ton point de vue sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
« Que ton aliment soit ta seule médecine ! »
(Hippocrate)
SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
( 27( 27
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extra-poler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
la santé vient en mangeant
•pages 16 et 17
Ventre affamé n’a point d’oreille
Objectifs Communication
– Comprendre une campagne institutionnelle sur la santé et l’alimentation (affiche).
– Exprimer la manière.
– Comprendre des affiches de sensibilisation aux problèmes alimentaires.
– Comprendre des données sociologiques sur des problèmes alimentaires.
Linguistique
– Grammaire Le gérondif.
– Lexique L’alimentation.
– Phonétique La lecture à voix haute.
Socioculturel
– Les problèmes alimentaires dans le monde.
– Les associations de lutte contre la faim.
sensibilisation
Déroulement (3 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Pourquoi c’est important de faire attention à son alimentation, de manger des fruits et légumes, de ne pas manger trop de matières grasses, de produits sucrés ? ». (Pour ne pas grossir, pour être en forme, en bonne santé.)
28 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3ÉvaluationÉvaluation
28 )
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3compréhension globale
Activité 1 • page 16
a. Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et faire l’activité, en grand groupe, à l’oral.
compréhension finalisée
b. Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note la réponse donnée par les élèves au tableau.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue– Demander : « Comment est exprimée la manière d’être en bonne santé ? ». (Par en + verbe au participe présent.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : exprimer la manière : le gérondif et reformuler la règle.
exercice possible
Voir Évaluation p. 29, exercice 7.
Production écrite
Activité 2 • page 16
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en com-mun, en grand groupe, l’enseignant peut accrocher les affiches dans la classe et procéder à un vote pour choisir les meilleures.
Corrigé
a. C’est une affiche pour une campagne sur l’alimentation et la santé, sur la nutrition. Elle est composée d’un slogan et d’un visage représenté avec des fruits et légumes : une tranche de melon, un citron, de la mâche (salade)…
b. Pour être en bonne santé il faut manger équilibré.
Activité 1
Production écrite
Activité 3 • page 16
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler en sous-groupes. L’activité peut se faire en partie en-dehors de la classe (recherche de photos, réalisation de des-sins) et en partie dans la classe (réflexion pour trouver des solutions, rédaction à l’aide de l’encadré POUR VOUS AIDER, fabrication de l’affiche). Pour la mise en commun, les affiches peuvent être accrochées dans la classe et présentées par chaque sous-groupe.
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
Le Malade imaginaire de Molière, Extrait de la scène 10, acte 3.Toinette : Qui est votre médecin ?ArGan : Monsieur Purgon.Toinette : Cet homme-là n’est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ?ArGan : Il dit que c’est du foie, et d’autres disent que c’est de la rate.Toinette : Ce sont des ignorants ! C’est du poumon que vous êtes malade.ArGan : Du poumon ?Toinette : Oui. Que sentez-vous ?ArGan : Je sens de temps en temps des douleurs de tête.Toinette : Justement, le poumon.ArGan : Il me semble parfois que j’ai un voile devant les yeux.Toinette : Le poumon.ArGan :J’ai quelquefois des maux de cœur.Toinette : Le poumon.ArGan : Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.Toinette : Le poumon.ArGan : Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c’était des coliques.Toinette : Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ?ArGan : Oui, Monsieur.Toinette : Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ?ArGan : Oui, Monsieur.Toinette : Le poumon….Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai en cette ville.ArGan : Vous m’obligerez beaucoupToinette : Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt. [...] Jusqu’au revoir.
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : peut com-prendre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet est d’intérêt personnel et la langue standard claire-ment articulée.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extra-poler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
le malade imaginaire
•pages 17 et 18
Objectifs Communication
– Comprendre un extrait du Malade imaginaire de Molière.
Linguistique
– Lexique La langue de Molière.
– Phonétique La lecture à voix haute.
Socioculturel
– Molière.
( 29( 29
30 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
Corrigé
C’est l’extrait de la pièce de théâtre « Le Malade imaginaire », de Molière. Un faux médecin (la servante, Toinette) parle avec un malade (Argan) de sa maladie et du traitement pour le soigner.
Activité 1
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants d’observer l’extrait du « Malade imaginaire » de Molière et demander : « À votre avis, qu’est-ce que c’est ? C’est ancien ou moderne ? ». (C’est un dialogue, peut-être de pièce de théâtre…)– Demander : « Vous connaissez des auteurs classiques de pièce de théâtre français ? ». (Réponses variables.) – Si les apprenants ne citent pas Molière, l’écrire au tableau et demander s’ils le connaissent. (Réponses variables.)– L’enseignant peut demander aux apprenants de faire des recherches sur Molière pour le présenter lors de la séance suivante.
compréhension globale
Activité 1 • page 18
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. – Poser les questions de l’activité en grand groupe.
compréhension finalisée
Activité 2 • page 18
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité individuellement. Ils com-parent ensuite leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données par les élèves au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Corrigé
Activité 2
Rate
Cœur
Yeux
Tête
Poumon
Foie
Ventre
Membres
SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
( 31
Activité 3 • page 18
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux.
– Inviter les apprenants à lire le dialogue. Leur demander de le mémoriser et de le jouer devant la classe.– Variante: demander aux apprenants de varier les symptômes et les conseils du dialogue avant de jouer les dialogues.
Activité 4 • page 18
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale, compréhension écrite
Modalités : par deux et en grand groupe
– Lire la consigne et demander aux apprenants de répondre aux questions en travaillant avec leur voisin.– Mettre en commun en grand groupe.
Activité 5 • page 18
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale
Modalités : par deux
– Lire la consigne et demander aux apprenants d'imaginer le dialogue. Réponses libres.
Corrigé
Madame Alain est pâle. Elle a mal à la tête, elle tousse et elle a le nez qui coule. Elle a aussi mal au dos, mais ce n'est pas grave. Elle doit prendre du thé, de l'aspirine, de la vitamine C et de se reposer.
Activité 4
Pour votre information
Moli ’ereDe son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en 1622. il est le fils d’un marchand tapissier, fournisseur officiel de la cour. En 1640, il suit des études de droit pour devenir avocat et est reçu en 1641, mais finalement décide, contre l’avis de son père, de devenir comédien. il fonde la compa-gnie théâtrale l’illustre-théâtre et prend le nom de Molière.il quitte Paris pour parcourir l’ouest et le sud de la France pendant plus de treize ans.En 1655, Molière écrit sa première pièce de théâtre connue, l’Étourdi, jouée à Lyon. Puis, en 1656, le Dépit amoureux qui est créé à Béziers. Molière rentre à Paris en 1658, fort d’une double expérience d’acteur comique et d’auteur dramatique. il reçoit la protection de Monsieur, le frère du roi. il connaît alors un grand succès qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie, en 1673.
32 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3Œuvres Dates de création
Le Médecin volant (farce) 1645La Jalousie du barbouillé (farce) 1650L’étourdi ou les contretemps 1655Le Dépit amoureux 1656Le Docteur amoureux 1658Les Précieuses ridicules 1659Sganarelle ou le cocu imaginaire 1660Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux 1661L’école des maris 1661Les Fâcheux 1661L’école des femmes 1663La Jalousie du Gros-René 1663La critique de l’école des femmes 1663L’impromptu de versailles 1663Le Mariage forcé 1664Gros-René, petit enfant 1664La Princesse d’élide 1664tartuffe ou l’imposteur 1664Dom Juan ou le Festin de pierre 1665L’Amour médecin 1665Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux 1666Le Médecin malgré lui 1666Mélicerte 1666Pastorale comique 1667Le Sicilien ou l’Amour peintre 1667Amphitryon 1668George Dandin ou le Mari confondu 1668L’Avare ou l’école du mensonge 1668Monsieur de Pourceaugnac 1669Les Amants magnifiques 1670Le Bourgeois gentilhomme 1670Psyché 1671Les Fourberies de Scapin 1671La comtesse d’Escarbagnas 1671Les Femmes savantes 1672Le Malade imaginaire 1673
SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
( 33
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extra-poler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Production écrite générale :– peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
fondant au chocolat
•page 19
Objectifs Communication
– Comprendre une recette de pâtisserie.
Linguistique
– Lexique La cuisine / la pâtisserie : l’électroménager, les ustensiles, les actions.
– Phonétique La lecture à voix haute.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Vous faites la cuisine ? Qu’est-ce que vous cuisinez ? » (Réponses libres.)
compréhension globale
Activité 6 • page 19
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Faire identifier le document en grand groupe. (C’est la recette d’un gâteau au chocolat.)– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité individuellement. Ils comparent ensuite leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun en grand groupe, l’enseignant note les réponses données par les élèves au tableau.
Corrigé
De haut en bas et de gauche à droite : 8 / 2 / 5 / 63 / 4 / 910 / 1 / 7
Activité 6
34 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 3 ou 4 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un dialogue.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. C’est un dialogue entre : /1
w Vincent et une camarade de classe
w Vincent et sa mère
w Vincent et un professeur
2. Vincent s’est ennuyé à l’école. /1Vrai w Faux w
3. Il a visité une exposition sur quel fruit ? /24. Vincent donne des informations sur ce fruit. Lesquelles ? /4w Sa couleurw Son prixw Son goûtw Ses qualités nutritionnellesw Sa provenancew Sa forme
5. La culture de ce fruit est très importante. /1Vrai w Faux w
6. Vincent ne veut pas manger ce fruit tous les jours. /1Vrai w Faux w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Tout le monde aime le chocolat !
Le chocolat est consommé et apprécié dans le monde entier. En France, c’est la boisson préférée des enfants le matin, puisque plus de 60% des 4-10 ans en boivent. Presque 95% des Français consomment du chocolat, mais nous l’apprécions différemment : noir, au lait ou blanc ; liquide ou solide ; chaud ou froid ; seul ou cuisiné.Selon les pays, les différences sont encore plus grandes : si en France, nous le préférons en tablette, en Angleterre, il est surtout consommé dans des spécialités à base de chocolat comme des barres à la menthe enrobées d’un chocolat au lait très sucré. Dans le nord de l’Europe, le chocolat est un aliment quotidien. Les Allemands et les Belges mangent du chocolat toute l’année et le préfèrent dur mais crémeux. Les Suisses consomment 9 kg de chocolat par an et par personne ! Dans le sud de l’Europe, en Espagne par exemple, on le préfère sous forme de boisson ou de pâte à tartiner.
1. C’est un article sur les différentes manières de cuisiner le chocolat. /1Vrai w Faux w
2. Seuls les Européens mangent du chocolat. /1Vrai w Faux w
( 35( 35
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3
test d’évaluation type DELF B13. En France, la majorité des enfants boivent du chocolat le matin. /1Vrai w Faux w
4. Quels sont les différences : /3,51. de goût / couleur : – ………………………………………– ………………………………………– ………………………………………2. de consistance :– ………………………………………– ………………………………………3. de température :– ………………………………………– ………………………………………
5. Les Européens du nord ne mangent pas beaucoup de chocolat. /1Vrai w Faux w
6. Qui le préfère comment ? /2,5
Liquide Solide On ne sait pas
Les Français
Les Allemands
Les Belges
Les Suisses
Les Espagnols
Production écrite : /10
Tu as lu cet extrait d’article et tu souhaites réagir : tu écris une lettre au courrier des lecteurs de TchatMag pour expliquer cette situation et dire ce que tu en penses. (60 mots)
Exercice en interaction : /10
Tu dois simuler un dialogue avec le professeur ou un(e) camarade afin de résoudre une situation de la vie quotidienne.
Sujet : Tu as mangé trop de chocolat. Tu vas chez le docteur et lui expliques comment tu te sens.
Tout le monde aime le chocolat !
Le chocolat est consommé et apprécié dans le monde entier. En France, c’est la boisson préférée des enfants le matin, puisque plus de 60% des 4-10 ans en boivent. Presque 95% des Français con-somment du chocolat, mais nous l’apprécions différemment : noir, au lait ou blanc ; liquide ou solide ; chaud ou froid ; seul ou cuisiné.Selon les pays, les différences sont encore plus grandes : si en France,
Le Journal des jeunes
La fin des plats cuisinés à la maison ?Une enquête sur l’alimentation a montré que les Français mangent de plus en plus de produits prêts à consommer, en conserve, surgelés ou à emporter.
Selon les pays, les différences sont encore plus grandes : si en France, nous le préférons en tablette, en Angleterre, il est surtout consommé dans des spécialités à base de chocolat comme des barres à la menthe enrobées d’un chocolat au lait très sucré. Dans le nord de l’Europe, le chocolat est un aliment quotidien. Les Allemands et les Belges mangent du chocolat toute l’année et le préfèrent dur mais crémeux. Les Suisses consomment 9 kg de chocolat par an et par personne ! Dans le
chocolat comme des barres à la menthe enrobées d’un chocolat au lait très sucré. Dans le nord de l’Europe, le chocolat est un
consomment 9 kg de chocolat par an et par personne ! Dans le sud de l’Europe, en Espagne par exemple, on le préfère sous forme
aliment quotidien. Les Allemands et les Belges mangent du chocolat toute l’année et le préfèrent dur mais crémeux. Les Suisses
Coupure journal.indd 1
18/06/09 14:01:09
Le projet, par son résultat concret à obtenir, constitue l’approche
actionnelle du module.
Le projet reprend tous les objectifs du module, toutes les compétences
travaillées à travers une série de tâches contextualisées à réaliser,
lors desquelles les apprenants vont être amenés à interagir.
Le projet s’articule en trois parties : une mise en route pour permettre
aux apprenants d’entrer dans la thématique et présenter le projet
qu’ils vont réaliser ; une activité de réception pendant laquelle ils
vont (re)mobiliser les moyens linguistiques et fonctionnels nécessaires
à la réalisation du projet et se placer dans le contexte situationnel ;
la réalisation du projet lui-même lors de laquelle chaque groupe tra-
vaillera en autonomie guidée.
Le temps imparti à chaque étape n’est qu’une estimation et peut, bien
entendu, varier selon les classes.
•pages 20 et 21
z Mise en route– L’enseignant présente le projet : expliquer aux élèves qu’ils vont organiser un concours culinaire, « Super Sandwich », puis y participer.– En grand groupe, demander : « À votre avis, qu’allez-vous devoir réaliser pour parti-ciper à ce concours ? ». (Un sandwich.)– Demander : « Est-ce que c’est un repas équilibré et bon pour la santé ? ». (Ça dépend des ingrédients utilisés.)
36 )
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habi-tuels ou non, en relation avec son domaine ; – peut échanger, vérifier et confirmer des informations.
S’adresser à un auditoire : – peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps ; – peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était trop rapide.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
cadre de référence B1
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1 Tu organises et participes au concours « Super Sandwich »
( 37
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1
( 37( 37
– Demander à la classe : « À votre avis, quels vont être les choix importants que vous devrez faire pour organiser ce concours ? » et noter les réponses au tableau. (Décider les critères pour évaluer le sandwich, choisir les participants, le jury et la date du concours.)– Demander aux apprenants de se mettre en sous-groupes de trois ou quatre pour réa-liser la première partie du projet.
z 1re tâche : Réception d’informations sur la réalisation d’un sandwich
1re étAPE - 1 • page 20
Déroulement (15 min)
Compétences mises en œuvre : compréhension écrite et expression orale.
Modalités : individuellement, en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire individuellement la recette.– Leur demander ensuite de travailler en sous-groupes pour répondre aux questions de l'activité. Pour la mise en commun, en grand groupe, chaque sous-groupe désigne un secrétaire pour rendre compte de la discussion.
z 2e tâche : Organisation du concours
2e étAPE - 2 • page 21
Déroulement (15 min)
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser chaque sous-groupe faire l'activité. Pour la mise en commun, en grand groupe, demander s'ils ont trouvé d'autres critères pour évaluer le sandwich.– Procéder à un vote pour que la classe décide quels critères supplémentaires garder pour le concours.
z 3e tâche : Réalisation du sandwich
3e étAPE - 3 • page 21
Déroulement (1 heure)
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre.
a. Lire la consigne et demander aux apprenants de faire cette activité en dehors de la classe et de prévoir le matériel nécessaire pour la date du concours qui a été fixée précédemment. L’enseignant, de son côté, peut prévoir d’apporter quelques ustensiles… et de quoi faire le ménage après le concours !
b. Lire la consigne et laisser chaque équipe écrire la recette.
c. Chaque équipe présente son sandwich / sa recette au jury. Laisser le jury délibérer et noter les sandwiches.
38 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3ÉvaluationÉvaluation
•pages 22 et 23Modalités : individuellement.
Activité 1 • page 22
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 2 • page 22
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 3 • page 22
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Corrigé
1. C / 2. A./ 3. D / 4. B.
Activité 1
Corrigé
Le docteur :- C’est une brûlure bénigne.- Ouvrez la bouche.- Vous avez mal où ?- Vous devez manger moins de sucre.Le patient :- Est-ce que c’est une maladie contagieuse ?- Je ne suis pas douillet.- J’ai mal à la gorge.
Activité 2
Corrigé
1. Je fais un régime, pourtant/or/cependant je ne maigris pas.2. Contrairement à toi, je ne mange pas beaucoup de chocolat.3. Je n’aime pas cuisiner, pourtant/or/cependant je suis gourmande.4. La planète produit 110% des besoins alimentaires de l’humanité, pourtant/or/cependant 30 millions d’êtres humains meurent de faim chaque année.
Activité 3
( 39
SÉQUENCE 1SÉQUENCE 1SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 3SÉQUENCE 3ÉvaluationÉvaluation
Activité 4 • page 23
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 5 • page 23
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.
Activité 6 • page 23
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Corrigé
Menu jeune : - entrée : œufs durs mayonnaise,- plat : poulet rôti et frites,- dessert : mousse au chocolat.Menu « régime » :- entrée : salade de tomates,- plat : rôti de veau et haricots verts,- dessert : salade de fruits.
Activité 4
ExEmplEs dE réponsE
- Des fruits : Je n’en mange jamais.- Des légumes : J’en mange parfois.- De la viande : J’en mange souvent.- Du poisson : J’en mange parfois.- Du pain : J’en mange souvent.- Des bonbons : J’en mange parfois.- Des glaces : J’en mange parfois.- Des gâteaux : J’en mange parfois.
Activité 5
Corrigé
1. J’ai une belle peau en la nettoyant avec un gel spécifique ou un savon dermatologique.2. Je n’ai pas d’acné en achetant de bons produits en pharmacie.3. Je n’ai pas de trou en n’éclatant pas mes boutons.4. J’évite les carences en mangeant des fruits et légumes.5. J’aide à la constitution de mes os en faisant du sport.6. Je calme ma soif en buvant de l’eau.
Activité 6
( 39
42 )
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : peut géné-ralement suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa présence.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
Objectifs Communication
– Exprimer la fréquence.
– Organiser le discours (4) : exprimer l’opposition / la concession.
Linguistique
– Grammaire Les articulateurs logiques : par contre, malgré.
La fréquence : une fois par... ; tous les... ; chaque...
– Lexique L’argent.
– Phonétique Le [e] muet ou prononcé.
Socioculturel
– L’argent de poche.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer la photo et demander : « Qui vous voyez ? Où sont-ils ? Que font-ils ? ». (Sur la photo, on voit des jeunes assis sur un banc dans la cour de l’école. Ils parlent.)
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4 Au jour le jour
l’argent de poche
•pages 26 et 27- Franck : Qu’est-ce que vous faites ce week-end ?- Céline : Moi, pas grand-chose, j’ai plus d’argent. Enfin, j’ai de quoi me payer un chocolat chaud et c’est tout- émilie : Ça dépend de ce qu’on fait. Si vous venez chez moi, c’est bon, pas besoin d’argent.- mathilde : Combien vous avez d’argent de poche ?- Franck : Moi, mes parents me donnent 10 E tous les samedis.- Céline : C’est tout ? C’est pas grand-chose. Moi, j’ai 15 E tous les mercredis et parfois, quand le week-end arrive, j’ai plus rien malgré mes efforts pour économiser.- émilie : Ma mère me donne 20 E deux fois par mois et malgré mes dépenses en magazines, je m’en sors très bien.- Franck : Eh ! c’est pareil que 10 E tous les lundis ! Quand j’avais... 10 ans, je crois, ils me donnaient de l’argent une fois par mois ; mais je m’en sortais pas. Je pouvais pas gérer, c’était trop dur.- émilie : Pourquoi ?- Franck : Je dépensais tout assez vite, alors j’ai négocié ce nouveau système.
( 43
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4– Faire observer les illustrations : billets et pièces de monnaie, la carte de crédit et le distributeur et faire identifier chaque objet. Demander : « À votre avis, les jeunes parlent de quoi ? ». (Ils parlent d’argent.)– Demander : « Ils travaillent ? Ils gagnent de l’argent ? Qui leur donne de l’argent ? ». (Ils travaillent peut-être en dehors de l’école pour gagner de l’argent. S’ils ne travaillent pas, ce sont leurs parents qui leur donnent de l’argent.)– Demander : « À votre avis, comment ça s’appelle l’argent que donnent les parents ? ». (Réponses possibles : l’argent des jeunes, l’argent pour les loisirs, etc. Réponse atten-due : l’argent de poche.)
compréhension globale
Activité 1 • page 26
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire écouter l’enregistrement une première fois. Demander, en grand groupe, « Qui vous avez entendu ? ». (Les jeunes qui sont sur la photo. Il y a un garçon et trois filles.)– Lire la consigne et faire faire l’activité en grand groupe.
compréhension finalisée (1)
– Demander : « Que va faire Céline ce week-end ? ». Faire réécouter le début de l’en-registrement si nécessaire. (Elle dit qu’elle ne va pas faire grand-chose parce qu’elle n’a plus d’argent.)– Demander : « Comment les jeunes disent qu’ils n’ont pas assez d’argent ? ». Faire réécouter l’enregistrement si nécessaire. (Ils disent que ce n’est « pas grand-chose ».)– Demander aux élèves de prendre connaissance de l’encadré AU FAIT !
Activité 2 • page 26
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Dessiner la grille au tableau. Lire la consigne et faire écouter à nouveau l’enregistre-ment. Les apprenants font l’activité, individuellement, puis ils comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demander à des élèves de venir les noter.– Poser la première question en grand groupe.– Demander aux élèves de prendre connaissance de l’encadré les expressions pour… exprimer la fréquence.– Poser la deuxième question en grand groupe. (Réponse libre.)
Corrigé
1. Vrai. / 2. Vrai. / 3. Faux. / 4. Vrai.
Activité 1
Corrigé
Mathilde : 20 E, chaque semaine.Céline : 15 E tous les mercredis.Franck : 10 E tous les samedis.Emilie : 20 E deux fois par mois.C’est Mathilde qui en a le plus. Elle a 80 E par mois alors que Céline a 60 E par mois et Émilie et Franck ont 40 E par mois.
Activité 2
44 )
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4exercice
Activité 3 • page 27
Déroulement (15 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, à l’oral, interroger plusieurs groupes.
compréhension finalisée (2)
Activité 4 • page 27
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne. Les apprenants lisent le dialogue pour retrouver les phrases, puis comparent leurs réponses avec celles de leur voisin. Pour la mise en commun, en grand groupe, l'enseignant note les réponses au tableau.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue– Demander aux apprenants d'observer ces deux phrases et de dire, pour chacune, quelle est la relation entre la première et la deuxième partie (la deuxième partie n'est pas logique par rapport à la première).– Demander : « Quels mots marquent ces deux idées ? ». (malgré et même si)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Pour communiquer et structurer: organiser le discours (4).
Activité 5 • page 27
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demander à des élèves de venir les noter.
Production orale
Activité 6 • page 27
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
ExEmplEs dE produCtions
a. Moi, je fais du sport deux fois par semaine et elle, elle fait du sport une fois par semaine.
b.Moi, je tchate sur internet tous les jours et elle, elle tchate chaque week-end.
Activité 3
Corrigé
1. Quand le week-end arrive, j’ai plus rien malgré mes efforts pour économiser.2. Malgré mes dépenses en magazines, je m’en sors très bien.
Activité 4
Corrigé
1. Elle arrive à économiser malgré ses dépenses en vêtements.2. Céline dépense tous ce qu’elle a, par contre Émilie fait des économies.3. Franck ne sait pas gérer son budget, par contre Mathilde s’en sort très bien.
Activité 5
( 45
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire travailler les apprenants par deux. Pour la mise en commun, à l’oral, chaque apprenant rapportera ce que l’autre lui a dit. – Demander à la classe : « Écoutez vos camarades et relevez deux mots en relation avec l’argent de poche, une expression de la fréquence, une opposition et une conces-sion ».
un champion : grégory Coupet
• pages 28 et 29
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : – peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enre-gistrés ayant trait à un sujet courant prévisible ;– peut comprendre des expressions et des mots porteurs de sens relatifs à des domaines de priorité immédiate.
Compréhension générale de l’écrit : peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un voca-bulaire internationalement partagé.
Monologue suivi : peut décrire des activités passées et des expériences per-sonnelles.
cadre de référence a2
Objectifs Communication
– Situer dans le temps pour parler de soi.
– Exprimer l’antériorité dans le passé.
Linguistique
– Grammaire Le plus-que parfait
– Lexique Le football
Les mots tronqués (restau, pro)
– Phonétique [o] / [ô]
(livre de l’élève, page 89)
Socioculturel
– La place du football.
– La vie d’un champion de football.
Journaliste : Fils de gardien de but, c’était naturel pour toi d’occuper le même poste que ton père ?G. Coupet : Petit, j’étais un casse-cou sur le terrain, je courrais partout avec le ballon. Mais rapidement, j’ai pris du plaisir à être gardien. En 1992, l’année de mes 20 ans, j’ai signé mon premier contrat « pro », à Saint-Étienne. J’avais déjà une longue expérience derrière moi parce qu’on m’avait donné ma première paire de gants de gardien à 7 ans quand j’ai commencé à jouer et j’étais allé à plein de matchs.Journaliste : Gardien de but est-il vraiment un poste à part ?G. Coupet : Oui ! D’abord, pendant un match, le gardien est le seul à ne pas jouer au football. À la récré, quand j’étais petit, être gardien m’avait attiré parce que ça me permettait de me démarquer, de ne pas faire comme les autres.Journaliste : Pour la Coupe du Monde, il y a eu un grand suspense concernant celui qui garderait les buts des Bleus, Barthez ou toi. Comment as-tu vécu cela ?G. Coupet : Avant les matchs éliminatoires, ils avaient décidé que le meilleur du moment serait désigné. Et la Coupe du Monde, c’est sept rencontres, alors on n’était pas trop de deux pour relever ce défi.
46 )
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
46 )
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Modalités : en grand groupe.
Faire observer les photos et demander : « Qui vous voyez ? Que font-ils ? Vous les connaissez ? Qu’est-ce que vous connaissez d’eux ? » (Des footballeurs en train de s’entraîner. Fabien Barthez et Grégory Coupet sont gardiens de but.)
compréhension globale
Activité 1 • page 28
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Faire écouter l’enregistrement une première fois. Demander en grand groupe : « Quelle est la situation ? Qui vous avez entendu ? ». (C’est une interview. Un journaliste pose des questions à Grégory Coupet.)
a.Réaliser l’activité en grand groupe.
b.– Lire la consigne et faire écouter une deuxième fois l’enregistrement. Mettre en commun en grand groupe à l’oral.– Demander aux élèves de prendre connaissance de l’encadré au fait ! On a l’habi-tude de couper les mots. Elargir en demandant s’ils connaissent d’autres expressions. (Plusieurs réponses possibles : le métro, le vélo, le ciné, la fac, etc.)
Activité 2 • page 28
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de lire l’interview et de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun en grand groupe, l’enseignant note les réponses (il y en a plus de huit) au tableau en les organisant.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Culture & Compagnie.– Demander de trouver un titre pour les colonnes 2 et 3 du tableau ci-dessous et de compléter les trois colonnes avec d’autres mots.
Plusieurs réponses possibles :
Corrigé
L’équipeLe poste : le gardienLes BleusLes équipementsLe terrainLes butsLe ballonUne paire de gants de gardienLa compétitionLes matchsLes matchs éliminatoiresLes rencontresLa Coupe du Monde
Activité 2
Activité 1 (suite)
Corrigé
a.
1. Faux - 2. Vrai - 3. Vrai
b.
1. Il est gardien de but.2. Il est professionnel depuis 1992. Il a signé son premier contrat « pro » l’année de ses 20 ans.3. Il dit que le gardien est le seul à ne pas jouer au football et que ça lui permet de ne pas faire comme les autres, de se démarquer.
( 47
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
L’équipe Les équipements La compétition
11 joueurs : les attaquants, les défenseurs, les milieux de terrain
Le CapitaineZidane...
Le maillotLe shortLes chaussures à crampons...
La finaleL’arbitreLa mi-tempsLe penaltyLe match nul...
(Pour le vocabulaire en relation avec le football, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_football)
compréhension finalisée
Activité 3 • page 29
a. Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les élèves relever les informations par deux. Pour la mise en commun en grand groupe, l’enseignant note les réponses des élèves au tableau.
b. Déroulement (10 min)
Réflexion sur le fonctionnement de la langue.
Modalités : en grand groupe.
– L’enseignant trace au tableau une ligne représentant le temps et y place « J’avais déjà une longue expérience ». Demander aux élèves où ils situent « on m’avait donné ma première paire de gants de gardien à 7 ans » et « j’étais allé à pleins de matchs », avant ou après ? (Avant.)– Lire la consigne et demander aux élèves : « Comment les informations sont situées dans le temps ? ». (Grégory Coupet précise l’âge qu’il avait au moment des faits.)– Demander de trouver d’autres expressions dans l’interview. (« L’année de mes 20 ans » / « À la récré, quand j’étais petit »)– Demander de prendre connaissance de l’encadré On dit... Pour situer dans le temps quand on parle de soi.– Faire observer à nouveau la chronologie et demander : « Quel autre moyen il y a pour situer les informations dans le temps ? ». (Les informations actuelles sont au présent. Les informations passées sont au passé composé et à l’imparfait et les faits situés avant sont donnés avec un temps composé d’un auxiliaire conjugué à l’imparfait + le participe passé du verbe.)
Corrigé
a.
J’avais déjà une longue expérience derrière moi parce qu’on m’avait donné ma première paire de gants de gardien à 7 ans et j’étais allé à pleins de matchs.
Activité 3
48 )
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
Corrigé
A- 1. J’avais invité mes copains. - 2. Ma mère n’était pas contente. - 3. J’ai dû annuler ma fête.
B- 1. J’avais pris froid. - 2. J’étais malade. - 3. Je suis allé chez le médecin.
C- 1. Je n’avais pas compris. - 2. Je n’ai pas fait mes exercices. - 3. J’ai une mauvaise note.
Activité 5
ExEmplE dE produCtion
Quand j’étais petite, je faisais de la gymnastique. J’avais commencé par faire de l’escrime mais ça ne me plaisait pas. Dans le gymnase, il y avait aussi des cours de gymnastique et j’ai demandé à ma mère d’arrêter l’escrime pour faire de la gymnastique. Elle a accepté. À 10 ans, j’ai fait ma première compétition et je suis arrivée 21e ! À 11 ans, j’ai fait ma deuxième compétition et je suis arrivée 1re ! J’avais beaucoup travaillé et j’avais fait beaucoup de progrès. L’année de mes 15 ans, j’ai dû arrêter ce sport parce que j’étais tombée et je m’étais blessée pendant une compétition.
Activité 6
Activité 4 • page 29
Déroulement (5 min)
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.– Demander de prendre connaissance de l’encadré Grammaire et reformuler la règle d’utilisation et de formation. Faire noter que les règles pour les auxiliaires au plus-que-parfait sont les mêmes que celles du passé-composé.
exercice
Activité 5 • page 29
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les élèves faire l’exercice par deux. Pour la mise en commun en grand groupe, l’enseignant note les réponses au tableau.
Production orale
Activité 6 • page 29
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux : chacun raconte un souvenir à l’autre. Pour la mise en commun en grand groupe, les élèves racontent le souvenir d’un autre.
Corrigé
J’avais connu beaucoup de joueurs. ➝ ConnaîtreJ’avais parlé avec mes parents. ➝ ParlerJ’étais tombé amoureux du foot. ➝ TomberJ’avais beaucoup réfléchi avant de décider d’être gardien de but. ➝ Réfléchir
Activité 4
( 49
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
Test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un reportage radio.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.1. Ce reportage parle de l’argent dépensé par les Européens pour leurs enfants. /1Vrai w Faux w
2. Quelle est la proportion de parents en Europe ? /1w 25% w 40% w 50%
3. Quel est l’ordre des dépenses des parents en Europe, du plus important au moins important ? Numérote de 1 à 3. /3- éducation : ………….
- vêtements : ………….
- alimentation : ………….
4. En Europe, ce sont les Français qui donnent le plus d’argent de poche à leurs enfants. /1Vrai w Faux w
5. En Europe, qui reçoit combien ? /2- Entre 5 et 10 ans : ………….
- Entre 11 et 14 ans : ………….
- Entre 15 et 17 ans : ………….
- Entre 18 et 20 ans : ………….
6. Peu de parents européens mettent de l’argent de côté pour leurs enfants. /1Vrai w Faux w
7. Dans quel pays les parents mettent le plus d’ar-gent de côté pour leurs enfants ? /1w en France w en Allemagne w en Espagne
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
LYCEE’MAG.COMLes loisirs des jeunes Honfleurais
Selon notre sondage, réalisé en mars 2009 à Honfleur, on constate que la majorité des adoles-cents de 16 à 18 ans sortent le mercredi, le ven-dredi et le samedi. Il est intéressant de noter que ceux qui sortent le mercredi et le vendredi sont, majoritairement, les élèves du lycée professionnel. Cela signifie peut-être qu’ils ont plus de temps libre que les élèves du lycée général qui ont beau-coup de devoirs en dehors de l’école.En ce qui concerne la pratique d’un sport, la plupart des jeunes Honfleurais déclarent faire du basket. Cependant, nos chiffres sont sûrement un peu faussés par le fait que nous avons interrogé des personnes appartenant à une équipe de basket pour avoir davantage de réponses. Nous observons que 62% des élèves du lycée général font du sport, contre 41% des élèves du lycée profession-nel, qui déclarent ne pas en faire par manque de motivation (30%) ou simplement par manque de temps (15%).
50 )
SÉQUENCE 4SÉQUENCE 4
test d’évaluation type DELF B1
Pour ce qui est des sorties au cinéma, nous consta-tons que les élèves du lycée général y vont plus souvent que les élèves du lycée professionnel ; ce qui peut s’expliquer par un plus fort désir d’enrichir leur culture générale.Les sorties en boîte concernent autant les élèves de lycée professionnel que ceux du lycée général. La boîte de nuit la plus fréquentée est le Château.
Les élèves de seconde A.
1. C’est un sondage sur ce que font les jeunes Honfleurais : /1w à l’école w en dehors de l’école
2. Qui a réalisé ce sondage ? /2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quels sont les deux groupes qui ont été interrogés ? /2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Qui en fait le plus ? /4
Les élèves du lycée général
Les élèves du lycée professionnel
Sorties le mercredi et le vendredi
Sport
Cinéma
Sorties en boîtes de nuit
5. Qui a le plus de temps libre ? /1w Les élèves du lycée général w Les élèves du lycée professionnel
Production écrite : /10
D’après une enquête, les parents européens dépensent plus pour les vêtements de leurs enfants que pour leur alimentation.
Tu as lu cet extrait d’article et tu souhaites réagir. Écris une lettre au courrier des lecteurs du journal pour donner des explications sur cette situation et dire ce que tu en penses.
Entretien dirigé : /10
Présente-toi et parle de tes loisirs.
Lire pour s’informer et discuter : – peut reconnaître les points significatifs d’un article direct et non complexe sur un sujet familier ;– peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un pro-blème ;– peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
la Mixité À l’éCOle
•pages 30 et 31
Objectifs Communication
– Organiser le discours (5): présenter deux informations dans la même phrase; exprimer la conséquence.
– Comprendre des graphiques et des tableaux statistiques sur la mixité à l'école.
Linguistique
– Grammaire Les articulateurs logiques : d'abord, ensuite, finalement, d'une part, d'autre part, c'est pourquoi, de plus, bref
– Lexique L’enseignement : les niveaux, les filières, la mixité, la parité.
– Phonétique L’intonation expressive.
Les interjections.
Socioculturel
– La mixité, la parité à l’école.
– Le choix des filières.
– La réussite scolaire.
SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
( 51
L'ecole est une chance
52 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
L’enseignant écrit « mixité » au tableau et demande aux apprenants s’ils connaissent ce mot. (Réponses variables. Réponses attendues : ce mot ressemble à « mixer » qui signifie « mélanger », « mixte », qui signifie « mélangé ». Mixité veut dire qu’il y a des garçons et des filles.)
compréhension globale
Activité 1 • page 30
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer et identifier les documents 1 à 3 en grand groupe.– Demander : « Quel document est en relation avec la nature des études ? » (Document 3).« Lequel est en relation avec l'âge ? (Document 1). » Quel document explique la mixité ? ». (Document 2).– Demander aux apprenants d'observer les documents en détail et de les analyser et expliquer en grandgroupe. Apporter les explications nécessaires.
compréhension finalisée
Activité 2 • page 31
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Pour communiquer et structurer: orGaniser le discours (5) et reformuler les règles d'utilisation.– Leur demander de prendre connaissance de l'encadré Culture et compagnie. Faire expliquer.– Lire la consigne. Diviser la classe en sous-groupes de trois ou quatre apprenants. Laisser les apprenants travailler pour préparer les réponses à ces questions. Pour la mise en com-mun, organiser une discussion en grand groupe.
Corrigé
On remarque que les filles restent scolarisées plus longtemps que les garçons (document 4). D’une part, elles restent à l’école un an de plus en moyenne que les garçons, d’autre part, à 17 ans, elles sont plus nombreuses en terminale générale (document 3). Lorsqu’elles passent le brevet (en fin de 3e), elles le réussissent à 82 % contre 76 % pour les garçons (document 2). C’est pourquoi il y a beaucoup moins d’apprentis filles que d’apprentis garçons (document 1). En outre, elles arrivent plus tard que les garçons dans les parcours plus professionnels. Bref, le pourcentage de filles est particulièrement élevé en terminale L (document 1).
Activité 2
SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
Objectifs Communication
– Comprendre une BD satirique sur la vie des femmes.
Linguistique
– Phonétique L’intonation expressive.
Les interjections.
Socioculturel
– Le quotidien d’une mère de famille vu par un caricaturiste.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Qu’est-ce que vous pensez du travail à la maison ? Plus tard, aimeriez-vous avoir un travail qui vous permette de rester à la maison ? Pourquoi ? ». (Réponses libres.)
compréhension globale
Activité 1 • page 33
Déroulement (5 min)
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Production orale générale : peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points.
Écriture créative : peut raconter une histoire.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
la JOurNée De la FeMMe
•pages 32 et 33
( 53
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est une planche de bande dessinée.)– Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer. (Réponses libres.)
Activité 2 • page 33
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants lire la BD. Faire l’activité en grand groupe.
compréhension finalisée
Activité 3 • page 33
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants travailler par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Production orale
Activité 4 • page 33
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.
Lire la consigne et diviser la classe en deux : les filles d’un côté, les garçons de l’autre. Chaque groupe répond aux questions de l’activité. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant donne la parole alternativement à chaque groupe.
Production écrite
Activité 5 • page 33
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : individuellement ou par deux.
54 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
Corrigé
a. Ça raconte la journée d’une mère de famille.b. Chaque vignette correspond à un moment de la journée de la mère de famille.- Le matin : 6h, 8h, 10h. Midi. L’après-midi et début de soirée : 14h, 16h, 17h, 19h.- Un dieu hindou qui a plusieurs bras (Shiva ou Vishnu).- Elle travaille dans un bureau, elle est peut-être secrétaire ou assistante de direction car un homme, peut-être son patron, lui demande « le dossier mutuelles » et elle assiste à une réunion.- Elle parle peut-être à son mari.- Parce que c’est la table de multiplication que son enfant doit connaître.c. La Journée internationale des Femmes.d. Elle est très fatiguée, exténuée, épuisée.
Activité 2
Corrigé
Vignette 1 : se réveiller, préparer le petit déjeuner.Vignette 2 : pousser, calculer, se déplacer, crier.Vignette 3 : écrire un mél, crier.Vignette 4 : faire les courses, acheter, pousser, répondre au téléphone, dépenser, lire, calculer.Vignette 5 : imaginer, calculer, jouer, répondre au téléphone, préparer le petit déjeuner, écrire un mail.Vignette 6 : courir, transpirer, calculer.Vignette 7 : conduire dans les embouteillages, se déplacer, discuter, répondre au téléphone.Vignette 8 : répondre au téléphone, calculer, discuter, se réunir.Vignette 9 : dormir, rêver, calculer.
Activité 3
SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
( 55
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité, par deux, en classe (ils devront alors négocier pour choisir ce qu’ils représenteront sur chaque vignette) ou indi-viduellement, en dehors de la classe.
Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant peut organiser une exposition des planches de bande dessinée et demander aux apprenants de voter pour les meil-leures.
Pour votre information
L’ECJSL’éducation civique, juridique et sociale est une matière scolaire enseignée dans les lycées en France. Elle fait suite à l’instruction civique enseignée au collège. Son but est de former à la citoyenneté en organisant des débats argumentés sur les principes et valeurs fondamentales de la vie en société : droit, pouvoir et liberté. cette matière a été mise au programme en septembre 2001.Dans l’Union européenne, plusieurs pays souhaitent favoriser l’apprentis-sage de cette matière et former des professeurs compétents.
La Journée de la femmeLa Journée internationale des droits de la femme est célébrée le 8 mars et a été officialisée par les Nations-unies en 1977, qui ont invité chaque pays à célébrer une journée pour les droits des femmes.cette journée de manifestations à travers le monde sert à revendiquer l’égalité et faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde.
56 )
SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Préparation : 5 minutes Passation : 3 ou 4 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un dialogue.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.1. Combien de personnes parlent ? /1w 2 w 3 w 4
2. Ils parlent de quoi ? /1w D’une loi sur la parité w D’une loi sur l’égalité w D’une loi sur la mixité
3. C’est une loi : /1w française w européenne
4. Qui connaît cette loi ? /2w Zoé w Bertrand w Magalie
5. Zoé et Magalie sont d’accord. /1Vrai w Faux w
6. Qui pense quoi ? /4
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le concours « écrivain » de LA JOURNÉE DE LA FEMME 2009
Thème : égalité, parité, réalité
Le concours est ouvert à toutes les formes d’expression littéraire : poésie, texte décoré, texte de chanson, prose.
Le texte gagnant, élu texte de l’année JDF2009 par les internautes, sera diffusé gratuitement
avec les coordonnées de son auteur.C’est, bien sûr, une belle occasion de faire connaître
vos talents d’écrivain et de marquer de votre empreinte notre civilisation..
Le texte devra :• selon votre sensibilité, exprimer votre opinion vis-à-vis du thème proposé ;• ne pas faire plus d’une page ;• porter au moins une fois la mention « Journée de la femme 8 mars 2009 » ou la mention « Journée internatio-nales des droits des femmes » ;• comporter un titre original ;• être envoyé par email en pièce jointe à l’adresse
[email protected] le samedi 7 mars 2009, minuit.
Votre mail comprendra :• vos coordonnées complètes ;• votre acceptation du mini règlement ;• l’autorisation de faire paraître votre nom d’artiste et votre œuvre sur le site :Journee-de-la-femme.com.
Les textes seront proposés aux internautes dans l’ordre d’arrivée.
Magalie Bertrand Zoé
L’Éducation nationale n’appliquera pas cette loi.
Des parents d’élèves demanderont des cours non mixtes.
Des parents ne deman-deront jamais des cours non mixtes.
( 57( 57
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 5SÉQUENCE 5
test d’évaluation type DELF B11. Quel événement est annoncé dans ce document ? /1……………………………………………………………………………………….
2. Pour participer à ce concours, il faut écrire un roman. /1Vrai w Faux w
3. Qui vote pour élire le texte ? /1……………………………………………………………………………………….
4. Quel doit être le sujet du texte ? /2……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
5. Que doit-il y avoir obligatoirement dans le texte ? /21. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
6. Dans ce concours, tout se fait par internet. /1Vrai w Faux w
7. Les textes sont présentés sur le site par ordre alphabétique. /1Vrai w Faux w
Production écrite : /10
Tu participes au concours « écrivain » de la Journée de la femme 2009 : écris un texte qui respecte le règlement. (60 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu dégages le thème soulevé par le document et tu présentes ton point de vue sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
« Les garçons et les filles, dès la naissance, ne sont pas sur un pied d’égalité. Les attentes des parents et de la société envers eux sont très différentes et l’éducation qui leur est donnée les oriente vers des aptitudes et des professions bien spécifiques. »
58 )
ÉvaluationÉvaluation
58 )
SÉQUENCE 2SÉQUENCE 2SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
Lire pour s’informer et discuter : peut reconnaître les points significatifs d’un article direct et non complexe sur un sujet familier.
Compréhension générale de l’oral : peut comprendre une information factuel-le directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux et les points de détail.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Écriture créative : peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
la DisCriMiNatiON
•pages 34 et 35
Objectifs Communication
– Comprendre la page d’accueil d’un site institutionnel contre la discrimination.
– Comprendre et produire des messages contre les discriminations.
Linguistique
– Lexique La discrimination.
– Phonétique La dénasalisation.
Socioculturel
– La HALDE.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants d’observer et de décrire la photo de groupe. (Il y a des jeunes d’origines différentes, des garçons, des filles, une handicapée dans un fauteuil roulant.)– Demander : « Que symbolisent cette photo à votre avis ? ». (La différence entre les personnes : différence de sexes, d’origines, de cultures, de capacités physiques…)
Un pour tous, tous pour un
( 59
compréhension globale
Activité 1 • page 34
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est la page d’accueil d’un site officiel.)a.– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.b.– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.
compréhension finalisée
Activité 2 • page 34
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité individuellement. Ils comparent ensuite leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Demander aux apprenants de travailler par deux pour reformuler la définition de la discrimination avec leurs propres mots et en donnant des exemples. Pour la mise en commun, à l’oral, l’enseignant interroge chaque groupe. (La discrimination c’est quand on ne se comporte pas avec tout le monde de la même façon pour des raisons interdites par la loi. Par exemple, ne pas louer un appartement à un étranger, ne pas donner de travail à une femme, ne pas accepter de handicapés à l’école…)
Activité 3 • page 34
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
Corrigé
a. De gauche à droite et de bas en haut : 1. HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) sur fond jaune, un dessin bleu blanc rouge avec les mots « Liberté, égalité, fraternité » et « République française » et des rubriques (La Halde, actions…) / 2. Tu es contre la discrimination, écris-le haut et fort / 3. Une définition de la discrimination. / 4. Des rubriques (emploi, logement…).
b.La France est représentée par le logo bleu blanc rouge qui montre une femme de profil (Marianne, symbole de la République), dessous il y a la devise de la République française. La présence de ce logo indique que la HALDE est un organisme public.
Activité 1
Corrigé
interdit : prohibé ; champ d’activité : domaine ; basée : fondée ; une indication : un indice, un signe…
Activité 2
Corrigé
- très gros : l’apparence physique- asthmatique : l’état de santé- communiste : les opinions politiques- bouddhiste : les convictions religieuses- métis : les caractéristiques génétiques
Activité 3
( 59
60 )
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6compréhension globale
Activité 4 • page 34
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Faire écouter et identifier le document. (C’est d’un homme qui a vécu une discrimina-tion. On peut l’entendre sur le site internet de la HALDE, peut-être.)a.– Poser les deux questions de l’activité.– Demander : « Qu’a dit le directeur de la salle de concert sur le nom de Saïd ? ». (Il a dit : « C’est pas vendeur, ça va pas le faire ! ».)– Demander : « À votre avis, que voulait dire le directeur ? » (Avec c’est pas vendeur, il voulait dire que les gens n’allaient pas acheter de billets pour venir voir le concert et avec ça va pas le faire, que ça ne va pas marcher, ça ne va pas être possible.)
compréhension finalisée
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la dernière partie de la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, à l’oral, l’enseignant demande la réponse à plusieurs groupes.
Production orale
b.
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement sous forme de forum. (Réponses libres.)
compréhension globale
Activité 5 • page 35
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est une affiche.)– Lire les questions de l’activité.
Corrigé
a. Il s’appelle Saïd Méziou et il est chanteur. Il a été victime d’une discrimination.C’est une discrimination sur le nom de famille parce que c’est le nom de Saïd qui pose un problème au directeur de la salle de concert. Mais c’est aussi une discrimination sur l’origine parce que son nom montre qu’il est originaire d’Afrique du Nord.
Activité 4
Corrigé
Elle représente deux jeunes, un garçon et une fille. On ne peut pas écrire haut et fort, on peut dire quelque chose haut et fort. Le mot en rouge est « cri ». Les équivalents de crier : hurler, se plaindre, affirmer, annoncer…
Activité 5
Le premier gros concert que j’ai fait c’était dans une salle de concert parisienne très réputée. le concert était produit par le directeur de la salle et le directeur a dit à .... parce qu’en fait ily avait deux chanteurs ce soir sur scène, et il a dit « bon, là on est en train de faire l’affiche et j’ai un problème c’est que Saïd Méziou... tu comprends le nom de Saïd Méziou, sur une affiche,c’est pas vendeur, ça va pas le faire... »
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
( 61
compréhension finalisée
Activité 6 • page 35
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire le texte. Poser les questions de l’activité.– Demander : « Qui organise ce concours ? ». (Skyrock, une radio, et la HALDE.)
Activité 7 • page 35
Déroulement (4 min)
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. – Poser la première question de l’activité. (Réponses libres.)– Poser la deuxième question de l’activité.
Activité 8 • page 35
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire les textes. – Poser la question de l’activité.
Production écrite
Activité 9 • page 35
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement à nouveau. Laisser les apprenants tra-vailler par deux. Pour la mise en commun, leur demander de chanter leurs textes avec la musique.
Corrigé
C’est un concours. Pour y participer, il faut écrire un texte contre la discrimination qui va avec une musique composée par Benza et le poster dans les commentaires. On peut gagner un enregistrement de son texte dans un studio.
Activité 6
Corrigé
C’est du rap, du hip-hop.
Activité 7
Corrigé
Ce sont des textes anti-discrimination poétiques écrits pour le concours. Il y a des rimes.
Activité 8
ExEmplE dE produCtion
Toi tu marches grâce à des roulettesMais le monde, lui, marche sur la têteToi t’as pas de boulot car t’es une filleMais pour moi t’es une étoile qui brille.
Activité 9
62 )
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
Lire pour s’informer et discuter : peut reconnaître les points significatifs d’un article direct et non complexe sur un sujet familier.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Écriture créative : peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
uN Peu De PHilOsOPHie…
•page 36
Objectifs Communication
– Comprendre une page d’un moteur de recherche sur Rousseau.
– Comprendre un extrait du « Discours sur l’origine... » de Rousseau.
Linguistique
– Lexique La biographie.
La philosophie.
L’inégalité.
– Phonétique La dénasalisation.
Socioculturel
– Jean-Jacques Rousseau.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
L’enseignant écrit « Philosophie » et demande aux apprenants de réagir librement à ce mot. (Réponses libres.)
( 63
Activité 1 • page 36
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants observer le portrait et faire des hypothèses d’abord individuellement, puis par deux. Mettre en commun en grand groupe à l’oral.
compréhension globale
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est une page du moteur de recherches Google avec, comme mots-clés de recherche, « biographie de rousseau »).– Demander : « À votre avis, qui était Rousseau ? » (Un philosophe.)
compréhension finalisée
Activité 2 • page 36
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne puis laisser les apprenants faire l’activité individuellement avant de comparer leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
Corrigé
Il a les cheveux blancs, c’est peut-être une perruque ; il porte une chemise blanche avec un col assez haut et une veste bleue. Il sourit, il a l’air calme et posé. C’est un homme du 18e ou du 19e siècle.
Activité 1
Corrigé
Jean-Jacques Rousseau naît à Genève le 28 juin 1712 et sa mère meut le 7 juillet.Les Confessions.Littérature, biographie, œuvre, philosophie…
Activité 2
( 63
64 )
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
Objectifs Communication
– Comprendre les messages liés à la vie quotidienne.– Comprendre une liste de courses
Linguistique
– Grammaire Nombres
– Lexique Lexique des courses
Les tâches ménagères
– Phonétique / u /
Socioculturel
– Écrire un message
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants : « Vous avez des frères et des soeurs? Qui est plus actif dans la maison, vous ou lui / elle? Qui fait plus de tâches ménagères ? ».
Compréhension générale de l’oral : peut comprendre une information fac-tuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en reconnais-sant les messages généraux et les points de détail.
Lire pour s’informer et discuter : peut reconnaître les points significatifs d’un article direct et non complexe sur un sujet familier.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Écriture créative : peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de péri-phrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
un peu de vie quotidienne
•page 37
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
( 65
Activité 1 • page 37
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite, expression écrite.
Modalités : individuellement, puis en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire le message individuellement.– Demander: « Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Que doivent-ils acheter à l'épi-cerie? »
Activité 2 • page 37
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux.
– Lire la consigne.– Dire aux apprenants de se mettre d'accord sur les rôles à jouer.– Les apprenants préparent le jeu de rôles et le jouent devant la classe.
Activité 3 • page 37
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : individuellement, par deux.
– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Gramm'rappel et de réviser les nombres.– Lire la consigne. Les apprenants préparent le jeu de rôles et le jouent devant la classe.
66 )
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
test d’évaluation type DELF B1
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
3 ou 4 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un reportage radio.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répondre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. C’est un reportage sur les discriminations professionnelles entre les hommes et les femmes /1Vrai w Faux w
2. Où se situent les inégalités entre hommes et femmes ? /2,5
Oui Non
Demande de vacances
Accès à l’emploi
Salaire
Heures supplémentaires
Déroulement de carrière
3. Où y a-t-il le plus de femmes et le plus d’hommes ? /4
Femmes Hommes
Emplois à temps partiel
Bas salaires
Postes à responsabilités
Université
4. Quelle est la différence de salaire entre hommes et femmes ? /1,5
……………………………………………………..
5. Cette différence de salaire est autorisée par le code du travail. /1Vrai w Faux w
( 67( 67
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
Le Journal des JeunesLa Déclaration des droits de l’enfant
Sais-tu qu’il existe une Déclaration des Droits de l’Enfant, adoptée par I’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1959 ? Ado’Mag en a sélectionné dix.
1. Le droit de s’alimenter et d’être à l’abri« L’enfant a droit à une alimentation adéquate et à un logement sain. »2. Le droit à la santé« L’enfant a droit à des soins médicaux. »3. Le droit des enfants handicapés« L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir traitement, éducation et soins spéciaux. »4. Le droit à l’école« L’enfant a droit à une éducation. »5. Le droit aux loisirs« L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et des activités récréatives orientées à des fins éducatives. »6. Le droit à la culture« L’enfant a droit à une éducation qui contribue à sa culture. »7. Le droit aux secours« L’enfant doit en toutes circonstances être parmi les premiers à recevoir protection et secours. »8. Le droit d’être protégé contre l’exploitation dans le travail« L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant un âge minimum approprié ni prendre une occupation qui nuise à sa santé, ni à son éducation. »9. Le droit d’être protégé contre les mauvais traitements« L’enfant doit être protégé contre toute forme de violence, brutalité ou de négligence. »10. Le droit à l’expression« L’enfant a droit à la liberté d’expression qui comprend la liberté de rechercher, recevoir, produire l’information, à la liberté d’association et à la liberté de réunion. »
Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune et sans distinction ou discrimination sur la couleur, le sexe, la religion, l’origine nationale ou sociale ou toute autre situation.
1. Le Journal des Jeunes publie la Déclaration des droits de l’enfant en totalité. /1
Vrai w Faux w
2. La Déclaration des droits de l’enfant a été rédigée par des adultes. /1
Vrai w Faux w
3. D’après cette Déclaration, à quoi ont droit tous les enfants ? /1
68 )
SÉQUENCE 6SÉQUENCE 6
test d’évaluation type DELF B1
Oui w Non w Oui w Non w Oui w Non w Oui w Non w
Oui w Non w Oui w Non w Oui w Non w Oui w Non w
4. D’après la Déclaration des droits de l’enfant, le travail des jeunes peut être obligatoire. /1
Vrai w Faux w
5. D’après la Déclaration des droits de l’enfant, tous les enfants sont égaux. /1
Vrai w Faux w
Production écrite : /10
Vous avez été victime ou témoin d’une discrimination ? Saisissez la Halde !
Tu écris une lettre à la Halde pour raconter la discrimination que tu as subie ou dont tu as été témoin. (60 mots)
Exercice en interaction : /10
Tu dois simuler un dialogue avec le professeur ou un(e) camarade afin de résoudre une situation de la vie quo-tidienne.
Sujet : Tu as subi ou été témoin d’une discrimination. Tu téléphones à la Halde pour raconter l’histoire.
( 69
Le projet, par son résultat concret à obtenir, constitue l’approche
actionnelle du module.
Le projet reprend tous les objectifs du module, toutes les compétences
travaillées à travers une série de tâches contextualisées à réaliser,
lors desquelles les apprenants vont être amenés à interagir.
Le projet s’articule en trois parties : une mise en route pour permettre
aux apprenants d’entrer dans la thématique et présenter le projet
qu’ils vont réaliser ; une activité de réception pendant laquelle les
apprenants vont (re)mobiliser les moyens linguistiques et fonctionnels
nécessaires à la réalisation du projet et se placer dans le contexte
situationnel ; la réalisation du projet lui-même lors de laquelle chaque
groupe travaillera en autonomie guidée.
Le temps imparti à chaque étape n’est qu’une estimation et peut, bien
entendu, varier selon les classes.
•pages 38 et 39
z Mise en route– L’enseignant présente le projet : expliquer aux élèves qu’ils vont réaliser un sondage sur les loisirs des collégiens.– En grand groupe, demander : « Quels choix allez-vous devoir faire pour réaliser ce sondage » et noter les réponses au tableau.– Demander aux apprenants de se mettre en sous-groupes de quatre ou cinq pour réaliser le projet.
Tu réalises un sondage sur les loisirs des collégiens
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habi-tuels ou non, en relation avec son domaine ; – peut échanger, vérifier et confirmer des informations.
S’adresser à un auditoire : – peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps ; – peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était trop rapide.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
cadre de référence B1
70 )70 )
z 1re tâche : Réception d’informations sur la réalisation d’un sondage
1re étApE - 1 • page 38
Déroulement (15 min)
Compétences mises en œuvre : compréhension écrite et expression orale.
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses au tableau ou demande à des apprenants de venir les noter.Exemples de questions1. Donnez-vous de l’argent de poche à votre enfant/vos enfants ?2. Pourquoi ne donnez-vous pas d’argent de poche à votre enfant/vos enfants ? – Votre enfant/vos enfants est/sont trop jeune(s). – Vous n’avez pas assez d’argent.3. Combien leur donnez-vous ?4. Vous avez une/des fille(s) ou un/des garçon(s) ?5. À partir de quel âge donnez-vous de l’argent de poche à votre enfant/vos enfants ?6. Combien versez-vous sur le compte de votre enfant/vos enfants chaque année ?
z 2e tâche : Réalisation du sondage
2e étApE - 2 • page 39
Déroulement (40 min)
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq et en grand groupe.
Lire les décisions à prendre pour faire le sondage. Lire les consignes a., b., c. relatives à la réalisation du sondage et demander aux apprenants de travailler en sous-groupes. Pour la mise en commun, chaque groupe présente son sondage et note ses choix au tableau (a., b., c. : réponses variables).
z 3e tâche : Analyse et présentation du sondage
3e étApE - 3 • page 39
Déroulement (60 min)
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq.
d.Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité. Il est possible de faire une première mise en commun en grand groupe : chaque groupe présente son analyse à la classe ; ou alors, l’enseignant corrige les travaux en dehors de la classe.e.Lire la consigne et laisser chaque-sous groupe choisir un mode de présentation puis réaliser les graphiques. Pour la mise en commun, l’enseignant peut afficher les travaux dans la classe et demander à chaque groupe de présenter son travail.
ÉvaluationÉvaluation
( 71
Modalités : individuellement.
•pages 40 et 41
Activité 1 • page 40
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 2 • page 40
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'exercice.
Corrigé
1. Il a un cours de saxophone tous les lundis.2. Il va chez sa grand-mère cinq fois par mois.3. Il fait du judo tous les vendredis.4. Il sort avec Pauline deux fois par mois.
Activité 1
Corrigé
julie : Papa ?le père : Hmm ?julie : Tu sais, les dix euros que tu me donnes chaque samedi…le père : Ton argent de poche ? Oui, qu’est-ce qu’il y a ?julie : Bah, dix euros par semaine, c’est pas grand-chose. Je dépense tout en deux jours.le père : Quoi ? Quand j’avais ton âge, je n’avais que cinq euros par semaine, et je m’en sortais très bien.julie : Mais moi, je m’en sors pas, c’est trop dur. Mes copines, elles ont toutes quinze, vingt, trente euros. Nathalie a sa propre carte de retrait. Elle peut aller retirer de l’argent au distributeur.julie : Mais je n’ai même pas de quoi me payer un jeu vidéo.le père : Tu l’auras.julie : Mais comment ?
Activité 3
72 )
Activité 4 • page 41
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 5 • page 41
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'exercice.
ÉvaluationÉvaluation
Corrigé
Les jeux vidéo occupent une place de plus en plus importante dans la vie des jeunes. Mais ce n’est pas sans danger. Tout d’abord, un usage excessif peut devenir une habitude et compromettre la réussite scolaire. Autre détail, certains jeux en ligne peuvent coûter très cher. Bref, il faut surveiller ses dépenses si on veut jouer. C’est pourquoi le collège Étienne Marcel à Poitiers organise des réunions d’information pour les élèves et les parents : « Nous voulons dialoguer avec les familles au lieu de nous plaindre […]« Ce n’est qu’un jeu. De plus, je préfère que mon fils ne sorte pas le soir. Avec les jeux vidéos, il reste à la maison. […] « Quand j’ai commencé à jouer, j’y ai passé des heures et mes notes ont baissé […] ensuite, j’ai fait attention de ne pas jouer en semaine. Finalement, mes notes ont remonté. »
« Les jeunes perdent beaucoup de temps avec cette activité, en revanche, c’est excellent pour leur développement psychomoteur » […]Certains professeurs regrettent le fait que cette activité remplace souvent la lecture, et même les devoirs. Enfin, il faut espérer que les élèves trouvent le bon équilibre entre le jeu et le travail.
Activité 4
Corrigé
1. mille sept cent douze2. mille sept cent quarante-trois3. mille huit cent soixante-six4. mille neuf cent soixante-quatorze5. deux mille douze
Activité 5
74 )
Comprendre une interaction entre locuteurs natifs : peut généralement sui-vre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa présence.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habituels ou non, en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
Objectifs Communication
– Rapporter les paroles de quelqu’un.
Linguistique
– Grammaire Le style indirect au passé.
– Lexique L’internet. Les réseaux sociaux.
– Phonétique [l], [n], [r].
Socioculturel
– Le réseau social Facebook
sensibilisation
Activité 1 • page 44
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe.– Demander : « Qu’est-ce qu’il faut faire pour s’inscrire ? ». (Il faut compléter le formu-laire avec des informations personnelles et donner un mot de passe.)– Demander si l’inscription est payante. (Non, c’est gratuit.)– Demander : « Vous êtes inscrits sur Facebook ? ». (Réponses libres.)– Si des élèves sont inscrits, demander : « Qu’est-ce que c’est Facebook ? ». (C’est un site sur internet pour communiquer avec des amis.)
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7 Les amis de mes amis sont mes amis
Les amis sUr internet
•pages 44 et 45- Amélia : L’autre jour, je discutais avec ma sœur et elle m’a dit qu’elle était sur Facebook. Tu connais ? Elle m’a demandé si je voulais qu’elle m’ajoute à ses amis. Elle m’a raconté qu’elle avait retrouvé plein de gens qu’elle connaît et aussi qu’elle avait retrouvé ses copains et copines de la fac. Je lui ai dit que ça me faisait peur ces trucs-là mais elle m’a assuré que ce n’était pas dangereux. Elle m’a demandé ce qui me faisait peur. J’ai dit que je savais pas. Je vais le faire, je crois.- Pauline : C’est quoi exactement ?- Amélia : C’est un site de réseau. On appelle ça un réseau social. Ça rassemble des personnes proches ou inconnues. Ma sœur m’a dit qu’il y avait 200 millions de membres à travers le monde et que c’était le site le plus visité.- Pauline : C’est américain ?- Amélia : Oui. Ma sœur, qui est très branchée sur ces trucs-là, m’a expliqué que c’était les étudiants de Harvard qui avaient créé un réseau pour leur université, et puis le réseau s’est étendu aux autres facs. Elle m’a dit que ce serait bien que j’y sois et mes copains aussi. Elle m’a dit qu’elle m’enverrait une invitation. C’est comme ça que ça s’appelle. Je l’accepte, c’est comme ça qu’on dit, et après, je peux, à mon tour, inviter mes amis.- Pauline : Et on fait quoi avec Facebook ?- Amélia : Eh bien, tu y mets des informations personnelles, des photos, des vidéos, de la musique que tu aimes. Tu tchates et tu partages tout ça avec tes amis. Et puis elle m’a dit que c’était drôle l’histoire du mur.- Pauline : C’est quoi le mur ?- Amélia : Eh bien sur ta page, il y a ta photo, des informations personnelles et puis ton mur où les copains peuvent te laisser des messages, commenter tes photos. Ils peuvent aussi y publier des photos de toi, que toi tu n’as pas. Ma sœur m’a dit que c’était sans danger parce que seuls tes amis ont accès à ta page. Elle m’a dit que je devrais le faire. Je suis sûre que Scott, mon correspondant américain y est.- Pauline : On peut aller chez toi ?- Amélia : Oui, viens ! On y va. J’espère que ma sœur sera là.
( 75
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7– Faire observer et décrire la photo. (Deux filles, assises sur un banc à un arrêt de bus, discutent.)– Demander : « À votre avis, elles discutent de quoi ? ». (Elles parlent peut-être de Facebook.)
compréhension globale
Activité 2 • page 44
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter le dialogue. Faire l’activité en grand groupe.– Demander : « De quel réseau elles parlent ? ». (De Facebook.)
compréhension finalisée
– Demander : « Quelle est le sentiment d’Amélia sur Facebook et comment elle le dit ? ». (Elle a peur de ces trucs-là.)– Demander par quel mot on peut remplacer « ces trucs-là ». (Facebook et ce style de site de réseau sur internet. Le mot « truc » peut remplacer d’autres mots dans un registre familier.)– Demander ce qu’en pense la sœur d’Amélia et si elle connaît bien Facebook. (Elle pense que ce n’est pas dangereux et elle connaît bien Facebook ; elle est très branchée sur ces trucs-là.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré AU FAIT ! Puis, demander : « Et vous, vous êtes branchés sur ces trucs-là ? ». (Réponses libres.)
Activité 3 • page 44
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter le dialogue une deuxième fois. Les apprenants font l’activité individuellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données par les élèves au tableau.– Demander quelles informations Pauline et Amélia donnent sur Facebook. (Il y a 200 millions de membres et c’est le site le plus visité) ou demander aux apprenants de dire ce qu’ils ont appris sur Facebook…– Demander : « comment Pauline et Amélia peuvent devenir membres de Facebook ? ». (Une personne peut leur envoyer une invitation et elles doivent l’accepter.)
Corrigé
C’est le logo de Facebook. C’est le formulaire pour s’inscrire sur Facebook.
Activité 1
Corrigé
- Ma sœur m’a dit qu’il y avait 200 millions de membres : 4- Elle m’a dit qu’elle était sur Facebook : 1- Elle m’a dit qu’elle m’enverrait une invitation : 5- Elle m’a assuré que c’était pas dangereux : 3- Elle m’a dit que c’était drôle l’histoire du mur : 6- Elle m’a raconté qu’elle avait retrouvé plein de gens : 2
Activité 3
Corrigé
1. Faux / 2. Faux / 3. Vrai / 4. Faux / 5. Vrai
Activité 2
76 )
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7– Demander ce que Pauline et Amélia pourront faire sur Facebook. (Elles pourront publier des photos, des vidéos, de la musique, tchater…)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Les mots d’un… réseau internet puis, demander : « Pourquoi on met des photos, des vidéos sur Facebook ? ». (Pour les partager avec les amis qui ont accès à notre page.)– Demander : « La sœur d’Amélia a retrouvé qui sur Facebook ? ». (Des copains et des copines de la fac.)– Demander : « À quel âge va-t-on à la fac ? Après quel examen / diplôme ? ». (Vers 18 ans, après le bac. La fac, c’est la faculté, l’université.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré AU FAIT !
Activité 4 • page 45
Déroulement (20 min)
Compétences travaillées : compréhensions orale et écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter le dialogue une troisième fois. Les apprenants font l’activité individuellement puis vérifient, par deux, en lisant le dialogue. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants de comparer et relever les changements entre le discours direct et le discours indirect. – Demander quand la conjugaison ne change pas ? (Pour le subjonctif présent et le conditionnel présent.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : rapporter Les paroLes de queLqu’un / le style indi-rect (1) et reformuler les règles.
SynthèseLe discours indirect est introduit par un verbe introducteur (dire, raconter, etc.), conju-gué au passé composé + qu’/que, qui signifie que la phrase a été dite. Pour les questions, est-ce que devient si et qu’est-ce que devient ce que.Les pronoms et les possessifs changent.Le temps des verbes change :
Discours direct Discours indirect
Verbe au présent Verbe à l’imparfait
Verbe au passé composé Verbe au plus-que-parfait
Verbe au futur Verbe au conditionnel présent
Corrigé
Elle m’a dit qu’elle était sur Facebook.Elle m’a demandé si je voulais y être.Elle m’a raconté qu’elle avait retrouvé plein de gens.Je lui ai dit que ça me faisait peur.Elle m’a demandé ce qui me faisait peur.Elle m’a dit que ce serait bien je j’y sois.Elle m’a dit qu’elle m’enverrait une invitation.
Activité 4
( 77
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7exercice
Activité 5 • page 45
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Production orale
Activité 6 • page 45
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de se poser les questions de l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant demande à quelques élèves de rapporter les paroles de leur camarade.– Demander à la classe : « Écoutez vos camarades et notez une parole rapportée ».
Activité 7 • page 45
Déroulement (25 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants travailler par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant peut interroger quelques élèves tirés au sort.– Demander à la classe : « Écoutez vos camarades et notez une parole rapportée et retrouvez les paroles prononcées par la personne à l’origine. Notez également deux expressions en rapport avec les réseaux internet. ».
Corrigé
Ce n’est pas dangereux.Ce sont des étudiants de Harvard…
Activité 5
Objectifs Communication
– Comprendre une page de profil de Facebook.
– Raconter une sortie.
Linguistique
– Grammaire L’accord du participe passé : avec être, avoir et les verbes pronominaux.
– Lexique Le concert.
– Phonétique [l], [n], [r].
Socioculturel
– Une sortie : le concert.
– Participer à un réseau social.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Vous allez à des concerts ? Vous aimeriez y aller ? Qui aimeriez-vous voir en concert ? ». (Réponses libres.)
78 )
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle général, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle.
cadre de référence B1
Le premier concert
•pages 46 et 47
( 79
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7compréhension globale
Activité 1 • page 46
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est la page Facebook d’Amélia.)– Lire la consigne et les questions de l’activité en grand groupe.– Demander par quel mot on peut remplacer bahut. (Collège, lycée…)
Activité 2 • page 47
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire les messages individuellement. Faire l’ac-tivité en grand groupe.– Demander : « Avec qui Amélia est allée au concert ? Elles sont allées voir qui ? ». (Avec Marie. Elles sont allées voir Camille.)– Demander : « Elles étaient placées où ? ». (Juste devant la scène.)
compréhension finalisée
Activité 3 • page 47
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité individuellement. Ils comparent ensuite leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Lire les questions de l’activité et laisser les apprenants répondre en grand groupe.– Demander : « Quel temps est utilisé pour parler de ce qui s’est passé avant le concert ? ». (Le plus-que-parfait.)– Demander : « Qu’est-ce qu’on peut faire pendant un concert ? ». (Taper des pieds, crier, chanter, danser.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Les mots des… concerts et AU FAIT ! – Demander aux élèves de mimer « taper des pieds » et « les cris » pour vérifier la compréhension.
Corrigé
Informations sur Amélia : elle est née le 31 juillet 1993, elle habite à Paris, elle a 123 photos et 44 amis.Elle pense au concert de Camille. Elle écrit à Scott (son correspondant) entre 16 h 45 et 21 h 34.Scott est aux États-Unis : c’est le correspondant américain d’Amélia ; il dit qu’il est loin et qu’il est l’heure d’aller au bahut alors que pour Amélia, en France, c’est le soir.
Activité 1
Corrigé
État d’Amélia et de Marie : On était complètement excitées. On était mortes.Ambiance, décor, description de la chanteuse : Il y avait plein de monde.Tout le monde tapait des pieds.Elle sautait comme une folle.On ne s’entendait plus parce que juste devant la scène c’était vraiment fort.C’était super.Ce qu’elles ont fait. / Ce qui s’est passé : Je suis allée au concert de Camille.On est entrées et on s’est mises juste devant la scène.Les lumières se sont éteintes.Il y a eu plein de cris.Camille est entrée sur scène.On a chanté.On s’est raconté les choses qu’ont a aimées en rentrant.Je suis rentrée tard.Je me suis brossé les dents et je me suis couchée.Les descriptions sont à l’imparfait, ce qui s’est passé est au passé composé. Le temps qui fait avancer le récit est le passé composé.
Activité 3
Corrigé
1. Vrai / 2. Faux / 3. Vrai / 4. Vrai / 5. Faux
Activité 2
80 )
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7
Activité 4 • page 47
Déroulement (15 min)
Réflexion sur le fonctionnement de la langue.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité individuellement. Ils comparent ensuite leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Classement des règles d’accord
Accord du participe passé Pas d’accord du participe passé
On s’est mises devant. On est entrées. On s’est vues.
Les choses qu’on a aimées.
Je me suis brossé les dents.
On a chanté toutes les chansons.
On ne s’est pas parlé.On s’est raconté les choses.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses au tableau.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : Les accords du participe passé et reformuler les règles.Règles d’accordsAvec l’auxiliaire être, on fait l’accord du participe passé avec le sujet excepté pour les verbes pronominaux :– quand la structure est indirecte (« se » = COI → se parler = parler à quelqu’un)– quand l’action ne porte pas sur le sujet (Elle s’est brossé les dents → l’action porte sur les dents)Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. Le participe passé s’accorde avec le COD quand il est placé avant le verbe, mais ne s’ac-corde pas quand il est placé après.
exercice
Activité 5 • page 47
Déroulement (15 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Corrigé
Je suis allé à un concert des Fugges. Tu connais ? Je les avais déjà vus l’année dernière. Cette fois, c’était encore mieux. Il y avait un monde fou. Tout le monde criait. Mes copains étaient là et on s’est bien amusés. La chanson que je préfère, ils l’ont reprise à la fin.
Activité 5
( 81
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7Production orale
Activité 6 • page 47
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de se poser les questions de l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant demande à quelques élèves de rapporter les paroles de leur camarade.– Demander à la classe : « Écoutez vos camarades et notez deux expressions pour dire ce qui s’est passé au concert ».
Production écrite
Activité 7 • page 47
Déroulement (25 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : individuellement ou par deux.
Cette activité peut se faire par deux, en classe, ou individuellement, à la maison.
ExEmplE dE produCtion
Sarah a écrit à 20 h 03Salut Amélia ! Moi aussi je suis allée à un concert le week-end dernier : celui de M, tu connais ? C’était génial ! Il avait prévu une mise en scène incroyable avec des écrans qui passaient des images bizarres. Les musiciens sont arrivés avant lui et ont commencé à jouer. M est arrivé quelques minutes plus tard sur un scooter !!! C’était vraiment drôle. Le concert a duré plus de deux heures et on a chanté pendant ces deux heures avec lui. La dernière chanson qu’il a chantée était très belle. Je suis rentrée à pieds parce que la salle de concert n’était pas loin de chez moi. Je me suis couchée et je me suis endormie tout de suite.
Activité 7
82 )
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois une interview.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. Qui est la personne interviewée ? /3Son prénom : ……Son âge : ……Ses études : ……
2. Aurélien est contre Facebook. /1Vrai w Faux w
3. Aurélien connaît beaucoup de monde. /1Vrai w Faux w
4. Aurélien pense qu’on peut avoir beaucoup d’amis. /1Vrai w Faux w
5. Aurélien a très envie de revoir d’anciens copains. /1Vrai w Faux w
6. Aurélien ne va pas sur Facebook pour protéger quoi ? /2………………………………………………………
7. Aurélien pense qu’internet protège la vie privée ? /1Vrai w Faux w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le Journal des ados
Des Agents secrets trouvés sur Facebook
Les services secrets ont décidé d’élargir leur recrutement et de rechercher une nouvelle génération d’espions en utilisant le site de réseau social Facebook. Ce réseau sur Internet serait parfait « pour cibler des réservoirs de talents qui représentent la société d’aujourd’hui », selon un agent chargé de trouver d’autres agents. Lors de précédentes campagnes, les services secrets avaient lancé des annonces à la radio et publié des offres d’emploi dans les journaux.Différentes publicités sont visibles sur internet. La première s’adresse aux personnes qui ont fait des études universitaires et leur propose de « développer une carrière en tant qu’agents chargés de collecter et d’analyser des données ». La deuxième s’adresse aux personnes qui souhaitent changer de métier : « Envie de changer de boulot ? Les services secrets ont besoin de vos capacités, rejoignez-nous en tant qu’agent chargé de collecter des informations ». Vous avez toujours rêvé d’être un vrai James Bond ? Il ne vous reste plus qu’à foncer sur Facebook et à répondre à l’annonce.
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Préparation : 5 minutes Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
( 83
SÉQUENCE 7SÉQUENCE 7
test d’évaluation type DELF B11. Cet article parle des services secrets. /1Vrai w Faux w
2. Tous les membres de Facebook sont des agents secrets. /1Vrai w Faux w
3. Par quels moyens les services secrets avaient déjà recruté des agents ? /31. ………………………………………………………2. ………………………………………………………
4. Quelles personnes les services secrets recherchent ? /41. ………………………………………………………2. ………………………………………………………
5. James Bond est inscrit sur Facebook /1Vrai w Faux w
Production écrite : /10
Que penses-tu des réseaux sociaux sur internet et des amitiés virtuelles ?Écris un texte pour donner ton opinion. (60 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu dégages le thème soulevé par le document et tu présentes ton point de vue sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
Se connecter à internet, c’est y rencontrer des centaines de gens avec qui on n’aurait jamais eu envie d’avoir le moindre rapport.
Objectifs Communication
– Comprendre le résumé oral d’un débat.
– Repérer les spécificités de l’oral.
– Rapporter des idées.
Linguistique
– Grammaire Les marques de l’oral : interruptions ; répétitions ; « quoi », « là » ; négation.
– Lexique L’adolescence
– Phonétique “e”, “é”, “è”, “ê”. [e] ou [è]
Socioculturel
– Être ados aujourd’hui.
84 )
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : peut compren-dre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou radio-diffusés, dont le sujet est un intérêt personnel et la langue standard clairement articulée.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
S’adresser à un auditoire : peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision.
Correction grammaticale : communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle général, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
Être ado
Les aDos VUs par eUX-mêmes
•pages 48 et 49- Journaliste : Vous êtes sur Radio ado, il est 16 h et nous allons écouter les rapporteurs du débat sur « comment vivre avec les autres ». J’appelle... oui ils sont là, Jackson bonjour, Anna bonjour. Nous avons aussi dans notre studio Alain Dupuis, sociologue et Valérie Laurent, pédopsychiatre. - Anna : D’abord, on a parlé de comment est-ce que notre famille peut nous aider dans les moments difficiles, quand ça va mal. Comment est-ce qu’on peut faire pour mieux communiquer avec nos parents, les adultes ? Puis, on s’est posé la question de savoir si... quand on a des problèmes avec les adultes, notre famille, notre environnement familial quoi... si nos amis, les amis de notre âge, pouvaient nous aider à résoudre notre problème, à le surmonter, nous aider, quoi... les copains c’est pas toujours une bonne solution, quoi. Est-ce qu’ils ont assez d’expérience, et là... c’est pas sûr.- Jackson : C’est vrai que maintenant les parents sont plus cools. Mes grands-parents devaient être plus stricts. Et moi je serai moins strict que me parents. En fait après on a parlé de liberté, la liberté de...en fait, nous croyons que les jeunes sont plus fêtards que les adultes. (Rires.) En fait, par rapport aux années 70-80, mais c’est vrai ! Nous on s’amuse mieux. Nous, maintenant on va plus sortir en discothèque, ou dans les fêtes. On drague plus.- Journaliste : Vous rêvez !
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
( 85
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Demander : « Comment trouvez-vous vos parents ? Sévères ou pas ? Vous parlez beaucoup avec eux ou avec d’autres adultes ? Et avec vos copains ? Vous parlez de quoi ? ». (Réponses libres.)
compréhension globale
Activité 1 • page 48
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Faire identifier le document. (C’est un extrait d’une émission radio.)– Faire l’activité en grand groupe.
compréhension finalisée
– Demander : « D’après Jackson, les jeunes font plus la fête. Que font-ils de plus encore ? ». (Les jeunes sortent plus en discothèque, draguent plus.)– Demander quelle expression utilise le journaliste pour se moquer de Jackson. (Il dit « Vous rêvez ! »).– Demander : « Que veut dire le journaliste avec cette expression ? ». (Que Jackson ne dit pas la vérité.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré AU FAIT !
Activité 2 • page 48
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement une deuxième fois. Les apprenants font l’activité individuellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données par les élèves au tableau.– Demander aux apprenants de justifier leurs réponses avec des passages de la transcrip-tion. (Le rôle de la famille en cas de problème : « comment est-ce que notre famille peut
Corrigé
1. 3. 2. Vrai. 3. Vrai (Alain Dupuis, sociologue, et Valérie Laurent, pédopsychiatre). 4. Vrai. 5. Vrai.
Activité 1
Corrigé
Le rôle de la famille en cas de problème. / Le rôle des amis. / La communication avec les parents. / L’autorité des parents.
Activité 2
86 )
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8nous aider dans les moments difficiles ». Le rôle des amis : « on s’est posé la question de savoir si quand on a des problèmes avec les adultes, notre famille, notre environ-nement familial, si nos amis, les amis de notre âge, pouvaient nous aider à résoudre notre problème, à le surmonter. Les copains, c’est pas toujours une bonne solution ». La communication avec les parents : « comment est-ce qu’on peut faire pour mieux communiquer avec nos parents, les adultes ? ». L’autorité des parents : « Maintenant les parents sont plus cools. Mes grands-parents devaient être plus stricts. Et moi je serai moins strict que mes parents ».– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Les mots de… l’adolescence et demander : « Quelles expressions sont en rapport avec la famille ? Quelles expressions sont en rapport avec ce que les jeunes font ensemble ? ». (La famille : l’environnement familial, communiquer avec ses parents, être strict. Les jeunes ensemble : être fêtard, draguer, sortir en discothèque.)
Activité 3 • page 49
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale et écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Tableau de synthèse
Phrase pas finie Les mots qu’on utilise pour insister
Absence de négation Une répétition
J’appelle… oui ils sont là.
Là Quoi
C’est pas toujours une bonne solution.C’est pas sûr.
En fait, après on a parlé de liberté en fait
Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : Les marques de L’oraL.
exercice
Voir Cahier d’exercices, exercice 2, p. 48.
Production orale
Activité 4 • page 49
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement.
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
( 87
Activité 5 • page 49
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq.
– Lire la consigne et laisser les apprenants travailler en sous-groupes puis mettre en commun, en grand groupe, en interrogeant chaque rapporteur.– Demandez à la classe : « Écoutez vos camarades et notez quels thèmes ils ont abor-dés. ».
Lire pour s’informer et discuter : peut reconnaître les points significatifs d’un article, direct et non complexe, sur un sujet familier.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers, habi-tuels ou non, en relation avec ses intérêts ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
Les Uns et Les aUtres
•pages 50 et 51
Objectifs Communication
– Comprendre un article d’un magazine culturel sur une activité artistique.
Linguistique
– Lexique La mode. Les vêtements. Les styles vestimentaires.
– Phonétique “e”, “é”, “è”, “ê”. [e] ou [è]
Socioculturel
– Une activité culturelle originale : regrouper les styles vestimentaires.
88 )
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8sensibilisation
Activité 1 • page 50
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Lire la consigne et recueillir les réponses (libres) et demander aux apprenants de décrire les photos. (Ce sont des photos de personnes qui s’habillent de la même façon, qui ont le même style vestimentaire.)
Activité 2 • page 50
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.
Activité 3 • page 51
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.
compréhension globale
Activité 4 • page 51
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Faire identifier le document en grand groupe. (C’est un article du magazine Télérama du 8 octobre 2008, écrit par Nicolas Delesalle.)– Demander : « D’après le titre et les photos, de quoi va parler l’article à votre avis ? ». (De la mode, de différents styles vestimentaires et du fait que des groupes de personnes ont le même style vestimentaire et donc se ressemblent [les clones]).a.– Lire la consigne et laisser les apprenants lire le texte. Ils font l’activité individuellement, puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.– Demander : « Quelle est la profession des deux personnes présentées par l’article ? ». (Ari Versluis est photographe et Ellie Uyttenbroek est styliste.)
Corrigé
bonnet / veste / blouson / casquette / jean / pantalon de sport / tee-shirt imprimé / ceinture / sweat / foulard
Activité 2
Corrigé
gris / noir / bleu / beige.
Activité 3
Corrigé
a. 1. Vrai / 2. Vrai / 3. Vrai b. D’après le journaliste : ils repèrent des familles urbaines et les détaillent. Ils regardent les gens, les détaillent et les classent.Ils sillonnent le monde et chassent les gens.La photo est prise en quelques minutes.Leur travail sériel […] obsessionnel.D’après eux-mêmes : Nous sommes des sortes de profilers.Nous sommes des loupes.
Activité 4
( 89
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
– Demander où ils ont pris les photos. (À Rotterdam, en Hollande [aux Pays-Bas], et à Paris, en France.)– Demander : « À quelle occasion et où leur travail va être exposé ? ». (Lors de « Paris Photo », au musée du Louvre.)
compréhension finalisée
b. Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en com-mun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
exercice
Voir Cahier d’exercices, exercice 11, p. 52.
Production orale
Activité 5 • page 51
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement.
Activité 6 • page 51
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée :compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants: « Quels mots ont remplacé 'le bouquet de fleurs' et 'maman' »? (le, lui)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Gramm'rappel: COI, COD
Activité 7 • page 51
Déroulement (10 min)
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'activité individuellement.– Mettre en commun en grand groupe et au tableau.
Corrigé
Ne l'achète pas! - Range-la! - Donne-le-lui!
Activité 7
( 89
90 )
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois un reportage.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. C’est un reportage sur le bien-être : /1w des enfantsw des adolescentsw des adultes
2. Les ados vont mal. /1Vrai w Faux w
3. Qui a été interrogé ? /31. ……………………………………..2. ……………………………………..
4. Combien d’adolescents ont dit quoi ? /3
Une majorité Une minorité
sont satisfaits de leur vie
sont mal dans leur peau
5. Les parents ont une vision fausse du bien-être des adolescents. /1Vrai w Faux w
6. Les parents pensent qu’une majorité de jeunes sont bien dans leur peau. /1Vrai w Faux w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le Journal des ados
Vive la famille !
D’après une enquête récente, la famille est essentielle pour 99 % des Français. Lorsqu’ils parlent de la famille, la moitié des Français l’associent à l’amour et un quart d’entre eux disent que c’est la solidarité qui illustre le mieux l’idée qu’ils ont de la famille. D’autres mots reviennent aussi souvent dans la bouche des personnes interrogées, comme le soutien et le bonheur.En revanche, les Français déclarent ne pas toujours tenir compte des conseils de leur famille dans les prises de décision. La famille idéale pour les Français serait donc importante mais pas trop présente.
1. Cet article donne les résultats d’une enquête sur les adolescents. /1Vrai w Faux w
2. Presque la totalité des Français pensent que la famille est très importante. /1Vrai w Faux w
3. À quels mots les Français associent la famille ? /41. ………………………………………………………2. ………………………………………………………
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Préparation : 5 minutesPassation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
( 91( 91
SÉQUENCE 8SÉQUENCE 8
test d’évaluation type DELF B13. ………………………………………………………4. ………………………………………………………
4. Combien de Français associent la famille à l’amour ? /1
w 100 % w 75 % w 50 %
5. Combien de Français associent la famille à la solidarité ? /1
w un sur deux w un sur trois w un sur quatre
6. Les Français ne prennent jamais de décision sans consulter leur famille ? /1Vrai w Faux w
7. La famille idéale pour les Français est très présente. /1Vrai w Faux w
Production écrite : /10
« L’influence de la mode est si puissante qu’elle nous oblige parfois à admirer des choses sans inté-rêt et qui sembleront même quelques années plus tard d’une extrême laideur. » (Gustave Lebon)
Tu as lu cette citation dans un magazine de mode et tu souhaites réagir. Écris une lettre au courrier des lecteurs du magazine pour dire ce que tu en penses. (60 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu dégages le thème soulevé par le document et tu présentes ton point de vue sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
Le Livre de Viviane Mahler, Ados, comment on vous manipule, vous propose de décoder les petites et grandes manipulations dont vous êtes la cible via la publicité, internet…
92 )
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
Objectifs Communication
– Comprendre un titre du journal télévisé.
– Comprendre une biographie.
– Comprendre un écrivain délivrant un message sur la littérature.
– Caractériser.
Linguistique
– Grammaire Les présentatifs.
– Lexique La vie littéraire.
La littérature.
– Phonétique Les consonnes géminées.
Socioculturel
– Le journal télévisé.
– Le prix Nobel de littérature.
– L’autobiographie.
– Le Clézio.
Voyages, voyages
Comprendre des émissions de radio et des enregistrements : peut compren-dre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou radio-diffusés, dont le sujet est un intérêt personnel et la langue standard clairement articulée.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
S’adresser à un auditoire : peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision.
Correction grammaticale : communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle général, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
Le priX noBeL De LittÉratUre
•pages 52 et 53
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
( 93
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer et décrire l’image. (C’est un téléviseur allumé. À l’écran, on voit une femme [une présentatrice, une journaliste] en gros plan. En bas, à gauche, on observe le logo de la chaîne (TF1). À droite, en gros plan, on voit un rectangle rouge, avec une accroche : « PRIX Nobel de Littérature 2008 »] surmontée d’une médaille en or qui représente un homme de profil : Alfred Nobel. En bas de l’écran on peut lire les paroles de la journaliste.)– Demander : « Vous avez déjà entendu parler de ce Nobel ? ». (Réponses variables. Réponse attendue : C’est le nom d’un prix international donné à des personnalités scientifiques, littéraires…)– Demander : « À votre avis, de quoi parle la journaliste ? ». (Elle présente le prix Nobel de littérature 2008.)
DOCUMENT 1
compréhension globale
Activité 1 • page 52
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Faire l’activité en grand groupe.– Demander aux apprenants de justifier leurs réponses. (1. La journaliste dit « bonsoir et bienvenue dans le journal de TF1 ». 2. J.M.G. Le Clézio a reçu le prix Nobel de litté-rature. 3. Elle dit « nous entendrons sa première réaction dans un instant ». 4. Il est le 14e Français à recevoir ce prix.)
compréhension finalisée
Activité 2 • page 52
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter une deuxième fois l’enregistrement. Faire l’activité en grand groupe.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. Dans l’actualité ce soir, le prix Nobel de littérature attribué à Jean-Marie Le Clézio. L’écrivain de 68 ans est le 14e Français à obtenir cette consécration après Claude Simon ou Albert Camus. Nous entendrons sa première réaction dans un instant.
Corrigé
1. Vrai / 2. Faux / 3. Vrai / 4. Vrai
Activité 1
Corrigé
Il a 68 ans. Il a reçu le prix Nobel de littérature.
Activité 2
94 )
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
DOCUMENT 2
compréhension globale
Activité 3 • page 53
Déroulement (3 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement. (Réponses libres.)– Faire observer et identifier le document. (C’est la biographie de Le Clézio.)
compréhension finalisée
Activité 4 • page 53
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants lire le document. Par deux, ils choisissent les faits importants. Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.
Activité 5 • page 53
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Pour la mise en com-mun, l’enseignant note les réponses des élèves au tableau et leur demande de justifier.
DOCUMENT 3
compréhension globale
Activité 6 • page 53
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. – Faire identifier le document. (C’est un message de J.M.G. Le Clézio. Il parle de la litté-rature, du roman, du romancier.)
réponsEs possiblEs
Il est né à Nice en 1940, il a fait des études en Angleterre, il publie un livre à 23 ans, il a beaucoup voyagé (Thaïlande, Mexique, États-Unis, Corée), il a vécu avec des Indiens, il enseigne dans une université américaine, il a publié plus de 50 livres…
Activité 4
réponsEs possiblEs
Aventurier : il a beaucoup voyagé, il a vécu dans la jungle.Humaniste : il a vécu avec des Indiens, il a étudié le maya.Intellectuel : il a fait de longues études, il est professeur à l’université, il a écrit beaucoup de livres.Simple : il ne vit pas dans le luxe.Curieux : il s’intéresse à beaucoup de choses : les langues, l’histoire…
Activité 5
Mon message c’est très clair, c’est qu’il faut continuer à lire des romans, parce que je crois que le roman est un très bon moyen d’interroger le monde actuel et... sans avoir de réponse qui soit trop trop heu… schématique, trop automatique. c’est… heu… un romancier c’est pas un philosophe, c’est pas c’est pas un technicien du langage parlé c’est quelqu’un qui écrit avant tout et qui au moyen du roman pose des questions. Je crois que s’il y a un message que je voudrais livrer c’est celui-là : posez des questions.
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
( 95
compréhension finalisée
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Poser la première question de l’activité. Faire écouter l’enregistrement une deuxième fois si nécessaire.
Réflexion sur le fonctionnement de la langueDemander : « Comment il délivre son message ? ». (Il utilise les expressions de la néces-sité : « il faut » + infinitif et l’impératif.)
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Poser la deuxième question de l’activité.– Demander : « Pour lui, qu’est-ce qu’un romancier est, et n’est pas ? ». Noter la répon-se donnée par les élèves au tableau. (« un romancier, c’est pas un philosophe, c’est pas un technicien du langage parlé, c’est quelqu’un qui écrit avant tout et qui, au moyen du roman, pose des questions. »)– Demander aux apprenants d’observer la phrase et de dire comment elle est organisée. (« Ce n’est pas » + nom et « c’est quelqu’un qui » + verbe.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : caractériser.
exercice
Voir Cahier d’exercices, exercice 1, p. 54.
Production orale
Activité 7 • page 53
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire les questions de l’activité et laisser les apprenants s’exprimer librement.
Activité 8 • page 53
Déroulement (25 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant interroge chaque groupe.– Demandez à la classe : « Écoutez vos camarades et notez ce qu’ils ont défini et comment. »
Corrigé
Il a un message pour le lecteur (« Il faut continuer à lire des romans ») et un message pour le lecteur et le romancier (« posez des questions »).« Le roman est un très bon moyen d’interroger le monde actuel […] sans avoir de réponses trop schématiques, trop automatiques. »
Activité 6
96 )
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Écriture créative : peut raconter une histoire.
Correction grammaticale : communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle général, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle.
Maîtrise du vocabulaire : montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémen-taire mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.
cadre de référence B1
Le DÉsert
•pages 54 et 55
Objectifs Communication
– Comprendre un extrait du livre « Le Désert », de Le Clézio.
– Raconter, de façon « littéraire ».
Linguistique
– Grammaire Le passé simple dans le récit littéraire.
– Lexique Le désert.
– Phonétique Les consonnes géminées.
Socioculturel
– Le Clézio.
– Écrire une lettre.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Faire observer et décrire les images. (On voit, en image de fond, un désert avec une grande dune. À droite, une photo montre des hommes assis dans le désert. En bas, à gauche, une autre photo montre des dromadaires.)– Demander : « Vous êtes déjà allés dans un désert ? Si oui, lequel ? Qu’avez-vous ressenti ? ».
( 97
compréhension globale
Activité 1 • page 54
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Faire observer et identifier le document. (C’est un extrait d’un roman de Le Clézio qui s’appelle Le Désert.)– Lire la consigne et laisser les apprenants lire le document. Faire l’activité, en grand groupe, à l’oral.– Demander : « Où se passe l’histoire ? ». (Dans le désert, à côté de la ville de Smara. Smara se trouve peut-être dans le Sahara, dans le monde islamique puisqu’on parle d’un cheikh.)
Activité 2 • page 54
Déroulement (15 min)
Réflexion sur le fonctionnement de la langue
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Poser la question de l’activité en grand groupe.– Demander aux apprenants de prendre connaissance des encadrés Pour communi-quer et structurer : Le passé simpLe dans Le récit Littéraire et Le passé simpLe et refor-muler les règles.
Activité 3 • page 55
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : individuellement.
– Lire la consigne a) ainsi que la consigne b) et laisser les apprenants choisir entre deux sujets d'expression écrite.– Les apprenants écrivent le courriel et lisent leurs productions devant la classe.
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
Corrigé
Le texte est écrit à la troisième personne.Le personnage s’appelle Nour.C’est un enfant (il parle de son père et son frère).Ça se passe la nuit.
Activité 1
Corrigé
il a pu ➝ il putil a entendu ➝ il entenditil s’est levé ➝ il se levail s’est réveillé ➝ il se réveillail a vu ➝ il vitil a compris ➝ il compritil a commencé ➝ il commençail a découvert ➝ il découvritil s’est approché ➝ il s’approchaC’est un temps simple et pas composé, c’est le temps qui fait avancer le récit. Pour le verbe pouvoir, ça ressemble au participe passé. Les verbes du premier groupe se terminent par « a », les verbes du 3e groupe en « endre » et « ir » se terminent par « it ».
Activité 2
( 97
98 )
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois une interview (enquête).Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. C’est une enquête sur : /1w le prix Nobel w la littérature w les habitudes de lecture
2. La femme accepte de répondre : (2 réponses) /3w parce que le sondage ne dure pas longtempsw parce qu’elle a du temps librew parce qu’elle est étudiantew parce qu’elle a aussi fait des sondages quand elle était étudiante pour gagner de l’argent
3. Cochez les questions posées par l’enquêteur. /2,5w Est-ce que vous aimez lire ?w Est-ce que vous lisez ?w Qu’est-ce que vous lisez ?w Pour quelles raisons vous lisez ?w Écoutez-vous les conseils de vos amis ?w Comment choisissez-vous vos livres ?w Vous lisez des magazines ?w La lecture est-elle un sujet de conversation avec vos amis ?w Prêtez-vous des livres à vos amis ?
4. La femme qui répond lit : (5 réponses) /2,5w tous les romans des auteurs qu’elle apprécie
w des articles scientifiquesw des magazinesw des bandes dessinéesw des journauxw tous les livres qui ont reçu le Prix Nobelw certains livres conseillés par ses amisw tous les livres conseillés par ses amis
5. Elle conseille parfois des livres à ses amis. /1Vrai w Faux w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le Journal des ados
Qu’est-ce que le prix Nobel ?
Le prix Nobel est une récompense internationale qui existe depuis 1901. Il récompense chaque année des personnes qui ont apporté à l’humanité quelque chose d’important dans différents domaines : il peut s’agir de découvertes scientifiques, d’une œuvre littéraire impressionnante ou d’une action pour la paix.Le prix Nobel tire son nom du scientifique suédois Alfred Nobel qui, à la fin de sa vie, demanda que sa fortune serve à créer une institution qui récompense chaque année des personnes qui ont accompli une grande chose dans un domaine spécifique.Les gagnants se partagent un montant de 10 millions d’euros dont ils font ce qu’ils veulent mais qui doit leur permettre de continuer leurs travaux.
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
( 99( 99
SÉQUENCE 9SÉQUENCE 9
test d’évaluation type DELF B11. Cet article parle d’une compétition sportive. /1Vrai w Faux w
2. Le prix Nobel récompense des personnes dans le monde entier. /1Vrai w Faux w
3. Le prix Nobel est décerné pour des travaux dans trois domaines. Lesquels ? /31. : ………………………………………………………2. : ………………………………………………………3. : ………………………………………………………
4. Pourquoi ce prix s’appelle Nobel ? /3………………………………………………………………………………………………………………
5. Chaque gagnant reçoit 10 millions d’euros. /1Vrai w Faux w
6. Les gagnants sont obligés d’utiliser la somme pour financer leurs travaux. /1Vrai w Faux w
Production écrite : /10
Tu as vu cette affiche dans le métro. Tu écris un mail aux organisateurs pour leurs demander des renseigne-ments sur cet événement. (60 mots).
Entretien dirigé : /10
Et toi, quelles sont tes habitudes de lecture ? Réponds aux questions du sondage de la compréhension orale. Ton professeur ou un autre élève te pose les ques-tions.
Source : http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pdf/DossierPresse08.pdf
100 )
Le projet, par son résultat concret à obtenir, constitue l’approche
actionnelle du module.
Le projet reprend tous les objectifs du module, toutes les compétences
travaillées à travers une série de tâches contextualisées à réaliser,
lors desquelles les apprenants vont être amenés à interagir.
Le projet s’articule en trois parties : une mise en route pour permettre
aux apprenants d’entrer dans la thématique et présenter le projet
qu’ils vont réaliser ; une activité de réception pendant laquelle les
apprenants vont (re)mobiliser les moyens linguistiques et fonctionnels
nécessaires à la réalisation du projet et se placer dans le contexte
situationnel ; la réalisation du projet lui-même lors de laquelle chaque
groupe travaillera en autonomie guidée.
Le temps imparti à chaque étape n’est qu’une estimation et peut, bien
entendu, varier selon les classes.
•pages 56 et 57
z Mise en route– L’enseignant présente le projet : expliquer aux élèves qu’ils vont réaliser une interview pour le journal ou le site de leur collège.– En grand groupe, demander : « À votre avis, quelles vont être les différentes étapes pour réaliser cette interview ? ». (Choisir une personne à interviewer, la contacter pour lui demander son accord, préparer les questions à lui poser, rencontrer et interviewer la personne, rédiger l’interview.)– Demander aux apprenants de se mettre en sous-groupes de deux ou trois.
Tu réalises une interview pour le journal ou le site de ton collège
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habi-tuels ou non en relation avec son domaine ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations.
S’adresser à un auditoire : – peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps ;– peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était trop rapide.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
cadre de référence B1
( 101
z 1re tâche : Réception d’informations
1re étApE - 1 • page 56
Déroulement (15 min)
Compétence mise en œuvre : expression orale.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants travailler en sous-groupes. Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les noms donnés au tableau. (De gauche à droite et de haut en bas : Jet Li, Ellen Mac Arthur, Milla Jovovich, Nelson Mandela, Sophie Marceau, Barack Obama, J. K. Rowling, Bill Kaulitz, Salma Hayek.)– Demander : « Pourquoi ces personnes sont connues ? Qu’est-ce qu’elles font ou ont fait ? ». (- Jet Li est un acteur qui pratique les arts martiaux, - Ellen MacArthur est skipper, - Milla Jovovich a été top model et est maintenant actrice, - Nelson Mandela a lutté contre l’apartheid en Afrique du Sud et a été président de la République sud-africaine de 1994 à 1999, - Sophie Marceau est une actrice française, - Barack Obama est le président des États-Unis, - J. K. Rowling est l’auteur de Harry Potter, - Bill Kaulitz est le chanteur de Tokio Hotel, - Salma Hayek est actrice.)– Ajouter : « Vous aimeriez les interviewer ? Pourquoi ? ». (Réponses libres.)– Demander quel est le point commun de ces personnes. (Ce sont des personnalités publiques qui on été ou sont souvent interviewées.)
z 2e tâche : Préparation de l’interview
2e étApE - 2 • page 57
Déroulement (30 min)
Compétences mises en œuvre : expressions écrite et orale.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.
a.Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité en sous-groupes. Pour la mise en commun, en grand groupe, chaque groupe présente la personne choisie et explique à la classe pourquoi elle a été choisie. b.– Lire la consigne et laisser chaque groupe rédiger les questions. Pour la mise en com-mun, en grand groupe, chaque groupe désigne un rapporteur qui présente les questions à la classe. – Demande à la classe de donner son avis sur les questionnaires et procéder, si néces-saire, à des modifications ou des corrections.
102 )
z 3e tâche : Réalisation de l’interview
3e étApE - 3 • page 57
Déroulement (20 min)
Compétences mises en œuvre : expressions écrite et orale.
Modalités : en sous-groupe de quatre ou cinq.
a.Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en dehors de la classe. Lors de la séance suivante, chaque sous-groupes présente le jour, l’heure et le lieu du rendez-vous pour faire l’interview.b.Lire la consigne et demander aux apprenants de prendre les décisions en classe. L’enseignant note le rôle de chacun. Chaque sous-groupe réalisera l’interview en-dehors de la classe. L’enseignant fixe la date d’une séance pour la prochaine étape du projet.
4e étApE - 4 • page 57
Déroulement (1 heure)
Compétence mise en œuvre : expression écrite.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité. Au sein de chaque sous-groupe, la rédaction de l’article se fait en commun et les élèves peuvent se répartir la mise en page, la réalisation des illustrations (photo, dessin…).
Pour la mise en commun :– l’enseignant accroche les articles et demande à la classe de voter pour élire les meilleurs (les plus complets, les plus originaux, les mieux présentés, les mieux écrits…),– si le collège est doté d’un journal ou d’un site, proposer à l’équipe de rédaction de publier une ou plusieurs interview(s).
ÉvaluationÉvaluation
( 103
Modalités : individuellement.
•pages 58 et 59
Activité 1 • page 58
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 2 • page 58
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 3 • page 58
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Corrigé
- Sébastien : Est-ce que je peux sortir demain ?- Le père : Non, parce que tu n’as pas fini tes devoirs.- Sébastien : Je les finirai dimanche.- Le père : Qu’est-ce que tu veux faire ?- Sébastien : Du skateboard.- Le père : J’ai peur qu’il ne fasse pas beau demain.- Sébastien : Ça ira !- Le père : Bon, c’est d’accord.
Activité 1
Corrigé
Pour garder le contact avec mes amis à l’étranger et dans d’autres villes, j’utilise un site de réseau sur internet. Je suis membre du site, et j’ai ma propre page où je mets ce que je veux. Mais pour la voir il faut être mon « ami ». Si je veux que quelqu’un devienne mon « ami », je lui envoie une invitation. S’il accepte, il a accès à ma page, et vice versa. Quand je veux partager quelque chose avec mes amis, les photos d’une fête ou d’une sortie par exemple, je la publie. On se fait plein d’amis, c’est pour ça qu’on l’appelle un réseau social. Tout le monde le fait maintenant, c’est très branché.
Activité 2
Corrigé
Vendredi dernier, je suis allée au concert de Sum 41 avec Mathilde et Anne-So. J’avais trouvé les billets sur internet. On est arrivées quarante minutes avant le début, mais quand même il y avait déjà beaucoup de monde. Au début, un autre groupe a chanté. Mais nous n’avons pas aimé et nous n’avons pas écouté. Quand Sum 41 est arrivé, tout le monde est devenu fou.Mathilde et Anne-So ont pris plein de photos avec leurs portables, mais moi j’avais oublié le mien à la maison. Malheureusement, on était trop loin de la scène, et on n’a pas bien vu. En plus j’ai perdu ma carte de métro. Mais quand même, j’ai adoré !
Activité 3
Activité 4 • page 58
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 5 • page 59
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 6 • page 59
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
104 )
ÉvaluationÉvaluation
Corrigé
Je suis allée au cinéma hier. Nina et Théo sont venus aussi. Nous nous sommes retrouvés devant le ciné. Nous sommes entrés ensemble, et nous nous sommes mis devant. Théo avait déjà vu le film, mais pas moi, ni Nina. J’ai bien aimé Scarlett Johansson dans ce film, mais Nina l’a détestée. Après le film, nous avons mangé ensemble, nous nous sommes parlé de plein de choses. Puis Théo est parti, et je suis restée un peu avec Nina. Nous nous sommes parlé, puis nous sommes rentrées à la maison. J’ai passé une très bonne journée.
Activité 4
Corrigé
1. Oui, je la lui ai donnée.2. Non, je ne le lui ai pas envoyé.3. Oui, je les lui ai montrées.4. Non, je ne le connais pas.5. Oui, je veux te les donner.
Activité 5
Corrigé
a.Réponses possibles : Un bon professeur, ce n’est pas forcément un professeur qui parle beaucoup, c’est un professeur qui laisse parler les élèves.- Un film effrayant, ce n’est pas forcément un film avec beaucoup de meurtres, c’est un film avec du suspens.b.Réponses possibles : - Pour protéger l’environnement, il faut recycler les déchets.- Pour avoir des amis, il faut aller vers les autres.
Activité 6
ÉvaluationÉvaluation
( 105
Activité 7 • page 59
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 8 • page 59
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Corrigé
C’est une histoire très compliquée. Il y a un espion qui travaille pour une organisation secrète. On lui donne une mission hyper dangereuse : infiltrer un groupe. Les méchants veulent détruire quelque chose de très important, mais on ne sait pas quoi. Sa mission, c’est d’apprendre quel est leur objectif. L’espion est joué par un acteur beau et musclé dont je ne sais plus le nom. Il rencontre une femme magnifique et ensemble ils essaient de…
Activité 7
Corrigé
Horizontalement : 1 : chaleur / 2 : braséro / 3 : tapis / 4 : thé / 5 : lune / 6 : tente
Verticalement : A : campement / B : cailloux / C : arbustes / D : sable / E : cheikh / F : bouilloires
Activité 8
108 )
Comprendre une interaction entre locuteurs natifs : peut généralement suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa présence.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
Objectifs Communication
– Comprendre un débat sur l’Union Européenne (UE).
– Exprimer son accord / son désaccord.
– Exprimer son accord avec restriction.
– Donner son point de vue.
– Proposer / suggérer.
Linguistique
– Grammaire L’indicatif/le subjonctif. Le conditionnel.
L'expression de but.
– Lexique L’opinion. L’accord/le désaccord. Le point de vue.
– Phonétique La prononciation de « plus ».
Socioculturel
– Citoyen européen.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander : « Que connaissez-vous de l’Europe ? » (Réponses variables.)– Faire identifier la photo. (On voit des élèves dans une classe avec un professeur.)
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10 De la discussion jaillit la lumière
POUR OUVRIR LE DÉBAT
•pages 62 et 63- Le professeur : Pour ouvrir le débat, une question simple : l’Union européenne, c’est quoi pour vous ? Clara ?- Clara : Pour moi, l’Europe, c’est très important. C’est bien pour l’égalité entre les pays et pour la paix.- Charles : C’est sûr que c’est important mais j’ai l’impression qu’on fait pas grand-chose. On devrait faire de l’Europe un pays sans frontières, ça ferait avancer les choses !- Jules : Ah, oui ! Je suis d’accord avec Charles ! On aurait une vraie puissance à présenter en face des États-Unis.- Le professeur : Euh Jules ! On parle seulement de l’Europe, pas de jugement envers les autres pays, s’il te plaît ! Élise ? Tu veux dire quelque chose ?- Élise : Ben moi, je trouve que l’Europe, ça sert à rien. Je ne me sens pas concernée par l’Europe. Je me sens beaucoup plus française qu’européenne.- Jules : Ah, non ! je suis pas d’accord ! Comment tu peux dire ça ! L’Europe, ça fait progresser culturellement car il y a plus de mélange. Ça permet de voyager et d’étudier dans d’autres pays. C’est très important ! Et avec l’euro, c’est plus facile !- RaChida : N’importe quoi ! Avec l’euro, tous les prix ont augmenté et il n’y a que 14 pays sur 27 qui l’utilisent. En plus, moi, je ne pense pas que la priorité de l’Europe soit un échange culturel entre les peuples. Je crois que c’est seulement économique ; gagner toujours plus d’argent !- Clara : C’est vrai mais ce progrès économique a quand même aidé des pays à se développer, à atteindre un meilleur niveau de vie.- Jules : Exactement ! Sauf qu’il n’y a pas que l’Europe dans le monde ! Il faudrait aussi aider les autres pays dans les autres continents. Citoyen européen, c’est bien, mais citoyen du monde c’est encore mieux !- Élise : Oui ! ben, là, tu rêves un peu !- Le professeur : Bien, bien. Justement, est-ce que vous pensez que l’Union européenne doit s’agrandir ? Est-ce qu’il faut accueillir d’autres pays ou se limiter à 27 ?- Élise : Je connais même pas les 27, alors s’il y en a d’autres !
( 109
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10compréhension globale
Activité 1 • page 62
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter le dialogue. Demander : « Qu’est-ce que vous avez entendu ? ». (Un débat entre des élèves animé par un professeur.)– Demander : « À votre avis, c’est un prof de quoi ? » (D’histoire ou d’éducation civi-que.)a.– Poser la question en grand groupe.
compréhension finalisée
b.
– Poser la question en grand groupe.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré les expressions pour exprimer son accord / son désaccord.
Activité 2 • page 62
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.Lire la consigne et faire écouter le dialogue une deuxième fois. Les apprenants font l’ac-tivité individuellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, l’enseignant note leurs réponses au tableau.
Activité 3 • page 63
Déroulement (20 min)
Compétences travaillées : compréhensions orale et écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire écouter le dialogue une troisième fois. Les apprenants font l’activité individuellement puis vérifient, par deux, en lisant le dialogue. Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Corrigé
a. L’Union européenne. Les étudiants donnent leur opinion.b. Les élèves ne sont pas tous d’accord. Ils disent « c’est sûr », « je suis d’accord », « c’est vrai », « exactement », mais d’autres disent « je ne suis pas d’accord », « n’importe quoi », « tu rêves un peu », « comment tu peux dire ça ! ».
Activité 1
Corrigé
Les échanges culturels / la paix / les échanges économiques / les études / les voyages / le niveau de vie / l’aide aux pays en difficulté / l’élargissement de l’Europe.
Activité 2
110 )
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10– Demander aux apprenants de relever les expressions qui donnent un point de vue posi-tif et celles qui donnent un point de vue négatif. L’enseignant souligne les expressions. (Point de vue positif : c’est très important, c’est bien pour…, ça fait progresser, ça permet de voyager. Point de vue négatif : ça sert à rien, je ne me sens pas concernée.)– Demander aux apprenants de relever les expressions pour dire qu’on n’est pas complè-tement d’accord. L’enseignant souligne les expressions. (C’est sûr que c’est important, mais… / c’est vrai, mais…)– Leur demander de relire la transcription pour trouver une autre expression qui donne un point de vue positif mais avec une restriction. L’enseignant note la réponse au tableau. (Exactement ! Sauf que…)– Leur demander de prendre connaissance de l’encadré les expressions pour exprimer son accord avec une restriction et donner son point de vue (positif / négatif).
b. Déroulement (15 min)
Réflexion sur le fonctionnement de la langue
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe : l’enseignant souligne les expres-sions relevées par les élèves.– Demander : « Vous connaissez d’autres expressions pour donner son point de vue ? Elles sont suivies du subjonctif ou de l’indicatif ? ». (Je pense que… est suivie de l’indi-catif et je ne crois pas que… est suivie du subjonctif.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : donner son point de vue : l’indicatif ou le subjonctif et reformuler les règles d’utilisation.– Demander : « Pour les suggestions, quel est le mode utilisé et pourquoi ? ». (Le condi-tionnel parce que dans les suggestions, les propositions ne sont pas des faits réels mais des faits imaginés.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : faire une proposition, une suggestion : le conditionnel et reformuler la règle.
exercice
Activité 4 • page 63
Déroulement (15 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Corrigé
1. Il fait des économies pour acheter un vélo.2. Elle a préparé le repas pour que ses enfants puissent manger.3. Il fait son lit pour que la chambre soit propre quand ses amis arriveront.4. J'ai lavé la voiture pour que mon père me donne de l'argent de poche.5. Nous nous sommes réveillés pour finir notre devoir.
Activité 4
Corrigé
a. Point de vue positif : Pour moi, l’Europe, c’est très important. C’est bien pour l’égalité entre les pays et pour la paix.L’Europe, ça fait progresser culturellement car il y a plus de mélange. Ça permet de voyager et d’étudier dans d’autres pays. C’est très important ! Et avec l’euro c’est plus facile !C’est vrai, mais ce progrès économique a quand même aidé des pays à se développer, à atteindre un meilleur niveau de vie.Point de vue négatif : C’est sûr que c’est important, mais j’ai l’impression qu’on fait pas grand chose.Je trouve que l’Europe ça sert à rien. Je ne me sens pas concernée par l’Europe.Avec l’euro tous les prix ont augmenté et il n’y a que 14 pays sur 27 qui l’utilisent. En plus, je ne pense pas que la priorité de l’Europe soit un échange culturel entre les peuples. Je crois que c’est seulement économique. Gagner toujours plus d’argent !Suggestions (propositions) : On devrait faire de l’Europe un pays sans frontières, ça ferait avancer les choses !On aurait une vraie puissance à présenter en face des États-Unis.Il faudrait aussi aider les autres pays dans les autres continents.b.Pour moi, j’ai l’impression que, je trouve que, je crois que… sont suivies de l’indicatif. Je ne pense pas que… est suivie du subjonctif.
Activité 3
( 111
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10Production écrite
Activité 5 • page 63
Déroulement (25 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant note les idées des élèves au tableau ou demande à des élèves de venir les noter dans la grille.
Exemple de grille
Point de vue positif Point de vue positif avec restriction
Point de vue négatif Suggestion
Production orale
Activité 6 • page 63
Déroulement (25 min)
Modalités : en sous-groupes de quatre ou cinq.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes : ils mettent en place leurs arguments. Puis, en grand groupe, l’enseignant organise un débat entre les différents sous-groupes.– Demander à la classe : « Écoutez vos camarades et notez une expression pour exprimer son accord, une pour exprimer son désaccord et une pour exprimer son accord avec une restriction. ».
112 )
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Tours de parole : peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier en utilisant une expression adéquate pour prendre la parole.
Faire clarifier : peut demander à quelqu’un de clarifier ce qui vient d’être dit.
S’adresser à un auditoire : – peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision ;– peut gérer les questions qui suivent.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
L'auto volante
•pages 64 et 65
Objectifs Communication
– Comprendre un article de magazine relatant l’histoire d’une invention technologique.
– Dater un événement historique.
– Indiquer des dimensions.
– Indiquer une vitesse.
– Convaincre : exprimer avec certitude un événement futur.
– Indiquer le futur immédiat d’un événement.
Linguistique
– Grammaire Le futur simple.
Le futur antérieur.
– Lexique Les dimensions. La vitesse. L’aviation.
– Phonétique La prononciation de « plus ».
Socioculturel
– L’autogire, une invention européenne.
( 113
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer les images et formuler des hypothèses. (Ces sont des sortes de véhicu-les volants. Il y en a un qui est ancien, il ressemble à un petit avion. L’autre modèle est moderne et ressemble à la fois à une moto et à une voiture.)– Demander : « À votre avis, est-ce que ce véhicule existe ? Est-ce qu’on peut l’ache-ter ? ». (Réponses variables.)
compréhension globale
Activité 1 • page 64
a.
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser lire les apprenants. Faire l’activité en grand groupe.
b.
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en commun, l’enseignant demande à des élèves de venir au tableau pour dessiner l’auto volante et localiser les différents éléments.
Exemple de document légendé.
Corrigé
a. L’article parle d’une auto volante qui pourra être achetée en 2011.b. Voir document légendé.c. Réponses variables.d. L’article parle effectivement d’une auto volante, qui s’appelle le Pal-V. Il parle aussi d’un autogire inventé en 1923.Un autogire.e. Comme une moto ou une voiture, le Pal-V peut rouler sur la route, mais comme un hélicoptère ou unavion, il peut aussi voler.f. 3 heures ( 600 km à 200 km/h)
Activité 1
L’hélice
Le rotor
Les roues
Le toit
Les pales
c.
Déroulement (3 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
Poser la question de l’activité.
d.
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la première partie de la consigne et laisser lire les apprenants. Faire l’activité en grand groupe.– Lire la deuxième partie de la consigne et faire l’activité en grand groupe.
e.
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré les mots de … l'aviation.– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l'activité.– Mettre en commun en grand groupe.
f.
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de répondre à la question en justifiant leur réponse.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré les expressions pour indiquer une vitesse.
g.
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré les expressions pour indiquer des dimensions.
114 )
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10
( 115
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10Schéma du Pal-V
1 mètre
4 mètres
1,60 mètres
Activité 2 • page 65
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite, expression écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Pour communiquer et structurer : Le futur antérieur et d'expliquer la formation et l'emploi du futur anté-rieur à l'aide des exemples donnés.– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l'activité individuellement.– Mettre en commun en grand groupe et au tableau.
Production orale
Activité 3 • page 65
Déroulement (15 min)
Modalités : en grand groupe.
Lire les questions de l’activité et laisser les apprenants s’exprimer librement.
Activité 4 • page 65
Déroulement (15 min)
Modalités : un ou plusieurs sous-groupe(s) de quatre ou cinq.
Demander aux apprenants de faire cette activité en dehors de la classe (en bibliothèque, à la maison). Ils devront prévoir de présenter ce travail sous forme d’exposé lors d’une séance ultérieure.
Corrigé
Quand j'aurai fini ce livre, je m'en achèterai un autre.Quand elle sera arrivée à Paris, elle s'installera dans un hôtel.Quand ils seront rentrés, nous commencerons la réunion.
Activité 2
116 )
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois une interview.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. C’est une émission radio qui parle de l’Europe. /1Vrai w Faux w
2. Cette émission s’adresse : /1w aux adultes w aux adolescentsw à tout le monde
3. Quelle est la profession de la personne interviewée ? /2w Historien w Archéologue
4. Il est interviewé au sujet du peuplement : /1w de l’Afrique w de l’Europe
5. D’où venaient les premiers européens ? /1………………………………………………………
6. Les premières traces d’activité humaine en Europe datent de : /1w plus d’un milliard d’annéesw plus d’un million d’annéesw plus d’un millier d’années
7. Philippe Gardère parle de deux théories. Quelle est l’ancienne ? Quelle est la nouvelle ? /2
8. Quelle théorie retient Philippe Gardère ? /1w l’ancienne w la nouvelle
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le Journal des ados Les premiers pas de la voiture…
en Europe !C’est un Français, un certain Étienne Lenoir, qui crée, en 1860, le premier moteur à explosion. Pour expérimenter son moteur, il l’installe sur une voiture rudimentaire et parvient à rouler 12 km ! Malheureusement, faute de moyens matériels et financiers, Lenoir se voit dans l’obligation d’abandonner ses recherches.Le premier « vrai » moteur à quatre temps est mis au point par deux ingénieurs allemands, Daimler (1872) et Benz (1882) qui, chacun de leur côté, cherchent à vendre leur brevet en France. En 1889, le moteur de Daimler est installé par Panhard et Levassor sur une voiture à quatre places.À partir de cette date, l’automobile va progresser très rapidement dans tous les pays.C’est aussi à cette date que commencent les mésaventures de la voiture ! Les routes ne sont pas encore aménagées et la signalisation n’existe pas, le démarrage du moteur est très difficile et les conditions climatiques, comme la pluie, sont redoutées puisque les voitures ne sont pas couvertes.Mais toutes ces difficultés ne font pas peur aux passionnés qui veulent faire découvrir à tout le monde « la voiture sans chevaux », comme on la surnomme à l’époque. Pour cela, ils organisent des courses comme la Paris-Rouen qui a lieu, pour la première fois, en 1894.Le mot « automobile » n’apparaît que plus tard. L’Académie française en fait d’abord un mot masculin et à l’époque on dit un automobile. Le mot est déclaré féminin en 1896.
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Préparation : 5 minutes Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
Le peuplement de l’Europe s’est fait :
Nouvelle théorie
Ancienne théorie
– par le détroit de Gibraltar.– par la Turquie.
( 117
SÉQUENCE 10SÉQUENCE 10
test d’évaluation type DELF B11. C’est un article sur l’histoire du moteur. /1Vrai w Faux w
2. La première voiture a été construite par : /1w Lenoirw Daimlerw Panhard et Levassor
3. Remets les événements dans l’ordre chronologi-que. (Numérote de 1 à 4.) /2La mise au point du premier moteur à quatre temps. ………….Les 12 premiers km de la voiture. ………….La première course de voitures. ………….La première voiture à quatre places. ………….
4. Cite deux problèmes rencontrés par les premières voitures. /21. ……………………………………………………….. ou ………………………………2. ………………………………ou ………………………………
5. Les voitures étaient couvertes dès le début. /1Vrai w Faux w
6. Comment s’appelait la voiture à l’origine ? /2………………………………………………………
7. Actuellement, on dit : /1w un automobile w une automobile
Production écrite : /10
Selon toi, quels sont les avantages et les inconvé-nients des unions de pays (comme l’Union euro-péenne) ?
Écris un texte pour le journal ou le site internet de ton collège dans lequel tu donnes ton opinion. (60 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu dégages le thème soulevé par le document et tu présentes ton point de vue sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
« L’Europe est un état composé de plusieurs pro-
vinces. » (Montesquieu)
118 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
Comprendre une interaction entre locuteurs natifs : peut généralement sui-vre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa présence.
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
C’EST QUOI TON SIGNE ?
•pages 66 et 67- Dylan : Qu’est-ce que tu regardes ? Jennifer ?- Jennifer : Mon horoscope.- Dylan : N’importe quoi ! Tu crois à l’astrologie maintenant ?- Jennifer : Ben, oui ! Si je l’avais regardé la semaine dernière, je ne t’aurais pas emprunté ton cyclo !- Dylan : De toute façon, je ne te le prêterai plus ; mon père ne veut pas payer l’amende, je ne peux pas le récupérer.- Jennifer : C’est quoi ton signe ? Je vais voir si ça va s’arranger et si on va te le rendre...- Dylan : Pff… je suis Cancer, mais j’y crois pas à ton truc !
Objectifs Communication
– Prêter / emprunter un objet.
– Comprendre un horoscope.
– Faire des constats ; faire des prédictions ; donner des conseils.
– Parler de quelque chose / quelqu’un que l’on ne connait pas.
Linguistique
– Grammaire Le présent dans les constats
Le futur et le futur proche dans les prédictions
L’impératif dans les conseils.
– Lexique Le prêt / l’emprunt
L’horoscope : les signes ; la vie sociale ; la chance ; les études ; le cœur.
– Phonétique Les virelangues.
Socioculturel
– L’horoscope.
Qui ne risque rien n'a rien
( 119
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer et décrire la série de photos. (Des jeunes [Jennifer et Dylan] discutent. Jennifer lit un magazine.)– Demander : « À votre avis, qu’est-ce qu’elle lit ? ». (Elle peut lire un article sur une vedette, sur la musique, sur la beauté, sur la mode ; en fait, elle lit son horoscope…)
compréhension globale
Activité 1 • page 66
Déroulement (4 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire écouter le dialogue. Poser la question de l’activité et laisser les apprenants donner leur réponse pour le premier item.– Demander : « Qu’est-ce que c’est l’horoscope ? ». (Des textes qui disent aux personnes ce qui va leur arriver en fonction de leur signe astrologique.)– Demander quel est le signe de Dylan. (Il est cancer.)
compréhension finalisée
Activité 1 • page 66 (suite)
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Faire la suite de l’activité en grand groupe.– Demander aux apprenants de justifier leurs réponses. Faire écouter le dialogue une troisième fois. Ils prennent des notent individuellement puis comparent leurs réponses avec leur(e) voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données ou demande à des élèves de venir les noter.(2. Elle dit « Si je l’avais regardé la semaine dernière, je ne t’aurais pas emprunté ton cyclo » / 3. Il dit « Je n’y crois pas à ce truc ». / 4. Il dit que son père ne veut pas payer l’amende et qu’il ne peut pas le récupérer.)
Corrigé
1. Vrai / 2. Faux / 3. Faux / 4. Faux
Activité 1
( 119
120 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11compréhension globale
Activité 2 • page 66
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
– Faire identifier le document. (C’est un horoscope. Il donne des prévisions sur la vie sociale, la chance, les études, le cœur pour quatre signes : Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Pour les huit autres, il n’y a pas d’information.)– Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe : chaque apprenant donne son signe. (Réponses variables.)
Activité 3 • page 67
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants lire l’horoscope du Cancer. Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.
Activité 4 • page 67
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité individuellement puis comparer leurs réponses avec leur voisin(e). Mettre en commun, en grand groupe, à l’oral.– Demander : « Dans un horoscope, il y a quels types d’informations ? ». (Des constats, des prédictions et des conseils.)
compréhension finalisée
Activité 5 • page 67
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement, en sous-groupes et en grand groupe.
Organisation– Pour une réalisation plus dynamique et rapide de cette activité, l’enseignant peut divi-ser la classe en quatre : chaque groupe s’occupera de l’horoscope d’un signe.
Corrigé
Il est plutôt pessimiste. D’après l’horoscope, ses problèmes ne vont pas s’arranger : « la chance n’est pas au rendez-vous ».
Activité 3
Corrigé
Les deux plus positifs : Bélier (il peut compter sur ses amis, tout va bien dans ses études, il va avoir de la chance et rencontrer l’amour) et Gémeaux (il est de bonne humeur et attire de nouvelles personnes, il n’a peur de rien, il réussit ses études, il est heureux en amour)Négatif : Taureau (il ne pense pas assez à ses amis, il n’a pas de chance mais elle va revenir, ça ne va pas très bien dans ses études mais il va recevoir l’aide de quelqu’un)
Activité 4
( 121
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
Corrigé
(réponse possible)Aujourd'hui, en France, il fera très beau au sud, avec des températures d'environ 20 degrés. Des nuagesau nord et à l'est et de la pluie à l'ouest.
Activité 6
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité individuellement en sous-groupes. Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Tableau de synthèse
Les constats Les prédictions Les conseils
Vous êtes énervéVos amis sont près de vousVous pouvez compter sur euxTout va bienLe travail c’est importantUne petite baisse de performanceQuelque chose ne vous plaît pasVotre bonne humeur attire de nouvelles connaissancesRien ne vous fait peur, vous avez raisonVous ne réclamez rien, c’est ce qui lui plaîtVous ne voulez voir personneLa chance n’est pas au rendez-vousPersonne ne fait attention à vous
Vous allez rencontrer quelqu’unElle va revenir bientôtQuelqu’un va vous aiderLes professeurs vous féliciteront pour vos efforts
Soyez patientContinuezPréparez-vousPensez aussi à vos amisIl faut attendre un peuParlez-enNe vous déconcentrez pasAttention aux examens !Soyez plus souriant.
Réflexion sur le fonctionnement de la langue– Demander aux apprenants d’observer le tableau et de dire quelles conjugaisons on utilise pour faire des constats, faire des prédictions et donner des conseils.(Pour faire des constats : le présent.Pour faire des prédictions : le futur simple, le futur proche.Pour donner des conseils : l’impératif et il faut + infinitif.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : faire des constats, faire des prédictions, donner des conseils.
Activité 6 • page 67
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et dire aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Pour communiquer et structurer : parler du temps qu'il fait.– Demander aux apprenants de travailler par deux et de préparer le bulletin météorolo-gique pour la France.– Mettre en commun en grand groupe.– Prolongement possible; apporter une carte de Serbie et faire des prévisions météoro-logiques pour les différentes villes.
( 121
122 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
Production orale
Activité 7 • page 67
Déroulement (25 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes. Pour la mise en commun, en grand groupe, chaque groupe désigne un rapporteur pour rendre-compte de la discussion à la classe.
Production écrite
Activité 8 • page 7
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes. Pour la mise en commun, chaque sous-groupe peut accrocher ses horoscopes sur les murs de la classe pour que tout le monde puisse les lire.
ExEmplE dE produCtion
Scorpion24 octobre - 22 novembreVie sociale : Vous allez vous disputer avec quelqu’un.Chance : Elle ne vous sourit plus ! Soyez patient.Études : Vous raterez tous vos examens. Travaillez plus !Cœur : Personne ne vous aime et vous n’aimez personne.Sagittaire23 novembre - 21 décembreVie sociale : Vos amis vous adorent !Chance :Rien de mal ne peut vous arriver.Études : Personne ne réussit mieux que vous! Vous allez rafler toutes les bonnes notes.Cœur : Quelqu’un vous aime secrètement. Trouvez qui !
Activité 8
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
( 123
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Correction grammaticale : peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
cadre de référence B1
SI ON LISAIT DES BD
•pages 68 et 69
Objectifs Communication
– Comprendre des planches de BD sur des prédictions, des hypothèses. (Le Chat, Astérix).
– Faire des prédictions, des hypothèses (2).
– Faire des hypothèses dans le passé.
– Faire des reproches, exprimer des regrets (2).
Linguistique
– Grammaire Le conditionnel passé. (2)
« Si » + présent, futur.
« quand » + futur, futur.
« Si » + imparfait, conditionnel présent.
– Phonétique Les virelangues.
Socioculturel
– La BD « Le Chat ».
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Demander : « Vous connaissez des personnages de BD française ? ». (Réponses variables.)
124 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
Corrigé
C’est Le Chat (un homme avec une tête de chat), un personnage de Philippe Geluck. Sur la première planche (trois vignettes), il est sur la plage et il tient un coquillage. Sur les deux autres vignettes (doc. 2 et 3), il est assis dans un fauteuil, peut-être dans son salon, et (doc. 2) il boit.
Activité 1
– Demander : « Regardez ces planches, vous reconnaissez le personnage ? ». (Le Chat)– Leur demander s'ils ont déjà lu la BD du Chat. S'ils ont aimé et pourquoi. S'ils ont lu d'autres bandes dessinées ? Si oui, lesquelles ?
compréhension globale
Activité 1 • page 68
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et faire l’activité en grand groupe à l’oral.
Activité 2 • page 68
a. Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants lire. Faire l’activité en grand groupe à l’oral. (Réponses variables.)– Demander : « Quel est le point commun des paroles du Chat sur les trois docu-ments ? ». (Il parle de choses plus ou moins probables : il fait des hypothèses et des prédictions.)
compréhension finalisée
b. Déroulement (15 min)
Réflexion sur le fonctionnement de la langue
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité individuellement puis compa-rer leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.– Demander aux apprenants de relever la construction de chaque phrase et de dire ce que ces constructions expriment. (Si + imparfait, conditionnel présent : une hypothèse et un résultat peu probable.Quand + futur, futur : une prédiciton probable.Si + présent, futur : une hypothèse possible et un résultat probable.)– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’encadré Pour communiquer et structurer : faire des prédictions, des hypothèses et reformuler les règles.
Corrigé
Si j’étais très très très riche, je distribuerais mon argent jusqu’à ne plus être que très riche.Quand je serai très riche, je payerai quelqu’un pour faire mon jogging à ma place. Si tu ramasses un coquillage et que tu le portes à ton oreille, tu entendras la mer. Si tu le portes à ta poitrine, il entendra ton coeur.
Activité 2
( 125
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
compréhension globale
Activité 3 • page 69
Déroulement (10 min)
Modalités : par deux et en grand groupe.
– Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'activité par deux. Pour la mise en com-mun, l'enseignant note les réponses données au tableau ou demande aux apprenants de venir les noter.
Production écrite
Activité 4 • page 69
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes. Puis procéder à la mise en commun et au vote en grand groupe.
Activité 5 • page 69
Déroulement (30 min)
Compétence travaillée : expression écrite.
Modalités : en sous-groupes et en grand groupe.
– Lire la consigne et former des sous-groupes.– Dessiner la grille suivante au tableau et demander aux apprenants de venir au tableau la compléter à tour de rôle.
Nom Verbe Adjectif Adverbe Nombre Connecteur
– Demander aux apprenants d'écrire leur histoire. Évaluer les productions après la lec-ture.
Corrigé
Si je gagne au loto, j'achèterai une moto.Si je gagnais au loto, j'achèterais une moto.Quand je gagnerai au loto, j'achèterai une moto.
Activité 3
( 125
126 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11Pour votre information
Le ChatPersonnage de bande dessinée créé par Philippe Geluck. il est apparu pour la première fois le 22 novembre 1983 dans un supplément du journal belge Le Soir. il s’agit d’un chat, vêtu comme un homme, qui s’adresse directe-ment au lecteur sur un ton humoristique, la plupart du temps pour faire des jeux de mots.
Liste des albums :- Le Chat, casterman, 2001 - Le retour du Chat, casterman, 2001 - La vengeance du Chat, casterman, 2002 - Le quatrième Chat, casterman, 2002 - Le Chat au Congo, casterman, 2003 - Ma langue au Chat, casterman, 2004 - Le Chat à Malibu, casterman, 2005 - Le Chat 1999,9999, casterman, 1999 - L’avenir du Chat, casterman, 1999 - Le Chat est content, casterman, 2000 - L’affaire le Chat, casterman, 2001 - Et vous, chat va ?, casterman, 2003 - Le Chat a encore frappé, casterman, 2005 - La Marque du Chat, casterman, 2007 - Une Vie de Chat, casterman, 2008 Liste des best off’s : - Le meilleur du Chat, casterman, 1994 - L’excellent du Chat, casterman, 1996 - Le succulent du Chat, casterman, 1999 - Entrechats, Casterman, 1999
Astérix et ObélixBande dessinée créé par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo en 1959.il existe un site officiel : http://www.asterix.com/
Liste des albums :
Tome Titre Scénario Dessins Parution
1 Astérix le Gaulois Goscinny Uderzo 1961
2 La serpe d or Goscinny Uderzo 1962
3 Astérix et les Goths Goscinny Uderzo 1963
4 Astérix Gladiateur Goscinny Uderzo 1964
5 Le tour de Gaule Goscinny Uderzo 1965
6 Astérix et cléopâtre Goscinny Uderzo 1965
7 Le combat des chefs Goscinny Uderzo 1966
8 Astérix chez les Bretons Goscinny Uderzo 1966
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
( 127
9 Astérix et les Normands Goscinny Uderzo 1967
10 Astérix légionnaire Goscinny Uderzo 1967
11 Le Bouclier Averne Goscinny Uderzo 1968
12 Astérix aux Jeux Olympiques Goscinny Uderzo 1968
13 Astérix et le chaudron Goscinny Uderzo 1969
14 Astérix en Hispanie Goscinny Uderzo 1969
15 La Zizanie Goscinny Uderzo 1970
16 Astérix chez les Helvètes Goscinny Uderzo 1970
17 Le domaine des Dieux Goscinny Uderzo 1971
18 Les lauriers de césar Goscinny Uderzo 1972
19 Le Devin Goscinny Uderzo 1972
20 Astérix en corse Goscinny Uderzo 1973
21 Le cadeau de césar Goscinny Uderzo 1974
22 La grande traversée Goscinny Uderzo 1975
23 Obélix et compagnie Goscinny Uderzo 1976
24 Astérix chez les Belges Goscinny Uderzo 1979
25 Le grand fossé Uderzo Uderzo 1980
26 L odyssée d Astérix Uderzo Uderzo 1981
27 Le fils d Astérix Uderzo Uderzo 1983
28 Astérix chez Rahazade Uderzo Uderzo 1987
29 La rose et le glaive Uderzo Uderzo 1991
30 La galère d Obélix Uderzo Uderzo 1996
31 Astérix et Latraviata Uderzo Uderzo 2001
32 Astérix et la rentrée gauloise Goscinny, Uderzo Uderzo 2003
33 Le ciel lui tombe sur la tête Uderzo Uderzo 2005
Source : http://www.bdcentral.com/Asterix/albums_liste.php?champ=idalbum&ordre=Asc
128 )
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois une émission de radio.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. Vous venez d’entendre : /1w une interview w une chronique
2. Cette émission s’adresse : /1w aux adultesw aux adolescentsw à tout le monde
3. Charles Planel parle : /1w d’une voiturew d’un scooterw d’un engin à quatre roues
4. La Caisse-à-ado est une idée qui vient : /1w d’Asiew des États-Unisw d’Europe
5. La Caisse-à-ado peut accueillir : /1w 2 personnesw 3 personnesw 4 personnes
6. La Caisse-à-ado peut être conduite sans permis : /1Vrai w Faux w
7. La Caisse-à-ado est exclusivement réservée aux jeunes entre 16 et 18 ans. /1Vrai w Faux w
8. Cite un avantage et un inconvénient de la Caisse-à-ado. /3a. avantages : …………………………………………..…………………………………………………………..b. inconvénients : ……………………………………..…………………………………………………………..
Compréhension de l’écrit : /10
Lis l’article suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’infor-mation demandée.
Le Journal des ados Silence on tourne !
Des adolescents réalisent un court-métrage sur la sécurité routière.
D’après ces cinq ados, ce n’est pas simple de parler de sécurité routière à leurs camarades. Ben, Alice, Corentin, Marie et Fred ont donc décidé de tourner un court-métrage pour sensibiliser leurs amis aux conduites routières à risques. Âgés de 12 à 17 ans, et donc trop jeunes pour conduire, les cinq adolescents ne sont pas pour autant insensibles aux risques de la route : « Quand on fait la fête, mieux vaut rentrer à pied ou appeler ses parents ».Ils sont tous les cinq volontaires, se sont posé des questions et ont produit un vrai travail. Ils ont travaillé à l’écriture du scénario en compagnie d’une personne de l’association Bonne vue, spécialisée dans l’éducation à l’image, qui les a accompagnés lors du tournage et du montage du film.Le film sera présenté le 25 avril dans le cadre de « Non ! », événement axé sur la prévention routière et organisé par l’association Le Triangle.
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
( 129( 129
SÉQUENCE 11SÉQUENCE 11
test d’évaluation type DELF B11. Cinq ados vont réaliser un film d’1h30 sur la sécurité routière. /1Vrai w Faux w
2. Ils ont des difficultés à parler de sécurité routière avec : /1w leurs parentsw leurs amisw leurs parents et à leurs amis
3. Ils tournent ce court-métrage pour : /1w enseigner la sécurité routièrew passer leur permisw sensibiliser aux dangers de la route
4. Certains d’entre eux ont leur permis de conduire. /1Vrai w Faux w
5. Quel conseil donnent-ils aux jeunes qui font la fête ? /2…………………………………………………………
6. Ils ont choisi de faire ce film. /1Vrai w Faux w
7. Qu’ont-ils fait seuls ou avec l’aide de quelqu’un ? /1
8. Ce film sera diffusé dans le cadre d’un événement organisé par une association qui s’occupe : /2w de l’éducation à l’imagew de sécurité routièrew des adolescents
Production écrite : /10
Tu écris une lettre au courrier des lecteurs du Journal des ados pour donner ton opinion sur l’ac-tion de ces cinq jeunes et dire si tu te sens concerné par la sécurité routière. (60 mots)
Production orale : /10
Entretien dirigé
Tu conduis ? Tu as un deux-roues ?Si oui, quel conducteur es-tu : plutôt prudent ou pas ?Si non, tu aimerais en avoir un ? Pourquoi ? Imagine que tu en aies un : quel conducteur serais-tu : plutôt prudent ou pas ?Es-tu sensible à la sécurité routière ? Pourquoi ?Seuls Avec l’aide
de quelqu’un
Ils se sont posé des questions
Ils ont écrit le scénario
Ils ont fait le tournage
Ils ont fait le montage
130 )
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
Compréhension générale de l’oral : peut comprendre les points principaux d’une intervention.
Reconnaître des indices et faire des déductions : peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que le sujet soit familier.
Interaction orale générale : peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation avec ses intérêts.
Vocabulaire : possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne.
cadre de référence B1
LES FRANÇAIS, ICI ET AILLEURS
•pages 70 et 71Bonjour ! Je m’appelle Amélie Tremblay, je suis née à Montréal et je travaille comme professeur d’histoire à l’université de Montréal. Au Québec, on parle français mais il y a des petites différences comme les expressions, comme : « je vais barrer mon char » ou « ce film est quétaine ». Ça veut dire : je vais fermer la portière de ma voiture et ce film est fleur bleue. Bon eh bien, je vous attends à Montréal. Au revoir !
Alors je m’appelle Idir Minasri. Je travaille comme surveillant à l’Alliance française, depuis 35 ans, à l’Alliance. Et je continue jusqu’à 2010 et ça fait euh… je prends ma retraite, là. Voilà, il me reste encore une année. Je suis algérien kabyle et je suis rentré en France depuis 1973. Je continue ma retraite ici, à Paris. J’espère que je continue ma retraite ici, pour ma fille aussi parce que c’est là qu’elle est née, c’est là qu’elle est née, c’est là qu’elle fait ses études, donc je ne peux pas lui couper ses études. Bonjour en tamazight ? « Azul ! » Et en arabe ? « Sabahlher ! » Au revoir et merci !
Bonjour, je m’appelle Pauline. J’ai 25 ans. J’habite à Genève, en Suisse. Je suis étudiante. À Genève, on a quelques expressions qui sont différentes de la France comme par exemple : « je vais faire nono » qui veut dire je vais dormir ou encore : « je vais me bâcher » ; ça veut dire : je rentre. Au revoir !
Oui, euh... bonsoir, Jean-Thierry euh je suis Flore-Sidonie Seri. Je suis née en Côte d’Ivoire euh, je suis à Paris depuis 17 ans. J’habite une banlieue proche de Paris, Garges-lès-Gonesse. Donc là, euh je suis d’un pays colonisé français, donc euh chez nous, on parle couramment le français, en Côte d’Ivoire euh mais il y a des expressions, des jeunes de maintenant. Comme exemple euh, je suis parti ou bien je m’en vais : « je vais béou » ou « j’ai béou » ce qui veut dire je suis parti. Et puis, pour dire il est costaud, il est grand, il est fort, on dit : « ah ! le bonhomme, il est diba », cela veut dire qu’il est costaud, il est « diba ». Voilà. Donc ce sont des expressions que les enfants, entre eux, ils savent et puis bon, les grands aussi savent parce que c’est courant. Voilà. Merci. Au revoir !
Je m’appelle Caroline, je suis originaire d’Haïti qui se trouve dans les grandes Antilles, ancienne colonie française où nous parlons français, évidemment. Alors, nous avons certaines expressions en créole, comme par exemple : « achté péyé preté remet sa fè ké zammi diré ».
Objectifs Communication
– Se sensibiliser à des accents français « régionaux ».
Linguistique
– Lexique Quelques expressions régionales.
– Phonétique Quelques accents « régionaux ».
Socioculturel
– Les accents « régionaux » du français.
sensibilisation
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
– Faire observer et identifier la carte du monde et les informations indiquées. (C’est une carte du monde. Les villes ou les pays indiqués en rouge ont un point commun : on y parle français, ce sont des pays de la Francophonie.)– Demander : « À votre avis, est-ce que c’est le même français qu’on parle dans tous ces endroits ? ». (Il y a sûrement une base commune mais il doit y avoir des différences de vocabulaires, d’accents…)
Activité 1 • page 70
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Il n'y a que le premier pas quicoûte
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
( 131
Alors, ça veut dire : les bons comptes font les bons amis. Voilà ! comme partout !
Bonjour ! Euh… je m’appelle Ali Saïd, je suis comorien. Euh… les Comores, ce sont des îles qui se trouvent dans l’océan Indien, entre Madagascar et l’Afrique. Aux Comores, on parle le français ; d’ailleurs, c’est la langue officielle et le comorien qui est un mélange de mots arabes, de mots français, quelques mots en anglais et des mots en portugais aussi. Euh… Comment ça va ?, on dit : « Ejé ». Ça va bien : « njema ».
Bon, alors, bonjour ! Alors je vais vous raconter mon histoire ; je m’appelle Coco, Marc Israbian, j’habite à la Réunion mais je suis né à Marseille. Alors, à Marseille, bien sûr, comme à la Réunion, on parle français mais il y a des petites expressions qu’on n’entend pas ailleurs. Alors, par exemple, « l’autre jour, sur mon cyclo, je chalais mon collègue, et comme il n’avait pas de casque, on s’est fait empêguer par les flics et on a été marron quoi ! ». Voilà ! donc, en français, à Paris, on aurait dit : je portais mon ami sur la selle derrière moi, en cyclomoteur et on s’est fait arrêter par la police. Voilà ! et ils nous ont mis une contravention. Au revoir !
Corrigé
Amélie Tremblay → Montréal, QuébecIdir Minasri → AlgériePauline → Genève, SuisseFlore Sidonie Seri → Côte d’IvoireCaroline → HaïtiAli Saïd → Les ComoresCoco, Marc Israbian → Marseille
Activité 2
Corrigé
Idir Minasri : vient d’Algérie et habite à Paris.Flore Sidonie Seri : vient de Côte d’Ivoire et habite une banlieue proche de Paris (Garges-lès-Gonesse).Coco, Marc Israbian : vient de Marseille et habite à la Réunion.
Activité 3
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’activité par deux. Mettre en commun en grand groupe, à l’oral. (Réponses variables.)
compréhension globale
Activité 2 • page 70
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement. Les apprenants font l’activité indivi-duellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Activité 3 • page 70
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : individuellement, par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement une deuxième fois. Les apprenants font l’activité individuellement puis comparent leurs réponses avec leur voisin(e). Pour la mise en commun, en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Activité 4 • page 70
Déroulement (5 min)
Compétence travaillée : compréhension orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et faire écouter l’enregistrement une troisième fois. Faire l’activité en grand groupe à l’oral. (Réponses variables.)
compréhension finalisée
Activité 5 • page 71
Déroulement (10 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite.
Modalités : par deux et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de travailler par deux. Pour la mise en com-mun en grand groupe, l’enseignant note les réponses données au tableau ou demande à des élèves de venir les noter.
Activité 6 • page 71
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants s’exprimer librement. (Réponses variables.)
Production orale
Activité 7 • page 71
Déroulement (15 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l’activité en sous-groupes. Pour la mise en commun, l’enseignant interroge chaque groupe, note les réponses au tableau et demande aux autres groupes s’ils connaissent ces expressions. (Réponses variables.)
132 )
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
Corrigé
Expressions qui utilisent des mots français :Je vais barrer mon char /Ce film est quétaine / Je vais faire nono / Je vais me bâcher / Les bons comptes font les bons amis / L’autre jour, sur mon cyclo, je chalais mon collègue, et comme il n’avait pas de casque, on s’est fait empêguer par les flics et on a été marron quoi! Expressions qui utilisent des mots d’autres langues : Azul (en tamazight)Sabahlher (en arabe)Je vais / J’ai béouLe bonhomme, il est dibaAchté péyé preté remet sa fè ké zammi diréEjéNjema
Activité 5
Tchat Mag
•pages 72 et 73
Activité 1 • page 72
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : compréhension écrite, expression orale.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de lire le texte Le bonheur se porte-t-il?– Leur demander: « Qu'est-ce qui est exprimé par les mots puisque et grâce à? » (La cause d'un évènement)– Dire aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Pour exprimer la cause.
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
( 133
Corrigé
Permettre toutes les réponses correctes, vu que plusieurs réponses sont possibles.
Activité 4
Activité 2 • page 72
Déroulement (15 min)
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Lire la consigne et demander aux apprenants de faire l'exercice individuellement.– Mettre en commun au tableau et en grand groupe.
Activité 3 • page 72
Déroulement (20 min)
Compétence travaillée : expression orale.
Modalités : individuellement et en grand groupe.
Lire la consigne et demander aux apprenants de préparer leur exposé individuellement.Les apprenants présentent leurs productions devant la classe.
Activité 4 • page 73
Déroulement (20 min)
Modalités : individuellement et en grand groupe.
– Demander aux apprenants de prendre connaissance de l'encadré Gramm'rappel et de réviser l'emploi des adjectifs possessifs et démonstratifs.– Leur demander de faire l'exercice individuellement.– Mettre en commun en grand groupe et au tableau.
134 )
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
test d’évaluation type DELF B1
Compréhension orale : /10
Tu vas entendre deux fois une interview.Lis d’abord les questions (1 minute).Première écoute : concentre-toi sur l’écoute, n’essaie pas de répondre à toutes les questions.Deuxième écoute : tu as quatre minutes pour répon-dre à toutes les questions.Réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
1. Cédric et Élise sont des camarades d’école. /1Vrai w Faux w
2. Qui a écrit à qui ? /1w Élise a écrit à Cédric w Cédric a écrit à Élise
3. Qu’est-ce qui a été écrit ? /1w une lettre w un poème w un mail
4. Pour quelle occasion ? /1w la Saint-Valentinw le Printemps de poètes
5. Élise connait cet événement. /1Vrai w Faux w
6. Cet événement s’adresse : /1w aux poètes w aux amoureux w à tout le monde
7. Le poème peut-être transmis : (4 réponses) /2w en le glissant sous la porte d’une maisonw en le publiant dans le journalw en le disant oralement w par la postew à l’école w dans la rue w dans un livre
8. Élise trouve que Cédric a du talent. /1Vrai w Faux w
9. Élise va écrire une lettre à Cédric. /1Vrai w Faux w
Compréhension de l’écrit : /10
Lis le bon de commande suivant puis réponds aux questions en cochant la réponse exacte (X) ou en écrivant l’information demandée.
Nature des épreuves
Compréhension oraleCompréhension des écritsProduction écriteProduction orale
Durée
10 minutes20 minutes20 minutes
Préparation : 5 minutes Passation : 5 minutes
Note totale :
Note sur
/10/10/10/10
/40
D’après le site http://www.printempsdespoetes.com/
( 135( 135
SÉQUENCE 12SÉQUENCE 12
test d’évaluation type DELF B11. Que peut-on commander avec ce bon de commande ? /1…………………………………………………………
2. Qu’est-ce qui est gratuit ? /1w L’affiche w Les frais d’envois
3. En 2009, le Printemps des poètes existe depuis : /1w 5 ans w 7 ans w 11 ans
4. Chaque année, le Printemps des poètes dure : /1w une semainew deux semainesw trois semaines
5. On ne peut pas commander plus de 107 affiches. /1Vrai w Faux w
6. Celui qui commande doit fournir l’enveloppe et les timbres. /1Vrai w Faux w
7. Quelles informations faut-il écrire sur le bon de commande ? /41. ……………………………………2. ……………………………………3. ……………………………………4. ……………………………………
Production écrite : /10
Tu as commandé une ou des affiche(s) du Printemps des poètes mais tu ne les as pas reçues ! Tu écris un mail au service réclamation dans lequel :– tu te présentes– tu rappelles les détails de ta commande (la date, le nombre d’affiches et les raisons de ta commande)– tu demandes des explications et un nouvel envoi– tu salues(60 mots)
Expression d’un point de vue : /10
Tu présentes le document et tu donnes ton point de vue sur cette manifestation sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. Le professeur ou un(e) camarade pourra te poser quelques questions.
« La poésie est le souvenir des meilleurs et des
plus heureux moments, des meilleurs et des
plus heureux souvenirs. » (Percy Bysshe Shelley,
Défense de la poésie)
136 )
Le projet, par son résultat concret à obtenir, constitue l’approche
actionnelle du module.
Le projet reprend tous les objectifs du module, toutes les compétences
travaillées à travers une série de tâches contextualisées à réaliser,
lors desquelles les apprenants vont être amenés à interagir.
Le projet s’articule en trois parties : une mise en route pour permettre
aux apprenants d’entrer dans la thématique et présenter le projet
qu’ils vont réaliser ; une activité de réception pendant laquelle les
apprenants vont (re)mobiliser les moyens linguistiques et fonctionnels
nécessaires à la réalisation du projet et se placer dans le contexte
situationnel ; la réalisation du projet lui-même lors de laquelle chaque
groupe travaillera en autonomie guidée.
Le temps imparti à chaque étape n’est qu’une estimation et peut, bien
entendu, varier selon les classes.
•pages 74 et 75
z Mise en route– L’enseignant présente le projet : expliquer aux élèves qu’ils vont réaliser une planche de bande dessinée à partir d’un fait divers.– En grand groupe, demander : « À votre avis, quelles vont être les différentes étapes de la réalisation de la planche ? ». (Prendre connaissance du fait divers, créer les per-sonnages, mettre en place le scénario, organiser la planche en vignettes et écrire le dialogue, dessiner les vignettes.)– Demander aux apprenants de se mettre en sous-groupes de trois ou quatre pour réaliser le projet.
Tu crées une planche de bande dessinée
Compréhension générale de l’écrit : peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension.
Interaction orale générale : – peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habi-tuels ou non en relation avec son domaine ;– peut échanger, vérifier et confirmer des informations.
S’adresser à un auditoire : peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps.
Production écrite générale : peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.
Écriture créative : peut raconter une histoire.
cadre de référence B1
( 137
z 1re tâche : Réception d’informations sur l’histoire à dessiner
1re étAPE - 1 • page 74
Déroulement (20 min)
Compétences mises en œuvre : compréhension écrite et expression orale.
Modalités : individuellement, en sous-groupes de trois ou quatre et en grand groupe.
Lire la consigne et laisser les apprenants lire individuellement.
a.Lire la consigne et faire l’activité en grand-groupe. L’enseignant note les réponses au tableau. (Le drapeau de l’Union européenne a été volé hier à Bruxelles par une personne dans un véhicule volant.)
b.Lire la consigne et faire l’activité en grand-groupe. L’enseignant note les réponses au tableau. (Le voleur, l’inspecteur Le Belge, trois témoins.)
c.Lire la consigne et faire l’activité en grand-groupe. L’enseignant note les réponses au tableau. (Avant le vol : 1er paragraphe / Pendant le vol : 2e paragraphe / Après le vol : 3e paragraphe.)
d.Lire la consigne et demander de faire l’activité en sous-groupes. Mettre en commun en grand-groupe.
Une onomatopée
Une vignette
Une bulle
e.Lire la consigne et demander de faire l’activité en sous-groupes. Mettre en commun en grand-groupe.(Vrrrrrrr → le bruit d’un moteur Han ! → la surpriseWahou ! → l’admirationAaaahhh ! → la peur)
138 )138 )
2e étAPE - 4 • page 75
Déroulement (1 heure)
Compétences mises en œuvre : expressions écrite et orale.
Modalités : en sous-groupes de trois ou quatre.
a.Lire la consigne et laisser les apprenants organiser leur planche. Ils choisissent la taille des vignettes et leur disposition sur la planche. Ils écrivent à l’intérieur de chaque vignette ce qu’ils vont y dessiner. Ils écrivent ensuite le dialogue qui sera placé dans les bulles.
b.Lire la consigne et laisser les apprenants réaliser leur planche.
4e étAPE - 5 • page 75
Déroulement (30 min)
Compétences mises en œuvre : expression orale.
Modalités : en grand groupe.
L’enseignant accroche les planches dans la classe. Chaque sous-groupe explique ses choix (taille des vignettes, passages de l’histoire dessinées, onomatopées…). Les appre-nants votent pour la meilleure planche.
ÉvaluationÉvaluation
Corrigé
Je pense que l’Europe est importante pour la paix.Je ne crois pas que l’Europe doive s’agrandir / soit juste faite pour gagner de l’argentPour moi, l’Europe c’est la possibilité de voyager. J’ai l’impression que l’Europe est importante pour la paix / que l’Europe c’est la possibilité de voyager.
Activité 1
ExEmplE dE réponsE
Je ne pense pas que l’astrologie, ce soit sérieux. Je pense que ce n’est pas important de connaître le signe astrologique de quelqu’un. Je ne crois pas que l’horoscope permette de prédire l’avenir et que ça puisse aider à prendre des décisions importantes.
Activité 2
ExEmplE dE réponsE
L’histoire du Concorde commence à la fin des années 1950 lorsque des entreprises britannique, française, américaine et soviétique veulent construire le premier avion civil supersonique.Dix-sept ans plus tard, le premier prototype français d’avion civil supersonique est présenté à Toulouse. Il mesure 62,19 m de long, 25,60 m de large, 12,19 m de haut et peut aller jusqu’à 2179 km/h.Le Concorde fait son premier vol le 2 mars 1969. Son premier vol commercial entre Paris, Dakar et Rio de Janeiro a lieu sept ans après. Le 31 mai 2003, le Concorde fait son dernier vol commercial sous les couleurs d’Air France. Trois ans auparavant, il y a un accident de Concorde près de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
Activité 3
Modalités : individuellement.
•pages 76 et 77
Activité 1 • page 76
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 2 • page 76
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 3 • page 76
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l’exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
( 139
140 )
ÉvaluationÉvaluation
Activité 4 • page 77
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 5 • page 77
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'exercice. Pour la mise en commun, en grand groupe, noter leurs réponses au tableau.
Activité 6 • page 77
Lire la consigne et laisser les apprenants faire l'exercice. Les apprenants présentent leurs productions devant la classe.
Corrigé
1. Dans quinze jours, nous aurons passé tous nos examens.2. Les travaux seront terminés dans trois semaines.3. Lorsque vous aurez lu le premier chapitre, nous commencerons le débat.4. Ne t'inquiète pas, lorsqu'elle sera arrivée elle nous téléphonera.5. Ne t'inquiète pas, il aura trouvé le moyen de résoudre son problème.
Activité 4
Corrigé
1. Comme il a trouvé un travail en France, il n'habite plus à Belgrade.2. La mère de Luc est triste parce qu'il ne lui téléphone pas assez souvent.3. Tout le monde est en retard à cause de la grève générale.4. Puisque tu es enrhumé, prends de l'aspirine.5. Il a arrêté de fumer grâce à un nouveau médicament.
Activité 5
( 141
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
•page 103
écoute
1 et c / 2 et b / 3 et a / 4 et e / 5 et d / 6 et f
Parle1. a. 1 syllabe : Non ! Ouille !2 syllabes : Au secours ! Allô ! 3 syllabes : Une question ? À tout de suite !4 syllabes : Absolument ! Bonjour docteur.5 syllabes : Félicitation ! Elle a des lentilles.6 syllabes : L’activité physique Vous avez des lunettes.b. Exemples d’autres mots de X syllabes : réponses libres.
2. tête gistela tête lo gistela la tête mo lo gistema la la tête tal mo lo gistela ma la la tête nof tal mo lo gistei la ma la la tête = il a mal à la tête un nof tal mo lo giste = un ophtalmologiste
•page 104
écoute
1. et 2. Transcription et réponses1. Je déteste la cantine ! 4. C’est pas bon pour la santé !2. Encore des haricots verts ! 5. Au moins cinq par jour !3. Tu as beaucoup de frites ! 6. Je prends une pomme !
Syllabes accentuées et liaisons Nombre de syllabes
1. Un ophtalmologiste2. Un dermatologue 3. Un ORL4. Un dentiste 5. Docteur ! 6. Aïe ! a. J’ai mal aux dents b. Une crème nettoyante c. Un savon dégraissant d. Ça pique ! e. Tout à fait ! f. Oui
654321456231
SÉQUENCE 1 Groupe et rythme
SÉQUENCE 2 L’ACCENT D’INSISTANCE
142 )
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
3. Oui, la dernière syllabe du groupe est toujours plus longue.
Parle
1. 2. 1. C’est dommage ! Ex : ce n’est pas possible. ➞ C’est impossible !2. J’adore le chocolat ! 1. Ce n’est pas juste. ➞ C’est injuste !3. Je déteste les légumes ! 2. Ce n’est pas mangeable. ➞ C’est immangeable !4. Tu manges encore des frites ! 3. Ce n’est pas buvable. ➞ C’est imbuvable !5. Tu manges trop de frites ! 4. Ce n’est pas poli. ➞ C’est impoli !6. Cinq légumes par jour ! C’est impossible ! 5. Ce n’est pas croyable. ➞ C’est incroyable ! 6. Ce n’est pas suffisant. ➞ C’est insuffisant !
•pages 104 et 105
écoute
Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez le sucre en poudre et le beurre mou (//). Remuez avec une cuillère en bois ou un batteur électrique (//). Quand le mélange devient léger et onctueux (/), ajoutez alors les œufs un à un en alternant avec la farine (//).
Parle
1. Pendant ce temps,(/) éplucher les pommes de terre,(/) les laver (/)et les couper (/)en quatres morceaux. (//)Les rajouter (/)dans la cocotte, (/)ainsi que les olives (/)et les champignons.(//)Fermer la cocotte (/)et laisser cuire (/)15 minutes (/)à feu moyen.(//)
2. Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre,(/) les laver et les couper en quatre morceaux. (//)Les rajouter dans la cocotte, (/)ainsi que les olives et les champignons.(//)Fermer la cocotte et laisser cuire 15 minutes à feu moyen.(//)
3. Moins de pauses possible : Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez le sucre en poudre et le beurre mou.(//) Remuez avec une cuillère en bois ou un batteur électrique.(//)
SÉQUENCE 3 LA LECTURE À VOIX HAUTE
( 143
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
Quand le mélange devient léger et onctueux, (/)ajoutez alors les œufs un à un en alternant avec la farine.(//)
•page 105
écoute 1
Le “e” prononcé [E]L’argent de poche, je n’en ai jamais assez ! Mes parents me donnent 15 euros tous les samedis, mais après le week-end, il ne me reste rien ! Dès le mercredi, je demande une avance ! Le vendredi, c’est terrible !
Parle
Le premier « e » se prononce [ è ] car il est suivi d’une consonne prononcée (« r ») dans la même syllabe.Le deuxième « e » se prononce [ e ] car il est final de syllabe : mer-cre-dimercredi = [ mèrkredi]
écoute 2
Le “e” muetL’argent de poche, je n’en ai jamais assez ! Mes parents me donnent 15 euros tous les samedis, mais après le week-end, il ne me reste rien ! Dès le mercredi, je demande une avance ! Le vendredi, c’est terrible !
Parle
L’argent de poche,(/) je n’en ai jamais assez ! (//)Mes parents (/) me donnent 15 euros (/) tous les samedis, (/)mais après le week-end,(/) il ne me reste rien ! (//)Dès le mercredi, (/) je demande une avance ! (//)Le vendredi, (/) c’est terrible ! (//)
•page 106
écoute
1.Ouf ! Comme papa, j’ai la chance d’être un garçon ! monteEuh ! Je ne sais pas ! monteHein ! C’est pas possible ! monteAh ? tu crois vraiment ? monteBof ! Ça m’est égal ! descendChouette ! Ça va être super ! monteZut ! J’ai oulié mes affaires ! monte
SÉQUENCE 4 Le [|--E--| muet ou prononcé ?
SÉQUENCE 5 L’INTONATION EXPRESSIVE – LES INTERJECTIONS
144 )
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
2.
agacement étonnement hésitation indifférence joie soulagement doute
Ouf ! x
Euh ! x
Hein ! x
Ah ? x
Bof ! x
Chouette ! x
Zut ! x
Parle
Ouh ! la-la ! C’est pas vrai ! (étonnement)Bof ! Je (ne) sais pas ! (indifférence)Ah ? les filles réussissent mieux ? (doute)Ouf ! Ça y est ! J’ai fini ! (soulagement)Euh ! Ce que je pense de l’égalité... ! (hésitation)Chouette ! Il vient avec nous ! (joie)Zut ! Zut ! Zut ! Il vient avec nous ! (agacement)
•pages 106 et 107
écoute
On entend [E]=[è] ou [ü]
[in], [èn], [jèn] ou [yn]
[Æ] [an] [ö] [ôn]
machiniste x
historienne x
Le jardin x
moins x
violoniste x
compositrice x
gantière x
historien x
urbaniste x
une amie x
un ami x
moine x
SÉQUENCE 6 LA DÉNASALISATION
( 145
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
Parle
1. il est bon elle est bonne 8. il est pharmacien elle est pharmacienne2. c’est son nom c’est son homme 9. il vient ils viennent3. c’est à Jean c’est à Jeanne 10. des européens des européennes4. il est à Caen il est à Cannes 11. les voisins les voisines5. au moins au moine 12. il est plein elle est pleine6. à chacun à chacune 13. il est humain elle est humaine7. un artiste une artiste
•pages 107 et 108
écoute
1. « l » 4. des années 7. rage2. « r » 5. des arrêts 8. nage3. « n » 6. des allées 9. l’âge
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[l] X X X
[n] X X X
[R] X X X
Parle
1.1. « l » « n » « r » 2. des allées des années des arrêts 3. l’âge nage rage 4. on lit on nie on rit
2.1. Elle rappelle Elle appellera Elle rappellera2. Elle nous dépanne Elle nous dépannera Dépanne-la3. C’est personnel C’est une information personnelle Informe-nous personnellement
3. Loulou : Salut Riri.Riri : Salut Loulou.Loulou : Tu lis ton mur ? Riri : J’ai reçu une photo d’Annabelle.Loulou : La soeur de Marie ? Riri : Oui. Une sacrée nana !Loulou : Elle n’a pas le téléphone ? Riri : Si ! elle nous téléphonera ce soir.Loulou : Sur le net ? Riri : Sûr ! Avec « Skype ».
SÉQUENCE 7 [l] - [n] - [R]
146 )
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
•page 108
écoute
1.
[e] [è]
1. Le quatrième X
2. Le dernier X
3. Le dernier X
4. Le thème X
5. La journée X
6. Appeler X
7. Mon père X
8. La liberté X
9. En rêve X
10. J’appelle X
11. Vous pouvez X
2. [e] s’écrit « é » et « e » + consonne muette[è] s’écrit « è », « ê » et « e » + consonne prononcée dans la même syllabe
écris
Des ados bien dans leur tête!D’après une récente étude, les 12-17 ans disent ne pas avoir de problèmes de santé. Ils consultent un médecin, généraliste le plus souvent, pour des affections bénignes, des actes de pré-
vention ou pour obtenir des certificats médicaux. La grande majorité des ados se sent bien à l’école malgré un sentiment de pression. L’école, le collège, le lycée semblent d’ailleurs avoir une influence considérable sur le
bien-être des jeunes.
•page 109
écoute
1. il attend il l’attend2. on va lire on va le lire3. il espéra il espérera4. un jus génial un juge génial5. Éva sert Éva se sert6. neuf hachés neuf fâchés 7. la lunette la lune nette8. madame a souri madame m’a souri9. il vend des livres ils vendent des livres10. il coupa il (ne) coupe pas
SÉQUENCE 8 « e », « é », « è », « ê ». [e] ou [è]
SÉQUENCE 9 LES CONSONNES GÉMINÉES
( 147
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
Parle
1. Quelle belle robe bleue ! (4 syllabes)2. Ce couteau ne coupe pas ! (6 syllabes)3. Elle vient de dîner ! (4 syllabes)4. Un tempête terrible ! (5 syllabes)5. De magnifiques côtes ! (5 syllabes)6. Un gag gai ! (3 syllabes)7. J’aime Marie ! (3 syllabes)8. Bonne nuit ! (2 syllabes)9. Un philosophe français ! (6 syllabes)10. Une cave verte ! (3 syllabes)11. De nombreuses années ! (5 syllabes)12. On se sent bien ! (3 syllabes)13. Le langage jeunes (4 syllabes)14. Une douche chaude ! (3 syllabes)15. Une belle langue ! (3 syllabes)16. Une première réaction ! (6 syllabes)
•pages 110 et 111
écoute
[ply] [plys]
Je me sens plus français qu’européen. x
Il y a plus de mélange x
En plus, je ne pense pas... x
Gagner toujours plus d’argent ! x
Un an plus tard... x
L’Europe n’est plus seulement économique x
Et trois ans plus tard... x
Plus facile à conduire qu’un avion ! x
beaucoup plus basse que les avions x
Parle
1. Je n’ai plus le temps. [ply]2. J’ai plus de temps. [plys]3. Je suis plus patient que toi. [ply]4. Tu es plus impatient que moi ! [plyz]5. En plus, tu ne travaille plus ! [plys], [ply]6. Et moi, je travaille plus ! [plys]7. J’ai plus d’amis que toi, tu aimerais bien en avoir plus ? [plys], [plys]
SÉQUENCE 10 LA PRONONCIATION DE « PLUS »
148 )
Activités de phonétiqueActivités de phonétiquecorrigés
•page 110
écoute
1. Six mules ont-elles bu là ? Oui, six mules ont bu là. Si six mules ont bu là, six cent six mules y boiront.2. Combien sont ces six saucissons-ci ? Ces six saucissons-ci sont six sous.Si ces six saucissons-ci sont six sous, ces six saucissons-ci ne sont pas chers !3. Natacha n’attacha pas son chat qui s’échappa. Cela facha Sacha qui chassa Natacha.4. Didon dîna, dit-on, de dix dodus dindons.De dix dos dodus de dix dodus dindons, Didon dîna dit-on.5. Madame Coutufon dit à Madame Foncoutu : « combien y a-t-il de Foncoutu à Coutufon? »Madame Foncoutu lui répondit : « il y a autant de Foncoutu à Coutufon que de Coutufon à Foncoutu ! »6. La cavale du valet avala l’eau du lac. L’eau du lac lava la cavale du valet. Le valet se lava dans l’eau salie du lac après que sa cavale se fut lavée au lac.7. Trois tortues trottaient sur trois étroits toits.Trottant sur trois toits très étroits, trottaient trois tortues trottant.8. Au luxe et à l’exquis, le fisc fixe chaque taxe fixe, exprès.9. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier.10. Mon thé t’a-t-il ôté ta toux ?Oui, ton thé a ôté ma toux !Ma toux a été ôtée par ton thé !
•page 110
écoute
C’est la fin de l’année scolaire, on part en vacances et on se repose !
Parle
1. standard2. méridional (sud-est)3. sud-ouest4. corse5. Suisse6. belge7. québécois8. « jeune » des cités en banlieue parisienne.
SÉQUENCE 11 LES VIRELANGUES
SÉQUENCE 12 QUELQUES ACCENTS !
( 149
DELF B1corrigés
PARTIE 1 •page 113
Compréhension de l’oral
EXERCICE 1
Lis les questions
Première écoute.La journaliste : « Passe ton diplôme d’astronaute junior », tel est le titre d’une animation que vous proposez aux enfants de 4 à 12 ans Bernard Burel, bonjour !Bernard Burel : Bonjour !La journaliste : Vous êtes directeur de la Cité de l’espace à Toulouse. Alors, en quoi consiste ce nouveau diplôme ?Bernard Burel : Et bien, nous invitons, effectivement, tous les enfants de 4 à 12 ans à venir passer leur diplôme, c’est-à-dire qu’on leur propose de passer des épreuves qui vont leur permettre de vérifier quelles sont toutes les compétences, les qualités que l’on doit réunir si on veut être un jour astronaute.La journaliste : Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de ces épreuves ?Bernard Burel : D’abord, il y a deux types d’épreuves, l’un pour les enfants de 4 à 6 ans et l’autre pour les 7 à 12 ans. Par exemple, pour les petits, on leur propose d’utiliser un bras manipulateur pour aller récolter des échantillons de roches martiennes. On voit la difficulté à manipuler ce bras, il faut coordonner ses mouvements et donc c’est une véritable épreuve qui est proposée aux enfants.La journaliste : Et en même temps, j’imagine que vous leur expliquer quel est l’intérêt de cette manipulation ?Bernard Burel : Tout à fait, donc on leur explique « Qu’est-ce qu’on fait » avec ces échantillons martiens qu’on récolte. Là, il y a tout un travail qui est fait par nos animateurs scientifiques, d’explication du pourquoi…La journaliste : Et du comment bien sûr. Un autre exemple ?Bernard Burel : Les enfants, il leur est proposé également de fabriquer leurs boissons à partir d’un produit lyophilisé. Donc, là encore, pourquoi utilise-t-on des produits lyophilisés dans l’espace.La journaliste : Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas emporter du liquide, tout simplement.Bernard Burel : Voilà, exactement, parce que c’est dangereux. Toutes ces gouttelettes peuvent, disons, altérer le bon fonctionnement de la station spatiale internationale. Donc on va utiliser plutôt des gélatines, des choses un peu consistantes, peut-être pas toujours très agréables à boire.La journaliste : Donc, de quoi leur expliquer que quand il n’y a pas de pesanteur l’eau ne peut pas couler.Bernard Burel : Exactement.La journaliste : C’était Bernard Burel, Directeur de la Cité de l’espace à Toulouse qui vous invite dès samedi à venir gagner votre diplôme d’astronaute mais pour en savoir plus une adresse : France-info.com, chronique, info sciences.
Deuxième écoute.« Passe ton diplôme d’astronaute junior », tel est le titre d’une animation que vous proposez aux enfants de 4 à 12 ans Bernard Burel, bonjour !Bonjour !
150 )
DELF B1corrigés
Vous êtes directeur de la Cité de l’espace à Toulouse. Alors, en quoi consiste ce nouveau diplôme ?Et bien, nous invitons, effectivement, tous les enfants de 4 à 12 ans à venir passer leur diplôme, c’est-à-dire qu’on leur propose de passer des épreuves qui vont leur permettre de vérifier quelles sont toutes les compétences, les qualités que l’on doit réunir si on veut être un jour astronaute.Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de ces épreuves ?D’abord, il y a deux types d’épreuves, l’un pour les enfants de 4 à 6 ans et l’autre pour les 7 à 12 ans. Par exemple, pour les petits, on leur propose d’utiliser un bras manipulateur pour aller récolter des échantillons de roches martiennes. On voit la difficulté à manipuler ce bras, il faut coordonner ses mouvements et donc c’est une véritable épreuve qui est proposée aux enfants.Et en même temps, j’imagine que vous leur expliquer quel est l’intérêt de cette manipulation ?Tout à fait, donc on leur explique « Qu’est-ce qu’on fait » avec ces échantillons martiens qu’on récolte. Là, il y a tout un travail qui est fait par nos animateurs scientifiques, d’explication du pourquoi…Et du comment bien sûr. Un autre exemple ?Les enfants, il leur est proposé également de fabriquer leurs boissons à partir d’un produit lyophilisé. Donc, là encore, pourquoi utilise-t-on des produits lyophilisés dans l’espace.Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas emporter du liquide, tout simplement.Voilà, exactement, parce que c’est dangereux. Toutes ces gouttelettes peuvent, disons, altérer le bon fonctionnement de la station spatiale internationale. Donc on va utiliser plutôt des gélatines, des choses un peu consistantes, peut-être pas toujours très agréables à boire.Donc, de quoi leur expliquer que quand il n’y a pas de pesanteur l’eau ne peut pas couler.Exactement.C’était Bernard Burel, Directeur de la Cité de l’espace à Toulouse qui vous invite dès samedi à venir gagner votre diplôme d’astronaute mais pour en savoir plus une adresse : France-info.com, chronique, info sciences.
(10 points)1. Une interview à la radio.2. Faux (il s’agit davantage d’une découverte pédagogique).3. De 4 à 12 ans.4. Deux types d’épreuves (selon l’âge).5. De 4 à 6 ans.6. Faux.7. Aller sur un site internet.
EXERCICE 2
Lis les questions
Première écoute. Tu veux passer ton diplôme d’astronaute junior ? Alors viens à la Cité de l’espace à Toulouse. Le jeu se déroule pendant les vacances scolaires. La Cité est ouverte 7 jours sur 7, de 9 heures et demie le matin à 6 heures le soir. Le jeu-concours est compris dans le prix de l’entrée, 13 E pour les enfants de 5 à 15 ans et 19,50 E pour les adultes. Les familles bénéficient d’un tarif réduit.
( 151
DELF B1corrigés
Deuxième écoute.(5 points)1. Faux.2. Vrai (pendant les vacances scolaires).3. de 9 heures et demie le matin (ou 9h30) à 6 heures le soir (ou 18h).4. Faux.5. Vrai.
EXERCICE 3
Lis les questions
Première écoute. Cédric : Salut Élodie ! Ça va !élodie : Salut Cédric !Super bien ! Tu ne devineras jamais ce que j’ai fait hier ! Cédric : Raconte !élodie : Je suis allée avec mes parents à la Cité de l’espace et… Cédric : C’est où la Cité de l’espace ?élodie : À Toulouse. Cédric : Toulouse ! Mais c’est super loin ! Tu y es allée toute seule ?élodie : Mais non, avec mes parents, on a mis 3 heures en voiture. Bon, je peux continuer ? Cédric : Vas-y !élodie : Là-bas, ils proposent un jeu-concours pour passer son diplôme d’astronaute junior ! Et je l’ai gagné ! Cédric : Tu es devenue astronaute ?élodie : Mais non, je suis trop jeune. C’est juste un parcours composé de 10 épreuves et si tu réussis, on te donne un diplôme signé par deux astronautes de l’Agence spatiale européenne. Cédric : C’est génial. Et qu’est-ce que tu as fait comme épreuves ?élodie : Alors, j’ai marché sur un sol martien dans un drôle de vêtement qui s’appelle un scaphandre-bulle. Là j’ai dû éviter des obstacles et crois-moi, c’est pas facile sur Mars ! Cédric : Tu es allée sur Mars ?élodie : Mais non, c’est juste une imitation des conditions sur Mars ! Cédric : Ah ! Je comprends.élodie : J’ai aussi testé la nourriture spatiale ! Cédric : Quoi ! T’as mangé de la nourriture de Martiens ?élodie : Mais non ! Tu dis vraiment n’importe quoi ! Dans l’espace, on ne peut pas manger comme sur Terre parce qu’il n’y a pas de pesanteur. Alors, la nourriture est en poudre ou alors sous forme de gel… Cédric : Beurk !élodie : En effet, ce n’est pas très bon. Je me suis aussi installée aux commandes d’un vaisseau spatial et j’ai dû deviner comment il fonctionne. Cédric : Toute seule, tu es trop forte ! élodie : Non avec un animateur-instructeur qui me donnait des conseils ! Et j’ai aussi participé à un quiz sur l’espace et devine quoi ? Cédric : Je sais, je sais, tu as trouvé toutes les réponses !
152 )
DELF B1corrigés
élodie : Exact.Cédric : Mais dis-moi, c’est pas plutôt pour les garçons ce jeu ?élodie : La parité, tu connais ?Cédric : Ouais ouais.
Deuxième écoute.(10 points)1. Amis.2. Faux.3. Vrai.4. 10 épreuves.5. Faux.6. Elle a marché sur un sol martien dans un drôle de vêtement ; testé la nourriture spatiale (poudre et gel) ; s’est installée aux commandes d’un vaisseau spatial, a répondu à un quiz… 7. On ne sait pas.
PARTIE 2 •page 116
Compréhension des écrits
EXERCICE 1
Corrigé type (10 points)
Film Justification
Marion Malto Alfonz (accepter aussi L’Inconnu)
0,5 point
Marion aime James Bond, et ce film a une organisation criminelle et une aventure dans plusieurs pays, comme dans James Bond.
2 points
Justine Le Crépuscule du loup (accepter aussi L’Inconnu
0,5 point
Justine aime les films d’horreur, et ce film fait peur. 2 points
Sami Les Sables de l’amour
0,5 point
Sami aime le camping, et ce film montre des images de la nature et des paysages africains.
2 points
Antoine Dino Danger 0,5 point
Antoine veut emmener des enfants au cinéma, et ce film est un film pour enfants. C’est probablement un dessin animé.
2 points
EXERCICE 2
1. Cet article parle d’un rapport qui suggère comment encourager le sport chez les Français. 1,5 point
( 153
DELF B1corrigés
2. On propose de mettre en place des activités sportives à l’école après les cours. 1,5 point3. Il conseille de se déplacer à pieds, à vélo.2 points4. 1. Faux / 2. Vrai / 3. Faux / 4. ?4 points5. 1. 12%. 2. L’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes) 3. hypertension, diabète (dépression, obésité, cancer) 4. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 5. 74% (Accepter les sigles pour le 2 et le 4) 6 points
PARTIE 3 •page 120
Production écrite
Grille du barème
Respect de la consignePeut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé.Respecte la consigne de longueur minimale indiquée.
0 0,5 1 1,5 2
Capacité à présenter des faitsPeut décrire des faits, des événements ou des expériences.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Capacité à exprimer sa penséePeut présenter ses idées, ses sentiments et/ou ses réactions et donner son opinion.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Cohérence et cohésionPeut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Compétence lexicale / orthographe lexicale
Etendue du vocabulairePossède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases.
0 0,5 1 1,5 2
Maîtrise du vocabulaireMontre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.
0 0,5 1 1,5 2
154 )
DELF B1corrigés
Maîtrise de l’orthographe lexicaleL’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent.
0 0,5 1 1,5 2
Compétence grammaticale / orthographe grammaticale
Degré d’élaboration des phrasesMaîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes.
0 0,5 1 1,5 2
Choix des temps et des modesFait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle.
0 0,5 1 1,5 2
Morphosyntaxes / orthographe grammaticaleAccord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales, etc.
0 0,5 1 1,5 2
TOTAL : 25 points
PARTIE 4 •page 121
Production orale
Grille du barème
1re partie : Entretien dirigé
Peut parler de soi avec une certaine assurance en donnant informations, raisons et explications relatives à ses centres d’intérêt, projets et actions.
0 0,5 1 1,5 2
Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance. 0 0,5 1
2e partie : Exercice en interaction
Peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante (respect de la situation et des codes sociolinguistiques).
0 0,5 1
Peut adapter les actes de parole à la situation. 0 0,5 1 1,5 2
Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue de l’autre, etc.).
0 0,5 1 1,5 2
( 155
DELF B1corrigés
3e partie : Expression d’un point de vue
Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer. 0 0,5 1
Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion personnelle. 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps.
0 0,5 1 1,5
Pour l’ensemble des trois parties de l’épreuve
LexiquePossède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases.Des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
MorphosyntaxeMaîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes.Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Maîtrise du système phonologiquePeut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles.La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
TOTAL : 25 points
156 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
Module 1 page 3
Séquence 1 - page 3
Exercice 1 page 3Le pédiatre soigne les enfants.
Le dentiste soigne les dents.
Le dermatologue soigne la peau, les cheveux, les ongles.
L’ORL soigne la gorge, le nez, les oreilles.
Le pharmacien vend des médicaments.
L’ophtalmologiste soigne les yeux.
Le pneumologue soigne les poumons.
Exercice 2 page 4Valentine : Tu as écouté l’émission « Quoi de neuf docteur »
hier soir ?
Stéphanie : Non, pourquoi ?
Valentine : C’était sur les yeux, très intéressant ! J’ai même
téléphoné pour poser une question à l’ophtalmologiste
qui était invité !
Stéphanie : Qu’est ce que c’est un ophtalmologiste ?
Valentine : Un médecin spécialiste des yeux. Je lui ai
demandé si la conjonctivite était une maladie.
Stéphanie : C’est quoi la conjonctivite ?
Valentine : C’est une infection des yeux très fréquente.
Stéphanie : Et alors, est-ce que c’est une maladie ?
Valentine : Oui mais c’est une maladie bénigne.
Stéphanie : Qu’est-ce que ça veut dire bénigne ?
Valentine : Sans gravité. Et un garçon a téléphoné pour
demander si la myopie était contagieuse et elle ne l’est
pas.
Stéphanie : Contagieuse, qu’est-ce que c’est ?
Valentine : Ça veut dire qu’on ne peut pas la transmettre à
d’autres personnes.
Stéphanie : Ah !
Valentine : Il a aussi dit à une fille qu’il fallait faire attention
avec le maquillage quand on portait des lentilles.
Stéphanie : Pourquoi ?
Valentine : Parce que si les produits ne sont pas bons, ils
peuvent favoriser les infections oculaires.
Stéphanie : Comment on peut savoir si les produits sont
bons ou pas ?
Valentine : Il faut les acheter dans une pharmacie, c’est
plus cher mais c’est mieux pour la peau ! Heureusement
que je l’ai écoutée, moi, l’émission !
Exercice 3 pages 4 et 5Tu te rends compte ! Elle porte des lunettes et elle n’a pas
écouté l’émission ! Heureusement que je l’ai écoutée, moi,
pour répondre à ses questions !
Elle m’a demandé ce qu’était un ophtalmologiste,
et ce qu’était la conjonctivite
et si c’était une maladie
et aussi ce que c’était bénigne
et ensuite ce que c’était contagieuse
et puis pourquoi il fallait faire attention avec le maquillage
quand on portait des lentilles
et enfin comment on peut savoir si les produits sont bons
ou pas.
Exercice 4 page 5Claire : Est-ce que la conjonctivite est une maladie ?
ValentineE : Oui, mais bénigne.
Claire : Est-ce que la myopie est contagieuse ?
ValentineE : Absolument pas ! Il n’y a aucun risque de
contagion.
Claire : Est-ce qu’on peut se maquiller avec des lentilles ?
Valentine : Eh bien c’est possible mais il faut acheter de
bons produits.
Claire : Les bons produits se trouvent en pharmacie ?
Valentine : Oui, tout à fait.
Exercice 5 page 5
Médecin Maladie Vue
ophtalmologiste – conjonctivite
– infections
oculaires
– les yeux
– les lentilles
– les lunettes
Exercice 6 page 61. L’alimentation comme facteur responsable de l’acné
n’est pas prouvé, mais/cependant certains dermatologues
pensent qu’elle peut avoir un effet.
2. Le maquillage n’est pas interdit quand on a de l’acné,
mais/cependant il faut éviter les produits trop gras et de
mauvaise qualité.
3. L’exposition au soleil améliore passagèrement l’acné,
mais/cependant par la suite, l’acné peut réapparaître et être
encore plus important qu’au début.
4. Certaines plantes semblent pouvoir traiter l’acné, mais/
cependant ce n’est prouvé.
Pour les activités de production libre, les corrigés sont des propositions.
( 157
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
Exercice 7 page 61. Ça pique !
2. Ça brûle !
3. Ça brûle !
4. Ça pique !
5. Ça pique !
6. Ça brûle !
Exercice 8 page 7T’es une nana super / top, ch’uis un mec super / top. C’est
nickel ! On est faits l’un pour l’autre !
Séquence 2 - page 8
Exercice 1 page 8
Menu équilibré Menu non équilibré
Entrée salade de tomates saucisson
Plat principal poisson / riz steak / frites
Dessert fruits gâteau au chocolat
Boisson eau soda
Exercice 2 page 8a. Une personne qui choisit le menu équilibré :
mange des tomates, du poisson, du riz, des fruits
et boit de l’eau
b. Une personne qui choisit le menu non équilibré :
mange du saucisson, du steak, des frites, du gâteau au
chocolat et boit du soda
Exercice 3 page 8J’aime les frites, le soda, les tomates…
Je n’aime pas le poisson, le saucisson…
Exercice 4 page 91. Il y a assez de frites.
2. Il n’y a pas de frites.
3. Il y a trop de frites.
4. Il y a beaucoup de frites.
5. Il y a un peu de frites.
Exercice 5 page 10Est-ce que tu manges :
- de la viande ? J’en mange / Je n’en mange pas
- du poisson ? J’en mange / Je n’en mange pas
- des légumes ? J’en mange / Je n’en mange pas
- des fruits ? J’en mange / Je n’en mange pas
- des gâteaux ? J’en mange / Je n’en mange pas
- des produits laitiers ? J’en mange / Je n’en mange pas
Est-ce que tu bois :
- de l’eau ? J’en bois / Je n’en bois pas
- du soda ? J’en bois / Je n’en bois pas
- du jus de fruit ? J’en bois / Je n’en bois pas
- du café ? J’en bois / Je n’en bois pas
- du thé ? J’en bois / Je n’en bois pas
- du lait ? J’en bois / Je n’en bois pas
Exercice 6 page 101. Des escargots, on en mange / on n’en mange pas
2. Des cuisses de grenouille, on en mange / on n’en mange
pas
3. Des moules, on en mange / on n’en mange pas
4. Du pain (de la baguette), on en mange / on n’en mange
pas
5. Une religieuse, on en mange / on n’en mange pas
6. Des frites, on en mange / on n’en mange pas
7. Des crêpes, on en mange / on n’en mange pas
Exercice 7 page 11Vignette A : Qu’est-ce que vous prendrez comme entrée ?
Salade de tomates ou pâté ? / Je voudrais une salade de
tomates, s’il vous plaît.
Vignette B : Et comme plat ? / Un steak avec des haricots
verts.
Vignette C : Vous avez assez de haricots verts ? / Oui, j’en
ai assez.
Vignette D : Et comme dessert ? / Je prendrai une mousse
au chocolat.
Exercice 8 page 12
C
S U R G E L E S
I N
T
S C R U S
O
N
S
E
F R A I S
V
E
Exercice 9 page 131. L’obésité s’étend dans le monde entier. Or / pourtant
ses conséquences peuvent être très graves pour la santé.
A
B
1
2
3
158 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
2. Les gens mangent peu de fruits et légumes. Or / pour-
tant il faut en manger au minimum cinq fois par jour.
3. Les Français trouvent les produits alimentaires trop
chers. Or / pourtant ils n’envisagent pas de diminuer leurs
dépenses en nourriture.
4. En France, on continue de manger assis autour d’une
table et en famille, contrairement à de nombreux pays où
cette habitude s’est perdue.
5. Les gens pensent que les légumes surgelés sont moins
bons pour la santé que les frais. Or / pourtant les méde-
cins assurent que les fruits et légumes ont des vertus pour
la santé qu’ils soient frais, crus, cuits ou surgelés.
6. Les Français préfèrent manger des produits sucrés au
petit déjeuner, contrairement aux Anglais qui préfèrent
manger des produits salés au petit déjeuner.
Exercice 10 page 14Retrouve les mots qui correspondent à des produits alimen-
taires. Il y a 3 boissons et 20 aliments.
A S O D A T A X N L I G W C A
H A R I C O T V E R T Q O H R
B L B Z U M I E L H R K M O F
C A J F P A T E Q U T C P C H
O D P J Y T R L B R M E V O K
M E O G O E U F Y G N R I L I
P A I W C I T R Q U S E S A L
O N S U R Y A O U R T A O T Q
T X S Q J L E M L P O L V J P
E H O I V O L A I L L E C U I
M U N G N L E G U M E Z R Q V
I P O M M E D E T E R R E B R
L A I T Z I O M S A H T M A S
V I A N D E M A O U Q I E I E
A N F C R K F E C U L E N T L
Exercice 11 page 14- Un petit déjeuner : un chocolat au lait, du pain avec du
miel, des céréales.
- Un déjeuner : une salade de tomate, de la volaille avec des
pommes de terre ou des pâtes, un yaourt.
- Un goûter : un yaourt, du lait, du pain avec du miel, une
compote.
- Un dîner : un œuf dur, du poisson avec des haricots verts,
une compote.
Séquence 3 - page 15
Exercice 1 page 151. en étant 6. en venant
2. en ayant 7. en choisissant
3. en faisant 8. en voulant
4. en visitant 9. en sachant
5. en se levant 10. en apprenant
Exercice 2 page 15La bande dessinée « Le droit à l’alimentation : une fenêtre
sur la planète » parle du droit de chaque être humain
d’être à l’abri de la faim en racontant huit histoires qui se
déroulent dans des pays et des cultures différents. Ces his-
toires nous donnent une leçon de solidarité en montrant comment les habitants d’un pays, en s’unissant, peuvent
résoudre des problèmes graves. Tous les récits insistent
sur la nécessité d’agir pour que tout le monde ait accès à
l’alimentation.
En lisant cette BD, on comprend que nous sommes tous
responsables de la protection et de la réalisation du droit à
l’alimentation pour tous.
Cette BD est accompagnée d’un guide qui propose des
activités pour apprendre en s’amusant et qui peut aider à
expliquer à d’autres personnes le problème de la faim et le
sens du droit à l’alimentation en apportant des informa-
tions supplémentaires utiles.
Exercice 3 page 16Exemple de slogan :
Gagnons le combat du droit à l’alimentation pour tous en
agissant maintenant !
Exercice 4 page 16Verticalement :
1. Les poumons se trouvent dans la cage thoracique ; ils
servent à respirer et il y en a deux.
2. La rate est située en haut à gauche de l’abdomen ; elle
joue un rôle important pour la pureté du sang.
3. Le ventre est au-dessous de la taille ; il contient l’esto-
mac et les intestins.
4. Le foie se trouve dans la partie supérieure droite de
l’abdomen ; il filtre et renouvelle le sang.
Horizontalement :
5. Les yeux sont les organes de la vue ; il y en a deux.
6. Le cœur est situé entre les deux poumons ; il bat !
7. La tête est la partie supérieure du corps humain ; elle
contient le cerveau.
( 159
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
8. Les membres sont au nombre de quatre : les bras, appe-
lés membres supérieurs, les jambes, appelées membres inférieurs.
P F
O O
Y E U X V I
M M E M B R E S
C O E U R N
N A T
S T R
T E T E
Exercice 5 page 18Vignette 2 :
Doc : Ah, vous avez mal au cœur ! / Patient : Non, docteur.
Ici ce n’est pas mon cœur c’est ma tête !
Vignette 4 :
Doc : Et c’est tout ? / Patient : Non, j’ai aussi mal ici. (Il
montre son ventre.)
Vignette 5 :
Doc : Ah, vous avez mal au poumon ! / Patient : Non, doc-
teur. Ici ce n’est pas mon poumon c’est mon ventre !
Vignette 7 :
Doc : Laissez-moi ausculter votre cœur. / Patient : Mais ça
n’est pas mon cœur ! Ce sont mes yeux ! Vous êtes sûr
que vous allez bien docteur ?
Exercice 6 page 191 : g / 2 : i / 3 : b / 4 : f / 5 : h / 6 : d / 7 : j / 8 : k / 9 : a /
10 : e / 11 : c
Exercice 7 page 19
Un réfrigérateur n° 5
Un verre n° 10
Une assiette n° 1
Un micro ondes n° 7
Une fourchette n° 3
Un couteau n° 4
Un batteur électrique n° 9
Un moule n° 6
Une cafetière n° 2
Un lave-vaisselle n° 8
Exercice 8 page 19Dessins libres.
Exercice 9 page 20Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Dans un saladier, battez les jaunes d’œufs et le sucre.
Ajoutez le beurre fondu, versez le chocolat et mélangez
bien. Incorporez la crème fraîche.
Mettez au frais pendant une heure.
Sortez du réfrigérateur. Faites à la main des petites
boules et roulez-les dans la poudre de cacao.
Module 2 page 21
Séquence 4 - page 21
Exercice 1 page 211. Oui, j’ai pas fait grand-chose.
2. Oui, c’était pas grand-chose.
3. Non, j’ai pas fait grand-chose.
4. Pas grand-chose.
5. Si, je m’en sors pas
6. Oui, je m’en sors pas.
7. Oh, c’était pas grand-chose.
8. Oui, et je m’en sors pas avec ça.
9. Non, je ne m’en sors pas.
10. Oh, pas grand-chose.
Exercice 2 page 21Pour être enfin libres, le mieux c’est de demander à tes
parents de t’ouvrir un compte. Tu pourras avoir une carte
de retrait à ton nom, pour retirer de l’argent dans n’importe
quel distributeur. Fini la dépendance ! Tu peux gérer ton
argent de poche comme tu veux ! Tu peux le dépenser ou le
garder pour avoir de quoi te payer tout ce que tu veux !
Exercice 3 page 21Par contre
Même si / Par contre
Par contre
Par contre
Par contre
Exercice 4 page 221. Elle va au cinéma, malgré son manque d’argent ou
Malgré le manque d’argent, elle va au cinéma.
2. Elle aime les films d’action, par contre il aime les histoires
d’amour.
3. Elle est forte en maths, par contre il est fort en français.
160 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
4. Malgré ses efforts, elle n’arrive pas à faire son exercice.
5. Malgré sa beauté, elle n’a pas de copain.
6. Leurs parents sont sévères pendant l’année scolaire, par
contre ils sont très cool pendant les vacances.
Exercice 5 page 23Réponses libres.
Exercice 6 page 232. Actuel
Porter une casquette, c’est actuel. Par contre, porter un
chapeau haut de forme, c’est démodé.
3. Démodé
Écrire des cartes postales, c’est démodé. Par contre, envoyer
des mails, c’est actuel.
4. Actuel
Tchater, c’est actuel. Par contre, téléphoner, c’est démodé.
5. Démodé
Aller au bal, c’est démodé. Par contre, aller en boîte de
nuit, c’est actuel.
6. Actuel
S’envoyer des mails, c’est actuel. Par contre, s’écrire des
lettres, c’est démodé.
7. Actuel
Porter des jeans, c’est actuel. Par contre, porter un cos-
tume, c’est démodé.
8. Actuel / Démodé
Réponse libre.
9. Actuel
Porter des tennis, c’est actuel. Par contre, porter des chaus-
sures en cuir, c’est démodé.
10. Actuel
Envoyer des textos, c’est actuel. Par contre, envoyer un
télégramme c’est démodé.
11. Actuel / Démodé
Réponse libre.
Exercice 7 page 24
o n t re
de
g a r d iminatoire
lé
e ncontre
er
d e
du
monde
epuoc
al
ballon
u terrain
ant c hams
ia s s e – c o ucp
a t p r o
➧
➧
➧
A
1
2
4
5
3
B C
E F
D
c
Exercice 8 page 251. Vrai ➝ Fils de gardien de but (...)
2. Faux ➝ Petit, j’étais un casse-cou sur le terrain,
je courrais partout avec le ballon.
3. Vrai ➝ En 1992, l’année de mes vingt ans (...)
4. Faux ➝ (...) j’ai signé mon premier contrat « pro », à
Saint-Étienne.
5. Faux ➝ (...) on m’avait donné ma première paire de
gants de gardien à 7 ans (...)
6. Faux ➝ (...) le gardien est le seul à ne pas jouer au
football.
7. Faux ➝ (...) ils avaient décidé que le meilleur du
moment serait désigné.
8. Faux ➝ Et la Coupe du Monde, c’est sept rencontres
(...)
Exercice 9 page 25avait gardé - avait donné - était allé - avait attiré -
s’étaient demandés - avaient décidé
Exercice 10 page 26avait eu - avait joué - avait vu - avaient hésité -
avait travaillé - avait trouvé
Exercice 11 page 261. J’ai eu une bonne note parce que j’avais préparé le
contrôle d’anglais avec Marc.
( 161
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
2. Le prof n’était pas content parce que je n’avais pas fait
les devoirs de maths.
3. On a gagné le match parce que nous avions passé des
heures à nous entraîner avec mon équipe de football.
4. J’étais fatigué pendant tout l’après-midi parce que
j’avais beaucoup mangé au déjeuner.
5. Je suis allé voir le film de Harry Potter la semaine
dernière parce que j’avais bien aimé le cinquième livre.
6. Je ne suis pas allé à sa fête parce que Julien ne m’avait
pas invité.
Exercice 12 page 27FAIRE : a. avait fait - b. a fait - c. faisait
JOUER : a. j’avais joué - b. je jouais - c. j’ai joué
SORTIR : a. est sorti - b. sortait - c. était sorti
Exercice 13 page 28Charlotte regarde le même nombre de DVD que Valentin.
Charlotte va davantage au théâtre que Valentin.
Valentin a davantage d’argent de poche que Charlotte.
Charlotte prend plus de temps pour s’habiller que Valentin.
Valentin est plus consciencieux que Charlotte.
Charlotte a autant d’amis que Valentin.
Charlotte a plus de converses que Valentin.
Charlotte dort plus que Valentin.
Exercice 14 page 28Les filles téléphonent davantage à leurs amis que les gar-
çons.
Les filles font moins de sport que les garçons.
Les filles consacrent un temps plus important aux loisirs
culturels que les garçons.
Les filles consacrent 2 heures aux tâches ménagères, contre
30 minutes pour les garçons.
Le temps que les filles consacrent à l’aide aux devoirs de
leurs petits frères et sœurs est aussi important que les
garçons.
Les filles passent autant de temps sur internet que les
garçons.
Elles se couchent à la même heure que les garçons.
Séquence 5 - page 29
Exercice 1 page 29Réponses libres.
Exercice 2 page 30a.1. D’une part, ils sortent le soir, d’autre part ils rentrent à
l’heure qu’ils veulent.
2. D’une part, ils veulent réussir leurs études, d’autre part ils
préfèrent avoir beaucoup de temps pour leurs loisirs.
3. D’une part, elles réussissent leurs examens, d’autre part
elles font des études plus longues.
b.1. Leurs parents sont compréhensifs. C’est pourquoi, ils
obtiennent ce qu’ils veulent.
2. Ils habitent dans le centre. C’est pourquoi ils n’ont
aucune difficulté pour rentrer le soir.
3. Les filles échouent peu au Brevet. C’est pourquoi elles
sont peu apprenties.
Exercice 3 page 30Réponses libres.
Exercice 4 page 31Réponses libres.
Exercice 5 page 31Pourquoi faire une journée des femmes ? L’égalité je ne suis
pas pour. Moi je ne veux pas faire les courses, m’occuper
des enfants ou cuisiner quand je rentre. Je préfère lire le
journal, ou regarder la télé. Je ne voterai pas pour une
femme présidente de la République. Les femmes et la
politique ça ne marche pas. Elles sont trop bavardes, elles
rigolent toujours, dépensent beaucoup d’argent, aiment les
films romantiques.
Séquence 6 - page 32
Exercice 1 page 321.
1. L’adresse 6. Le collège 11. La taille
2. Les convictions religieuses 7. La rue 12. Les vêtements
3. Les goûts 8. L’emploi 13. L’apparence physique
4. Communiste 9. Les sorties 14. Les couleurs
5. Le handicap 10. Le métro 15. L’origine
Exercice 2 page 32Réponses types :
1. La critique. 2. La beauté. 3. enfant. 4. soir. 5. L’intolérance.
6. Une famille. 7. Un pantalon. 8. Une piscine.
Exercice 3 pages 32 Réponses libres
Exercice 4 pages 33 Réponses libres
162 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
Exercice 5 pages 33 deux cent soixante-cinq euros; soixante-quinze euros; cin-
quante-huit euros; vingt euros cinquante;
quatre-vingt-treize euros; mille quatre cent quatre-vingts
euros
Module 3 page 34
Séquence 7 - page 34
Exercice 1 page 34A / 2. D / 3. C / 4. E / 5. F / 6. B
Exercice 2 pages 341. Nous avons fait du bowling, et comme tu n’aimes pas le
bowling, nous ne t’avons pas invitée.
2. Non, ce n’est pas vrai.
3. Je n’ai jamais essayé de jouer au bowling, mais j’aimerais
sûrement ça.
4. Pour y aller, il faut être un joueur expérimenté.
5. C’est n’importe quoi, si c’est ouvert au public, tout le
monde peut y rentrer.
6. Ça aurait été mieux de m’en parler parce que je fais
partie de votre groupe.
7. Tu n’en fais plus partie.
8. Nous trouvons que tu n’es pas assez disponible.
Exercice 3 page 35Réponses libres.
Exercice 4 pages 351. internaute. 2. se connecter. 3. surfer. 4. publier. 5. accès.
6. télécharger. 7. fréquenter.
Exercice 5 page 361. trop cool. 2. bahut. 3. un monde fou. 4. comme des
fous. 5. par cœur.
Exercice 6 page 36Je (voulais / veux) faire mes devoirs de maths hier soir, mais
(j’avais prêté / je prêtais) mon manuel à Mathilde. Je lui
(ai téléphoné / avais téléphoné). Son père m’a dit qu’elle
(ne pouvait pas / n’a pas pu) répondre, qu’elle (avait pris /
prenait) sa douche. (Je laissais / J’ai laissé) un message pour
qu’elle me rappelle. Deux heures plus tard, après le dîner,
elle (n’avait toujours pas rappelé / ne rappelait toujours
pas). Je lui (téléphonais / ai téléphoné) de nouveau. Elle m’a
raconté qu’elle (avait oublié / a oublié) mon manuel dans la
salle de physique. (J’ai été / J’étais) furieux ! À cause d’elle,
(j’ai eu / j’avais) une punition.
Exercice 7 pages 36 et 37Facebook a été imaginé avant l’internet. En effet, les uni-
versités américaines, distribuaient des livrets avec les pho-
tos de tous leurs étudiants, pour les aider à se connaître.
Pendant les premières années de l’Internet, au lieu de créer
des livrets en papier, les universités en mettaient sur leur
réseau interne.
Un jour Mark Zuckerberg, un étudiant, a eu l’idée de copier
les photos de ses camarades sur son propre site. Puis il a
invité les internautes à voter pour les étudiants les plus
populaires. Le site a eu beaucoup de succès, mais Mark
n’avait pas demandé l’autorisation de publier ces photos et
l’université a fermé son site.
Quelques mois plus tard, Mark a créé une version privée
de son ancien site. Les étudiants de son université pou-
vaient s’inscrire et éditer leurs propres pages. Facebook
était né. Un mois après, la moitié des étudiants s’étaient
inscrits sur Facebook. L’année suivante, Mark a ouvert son
site à d’autres universités. Deux ans plus tard, Facebook
accueillait / a accueilli tout le monde !
Exercice 8 page 371. parlé / vue; 2. mises; 3. vus; 4. arrivé
Séquence 8 - page 38
Exercice 1 page 38Le journaliste : 6. Jackson : 2, 4, 5. Anna : 1, 3, 7.
Exercice 2 page 38C’est facile de s’occuper d’un..., c’est plus facile de s’oc-
cuper d’un chat que d’un chien. Un chien, tu dois le sortir
deux fois par jour, un chat, ça reste à la maison, quoi. Par
contre il faut pas oublier de lui donner à manger. La mien-
ne s’appelle Mimosa. Elle est jolie. C’est une princesse quoi.
Elle aime pas les inconnus. Parfois j’ai des amis qui vien-
nent, et là, elle se cache sous mon lit. Bien sûr elle mange
beaucoup, elle a besoin qu’on s’occupe d’elle, bien sûr.
Exercice 3 page 38Nous avons parlé (parler) de musique. Mathilde a dit qu’elle
aimait (aimer) bien le pop-rock, surtout avec un peu de
guitare métal, genre « Metallica ». Elle m’a expliqué qu’elle
n’aimait pas (ne pas aimer) le rap. Je lui ai dit qu’elle aime-
rait (aimer) peut-être K’naan, tu sais, le rappeur somalien.
J’ai offert de lui prêter (prêter) mon CD. Elle a dit qu’elle
( 163
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
l’écouterait (écouter) le lendemain. On s’est posé (se poser)
la question de savoir si Muse était (être) mieux que Franz
Ferdinand. Puis elle m’a demandé ce que je pensais (pen-
ser) de Little Boots. Moi j’ai répondu que je n’en avais pas
entendu parler (ne pas en entendre parler). Elle m’a fait
écouter sur son MP3 et j’ai trouvé que c’était (être) pas mal,
genre « Electronica ».
Exercice 4 page 391. environnement familial. 2. Tu rêves. 3. fêtard. 4. surmon-
ter. 5. stricte. 6. discothèque. 7. draguer. 8. communiquer
avec.
Exercice 5 page 39Réponses libres
Exercice 6 page 40Mariana : fiche 2. Paul : fiche 1. Pierre : fiche 3. Guy : fiche
5. Alexandra : fiche 4.
Exercice 7 page 40A. Elle porte une veste militaire, un tee-shirt imprimé et
un jean.
B. Elle porte une chemise, une jupe et des bottes. Elle a
aussi un blouson et un sac.
C. Il porte un pantalon de costume et une chemise. Il a
aussi une écharpe.
D. Il porte un short et un sweat. Il a aussi une casquette et
des baskets.
E. Elle porte un blouson de cuir, une chemise et une jupe.
Séquence 9 - page 42
Exercice 1 page 42Je crois que cet auteur veut nous livrer un message :
« Voyagez ». Il veut nous montrer que notre monde
moderne est plein de mensonges. La vraie vie se trouve
dans la nature. Vivre, ce n’est pas accepter la place que le
monde moderne te donne, c’est faire un voyage personnel,
se lancer dans le vide. C’est pour ça que les personnages
de Nour et Lalla doivent faire chacun un long voyage. Et
le désert, c’est l’incertitude qu’il faut accepter. Ce roman
nous montre qu’il faut voyager. Moi, je pense que ce n’est
pas forcément un voyage physique, mais ça peut aussi être
un voyage dans les livres, ou dans la musique, par exemple.
Voyager, ce n’est pas juste un loisir, c’est ce que tu fais pour
savoir qui tu es.
Exercice 2 page 42claire : « J.M.G. Le Clézio a fait ses études aux États-Unis.
(J.M.G. Le Clézio a fait ses études à Nice, Aix-en-Provence, Londres et Bristol.) Puis il a publié son premier
roman en 1969. (Il a publié son premier roman en 1963.) Euh... il a été expulsé du Mexique (Il a été expulsé de Thaïlande) où il faisait son service militaire. Après il a
vécu quatre ans avec les Mayas. (Il a vécu quatre ans avec les Indiens Emberas et Waunanas.)Puis il a fait une thèse de doctorat en littérature. (Il a fait une thèse en histoire.)Il a publié trente romans, je crois. (Il a publié plus de 50 livres.) Et il a gagné le Prix Goncourt en 2008. » (Il a gagné le Prix Nobel en 2008.)
Exercice 3 page 43Salut, Maman,
Tout va bien, je m'amuse beaucoup! Mais je suis fatigué:
beaucoup de marche, un grand sac à dos, il
fait du soleil... C'est épuisant... Papa me dit que je vais
m'habituer. Hier, on a rencontré un fermier. Il
nous a montré une colline où, il a dit, il y a des ruines
romaines. On les a visitées aujourd'hui. Rien de
spécial. Puis, on a mangé un déjeuner délicieux. Après on
a fait la sieste. Je t'écrirai demain.
Je t'embrasse,
Romain
Exercice 4 page 43Réponses libres.
Exercice 5 page 44A l’âge de 15 ans, elle décida qu’elle voulait être écrivaine.
Après son baccalauréat, elle réussit des études en mathé-
matiques, langues, littérature et surtout philosophie. C’est
à cette époque qu’elle rencontra Jean-Paul Sartre. Très vite,
ils commencèrent une relation très forte. Sartre et Beauvoir
formèrent un couple mythique qui continua jusqu’à leur
mort. Le ministère de l’Éducation envoya Simone à Marseille
pour son premier poste, tandis que Jean-Paul partit au
Havre pour la même raison. Pour pouvoir rester ensemble,
Jean-Paul proposa le mariage à Simone, mais elle le rejeta
avec horreur. En 1949 elle publia Le Deuxième Sexe. Cette
analyse de la condition des femmes provoqua un immense
scandale. Après de nombreux romans et livres sur la philo-
sophie et le féminisme, elle mourut en 1986.
164 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
Module 4 page 45
Séquence 10 - page 45
Exercice 1 page 45Réponses libres.
Exercice 2 page 46eliana (Rome, Italie) : Je trouve que l’Europe est un conti-
nent avec beaucoup de richesses naturelles et culturelles.
Matthias (Berlin, Allemagne) : Je ne pense pas que les gens
aillent mieux grâce à l’Europe.
lenka (Bratislava, Slovaquie) : Je pense qu’en Europe, nous
partageons les mêmes valeurs et les mêmes idées.
preda (Bucarest, Roumanie) : Je ne crois pas que l’Europe
nous aide beaucoup.
Maria (Madrid, Espagne) : J’ai l’impression qu’en Europe,
nous ne pensons pas assez aux autres.
laura (Helsinki, Finlande) : Je ne pense pas que tous les
droits soient respectés en Europe.
hannah (Londres, Royaume-Uni) : Pour moi, l’Union euro-
péenne ne veut pas dire grand-chose.
Exercice 3 page 46Réponses libres.
Exercice 4 page 46Réponses libres.
Exercice 5 page 47Barack Obama (naître) nait le 4 août 1961 à Honolulu
(Hawaï). En 1967, il (partir) part à Djakarta (Indonésie) avec
sa mère. Il (retourner) retourne.vivre à Honolulu chez sa
grand-mère 4 ans plus tard. En 1991, il (obtenir) obtient
le diplôme de Juris Doctor (doctorat) de l’université de
Harvard. 8 ans auparavant, il (décrocher) décroche. une
licence en sciences politiques et relations internationales de
l’université Columbia à New York. En 1991, il (s’installer)
s’installe à Chicago. Il (devenir) devient sénateur de l’Illinois
(Chicago) 4 ans après. Entre-temps, il (publier) publie un
essai autobiographique, « Dreams of my father ». En 2004,
il (entrer) entre au Congrès des États-Unis. Le 4 novembre 2008, il (devenir) devient le 44e président des États-Unis.
(Premier président noir de l’histoire des États-Unis). Il (être
investi) est investi officiellement le 20 janvier 2009.
Exercice 6 page 501. Le Royaume Uni (M)
2. La Bulgarie et la Roumanie (O)
3. La Finlande (N)
4. En 1957 (N)
5. En 1979 (E)
6. En 1992 (T)
= MONNET
Exercice 7 page 48Dans les années soixante, la guerre fait rage au Viet-Nam.
À la fin des années soixante, face à l’escalade des bom-
bardements, de nombreuses manifestations ont lieu dans
le monde entier.
En 1967, 100 000 personnes marchent sur la Maison
Blanche à Washington. L’année suivante, en 1968, de
violents affrontements opposent manifestants et forces de
l’ordre à Paris, Rome, Madrid, Tokyo, Mexico...
La même année, en avril 68, le pasteur Martin Luther King
et le sénateur Robert Kennedy, deux figures de l’espoir,
sont assassinés. En août, les chars soviétiques envahissent
Prague et mettent fin à la révolte de la Tchécoslovaquie.
À la fin des années soixante et au début des années
soixante-dix, le pacifisme est à la mode. En août 1969,
400 000 jeunes du monde entier se rassemblent au fes-
tival de musique de Woodstock (près de New-York) pour
écouter de la musique mais aussi pour crier leur refus de la
guerre et de la société de consommation.
En France, c’est en mai 68 que se déroulent les événements
les plus marquants. Étudiants et ouvriers sont en grève. La
France est paralysée. Le calme revient en juillet. Mais beau-
coup de choses changent les années suivantes. En 1969,
les établissements scolaires deviennent mixtes. L’année suivante, en 1970, les filles ont le droit d’aller à l’école en
pantalon. Le 16 juillet 1974, l’âge de la majorité passe de
21 à 18 ans.
Exercice 8 page 49Réponses libres.
Exercice 9 page 50Le cri cri MC 15 F-PMAY mesure 1,50 m de hauteur et 3,90
m de longueur. Il fait 4 m 90 de largeur.
Il vole à 200 km/h.
L’Airbus A380-800 mesure 24,10 m de hauteur et 24,10 m
de longueur. Il fait 79,8 m de largeur.
Il vole à 1 040 km/h.
Exercice 10 page 501. Décoller
2. S’envoler
3. Voler
4. Survoler
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
( 165
5. Planer
6. Atterrir
Exercice 11 page 51
aller nous serons allés il sera allé
partir tu seras parti elles seront parties
finir ils auront fini vous aurez fini
dire elle aura dit nous aurons dit
Exercice 12 page 51Réponses libres.
Séquence 11 - page 52
Exercice 1 page 52En France, pour conduire un cyclomoteur, il faut avoir
14 ans et il faut passer le Brevet de sécurité routière. Pour
conduire une voiture, il faut être âgé de 18 ans et il ne faut
pas rater son permis de conduire ! Il faut avoir une assu-
rance et le certificat de conformité du véhicule. Si on est
arrêté par la police et qu’on n’a pas ses papiers, on prend
une amende qui peut être très chère!
Exercice 2 page 52Un conducteur de cyclomoteur roule sans casque.
Un scooter n’a pas sa lumière allumée (tous les autres deux-
roues motorisés ont leurs lumières) et se tient au milieu de
la chaussée.
Une moto roule sur le trottoir.
Un cycliste se fait remorquer par un camion.
Un cycliste n’emprunte pas la piste cyclable.
Une moto emprunte la piste cyclable.
Trois personnes sur un scooter qui traverse le croisement
sans tenir sa droite…
Trois cyclistes roulent de front.
Exercice 3 page 53Jennifer : Je peux t’emprunter ton CD de Bob Sainclar ?
dylan : Ce n’est pas possible, j’ai promis à Marie de le lui
rendre.
Jennifer : Et tu vas le récupérer quand ?
dylan : Elle doit me le rendre demain.
Jennifer : Alors demain, tu pourras me le prêter.
dylan : Ben non ! Il n’est pas à moi! Je l’ai emprunté à
Pauline et c’est Kevin qui le lui avait prêté. Je dois le lui
rendre.
Jennifer : À qui ? Je n’ai rien compris ! Bon, je demanderai
à Marie, elle voudra me le prêter.
dylan : Il n’est pas prêt de le récupérer son CD, le pauvre
Kevin !
Exercice 4 page 53
Réponses libres
Exercice 5 page 53
Constats : 2, 4.
Prédictions : 1, 6.
Conseils : 3, 5.
Exercice 6 page 53
Cancer
Vie sociale : Vous (se sentir) vous sentez seul, mais bientôt
vos amis (penser) penserons à vous. (ne pas se renfermer)
Ne vous renfermez pas !
Chance : Elle vous (fuir) fuit ces derniers temps. (être) Soyez
patient ! Elle (revenir) reviendra.
Études : Vos résultats (ne pas être) ne sont pas excellents.
(penser) Pensez à autre chose. Tout (s’arranger) va s’arran-
ger.
Cœur : Tout (aller) va bien ! (ne pas changer) Ne changez
pas d’attitude. Ça (ne pas s’arrêter) ne va pas s’arrêter.
Exercice 7 page 53
Réponses libres.
Exercice 8 page 54
Marc : Tu me prêtes ton cyclo ?
Julie : Tu veux toujours qu’on te prête quelque chose mais
toi, tu ne veux jamais rien prêter.
Marc : Ce n’est pas vrai. Si quelqu’un me demande
quelque chose, je le lui prête volontiers. Mais personne ne
me demande jamais rien.
Séquence 12 - page 55
Exercice 1 page 55
1. puisque -2. grâce à -3. parce que -4. à cause de
-5. grâce à -6. puisqu'
Exercice 2 page 55
1. parce que -2. comme / puisque -3. comme -4. grâce à
-5. à cause de
Exercice 3 page 56
1. son -2. leur -3. ma -4. ses -5. mes -6. sa -7. leurs
166 )
Corrigés des exercicesCorrigés des exercices
Exercice 4 page 561. Ces filles ne sont pas à l'heure.
2. Il achète ces sacs à dos.
3. Quel est le prix de ces ordinateurs?
4. Il connaît ces hôtels.
5. Je regarde ces émissions.
Exercice 5 page 57a. Ce poème compte une strophe, cinq vers.
b. Chaque vers compte 8 pieds.
c. Les rimes sont :
“aire”
“ra”
“ra”
“aire”
“aire”
d. Trois verbes sont au passé simple. Leur infinitif est :
- courut : courir
- admira : admirer
- fit : faire
e. Réponses libres.
Exercice 6 page 58a. 1. B / 2. A / 3. C
b. Ça n’existe pas, ça n’existe pas
c. Réponses libres.
Exercice 7 page 58
Un sous-marin un sandwich
Se sucrer le bec manger des sucreries
Se rincer le bec boire un verre
Le dépanneur l’épicier ouvert 24h/24
Magasiner faire du shoping
Un bicycle à gaz une moto
Ma blonde ma petite amie
Une piastre un dollar
Exercice 8 page 59a. Natation. Karaté. Judo. Equitation.
b.
Un hamster allemand
Un ghetto italien
Un ranch espagnol
L’alcool arabe
Le paprika hongrois
Le soja manchou
c. Chocolat. Tomate. Cacao.
d. Un divan : E
Un matelas C
Un hamac : F
Un tabouret : G
Une carafe : A
Une tasse : B
Une bougie : H
Un chiffre : D
e. Du Japon.
Exercice 9 page 60Réponses variables.
Exercice 10 page 60- Nonante-trois = quatre-vingt-treize (93).
- Septante-cinq = soixante6quinze (75).
- Octante-neuf (ou huitante-neuf) = quatre-vingt-neuf
(89)..
corrigés des testscorrigés des tests
Module 1
z Séquence 1 pages 16 et 17
Compréhension oraleTranscriptionDialogue entre deux adolescentes.- Aude : Salut Clémence, ça va ?
- ClémenCe : Salut Aude. Mouais, ça va.
- Aude : Oh ! T’as pas l’air d’être très en forme toi ! Qu’est-
ce qui se passe ?
- ClémenCe : Ben tu sais, ça faisait pas mal de temps que
j’avais des migraines à répétition…
- Aude : Qu’est-ce que c’est des migraines ?
- ClémenCe : Ben des maux de tête !
- Aude : Ah ! Oui, c’est vrai que depuis quelques temps tu
dis souvent que tu as mal à la tête !
- ClémenCe : Alors mon médecin m’a conseillé d’aller voir un
ophtalmo et j’y suis allée hier.
- Aude : Et alors ?
- ClémenCe : Ben je vais devoir porter des lunettes.
- Aude : C’est génial !
- ClémenCe : Tu plaisantes ?
- Aude : Absolument pas ! Les lunettes, ça donne un air
intelligent et intellectuel !
- ClémenCe : Ça donne surtout l’impression d’avoir quatre
yeux, tu veux dire !
- Aude : Ben comme ça t’auras des yeux quatre fois plus
beaux !
- ClémenCe : T’es pas drôle !
- Aude : Et en plus, les lunettes, maintenant, c’est un
accessoire de mode. Il en existe de toutes les marques, de
toutes les couleurs. C’est comme un bijou ou une paire de
chaussures.
- ClémenCe : Tu dis ça parce que c’est pas toi qui vas devoir
porter des lunettes !
- Aude : Écoute, ça pourrait être pire ! Imagine, tu ne sors
pas de chez ton ophtalmo mais de chez ton dentiste et il t’a
dit que tu vas devoir porter un appareil dentaire…
- ClémenCe : J’ai rendez-vous chez le dentiste demain. Merci
Aude, t’es une amie géniale !
- Aude : Désolée. Mais tu sais, les appareils sont super à la
mode maintenant. Et il y en a aussi de toutes les couleurs !
Corrigés1. Faux
2. Vrai
3. Un généraliste et un ophtalmologiste
4. Faux
5. Aude : Les lunettes donnent un air intelligent. Les
lunettes permettent d’avoir des yeux encore plus beaux. Les
lunettes sont un accessoire de mode.
Clémence : Les lunettes doublent le nombre d’yeux.
6. On ne sait pas.
Compréhension de l’écrit1. D’un site internet, www.medecine.com
2. Il parle d’une maladie dermatologique.
3. Faux
4. Symptômes : dessèchement de la peau, rougeurs, irri-
tations
5. Vrai
6. Une hygiène très élevée
7. Une protection contre les microbes
Production écriteExemple de productionSalut Jerry !
Moi aussi j’avais de l’acné avant mais je suis allé voir un der-
matologue. Il m’a donné quelques conseils et m’a prescrit
des produits (à acheter en pharmacie, pour être sûr qu’ils
sont bons).
Fais attention au soleil, il favorise l’irruption de boutons. Et
surtout ne les tripote pas ! Tu crois que tu les soignes mais
c’est pire après ! Et ça peut faire des cicatrices. Ne nettoie
pas ta peau trop souvent, ça ne sert à rien. Deux fois par
jour avec un produit adapté, c’est suffisant.
Voilà, j’espère que ça t’aidera.
À bientôt.
Thierry
z Séquence 2 pages 25 et 26
Compréhension oraleTranscriptionÉmission de radio (reportage)Aujourd’hui commence la semaine de la Fraîch’attitude qui
se déroulera jusqu’au 28 mai. Elle propose des dégustations
de fruits et légumes frais, des animations et des jeux dans
toute la France pour nous inciter à manger plus de fruits
et légumes.
Mais ces campagnes, qui défendent une alimentation saine
et équilibrée, ont bien moins d’impact que les publicités de
l’industrie de l’alimentation qui tentent de nous convaincre
d’acheter des sodas, des barres chocolatées, des plats
cuisinés, des hamburgers. Tous ces produits, trop sucrés et
trop gras, sont les principaux responsables des problèmes
d’obésité.
Espérons que toutes ces campagnes, comme la
( 167
168 )
Corrigés des testsCorrigés des tests
Fraîch’attitude, la Semaine du goût ou Manger-bouger,
parviendront à sensibiliser les enfants et les parents à
l’importance d’avoir une alimentation équilibrée.
Corrigés1. Vrai
2. Une semaine
3. Les fruits et légumes frais
4. Des animations et des jeux
5. C’est manger des fruits et légumes frais.
6. Faux
7. Vrai
8. La Fraîch’attitude s’adresse aux enfants et aux parents.
Compréhension de l’écrit1. Au printemps
2. Des professionnels de l’alimentation et de la restauration
/ Des municipalités / Des écoles
3. 1. Faux / 2. Faux / 3. Vrai
4. Pour le petit-déjeuner : associer des fruits aux tartines et
produits laitiers / Pour le déjeuner et le dîner : commencer le
repas par des crudités ou une soupe, accompagner la vian-
de ou le poisson de légumes, prendre un fruit en dessert.
Production écriteExemple de productionSalut !
Tout se passe bien ici à Marseille. C’est une ville vraiment
incroyable ! Les gens sont drôles, ils parlent avec un accent
très fort.
En ce moment en France c’est une semaine spéciale : elle
s’appelle Fraîch’attitude. C’est une semaine consacrée à
l’alimentation et son importance pour la santé. Hier, nous
sommes allés nous promener dans la ville et il y avait plein
d’activités proposées. Nous avons discuté avec des grands
cuisiniers qui nous ont expliqué ce qu’il fallait manger pour
être en bonne santé : beaucoup de fruits et légumes, la
moitié d’un repas ! Ils nous ont ensuite fait goûter des plats
délicieux. C’était super.
Je vous embrasse très fort.
z SéquenCe 3 pages 34 et 35
Compréhension oraleTranscriptionDialogue entre un ado et sa mère.‑ Vincent : Salut maman !
‑ La mère : Bonjour mon grand. C’était bien le collège
aujourd’hui ?
‑ Vincent : Génial ! On est allés visiter une exposition pas‑
sionnante !
‑ La mère : Ah ! Oui, une expo sur quoi ?
‑ Vincent : Sur un fruit.
‑ La mère : Un fruit ! Mais quel fruit ?
‑ Vincent : Si je te dis que c’est un fruit facile à éplucher qui
a une belle couleur jaune, qui ne coûte pas cher et qu’on
peut tomber si on glisse sur sa peau, tu devines ?
‑ La mère : La banane !
‑ Vincent : C’est ça. Il y a une expo sur la banane à l’Agro-
polis Museum en ce moment. Et notre prof de SVT nous y
a emmenés aujourd’hui.
‑ La mère : Et qu’est‑ce que tu as appris d’intéressant ?
‑ Vincent : C’est un fruit plein d’énergie, comme le potas‑
sium, le fer. C’est une des plantes alimentaires les plus
cultivées dans le monde.
‑ La mère : Ah bon ! Je ne savais pas. Et elle est cultivée
où ?
‑ Vincent : Dans les pays chauds uniquement. En Amérique
latine, en Afrique, en Asie. La banane est un aliment de
base essentiel pour les habitants.
‑ La mère : Vincent, à partir de maintenant, tu mangeras une
banane par jour !
‑ Vincent : Pas de problème.
Corrigés1. Un dialogue entre Vincent et sa mère
2. Faux
3. La banane
4. Sa couleur / Son prix / Ses qualités nutritionnelles / Sa
provenance
5. Vrai
6. Faux
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Faux
3. Vrai
4. 1. noir / au lait / blanc / 2. liquide / solide / 3. chaud /
froid
5. Faux
6. Liquide : les Espagnols / Solide : les Français, les
Allemands, les Belges / On ne sait pas : les Suisses.
Production écriteExemple de productionJ’ai lu votre article sur l’alimentation des Français et j’ai été
très choqué ! Pour tout le monde, la France est le pays de la
grande gastronomie, des bons produits et les Français s’ali‑
mentent mal ! C’est un scandale ! Bien sûr je comprends
( 169
Corrigés des testsCorrigés des tests
qu’avec la vie moderne, prendre du temps pour cuisiner
est devenu difficile. Les deux parents travaillent et quand
ils rentrent le soir du travail, ils n’ont pas toujours envie
de se mettre derrière les fourneaux. Alors ouvrir une boîte
de conserve, sortir un plat déjà préparé du congélateur ou
commander une pizza, c’est plus simple. Mais pour la santé,
c’est important de faire un effort, pour eux et pour leurs
enfants. Les parents habituent leurs enfants à mal manger
et, à l’âge adulte, ils feront la même chose. Je pense qu’il
faudrait que les patrons laissent partir les employés une
heure plus tôt chaque soir pour leur permettre de cuisiner
et mieux manger !
Module 2
z SéquenCe 4 pages 49 et 50
Compréhension oraleTranscriptionReportage radioÊtre parent d’un enfant ou d’un adolescent, ce qui est le
cas d’un Européen sur quatre, a, bien sûr, des conséquen‑
ces importantes sur le budget.
L’habillement arrive en première position : 42% des
Européens déclarent que le budget pour les enfants est
surtout dépensé en vêtements, devant l’alimentation (37%)
et l’éducation (35%).
71% des Européens donnent de l’argent de poche à leurs
enfants, mais ils ne sont que cinq sur dix en France contre
84% en Allemagne. Les enfants européens reçoivent en
moyenne 31 E par mois, montant qui évolue en fonction
de l’âge : 15 E entre 5 et 10 ans, 27 E entre 11 et 14 ans,
47 E entre 15 et 17 ans et 62 E entre 18 et 20 ans.
80% des parents européens mettent de l’argent sur un
compte pour leurs enfants mais la somme est variable :
31% déclarent en mettre « peu », mais seulement 10%
« beaucoup ». C’est en Allemagne que la pratique est la
plus répandue puisque 91% des parents déclarent mettre
de l’argent de côté pour leurs enfants, contre 63% en
Espagne.
Corrigés1. Vrai.
2. 25 %.
3. 1 : vêtements. 2 : alimentation. 3 : éducation.
4. Faux.
5. Entre 5 et 10 ans : 15 E. Entre 11 et 14 ans : 27 E. Entre
15 et 17 ans : 47 E. Entre 18 et 20 ans : 62 E.
6. Faux.
7. En Allemagne.
Compréhension de l’écrit1. En dehors de l’école.
2. les élèves de seconde A.
3. Les élèves du lycée général et les élèves du lycée pro-
fessionnel.
4. Les élèves du lycée général : Sport / Cinéma / Sorties en
boîte de nuit
Les élèves du lycée professionnel : Sorties le mercredi et le
vendredi / Sorties en boîte de nuit
5. Les élèves du lycée professionnel.
Production écriteExemple de productionJ’ai lu votre article sur les dépenses des parents français
pour leurs enfants et j’ai été très étonné d’apprendre qu’ils
dépensent plus pour les vêtements que pour l’alimenta‑
tion.
Qu’est‑ce qui est le plus important ? L’alimentation ou les
vêtements ? Moi, je pense que c’est l’alimentation parce
qu’elle est essentielle pour vivre et que meilleure est l’ali‑
mentation, plus longue est la vie.
Si les parents dépensent beaucoup pour les vêtements c’est
aussi parce que les enfants veulent avoir des affaires de
marque et ça, c’est très cher ! Je pense que les parents ne
devraient pas céder aux caprices de leurs enfants : c’est ça
l’éducation ! Ils devraient leur apprendre ce qui est impor‑
tant dans la vie, les valeurs essentielles. Bien manger est
plus important que de porter des vêtements de marque !
z SéquenCe 5 pages 56 et 57
Compréhension oraleTranscriptionDialogue entre trois ados‑ magaLie : Salut Bertrand ! Salut Zoé !
‑ Bertrand, Zoé : Salut Magalie !
‑ magaLie : Vous avez entendu la nouvelle ? La mixité à
l’école est menacée !
‑ Bertrand : Quoi ! C’est quoi cette histoire ?
‑ Zoé : Oui, moi j’en ai entendu parler, mais tu exagères un
peu Magalie ! Ce n’est pas vraiment une menace.
‑ magaLie : Bien sûr que si !
‑ Bertrand : Bon, vous nous expliquez les filles !
‑ magaLie : Une loi européenne donne la possibilité aux
écoles d’organiser des classes en séparant les filles et les
garçons.
170 )
Corrigés des testsCorrigés des tests
‑ Bertrand : C’est une loi européenne, ce n’est pas une loi
française !
‑ magaLie : La France est en Europe, je te rappelle ! Nous
devons adopter certaines lois européennes.
‑ Zoé : Oui, mais l’Éducation nationale a garanti que la
mixité serait préservée.
‑ magaLie : Imagine que des parents d’élèves demandent
des cours séparés ! Ils pourraient utiliser cette loi.
‑ Bertrand : Quels cours par exemple ?
‑ magaLie : Je ne sais pas moi, les cours d’éducation physi‑
que ou les cours de maths !
‑ Bertrand : C’est impossible, je n’y crois pas !
‑ Zoé : Tu dramatises Magalie. Les parents ne demanderont
jamais qu’on organise des classes séparées !
‑ magaLie : Comment tu peux le savoir, Zoé !
‑ Zoé : Mais parce qu’on est en France, pays de la liberté et
des droits de l’homme !
‑ magaLie : J’espère que tu as raison.
‑ Bertrand : Je vais devoir encore vous supporter alors !
Corrigés1. 3 personnes.
2. Ils parlent d’une loi sur la mixité.
3. C’est une loi européenne.
4. Zoé et Magalie.
5. Faux.
6.
Magalie Bertrand Zoé
L’Éducation nationale n’appliquera pas cette loi.
X
Des parents d’élèves demanderont des cours non mixtes.
X
Des parents ne demanderont jamais des cours non mixtes.
X X
Compréhension de l’écrit1. Le concours « écrivain » de la Journée de la Femme
2009
2. Faux
3. Les internautes
4. Le thème : égalité, parité, réalité ?
5. 1. Au moins une fois la mention « Journée de la Femme
8 mars 2009 » ou la mention « Journée internationales des
droits des femmes ». 2. Un titre.
6. Vrai
7. Faux
Production écriteExemple de production
Égalité, parité, nécessité !
La question posée par la Journée de la femme 2009
Incite à constater s’il y a quelque chose de neuf
À la maison, dans la rue, dans la société
L’égalité et la parité sont‑elles une réalité ?
Ces deux valeurs pour moi sont une nécessité
Et finalement ne suffirait‑il pas de transformer
Le point d’interrogation en point d’exclamation
Pour passer d’une question à une décision.
z SéquenCe 6 pages 66 et 68
Compréhension oraleTranscriptionReportage radioD’après la Halde, les discriminations entre hommes et fem‑
mes dans le monde du travail sont encore très présentes,
malgré de nouvelles lois en faveur de l’égalité. Ces inéga‑
lités se manifestent à trois niveaux : l’accès à l’emploi, la
rémunération et le déroulement de carrière. En effet, les
femmes sont plus nombreuses dans les emplois à temps
partiel et à bas salaire et elles restent rares dans les postes
à responsabilité alors qu’elles sont majoritaires à l’univer‑
sité. De plus, on constate une différence de salaire entre
hommes et femmes : à travail égal, les femmes touchent
en moyenne 21% de moins que les hommes. Pourtant le
code du travail prévoit que « Tout employeur assure, pour
un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’éga‑
lité de rémunération entre les hommes et les femmes. » et
qu’« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération […] à raison de
son sexe […] ».
Corrigés1. Vrai
2. Oui : accès à l’emploi / salaire / déroulement de carrière
Non : demande de vacances / heures supplémentaires
3. Le plus de femmes : emplois à temps partiel / bas salaires
/ université
Le plus d’hommes : postes à responsabilités
4. 21%
5. Faux
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Vrai
3. Le droit de s’alimenter (une assiette avec des aliments et
( 171
Corrigés des testsCorrigés des tests
un enfant qui boit de l’eau). Le droit d’être à l’abri (une mai-
son). Le droit à la santé (un docteur). Le droit à l’éducation
(un professeur dans une école avec une classe). Le droit à
l’éducation et à la culture (un jeune avec un livre).
4. Faux
5. Vrai
Production écriteExemple de productionMadame, Monsieur,
Je m’adresse à vous car j’ai été témoin d’une discrimination
le 18 juillet dernier dans le bus.
Une femme de couleur, enceinte et visiblement fatiguée,
est montée dans le bus. Il n’y avait plus de place assise
(j’étais moi‑même debout) et personne ne lui a proposé de
lui laisser sa place. Quelques stations plus loin, une femme
de type européen est montée dans le bus et là, immédia‑
tement, plusieurs personnes lui ont proposé leur place. Elle
s’est assise. Cette situation m’a mis en colère et je me suis
permis de faire la réflexion aux personnes responsables qui
ne m’ont même pas répondu.
Je voudrais savoir s’il y a quelque chose à faire dans ce
genre de situation ? Normalement, il est obligatoire de lais‑
ser sa place à une femme enceinte, le chauffeur du bus ne
doit‑il pas intervenir pour faire respecter cette règle ?
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porte‑
rez à mon courrier.
Module 3
z SéquenCe 7 pages 82 et 83
Compréhension oraleTranscriptionInterview- Journaliste : Facebook, comme tout phénomène de mode,
a ses résistants ! Nous avons rencontré Aurélien. Il a 22
ans, est étudiant en communication et refuse de s’inscrire
sur Facebook.
Pourquoi ce rejet de Facebook Aurélien ?
- aurélien : Pour plusieurs raisons. La première : je n’arrive
déjà plus à gérer mon carnet d’adresses réel ! Alors le vir-
tuel, vous pensez ! En fait, c’est parce que je crois que les
vrais amis, on les compte sur les doigts de la main et que
l’amitié se construit pendant des années. Alors, le « Veux-
tu être mon ami ? » de Facebook me choque !
- Journaliste : L’idée d’organiser un dîner avec vos anciens
copains de l’école maternelle ne vous tente pas ?
- aurélien : Je préfère organiser un dîner avec mes vrais
amis.
- Journaliste : Quelles sont les autres raisons de votre
refus ?
- aurélien : Eh bien, je me méfie beaucoup d’internet et de
tous ces réseaux sociaux qui vous demandent de donner
des informations personnelles, ou même de mettre en
ligne votre vie privée. Qui sait comment tout ça peut être
utilisé !
- Journaliste : Mais c’est vous qui choisissez qui a accès à
vos informations sur Facebook.
- aurélien : En théorie oui. Mais tout le monde sait que tout
est possible en informatique.
- Journaliste : Aurélien, merci.
Corrigés1. Aurélien. 22 ans. Étudiant en communication.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux.
5. Faux.
6. Les informations personnelles / Sa vie privée
7. Faux.
Compréhension de l’écrit1. Faux.
2. Faux.
3. Par : 1. des annonces à la radio / 2. des offres d’emploi
dans les journaux.
4. Les services secrets recherchent : 1. des personnes qui
ont fait des études universitaires / 2. des personnes qui
souhaitent changer de métier.
5. Faux.
Production écriteExemple de productionLes réseaux sociaux sur internet sont une réalité et, à mon
avis, ils vont se développer de plus en plus. Je pense que
nous n’avons plus le choix : nous devons apprendre à vivre
avec, à les utiliser mais avec intelligence.
Ils peuvent être utiles, bien sûr, dans un contexte profes‑
sionnel. Certaines personnes peuvent même trouver du
travail grâce à ces réseaux.
Dans un contexte privé, je pense qu’il faut rester très
prudent. On peut choisir les personnes qui font partie de
notre réseau et protéger les informations qu’on met sur
les pages. Personnellement, mes « amis » sur Facebook
sont des personnes que je connais vraiment, sauf une.
Lorsque je l’ai accepté comme ami, je ne savais pas si je
le connaissais ou non, mais, comme nous avions des amis
172 )
Corrigés des testsCorrigés des tests
en commun, j’ai pensé que je le connaissais. C’était mes
débuts sur Facebook et je ne savais pas encore comment
cela fonctionnait. Depuis je l’ai rencontré et nous sommes
devenus très amis.
Maintenant, je n’accepte plus les demandes des gens que
je ne suis pas sûre de connaître. Il faut se protéger car, sur
internet, on peut trouver le meilleur comme le pire.
z SéquenCe 8 pages 90 et 91
Compréhension oraleTranscriptionReportageLes ados sont-ils angoissés par l’avenir ? Contrairement à ce
que pensent les parents, un sondage réalisé dernièrement
nous apprend que non ! Presque 70% des jeunes interro-
gés disent qu’ils sont satisfaits de leur vie.
Ce qui est intéressant dans ce sondage c’est que les parents
ont une image inexacte des adolescents ils pensent que
80% des jeunes sont mal dans leur peau alors que seule-
ment 30% déclarent l’être en réalité.
Corrigés1. C’est un reportage sur le bien-être des adolescents ;
2. Faux ;
3. 1. Des adolescents. 2. Des parents.
4. Une majorité d’ados sont satisfaits de leur vie.
Une minorité d’ados sont mal dans leur peau.
5. Vrai.
6. Faux.
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Vrai
3. 1. L’amour / 2. La solidarité / 3. Le soutien / 4. Le bonheur
4. 50 %
5. Un sur quatre
6. Faux
7. Faux
Production écriteExemple de productionLa phrase de Gustave Lebon que vous avez publiée dans
votre magazine me semble très intéressante. Elle soulève le
problème d’être ou ne pas être victime de la mode.
Tout d’abord, la mode est partout autour de nous. La
mode vestimentaire, bien sûr, mais aussi la mode dans
d’autres domaines : l’automobile, la cuisine, le prénom
d’un enfant… Mais acheter un vêtement non pas parce
qu’il est beau mais parce qu’il est à la mode est moins
grave que de choisir le prénom d’un enfant. Le vêtement,
on peut s’en débarrasser un jour, mais l’enfant portera son
prénom toute sa vie.
Ensuite, pour les vêtements, les conséquences sont moins
graves : en effet, porter un vêtement laid uniquement parce
qu’il est la mode est ridicule mais ce n’est pas très grave.
En plus, comme tout le monde porte le même, qui peut
s’en apercevoir ?
Bref, je pense qu’il ne faut pas être victime de la mode dans
tous les domaines, certains sont moins graves que d’autres.
z SéquenCe 9 pages 98 et 99
Compréhension oraleTranscriptionSondage- enquêteur : Bonjour, vous voulez bien répondre à quelques
questions ? C’est pour un sondage.
- Femme : Je suis désolée, je n’ai pas le temps !
- enquêteur : C’est un sondage sur les habitudes de lecture
des Français, ça prend trois minutes !
- Femme : Bon, d’accord ! Moi aussi j’ai fait des sondages
pour gagner de l’argent quand je faisais mes études ! Trois
minutes, pas plus hein ?
- enquêteur : Promis. Première question : vous lisez ? Si oui,
que lisez-vous ?
- Femme : Oui, je lis. Des romans surtout. Mais je lis aussi
le journal.
- enquêteur : Vous lisez pour le plaisir, pour passer le temps
ou parce que vous y êtes obligée ?
- Femme : Les romans, pour le plaisir. Mais je lis aussi des
articles scientifiques pour mon travail, je suis médecin.
- enquêteur : Comment vous choisissez les livres ?
- Femme : J’aime certains auteurs alors je lis tous leurs livres.
Je lis aussi toujours les livres de ceux qui ont reçu le Prix
Nobel. Parfois je lis des livres conseillés par des amis.
- enquêteur : Avec vos amis, vous parlez souvent de ce que
vous lisez ?
- Femme : Parfois oui, quand un livre m’a vraiment beaucoup
plu. Et eux aussi me parlent des livres qu’ils ont trouvés
particulièrement intéressants.
- enquêteur : Merci beaucoup Madame !
- Femme : C’est déjà fini !
Corrigés1. C’est une enquête sur les habitudes de lecture.
2. Parce que le sondage ne dure pas longtemps.
Parce qu’elle a aussi fait des sondages quand elle était étu-
diante pour gagner de l’argent.
( 173
Corrigés des testsCorrigés des tests
3. Est-ce que vous lisez ?
Qu’est-ce que vous lisez ?
Pour quelles raisons vous lisez ?
Comment choisissez-vous vos livres ?
La lecture est-elle un sujet de conversation avec vos amis ?
4. La femme lit :
- tous les romans des auteurs qu’elle apprécie,
- des articles scientifiques,
- des journaux,
- tous les livres qui ont reçu le Prix Nobel,
- certains livres conseillés par ses amis.
5. Vrai.
6. Faux.
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Vrai
3. 1. La science / 2. La littérature / 3) La paix
4. C’est le scientifique suédois Alfred Nobel qui a demandé
que sa fortune serve à récompenser des personnes qui ont
fait quelque chose d’important pour l’humanité.
5. Faux
Production écriteExemple de productionMadame, Monsieur,
J’ai vu, aujourd’hui dans le métro, l’affiche du 24e salon
du livre et de la presse jeunesse et je souhaiterais avoir
quelques renseignements. En effet, j’aimerais organiser une
visite avec ma classe.
Tout d’abord, l’affiche ne précise pas les horaires d’ouver‑
ture. Pourriez‑vous me les communiquer ?
Ensuite, pourriez‑vous me préciser les tarifs et si vous faites
des réductions pour les jeunes ? Si oui, jusqu’à quel âge ?
Avez‑vous un tarif spécial pour les groupes ? Si oui, à partir
de combien de personnes ?
Par ailleurs, je souhaiterais savoir quelles animations vous
proposez pour des jeunes de 16 ans ?
Merci d’avance.
Module 4
z SéquenCe 10 pages 116 et 117
Compréhension oraleTranscriptionInterview radio
‑ JournaListe : Aujourd’hui Europe et Compagnie propose à
nos jeunes auditeurs de découvrir qui étaient les premiers
européens avec Philippe Gardère, historien, archéologue.
Philippe Gardère, bonjour.
‑ PhiLiPPe gardère : Bonjour.
‑ JournaListe : Alors pendant longtemps, on a pensé que
l’Europe avait été peuplée par des hommes venus d’Afrique
en passant par le détroit de Gibraltar. Mais il semblerait que
les spécialistes remettent en question cette théorie.
‑ PhiLiPPe gardère : Absolument. Les historiens pensaient que
le peuplement de l’Europe s’était fait à partir de l’Afrique
en passant par le détroit de Gibraltar qui se trouve entre le
continent européen et le continent africain. Mais, en fait,
ce n’était pas le seul passage possible pour passer d’un
continent à l’autre.
‑ JournaListe : Ah ! oui ! Alors, quel était l’autre passage ?
‑ PhiLiPPe gardère : La Bulgarie. Une grotte découverte en
1920 dans ce pays présente des traces d’activité humaine
datant d’il y a environ 1, 6 millions d’années. Et c’est juste‑
ment à cette époque que les premiers humains ont peuplé
l’Europe.
‑ JournaListe : Et ces hommes venus d’Afrique, alors, ils ont
pris quel chemin ?
‑ PhiLiPPe gardère : Ces hommes ont suivi les bords de la
Méditerranée et l’ont traversée par la Turquie pour venir
s’installer en Europe, en Bulgarie tout d’abord.
‑ JournaListe : Et vous, qu’en pensez‑vous ?
‑ PhiLiPPe gardère : Les faits archéologiques ont parlé ! Cette
grotte en Bulgarie me paraît être la preuve que cette nou‑
velle théorie est la bonne.
‑ JournaListe : Philippe Gardère, je vous remercie.
Corrigés1. Vrai
2. Aux adolescents
3. Historien. Archéologue.
4. De l’Europe
5. D’Afrique
6. Plus d’un million d’années
7.
Le peuplement de l’Europe s’est fait par :
Nouvelle théorie
Ancienne théorie
- le détroit de Gibraltar X
- la Turquie X
8. La nouvelle
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Lenoir
174 )
Corrigés des testsCorrigés des tests
3. La mise au point du premier
moteur à quatre temps : 2
Les 12 premiers km de la voiture : 1
La première course de voitures : 4
La première voiture à quatre places : 3
4. 1. Les routes ne sont pas encore aménagées ou la signa-
lisation n’existe pas / 2. Le démarrage du moteur est très
difficile ou les conditions climatiques, comme la pluie, sont
redoutées
5. Faux
6. La voiture sans chevaux
7. Une automobile
Production écriteExemple de productionTout d’abord, les unions de pays ont, à mon avis, de
nombreux avantages. Sur le plan économique, les pays
qui s’unissent sont plus forts et peuvent s’aider en cas de
problème. Par ailleurs, les citoyens de chaque pays peuvent
voyager librement à l’intérieur de la communauté et décou‑
vrir de nouvelles cultures. Enfin, les pays qui s’unissent font
le choix de la paix et non du conflit, ce qui me semble très
important pour l’avenir du monde.
Mais les unions de pays ont aussi quelques inconvénients.
Par exemple, lorsque tous les pays doivent respecter les
mêmes règles ou les mêmes normes. Ainsi, en Europe,
l’avenir du fromage français est peut‑être menacé par les
normes qui sont imposées. Les unions de pays peuvent
participer aux rencontres de culture mais elles peuvent aussi
aller jusqu’à l’uniformisation des cultures : on peut finir par
retrouver les mêmes produits dans tous les pays. Il y a un
autre inconvénient majeur : des pays qui s’unissent peuvent
représenter un bloc qui s’oppose au reste du monde et,
alors, être source de conflits.
z SéquenCe 11 pages 128 et 129
Compréhension oraleTranscriptionÉmission radio‑ JournaListe : Et voici un reportage qui devrait intéresser
tous nos auditeurs, les ados et leurs parents. Charles Planel
va nous parler de la Caisse‑à‑ado, une voiture pour les
moins de 18 ans.
‑ charLes PLaneL : Oui, la Caisse‑à‑ado, une voiture pour les
ados ! Je ne sais pas si cela va faire très plaisir aux parents…
C’est une entreprise française qui a eu cette idée : ce n’est
ni une voiture ni un scooter mais un quadricycle, une voitu‑
rette, de deux places pouvant rouler jusqu’à 100 km/h. Cet
engin est destiné aux jeunes à partir de 16 ans. Il suffit pour
cela d’avoir un permis spécial, appelé permis B1, et surtout
des parents généreux car elle coûte 7 000 euros. Si la Caisse‑
à‑ado peut être conduite par les jeunes de plus de 16 ans,
elle est aussi idéale pour rouler en ville et se garer facilement.
Et comme rien n’empêche les plus de 18 ans de la conduire,
elle séduira peut‑être des adultes qui ont l’habitude de se
déplacer seul et qui n’ont pas forcément besoin d’une grosse
voiture. Mais attention à vos jambes si vous êtes grands : la
Caisse‑à‑ado ne mesure que 2,70 m de long !
‑ JournaListe : Merci, Charles et à demain pour votre chro‑
nique quotidienne.
1. Une chronique
2. À tout le monde
3. D’un engin à quatre roues
4. D’Europe
5. Deux personnes
6. Faux
7. Faux
8. a. Avantages : rouler en ville ou se garer facilement /
b. Inconvénients : elle coûte cher ou elle est petite
Compréhension de l’écrit1. Faux
2. Leurs amis
3. Sensibiliser aux dangers de la route
4. Faux
5. Rentrer à pied ou appeler leurs parents
6. Vrai
7. Seuls : Ils se sont posé des questions / Avec l’aide de
quelqu’un : Ils ont écrit le scénario / Ils ont fait le tournage
/ Ils ont fait le montage
8. De sécurité routière
Production écriteExemple de productionJe viens de lire votre article sur le court métrage réalisé
par Ben, Alice, Corentin, Marie et Fred. Je trouve que c’est
une très bonne idée. Il est très important de sensibiliser les
jeunes à la sécurité routière.
Sur les routes, chaque année, il y a des milliers et milliers
d’accidents mortels. Beaucoup de ces accidents impliquent
des jeunes.
Les jeunes sont un peu « fous », ils ne réfléchissent pas
toujours aux conséquences de leurs actes. Lorsqu’ils ont
une conduite à risque, ils ne s’en rendent pas forcément
compte. Ils sortent, ils font la fête, ils veulent conduire vite
pour ressentir des sensations, ils ne voient que le meilleur
et pas le pire.
( 175
Corrigés des testsCorrigés des tests
Je pense qu’un film fait par des jeunes pour les jeunes peut
favoriser une prise de conscience : ce n’est pas parce qu’on
est jeune et qu’on veut s’amuser, qu’on ne doit pas égale‑
ment avoir un comportement responsable pour se protéger
soi‑même et protéger les autres.
Bravo pour cette initiative !
z SéquenCe 12 pages 134 et 135
Compréhension oraleTranscriptionDialogue‑ éLise : Dis donc Cédric, c’est toi qui a mis ce poème dans
mon cartable ?
‑ cédric : Euh… oui !
‑ éLise : Ben ! Qu’est‑ce qui t’arrive ? On est amis ! Tu ne
peux pas être amoureux de moi !
‑ cédric : C’est pas parce ce que je t’écris un poème que je
suis amoureux de toi ! Tu as vu le mot amour écrit quelque
part ?
‑ éLise : Non, en effet. Alors, pourquoi tu m’as écrit ce
poème ?
‑ cédric : Ben, on est le 10 mars !
‑ éLise : Et alors, la Saint‑Valentin c’est en février !
‑ cédric : Je te répète que je ne suis pas amoureux de toi !
Pourquoi je t’écrirais un poème pour la Saint‑Valentin ?
C’est la fête des amoureux !
‑ éLise : C’est juste. Alors, pourquoi tu m’écris un poème
précisément le 10 mars ?
‑ cédric : C’est le Printemps des poètes !
‑ éLise : Le Printemps des poètes, c’est quoi ça ?
‑ cédric : Oh ! Élise, t’es nulle ! Tu connais pas le Printemps
des poètes ?
‑ éLise : Non !
‑ cédric : C’est une journée, aujourd’hui le 10 mars, pour
que tout le monde laisse parler le poète qui est en lui !
‑ éLise : C’est quoi cette histoire ?
‑ cédric : Ben oui ! Il y a un poète en chacun de nous !
Et aujourd’hui, c’est sa fête ! Sur l’affiche, on peut lire :
« Chez vous, au travail, à l’école, dans la rue . . . offrez un
poème, échangez vos poèmes, postez un poème, glissez un
poème sous la porte, ceci ou cela mais donnez un poème à
l’autre ». Alors, voilà ! Je te donne un poème !
‑ éLise : Ah ! J’ai compris ! Le Printemps des poètes, c’est
pour ceux qui n’osent pas dire « Je t’aime » le jour de la
Saint‑Valentin !
‑ cédric : Pfff ! N’importe quoi ! Le printemps des poètes
c’est bien plus que ça !
‑ éLise : En tout cas, il est très beau ton poème ! Tu as
beaucoup de talent !
‑ cédric : Tu dis pas ça juste pour me faire plaisir ?
‑ éLise : Non, je le pense vraiment. Moi aussi, je vais t’écrire
un poème.
‑ cédric : Donc tu es amoureuse de moi ?
‑ éLise : Sûrement pas !
1. Vrai
2. Cédric a écrit à Élise
3. Un poème
4. Le Printemps de poètes
5. Faux
6. À tout le monde
7. En le glissant sous la porte d’une maison / par la poste /
à l’école / dans la rue
8. Vrai
9. Faux
Compréhension de l’écrit1. Une ou des affiches du Printemps des poètes
2. L’affiche
3. 11 ans
4. Deux semaines
5. Faux
6. Vrai
7. 1. le nombre d’affiches / 2. le numéro de téléphone / 3.
le tarif d’affranchissement / 4. l’adresse de livraison
Production écriteExemple de productionMadame, Monsieur,
Je suis élève au lycée George Sand de Melun et je souhaite
organiser des animations autour du Printemps des poètes.
Je reviens vers vous suite à ma commande du 15 février
dernier. Je vous avais commandé 4 affiches de la 11e édi‑
tion du « Printemps des poètes » et ne les ai toujours pas
reçues, pourtant la manifestation commence demain. Je
vous avais également envoyé une enveloppe de 22, 8 sur
35 cm affranchie au tarif demandé (2,18 €).
Avez‑vous bien reçu ma commande ? Si oui, les affiches
ont‑elles été envoyées ? Je souhaiterais savoir où est le
problème pour trouver une solution rapidement. Si le
problème se situe à votre niveau, pourriez‑vous, s’il vous
plaît, le régler le plus rapidement possible en m’envoyant
ces 4 affiches ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.