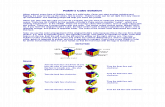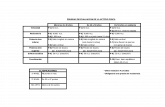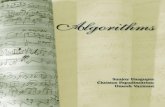VanDerLugt_MonstresHumaniteSacrementsPenseeMedievale_2008
-
Upload
blackdogrunsatnight -
Category
Documents
-
view
20 -
download
16
description
Transcript of VanDerLugt_MonstresHumaniteSacrementsPenseeMedievale_2008
-
Lhumanit des monstres et leur accs auxsacrements dans la pense mdivale
Maaike van der Lugt
Au mois de janvier 1317 naquit, prs de Florence, un garon avec deux corps .Giovanni Villani signale que, amen la ville, les prieurs refusrent de le faire entrerau palais, parce que les monstres ainsi faits annoncent, selon les anciens, des mauxfuturs . Le petit tre double mourut au bout de vingt jours lhpital de Santa Mariadella Scala, dabord lun, puis lautre 1. Un relief sculpt contemporain, sur la fa-ade de linstitution, le reprsente : on y voit un tronc commun, avec une tte et deuxbras chaque extrmit, et une paire de jambes, surmonte dun sexe mle, qui sortperpendiculairement dun flanc, une troisime jambe dforme sortant de lautre2. Unsicle plus tard, un autre chroniqueur, le Bourgeois de Paris, raconte un vnementsimilaire dans son journal : la naissance, Aubervilliers, de deux enfants qui se par-tageaient le ventre et le nombril, mais qui avaient deux ttes, quatre bras, deux cous,deux dos, quatre jambes et quatre pieds. Les jumelles moururent une heure aprs avoirt baptises lune sappelait Agns, lautre Jeanne et furent ensuite exposes pen-dant trois jours au peuple de Paris qui se pressa pour les voir. Le Bourgeois de Parisassure les avoir lui-mme tenues entre les mains3.
Publi, sans les rfrences en latin, dans Caiozzo A. et Demartini A.-E., Monstre et imaginaire social.Approches historiques, Paris : Craphis, 2008, pp. 135161.1. Giovanni Villani, Nuova Cronica, X, 79 : E nel detto anno, del mese di gennaio, a la signoria
del detto conte [da Battifolle] nacque al Terraio in Valdarno uno fanciullo con due corpi cos fatto, e furecato in Firenze, e vivette pi di XX d ; poi mor a lo spedale di Santa Maria della Scala, luno prima chelaltro : e volendo essere recato vivo a priori challora erano, per maraviglia non vollono chentrasse inpalagio, recandolsi a pianta e sospetto di s fatto mostro, il quale secondo loppenione degli antichi ovenasce era segno di futuro danno (d. Porta G., Nuova Cronica di Giovanni Villani, 3 vol., Parme, 1991, 2,p. 284).
2. Le relief, actuellement dans le Museo di San Marco, est reproduit chez Daston et Park (cit note5), p. 55.
3. Journal dun bourgeois de 1405-1449 : Item, le 6e jour du mois de juin audit an 1429, furent nes Aubervilliers deux enfants qui taient proprement, ainsi comme cette figure est, car pour vrai je les vis etles tins entre mes mains, et avaient, comme vous voyez, deux ttes, quatre bras, deux cous, quatre jambes,quatre pieds, et navaient quun ventre et quun nombril, deux ttes, deux dos. Et furent christianes, etfurent trois jours sur terre pour voir la grande merveille au peuple de Paris ; et pour vrai, du peuple deParis y fut les voir plus de dix mille personnes, hommes que femmes [ ]. Elles furent nes environ septheures au matin, et furent christianes en la paroisse Saint-Christophe, et la dextre fut nomme Agns,la senestre Jeanne et vcurent aprs le baptme une heure , d. Beaune C., Paris, 1990, pp. 259-260.
1
-
M. van der Lugt
Les chroniques mdivales dcrivent, avec une certaine frquence, la naissance den-fants dont lapparence physique insolite conduit les chroniqueurs les dsigner commedes monstres (monstrum, prodigium, portentum, ostensum, etc.4). Comme lont montrLorraine Daston et Katherine Park dans un livre important, ces rcits illustrent lesractions suscites par les naissances monstrueuses dans la socit mdivale5. Pro-voquant parfois la fascination, comme dans le second rcit, les motions dinquitudeet dhorreur prdominent, que lon interprte ces naissances, comme dans le rcit deVillani, et linstar des Romains dj, comme le signe dun mal futur, ou approchedinspiration chrtienne comme leffet visible du pch, le plus souvent une fautecollective6. Loin de ntre quun drame priv, la naissance dun enfant monstrueux estun vnement public qui attire les foules, appelle lintervention des autorits et suscitedes initiatives de commmoration pour que le message vhicul par le prodige ne seperde pas.La place et la signification des naissances prodigieuses dans la socit mdivale
ne sont ainsi pas les mmes que celles dun autre type de monstres : les peuplesou races lgendaires, tels les hommes sans tte (blemmyae), les cynocphales ou lespygmes, et ce mme si leur apparence peut tre similaire (nains et pygmes, herma-phrodites et peuple androgyne, par exemple)7. Alors que les naissances monstrueuses des cas et non des groupes font irruption au sein mme du monde chrtien, lespeuples monstrueux vivent sur les confins du monde connu, suscitant moins la peurque lmerveillement, linstar dautres mirabilia sur les marges du monde8. Suivant lemotif augustinien de la concordia discors, les races lgendaires embellissent la cration,leur fonction esthtique constituant en mme temps leur raison dtre9.Il est vrai quAugustin galise les espces merveilleuses et les individus prodigieux
comme autant de manifestations de la volont divine, en disant que rien ne peuttre contre nature, puisque tout mane de Dieu. Cependant, avec lautonomisationprogressive de la nature partir du xiie sicle, lcart entre les deux types de monstresse creuse. Si les races lgendaires compltent en quelque sorte lordre de la nature, lesnaissances monstrueuses apparaissent comme le fruit dune suspension temporaire ducours habituel de la nature, due lintervention dun Dieu en colre ou une erreur dela nature, qui, loin de rpondre des lois dairain, laisse parfois chapper des produits
4. Le sens de ces termes nest pas limit aux monstres mais renvoie aux phnomnes merveilleux etextraordinaires en gnral. Cependant, ds lpoque carolingienne, le monstrum apparat essentiellementcomme un phnomne zoologique. Cf. Friedman J. B., The Monstrous Races in Medieval Art and Thought,Cambridge (Mass.), 1981, p. 111.
5. Daston L. et Park K., Wonders and the Order of Nature, New York, 1998, chapitre 1. Elles citent lesrcits de Villani et du Bourgeois de Paris aux pages 57 et 65 respectivement.
6. Les naissances monstrueuses peuvent aussi tre interprtes comme la consquence de la violationdes normes sexuelles par les parents ; le monstre lui-mme nest pas en cause. Cf. Daston L. et Park K.,Wonders, op. cit., p. 56, p. 181. Les deux interprtations peuvent aussi ce complter, le mal futur annoncpar le monstre punissant le pch pass.
7. Voir Daston L. et Park K., Wonders, op. cit., pp. 48-59, p. 175, p. 181.8. Dans lOccident mdival, cette attitude positive envers les merveilles des marges semble se dve-
lopper partir du xiie et surtout du xiiie sicle. Les textes du Haut Moyen Age accentuent en revanchele caractre menaant des merveilles de lOrient. Cf. Daston L. et Park K., Wonders, op. cit., pp. 26-27.
9. Friedman J. B., The Monstrous Races, op. cit., pp. 184-185.
2 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
imparfaits10.Cette rapide vocation de la distinction entre monstre individuel et race mons-
trueuse permet dvacuer ce que je ne ferai pas dans cet article, cest--dire dresserune typologie des monstres ou tudier les reprsentations des monstres au MoyenAge11. Je partirai dune conception savante de la monstruosit qui ne recouvre quepartiellement le langage des sources littraires. En effet, selon lapproche particuli-rement gradualiste dAristote, assimile par les savants mdivaux partir du xiiie
sicle, le concept de la monstruosit est relatif. Le monstre au sens fort est certes celuidont la forme nest pas humaine, mais tout enfant qui ne ressemble pas ses parentsest dj en quelque sorte monstrueux, dans la mesure o la force du sperme nest pasparvenue reproduire lapparence du pre12. Si le Moyen Age ignore les cabinets decuriosits, les collections de ftus anormaux et la tratologie comme domaine de re-cherche bien dfinie, les philosophes et mdecins mdivaux proposent assez souvent,dans le sillage dAristote et des mdecins grecs et arabes, des explications purementnaturelles des naissances monstrueuses13.Dans les textes des savants mdivaux que jtudierai dans les pages qui suivent,
la distinction entre race monstrueuse et individu prodigieux a moins dimportanceque de savoir tracer une limite entre humanit et inhumanit : cest le problme delappartenance des monstres lespce humaine ou, pour retranscrire cette questiondans le lexique spirituel et thologique, de leur statut dans lconomie du salut etde leur accs au sacrement de baptme. Ces questions sinscrivent dans un ensembledinterrogations sur les limites de la personne humaine, questions qui permettent auxsavants scolastiques de mieux la dfinir. Cependant, en fonction de leur anomalie, lesmonstres mettent aussi en cause dautres classifications, comme la division entre lessexes, dans le cas de lhermaphrodite dont lhumanit ne fait pas de doute. En mme
10. Daston L. et Park K., Wonders, op. cit., pp. 48-57. Sur le changement de la conception de la nature partir du xiie sicle, voir aussi Van der Lugt M., Le ver, le dmon et la vierge. Les thories mdivales de lagnration extraordinaire, Paris, 2004, pp. 16-21.
11. Pour lOccident mdival, il existe une bibliographie abondante. Outre louvrage de Daston etPark et celui de Friedman, mentionnons, sans aucune prtention lexhaustivit, Kappler C., Monstres,demons et merveilles la fin du Moyen Age, Paris, 1980 ; Lecouteux C., Les monstres dans la pense mdivaleeuropenne, Paris, 1993 ; Williams D., Deformed Discourse : The Function of the Monster in Mediaeval Thoughtand Literature, Exeter, 1996 ; Olsen K. E. et Houwen L. A. J. R. (d.), Monsters and the Monstrous in MedievalNorthwest Europe, Leuven, 2001 ; Bovey A.,Monsters and Grotesques in Medieval Manuscripts, Londres, 2002.
12. Cest dans cette perspective que lon doit comprendre la clbre qualification de la femme comme contre nature (De generatione animalium, IV, 3, 767b). Aristote souligne toutefois que la femme nestpas un monstre au vrai sens du terme, dans la mesure o sa naissance possde une cause finale : laperptuation de lespce. Cette dimension manque au vrai monstre qui nest que le rsultat dun concoursde causes circonstancielles. Ajoutons que lappartenance de la femme lespce humaine et sa possessiondune me va de soi pour les thologiens mdivaux. Linterdiction de lordination des femmes a dautresraisons. Dans ce qui suit, je me concentre sur les formes de monstruosit qui posent le problme delappartenance lespce humaine et de laccs aux sacrements.
13. Il nexiste, ma connaissance, pas dtude gnrale des explications naturalistes des monstres auMoyen Age. Voir, pour le cas dAlbert le Grand, Demaitre L. E. et Travill A. A., Human Embryologyand Development in the Works of Albertus Magnus , in Weisheipl J. (d.), Albertus Magnus and theSciences. Commemorative Essays, Toronto, 1980, pp. 405-440. Daston L. et Park K., Wonders, op. cit., chapitre5 proposent une tude dtaille des discours naturalistes sur les monstres au dbut de lEpoque moderne.
3 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
temps, lenjeu des dbats sur les monstres a une dimension minemment pratique :il sagit de dcider quelle politique lEglise doit adopter face aux monstres, parfoisdans des situations durgence. Faut-il vangliser les races monstrueuses, baptiser lesenfants monstrueux ? Les monstres peuvent-ils conclure un mariage, tre ordonnsprtre ?
Peuples sur les marges et les frontires de lhumanit
Comme sur beaucoup de sujets, cest Augustin (354-430), rfrence oblige pourlOccident mdival, qui a lanc le dbat sur lhumanit des races monstrueuses. Dansun passage clbre de la Cit de Dieu, il laisse ouverte la question de leur existence, touten ajoutant que sils existent, la question de leur appartenance lespce humaine doitse poser. Leur apparence insolite na rien de choquant, dans la mesure o elle reflte lavolont de Dieu, et elle nest certainement pas un critre pour exclure leur humanit.Aprs tout, on ne doute pas de la nature humaine des prodiges individuels. Lhommeest un animal rationnel mortel ; cest donc lme rationnelle qui distingue lhommedes autres animaux14. Comme lexplique Augustin ailleurs, la parole de la Gense se-lon laquelle lhomme a t cr daprs limage de Dieu (1 :26 et 1 :27) ne doit passe comprendre dans un sens corporel15. Si donc les peuples monstrueux ont une merationnelle, on ne saurait douter quils descendent, comme nous, dAdam. Mais ont-ilsune me ? Prudent comme son habitude, Augustin ne se prononce finalement pas surce point, ni nexplique comment reconnatre la prsence de lme rationnelle, invisible.Cependant, la discussion vhicule une conception inclusive et universaliste de lhuma-nit et une grande indiffrence envers les anomalies physiques. Dautre part, lextrapo-lation des naissances monstrueuses aux races extraordinaires montre que lhumanitdes enfants prodigieux, et donc leur accs aux sacrements, va de soi. Lanalogie estencore plus explicite chez lencyclopdiste Isidore de Sville16, qui dresse, deux siclesplus tard, une typologie trs influente des monstres, dans laquelle il affirme pourtantgalement que les cynocphales, cause de leur apparence canine, sassimilent auxanimaux plutt quaux hommes17. La vision inclusive de lhumanit se confirme dansles crits dautres Pres de lEglise bien connus au Moyen Age, comme dans le portraitdress par Jrme dun monstre hybride que rencontre saint Antoine dans le dsert18.Soulignons que cette attitude chrtienne tranche avec la tradition romaine. La Loi
des XII tables ordonne llimination des enfant faibles et monstrueux. La pratique dela suppression de ces derniers, considrs comme de mauvais augure, est effective-
14. Augustin dHippone, De civitate Dei, XVI, 8, 1-2 (Bibliothque augustinienne 36, pp. 206-212).15. Augustin dHippone, Confessiones, VI, 3, 4 (Bibliothque augustinienne 13, p. 524).16. Isidore de Sville, Etymologiarum sive Originum libri xx, xi, 3 : Sicut autem in singulis gentibus
quaedam monstra sunt hominum, ita in universo genere humano quaedam monstra sunt gentium, ut Gi-gantes, Cynocephali, Cyclopes, et cetera. (d. Lindsay W. M., Oxford, 1911, 2 vol., t. 2, sans pagination).Isidore ne pose pas la question de lhumanit des monstres de manire explicite, mais il prsente, par levocabulaire utilis, les races lgendaires et les naissances prodigieuses comme des tres humains.
17. Isidore, ibidem : Cynocephali appellantur, eo quod canina capita habeant, quousque ipsi latratusmagis bestias quam homines confitentur .
18. Jrme, Vita sancti Pauli, 8 (PL 23, c. 23). Cf. Van der Lugt M., Le ver, op. cit., pp. 196-198.
4 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
ment atteste. Sans prconiser leur limination, le droit romain refuse quant lui deleur reconnatre le statut denfant avec tous les droits qui y sont associs, en prci-sant toutefois que ceci sapplique aux cas les plus svres, dont lapparence nest pashumaine, et non aux individus affects dune simple malformation19. Lme ne joueaucun rle dans ces considrations. Augustin et le droit romain constitueront, ctdautres traditions (philosophiques, littraires, etc.), deux rfrences importantes pourles dbats mdivaux sur le statut ontologique, juridique et spirituel des monstres.Dans lOccident mdival, le problme de lhumanit des races monstrueuses (ou,
dans les termes dAugustin, leur origine en Adam) surgit de temps autre, sans ja-mais constituer un thme central. Au ixe sicle, Ratramne de Corbie, rpond, dans unelettre clbre, aux interrogations du missionnaire Rimbert qui souhaite savoir si lescynocphales quil a rencontrs, ou risque de rencontrer, au Danemark ont une me,et donc, implicitement, sil convient de les vangliser20. Selon Ratramne, les doc-teurs de lEglise considrent les cynocphales, cause de leur apparence canine,comme des animaux plutt que des hommes, rfrence probable Isidore de Sville.Sil arrive la conclusion oppose, ce nest pas cause de lautorit dAugustin quilne cite curieusement pas, ni la faveur de lanalogie entre naissances inhabituelles etpeuples monstrueux, pour laquelle il cite explicitement Isidore de Sville. Au contraire,Ratramne souligne que tout ce qui est issu des hommes nest pas ncessairement hu-main, voquant, l encore daprs Isidore, le cas de femmes accouchant dun veau,dun serpent, ou dun tre hybride, mi-homme, mi-animal21. Il semble aussi dubitatifsur lappartenance lespce humaine dautres peuples monstrueux. Pour les cyno-cphales, cest le tmoignage de Rimbert sur leurs murs et leur mode de vie quiest dterminant. Les cynocphales portent des vtements signe de leur sens de lapudeur et de leurs capacits techniques , pratiquent lagriculture, ont des animauxdomestiqus et vivent en socit, selon des coutumes ; tout cela suppose la prsencedune me rationnelle. La lgende de saint Christophe, cynocphale martyr, apporteun argument supplmentaire22.
19. Digeste, 1.5.14 : Paulus. Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more pro-creantur, veluti si mulier monstrosum aliquid, aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorumhumanorum officia ampliavit aliquatenus videtur efectus ; et ideo inter liberos connumerabitur . VoirSchrage E., Capable of Containing a Reasonable Soul , Collatio iuris romani, Amsterdam, 1995, II,pp. 469-488, surtout pp. 469-476 et Lefebvre-Teillard A., Infans conceptus. Existence physique et exis-tence juridique , Revue historique du droit franais et tranger, 72 (1994), pp. 499-525, surtout pp. 501 et505.
20. Les cynocphales apparaissent de manire rcurrente dans les crits du Haut Moyen Age surlEurope du Nord et du Nord-Est, mais le terme renvoie aussi de manire spcifique aux Danois. Il sagitdune figure littraire servant effrayer, mais il est possible que certains habitants de ces rgions aienteffectivement t connus sous le nom de cynocphales et quils aient port des masques de chien. Cf.Wood I., The Missionary Life. Saints and the Evangelisation of Europe, 400-1050, Harlow, 2001, p. 252. Lalettre de Ratramne ne permet pas de dterminer si Rimbert, dans sa propre lettre qui ne nous est pasparvenue, avait dcrit les cynocphales daprs ses propres observations, daprs celles dun tiers, voiredaprs une tradition littraire.
21. Isidore de Sville, dans le chapitre cit la note 16.22. Ratramne de Corbie, Epistola de cynocephalis (Epistola 12), d. Dmmler E., Epistolae Karolini Aevi,
MGH Epist. 6, Berlin, 1902, pp. 155-157. Voir Wood I., The Missionary, op. cit., pp. 252-253.
5 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
La lettre de Ratramne reste apparemment sans postrit et il faut semble-t-il attendreplusieurs sicles pour trouver nouveau quelques discussions parses sur lhumanitdes peuples monstrueux. Ces dbats sinscrivent alors dans le dveloppement du nou-veau savoir scolastique et, surtout partir du xiiie sicle, dans le cadre dune rflexionanthropologique nourrie de la rception de textes mdicaux et philosophiques grco-arabes. Au dbut du xiie sicle, Pierre Ablard soutient dans un court passage duncommentaire biblique, qu lorigine, les satyres sont ns des rapports entre des va-lets et des animaux, puis se sont reproduits entre eux. Malgr leur forme hybride, lessatyres sont, selon Ablard qui renvoie la description du monstre hybride chez J-rme, des animaux rationnels et mortels, qui peuvent parler comme nous . Dans lesillage patristique, Ablard considre quune forme corporelle insolite nempche pasla possession dune me humaine. De plus, son esprit, il suffit davoir un seul parenthumain, mme lointain, pour appartenir lespce humaine23.Vers 1250, lauteur anonyme du Trait sur le corps de lhomme ajout la Somme dite
dAlexandre de Hals24 reste galement dans la ligne dAugustin, abondamment cit,en souscrivant la fonction esthtique des monstres et en gnralisant des naissancesindividuelles aux races monstrueuses. La question sinsre ici dans une longue in-terrogation sur la cration de lhomme et de la femme. Cependant, les rponses dumatre franciscain aux objections indiquent quil est devenu difficile de faire abstrac-tion de lapparence insolite des monstres. Si laristotlisme conforte, avec le conceptde forme substantielle, la doctrine chrtienne de luniversalit de lhumain, il familia-rise en mme temps les auteurs scolastiques avec lide dune adquation ncessaireentre forme et matire, entre corps et me, renforant une tendance dj perceptible partir du xiie sicle25. Chaque espce est caractrise par une organisation matrielleparticulire et lme humaine ne peut sassocier qu un corps qui lui est adapt. Tho-mas de Cantimpr qui avait frquent luniversit de Paris deux dcennies plus tt,nie dailleurs, pour cette raison, lhumanit des peuples monstrueux. Le principe de lacorrespondance entre capacits mentales et forme physique explique en mme temps,selon lencyclopdiste dominicain, que les monstres, y compris les monstres hybridescomme lindividu dcrit par Jrme, ont, grce certaines similitudes physiques aveclhomme, des comportements qui les situent au-dessus des autres animaux26.
23. Commentarius Cantabrigiensis in Epistolas Pauli e Schola Petri Abaelardi, ad Eph 2 (d. Landgraf A.,Notre Dame (Indiana), 1937-45, pp. 395-396). Voir aussi Van der Lugt M., Le ver, op. cit., p. 246. Larfrence la parole nest pas anodine. Selon la tradition littraire (prsente dans le Liber monstrorumcompil au Haut Moyen Age, puis dans de nombreuses encyclopdies mdivales), le centaure, autremonstre hybride, bouge les lvres comme pour parler, mais il lui manque finalement la capacit dulangage humain. Pour le centaure, cf. Williams D., Deformed, op. cit., pp. 182-183.
24. Pour la date du trait et son rapport avec la Somme, cf. Doucet V., Prolegomena dans Summa fratrisAlexandri (d. Quaracchi, 1948, IV/1, pp. cxx-cxxi).
25. Ds le xiie sicle, lide de lorganisation corporelle ncessaire motive la prise de position en faveurde linfusion de lme dans lembryon au moment de lapparition de la forme humaine. Cf. Van der LugtM., Lanimation de lembryon humain et le statut de lenfant natre dans la pense mdivale , inFormation et animation de lembryon dans lAntiquit et au Moyen Age, Brisson L., Congourdeau M.-H. etSolre J.-L. d., Paris : Vrin, sous presse.
26. Thomas de Cantimpr, De natura rerum, III, 1 : Secundum Augustinum utique determinaturanimal habere animam, quod est rationale mortale ; neque tantum forma, sed actus et habitus hominem
6 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
Lauteur du Trait sur le corps de lhomme concde quant lui que les hommessans tte ne peuvent tre considrs comme des tres humains qu condition dedisposer, dans une autre partie de leur corps, dun organe quivalent au cerveau. Ilse voit galement contraint relativiser laspect canin des cynocphales : plutt quede vritables ttes de chien, ils ont des visages particulirement disgracieux, et pluttque de vrais aboiements, leur prononciation rappelle le bruit des chiens. Au bout ducompte, lappartenance lespce humaine relve moins de lapparence extrieure quedun certain ordre intrieur (dispositio interior), savoir laccord interne du corps aveclme, et des organes principaux caractristiques de lhomme : le cerveau, le cur,le foie et les testicules27. Dautre part, si cet ordre interne diffrencie lhomme delanimal, il rend aussi la monstruosit possible, dans la mesure o seuls les hommessont capables du pch et que la difformit de lme finit par infecter le corps. Parun retournement curieux, la perception de la monstruosit comme punition vient iciappuyer lhumanit des monstres. Les cynocphales sont des tres humains, mais ilsagit dune humanit infrieure, tant sur le plan esthtique que moral28.La rflexion anthropologique prend un lan particulier et exceptionnel dans ce trait
franciscain, mais reste finalement aussi assez isole29. Pierre Lombard navait pas vo-qu les races monstrueuses dans la partie sur la cration de ses Sentences et la traditiondes commentaires reste, semble-t-il, silencieuse. Nanmoins, durant la seconde moitidu xiiie sicle, la question apparat sous la plume de plusieurs auteurs scolastiques,tant des philosophes que des thologiens, propos dun peuple en particulier : lespygmes30. La forme de ces discussions nest pas anodine : il sagit pour la plupart
manifestant. Animalibus vero monstruosis animam inesse non credimus, et si per aliquos actus ad ra-tionis motum sensu estimationis habilitentur extrinsecus, quoniam non habent cursum organizationis incorpore, ut sensu intellectuali rationis scemate perfruantur. Et non mirum, si monstra huiusmodi alicuiusactus habilitatione ceteris animalibus preferantur, quia forte secundum quod plus appropinquant hominiexteriori forma in corpore, tanto illi appropinquant sensu estimationis in corde (d. Boese H., Berlin /New York, 1973, p. 97).
27. Somme dite dAlexandre de Hals , lib. II, pars 2, inq. 4, tract. 2 (Tractatus de corpore humano),sect. 2, q. 1, tit. 1, cap. 3 (452), ad 4 : Et est dispositio interior, quae attenditur in convenientia etcongruitate numerorum et harmoniae corporis organici ad animam : et quantum ad hanc dispositionemsecundum differentiam animarum est diversitas dispositionum ipsorum organorum. Nec habent homineset bruta quantum ad huiusmodi dispositionem organa similia : non enim requiritur diversitas multaquantum ad dispositionem exteriorem inter membra hominum et brutorum quorumlibet, etiam quantumad principalia membra, cuiusmodi sunt cerebrum, cor, hepar et testiculi, ut patet in multis (d. cit.,p. 576). Pour la notion galnique des organes principaux, voir Siraisi N., Taddeo Alderotti and his Pupils.Two Generations of Italian Medical Learning, Princeton, 1981, p. 187.
28. Sur ce point, voir Friedman J. B., The Monstrous, op. cit., p. 187.29. Le trait propose galement une discussion exceptionnelle et relativement isole sur la raison dtre
de la diffrence sexuelle, voir Van der Lugt M. , Pourquoi Dieu a-t-Il cr la femme ? Diffrence sexuelleet thologie mdivale , in Eve et Pandora. La cration de la premire femme, Schmitt J.- C. (dir.), Paris, 2002,pp. 89-113, ici pp. 103-113.
30. Albert le Grand, De animalibus, d. Stadler H., Albertus Magnus de animalibus libri xxvi. Nach derKlner Handschrift, Mnster, 1916 et 1921 (Albert voque les pygmes dans de nombreux passages, voirltude de J. Koch cit ci-dessous pour des indications prcises) ; Quodlibeta dun matre franciscain ano-nyme (vers 1286-87) Utrum pygmei sint homines (B.n.F., ms. lat. 15850, fo16vo17ro) ; Henri dAlle-magne et Henri de Bruxelles, Quodlibeta ( facult des Arts, vers 1300) Utrum aliquod animal possithabere aliquam figurationem hominis sine intellectu (B.n.F., ms. lat. 16089, fo 58vo) ; Pierre dAuvergne,
7 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
de questions quodlibtiques , exercices universitaires plus libres que les commen-taires sur les textes qui font autorit et plus susceptibles daborder des thmes extra-curriculaires31. En mme temps, on peut penser que lintrt privilgi pour les pyg-mes tient leur prsence, non seulement dans des encyclopdies et rcits de voyages,mais aussi dans des textes scolastiques de base : la Bible32 et surtout les uvres dAris-tote33.Lessentiel du portrait des pygmes vient de sources livresques : leur taille (une cou-
de34), leur dure de vie et ge de reproduction (huit et cinq ans), leur combat avecdes grues, leur habitat ( la source du Nil ou encore en Inde), la domestication pareux de petits chevaux. Nanmoins, plusieurs auteurs sappuient galement sur desobservations personnelles ou des tmoignages dou-dire. Albert le Grand, initiateurdu dbat, affirme que de nombreuses personnes ont vu les pygmes et il est aussi pos-sible quil applique aux pygmes les tmoignages recueillis sur des hommes sauvagesen Saxe35. Le philosophe et mdecin Pietro dAbano dit avoir vu et touch despygmes lui-mme, et Pierre dAuvergne semble tirer certains lments dun informa-teur qui a vu des marchands dans des rgions qui nous sont plus proches quelhabitat naturel des pygmes et qui proposent des exemplaires morts et embaums la vente. Il considre pourtant ces informations comme peu fiables, car les marchandsmaquilleraient et trafiqueraient les pygmes pour mieux les vendre. Il se peut queces tmoignages concernent des singes. Il est extrmement peu vraisemblable que lesauteurs mdivaux aient vu de vrais pygmes.
Quodlibeta (facult de thologie, Nol 1301) Utrum pygmei sint homines (d. Koch J., Sind diePygmen Menschen ? Ein Kapittel aus der philosophischen Anthropologie der mittelalterlichen Scholas-tik , Archiv fr Geschichte der Philosophie, 40, 1931, pp. 194-213, ici pp. 209-213). Dans son commentairesur les Problmes dAristote achev en 1310, le philosophe et mdecin Pietro dAbano rsume largumen-tation dAlbert le Grand : Expositio Problematum, X, 12, d. Venise 1482, sans foliotation. Plusieurs auteursse sont dj intresss au dbat mdival sur les pygmes : Koch J., Sind die Pygmen , op. cit., (surAlbert le Grand et Pierre dAuvergne) ; Khler T. W., Anthropologische Erkennungsmerkmale men-schlichen Seins. Die Frage der Pygmei in der Hochscholastik , in Mensch und Natur im Mittelalter,Zimmermann A. et Speer A. (d.), 2 vol., Berlin / New York, 1992, t. 2, pp. 718-730 (sur Albert, PierredAuvergne, lanonyme franciscain). Thijssen J. M. M. H., Reforging the Great Chain of Being : TheMedieval Discussion of the Human Status of Pygmies and its Influence on Edward Tyson , in Ape,Man, Apeman : Changing Views since 1600, Corbey R. et Theunissen B. (d.), Leiden, 1995, pp. 43-50 (surAlbert le Grand et Pierre dAuvergne). Thijssen critique juste titre certaines interprtations proposespar H. W. Janson (Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance, Londres, 1952, pp. 88-90) etpar Friedman (The Monstrous, op. cit., pp. 192-193). Afin dallger les notes, je noterai, dans ce qui suit,en gnral uniquement le nom des auteurs mdivaux, sauf lorsque celui-ci nest pas discut par Koch,Khler et Thijssen.
31. Sur le genre et son originalit, voir Bazn B., Wippel J., Fransen G.et Jacquart D., Les questionsdisputes et les questions quodlibtiques dans les facults de thologie, de droit et de mdecine, Turnhout, 1984 etMarmursztejn E., LAutorit des matres. Scolastique, normes et socit au xiiie sicle, Paris, 2007.
32. Ezchiel 27, 11 mentionne les pygmes parmi les peuples ayant contribu la richesse et la notoritde la ville de Tyr. Les commentaires exgtiques sur ce passage sont pauvres dintrt, voir FriedmanJ. B., The Monstrous, op. cit., p. 191. Le matre franciscain anonyme (cf. infra) cite ce verset en faveur delhumanit des pygmes.
33. Aristote, Histoire des animaux, VIII, 12, 597a et (Ps.)-Aristote, Problmes, X, 12, 892a18.34. Pierre dAuvergne dit une demi-coude.35. Cf. Koch J., Sind die Pygmen , op. cit., p. 205.
8 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
Rompant avec la conception augustinienne, la plupart des auteurs refusent aux pyg-mes mme un niveau infrieur dhumanit. Dans la chane de ltre, ils occupentplutt une place intermdiaire entre lhomme et le singe36. Les critres pris en comptecomme marqueur dhumanit sont de diffrents types : lanatomie, mais surtout lecomportement social, moral et religieux et les capacits cognitives et linguistiques. Al-bert le Grand et Pierre dAuvergne concdent que la ressemblance entre les corps despygmes et les corps humains, tant globalement que pour chaque membre individuel-lement, plaide en faveur de leur humanit, de mme (pour Albert), que leur bipdie,lusage des mains, et une certaine matrise du langage, ainsi que (Pierre) la culture dela terre, leur lutte avec les grues et leurs pratiques religieuses (ils battraient leurs mainsau lever du soleil). Cependant, une comparaison minutieuse avec dautres animauxmontre, selon Albert, que les pygmes nont finalement quune ombre de raison .Pourvus dune mmoire et capables dapprendre par imitation, comme les singes,ils sont incapables de former de vritables concepts et de parler de choses abstraitesou gnrales. Albert compare le langage des pygmes certes suprieur aux sons si-miesques aux balbutiements des handicaps mentaux (moriones) incapables dutiliserleur raison cause dun empchement accidentel37. Lusage des mains est, comme ledit Aristote, un signe dintellect, mais l encore, le pygme se situe entre le singe etlhomme, car il reste incapable de dvelopper des techniques. Les pygmes chouent constituer une vritable socit, ils vivent en groupe, mais nont ni organisation po-litique, ni lois ; ils suivent leurs instincts, comme les animaux, et nont aucun sens delhonneur ou de la pudeur (nous avons vu limportance de ce critre chez Ratramne).Pierre dAuvergne considre que leur suppose pratique de lensemencement et leurculte solaire ne prouvent rien non plus. On trouve des comportements similaires chezdes animaux qui font des stocks de nourriture, les fleurs souvrent et se referment enfonction de la chaleur et de la lumire et lopposition des pygmes aux grues peut secomparer la lutte pour la nourriture et la survie entre animaux despces diffrentes.En ce qui concerne la similitude physique, le thologien note que dautres animaux seressemblent (le loup et le chien par exemple) tout en appartenant des espces dif-frentes. Enfin, selon Pierre et les auteurs dune question quodlibtique dispute vers1300 Paris, les pygmes sont simplement trop petits pour tre humains38 . La forme
36. Nicole Oresme, qui ne discute pas de lhumanit des pygmes en dtail, confirme leur place dansla chane de ltre sur le plan embryologique. La squence des phases du dveloppement embryonnaireest analogue la hirarchie de la chane de ltre. Lembryon humain est dabord du sperme, ressembleensuite un champignon, puis un animal informe, puis un singe, puis un pygme et seulementenfin un tre humain parfaitement form. Quodlibeta, cap. 3, 6 (Hansen B., Nicole Oresme and the Marvelsof nature : A Study of his De causis mirabilium with Critical Edition, Translation, and Commentary, Toronto,1985, p. 238).
37. Albert le Grand, De animalibus, xxi, tract. 1, cap. 2, 12 : Et ideo pigmeus nichil omnino percipitde rerum quiditatibus nec umquam percipit habitudines argumentorum : et sua locutio et sicut locutiomorionum qui naturaliter stulti sunt eo quod non perceptibiles sunt rationum. Sed in hoc est differentiaquod pigmeus habet privationem rationis ex natura, morio autem habet per accidens ex melancolia velalio accidente non privationem rationis, sed potius privationem usus rationis (d. cit., p. 1328).
38. Henri de Bruxelles et Henri dAllemagne, Quodlibeta, Utrum aliquod animal possit habere ali-quam figurationem hominis sine intellectu ? Dicendum quod sic. [. . .] Et respondendum quod oportetex debilitatem ( !) virtutis et defectum ( !) quantitatis debite ad formam intellectivam. Item et propter
9 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
extrieure du corps doit correspondre aussi quantitativement la forme intrieure. Lataille moyenne de lhomme tant de quatre coudes, les pygmes sloignent trop dela norme.Largument quantitatif ne fait pourtant pas lunanimit. Une quinzaine dannes
plus tt, un thologien franciscain fait valoir que personne ne doute de lhumanitdun embryon de quarante-six jours (selon une thorie trs rpandue, Dieu infuselme humaine ce stade de la gestation ; lembryon aurait alors acquis les linamentsde la forme humaine39). Les pygmes sont donc vraisemblablement des tres humains.Il sagit sans doute de descendants de couples de nains, ou alors leur taille rduitesexplique par linfluence astrologique dans les rgions o ils habitent. Pour le matrefranciscain, lessentiel cest que les pygmes possdent un corps bien proportionn (or-ganizatio debita). Bien sr, cette caractristique distingue les pygmes de bien des racesmonstrueuses. Paradoxalement, largument se rvle finalement double tranchantpour les autres peuples insolites et surtout pour les prodiges individuels. Un monstre,mme issu de parents humains, avec la tte en bas et les pieds sur le ct nest pasun tre humain et ne doit pas tre baptis. Souscrivant galement lide que certainsenfants monstrueux sont le fruit de rapports bestiaux, le matre franciscain ajoute queceux-l ne peuvent pas non plus recevoir le baptme40.La doctrine baptismale du matre franciscain prfigure la littrature thologique et
canonique de lEpoque moderne41, mais elle ne se retrouve gure ou pas chez lesthologiens et canonistes mdivaux. En revanche, elle se rapproche du droit civilmdival, tout en refltant sans doute des croyances et des mentalits communes. Ledroit romain classique, on la vu, dnie au monstre le statut et les droits dun en-fant, sans exclure toutefois ceux affects dune simple multiplication ou diminutiondes membres. Les civilistes mdivaux attribuent les monstres de la premire catgo-rie des rapports bestiaux, mme sils signalent que les mdecins savants (physici) yvoient leffet de limagination maternelle42, interprtation qui permet dattnuer les
dispositionem materie ad talem formam [. . .] (B.n.F., ms. lat. 16089, fo 58vo).39. Cf. Van der Lugt M., Lanimation , op. cit.40. Anonyme, Quodlibeta, Utrum pygmei sint homines ? [. . .] quedam sunt monstra que sunt ex
humanis principiis, sicut ex semine viri et mulieris, sed propter defectum materie seu (ms. sed) super-habundantiam fiunt cum sex digitis vel tribus, vel etiam causantur propter defectum alicuis qualitatisvel propter inconvenientem dispositionem matricis et ideo monstra diversa causantur in specie humana.Unde si habeant organizationem debitam sunt capacia gratie, sed si non haberent organizationem debi-tam, puta caput inferius et pedes ad latus vel aliquo alio modo consimili, tunc non essent capascia ( !)gratie, nec essent baptizanda. [. . .] Alia sunt monstra que causantur ex comistione seminum (ms. simi-tium) animalium diversorum specie, sicut ex semine viri et femelle alterius specie vel e contrario et licethaberet aliquam figuram hominis, non tamen est homo ille fetus nec capax gratie nec debet baptizari.Quod non sit homo satis patet : semen hominis non est tante virtutis quod possit convertere aliud semenad suam speciem sicut asinus non convertit semen eque, sed facit tertiam partem, sicut dico in propositoideo et cetera , (B.n.F., ms. lat. 15850, fo 16vo17ro).
41. Pour des rfrences voir Friedman J. B., The Monstrous Races, op. cit., p. 182 et Card J., La nature etles prodiges. Linsolite au xive sicle en France, Genve, 1977, p. ix, note 3.
42. Lide que limagination affecte laspect du ftus est trs rpandue et largement accepte par lessavants mdivaux, voir Van der Lugt M., La peau noire dans la science mdivale , in Micrologus, 13,2005, pp. 439-475.
10 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
implications funestes de lhypothse bestiale, tant pour la mre que pour lenfant43.Lide du rapport entre naissances monstrueuses et bestialit est ancienne et rpan-
due ; nous avons vu quAblard y souscrivait galement. Cependant, les mdecins etles philosophes mdivaux lont le plus souvent combattue, surtout aprs la rcep-tion de la philosophie naturelle dAristote. Selon ce dernier le mlange despce nestpossible quentre espces trs voisines dont la taille et la dure de gestation se rap-prochent, comme le cheval et lne, le renard et le chien, et il rejette explicitement lescroisements entre un homme et un mouton, un chien ou un buf44. Une anecdote si-gnificative raconte comment lintervention dAlbert le Grand dans un village prvientde justesse lexcution dun berger aprs la naissance suspecte dun veau45. Cepen-dant, la croyance a la vie dure et reoit de plus, on la vu, laval des civilistes. Uncas rel, similaire lanecdote concernant Albert le Grand, jug devant la Cour de laHollande en 1464, se termine ainsi par la condamnation mort de laccus46.
43. Cette distinction apparat partir de Azon (fin xiie sicle) dans sa discussion sur les enfantsposthumes et sera reprise dans la Glose ordinaire. Azon, Summa codicis, ad. C. 6.29.2 : [. . .] Et certetunc distingui potest, an id acciderit propter delictum mulieris, ut quia rem habuit cum aliquo animaliirrationali, ut tunc nati non debeant reputari liberi. An ideo, quia cum ipsa cognosceretur a masculo dealiquo animali cogitaverit, nam ex cogitatione concipienti talia accidunt, ut dicunt physici, et tunc natipostumi habentur pro liberis . Voir aussi ibidem, ad C. 6.29.3 (cit par Schrage E., Capable , op. cit.,p. 477). Voir aussi Lefebvre-Teillard A., Infans , op. cit., p. 505, note 20.
44. Aristote, De generatione animalium, II, 7, 746a et IV, 3, 769 b. Au dbut des annes 1230, le thologienGuillaume dAuvergne soutient que les semences de certains animaux se mlent facilement avec cellesdes hommes. Cependant, devant labsence de soutien de la part des autorits savantes, il recourt desrcits folkloriques pour le prouver. Cf. Van der Lugt M., Le ver, op. cit., pp. 259-260. Thomas de Cantimprdoute dj fort de la fertilit des croisements : De natura rerum, III, 1 (d. cit., p. 97).
45. Ps-Albert le Grand, De secretis mulierum, tract. 2, cap. 6, commentaire B (d. Francfort, 1615, pp. 198-199). Voir aussi Rodnite Lemay H., Womens Secrets. A Translation of Pseudo-Albertus Magnus De secretismulierum with commentaries, Albany NY, 1992, pp. 115-116. Lanecdote en tant que telle ne se trouve pasdans luvre dAlbert, mais ce dernier attribue les monstres laspect hybride aux influences astrales :Physica, ii, iii, 3 (d. Hossfeld P., Opera omnia, t. 4-1, p. 138) ; De mineralibus, ii, iii, 2 (Opera omnia, t. 5,p. 49).
46. Cas dun certain Willem Boudewinszn originaire de Kralingen et g denviron vingt-huit ans,ayant confess, sans tre soumis la torture, avoir commis de nombreuses reprises des actes de bes-tialit avec plusieurs vaches, dont lune a par consquent donn naissance un veau anormal. Laccusest condamn mort. Son cadavre, ainsi que celui de la vache, devront tre brls. La Haye, AlgemeenRijksarchief, Hof van Holland, nr. 466, fo 115 : Roerende Willem Boudewinszn onlancx gerecht mit-ten brande. Alsoe Willem Boudewinszn, wonende in Cralingen, oudt xxviii jair off dair omtrent, hierjegenwoirdich staende voir den Hove van Hollant gekent ende gelijdt heeft, buyten pijne ende bande vanysere, dat hij tot veel ende diversche stonden mit alrehanden koeyen die onnatuerlicken ende onmensche-licke sonde van zodomye tegens nature gedaen ende volbracht heeft, zoe dat een van den voirs. koeyengekalft heeft een kalf, hebbende een onbehoirlicke ende een andere figuur dan een kalf behoirt te hebben.Ende dat hij hem eens van enen persoon heeft laten doen die voirs. onnatuerlicken zonde vanzodomye. Soe condempneert dairomme tvoirs. hoff ende wijst voir recht inden name ende van wegenmijnen genadige heren sHertogen van Bourgondien, grave van Hollant, den voirn. Willem Boudewinszn.verbuert te hebben zijn lijf ende zijn goet ende dat men hem rechten sal mitten stake ende mitten brandeende dat zijn lichaem ende desgelijcx die koe dair hij lestleden mede te doen heeft gehadt, verbrant endein asch ende polvere gewandelt sal (ms. dal) wesen. Gedaen xxi dagen in julio anno 1464. PresentibusGruuthuyse, Alcmade, Assendelf, Haelwijn, Eycke ende Werve . Je dois cet exemple Christiaan vander Riet, par lintermdiaire de Wim Blockmans. Quils soient tous les deux remercis. Sur la pratique dela mise mort de lanimal en mme temps que du coupable, cf. Berkenhoff A. H., Tierstrafe, Tierbannung
11 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
En droit civil, lenjeu de lhumanit des naissances monstrueuses concerne non pasleur statut spirituel, mais des points de droit successoral, la cration des liens entreparents et enfants, ainsi que le droit criminel (la mort par touffement de lenfantmonstrueux est-elle ou non un homicide)47. Le critre de la forme tant dcisif, lesdbats tournent autour la question de savoir o situer la frontire entre monstruositvritable et simple malformation. Au plus tard au xive sicle, se dgage lide que latte bien forme est caution dhumanit, mme si dautres parties du corps sont mons-trueuses. En mme temps, les civilistes commencent intgrer dans leurs discussionsla problmatique de lme et du baptme48. Dans son commentaire trs influent, Baldeinsiste ainsi sur laccord ncessaire entre corps et me, en signalant que ce qui na pasde corps humain ne peut avoir dme et ne peut recevoir le baptme49.Les civilistes partent de lide quil est possible dtablir des critres dhumanit,
partageant cette conviction avec les thologiens et les philosophes dans leurs dbatssur les pygmes. Vers 1370, Nicole Oresme sera en revanche bien plus sceptique surla possibilit de dterminer quel degr de malformation physique un monstre estencore de la mme espce que ses parents et quand il ne lest plus. Il critique en mmetemps limportance primordiale accorde la forme et lindiffrence de ses contem-porains aux fonctions sensitives et mentales. Pour Oresme, les personnes aveugles,sourdes et doues de moins de raisons quun chien sont bien plus monstrueusesque celles frappes de malformations physiques, car cest lintellect qui distinguelhomme de lanimal. Pourtant, stonne-t-il, personne ne doute de lhumanit deces individus50. Oresme nentend pas leur refuser le baptme ; sa remarque sinscrit
und rechtsrituelle Tierttung im Mittelalter, Leipzig / Strasbourg / Zurich, 1937, pp. 103-107.47. Schrage E., Capable , op. cit., pp. 469-476.48. Linfluence de lanthropologie et des normes chrtiennes se constate galement dans la doctrine
des civilistes sur lavortement. Le droit romain fait abstraction de lme et recourt la fiction pour trouverdes solutions profitables lenfant. Lavortement est puni non pas la faveur dun quelconque droit la vie du ftus, mais en raison dautres considrations civiles ou criminelles (ne pas priver le pre deson hritier, sanctionner lempoisonnement, etc.). En revanche, les civilistes mdivaux interprtent la po-sition du droit romain selon la thorie de lanimation dominante leur propre poque et en concordanceavec la thologie et le droit canon, en qualifiant lavortement dun ftus form (et donc anim) dho-micide. Cf. Mller W. P., Die Abtreibung. Anfnge der Kriminalisierung 1140-1650, Cologne, 2000, pp. 5-7 ;20-21, 30-32 ; 47-50.
49. Balde, In primam Digesti Veteris partem, ad D. 1.5.14 : Quod non habet corpus hominis, animamhabere hominis non presumitur, quia presumitur, quod natura non ponat animam, ubi non est corpus[. . .]. Vide utrum isti qui non habent formam humanam debeant baptizari ? Certe non, si habent formamcontrariam homini, sed si habent formam hominis, que maxime consistit in facie, licet deficiat aliquodmembrum, debent baptizari (d. Lyon, 1585, fo 33v-34r). Quelques dcennies plus tt, Pietro dAbanodcrit dj cette position comme celle des juristes (doctores legis nostre) : Expositio in Problematas Aristotelis,IV, 13 : Et scias quod maxime decernitur in figuracione capitis, si aliquid animal debet dici nostrumgenitus. Si enim caput habuerit plene ut generans figuratum, etiam si in multis aliis partibus est mons-truosus, potuit dici nostrum ; quid et doctores legis nostre considerantes percipiunt baptizari tanquamrecipiendum sit in specie nostra (d. cit., sans foliotation).
50. Nicole Oresme, Quodlibeta (De causis mirabilium) (1370), cap. 3, 6 : Sed hic est magna difficultas :quomodo fiunt monstra alterius speciei ? Non est mirum quod generatur homo claudus aut sine capitepulchro et cetera. et ita in aliis quod turpis equus aut porcus ita quod fit error in figura aut colore.Sed quod sit error in specie ita quod equus generat porcum aut homo cattum vel et cetera est magismirabile cum simile a simili producatur. [. . .] Dico 2 quod non queque diversitas in figura et colore
12 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
dans une rflexion pistmologique. Il est vrai que la thologie et le droit canon neconsidrent pas le handicap mental comme un obstacle au baptme, voyant lafflictioncomme purement accidentelle, due une obstruction organique. Le handicap men-tal, comme le fou furieux, est dou dune me rationnelle, mme sil est incapable,de manire temporaire ou permanente, den faire usage. LEglise lassimile aux petitsenfants, incapables eux aussi de donner leur consentement clair, de croire et de fairepnitence51.
sufficit ad concludendum quod sit alterius speciei. Dico 3 quod difficile est scire que diversitas et quantain colore et figura et accidentibus sufficit ad concludendum quod est alterius speciei. Dico 4 quodex hoc sequitur quod possibile est quod sepe erramus in iudicando hoc esse porcum vel et cetera ethoc esse monstruosum, quamvis enim accidentia conferant ad cogitandum quod quid est, non tamenquecunque accidentia. Sed que et quanta et quot sufficiant scire est bene difficile, ideo in multis decipimurut iudicando de cupro quod sit aurum vel et cetera. Et dico 5 quod in hominum monstris est adhucdifficilius iudicare quia nescimus qua hora Deus gloriosus infundit animam rationalem et quante etqualis figure sit fetus tunc quando scilicet Deus et cetera. Et credo quod nullus sit qui sciat nec possitscire que et quanta diversitas in membris sufficit ad concludendum quod exeat speciem, et precipue inprincipio nativitatis, quia tunc omnes fetus, etiam non monstruosi, multum distant a perfectione tamin membris quam in operationibus. [. . .] Et fiunt sepe monstra de quibus non curamus. Exemplum :aliqui homines nascuntur ceci et muti et nulla ratione utentes minus quam canis. Comedunt autem etcrescunt, sed nec loquuntur nec vident nec audiunt nec videntur aliqua ratione uti et cetera. Alii suntqui quamvis videant et audiant sunt tamen omni ratione carentes et tales ut michi apparet plus debentdici monstruosi quam figura debita carentes vel et cetera. Unde utrum in talibus Deus gloriosus infundatanimam rationalem quis novit ? Et tamen, postquam fetus mulieris habet figuram humanam, nullusdubitat si sit homo non obstante quacumque monstruositate in membris principalibus et potentiis animecognoscitivis. Ideo videtur quod semper esset dubitandum utrum puer vel fetus sit homo usquequovideatur si possit uti ratione ; quod si non, videtur michi quod magis deberet credi in casibus positisquod non sit homo, quam in principio nativitatis propter diversam figuram et cetera, quia in naturahumana est maior monstruositas defectus in membris sensuum et sedibus seu organis anime quamin aliis membris (d. cit., pp. 230-234). Voir Caroti S., Mirabilia e monstra nei quodlibeta di NicoleOresme , in History and Philosophy of the Life Sciences, 6, 1984, pp. 133-150.
51. Par exemple Thomas dAquin, Summa theologiae, 3a, q. 68, a. 12 : Utrum furiosi et amentesdebeant baptizari. [. . .] Ad primum ergo dicendum quod amentes qui nunquam habuerunt nec habentusum rationis, baptizantur ex intentione Ecclesiae, sicut ex ritu Ecclesiae credunt et poenitent, sicut utsupra de pueris dictum est. [. . .]. Ad secundum dicendum quod furiosi vel amentes carent usu rationisper accidens, scilicet propter aliquod impedimentum organi corporalis, non autem propter defectumanimae rationalis, sicut bruta animalia. Unde non est de eis similis ratio . En cas de folie passagre,lEglise prconise dattendre un moment de lucidit.
13 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
Le baptme et le mariage des jumeaux siamois52
Le fait que la thologie et le droit canon mdivaux sinterrogent de manire sys-tmatique sur le baptme des enfants, des fous furieux, des arrirs mentaux et dessomnambules confirme limportance primordiale accorde dans ce contexte lme et la volont, et non au corps53. La place des naissances monstrueuses y est en com-paraison bien plus modeste et les interrogations se limitent au Moyen Age un casparticulier : celui des jumeaux siamois. De plus, la question se concentre l encore surlme, car il ne sagit pas de savoir si les jumeaux ont une me et sil faut les bapti-ser cela va manifestement sans dire mais dtablir comment il convient de le faire,comme une personne ou deux54. Les rcits cits plus haut confirment le caractre peucontrovers du baptme des jumeaux siamois en tant que tel : le Bourgeois de Parisprsente ce baptme comme allant de soi, tandis que le fait que Villani nen parle pasnimplique nullement que le monstre florentin ne lait pas reu55. De lautre ct, cesrcits tmoignent de la difficult daccorder un nombre aux jumeaux siamois. Alorsque le Bourgeois de Paris utilise systmatiquement le pluriel pour dcrire les jumellessiamoises dAubervilliers, le chroniqueur florentin emploie quant lui le singulier (enparlant, par exemple, dun garon avec deux corps ), mme sil glisse, et cest ensoi significatif , vers le pluriel en voquant sa mort ( lun avant lautre ).Dans la littrature savante, le problme des monstres siamois jouit dune certaine
popularit la fin du xiiie et le dbut du xive sicle ; comme la question des pygmes,cest presque exclusivement dans le cadre des dbats quodlibtiques56. Son intgra-
52. Dans la perspective philosophique aristotlicienne, les jumeaux ordinaires (non-conjoints) re-lvent dj de la monstruosit, dans la mesure o ils vont contre le cours habituel de la nature, indicationque la cause finale na pas t atteinte. De mme, tout comme lenfant avec onze doigts, les jumeauxsont la consquence dun surplus de matire, cf. Thijssen J. M. M. H., Twins as Monsters. AlbertusMagnuss Theory of the Generation of Monsters and its Philosophical Context , in Bulletin of the Historyof Medicine, 61, 1987, pp. 237-246, surtout pp. 239-241. La littrature mdivale en langue vernaculairevhicule galement une image ngative et inquitante des jumeaux, souvent considrs comme preuvede ladultre de la mre, mme si la littrature prsente aussi parfois cette dernire ide comme unesuperstition, cf. Kooper E., Moeders en meerlingen in de middeleeuwse letterkunde , in Madoc, 11,1997, pp. 228-235 et Desclais Berkvam D., Enfance et maternit dans la littrature franaise des xiie et xiiie
sicles, Paris, 1981, pp. 21-22. Cependant, je me cantonne ici aux formes de monstruosit qui posent leproblme de laccs aux sacrements.
53. En mme temps, comme la montr Alain Boureau, les discussions sur les somnambules t-moignent dune redcouverte de lautonomie du corps : La redcouverte de lautonomie du corps :lmergence du somnambule (xiiie -xive sicle) , in Micrologus, 1, 1993, pp. 27-42 et Idem, Pierre deJean Olivi et le semi-dormeur. Une laboration mdivale de lactivit inconsciente , in Nouvelle Revuede Psychanalyse, 48, 1993, pp. 231-238.
54. Les jumeaux siamois posent galement des questions philosophiques et mtaphysiques qui d-passent le cadre de cet article. Le thologien Henri de Gand (cf. infra note 56) utilise la question dubaptme des monstres pour combattre la thorie de la forme substantielle unique (lide, dfendue entreautres par Thomas dAquin, que lhomme est structur par une seule forme, lme). Pour le dbat surlunicit et la pluralit des formes substantielles, voir Boureau A., Thologie, science et censure au xiiie sicle.Le cas de Jean Peckham, Paris, 1999, surtout pp. 39-136.
55. Pour dautres cas o les sources signalent que des monstres siamois reoivent le baptme, voirFriedman J. B., The Monstrous, op. cit., p. 181 et Daston L. et Park K., Wonders, op. cit., p. 52.
56. Jean Peckham, Quodlibeta, II, 24 (facult de thologie, Nol 1270) Qualiter debeat baptizari
14 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
tion dans les commentaires sur les Sentences et dans le droit canon est modeste etrelativement tardive57.Si la tte bien forme est selon les civilistes mdivaux une condition pour le bap-
tme de lenfant monstrueux, pour les jumeaux siamois la prsence de deux ttes estcertes juge ncessaire58, mais pas suffisante pour conclure la prsence de deux mes.A la suite dAristote, les thologiens mdivaux donnent la priorit au cur. Aristoteconsidre le cur comme lorgane principal, qui contrle non seulement les veines etles artres, mais aussi la sensation et le mouvement (alors que Galien, et avec lui lamajorit des mdecins mdivaux voient le cerveau comme lorgane de la pense etde la sensation)59. Si les jumeaux siamois ont deux ttes, deux cous et deux poitrines,on peut tre sr quils ont galement deux curs et on peut alors les baptiser sans r-serve comme deux personnes. Mais si les deux ttes senracinent dans un seul cou, lasituation est plus dlicate. Il faut viter de rebaptiser la mme personne et il est doncprfrable de baptiser dabord le premier, puis le second de manire conditionnelle60.Le baptme sous rserve simpose aussi lorsque lune des ttes nest pas parfaitementforme61.Les scolastiques combinent souvent cette approche anatomique avec un argument
plus fonctionnel, en renvoyant aux comportements, motions et volonts opposs desdeux jumeaux. Parfois lun rit, alors que lautre pleure ; lun dort alors que lautreveille ; lun veut tre chaste, alors que lautre aspire des rapports sexuels ; lun peut
monstrum nascens cum duobus capitibus (d. Etzkorn F. et Delorme G., Quodlibeta quatuor, Grottafer-rata, 1989, pp. 120-121 (ce quodlibet a survcu dans de nombreux manuscrits, autour de 45, semble-t-il cause de son intgration, erronne, dans un exemplar des quodlibets de Thomas dAquin, cf. Dondaine A., Le Quodlibet de Jean Pecham De Natali dans la Tradition Manuscrite Thomiste , in Studies HonoringIgnatius Charles Brady. Friar Minor, The Franciscan Institute, St. Bonaventure University, 1976, pp. 199-218, ici p. 213) ; Henri de Gand, Quodlibeta, VI, 14 et VI, 15 (facult de thologie, 1281-1282) Utrum,si duo capita in monstro apparerent, in baptizando debant ei imponi duo nomina an unum tantum et Utrum, si duo capita in monstro apparerent, et si dicat sacerdos : ego te baptizo, ambo vel altereorum sit baptizatus (d. Wilson G., Louvain, 1987, pp. 156-169) ; Rmi de Florence, Quodlibeta, II, 9(Prouse, couvent des dominicains, 1304-1307) Utrum homo monstruosus habens duo capita sit unushomo vel duo ? (d. Emilio P., I Quodlibeti di Remigio dei Girolami , in Memorie domenicane, 14,1983, pp. 66-149, ici pp. 125-128) ; Jean de Naples (facult de thologie, actif de 1300-1325), Quodlibeta, I,11 Utrum in monstruo habente duo capita sint due anime (Arras, Bibliothque municipale, 873) ; GuiTerreni, Quodlibeta, IV, 13 (facult de thologie, 1316) Utrum posito tali monstro quod usque ad zonamsunt duo capita et cetera membra duplicata, post zonam autem sunt tantum unica, scilicet quod nonnisiunus venter, due coxe, due tibie, debeat baptizari in numero singulari ? (Citt del Vaticano, BAV, ms.Vat. Borgh. 39, fo191vo-192ro). Afin dallger les notes je citerai dans ce qui suit uniquement les noms deces auteurs.
57. Par exemple : Jean Baconthorpe, In IV Sent., dist. 5, q. 2, art. 2 (d. Super quatuor Sententiarumlibros, Venise, 1526, fo 105ro) ; Pierre de La Palud, In IV Sent., dist. 6, q. 4 (d. Scriptum in quartum librumSententiarum, s. l., 1514, fo 27v) ; Guy de Baysio, Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria, secundapars, de consecratione, dist. 4 (d. Venise 1601, fo 402vo). Baconthorpe et Guy de Baysio citent Thomas,mais on ne trouve rien ce sujet chez lAquinate.
58. Ainsi dans le cas dun jumeau parasitaire sans tte qui sort du corps de son jumeau, il sagit duneseule personne. Pierre de La Palud dit avoir vu et touch un tel monstre (d. cit., fo27vo).
59. Pour ce dbat voir Siraisi, Taddeo Alderotti, op. cit., pp. 186-195.60. Jean Peckham, Henri de Gand.61. Pierre de La Palud, dcrivant la position commune des thologiens.
15 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
tre affect dune maladie mentale et pas lautre. Lindpendance des jumeaux estencore confirme par le fait que le dcs de lun ne conduit pas immdiatement la mort de lautre, mais seulement aprs quelques jours, cause de la puanteur ducadavre62.Au dbut du xive sicle, le dominicain Pierre de La Palud cite largument anato-
mique comme lopinion commune, mais lui prfre une autre approche. Pour conclure la prsence de deux personnes, il suffit de trouver une zone sensible sur le corps dontla stimulation ou la blessure est ressentie par lune des ttes seulement. Si cela est lecas, les corps ne forment pas un ensemble continu, mais sont contigus comme le ftusdans le ventre de la mre63. Approche subtile, qui permet en mme temps de rsoudrele problme de la coexistence de deux mes dans ce qui semble une seule matire64,mais sans grande utilit pratique. Les jumeaux siamois meurent souvent peu aprs leurvenue au monde, le prtre ou la sage femme doivent dcider dans lurgence65. Quandla question du baptme des jumeaux siamois trouve son chemin dans des manuelspratiques, lanatomie extrieure des enfants est le seul critre retenu et on a mmetendance faire abstraction du nombre de curs pour se concentrer sur le nombre dettes66. Le baptme conditionnel permet de remdier aux erreurs dapprciation.Une question bien plus isole sans doute bien rares sont les jumeaux siamois qui
atteignent lge adulte concerne leur accs au mariage, et, le cas chant, le nombrepossible de partenaires67. Dans un quodlibet consacr ce problme, le sculier Eus-tache de Grandcour signale que plusieurs arguments semblent sopposer au mariage.Les jumeaux siamois qui partagent un corps infrieur ont deux volonts, mais seule-ment un instrumentum, en loccurrence un vagin. Lhomme qui accomplit son devoir
62. Henri de Gand, Gui Terreni, Rmi de Florence.63. Pierre de La Palud, Scriptum in librum quartum Sententiarum, dist. 6, q. 4 : Videretur tamen aliter
distinguendum, quia si in illo toto corpore monstruoso non est aliqua pars quae lesa vel puncta nontranseat dolor ad aliud caput, videtur unum continuum, et per consequens non nisi unus homo, cum ineadem parte materie non sint plures anime eiusdem rationis, nec potest ibi sentire ubi anima non est. Siautem sit aliqua pars qua puncta vel lesa unus sentiat, alius non sentiat videtur contigua, non continua,sicut fetus matri, et sic duo homines, quamvis aliquis diceret quod etiam in uno continuo sunt partesinsensibiles sicut capilli et dentes et ungues. Sed tunc non esset ratio, quare magis uni esset illa parsinsensibilis quam alii (d. cit., fo27vo).
64. Rmi de Florence compare quant lui les corps des jumeaux siamois un arbre greff.65. Sur le rle des sages-femmes dans londoiement et la lgislation ecclsiastique les concernant (sans
rfrence particulire aux naissances monstrueuses), cf. Taglia K., Delivering a Christian Identity :Midwives in Northern French Synodal Legislation, c. 1200-1500 , in Biller P. et Ziegler J. (d.), Religionand Medicine in the Middle Ages, Woodbridge, 2001, pp. 77-90 ; Lefebvre-Teillard A. , Baptme et nomde baptme. Notes sur londoiement , in Mlanges en hommage Jean Imbert. Histoire du droit social, Paris,1989, pp. 365-370.
66. Par exemple le manuel trs influent de Guido de Mont Rocher (xive sicle), Manipulus curatorum,Rouen, 1494, fo 14ro. Pour dautres exemples lEpoque moderne, voir Friedman J. B., The Monstrous, op.cit., pp. 181-182.
67. Encore une autre question, dans une collection anonyme (Florence, Biblioteca laurenziana, ms. plut.17 sin. 7, fo 192vo), demande si lon peut excuter des jumeaux siamois si lun des deux a commis unhomicide. La rponse, ngative, consiste dire que limpunit du coupable est prfrable la punition in-juste dun innocent, en renvoyant la politique ecclsiastique en matire de spulture. Sil est impossiblede sparer les ossements des excommunis de ceux des fidles, on laisse tous les ossements en place. Ontrouve la mme ide propos de linterdiction dexcuter une femme enceinte.
16 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
conjugal avec lune des jumelles commet automatiquement la fois ladultre et lin-ceste, car il saccouple aussi avec la sur de sa femme. Ces objections ne sont pas vrai-ment rfutes, mais les arguments en faveur du mariage sont jugs plus concluants.Leur refuser ce sacrement reviendrait les pousser la fornication, or prvenir lafornication a toujours t largument par excellence de lEglise en faveur du mariage.Dautre part, les jumelles runissent toutes les conditions du mariage. Capables duconsentement, car possdant chacune une volont, comme le montre leur comporte-ment oppos, elles peuvent galement consommer leur mariage, car elles ont un vagin.La nature ne fait rien en vain, il faut utiliser ce vagin pour procrer et sans doute ceseul vagin dbouche sur deux utrus68. Elles peuvent donc se marier avec deux par-tenaires distincts, condition de bien expliquer ces derniers quils ne peuvent pasconsommer leur mariage simultanment69.
Hermaphrodisme et sacrements
Le problme du mariage se pose plus frquemment pour un autre type de monstres,les hermaphrodites70. Lintrt des thologiens et canonistes pour ce thme est rela-tivement prcoce et sinscrit en partie dans le dveloppement, dans certains milieuxecclsiastiques, dun discours moral visant lhomosexualit masculine. Plutt quune
68. Eustache de Grandcour nvoque pas la question de savoir qui sera la mre de lenfant conu dansces conditions, mais lide dun utrus double permet de remdier en partie ce problme. Bien desaspects restent inexplors dans cette question assez superficielle. Que faire, par exemple, si lune desjumelles refuse laccs au vagin commun au mari de sa sur ?
69. Eustache de Grandcour, Quodlibeta, I, 2 (1290-1303, facult de thologie) : Quoddam monstrumfuit habens a dyafragmata superius duo capita quotuor brachia et quatuor mamillas et duo corda ; infe-rius unum instrumentum generationis et duos pedes. Queritur utrum tale monstrum possit contraherematrimonium. Et videtur quod non, quia si posset contrahere matrimonium aut hoc esset cum uno autcum pluribus. Sed cum uno non possit. Probatur, quia tale matrimonium habet (mot illisible) ex consensuunius cum uno, sed ibi sunt duo sensus et due voluntates cum sint duo corda, ideo et cetera. Nec potestcontrahere cum duobus, quia cum unus solveret debitum sue, contractaret cum altera, cum non sit nisiunum instrumentum et sic videtur quod in reddendo debitum sue conmitere adulterium cognoscendonon suam et incestum cognoscendo sororem uxoris sue, ideo etcetera. Contra, natura nichil facit frustra,sed natura dedit instrumentum per quod potest in finem matrimonii, scilicet in generationem prolis, ideoet cetera. Item si non, daretur eis occasio peccandi et fornicandi, quod non est faciendum, ideo et cetera.Dicendum quod ego intellexi a patre meo quod ipse vidit tale monstrum habens duo capita et quatuormamillas et quod una illarum mulierum mortua fuit ante aliam per tres dies et altera fuit mortua per ni-mio fetore, quem non potuit sustinere. Nunc dico, quod potest contrahere matrimonium et cum diversisquia habent omnia per que matrimonium potest esse perfectam, quoniam habent consensum per quemmatrimonium efficitur (ms. pertricitur), habent etiam instrumentum per quid potest consumari, quo-niam matrimonium consummatur per carnis copulationem et ideo cum habeant omnia que requirunturad matrimonium poterunt contrahere et cum diversis cum habeant diversas voluntates etiam diversosconsensus, nam visum est quod huius mulierum unam cantabat et altera flebat, una volebat virum, al-tera volebat continere et possibile erat quod habuerint diversas matrices. Et bene caveant sibi qui cumtalibus contrahunt, quia bene possunt scire quod simul cohabitare non possunt, ideo etcetera (B.n.F.,ms. lat. 15850, fo29rovo).
70. Sur lhermaphrodite dans les discours mdicaux, thologiques et juridiques mdivaux, voir aussiCadden J., Meanings of Sex Difference in the Middle Ages. Medicine, Science and Culture, Cambridge, 1993,pp. 198-202 et pp. 209-214 ; Nederman C. J. et True J., The Third Sex. The Idea of the Hermaphroditein Twelfth century Europe , in Journal of the History of Sexuality, 6, 1996, pp. 497-517.
17 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
offensive contre les pratiques sexuelles des lacs, cette homophobie se replace dailleursdans une lutte interne lEglise au sujet du clibat des clercs71. Le droit civil constitueune rfrence importante pour ces dbats, car lhermaphrodisme avait dj proccuples juristes romains72, et lanalogie entre hermaphrodisme et homosexualit remontegalement lAntiquit. Les encyclopdies et bestiaires mdivaux rapportent des l-gendes animales antiques qui prsentent certains animaux, comme le livre, le lapin,lhyne et la belette, la fois comme des animaux hermaphrodites (ou changeant r-gulirement de sexe) et des homosexuels73.Dans son trait de thologie morale, Pierre le Chantre (fin xiie sicle), lun des re-
prsentants les plus virulents de la tendance antihomosexuelle, consacre un long pa-ragraphe la sodomie. Il sy arrte en dtail sur le problme de lidentit sexuelle deshermaphrodites, capables aussi bien du rle sexuel actif que du rle passif. LEgliseautorise le mariage de lhermaphrodite, mais seulement sil adopte le rle fminin oucelui masculin. Il doit choisir le rle sexuel qui lui procure les motions les plus viveset qui lui permettra daccomplir au mieux ses devoirs matrimoniaux. Il ne pourra pasrevenir sur ce choix et se remarier selon lautre sexe, si son premier partenaire venait dcder. Sil na pas de prfrence sexuelle, il doit rester chaste toute sa vie pourviter toute ressemblance avec linversion des sodomites, que Dieu a en horreur 74.Si lhermaphrodisme napparat pas ici comme une faute en soi, cette constitution
physique a nanmoins des implications morales inquitantes, parce quelle permetlalternance des rles sexuels. Tant lhomosexuel que lhermaphrodite compromettentlordre voulu par Dieu o les rles sexuels sont clairement distingus entre les hommeset les femmes. Si lambigut sexuelle prend parfois une valeur positive sur le plansymbolique, par exemple dans la reprsentation de Jsus comme mre dans les ou-vrages de spiritualit ou dans limage de lhermaphrodite alchimique, elle rencontrepeu de sympathie chez les thologiens et les juristes75. La politique de lEglise en ma-tire matrimoniale consiste ramener lhermaphrodite une classification binaire ; ellereprend sur ce point un principe du droit civil76. En mme temps, elle voit dans lher-
71. Linterprtation de la sodomie comme se rapportant exclusivement lhomosexualit et la qualifi-cation de celle-ci comme par excellence le vice contre nature datent aussi de cette poque. Voir BoswellJ., Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay People in Western Europe from the Beginnings of theChristian Era to the Fourteenth Century, Chicago / Londres, 1980, pp. 277-278 ; 312-332 (tr. fr. Christianisme,tolrance sociale et homosexualit, Paris, 1985, pp. 349-350 ; 392-417). Cf. aussi Moore R. I., The Formationof a Persecuting Society. Power and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford, 1987, pp. 91-94 (tr. fr. Laperscution. Sa formation en Europe xe xiiie sicle, Paris, 1991, pp. 109-113).
72. Pour quelques exemples, voir infra, note 76 et 83. Je me concentre toutefois ici sur le problme dessacrements.
73. Boswell J., Christianity, op. cit., pp. 137-143 ; 305-308. (tr. fr., pp. 181-188 ; pp. 384-386).74. Pierre le Chantre, Verbum abbreviatum, 138 (PL 205, col. 333-35, traduit en annexe dans Boswell J.,
Christianisme, op. cit., note 29). Pierre le Chantre traite aussi le problme du mariage des hermaphroditesdans sa Summa de sacramentis et animae consiliis, III, 2a, cap. 17, par. 254 (d. Dugauquier J.-A., Analectamediaevalia namurcensia, xvi, p. 259). Voir aussi Robert de Courson, Summa, De hermafroditis (B.n.F.,ms. lat. 3258, fo 200vo).
75. Cf. Cadden J., Meanings, op. cit., pp. 209, 214.76. Digeste, 1.5.10 : Ulpianus [. . .]. Quaeritur hermaphroditum cui comparamus et magis puto eius
sexus aestimandum, qui in eo praevalet . Voir aussi Digeste, 28.2.6.2 et 22.5.15.1.
18 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
maphrodite parfaitement symtrique une personne empche77. Certains vont plusloin encore en affirmant que celui-ci nexiste pas ; Robert de Courson, disciple dePierre le Chantre, limine ainsi le problme de lambigut sexuelle en renvoyant lopinion des mdecins78. Mme si les textes mdicaux prsentent parfois les herma-phrodites comme un troisime sexe par exemple en liant la dtermination sexuelle la place occupe par les semences dans lutrus (droite/gauche) et en assignant lhermaphrodite une place au milieu , nombre de mdecins et philosophes m-divaux nient, dans le sillage dAristote, lexistence dun intermdiaire parfait entrelhomme et la femme. Ils admettent cependant parfois que lexamen mdical et lob-servation anatomique ne permettent souvent gure de lever lambigut79. Pierre leChantre utilise comme on la vu des critres non pas anatomiques mais fonctionnels.Vers la mme poque, Huguccio sappuie encore plus clairement sur le principe dela possession dtat . Lexamen des parties gnitales peut tre utile, mais le cano-niste italien met laccent sur lapparence physique extrieure (barbe ou pas de barbe),facilement reprable sans examen approfondi. Et contrairement Pierre le Chantre, ilinsiste, non pas sur le rle de lhermaphrodite dans lacte sexuel, mais sur son com-portement public comme rvlateur du sexe dominant. Si lhermaphrodite prfre lesactivits masculines et la compagnie des hommes, le droit le considrera comme unhomme80.Les savants mdivaux sinterrogent aussi sur le statut de lhermaphrodite face
dautres sacrements. Comme pour le mariage, la supposition est le plus souvent quunsexe domine forcment, mme si celui-ci peut tre difficile tablir. Pour le baptmelincertitude nest pas trs gnante, car la formule baptismale ne tient pas comptedu sexe : en cas de doute, on impose un nom masculin. Si lon dcouvre plus tardque llment fminin domine, Robert deviendra Roberta, et on utilisera ce nom aumoment de la confirmation. Ce mme principe vaut pour les baptmes durgenceau moment de laccouchement, lorsque lon ne peut pas encore vrifier le sexe delenfant81.La question de lordination est bien plus pineuse, car lEglise refuse laccs des
77. Dans dautres contextes, le droit canonique accorde au vrai hermaphrodite le statut juridique dela femme, cf. infra.
78. Robert de Courson, Summa, De hermafroditis : [ ] ut tradunt physici, non potest contingerequod duo sexus in hermafrodito equaliter vigeant, immo oportet quod semper unus obtineat privile-gium (B.n.F., ms. lat. 3258, fo 200va).
79. Voir par exemple Albert le Grand, Quaestiones super de animalibus, xviii, q. 2 (d. Opera omnia,Mnster, p. 297) et Henri dAllemagne et Henri de Bruxelles, Quodlibeta, Utrum homo habens duplicemsexum possit generare et etiam concipere ? [ ] Dicendum quod hominem habere duplicem sexum potestesse dupliciter, aut quia perfectius habet sexum masculinum et talis vir mofroditus, aut perfectiushabeat sexum femineum et talis dicitur mulier hermofrodrita (B.n.F., ms. lat. 16089, fo58vab). Voir aussiCadden J., Meanings, op. cit., pp. 212-213. Nederman et True ( The Third Sex , op. cit.) insistent sur lareprsentation de lhermaphrodite comme troisime sexe, tout en admettant que cette reprsentation estmise en cause par la rception dAristote.
80. Huguccio, C. IV, q. 2 et 3, c. 3, par. 22, ad v. sexus incalescentis (B.n.F., ms. lat. 15396, fo 136va).81. Pierre le Chantre, Summa de sacramentis et anima consiliis, III, 2a, cap. xvii (d. Dugauquier J.-A.,
Analecta mediaevalia namurcensia, 16, p. 259). Londoiement est possible ds que la tte, voire une autrepartie du corps est sortie.
19 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
femmes la prtrise82. Il ny a pas de rponse tout fait unifie la question. Parfoisles juristes disent que lhermaphrodite peut tre ordonn si le sexe masculin domine.Cette solution est justifie par un principe du droit civil qui interdit aux femmes et auxhermaphrodites fminins, mais non aux hermaphrodites masculins, de tmoigner lorsde ltablissement dun testament. Lhermaphrodite pur est juridiquement assimil la femme et ne sera donc pas non plus ordonn, car on ne peut pas dire que laspectmasculin domine en lui83.Dans dautres contextes, le droit canon refuse mme lordination des hermaphro-
dites dominance mle ; non pas, toutefois, cause de leur identit sexuelle ambigu,mais cause de leur monstruosit84. Le dbat sur lhermaphrodisme rejoint ici celui,plus large, de lirrgularit de la personne, cest--dire des empchements la pr-trise. Selon le droit canon, certains dfauts physiques constituent en effet un obstacle lordination, tout comme la naissance illgitime, la servitude ou lillettrisme. Cestares entravent la dignit de la prtrise, le prtre reprsentant le Christ, et troublentlordre public. La liste des empchements est ancienne et elle donne lieu de nom-breuses discussions chez les juristes scolastiques. En pratique, pour certaines de cestares, notamment la btardise, les drogations sont frquentes. En ce qui concerneles dfauts corporels, lopinion commune distingue entre les tares visibles et invi-sibles. Ces dernires, y compris la mutilation sexuelle (castration), ne constituent pasdobstacle lordination, moins quelles soient volontaires ou quils empchent lac-complissement des gestes ncessaires la clbration de loffice. Les dfauts visiblesimportants empchent toujours en revanche lordination, les dfauts des mains (en
82. Gillmann F., Weibliche Kleriker nach dem Urteil der Frhscholastik , in Archiv fr katholischesKirchenrecht, 93, 1913, pp. 239-253 (sur lhermaphrodite, p. 246).
83. Digeste, 22.5.15 : Paulus. [. . .] Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexusincalescentis ostendit . Repris par Gratien, Decretum, C. IV, q. 2 et 3, c. 3, par. 22 (d. Friedberg E. , Corpusiuris canonici, Leipzig, 1879, I, col. 540). Huguccio, C. IV, q. 2 et 3, c. 3, par. 22, ad v. sexus incalescentis : ostendit quia si magis incalescat in virum quam in femina, id est in opera virilia quam feminea, quia sisexus virilis in eo prevalet adhibetur etiam in testimonio si femineus non admittitur in testamento, quiafemina in testamento testis esse non poset ( !). [. . .] si quidem habet barbam et semper vult exercere viriliaet non feminea et semper vult conversari cum viris et non cum feminis, signum est quod virilis sexusin eo prevalet et tunc potest esse testis ubi mulier non admittitur, scilicet in testamento et ultimis (ms.multimis) volumptatibus, tunc etiam ordinari potest. Si vero caret barba et semper vult esse cum feminiset exercere feminea opera, iudicium est quod feminini ( !) sexus in eo prevalet et tunc non admittitur adtestimonium ubi femina non admittatur, scilicet in testamento, sed nec tunc ordinari potest, quia feminaordinem non recipit. Preterea ad talem discretionem multum valet inspectio genitalium, quid si illi duosexus equales per omnia inveniuntur in eo credo quod debeat iudicari de eo tamquam femineus sexusin eo prevaleret quia verum est virilem sexum in eo non prevalere (B.n.F., ms. lat. 15396, fo 136va).Cependant, le tmoignage des femmes est recevable dans les tribunaux ecclsiastiques.
84. Huguccio, C. XXVII, q. 1, c. 23 ad v. ordinari : Item ermafroditus, si ergo magis calet in feminaquam in virum non recipit ordinem. Si e contrario recipere potest sed non debet ordinari propter de-formitatem et monstruositatem (B.n.F., ms. lat. 15397, fo 61rb). Laurent dEspagne, C. XXVII, q. 1, c.23, ad v. diaconissa : [. . .] hermafroditum autem dico non promovendum propter populi scandalumlicet in eo plus incalescat sexus virilis et ad alia virilia admittatur ut IIII q. III (Citt del Vaticano, BAV,ms. Vat. Reg. lat. 977, fo 220vo marge). Repris dans Guy de Baysio, Rosarium, C. XXVII, q. 1 (d. cit., fo
335vo). Egalement repris dans les pnitentiels, voir par exemple Robert de Flamborough, Liber poeniten-tialis (1208-1213), III, 2, 76 De sexu (d. Firth J. J. F., Robert of Flamborough, canon-penitentiary of Saint-Victorat Paris. Liber poenitentialis. A Critical Edition with Introduction and Notes, Toronto, 1971, p. 101).
20 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
particulier ceux des trois premiers doigts) et du visage (surtout le nez) tant les plusgraves85. Lapparence du prtre, surtout pendant la clbration de leucharistie, doittre en accord avec la beaut et la dignit du rituel. Lhermaphrodisme est-il considrcomme une tare visible ou invisible ? Quoi quil en soit, lexclusion par le droit canonde lhermaphrodite pour cause dirrgularit ne prend pas en compte cette distinction.
*
Au Moyen Age, la question de lhumanit des monstres et de leur accs aux sacre-ments a donn lieu des discussions dtailles et sophistiques. Toutefois, il nexistepas de lieu unique qui synthtiserait tous les aspects de la problmatique ; les discus-sions restent relativement parses et clates, avec des chronologies, des contextes etdes enjeux varis. La lettre de Ratramne sur les cynocphales, rdige au ixe sicle,dans un contexte missionnaire, et la longue discussion sur les races lgendaires dansla partie anthropologique de la Somme dite dAlexandre de Hals, au milieu du xiiie
sicle, constituent finalement des hapax. Les discussions sur lhermaphrodite sontcertes moins isoles, mais se droulent pour lessentiel entre la fin du xiie et le toutdbut du xiiie sicle. Li, entre autres, aux dbats contemporains sur lhomosexualitet sur lirrgularit de la personne, lhermaphrodite intresse surtout les canonisteset les thologiens. Les discussions sur les pygmes et sur les jumeaux siamois, quiprennent essentiellement la forme de questions quodlibtiques, se concentrent en re-vanche dans la seconde moiti, voire dans le dernier tiers du xiiie sicle, priode quiconstitue, surtout chez les thologiens, un moment fort pour la rflexion anthropo-logique86. Le monstre sert doutil conceptuel, au mme titre que dautres cas limitescomme lembryon ou le cadavre, pour penser la personne humaine et les rapportscomplexes entre me et corps, forme et matire. Les enjeux des dbats sur lhumanitdes monstres et leur accs aux sacrements dpassent donc le problme pratique et im-mdiat de la politique adopter face aux monstres rels et concrets. Dailleurs, mmesi certaines discussions refltent des observations des monstres directes ou indirectes,ces derniers restent souvent, au Moyen Age, des tres de papier.Quelle est finalement la position des savants mdivaux concernant lhumanit des
monstres ? En ce qui concerne les races monstrueuses, la rponse nest ni unifie ni g-nrale, mais on peut dire qu lpoque scolastique, lide dun ncessaire accord entrecorps et me rend la position dAugustin, inclusive et universaliste, plus difficile dfendre. Pour les pygmes, la prise en compte dautres critres que lapparence phy-sique (comportement social et religieux, capacits linguistiques et mentales) contribue les exclure de lespce humaine. Cependant, sur la base de critres et de donnessimilaires, Ratramne avait conclu lhumanit des cynocphales danois.En revanche, pour les naissances prodigieuses, lindiffrence augustinienne concer-
nant la forme physique des monstres rsiste mieux. En droit canon et en thologie,
85. Voir Firth, Robert of Flamborough, op. cit., pp. 166-168, surtout p. 167 note 91. Voir aussi Hostiensis,Summa aurea, I, 40, De corpore vitiatis ordinandis vel non (d. Lyon, 1537, f 40r).
86. Voir par exemple ltude dAlain Boureau sur les discussions autour le cadavre cette poque :Thologie, op. cit.
21 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
lhumanit des monstres ns de parents humains semble en tout cas plus ou moinsaller de soi. La question de leur baptme ne se pose que pour les jumeaux siamoiset ne concerne que le nombre de personnes baptiser. Cest paradoxalement en droitcivil, discipline a priori peu concerne par le problme des sacrements, que lon trouve, partir du xive sicle, lide que les enfants dpourvus dapparence humaine doiventtre exclus du baptme. Dans la ligne du droit romain classique, les civilistes consi-drent la forme du corps, et non lme, comme le critre dcisif de lhumanit. Ceprincipe saccompagne de lide que certaines naissances monstrueuses sont dues une violation des normes sexuelles, plus prcisment des rapports bestiaux, croyancecommune que les mdecins et philosophes mdivaux ont cependant le plus souventcombattue. A lEpoque moderne, le droit canon finira toutefois par assimiler la posi-tion civiliste.Lhermaphrodite, comme lhomosexuel avec lequel il est souvent associ, met en
cause non pas les limites de la personne son humanit va de soi , mais la divisiondes sexes. Les savants mdivaux admettent parfois lexistence dun intermdiaire par-fait entre lhomme et la femme, mais ils soutiennent aussi souvent que lun des deuxsexes domine forcment, surtout partir du xiiie sicle. Lanatomie joue un rle re-lativement limit comme critre de classification. Le droit mdival peroit lidentitsexuelle comme une ralit avant tout sociale87. Cest moins le mdecin (et la mde-cine mdivale ne sintresse que peu lhermaphrodisme88) que lhermaphrodite quidcide, par son comportement, de son identit sexuelle, du moins dans le contexte dumariage. Approche qui dun ct diffre considrablement de lattitude de la mde-cine moderne face aux hermaphrodites, et qui de lautre, nest pas sans parallle avecles notions actuelles du genre. Lattitude des canonistes est dautant plus remarquableque dans un contexte voisin, celui des empchements du mariage, lexamen des par-ties gnitales est prconis pour dterminer si le mariage a t consomm, conditionde sa validit89.Afin dapprcier limportance relative et lenjeu des dbats mdivaux sur lherma-
phrodite, une comparaison avec le droit musulman se rvle instructive. Comme lemontre ltude de Mohammed Hocine Benkheira90, les domaines et les cas envisa-gs (rgles pour le plerinage, la prire, la puret rituelle, la toilette funraire, le portde bijoux et de vtements en soie, les rgles de succession, la calomnie, etc.) y sont
87. Dans un tout autre domaine, la littrature mdivale en langue vernaculaire, on retrouve, avecle motif du travestissement, lide que le comportement cre lidentit sexuelle. Yde, par exemple, sedguise en homme pour chapper aux avances dun pre incestueux, se marie avec une femme et setransforme miraculeusement en homme. Voir Michle Perret, Travesties et transsexuelles : Yde, Silence,Grisandole, Blanchandine , in Romance Notes, 25, 3, 1985, pp. 328-340. Je remercie Charles de Miramonde mavoir signal ce parallle.
88. Les discussions concernent essentiellement les causes de lhermaphrodisme. Les mdecins disentparfois que la chirurgie permet de corriger les anomalies les plus apparentes, cf. Jacquart D. et ThomassetC., Sexualit et savoir mdical au Moyen Age, Paris, 1985, pp. 195-196. Je nai pas pu consulter GadebuschBondio M., Medizinische sthetik. Kosmetik und plastische Chirurgie zwischen Antike und frher Neuzeit, Mu-nich, 2005.
89. Voir les dbats autour X, 4, 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi (d. Friedberg E., Corpusiuris canonici, Leipzig, 1879, II, c. 704-708).
90. Homme ou femme ? Les juristes musulmans face lhermaphrodisme , dans le prsent volume.
22 ttssrsrtsr
-
M. van der Lugt
autrement plus varis et nombreux que dans le droit occidental. Cette plus granderichesse des discussions est vraisemblablement le signe de la place plus fondamentaleet primordiale de la diffrence des sexes dans les socits du Moyen-Orient. En com-paraison, le droit canon tend plutt galiser les hommes et les femmes, sauf danscertains cas trs prcis comme lordination des prtres, et sur le statut de la femme, ilsoppose galement au droit civil. Si le droit romain refuse, on la vu, le tmoignagedes femmes pour ltablissement dun testament, leur tmoignage est recevable devantles tribunaux ecclsiastiques.Tout cela ne veut pas dire bien sr que la socit occidentale soit indiffrente la
diffrence des sexes, ni que les savants mdivaux voient lambigut sexuelle dunbon il. Au contraire, lhermaphrodite doit adopter un rle et sy tenir ; cest la pos-sibilit de lalternance des rles sexuels qui inquite le plus. Confront aux questionsconcernant lhermaphrodite, et notamment celle de savoir si ce dernier peut, la mortde son conjoint, se remarier avec une personne du sexe oppos du premier partenaire,Huguccio sexclame qu au sujet des monstres on peut poser des questions mons-trueuses 91.
91. Glossa ordinaria, C. IV, q. 2 et 3, canon 3, par. 22 : Quaesitum fuit utrum hermaphroditus, idestqui habet sexum maris et feminae, possit esse testis in testamento ? [...] Sed quid si in omnibus estparilitas ? Item numquid talis potest ordinari ? Item an contrahet cum viro, an cum muliere, et si priuscum viro contraxit, an possit eo mortuo cum muliere contrahere ? Io. Sed certe inomnibus his respici debet sexus qui magis incalescit. De monstro possunt fieri monstruosae quaestiones.Hug (d. Lyon, 1571, c. 713).
23 ttssrsrtsr
Peuples sur les marges et les frontires de l'humanitLe baptme et le mariage des jumeaux siamoisHermaphrodisme et sacrements