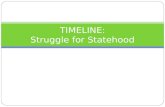Neil Brenner, New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University...
Click here to load reader
-
Upload
jonathan-rutherford -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
Transcript of Neil Brenner, New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford University...

Comptes rendus 255
en partie délaissé les analyses macro, même s’ils n’ont pas pour autant abandonné l’étude desinégalités scolaires, comme en témoigne le dernier ouvrage de Marie Duru-Bellat, n’est passimplement la cause d’une demande sociale. Cette inflexion de la sociologie de l’école est ainsià mettre en lien avec l’importation de nouveaux concepts nord-américains, comme le souligned’ailleurs Franck Poupeau, mais aussi plus largement avec la mise en avant de perspectives que lasociologie critique avait largement laissé dans l’ombre, telle que la notion d’effet établissement.La sociologie scolaire contemporaine constituerait même à certains égards, et ce contrairementaux thèses exposées par l’auteur, le prolongement à l’échelle du local des analyses développéesdans La Reproduction. Enfin, troisième regret, on ne peut manquer de relever la lecture tropmanichéenne de l’auteur dans l’opposition qu’il dresse entre une « sociologie d’expertise » et une« sociologie scientifique ». Il aurait été ainsi plus juste et plus crédible de souligner les usagessociaux qui ont pu être faits de modèles, apparemment plus « scientifiques », comme celui de lareproduction. Vouloir asséner une lecon de sociologie en échappant soi-même à toute réflexivitérend fragile la thèse défendue par l’auteur.
Éric FargesLaboratoire Triangle, institut d’études politiques de Lyon,
14, avenue Berthelot, 69365 Lyon cedex 07, FranceAdresse e-mail : [email protected]
doi: 10.1016/j.soctra.2008.03.006
Neil Brenner, New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood, OxfordUniversity Press, Oxford, 2004 (351 p.)
Ces dix dernières années, Neil Brenner a notablement contribué à éclairer les formes etles effets de la réorganisation territoriale qui a suivi la crise politico-économique des années1970. Son ouvrage New State Spaces offre une synthèse de ce travail, le précise et en étend laportée.
Résumons cette thèse, bien développée dans les trois premiers chapitres. Pour Neil Brenner,les politiques urbaines sont au principe d’une transformation institutionnelle et géographiquede l’État. Des programmes visant le développement économique de régions urbaines spé-cifiques (les « nouveaux espaces de l’État ») ont été mis en place sur les décombres depolitiques centrales imprégnées d’une philosophie en faveur de l’égalité socioterritoriale. Nombred’institutions étatiques ont été disséminées sur le territoire et elles jouent désormais unrôle important dans la gouvernance urbaine. L’auteur soutient cependant que, si elle a peséen faveur d’une nouvelle configuration des régulations politique et économique plus favo-rables aux espaces infra-nationaux, la mondialisation n’a pas annihilé la portée du niveaunational.
L’auteur s’emploie à démontrer cette thèse empiriquement en se focalisant sur un objet derecherche précis : les nouvelles approches de la gouvernance des grandes régions métropolitainesde l’Europe de l’Ouest depuis les années 1970. Dans le chapitre 4, il décrit les projets fordiste-keynésiens de l’État. Longtemps prééminents, ces derniers se caractérisaient par la promotion deterritoires nationaux homogènes et par une politique de redistribution menée sous la houlette del’État-providence. Dans les chapitres 5 et 6, il décrit les restructurations politico-économiques quifont suite à cet ancien modèle. Au nom du développement économique et de la concurrence, ces

256 Comptes rendus
nouvelles formes d’action ont concentré les investissements sur des régions urbaines clés et en ontdélaissé d’autres, produisant ainsi de l’inégalité territoriale. Le livre de Neil Brenner n’entend pasrendre raison de toutes les formes de développement inégal, de leur caractère socialement régressifou encore de l’instabilité politique qu’elles peuvent susciter. Neil Brenner porte intérêt avant toutaux implications d’une telle politique sur la réorganisation de l’État. Autrement dit, les processus(« réétalonnage », reterritorialisation) l’intéressent davantage que les conséquences sociospatialesdes politiques qu’il analyse. On comprend dans ces conditions la référence privilégiée aux théoriesde l’État de Henri Lefebvre et Bob Jessop.
En dépit de la grande cohérence du propos et de l’art de la synthèse (nombreux tableaux etschémas) dont fait preuve l’auteur, un déséquilibre saute aux yeux du lecteur. Le cadre théoriqueforgé dans la première moitié de New State Spaces apparaît plus convaincant que l’analyse desobjets empiriques que Neil Brenner utilise pour démontrer sa thèse (chapitres 5 et 6). Troisobservations critiques peuvent être développées à ce sujet.
En premier lieu, Neil Brenner évoque trois formes de restructuration « qui illuminent clai-rement les liens entre les politiques urbaines de localisation et le réétalonnage de l’espacede l’État » (p. 215). L’auteur évoque ici la décentralisation de certaines responsabilités poli-tiques, la réforme des relations intergouvernementales, la métropolisation des systèmes nationauxd’aménagement du territoire et enfin les conséquences en termes d’émiettements des grands projetsd’infrastructures. Dans chacun des cas examinés, on est frappé par l’absence relative des entre-prises du secteur privé et par l’ignorance également relative des restructurations de ces dernières.N’est-ce pas là un point aveugle qui, s’il était davantage éclairé, permettrait de mieux situer lesreconfigurations sociospatiales de l’État dans le contexte global de l’urbanisation capitalistique ?
Deuxièmement, l’analyse de chacune de ces formes n’est pas suffisamment développée. On leregrette d’autant plus que, pour étayer sa thèse, l’auteur compare plusieurs régions métropolitaines.Même si un certain niveau d’abstraction est nécessaire pour décrire des tendances générales, leschercheurs travaillant sur les relations intergouvernementales, l’aménagement du territoire ou lesinfrastructures urbaines pourront s’étonner de la concision d’une analyse alimentée par des étudesde cas anecdotiques. Dans le cas des infrastructures, par exemple, il est gênant que Neil Brenners’appuie sur un seul ouvrage (Splintering Urbanism de Stephen Graham et Simon Marvin) pourapprécier la place des réseaux techniques et des mégaprojets urbains dans la production « surmesure » de certains espaces urbains. Ce faisant, il néglige les différences entre pays européensen matière de politiques d’infrastructures.
Enfin, l’auteur privilégie souvent un seul discours officiel, sans jamais prendre le recul cri-tique qui sied. Le lecteur francais pourra ainsi s’étonner du poids accordé à la DATAR et à sesdifférents programmes dans les transformations des politiques d’aménagement du territoire, sanscommune mesure avec le caractère limité de la plupart de ses initiatives. On atteint ici les limitesde l’approche « méso » adoptée par Neil Brenner, qui l’oblige à fonder ses observations empi-riques sur une lecture exhaustive de la documentation secondaire et des travaux existants surce sujet. De ce point de vue, on lira avec profit, dans la préface, le récit de la genèse du livreet le passage d’une monographie comparée de Francfort et Amsterdam à une exploration plusthéorique des relations entre la gouvernance urbaine et les politiques d’aménagement des Étatseuropéens.
Ces observations critiques ne font que dire les limites habituelles des travaux spécialisés quiprétendent à la montée en généralité. Neil Brenner est d’ailleurs bien conscient du fait que laperspective qui est la sienne n’est pas la seule manière d’éclairer les formes et les effets de laréorganisation politico-économique. Ajoutons pour conclure que, en dépit des remarques précé-dentes, New State Spaces est un livre stimulant, qui révèle avec brio un vrai travail de chercheur.

Comptes rendus 257
Le cadre analytique (approche par le « réétalonnage » politique) offrira un appui solide à biend’autres travaux dans le champ urbain et bien au-delà encore.
Jonathan RutherfordLaboratoire techniques, territoires et sociétés (Latts), École nationale des ponts et chaussées,
6 et 8, avenue Blaise-Pascal, Cité Descartes, 77455 Marne-la-Vallée cedex 2, FranceAdresse e-mail : [email protected]
doi: 10.1016/j.soctra.2008.03.019
Franck Aggeri, Éric Pezet, Christophe Abrassart, Aurélien Acquier, Organiser le dévelop-pement durable, ADEME, Angers, 2005 (278 p.)
Derrière l’inflation des discours sur le développement durable et la responsabilité sociale del’entreprise, les auteurs de l’ouvrage s’interrogent sur les pratiques réelles des grandes entreprises.Grâce à une approche généalogique, ils questionnent les pratiques, les discours et les théories quiont participé à l’intégration du développement durable au sein des entreprises, sans oublier deprendre en compte dans l’analyse, à l’instar des travaux de Michel Foucault, leur formalisationvia la fabrication de dispositifs de gestion.
La première partie de l’ouvrage s’interroge sur le processus d’institutionnalisation et la rela-tive homogénéité croissante des pratiques du développement durable dans les entreprises. Pourles auteurs, il faut aller au-delà de la seule hypothèse des « pressions externes » alimentée parla convergence des contextes institutionnels (internationalisation croissante des firmes, juridicia-risation de la société, etc.), les nouvelles incitations réglementaires (loi NRE (sur les nouvellesrégulations économiques) en France, etc.) et financières (fonds éthiques et agences de notationextra-financière), les pressions des stakeholders (ONG, riverains, etc.) et le rôle grandissant de lanormalisation et du droit. Les auteurs se livrent ainsi à une analyse rigoureuse et approfondie de la« généalogie des concepts théoriques » dans le champ de la responsabilité sociale de l’entreprise(RSE) aux États-Unis, via notamment le décryptage des travaux de recherche qui se sont constituésautour du thème Business and Society. Lors des années 1990, le rôle déterminant des consultantsdans la traduction de ces concepts en pratique de management est clairement mis en évidence parles auteurs à travers la métaphore de la « main invisible » des cabinets de consulting. Les auteursexplicitent le travail effectué par ces prescripteurs dans la phase de la normalisation des savoirset des expertises sur le reporting extrafinancier. À ce propos, l’ouvrage souligne que si la RSEétait à l’origine davantage fondée sur des réflexions éthiques et morales que sur les principes dudéveloppement durable, ce sont les consultants qui ont fait le lien entre ces deux courants depensée.
La deuxième partie nous plonge au cœur des pratiques à travers des études de cas centréessur quatre entreprises pionnières en matière de développement durable : Accor, Arcelor, Lafargeet Monoprix. Les auteurs avancent comme hypothèse que l’incorporation du développementdurable dans le mode de gestion des entreprises dépasse la seule logique du risk management(avec l’hypothèse des « pressions externes ») pour devenir un enjeu important de la stratégie et del’innovation des entreprises. Ainsi les auteurs analysent comment les diverses formes que revêt ledéveloppement durable au sein des entreprises s’institutionnalisent en fonction de leur histoire etde leurs enjeux, que ce soit avec la formalisation d’un reporting extra-financier (pour Accor), avecla mise en place de comité de stakeholders et d’une plus grande concertation sociale (Lafarge,Arcelor, Monoprix), avec le développement de nouveaux produits « durables » (Monoprix) ou