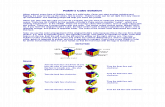3_guilhou
-
Upload
isabela-rosa-lachtermacher -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of 3_guilhou

Images de l’au-delà égyptien : l’aménagement de l’espace
Nadine GUILHOU
Université Paul-Valéry Montpellier 3 Le devenir du roi, et plus largement du défunt, est astral : « astre unique », c'est-à-dire étoile, qu’elle soit impérissable ou décanale, lune, voire Vénus, « dans la suite de Rê », « parmi les suivants de Rê », le mort prend place dans l’une des multiples barques qui sillonnent le ciel. Il faut entendre par ciel l’espace visible ou invisible, et tour à tour visible et invisible, que parcourent les astres nuit et jour. Création et mise en forme de cet espace sont évoquées par des mythes étiologiques, comme le Mythe de la Vache céleste, où il s’agit de mettre en place un lieu où le dieu solaire vieilli puisse se retirer : Nout, transformée en vache céleste, emporte Rê sur son dos pour l’éloigner du monde des hommes. À cette occasion, l’espace céleste invisible est aménagé : Champ des offrandes, Champ des souchets, étoiles verdoyantes (ikhikh). C’est pourquoi Rê demande à Thot de le remplacer dans le ciel nocturne :
« Sois là dans le ciel, à ma place, puisque c’est moi qui doit donner le rayonnement de la lumière du soleil à la Douat et aussi à l’Île de Baba »1.
Les éléments de ce monde imaginaire, donnés dans le désordre par les plus anciens recueils comme les Textes des Pyramides et les Textes des Sarcophages, sont organisés au Nouvel Empire dans les recueils funéraires royaux. Ceux-ci se présentent désormais comme des livres d’images complétées par des légendes et explicitées par des textes d’introduction et/ou de conclusion permettant de les décrypter, tant il est vrai que l’image est elle-même une écriture, donc ne se suffisant pas en soi et à lire comme élément d’un ensemble. Dès le Moyen Empire, sur le fond de certains sarcophages, le Livre des Deux chemins (d’eau et de feu) constituait un premier exemple de topographie avec image. Les recueils funéraires royaux du Nouvel Empire présentent différents espaces, réels et imaginaires, correspondant aux différentes étapes du parcours des astres. Parmi les espaces réels, les plafonds astronomiques, comme celui de la tombe de Séthy Ier, offrent une image du ciel nocturne, tandis que le Livre du Jour montre les transformations successives du soleil au cours des heures de la journée. Le mort peut espérer faire partie de l’un et l’autre de ces espaces2. Cependant, si dans le ciel nocturne visible, il peut paraître sous la forme d’une étoile, voire s’assimiler à l’astre lunaire, étant donc revêtu d’une apparence, il demeure, dans le ciel diurne, totalement invisible, alors même qu’il est installé dans la barque de Rê, noyé qu’il est par le vif éclat du soleil3. Les recueils consacrés à l’espace imaginaire, inconnu et donc générateur de crainte, sont cependant les plus nombreux. Ils concernent essentiellement le parcours du soleil dans le monde invisible et sont le plus souvent structurés de façon temporelle, selon un découpage en douze heures délimitant autant de sections. Il en est ainsi en particulier
1. Livre de la Vache céleste, version de Séthy Ier, col. 64-66 ; Nadine Guilhou, La vieillesse des dieux, p. 12, 20. 2. Le désir de se retrouver à la lumière du soleil est exprimé par le titre même de la « Formule pour sortir le jour », que nous appelons « Livre des Morts », recueil destiné à apprendre comment revenir à la lumière du jour après la traversée de la nuit/mort. 3. Telles les étoiles décanales le jour comme le présente l’image illustrant le Texte dramatique, dans l’Osireion et la tombe de Ramsès IV. Voir l’analyse de Bernard Arquier, Images diurnes et nocturnes de l’au-delà céleste dans l’ancienne Égypte, ici même.

Images de l’au-delà égyptien
31
dans le Livre de l’Amdouat4 et dans le Livre des Portes. Les représentations, organisées en trois registres, dépeignent la navigation de la barque, tantôt glissant sur l’eau, tantôt halée sur les bancs de sable qui obstruent le courant. De part et d’autre, sur les rives, se pressent les différents êtres qui peuplent l’au-delà – les « vivants » ! –, acclamant le soleil à son passage, tandis que les méchants sont punis et définitivement « morts ». Le Livre des Cavernes insiste davantage sur les grottes qui bordent le chemin – les caveaux –, s’animant tour à tour à l’éclat de la lumière. Quant aux Litanies de Rê, elles évoquent les 74 hypostases du dieu solaire, qualifié de « Migrateur », ou encore de « Navigateur », étapes de son devenir nocturne. Dans tous les cas, il s’agit d’un monde de ténèbres, fugacement éclairé par le passage de l’astre solaire qui vient se régénérer dans ces ténèbres primordiales – « l’obscurité totale ». La caverne, l’obscurité, sont des lieux ambivalents : c’est l’espace du corps/cadavre, mais aussi celui où l’on peut se ressourcer, se régénérer, image de l’incréé, aux origines de la création. Ces différents recueils sont autant de livres de savoir. Il s’agit d’élaborer des livres permettant une connaissance de l’espace imaginaire de façon à pouvoir le maîtriser. Ce souci est essentiel. C’est un thème récurrent dans les titres et les rubriques
« Écrits de la chambre cachée. Position des âmes, des dieux, des ombres et des glorifiés, et ce qu’ils font. Début : ouverture occidentale, à la porte de l’horizon occidental. Fin : l’obscurité (totale), à la porte de l’horizon occidental. Connaître les âmes de ceux de la Douat (selon certaines graphies : des étoiles), connaître ce qu’(ils) font, connaître leur glorification de Rê. Connaître les âmes secrètes, connaître ce qui est dans les heures et leurs divinités. Connaître l’appel qu’il (= Rê) leur adresse. Connaître les portes et les chemins qu’emprunte le grand dieu. Connaître le parcours des heures et leurs divinités. Connaître les élus et les damnés 5. »
On y relève des contradictions, comme l’absence des lieux de purification de Rê lors du passage de l’horizon, mentionnés dans le Livre des Morts mais absents des recueils funéraires comme Amdouat et Livre des Portes, qui font qu’il est impossible de dresser une topographie de l’au-delà. Mais il y a également des constantes. Tous empruntent en effet tout ou partie de l’espace dans lequel évolue le défunt au monde réel, ou s’en inspirent largement. On y retrouve en effet des éléments des différents biotopes de l’Égypte. L’espace aquatique Lacs et canaux sont omniprésents dès les Textes des Pyramides. Dans un univers liquide – le ciel peut être qualifié d’Immensité verte », soit une désignation de la mer ou des marécages du Delta6 – les canaux navigables servent de chemin. Le mort les traverse parfois, pour se rendre dans le Champ des offrandes, pour rejoindre les étoiles Impérissables (= circumpolaires) sur l’île qu’elles occupent, au Nord du ciel (formule 519), ou pour gagner le côté oriental du ciel, vers l’horizon (formule 359). Le danger peut être matérialisé par les bancs de sable qui affleurent, interrompant la navigation, c'est-à-dire arrêtant l’écoulement du temps : ainsi dans les quatrième et cinquième heure de
4. C’est-à-dire Livre de ce qu’il y a dans l’au-delà, la Douat étant l’une des désignations de l’au-delà. Ce titre est moderne, le titre égyptien étant « Livre de la chambre cachée ». 5. Titre de l’Amdouat ; SS.w n(y) a.t jmn.t aHaw bA.w nTr.w Swy.wt Ax.w jrr.w HA.t wp.t jmn.t sbA n(y) Ax.t jmnt(y).t Rx bA.w dwAty.w rx jrrw rx sAx.w=sn n Ra rx bA.w StAy.w rx jmy.w wnw.t nTr.w=sn rx Dwj=f n=sn rx sbA.w wA.wt app(w).t nTr aA Hr=sn rx Sm.t wn.wt / sbA.w nTr.w=sn rx wASy.w Htmy.w. 6. Par exemple, formules 437, 576, 610 des Textes des Pyramides.

Imaginer et représenter l’au-delà
32
l’Amdouat, où la barque solaire doit être halée sur le sable, ou dans le chapitre 108 du Livre des Morts, où un serpent gigantesque avale l’eau afin d’échouer la barque. Les lacs, nombreux, peuvent être dangereux ou propices : on recommande au défunt de « se garder » du Grand Lac qu’il doit traverser. Au contraire, c’est dans le(s) Lac(s) du/des Chacal(s) ou dans le Lac de la Douat (par exemple formules 268, 504, 512 et 697 des Textes des Pyramides) que, dans sa forme stellaire, il se débarrasse de son impureté (i.e. la putréfaction due à la mort) pour renaître7. De même, à l’image du soleil, il se purifie dans le Lac des oies-semen (formule 577). Selon nombre de cosmogonies, en effet, le marécage est le lieu de naissance de la vie, à l’image des tertres émergeant chaque année de la crue étale. Le mort évolue enfin aux côtés de Rê dans le marécage, milieu d’origine du vivant, où il anéantit ses ennemis sous la forme d’oiseaux et de poissons (fig. 1), tout comme il le fait pour les êtres hostiles qui peuplent le milieu désertique :
« Tu pourras maintenant parcourir la nature sauvage8 avec Rê. Il te permettra de voir les lieux d'agrément,
de trouver les oueds remplis d'eau, où te laver et te purifier, de cueillir papyrus et roseau, lotus en fleurs et en boutons.
Il fera venir à toi des oiseaux aquatiques par milliers, posés sur ton chemin.
Que tu lances ton bâton de jet contre eux, et c'est un millier qui est tombé au seul bruit de l'air qu'il déplace :
oies cendrées, colverts, oies rieuses, canards pilets. Il te fera apporter des petits de gazelle,
taureaux blancs à cornes courtes, hardes d'ibex, mouflons bien gras.
(Puis) on te dressera une échelle vers le ciel, que Nout te tende les bras.
Tu navigueras sur le canal en pente, tu feras voile dans une barque de huit.
Ces deux équipages des Étoiles Impérissables et des Infatigables te convoieront, ils te piloteront,
ils te haleront sur la plaine liquide, avec leurs cordes de métal céleste (= fer)9. »
Comme l’indique la double mention des Impérissables et des Infatigables, cette description évoque l’ensemble du parcours du défunt dans la barque de Rê, successivement pendant le jour et pendant la nuit, sans véritable rupture10. Ainsi est évoqué le double aspect de l’élément liquide : l’espace sauvage avec le marécage ; espace entretenu et maîtrisé avec les bassins, les canaux et les voies navigables. Le désert Le désert représente, dans l’au-delà comme sur terre, un espace hostile. Domaine de Seth, dieu de la stérilité et du désordre, il constitue toujours une menace pour la vallée fertile, toujours à la merci d’une crue trop faible : crainte du sable, qui envahit tout, des nomades qui y vivent, peur de la faim et de la soif, qui réduiraient le mort à manger ses excréments et à boire son urine, des animaux réels (prédateurs des cultures) et fabuleux qui le peuplent, il fournit le modèle d’un monde de feu et de flammes, flammes qui illustrent 7. Ceci correspond à la période d’invisibilité des étoiles qui se déplacent sur la bande zodiacale. 8. xAs.wt : nature sauvage, plutôt qu'au sens habituel de « pays étrangers / montagneux » ou « désert ». 9. Chapitre 62 des Textes des Sarcophages ; traduction N. Guilhou, Le paysage égyptien, p. 22. 10. En effet, les Impérissables tirent la barque de Rê pendant le jour, tandis que les Infatigables prennent le relais pendant la nuit.

Images de l’au-delà égyptien
33
aussi le combat de la naissance du soleil, matérialisé par le rougeoiement de l’aurore. Ainsi certaines des buttes du chapitre 149 du Livre des Morts (fig. 2) :
« Treizième butte, verte. Celui qui ouvre sa gueule (= hippopotame, gardien de la butte) ; plateau d’eau (= caractéristique de la butte). Ô, cette butte des Glorifiés sur laquelle ils sont sans pouvoir, dont l’eau est du feu, dont les vagues sont du feu, dont le souffle est un brandon de feu, pour empêcher qu’on ne puisse boire son eau, en sorte que soit étanchée leur soif qui est en eux, tant est grande la crainte qu’il (= le gardien de la butte) inspire, tant est puissant le respect qu’il inspire ! Les dieux et les Glorifiés voient son eau de loin, ils ne peuvent étancher leur soif, ils ne peuvent satisfaire leurs désirs. Afin qu’on ne puisse s’en approcher, la rivière est encombrée de fourrés de papyrus, comme le flot (?) que sont les humeurs sorties d’Osiris (i.e. le fleuve en crue). Puissè-je disposer de l’eau, puissè-je boire de l’onde, comme ce dieu qui habite la butte de l’eau ; c’est lui qui la garde, dans la crainte que les dieux ne boivent son eau, en la tenant à l’écart des Glorifiés » (trad. d’après P. Barguet) 11.
Dieux et Glorifiés, c'est-à-dire autant de désignations des morts, regardent l’eau de loin, dans la position de celui qui est dans le désert et qui doit traverser un espace hostile et brûlant, puis se frayer un chemin dans les fourrés de papyrus avant d’atteindre le fleuve. Le feu peut cependant avoir un aspect positif : dans la troisième heure du Livre des Portes, au registre supérieur, devant les momies, debout dans leur chapelle respective et réveillées au passage du soleil s’étend le Lac de flammes, qui approvisionne les morts. De même, au chapitre 126 du Livre des Morts, le Lac de flammes (fig. 3), métaphore pour le soleil, est gardé par quatre babouins qui débarrassent le mort des fautes qu’il a pu connaître et l’introduisent dans la nécropole, où ils le pourvoiront en offrandes alimentaires. Selon ce chapitre, qui fait suite à la psychostasie, le feu, barrière contre les méchants, joue en quelque sorte un rôle purificateur. La vallée fertile Par opposition à ce monde inquiétant du désert, l’espace agricole est très présent. Il s’agit d’assurer la permanence de l’offrande alimentaire, mais aussi la pérennité de la vie, à travers l’évocation de la production agraire et du calendrier des saisons. Les étoiles piquetant l’espace céleste visible peuvent être métaphoriquement assimilées à des jeunes pousses trouant la terre noire (formules 350 à 352 et 483 des Textes des Pyramides). De même, l’espace invisible est peuplé de champs fabuleux. Le mort peut s’y approvisionner, mais surtout, il est désormais partie intégrante du cycle de fertilité 12, ce qu’exprime l’image selon laquelle il y laboure et il y moissonne :
« Je connais ce Champ des Souchets de Rê ; ses murs sont en cuivre ; la hauteur de son orge est de cinq coudées, avec des épis de deux coudées et des tiges de trois coudées ; son épeautre est de sept coudées, avec des épis de trois coudées et des épis (sic) de quatre coudées ; ce sont des Glorifiés de neuf coudées de haut chacun qui les moissonnent aux côtés des Âmes de l’Orient »13.
Au gigantisme des épis – la coudée fait 52 cm de long – répond celui des glorifiés, qui se voient en outre attribuer un fessier de sept coudées de large dans la cinquième butte du chapitre 149 du Livre des Morts ! Ces champs sont représentés sur la très belle vignette du chapitre 110 du Livre des Morts, qui montre un terroir aménagé et irrigué (fig. 4). Chaque recueil funéraire est personnalisé par la présence du nom, si bien que le défunt,
11. Traduction d’après P. Barguet, Le Livre des Morts des anciens Égyptiens, p. 212-213. 12. Idée selon laquelle la vie naît de la mort, également transcrite par le mythe d’Osiris, engendrant son fils après sa propre mort et dont les lymphes constituent les eaux fertilisatrices de l’inondation. 13. Chapitre 109 du Livre des Morts. C’est aussi la description de la deuxième butte du chapitre 149. P. Barguet, Le Livre des Morts des anciens Égyptiens, p. 143, 209 ; p. 210 pour la cinquième butte.

Imaginer et représenter l’au-delà
34
qu’il soit roi ou simple particulier, est directement et personnellement impliqué dans ce déroulement du calendrier agraire14. Dans l’obscurité de l’Au-delà poussent les plantes. Ainsi, au registre inférieur de la deuxième heure du Livre de l’Amdouat, des génies portant un épi en main ou coiffés de deux épis (fig. 5), parmi lesquels Néper15, sont en tête du cortège, tandis qu’au registre supérieur glisse une barque dans laquelle se dressent deux épis de belle taille, Néper à la proue et « hampe d’orge kamoutet » à la poupe (fig. 6). Ils incarnent le pouvoir germinatif présent au plus profond de la nuit, garant du renouveau de la végétation16. À la neuvième heure, la légende inscrite à côté de génies porteurs de végétaux (fig. 2) les identifie comme « les dieux des champs de cette section », « ceux qui font exister tout champ et toute plante dans cette section »17. On y délimite des champs qui sont attribués aux défunts, comme au registre supérieur de la cinquième heure du Livre des Portes, tandis qu’au registre inférieur leur est octroyé le temps de vie. Dans la septième heure du même recueil, aux registres supérieur et inférieur, il est question de l’approvisionnement, avec la production du grain : en haut, une série de personnages porte un panier à grain au-dessus de la tête (fig. 8), tandis que d’autres arborent la plume de la justification consécutive au jugement. En bas, certains travaillent aux champs, tandis que d’autres brandissent des faucilles. Ainsi sont évoquées la mise en culture, la germination et la pousse des céréales dont le Champ des Souchets, situé juste avant l’horizon, nous présente la récolte. S’il y a une cohérence temporelle interne à chaque recueil, il n’y en a guère entre les divers recueils, mais il est clair que le monde de la nuit, tout comme celui de l’eau, est aussi le domaine de la régénération, auquel le cycle de la végétation prête ses images. Géographie réelle et géographie mythique À côté de lieux spécifiques à l’au-delà, comme le Champ des Souchets, le Champ des Offrandes et les divers lacs et canaux déjà cités, et de représentations qui trouvent leurs racines dans une réalité plus diffuse, comme les buttes émergeant du Nil en crue ou les falaises limitant l’horizon oriental et l’horizon occidental, les recueils funéraires sont enfin émaillés de références géographiques précises. Celles-ci sont de deux types : on y trouve nommés des lieux et toponymes réels et des lieux mythiques. Parmi les premiers, soulignons la division en Haute-Égypte et en Basse-Égypte ; la mention de grands sanctuaires, comme Abydos, sanctuaire principal d’Osiris, où doit se rendre le défunt ; de lieux importants d’un point de vue religieux et symbolique, comme Éléphantine, lieu d’origine de la crue, où l’on va puiser l’eau nécessaire à la purification matinale du défunt. Parmi les seconds, on trouvera Nedit et Gehesety, lieux de l’assassinat d’Osiris ; les marais de Chemnis, où Isis éleva son fils Horus. Bien que mythiques, ces lieux sont approximativement situés dans le monde réel (ainsi Chemnis, dans le Delta). Tout ceci a pu faire penser à un décalque de l’Égypte dans l’au-delà, aussi bien dans le ciel visible des constellations que dans le monde invisible de l’au-delà18. Le cheminement du mort se fait en effet selon les directions cardinales et s’y ajoute, d’un point de vue temporel, un cheminement de fêtes en fêtes, ces dernières étant liés à des événements mythiques et/ou à des sanctuaires, d’où les multiples références à la géographie réelle de l’Égypte. Les lieux mythiques insérés dans l’espace réel, quant à eux, font référence à l’époque
14. Il en est de même dans les chapitres 6 et 137B du Livre des Morts où l’ouchebti, double et effigie du défunt, est chargé de transporter le sable pour creuser les canaux et édifier les digues, c'est-à-dire de participer à la gestion de l’eau dans l’espace agricole. 15. Personnification divinisée du Grain, comme Renenoutet est celle de la Récolte. 16. E. Hornung, Das Amduat ; Die Schrift des verborgenen Raumes II, p. 54-55, n° 86-92 ; N. Guilhou, Présentation et offrande des épis dans l’Égypte ancienne (I), p. 352. 17. E. Hornung, ibidem, II, p. 159, n° 683-691 ; S. Aufrère, À propos de « Ceux qui font les arbres » (jrw nhwt) de la IXe section du Livre de l’Amdouat, p. 165. 18. Voir par exemple G. Daressy, L’Égypte céleste, p. 1-34.

Images de l’au-delà égyptien
35
mythique où les dieux vivaient sur terre 19 et sont transposés de ce fait dans l’histoire. Tout se passe comme si l’on avait affaire, à côté du monde réel, à des reflets plus ou moins estompés, de cette réalité. En conclusion, on peut dire que le monde réel, avec sa géographie et ses différents biotopes est à base de la mise en images de l’au-delà dans ses différentes représentations : espaces célestes diurne et nocturne, bien réels ceux-là, mais aussi espace invisible imaginaire. C’est un moyen de rendre plus familier et plus rassurant un monde inconnu, lieu de tous les dangers, dans la perspective de la connaissance indispensable. Cependant, cet espace imaginaire est bien loin d’être un simple décalque du quotidien familier. Il renvoie à des modèles fournis par le monde réel, mais biaisés, gauchis. Ainsi, le Champ des Souchets, avec ses épis fabuleux, est la transposition idéale des champs fertiles de la vallée. Il est la projection de l’angoisse permanente de la famine, dans une civilisation qui vit en équilibre précaire, tout comme les flammes des douzième et treizième buttes sont celle de la peur engendrée par le désert, domaine de la stérilité, de la faim et de la soif. Voilà pourquoi leurs caractères en sont outrés et extrêmes. Du fait qu’il est décrit, maîtrisé, l’imaginaire peut être appréhendé. Même le noir terrifiant du caveau renvoie à la grotte, à la caverne, lieu d’origine de l’inondation, ou à la nuit au sein de laquelle se régénère le soleil. D’une stricte connotation négative, il acquiert de ce fait une valeur positive. Voilà pourquoi, par exemple, on y situe le pouvoir de germination. Il s’agit de rendre propice en installant dans l’inconnu des repères familiers. D’où mise en images, d’abord ; images d’un monde connu, images multiples, seules capables d’exprimer l’inconnaissable – d’où la diversité des approches ; l’étrangeté du monde ainsi évoqué venant tant des éventuelles modifications de ces images pour s’adapter à un monde imaginé que de leur juxtaposition ou encore de leur insertion dans un espace peuplé d’êtres fabuleux. À cela s’ajoute enfin une dimension nouvelle : les espaces ainsi définis sont des espaces en mouvement ; c’est ce qui permet de les raccorder (par le biais de la barque, écriture du mouvement), le but étant d’échapper à l’immobilisme de la terre (du caveau) et de passer, indéfiniment, d’un espace à un autre.
Résumé L’au-delà est omniprésent dans la littérature funéraire égyptienne. Les différents recueils nous en proposent de multiples images, à partir desquelles on essaiera de montrer la cohérence du monde imaginaire ainsi évoqué et les rapports qu’il entretient avec le monde réel. On s’intéressera en particulier à l’aménagement de l’espace et au paysage ainsi défini. En quoi est-il un décalque de celui que les Égyptiens avaient sous les yeux : fournit-il du « Double-Pays » une image parallèle ou une image corrigée et améliorée ? Existe-t-il une vision unique ou des représentations diverses et multiples de l’au-delà ? La communication fera le point sur ces différents aspects.
19. Se reporter à la communication de B. Arquier, N. Guilhou, Le temps des dieux, 129e Congrès du CTHS à paraître.

Imaginer et représenter l’au-delà
36
Bibliographie ARQUIER Bernard, GUILHOU Nadine, « Le temps des dieux », 129e Congrès du CTHS, Besançon, avril 2004. AUFRERE Sydney H., À propos de « Ceux qui font les arbres (jrw nhwt) de la IXe section du Livre de l’Amdouat », dans S. AUFRERE (éd.), Encyclopédie religieuse de l’univers végétal II, Montpellier, 2001, p. 163-168 (Orientalia Monspeliensia XI). BARGUET Paul, Le Livre des Morts des anciens Égyptiens, Paris, Éditions du Cerf, 1967 (Littératures anciennes du Proche-Orient 1). DARESSY Georges, L’Égypte céleste, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 12, Le Caire, Ifao, 1916, p. 1-34. GUILHOU Nadine, La vieillesse des dieux, Montpellier, 1989 ; (Orientalia Monspeliensia V). GUILHOU Nadine, Le paysage égyptien, Egyptes n° 4, Avignon, 1994, p. 20-23. GUILHOU Nadine, Présentation et offrande des épis dans l’Égypte ancienne (I), dans S. Aufrère (éd.), Encyclopédie religieuse de l’univers végétal I, Montpellier, 1999, p. 335-364 (Orientalia Monspeliensia X). HORNUNG Erik, Das Amduat ; Die Schrift des verborgenen Raumes, Wiesbaden, 1963 ; (Ägyptische Abhandlungen 7).

Images de l’au-delà égyptien
37
Illustrations Fig. 1 : Chasse et pêche dans les marais, oiseaux et poissons représentant diverses manifestations de l’ennemi. C’est en même temps une illustration des activités de la saison akhet, saison de l’inondation, première saison égyptienne. Tombe de Sabni, Assouan, Ancien Empire. Cliché N. Guilhou.
Fig. 2 : Cinquième et sixième buttes du chapitre 149 du Livre des Morts. Papyrus Caire A26, P1 Stairs E.1.A. Cliché N. Guilhou.

Imaginer et représenter l’au-delà
38
Fig. 3 : Le Lac de flammes gardé par quatre babouins. Les flammes sont représentées par les quatre idéogrammes du brasier, sur les quatre côtés du lac. Vignette du chapitre 126 du Livre des Morts, tombe de Ramsès IX. Cliché B. Arquier.
Fig. 4 : Vignette du chapitre 110 du Livre des Morts. Le défunt moissonne les champs fabuleux de l’au-delà, image de la fertilité et de l’abondance. Papyrus de Iahmès, Louvre 3086 (8). Cliché B. Arquier.

Images de l’au-delà égyptien
39
Fig. 5 : Génies de la végétation, symbolisant la capacité de germination. Deuxième heure du Livre de l’Amdouat, registre inférieur. Tombe de Thoutmosis III. Dessin N. Guilhou, d’après cliché personnel.
Fig. 6 : Épi d’orge à la proue de la barque, illustrant également le pouvoir de germination pendant la nuit. Deuxième heure du Livre de l’Amdouat, registre supérieur. Tombe de Ramsès III. Cliché N. Guilhou.

Imaginer et représenter l’au-delà
40
Fig. 7 : Génies chargés de faire pousser les plantes de la neuvième heure du Livre de l’Amdouat. Tombe de Ramsès III. Cliché N. Guilhou.
Fig. 8 : Personnages portant des paniers pour le grain, à la septième heure du Livre des Portes. Tombe de Ramsès VI. Cliché N. Guilhou.