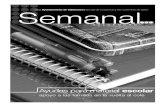381
-
Upload
simionescu-alin -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of 381

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
PRISE EN CHARGE IMMEDIATE PRE-‐HOSPITALIERE ET A L'ARRIVEE A L'HOPITAL, EVALUATION DES COMPLICATIONS CHEZ : UN BRULE, UN POLYTRAUMATISE, UN TRAUMATISE ABDOMINAL, UN TRAUMATISE DES MEMBRES, UN TRAUMATISE DU RACHIS, UN TRAUMATISE THORACIQUE, UN TRAUMATISE OCULAIRE, UN PATIENT AYANT UNE PLAIE DES PARTIES MOLLES. Question ECN n°329 Dr Philippe LORIAUT Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique Hôpital de la Pitié Salpétrière – APHP -‐ Paris
1. Brûlures -‐ Définition: La brûlure est une lésion du revêtement cutané produite par l’action de la chaleur, de l’électricité, des rayonnements ou des produits chimiques.
1.1 Physiopathologie -‐ Agents vulnérants
Brûlures thermiques = 90%
Brûlures électriques = 5%
Brûlures chimiques = 5%
Brûlures par rayonnements ionisants.
-‐ Circonstances (par ordre de fréquence)
Accidents domestiques
Accidents du travail
Tentatives de suicide
Accidents de la voie publique
1.2 Examen clinique -‐ Interrogatoire du blessé (ou à défaut, de son entourage)

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
Âge Antécédents médico-‐chirurgicaux / Allergies connues Traitements en cours Poids Statut de la vaccination antitétanique Mécanisme : Durée du contact, type de brûlure
Heure du traumatisme/ Heure de jeûne
Recherche de critères de gravité : durée de contact élevée, notion d'intoxication oxycarbonée, polytraumatisme associé.
-‐ Examen physique
Faire un schéma daté et signé.
Prise des constantes.
Inspection :
-‐ Evaluer la profondeur de la brûlure
-‐ Premier degré – Atteinte isolée de l’épiderme sans atteinte de la couche basale de Malpighi. – Érythème douloureux sans phlyctènes. Il guérit sans séquelles en deux à quatre jours après une courte desquamation. – Il ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation de la surface brûlée chez un grand brûlé. -‐ Deuxième degré Il existe une atteinte du derme. – Deuxième degré superficiel : * Atteinte partielle de la couche basale de Malpighi. * Se caractérise par un décollement épidermique à l’origine de phlyctènes. * Hyperesthésie sans hypoesthésie. * Guérison en dix à quinze jours à partir de la couche basale. – Deuxième degré profond : * Destruction de la couche basale de Malpighi avec quelques enclaves épidermiques intactes (bulbes pileux, glandes sébacées et sudoripares). * Zone d’hypoesthésie avec peau blanche ou rouge foncé.

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
* Guérison en trois à six semaines à partir des enclaves épidermiques sous réserve de conditions locales favorables et avec séquelles à base de rétractions cicatricielles. -‐ Troisième degré – Destruction complète de l’épiderme, du derme et d’une partie de l’hypoderme. – Thromboses vasculaires et destruction des filets nerveux. – Peau insensible d’aspect variable : blanc à noir cartonné. – Cicatrisation spontanée impossible.
-‐ Evaluer la surface corporelle brûlée
-‐ Règle des 9 de Wallace : pourcentage de la surface corporelle.

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Cas particulier de l'enfant La surface de la tête est plus importante que chez l’adulte (18 % à la naissance) et la surface des membres inférieurs est moins importante (9 % par membre à la naissance). -‐ Evaluer la localisation de la brûlure Certaines zones sont à risque soit d’ordre vital immédiat, soit à moyen ou long terme du fait de complications ou de séquelles possibles. – Voies aériennes supérieures. – Face. – Mains. – Plis de flexion des membres. – Périnée.
-‐ Evaluer les critères de gravité :
-‐ Profondeur de la brûlure: 2e degré profond et 3e degré
-‐ Etendue de la brûlure: grave si surface brûlée > 20% (Pronostic vital engagé si surface brûlée > 40%)
Atteintes des muqueuses de la bouche, de la face, des voies aériennes supérieurs (détresse respiratoire) et des mains
Intoxication associée : CO et cyanhydrique
Polytraumatisme associé
Brûlures circulaires (risque de syndrome des loges et d’ischémie aigue)
-‐ Règle de Bau -‐ Âge + % surface brûlée < 50 fi survie = 100 %. -‐ Âge + % surface brûlée > 100 fi survie < 10 %. -‐ UBS (unit burn standard) -‐ UBS = % surface brûlée + [3 x (% surface brûlée au 3e degré)]. -‐ UBS > 100 fi pronostic vital en jeu.
1.3 Examens paracliniques -‐ biologiques : NFS/plaquettes, Hémostase : TP/TCA (CIVD), protidémie, ionogramme sanguin, Urée, Créatinémie, Gaz du sang artériel + Lactates + HbCO, CPK, Groupage 2 déterminations, Rhésus, RAI, Troponine

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ imagerie : radio thorax de face, ECG
1.4 Complications -‐A court terme: Déshydratation / Choc hypovolémique, hypothermie, dénutrition (fuite protidique + hyperactivité métabolique), OAP lésionnel voire SDRA, Œdème cérébral, Insuffisance rénale aigue fonctionnelle sur déshydratation ou organique par nécrose tubulaire aigue sur hypovolémie ou rhabdomyolyse, syndrome des loges ou ischémie aigue de membre sur brûlure circulaire, Intox au CO, Intox cyanhydrique
-‐ Complications de réanimation : complications thrombo-‐emboliques et de décubitus, surinfection cutanée, décès
-‐ A long terme: handicap social lié aux cicatrices, séquelles esthétiques cutanées, séquelles fonctionnelles ostéo-‐articulaires s et tendineuse: rétraction cutanée, séquelles psychologiques , cancers cutanés.
2. Prise en charge immédiate pré-‐hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications chez un polytraumatisé Définition du polytraumatisé : Patient présentant au moins deux lésions dont au moins une engageant le pronostic vital.
2.1 Avant l’arrivée du SAMU (PAS) -‐ Protéger : se protéger, retirer le(s) blessé(s) de l’agent traumatique, éviter le sur-‐accident
-‐ Alerter : appeler le 15 (SAMU-‐SMUR), le 18 (Pompiers), rechercher de l’aide autour de soi, préciser : lieu de l’accident, nombre de blessé, gravité des blessures.
-‐ Secourir : Ventilation par bouche à bouche, massage cardiaque externe, compression manuelle des hémorragies extériorisées, immobilisation de l’axe cranio-‐rachidien,position latérale de sécurité, couverture.
2.2 Prise en charge par le SAMU -‐ Evaluer les fonctions:
-‐ Neurologiques : Glasgow, Examen des pupilles, tonicité des membres et rectale (TR)
-‐ Hémodynamiques : TA, FC, palpation des pouls, hémorragie, signes de choc (marbrures, temps de recoloration cutanée).

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Respiratoires : SpO2 , FR, cyanose, détresse respiratoire.
-‐ Conditionnement : Urgence thérapeutique
Tout patient polytraumatisé inconscient a une lésion rachidienne instable jusqu’à preuve du contraire.
-‐ Immobilisation avec maintien de la rectitude crânio-‐rachidienne (collier cervical rigide + matelas coquille)
-‐ Scope, TA, FC, SaO2, Dextro, Hemocue
-‐ Pose de 2 VVP de bon calibre
-‐ Couverture de survie
-‐ Oxygénothérapie nasale pour SaO2 > 95% ou intubation oro-‐trachéale + ventilation mécanique si Glasgow < 9 ou détresse respiratoire.
-‐ Remplissage vasculaire (si hypotension artérielle) + Transfusion si nécessaire (O-‐)
-‐ Introduire amines vasoactives si hypotension persistante malgré remplissage vasculaire adapté.
-‐ Compression d’une hémorragie extériorisée
-‐ Antalgiques
-‐ Drainage d’un hémothorax compressif ou exsufflation d’un pneumothorax suffocant
-‐ Examen clinique complet (fractures, plaies,…)
2.3 Prise en charge hospitalière Urgence thérapeutique
-‐ Au déchocage, voire en réanimation ou directement au bloc opératoire
-‐ Immobilisation avec maintien de la rectitude crânio-‐rachidienne (collier cervical rigide + matelas coquille)
-‐ Scope, TA, FC, SaO2, Dextro, Hemocue
-‐ Information du radiologue, de l’anesthésiste et des différents chirurgiens concernés

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Poursuite des éléments thérapeutiques introduit en pré-‐hospitalier : ventilation mécanique, en cas de choc : pose d’une VVC et d’un cathéter artériel, poursuite du remplissage vasculaire +/-‐ de la transfusion, introduction ou poursuite d’amines vasopressives si nécessaire, BU + Sondage vésical (en l’absence d’hématurie), vérification du statut vaccinal anti-‐tétanique : Quick Test +/-‐ SAT/VAT, examen clinique complet, ECG, schéma daté et signé
-‐ bilan paraclinique en urgence
• Bilan biologique complet : NFS/plaquettes, Groupage 2 déterminations/Rhésus/RAI, ionogramme sanguin, urée, créatinémie,glycémie capillaire et sanguine, TP/TCA, bilan hépatique complet, lipase, tropo, CPK, gaz du sang artériel, lactates artériels, β-‐HCG, alcoolémie, toxicologie
• Imagerie :
-‐ si patient instable hémodynamiquement : au lit du malade :
• FAST echo = échographie cardiaque, pleural et abdominale à la recherche d’un épanchement (hémorragique) péricardique, pleural et intra-‐abdominal
• Rx Thorax Face (volet, pneumothorax, hémothorax)
• Rx Bassin Face
• Rx rachis cervical F/P
-‐ si patient stable ou stabilisé :
• TDM corps entier = bodyscan = cérébro-‐cervico-‐ thoraco-‐abdomino-‐pelvien, avec injection de PDC iodés pour séquence d’acquisition de l’aorte et des vaisseaux du cou (trauma à haute cinétique)
+ Rx standards des membres si suspicion de fracture
-‐ TTT étiologique médico-‐chirurgical ou radio-‐interventionnel
-‐ TTT symptomatique : TTT antalgiques
-‐ Prévention des complications de décubitus
-‐ Certificat médical descriptif

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Surveillance clinique et paraclinique en réanimation de l’efficacité et de la tolérance des thérapeutiques
3. Prise en charge et évaluation des complications chez un traumatisé des membres
3.1 Examen clinique -‐ Interrogatoire
Âge
Circonstances de l’accident / Mécanisme
Profession – Accident de Travail ?
Main dominante
Vérification du statut vaccinal anti-‐tétanique
Heure de survenue, Heure de jeûne
ATCD médico-‐chirurgicaux / Allergies
TTT
-‐ Signes fonctionnels :
-‐ Douleur, sensation de craquement, impotence fonctionnelle
-‐ Examen physique
Schéma daté et signé + certificat médical initial descriptif
Examen bilatéral symétrique et comparatif
Constantes : TA, FC, SpO2, FR, T°C, Dextro, Hemocue si hémorragie + ECG
Inspection :
-‐ Attitude du traumatisé du membre supérieur / boiterie

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Etat cutané : fracture ouverte ? (classification de Cauchoix-‐Duparc), contusion cutanée à risque de nécrose
-‐ Déformation
Palpation :
-‐ Mobilité articulaire passive et active
-‐ Mobilité extra-‐articulaire
Recherche de complications immédiates :
-‐ Cutanées : fracture ouverte
-‐ Ostéo-‐articulaires : Plaie articulaire, Déformation
-‐ Nerveuses : sidération / section nerveuse
Test sensitivo-‐moteur en dessous du site fracturaire
-‐ Myo – Tendineuses : rupture tendineuse associée, syndrome des loges
-‐ Vasculaires : plaie artérielle / veineuse / hémorragie
-‐ Inspection : coloration
-‐ Palpation : temps de recoloration
3.2 Examens paracliniques -‐ Imagerie
Rx standard F/P du membre suspect
Description détaillée de la Rx et de la fracture
En cas de fracture complexe ou articulaire : TDM du membre concernée
Echo-‐doppler artériel en urgence en cas de doute sur une plaie artérielle
Electromyogramme si doute ou de référence sur une section nerveuse
Bilan pré-‐opératoire : Rx thorax Face

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Biologiques
Bilan pré-‐opératoire : NFS/plaquettes, Hémostase : TP/TCA +/-‐ INR, transfusion : groupage 2 déterminations/Rhésus/RAI si nécessaire, ionogramme sanguin, urée / créatinémie, glycémie,
3.3 Complications précoces -‐ Syndrome des loges : Ischémie tissulaire par interruption de la circulation musculaire secondaire à l’hyperpression des loges aponévrotiques créées par l’œdème et l’hématome.
Le diagnostic est clinique.
Douleurs insupportables dans les premières 24h à type de brûlures ou constrictives
Inspection : membre turgescent, main en crochet irréductible
Palpation : Douleur à la palpation des loges musculaires
Pouls périphériques présents, chaleur normale
Signes neurologiques : paresthésie puis hyperesthésie puis hypoesthésie
Fréquent pour le nerf fibulaire en jambe
PEC thérapeutique : Urgence chirurgicale
Aucun examen complémentaire ne doit retarder le diagnostic
-‐ Bivalver le plâtre
-‐ Hospitalisation en urgence avec transfert au bloc opératoire immédiatement
-‐ Traitement chirurgical
• Aponévrotomie de décharge des 4 loges au membre inférieur ou des 2 loges au membre supérieur
• Cicatrisation dirigée
-‐ Traitement médical : antalgiques, rééducation précoce passive et active, anticoagulation si mebre inférieur.
-‐ Surveillance clinique et paraclinique de l’efficacité et de la tolérance du TTT

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
-‐ Infection / sepsis sévère / choc septique
• Sur fracture ouverte le plus souvent
• Vérification du statut vaccinal anti-‐tétanique
• Antibioprophylaxie si plaie souillée
-‐ Choc hémorragique
• Transfusion CGR / PFC / Plaquettes si nécessaire
• Hémostase chirurgicale
-‐ Embolie graisseuse
Obstruction du réseau micro-‐circulatoire par des micro-‐gouttelettes lipidiques insolubles provenant de la moelle osseuse
Complication rare des fractures diaphysaires d’os longs (90%)
Examen clinique
Classiquement après un intervalle libre de 24-‐48h :
-‐ Troubles de la conscience pouvant aller jusqu’au coma
-‐ Détresse respiratoire sur OAP lésionnel pouvant aller jusqu’au SDRA
-‐ CIVD : purpura, hémorragies sous conjonctivales
Examens paracliniques
Imagerie :
-‐ Fond d’œil : Hémorragies rétiniennes en flammèche suivant les trajets vasculaires, Taches blanches cotonneuses, Œdème maculaire discret
-‐ Rx standard Thorax Face : après un temps de latence (J1), apparition d'un syndrome Alvéolaire diffus Bilatéral prédominant lobes supérieures (J2) puis d' image en tempête de neige d’Allred: opacités micro nodulaires allant de la périphérie vers les hiles avec bronchogramme aérien (J3). Enfin un syndrome interstitiel bilatéral apparait (J3-‐J14)
-‐ Scanner crânien : Œdème Cérébral diffus, foyers d’hypodensités dans la substance blanche.

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
Biologiques :
-‐ LBA : inclusion lipidique dans les macrophages
-‐ Gazométrie: Hypoxie +++ symptôme le plus précoce.
-‐ Troubles de la Coagulation: Thrombopénie, CIVD sans chute marquée du fibrinogène
-‐ Anémie Hémolytique
-‐ Perturbation du bilan lipidique: Baisse du cholestérol
Prise en charge thérapeutique : préventif +++
-‐ Immobilisation du foyer de Fracture précoce +++ dès les lieux de l’accident
-‐ Sinon TTT symptomatique
-‐ Crush syndrome = syndrome d’ischémie-‐reperfusion
Compression des masses musculaires responsable d’une ischémie avec lyse cellulaire et de troubles de la perméabilité membranaires à l’origine de l’accumulation de toxines (myoglobine, K+), de facteurs de l’inflammation et de radicaux libres et d’un œdème.
Lors de la reperfusion, le relargage de ces toxines dans la circulation sanguine systémique pourra être à l’origine de :
Troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque (hyperkaliémie)
Insuffisance Rénale Aigue Organique (IRAO) par Nécrose Tubulaire Aigue (NTA) suite à la précipitation de la myoglobine dans les tubules rénaux
Détresse respiratoire pouvant aller jusqu’au SDRA
CIVD
Syndrome des loges

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
4. Prise en charge et évaluation des complications chez un patient ayant une plaie des parties molles.
4.1 Examen Clinique -‐ Interrogatoire : Age, mécanisme (coupure, ecrasement, explosion), profession (AT?), main dominante, SAT-‐VAT, heure de survenue, heure de jeûne, ATCD médico-‐chirurgicaux / Allergies, traitements (antiagrégants – anticoagulants)
-‐ Examen physique
Constantes : TA, FC, SpO2, FR, T°C
Inspection :
-‐ Site de la lésion
-‐ Aspect de la plaie : Nette, Perte de substance, Sale, Punctiforme, Taille, Profondeur
-‐ Présence d’un corps étranger ?
Palpation :
-‐ Recherche d’une complication immédiate :
• Vasculaire : palpation des pouls périphériques (plaie artérielle ?)
• Nerveuse : Test de la sensibilité (pique-‐touche, chaud-‐froid) et de la motricité
• Tendineuse : Test des mobilités (rupture ?)
• Articulaire : plaie articulaire
Schéma daté et signé
4.2 Examens Paracliniques Imagerie : Rx standards F/P du membre si plaie par écrasement ou si doute sur la présence d’un corps étranger
Biologique : Bilan pré-‐opératoire : NFS/Plaquettes, TP/TCA +/-‐ INR, Ionogramme sanguin, Urée, Créatinémie + bilan inflammatoire si plaie suspecte : VS/CRP

Collegium GALILEO – Paris 6 / Paris 12 Département d’Enseignement Ostéo-‐Articulaire -‐ Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Université Paris Est – Créteil, Paris 12
ECN n°329
DEOA Paris 6
DEOA Paris 6
4.3 Prise en charge thérapeutique -‐ Hospitalisation en urgence en Orthopédie
-‐ 2 VVP si hémorragie importante
-‐ Retrait des bagues et bracelets
-‐ Appel Chirurgien orthopédiste et Anesthésiste
-‐ Vérification du statut vaccinal anti-‐tétanique
-‐ Transfert au bloc opératoire pour exploration sous AG ou ALR
• Recherche de corps étranger
• Recherche et suture de lésions des structures nobles : nerf, artère, tendon
• Ostéosynthèse d’une éventuelle fracture
• Débridement de la plaie/Parage/Lavage/Suture
• Immobilisation protectrice si suture d’éléments nobles 4 à 6 semaines
-‐ TTT symptomatique :
• Antibiothérapie probabiliste, à bonne pénétration cutanée, actif contre le staphylocoque doré et les BG négatif type Amox-‐Ac Clavulanique pendant 5j si plaie souillée, délai prolongé de prise en charge ou plaie articulaire
• TTT antalgiques : Palier OMS
• Rééducation précoce
-‐ Mesures sociales : Déclaration d’accident de travail si nécessaire
-‐ Arrêt de travail si profession alimentaire/santé
-‐ Certificat Initial Descriptif
-‐ Education : Prévention des récidives
-‐ Infirmières à domicile pour pansements et ablation des points à 10-‐15j
-‐ Surveillance clinique et biologique de l’efficacité et de la tolérance du traitement