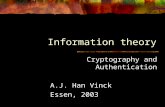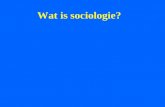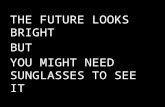Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
Transcript of Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 1/12
Slightly revised for :
Serge Proulx et Annabelle Klein (dir.). (2012) Connexion. Communication
numérique et lien social, Namur : PUN, pp. 39-48.
La sociologie des sciences aux prises avec les
infrastructures TIC
Dominique VINCK1
1 Professeur, Université de Lausanne, Labso, [email protected]
Résumé: L’intérêt de la sociologie des sciences pour les pratiques
concrètes de l’activité scientifique et technique et ses extensions sousla forme de réseaux sociotechniques conduit à s’intéresser aujourd’hui
au défi que constitue la fabrication de nouvelles infrastructures,
partiellement invisibles, qui, des laboratoires jusqu’aux traces
produites par les usages, façonnent l’assemblage d’un nouvel
écosystème.
***
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 2/12
Slightly revised for :
Serge Proulx et Annabelle Klein (dir.). (2012) Connexion. Communication
numérique et lien social, Namur : PUN, pp. 39-48.
La sociologie des sciences étend son regard aux pratiques et auxobjets
A ses origines, la sociologie des sciences s’intéresse aux conditions
sociales et historiques qui expliquent l’éclosion de la science en tantqu’activité légitime et valorisée dans la société. Elle montre la relative
symbiose entre des courants de pensée qui prônent un mode
production des connaissances ancré dans l’expérimentation et à
l’écoute de la nature et des valeurs éthiques et religieuses qui
valorisent les choses d’ici-bas. De la mise en évidence de cesrapprochements, la sociologie des sciences1 retient surtout la
conscience d’une dépendance de l’activité scientifique vis-à-vis de lasociété et la convergence des valeurs qui orientent les activités des
nouveaux savants. Avec Merton ([1942]1973), elle s’intéresse, en
particulier, à la structure normative (ensemble de normes) qui régit
leur comportement. Ces normes sont de deux types : 1/ les normes
éthiques qui portent sur les comportements professionnels ; 2/ les
normes techniques qui concernent les aspects méthodologiques. Les
premières apportent une caution morale aux secondes. La sociologie
des sciences analyse exclusivement les premières (l’Ethos de la
science). Prescriptions liées aux valeurs de l’institution sociale de lascience, ces normes ne sont pas codifiées, mais intériorisées. Il s’agit
donc d’impératifs institutionnels requis par la finalité de la science, à
savoir l’expansion continue des connaissances validées et certifiées
par les pairs. La sociologie des sciences porte alors son attention au
fonctionnement du collectif des savants à l’œuvre dans la fabrication
des connaissances (la communauté scientifique, les disciplines, les
réseaux sociaux) et aux modalités des communications entrescientifiques (principalement la publication des résultats et les
mécanismes d’évaluation par les pairs). En se focalisant ainsi sur la
communication et sur la normativité qui régit les relations entre les
membres de la communauté scientifique, la sociologie des scienceslaisse de côté les pratiques expérimentales (pourtant valorisées par les
normes sociales légitimant ce type d’activité), les normes techniques
(deuxième volet de la structure normative) et les formes concrètes de
1 Pour des présentations des courants de pensée qui traversent la sociologie des sciences, voir
Dubois (1999, 2001), Vinck (2007).
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 3/12
La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC 3
l’organisation du travail scientifique (modalités de la division du
travail, mécanismes de coordination, différenciation des rôles dont
celui de technicien ou d’assistant dont la littérature dit peu de choses).
De l’infrastructure des sciences, la sociologie analyse surtout la
structure normative, en particulier l’éthique qui régit le comportement
général des chercheurs, et le fonctionnement institutionnel de la
communication entre scientifiques et ses conséquences telle que la
constitution d’une stratification sociale et d’une méritocratie.
La sociologie des sciences se renouvelle dans les années 1970 par
des courants de pensée qui s’intéressent aux influences sociales et
culturelles qui pèsent sur la production des contenus scientifiques – etnon plus seulement sur la légitimité et la valorisation sociales de
l’activité scientifique en soi. Du coup, les sociologues, dans leurs
analyses, non seulement différencient, au sein des sciences, des sous-
groupes de chercheurs parfois en rivalité les uns par rapport aux autresquant à la définition des objets de recherche et des pratiques valides,
mais ils prennent aussi en compte d’autres groupes sociaux en
interaction avec les scientifiques. Ces groupes, au sein et en dehors de
l’institution sociale des sciences, agissent en fonction d’intérêts
cognitifs qui leur sont propres – vis-à-vis d’un type d’objet d’étude oud’une manière de l’étudier – mais aussi en fonction d’intérêts sociaux
ou professionnels liés aux investissements consentis dans le passé ou àdes appartenances sociales. Les structures alors prises en compte dans
l’analyse ne se limitent plus aux normes éthiques propres à
l’institution sociale des sciences et aux stratifications induites en
termes de reconnaissance scientifique puisqu’il s’agit cette fois de
prendre en compte les structures de la composition sociale au sein et
dehors des sciences. En outre, cette sociologie des sciences met en
évidence les relations étroites qui existent entre certains groupes
scientifiques (disciplines, sous-groupes de spécialistes, scientifiques
de générations différentes) avec certains groupes sociaux hors del’institution scientifique (notamment des mouvements sociaux, des
classes sociales, des Nations, des réseaux d’influence, des activités
socio-économiques, etc.). Elle prend également en compte les
dynamiques collectives de la production des connaissances, en
particulier les rivalités et les controverses scientifiques. La
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 4/12
4 Dominique Vinck
communication n’est plus de l’ordre de la circulation, de l’évaluation
et du partage des connaissances mais de la stratégie d’influence et de
conviction, du rapport de force jusqu’à la clôture éventuelle de la
controverse. Toutefois, la sociologie des sciences s’intéresse moins
aux lieux et aux formes concrètes de la controverse qu’aux rapports
sociaux sous-jacents aux arguments scientifiques en rivalité.
A la fin des années 1970, plusieurs sociologues vont ouvrir de
nouvelles voies de recherche en portant leur attention aux pratiques
concrètes de travail des chercheurs au sein des laboratoires. Il ne s’agit
alors plus d’expliquer les connaissances qui se fabriquent par des
appartenances sociales et par des controverses argumentatives mais derendre compte des manipulations d’échantillons, d’instruments et de
traces graphiques auxquelles procèdent les chercheurs pour faire
émerger des phénomènes, établir des faits et éprouver des énoncés.
L’observation située les conduit à produire quelques ethnographies delaboratoire qui rendent compte des ensembles d’humains, souvent
hétérogènes sur le plan des statuts (techniciens, chercheurs
théoriciens/expérimentateurs, directeurs de laboratoire, collaborateurs
externes) et des disciplines, et d’objets (instruments, supports
d’information, matériaux). L’infrastructure prise en compte n’est pluscelle des normes éthiques générales ni celles de groupes sociaux en
rivalité mais celle des bâtiments (salle de manipulation / bureau deschercheurs), du parc instrumental, de la logistique de transformation et
de gestion des échantillons et des matériaux, des flux de traces
graphiques et des transformations qu’elles subissent, ainsi que des
communautés épistémiques.
Le localisme de ces ethnographies de laboratoire ayant été critiqué,
y compris par certains protagonistes de ces approches, l’analyse s’est
alors étendue bien au-delà des portes du laboratoire, en suivant les
personnes (chercheurs, techniciens, étudiants, collaborateursnotamment) et les objets (articles, échantillons, instruments), y
compris les flux financiers et informationnels.
Ces évolutions et extensions de la sociologie des sciences ont
donné lieu à débats et commentaires de la part des sociologues eux-
mêmes qui y ont souvent vu des réorientations significatives – il s’agit
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 5/12
La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC 5
parfois de retours à de questionnements antérieurs –, qualifiées de
« tournants » : tournant social, tournant rhétorique, tournant matériel,
tournant sémiotique, tournant cognitif, tournant pragmatique, tournant
sociotechnique (« One more turn after the social turn » dit B.Latour),
tournant épistémique, tournant normatif, tournant réflexif (« Turn,
turn, and turn again » dit T.Pinch à propos de S.Woolgar).
Nouvelles articulations de la sociologie des sciences avec d’autresdisciplines et questionnements
Au cours des années 1990 et 2000, la sociologie des sciences s’est
ouverte à une série de questions visant à comprendre le sort des
productions scientifiques dans la société ainsi que les conditionsconcrètes de production de connaissances certifiées, non plus de
manière générale comme le fit Merton, mais sur des objets de
recherche et sur des questions spécifiques (par exemple, le dépistage
génétique, l’imagerie médicale, l’expertise en matière de risque
sanitaire ou industriel, la modélisation du climat). Le « Science,
technologie et société » devient « science et technologie dans la
société ». La sociologie des sciences s’intéresse aux controverses
sociétales portant sur des productions scientifiques et technologiquesou sur des affaires liées à ces activités (OGM, vache folle, sang
contaminé, nanotechnologies, etc.). L’attention des sociologues se
déplace alors des laboratoires vers l’espace public, celui du débat
politique, de la délibération et de l’expertise. Elle porte son attention
sur la question des dimensions éthiques et politiques soulevées par les
activités scientifiques et l’innovation technologique. Elle s’interroge
sur les processus de décision en matière de politique scientifique et de
régulation de l’inscription sociétale des innovations, en particulier surla question des conditions sociales de l’expertise, de la participation
du public en général ou de groupes sociaux concernés, des processus
de concertation et de la démocratie en matière scientifique et
technique. Elle soulève des questions portant sur la distribution et sur
la variété des savoirs au sein de la société et sur les modalités de leur
reconnaissance au sein de controverses et d’expertises collectives (par
exemple, l’étude des associations de patients et leur implication dansles dynamiques de la recherche biomédicale ou sur les institutions
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 6/12
6 Dominique Vinck
émergentes de la biodiversité). La sociologie des sciences retrouve
alors des questionnements portant sur les formes de régulation et de
gouvernance dans la société, en amont des politiques scientifiques et
industrielles et en aval dans l’introduction de nouveaux produits ou
procédés dans l’industrie, dans les institutions de soins et sur les
marchés. La question des modalités de la communication entre acteurs
dans la société redevient centrale non plus en termes d’influence à
sens unique de la société sur le développement des sciences ou des
sciences sur le progrès de la société mais dans le sens de délibération
entre acteurs multiples, certains émergents et imprévus, et souventstratèges (entreprises, ONG et agences de régulation multi- ou
supranationales). La question des infrastructures d’information et de
communication devient celle des conditions d’une conduite collective
des évolutions d’une société largement façonnée par des nouvelles
technologies qui supposent de grandes capacités à produire et à gérer
des masses connaissances nouvelles.
La sociologie des sciences, lorsqu’elle se penche encore sur le
travail des chercheurs, s’intéresse aux plateformes technologiques
(Peerbaye, 2004 ; Hubert, 2011), aux banques de matériaux et aux
énormes bases et réseaux de données. Elle se rapproche de l’examendes politiques scientifiques (orientation des masses financières qui
façonne le paysage scientifique) et de l’économie ou de la société dela connaissance. Ses questionnements croisent alors aussi ceux des
gestionnaires de l’innovation qui portent sur l’efficacité du processus
permettant d’articuler un continuum d’activités entre compréhension
des phénomènes, production de masse de connaissances robustes et
mobilisables dans la conception et la réalisation de nouveaux produits,
activité de conception, création de nouveaux usages et marchés,
invention de modèles d’affaire. L’activité scientifique, devenue
massive et support de l’innovation technologique et industrielle, se
trouve elle-même industrialisée, gérée avec des méthodes issues dumanagement des grandes entreprises (gestion de la qualité,
management des connaissances, gestion de la propriété) et organisée à
l’échelle des territoires (par exemple, avec la constitution de grands
pôles de recherche et de pôles de compétitivité industrielle).
Instrument d’une course au prestige entre Nations et institutions, elle
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 7/12
La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC 7
est sommée d’être efficace ce qui passe par de nouvelles formes
d’organisation et de management des chercheurs (traités comme
salariés d’organisations en compétition plus que comme savants
autonomes) et de leurs carrières et par de nouvelles pratiques et
instrumentations de l’évaluation. Cela conduit certains sociologues
des sciences à se rapprocher et à dialoguer avec les économistes et les
sociologues de l’emploi pour étudier les trajectoires professionnelles
et l’hybridation des carrières, mais aussi avec les géographes pour
comprendre les processus de territorialisation à l’échelle locale
(constitution de clusters), nationale (différenciation scientifique duterritoire) et internationale (rivalité entre grandes régions et nations
dont certaines montent en puissance, formes de fractures Nord-Sud
dans l’accès à la connaissance, formes d’interdépendances et
circulation des chercheurs et des connaissances).
Retour à la sociologie des pratiques scientifiques et techniquespour saisir la fabrique de nos nouvelles écologies
Les questions de la communication et de la non communication
sont devenues centrales et stratégiques. Des débats se sont fait jours
autour de la libre circulation et du libre accès aux connaissancesscientifiques qui ne sont qu’un frémissement visible à la surface des
remous qui agitent les réseaux institutionnels et commerciaux de
l’édition, de la diffusion, de la conservation, du traitement et de mise à
disposition des masses de connaissances scientifiques. Ce que cela
produit dans l’activité scientifique elle-même n’est encore que
marginalement étudié. Les outils classiques de la sociologie
institutionnelle héritée de Merton, de l’analyse relativiste des
controverses scientifiques, de l’ethnographie des laboratoires et desréseaux sociotechniques ou de l’analyse des formes de gouvernance
de questions scientifiques et techniques spécifiques semblent
insuffisants pour comprendre ce qui se produit.
Une analyse planétaire, si elle permet de repérer des tendances,n’est pas en mesure de comprendre la fabrication de ce qui se fait. Une
analyse « par le bas » reste incontournable tant il s’agit de comprendre
les nouvelles pratiques des fabricants et gestionnaires de bases de
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 8/12
8 Dominique Vinck
données et d’information scientifiques, d’agencements
sociotechniques inédits et de nouvelles pratiques scientifiques (par
exemple, le recours très généralisé aux activités de modélisation et de
simulation qui détrônent une part de la recherche expérimentale). Or,
rares sont devenus les travaux de sociologie des sciences qui portent
sur la fabrique de contenus scientifiques, sur des nouvelles pratiques
de recherche ou sur les nouveaux régimes de production de
connaissances. Tout se passe comme si la sociologie des sciences était
devenue une ressource mobilisée pour travailler dans différents
champs d’inscription sociétale des productions scientifiques ettechnologiques. Les sociologues étudient les sciences et les
technologies dans la société sans plus porter beaucoup d’attention à
leur fabrication dans les espaces protégés que sont les laboratoires, les
plateformes technologiques et les bureaux d’études. Autrement dit, la
sociologie des sciences étudie désormais moins les sciences que
l’insertion de ses produits dans la société, comme si la fabrique des
sciences était désormais suffisamment connue que pour ne plus
nécessiter d’y revenir. Or, le monde des sciences, ses organisations et
ses pratiques changent, ce qui nous invite à retourner voir ce qu’il en
est, ce qui se fait et comment. Par ailleurs, le monde des sciences est si
gigantesque et varié qu’on ne peut pas se contenter des quelquesbonnes ethnographies réalisées dans les années 1970-1980. Tout cela
appelle un renouveau de l’étude des sciences qui prennent en comptedes transformations à l’œuvre au niveau des institutions (évaluation et
gestion de la carrière des chercheurs par exemple), des formes
d’activité, des pratiques instrumentales et de modélisation, des formes
de rationalité, des interdépendances entre groupes de rechercherépartis dans le monde.
Une sociologie des nouvelles infrastructures sociotechniques en
train de se faire
Le défi scientifique est aujourd’hui d’apprendre à analyser ce qui
façonne nos nouvelles écologies à haute densité en technologies
discrètes, elles-mêmes liées à la mobilisation de masses de
connaissances scientifiques. Face à l’ampleur du phénomène, latentation est de procéder à des modélisations globales, à l’analyse de
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 9/12
La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC 9
tendances lourdes ou à l’analyse des institutions, approches qui
négligent tout le bénéfice d’une sociologie de l’action située et de
l’ethnographie des pratiques concrètes. Le problème est alors de
construire de nouveaux cadres d’analyse qui permettent de saisir des
phénomènes qui s’étendent loin (sans idée a priori de l’espace en
question) tout en n’étant jamais constitué que localement. Latour
(2006) introduit l’idée d’étudier les assemblages, la constitution
d’ensembles complexes, hétérogènes et étendus d’êtres reconfigurés
localement. Une telle approche devrait permettre de rendre compte des
assemblages comme autant d’achèvements relativement précaires, desordres de totalité signifiants et structurants qui prennent plus ou moins
la place d’autres institutions (marchés, Nation…) et dont il s’agit aussi
d’analyser la performativité in situ.
Parmi ces totalités locales étendues, ces achèvements structurants
précaires, les infrastructures méritent une attention particulière qu’ils’agisse des infrastructures invisibles (Bowker et Star, 1999 ; Star,
1999 ; Star et Ruhleder, [1996]2010) telles que les classifications
(infrastructures de connaissance qui supposent des opérations de
sélection et d’exclusion) ou des réseaux physiques (eux-mêmes liés à
des classifications invisibles et à des bases installées et plus ou moinsoubliées). La genèse, la stabilisation, la maintenance et la
transformation de ces infrastructures (travail d’alignement parfois prisen charge par des acteurs invisibles) constituent un fondement
partiellement invisible de l’action et de la coordination. La mise en
place d’une infrastructure conduit aussi à rendent invisibles et
silencieuses d’autres actants (non catégorisés), à rabattre les
singularités dans une catégorie standard, à rendre inconnaissable ce
qui n’est pas pris en compte et dont il n’est pas rendu compte
(accountable).
Les infrastructures de TIC notamment participent à la fabricationd’un environnement dense en technologies dont la sémiotique
matérielle se fait contraignante. En repartant des acquis de la
sociologie des sciences, il ne s’agit alors pas de les étudier avec uneentrée « communication » mais plutôt comme la fabrication de
nouvelles écologies sociotechniques au sein desquelles nous vivons. Il
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 10/12
10 Dominique Vinck
ne s’agit pas d’un « support » technique ou d’une ressource
instrumentale qu’utilisent les humains pour communiquer et agir. Il
s’agit d’une toile sociotechnique (dont le web n’est qu’un aspect) faite
de technologies qui communiquent même à notre insu, de contrats et
de lois qui tiennent plus ou moins les acteurs, de savoir-faire et de
routines incorporées. Nous sommes pris dans cette toile que
chercheurs, ingénieurs, marchands, usagers et régulateurs façonnent
volontairement ou par le seul fait d’y laisser une trace de son activité.
La fabrication et la prolifération des capteurs de toutes sortes (dont
ceux qui permettent la géolocalisation) est un exemple intéressant àétudier dans la mesure où elles insèrent toute chose (être humain et
autres êtres vivants, produits de consommation) dans un monde
d’ondes (portable, wifi, RFID…) et de flux de renseignements
(donnée, trace, information), fabriqué par des myriades de chercheurs,
d’industriels et d’usagers, qui produisent de l’interconnexion et des
barrières, de l’invasion et des protections, de l’intelligence ambiance
comme de l’automatisme sous-réflexif. Ce travail agrégé mais peut-
être pas concerté des ingénieurs, des marketeurs, des juristes, des
consommateurs, des chercheurs en sciences de l’information, des
mathématiciens, etc. est en train de produire une numérisation de la
planète. Aux flux physiques (eau, courants aériens et de pollution…)et informationnels hérités de la nature reconfigurée par des millénaires
d’occupation humaine et par les révolutions industrielles des dernierssiècles, nous sommes en train d’ajouter de nouveaux flux et de
nouvelles interdépendances qui passent par un travail d’équipement
des êtres (Vinck, 2011). Ce que chercheurs et ingénieurs fabriquent en
termes de capteurs, de bases de données, d’outils de traitement(modélisation, optimisation fonctionnelle de tout) est en train de
fabriquer de nouvelles convergences partielles (Miège et Vinck, 2011)
entre les infrastructures physiques et numériques. Ces convergences
vont souvent de pair avec la fabrication de nouvelles frontières,
divergences ou interfaces (Hubert et Vinck, 2011) ainsi qu’avec lamise sous silence de ce qui n’entre pas dans la nouvelle infrastructure.
Ce n’est alors qu’à travers les anomalies, les débordements et lestensions que le sociologue réussit à les déceler. L’ethnographie et le
suivi de la fabrication des infrastructures et de leurs ingrédients
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 11/12
La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC 11
devrait alors permettre de rendre compte de leur travail de mise en
forme.
La sociologie des sciences et des techniques se trouve face à un
nouveau défi. Celui qui consiste à étudier, sans rupture de continuité,
ce qui se fabrique en termes de renseignements et d’assemblages de
renseignements, depuis le travail des chercheurs sur l’assemblage des
atomes, financé par des politiques publiques industrielles, jusqu’à
l’usager qui trace des sentiers du seul fait de ses choix singuliers ouroutiniers. La fabrique du renseignement et son traitement, dans deslaboratoires, dans des services d’études de marché, dans des
associations de citoyens vigilants, dans les salles de fabrication des
ordres boursiers, devrait désormais être au cœur de la sociologie et de
l’anthropologie des connaissances.
Bibliographie
BOWKER G., STAR S.L., 1999, Sorting Things Out: Classification
and Its Consequences. Cambridge, MA : MIT PressDUBOIS M., 1999, Introduction à la sociologie des sciences et des
connaissances, Paris, PUF.
DUBOIS M., 2001, La nouvelle sociologie des sciences, Paris, PUF.
HUBERT M., 2011, Partager des expériences de laboratoire. La
recherche à l’épreuve des réorganisations, Paris. Editions des
Archives Contemporaines.
HUBERT M., VINCK D., 2011, La convergence entre logiciel et
matériel. Histoire de rapprochements et de mises à distance.
dans MIEGE B., VINCK D. (éd.), Les masques de la
convergence. Enquêtes sur sciences, industries et
aménagements. Paris. Editions des Archives Contemporaines.
LATOUR B., 2006, Changer de société. Refaire de la sociologie.
Paris, La Découverte.
7/23/2019 Vinck, D (2012) La sociologie des sciences aux prises avec les infrastructures TIC
http://slidepdf.com/reader/full/vinck-d-2012-la-sociologie-des-sciences-aux-prises-avec-les-infrastructures 12/12
12 Dominique Vinck
MERTON R., 1973 [1942], « The Normative Structure of Science »,
in MERTON R., The Sociology of Science, Chicago, University
of Chicago Press, p. 267-278.
MIEGE B., VINCK B. (éd.), 2011, Les masques de la convergence.
Enquêtes sur sciences, industries et aménagements. Paris.
Editions des Archives Contemporaines.
PEERBAYE A., 2004, La construction de l’espace génomique en
France : la place des dispositifs instrumentaux. Thèse de
doctorat, Ecole Normale Supérieure de Cachan.
STAR S.L., 1999, The ethnography of infrastructure, American
Behavioral Scientist , vol. 43, nº 3, p. 377-391
STAR S.L., RUHLEDER K., 2010 [1996], Vers une écologie de
l’infrastructure. Conception et accès aux grands espaces
d’information, Revue d’Anthropologie des Connaissances, vol.
4, n° 1, p. 114-161.
VINCK D., 2007, Sciences et société. Sociologie du travail
scientifique, Paris, A.Colin.
VINCK D., 2011, Taking intermediary objects and equipping work
into account when studying engineering practices, EngineeringStudies, vol. 3, n° 1, p. 25-44.