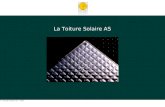Schuhl, Pierre-Maxime. L'Apollon Solaire (1974)
-
Upload
jeremyenigma -
Category
Documents
-
view
18 -
download
0
Transcript of Schuhl, Pierre-Maxime. L'Apollon Solaire (1974)

L'Apollon solaireAuthor(s): Pierre-Maxime SchuhlReviewed work(s):Source: Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, T. 164, No. 4, XÉNOPHANE(OCTOBRE-DÉCEMBRE 1974), pp. 508-509Published by: Presses Universitaires de FranceStable URL: http://www.jstor.org/stable/41091671 .
Accessed: 22/01/2013 14:29
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to RevuePhilosophique de la France et de l'Étranger.
http://www.jstor.org
This content downloaded on Tue, 22 Jan 2013 14:29:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

508 REVUE PHILOSOPHIQUE
l'agrément des programmes. Celui des solistes de l'orchestre de Berlin dut être modifié par suite d'une maladie du violoniste et de son remplaçant auquel se substitua un claveciniste. Je m'étais réjoui d'entendre la Sérénade en ré majeur que Beethoven écrivit à 14 ans et le Quatuor de hautbois de Pleyel. Mais l'on put entendre l'émouvant Trio en la mineur pour flûte, violoncelle et clavecin d'Antonio Vivaldi, dont le largo cantabile en parti- culier est si prenant ; l'exquise Sonate en si mineur pour flûte et basse continue de G. F. Haendel, où sept mouvements se succèdent allègrement - suivi en bis de sa bourrée. De Jean-Sébastien Bach la Suite n° S en sol majeur, pour violoncelle seul, dont la Sarabande fut répétée en bis, et la Toccata en ré majeur pour clavecin. Enfin une découverte : de Marin Marais, les Folies d'Espagne, pour flûte, clavecin et violoncelle - un petit chef-d'œuvre d'imagination et d'invention. Et tout cela dans la Salle des Chevaliers du château de Chillon, éclairée par les bougies d'une dizaine de candélabres. A la sortie, les cours sombres au pied du donjon en pleine lumière, tranchant sur le fond noir du lac et des montagnes.
Le 31 août, le quintette baroque de Winterthur avait présenté une récolte agréable et enrichissante. C'est ainsi que fut jouée une très belle Sonate en do majeur du flûtiste Devienne dont on connaît le très beau portrait que fit de lui Louis David ; mais dont on connaît moins la Sonate en do majeur intéressante entre autres par le rôle actif qu'il donne, dans l'ensemble, au clavecin, annonçant celui qu'allait recevoir le piano1. Signalons aussi le Quintette en fa majeur de Jean-Christian Bach (celui de Londres), et la mise en lumière de deux inconnus (de moi du moins !) : l'Anglais M. C. Festings, 1680-1752 (Trio en la majeur) et Johann Gottlieb Janitsch 1708-1763 (Sonata da Camera en ré majeur). On n'a jamais fini de découvrir le xvine siècle ! Ce concert avait lieu dans la Salle des Fêtes, construite en 1906 et récemment rénovée, du Palace, et c'était fort bien ainsi ; l'esprit de la douceur de vivre d'avant 1789 s'associe sans peine à celui de la « belle époque » d'avant 1914 ; et le rococo ne jure pas du tout avec le « modern'style », qui, au fond, en est une forme.
Parmi les à-côtés, signalons encore la remise du grand prix du disque à l'octogénaire Karl Böhm, auteur de célèbres enregistrements de Mozart, Richard Strauss, etc., et à deux ingénieurs, l'un Japonais, T. Inone, l'autre, Américain, Benjamin Bauer, inventeurs de la tétraphonie (je me refuse à employer, comme on fait ici, le mot barbare de quadraphonie !), perfection- nement de la stéréophonie.
1J.-M. ö.
L'Apollon solaire2 II n'est pas trop tard pour analyser une excellente étude dont il serait
dommage que les historiens de la philosophie ne puissent pas faire leur profit.
Il ne s'agit pas ici de la controverse classique sur les origines - orientales ou nordiques - d'Apollon, mais de son identification à Hélios, déjà connue
1. On sait que Devienne a passé les derniers temps de sa vie à la maison de Gharenton, comme Sarde. Les archives de l'actuel hôpital Esquirol à Saint- Maurice vous apporteraient peut-être d'excellentes indications sur la psycho- logie de cet excellent musicien.
t>. P. Boyance, L Apollon solaire, Melanges Carcopino, 1906, p. 119-1 70.
This content downloaded on Tue, 22 Jan 2013 14:29:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

CARNET DE NOTES 509
non seulement par Euripide, mais par Eschyle « comme le fruit de spécula- tions savantes w1. M. Boyancé pense que ces spéculateurs sont, plutôt que des orphiques, des pythagoriciens recherchant « l'unité de la tradition religieuse et des découvertes scientifiques, ici astronomiques »2, la vague désignation collective cachant une personnalité importante, celle d'Œnopide de Chios, l'astronome et mathématicien du troisième quart du 'e siècle connu pour sa découverte de l'obliquité de l'écliptique, par laquelle il aurait expliqué l'épithète de Loxias donnée à Apollon3. (Enopido serait également l'auteur d'interprétations de la voie lactée et des « parallaxes » du soleil faisant intervenir le mythe du festin de Thyeste et celui de Phaéton que mentionnent avec des préoccupations analogues Platon4 et Aristote5. Il aurait également fait intervenir le mythe de la chaîne d'or identifiée au Soleil, mythe cité dans le Cratyle, 413 b, qui connaît « le rôle cosmique d'Apollon » (p. 163).
Pourtant, contrairement aux interprétations données par Porphyre6 et par Proclus7, Platon juxtapose seulement Apollon et Hélios, qui ne seront identifiés que par Speusippe8.
Ainsi, dans la cité des Lois, les magistrats suprêmes (euthynoi) sont prêtres d'Apollon et d'Hélios ; c'est dans le temple de ces deux divinités qu'a lieu leur élection, chaque automne (« après l'époque où le Soleil passe des constellations de l'été à celles de l'hiver ») (945 e). L'un d'entre eux est élu grand-prêtre et devient éponyme « afin, dit Platon, de servir de mesure pour la supputation du temps »9 (p. 163).
C'est sans doute sous l'influence de telles doctrines que Philochore, purificateur et devin qui vivait vers 300 et mourut peu après 260, déclara, dans son traité Des Jours que « le premier jour du mois appartient à Apollon et Hélios »10.
Pourquoi Platon n'est-il pas allé plus loin dans cette voie ? Probablement parce qu'à l'influence d'Œnopide s'oppose celle d'un autre pythagoricien, Philolaos, qu'on a décelée dans le Cratyle11.
Reste à parler des Stoïciens, ou plus précisément de Cléanthe qui - sans attendre Posidonius - a fait du Soleil le siège de l'hégémonikon du Cosmos12. Comme nous l'a appris Cicéron, cette image nous ramène à une ambiance aristotélicienne et, par-delà Arisfote, par Empédocle, pythagoricienne.
Pierre-Maxime Sein; h l.
1. P. 154. 2. P. 157. 3. Source : Apollodore cité par Macroimî, No/., I, 17, 3 (Vors., 29, 7). 4. Timée, 22 c-d ; Politique, 269 e. 5. Météo, I, 3, p. 345 α 13 [Vors., 29, 10); cf. Mela, XT, Γ>, 1071 a 13 ;
Gen. Corr., II, 10, 336 α 31. 6. Macrobe, Sai., I, 17, 7. 7. Théol. plat., VI, 12. 8. Macrobe, Saturn., I, 17, 8. 9. 947 b μέτρον αριθμού του χρόνου (trad. Robin).
10. P. 164-165. Fragment 181, cd. R. Reitzenstein, Göll. Gel. Nachr., 1906, p. 40 sq.
11. V. P. Boyancé, La doctrine d'Euthyphron dans le Cratyle, H.E.G., 1941 (LIV), p. 155 sq.
12. Arius Didyme, Epil., 29, 7 (Dnx. gr., 465, 5) ; SI. Vet. />·., I, 499; Aet., Plae, II, 4, 16 {Dox. gr., 332, 23).
This content downloaded on Tue, 22 Jan 2013 14:29:29 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions