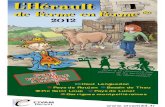pour la viande - campagnesetenvironnement.fr€¦ · grande ferme de France lors du Salon ... de...
Transcript of pour la viande - campagnesetenvironnement.fr€¦ · grande ferme de France lors du Salon ... de...
1
Quel avenir
pour la viande ?
La consommation de viande,
s’est aujourd’hui démocratisée,
car produite plus vite, en plus
grande quantité et à moindre
coût. Mais, cette augmentation
mondiale de la consommation
de viande, pose à la société des
questions nutritionnelles,
écologiques, économiques et
éthiques.
L’élevage, architecte de nos
terroirs
Chaque année, des dizaines de milliers
de visiteurs foulent le sol de la plus
grande ferme de France lors du Salon
International de l’Agriculture de Paris.
Et chaque année, vaches, cochons et
moutons restent l’attraction principale.
L’élevage demeure une tradition
française tenace, au point d’atterrir
dans nos écrans pour des émissions de
téléréalité. Hormis les élevages porcin
et avicole, de nos jours majoritairement
hors-sol (5 % de la production porcine
en plein air), les autres élevages
participent grandement à l’entretien
d’une mosaïque de paysages
mondialement
reconnue
faisant alterner
forêts, prairies,
cultures
séparées par
des haies
bocagères,
talus, murets ou
étiers. Et ceci
d’autant plus
qu’en Europe,
les herbivores
sauvages ont presque tous disparu, le
dernier bovidé sauvage ayant été tué
au XVIIème siècle en Pologne.
Les herbivores ont la spécificité de
pouvoir digérer et valoriser pour la
production de viande et de lait des
végétaux non comestibles pour
l’homme. Ils participent donc
pleinement à l’entretien de milieux
variés et au maintien de la biodiversité.
On estime ainsi aujourd’hui que 11
millions d’hectares de prairies
permanentes et 2,5 millions d’hectares
de parcours de montagne sont
entretenus par l’élevage, soit 20 % de la
superficie totale du pays. Mais, à cause
de l’abandon des prairies, ces chiffres
sont en baisse au profit de
l’urbanisation et des forêts.
L’élevage permet l’utilisation de
territoires très difficiles à cultiver en
raison de leur morphologie, de leur
climat ou de leur sol : sols caillouteux
ou arides, zones humides ou zones
montagneuses. Partout
sur notre planète, on
utilise cette capacité
des herbivores à
valoriser une
végétation spécifique,
des steppes d’Asie
centrale à la pampa de
Patagonie, en passant
par les savanes
africaines. Par ailleurs,
dans ces territoires,
l’élevage joue un réel
rôle de protection naturelle avec le
maintien de zones débroussaillées
pare-feux dans les régions au climat
sec, l’entretien des prairies rases contre
les avalanches en montagne ou
l’absorption de l’eau excédentaire par
les prairies. L’élevage est parfois la
seule activité économique de zones
naturellement défavorisées.
Du 4 au 6 juin 2012 se tenait à Paris le 19ème
Congrès Mondial de la Viande. Les professionnels du secteur de la viande venus du
monde entier ont pu débattre des problématiques actuelles liées à une filière agricole aujourd’hui largement décriée. Il s’agissait
de démontrer que la production de viande est utile à plus d’un titre, pour sa faculté à nourrir une population toujours croissante,
pour le maintien d’une économie agricole forte ou pour l’équilibre écologique des territoires ruraux. Quelle sera la place de la
viande dans l’alimentation humaine dans 50 ans ? L’élevage est-il une menace écologique forte pour la planète ? Comment
assurer le bien-être animal et la sécurité du consommateur ? Le choix de la France pour ces rencontres n’était évidemment pas
anodin, tant le secteur de la viande y tient une place importante et est porteur d’efforts pour fournir au consommateur une
viande sûre et éthique.
EDITO
Issu du monde rural et amateur de bonne
viande, il m’arrive de me poser la question
de ma légitimité à manger de la viande. Je
suis citoyen de la planète, amoureux de la
nature, futur vétérinaire mais aussi
omnivore et fier de nos traditions. Devenir
végétarien ? Autant arrêter de boire du lait
et de manger des œufs car on oublie bien
souvent que poussins et veaux mâles auront
la même influence sur le réchauffement
climatique s’ils ne sont utilisés à d’autres fins
comme la production de viande. Les éliminer
à la naissance serait une solution bien peu
sérieuse pour ceux qui critiquent la cruauté
de l’abattage. La projection de notre
anthropomorphisme et l’enfer du propre qui
régissent nos sociétés ne doivent pas faire de
la viande un aliment, sans goût et sans
variété. C’est le produit qui doit dicter la
production et non l’inverse. La
consommation de viande dans nos pays
industrialisés doit nécessairement diminuer.
Dans les pays en développement, la viande
est une solution formidable pour nourrir des
populations toujours croissantes. Nous ne
pouvons cependant pas oublier qu’une
agriculture non raisonnée court à sa propre
perte. Appuyons-nous sur les initiatives
d’avenir pour le respect des animaux, des
hommes et de la planète. On peut retenir ces
mots de Luc Guyau, président de la FAO, qui
après le Congrès International de la Viande,
n’hésitait pas à dire que « l’élevage est un
élément essentiel de la planète et de
l’équilibre alimentaire, quoiqu’on en dise. »
Mathieu Raffeneau
Troupeau dans le Champsaur, Alpes du Sud, par JM Gaude
Chiffres clés en France
19 millions de bovins de plus 25 races
7 millions d’ovins de plus de 30 races
1 million d’équidés de 43 races
25 millions de porcs de races sélectionnées (350 races dans le monde)
268 abattoirs
87,1 kg de viande consommée par an et par habitant
3
Pour cela, la France a su
conserver en petits effectifs des
races rustiques traditionnelles
adaptées à des conditions
d’élevage difficiles. Les mesures
de soutien à l’élevage mises en
place au niveau national et
européen vont dans le sens de la
sauvegarde des paysages liées à ce
secteur agricole. Ces races en
faible effectif, ces modes
d’élevage ainsi que leurs
productions respectives sont au
cœur de nombreuses traditions et
cultures très ancrées dans nos
territoires ruraux qui font le
charme de tout un pays et qui ont
permis l’inscription du repas
gastronomique français au
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO en 2010.
La filière viande est un secteur
économique qui a été plus ou
moins épargné par la crise. Se
passer de l’élevage mettrait à
mal l’économie de nombreuses
filières prospères et mettrait
ainsi en péril la situation
professionnelle de nombreux
salariés, des élevages aux
commerces de bouche en
passant par les industries agro-
alimentaires, avec une main-
d’œuvre soit très spécialisée,
soit très peu qualifiée, à la
reconversion difficile.
L’élevage, une usine à gaz ?
20 ans après le premier Sommet de
la Terre à Rio de Janeiro, une
nouvelle conférence internationale a
eu lieu en juin dernier au Brésil dans
l’espoir de prendre des mesures en
faveur de notre planète. L’agriculture
et en particulier l’élevage sont de plus
en plus décriés pour les menaces
qu’ils font peser sur l’équilibre
écologique de notre planète. En 2006,
le rapport de la FAO Livestock’s long
shadow avait fait beaucoup de bruit.
Pour autant, comme l’a récemment
affiché le géant de la restauration
collective Sodexo, manger un kilo de
viande pollue-t-il plus que 220 km en
voiture ?
Le secteur agricole est à l’origine de
13,5 % des émissions mondiales de
gaz à effets de serre (GES) et de 21 %
des émissions françaises et est le 1er
secteur émetteur si on lui associe la
déforestation (4ème
rapport du GIEC,
2007). L’agriculture est le principal
émetteur de certains GES comme le
protoxyde d’azote N2O (85 % des
émissions) et le méthane CH4 (80 %) à
cause surtout des
déjections animales et
fermentations entériques
des ruminants. Entre 1990
et 2008, ces émissions ont
baissé de 8 % en France et
de 21 % en Europe, grâce
à la diminution du cheptel
bovin et la rationalisation
des pratiques agricoles.
Dans les pays du Sud en
revanche, ces émissions
sont en forte
augmentation. Le
principal problème du
méthane et du protoxyde
d’azote est leur pouvoir
de réchauffement global
(PRG), qui mesure l’impact d’un gaz
sur une durée de 100 ans par rapport
au GES de référence, le dioxyde de
carbone CO2. Les PRG du CH4 et du
N2O sont élevés, respectivement de
25 (1 kg de CH4 a le même effet que
25 kg de CO2) et 298. Selon le Citepa
(Centre Interprofessionnel Technique
d’Etudes de la Pollution
Atmosphérique), en 2010,
l’agriculture est responsable de 48 %
des émissions de particules
atmosphériques. Les plus néfastes
d’entre elles sont responsables de
42 000 décès prématurés par an en
France l’OMS. Enfin, l’élevage
apparaît comme le premier émetteur
d’ammoniac à hauteur de 75 % via les
déjections animales, cause
d’eutrophisation des milieux.
Trois types d’élevages traditionnels français
Bœuf gras bazadais. Depuis 730 ans, le jeudi avant
mardi gras, la ville de Bazas (Gironde) fête ses
« Bœufs gras ». Elle voit défiler les plus beaux bœufs
de race bazadaise, avant la pesée et le passage
devant le jury. Photo : www.tourisme-bazadais.com
Mouton Mérinos d’Arles. Cette race est, depuis le
XVIIIème
siècle l’emblème de la transhumance, des
coussouls de Crau en Provence (dernière steppe
semi-aride de plaine en France) aux prairies alpines.
Cette production de viande (agneau de Sisteron) et
de laine permet l’entretien des paysages, grâce au
pastoralisme et au travail des bergers. Photo :
www.merinoscope2010.fr
Porc Noir de Bigorre. Ce porc de race gasconne des
Pyrénées centrales ne comptait qu’une trentaine
d’individus en 1981 avant de connaître un nouvel
essor local. L’élevage, très différent des productions
hors-sol, fournit une viande de qualité avec le
Jambon Noir de Bigorre et sa tradition de tranchage. Photo : www.lavignecoise.com
4
Ces chiffres sont légitimement
contestés, par les partisans et les
détracteurs de l’élevage. D’un côté,
on avance que les modes de
comptabilisation des émissions
varient selon les organismes et les
pays. De plus, on utilise des valeurs
moyennes d’émissions par tête de
bétail et on ne s’intéresse pas aux
facteurs de variation
alimentaires, raciaux et
zootechniques. De l’autre
côté, on affirme que ces
chiffres sous-estiment la
pollution réelle due à la
production de viande en
ne tenant pas compte
des rejets de l’industrie
agro-alimentaire. Et que,
malgré la très utile
fixation de carbone des prairies, les
manques de fixation dus à la
déforestation sont gigantesques.
Selon Greenpeace, pour libérer des
terres d’élevage et de cultures,
l’élevage est responsable de 80 % de
la déforestation amazonienne et de
14 % de la déforestation mondiale.
Pour Nicolas Hulot, « il est absurde de
nourrir le bétail européen à partir de
tourteau de soja brésilien participant
à la déforestation », surtout lorsque
des alternatives existent.
Aujourd’hui, on doit absolument
réduire ces émissions pour la santé
de l’Homme et de la planète. Une
conception raisonnée des bâtiments,
une conduite d’élevage réfléchie
(alimentation réduite en matières
azotées totales, température et
ventilation maîtrisées, litière adaptée,
densité animale réduite, temps au
pâturage augmenté), un stockage
couvert des déjections et un
épandage rapidement
enfoui permettent la
réduction des émissions
d’ammoniac. La
méthanisation
(production de biogaz à
partir de la dégradation
des coproduits d’élevage
par des micro-
organismes anaérobies)
permet la réduction des
émissions de GES avec production
d’énergie renouvelable. Son
développement est encouragé par
l’Etat, qui prévoit l’installation de
1300 unités d’ici 2020. Selon l’INRA,
l’incorporation d’huile de lin dans la
ration peut diminuer la production de
CH4 de 30 à 50 %. L’ajout de
légumineuses dans les prairies aurait
le même effet. En Australie, en 2004,
une ébauche de vaccin agissant sur le
microbisme ruminal a permis de
réduire la production de CH4 de 10 %.
Enfin, un rapport de la FAO datant de
2009 avance que convertir
l’agriculture mondiale en agriculture
biologique réduirait de 40 %
l’émission de GES tout en assurant
l’équilibre alimentaire mondial.
CO2 75%
N2O 12%
CH4 10%
Gaz fluorés
3%
Contribution des GES au PRG Source : Citepa 2008
“ Il est absurde de
nourrir le bétail
européen à partir de
tourteau de soja
brésilien participant
à la déforestation ”
Part des différentes activités dans les émissions de GES
agricoles Source : Citepa 2008
Sols agricoles 46 %
Consommation d'énergie
10 %
Déjections animales
18 %
Fermentation entérique
26 %
Unité de méthanisation à la ferme, Allemagne
Source : Réussir
Porcs, C. Pruilh
Elevage et environnement
20 % de la France entretenue par l’élevage
21 % des émissions de GES dues à l’agriculture
80 % de la déforestation en Amazonie liée à
l’élevage
Déforestation pour la culture de soja dans le Mato Grosso, Brésil
Source : Home, Yann
Arthus-Bertrand
5
5 besoins fondamentaux des
animaux d’élevage (Farm Animal Welfare Council, 1993)
Absence de soif, de faim, de malnutrition
Absence d’inconfort climatique ou
physique
Absence de douleur, blessure, maladie
Liberté d’exprimer un comportement
normal
Absence de peur ou détresse
Une maîtrise sanitaire et organoleptique, de la fourche à la fourchette
Le paradoxe entre l’élevage acteur
de la biodiversité et l’élevage
pollueur se retrouve à d’autres
niveaux. Nous consommons en 2010
en France 87,1 kg de viande par
habitant. Cependant, la viande fait
peur. Les crises sanitaires à répétition
(ESB, fièvre aphteuse) ont ébranlé la
filière. Les consommateurs sont de
plus en plus sceptiques quant à la
qualité des aliments qui leur sont
vendus. Pourtant, tout au long de la
filière, éleveurs, techniciens,
ingénieurs, industriels, commerçants,
vétérinaires et institutions s’assurent
de la qualité des viandes pour offrir
au consommateur un produit sûr,
nutritif et bon.
A la base de la filière, l’éleveur
exerce son métier comme une
passion. Jacques Giraudeau, éleveur à
Martinet (Vendée), élève 430 bovins
de race charolaise
au sein du GAEC La
Coutancière.
Comme 62 % des
élevages bovins
français il adhère à
la Charte des Bonnes Pratiques
d’Elevage, créée en 1999 et reconnue
comme première démarche « qualité
du métier d’éleveur ». Elle comporte
six engagements : traçabilité, santé,
alimentation, hygiène du lait, bien-
être des animaux et sécurité des
personnes et protection de
l’environnement.
Les passeports
bovins délivrés
par
l’Etablissement
Départemental
de l’Elevage ainsi
que l’Information
sur la Chaîne Alimentaire
transmise à l’abattoir sont garants
d’une traçabilité maximale. Le registre
d’élevage compilant données
médicales et zootechniques, le
respect des temps d’attente des
médicaments et les mesures de
prophylaxie sont vérifiés par le
vétérinaire sanitaire notamment tous
les 2 ans lors de la Visite Sanitaire
Bovine. Les rations alimentaires sont
basées sur des fourrages de type
herbe ou ensilage de maïs produits
sur l’exploitation et complémentées
de céréales, minéraux et oligo-
éléments. Les animaux restent le plus
longtemps possible au pâturage. Sur
les 135 hectares de l’exploitation, 65
sont occupées par des prairies
permanentes. Tous les bâtiments sont
conçus dans le respect des normes
d’hygiène, de bien-être des animaux
et de sécurité du personnel. Enfin, le
GAEC s’engage, via la charte, à limiter
l’impact de ses activités sur
l’environnement. Pour Jacques
Giraudeau, le développement de
nouvelles pratiques technologiques
aide à cette
limitation.
L’utilisation du GPS
permet un emploi
limité des
phytosanitaires. Un
projet de grand
bâtiment à toit photovoltaïque a été
abandonné pour des raisons
financières. L’installation d’une unité
de méthanisation n’est pour le
moment pas envisagée en raison de
son coût, de la nécessité de personnel
supplémentaire et de la trop faible
production de substrats organiques
sur l’exploitation. Pour Jacques
Giraudeau, la charte « ne fait
qu’officialiser les bonnes pratiques
qui étaient déjà réalisées dans
certains élevages, c’est un excellent
outil de communication ». Et qui peut
certainement inciter bon nombre
d’éleveurs aux mêmes pratiques.
De nombreux efforts restent encore
à fournir dans les élevages et
notamment dans les élevages porcins
et avicoles hors-sol où
industrialisation de la production et
respect du bien-être animal ne vont
pas toujours de pair. Ce sont les
élevages les plus critiqués par les
associations de défense animale plus
ou moins radicales comme L214 ou
l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes
d’Abattoir. C’est pourquoi de plus en
plus d’éleveurs se tournent vers des
labels et chartes de qualité imposant
un cahier des charges spécifique mais
augmentant la qualité des viandes
produites.
Porc 33,1
Bovin 25,8
Volaille 24,5
Ovin-caprin
3,4
Equidé 0,3
Consommation (kg/an/hab.) Source : SSP du MAAPRAT 2010
Passeport bovin (rose) et
Attestation sanitaire à délivrance
anticipée (vert)
6
La sécurité sanitaire des élevages et
donc celle des consommateurs est en
partie assurée par le vétérinaire
sanitaire, nommé par le préfet. Il
participe à l’épidémiosurveillance des
maladies réglementées (brucellose,
tuberculose, ESB…). Il est également
le garant de la bonne réalisation des
grandes opérations de prophylaxie
organisées par l’Etat via les DDPP
(Directions départementales de la
protection des populations) en
coopération avec les GDS
(Groupements de défense sanitaire)
et GTV (Groupements techniques
vétérinaires).
L’étape suivante, l’abattage, reste la
plus critiquée dans la production de
viande. Chaque année, un abattoir
bovin du Grand Ouest ouvre ses
portes aux élèves vétérinaires dans le
cadre de leur formation. En France,
tous les abattoirs sont agréés par les
Services Vétérinaires. Ils répondent
donc à des normes précises
d’aménagement pour garantir la
sécurité des viandes et la
bientraitance des animaux, normes
renforcées suite à la mise ne place du
Paquet Hygiène communautaire en
2006. Le terme de bientraitance,
traduction du welfare anglais est
utilisé pour les animaux depuis 2004
en remplacement du terme de bien-
être, quelque peu déplacé en
abattoir. Après un transport
réglementé, l’animal et son passeport
sont inspectés par un agent des
Services Vétérinaires. Seul un animal
identifié, propre et en bonne santé
peut être abattu. On lui attribue alors
un numéro d’abattage pour
permettre la traçabilité des carcasses
et abats rouges. L’animal est amené
par un couloir sombre et calme vers
un box de contention. Il est alors
rendu inconscient par choc frontal ou
courant électrique, même en
abattage rituel dans cet abattoir.
L’animal est alors immobilisé et
saigné par un technicien expérimenté.
La mort de l’animal est très rapide.
Selon l’EFSA (Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments), les spasmes
observés font partie des signes d’un
étourdissement efficace. Ils peuvent
aussi être des signes de Lazare
consécutifs à la mort et ne sont que
très rarement dus au réveil de
l’animal. La peau est ensuite retirée,
comme les viscères abdominaux
préalablement ligaturés pour éviter
toute contamination par des bactéries
telles qu’Escherichia coli puis les
viscères thoraciques. Une attention
particulière est portée au test ESB et à
l’aspiration de la moelle épinière
ensuite détruite. Les carcasses sont
pesées, classées (selon la
conformation musculaire et
l’engraissement) et estampillées puis
contrôlées avec les abats rouges par
un agent des Services Vétérinaires qui
repère les éventuelles lésions et retire
ces pièces de la chaîne dans l’attente
d’un contrôle officiel. La réfrigération
contrôlée évite tout développement
bactérien et garantit les qualités
organoleptiques (tendreté, saveur et
couleur) de la viande.
Entre l’abattage et
l’assiette, la viande passe
par des circuits plus ou
moins directs de
transformation. Au GAEC
La Coutancière, on a
notamment choisi de
mettre en place un système de vente
directe à la ferme. Cette démarche
lancée à la fin des années 90 a pris un
réel essor suite à la crise de l’ESB, le
consommateur ayant besoin de se
rapprocher du produit et du
producteur. Ce circuit court ne
concerne qu’une vingtaine de vaches
et une dizaine de veaux par an et
engendre de nombreux frais. Mais
c’est aussi un moyen de répondre au
souhait du consommateur et de
communiquer sur l’élevage, en
particulier lors d’une journée Portes
Ouvertes annuelle. Il s’agit de
répondre aux nombreuses questions
du consommateur et d’expliquer le
fonctionnement de l’exploitation au
travers de visites guidées.
La viande est un produit de grande
qualité nutritionnelle car apportant
de nombreuses protéines de hautes
valeur biologique, des vitamines
indispensables (B12), et des minéraux
tels que le fer ou le zinc, au contraire
de la plupart des végétaux. La viande
facilite donc l’équilibre des régimes.
Cependant, d’un point de vue
nutritionnel, cette consommation
devrait effectivement être réduite
dans nos pays développés à cause
d’un excédent de certains lipides.
Certains éleveurs
adhèrent à la démarche
Bleu-Blanc-Cœur pour
fournir des produits au
profil lipidique
rééquilibré. L’influence de
la surconsommation de
viande sur l’incidence du
cancer du côlon est
encore sujette à discussion. Certaines
associations préconisent une
« journée sans viande » par semaine,
journée statistiquement déjà réalisée
puisque le consommateur français ne
Visite guidée au GAEC La Coutancière
en 2010
“ Se passer
d’animaux pour
l’alimentation pose
un problème ”
7
consomme en général que 3 à 4
portions de viande par semaine. Dans
une interview accordée à l’association
TerrEthique, Daniel Tomé, professeur
à AgroParisTech et directeur de
l’unité mixte de recherche Physiologie
de la nutrition et comportement
alimentaire à l’INRA, confiait que « se
passer d’animaux pour l’alimentation
pose un problème […] C’est un choix
politique long à mettre en place ». Et
peut-être que d’ici là, l’élevage pourra
aider à nourrir les 9 milliards
d’habitants de la planète en 2050.
Bleu-Blanc-Cœur, une démarche qualité et nutrition
« Quand les animaux sont bien nourris, l’homme se nourrit mieux » C’est le slogan de cette filière créée en 2000, reconnue
par l’Union Européenne, permettant l’amélioration de la qualité des produits, lait, viande et œufs (plus riches en Oméga 3).
Elle se base sur une alimentation animale diversifiée grâce à l’apport à hauteur de 5 % de la ration de graines
naturellement riches en oméga 3 comme le lin, le lupin ou le colza produits localement. D’autre part, les 5000 adhérents à
cette filière améliorent la qualité de l’environnement par réduction de 12 % à 20 % des émissions de méthane (méthode
reconnue par l’Etat en 2011) et par diminution de l’apport de maïs ou soja OGM aux rations. La santé et la fertilité des
animaux sont également améliorées, tout en ne dépassant pas un surcoût de 5 % à la production pour les éleveurs
adhérents et un surcoût de 10 % pour le consommateur.