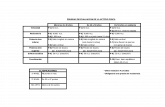nasledje19
-
Upload
feng-shui-redakcija -
Category
Documents
-
view
121 -
download
6
description
Transcript of nasledje19


Nas
le|e
19

Filolo{ko-umetni~ki fakultet KragujevacFaculty of Philology and Arts KragujevacFaculté des lettres et des arts, Kragujevac
GODINA VIII / BROJ / 19 / 2011
Year VIII / Volume / 19 / 2011
Année VIII / Volumen / 19 / 2011
^ASOPIS ZA KWI@EVNOST, JEZIK, UMETNOST I KULTURUJournal of Language, Literature, Art and Culture
Nasle|e19
Темат Наслеђа / Thematic issue of Nasledje / Numéro thématique
Говорити, писати, делати на француском
Speaking, writing, acting in French
Dire, écrire, agir en français

САДРЖАЈ

5
УВОД 9
НАУЧНИРАДОВИLaurent Bazin LaLittératureàL’estomac:pourunedidactiquedeLadétestation 19Jelena NovakovićLittératureetméLancoLie:LesauteursfrançaisdansLescahiersdenotesd’ivoandrić 29Pavle Sekeruš, Ivana Živančević-SekerušreprésentationiconographiquedessLavesdusud(1774–1849) 43Julien Roumetteromaingary,vercorsetLedeuiLdeLarésistance 55Katarina MelićsebaLdetmodiano,archéoLoguesdeLamémoire 67Ljiljana Petrovićtrauma,témoignageetdémystification-expériencedeLagrandeguerre:barbusseetmaLaparte 85Justyna ZychLaréceptiondeLapsychanaLysedansLemiLieudeLaNRF dansLesannéesvingtduxxesiècLe 95Marija Džunić-DrinjakovićJubiLationiconocLastedemarceLaymé 107Biljana Tešanovićbeckettetsarraute:àLarecherched’unnouveLartromanesque 119Ana LončarLa moRt d’odjigh demarceLschwob–réécritured’unmythe 131Ljiljana MatićbernarddadiéetL’inspirationdesrécitstraditionneLsafricains 143Elena DinevaL’imagedoubLedeLafemmevueparLeregarddeL’artiste(étudecomparéeduromanBruges-la-moRteetdeLapeinturedehansmemLing) 157Marjana ĐukićLapratiquedeL’antiromandansLesvieuxromans 165

6
Тamara Valčić BulićLes iLLustRes FRaNçaises(1713)derobertchaLLe:entretraditionetmodernité? 171Marija Panić entreLapurificationetLaputréfaction:L’eaudansLesbestiairesfrançaismédiévaux 181Zorana KrsmanovićLadameduLacetgaLadrieL:unéchomédiévaLdansLeseigNeuR des aNNeaux 193Jasmina NikčevićLesreprésentationsdeLacuLturegrecquede1780à1830 203Ivan RadeljkovićécLatementdansLapoésiemoderneauxixesiècLe215Henri BoyerpourunehistoiresocioLinguistiquedeLaLanguefrançaise.NoRmativisatioNetNoRmaLisatioNdufrançaissurLaLonguedurée 223Snežana GudurićL’expressiondeL’hypothèseenfrançaisetenserbe-unaperçugénéraL 235Mihailo PopovićLechamponomasioLogiquedu«transfertdepossession»enfrançais 247Veran StanojevićLaconJonctionquaNdetLesreLationstemporeLLesenfrançais 265Tijana AšićcommenttraduireLeseffetsstyListiquesetpragmatiquesdestempsverbaux?anaLyseduconte«periferiJskizmaJevi» devidosavstevanovićetdesonéquivaLentfrançais 281Dragana Drobnjak, Ana TopoljskatermesbotaniquesetzooLogiquesdansLefrançaisargotique 295Andrej Fajgelj, Jovana FajgeljLesserbismesenfrançais 303Jasmina Tatar AnđelićinfinitifsrégisparLesverbesdeperception:propositionssubordonnéesousyntagmesverbauxcompLémentsdeverbe? 315

7
Altijana BrkanétudeaérodynamiquedeLanasaLisationcontextueLLeenfrançaisetenbosnien 333Aleksandra StevanovićanaLysesémantiquedesexpressionsrégionaLesetdesmétaphoresdansLeromantestameNtdevidosavstevanovićetdanssonéquivaLentfrançais,Le PRéLude à La gueRRe 347Nataša Popović, Jelena MihailovićLapoLysémiedeLaprépositionfrançaisedaNsetseséquivaLentsserbes 355Vesna KrehoquiestLetraducteur? 367Irène Kristevadéformationsinconscientesentraduction 373Ana Vujovićapprentissageprécoced’uneLangueétrangère 383Claudine PontentrerdansL’écrit:recherchemenéeenmaterneLLe.LorsqueLesapprochesd’éveiLauxLanguesseconJuguentàceLLesdeL’enseignement–apprentissagedeLaLecture.queLquesrésuLtats. 395Yves Érard, Thérèse JeanneretduJournaLdeséJourcommeJeudemiroirdansL’apprentissaged’uneLangueétrangère 411Tatjana Šotra-KatunarićunespaceverbaLdethéâtreàdidactiser:Lecasdeionesco 429Biljana StikićL’acquisitiondufLeetLacompétencediscursive:surLamaîtrisedesgenresdiscursifsàL’oraL 445Ivona Jovanović, Aleksandar MilivojevićLaformationdesguides-interprètesaumonténégro-éLaborationd’unréférentieLdecompétences 453Isidora MilivojevićL’émergencedeL’inconscientdansL’appropriationdeLaLangueétrangère 465
АУТОРИНАСЛЕЂА

8

9
УВОД
Овајзборникчинерефератисаопштенинамеђународномску-пу„Говорити,писати,делатинафранцуском“одржаном22.и23.октобра 2010. год. на Филолошко-уметничком факултету у Кра-гујевцу.СкупјеорганизовалаКатедразароманистикуузподршкуУниверзитетауКрагујевцу,градаКрагујевца,СервисазасарадњуикултурнуделатностФранцсукеамбасадеуБеограду,сациљемдаповеженаставнике,истраживачеидокторандесаподручјаБалкана(посебносапросторабившеЈугославије),ФранцускеиШвајцарс-кекојисебавефранцускимјезикомифранцускомифранкофономкњижевношћу.
Квалитетиоригиналностовдесакупљенихтекстовапотврђујудаунашојсредини јошувекпостојиврложивоинтересовањезафранцускијезик,наставуфранцускогјезика,каоињегову«одбра-нуислављење»итопресвегапутемлингвистичкихикњижевниханализа.Напоменимодасморадовеподелилиудвегрупе:књижев-нирадовиилингвистичко-дидактичкирадови.
Књижевнаистраживањапосвећенасуписцимакојиприпадајуразличитимепохамаиземљамаалипресвегасеодносенасавре-менефранцускеауторе:такосеЖ.РуметинтересујезадваписцаизпериодаОтпора, РоменаГаријаиВеркора, који су, суочени садруштвено-историјскимзбивањимапослератногпериода еволуи-ралиусвомкњижевномстваралаштву,створившиновепацифис-тичкеформеборбе,иреформисали својидеализамучинивши гауниверзалним.ИстраживањеновихформијетакођетемачланкаБ.ТешановићкојасебавиСемјуеломБекетомиНаталиСарот,каоиМ.Џунић-ДрињаковићкојаанализирастилскипоступакМарселаЕмеакојиобнављакраткуприповедачкуформуузевшијезаосно-вицусвојехумористичнепрозе.
Ј. Зих интересује рецепција психонализе у средини НовогФранцускогЧасописа,докА.ЛончарусвојојанализироманаМар-селаШвоба Ођингова смрт разматрауметничкооживљавањејед-ногамероиндијанскогмита.
Уовомзборникунијезаобиђенанифранкофонакњижевност.ТакоЉ.Матићуказујенаважносттрадиционалнихафричкихпри-повести у делу Бернара Дадијеа, док Е. Динева, истичући значајсликарствауконституисањуипотврђивањубелгијскогидентите-

10
та, упоређујеживоти стварање једногписца, Роденбахаи једногсликара,Мемлинга.
Истаклибисмоовдејошједнузанимљивуствар:средњовеков-накњижевност,иакодалекапотемамаисензибилитету,привуклајепажњунеколикоученикаовогскупа:М.Ђукићиспитујепосту-паканти-романаустаримроманима,чланакН.Панићбависемо-тивом воде у средњевековним француским бестијариумима (xiiиxiiiвек)доксеЗ.КрсмановићопределилазаупореднуанализуглавнејунакињеЛанселота у прозиихероинеТолкиновогГоспода-ра прстенова.
Т.ВалчићБулић,испитујућиреализамиприродно,тебавећисеполифонијскомструктуромједногроманакојијебиоомиљенуЕвропитокомцелог18.века–Чувених ФранцускињаРобераШалаоткриваулогуовогделаурађањумодерногроманауФранцуској.
Рецимосаданештоорадовимакомпаративистичкогкаракте-ра:Ј.Новаковићзанимасезастраницепосвећенемеланхолијикојеналазимокоднеколикофранцускихписаца(Дидро,Нервал,Фло-бер,Блоа),акојејенашнобеловацИвоАндрићпреписаоусвојимбелешкамадабимупослужилеууметничкомизражавањусопстве-них осећања. К. Мелић пореди два савремена аутора, ФранцузаП.МодијанаиНемцаw.Г.Зебалдакојиусвојимделимапонируупрошлост,доводеупитањеИсторијуињенузваничнуверзијукакобиуказалинапропусте,заборавеиизвитоперенеинтерпретацијетеистеИсторије.Љ.ПетровићусвојојанализиБарбисовогиМа-лапартовог романа показује да је истовремено неопходно путемуметинчкепрозеговоритиотраумионихкојисупреживелиПрвисветскирадалиидемистификоватиодређенесликекојевезујемозатуепоху.
Поезијатакођеимасвојеместоуовомзборнику.И.Радељко-вићулазиусржфранцускогпесништва19.века,чијасерадикалнамодерностиоргиналностуодносунасвештојојјепретходилоза-сниванапринципураспрскавања.
РадП.СекерушаиИ.Живанчевић-Секерушпосвећенјеико-нографскимпредставамаЈужнихСловена(1774–1849),докчланакЈ.НикћевићописујепроменеупредстављањуСтареГрчкепочеводпериодаПросветитељствадоепохеРомантизма.
Најзад, Л. Базен поставља вечито и незаобилазно питање сакојимсесусрећусвипрофесорикњижевности,питањеулогеииз-боралитерарнихделаупредавањуфранцускогјезикакаостраног
У другом делу ове књиге налазе се радови посвећени линг-вистичкој,дидактичкојитрадуктолошкојпроблематици.Иакосу

11
напрвипогледтемеипруступиврлоразнородникрозсвестудијепровлачисезаједничканит:одредитииописатијезичкефеноменекојипредстављајуизазовзасвекојижеледанауче,предајуианали-зирајуфранцускијезик.УправојеовапотребаоваплоћенаурадуА.Боаје-акојиразматраодносизмеђуспонтаногразвојафранцускогјезикаисоциолингвистичкенормативизацијеинормализације.
Највећи број радова је посвећен семантици, како лексичкој,тако и пропозиционалној. Теме које су привукле научну пажњуучесникаовог зворника суименовањеконцепта трансферапосе-довања(М.Поповић),стандарднеинестандарднеупотребепред-логаdans (у) (Н.Поповићи Ј.Михајловић)иизражавањереалне,потенцијалнеииреалнехипотезе(С.Гудурић).Напоменулибисмодачланакозоолошкимиботаничкимтерминимауфамилијарном,популарномижаргонскомрегиструфранцуског(Д.ДробњакиА.Топољска),каоирадА.ФајгељаиЈ.Фајгељосербизмимауфранцу-скомјезикуудијахронијскојперспективи,залазеуграничнопод-ручјеизмеђусоциолингвистикеисемантике.
Сличнутенденцијудасеуанализијезичкихчињеницапрева-зиђе строго и једносмерно испитивање значења и потребу да сезађеудругеобласти–овогапутауподручјепрагматике–показујуирадовиТ.АшићиА.Стевановић:првиодњихбависестилистич-кимефектимаглаголскихвременаунарацијиадругифункцијомметафореууниверзумуфикције.
Занимљивоједајесинтаксипосвећенсамоједанрад-уњемусе на дескриптивистички начин представљају инфинитивне кон-струкције које зависе од глагола перцепције (Ј. Татар-Анђелић).Фонетикајепредметистраживањасамоједногодучесникаконфе-ренције:А.Брканиспитујеаеродинамикуназалности.
Напоменимодавећинурадоваодликујекомпаративниприступ:ауториполазеодидеједаћелингвистичкисистемфранцускогјезикабољедефинисатииобјаснитиуколикогаупоредесаструктуромсвогматерњег језика.И традуктолошкаистраживања у овомЗборникуследеистипринцип (В.Крехо,И.Кристева).Процеспревођењасепосматранесамокаопросторсусретаиразменеизмеђудвајезикавећикаопољестварањаиуништавањајезика.
Рецимонајзаддасвидидактичкирадови(К.Пон,И.ЕрариТ.Жанре,А.Вујовић,Т.ШотраКатунарић,И.Миливојевић,И.Јова-новић,А.Миливојевић,Б.Стикић)сведочеодвемаамбицијама:а)оправдативажностпопуларизацијефранцускогјезиканасвимни-воимашколовањаиуниверзитетскогобразовања;б)створитинове

12
методезаусавршавањеимодернизацијунаставефранцускогјези-ка,којаисамапостајекреативничиниуметничкаигра.
Свеусвему,текстовиобједињенинаовомместупоказујудаје,дабисебардонеклеспозналоиобјаснилочудојезикаусвимњего-вимманифестацијама(одкојихјекњижевностнајузвишенија),не-опходнопоћиодразличитих,честосупротстављених,приступаитеорија.Атематскеитеоријскевезепрвогидругогделаовекњигеињиховонепрекиднопрожимањеученасданаукаокњижевностинаукаојезикунемогуопстатиједнабездруге.
Нашајежељадаовајзборникпостаневишеодсведочанстваоједномизузетноуспеломнаучномскупу,дабудепозивфилолозимадаусвојимистраживањиманепрекидноинеуморноповезујујезикињеговустваралачкуистворитељскуупотребу.
Искористимоовуприликуданапосебанначининтерпретира-моједнумисаовеликогфранцускогписцаМарселаПруста,параф-разирајућињеговеречи:
Захваљујући уметности и науци, уместо да видимо један свет, овај наш, ми посматрамо мношто светова у настајању и колико год да има оригиналних уметника и научника, толико нам светова стоји на располагању, различитијих међу собом но што су делови васионе.
(М. Пруст, Нађено време)
Уреднице: Катарина Мелић, Тијана Ашић

13
cevolumeréunitunesélectiond’articlesfaisantsuiteauxcommu-nicationsprésentéesaucolloqueinternational«dire,écrire,agirenfran-çais»quis’esttenules22et23octobre2010àlafacultédeslettresetdesartsàkragujevac.ce troisièmecolloquedesétudes françaisesenser-bieaétéorganiséparledépartementd’étudesromanes,aveclesoutiende l’universitédekragujevacetduservicedecoopérationetd’actionculturellede l’ambassadedefranceàbelgrade,avecpourbutderéu-nirleschercheurs,enseignantsetdoctorants,travaillantdanslesbalk-ans(notammentdanslespaysissusdel’ex-yougoslavie),enfranceetensuisse,ets’intéressantàlalanguefrançaiseetauxlittératuresfrançaiseetfrancophone.
Laqualité et l’originalitédes contributions réuniesdansce recueilconfirmentque,dansnotrerégion,ilexistetoujoursunintérêttrèsvifpourlalanguefrançaise,sonenseignementainsiquepoursa«défenseetillustration»àtraverslesanalyseslinguistiquesetlittéraires.nousavonsregroupélesinterventionsendeuxsections:rechercheslittérairesetre-chercheslinguistiquesetdidactiques.
Lesrecherches littérairesontportésurdesauteursdesièclesetdepays différents. elles sont surtout centrées sur la littérature françaisecontemporaine:J.roumettes’intéresseàdeuxécrivainsdelarésistance,romaingaryetvercors,qui,suiteauxévénementssocio-historiquedel’après-guerreontévoluédansleurcréationlittéraireetimaginédesfor-mesnouvellesetpacifiquesdelutte,lesconduisantàrefonderleuridéa-lismesurdesbasesplusuniverselles.Larecherchedenouvellesformeslittérairesaétéaussil’objetdel’intérêtdeb.tešanovićdanssonarticlesursamuelbeckettetnathaliesarrauteetdem.džunić-drinjakovićquianalysecommentmarcelayméarenouvelélaformenarrativebrèveenmettantaucentredesesrécits,lerire.J.zychs’intéresseàlaréceptiondelapsychanalysedanslemilieudelaNouvelle revue Française, tandisquea.Lončarappliquedanssonanalyseduromandemarcelschwob,La mort d’odjigh,laréécritured’unmytheamérindien.
Lalittératurefrancophonen’apasétéoubliéepuisqueLj.matićdé-montre l’importance des récits traditionnels africains dans l’œuvre debernarddadié,alorsquee.dineva,ens’appuyantsurleconstatdel’im-portancedelapeinturedanslaconstructionetl’affirmationdel’identité

14
belge,focalisesonattentionsurlamiseenparallèled’unromancier,g.rodenbach,etd’unpeintre,h.memling.
fait intéressant quenousprenonsplaisir ànoter: la littératuredumoyen-âge a suscité l’intérêt d’un certain nombre de chercheurs.m.djukićinterrogelapratiquedel’antiromandanslesvieuxromans;l’ar-ticledem.panićtraitede laprésencede l’eaudans lesbestiaires fran-çaismédiévaux(xiieetxiiiesiècle)cetarticletraitedelaprésencedel’eaudans lesbestiaires françaismédiévaux (xiie etxiiie siècle) etz.krsmanovićquisepenchesurlareprésentationdesdeuxfiguresfémi-ninesimportantesdansleLancelot en proseetdansleseigneur des an-neauxdetolkien.t.valčićbulić,enétudiantleréalismeetlenaturel,lastructurepolyphoniqueduromanàsuccèseuropéenpendanttoutle18esiècle,les Illustres Françaises,derobertchalles’interrogesurlerôledecetteœuvredanslanaissanceduromanmoderneenfrance.
L’approchecomparatisteestaurendez-vous:J.novakovićexaminelethèmedelamélancoliechezquelquesécrivainsfrançais(diderot,ner-val, flaubert, bloy) qui ont influencé le prixnobel serbe, ivoandrićdansl’inscriptiondesapropremélancoliedansl’écritureetlalittérature.k.melićs’intéresseàdeuxauteurscontemporains,l’unfrançais,p.mo-diano,l’autre,allemand,w.g.sebaldquidansleursœuvresenquêtentsurlepassé,s’interrogentsurl’histoireetsareprésentationofficiellepouressayerdedirelesoublis,leslacunesetlesoblitérationsdecettemêmehistoire.Lj.petrovićtraitedelanécessitédemettreenrécit letraumadesauteursayantparticipéàlagrandeguerre,toutcommedubesoindedémystifier,danslalittérature,lesimagestrompeusesdecetteguerreenanalysantlesromansdehenribarbusseetdecurziomalaparte.
Lapoésien’estpasoubliéepuisquei.radeljkovićseproposedelirel’histoiredelamodernitépoétiquedanslalittératurefrançaiseduxixesiècleàtraverslanotiond’éclatement,quiaabouti,audébutduxxesiè-cle,àlacréationd’unepoésieradicalementdifférenteparrapportàcelledusiècleprécédent.
p.sekerušeti.Živančević-sekerušs’intéresseàlareprésentationico-nographiquesdesslavesdusudentre1774et1849,alorsqueJ.nikčevićesquisse,danssonarticle,lamutationdesreprésentationsdelagrècedusiècledesLumièresauromantisme.
et, finalement,L.bazinposedans sonarticle, laquestionde l’en-seignementdesœuvreslittérairesdanslecadredesclassesdefrançaisLangueétrangère(fLe)etduchoixdecesmêmesœuvres,questionàlaquelletoutenseignantdelittératureaétéconfronténeserait-cequ’unefois.

15
venons-enauxarticlesconsacrésàla linguistique, ladidactiqueetlatraductologie.malgréladiversitéapparentedessujetsetd’approches,ontrouvedanscesétudesunepréoccupationcommune:détermineretdécrirelesphénomèneslangagiersprésentantundéfipourtousceuxquiveulentapprendre,enseigner,décrireetcomprendrelalanguefrançaise.cebesoinest égalementexprimédans la contributiond’henriboyerquitraitelarelationentrel’évolutionspontanéedufrançaisetlesphéno-mènesdenormativisationetdenormalisationsociolinguistiques.
Lagrandemajoritéd’articlesportentsurdesproblèmesdelaséman-tique, soit lexicale, soitpropositionnelle.parmi lesquestionsabordéesfigurentl’expressionduconceptdutransfert de possession (m.popović), lesusagesstandardetnon-standarddelaprépositiondans (n.popovićet J.mihajlović), l’interactiondes instructionsprocéduralesdes tempsverbauxetdelaconjonctionquand (v.stanojević), l’encodagedel’hypo-thèseréelle,potentielleouirréelle(s.gudurić).notonsquel’étudesurlestermeszoologiquesetbotaniquesdanslefrançaisfamilier,populaireetargotique(d.drobnjaketa.topoljska)ainsiqueletravaildea.fa-jgeljetJ.fajgeljsurlesserbismesenfrançaisdansuneperspectivedia-chroniquesontàmi-cheminentrelasémantiqueetlasociolinguistique.cettemêmetendancededépasserledomained’étudestricteetpuredusensetdeselancerdansledomainedelapragmatiqueestobservéedanslescontributionsde t.ašićeta.stevanović,danslesquellessontanaly-sés,respectivement:lerôledesmarqueurspolyphoniquesdansl’échangeconversationnel,leseffetsstylistiquesdestempsverbauxdanslanarra-tionetlafonctiondesmétaphoresdansl’universdelafiction.Lasyntaxen’estpasoubliée:yestconsacréunarticleportantsurl’analysedescripti-vistedesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception(J.tatar-anđelić).Laphonétiquen’asuccitél’intérêtqued’unseulauteur(a.brkan)quiapportesacontributionàl’étudedel’aérodynamiquedelanasalité.
ilestàsoulignerquelamajoritédescontributionspartentd’uneap-prochecontrastiveetcomparative:lesystèmelinguistiquedufrançaisestmieuxsaisietdéfinipartantdesdifférenceentrecelui-cietlalanguema-ternelle des contributeurs.cette dualité est également abordée dans lestravauxportantsurlatraductologie(v.kreho,i.kristeva).Leprocessusdelatraductionestvunonseulementcommeunespacederencontreetd’échangeentredeuxlangues,maisaussicommeunchampdecréationetdedestructionlangagière.
finalement,lestravauxendidactique(c.pont,y.érardett.Jean-neret, a. vujović, t. Šotra katunarić, i. milivojević, i. Jovanović, a.milivojević,b.stikić)révèlenttousunedoubleintention:a)dejustifier

16
l’importancedelapopularisationdufrançaisauxniveauxdifférentsdescolaritéetd’éducationuniversitaire;b)decréerdenouvellesméthodespourperfectionneretmoderniserl’enseignement,quidevientlui-mêmeunespacedecréationetdejeuartistique.
Lescontributionsréuniesdanscevolumemontrentbienque,pourrendrecomptedumiraclequiestl’existenced’unelanguedanssesfor-mesmultiplesdemanifestation(dontlalittératureestlaplusnoble),ilestindispensabledeproposeretdeconfronterdesapprochesetdespointsdevuedifférents.enmêmetemps,ilestimportantdecomprendrequel´histoireet la théoriede la littératured´unepartet la linguistiquedel´autrenepeuventpasetnedoiventpassepasserl´unedel´autre.puis-secerecueilêtrecomprisaussicommeunappelaurapprochementdecesdeux facesd´unmêmephénomène,deceluidu langageetde sonusagecréatifetcréateur.nouspouvonsàjustetitreparaphraser marcelproust:
grâce à l’art et grâce à la science, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a d’artistes et de cher-cheurs originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini.
(Marcel Proust, le temps retrouvé)
les rédactrices: Katarina Melić, Tijana ašić


НАУЧНИ РАДОВИ

19
УДКрад
Laurent Bazin université de versailles saint-quentin-en-Yvelines
LA LITTÉRATuRE à L’ESToMAC: PouR uNE DIDACTIquE DE LA DÉTESTATIoN
il n’est pas aisé d’aborder uneœuvre littéraire dans le cadre d’uneclasse defLe.questionde générations, d’abord: tout enseignant auraconstaté le décalage entre son enthousiasmepour les vertus du patri-moinelittéraireetl’apparenteindifférencequesoulèveparfoissonpro-pos.questiondecontexte,ensuite:caràladistanceculturelles’ajoutelabarrièrelinguistiquequiredoubleladifficultéd’appréhenderuneœuvreperçuecommeétrangetoutautantqu’étrangère.Laquestionestdesavoirsil’onchoisitdesesatisfairedecetétatdefaitousil’onpeuttirerpartidurejetaffichéparcertainsétudiants.L’objetdecetarticleestainsideprendreausérieuxcequedétesteruneœuvreveutdireetcequ’onpeutenretirer,dudoublepointdevuelinguistiqueetlittéraire.celaconsisteàglisserdel’expressiondesaffectsàlaconsciencedesphénomènes,doncdelapsychologieàl’épistémologiepourendéduireunethéoriedelalit-tératurepartieprenantede l’acquisitiond’une langue; en sommeà es-quisserquelquespistesenfaveurd’unedidactique de la détestation.
Mots-clés:didactique,littérature,lecture,critique,jugement,récep-tion,subjectivité,interprétation
«On ne sait si il y a une crise de la littérature, mais il crève les yeux qu’il existe une crise du jugement littéraire.»(gracq1949:11)
«moij’aime,maismesprofsdétestent»:voilàunephrasequ’iln’estpasrared’entendredanslescoursdelycéeoulescouloirsd’université.en-tendresesétudiantsparlerdesœuvresqu’ilsaiment,c’estsouventécou-terunlongchapeletdetitresempruntésàdesgenresauxquelsl’enceinteacadémiqueneconfèrepas laplusgrandenoblesse: romansà l’eauderoseouàl’encrenoiredesthrillers,histoiresdevampiresoudesorciersetmêmemangas.L’inversen’estpasmoinsvrai,etchacund’entrenousaurafaitaumoinsunefoisdanssavieleconstatdésabusésinonamerdudécalageentre l’enthousiasmede l’enseignantsoucieuxdeconvertirsesouaillesauxvertusdupatrimoinelittéraireetl’apparenteindifférence

Bazin L.
20
voirelerejetaffichéquesoulèveparfoissonpropos.Laquestionestdesavoirsi l’onchoisitdesesatisfaired’unétatdefaitquisanctionneunincontestablefossédegénérationaggravéchaquejourparlesmutationsdessociétéscontemporaines,ous’ilyaquelquechoseàfairedecettepri-sedeconsciencedouloureuse-quitteàmettreledoigtàl’endroitmêmeoùçafaitmal.aprèstout,lesexplicationsfranchesvalentmieuxquelesdialoguesdesourdsetongagneratoujours,plutôtqu’àprêcherdansledésert,àsecolleteravecleprincipederéalité.
encore faut-il décider alors, une fois résolude s’attaquer de frontauproblème,dequelle façonons’yprend.car ilne s’agitpas,oupasseulement,des’enteniràunepédagogiebienveillantemâtinéed’unbrindecomplaisancequiconsisteraitàrecueillirreligieusementlecahierdedoléancesoudepréférencesdesonauditoire.nonpasqu’unetelleap-prochesoitdépourvuedetoutepertinence,bienaucontraire:ladidac-tique des langues, par exemple, a intégré depuis longtemps les vertusde l’approcheparcompétenceset faitsienne,depuis lesactesdeparo-lesduNiveau seuiljusqu’auxcompétencesdecommunicationduCadre commun de référence, les activités d’expression basées sur l’oppositionj’aime–j’aimepas.outrequ’ellepermetsimultanémentdes’approprierlespropriétéssémantiquesetsyntaxiquesdel’expressionaffective,ellealeméritedepartirduressentidel’apprenantet,neserait-cequ’àceseultire,justifiequ’oncontinuedel’exploiterensituationd’apprentissagedetoute langue étrangère.mais ce qui nous intéresse ici n’est pas tant ladidactiquedeslanguesquecelledelalittérature,quandbienmêmelesdeuxauraientpartie liée.notrepropos estdoncd’unautreordre,quiconsisteàprendreausérieuxcequedétesteruneœuvreveutdireetcequ’onpeutenretirersurlaspécificitémêmedufaitlittéraireetlanaturedesfaitsquisontenjeu.celaconsisteensommeàglisserdelapsycho-logieà l’épistémologieetde l’expressiondesaffectsà laconsciencedesphénomènes;dumoinsest-celamodesteambitiondecetteprésentationqued’esquisserquelquespistesenfaveurd’unepareilledidactiquedeladétestation.
oncommenceraparrappelerl’utilitédecommencertoutcourssurla littératureparunemiseencommun,sinonunemiseàplat,desre-présentationsdechacun.untelpréambulenoussembleallerdesoi,neserait-cequepourceseulmotifquelaLittérature,précisément,nevaja-maisdesoi.aussin’est-iljamaisinutilederappelerquelaplacedulitté-raire,danslasociétéengénéraletdansl’enseignementenparticulier,estlerésultatd’unecombinaisonentredifférentsparamètresdontl’interac-tionconstruitdansladuréedesconceptsetdesoutilsproposésenhori-zonderéférenceauxpublicsconcernés.cettecombinatoires’organiseen

La littérature à l’estomac: pour une didactique de la détestation
21
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
-28
équilibresplusoumoinsstablesselonlapondérationrespectivedesescontributeurs: l’institutionlittéraire,organiséeautourdesprocessusdediffusion éditoriale et de légitimation critique; l’enceinte universitaire,adosséeàunedoublerechercheenthéorielittéraireetendidactiquedelalittérature;l’institutionscolaire,enfin,avecdesenseignantsécartelésentrelesorientationsdelarechercheetlesperceptionsdeleursélèves–cesderniersétanteux-mêmestributairesdansleursreprésentationsdesévolutionsdelasociété.orcephénomènecomplexe,quifaitévoluerlechampaugrédesrapportsde forceentre lespartiesprenantes, tendàêtreoccultépar lepoidsde la traditionet lapropensiondesprescrip-teursàpassersoussilenceleprocessusdelégitimationquiinstitueuneœuvreentantquelittéraire.ilenrésulteuneapprocheessentialistedelaLittérature,présentéeàlafaçondestableauxdemuséeoùl’encadrementdestoilesfaitoublierletravaildel’atelier;exemplifiéestantôtdansleurdétail,danslecasdesanthologiesoudesmanuels«àlaLagardeetmi-chard»,ettantôtdansleurtotalité,notammentdanslescollectionsditesde«classiques»,lesœuvresseretrouventinsidieusementpanthéoniséesettoutlepoidsdelaculturedominanteconsistealorsàsusciterenfaced’ellesadmirationsinonadoration.L’enjeun’estpasmince:exigerlarévé-rencesanscontrepartie,c’esteneffetcourirlerisqued’unealtérationduregardcritique;quandonn’apasd’autrechoixquedelirepourargentcomptant,onenfinitbienviteparabdiquertoutjugementpourseréfu-gierdansl’oppositionfrontale.
JuliengracqaremarquablementmisenlumièrecephénomènedanssontrèsvirulentpamphletLa littérature à l’estomac,publiéaulendemaindelasecondeguerremondialemaisdontl’acuitén’arienperdudesaper-tinenceaupointdepouvoirpassermotpourmotpourunechroniqueaffûtéedenotretemps.L’auteurypasseaucribled’uneplumevitrioléelesmœursd’unesociétédeslettresinféodéeàlafoireauxprixdesren-trées littéraires,montrant les effetsperversdecette survalorisationdel’événementéditorialdoubléed’uneobsessionsacraliséedelachasseaugrandécrivain.pourtant,rappellegracq,toutesituationdelecturede-vraitcommenceraveclaconjonctiond’ungoûtetd’uneopinion:
placéentêteen têteavecuntexte, lemêmedéclic intérieurqui joueennous,sansrègleetsansraison,àlarencontred’unêtrevaseproduire[chezlelecteur]:il«aime»ouil«n’aimepas»,ilest,ouiln’estpas,à son affaire. (gracq1949:19-20)
or, l’institutionnalisationdevaleurs littérairescotéesà la façondevaleursfiduciairesetlephénomènedepanthéonisationculturellequilasous-tendtendentàinduireundésengagementdulectoratdéchudesondroitàl’opinionparl’intimidationperformativedelacritiquelégitimée:

Bazin L.
22
sidélibérémentquenouscherchionsànousnettoyerlesyeuxenfacedenos lectures,àne tenircomptequedenosgoûtsauthentiques, ilyauntributpayéauxnomsconnusetauxsituationsacquisesdontnousnenousdébarrasseronsjamaiscomplètement.(gracq1949:34-35)
Le pamphlétaire conclut sur cette observation aussi pertinenteaujourd’huiqu’ellel’étaitàlasortiedel’opuscule:«onnesaitsiilyaunecrisedelalittérature,maisilcrèvelesyeuxqu’ilexisteunecrisedujuge-mentlittéraire.»
cediagnosticsansconcessionn’estpassansévoquerlaformulela-pidaireetguèremoinscaustiqued’unJulesrenard:«qu’est-cequ’uncri-tique ?un lecteurqui faitdes embarras» (renard2002).onpourraitcroiredansl’unetl’autrecasàdesmouvementsd’humeur;enfaitlafor-cedetelspropostientjustementàcequ’ilsréhabilitentl’humeurcommeélémentconstitutif,sinonpremier,duregardcritique-voiredufaitlit-téraire.carenrappelantledroitimprescriptibledetoutlecteurd’aimer,maisaussidedétesteruneœuvre–brefledroitdefairedesembarras,lesdeuxpolémistesproposentaufondunerevalorisationdu«goûtin-time» quiestpourgracq «cequifondeenvéritélesouvragesdel’esprit»(gracq1949:32).ilyalàuneintuitiongénialequianticipelesréflexionslespluscontemporainessur leprincipede littérarité.cequifait la lit-térature,cequienconstitueleprocessusenacteetnonplusseulementl’inventaireenlivres,c’estd’abordetavanttoutcetterelationprivilégiée,etchaquefoisunique,quis’installeentreunregardetuntexte,dansl’al-chimiedécisivequis’opèreentreuneœuvre,ungoûtetpuisuneopinion.Lagrandeoriginalitédudiscoursgracquienestensommedeporterengermedès1949lesprémissesdelarévolutioncoperniciennequiaréin-vestilaquestiondulecteuraucœurmêmedel’expériencelittéraire,ens’appuyantsurlesacquisdelapsychologiecognitive,delaphénoméno-logiedesreprésentationsetdesesthétiquesdelaréception.
dans ce courant de recherche qui conduit de Jauss et iser (Jauss1974;iser1985)àpicard,rouxelougervais(picard1986;rouxel2004;gervais2007),onminorelespositionshistoriquementetculturellementdominantesdel’auteuretducorpuspourleurpréférerunevalorisationdel’actedelecture,faisantainsiglisserlecurseurdelalecturedestexteslittérairesàlalecturelittérairedestextes.danscettenouvelleconfigura-tion,laLittératuresedéfinitmoinscommel’émanationd’unsujetcréa-teur antérieur au processus de transmission que comme l’action d’unsujetlecteurplacéàl’autreextrémitéduspectreetdontl’investissement(affectifet/ouintellectuel)vadonnersensàl’ensembledudispositifaugrédecequ’ilestaujourd’huiconvenud’appelerlalecturesubjective,ouencore lecture créative. plutôt que la remontée rétrospective vers une

La littérature à l’estomac: pour une didactique de la détestation
23
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
-28
genèsemythiquesinonmystiquedel’œuvre(sonsensousonessence),onprivilégiecettefoislarencontreaposteriorientrelefaitetl’affect,en-trelereprésentéetleressenti.onretrouvel’héritagedel’anthropologieculturelle (durand 1960): l’identité d’un sujet lecteur se constitue parcontaminationentreuneimagination(c’est-à-direlacireencoreviergedepossiblesenattented’actualisation)etun imaginaire(soit lemuséedesmotifsindividuelsetcollectifseninstancederéalisation).Lire,àcet-teaune,n’estdoncpastantlafonctiond’interprétationquinouspermet-traitderetrouverlasignificationd’unlivreoulasilhouettedesonauteurquel’interactionpsycho-affectiveetréflexivequ’unindividuentretientaveclui-mêmeetlesautresparactedelecture.pourledireautrementlepremierdéclencheurdelittéraritéseradésormaisàchercherdansl’ordreduprojetdelecture,qu’ilfaudraitdésormaiscomprendresurunmodegérondif, comme le rappelle cet autre titre célèbre de la bibliographiegracquienne -en lisant en écrivant (gracq1980).cetteprojectiongé-rondivequidénietouteprépondéranceauxintentionsd’auteurenleursubstituantle«champdeforces»del’imaginationprojectiveestàinter-prétersurunmodeinverséparrapportauxprésupposésquiinstituaientlarelationaulittérairecommehéritageettransmission;cequ’onpouvaitautrefoisconcevoircommeunethéoriedumodèle(c’estenlisantqu’onrencontredesécrivains)procèdeicid’unepratiquedumodelage(c’estenlisantqu’onsefaitécrivant,parl’actedelecturequ’onfaitadvenirlefaitd’écriture).
en somme, prôner le droit à la détestation, ce serait au fondunefaçonpasmoinspertinentequ’uneautre,etpeut-être stratégiquementplushabile,derappelerquelaLittérature,c’estd’abordetavanttoutunphénomène vivant plutôt qu’un corpsmort ou qu’un corpus fossilisé.c’estinduireunchangementdepostureenfaced’œuvressouventhon-niesparcequed’abordimposées:lireuneœuvre,cen’estpasseulemententrerdedans(quecesoitdanssadiégèseoudanssonesthétique);c’estaussi luirentrerdedans,autrementdit secolleteravecelle; c’estassu-mersesémotionsetsesimpressionspourcomprendrepourquoietcom-ment cetteœuvreparticulièreme toucheoume rebute; c’est au fonds’engagerdanssarelationauxtextespourendemanderraison.unetelleposition lectorale, qu’illustrent par exemple le «droit au bovarysme»(pennac1992:9)ouencorela«lecture-braconnage»(decerteau1980:292),présente lemérited’être immédiatementopératoirepour les lec-teursendifficulté;maisellen’estpasmoinsvalidejusquechezdeslec-teurs«confirmés»auprèsdequielleexemplifielesprincipesdel’illusionréférentielle et de la participation psycho-cognitive à la constructiondetoutediégèse.encorefaut-ilapprendreencecas,d’abordàprendre

Bazin L.
24
consciencedesphénomènesenjeu,ensuiteàenprendrelamesure;c’estàcetteconditioneneffetqu’onparvientàdépasserlestadeprimitifdesaffects et à basculer d’une pratique psychologisante de la spontanéitéimmédiateàunemédiationréfléchiesurleprincipedelittérarité.aussiest-ilindispensable,aussitôtvalorisél’investissementpsycho-affectifdulecteur (par empathieouparantipathie),d’enclencherunmouvementde distanciation qui permette de dépasser le premier degré (du texte,maisaussidusujet).basésurl’analysedesdiscours,unteltravailper-metdecorrélerdesémotionssubjectivesà l’observationdesvirtualitésdutexte; confrontersesaffectsaveclesfaitset leseffetsdutexte,c’estalorsexploiterpulsionsetimpulsionscommeautantd’intuitionsdelec-turedestinéesànourrirlacomplémentaritédeslecturesheuristiquesetdeslecturesherméneutiques(riffaterre1983:95-96).
cevaetviententreparticipationetdistanciationestbienconnuenpédagogie,oùilrecoupelespratiquesdel’ancrageetdudésancrageouencoredelacontextualisationetdeladécontextualisationàtraversles-quelslesdidacticienss’efforcentd’impliquerl’apprenanttoutenlefaisantévoluer.c’estpourquoionnevoudraitpasacheverceplaidoyerenfaveurd’unerevivificationdelalecturesansévoquerquelquespistespratiquesd’exploitation en contexte scolaireouuniversitaire. si certainesde cestechniquessontdéjàconnuesdesenseignants,ellesnesontpeut-êtrepaspourautantpratiquéesdefaçonsystématisée;ornousplaidonsquantànouspourl’intérêtqu’ilpeutyavoiràregrouperdetelsoutilsdansunparcoursorganiséconduisantinsensiblementdel’expressioninitialedesopinions,fûssent-ellesdesplushostiles,àlaprisedeconscienceassuméede la complexitédesphénomènes considérés.onpartirapar exempled’untourdetabledesréactionsàuneœuvredonnéepourpermettreàchacundefairevaloirsapropreposition,sansstigmatisernicondamnerapriorilesjugementsénoncés.onélargitledébatenyajoutantlepointdevuedel’universdeslettres:onferanotammentappelauxpolémiquesquiagitenttouterentréelittéraire,etquiintriguentd’autantplusvolon-tierslesétudiantsqu’ilsydécouvrentdescélébritésetdes«profession-nels»fairecordialementétatdeleursdétestationsréciproques;auxtribu-nauxdel’histoirerésolumentpassésàcôtéd’uneœuvrevilipendéehieretencenséeaujourd’hui(baudelaire,flaubert…);enfinauxjugementsdespairssureux-mêmes,enparticulierdanslessailliesredoutablementacidesquedesauteursrévérésadressentparfoisàd’autresauteursnonmoins vénérés.car l’onne saurait sous-estimer la jubilation, pourunétudiantrétifàl’écriturenaturaliste,d’apprendrequ’unzolaétaitdétestéaussibienparunvictorhugo(«tantqu’émilezolan’aurapasdépeint

La littérature à l’estomac: pour une didactique de la détestation
25
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
-28
complètementunpotdechambreplein,iln’aurarienfait»)ouunLéonbloy(«messiedelatinetteetdutorche-cul.vieilletruelleàmerde»).
untelrecoursàlascatologien’estjamaisqu’unevariationculturelle-mentlégitiméesurlelangagequotidiendenosétudiantsfrançais(«zola,çamefait….»);maisilestaussibienplusqueceladèslorsqu’onsepiqued’en tirer les leçons.car l’affront entre auteurs ennemis estune situa-tiontrèsriched’enseignements:d’abordparcequ’ilparticipedel’histoireculturelleenpermettantderappelerque la jouteoratoireconstitueungenreàpart entière caractéristiquedepériodesdont il aideàdégagerlaspécificité;ensuiteparcequ’ilpermetdemettreenévidencelesmo-dalités rhétoriquesde l’insulte et, plus généralement, de tout discoursàfinalitépolémique(cequiestunacquis linguistiqueetsémiologiqueprécieuxdansunmondeoùl’injurecontaminelesécrivainscommelespoliticiens);enfinparcequ’ilenclencheuneréflexionsurlarelativitédespointsdevue, laréciprocitédes jugementset lapropagationdesposi-tionscritiques.ontirerapartidecettedécouvertedécisiveenamenantles étudiants à s’en approprier lesmodes de fonctionnement: ainsi ensuscitant dans l’enceinte académiquedes cercles de lecture, ou encoreenrejouantàl’échelled’uneclasselesdiscussionsetdécisionsquipréva-lentàl’attributiond’unprixlittéraire:goncourtdeslycéensouprixdesétudiants.carenseretrouvantenpositiondejurychargédedéfendreauprèsdesespairs lavaliditédeseschoix, l’apprenantnepeutplussecontenterd’un«j’aime»ou«jedéteste»dont ilcomprendviteque leurvirulencenesuffirapasàluigagnerl’approbationdesespairs;maisquec’est seulementdans le déploiementd’une argumentation irriguéeparsonprojetdelecturequ’ilsepositionneraàsontourenamateurdelivresautantquecommecritique.
mais ilyaplus.car l’examenattentifdes formesde ladétestationconstitueégalementunlevierpour(r)entrerdansl’œuvreetapprendreàylire,pardelàlesaffectsqu’onchoisitd’yaffecter,lesmodalitésd’uneécrituredont onprend consciencepar celamêmequi en est critiqué.c’estcequerappelleavecfinesseJuliengracqlorsqu’ilévoqueledédainaveclequelonpeutparlerd’uneœuvre:
Lorsquenouslaissonstombernégligemment[…]«c’estbiendux...»ou«duy...»,unetendanceinstinctivesesatisfaitparlààpeineconsciemment,quiestdefairereparaîtrel’essencepermanentesousl’apparenceaccidentelle,d’enappelerdelasingularitéconcrèteetparfoisdéroutanted’uneoeuvreàunesortedenoumènedel’écrivain...»(gracq1949:41)
encesensfaireanalyserauxétudiantshilareslesraisonsquijusti-fientcetteobsessionscatologiquedanslespamphletsanti-zolan’estpaslafaçonlamoinspertinentedemettreenlumièrel’undesversantsd’une

Bazin L.
26
œuvreplacéesouslesdoublesauspicesdel’éjectionsocialeetdeladéjec-tionpsychique.demêmelorsqu’unJulesrenards’enprendàstéphanemallarméetleprétend«intraduisible,mêmeenfrançais»(renard2002),n’est-ilpasjustemententraindemettreenexerguel’essencemêmed’unepoétiquevouéeàladéconstructiondulangageordinaire?Lorsqu’ildé-nie àmaupassant tout talent descriptif («maupassantn’observepas: ilimagine laréalité.cen’estencorequede l’à-peu-près»idem),nedon-ne-t-ilpasuneclédelectured’unegrandefinessepourappréhenderlafacerésolumentfantastiqued’unauteurtropsouventréduitàl’aunedesonseulréalisme?onlevoit,ilyabeaucoupàtirerdel’insulteetdupamphletdèslorsqu’onycherchel’espritpardelàlalettre.aprèsl’hu-meurvientl’analyse,etdanscemouvementquireliel’affectetlaraisonseconstruisentuneopinionetungoût,prérequisdetoutjugementcri-tique.c’estpourquoiongagneraàexploitercesformesdelasatirequesont laparodieouencore lepastiche,autresexemplesdedéformationgrossissanteàlafaçond’uneloupe.étudierdespastichesexemplaires,encomparerplusieurspourunemêmeœuvreouencorefaireécriresuruntextedonnéunbilletd’humeurvoireuneattaqueenrègle,c’estsouventl’unedesplussûresfaçonsdefairetoucherdudoigt laspécificitéd’unstyle,l’idiosyncrasied’unevoixetl’originalitéd’uneécriture.
ilseraitdonchâtifdepenserquelerecoursauxposturesd’opposi-tionet,plusgénéralement,l’exploitationsystématiséedel’investissementaffectifdu lecteurrelèved’unseulsoucidedémagogie.nousconsidé-ronsquantànousqu’ilparticiped’uneffortauthentiquedepédagogieetqu’àcetitreilconstitueunevraiestratégieéducativequimobilisel’étu-diantnonseulementdansl’acquisitiondeconnaissancessurlesœuvres,maisaussidans laconstructiondesapersonnalité, individuelleautantquecollective.carenacceptantdepartirdesreprésentationsdesesap-prentis-lecteurs,quandbienmêmeelless’énonceraientsur lemodedeladétestation,onremonteàlasourcedecequifondetouteexpériencelittéraire,àsavoirenpremierlieularencontreentreuneœuvreetunesubjectivité et, dans la foulée, la combinaison des réactions ainsi dé-clenchéesdansune communautéd’appartenanceoù se joueunprojetdelecturesinondesociété.Lireavecsestripes,d’abord;puisspéculersursesreprésentationspourengarderlesucsansenêtrelevalet;enfinsupputer à l’aunedes jugements d’autrui ce qui confirme, ou infirme,sonpropre regard critique. s’installe alors une relation systémique aulittéraire,dansunjeud’allersetretoursentrecequiyattacheetcequiendétache,entrel’émotionneletl’intellectuel,entreadhésionetmiseàdistance: l’appréhensionde l’œuvreestvécueà travers le filtrecritiqued’unesensibilitéquis’assumepleinemententouteconscienced’elle-mê-

La littérature à l’estomac: pour une didactique de la détestation
27
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
-28
me,danslajouissancedesaconsommationimmédiatecommedanssestentativesanalytiquespourenmédiatisersesimpressions.untellecteurestaufondunadultequigrandirait toutengardantsonâmed’enfant,tirantuneaussifortejubilationdel’investissementaffectifgarantedesavieintérieurequedelamaturationrationnellequigarantitsoninscrip-tiondanslavraievie.
préconiserlalecturesubjectiveestpeut-êtreensommelepréambuleincontournabledetouteréflexionsurlaconstructiondel’être-à-soi-mê-meetdel’être-pour-autrui;dulireensembleautantqueduvivreensem-ble.montrerquelalittéraritéd’uneœuvrenaîtdelarelationdialectiqueentreunesubjectivité,première,et lacommunautédes individus,pri-mordiale,me semble en effet une façon ouverte et très démocratiquederappelerque la littératureet leregardqu’onportesurelleengagenttouteunevisiondumonde,uneidéologieetmêmeunchoixdesociété.dès lors la prise de consciencepar les étudiants de la complexité desparamètresenjeuestpeut-êtrelaconditiondeleurentréedansl’universdescommunautésd’interprétation.quiditesthétiquedugoûtditaussiéthiquedelaresponsabilité:iln’estjamaisinutiledelerappeleràl’heurede lablogosphère,de lasurmédiatisationdesopinionsprivéesetde lasocialisationgénéralisée.
Bibliographie
decerteau1980:m.decerteau,L’invention du quotidien,paris:gallimard.durand1960:g.durand,Les structures anthropologiques de l’imaginaire,pa-ris:p.u.f.gervais2007:b.gervais,r.bouvet,théories et pratiques de la lecture littéraire,québec:pressesdel’universitéduquébec.gracq1949:J.gracq,La littérature à l’estomac,paris:Josécorti.gracq1980:J.gracq,en lisant en écrivant,paris:Josécorti.iser1985:w.iser,l’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique,bruxelles:mar-daga.Jauss1974:h.-r.Jauss,Pour une esthétique de la réception,paris:gallimard.pennac1992:d.pennac,Comme un roman,paris:gallimard.picard1986:m.picard,la lecture Comme Jeu: essai sur la littérature,paris:éditionsdeminuit.renard2002:J.renard,journal 1894-1904(annotationsdu23avril1899,1ermars1998et16juillet1903),paris:robertLaffont.riffaterre1983:m.riffaterre,sémiotique de la poésie,paris:seuil.rouxel2004:a.rouxel,g.Langlade,le sujet lecteur. lecture subjective et en-seignement de la littérature,rennes:pressesuniversitaires.

Bazin L.
28
Лоран БазенКЊИЖЕВНОСТ У СТОМАКУ: ЗА ДИДАКТИКУ ПРЕЗИРА
РезимеНијелакоприступитикњижевномделуначасовимафранцускогкаостраногјезика.
Прво, питање је генерација: вероватно ће сваки наставник приметити несклад измеђусвогентузијазмазаврлинекњижевнебаштинеиочигледнеравнодушностикојукаткадизазивајуњеговеречи.Затим,питањејеконтекста:јерсекултурнојдистанципридружујејезичкабаријеракојаудвостручујетешкоћуразумевањаделакојесевидикаоподједнакочудноистрано.Питањејезнатидалиизабратиоваквостањестрвариизадовољитисеоваквимстањемствариилисеможеискористититоодбацивањекојепоказујупојединистуденти.Предметовоградаје,дакле,даозбиљносхватиштазначипрезиратинекоделоиштасеизтогможеизвући,сјезичкеикњижевнетачкегледишта.Топодразумевадасеклизисаизразаосећањанасвестфеномена,даклесапсихологијенаепистемологију,дабисетакоизвелатеоријакњижевностикојапомажеусвајањујезика;украткодасескициранеколикопутањауприлогдидактици презира.
Примљено: 03. 02. 2011.

29
УДКрад
Jelena NovakovićFaculté de philologie, université de Belgrade
LITTÉRATuRE ET MÉLANCoLIE: LES AuTEuRS FRANçAIS DANS LES CAHIERS
De NoTeS D’IVo ANDrIć
L’auteurdecetravailexaminelethèmedelamélancolietelqu’ilseprésentedanslesfragmentsdesoeuvresdequelquesécrivainsfrançaisqueleprixnobelserbeivoandrić,grandamateuretconnaisseurdelalittératurefrançaise,acopiésdanssescahiersdenotes(diderot,nerval,stendhal,flaubert,Léonbloy).cetexamenmontrequetouscesauteursconsidèrent lamélancoliecommeunesourcedepenséeetdecréationartistique.
Mots-clés:mélancolie, amour, génie, création, sensualisme, déter-minisme
définiedansle Petit robertcomme«étatpathologiquecaractériséparuneprofondetristesse,unpessimismegénéralisé»,comme«étatd’abat-tement,detristesse,accompagnéderêverie»,cette«obscuritéintérieure»qu’est lamélancolie selon lephilosophenorvégienespenhammerat-tirel’attentiondesphilosophesetdesécrivains,del’antiquité,oùelleestconsidéréecommeleproduitdelabilenoireetcommeayantlamêmenaturequelegénie,enpassantparlemoyenâge,oùlapenséethéologi-queenfaitunpéchéetlarenaissancequilalieàsaturne,planètedelapensée,auxtempsmodernes,dominésparlapsychanalysequiyvoituneréactionpathologiqueà lapertede l’objetd’amourou,pouremployerlemotde Juliakristeva, «ledouble sombrede lapassionamoureuse»(kristeva1987:15),quibloquelesmécanismesphysiologiquesetpsychi-ques.Lamélancolie estun thèmeconstantde la littératureetdesartsplastiquesetlesauteursypuisentl’énergiequiinciteàl’actedecréationartistique.
cetravailseproposed’examinerlamélancoliedanslesoeuvresdequelquesécrivains français, tellequ’elle seprésentedans les fragmentsqueleprixnobelserbeivoandrić,grandamateuretconnaisseurdela

Novaković J.
30
littérature françaiseet leur lecteurassidu,acopiésdanssescahiersdenotes1.
undecesécrivainsestdenisdiderotquimentionnedansLe Ne-veu de Rameau «unmélancoliqueetmaussadepersonnage,dévorédevapeurs»,«qui sedéplaîtà lui-même»et«àqui toutdéplaît» (diderot1981:464).celacorrespondauxétatsd’âmequedécritivoandrićdansex Ponto,enconstatant que«lesmauvaisespenséesetlespressentimentsnoirsd’unmélancoliqueontleursexactitudeeffrayantebienqu’ilssem-blentabsurdesetinexactsàunhommesain»etencomparantlemélan-coliqueà«untremble,quifrissonneauxmomentsoùlesautresarbresnesententmêmepas levent»(andrić1986:33).Lesréflexionssur lamélancolieoccupentbeaucoupdeplacedanslesLettres à sophie vollandque,d’aprèssesbiographes,diderotarencontréeen1755.cetterencon-treaprovoquéunegrandepassionréciproquequis’esttransforméeplustardenunetendressequiaduréjusqu’àleurmort.ilssevoyaientdeuxfoisparsemaine,saufpendantlesséjoursdediderotàlacampagneoulesséjoursdesophieavecsamèredansleursterres.c’estalorsquedide-rotluiécrivaitdeslettres,quirendentpossiblenonseulementdesuivreledéveloppementde leur amour,mais aussi de connaître les traits decaractèredediderotlui-mêmeetl’époqueoùilavécu.ivoandrićaluces lettresetenatiréplusieursfragmentsqu’ilarecopiés, toujoursenoriginal,dansunesuitedecahiersquis’échelonnentdesannées trenteauxannéescinquante,cequimontrequesonintérêtpourcetouvragen’estpaslimitéàunmomentdonné,maisapersistépendantunegrandepartiedesavie2.
Les caractéristiques d’un mélancolique dansplusieursdeceslettresquiontattirésonl’attention,andrićaco-
piésurtoutlespassagesoùilestquestiondelamélancolie.danslecahierintituléCarnet en cuir bleu foncé(Tamno plavi kožni notes,ia410),ilécritencitantunpassagedelalettreàsophievollanddu28octobre1760:
unchirurgienécossaisquediderotavaitrencontréchezholbachsouffraitdecequ’onappelaitalors«lesvapeursanglaises»,cequiestaufaitlespleen.il disait: «Je sens depuis vingt ans un malaise général, plus ou moinsfâcheux;jen’aijamaislatêtelibre.elleestquelquefoissilourdequec’estcommeunpoidsquivous tireendevant,etquivousentraîneroitd’unefenêtredans la rue,ouau fondd’unerivière, sionétoit sur lebord. J’ai
1 cescahierssontconservésdanslesarchivesdel’académieserbedessciencesetdesarts.2 danscesnotes,iln’apasindiquél’édition,maisilaindiquélespagesetlesvolumes,sibien
qu’onpourraitconclurequ’ils’agitdel’éditionsuivante:denisdiderot,Lettres à sophie vol-land(introductionetnotes:andrébabelon),paris,gallimard,1938,2vol.

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
31
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
desidéesnoires,delatristesseetdel’ennui;jemetrouvemalpartout,jeneveuxrien,jenescauroisvouloir,jechercheàm’amuseretàm’occuper,inutilement;lagaietédesautresm’afflige,jesoufreàlesentendrerireouparler.connoissez-vouscetteespècedestupiditéoudemauvaisehumeurqu’on éprouve en se réveillant après avoir trop dormi? voilà mon étatordinaire,laviem’estendégoût»(dideroti1938:167-168).
auxviiiesiècle,outrelemotmélancolie,quisignifieengreclabilenoire,onemploielemotvapeursquidésignelestroublesnerveuxpro-voquésparlesévaporationsqui,d’aprèsl’explicationdelamédecinedece temps, surgissaient du sang et des autres liquides dans l’organismehumainetparvenaient au cerveau.diderot lui ajoute l’attributanglai-sespourlalierauclimatanglaishumide,brumeuxetpluvieuxetpourl’identifieraumotanglaisspleen,quidésignelarateetqu’ilemploielui-même,enl’écrivantd’unemanièredifférente,audébutdelalettrecitéeci-dessus:«vousnesavezpascequec’estque lespline,ou lesvapeursanglaises»,écrit-il(dideroti1938:167).Lemotspleen,définiparfeutrycomme «une affection vaporeuse, une tristesse de l’âme, une sorte deconsomption, ou toute autre langueur provenant d’unemaladie de larate»(citépardelon1987:42),pénètredanslalittératurefrançaiseaumilieuduxviiiesiècle,pouratteindresonapogéeetobtenirunedimen-sionphilosophiqueauxixe,danslapoésiedebaudelaire.
Lechirurgienécossaisn’estpassansrappelerdiderotlui-même,quiseprésenteàplusieursreprisescommeunêtreenproieà lamélanco-lie.«onditquej’ail’aird’unhommequivatoujourscherchantquelquechosequiluimanque.[…]Lamélancolieatrouvémonâmeouverte,elleyestentrée,etjenepensepasqu’onpuissel’endélogertoutàfait»,écrit-ildanssalettredu30septembre1760(dideroti1938:125).
Lemélancoliqueaunesombrevisiondelavie,quiestmiseaupremier plan audébutde la lettre du 26 septembre 1762d’oùandrićcopiesurunedesfeuillesréuniessousletitrecommunCopies, écrits et notices, matériaux(Ispisi, zapisi i beleške, gradja,ia445),lepassagesui-vant:
naîtredansl’imbécillité,aumilieudeladouleuretdescris;êtrelejouetdel’ignorance,del’erreur,dubesoin,desmaladies,delaméchanceté;dumomentoùl’onbalbutiejusqu’aumomentoùl’onradote,vivreparmidesfriponsetdescharlatansdetouteespèce;s’éteindreentreunhommequivoustâtelepouls,etunautrequivoustroublelatête;nescavoird’oùl’onvient,pourquoil’onestvenu,oùl’onva:voilàcequ’onappelleleprésentleplusimportantdenosparentsetdelanature,lavie(diderotii1938:7).
ce passage pourrait être considéré comme l’expression du pessi-mismed’andrić lui-même,exprimédanssignes au bord du cheminoù

Novaković J.
32
l’hommeseprésentecomme«unêtretragiqueàlaviebrève»(andritch1997:54)etcommevictimedes«forcesinconnuesetsupérieures»(56)autourdeluietenluietoùlasouffranceetlamélancolieapparaissentcommedesfaitsexistentiels:«…toutevotreexistence,jusqu’auderniersouffle,voussouffrirezàcausedecettesituationpeunaturelledans lemondeoùvousêtesjeté»(88).
Lemélancoliquetrouvetoujoursdesprétextespourlasouffran-ce:«peinesàlacampagne,peinesàlaville,peinespartout.celuiquineconnaîtpaslapeinen’estpasàcompterparmilesenfantsdeshommes.c’estquetouts’acquitte;lebienparlemal,lemalparlebien,etquelavien’est rien»,écritdiderotdans la lettredu3novembre1759 (dide-rot i1938:90),etandrićcopiecesdeuxphrases suruneautre feuilledesCopies, écrits et notices, matériaux.Lesréflexionssurlebonheuretlemalheur s’insèrentdans le contextedéterministe et aboutissent à laconclusion fataliste qu’on «ne peut ni améliorer ni empirer son sort»,quenotrebonheuretnotremisère«ontétécirconscriptsparunastrepuissant»(dideroti1938:90)etque«leshommessouffrentsansl’avoirmérité»(dideroti1938:154).
Les sources de la mélancolie Ledéterminismedediderotentraîneuneexplicationphysiologique
delamélancolie.«mais,jem’aperçoisquejedigèremal,etquetoutecet-tetristephilosophienaîtd’unestomacembarrassé»(dideroti1938:90),continue-t-ilsaréflexionsurl’universalitédelasouffrance.cetteremar-quecorrespondausensualismeduxviiiesièclequivoitdansl’hommeunagrégatdematièreoùlepsychiqueetlephysiologiqueagissentl’unsurl’autre,sibienquelesidéesmoralesdépendentdesperceptionsetdessensations.decepointdevue,oùl’explicationhippocratiqueparlabilenoiren’estpastoutàfaitrejetée,lamélancoliedépenddutempérament,del’âgeouduclimat,idéequin’estpasétrangèreàandrićlui-même,quiconstatedanssignes au bord du chemin quelesconditionsclimatiquesetleschangementsjournaliersetannuelsinfluencentlesétatsd’âmedel’hommeetprovoquentladépressionoul’euphorie:«Lesétatsd’âmelespluscontradictoires–lapeuretlajoiepernicieuseouencorelapaixfé-conde–s’échangentenl’hommeavecunerégularitéquasimathématiqueetreviennentparallèlementauxtransformationsdelaterre»(andritch1997:11)3.
3 acetteconstatationsemblecontredirelaphrasedevictorhugoqu’andrićacopiéedansLe Cahier vert ii(Zelena ii,ia416):«Lespleennaîtaussibienducielbleuqueducielsombre.mieuxpeut-être.»(hugo1965:p.92).

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
33
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
mais,lamélancoliedediderotestprovoquéesurtoutparl’absencedesophieque,«crapuleuxousombre,mélancoliqueouserein»,ilaime«également»,mais«lacouleurdusentimentn’estpaslamême»(dideroti1938:90).saréflexionsurlamélancolieseterminetoujoursparlere-touràl’objetdesonamourdontl’absenceestvécuesouslesespècesduregret,cequifaitdelacorrespondance,commeleconstatebenoîtme-lançon,«leplusessentiellementmélancoliquedetouslesgenres»(me-lançon1996:87).
Lasouffranceprovoquéeparl’absencedel’êtreaimépeutêtreadou-cieparsaprésence,maisaussiparl’écoulementdutempsquisupprimetouslesmauxetparlamortquimetenéquilibrelebonheuretlemal-heur,commelemontrelalettredu5septembre1760,oùdiderotécrit:«Lanature,quinousacondamnésàéprouver toutessortesdepeines,avouluqueletempslessoulageâtmalgrénous:heureusement,pourlaconservationdel’espècemalheureusedeshommes,presquerienneré-sisteàlaconsolationdutemps.c’estlàcequiquelquefoismefaitdésirersansscrupuleunegrandemaladiequim’emporte»(dideroti1938:102).cette remarqueanticipecequi fera l’objetdeL’éducation sentimentale deflaubert,dont lehéross’abandonneaucourantde lavieetserendcomptequesessouffrancessontadouciesparlepassagedutemps,parlevieillissementquiémousselessentimentsetéteintlefeudespassions(v.novaković1998:23-39),maisaussidecertainsfragmentsdessignes au bord du chemin oùandrićconstatequelavieelle-mêmefaitmal,c’est-à-direl’existencecommetelleetquec’estlamortquiest«leseuletvéritableremèdeàladouleuretàlapeur»(andritch1997:62).
Les aspects de la mélancolie Lamélancoliedediderot correspondà lapremièredes troisdes-
criptions de cet état d’âmedans l’encyclopédie dediderot et d’alem-bert.toutenétant«le sentimenthabitueldenotre imperfection»,ellen’estpasconsidéréecommeunphénomènenégatif:elle«seplaîtdanslaméditationquiexerceassezlesfacultésdel’âmepourluidonnerunsen-timentdouxdesonexistence»;elle«n’estpointl’ennemiedelavolupté,elleseprêteauxillusionsdel’amour,etlaissesavourerlesplaisirsdélicatsde l’âmeetdessens».ayantunbesoinirrésistibled’amitié,elle«s’atta-cheàcequ’elleaime,commelalierreàl’ormeau»(citéd’aprèshersant2005:684).aladifférencedecettemélancoliequ’onpourraitqualifierdesentimentale, lesdeuxautres(écritesavecun«h»), la«mélancholiereligieuse»etla«mélancholiepathologique»sontdangereusesetilfautlescombattre.diderots’arrêtesurtoutsurlamélancolie«religieuse»qui,d’aprèsladéfinitiondel’encyclopédie,naîtdela«fausseidée»d’unehu-

Novaković J.
34
manitédéchuequinepeutsesauverquepar«lejeûne,leslarmesetlacontritionducoeur»(citéd’aprèshersant2005:684)etqui,commeilleconstatedanslalettredu30septembre1760,incline«aufanatismeetàl’intolérance»(dideroti1938:90).quantàlamélancoliepathologique,liéeàlabilenoire,quifaitl’objetdutroisièmearticledel’encyclopédieetquiasurtoutunsensmédical,diderotnesemblepass’intéresserparti-culièrementàelle.
maisonpourraitrangerdanscettecatégorielamélancoliedegérarddenerval,conséquenced’unepertequiprovoquelasouffranceetquiseprésentecommeuneblessureinguérissable.ayantperdusamèrequantiln’avaitquedeuxansetélevéparungrand-oncle,nervalsouffredèssonenfance.«J’ailapudeurdelasouffrance»,écrit-ildansle Voyage en orient(nerval1956:93),premierouvrageoùilexprimesesobsessions.andrić,quiapassélaplusgrandepartiedesonenfancechezsatanteàvišegradetquiaétédonc,luiaussi,privédesoinsmaternels,copiecettephrasesurunedesfeuillesdesCopies, écrits et notices, matériaux4.danscelivre,nervalécritsurlevoyagequ’ilaeffectuéaudébutde1843,aprèslacrisenerveuseprovoquéeparlamortdeJennycolon,afinderesti-tuer son équilibremental. Les événements réels sont souvent enrichisd’épisodesimaginairesouliésauxautresvoyagespours’incorporerdansuneconstructionmi-réellemi-imaginairequiexprimeles«impressionssentimentales»(nerval1956:35)del’auteur,dominéparlesentimentdefrustrationetdeprivation(v.novaković1997:19-32).
cesentimentestexprimésurtoutdanslapremièrestrophedesonsonnetcélèbre«eldesdichado»qu’andrićatrouvédanslelivred’aris-tidemarie(marie1955:294):
Jesuisleténébreux-leveuf-l’inconsolé,Leprinced’aquitaineàlatourabolie.maseuleétoileestmorte,-etmonluthconstelléportelesoleil noirdelamélancolie.
Lesujetparlantest«déshérité»desonamour,«leveuf»quiaperdul’uneaprèsl’autreadrienne,sylvie,auréliaetunesuitedefemmesima-ginairesquiseprésententcommedesprojectionsdeJennycolon,fem-meréelle,maisinaccessiblepournervalquilatransformeenuneincar-nationdelabeautééternelleetunique.andrićcopiecettestropheaussisurunefeuilledesCopies, écrits et notices, matériaux,pourexprimersapropremélancolie.mais,àladifférencedenerval,dontlamélancoliea
4 enfaitandrićalulelivredeJeanrovesquiporteletitreDe Paris à Cythère (paris,ed.bos-sard,«collectiondeschefs-d’oeuvreméconnus»,1920)etquicontientonzepremierschapi-tresdel’introductionauVoyage en Orientdansl’éditioncharpentierde1851.nosréférencesrenvoientàlapaginationdel’éditionmentionnéedesoeuvres.

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
35
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
uncaractèrepathologiqueetaboutitàlamort,chezl’auteurserbesesontles forcesde laviequi l’emportent.ildépasse les infortunesqu’ilsubitparunesortedesagessequirappellecelledemontaigneetilchercheleremèdeàsamélancoliedanslemondeterrestre,sanscessercependantdes’intéresserauxgrandsmélancoliques.
danssescahiersdenotes,ontrouveunautreécrivainfrançaisdontla mélancolie prend un aspect pathologique. c’est gustave flaubert,pourqui «tout en lui et autourde lui estnoir etdésespérant; tout esten agonie», commeandrić l’écrit dansLe Cahier vert ii, en trouvantdansflaubert«uncasspécifiquedupessimismequicaractérisetouslesauteursduxixesiècle»,maisaussi sonsemblable: «commeflaubert,moiaussij’aimemesdouleurs»,dit-il(andrić1982:265).
danssalettreàmademoiselleLeroyerdechantepie,écritele4no-vembre1857,endécrivantsonétatd’âmequ’ilappelle«spleen»,flaubertdonneunedéfinitiondelamélancoliequienglobetouteunetraditionliée à ce sujet: « […] j’ai comme vous un spleen incessant, que je tâ-ched’apaiseraveclagrandevoixdel’art;etquandcettevoixdesirènevientàdéfaillir,c’estunaccablement,uneirritation,unennuiindicibles.quellepauvrechosequel’humanité,n’est-cepas?ilyadesjoursoùtoutm’apparaîtlamentable,etd’autresoùtoutmesemblegrotesque.Lavie,lamort,lajoieetleslarmes,toutcelasevaut,endéfinitive.duhautdelaplanètesaturne,notreuniversestunepetiteétincelle.ilfauttâcher,jelesaisbien,d’êtreparl’espritaussihautplacéquelesétoiles.maiscelan’estpasfacile,continuellement»(flaubertiii1925:106).
dans la lettre à georges sand du 19 avril 1870, il écrit qu’il est«submergé par unemélancolie noire, qui revient à propos de tout etde rien,plusieurs foisdans la journée», en remarquantqu’il yapeut-être «trop longtemps» qu’il n’a pas écrit (flaubert iv 1924: 16). sacorrespondanceabondeenphrasesmélancoliquesquiserattachentauxréflexions sur la création littéraire.dansLe Cahier vert ii,andrić encopiedeuxqu’iltrouvedanslalettreàgeorgesanddu2décembre1874etquiexpriment lesentimentd’uneagoniegénéralisée:«Lesentimentdecetteagoniemepénètreetjesuistristeàcrever»(flaubertiv1924:207).«ilmesembleque je traverseunesolitudesansfin,pouraller jenesaisoù.etc’estmoiquisuistoutàlafoisledésert,levoyageuretlechameau» (flaubert iii 1925: 106). enparlant dans sa réponse à uneenquête des infortunes dumétier d’écrivain, il constate que flaubert,aussibienqueleromancierserbeborastankovićetlephilosophedanoiss.kierkegaardquisouffraitd’une«mélancoliegrave»,étaient«possédésparunemaladieouunepassionquia influencéd’une façonoud’uneautreleurviespirituelleetcréatrice»(andrić,1996:176).

Novaković J.
36
pourflaubert,cette«passion»estunequêtemaniaquedeperfectionstylistiquequine faitqu’aggraver sonétat. «ças’achètecher, le style»,écrit-ilàLouisecoletle12septembre1853(flaubertii1921:316).mais,andrić,quicopiecettedernièrephrasedansLe Cahier vert ii,prendunedistanceparrapportàcesouciexagérédeperfectionnerl’expressionet,entreparenthèses,ilécrit:«Jenel’aipassenti».sipourluiaussilacréa-tionlittéraireseprésentecommeuntravailassiduetméthodiquesurlestyle,ilestconscientdu«dangerquelestyledeviennepournousunbutensoiquenotrenarcissismeetnotreauto-admirationauronttôtfaitdemettreauservicedeleurscapricesetexigencestyranniques»(andritch1997:179)et ilrejette ladémesureflaubertiennequise transformeenobsessionetenmaladie.
Ledésaccordentre lemoiet lemonde,quiestunedessourcesdelamélancolie, apparaît avec beaucoup d’acuité chez lemystique et lepamphlétaire Léonbloy, sur lequelandrić a voulu écrire un essai (v.novaković 1999: 287-308 etnovaković 2008: 149-162). pourbloy, cedésaccord est inhérent à la condition de l’homme, qui est celle d’unprisonnieretd’unexilé:«ilmesemblaitêtre tombé, j’ignoraisdequelempyrée, dans un amas infini d’ordures où les êtres humainsm’appa-raissaientcommede lavermine.telleétait,àquatorzeans,et telleestencore,aujourd’hui,maconceptiondelasociétéhumaine!»,ditlehérosdudésespéré, qui estuneprojectionde l’auteur lui-même (bloy1953:30).cefragment,qu’andrićacopiésurunefeuilledesCopies, écrits et notices, matériaux,suggère,d’unepart,l’oppositionentrelemoiquiaspi-reàl’absoluetlemilieusocialquis’identifieà«unamasinfinid’ordures»et,d’autrepart,l’idéed’unétatantérieurdebéatitudedansunroyaumeinconnu,opposéà l’étatprésentdemisère,où lesêtreshumainsappa-raissentcomme«delavermine»,c’est-à-direl’idéeduparadisperdu.
siLéonbloyaeuplusieurs fois l’occasionde se sentirabandonnéettrahiparsesamis,quecesoitparsaproprefauteouparlafautedesautres,samélancolieest«naturelle»,c’est-à-direinnéeetnedépendpasdes circonstances extérieures: «Je suis tristenaturellement, commeonestpetitoucommeonestblond.[…]J’aimais instinctivement lemal-heur, je voulais être malheureux», écrit-il le 21 novembre 1889 à safiancée (cité parbéguin 1948: 57-58).dansLe désespéré, il confirmeet complète cette explicationendisantquecelan’est le résultat «nidel’éducation,nidumilieu,nid’aucunelésionmentale»,maisquec’est«letréfondsmystérieuxd’uneâmeunpeumoinsinconscientequ’uneautredesonabîmeetnaïvementenragéed’unabsoludesensationsoudesen-timentsquicorrespondîtàl’absoludesonentité»(bloy1953:33).ilnes’agitpasdecette«mélancoliebonnefille»(bloy1953:27)desromanti-

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
37
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
ques,quisecomplaisentdansleurssouffrances,maisd’unsentimentliéàlaconsciencedelanaturepécheressedel’hommequiabesoind’expiersonpêcher,cequin’estpassansrappelerla«mélancoliereligieuse»quediderot condamne et qui se rattache auxmythes de la chute et de larédemption,parlesquelsLéonbloyexpliquelaconditionhumaine:parsachute,l’hommeaabandonnél’éternitépourentrerdansletemps.ivoandrićexprimeuneidéesemblableencomparantlapenséehumaineàunnaufragéquis’esttrouvésuruneîleinconnue,pourconclure:«c’estpourquoinosidéesportentlesceauétrangeettragiquedesobjetstrouvésd’unnaufrage.elleportentlesstigmatesd’unautremondeoublié,delacatastrophequilesenaarrachés,etd’uneperpétuelle,maisvaineaspira-tionàfairelapaixavecleurnouveaumonde»(andritch1977:194-195).mais, l’idéede lachuteetdupêcherrestechezandrićassezvague, lachuteperdsesconnotationsreligieusesetseréduitàl’échellehumaine.
Lamélancolie se présente donc sous deux aspects. elle peut êtresombreetcontraignante,souventmarquéeparlafauteetlechâtimentetprendreparfoisuncaractèreagressif,commechezLéonbloyouunca-ractèresuicidaire,commec’estbienlecasdenervalquisombredanslafolieetlamortoudeflaubertquisombredansunpessimismenihiliste,exprimésurtoutdansBouvard et Pécuchet.cettemélancolienoireestex-priméeaussiparcertainesréflexionsd’ivoandrićsurledésirdumélan-coliquedépressifdequittercettevie.affranchiedudogmatismeetdestendancessuicidaires,lamélancolieaboutitàlacréationlittéraireetar-tistique,quiestunemanièredel’expulser.c’estsonsecondaspect.cettemélancolieproductiveestlafacultédel’écrivainquicompensel’absencede l’objetaiméet lesautres frustrationsparsonécritureetauquel songénieaccordeunepositionprivilégiéeparrapportauxautres,commeleconstatediderotquiécritdanslaRéfutation d’helvétiusqueleshommesgéniaux sont «plus enclins que les autres à laméditation, parce qu’ilssontatteintsdemélancolie»(diderot1994:840).
Mélancolie et création andrićs’arrêteàplusieursreprisessurseslettresàsophievolland
quiexprimentsonadmirationpourlesgrandsécrivainsetsonméprisdelamédiocrité,cequin’estpassansrappelerlaconceptionexpriméedansProblematadupseudo-aristote-labilenoiredéterminelesgrandshommesetlamélancolieestpropreauxpersonnesd’exception.Lamé-lancolieserattacheàunsentimentdesupérioritéqu’ontrouveaussichezLéonbloydontlamélancolieestàlafoisunmalheurquiluiestdestinéetun signed’unemission sublimequ’ildoit accomplir etdont le vraisensnesedécouvrequedansuncontextebiblique.maiscettemission

Novaković J.
38
n’estpaslacréationartistiqueoulittérairecar,commeillenotedanssonjournalle29août1892,etandrićcopiecetteremarquedanssoncahier,«toutl’artdumondeestinutile,ilfautdesidéesetdesfaits»(bloy1956:49-50).Lavocationdebloyn’estpaslalittérature,maislaprophétiequ’ilconsidèrecommeuneformeplusdirecteetplusefficacedecommuni-cationavecdieu.pourlui,l’artn’estpasunbut,maisseulement,commeil le note le 30 septembre 1902, «un instrument»dont il a appris à seservir«commed’uneépéeoud’uncanon»(bloy1963:119),enutilisanttouteslesressourcesdel’expressionartistique.aussineseretire-t-ilpasdumondedanssesespacesintérieurspourcréer,maislutte-t-ilcontreledésespoirparsonuniversalisationmystiqueoùsasouffranceseprésentecommeuneprojectiondelapassionduchristetparsonextériorisationqui transformesadépressionen invectivesviolentes,enuneagressivi-té envers laquelleandrićprend sesdistances.L’intolérancedebloy etsonacharnementcontresescontemporainssontencontradictionaveclescepticismeetl’agnosticismed’andrićquiconsidèresesexcèscommedesexpressionsd’unemaniedepersécution.
Le clivage entre lemoi et lemonde peut être surmonté sur deuxplans, sur le plan de la vie et sur le plan de la création artistique. Laconsciencede l’universalitéde la souffranceetde labrièvetéde lavieaboutitpourdiderotàlaconclusionstoïcistequ’ilestpossibledetrou-verlebonheurdanssonâmeparuneacceptationlucidedudéterminis-meetdel’imperfectiondumonde,commelefaitsonJacqueslefataliste,aussibienquelecandidedevoltaireetversl’effortépicuriendeprofiterdesmomentsdelajoie:«maisàquoibonl’heuresonne-t-elle,sicen’estjamaisl’heureduplaisir?venez,monamie,venezquejevousembrasse,venezetquetousvosinstantsettouslemienssoientmarquésparnotretendresse;quevotrependuleetlamiennebattenttoujourslaminuteoùjevousaimeetquelalonguenuitquinousattendsoitaumoinsprécédéedequelquesbeauxjours»,écrit-ilàsophievollandle18octobre1760(dideroti1938:147),etandrićcopieaussicettephrasesurunefeuilledesCopies, écrits et notices, matériaux.cettenotecorrespondàl’attituded’andrićlui-même,quiconseilleàsonlecteurd’êtrejoyeuxchaquefoisquel’occasionseprésentecar«cesinstantsdepurejoievalentbienplusquedes jours et desmois passés dans le jeu trouble denospetites etgrandespassionsetexigences»et«uneminutedejoiepureresteenvouspourtoujours,pareilleàunéclatqueriennepeutobscurcir»(andritch1997:56).mais,tandisqu’andrićrestedansleslimitesdesconstatationsgénérales,enparlantdecequienestleprétexte,lesréflexionsdedide-rotdansleslettresqu’ilécritàsophievollandonttoujoursunemarque

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
39
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
personnelle,ellessontliéesàsonexpérienceimmédiateetorientéesversuneseuleetmêmepersonne,celleàlaquelleseslettressontadressées.
Lasolutionseprésentedansunesortedecarpe diemépicurien,danslajouissancedescourtsmomentsdejoie,àlaquelles’ajoutelacréationlittéraire,quiestunesecondemanièred’expulserlamélancolie.c’estl’at-titudedediderotquiessaiederemplirlevideproduitparl’absencedesophieparl’écriture,maisaussidesautresécrivainsdontandrićacopiélesréflexionsdanssescahiers,denervalquiessaiedes’opposerparsesversau«soleilnoirde lamélancolie»,debalzacquiécritdes lettresà«l’étrangère»5,destendhalquidéclarequ’ilest«faitpourvivreavecdeuxbougiesetunécritoire»etqui,enécrivant,sesent«heureuxainsi»(citédansroves1926:113)6,deflaubertqui secoueunpeuson«manteaud’angoisses»pourécrireunelettreàLouisecollet7etquiessaied’apaisersamélancolie«aveclagrandevoixdel’art»,parsonécriture,conscientque«leslettresconsolentdebiendesinfortunes»(flaubertiv1924:146)etmêmedeLéonbloyquiconsidèrel’écriturecommeunevoiequimèneàdieu.àcesécrivainssejointandrégidedontandrićaluetcommen-téLe journal.Le13février1924.gideécritqu’iln’apastenusonjour-nal«durantleslonguespériodesd’équilibre,desanté,debonheur»,mais«durantcespériodesdedépression»,oùilsemontrait«dolent,geignant,pitoyable»etoù ilavaitbesoind’écrirepourse«ressaisir» (gide1948:782).c’estaussil’attituded’andrićlui-mêmequiditquesonoeuvreestleproduitd’unmalaise intérieur,de la«consciencedouloureuse»d’unmélancolique(andritch1997:379).dansLe Pont sur la drina,letrau-matismedelaséparationforcéedesafamilleetdesonpaysnatal,qu’ilportaitcommeune«blessure»danssoncoeur,ainspirémehmed-pašaàfaireconstruireunpontsurladrinapourlaguérir.
il est à noter que lamélancolie des écrivains dont il est questiondanscetarticlen’estpasseulementl’expressiondetourmentsindividuels,maisausside«troublesdusiècle»,pouremployerlemotd’andrićdanssignes au bord du chemin.dans le casdediderot, c’est l’époquede ladécadenceduclassicismequicèdelaplaceauromantismeetdelacrisedel’ancienrégime,quiaboutiraàlarévolutionde1789.danslecasdesauteursduxixesiècle,marquéparledésirromantiquedel’infini,auquelsuccèdelacroyancepositivisteàlascience,maisaussiunenouvelleprisedeconsciencedeslimitesdel’hommeetdesonimpuissanceàatteindrel’infini et à trouver la vérité, c’est le sentiment de défaite.dans le cas
5 Les lettresdebalzac àmadamehanska sont réunies etpubliées après samort: «vousmemanquezcommeunpaysqu’onaime»,luiécrit-il.etensuite:«cetteaffreusemaladiedel’âmequis’appellel’absence.»andrićcopiedanssoncahiercesdeuxphrases.
6 cequin’estpassansrappeleruncercueil,commelecommenteandrić.7 Lettredu14janvier1852,http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/accueil.html

Novaković J.
40
d’andrić,c’estlacrisespirituelleaprèslapremièreguerremondialequiadétruitlesystèmedevaleursexistantettransforméle«vaguedespas-sions»romantiqueen«cri»expressionniste.
***Les fragmentsd’auteurs françaissur lamélancoliequ’andrićaco-
piésdanssescahiersdenotess’incorporentdanssonpropresystèmedepenséeetseprésententcommel’expressiondesapropremélancoliequ’ilaréussiàconjurerparsontravail(leservicediplomatique)etsurtoutparl’écriturequitransformelevideexistentielenmatièreromanesqueetledésird’absoluenunequêtedeperfectionstylistique.touscesauteurs,aussibienqu’andrićlui-même,chacunàsamanière,semblentrejoindrela traditionqui tire sonoriginedesProblemata dupseudo-aristoteetdontl’expressionlapluscélèbreestlamelencoliadedürer,transpositionpicturaledes théoriesdemarsileficin,etquiassimile lamélancolieàlacréativité: lamélancoliesortdudomainede lapathologiepourêtreconsidérée commeunétat limitede lanaturehumaine susceptiblederévélerlessecretsdumondeetlavéritédel’Êtreetcommeunesourcedepenséeetdecréationartistique.
Bibliographie
andritch1977: i.andritch,l’Éléphant du vizir. récits de Bosnie et d’ailleurs,paris:publicationsorientalistesdefrance.andrić1986:i.andrić,ex Ponto, Nemiri, lirika,beograd:udruženiizdavači.andrić 1994: i.andrić,Pisac govori svojim delom, beograd: bigz– srpskaknjiževnazadruga.andritch1997:i.andritch,signes au bord du chemin,Lausanne:L’aged’hom-me.balzac1942-1950:h.debalzac,Lettres à l’étrangère,i-iii,paris:calman-Lévy.béguin1948:a.béguin,léon Bloy. Mystique de la douleur,paris:éd.Laberge-rie.bloy1953:L.bloy,Le désespéré,paris:mercuredefrance.bloy1956:L.bloy,Journal de léon Bloy. le Mendiant ingrat, paris:mercuredefrance.bloy1963:L.bloy, Journal de léon Bloy. Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne. l’Invendable,paris:mercuredefrance.delon1987:m.delon,Lesombresdusiècledeslumières,Magazine littéraire,244,juillet-août.diderot,d’alembert1778:d.diderot,J.d’alembert,encyclopédie, ou diction-naire raisonné des sciences, des arts et des métiers,genève:éd.degenève.

Littérature et mélancolie: Les auteurs français dans les cahiers de notes d’Ivo Andrić
41
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
-42
diderot1938:d.diderot,Lettres à sophie volland,i-ii,paris:gallimard.diderot1981:d.diderot,oeuvres romanesques,paris:éd.garnierfrères,..diderot 1994:d.diderot, réfutation suivie de l’ouvrage d’helvétius intitulél’homme,in:Œuvres: philosophie,(éd.Laurentversini),i,paris:Laffont.flaubert,g.,Correspondance,i-iv,paris,http://flaubert.univ-rouen.fr/corres-pondance/conard/accueil.html).gide1948:a.gide, Journal. 1889-1939,paris:gallimard,bibliothèquede lapléiade.hamer2009:e.hamer,unutarnji mrak. esej o melanholiji,beograd:geopoe-tika.hersant2005:y.hersant,mélancolies,paris:robertLaffont.Jandric1982:Lj.andrić, sa Ivom andrićem,sarajevo:veselinmasleša.kristeva 1987: J. kristeva, soleil noir. Dépression et mélancolie, paris: galli-mard.marie1955:a.mariegérard de Nerval: le poète et l’homme; d’après les docu-ments inédits,paris:hachette.melançon1996:benoîtmelançon,Diderot épistolier, contribution à une poéti-que de la lettre familière de xviiie siècle,montréal:fides.montaigne1965:m.demontaigne,essais,paris:puf.nerval1956:g.denerval,oeuvres,ii,paris:gallimard.novaković 1997: J.novaković, ivoandrić etgérard denerval, in:Filološki pregled, xxiv,1-2,19-32.novaković1998:J.novaković,floberovaprepiskauogledaluandrićevihza-pisa,Filološki pregled,xxv,2,23-39.novaković 1999: J.novaković,un lecteur inconnu de bloy: ivoandrić, in:léon Bloy. 4. un siècle de réception,paris:minard,287-308.novaković2008:J.novaković,ivoandrić,lecteurdudésespéré,in:léon Bloy 8. sur «Le désespéré»,dossier2,caen:Lettresmodernesminard,149-162.novaković 2009: J.novaković,une formeparticulière de l’intertextualité: lalittératurefrançaisedanslescahiersdenotesd’ivoandrić,in:Filološki pregled,xxxvi,2,19-30.roves1926:J.roves,Bréviaire stendhalien,paris:éditionsdusiècle.

Novaković J.
42
Јелена НоваковићКЊИЖЕВНОСТ И МЕЛАНХОЛИЈА: ФРАНЦУСКИ ПИСЦИ У
АНДРИЋЕВИМ БЕЛЕЖНИЦАМА Резиме
Урадусеиспитујетемамеланхолијеуонимвидовимаукојимасеонапојављујеуде-лимафранцускихписацачијејеодломкеИвоАндрићунеоусвојебележнице.ТиписцисуДидро,којипишедајемеланхолијапродрлауњеговудушуидајујенемогућеодатлеистерати,Нервалчија„звезданалира“носи„црносунцеМеланхолије“,Стендалчији јеОктав,главнијунакроманаАрманса,меланхоличнисањаркојискриванекуболнутајну,Флоберкојије„преплављенмрачномсетом“иЛеонБлоакојије„тужанпоприроди“.ТоодговарадушевнимстањимаописанимунекимделимаИвеАндрићакојикажеда„злемислиицрнеслутњеједногмеланхоликаимајусвојустрашнутачност“.
Фрагментиомеланхолији,којупсихоанализасматрапатолошкомреакцијомнагуби-такпредметаљубави,укључујусеумисаонисистемсамогаАндрићаипојављујусекаоизразњеговевластитемеланхолијекоју јеонуспеодаодагнасвојимрадом(дипломат-скаслужба)и,нарочито,писањемкојепретвараосећањепразнинеигубиткаукњижевнуграђу,ажељузаапсолутомутрагањезастилскимсавршенством.Свиовиписци,каоисамАндрић,повезујумеланхолијусакреативношћуиукључујусеуонутрадицијукојаводипореклоодпсеудо-АристотеловихProblemata,ачијијенајчувенијиизразДирероваМеланхолија.Извлачећимеланхолијуизобластипатологије,они јепосматрајукао гра-ничностањељудскеприродекојеомогућавадасеоткријутајнесветаиистинаочовекуикаоизвормислииуметничкогстварања.
Примљено: 22. 01. 2011.

43
УДКрад
[email protected]@ff.uns.ac.rs
Pavle Sekeruš, Ivana Živančević-SekerušFaculté de philosophie, université de Novi sad
rePréSeNTATIoN IcoNoGrAPhIque DeS SLAVeS Du SuD (1774 – 1849)
L’imagologuedoit«regarder»carlaculturedevientdeplusenplusvisuelleet laraisonn’estpasobligatoirementetexclusivementdans lesmots,elleestdeplusenplusdanslesimagescequiexigelaconnaissancede la logiquequi leurestpropre.L’image(dessin,gravure,peinture…)estunsignebasésurdessymbolesdont l’utilisationdonne lemessageet la signification. par la répétition elle devient presque l’image d’unpersonnageoud’uncaractère:unpeupleestprésentécommehaïssable,aimable,querelleur,bagarreuretc.
duchoixmodestedesdessinsetdesgravuresqui représentent lesslaves du sud du début duxixe siècle, il est difficile de dégager uneconclusion convaincante. du philosophe et anthropologue du xviiiecommefortis,passantparleclassicismeromantisédecassasetleréa-lismedebartlett,onremarquesurtoutlechangementdel’expressiondudessinateur, tandisque l’imagede lapopulationvariepeu.Lecostumenationalcommesigneleplusvisibledel’altéritéestpartoutprésent.for-tisestleseulquiportaitsonintérêtavanttoutàlapopulation.pourcas-sasetLavalléeelleétaitl’ajoutpresquefortuitdelanatureetdel’archi-tecture.sazeracetbartlettintroduisentunenoteoptimisteetlacroyanceenprogrèstoutenpréservanteuxaussilaplacedominanteauxpaysagesetàl’architecture.
Mots-clés:slavesdusud, imagologie,gravures,xixe siècle,fortis,mérimée,cassas-Lavallée,sazerac
attirésdepuisdesannéespardesimagescrééesavecdesmots,c’est-à-diredesimageslittérairesdespeuplesettrèsmarginalementpardesimagesproprementdites,danslaprésentecommunicationnousavonschangécetteapprochepournoustournerversdesspécimensdesartsiconogra-phiques,cesgravuresquiaccompagnaientlestextesdansleslivres.decettefaçonnousessayonsdediversifierlessourcesquicontribuentàlacréationdel’imaginairesudslaveenfranceetdecomparerl’effetproduitparletexteetl’image.

Sekeruš P., Živančević-Sekeruš I.
44
Lapériodechoisieestlapremièrepartieduxixesièclequiestrela-tivementpauvreenreprésentationiconographiquesurtoutquandonlacompareaveclasituationactuelle.
cepassagedetexteàl’imagesejustifieparlechangementdanslaproduction des images sur les autres. L’imagologue d’aujourd’hui doit«regarder»carlaculturedevientdeplusenplusvisuelleetlaraisonn’estpasobligatoirementetexclusivementdanslesmots,elleestdeplusenplusdanslesimagescequiexigelaconnaissancedelalogiquequileurestpropre.L’image(dessin,gravure,peinture…)estunsignebasésurdessymbolesdontl’utilisationdonnelemessageetlasignification.L’imagesymbolique d’un peuple est souvent bourrée de contenu idéologique.par larépétitionelledevientpresque l’imaged’unpersonnageoud’uncaractère,unpeupleestprésentécommehaïssable,aimable,querelleur,bagarreur,etc.
quandonparledel’imagedesslavesdusudduxixesiècle,onestobligédementionnerunlivreduxviiiesiècle,celuidel’abbéalbertofortis qui est une des premières sources importantes de l’imaginairesudslavepourlesfrançais.ils’agitdeViaggio in Dalmaziapubliéen1774àveniseettraduitenfrançaisquatreansplustard.fortisestphilosophedepadou, successivementphysicien,naturaliste,poète, journaliste,bi-bliographeetterminecommepréfetdelarichebibliothèquedebologne.il joueaussiunrôledepionnierdans lesrecherchesanthropologiquescommeobservateurdirectdespopulationsprimitivesqu’ilanalyseetdé-critenseréférantàlaphilosophiedeslumières.Lapopulationquinousintéresseparticulièrement,ce sontces fameuxmorlaquesquevoltaireamisdansonessais sur les moeurs(1756)àcôtédeshottentots,Laponetdupeupled’islandecommedessauvagesreprésentatifs.ils’agitdelapopulationcontinentaledeladalmatie,delreligionorthodoxeouca-tholique,connueenitaliedepuisdessiècles.Leurnomesttrèsprobable-mentd’originebyzantineoù,souslaformedemaurovlahos,ildésignelespâtresdesmontagnes,habitantscontinentauxdeladalmatievénitienne,indigènesdesbalkans.àpartirduxviie siècle, il estdeplus enplusévidentqu’ilnes’agitpasd’unpeupleàpart,maisdumêmepeuplequ’onnommeparfoisslovinique,illyrique,croateouserbe.
fortisquivoyageaitencompagnied’undessinateurdontilnepré-cisepaslenom,maisdontilditlaconiquement:«pendantquemoncom-pagnondessinaitcepaïssage[sic!]extraordinaire,j’enfisàmonaiseladescription(fortis1778:116),insèredebellesplanchesentaille-douce(15planchesgravéeshorstexte,costumes,vues,cartes)defameuxmor-

Représentation iconographique des Slaves du Sud (1774 – 1849)
45
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
3-5
3
laquesetdeleurterritoire.Lesgravurespourlelivresontfaitespar«Jac.Leonardisscul.».1
àcôtédespaysages,son«compagnon»laissaplusieursdessinsdesfameux«morlaques»encostumestypiquesetdansdespostureshéroï-ques.Lesplusconnussont lagravuredufameux«haïdoukmorlaque»sočivicaetcelled’unefemmedesenvironsdezadar.
fortisdécritendétailsleurshabits:L’habillementdeshommesestsimple&économique.ilsseservent,commeles femmes,d’opanké enguisedesouliers: ils sechaussentd’uneespècedebrodequintricoté,nomméNavlakaza,quiau-dessusdelachevilledupiedsejointàl’extrémitédelaculotte,parlaquellelerestedesjambesestcouvert.cetteculotte,faited’unegrossesergeblanche,selieauxhanchesparuncordondelaine,quilaserrecommeunsacdevoyage.Lachemiseentrepeudanscetteculotte.surlachemiseilsportentunpourpoint,appeléjacerma,&enhyverilsmettentencorepardessusunmanteaudegrosdraprouge, qu’ils nommentKabaniza, ou japungia. Leur tête se couvre avecunbonnet,surmontéd’uneespècedeturbancylindrique,appeléKalpak.[...]ilsseceignent lesreinsavecuneécharperouge,delaineoudesoyetisséeàmailles.entrecetteécharpe&laculotteilsplacentleursarmes,enarrièreunoudeuxpistolets;enavantunénormecouteau,nomméHanzar,enfermé dans une gaine de laiton, ornée de fausses pierreries [...] à lamêmeplace ilsmettentuncornet,garnid’étain,dans lequel ils tiennentlagraissenécessairepourgarantir leursarmesdel’humidité,oupourseguérireux-mêmes,quandcheminfaisantilssemeurtrissentlespieds[...]Le tabac à fumer se conserve encore dans l’écharpe, enfermé dans unevessiesèche.ilstiennentlapipesurlesépaules,laissantlatêtedehors,&passantletuyauentrelachemise&lapeaunue.quandunmorlaquesortdechezluiilportetoujourssonfusilsurl’épaule(fortis1778:127-128).
nousallonsfaireunsautenavantd’unecinquantained’annéescarlehaïdoukdefortiscorrespondaudétailprèsàlagravuredehyacinthemaglanovich,lebardeslaveimaginairedemérimée,publiédanssonre-cueildelapoésiepopulairela guzla en1827.certainsauteurspréten-daientquemérimées’étaitprésentélui-mêmesouslestraitsdemaglano-vich.difficiled’enjuger!L’habitestpresqueidentiqueàceluidesočivicadefortis,mais lenaturel et la justessede saposition, lesproportions
1 giacomoLeonardis(1723,palmanova–c.1794),graveuretaquafortiste italien.ilétaitnéàpalmanovadanslarépubliquedevenise.élèvedem.benvilleetdetiepolo,ilaobtenule premier prix à l’académie de venise. il a gravé plusieurs planches d’après les maîtresitaliens,dontgiuliocarpioni,sebastianoconcaettintoret.Leonardisagravéaussilelivregerusalemme liberatabasésurlesdessinsdebernardocastelloutilisésdansl’édition1617dupoème.ilexiste96vignettesdansletexteetàlafindechaquechantgravéparLeonardisd’après pietro antonio novelli. novelli et Leonardis ont été influencés par giambatistatiepolo.

Sekeruš P., Živančević-Sekeruš I.
46
del’instrumentparrapportaujoueur,toutsuggèrequemériméeavaitfaitundessind’aprèsnature.Lagravureestsignéea.br.cequinenouséclairepasplussurl’auteur(yovanovitch1911:234).
à propos de la planche intituléeLa femme de l’environ de Zadar,nousajouteronsquelquesmotssur«lafemmemorlaque»selonfortis:
Leshabitsdesfemmesmorlaquesvarientsuivantlesdistricts,&paroissenttoujours singuliers aux yeux d’un étranger. [...] Les bas des filles sonttoujours rouges, & leurs souliers, ou opanké, semblables à ceux deshommes, sont composés d’une semelle de cuir crue, avec un dessus debandelettesentrelacéesdepeaudemouton,appeléesoputé.…elleslientces bandelettes au-dessus de la cheville du pied, de manière que cettechaussureressembleaubrodequindesanciens.quelquerichequesoitunefamille,onn’ypermetpasauxfillesdeseservird’autressouliers,mariées:ellespeuventquitterlesopanke&prendredesbabouches,ouPapuzzé,àlamodedesturques (fortis1778:102-104).
Lestylereste inchangé, toujours ladescriptionminutieuse,ethno-logique,dirait-on.ilest intéressantdeconstaterque lesgravuresde latraductionfrançaisesontdifférentes,faitesd’aprèscellesdel’éditionita-lienneettrèsinférieuresparrapportàl’original.fortisajouteaussiquel-quesgravuresdepaysagequi illustrentencoremieuxque lesplanchesprécédentesl’approche«philosopheduxviiie»defortis.sanaturede-vientunesortedelaboratoirequiàceluiquisaitlalireoffredemultiplespossibilitésdeconnaissance.
dulivreethnologiquedefortisnouspassonsà lamélancoliepré-romantiquedeLouis-françoiscassasetJosephLavalléequipublièrenten1802leurouvrageVoyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la dalmatie.surlacouverturenousapprenonsquelelivreestfaitparJo-sephLavallée,(membredelasociétépolytechnique,delasociétélibredes sciences, etc. selon l’itinérairede J.f.cassas,peintre et architectequiadessiné lesestampes,cartesetdessinsquiontservicommebasepour lesgravuresquiornent l’ouvrage).dans lapartietextuelle faiteà posterioriLavalléeutiliseabondammentlelivredefortisaveclapano-pliede«lacouleurlocale»représentéeparlesuscoques,lesheiduques,lesmorlaques et leursmoeurs pittoresques.mais dans les eaux-fortesdessinéesparcassasetgravéesparLouis-Josephmasquelier2,antoine-
2 Louis-Josephmasquelier(cisoing,1741-paris1811),vintàparispourtravaillerdanslagra-vuresousladirectiondephilippelebas.avecsonaminéeildirigeal’entreprisedestableauxdelasuissedelaborde,duvoyagedeLapérouse,duvoyagedeladalmatieetlevoyagedel’italiedesaintnon.ilaornédesesgravureslaplusgrandepartiedeséditionsimpriméesdesontemps,tellesquelesmétamorphosed’ovide,les Fablesetles Baisersdedorat,les Chansons delaborde,les évangiles.

Représentation iconographique des Slaves du Sud (1774 – 1849)
47
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
3-5
3
michelfilhol3etJean-baptisteréville4,onnetrouveriendetoutcela.cassas comme objet unique de ses dessins choisit lesmonuments del’antiquitéromaine,vusdanslesvillesdelacôtedalmateetdel’istriecommepiran,zadar(zara),pula(pola)etsplit(spalatro).celan’étonnepasquandonsaitquecesgraveursétaientreprésentantsdunéoclassi-cisme,denouveauenvogueàl’époquenapoléonienne.néàrome,sousl’influencedeplusieursfacteursparmilesquelslaredécouvertedepom-péietherculanumaumilieuduxviiie,leclassicismesepropagerapi-dementenfrancepar l’intermédiairedesélèvespeintreset sculpteursde l’académiedefranceàrome, et enangleterregrâceà lapratiquedugrandtourdelajeunessenoblebritannique,maisdanslerestedel’europeaussi.ilpréconiseunretourauxvaleursvertueusesetsimplesdel’antiquité,aprèslebaroqueetlesexcèsdesfrivolitésdurococodesannéesprécédentes.Leclassicismeestchoisipar lespouvoirsdenou-vellesrépubliquesissuesdesrévolutionsfrançaisesetaméricainescarcestylereprésentaitsymboliquementladémocratiedelagrèceantiqueetdelarépubliqueromaine.Laromeimpérialedevientainsiunmodèleenfrancesousnapoléonier.
dansl’introductionduVoyage en Istrie,Lavalléedonneunesortedecredodecetouvrage,quiéclaireunpeuplussurlechoixdessujetsdesgravures:
L’istrieetladalmatieprésententàl’observateurlascènelapluscurieuse:d’uncôté le squelettede l’empire romain;de l’autre, etdans ladalmatiesurtout,unpeuplepasteur,nomade,etpeut-êtremêmeredescenduparladégradationàl’étatsauvage;icilestracesfastueusesdesmaîtresdumonde,làl’obscureindigencedequelquestribusignorées;[…]lesarcstriomphauxde la victoire, les armes grossières dumorlaque sans milice, les restesmajestueuxdestemplesdeJupiter,lesinformeschapellesduchristianisme;lesbainsspacieuxoùlavoluptéromainedélaissaitlesgrâcesetlabeauté,lapailleinfecteoùladalmatienneaviliereposeloindel’estimeconjugale;enfinlesossementsdesarts,etlecorpsdifformedel’ignorance.telssontlescontrastesdont lerapprochementdouloureuxfrappeàchaquepas levoyageurquiparcourtcescontrées(cassas,Lavallée1802:2).
Lavalléen’avaitdéfinitivementpasbeaucoupd’estimepourlesmor-laquesrustiques;l’apologiedubanditromantiqueetdesonhomologue
3 antoine-michel filhol (paris 1759-1812 paris), graveur et marchand d’estampes, connucommeéditeurduCours élémentaire de peintureougalerie complète du musée Napoléonde1804.
4 Jean-baptisteréville (1767-1825), graveur, élèvedugraveurberthault.travailla auxplan-chesdelaDescription de l’Égypte ou recueil des observations et recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition françaiseœuvremonumentalequicomportedixvolumesde974planches,dont74encouleur,unatlascartographiqueetneufvolumesdetexte,publiéeentre1809et1828.

Sekeruš P., Živančević-Sekeruš I.
48
desbalkans,l’heiduque,estencoreloin.Lagrandeurromainerendlesmorlaquesetlesdalmatesinfinimentpetitsselonlui.danslesdessinsdecassascelasetraduitparladisproportionentrelesrestesdestemplesromains,agrandisdémesurémentet les figureshumainesencostumesmorlaquesouturcs,rapetissées.entrelesmortsetlesvivants,entrelesobjetsetlessujets,cassasetLavalléechoisissentlesobjetsetlesmorts.Leurtristessepréromantiquedevantlesruinesd’unecivilisationn’avaitpasd’intérêtpourlesindigènessaufdanslamesureoùilscontribuaientaumaldusièclequitorturaitleursâmes.Ladéchéancedel’hommeetde sesœuvresqu’il croyait éternelles, faceà lanatureet au tempsquilesflétrissentetdétruisent,nerespectantpasmêmelesmonumentsdupassélesplussublimescommeruinesantiques,danslesquellesdesar-bresplongentleursracinessanségardpourleschefsd’œuvreetlagloired’uneépoquedisparueestlevéritablesujetdesesgravures.
Lesdernièrespagesdulivrechangentsoudainement leurcontenu.des ruines de l’antiquité dans les dernières pages du livre l’auteur setourneversunautrethèmecherauromantique,lanature,belle,drama-tique,grandiose,etajoutequelquesplancheavecdeschutesd’eau,deslacsdemontagne,desrochersquiportentdeschâteauxcommedesnidsd’aigles.
quarante-sept ans après le livre plongé dans «la mélancolie desruines»decassasetLavallée,unouvragepleind’optimismedécrit«lesmorlaques»del’estetdunorddespayssudslaves.c’estle Danube illus-trédeh.L.sazeracde1849,unetraductionlibrefrançaised’unouvrageintituléThe Danube: its history, scenery and topography,àpartirdeses-quissesfaitesparw.h.bartlettquifaitsonvoyageen1842,publiéparwilliambeattieàLondreen1844.
L’auteur(williambeattie,1793-1875)décritunparcoursdeconstan-tinopleàviennepar ledanube(qu’iln’a jamais faitd’ailleurs)à la fa-çond’un guide touristique, une sorte d’ancêtre du guidemichelin quipourraitêtreintituléDu confluent à la source du Danube.Levoyageenpaquebotestlesignedelanouvelleépoquedel’industrialisationeneu-rope,duprogrèstechniqueetscientifique.beattieacréésontexteautourdesdessinsdewilliamhenrybartlett5àpartirdesquels«plusieursartis-tesanglais»tirerontplustarddesgravures.
bienqu’éprisduprogrèstechnique,beattieestaussiunespritpoé-tiquequinousinformeque«partoutenfinl’âmerêveuse,l’imaginationcapricieuseetvive trouventà leurchoix le tableauqui leurconvient.»notreauteurl’atrouvésurledanube.Levoyagecommenceàconstan-
5 artisteanglais(1809-1854)trèsconnupoursesgravurestiréesd’aprèslesdessinsdespaysa-gesfaitspendantlesvoyagesàtraversl’europe,lesbalkansetl’amériquedunord.

Représentation iconographique des Slaves du Sud (1774 – 1849)
49
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
3-5
3
tinopleaveclavisiteetladescriptiondétailléedecetteville.verslafindemai1847,levoyageurquitteconstantinopleavecsesamis«avecl’in-tentionderemonterledanubedanssoncoursjusqu’àvienne,etd’allermêmeinterroger lefleuvejusqu’àsasource,si lecoeurnousendisait,àbordd’unbateauàvapeur,un«steamer»,commeaimaientàdirelesanglophilesdecesiècle.
pour mieux informer ses lecteurs sur les régions qu’il va visiter,beattie donne un abrégé de l’histoire d’autriche.malheureusement, ilnementionnepasuneseulefoislesslavesdecetempire,quienfaisaientlecorpsetdont la têteétaitallemande,commeonledisaità l’époque.néanmoins,Lecourantdudanubelesyoblige,ilstraversentlesvillesavec lapopulation sudslave:cladovo,belgrade,zemun,petrovaradin.bartlettfaitdesdessins.
La première agglomération avec la population serbe est le villagedecladovo, point de rencontre des slaves et desroumains. «Les po-pulations,sortantd’une longue léthargie,se livrentavecsécuritéàdesespérancesquelanavigationàvapeurnetarderapasàréaliser.Letra-vail,l’industrie,lecommerce,cesdivinitésdespeupleséclairésetsages,s’éveillentetpromettentàcescontréesuneprospéritéprochaine».avantquecesrêvestraversésparlacroyanceauxbienfaitsdelascienceetdel’industrieneseréalisent, ledessinateur,bartlett,s’intéresseavanttoutauxcostumesfolkloriques.ilposeplusieursfiguresd’hommesetdefem-mesaupremierplandesondessin,travaillantendétailleurshabits.ici,lamassed’eauoccupe l’ailedroitedudessin,poséeverticalementdansladirectionnord-sudetseperdantdanslaperspective.celalaissedeuxtiersdelasurfacedudessinpourlaprésentationduvillage:
Lesmaisonsdeshabitantsdegladova,couvertesdechaume,ressemblentbeaucoupauxpauvreschaumièresdescampagnesdefrance.grossièresdans leurs constructions, et engénérale troppetites, elles forment, aveclesvêtementsassez recherchésetpresquerichesde leurs jolieshôtesses,unedisparatefrappante.Lagrue,quifaitleservicedupuitscommunduvillage,luidonneuntraitdeplusderessemblanceavecnoshameaux.maisàceschétivesdemeuressuccéderont,bientôtsansdoute,desmaisonsplussolidesetplusvastes.Leprogrèsafaitunpasencelieu;ilypoursuivrasamarcheascendante(sazerac1849:21).
enplusd’insistersurcescontréesnepouvantéchapperauprogrès,levoyageursouligneplusieursfoislasimilaritéaveclafrance.celan’estpas le procédé souvent employé par d’autres voyageurs qui essayaientavanttoutdemontrerla«couleurlocale»uniqueetspécifiquedeslieuxqu’ilsvisitaient.

Sekeruš P., Živančević-Sekeruš I.
50
nosvoyageurscontinuentleurrouteverslasourcedudanubetra-versantd’autresagglomérationsavecdespopulationsslaves,serbesavanttout,commesmederevo,«avecsaforteressedeformetriangulaire,créa-tiond’unprinceservienquilafitconstruireaucommencementduxvesiècle»; ensuitepančevo,villepopuleuse,qui faitpartiedubanat alle-mand.sazeracbeattieajoute:«nousnenousfatigueronspointàtracerlastatistiquedeslieuxdontlesnomsontété,seulementpourl’acquisdenotreconsciencedevoyageur,inscritssurnotrejournal de bord».
c’estbelgradequiattireleplusd’attention:belgrade,situéeauconfluentdelasaveetdudanube,estlacapitaledelaservieetl’unedesplusfortesplacesdel’empire.c’estl’alba graecadesromains.sapositionest admirable; en tempsdepaix, iln’enestpasdemeilleurepourlesopérationscommerciales;iln’enestguère,toutefois,deplus fâcheuse en tempsde guerre; car il ne se tire pas un seul coupdecanon entre l’autriche et laporte ottomanequ’elle n’en ressente aussitôtleseffets.elleaétési souventassiégée, si souventpriseet reprise;elleapassédanstantdemains,elleaeutantdemaîtres,qu’envéritéilfaudraitdixvolumes,deuxfoisplusgrandsquelenôtre,pourtracerletableaudetoutessesvicissitudes(sazerac1849:41).
aprèsl’avoirsituéedanslepaysageetdansl’histoire,sazeracpasseàladescriptiondelaville:
avecsesmosquéesmagnifiques,seshautsminarets,sesdômessuperbes,seshautes tours,sesboisdecyprès,belgradeprésentede loinunaspectremplidegrandeur;elleestcependantassezmalbâtie,engénéral,etsesruesnesontpointpavées.elleoffre,d’uncôté, lestraitsde lasplendeurorientale,del’autre,ceuxdel’indolenceasiatiquequilaissetoutinachevé.Le pacha de servie fait sa résidence dans la citadelle, qui, de ses yeuxtoujoursmenaçants,interrogeledanubequ’elledomine.[...]quandonavulestreizemosquéesdebelgrade,seséglisescatholiques,lepalaisquifutlademeuredeczerni-georges,lesruinesdeceluiduprinceeugène,onn’aplusrienàyvoir(sazerac1849:42).
bartlett adessiné la ville en seplaçantdu côté autrichienduda-nubepour capter l’ensemblede la forteresse turque etdudanubequiséparebelgradedezemun(zemlin),etlaserbie,c’estàdirelaturquie,delahongrie.troisgroupesd’hommessetrouventàproximitédudes-sinateur,dontdeuxturcs,reconnaissablesàleursturbans.Letroisièmeestcomposédedouaniersautrichiens.Lepostefrontièreestmarquéparl’aigleàdeuxtêtesdeshabsbourg.uneénormemassed’eautranquillesépare cesdeuxmondesqui s’interpénètrentmais restentdivisés: l’unestreprésentéparlesturbansetlesminaretsquimontentversleciel,etl’autreparcetaigleautrichienetcesdouaniers.deuxcivilisations,pourunefois,coexistentpaisiblementsurcettegravure.

Représentation iconographique des Slaves du Sud (1774 – 1849)
51
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
3-5
3
Ladernièregravuredebartlett,intéressantepournous,représentelabourgadedepetrovaradin(peterwardein)etsaforteresseautrichienne,connueaussisouslenomde«gibraltardedanube».cetteforteresseestàl’originedel’agglomérationdel’autrecôtédudanubeappeléenovisadparlesserbes,neüsatzparlesallemands»etujvidekparleshongrois.Lacompositiondelagravureestidentiqueàcelledebelgrade.L’artistesetrouveducôtédenovisadpourprendreledanubequihorizontale-mentcoupel’imageetséparelaforteresse,situéeaucentredudessin,delarivegauche.aupremierplansetrouventplusieursgroupesd’hommesetunefemme,tousenhabits«européens».unbateauàvapeuraumi-lieududessinlaissesortirsarichefuméenoire.quelquesouvriersfontroulerdestonneauxpourlesembarquersurlesbateaux.Lamarchandiseprêtepourletransportcouvrelepremierplandesailesgaucheetdroitedelagravure.aumilieududanube,àl’extrêmegauchedel’image,onvoitunpontonformédenombreuxbateaux.L’imageestplusdynamiquequecelledebelgrade.Lesturcs immobilessontremplacés icipardesouvriersindustrieux.iln’ypasdetracesd’orient.c’estl’europe.L’imagecolportelesclichésaussibienquelesmots.
duchoixmodestedesdessinsetdesgravuresquireprésentent lesslavesdusud, il estdifficilededégageruneconclusionconvaincante.commedanslalittérature,l’influencedesgravuresdulivredefortisétaitimportante car le heiduque demérimée en est visiblement imprégné,aussibienquelesmorlaquesquipeuplentlespalaisromainsdecassasetLavallée.maiscassas,avecsestemplesromains,auraitpufairelemêmegenrededessinsenitalieouengrèce,ladifférencedupaysseraitsansimportancepourlegenred’imagesqu’ilfaisait.
qu’estcequiachangédefortisàsazeracdanslaprésentationico-nographiquedesslavesdusud?Lesexigencesesthétiquesdesépoquessonttrèssensibles:duphilosopheetanthropologueduxviiiecommefortis,passantparleclassicismeromantisédecassasetleréalismedebartlett,onremarquesurtoutlechangementdel’expressiondudessina-teur,tandisquel’imagedelapopulationnevariepas.Lecostumenatio-nalcommesigneleplusvisibledel’altéritéestpartoutprésent.fortisestleseulquiportaitsonintérêtavanttoutàlapopulation.pourcassasetLavalléeelleétaitl’ajoutpresquefortuitdelanatureetdel’architecture,c’étaitlesbarbareségaréssurleslieuxdel’anciennegrandeur.sazeracetbartlettintroduisentunenoteoptimisteetlacroyanceenleprogrèstoutenpréservanteuxaussilaplacedominanteauxpaysagesetàl’architec-ture.

Sekeruš P., Živančević-Sekeruš I.
52
Bibliographie
amossy1991:r.amossy,Les idées reçues,paris:nathan.fortis1778:a.fortis,le Voyage en Dalmatie,(traduitdel’italien),berne:so-ciététypographique.Lavalée,cassas1802:J.Lavallée,L.f.cassas,Voyage pittoresque et historique de l’istrie et de la dalmatie,paris:pierredidotl’aînépourné.Leerssenetall.2007:J.Leerssen, The cultural construction and literary represen-tation of national caracters,amsterdam-newyork:rodopi.mérimée1885:p.mérimée,la double méprise.la guzla, paris:calmanLévy.moura 1992: J.-m. moura, L’image du tiers monde dans le roman français contemporain,paris:puf.pageaux1994:d.-h.pageaux,Littérature comparée, paris:armandcollin.sazerac1849-1850:h.L.sazerac,le Danube illustré. Vues d’après nature, dessi-nés par Bartlett, gravées par plusieurs artistes anglais,(traduitdel’anglais),pa-ris:h.mandeville.sekeruš2002:p.sekeruš,Les slaves du sud dans le miroir français,beograd:zadužbinaandrejević.sekeruš2009:p.sekeruš,Cyprien robert. un slavisant français du XIXe siècle, novisad:filozofskifakultet.syndram1991:k.u.syndram,theaesteticsofalterity:literatureandimagolo-gicalapproach,in:Yearbook of european studies,4,amsterdam:rodopi,177-192.yovanovitch 1911:v.m.yovanovitch,la guzla de Prosper Mérimée – étude d’histoire romantique,paris:hachette.
Павле Секеруш Ивана Живанчевић-Секеруш
ИКОНОГРАФСКА ПРЕДСТАВА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА (1774 – 1849)
РезимеИмагологија као метода компаративне књижевности, не може се задовољити само
текстуалнимизворимаисвевишеморада„посматра“дабиправилаанализе.Културајеусвевећојмеривизуелна,штозахтевапознавањелогикекојајесликамасвојствена.Сли-ка(цртеж,гравира,фотографија...)језнакзаснованнасимболимачијаупотребастварапорукуизначење.Понављањемсликенародапочињудаличенасликуособе,пасетаконародипредстављајукаоварварски,свадљиви,раздражљиви,мрскиилимили.
ИзскромногизборацртежаигравиракојипредставаљајуЈужнеСловенесапочеткаxixвекатешкојенаправитиубедљивзакључак.ОдфилозофаиантропологаxviiiвекакакавјебиоФортис,прекокласицизмаипредромантизмаКасасаиЛавалеадореалистеБартлета, пре свега уочавамопроменуизражајних средстава док се самапредстава Ју-жнихСловенанемењазначајније.Националникостимкаонајвидљивијизнакалтеритета

Représentation iconographique des Slaves du Sud (1774 – 1849)
53
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
3-5
3
јесвудаприсутан.Фортисјејединикојисеинтересујепресвегазастановништвоињего-веобичаје.ЗаКасасаиЛавалеаонојеслучајнидодатакприродиипресвегаархитектури.СазеракиБартлетуводеједнуоптимистичкунотусаверомупрогрес,мадаисамичувајудоминантноместозапејзажиархитетктуру.
Примљено: 28. 02. 2011.


55
УДКрад
Julien RoumetteelH-PlH, université de Toulouse le Mirail
roMAIN GAry, VercorS eT Le DeuIL De LA RÉSISTANCE
romaingaryetvercorssontdevenusécrivainspendantlaguerre,dontilsontététousdeuxdeshéros.bienquedetempéramentsetd’iti-néraires très différents, ils ont en commun, après guerre, d’être restésfidèles aux idéauxde larésistance et de la france libre.mais dans lecontextedelaguerrefroide,illeurafallufaireledeuildelarésistance.plutôtquedeseréfugierdanslecynisme,ilsfontledeuildumessianis-merévolutionnaireetimaginentdansleursrécitsdesformesnouvellesetpacifiquesdelutte,lesconduisantàrefonderleuridéalismesurdesbasesplusuniverselles,défendantcequegaryappelle«unemargehumaine»danstoutengagement.Lesgrandsromansquiontmarquélasortiedecedeuil,Les animaux dénaturés(1952),devercors,etLes Racines du ciel (1956),degary,sontàl’imagedurêvequelesanciensdelarésistancesesontfaitdeleurrôledanslasociétéd’après-guerre:êtrelesfermentsdesnouveauxcombats,lesveilleursdumondemoderne.
Mots-clés: romaingary,vercors,résistance, idéalisme,deuil, cy-nisme,roman,engagement,communisme,après-guerre
onnepeutque s’étonnerdevant le contrasteentre lapremièreœuvrederomaingary,écriteenpleineguerre,en1943,éducation européenne(publiéeenanglaisen1944etenfranceen1945),etlaseconde,tulipe,écriteàpeineunanplustard,en1944-45etpubliéeen1946.Lapremièreestunefableidéalistesurlarésistance,dontl’humourparfoisdécapantn’entamepasl’idéalisme.Lasecondeestunefarceprovocante,profondé-mentdésespérée,oùunpersonnageseforceaucynismepours’adapteraumonde,avantdeselaissermouriraunomd’unidéalintrouvabledel’homme.etpourtant,entrelesdeux:lavictoiresurlesnazis!aulieud’apporterl’espoiretdeconforteruneluttedanslaquelleilajouésavie,lavictoireprovoquechezgaryuneprisedeconsciencedouloureuse.
c’estquelavictoirequ’appelaitdesesvœuxlepersonnageprincipald’Éducation européenne,devenueréalité,n’aplusgrandchoseàvoiraveclavéritéquiétaitcelledesmaquisetdescombattantsdelafranceLibre.

Roumette J.
56
Ladistanceesttropgrandeaveclaréalitéd’uneaprès-guerrequibasculetrèsvitedansuneguerrefroidedont,jusqu’audébutdesannéescinquan-te,onpensequ’ellepeutdéraperversunenouvelleguerremondiale.decedécalagenaissentl’amertumeetl’humourférocedetulipe.
garyn’estpasseulàressentircetteamertume.c’estunsentimentestassezrépanduchezlesanciensrésistants.beaucouppréfèrentlesilence,seretirentdel’espacepublicetsetaisent.chezlesécrivains,raressontceuxquirestentfidèlesàunengagementmarquéparlefrontantifascistedesannées1930,dontlaguerrefroideafaitéclaterl’unité.unsignedecette fidélité fut lechoixparcertainsdeconserver leurspseudonymesdeguerre.ilsnefurentpastrèsnombreux.essentiellementdesmilitai-resoudescombattantsengagésdanslaluttearmée,quiaccolèrentleurpseudoàleurnomdefamille,commeChaban-delmas,Rol-tanguy,Le-clerc dehauteclocque,etc.raresfurent lessubstitutioncomplètentdunom.chez lesécrivains,ce futexceptionnel:deux,en fait,principale-ment:romankacewdevintromaingaryetJeanbruller,vercors.
Lespersonnalitésetleshistoiresdesdeuxhommessonttrèsdissem-blables,maisilsontencommund’êtrenéstousdeuxcommeécrivainsdeleurengagementdanslaguerre.cesontdeuxhéros,demanièresdif-férentes:garyfutuncombattant,décoré,compagnondelaLibération;vercorsn’apascombattulesarmesà lamain,mais il incarne,avec leséditionsdeminuit, larésistancespirituelleauxnazispendant l’occu-pation.ce sontdeux idéalistes authentiques, qui se sont engagésplusparidéalismequeparconvictionspolitiques.contraintsàfairelaguer-re,maisnel’aimantpas,ilsontpuisél’énergiedeleurcombatdansuneconceptiondel’homme:ilssesontengagésaunomd’unemorale.c’estpourquoilavictoireenelle-mêmenesuffitpasàlessatisfaire.pourdeshommescommeeux,lavictoiremilitairen’estpasunefinensoi,elledoitêtreelle-même jugéeà l’aunedecritèresmoraux. ilsnesontpasprêtsauxsimplificationsidéologiquesetalignementspolitiques.
d’oùleuramèredésillusion.Lesluttesidéologiquesdelaguerrefroi-de,qui s’attisentdès lesderniersmoisavant laLibération, lesconster-nent.Lasituations’aggravant,lesalliésd’hierdevenantlesnouveauxen-nemis,jusqu’aupointculminantdelatensionquefutlaguerredecorée,lescontraintaudeuildecequifutleurengagement,àlarupture,rapideouplusprogressiveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatdelafaillited’unidéalcommun.
cedeuil contraintde l’élanqui les avaitportés et avaitportéaveceuxtouteunegénération,lesmetaupieddeleurœuvre.ilexpliquedestrajectoirescréatricesquinecadrentavecaucundesmouvementslitté-rairesd’après-guerre.garycommevercorsnepouvaientsereconnaître

Romain Gary, Vercors et le deuil de la Résistance
57
Nasl
e|e 19
• 2011 • 5
5-6
6
nidans l’existentialisme,nidans l’absurde,nidans lenouveau roman,encoremoins dans quelque forme de roman réaliste socialiste que cesoit,mais seulementdansune fidélité àune formede lutte spirituelleélaboréependantlaguerre–fidélitéquiacontribuéàfaçonnerleures-thétique.c’estdeladifficultémaisaussidelaféconditédecedeuilquejevoudraisparler.
L’amertume de la victoire: le temps des ricanementsgary a vécu pour la secondeguerremondiale quelque chose de
comparableàcequ’ontvécupourlaguerred’espagnegeorgesorwell(hommage à la Catalogne)etarthurkoestler:ilsensontsortisavecuneméfianceredoubléepour lesmanœuvrespolitiquesqui instrumentali-sentcyniquementl’idéalismeàdesfinsdepouvoir.garyenafait l’ex-périence avec le sortde lapologne à la finde la guerre. il a vécu sespremièresannéesdansunevillequiétaitalorspolonaise, sous lenomdewilno(aujourd’huivilnius),etquiétaitunsymboledunationalismepolonaisdel’entre-deuxguerres.davidbellosabienmontrécommentgaryreprendengrandepartieàsoncomptecenationalismedans édu-cation européenne (bellos2004:155-156).La façondont lesalliésontabandonnélapologneà l’unionsoviétiqueen1945aétépourluiunecruelle leçon.Leçonbientôtredoublée,enbulgarie,quand,enposteàl’ambassadedefrance,ilassisteauxpremièreslogesàlaréalitédupou-voirstalinien.
L’idéemaîtressedetulipeestquelavictoirenerèglerien:«Lorsqu’uneguerreestgagnée,monmaître,cesontlesvaincusquisontlibérés,paslesvainqueurs.»(gary1946:24).Lepersonnagelanceunegrèvede lafaimavecleslogan:«prièrepourlesvainqueurs»(gary1946:55):«nousvenonsdegagneruneguerreaunomdelacivilisationmenacéeetdéjà,surlesruinesdenosvilles,planel’ombred’unenouvellecroisadepourdéfendrelacivilisation.[…]j’aicommencéunegrèvedelafaimpourprotester contre la civilisation, exiger son abolition immédiate et sonremplacementparungrandmouvementdepitié,decompréhensionetdesolidaritéhumaines.»(gary1946:54).
pourgary,c’esttoutel’époquequiestmarquéeparlarancœur.dansLes Racines du ciel,écritaudébutdesannéescinquante,publiéen1956,aprèslamortdestaline,ilfaitlebilandecettepériode:
sil’attentatcontreornandoavaitprovoquéuntelintérêtdanslemonde,cen’étaitpastellementàcausedelapersonnalitédelavictime,maisparcequelapeur,larancuneetlesdésillusionsavaientfiniparmarquerlecœurdemillionsd’hommesd’unepointedemisanthropie.(gary1956:82)

Roumette J.
58
ce sentiment d’amertume n’est pas limité aux anciens résistants,maisillestouchesansdouteplusviolemmentqued’autres,àlamesuredessacrificesaccomplis,etdesespoirsmisdanslalutte.
àdirevrai,cetteincompréhensiondatedelaguerre–lenombredescamaradestombésacreusélefosséentreceuxquisesontengagésetlesautres.àlafind’éducation européenne,undialogueentrelehérosetunpartisanmouranttirelaleçondésespérantedelaguerre–anticipationd’uneluciditéquin’auraquetropl’occasiondesevérifier:
–parle-leurdelafaimetdugrandfroid,del’espoiretdel’amour…–Jeleurenparlerai.–Jevoudraisqu’ilssoientfiersdenousetqu’ilsaienthonte…–ilsserontfiersd’euxetilsauronthontedenous.–essaye…Jevoudraisqu’ilsnerecommencentjamais…–ilsrecommenceront.–ouvre-leurtonpoitrail…tonpoitraild’homme…–ilsnevoudrontpasregarder.ilspasserontàcôté,leslèvresserréesetleregardfroid.
–essaye…(gary1946:177)ceregard froidnequitterapasgaryaprèsguerre.ilhantesesrécits.
garys’yheurteavecuneviolencedésespéréeaussibiendanstulipequedansLe grand vestiaire ouLes Couleurs du jour.Lesentimentque lesmeilleurssontpartisetquelalutteabeauêtrevictorieuse,ellenechan-gerapas lanaturehumaine est désespérant.dans les romansd’après-guerrederomaingary,leshéros,retirésdudevantdelascène,reléguésdanslesmarges,setaisentou…sesuicident.moralementcommeLucmartin, à la findugrand vestiaire, ouphysiquement commerainierqui,àlafindesCouleurs du jour,partsefairetueraufront.
vercors,delamêmefaçon,constateavecuneluciditédésabuséel’isolementdesanciensrésistantsdanslesannéesd’après-guerre.dansunromanécritetpubliéàpeuprèsaumêmemomentqueLes Couleurs du jour,en1951,La Puissance du jour–titrequisonneprochedeceuxdegary–,vercorsmetenscèned’anciensrésistantsdontleréseaudis-persésereformepourenleverunancienpréfetcollaborateurquialivrédenombreuxrésistantsàlagestapoetqu’unnon-lieuvientdelibérer.L’actionsedérouleen1946.elleestl’occasiond’uneétudedesdifficul-tésquisurgissententrelesancienscamarades,delafaçondontilsfontfaceàunmondequiachangé.Leshérossontdevenusmarginaux,plu-tôtcraintsqu’admirés.malgrélavictoire,ilsontl’impressiond’avoirétévaincus:

Romain Gary, Vercors et le deuil de la Résistance
59
Nasl
e|e 19
• 2011 • 5
5-6
6
ce n’est pas par hasard que nous sommes entourés par cet oubliétrange,vraimentextraordinaire,n’est-cepas?quandonysonge,qu’onnousignore,qu’onnouslorgneavecinquiétudequandonnesedétournepasdenous:c’estquelaparolequenousreprésentonsestrude,épineuse,confuse,obscureetpénible.(vercors2002:502)
Lafindelaguerreajouteàcetteamertumeladissolutiondelafra-ternitécombattante.toussaventquelapuretédésintéresséequifutcelledeleurcombatestperdueaveclafindelaguerre:«omesamisoserai-jevousledire?cebonheur,aujourd’hui,j’aipeurdeleperdre»,écritver-corsdansLes Lettres françaises fin1944(vercors2002:759),aumomentoùgaryrédigetulipeetsedéfendcontreunsentimentsimilaireparsessarcasmes.Lesbrouilles,lesmalentendusetlesdivergencespolitiques,lafindel’actioncommune,dispersentlesréseauxetlesamitiés.L’intensitédel’élanaététellequ’elleplongetoutlerestedansl’ombre,etl’amertumemenacedetoutsubmerger,faisantécranaveclavie.
La tentation du cynisme cette situation comporte un danger: la désillusion et l’amertume
peuventconduireaucynisme.garyafortàfairepoursedéfendrecontrecequiestunevéritabletentation.Lespersonnagesdesespremierstextessedébattentavecellecommedebeauxdiables:tulipe,Le grand vestiaire,Les Couleurs du jourracontentlespéripétiesdesluttesd’idéalistesdéçusquitententdedevenircyniquesparréalisme,pours’adapteràlaréalitéde la nature humaine. «tu crois que les hommes, ça existe ?» (gary1948:168)demandelehérosdugrand vestiaire,quicherchedesmainstenduesetdesvisagesetnerencontreleplussouventquedesdéfroquesvidesd’humanité.«L’hommeçanesepardonnepas!»(gary1948:304)est la formuleconclusivedurécit,qui seclôtparuneexécution,balledans lanuque.alors qu’audébut le cynismedu jeunehomme fuyantlecamaradedesonpèren’étaitqu’uneformederévolte,plutôttoniqueetdestinéeà faire tomber lesmasques, leralliementcyniquefinalà labassessehumaineestenvoyéenpleinvisagedulecteur,enungestederancuneprovocatriceetagressive.
‘fairehonteauxhommes’,commel’envisageaitlenarrateurd’éduca-tion européenne,peutdevenir:fairehonteaulecteur.danslerappeldesnomsetdeshistoiresdescamaradestombésaucombatdansLes Cou-leurs du jour,ilyadel’agressivité.L’hommageestrancunier,contraire-mentàceuxdela Promesse de l’aube.Lesouvenirdesmortsestfaitavecunecertainehauteurpourun lecteur supposéoccupéà ses affaires etindifférentauxsacrificesfaitsparlesautres:

Roumette J.
60
Lecommandantgoumencaobtenualorsdefairecequ’onappelleunemissionde sacrifice–nedemandezpas ceque c’est, c’estpasdesimpôts,entoutcas–etsefittuersurlacrètepourracheterça.(gary1952:68)
gary,parl’intermédiairederainier,envoieauvisagedulecteursonstatutdehéros,pasmécontentdeletancerunpeu:«dites-vousbiencecimespetitsmoutons…»(gary1952:70).danslahainedes«planqués»,lafraternitémilitairerestetrèssensible.
cestroisrécitssontdesfuitesenavant.àceniveaud’exaspérationetd’amertume,onpeutsedemandercommentgaryapucontinueràécrire,commentilapunepas,commecertainsdeseshéros,rechercherlamort.
symboliquement,dansLes Couleurs du jour,unegénérationsesui-cide.elles’apprêteàdisparaîtresurunderniercoupd’éclat,maisincom-priseparlagénérationsuivanteetdansl’indifférence.c’estlamortdelagénérationdeshommesdegaucheforgéedanslescombatsdesannéestrente et de la guerre. L’impasse romanesque de l’œuvre est à l’imaged’uneimpassepolitique.elleappelleàunnouveaudépart,fautedequoi,l’exaspérationetl’amertumemenacentdecondamnerl’écrivainausilen-ce,deparalysersacréation.
Le deuil du messianisme révolutionnairepenserl’humanitéentrel’idéald’unefraternitégénéreuseetunemé-
fiancegénéraliséeenversleshommes,c’estlatâchecompliquée,presqueimpossible,desrésistants après-guerre.commentmaintenir vivant lelienquiaéténoué?commentétablirourétablirlaréalitéagissantedel’horizonfraternel?
garyetvercorsmènentuntravaild’orientationpendantcesannées,chacundesoncôtédansuncheminementessentiellementsolitaire.nonseulementilsnerenoncentpasàleursidéaux,maisilsrefusentd’enra-battreaunomdequelque«réalisme»politiquequecesoit.pouréviterdesedéfiniruniquementencontre,d’êtreacculésaurefusetà laran-cœurcontreunmondequin’estpasceluipourlequel leurscamaradesontdonnéleurvie, ilspoussentplusloinl’universalisationducombat.ilsposentlaquestiondel’engagemententermeséthiquesdeplusenplusgénéraux,afindenepasresterenfermésdanslescombatsdeleurgéné-ration–pourlesquelslesclivagessontmarquésetnes’effacerontpas–etdes’ouvriràceuxdesgénérationssuivantes.
Les lignesbougentvite.Laguerre froideaccélère ladésagrégationdel’unitéanti-fasciste.Laréorientationaccompagnelaruptureavec lestalinismeduparticommuniste.pourcertainsdeceuxquis’enétaient

Romain Gary, Vercors et le deuil de la Résistance
61
Nasl
e|e 19
• 2011 • 5
5-6
6
rapprochéspendantouaprèslaguerre,voireyavaientadhéré,letour-nantdesannéescinquantesonnel’heuredesexclusionsoududépart:ediththomasquittelepcen1949,vercorssignifierapubliquementsaruptureen1957dansP.P.C. (Pour Prendre Congé).Laguerredecorée,parcequ’ellesembleêtreledébutd’untroisièmeconflitmondial,estuntournanthistorique.degrandesfigureslittérairesde«gauche»,commeJohnsteinbeck,soutiennent l’interventionarméeencoréeaunomdel’antistalinisme.garyréagitdelamêmefaçondansLes Couleurs du jour,oùd’anciensdelafrancelibrepartentsebattresousledrapeaudesna-tionsunies.
au-delàdesprisesdepositionpolitiques,ledeuildelafrancelibreetdelarésistanceestaussiledeuild’uncertainmessianismerévolution-naire.La ruptureavec lescommunistesentraîne la finde lapoursuited’unidéalquipourraits’incarnerhistoriquement.cequiconduitgaryetvercors àopérerundéplacementdu terrainde l’idéalisme.avec laguerre,c’est lechamphistoriquetoutentierquidevientsuspect: l’his-toireestpiégée,elleseretournecontreceuxquilafont,mêmeaunomdevaleursjustes:«L’histoireafiniparnoussortirparlesnarinesetsielledoitcontinuersurlaterre,aumoinsquecenesoitpascheznous.»(gary1952: 202), positionqui est celle decamus égalementdansL’homme révolté(publiéen1951)etdontrogergrenieranalyseainsilesmotiva-tions:
Laguerre contre lesnazisneprêtaitpas àdiscussion, car elle était sansambiguïté.elleétaituncombatcontrelemal.Lemondenouveau,c’estlapeuratomique,lestalinisme,laguerrefroide,leproblèmecolonial,lescasdeconscienceposésparlesprocèsd’épuration.ondécouvrequ’aunomdel’histoireetdelarévolution,desmilliers,desmillionsd’innocentspeuventêtre anéantis. camus voit les intellectuels s’engager dans l’historicisme,expliquer ou justifier la terreur, les procès demoscou, voire les campsstaliniens,dontoncommenceàparler.ilnepeutadmettreladivinisationdel’histoire,quisembleprendrelerelaisdelareligion,defaçontoutaussiécrasantepourleshommes.(grenier1987:238)
La fin des perspectives révolutionnaires concrètes, qui sombrentdans lesprofondeursde l’établissementd’unnouvel empire totalitaire,lesrusescruellesdel’histoireimpliquentd’inventerdenouveauxmodesd’articulationdupolitiqueetdel’actionindividuelle.Laluttepourlajus-ticechangedeforme.
dansL’homme révolté,camusdistinguelarévoltedelarévolution,pourenfaireuneposturevitalequidépasselecadrepolitiqueethistori-que:«L’hommeestlaseulecréaturequirefused’êtrecequ’elleest.»(ca-mus1951:24).c’estcequevercorsappelle«Laséditionhumaine»,dansPlus ou moins homme, recueild’articlesparusdans lesannéesd’après-

Roumette J.
62
guerreréunisenunensemblecohérenten1950:«danslegrandcirqueuniversel,lanatureetl’hommesontauxprises.avantdes’êtreéveilléàsacondition,l’anthropoïdeétaitunmorceaudenaturecommelesautres.sans sécessionet sans révolte,pointd’hommes.cequicrée l’homme,c’estsaluttecontrelanature.»(vercors1950:47),natureétantprisiciausensdeloiduplusfort,loidelajungle.
La «marge humaine»maiscamus,enfocalisantledébatsurlaquestiondumeurtre,du
terrorismeetdesdéviationsdel’idéalisme,atendance,toutcommesar-tre,maisavecdespositionsdifférentes,àcontinueràcreuserlesdébatsdel’entre-deux-guerres.ilconstruitsonessaicontrelestalinisme,avecunecertaineefficacité.mais,cefaisant,ilresteprisonnierdetermesdudébatquiremontentenfaitàlafindu19èmesiècleetàdostoïevski.Labasede sa réflexion, cequidéfinit les termesde saproblématique, cesontlesnihilistesrusses.
c’estprécisémentàcettefaçondeposerledébatquetententd’échap-pergaryouvercors.cecombat,ilsl’ontdéjàlivréetilsneveulentpasêtretransformésenreprochesvivants,endonneursdeleçons,bref:enancienscombattants.poureux, la légitimitéde l’actionetde larévoltenefaitaucundoute.Leproblèmen’estpaslà.Làoùsartresefaitbrillam-mentdesnœuds,dansLes mains sales (1948),parexemple,garynevoitqu’unelignedroiteetclaire.L’événementl’amisàl’épreuve,etill’asur-montée.demêmepourvercors.mais,pourl’avoirvécu,ilssaventbienlafragilitéd’unerévoltefondéeuniquementsurdesmotifspolitiquesethistoriques.ilssaventqu’iln’yadevictoirequeprovisoiresurceterrain.Lapossibilitéduretournementdel’idéalismeenterreurn’estpasl’abou-tissementmaislepointdedépartdeleurréflexion:avoirétécontraintaucombatétaitdéjàuneformederenoncement.mêmesicesquestionssontimportantespoureux,cen’estpasversellesqu’ilsoriententleurré-flexion,cen’estpasd’ellesqu’ilsattendentuneouverture.
ilsréagissentenécrivains.ilssaventquec’estsurleterraindelafic-tionqu’ilspourrontagiraveclaplusgrandeinfluence.tousdeuxseré-clamentdesromansde Josephconrad,notammentparcequecelui-cifaitdelanoblesseindividuellelaquestionessentielle.ilscentrentleursrécitssurdesparcoursindividuelsquinesedissolventpasdansdescom-batscollectifs.Leursfictionssontdesuniversdefrancs-tireurs,solitairespointilleuxetintraitables.Lafraternité,dansceshistoires,estlaconsé-quenced’unequêteindividuelledenoblesse.
pour sortir du champ strictement politique, ils élargissent la ré-flexionsurl’engagementenreplaçantl’hommeaumilieudelanatureet

Romain Gary, Vercors et le deuil de la Résistance
63
Nasl
e|e 19
• 2011 • 5
5-6
6
desautresespècesvivantes.cen’estpluslerapportdésespérantàl’his-toire,mais le rapportdeshommesauxanimauxquidevient le testdel’humanité.cedéplacementestdécisif.sortirduchamphistoriquepourposerlaquestion«qu’est-cequel’homme?»,leurpermetd’échapperauxtermesidéologiquesquiontconfisquéledébatetl’ontperverti.
Les deux écrivains ont compris qu’il leur fallait poser l’enjeu dela discussion sur la nature humaine, non pas abstraitement,mais parlesconséquencesconcrètesdeces idées.Leurbutestmoinsdefonderunethéorie,quoiquevercorss’yessaiedansPlus ou moins homme,qued’écriredesrécitsquipermettentdedéplacerleslignesfigéesdel’affron-tementidéologique.vercorsetgaryfontcedéplacementd’angleàpeuprèsaumêmemoment,audébutdesannéescinquante.
dansLes animaux dénaturés,paruen1952,vercorsprenduncasextrême:dansuncontequiemprunteàlascience-fiction,ilenvisagedesêtresdontils’agitdedéciders’ilssontdeshommesoudesanimaux.L’in-certitudede la frontière entre les espèces conduit à s’interroger sur lanaturehumaine.gary,dansLes Racines du ciel,en1956,plusclassique-ment, invite leshommesàseregarderdans leurrapportauxanimauxsauvagesetày lire leur inhumanité.Ladéfensedeséléphantss’appuiesurl’idéedecequ’ilappelaitdansunentretienen1957,«unemargehu-maine»àtoutengagement(gary2005:20).Laplaceaccordéeauxani-mauxvalideuneréflexiongénéralesurl’homme,l’idéalisme,sesformesetseslimites.
Lesdeuxromansontbiendespointsencommun:unpetitgroupeimpporbabled’idéalisteschercheparsonactionàposerlaquestiondesvaleursendéfendantunecauseapparemmentmarginale.Lespersonna-gesduromandevercorsprésententunevariétéd’idéalistesquin’estpassansrappelerlepetitgroupequegaryrassembleraautourdemorel:unreligieux,unsavantunpeuâgémariéàunefemmejeuneetpassionnée,un journaliste,unchercheurbourru.L’actionestprincipalementnon-violente: lespersonnages agissent sur les espritspardes actes symbo-liquescapablesd’influencerl’opinionetdefairechangerleschosespardesmoyensessentiellementpacifiquesplutôtqueparlaviolence.Lere-coursàlaviolenceestminimal,réduitaustrictnécessairepourcréerlesconditionsd’undébatgénéral.cefaisant,vercorscommegarypensentl’engagementensortantducadreguerrier, imaginantdes luttesquinepassentpaspardescombatsmilitaires.
dans Les animaux dénaturés comme dansLes Racines du ciel, lapressejoueunrôledécisif.desarticlesdepressefictifssontcitésetcom-mentés.Lesdeuxromansmettentenscènelerôledel’opinionpublique,desrelaisjournalistiques,desréactionsdetoutessortesd’associationset

Roumette J.
64
deligues.ilsdépeignentl’universalisationencoursdescausesetdeslut-tes.garyinsisteplussurlesrelaismodernesdel’information,vercors,surl’appareiljudiciaireanglaisoùs’élaboreunembryondejusticeinter-nationale.cesontdessortesd’épopéesmodernes,nonguerrières,avecunhérosquisedétacheetremporteunebatailleessentiellementsym-bolique,maisqui,commetouslessymboles,estdestinéeàinfluersurlaréalitédefaçonbienplusprofondequ’aucuneguérilla.
Larévoltedeshérosconserveunedimensionindividuellejusqu’aubout:ils’agitdetoucherleplusgrandnombre,pasdecréerunmouve-mentquilesembrigade.celaconduitàuneformed’actionquelesoucid’efficacitédétournedelaluttearméepourutiliserlesarmesmodernesetautrementpuissantesdel’arènemédiatiquemondialealorsenconstruc-tion.
Lavictoiren’estqu’unedemi-victoire,danslesdeuxromans,defa-çonexemplaire: lecombatrestetoujoursàmener.Lamoralequever-corsinscritàlafindesonromanéclairesingulièrementLa Promesse de l’aube:ilycélèbrelagrandeurdel’échec,lapartdevictoirequ’ilyaàêtrevaincuensachantlalégitimitédecepourquoions’estbattu.
Jenemerappelleplusquiaécrit:«ceseraittropbeaudemourirpourunecausetoutàfaitjuste!»c’estvraiqu’iln’yenapas.Lacauselaplusjustel’estgénéralementpar-dessuslemarché.ilfauttoujourspourlasoutenirefficacement ces intérêts que vous appelez sordides.mais vous etmoi,noussavonsdésormaispourquoicettequalitéestinscritedanslaconditionhumaine–etloindel’avoirchoisie,c’estcontreellequenousluttons.ainsiladignitédeshommesrésidemêmedansleurséchecs,etmêmedansleurschutes.(vercors1952:213)
parsesactes, l’hommeengagesadignité.«L’humanitén’estpasunétatàsubir.c’estunedignitéàconquérir.dignitédouloureuse.»cetteluttenepeutdoncavoirdefin.Ladignitéhumaineremiseencauseenpermanence,commeundéfiàrelever.
enfin,l’humourlesrapproche.ilcontrebalancelepathétique.Leré-citdevercorsestprocheduconte, c’estuneœuvrepluscourteque leromandegary,danslatraditiondel’humouranglais,celuideswift.dèsqu’ils’agitdesprincipes,ladiscussiondevientâpre.vercorsmetenscènel’ironie,lecynisme,lamauvaisefoi,leracisme.L’humour,parfoissarcas-tique,tourneendérisionlesstéréotypes.Lespositionssontcaricaturées,l’humourdevientunattributducourageetdel’intelligence.
«vousavezinquiétélesgens»:c’estainsiquelejugefélicitelehérosdesanimaux dénaturés, «vousleuravezmislenezdansuneinconce-vablelacunequiduraitdepuisdesmillénaires»(vercors1952:215).in-quiéter,c’estbien lerôlequesedonnent lesdeuxécrivains.contre les

Romain Gary, Vercors et le deuil de la Résistance
65
Nasl
e|e 19
• 2011 • 5
5-6
6
certitudesapparentesdelavictoire.avecladistancedel’humour,sansfairelaleçon:trouble-fêtes,ilsveulentprovoquerleurslecteurs,dansungestedeconfianceenl’homme,lesamenersurleterraind’unefraternitéquinesoitpasunsloganmaisunpartaged’intelligenceetdebonté.
Les veilleursdifficiledecroirequegaryn’aitpas étéattentif à l’évolutiond’un
écrivainaussiindépendantetaiguquevercors,posantlesgrandesques-tionsdansdestermesaussiprochesque lui.mais il importemoinsdereleverd’éventuellessourcessurteloutelpointdedétailqu’unecommu-nautédepensée.c’estenécrivainsquevercorsetgaryfontleurdeuildelarésistance.undeuilquin’impliqueaucunreniement,maisundé-placement,unesortiehorsdel’histoirequileurpermetdetrouveruneparolequidéjouelespositionnementsidéologiques.ilscréenten-dehorsdescampsenprésence,desailleursoùlavoixdel’idéalismequifutleleurpendantlaguerretrouveunenouvellevigueur.parcequ’ilsparviennentànepasse laisserenfermerdans lerôlede lastatueducommandeur,ilsnouentlecontactaveclagénérationsuivante.passerdudiscoursàlafable,plusencoreàlalégendeouaumythe,estlaclédeleurévolution.dépayserl’idéalismepourl’allégerducontextehistorique–pourmieuxyrevenirparuneffetboomerangquele lecteurest invitéàaccomplir.cetteinvitationàlatranspositionchangetotalementleton:ledonneurdeleçonsetransformeenconteuretc’estlelecteurquitirelamoraledelafable.cequiétaitsubidevientunedémarchepersonnelle,augmentéeduplaisird’entrerencomplicitéavecl’auteur.ànotretourd’interpréterl’aventuredemorel,ànotretourdeprendrepartidansleprocèsdestro-pis.invitationscourtoisesqu’ilestdifficilederejeter.bienplus,auxquel-lesilesttentantdecéder.
fidèlesàuneesthétiquenonformaliste,ilsdéfendentuneconcep-tiondu récitqui leuravalud’êtremarginaliséspar lemilieu littérairedutemps.maisilsontchoisicetteplace.celaneveutpasdirequelesquestionsdeformenelespréoccupentpas.ilsserevendiquentd’autrestraditionsnarratives.ilsimportentdestonsquinesontpashabituelle-mentceuxde la littératurefrançaise: l’humourjuif,pourgary,avec latraditionhumoristiquerusse,celledegogolnotamment,unhumouretunstyledetextetrèsanglaispourvercors.
Les Racines du ciel,toutcommeLes animaux dénaturés,sontlerêvedurôlequelesanciensdelarésistanceetdelafrancelibreaimeraientjouerdanslasociétéd’après-guerre:celuid’êtrelefermentàpartirduquellèverontlesnouveauxcombats,êtredesveilleursdumondemoderne.

Roumette J.
66
Bibliographie
bellos2005:d.bellos,Lemalentendu:l’histoirecachéed’éducation européen-ne,in:p.audi,J.-f.hangouët(dir.), romain gary, cahierdel’herne,paris:édi-tionsdel’herne,150-168.camus1951:a.camus,L’homme révolté,paris:gallimard.gary1945:r.gary,éducation européenne,paris:calmann-Lévy(éditionori-ginale).gary1946:r.gary,tulipe,paris:calmann-Lévy.gary1949:r.gary,Le grand vestiaire,paris:gallimard.gary1952:r.gary,Les Couleurs du jour,paris:gallimard.gary1956:r.gary,Les Racines du ciel,paris:gallimard.gary2005:r.gary,L’affaire homme,paris:gallimard.grenier1987:r.grenier,Camus ombre et lumière,paris:gallimard.orwell1938:g.orwell,homage to Catalonia,London:martinsecker&war-burgltd.vercors1950:vercors,Plus ou moins homme,paris:albinmichel.vercors1951:vercors,La puissance du jour,paris:albinmichel.vercors1952:vercors,Les animaux dénaturés,paris:albinmichel.vercors1957:vercors,P.P.C.,paris:albinmichel.vercors2002:vercors,Le silence de la mer et autres œuvres,alainriffaudéd.,paris:omnibus.
Жилијен РуметРОМЕН ГАРИ, ВЕРКОР И ЖАЛ ЗА ПОКРЕТОМ ОТПОРА
РезимеРомен ГарииВеркор су посталиписци у току рата, у ком су обојица били хероји.
Мадасувеомаразличитихтемпераменатаикретања,заједничкоимјештосу,послерата,осталиверниидеалимаПокретаотпораислободнеФранцуске.Алиуконтекстухладнограта,билоимјепотребнодаизразежалзаПокретомотпора.Уместодапобегнууцини-зам,онитугујузареволуционарниммесијанствомизамишљајуусвојимпричамановеимирнеобликеборбе,којиихнаводеданановостворесвојидеализамнауниверзалнијимосновама,бранећионоштоГаризове„људскамаргина“усвакомангажовању.Великиро-маникојисуобележилипојављивањетогжала,ВеркоровеИзопачене животиње(1952)иГаријевиКорени неба (1956),наликсуснукојисуовибившиприпаднициПокретаотпорастворилиосвојојулозиудруштвунаконрата:дабудусеменовихбитака,ичуваримо-дерногсвета.
Примљено: 01. 03. 2011.

67
УДКрад
Katarina MelićFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
SEBALD ET MoDIANo, ArchéoLoGueS De LA MéMoIre
patrickmodianoetwinfriedgeorgsebald appartiennent à la gé-nérationdel’aprè-guerreetsefontundevoirdedirelapériodetroublede l’occupationenfranceet lespersécutionsnaziesenallemagne,decontrerlesilencedel’absence.questionnantl’histoireetsareprésenta-tionofficielle,enquêtantsurlepassé,àlaquêted’unemémoireaumoyend’uneécriture,fouillantdanslesarchives,ilstissentdestextesdansles-quelsilsdonnentplaceàceuxauxquelss’intéressedeplusenplusl’his-toriographie postmoderne, à savoir les «gens communs».nous allonsévoquerdeuxtextescontemporains–dora Bruder(1999)demodianoetausterlitz(2002)desebald,quiontpourthèmelashoah.ils’agirad’ex-plorercommentcesdeuxœuvresmélangentfictionetdocuments/archi-vespourquestionner l’histoireet lamémoirede l’histoire,etessaientdedirecequelaréalitédecestempsquel’histoireofficielleatendanceàoblitérer.peut-onretrouverlamémoired’unpasséoblitéréetdélibéré-mentenfoui,quellesreprésentationsdelamémoiresont-ellesdéployées?nousallonsessayerderegroupernosréflexionsselonlerapportsuivant:mémoireréelleetmémoirefictive.
Mots-clés: histoire, guerre, holocauste, mémoire, oubli, oblitéra-tion,traces,documents,identité,biographie,autobiographie
«enécrivantcelivre,jelancedesappels,commedessi-gnaux de phare dont je doutemalheureusement qu’ilspuissent éclairer la nuit.mais j’espère toujours.» (mo-diano,dora Bruder)
ce commentaireméta-textuel tiré du roman dora Bruder de patrickmodianodonneunéclairage sur l’œuvredepatrickmodianoetwin-friedgeorgsebald.cesdeuxécrivainsappartiennentàlamêmegéné-ration,cellequiagrandieaprèsladeuxièmeguerremondiale.bienquenés tous lesdeux juste juste avant et après la finde la guerre, ilsn’en

Melić K.
68
sontpasmoinsimpliqués(in)directementetrefusentderesterindiffé-rents.ilssefontundevoirdedirelapériodetroubledel’occupationenfranceetlespersécutionsnaziesenallemagne,decontrerlesilencedel’absence.nousallonsévoquerdeuxtextescontemporains:dora Bruder demodiano(1999)etausterlitz (2002)desebald,quiontpourthèmelashoah.Lesdeuxtextes–aucunneportelamentionde«roman»–seveulent êtredes enquêtes etdes récitsd’enquêtes etprésententdes si-militudes.d’ailleurs,leschémadelaquête/enquêtestructurelaplupartdesécritsdemodianoetdesebald,plusoumoinsautofictionnels.chezsebald,commechezmodiano,c’est lehasardquidicte lanarration. iln’yapasdetramepréétablie,seulementdesdéviationsaugrédesren-contresoudessouvenirs.ilyaunautrepointdeconvergencechezcesdeuxécrivainsquiestceluide leurmodede fonctionnement: la fron-tièreentrelemonderéeletlemondefictifestsouventfloue.danslesdeuxœuvresétudiées, il s’agirad’explorercomment sontentretissés lafictionetlesdocuments/lesarchivespourquestionnerlareprésentationdel’histoire,etexplicitementetimplicitement,celledelamémoirequiserévèleêtrelacunaireetvague,etdevoirdonccommentmodianoetsebaldfusionnentlafictionetlaréalitéafind’accéderàunereprésenta-tiondel’histoire.
MÉMOIRE RÉELLE, MÉMOIRE FICTIVE – RÉCIT FACTUEL, RÉCIT FICTIONNEL Du plus loin de la mémoire modianienne
dansdora bruder,lenarrateur,quipourraitêtrepatrickmodiano,enquêtesur lafugued’unejeunefille juiveàparisen1941.ilaapprissonexistenceetsadisparitiondansunvieuxjournaldu31décembre1941,en tombantsurunavisderecherchedans larubrique«d’hieràaujourd’hui»:
«parisonrechercheunejeunefille,dorabruder,15ans,1m55,visageovale,yeuxgris-marron,manteausportgris,pull-overbordeaux,jupeetchapeaubleumarine,chaussuressportmarron.adressertoutesindicationsàm.etmmebruder,41boulevardornano,paris.»(modiano1999:7)
desdécenniesplustard,lenarrateurrépondàl’appeletrédigesonenquêtequiaccumulelesmorceauxd’informationausujetdela jeunefille.Letextemodianienestdoncunjournald’enquêteoùsontnotéslesinformations,lesréflexionset,biensûr,lesdoutesquiontjalonnélesre-cherches.Lenarrateurreconstituepetitàpetitleparcoursdedoradansparisetdressesonportraitouplutôtdesfacettesdesonidentité.c’estun

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
69
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
récitfactuelcarlajeunefilleaexisté,elleestnéeetavécuàparisavecsesparentsimmigrésd’autricheetdehongrie,ernestetcécilebruder.danscetavis, le lecteurapprendqu’elleafaitunefugueetqu’elleétaitrecherchéeparsesparents.arrêtée,elleaétéinternéeàlaprisondetou-rellesle19juin1942ettransféréeàdrancyle13aoûtdelamêmeannée.elleaquittédrancyavecsonpère,arrêtéluiaussi,dansunconvoipourauschwitz.samère,arrêtéele16juillet1942,lejourdelagranderafle,aquittédrancydansleconvoidu11février19431.aucund’entreeuxn’estrevenud’auschwitz.
L’effort du narrateur qui constitue le récit, consiste à rendre sonhistoireàcette jeunefilledontonsaitseulementqu’elleavécuàparisetquesonseulcrimeétaitd’êtrenéejuive.Lacritiquel’asouligné–lepatronymededorabruder,frèreenallemand,asansdoutedéterminél’attentiondemodianoquines’estjamaisconsolédelamortdesonfrèrecadet,rudy.Lenarrateursemetàlarecherchedetouteslestracespos-siblesdelajeunefille:datedenaissance,lieuxettempsdescolarisation,adressesderésidences,circonstancesdesesfuguesetdesonarrestation.Lareconstitutiondelaviefactuellededorasefaitprogressivementaufildesdiversesdécouvertesfaitesparlenarrateuroufourniespard’autrespersonnes.modianofaituneenquêteminutieuseetdifficile,rassembleleschaînonsmanquants,émetdeshypothèsesetdesdoutes;ilconstruitunrécitenlivranttoutcequ’ilsaitenseservantducontextehistorique.
commepourunrécithistorique,lelivredonnebeaucoupdedates:l’étatcivildedoraetdesesparents,lesdatesdesloisanti-juives,rapportsdatés,etc.restituantunrapportadministratifconcernantlesfouillesdesinternésdans lescampsdedrancyetdepithiviers, l’écrivainaccréditeladémarchehistoriquedesonnarrateur.Lespiècesd’archivesquisontconvoquées,participentàlaconstructiondutextecarellesreprésententdesfondementssurlesquelss’appuielenarrateurpourraconterl’histoirededora.cesontaussidesindicesquiapportentunecrédibilitéhisto-riquemarquantlavraisemblancedel’histoirequeracontelenarrateur.apartirdecesarchivesdedecesinformations,lenarrateurcomblelestrous et lesblancsdans sondiscours, interroge ceque les archivesnedisentpas,cequ’elleslaissentdansl’incertain.Letextefaitaussipartdeséchecsdesarchivesàdireleréel.L’enquêtemontreleurcaractèrelacu-naire car lenarrateurn’arrivepasà trouver tout cequ’il cherchedanslesarchives, lesrapportset lesdossiersadministratifsquipeuventdis-paraîtreouseretrouverdansdesendroitsimprobables,tellelalettrede
1 unlecteuravertiremarqueraquelamèrededorabruderfaitpartiedumêmeconvoiendi-rectiond’auschwitzquelamèredegeorgesperec,cyrlaschulevitz,devenuecécileperecparsonmariage.

Melić K.
70
roberttartakovsky.L’écrivain-narrateurrecopiel’extraitdesmariagedesparents(modiano1999:26),l’actedenaissancededora(modiano1999:18-19),lapageduregistredel’internat(modiano1999:36),desextraitsduregistreducommissariatdepoliceetdelaprison(modiano1999:75, 112), des lettres adressées aupréfetdepolice (modiano1999: 84-86),undocumentdel’ugif2(modiano1999:87),lacirculairedu6juin1942(modiano1999:102-104),leregistredestourelles(modiano1999:112-113),lalettrederoberttartakovsky(modiano1999:121-127),etc.Lesarchivespeuventêtreaussisystématiquementdétruitescarcelafaitpartdesprocédures.Ladisparitionetladestructiondesarchivesmon-trentleurcaractèrefragmentaireettemporaire:
Leprocès-verbaldel’auditiond’ernestbrudernefigurepasauxarchivesdelapréfecturedepolice.sansdoutedétruisait-on,danslescommissariats,cegenrededocumentsàmesurequ’ilsdevenaientcaducs.quelquesannéesaprès la guerre, d’autres archives des commissariats ont été détruites,comme les registres spéciauxouvertsen juin1942(…)(modiano1999:76)
faceàladisparitiondesarchives,c’estàl’écrivainquepeutincomberlatâchedesefairegardiendelamémoire:
…etmaintenant,c’estnous,quin’étionspasencorenésàcetteépoque,quiensommeslesdestinatairesetlesgardiens(modiano1999:84)
ilnepeutaccepterquedesêtreshumainssoientrépertoriésdanslacatégoriedes«individusnonidentifiés»parcequecelavoudraitnierleurexistence:
rien que des personnes –mortes ou vivantes – que l’on range dans lacatégoriedesindividusnonidentifiés.(modiano1999:65)
aladifférencedesebald,modianon’insèrepasdesphotographiesmaisdécrit,parcontre,avecunegrandeprécisiondesphotosdedoraavecsamèreetdesagrand-mère:
J’aipuobtenirilyaquelquesmoisunephotodedorabruder,quitranchesurcellesquej’avaisdéjàrassemblées.(modiano1999:90)elle est en compagnie de samère et de sa grand-mèrematernelle. (…)doraestvêtued’unerobenoire–oubleumarine–etd’uneblouseàcolblanc,maiscelapourraitêtreaussiungiletetunejupe–laphoton’estpasasseznettepours’enrendrecompte.elleportedesbasetdeschaussuresàbrides.sescheveuxmi-longs lui tombentpresque jusqu’auxépaulesetsontramenéesenarrièreparunserre-tête,sonbrasgaucheestlelongducorps,aveclesdoigtsdelamaingaucherepliésetlebrasdroitcachéparsa
2 uniongénéraledesisraélitesdefrance.

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
71
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
grand-mère.elletientlatêtehaute,sesyeuxsontgraves,maisilflottesurseslèvresl’amorced’unsourire.etceladonneàsonvisageuneexpressiondedouceurtristeetdedéfi.(modiano1999:90-91)
ilfaitresurgirdanssonœuvretoutunpasséoulestracesdecemêmepassé–«ceblanc,ceblocd’inconnuetdesilence»(modiano1999:28)–quipourraient,unjour,s’évanouir.
silenarrateurs’interdittoutefoisd’inventer,lesquestionssurlesortdedoraabondent,ainsiquedesexpressionsquimettentendoutelafia-bilitédunarrateuretsoulignentlecaractèrehypothétiquedessupposi-tionsfaitesparlenarrateur,ainsiquel’impossibilitédetrouverdesré-ponses:«commentlesavoir?»,«quisait?»,«pourquellesraisonsexac-tes…»,«j’/onignore»,«j’hésite»,«jesuppose»,«j’essaiedereconstituer»,«jemedemandais»,«jedevine»,«jeserairéduitauxsuppositions»,«onnesaurajamais»,«sansdoute»,«peut-être»,«ilestprobable»,etc.malgréleseffortsapparentsdunarrateurpourfourniraulecteurlesdétailslesplusminutieuxdelavieetdudestindedora,sonrécitestfaitdebribesetd’anecdotesdécousues.devantlesilenceetl’absencedesarchives,lenarrateursetrouvesouvent,malgrésoninterdictiond’inventer,danslasituationdedevoirfairedessuppositionsetd’imaginer.Lelivredemo-dianorendpossiblelaprésencedel’absencededora,lafictionsedéve-loppantdanslescreuxdel’enquêtequiresteunequêteinachevée,lerécitfictionnels’entretissantaveclerécitfactuel.
enentrecroisantlesfilsdelavieded.bruderetdelasienne,l’ima-ginaire de l’auteur établit un parallélisme entre l’histoire de dora, lasienne,etcellefantasméedupèrejuifdunarrateur,obligédesecacher,survivantgrâceàdescombinesdouteuseetaumarchénoir.
Lenarrateurs’identifieàdora.ilpasse,defaçonarbitraire,durécitdesarecherchesurledestindedoraàdessouvenirspersonnelsd’en-fanceetd’adolescence,ainsiqu’àdespassagesquirelatentdesépisodesde laviede sonpèredurant l’occupation.Le«je»du narrateurparledesespropressouvenirsd’enfancedanscemêmequartierduboulevardornano,oùhabitaitdora:
J’ail’impressiond’êtretoutseulàfairelelienentreleparisdecetemps-làetceluid’aujourd’hui,leseulàmesouvenirdetouscesdétails.(modiano1999:50)
Lebutestdefairerenaîtrel’atmosphèredutempsdedora.parlantparexempledelafuguededoradupensionnatoùelleavaittrouvérefu-gedesraflesetdesinterpellationsallemandes,ilsesouvientdelasienneenjanvier1960.ilsupposequelesfugueursontlamêmesensationlorsdeleursfuites.ilssontpoussésparlagrisaille,parlefaitqu’ilssententunevivesolitudeetlasensationdesesentirbloqué.ilsvontàlarecher-

Melić K.
72
chedelalibertéetdel’amitié.audébutdesannéessoixante,l’auteurs’esttrouvéuneseulefoisdanssaviedansunpanieràsaladeavecsonpère.sesparentsétaientdivorcés,maisvivaientencoredanslemêmeimmeu-bleetsedisputaientpourlapensionalimentaire.Legarçonestalléchezsonpèreréclamerlasomme,lepèreaappelélapolice.ilestamenéavecsonpèreaubureaudans lepanieràsalade.Le filsa faillidemanderàsonpèrelescirconstancedel’embarquementdecelui-ciparlapoliceen1942,souvenirdeguerreracontéparlepère,unsoirdejuin1963,dansunrestaurantdeschampsélysées.ils’agitd’uneraflequiaeulieuaumoisde février1942. il imaginealorsunerencontreentresonpèreetdora:
danslepanieràsalade(…)ilavaitremarqué,parmid’autresombres,unejeunefilled’environdix-huitans.(…)monpèreavaitfaitàpeinementiondecettejeunefillelorsqu’ilm’avaitracontésamésaventurepourlapremièreetdernièrefois,unsoirdejuin1963(…)ilnem’avaitdonnéaucundétailsur son physique, sur ses vêtements. Je l’avais presque oubliée, jusqu’aujouroù j’aiappris l’existencededorabruder.alors, laprésencedecettejeunefilledanslepanieràsaladeavecmonpèreetd’autresinconnus,cettenuitdefévrier,m’estremontéeàlamémoireetbientôtjemesuisdemandésiellen’étaitpasdorabruder(…)(modiano1999:62-3)
unautresouvenirde l’année1962surgitaufildesespromenadesdansparis:ilestcentrésurlaruegreffuhledanslaquellesetrouvait,du-rantlaguerre,lapolicedesquestionsjuives.Lamèredunarrateurjouaitauthéâtremicheletlenarrateurallaitsouventl’attendre:
Jenesavaispasencorequemonpèreavaitrisquésavieparicietquejerevenaisdansunezonequiavaitétéuntrounoir.(modiano1999:65)
illaretrouvaitpourdîner«dansunrestaurant,ruegreffuhle–peut-êtreaubasdel’immeubledelapolicedesquestionsjuivesoùl’onavaittraînémonpèredanslebureauducommissaireschweblin.»(modiano1999:65).
L’auteursesertdefragmentsautobiographiquespourétofferleper-sonnage.Lerôledeceux-ciestdoncdesusciterdel’empathiepourdora.Lelecteurdoitsentirpourcomprendrelasituationdanslaquelleellesetrouvait.
dansDora Bruder, leshésitationsdunarrateurmontre lesproblè-mesliéesàlareprésentationdel’histoire.L’ambiguïtéetl’instabilitédelanarrationdemodianoreflètentcellesdel’occupation,périodetroubleoù les gens disparaissent et où leurs traces s’effacent. pourmodiano,l’histoirede l’occupationestaussiunehistoirepersonnelle,héritéedesesparents.Lafragmentationdelanarrationreprésenteladifficultédemodiano d’intégrer et de comprendre cette expérience traumatique.

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
73
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
cette intégration serait importante car elle permettrait àmodianodesereconstruire,derétablirsonidentitéetdefairefaceaupassé.faceàunpasséflouquel’onpréféreraitoublieretquel’onatendanceàoublier,faceàunnarrateurinstableetàunenarrationfragmentée,c’estaulec-teurquerevientlatâchedequestionneretdereconstruirecequiapusepasser.ildevientlui-mêmedétectivetantauniveaubiographique(laviededora,dunarrateuretcelledesonpère)qu’historique(lapériodedel’occupationenfranceetledestindesjuifseneurope).Ledésird’expli-cationetdedénouementactivelanarration/quête.mettantenquestionunereprésentationdéfinitivedupasséetlacapacitéd’unepersonne,lenarrateur,d’interpréterlepassé,modianosoulignelesdangersd’unevi-sionsimplistedel’histoire.Lafragmentationtypographiqueauseindurécitessaiedereproduirelechaosdelamémoiretoutcommelesblancsquiexistententrelesévénementsetleurcompréhension.c’estàl’écriturequerevientlerôledansletextemodianiendepareràl’oublietd’activerlamémoire,decomblerlevidedutempsetl’absence:
sijen’étaispaslàpourl’écrire,iln’yauraitplusaucunetracedelaprésencedecetteinconnueetcelledemonpèredansunpanieràsaladeenfévrier1942,surleschamps-élysées.(modiano1999:65)
Vertiges sebaldiens de la mémoirechercheur et écrivain,winfried georg sebald est un homme de
l’archive.danstoussesrécits,ilutilisedesdocuments,imagesettextestrouvésaucoursdesesrecherchesdanslesquelsilrencontredesêtres,desombresfugitivesdupassé.Laquêtedestracesdansæuvredesebaldnedonnepourtantpaslieuàdesfableshistoriques.toutaucontraire,lesoucidel’auteurestderestituerlaréalitédecequiaété,desexistencesd’êtresquiontété,etdont lamémoireestconsignéedans lesarchives. sebaldestné le18mai1944àwertag surallgaü,enbavièredusud,pendant ladeuxième guerremondiale. Lamémoire de cette période,coupléeausilencedelagénérationdesonpèresurlaguerre–cedernierétaitofficierdelawehrmacht-necessedelehanter.L’occultationdel’histoiredansl’allemagnedesonenfanceestfondatricepourcompren-dresonœuvre.sebaldfaiteneffetpartiedecettegénérationd’écrivainsallemandsd’après-guerrequiontunliensouventdouloureuxetimpor-tantavec l’histoireet lapolitique; ilnesaitpasquoifairedecettemé-moirecollectivedeladestruction.iln’apasvéculesbombardements,lescamps,laguerre,etpourtant,toutcelaluiappartient.
dansledispositifsebaldiendenarration,lenarrateurpremier,quipourrait être sebald lui-même, rencontredans la salledespasperdus

Melić K.
74
d’anvers,unchercheurenhistoiredel’art,Jacquesausterlitz.celvi-ciaunebiographiesingulièrequelerécitvaprogressivementretracer.c’estun être énigmatique, passionné d’architecture et de gares ferroviaires,philosophe au savoir encyclopédique, historien en quête de sa proprehistoireetdesonpassé.en1939,àcinqans,ilafaitpartied’unconvoid’enfants juifs tchécoslovaques, les kindertransport, qui les mène enangleterre.ilaétéensuiteadoptéparuncoupledeprotestantsgallois.cen’estqu’àl’adolescencequ’ilaapprissavéritableidentité.sansaucundocumentou témoignage, devenu adulte, il essaie àprague et àparisderetrouverlatracedesesparents.cettehistoirefait l’objetd’unrécitd’austerlizaunarrateur,reproduitleplussouventdirectement.auster-litz, leseuldeslivresdesebaldquisoitentièrementuneœuvredefic-tion,racontedoncl’histoired’unhommequi,ensuivantdefaçonpres-queinconscientedevaguessouvenirsquiluireviennentetlessensationsétrangesquecertainslieuxluiévoquent,retrouve,cinquanteansaprès,lesouvenirdesonenfanceàpragueetdesesoriginesjuives.cesorigi-nesavaientétéentièrementeffacéesparsesparentsadoptifsquil’avaientnommédaffydelias.Lerécitdevied’austerlitzestplacésouslesignedel’énigme:celledunom.aucontrairedelabiographietraditionnelle,ici,onpartd’unepersonne,austerlitz,dont lerécitconsisteàraconteraunarrateurcommeelleadécouvertlesecretdesonnom.nousavonsaf-fairelààuneenquêteidentitaire.c’estàl’âgedequinzeansqu’austerlitzapprendbrutalementparledirecteurdel’écolesesvéritablesorigines:
maisavanttout,ajoutapenrith-smith,ilétaitdesondevoirdemerévélerque surme feuilles d’examen je ne devais pas écriredafyddeliasmaisJacquesausterlitz.it appears,dit-il, that this is your real name3. (sebald2002:83)
cettedécouverte le coupede la réalité qui lui était familière. sonnomneluipermetplusdesereconnaîtredanslemondedanslequelilvivait,maisneluidonnepasnonplusuneouverturesurleprésent.aus-terlitz,obsédéparcettedécouvertesursonidentité,chercheencoredesdizainesd’annéesplustard,àsepenchersursonnom,etàlamentiondulieudebataillede1805queluiavaitdonnéeledirecteurdel’école:
I think you will find it is a small place in Moravia, site of a famous battle, you know4.(sebald2002:84)
s’ajoutentdessignes:dernièrementtoutefois,àl’instantmêmeoumachinalementj’allumaislaradio, j’entendis leprésentateurparlerdefredastaire,dont jene savais
3 enitaliqueetenanglaisdansletexte.4 enanglaisdansletexte.

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
75
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
absolumentrienjusqu’ici,etdirequesonvraipatronymeétaitausterliz.(sebald2002:84)
…quedanslesjournauxdekafkailestquestiond’unpetithommeauxjambes torses portant mon nom, qui circoncit le neveu de l’écrivain.(sebald2002:85)
…pasplusquejenemetsd’espoirdanscettenoted’archivestrouvéeilyaquelquestempsdansunedocumentationsurl’euthanasieetdontilressortqu’une certaine Laura austerlitz a fait le 28 juin 1966, devant un juged’instructionitalien,unedépositionrelativeàunecrimeperpétréen1944dansunerizeriedelapresqu’îledesaba,prèsdetrieste.(sebald2002:85)
Lesindicationsmontrentl’intensitédelaquête,sonobsessionetsondésarroi:ilcherchepartoutdesinformationsquirenvoientàdessourcesdifférentes(rumeur,archives)etàdesespacesgéographiquesdifférents,lescontinentseuropéenetaméricain,etàdesdomainesaussidifférentsquelemondedelalittérature,del’histoireetducinéma.Lerécitdesesdécouvertesn’apasune forme linéaire,maisprocèdeplutôtparblocs,parprogressionlogique,suivantledéroulementdesinvestigations.sisavieestdevenueuneénigme,c’estparcequ’ilestdevenupourlui-mêmeuneénigme:
aveclereculquej’aiaujourd’hui,jevoisbiensûrquemonnomàluiseul,(…) aurait dûme conduire sur la trace demes origines,mais j’ai aussicompriscesdernierstempspourquoiuneinstancesituéeenavantouau-dessusdemapenséeetœuvrantsansdoutequelquepartdansmoncerveauaveclaplusgrandecirconspectionm’avaittoujourspréservédemonpropresecret,m’avaitsystématiquementempêchédetirerlesconclusionslesplusévidentesetd’entreprendrelesrecherchesvoulues.(sebald2002:56)
Lesélémentsinconscientsdesonhistoireontdéterminéchezaus-terlitzlechoixdesonmétier:historiendel’architecture.alorsqu’ilestentraind’étudierl’histoirearchitecturaledelagaredeLiverpool,auster-litzressentpeuàpeu«deslambeauxdesouvenirsquicommençaientàflotterdanslesrégionsexternesde[son]cerveau»(sebald2002:164):
c’estcegenredesouvenirsquimevenaientdanslaLadies Waiting RoomdésaffectéedelaLiverpoolstreetstation,dessouvenirsderrièrelesquels,etdanslesquels,secachaientdeschosesencoreplusanciennes,toujoursimbriquées les unes dans les autres, proliférant exactement comme lesvoûtes labyrinthiques que je croyais distinguer dans la lumière grise etpoussiéreuse,àl’infini.J’avaisenvéritélesentimentquelasalled’attenteoùjemetenais,frappéd’éblouissement,recelaittouteslesheuresdemonpassé,mesangoisses,mesaspirationsdepuistoujoursréprimées,étouffées,quesousmespiedslemotifenlosangesnoirsetblancsdudallageétaitun

Melić K.
76
échiquierétalésurtoutelasurfacedutemps,surlequelmaviejouaitsafindepartie.(sebald2002:164-165)
derrièresonobsessiondesbâtimentsetdesgaressecacheunsou-venirrefoulé,celuidujouroùsesparents,enpleinmilieudelaterreurnazie, l’ont abandonné à la gare d’austerlitz à paris afin qu’il rejoignel’angleterre.
commentsebaldfusionne-t-illafictionetlaréalitépuisquelechoixdu récit fictionnel s’est vite imposé pour lui? comme chezmodiano,nous retrouvons chez sebald, un tissage de récit fictionnel et de récitfactuelcarilarecoursluiaussiauxdocumentsetauxarchives,еtdeplus,auxphotographies.L’originalitéde l’œuvredesebald a étémainte foissoulignée:ilintègreàsesrécitsdesphotographies,issuesdesacollectionpersonnelle.cettepratiquesingulièreinstaureundialogueentrel’imageetletexte,oùlaphotographien’estjamaisunesimpleillustration.mêmesi iloptepour la fiction, iln’écritpas toutefoisunroman,et trouve lemoyen,àl’aidedesphotographiesetdesdocuments,deminercettefic-tion.sebaldad’ailleursqualifiéausterlitz d’«élégie enprose», voulantdirepar làqu’ilne s’agissaitpasd’un romanquine seraitque fiction.pourlui,laproseenglobetoutcequiestécriturenarrative:lelecteurestàlafoisdansleroman,dansl’essai,danslanouvelle,ilyaunva-et-viententre l’analyseet l’imagination.pourpouvoir lireetdéchiffrer le récit,il lui fautêtreattentifaux tracesetauxcoïncidences,à lapratiquedumontagedesphotographiesquiprocèdeparméthodederessemblancesetdedissemblances.Lesphotographiesfontunrécitquipermetdedé-velopperdesassociationsd’idéesetderéflexions,demettreenplaceunregard.
Lerécitfictionnelseprésentecommeleproduitdelarencontredunarrateuretdupersonnageprincipal, Jacquesausterlitz.Leurrelationduredans le textevingt-neufans,de1967à1996, et se terminede lamanièresuivante:austerlitzchoisitdefairedunarrateurlelégatairedesonhistoire.cettedécisionestlerésultatd’unconcoursdecirconstancesalorsqu’ilsnes’étaientpasvusquelquesannées,mais le tempsn’apasvraimenteud’impact:
… un individu isolé dont je prenais en cet instant conscience qu’il nepouvaitêtrequeceluiperdudevuedepuisprèsdevingtans,austerlitz.iln’avaitabsolumentpaschangé…(sebald2002:51)
c’estainsiqu’austerlitzcesoir-là,…,areprislaconversationpresquelàoùnousl’avionslaissée.(sebald2002:53)
cechoixdefairedunarrateurlepasseurdesonhistoiresefaitsurlabasedurespectmutuelquis’estinstauréentrelesdeuxhommesaufildes

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
77
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
années.cesdeuxpersonnagespartagentuncertainnombredecaracté-ristiques:ilsviventtouslesdeuxdansunlieuquin’estpasleleur.sebald,commeJacques,estunexilé.ilachoisitrèstôt,àlafindesesétudesdes’installerenangleterrepouréchapperaupoidsdupasséallemandquipèsesurlui.
commemodiano,sebaldentrecroise,luiaussi,desfilsautobiogra-phiques etbiographiques etdes éléments ancrésdans la référentialité.dansausterlitz, lelecteurpeutremarquerquec’estl’imageduvraise-baldquisereflètedansunevitrinedelavilledeterezinàlapage233.LepèredeJacquesausterlitzs’appellemaximilienaychenwald,etsebald,détestantsesdeuxprénoms,sefaisaitappelermax.Lerécitausterlitzsetermineparl’inscriptiondequelquesnomsdeprisonniers,gravéssurlesmursdelaforteressedekaunas,desnomsavecunedateouunlieu.par-micesnoms,lenarrateurnoteceluidemaxstern,paris,18.5.44.dansunenoteenbasdepage,l’écrivain5donneledétailsuivant:datedenais-sancedew.g.sebald,elleestaussicelledel’arrivéeauneuvièmefortdekaunasduconvoi73aveclequel878Juifsdetoutesnationalitésontétédéportésàpartirdedrancy(sebald2002:350).etsurtout,ilparaîttoutàfaitpossibleaulecteurquel’énigmatiquephotoquel’onretrouveàlapage219,unpetitgarçonencostumeblancdepage,soitenréalitéunephotodesebaldenfant6.Lesphotographiesdesebaldfontpartiedesacollectionpersonnelleetn’ontjamaisdelégende.L’auteurfaittoutpourpermettrelaconfusionetl’hypothèse.
Lelivres’ouvresurlerécitdelavisitedunarrateuraufortbreedonk.or,c’estlelieuoùaétéinternéJeanaméryquienfaitlerécitdansPar delà le crime et le châtiment.sebaldreproduitd’ailleursuncourtextraitdecetexte.cemêmefortaétéutiliséparlesnaziscommecampjusqu’en1944,puislaisséàl’abandonavantd’êtretransforméenmémorialnatio-naletmuséedelarésistancebelge.sebaldnote:
personnenesauraitexpliquerexactementcequisepasseennouslorsquebrusquements’ouvrelaportederrièrelaquellesontenfouieslaterreursdelapetiteenfance.maisjesaisencorequedanslacasematedebreendonkune odeur immonde de savon noir vint frappermes narines, que cetteodeurdansunecirconvolutionperduedemoncerveau,s’associaàunmotquej’aitoujoursdétesté,etquemonpèreemployaitavecprédilection:«labrossedechiendent»(…)(sebald2002:34)
Lenarrateurproposeunlienentrelaprésencehistoriquedel’hor-reurqu’ilaressentieàbreedonketlessouvenirsd’uneenfancepasséeen
5 ilestbienpréciséqu’ils’agitd’unenotedel’écrivain.6 il s’agitde l’image laplus importantedu livrepuisqu’elleaétéreprisepar tous leséditeurs
pourlacouverturedulivre.

Melić K.
78
compagniedesonpèrequineparlaitjamaisdelaguerretoutenayantétéunsoldatdelawermacht.commel’anotéandréaciman:«sebaldnementionnejamaisl’holocauste.pourtant, lelecteurnepenseàriend’autre.»
austerlitzestunpersonnagedefiction,maislerécitdesavieetdesonenquêtesursesparentsdisparusesttisséàpartird’élémentshisto-riques: le transportd’enfants juifsdepraguevers l’angleterre, l’organi-sationducampdetherensienstadtoùsamèreestinternéeavantd’êtredéportéeàauschwitz,d’oùellenereviendrapas.Leplanducamp,lesphotogrammesdu filmdepropagande tourné surordredesnazis, lesphotosdelavilletellequ’elleseprésenteaujourd’hui, illustrentle livreetconfèrentaurécitunmaximumdevéracité.Letravaild’austerlitzestlemêmequeceluidesebald,cesontdesarchéologuesdupasséetdelamémoire.Lenarrateurécrit:
J’ai encore aujourd’hui enmémoire la facilité avec laquelle je suivais cequ’ilnommait sespistesde réflexion,quand ildissertait sur le sujetquiétaitlesiendepuisqu’ilétaitétudiant,l’architecturedel’èrecapitaliste,etenparticulier l’impératifd’ordonnance et la tendance aumonumental àl’œuvre dans les cours de justice et les établissements pénitentiaires, lesbourseset lesgares,maisaussi lescitésouvrièresconstruitessur leplanorthogonal.(sebald2002:43)
austerlitzluidit:aussi loin que je puisse revenir en arrière, dit austerlitz, j’ai toujourseu le sentimentdenepasavoirdeplacedans la réalité,denepasavoird’existence,et jamaiscesentimentn’aétéaussifortquecesoir-là(...)Lelendemainnonplus,tandisquejeroulaisversterezìn,jeneparvenaispasàmefaireuneidéedequij’étaisoudecequej’étais.(sebald2002:221)
danstoutessesœuvres,sebaldutilisedesdocuments,desimagesetdestextestrouvésaucoursdesesrecherches.Lesoucidel’auteurestderestituerlaréalitédecequiaété.s’ytrouventainsidesphotosennoiretblanc, sans légendes, sansattributions légales,disséminéesentre lespagescommeauhasard,semblantsurgirderien.etils’agitlàdecettedeuxièmetechniquedefusionnementdelaréalitéetdelafiction.sebaldinsèredesphotographiesquis’articulentencontre-pointdurécit.Leurrapportavecletextes’éclaircitprogressivement,aufuretàmesurequelelecteuressaiededonnerunsensauréseaud’histoires,dedescriptionsetdesouvenirsquesebaldrassembleenunepatientereconstructiondupassé. Lesdocuments et les photographies réfractent le sensdu texte.dansausterlitz,lesphotographiesontunevaleurmémorielle–attesterquecequel’onavuabienexister-etaccompagnentlecheminementdupersonnageprincipaldanssaproprehistoire.dansausterlitzsetrouve

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
79
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
unephotosingulièrequiprenduneplaceparticulièredanslerécit.ellesetrouveàlapage299etestcenséereprésenterlevisaged’agátaauster-litzová,lamèrenécessairementfictivedupersonnagefictifquiestJac-quesausterlitz.celui-ci,danslerécit,n’aaucunetracedesamère,etlatrouvaille de cettephotodans les archivesd’un théâtrepragois et sonauthentificationparsanourriced’autrefois,constituepourainsidirelafindesonenquête.onvoitcommentunefoisdeplussebaldmêleréa-litéetfiction–laphotod’unefemmeayantréellementexistépassepourcelle de lamère de son personnage imaginaire. il a, en effet, cherchédésespérémentàidentifierlevisagematernelparmiceuxdesfigurantsdu filmdepropagandeque lesnazisontobligé leréalisateur juifkurtgerroràtourneràtherensienstadt.
sonanciennenourrice,vĕra,qu’ilaretrouvéeàpraguesetquiluiarévélédesstratesenfouiesdesamémoireetlevélevoilesurl’énigmedesonidentité,n’apasréussiàapprendrecequiétaitadvenuàagáta:
J’essayaisdem’imagineroùagátasetrouvaitmaintenant(…).Jen’aiapprisquedesannéesplustardàquoiçaressemblait,delabouched’unsurvivant.(sebald2002:214)
tout comme il est allé àtherensienstadtqui est un lieu lourddesignificationpourlui.Lavilleestvide,abandonnéeàlavégétation,maisqu’importe,austerlitzestenmesuremaintenantdelire,danslevidedesrues,lessignesdecequiaétéautrefoisetquel’ondénievolontairement.savisiteaumuséedughettofaitcédersesdernièresrésistancesenluidé-voilantunedocumentationquil’aideàsefaireunereprésentationdecequ’ilalongtempsrefoulé.sontravaildedeuilestenpartieachevé.sonnom,austerlitz,acquiertdanslafiction,unnouvelécho:lesphonèmes«au»et«itz»renvoieàauschwitz,ledébutetlafind’uneexistencequiaétémarquéeparunpandel’histoiredontauschwitzestlesymbole.
siJacquespenseavoirretrouvédestracesdesamère,ilneretrouve-rapasdetracesdesonpèreexiléàparisaudébutdelaguerreetdisparudepuis.quaranteplustard,lefilsserendàparis.ilfaitdesrecherchesàlabibliothèquefrançoismitterrand,maisneretrouveaucunetracedesonpère.deplus,ilapprendquecettebibliothèqueaétéconstruitesurunterrainvagued’unancienentrepôt«oùlesallemandsregroupaienttouslesbienspillésdanslesappartementsdesJuifsparisiens.»(sebald2002:338).Lorsdeleurdernièrerencontre,austerlitzconfieaunarrateurquesonpère aurait été internédans le campdegurs etqu’il a l’intentiondes’yrendre.unlecteurcurieuxoudéjàinforméferavitelelienentrececampetsesinternésayantvécudanslemonderéel,commehannaharendtetwalterbenjamin,faisantainsilepontentrelemonderéeletlemondefictif.L’insertiondetelsindicesrelèved’uneaccentuationdu

Melić K.
80
pouvoirdereprésentationduréel.Lelecteurestmisenpositiondepen-serquelafictionreconstruitnonseulementunmondepossible,maisunmondeavéré,qu’ilestinvitéàpercevoircommeréférentinterprétable.ildoitainsialleràlagared’austerlitzprendresacorrespondancepourlesuddelafrance,coïncidencequiapoureffet,commeilenfaitlaremar-que,delerapprocherdesonpère:
(...)illuiétaitvenuàl’espritquesonpèreaprèsl’entréedesallemandsavaitdûquitterparisparici,parcettegarelaplusprochedesondomicile(...)»(sebald2002:342)
de nouvelles significations quant au nom apparaissent: l’originegéographiquedupersonnage(lamoravie),sonidentitéàtraverslenomdesamère,nomquiamenéàlamortdelamèreetàladisparitiondupèredanslesystèmededestructionqu’auschwitzsymboliseetdontonretrouveenéchodansausterlitz,etc’estaussilenomdelagared’oùaétédéportémaximilianetd’oùestpartiJacquesendirectiondel’angle-terre.débutetfin.départetarrivée,oupeut-être,arrivéeetdépart?carle récitd’austertlitz est celuid’unpersonnagequi vit dansunprésentconstammentimprégnédesonpassé.
en faisant de son passeur de récit, unallemand, identifiable auxbourreauxdel’histoireetdesaproprehistoire,austerlitzplacesonhis-toirepersonnellesurunplanquitranscendeunedimensionindividuelle.c’estaunarrateurdefairepasserletémoignageoraldansl’écritetd’en-tamerleprocessusdetransmission,c’estàluiqu’appartientmaintenantlerécitde lavied’austerlitz.austerlitz est lerécitd’unrécit.et iln’estpassurprenantqu’austerlitzs’effaceàlafindutextepuisqu’ilaaccomplisamission–confiersavieaunarrateur–etleurdernièrerencontreestcelledesadieux:
ilmetenditlesclésdesamaisondel’alderneystreet:jepouvaisyprendremesquartiersquandjevoulais,dit-il,etétudierlesphotosennoiretblancquiseraient lesseules traces témoignantdesonexistence. (sebald2002:344)
Legesten’estpasseulementsymbolique,ilestimportantsurleplannarratifpuisquel’onsortdelafiction;parsoninvitationàregarderlesphotosetàvisiterlevieilcimetièreashkenazeavoisinantlamaison,aus-terlitzabiendélimitécequ’ilavaitvouluéclairer,àsavoirlesévénementsd’uneépoque7.etiln’estpassurprenantquelerécit,àsafin,reprennelàoù ilacommencé–parunenouvellevisitedunarrateurau fortdebreendonk.ceretourn’estpaslafindelaboucledurécit,aucontraire,ilpermetaulecteurdevoirlesdifférencesentrelaperceptioninitialedece
7 d’ailleurs,toutaulongdutexte,iln’estjamaisfaitmentiondelavieprivéed’austerlitz.

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
81
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
fortetcelledelafindulivre.Lenarrateur(etlelecteur)sorttransforméduparcoursnarratifetvoitdifféremmentlaréalitédecetteépoquedel’histoire.
poursebald,commepourmodiano,iln’yapasd’autrespossibilitésqued’écrireautourdeladeuxièmeguerremondiale.ilnes’agitpasdedevoirdemémoire–lamémoireestici,danslesdeuxcas,laconditionmêmedel’écriture.c’estundevoirimposéquirendpossiblel’existence.c’estcecadrequilespousseàélaborerunmélangeentrefictionetréalité.L’impératifmoraldesauverl’expérienceindividuelledela«catastrophedusilence» imprègne leursœuvres.Leurs textes interrogent le rôledelalittératuredanssonrapportàl’histoire.Lesdeuxécrivainsfonction-nentcommechercheursdansleurdémarched’écriture.Leurstextesnecontiennentpasdediscourspolitique,bienquel’onpuisseparlerd’unecertaine politique de la littérature. etmodiano et sebald s’intéressentauxtabousdel’histoire,donnentunevisionpolitiquedel’histoire.
Lesœuvresdemodianoetdesebaldsemblentêtreguidéesparuneuniqueinterrogation:commentlesouvenirdesgensetdesévénementsdupassévienthanternosviesetrésonnerdansl’espacequinousentoure?Lepassérésisteàtoutmodedereprésentationquipourrait luidonneruneforme.c’estàpartirdel’absencequelepassépeutêtreapproché.Lareconstructionest toujours indirecte,pleined’objetsdisparatesqui,deleursilence,évoquentuneabsence.c’estàl’écrivain,donc,querevientledevoirdetrouvertouteslestracesquipourraientdessinerlepassé.cestracespeuventdésignerdessituations,despersonnages,desatmosphè-res,desdécors.pourlireetdéchiffrerlerécit,ilfautêtreattentifauxtra-cesetauxcoïncidencesquel’oninsèredanslerécitàl’étatdedocument.L’originalitédesœuvresdemodianoetsebaldrésidedanscetteapprocheéthiqueetempathique,dansl’usagedesarchivesetdocuments,lespho-tographiesauseinmêmedelafiction,bousculantlescatégoriesdugenreromanesque.Ledéchiffrementdestracesetdesindices,lemontagedefragments,dedocumentsetdephotographiespermetàlalittératuredesetarguerd’uneconnaissancedel’histoire.ilsselancentdansdesen-quêtes,empruntentladémarchedel’historienquiestprochedelami-cro-histoirepour tenterd’arriverà lamacro-histoire.archéologuesdelamémoire,ilsessaientd’allerverslespetitesgens,ceuxquel’histoirealeplusfacilementtendanceàoublier,lesvictimesoubliéesqu’ilsnepar-viennentpasàressusciter,maisqu’ilstirentdel’oubli.Lesimageschezsebald, lesdocumentset lesarchiveschezmodianoetsebaldontunefonctiondocumentairequi favorisent l’ancragehistorique et fonction-nentcommetracesdanslanarration–ilspermettentdefaireapparaîtreles«revenants»(danslesenslittéraletmétaphorique)del’histoire.tous

Melić K.
82
lesdeuxparviennentànouerl’histoireetlafictiondansuneapprochequipermetàlalittératuredefaireœuvredetémoignage.
«L’intelligenceoublie,l’imaginationn’oubliejamais.»(handke)
Bibliographie
modiano1999:p.modiano,dora Bruder,paris:gallimard,folio.sebald2002:w.g.sebald,austerlitz,arles:actessud.
Sources
agamben2003:g.agamben,Ce qui reste d’auschwitz, paris: payot,rivagespoche.bouju2006:e.bouju,la transcription de l’histoire – essai sur le roman euro-péen de la findu xxe siècle,rennes:pressesuniversitairesderennes.blanckeman2009:b.blanckeman,Lire Patrick modiano,paris:armandco-lin.dayanrosenman2007:a.dayanrosenman,les alphabets de la shoah,paris:cnrséditions.dubosclard2006:J.dubosclard,Patrick modiano dora Bruder,paris:hatier.genette1991:g.genette,Fiction et diction,paris:éd.duseuil.kuljić2006:t.kuljić,Kultura sećanja,beograd:Čigoja.origgi 2006:g.origgi,Mémoire narrative, mémoire épisodique: la mémoire selon W. g.sebald,http://www.fabula.org/lht/1/origgi.html20.07.2010.ricoeur2000:p.ricoeur,la mémoire, l’histoire, l’oubli,paris:éd.duseuil.samoyault2001:t.samoyault,fictionetabstraction, littérature,123,56–66.trouillot1995:m.-r.trouillot,silencing the Past – Power and the Production of History,boston:beaconpress.
Катарина МелићЗЕБАЛД И МОДИЈАНО, АРХЕОЛОЗИ МЕМОРИЈЕ
РезимеПатрикМодијаноиВинфридГеоргЗебалдприпадајуистојгенерацијикојајеодраста-
лапослеДругогсветскограта.СебидајузадатакдаговореомутнимвременимаОкупа-цијеуФранцускојкаоионацистичкимпрогањањимауНемачкој.ИспитујућиИсторијуињенозваничнопредстављање,истражујућипрошлостусећањимаиархивама,трагајућизамеморијомкрозписање,овадваписцастварајуделаукојимадајуместоонимазакојесепостомодернаисториографијасвевишезанима–„обичниљуди“.Предметнашеграда

Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire
83
Nasl
e|e 19
• 2011 • 6
7-85
судвадела–dora Bruder (1999)Модијаноаиausterlitz (2002)Зебалда,укојима јеШоаглавнатема.Обатекстапредстављајуистраживањеинарацијуистраживањаиимајумно-госличности.Наша јенамерадаистражимокакоовадватекстамешајуфикцијуидо-кумента/архивууциљу(пре)испитивањаИсторијеимеморијеИсторије,инатајначин,покушајсудасеиспричареалноствременакојејезваничнаИсторијаповременосклонадазаборави.Далисеможепронаћисећањенапрошлосткојајесвеснозаборављенаииз-мењена,окаквојјерепрезентацијимеморијереч?Покушаћемодадâмоодговортакоштоћемопратитиследећиправацразмишљања:односреалнемеморијеификтивнемеморије(фиктивнапричаифактуелнаприча).
Примљено: 29. 01. 2011.


85
УДКрад
Ljiljana PetrovićFaculté des arts, université de Niš
TrAuMA, TéMoIGNAGe eT DéMySTIfIcATIoN - exPérIeNce De LA GrANDe Guerre: BArBuSSe
ET MALAPARTE
cetarticleapourbutd’étudierlesauteursayantprispartàlaguerre-leurbesoindetémoigner,vécucommeunimpératifmoral,etleurné-cessitédemettreleurtraumaenrécitafindetenterdelerationaliseretdes’enlibérer.Lesrésultatsdesrecherchesmontrerontquelesquestionsdutémoignageetdutraumadeguerre,actualiséesaprèsl’expériencedel’holocauste,ontétéposéespourlapremièrefoisàlasuitedelagrandeguerre,cequeprouventlestextescritiquesdeJeannortoncru.vuquelecorpusd’œuvresétudiéseraLe Feudehenribarbusseetviva Caporetto! la rivolta dei santi maledetti.decurziomalaparte,lesrecherchesseronteffectuées à l’aide de l’approche comparative, de laméthode d’analyseetde synthèse, ainsiquede la critiquepsychanalytique.L’articlemèneàlaconclusionquel’actemêmed’écrirechezdesécrivainsrescapésdelaguerreatoujoursunsensthérapeutiqueetlavaleurdetémoignage.
Mots-clés:guerre,trauma,récit,écrivain,témoignage,démystifica-tion
diresespropresexpériences,parlerdecequ’onavuetvécu,c’esttou-joursundéfipourl’écrivain,aupointdevuedesoninvestissementémo-tif.quantauxauteursécrivantàproposdeleursexpériencesdeguerre,ilsparaissentencoreplusdéterminésparcetteémotivitéaccentuée.car,prendrepartàlaguerre,celaveutdireêtreexposéauxconditionsextrê-mesdelaproximitéconstantedelamort,sentirsanscesseunemenacevitale.cesconditionspsychiques,difficilesàsupporter,influencentfor-tementlapersonnalitédel’écrivainquisubitcertainschangements.
Lastructurepsychiquemodifiéechezdesex-combattantsestnotéepour lapremière fois,auniveaudesétudesscientifiques,après lapre-mièreguerremondiale.encetemps-là,freudavaitdéjàélargilasigni-ficationdumotgrectrauma,désignantd’aborduneblessurephysique,àuneblessurepsychiquequiportaitsurlestroublesnommés«lechocdestranchés».c’estunterme,établiaprèslagrandeguerre,pourindiquer

Petrović Lj.
86
lanévrosedecombat.oncroyaitd’abordquelechoc,diagnostiquéchezdes soldats revenusdu front, avait étéprovoquéparune causephysi-que.mais,vuquelessoldatesn’ayantpassubidetraumatismephysiquesouffraientégalementduchocdes tranchées,oncomprit trèsvitequel’origineduchocétaitpsychique.ils’agitdoncdustressintensecauséparuneexpositionconstanteàlamort.
c’estdanscesconditionsquenaitlebesoindetémoignerl’horreurvécue.etl’horreurvécue,oul’événementtraumatique,estdéfiniecom-medépassementdupossibleetdel’imaginable,commeexcèsdel’horri-blequinepeutpasêtrenomméd’unemanièreadéquate,nilimitéparlesformesdéjàexistantes.
ayantunetellestructure,l’événementtraumatiquenepeutpasêtreassimilé,compris,nivécucomplètementaumomentoùilseproduit.ilestdoncévidentquelasourced’untraumaestunévénementincomprisquiest,d’aprèsshoshanafelman,horsduchampdelacompréhension,delanarrationetdelamaîtrise.
danscecontexte,l’auteurseheurteaussiauproblèmedevraisem-blance,ilapeurquelelecteurnelecroitpas.ayantétéàunehorreurextrême,ilneréussitpasàaccepterconsciemmentl’informationquisetransforme en trauma.donc, si lui-même, celui qui a vécu son expé-rience,nepeutl’accepter,ceseraencoreplusdifficilepoursonlecteur.voilàd’oùvientcetteméfiance.
témoignersurunévénementdecegenreveutdirenommerl’hor-reurvécue,luidonnerforme,pourpouvoirladétermineretluttercontreelleetcontrelechaosqu’elleintroduitdanslaconstellationintérieuredel’auteur.témoigner,c’estdoncunbesoin,undéfietsurtoutunprocessusthérapeutiquepourl’auteur.
maisshoshanafelmansedemandesilamissiondeceluiquitémoi-gneestjustementdesesoignerlui-même,ousielleassumeunedimen-sionuniverselle.danscecontexte,ellefaitl’analysedel’œuvred’albertcamusLa peste,allégorietransparentedelacatastrophedeladeuxiè-meguerremondiale,enreconnaissantenledocteurrieux,témoindudésastrequisoignelesmalades–victimes,celuiquisoignelamaladiemêmeet,àtraverscettemaladie,lemaldumonde.ellevaencoreplusloinetsedemandesil’acted’écrirenereprésentepas,aufond,l’actedetémoignagesurletraumadelasurviedel’hommesurlaterre.Letémoi-gnageest,prétend-elle,siomniprésentqu’onlereconnaît,d’unecertainemanière,danspresque tous les typesde textes, car témoignerne veutpasdireseulementêtretémoindelavieprivéedequelqu’un,maisc’est«lepointoùsecroisentletexteetlavieoùuntémoignagetextuelpeut

Trauma, témoignage et démystification - expérience de la Grande Guerre: Barbusse et Malaparte
87
Nasl
e|e 19
• 2011 • 8
5-9
3
pénétrerdanslaviemême».(felmanandLaub1992:2)Letémoignageestinséparablementliéàlavie,àlaguérisonetàlavérité.
mais,c’estd’abordsavérité intérieureque le témoinveutsaisirenécrivantetqui,transforméeentrauma,luiéchappesanscesse.atra-vers lacréation, ilobjectivisesontrauma, lemetenœuvreetdecettemanière,l’événementtraumatiqueassumeladimensiontemporelledansl’espritdusujet,sesituedéfinitivementdanslepasséetlibèrel’individudesadestructivitéetdesonobsession:
c’est lerécitqui,àpartirduchoctraumatique,constitueune«histoire».autrementdit,avantlamiseenrécit,iln’yapasd’histoire,pasdecausalité,pasd’avant,dependantnid’après,puisqueletraumadébordenoscatégorieshabituellesdepenséeetlesparamètresdel’expériencequotidienne.(parent2006:116)
maisrationnaliseruntrauma,cen’estpasdutoutfacileetilestabso-lumentimpossibledetracerenavantlescheminsdecetterationalisationceque lecritique Jeannortoncruessaiede faire. ilavaitpourambi-tiond’établirunenouvelleformelittéraire,unrécittestimonialquiserait«non-menteur»,pourmontrerauxlecteurslavraieimagedelaguerre,etessayaitd’endonnerlesindicationsetlesrèglesprécises.
L’originede sonobsessionde lavérité sur laguerre etdurôledemissionnairequ’ilcroitavoir,remontentaufaitquelui-mêmepassaplusdedeux ansdans les tranchées et eut l’occasionde vivre et de voir laguerredénudéedesesmythesetlégendes.c’estlàqu’iladécouvertquetoutcequ’ilavaitsuavantducourage,dupatriotisme,dusacrifice,delamort,étaitfauxetque,d’aprèssesmots,lessoldatsreconnaissaient,auxpremièresballes, lemensongede l’anecdote,de l’histoire,de la littéra-ture,del’art.
aprèsavoirdévoilélaguerrecommepurecruautéetsouffrance,iltrouveque c’est unequestiond’honnêteté et demoralede le dire auxautres pourquepersonnene se retrouve jamaisdansune telle situa-tion.
Êtretémoin,d’aprèscru,imposeunengagementéthique,d’uncôtéenverslesgénérationsàveniret,del’autre,enverslescamaradesenvoyésaufrontettuésdansl’ignorance.avantd’êtrevictimesdelaguerre,ilssontd’abordvictimesdel’ignorancesoutenueparl’héritageculturelen-tier:littérature,art,histoire.
parler de la guerre telle qu’elle est, veut dire affronter beaucoupd’obstacles:lacensure,legoûtdupublicetlemanquedesmodèles,parcequelesujet«guerre»,ditcru,estencore,en1914,absolument«neuf».
Leraffinementdans l’horreuret la luttecontre sabanalisationestaussiunedesexigencesdececritique.ilavertitquelatendancedesécri-

Petrović Lj.
88
vainsdenierlapeuretd’affirmerlasoifdudangersuscitel’agressivitéchezleslecteursetcontribueàlacréationdelégendesfausses,cequiestencoreuneforme«d’intoxicationlittéraire».
maisd’autrepart,sionexagèreaveclesscènesd’apocalypse,lepu-blics’enhabitue,ellesperdentl’effetqu’ellesdevraientavoiretnesatis-fontqu’augoûtromanesque,endonnantauxjeunes,unefoisencore,desidéesfaussesdelaguerre.
crus’intéresseégalementauxeffetsdetrauma,bienqu’ilneseservepasdecetermepuisqu’ilestalorsenvoiedecréation.n’utilisantmêmepasde termespsychologiques,cruparle indirectementdutrauma,ensedemandantpour lapremièrefoiscommentdire l’indicibleetexpri-merl’inexprimable,questionsquisontposéesplustardparprimoLevi,Jorgesemprunetbeaucoupd’autresrescapésdescampsd’exterminationnazis.
donc, la tâche posée devant un écrivain est embarrassante.d’uncôté il fautoubliersessouvenirsmenaçants,se libérerdesamémoire,la situer définitivement dans le passé, et de l’autre côté, il est interditd’oublier.oublierdevientuneactioncontradictoirecontenantenmêmetempsnécessitéd’oublier etpeurd’oublier, ainsique le traumaqui secaractérisepar:
L’incompréhensibilitédel’événementtraumatiquequi,d’unepart,pousselesujetà tenterde l’intégrerdanssonhistoirepsychiqueparsamiseenrécit et d’autre part, cette incompréhensibilité constitue celamême quiempêchelamiseenrécitdel’événement.(parent2006:113)
c’est-à-dire qu’il impose la nécessité de verbalisation et enmêmetempséchappeàlacommunicationverbale.shoshanafelmanprétendquel’actedetémoignerestaussicontradictoirequeletrauma.d’uncôté,letémoinsetrouvedansunesituationpassiveetisolée,cartémoigner,d’aprèselle,veutdire:«supporterlasolitudedanslaresponsabilitéetlaresponsabilitédanslasolitude».(felmanandLaub1992:3)
maisdel’autrecôté,letémoignageestunacteau-delàdetouteiso-lation,cartémoignerveutaussidireparlerauxautresetpourlesautres.
eliascanettidécouvreunedimensionconsolatricedans le témoi-gnage.ilexpliquequ’untraumatisé,enrencontrantdesexpériencespa-reilleschezlesautres,comprendqu’iln’estpasseulcequirendsessouf-francesplussoutenables.
aprèsladeuxièmeguerremondiale,lagénérationdesJuifs,resca-pésdescampsnazis,s’estproclaméelacréatricedutémoignagecommegenrelittéraire.eliewieselprétendquesagénérationainventélalittéra-turedetémoignage,toutcommelesgrecsavaientinventélatragédieoulesromainslacorrespondance.

Trauma, témoignage et démystification - expérience de la Grande Guerre: Barbusse et Malaparte
89
Nasl
e|e 19
• 2011 • 8
5-9
3
etvraiment,c’étaitlapériodeoùlemondeétaitinondédelivressurlessouvenirsdesjuifsrescapésdel’holocauste.d’aprèssusanrubinsu-leiman,unegrandepartiedecestémoignagesseressemblent,parcequel’horreurvécuenepermettaitaucuneparaphrasenirhétorique,etsilemêmeévénementn’étaitpasdécrit toujoursde lamêmemanière,c’estparcequel’auteurmêmeavoulumettreenlumière,unefoislaguerre,uneautrefoislegénocide,oucequis’étaitpoursuiriaprès,mais,aufond,touscesauteursracontaientlamêmehistoireet,dansunsensgénéral,lemêmetrauma.(susanrubinsuleiman1998:406).
Lejeuentreletraumaetlerécitestunjeurisqué,incertain,souventunjeudelavieetdelamort.ilyadesauteursquiontécritdescentainesdepagesencherchantàselibérerdeleurssouvenirsobsédantsetsesontsuicidésàlafin,aprèsdix,quinze,vingtansdelutte.pendantcetemps,ilsinvententdesstratagèmes,desraisonnements,essayedecomprendre,derationaliser,depardonner–et toutcelapourse tirerdupassé.ta-deuszborowski,parexemple,appartientàcegrouped’écrivainsquiontsupportélestorturesducampnazi,maisquin’ontpaspusupporterlessouvenirs,oupaulcelan,uneautrevictimetardivedescampsnazisquis’estsuicidévingt-cinqansaprèsladeuxièmeguerremondialemalgréunénormesuccèslittéraire,ouJerzikosinski,primoLevi,etc.–lalisteestlongue.
fairelerécitdesonexpériencetraumatiqueveutdired’aprèsJorgesemprun«affronterlamortàtraversl’écriture».maisaffronterlamortveutdirequelavieaaussiseschances.
susanrubinsuleimanprétendqueceuxquisontvraimentdéses-pérésn’écriventpas,ouautrementdit,laprésenceetlemagnétismedelamortchezcesécrivains,n’exclutpaslaprésenceetlemagnétismedela vie enmême temps.ecrire son trauma c’estdéjà lutterpour la vie,l’actemêmed’écrireestpreuvedel’enviedevivre.cetteluttedureparfoispendantdesannéesetlafinresteimprévisible.tantôt,lamortgagneaumomentoùellesembledéjàbattue,tantôt,c’est laviequigagne,toutebrillante etmêmeplus séduisantequ’avant carplus laproximitéde lamort est étouffante et évidente, plus la vie se dévoile splendide et at-trayante.L’histoiredeviktorfranklenestuntémoignage.
perdre la capacité d’oublier c’est perdre la capacité de vivre.mais,peut-onsavoirquelleestlalimiteoùonperdlapossibilitéd’oublier,oùl’oublidevientimpossible?celadépenddequoi?delapuissanced’im-pressionoudelaforcepsychiquedusujet?est-cequ’ilyadeschosesuniversellementinoubliables,quepersonnenepeutoublier?
cathycaruthprétendqu’unévénementnepeutpastraumatisertoutlemondedelamêmemanièreetqu’ilfautplutôtchercherlapathologie

Petrović Lj.
90
dans ledomainede l’expériencequi représente la réponseaustimulusextérieur.donc,cen’estpaslestimulusextérieurquicauseuntrauma,maisnotreréponseàcestimulusextrêmementprovoquantquipeutêtrepathologique,c’est-à-diremanifesterlessymptômesdetroubledestresspost-traumatique.Lapathologiesecaractériseparsaréception:«...êtretraumatisé,c’estprécisémentêtrepossédéparuneimageouunévéne-ment»(parent2006:115).
donc,oublierdevraitêtresoulageant.mais,est-cevraimentsoula-geant ? sommes-nous vraiment desmachines à oublier comme le ditbarbusse?est-celaconditionpoursurvivre,pourpouvoircontinueràmarcherà travers le temps,pournepasêtrepour toujoursprisonnierdupassé?n’est-cepasunpeuégoïsted’oublier,mêmesionréussitàlefaire?
ainsi,onrestedanslemêmecercle,sanspossibilitéd’assumersonexpérienceetdeprogresser,dedonnerl’occasionauxgénérationsfuturesdedevenirdifférentes,desurpasserlesdouleurssuperfluesinventéesparleursancêtres.
sionoublie,sitoutlemondeoublie,l’atrocitédelaguerreviendradenouveauetneserapasreconnue,onseraprisdenouveauaupiège,etcequiestpire,onserareprisaumêmepiègequiprovoqueralamêmedouleuretlemêmeeffortdes’entirer.cerclevicieux.
entoutcas,tout lemonden’apaslamêmecapacitéd’oublier.desfois,c’estsimplementunequestiondesensibilité,desfois,c’estuneluttedureetlongueoùilfautconquérirledomainedesalibertépsychiqueàpetitspassansaucunegarantiequ’onarriveàlafin,jusqu’àl’oubli.
oublierneveutpasdire,nonplus,deveniramnésique,unamnési-quen’estpasmoinsmaladequeceluiquinepeutselibérerdesontrau-ma;celaneveutpasdire,nonplus,effacerdelamémoire,maislibérersonprésentdelahantisedupassé.
L’oubliabeaucoupdedegrés,oubliercomplètement,pourceuxquiontvéculeshorreursdelaguerre,estimpossible,maisilyaunepartidelamémoirequ’ilfauttromper,désarmer,neutraliser,luiôterladomina-tionqu’elleasurlavieintérieure,psychiquepournepastomberdanslepiègedelahaineenversceuxquiontcausédumal,dansl’agressionouencorepire,dansl’auto-agression.undespersonnagesdebarbusses’ex-clame:«chaquechosequ’onavuétaittrop.onn’estpasfabriquépourcontenirça.»(barbusse2007:381-382)
etsurcepointtoutlemondeestd’accord,qu’onn’estpasfabriquépour contenirune tellequantitéd’horreur,cru, ainsiquebarbusse etmalaparte,uncritiqueetdeuxsoldats-écrivainsquiontvéculagrandeguerredetoutprès.

Trauma, témoignage et démystification - expérience de la Grande Guerre: Barbusse et Malaparte
91
Nasl
e|e 19
• 2011 • 8
5-9
3
c’esthenribarbussequi,publielepremier,en1916,leromanauto-biographiqueLe feu, contenant ses souvenirsde laguerre. il s’est en-gagévolontairementdans l’infanterieà l’âgede41ans,et l’œuvrequ’ilengendreaprèsdeuxanspassésdanslestranchées,estd’unréalismesiinattendu,quantauxdescriptionsdesscènesdelaguerreetàlacritiquesociale,quecelaasoulevélesréactionsaiguësdupublic,maisaussil’en-thousiasmedesescamaradesdefront.c’estl’espritpacifistequidominecetteœuvre,critiquesocialeetdevoirdemémoire.
sionprendenconsidérationcescaractéristiques,onauraitpus’at-tendreàcequelaréactiondeJeannortoncrusoitpositive.mais,sesexigencesaupointdevuedel’éthiquedutémoinetd’unrécitvéridiquesontstrictesetprécises:resterauplusprochedelavéritédesonexpé-rience,sepriverdes«ondit»,c’est-à-direéliminerl’omniscienceetdé-crireseulementcequ’onavu,éprouvé,sentietpensé.
ilreproche,donc,àbarbussesanarrationomnisciente,sonstylesu-blime,sonrythmeenlevé,cequicontribuentàfairedelagrandeguerre,selonsesmots,uncataclysmelittérairementadorné,parcequelesfaitsréelssontassezextraordinairespournedemanderaucunornement.
mais ce que cru trouve vraiment impardonnable c’est le fait quebarbusseaitobtenuleprixgoncourt,c’estunepreuve,d’aprèslui,qu’ilflattelegoûtdupublic.
d’autrecôté,lejeunemalaparte,quis’engagecommevolontaireà16ans,d’aborddansl’arméefrançaise,pourpasserplustardaufrontitalien,esttellementfascinéparl’œuvreparueenfrance,qu’illaprendpoursonmodèlelittéraireetseproclamelebarbusseitalien.
L’influencedebarbusseestfacilementvisibledansl’analysedesévé-nementsde la guerre, ton et émotions, etdans les visions révolution-nairesethumanistes,mais,étantdonnéquelescirconstancesdesdeuxauteursétaienttrèsdifférentes,malapartealaisséuneœuvreautonomecarils’estdonnéunetâcheparticulièreetexigeante.
ayantparticipéàlabatailledecaporetto,unedespluslourdesdé-faites nationales italiennes qui a fait environ 270.000 de prisonnierset40.000demorts,ilsechargededévoileraupubliclavéritésurcetévénement.
Leschiffresnesontpaslesplusgênantsdanscettehistoire,maispluslefaitquel’arméeitalienneaétébattueparunennemiplusfaible.L’exem-pleleplusfrappantestceluidugénéralervinrommelqui,d’après,sesbiographes,emprisonna9000italiens.
malapartemènedoncunedoublelutte,contreletraumaindividueletcontreletraumacollectif,ouplusprécisément,ilventmontreraupu-blicquelabatailledecaporetton’estpasunactedelâcheté,maislarévo-

Petrović Lj.
92
lutiondessupprimésenvoyésaufrontcequiprouvel’excessivitédutitreVive Caporetto ! la révolte des saints maudits. entoutcascequ’onnepeutpasluireprocher,c’estd’avoirflattélegoûtdupublic,car,sonœuvreterminéeen1918etn’ayantpasputrouverd’éditeur,ildécidedel’impri-meren1921àsespropresfrais.chacunedestroiséditionssuivantesaétéconfisquéeetsuiviedemenacesetdeprotestationsdesnationalistesdevantleslibrairiesoùl’œuvreétaitexposée.bariccoditquecaporettoestunthèmetabouiséettraumatique,mêmeaujourd’hui,donc,enpar-lerencetemps-là,étaitunevraieaudace.
il s’efforce de lever le tabou sur’un événement historique, sur’unesituationconcrète,etcequiluimanquedanscetteentreprise,etquiest,d’autrepart,nécessairepourquecesoitnomméuntémoignage,cesontlesscènesréellesdelaguerre,cequelui-mêmeavuetvécu,d’autrepart,ils’occupebeaucoupdelacritiquesociale,«desadorateursdel’héroïsmedesautres»commeilledit.
maisleplusimportant,c’estlefaitqu’iln’enlèvepasl’idéedusensàlaguerre.Lesdescriptionsdesrescapésdevraientenleverlesensàtoutbutplusélevéquipourraitjustifierlaguerre.Laréalitédesdescriptionsdevraitdétruiretoutmythe,touteglorificationdelaguerre,tandisquel’œuvredemalaparteestpleinedemythes:c’estlanationitaliennequiestlapluschrétienneaumonde,lesoldatvictimepauvreetfier,l’héroïsmedelaracelatine.
cependant,laguerrepourcruestunmalpur,horsdupatriotisme,desraisonnementsetdesmécanismesdejustificationetàcepointaucundesdeuxauteurs,surtoutmalaparte,nesatisfaitauxcritères.
mais,siilnes’agîtpasicid’untémoignageausensstrictdumot,etmêmesionacceptelathèsequeletémoignagecommegenrelittéraireapparaîtaprèsladeuxièmeguerremondialeaveclesrescapésdescampsnazis,etquelesdimensionsdutraumatismedesécrivainsdelagrandeguerren’atteignentpascellesdesvictimesde l’holocauste,onnepeutpasnierlefaitquelesdeuxauteursontsenti l’horreurdelaguerredetoutprèsetqueleurenvied’écrireviennedufaitqu’ilsontétéprofon-démentfrappésparcequ’ilsavaientvuetqu’ilsontvoulumettrelemalvécuenrécitpoursesoulagereux-mêmes,pourrendrehommageàceuxquisontdisparuspourtoujoursetpouravertirlesgénérationsàvenir.celaprouvequ’ilsonttrouvél’équilibreentrel’oublietlamémoireetaumoinsessayédedirel’indicibleetd’exprimerl’inexprimable.

Trauma, témoignage et démystification - expérience de la Grande Guerre: Barbusse et Malaparte
93
Nasl
e|e 19
• 2011 • 8
5-9
3
Bibliographie
barbusse2007:h.barbusse,Lefeu,paris:folioplus.cru1929:J.n.cru,Témoins,nancy:pressesuniversitaires.felmanandLaub1992:sh.felmanandd.Laub,Testimony crises of witnessing in literature, psychoanalysis and history,London:routledge.malaparte1981:c.malaparte,viva Caporetto! La rivolta dei santi maledetti,milano:arnoldomondadorieditore.parent2006:a.m.parent,trauma, témoignageetrécit.Ladéroutedusens,Protée,volume34,chicoutimi:universitéduquébec,n.2-3,113-125.suleiman1998:s.r.suleiman,exileand creativity, signposts, travelers, outsi-ders, backward glances,London:dukeuniversitypress.Барико2007:А.Барико,Ова прича,Београд:Паидеиа.Франкл1987:В.Франкл,Нечујан вапај за смислом,Загреб:Напријед.Франкл1994:В.Франкл,Зашто се нисте убили: тражење смисла живота,Београд:ЖаркоАлбуљ.
Љиљана ПетровићТРАУМА, СВЕДОЧЕЊЕ И ДЕМИСТИФИКАЦИЈА –
ИСКУСТВА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: БАРБИС И МАЛАПАРТЕ
РезимеЦиљовоградаједаистражинаглашенупотребузасведочењемприсутнукодауто-
раучесникауратукојасе,уњиховомслучају,доживљавакаоморалниимператив,каоињиховупотребудапреживљенуратну трауму транспонују упричу, упокушају да јерационализујуинатајначиннеутралишу.Резултатиистраживањаћепоказатидајепи-тањесведочењаиратнетрауме,којепосебнодобијаназначајупослеискустваХолокауста,првипутбилопостављеновећнаконПрвогсветскограта,штосевидиукритичкимде-лимаЖанаНортонаКриа.Будућидаћенаведенетемебитиразматраненаделима:Oгањ, aнријаБарбисаи Живео Кобарид! Побуна светих проклетника,kурциаМалапартеа,урадућебитикоришћенианалитичко-синтетичкиметодолошкипоступци,компаратив-наметода,каоипсихоаналитичкакритика.Раднаводиназакључакдазаписцекојисупреживели ратписањепредстављасвојеврсносведочењеиимавредносттерапеутскогпоступка.
Примљено: 02. 02. 2011.

Petrović Lj.
94

95
УДКрад
[email protected],[email protected]
Justyna Zychuniversité de varsovie
LA RÉCEPTIoN DE LA PSYCHANALYSE DANS LE MILIEu DE LA NRF DANS LeS ANNéeS VINGT Du
XXe SIèCLE
LeprésentarticleapourbutdeprésenterlerôleconsidérablequelescritiquesliésàlaNouvelle Revue Française ontjouédansladiffusiondelapsychanalyseenfrancedanslesannéesvingtduxxesièclequandlathéoriefreudienneyétaitencoreméconnue.endécrivantl’accueilhosti-leréservéàlapsychanalyseenfranceetl’engoumentnaissantpourcettediscipline,àcetteépoque-là,danslessalonsparisiens,l’articleseproposedemettreenrelieflemériteindéniabledescritiquesetécrivainsgroupésautourdelarevue,telsqueJacquesrivière,albertthibaudet,Julesro-mainsouandrégide,d’approfondirlaconnaissancedel‘inventionfreu-dienneauprèsdupublicparlebiaisdedifférentesinitiatives,notammentgrâceauxarticles,auxtraductions,auxconférencesouencoreàlafictionlittéraires’inspirantdelathéoriedefreud.
LestexteslesplusimportantsconsacrésàlapsychanalyseparusdanslaNRF,audébutdesannéesvingt,sontrappelésd’unemanièresynthé-tiquedansleprésentarticle,quisefocaliseavanttoutsurlesconsidéra-tionsdescritiquesde laNRFconcernant l’adoptionpossibledesoutilspsychanalytiques dans le domaine littéraire. La présence, dans leursécrits,desréflexionstellementoriginalesàl’époqueconfirmelerôlepré-curseurquelegroupeNRF ajouédanslaréceptiondelapsychanalyseenfrance.
Mots-clés:La Nouvelle Revue Française, lapsychanalyse, lathéoriefreudienne,lacritiquelittéraire,lecompterendu,l’article,précurseur
raressontlestravauxetlesmonographiestraitantdel’histoiredelapsy-chanalyseenfrancequiremontentàlatoutepremièrepériodedelapré-sencedelapenséefreudiennedanslediscoursscientifique,médicaletcritiquefrançais,commes’iln’yavaitpasdevéritabledébutdel’histoirede la théorie freudienneenfranceoucommesiellenedébutaitvrai-mentqu’avecLacanquil’aconduitetoutdesuiteàsonapogéedanslesannéessoixanteetsoixante-dix. cependant,siLacanapudévelopperlesthèsesfreudiennesd’unefaçonaussibrillante,c’estaussi,oupeut-êtreavanttout,grâceàl’immenseeffortdesprécurseursdelapsychanalyse

Zych J.
96
enfrance,aujourd’huiunpeuoubliés–necitonsquemariebonaparte,angélohesnard,renéLaforgue,charlesbaudouin−quis’étaientlitté-ralementbattuspendantdesannéesentièrespourquelapsychoanalyse–commeonlanommaitencoreàcetteépoque,enprononçantlemotavecl’hiatus−soitreconnueenfranceentantqu’unebrancheneuveetpro-metteusedepsychologie,voireunetoutenouvelledisciplinedescienceentraind’émerger,maissérieuseetfiable.Lesous-titretrèsparlantdel’ouvragemonumentald’élisabethroudinescoconsacréàl’histoiredelapsychanalyseenfrance,àsavoirla bataille de cent ans,n’estpasdûauhasard(roudinesco1986).
grâceàsontravail,ainsiqu’àceuxd’autreshistoriensdelapsycha-nalyseenfrance,noussavonsquelaréceptiondesthéoriesfreudiennesenhexagoneétaitmarquéepardeuxdécenniesderetardetparl’hostili-tésanspair.oùchercherlagenèsedecerejetopiniâtre?Laprédilectiontoutecartésiennepourlalogiqueetlalimpiditéintellectuelle,laméfian-ceenverslasyntaxeallemandecompliquéeassimiléeaustylehermétiquedestraitésdephilosophesd’outre-rhinduxixesiècle,lamentalitébour-geoisedel’époqueetlediktatdel’églisecatholiqueéliminantlasexualitédetoutdiscours–scientifiqueouautre,l’ignorancequasi-généraledelalangueallemandeenfrancedudébutduxxesiècle,l’ambiancegerma-nophobeà l’aubede lapremièreguerremondiale et suite au souvenirtoujoursvifdel’échecdesedan,enfinl’antisémitismeprésentpartouteneurope–touscesnombreuxfacteurscontribuentàexpliquerpourquoi,enfrancedansl’entre-deux-guerres,lapsychanalyseseheurtaitàunre-fuscatégoriqueetpassaitpourunedisciplinepseudoscientifique,semi-mistique, voire charlatanesque et, de surcroît, scandaleuse.n’oublionspasqueletermede«pansexualisme»estdevenuàcetteépoquepresqueun synonimedunomde la théorie freudiennequi, elle,pendant troplongtemps,estrestéecomplètementinconnue,même–àquelquesraresexceptionsprès–demédecinsetdepsychologues.souventlaconnais-sancedelapsychanalyseselimitaitàdesmots-cléstirésdeleurcontexte,parmi lesquelsceuxà l’arrière-goûtdesensation,doncfaisantréféren-ceàlaviesexuelledel’homme,étaientsurtoutretenusetdiffusés.uneautreraisonpourlaquellelapsychanalyseétaitméconnueenfrancedecetemps-làestlefaitquedenombreuxscientifiquesfrançaisaientrefusétouteoriginalitéàlathéoriedefreud,enprétendantqu’ilajusterésuméet développé ce que ses prédécesseurs, tels que Jean-martin charcot,charlesrichetoupierreJanet,avaientdéjàdit.
Lapsychanalyseétaitconsidéréecommetroppeuscientifiquepourêtre enseignée à l’université, comme trop révolutionnaire pour qu’ellepuisseêtrepratiquéedansdeshôpitauxpsychiatriqueset,enfin,comme

La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle
97
Nasl
e|e 19
• 2011 • 9
5-10
6
tellement scandaleuse et obscène que personne ne devrait s’en occu-per.eneffet, lesmilieuxecclésiastiques,médicauxetuniversitairesenfranceontformél’unisono ostracisantfreudetsesthéories.d’oùlefaitquependant longtemps lafrance soit restéeune tacheblanche sur lacartedespaysoùdenombreusesassociationsetrevuespsychanalytiquesétaientcréées,oùdescongrèsetdescolloquesconsacrésàlapsychana-lyseavaient lieuetoùdestravauxdefreudétaient traduits.Lesfran-çaisdevaientattendrelapremièretraductiond’unouvrageduviennoisjusqu’à1920et,deplus,illadevaientauxfrancophonessuissescarc’estLa Revue de genèvequiapubliélatraductiondecinqconférencessurlapsychanalysequefreudavaitdonnéesen1909lorsdesonséjourauxétats-unis:lapublicationenquestionportaitletitreorigine et dévelop-pement de lapsychanalyseetelleétaitsignéeparunpsychologuesuisseyvesLeLay(demijolla1982:19).
certes,cettepremièretraductionavaituneimportanceànepassu-restimer,maiscen’estpasellequiadéclenchélavoguedel’intérêttardif,maisvifpour l’invention freudienneenfrance.Levrai tournantdansl’histoiredelapsychanalyseenhexagoneestmarquéparlefaitquecettedernièreaitéveillélacuriositédesmilieuxlittérairesparisiens.silalit-tératurefrançaiseestévoquéedanslecontextedesthéoriesfreudiennes,d’habitudec’estpourfaireréférenceauxsurréalistesquiseproposaientd’enfairelefondementthéoriquedeleurart.
andrébreton,déjàenoctobre1921,estalléàviennepourrendrehommage au «plus grand psychologue du temps», comme il appelaitfreudàl’époque(demijolla1982:19).cetterencontres’estavéréeuneénormedéception,carlefondateurdelapsychanalysequ’ilsavaientdé-signépourleurpatron,n’apascachésadistanceenverslessurréalistesetilaavouéouvertementqu’ilnecomprenaitpasleurartetqu’ilconsi-déraitlesmembresdecegroupeartistiquecommedes«fouxintégraux»(freud1967:490).toutdemême,àforcedeciterlenomdefreudetsestravaux,lessurréalistesontrompucemutismeentourantlapsychanaly-seenfrance,ceque,d’ailleurs,freudlui-mêmeareconnu,enadmettantquel’intérêtpoursadisciplineenfranceétaitnéegrâceauxhommesdeslettres(demijolla1982:23).
etils’agit–précisons-le–del’intérêtdugrandpublic.c’estlapres-sequotidienneetlethéâtrequis’emparentdecethèmeàlamode.desquotidienspopulairespublientdesarticlesayantpourbutd’expliquerenquoiconsistelaméthoderévolutionnaireetcontroverséedecureparpa-role,inventéeparledocteurfreud,ainsiqu’inculquerauxlecteursdesrudimentsde lanomenclature freudienne: l’inconscient, lanévrose, lecomplexed’Œdipe…Lapsychanalyses’introduitégalementdanslessal-

Zych J.
98
lesthéâtrales,cequi,bienévidemment,contribuelargementàsavulga-risation.L’unedespremièrestranspositionslittérairesdelapsychanalyse,lapiècedehenri-renéLenormandintituléeLe mangeur des rêves,jouéetoutd’abordàgenève, fait furreur sur les scènesparisiennes enhiver1921.s’inspirantdesthéoriesfreudiennesenvogue,voireenyfondantlenoyaudesonintrigue,ledramaturgefaitduduopsychanalytiqueanaly-sant-analysteunepairedeshérosprincipaux–latrameserésumeàl’his-toiretragiquedel’amourentreunpsychanalysteetsapatientenévrosée.Lapièceestl’événementdelasaison.dèslors,lesuccèssurlesplanchesse traduit immédiatemmentpar le triomphedans les salonsparisiens.Leshabituésdecesderniersseprécipitentsurlesdivanspourparticiperauxsessionspsychanalytiques,étantlederniercridemode.
cependant,cesoudainsuccèsspectaculaire,bienquesuperficiel,delapsychanalyseenfrance,n’étaitpasdûuniquementàlapublicitétapa-geusequeluiontassuréelessurréalistesetlethéâtre.àcetteépoque,lescritiquesetlesécrivainsliésàlaNRF sepiquaientaussidesthéoriesfreu-diennesetpourcause,carilsavaientaccèsàlapsychanalyse–pourainsidire–depremièremain.etceciparcequ’en1921eugéniesokolnickaestarrivéeàparis.freudlui-mêmel’avaitadoubée,enenfaisantsonémis-sairelégitimesurlesolfrançais,aussihostileàsesthéories.cettepolo-naised’originejuiveavaitétudiéàvarsovie,àparis,àzurichetàmunich,avaitfréquentélescoursdeJanetetdeferenczietavaitétéanalyséeparJungetensuiteparfreudlui-même.ilseraitdoncdifficiled’imaginerlasourcedusavoirpsychanalytiquepluscrédiblepourlesécrivainsetlescritiquesgroupésautourdelaNRF.sokolnickaapénétrédanscemilieulittérairegrâceàpaulbourgetqui l’yavait introduite.bientôt, les«let-trés»ontcommencéàserassemblerautourdecettepersonnalitécha-rismatiquepourapprofondirleursconnaissancesenpsychanalyse.ellerecevaitchezelle,ruedel’abbé-grégoire,chaquesemaine,le«clubdesrefoulés».andrégide,Jacquesrivière,rogermartindugard,gastongallimardetJeanschlumberger,touséditeursdelaNRF,étaientmem-bresdececénacleetilsappellaienteugénie«ladoctoresse»(v.diener,roudinesco2002:chapitreiv,5).
commeleremarqueélisabethroudinesco(roudinesco2009:688),«l’intérêtdugroupedelaNRFpourlapsychanalyseestaussiimportantqueceluidessurréalistes.cependant,departetd’autre,lesenjeuxsontdifférents.chezlesécrivainsdelaNRF,ils’agitmoinsdefairepasserlarévolutionfreudiennedansdesactesd’écriturequederéfléchirdema-nièrecritiquesurlesrapportsdelalittératureetdelapsychanalyse.toutcommenceparl’extraordinaireimbrogliod’unecorrespondanceperdueentrefreudetgide».eneffet,silacorrespondencequebretonaentrete-

La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle
99
Nasl
e|e 19
• 2011 • 9
5-10
6
nueavecfreudestsouventcitée,l’échangeépistolairedecedernieravecgiderestemoinsconnu.orgide, luiaussi, s’intéressaitbeaucoupà lapsychanalyse,cequil’aamenéàsolliciterlecontactdirectavecsoncréa-teur.L’écrivainacomprisquecettenouvelleméthodepouvaitfournirdesoutilspermettantdepénétrerlesprofondeursdel’âmehumaine,inson-dables jusqu’à l’invention freudienne, et il aapprécié le faitquefreudait réservé, dans sa théorie, une place aussi importante à la sexualité.d’ailleurs,ilvoulaitquecedernierécriveunepréfaceàlatraductional-lemandedesonfameuxCorydon.dansunelettredatéedu26décembre1921gideaécrit:
J’aientenduparlerdefreudpour lapremièrefoisauprintempsdernier.Jenelispasl’allemandassezcourammentpouravoirosél’aborderdansletexteoriginaletcen’estquegrâceauxarticlesparusdeluidanslaRevue de genève quej’aipuprendrecontactavecsapensée.Jen’aipasencoreachevélalecturedesongroslivre[Introduction à la psychanalyse] dontj’attendaislatraductionavecunegrandeimpatienceetqu’aucunpsychologuen’aledroitd’ignorer(cit.d’après:roudinesco2009:689).
selonlesbiographesdefreud,lefrançaisauraitégalementécritauviennoispour luidemander lapermissiondetraduiresesœuvresauxéditions de laNRF. ce qui est sûr ce qu’andrégide a entretenu unecorrespondance suivie avec dorothy bussy, sœur de James strachey,reponsable de la traduction en anglais desœuvres de freud. en avril1921,il luiaécritunelettreexprimantsondésirviolentderencontrerfreud. malgré toutes ces démarches, la rencontre n’a jamais eu lieu(roudinesco2009:689−691).
pourtant,andrégideadéjàsuccombéàcettemodeirrésistiblepourunécrivain,consistantàsemettreàl’écoutedesonpropreinconscient,et,commeiln’apaspufaireconnaissancedefreudlui-même,iladécidéd’entreprendreuneanalyseavecsokolnicka.finalement,laméthoderé-volutionnairedecureparlaparolen’apasconvaincul’écrivain,carilarenoncéà l’analysepeuaprès l’avoircommencée–à lasixièmeséance−maistoutecetteexpériencedécevanten’estpasrestéesansrésonancedanssonœuvre.troisansplustard,en1925,ilaimmortalisésonana-lystedanssonromanles Faux-monnayeurs − souslenomtrèssemblablephonétiquementàsonnomoriginal,notammentmadamesophroniska−entantquepsychanalysteayantentreprislacuredupetitboris.gideatransposésousuneformelittérairelefameuxcasexposéparsokolnickadevantlegroupedelaNRF.cependant,dansleroman,laréussitethé-rapeutiquespectaculairedeladoctoresseesttransforméeenunéchecdébouchantsurlesuicidedujeuneprotagoniste,commesigidevoulait

Zych J.
100
seservirdesonœuvrepourprendresarevancheaprèssapropredéfaitepsychanalytique.
maismalgrésondésenchantementpersonnel,giden’apasdélaissél’activité de propagateur de la pensée freudienne. c’est lui qui étaitpartisandepublierlestravauxdefreudchezgallimardetilalargementcontribué à la parution, en 1923, destrois essais sur la théorie de la sexualité danslatraductiondeblanchereverchon-Jouve,ouvragequiainauguréàlaNRFlacollectionintitulée«Lesdocumentsbleus».
certes, gide est une figure de proue dans le milieu de la NRF,maisleméritedes’intéresseràlapsychanalysenerevientpasàluiseul.d’ailleurs,cephénomèneétaittropcriardpourresterinaperçudescri-tiquesgroupésautourdelarevue.La NFRn’apaspunégligeroupasseroutrelefaitquelapsychanalysesoitdevenuelamodedesaisondanslessalonsparisiensetenavitefaituncompterenduassezsarcastiqueàseslecteurs,signéparJulesromainsqui,danssonarticleintitulé«aperçude lapsychanalyse», souligneàplusieurs reprises combiencette fasci-nationsoudainepourlapenséefreudienneétaitsuperficielleetpréten-tieuse.Ladescriptionhumoristiqueouvrantsontexteenditlongsurcetengouementcaricaturalpourlapsychanalyse:
cethiver-cisera, je lecrains, lasaisonfreud.Les«tendancesrefoulées»commencentàfaire,danslessalons,quelquebruit.Lesdamescontentleurdernierrêve,encaressantl’espoirqu’uninterprèteaudacieuxyvadécouvrirtoutessortesd’abominations.unauteurdramatiquedontjetairailenomadéjà–voyantpoindrelavogue–trouvéletempsd’écrireetdefairerefuserparplusieursdirecteursuneoudeuxpiècesnettementfreudiennes.Jeluiconseilledelescorserunpeuetdelesoffrird’urgenceaugrand-guignol.enfin les revues spéciales, après avoir pendant vingt-cinq ans omis deconstater l’existencedefreud, sedonnent le ridiculede ledécouvrir,dediscuterhâtivementsesthèsesou,cequiestplustouchant,delesadmettrecommelachoselaplusnaturelledumonde(romains1922:5)
cetarticle,datantdejanvier1922,portraituredoncvraimentsurlevifl’ambiancedessalonsparisiensdel’époque,s’apparentantàunrepor-tagepittoresque.aprèscepréludeironiqueetpleind’allusionsincisivesàl’actualitéparisienne,romainsdélaissesaveinedereporteurobserva-teurpoursonespritdesynthèseetlavolontéd’éluciderauxlecteurslavraie valeurde l’invention freudienne, en leur expliquant cequ’il fautcomprendreaujustesousletermedepsychanalyse:
en fait, le mot de psychanalyse se trouve aujourd’hui recouvrir quatrechoses solidaires,mais distinctes: uneméthoded’investigationpropre àdécelerlecontenudel’esprit;unethéorieétiologiquedesnévroses;unethérapeutique des névroses; enfin une théorie psychologique générale(romains1922:7).

La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle
101
Nasl
e|e 19
• 2011 • 9
5-10
6
si romains s’est proposé de faire un résumé ample et détaillé dela théorie freudienne, et par conséquent, s’est contenté de décrire etde rapporter, albert thibaudet, que l’omniprésence soudaine de lapsychanalyse dans les conversationsmondaines a également poussé ày consacrerunarticle, adépassé,dans son texte, leniveaude compterendupourdébouchersurlesdéveloppementspossiblesdelanouvelle– ou plutôt récemment découverte − méthode aussi prometteuse. ilfaut remarquer que son article est antérieur à celui de romains: ila été publié en avril 1921, bien sûr égalementdans laNRF. sialbertthibaudet, comme beaucoup d’autres commentateurs français de lapsychanalyse,refusedevoirenfreudl’innovateurtoutàfaitoriginal1,ildéplorenéanmoinsquelapenséefreudiennesoitméconnueenfrance.ilexprimecetregretdanslepréambuledesonarticle:
onsaitquelleinfluenceconsidérableexercentaujourd’huihorsdefranceles théories psychologiques et lesmoyens de thérapeutiquemorale quesiegmundfreudaformuléssouslenomdepsychanalyse.Jedis«horsdefrance»,cardesétrangersetfreudlui-mêmeontmanifestéplusieursfoisunétonnementunpeuattristéenvoyantquenonseulementnotrepublicinstruit,maismême,cequiestplusgrave,nospsychologuesparaissentlesignoreràpeuprès(thibaudet1921:467).
envéritableprécurseur,lecritiqueattirel’attentiondeslecteurssurdes issues intéressantesquecette théorieoffreàdenombreusesautresdisciplines,outre cellesdans lesquelles sonutilité semblait évidente, àsavoirlapsychologieetlamédicine.iln’estpassurprenantqu’ilsefocalisesurlapossibilitéd’appliquerdesoutilspsychanalytiquesàl’analyseetàl’interprétation d’œuvres littéraires, possibilité, d’ailleurs, déjà réaliséepar freud lui-même et certains de ses adeptes. thibaudet décrit cestentativesplusoumoinsheureusesdepsychanalyserlalittératuredelamanièresuivante:
(…)freudet sesdisciplesontpenséque lapsychanalyse jetaitune trèsneuve lumièresur lagenèsedesœuvres littéraires, ilsontessayé,parfoisavecingéniositéetparfoisavecunebienlourdefantasie,del’appliqueràl’histoireintérieuredesartistesetdesécrivains(thibaudet1921:470).
danssonarticle,lecritiqueanalyseendétaildeuxexemplesd’ouvra-gessuisses–detelstravauxprovenantdel’hexagonen’existantpasenco-
1 dans l’article en questionthibaudet écrit: «et je sais bien que ces théories nousparaîtrontenfrancemoinsneuvesqu’ellesnesemblentailleurs,etquefreudnoussembleraparfoisavoirsimplementnommédecertainsvocablesnouveauxetpres-tigieuxdesfaitsd’observationquel’analysepsychologiquenousavaitrévélésdepuislongtemps,commelesmédecinsquicroientavoirfaitavancerlasciencedumaldetêteenlenommantcéphalgie»(v.thibaudet1921:469−470).

Zych J.
102
reàl’époque−dontlesauteursontadoptélaperspectivefreudiennedanslebutd’intepréterdesœuvreslittéraires,àsavoirlapréfacedepierreko-hleràadolpheetlelivredevodozsurrolandetplusparticulièrementsur lemariage de Rolanddevictorhugo.ilrelèveaussibienles idéespertinentesdesauteurscommentésque leursthèses luiparaissantmalfondées,voireridicules.ilnedoutepasdel’utilitédelaméthodepsycha-nalytiquedans lesétudes littéraires,àconditionqu’ellenemonopolisetout lediscourscritiqueen l’apparentantàun traitémédical.eneffet,selonthibaudet,lapsychanalysenedevraitquerenforcerl’approchecri-tiquetraditionnellepourpermettredepénétrerlesensleplusprofondde l’œuvre.citons laconclusionde l’auteuroù, toutenavertissantdesdangersdel’excèsdepsychanalysedanslacritiquelittéraire,ilvantelesavantagesdesonemploimodéré:
(…)lecheminquinousaconduitsnousmontrequ’elle[lapsychanalyse]mène loin à la condition d’en sortir un peu, de voir parfois en elle denouveauxnomsappliquésàdevieilleschoses,delamettreaupointetàsonrangparmid’autrescourantsdepsychologieetdecritique.ilnefautpas liquider dédaigneusement les livres qu’elle inspire en suisse ou enallemagneparcequ’ilsnousrebutentd’abordparleuraspectd’excentricitéet de lourdeur. il nous faut comprendre que ces coups de sonde dansl’inconscient poétique ou artistique touchent en effet une matière trèsriche,uneépaisseurde réalités intérieuresoùbiendesdécouvertes sontpossibles.mais ceux qui s’y appliquent ne sauraient éliminer l’esprit definesse ni l’acquis de la critique littéraire. […] une fusion plus étroitede l’esprit scientifique et de l’esprit littéraire qui, séparés l’un de l’autre,arrivent,encesmatières,siviteauboutdeleurrouleau,estbiendésirable,etc’estd’unetelleunion,d’unetellediscipline,quedépendprobablementl’avenirdecesétudes(thibaudet1921:480−481).
bien évidemment, laprésencede lapsychanalysedans laNRF neserésumepasauxarticles luiconsacrésdirectementetayantpourbutd’expliqueraupubliclesenjeuxdecettethéorieenvogueetsesprolon-gementspossiblesdansledomainedelalittérature.Lesauteurspubliantdans laNRF desnotes surdes livresnouveaux étaient innovateurs aupoint de faire passer des éléments de l’optique freudienne dans leurscomptesrendus.bienentendu,àcetteépoque-là,ilnepeuts’agirencorequedesnotionsdelanomenclaturefreudienneoutoutsimplementdelamentiondunomdufondateurdelapsychanalyse,maismêmecesma-nifestationssuperficiellesdufreudismeassurentauxcritiquesdelaNRFletitredepionnierscapablesdeseservirdéjàdesconceptsquecertainsn’avaientpasencoredécouvertsouapprofondis.etc’estJacquesrivièrequiteinterasurtoutsestextescritiquesdecettenotepsychanalytiqueàlamode.

La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle
103
Nasl
e|e 19
• 2011 • 9
5-10
6
ainsi,danslaNRF datantdejuillet1923,apparaîtlecompterenduduromandefrançoismauriacLe Fleuve de feu signéJacquesrivière,dans lequel lecritique, inspirépar lapsychanalyse,donnera saproprerecette pour écrire un roman parlant d’amour qui soit véridique dupointdevuepsychologique.L’essaicommenceparunephraseassezin-triguante:«ilestbiencertain,commec’estdevenuunlieucommundeleproclamer,surtoutdepuislapublicationdesouvragesdefreud,quel’amouratteintenfranceàuneperfection,etsurtoutàunepondérationqu’ilnerencontrenullepartailleurs»(v.rivière1923:98).eneffet,danscetarticle,rivièreprétendque les romanciers françaisnemontrent ledésirqu’en tantquecombléetharmonieux,cequi l’amèneà formulerunesortedepostulatqu’il leuradresseetquiconsisteàpeindre laviesexuelledel’hommed’unefaçonplusvéridique,avectoussescomplica-tionsettourmentspossibles.néanmoins,illesavertitdudangerpossi-bledetomberdanslepiègedemultiplierdesapprochescaricaturalesetmonothématiquesdelasexualité,serésumantauxportraitsdesobsédéssexuelsetdesnévrosés.
parfoislenomdefreudluivientspontanémentàl’espritquandl’œu-vrelittérairequ’ilestentraind’analyserestmarquéeparunconceptouunmotifcaractéristiquepourlapsychanalyse.aussi,rivièrecite-t-illenomdesoninventeurdanssoncompterendudel’œuvredeJeancoc-teauintituléele secret Professionnel:illementionnenotammentdanslecontextedusymbolismedanslerêve,sujetdeprédilectionduviennois(rivière1922:631−633).
si l’échode la psychanalyse rétentit déjà dans ses textes critiques,Jacquesrivière entreprendra également l’activitédepropagateurde lathéoriefreudienne,ense lançant,aumoisde janvier1923,dans lasé-riedequatreconférencesauvieux-colombierintituléequelques progrès dans l’étude du cœur humain.
en guise d’introduction, sa première conférence, sous le titreLes trois grandes thèses de la psychanalyse,estconsacréeexclusivementàlapensée freudienne, se proposant de présenter et d’expliquer au publiccellesparmilesdécouvertesdefreudquerivièreconsidéraitcommelesplusprécieuses.aussi,avanttout,attribue-t-ilauviennoislemérited’af-firmerl’existencedel’inconscientpsychologique,enl’opposantenmêmetempsà laconceptionmétaphysiquede l’inconscientprésentechezdenombreuxautrespenseurs.endeuxièmelieu,ilénumèrelanotion-cléderefoulementqu’ildéfinitcommeunecertainerésistance,«uneforce,denatureproprementaffective,[…]quis’opposeàl’apparitiondanslaconscienceclaire,àl’illuminationdecertainsélémentspsychiquesqu’elleconsidère comme incongrus, comme impossibles à regarder en face»

Zych J.
104
(rivière 1985: 95). enfin,rivière attire l’attention sur la théorie de lasexualitéexposéeparleviennois,avecletermeessentieldelibido,quiserait,d’aprèsleconférencier,injustementassimiléeau«pansexualisme»,etqu’il faut,parcontre,comprendred’une façonbeaucoupplus large.voilàcommentil interprète lanotiondelibido:«[…]l’idéequeledé-sirestlemoteurdetoutenotreactivitéexpansive,meparaîtd’unenou-veautéetd’unevéritéadmirables.oumieuxencorel’idéequenousnesommescréateurs,producteursqu’entantquenousallonsdanslesensdudésir»(rivière1985:101).
Lestroisconférencessuivantesderivièreontpoursujetl’œuvredeproust et les analogies existant entre cette dernière et la pensée freu-dienne.d’un côté, le critique présente le cycle proustien comme unetranspositionromanesquedelathéoriepsychanalytique,enmettantenévidencelesgrandesquestionscommunesquiconstituentlenoyaudesréflexionsaussibiendel’écrivainqueduphilosophe-médecin,àsavoir:l’âme,letemps,lamémoire,lesexe,d’autrecôté,ilsoulignequ’aumoinsunedifférenceconsidérable lesdistingue:freudveutformulerdes loisgénérales,tandisqueproustseproposede«peindrel’essencefugitivedel’individu»(steel1987:907).
d. steel résumeainsi l’intérêt qu’éveille lapensée freudienne chezrivière:«ilestévidentquel’importancedelapsychanalyse,auxyeuxderivière,étaitprincipalementdenaturelittéraire.elleouvraitdenouvel-lesperspectivessurlecomportementsexueletsurlamotivationincons-cientedansleroman.enoutreelleavaitdesimplicationspourlacritiquelittéraire.àrivièrelemérited’avoirreconnuquelacritiquepsychanaly-tiquedevaitportersurl’œuvreetnon,commec’étaitlecasdanslesessaislittérairesdefreudetdelaplupartdesesdisciples,surl’auteur»(steel1987:915).
cerappelsynthétiquede laréceptionde lapsychanalyse,dans lesannéesvingtduxxesiècle,enfrance,etenparticulierdans lemilieudelaNRF,bienquebrefetsansdouteincomplet,apermisdemettreenvaleur le rôle sanspairqu’avaient joué lescritiquesgroupésautourdecetterevuedansladiffusiondelathéoriefreudienneenhexagone.nousavonsvuqu’ilsavaientpu,chosefortrareàl’époque,connaîtrelapsy-chanalysedepremièremainetdanssavesionlaplusorthodoxe,étantprochesdesokolnicka.s’ilsseréservaientlaplacedecommentateursunpeudistantsetsceptiquesdecettefoliepsychanalytiqueenvahissantlacapitale,ilsn’étaientcependantniindifférentsnihostilesàcettemode.bienaucontraire,ilscontribuaientlargementàladiffuser,maissousuneformeplus approfondie et équilibrée.compte tenude laqualitéde laNRF,ilspartaientd’una priori,qu’enécrivant,ilss’adressaientàunpu-

La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle
105
Nasl
e|e 19
• 2011 • 9
5-10
6
blicplusaverti.dansleursarticles,letondesensationrégnantàl’époqueàproposdelapsychanalyseadonccédélaplaceàlavolontéd’approfon-dirlesujet,deleprésenterd’unemanièreobjectiveetsolideetdemon-trerdevéritablesenjeuxdelathéoriefreudienne.deplus,lescritiquesliésàcetterevueétaientàlafoisdeschroniqueursetdescocréateursdelapsychanalyseenfrance,quiontmultiplié,enpassantpardesconfé-rencesetdestraduetions,lapublicationsd’articlesauxtranspositionslit-térairesdumotiffreudien.
Bibliographie
diener,roudinesco2002:y.diener,é.roudinesco,la psychanalyse en France,paris:adpf.freud1967:s.freud,Correspondance 1873−1939,paris:gallimard.demijolla1982:a.demijolla,Lapsychanalyseenfrance, in:histoire de la psychanalyse (dirigéparr.Jaccard),t.ii,paris:hachette,9−105.rivière1922:J.rivière,Lesecret ProfessionnelparJeancocteau,in:Nouvelle Revue Française,110,paris:gallimard,631−633.rivière 1923: J.rivière, Le Fleuve du feu parfrançoismauriac, in:Nouvelle Revue Française,118,paris:gallimard,98−101.rivière21985: J.rivière,quelquesprogrèsdans l’étudeducœurhumain, in:quelques progrès dans l’étude du cœur humain (dirigépart. Laget),cahiersmarcelproust,t.13,paris:gallimard,86−189.romains1922:J.romains,aperçudelapsychanalyse,in:Nouvelle Revue Fran-çaise,100,paris:gallimard,5−20.roudinesco1986:é.roudinesco,Histoire de la psychanalyse en France. 2 1925-1985.la bataille de cent ans,paris:éditionsduseuil.roudinesco32009:é.roudinesco,Histoire de la psychanalyse en France − jac-ques lacan. esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée,paris:Librairiegénéralefrançaise.steel 1987:d. steel, Jacques rivière et la pensée psychanalytique, in:Revue d’histoire littéraire de la France,5,paris:armandcolin,901−915.thibaudet 1921: a. thibaudet, psychanalyse et critique, in: Nouvelle Revue Française,91,paris:gallimard,467−481.

Zych J.
106
Јустина ЗихРЕЦЕПЦИЈА ПСИХОАНАЛИЗЕ У СРЕДИШТУ НРФ-а
ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА xx ВЕКАРезиме
ЦиљовогчланкаједаприкажезначајнуулогукојусукритичариблискиНовој фран-цуској ревији (nrf)ималиуширењупсихоанализеуФранцускојдвадесетихгодинаxxвекакада, јеФројдоватеоријатамобилајошувекнепозната.ОписујућинепријатељскипријемпсихоанализеуФранцускојинаклоносткојасетекрађалапремаовојдисципли-ни,утовреме,упарискимсалонима,овајчланакпокушавадаистакненеоспорнузаслугукритичараиписацагруписанихокоревије,каоштосуЖакРивијер,АлберТибоде,ЖилРоменилиАндреЖид,дапродубепознавањеФројдовоготкрићакодпубликеузпомоћразличитихиницијатива,нарочитозахваљујућичланцима,преводима,конференцијамаиликњижевнојфикцијикојајеинспирисанаФројдовомтеоријом.
Онајважнијимтекстовимапосвећенимпсихоанализиизашлимуnrf,почеткомдва-десетихгодинаxxвека, говорисесинтетичкиуовомчланку,којисеусредсређујепресвеганаразматрањакритичараnrfкојасетичумогућегусвајањапсихоаналитичкихала-танакњижевномпољу.Присуство,уњиховимсписима,такооригиналнихмишљењаутовремепотврђујеулогупретечекојујегрупаокоnrfодигралаурецепцијипсихоанализеуФранцуској.
Примљено: 31. 01. 2011.

107
УДКрад
Marija Džunić-DrinjakovićFaculté d’économie, université de Belgrade
JuBILATIoN ICoNoCLASTE DE MARCEL AYMÉ
Le rire jubilatoire et iconoclaste qui retentit dans de nombreuxcontesetnouvellesdemarcelaymé,rattachecetécrivainàunetraditionlittérairetrèsancienne,notammentauxgenresmédiévauxtelsquefarce,fabliauetsottie.cetravailseproposedereleverlestracesdecethéritagelittérairedansl’écritureayméenne.
Mots-clés:marcelaymé,rirejubilatoire,iconoclaste,farce,fabliau,sottie
si les récitsbrefsdemarcelaymé,qu’il appelle tour à tour contes etnouvelles,sanstenircomptedeladistinction1qu’onétablitgénéralemententrecesdeuxnotions(v.aubrit2002:117-120)représententunenou-veautédanslalittératurefrançaise,c’estqu’ilssedétachentsurlefonddugenrefantastique,telqu’ils’estdéveloppévers lafinduxviiièmeetaudébutduxixèmesiècle.alorsquelesillustresprédécesseursdemarcelayméqui excellentdans la formebrève, telsmérimée etmaupassant,construisentleurscontesetnouvellesautourd’unbasculementduréelaufantastique,toujoursinquiétantetangoissant,ceconteur-néinventelemoyendetraverserjoyeusementlafrontièreentreleréeletl’irréel,danssonuniversoù lesanimauxparlent, lespetits employés traversentdesmuraillesoubienviventunjoursurdeux.c’estainsiquelesurnaturel,loind’êtresynonymed’horreuretd’angoisse,s’yassocieàl’humouretaurire.desêtresfantastiquessortisdelégendesoudemythesnesuscitentpaslapeuretlafolieelle-mêmeestimprégnéedemaliceetderaillerie.cetamalgamedufantastiqueetduriren’estd’ailleurspasinconnudanslalittératuredessièclesprécédents:onletrouvedanscertainsgenresmi-neursdumoyenâge,tels farce, fabliauetsottie, lesquelstiraient leursmeilleurseffetsd’unmélangedumerveilleuxetdelafranchegaîté,delafusiondessituationscocassesavecunespritfrondeur…
1 L’attitudefaceàl’irrationnelestconsidéréegénéralementcommeundescritèreslesplussûrspourdistinguerlecontedelanouvelle.

Džunić-Drinjaković M.
108
Lefabliauseprésentecommeungenrenarratifbref(récitenocto-syllabes),faisantintervenirunnombrelimitédepersonnages,dansuneactionréduiteàuneseule«aventure»,quiprogressedemanièrelinéairedansunespacerestreintetdansuntempsresserré.décrivantlemondedelamaliceetdelaruse,dontlespersonnageséternelssontledupeuretledupé,lefabliauviseàamuser,maisilillustretoujours,explicitementou implicitement, une règle demorale pratique, réaliste et en généraltrivialement quotidienne (aubailly 1987: 200).outre le décor réalisteet la description desmœurs de l’époque, une autre caractéristique dugenreestlalibertédeparoleainsiquele«stylebas».commelefaitre-marquermichelzink,«untiersenvirondesfabliauxsontscatologiquesouobscènes,aupointsouventd’étonnerparlescabreuxdessituationsetlacruditédel’expressionmêmeàuneépoqueaussipeubégueulequelanôtre»(zink1992:217).
al’instardufabliau,lafarce(quiestàl’origineunintermèdecomi-quedonton«farcit»lesreprésentationssérieuses)apourobjetdesus-citer lerire;elleusepareillementducomique lesteetdesplaisanteriesgrivoisespourstigmatiserlestraversdutempsoutoutsimplementpourenseignersurlavie,defaçonréalisteetfamilière.c’estlegenrenarratifquiutilisenotammentlesmécanismesduretournementdesituation,lesprocédésscéniquesdudéguisementetde lacachette imprévue.si l’undesthèmeslesplussouventexploitésdelafarceestceluidel’adultère,c’estqu’ilpermetdemontrerd’unemanièreamusantelaprédominanceduprincipematérieletcorporel.L’auteurdelafarcefocalisesouventaveccynismelecôté«animalier»de l’homme,réduisant l’amourà l’instinctsexuel.oncomprendquelerirequecesdeuxgenressuscitent,avecladescriptiondespulsionsindomptablesetla«faiblessemorale»del’hom-mequienseraitlaconséquence,soitsouventgrossieretirrespectueux.tellefabliau,lafarceintroduitunjeuaveclalangue,enmettantenactedesproverbespopulaires(«Lavieillequigraissalamainduchevalier»;«farcedesfemmesquifontaccroireàleursmarisquevessiessontlan-ternes»),étalantparlàtoutessortesderuses,savoureusestromperiesetmalheursconjugaux.
cejeuaveclalangue,sourcedenombreuxeffetscomiques,esten-coreplusprésentdanslasottie:cegenredepiècebrève,nédanslesmi-lieuxurbains,estgénéralementconsidérécommeplus«intellectuel»quelafarceetlefabliau,carenmettantl’accentsurlaformefigéeilinterrogel’ambiguïtéetleslimitesdelalangue.Lasottieexploiteparticulièrementlediscoursfaitdeparadoxesetdenon-sens, tendantàdémontrerquedansdesproposquiparaissentêtredictésparladéraisonilyaparfoisplusdevéritéetdebonsensquedansdesproposdictésparlesenscom-

Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé
109
Nasl
e|e 19
• 2011 • 10
7-117
munetlesproverbescenséscontenirla«sagesse»dupeuple.safantaisieverbale,sescalemboursetlescoq-à-l’ânecachentmême,commelefaitremarquermichelzink,«sousunelibertéapparemmenttotale,unepa-rentéréelleaveclavirtuositéderhétoriqueurs»(zink1992:347).
or, l’influence de ces genres médiévaux est sensible chezmarcelaymé,notammentdanslesrécitsl’armure, Fiançailles, légende poldèveet grâce. nombred’élémentsnarratifsentémoignent:uncomiqueleste,l’histoire construite sur le contraste entre le haut et le bas, la duperiecommeressortdel’intrigue,toutessortesderusesetdetromperies,unrirequi jaillit du conflit insoluble entre l’instinct et la raison, entre lanaturebestialeetlanature«divine»del’homme…Leregardquemarcelayméportesurl’hommenesemblepasdifférerdeceluidel’auteurdelafarce:sansillusion,désabusé,voirecynique.
denisderougemontobservequecequiexpliquel’immensesuccèsdesfabliaux,c’estqu’ilssontissusd’un«ressentimentducorps»(rouge-mont1972:204).dansles«contesàrire»ayméens,réapparaîtlamêmeprimautédonnéeaumatérieletaucorporel,quisedoublesouventd’unvitalismeludique,commedanslerécitL’armure.cettegrivoisehistoired’unadultèrepascommelesautres,invited’unemanièreamusanteàré-fléchirsur lesrelationssocialesaussibienquesur la langue: lorsqu’unsoldatinduit lareineàtromperleroi,s’agit-ildecocuageoudecrimedelèse-majesté?résumonsenquelquesmotscettesavoureusetrompe-rieautourdelaquelleaymébâtitsonrécit:legrandconnétablegantus,égarédansleschambresdelacour,tombesurlareineentraindebroderlachemiseduroi(uneguirlandedemarguerites).Lesoldatn’ayantpasôtésonarmure, lareine leprend,dans lapénombredusoir,poursonmari.elleluiaccordesesfaveursavecbeaucoupdezèle,ellequid’habi-tude–commetientànouslesignalerlenarrateur-«vaauplaisircommeàl’échafaud».habituéeàentendre,danscessituations-là,leroiluiréciterdesverset luitenirde«tendresetgracieuxpropos», lareineest,onlecomprend,agréablementsurpriseparles«façonsmâlesetcavalières»desonvisiteurnocturne…Lelecteurapprendaussiquelesouvenirdecettesoiréeexceptionnelleresteravifdanssamémoire,d’autantqu’elleende-meure «meurtrie pendant toute une semaine», son amant n’ayant pasprisletempsderetirersacuirasse…commedanslesfabliaux,onvoiticilatendanceàglorifierlavolupté,ledédaindetouteslescomplicationssocialesdel’amour,l’indulgencepourleségoïsmesdelaviesexuelle.
Leroin’auraitjamaiseuventdecettefâcheusetromperie,maisunjourgantustombemaladeetcroyantsamort imminente, il tientàseconfesser.ainsileroiapprend,consterné,quesonconnétableaoséabu-serdelareineensefaisantpasserpoursonépoux.danssacolère,ilne

Džunić-Drinjaković M.
110
saitcommentréagir.cequiestclairpourlui,c’estquesonsoldatdoitêtresévèrementpunipouravoircommislecrime«delèse-majesté-car«unroinepeutêtrecocu».maisilresteconfussurunautrepoint:doit-il être jalouxounon ?carà encroiregantus, la reine est innocente,n’ayant«riensoupçonnédelasubstitution»…
Lesfabliauxraillaientlalittératureidéalisantedelasociétémédiéva-le.danslecontextecultureletlittéraireduxxèmesièclequiestlesien,marcelayménes’aviseévidemmentpasderelaterdessituationscomi-ques et cocasses afindepourfendre certaines règlesmorales, car ellessontdepuislongtempsdéjàtrèsrelâchées.ellessedoublentdoncd’élé-mentsorientantses«contesàrire»verslaréflexionsurl’hypocrisiedesmœurs,surl’absurditédesconventionsetdesrèglesdeconduited’unesociétéquiautoriseauxpuissantscequ’elleinterditauxfaibles…etauxmarginaux.elleinterditàlareinedefairel’amouraveclesoldatduroi,maisordonneenmêmetempsauroid’avoirdesmaîtresses.etcettecri-tiquesedouble,onl’auravu,d’uneréflexionsurlalangue:marcelayménousmontreleprince,incapabledesefieràsonjugement,convoquantses«plussavantsdocteursenphilosophie»etleurdemandantdeluidé-finir la jalousie afin qu’il puisse prendre de bonnes décisions concer-nantlareine.unjeuneéruditfinitpartrouverladéfinitionquiplaîtauroi: la jalousieseraitainsi«passion inquièted’unepersonnequicraintqu’onneluienpréfèrel’autre»(aymé1998:126).persuadéquegantusnevivrapas,leroisesentsoulagé:lareinen’ayantpasvuleconnétable,iln’aaucuneraisondesetracasser-iln’est«nullementjaloux».encoreunefois,marcelaymésemoqueimpitoyablementdusavoirpurementlivresque,del’incapacitédel’hommeàpenseravecsatête,àsefieràsoninstinctetsonbonsens.
ainsilessituationscocasseschezmarcelaymén’ontpaspourseulobjetdesusciterlerire,ellescontribuentégalementàillustrerd’unema-nièreamusante«lemessage»qu’iltransmet,unesortede«philosophie»qui imprègnesonunivers: lavienese laissepasenfermerdans l’étroitcarcandesmots,conceptsetidées.entémoigneaussiladernièrescène,oùlareinedonneune«leçon»auroi,necachantpasqu’ellepréfère,àses«vainsbabillages» et ses envoléespoétiques, lesbaisersdegantusquiont«ungoûtdeferetdefeu».outredesusciterlerireunpeugrossierfaceàlavictoiredel’erossurl’amourconventionnel,cettescèneapourfonctiondenousfaireréfléchirsurledécalagequ’ilpeutyavoirentrelemotdelachose.Lareine,lorsqueleroireprendses«gracieuxpropos»,lanceàsonépoux,agacée,que«tantqu’ilsecompareàunehirondelle,àune fontaine»,ellenepourra levoirquecommeune«piebavarde»,etserésigneraà«l’accomplissementd’undevoiràjamaisdépourvuede

Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé
111
Nasl
e|e 19
• 2011 • 10
7-117
cetteexaltantedignitéquiluifutrévéléeparunsoirdel’automne».Leroi,consterné,semetàsongerà«lavanitéde laphilosophieetdesesdéfinitions»(aymé1998:127).c’estainsiquel’histoireamusanted’unpersonnageberné,héritagecertainde la farceetdu fabliau, sedoubleimperceptiblementdeconsidérationsetdeviséesquidépassentlecadred’unsimple«conteàrire».
bakhtineamontréque le jeudedistanceenvers laparoled’autruiestunedessourcesimportantesd’effetshumoristiques.Lorsquegantuss’adresseauroi,ilsemetàmimerunetellelangue«élégante»etpleinedefioritures,laquelleneluiconvientguère.Lesmétaphoresuséesetlescli-chéspoétiquesauxquelsilarecoursetquinesontquedesbribesdesdis-coursd’autrui-ilareconnu«l’innocentereine»qu’ila«détournéedesesdevoirsd’épouse»,aumédaillonqu’elleportaitsurson«augustecorsage»(aymé1998:123)–contrastentfortementavecsafiguresymbolisantlaforcedel’erosetproduisentuneffetcomique.Lacaractéristiquedecerécitn’estdoncpasle«stylebas»desfabliaux.Lesoucid’unerhétoriquediscrète(lasymétrie,leparallélisme,ledoublesens…)cachéesouslessituationsburlesquesetlecomiqueleste,rattacheicimarcelayméauxsotties:le«retourglorieux»degantus,dontrêvelareine,asonpendantdans l’évocationdu«trépas glorieux» (aymé1998: 128)qu’à son rivalpréparesecrètement le roi,quines’attendaitpasà sonrétablissement.Lerécitdébuteparlascènequimontrelareinebrodantunechemisedenuit,«uneguirlandedemarguerites».ilsetermineparladéclarationdeguerreque fait le roi, sevantantd’avoirdéjà commandé l’armure, «enmétald’asturies,aupanachebleuetor»,dontlesépaulièressont«ornéesde fleurs champêtres etdemignonnes figuresdepages» (aymé1998:129).
avecsoncomiquegrossieretsoninsistancesurlecôté«animalier»de l’homme, le récitfiançailles estmarquépar l’influencede la farce,sensible dans une franche gaîté et un rire jubilatoire,mais aussi danslaprésencedesélémentsobscènesquiont fonctionde«démontrer» ladominationtyranniquedesloisnaturelles.unetensionentrelehautetlebas,l’abstraitetlematériel,estdéjàcrééedansl’incipit,quiportel’em-preintedecetteprimautédonnéeau«bas»corporel.eneffet,lenarrateurmetenscènedeuxpersonnages–lemarquisetleprélat–quidiscutentavecpassiondequestionsmétaphysiques,parmilesquellescelledel’exis-tencedel’âme.ilss’accordentàvoirdansl’âmeunprincipeimmatérieldontlacaractéristiquesubstantielleseraitsonindépendanceparrapportaucorps.or,justeaumomentoùmonseigneuraffirmeque«l’âmeétantimmatérielle»,ilest«vaindevouloirluiassignerunsiègedanslecorpsetplusgénéralementdansl’espace»(aymé1950:29-30),jaillitdesbois

Džunić-Drinjaković M.
112
uncentaure.onnetarderapasàapprendre–carcequicaractériselesrécitsayméens,c’estunrythmeeffervescent–qu’ils’agitenfaitdujeunearistide,descendantd’unefamillenobleetdontl’existenceaétécachéependantlongtemps.etvoicilacascaded’élémentsobscènesetscabreuxrelatifsauxcirconstancesdanslesquellescetêtrefantastiqueestvenuaumonde: ilaétéconçueneffetdansunmanoirégaré,«parhasard»aumomentoùlechevalrossignolétaitseul,lajumentétanttuéeparunebombe…Lefondscabreuxdecettehistoireestégalementsuggéréparlaremarquedubarondecappadoce,grand-pèred’aristide,selonlequelsafilleestelle«atoujoursétéunesensitive»,cequiconduitànepass’éton-nerdel’effetproduitsurellepar«lecommercedesgrecs»:elleserepré-sentesivivementleschoses«qu’illuiasuffid’imaginerunmythepresti-gieuxpourqu’aussitôtilcommenceàprendrecorpsdanssesentrailles»(aymé1950:27)…parcejeusurlesenslittéraletlesensfiguré,dansle-quelnecessedetransparaîtreunecertaineobscénité,marcelayméréus-sitàsusciterunrirejubilatoiremaisaussiiconoclaste,carirrespectueuxpournombredevaleurs,tabousetinterdits.cecôté«transgresseur»demarcelaymépourraitêtreillustréiciparlescrisdejoiequepousselecentaureàlavuedesformesopulentesd’ernestine:pourluiprouversonamouretsapassion,ilcompare«sescroupes»(aymé1950:28)àcellesdesamère,s’exclamantqu’iltrouved’ailleursmaman«trèsjolie»etqu’ill’épouseraitvolontiers.Laprincipalefonctionde lafigureducentaure,quidanslamythologiesymboliselecôtébestialdel’êtrehumain,estderappeleraulecteur–ettoujoursd’unemanièreamusante-quel’hommen’estpasseulementunêtrespirituel.
Lerirejailliticinonseulementducontrasteentrele(faux)spiritueletlematériel,maisaussientreunlangageartificiel,tropsoucieuxd’embellirleschoses,etleparlerrudeetfranc,quipourêtregrossiern’endécouvrepasmoinsunepartdevéritésurladoublenaturedel’êtrehumain.telestlecasdudialogueentreernestineetaristide,danslequellesenvoléespoétiquesdelajeunefille-élevéechezlesbonnessœurs,ellenecessed’évoquersonâme,«unebulleiriséebondissantdansladouceurdel’airprintanier»ous’envolant «vers la voûte étoilée sur les ailes d’azur du bonheur» (aymé1950:37)–,alternent,dansungrotesquecontrepoint,aveclespropossansdétourd’aristidequichoquentlesbienséances.maislecentauren’estguèreobsédéparl’enviededissimulersaconcupiscence.
–vraiment?c’est curieux. Lamienne, jene la vois pas,mais je la sensdansmoncorpset,commejeviensdevousledire,principalementdanslarégionduventre.serrez-moitrèsfortavecvoscuisses.ah!vousmefaitesdubien.quellechaleurdansmonventre!(aymé1950:36).

Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé
113
Nasl
e|e 19
• 2011 • 10
7-117
descascadesderiretonitruantsontsuscitéeségalementparlesten-tativesd’aristidequi,nesongeantqu’às’uniraveclajeunefille,semetàmimer,pourluiplaire,lestournuresetlesclichésd’unlangagevisantàétablirlaprédominancedelapuissancespirituellesurlebascorporel.ils’exclamequ’il«prendconsciencedesonâme»,qu’illavoit,tellesabien-aimée,comme«unebulleirisée»etparledesonardeurpourernestinecommed’une«ivressechantante»(aymé1950:37).maiscesnouvellesfaçonsdeparlerqu’aristideadopteenvuedeséduireernestine,serontdecourtedurée:dèsqu’unebellejumentjaillitdesbois,le«noble»cen-taure,quiparlaittoutàl’heuresi«poétiquement»,s’élanceaugalopaprèselle…onconstateiciencorel’incapacitédel’êtrehumainàmaîtrisersesinstincts,lafragilitéduvernisdevantmasquersanatureanimale.
L’écholointaindefabliauxetdefarcesrésonneégalementdansLé-gende poldève. ennousracontantl’histoiredemarichellaborboïé,unevieilledemoisellequi,ayantpassétoutesaviedansleméprisdel’amourcharnel,s’attendàcequ’aprèssamortdieuetlesangesl’accueillentavecles fanfares et ouvrentdevant elle lesportesduciel,aymé semoquedesfauxdévôtsetdetouteformed’hypocrisie.aulieud’êtrerécompen-séepoursavie«consomméedanslarecherchedesperfectionschrétien-nes»,lademoiselleborboïéneseraautoriséeàentrerdansleparadisquemontéesurlechevalentantque«catindurégiment».au-delàdel’hypo-crisie,leriredemarcelayméprendicipourciblelemythedelaguerre«juste».c’estunrireiconoclaste:ayméal’audacederenvoyerdosàdos,enpleindelaguerre2lesdeuxpartiesenconflit:lepeuple«poldève»etle peuple «molleton», qui «longtemps vivaient dans unemauvaise in-telligence»,incapablesdepasseroutreleurscontestations«d’autantplusqu’ilsavaientraisontouslesdeux».
Lerirejubilatoirequiretentitdanscerécitviseàdémasquerladan-gerosité des rhétoriqueurs qui avec leurs beaux discours patriotiqueset pathétiques, enflamment les cœurs simplespourpouvoirplus faci-lementlesacheminerversles«champsdel’honneur».pourguidersonlecteurverslaprisedeconsciencedudécalagequ’ilpeutyavoirentrelemotetlachose,lenarrateuropposeàlabanalitédel’événement,letongrandiloquentetpathétiqueauquelrecourentceuxquiformentl’opinionpublique,désireuxde transformerunévénementbanalenprétextedeguerre.ce«grave incident»quimit«le feuauxpoudres»dansunesi-tuation«déjàtendueentrelesdeuxetats»,c’estqu’un«unpetitgarçondemolletonie«pissadélibérémentpar-dessus la frontière»etarrosa leterritoirepoldève «avecun sourire sardonique». «c’en était troppourl’honneurdupeuplepoldèvedontlaconscienceserévolta,etlamobi-
2 cerecueilparaîten1943.

Džunić-Drinjaković M.
114
lisation futaussitôtdécrétée» (aymé1972:125).Le rireque suscite lecontrasteentre l’événementetson interprétationestsacrilège: il intro-duitunjoyeuxrelativismedonttémoigneparailleurslaconstatationdunarrateurquedanscetteguerre«touslessoldats,égalementconvaincusdelutterpourlebondroit,ontmisdieudeleurcôté».autrementdit,iln’yapasde«bons»etde«méchants»,tousméritentd’êtreappelésauparadis.«n’est-ilpasdit»,renchéritaymé,inscrivantsaparodiedansunintertextebiblique,«quetousceuxquimeurentpourunecausesacréeontbienméritéd’entrerauciel?»(aymé1972:128),inscrivantsaparo-diedansunintertextebiblique.
L’une des techniques auxquelles marcel aymé recourt égalementpourproduiredes effetshumoristiques, est l’introductionduplurilin-guisme.al’instardeswiftetderabelais,cetécrivainintroduitdanslelangagedesespersonnageslesfragmentsdesdiscoursd’autrui:enl’oc-currence, il s’agitde fragmentsdesdiscoursofficiels,avec leurpathos,quiapourobjetd’éveillerchezlesbravescitoyensunsentimentde«justerévolte». L’effet humoristique est produit par la distanciation ironiqueenverscesdiscoursmensongers.siaymérailleimpitoyablementcesdis-courspompeuxdontuselepouvoirpourattiserlespassions,c’estqu’ilrefused’êtreberné:ilsaitbienquelesgrands,quin’hésitentpasàdécla-reruneguerre,seretirerontsouspeu, dansleursforteressesetleurschâ-teaux,vêtusdeleursbeauxuniformesdegénéralissimeetprotégésparleurscuirasses,telleroidansL’armure:lesangquiabreuveralessillonsneserapasleleur.L’écrivainnemanqueaucuneoccasiondesemoquerdetoutdoublelangage.
ilfautdirequ’ilyauneparfaiteconcordanceentrelesvaleursquemarcelayméaffirmedans sonœuvre, et sesprisesdepositionsdansla vie politique.or, dans l’époque de grandes turbulences qui était lasienne,sesattitudesfurentsouventmalcomprises.ilenestainsidelapétitiondedroitequel’écrivainsignacontrelessanctionsdontétaitme-nacéel’italiedemussolini.Lalettreécriteàandréwurmser(1935)ré-vèlesesvraismobiles:marcelayméydéclaresonindignationdevant«unétatd’exaltationguerrièrequifrisaitledélire»,lesconversationsef-farantesentreintellectuelsdegauchequidébattaientetrésolvaient«parl’affirmativelaquestiondesavoirs’ilexistaitdesguerresjustes»(aymé2001:115).etilyreditqu’il«désapprouveentièrementl’expéditionita-lienne»(aymé2001:116).polvendrommeconsidèrequel’écrivain,qui«méprisaittouteslesfrénésies»etquidénonçaitlebellicisme«avecuneconstanceexemplaire»,asignécettepétitioncarilnevoulaitpas«ajou-teràuneabsurditéaventureuseuneabsurditéplusaventureuseencore».prenantsansambageslacausedemarcelaymé,vendrommerenchérit:

Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé
115
Nasl
e|e 19
• 2011 • 10
7-117
danscetteaffairel’écrivainmontreune«innocencedesfaiblesd’esprit»,«c’étaitcandideaujeudemassacre»(vandromme2009:24).
danslamêmeveine,noussignalonsqu’ilfautsegarderd’identifierlerefusdechimèresetlanégationdurègnedel’abstraitquesonœuvrevéhicule,àunenégationdelaspiritualité.ils’agittoutsimplementd’unstratagèmenarratifparlequelceconteur-né,quinecessed’amusersonlecteur,l’achemineimperceptiblementverslaprisedeconsciencedeladualitédenotreêtre.c’estcequil’apparented’ailleursàrabelais,chezquiladérisionn’égalejamaislapurenégation,maisdontlacomplexité–àcausedececôté«bouffon»quienéclipselesstrateslesplusprofondes–,risqueparfoisdenepasêtreremarquée.
autrementdit,aymé,telrabelais,neniepaslavertu,maislafaussevertu. La foi que pratique la «pieuse» demoisellemarichella borboïe,n’estpaslavraiefoi:c’estunefoidépravée,quiexigelemassacreducor-poreletdelajoiedevivre.Labigoteseleurreseulementsurlefaitd’êtreunebonnechrétienneenrenonçantàlavie.aucundesesactesn’estrégipar une foi sincère,mais par la volonté de «paraître», de se plier auxnormesetauxconventions.Lesmarquesd’unedistanciationironiquedunarrateurpeuventêtreperçuesdéjàdanslamanièredontilnousbrosseletableaudemarichella:«elleportaitlenoirentoutesaison»,«nepar-laitauxhommesquedanslecasd'extrêmenécessitéettoujourslesyeuxbaissés»,n’inspirant«aucunedecesmauvaisespenséesquiinduisentaupéchédeluxureetlesignoraitpoursoncompte»(aymé1872:123).ilest évident quepar le biais de ce personnage, l’auteur veut ridiculiserl’intolérablerenoncementàlavieetaubonheurd’exister,toutcommeiltientàstigmatiserl’hypocrisie.Lavraiefoin’arienàvoiraveclavolontédes’exhiber.aussi«châtie»-t-illavieillebigoteenlafaisantentrerdansleparadiscomme«catindurégiment».commedanslesfabliaux,ledu-peurestdupé,etlecôté«édifiant»decegenrepréservé.
enguisedeconclusion,nouspourrionsdirequ’enaccueillantdansses récitsuncomique leste, legrossieret l’obscène, élémentsdans les-quelstransparaîtl’héritagedefarcesetdefabliaux,marcelayméneces-sedelestransformerenmoyensnarratifsquioriententlelecteur–toutenne cessantde l’amuser - vers la réflexion surnombredequestions«sérieuses»,qu’ellessoientd’ordremoraletsocial,oubienrelevantdelalangue.Lafarceetlefabliauillustrentlesproverbes,lesrécitsdemarcelaymélesinterrogent,lesproblématisent,necessantdemettreenques-tiontouteformefigée.mikhaïlbakhtinesignaleque«lesvoixsocialesethistoriquesquipeuplentlelangages’organisentdansleromanenunharmonieux système stylistique, traduisant la position socio-idéologi-quedifférenciée de l’auteur au sein du plurilinguismede son époque»

Džunić-Drinjaković M.
116
(bakhtine1978:121).seposeencorelaquestiondesavoirenquoitendàsedifférencierlavoixdemarcelaymé.pourceluiquilitattentivementcetécrivainquiunitmerveilleusementnonseulementlefantastiqueetleréel,maisaussiledébatsérieuxavecledivertissement,laréponseestclaire:savoixdiffèredetousceslieuxcommunsquel’onveutfairepasserpourdesvérités,detouscesmythesparlesquelsonveutasservirl’êtrehumain,detoutesceschimèresdontnousparsèmentdenouveauxven-deursd’orviétanidéologiques…commechezrabelais«inconvénient»,ilyaeneffetchezmarcelayméiconoclaste,unevengeancenondissi-muléecontrelesdoctrinesofficiellesquecetauteurnecessedepourfen-dreàtraverssonrirejubilatoireetsacrilège.etcerirerestebraquénonseulement contre lesmodèles culturels prédominants de son époque,mais aussi contre toute languemensongère, toute idée creuse et toutevéritéunilatérale.
Bibliographie
aubailly1987:J.-c.aubailly,«commentaires»,in:Fabliaux et contes du Moyen Âge,paris:Lelivredepoche.aubrit2002:J.-p.aubrit,Le conte et la nouvelle,paris:armandcolin/vuef.aymé1950:m.aymé,en arrière,paris:gallimard.aymé1972:m.aymé, Le passe-muraille,paris:gallimard,coll.folio.aymé1998:m.aymé,Œuvres romanesques complètes,vol.ii,paris:gallimard,coll.pléiade.aymé2001:m.aymé,lettres d’une vie,paris:Lesbelleslettres/archimbaud.bakhtine1978:m.bakhtine, esthétique et théorie du roman,paris:gallimard.rougemont1972:d.derougemont,L’amour et l’occident,paris:plon.vandromme2009:p.vandromme,marcelaymé,journalisteàcontre-emploi,in: pol vandromme, une famille d’écrivains. Chroniques buissonnières, paris:éd.durocher.zink 1992: m. zink, littérature française du Moyen Âge, paris: quadrige /puf.

Jubilation iconoclaste de Marcel Aymé
117
Nasl
e|e 19
• 2011 • 10
7-117
Марија Џунић-ДрињаковићРУГАЛАЧКА ВЕСЕЛОСТ МАРСЕЛА ЕМЕА
РезимеУнизуприповедакаМарселаЕмеаодјекујевеселииругалачкисмехкојиделоовог
писцаповезује не само с раблеовском традицијомнегои са наслеђем средњовековнихжанровакојисусеуфранцускојкњижевностиразвијалинамаргинамаинституциона-лизованекултуре,атосуфарса,фаблиоисотија.Њиховутицајвидљивјеучестимпре-окретима ситуација, убрзаном ритму и нескривеној опсцености, али и у непрестаномпоигравањусамбивалентношћу језикатеизраженојсклоностикабуквализацијимета-форичнихизраза.ПривлачностовихродовазаМарселаЕмеалежиучињеницидасуониуспешноразвилипоступкепародирањасвегаштојеклишетираноистереотипноујезикуидруштвенојстварности.НапајајућисеизовихврелафранцускекњижевностиМарселЕмеразоткриваапсурдностопштеприхваћенихидеја,жигошелицемерјелажногговораиподривасветогрднимсмехоммногедоктринарневредностисвојеепохе.
Примљено: 25. 02. 2011.


119
УДКрад
Biljana TešanovićFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
BECKETT ET SARRAuTE: à LA RECHERCHE D’uN NouVeL ArT roMANeSque
danssonlivreremarquablesursamuelbeckett,p.casanovasouli-gnequel’écrivainresteincompris,puisqu’onneluiapasreconnud’avoirrévolutionné l’écriture en créant l’abstraction littéraire. c’est dans destermes similaires quem.wittig parle du travail denathalie sarrautequelques années auparavant. dans leurs expérimentations langagièreslespluspoussées,lesdeuxécrivainsfrançaisadoptifs,acharnésduverbeetascètes,réussissentleparidifficiledeproduireuntextequiéchappeàlareprésentation;maisalorsquebecketttravailleavecleréelirrepré-sentable,«innommable»,sarrautesesitueauniveaudecequ’elleappelle«l’innommé»,àlalisièredelaconscienceetdulangage.
Mots-clés: représentation, réalité, abstraction, révolution, formel,peinture
nilapeintured’elstir,nilamusiquedevinteuil,nisur-tout la littératuredebergotte–parcequ’elle était litté-rature,c’est-à-direl’artmêmedunarrateurs’ildevaitenpratiquerun–nepouvaitexprimerlavéritémystérieuseàlaquellelehérosétaitprèsdeparvenir,àlaquelleilneluimanquait pour parvenir que leur art. et c’est ainsiqu’ilcréalesien.(tadié1971:257)
en2002,d.viart seréjouit (2002:133)de lavitalité inespéréeduro-man,malgrélesuccèsgrandissantdel’audiovisueletdel’internet.grâceàunsystèmeéditoriallucratif,quitablesurlamultiplicationdestitres,maisaussidespointsdevente,presquequatrecentstitresparaissentàchaquerentréelittéraire,sanscompterceuxpubliésaucoursdel’année.enrevanche,ilestmoinsenthousiasméparlescritiques,notammenth.raczymowet J.-m.domenach, qui déplorent depuis quelques annéesladévaluationd’unelittératurequin’aplusrienàdire.admettant,évi-demment,qu’unegrandepartiedecestextesnesontquedes«produitspérissables»,d.viartfaitdeuxreproches(2002:133)àlacritique:sans

Tešanović B.
120
bienconnaîtreetcomprendreleromancontemporain,elleluiappliqueunegrilleévaluatived’unautretemps,alorsqu’elledevraitévolueraveclalittérature,s’adapter.celaressembleàl’éternellequerelledes«anciensetdesmodernes»,seulementladernièreendateadébutéen1963.avec«surracine»debarthes:àl’époque,eneffet,lanouvellecritiqueacal-quéjusqu’àsonnomsurlenouveauroman.est-ceàdirequ’iln’yapasunecrisedelalittératureaujourd’hui,maisunecrisedelacritiquelitté-raire?«iln’yaplusd’écoles,plusdemouvements,plusderevues,plusde grands critiques littéraires», regrette l’écrivain très controversé, quisequalifiede«révolté»,r.millet,«maisdesjournalistes,deséchotiersdupara-littéraire,unemicro-constellationd’auteursetd’écrivassiersquidonnentl’illusiond’unevie littéraire,morteavectel quel etlesCahiers du Chemin»(2005:32).
misàpartlefaitquel’inflationn’estjamaisungagedevaleur,maisplutôt le signald’une crise,nousmanquonsprobablementde recul etd’objectivitépourjugerdelavaleuresthétiqueduromancontemporain.ilafalluquaranteansàlacritiquebeckettiennepourneplusleconsi-dérercommeunécrivaindu«gâchis»,puisunedizained’annéesencorepourcomprendrelaportéedesarévolutionformelle,comparableàcelledelapeintureaudébutduxxesiècle.
grâce,de touteévidence, à lanaturede sonmatériau, lapeinturedusiècledernierestenavanced’unerévolutionformellesurlalittéra-ture,desorteàguiderdansleursrechercheslesplusexigeantsnovateurslittéraires.c’estaprèsapollinaire,cendrarsetgertrudesteinquebec-kett,maisaussisarrautedansunemoindremesure,ontété influencéspar l’artpictural.Lesdeuxécrivainsontbeaucoupencommun.alorsqu’ils sont considérés commedes écrivainsmajeurs du siècle dernier,leurspremierstextessontrefuséspardenombreuxéditeurs,puiséditéspresqueenmêmetempssansgrandbruit:leromanmurphyen1938etlerecueiltropismesen1939.ilestvraiquesarrautetrouvesavoiedèslepremierjet,sesdeuxpremierstextescourtsde1932,écritsaumomentoùellecommenceàs’éloignerdubarreau,deviendront lesnumérosiietixdestropismes.enrevanche,murphyappartientàlapremièrepé-riodedebeckett,qui cherche longtempsune identité littéraire.dès lafindelaguerre,en1946,l’incontournablesartrelessoutientenpubliantleurstextesdansLes temps modernes.beckettleconnaîtàpeine,maisluienvoieavecconfiancesespremierstextesenfrançais,aumomentoùsondeuxièmeromanenanglais,Watt,estrefusépartout,etquel’éditeuraméricaindevin-adairdécidedenepasfairefigurersespoèmesdans

Beckett et Sarraute: à la recherche d’un nouvel art romanesque
121
Nasl
e|e 19
• 2011 • 119
-129
une anthologiede lapoésie irlandaise1.de lamême façon, sartre ac-cepteunextraitdePortrait d’un inconnu,puis,écritunepréfaceetaidelapublicationdecelivre,dontpersonneneveut.refusantl’étiquettedunouveauroman,lesdeuxécrivainsfrançaisadoptifssontprofondémentmarquésparl’écrituredeproustetdeJoyce,aveclesquelsilspartagentlamêmeexigence,lamêmeconscienceaiguëdelanécessitédefaireévo-luerlalittérature:beckettlesconsidèrecomme«lesdeuxgéniesduxxe
siècle»(bair1978:107),alorsquesarrauteadmetleurdevoircequ’elleestcommeécrivain.
cependant,tandisquelaréflexionthéoriquedebeckettprécèdeetapparemment apporte sa propre solution aux problèmes formels qu’ilrencontre,plusintuitive,sarrautesevoitobligéedecomprendreetd’ex-pliqueraprès-coupsadémarcheartistique,quiseheurteà l’incompré-hensiongénérale:
mespremierslivres:tropismes,paruen1939,Portrait d’un inconnu,paruen1948,n’ontéveilléàpeuprèsaucunintérêt.ilssemblaientalleràcontre-courant.J’aiétéamenéeainsiàréfléchir–neserait-cequepourmejustifieroumerassureroum’encourager–auxraisonsquim’ontpousséeàcertainsrefus,quim’ont imposé certaines techniques, à examiner certainesœuvres dupassé,duprésent,àpressentircellesdel’avenir,pourdécouvriràtraversellesunmouvementirréversibledelalittératureetvoirsimestentativess’inscriventdanscemouvement.(sarraute1964:1554-55)
beckettchercheuneécritureauthentiquedurantpresquequinzeans.p.casanovaanalysedemanièreconvaincante(1997:82,88)lerapportparalysantqu’ilentretientavecJoyce,exiléàparisbienavantlui.commebeckett,celui-cirefusederépondreauxattentesdesmilieuxlittérairesanglaisouirlandais,inventantlamodernité«àtraversl’usagesubversifdelalangueetdescodesnationauxetsociauxquiysontliés»(casanova1997:60).beckettlerencontredèssonarrivéàpariscommelecteurd’an-glaisàl’écolenormalesupérieure;fascinéparsonaîné,ilprendbientôtactivement sadéfense contre les adversairesdeWork in Progress dansuntextebrefdontl’idéevientdeJoyce,«dante...bruno...vico...Joyce».L’identificationàJoyceesttellequ’elleenestgênante,maisellecorres-pondàune«réelleproximité[...]àvingtansd’écart–deleursitinéraires,deleurchoix,deleurscombats.»(casanova1997:64).rendonsjusticeàbeckettennecomparantquecequiestcomparable,cariln’aquevingt-trois ans à l’époque:deuxdécenniesplus tard, enpubliant satrilogie,
1 c’estsonélèvedetrinitycollege,lepoèteLesliedaiken,quilesenvoiesansautorisationdel’auteur.dansunelettre,devin-adairrépondàbeckettquesespoèmesnesont«pasassezirlandais»(bair1978:317).

Tešanović B.
122
ilégaleJoyce,considérécommeunpèredesubstitution2.sesfonctionsde lecteur terminées, beckett écrit sur commande une monographiesurproust,envoyantlemanuscritàchattoandwindusjusteavantdequitterparis.d’unstyleplusaffirméquesontravailcritiqueprécédent,saluécomme«brillant»par«dailytelegraph»(bair1978:107),celivreconfirmesacompréhensiondel’écrivain.aveccesdeuxtextes,beckettsembleavoiraffermi lesbasesde sonœuvreàvenir, sanspourautantpouvoircontinuer,puisque«touteentreprisedeconstructionformelleaétéaccaparéeparJoyce»(casanova1997:88).nilabrouilleaveclui,nil’éloignementnepeuventrienychanger.aucontraire,l’irlanderenforcesesblocages,desortequ’ilretournedéfinitivementvivreàparisenocto-bre1937,malgrél’imminencedelaguerre;c’estdirelaforceetl’urgencede sonbesoind’échapper àunemère abusive,qu’il a enfin le couragedequitter.ilrevoitJoyce,maisdéclineunenouvellecommanded’essais.soucieuxdeluitrouverunautresubstitutpaternellorsdesonséjouràdublin,mcgreevy,sonamilecteurdelarued’ulm,lerecommandedeparisaupeintreetécrivainJackb.yeats3,dontilcommenceàfréquenterlesréunionsamicalesdujeudi.pourbeckettécrivain,cetterencontreestpeut-êtreaussiimportantequecelledeJoyce,carc’estlepremierdesar-tistescélèbres,quideviendrontsesamisintimes.ilsontencommundevouloir«résoudreleproblèmedelacréationartistiqued’unefaçonquiressembleàlasienne»(bair1978:115).
becketts’intéresseauxarts,dont ilauneconnaissanceencyclopé-dique,maisc’estencoremcgreevyqui lui transmetsapassionpour lapeinture.partoutoùilsetrouveilparcourtdeslieuxd’expositions–mu-sées,galeries,voiredescollectionsprivées.Lorsqu’il faitunvoyageenallemagne,deseptembre1936àmars1937,visitantdesmuséesdevilleenville,ilécritles«germandiaries»,sixcahiersdenotestrèsperson-nellessurdescentainesdetableaux.
àlafindesannéestrente,cetintérêtpourlapeintureresteprofondémentlié à son désir de parvenir à composer ses propres œuvres littéraires.aprèslaguerre,sonécritureadeplusenpluspourparadigmelevisuel.avantd’êtrecapabledecondenserl’essentield’unevision,quiestdéjàenlentegestationenlui,enuneimage,beckettcommenceparunedescente,uneimmersion;autraversdesesréflexionssurleregardetsurl’image,ilse livre àune réflexion erratique, tortueuse,mais ininterrompue sur lesmoyensdesonart.Lapeinturelemetaudéfidefaireplace,danssestextes,à l’essentiel d’une vision, de parvenir à la peindre avec desmots. pour
2 cesentimentd’appartenanceàlamêmefamilleestpartagé,Joycesouhaiteenfairesongen-dre,maisfaceàl’indifférencedujeunehommepoursafilleLucia, ilrenonceàleuramitiépendantplusieursannées.
3 frèredupoètewilliamb.yeats.mcgreevyl’aégalementprésentéàJoyce.

Beckett et Sarraute: à la recherche d’un nouvel art romanesque
123
Nasl
e|e 19
• 2011 • 119
-129
lui, lapeintureconstituevéritablementun langageneuf,qu’ilobserveetinterrogelonguementduregard:lelangagedelavision.(Lüscher-morata2005:142)
L’esthétique beckettienne n’évoluera de manière concrète qu’aprèslaguerre,unedécennieaprèssoninstallationdéfinitiveàparis.salen-tegestation senourrirade la fréquentationquotidiennedenombreuxpeintres, amisdegeorgesduthuit, gendredematisse, donttalcoat,masson,staël,riopelle,samfrancis,parfoismatisse,giacometti4.ilen-tretientuneamitiéétroiteaveccertainsd’entreeux,Jackb.yeats,brametgeervanvelde, rencontrés en1937,henrihayden. il se sentpar-ticulièrementprochedebramvanvelde,car,selonbeckett, lepeintrerencontredanssontravaillesmêmesobstaclesquelui–l’impossiblere-présentationd’unobjetquisedérobe.
La peinture – en tant qu’elle est «moderne», c’est-à-dire qu’elle rompt,notamment par l’abstraction, avec les évidences de la représentation –devientpourlui,danslesannéesd’aprèsguerre,l’occasiond’unemiseenparallèle des problèmes plastiques et des questions littéraires. très viteil intègre à sa réflexiond’écrivain les questions formelles posées par lespeintresd’avant-garde.‘ilyadesbraquesquiressemblentàdesméditationsplastiquessurlesmoyensmisenœuvre’,écrit-ilalors;ilyaurademême–etc’estessentielpourcomprendrelasuitedel’œuvre–desbeckettquiméditerontsurlesmoyenslittérairesmisenœuvrepourcontinueràécrireenrépudiant,autantqu’ilestpossible,lareprésentation.(casanova1977:124-25)
beckettécritdeuxtextessurlesfrèresvanvelde,quisemblentdéci-sifspourcequ’onpeutappelersa«secondepériode»,marquéeaussiparlepassagedesaproductionenfrançais.sonessai La Peinture des van velde ou Le monde et le pantalon estune commande,publiéeparLes Cahiers d’artàl’occasiondesexpositionsdesfrèresvanveldeen1945.p.casanovaremarque(1977:125),sansinsister,quecetessai«ironique,résoluetdélibérémentobscur»,estécritquelquesmoisavantlafameuse«vision»debeckett,toujoursprésentéecommel'originedesanouvelleécriture.enréalité,ilsembleévidentquelaréflexionsuscitéeparl'avant-garde picturale aide l'écrivain à trouver sa propre solution.mais c'estsurtoutdans«Lespeintresdel'empêchement»,unarticlebrefetclairsurlesvanveldeparuen1948(l'annéedelarédactiondesdeuxpremiersvoletsdesatrilogie),quebeckettpréciselasolutionparadoxaledebramvanvelde au problème de la représentation: «[i]l y a toujours eu enpeinture»,citeb.clément,afind'expliquerlaprimautédesquestionssurdesréponses,«deuxsortesd'empêchements:l'empêchement-objet(jene
4 ildessinel’arbredeen attendantgodotàl’occasiond’unereprisedelapièceàodéon...

Tešanović B.
124
peuxvoirl'objet,pourlereprésenter,parcequ'ilestcequ'ilest)etl'em-pêchement-œil(jenepeuxvoirl'objet,pourlereprésenter,parcequejesuiscequejesuis)»(clément1994:421).or,bramvanveldenepeintpas l'objet,mais l'empêchementmêmede lepeindre,autrementdit, il«seraitunpeintrepeignantl''impeignable',exactementcommebeckettécrivainestentraind'écrirel’innommable.»(casanova1977:134).onareprochéàbeckettd’avoirfaitdutortaupeintre«impuissant»aveccetarticle,orientantdésormais leregardportésursapeinture.eneffet, ilsemble judicieuxde réfléchir sur ledegréde subjectivitéde l’écrivain.cestoilesluiservent-ellescommeécrandeprojectionsthéoriquesper-sonnelles?«saréflexionsur l’écritureest latentedanscetexte:onvoitqu’il opèreune sortede translation théorique enprêtant àunpeintreuneréflexionquineluiestpasspécifique»(casanova1977:127).aprèsavoirdécouvertsaproprevoie,beckettconfieàgeorgesduthuit(lettrede1949):«Jenepeuxplusécriredefaçonsuiviesurbramnisurn’im-portequoi.Jenepeuxpasécriresur.»(Lüscher-morata:144).
Lapeintureaprobablementinfluencé,voireengendrésesrecherchesetexpérimentationsaveclelangage:utiliserunmotcommeunecouleur,ledéfaire,l’étalersurlablancheurdelapage.b.clémentsouligne(1994:421)lephénomènedubilinguismequirendcetteœuvreunique,étantlasourceduprojetd’écrire,etnonpasseulementl’unedesescomposantes.ilévoqueunelettreàaxelkaun(juillet1937),danslaquellebeckettjus-tifiesonrefusdetraduireenanglaisdespoèmesdeJoachimringelnatz:
celadevientdeplusenplusdifficilepourmoi,pournepasdireabsurde,d’écrire enbon anglais.et deplus enplusmapropre languem’apparaîtcommeunvoilequ’ilfautdéchirerendeuxpourparvenirauxchoses(ouaunéant)quisecachentderrière.Lagrammaireetlestyle.ilssontdevenus[...] comme le costume de bain victorien ou le calme imperturbabled’un vrai gentleman. un masque. [...] y a-t-il quelque chose de sacré,deparalysant,danscettechosecontrenaturequ’est lemot[...]quinesetrouvaitpasdanslesmatériauxdesautresarts?ya-t-iluneraisonpourlaquelle cette matérialité tellement arbitraire de la surface du mot nepourraitpasêtredissoute[...]?(1994:238-39).
b.clémentprécise(1994:239)queleprojetn'estpasencoreconçu,àl'époque,d'utiliserunelangueétrangèrepourarriveràcequebeckettnommedanslamêmelettre«unelittératuredunon-mot»,visantàdé-truire sa languematernelle.néanmoins, ceprojetexpliquenonseule-mentlerecoursultérieuraufrançais,maisaussileretouràl'anglaisdanslesdernierstextes,«lefrançaisn'ayantauboutducompteserviqu'à‘for-ger'cetanglaisimparfait,troué,bancaldontilétaitquestiondès1937etdontWorstward ho,avecsesphrasessansverbesetsesmotscomposés,dontstirrings still,avecsesfautes[...]avecsesellipses»(clément1994:

Beckett et Sarraute: à la recherche d’un nouvel art romanesque
125
Nasl
e|e 19
• 2011 • 119
-129
240-41),sontl’expressionlaplusaboutie.pourp.casanova,Cap au pire(versionfrançaisedeWorstward ho,traduitparédithfournier),«unpurobjetdelangage,totalementautonome»,estunesortedetestamentdebeckett,dontlesimages«inaugurentlalittératureabstraite»(1977:32).
d’abord retour encore à trois. pas encore pour essayer d’empirer.simplementêtrelàdenouveau.Làdanscettetêtedanscettetête.Êtreçadenouveau.cette têtedans cette tête.yeux clos collés à ça seul. seul ?non.aussi.àçaaussi.Lecrâneincliné.Lesmainsatrophiées.yeuxclosécarquillés.yeuxcloscollésauxyeuxclosécarquillés.entrecetteombredenouveau.danscetteombredenouveau.parmilesautresombres.ombresquiempirent.danslapénombrevide.(beckett1991:27-8)
***d.wittig remarque (1995:32-33)avec justessequed’habitude les
innovateursduromanvisentladécouverte«desstructuresinconnues»,or, la démarche sarrautienne est plus radicale, car elle transforme lamatièreromanesqueelle-même».ellecroitnécessairededécouvrirunnouveaupanderéalitéquel’artisteestencoreseulàvoiretavoue,dans«romanetréalité»(sarraute1996:1651),avoirpatientéavantdecom-menceràécrire,fautedetrouver«uneautrematièreromanesque»quecelledesesprédécesseurs.Letravaildenathaliesarrautedéplaceainsilaproblématiquede la représentation: l’évolutiondans l’art est assuré-mentunehistoirededépassementdesformesconnues,maisdanssonpropretravail l’accentestmissur ledépassementdesréalitésconnues.aucontraire,beckettdécritdanslesannées60sespoèmesdesannées30comme«l’œuvred’untoutjeunehommequin’arienàdire,etladéman-geaisondefaire»(casanova1997:89).ilestvraiquelefondetlaformenefondqu’unpourbeckett,formantuneentitéquiouvreunespacederéel,celaadéjàétéditetrépété;c’estuneexigencequ’ilformulepoursapropreœuvreàvenir,alorsqu’ilcommentecelledeJoyce.delamêmefaçon,sarrauterefuseleconventionnelparcequ’ilestinanimé,elleguètel’innomédes tropismes,unenouvelle réalité toutevibrantedevie,quicependant se dérobe; les tropismes sont unis à leurmatrice formelle,endehorsdelaquelleilsnepeuventsubsister.c’estellequileurpermetd’êtreorganisésetexprimés,alorsqu’ilsappartiennentaupréconscientetaupréverbal:
comme, tandisquenous accomplissons cesmouvements, aucunmot–pasmême lesmotsdumonologue intérieur–ne les exprime, car ils sedéveloppent en nous et s’évanouissent avec une rapidité extrême, sansque nous percevions clairement ce qu’ils sont, produisant en nous dessensations souvent très intenses, mais brèves, il n’était possible de les

Tešanović B.
126
communiqueraulecteurquepardesimagesquiendonnentdeséquivalentsetluifassentéprouverdessensationsanalogues.ilfallaitaussidécomposercesmouvements et les faire sedéployerdans la consciencedu lecteuràlamanièred’unfilmauralenti.Letempsn’étaitplusceluidelavieréelle,maisceluid’unprésentdémesurémentagrandi.(sarraute1964:1554)
Laparticularitéde l’écrituresarrautienneestd’attirer lestropismesverslaconscienceetdetraduireleurlangageillisibleenimages,afindeprovoquerdessensationschezlelecteur.cetteopérationdélicateexigelemorcellementdeleursmouvements,doubléd’unedistorsiontemporelledontlerésultatestunprésenthypertrophié.àchaquenouveauroman,leniveaudestropismesdel’espaceromanesques’élargit,alorsquetoutlerestes’estompe,ycompris lespersonnages,«incarnés»pardesmotsdansledernierroman,Ouvrez.«aveclestropismes,onsetrouvedansunartpoétiqueduroman»(1995:36),écritm.wittigdeuxansavantlaparutionenfrançaisdeCap au pire,sans«mimesisouprétenduerepré-sentationd’unréelphysiqueousociologique»(1995:34),etelleconclutqu’apparemment«sarraute est lepremier écrivainabstrait, commeonditunpeintreabstrait»(1995:36).
sarrauteadmetbeaucoupdevoiràproustetàJoyce,maissapensées’est également enrichie aucontactd’autresdomaines artistiques.toutl’artmoderne, estime-elle dans «Langage dans l’art du roman» (1996:1693),notammentleroman,tendversl’abstraction,parcequ’ilselibèredes significations superflues, quimasquent «la sensationpure».aussiparle-t-elledemallarmé,carlelangageduromandoits’inspirerdulan-gagepoétique.eneffet,l’écrivainseconcentredeplusenplussurcequiest son invention littérairepropre– lemondedes tropismes–, faisantabstractiondureste.enmêmetemps,ellealeméritededévoileràsonlecteur son invisible réalité, détectée par sa sensibilité tout artistiqued’écorchéevive.sonmari,raymondsarraute,l’ainitiéeàlapeinture,àlaquelleellefaittoutefoismoinsréférencequebeckett.pourmieuxex-pliquercequ’elleentendparlaréalité,ellecitequelquespeintres,dontcézanne5etsurtout,àplusieursreprisespaulklee:«L’artnerestituepaslevisible:ilrendvisible»(1996:1657).toutsonartàelleconsisteàdé-finirl’indéfinissableetànommerl’innomé,afindelefaireexisterpourlesautres.davantage«désignation»que«dénomination»(bikialo2003:97),celaprendparfoislaformed’une«fusion»,parfoisaussicelled’une«résistance»,commentea.Jefferson(1996:2045),quiconnaîtbiencet-teœuvre.car, le tropismeestdifficileàdéfinir;étantà la lisièrede laconscience,ilexisteune«non-coïncidence»(bikialo2003:97)compré-
5 pourcézanne,laréalité«s’enchevêtreauxracinesdel’être,àlasourceimpalpabledusenti-ment».elleestcachéeparun«mondeentrompel’œil»(sarraute1996:1646).

Beckett et Sarraute: à la recherche d’un nouvel art romanesque
127
Nasl
e|e 19
• 2011 • 119
-129
hensibleentrelesmotsetlasensation.c’estpourquoisarrautenecher-chepasà trouverunmotuniquequi le figerait,maisapproche le tro-pismeparla«multinomination»(bikialo2003:90)comprenantlamiseenrelationd’aumoinsdeuxmots.
cettedésignationreprésentesacréation,parcequ’elletireversleni-veauconscientetverslelangageunesensationquiestseulementlatence,donc déjà là,mais invisible, puisqu’inconnue, vers la réalité effective,parcequeperceptibleetconnaissable:nonseulementque l’artne«co-pie»paslaréalité,n’estpassareprésentation,maisdepluselle«créeunmondequivientgrossirlaréalitéconnueetétendplusloinlechampduvisible»(sarraute1996:1658).celaexpliquel’apparenteincohérenceouparadoxedelarevendicationduréalismedelapartdesarraute:
mais, dira-t-on, qu’appelez-vous donc un auteur réaliste ? eh bien,tout bonnement – et que cela pourrait-il être d’autre ? – un auteur quis’attacheavanttout[...]àsaisir[...],àscruter,avectoutelasincéritédontilestcapable,aussiloinqueleluipermetl’acuitédesonregard,cequiluiapparaîtcommeétantlaréalité.[...]pouryparvenir,ils’acharneà débarrasser ce qu’il observe[...]de toute cette réalité de surfacequetoutlemondeperçoitsanseffortetdontchacunsesert,fautedemieux,etilarriveparfoisàatteindrequelquechosed’encoreinconnuqu’illuisembleêtrelepremieràvoir.ils’aperçoitsouvent,quandil cherche à mettre au jour cette parcelle de réalité qui est la sienne, quelesméthodesde sesprédécesseurs, crééespar euxpour leurpropre fin,nepeuventplus luiservir. il lesrejettealorssanshésiterets’efforced’entrouverdenouvelles,destinéesà sonpropreusage.peu importequ’ellesdéconcertent ou irritent d’abord les lecteurs. (sarraute 1996: 1613-14, n.s.).
toutefois,traduireuneréalitéinvisiblepourlesautresetl’abstrairede son niveau d’origine pour en donner des images «aumoyen d’ap-proximation,depronomsoudenomsàréférentindistinct(‘cela’,‘quel-quechose’),demétaphores»(bikialo2003:91),imagesisoléesdetouslesautresélémentsduréel(«delaréalitédesurface»),relèveeneffetdel’artabstrait,malgréleprojetdéclarédel’auteur.pouvons-nous,néanmoins,aprèssarraute, faireévoluernosconceptions,enadmettantque lano-tionderéalismedoitchangeretquepeut-êtreaprèsl’«èredusoupçon»,noussommesentrés,grâceaugénied’unécrivain,dans l’èredu–réa-lismeabstrait?
spécialiste de littérature contemporaine, d. viart admet que «laquantitéderomanspubliésdéfittouteanalyseexhaustive»6(2002:134),et qu’il devient impossible de tout lire.cela ne l’affecte pourtant pas,
6 n.b.:d.viartneprendencomptequel’éditionfrançaise.

Tešanović B.
128
puisqu’ilremarqueavecbeaucoupdejustessequel’approched’unécri-vaindoit commencerparunequestionéliminatoire: «celledesenjeuxque l’œuvre sedonneàelle-mêmeetdontelle témoigne» (2002:134).qu’ils’agissedutravaildebeckettoudeceluidesarraute,ilestévidentquecettequestionfondeleurécriture.c’estgrâceàleurexigencequ’ilsontrévolutionnéleroman.Leursdémarchessemblentpourtantoppo-sées:enadmettant l’impossibilitédereprésenter le réel,qui sedérobe,beckettinventel’abstractionlittéraire;ens’acharnantàrendrevisibleunpanduréelqu’elledécouvremalgrésadérobade,sarrauteinventeleréa-lismeabstrait.elleconsidéraitlalittératurecommeunecoursederelais,maisquiabienpuprendreleurstémoinsetpourcourirdansquelledi-rection?
Bibliographie
bair1978:d.bair,samuel Beckett,paris:fayard.beckett1991:s.beckett, Cap au pire,paris:Leséditionsdeminuit.bikialo2003:s.bikialo,Lanominationmultiple:uncompromisàlanon-coïn-cidencedesmotsetdelasensation,in:a.fontvielle,p.wahl(réd.),Nathalie sarraute. Du tropisme à la phrase,Lyon:puL,85-98.casanova 1997: p.casanova,Beckett l’abstracteur. anatomie d’une révolution littéraire,paris:seuil.Jefferson1996:a.Jefferson,critique(notice),in:n.sarraute(1996),Œuvres complètes,paris:gallimard,2034-2050.clément1994:b.clément,l’Œuvre sans qualités. rhétorique de samuel Bec-kett,paris:seuil.Lüscher-morata2005:d.Lüscher-morata,La souffrance portée au langage dans la prose de samuel Beckett,amsterdam/newyork:rodopi.millet2005:r.millet,harcèlement littéraire,paris:gallimard.sarraute1996:n.sarraute,Œuvres complètes,paris:gallimard.tadié1971:J.-y.tadié,Proust et le roman,paris:gallimard.viart2002:m.braudeauetal.,Le Roman français contemporain,paris:adpf.wittig1995:m.wittig,L’ordredupoème,in:v.minogue,s.raffy,autour de Nathalie sarraute: actes du colloque international de Cerisy-la-salle des 9 au 19 juillet 1989,besançon:pressesuniv.franche-comté,n°580,31-36.

Beckett et Sarraute: à la recherche d’un nouvel art romanesque
129
Nasl
e|e 19
• 2011 • 119
-129
Биљана ТешановићБЕКЕТ И САРОТ: У ПОТРАЗИ ЗА НОВОМ УМЕТНОШЋУ
РОМАНАРезиме
Вероватноданемамодовољнудистанцудаобјективносудимооестетичкојвредностисавременогромана.ТребалојескорополавекадабисебољесагледаодометделâСамјуелаБекетаиНаталиСарот,закојасениданаснезна,аунајбољемслучајунезнадовољно,којасуизвршиласвојеврснуформалнуреволуцију,којасеможеупоредитисаапстракт-нимсликарством.Размишљајућиогенезиисазревањуовихписаца,наосновукритичкихосвртаоњима,алииеволуцијењиховихсопственихтеоријскихставоваосликарствуикњижевности,наметнуонамсенеочекиванзакључак:акосепотврђујемишљењедајеБе-кетзачетникапстрактнекњижевности,специфичандоприносСаротовесенајбољеможедефинисатиоксимороном„апстрактниреализам“.
Примљено: 02. 03. 2011.


131
УДКрад
Ana LončarÉcole supérieure d’hôtellerie, université de Belgrade
LA MORT D’ODjIgh De MArceL SchwoB – RÉÉCRITuRE D’uN MYTHE
dans le conteLa mort d’odjigh,marcel schwob réécrit unmytheamérindienpeuconnu.afinderendrelerécitplusconformeàlatradi-tionmythologiqueeuropéenne,ileffectueuncertainnombredemodifi-cationsquichangentconsidérablementlaportéedumythe,nousinvitantainsideparlerplutôtderecréationquederéécritured’unmythe.
Mots- clés:schwob,mythe,odjigh,prométhée,réécriture,régénéra-tion,recréation,amérindien
Laparoleconteusedemarcelschwobembarquetoujourslelecteurpourunvoyagedanslepassé.or,dansLamort d’Odjigh,cepassé,s’ilal’appa-rencedelapréhistoire,cachel’envoûtementetlaforced’unespacemy-thique.celan’adoncpasétéunegrande surprisededécouvrirque lecontereposesurunauthentiquemytheamérindien1quemarcelschwobaréécrit.
Lorsqu’onanalyselatranspositiond’unmytheprimitifenmythelit-téraire,lepointdedépartestdedéfinirlaplacequ’occupel’imagemythi-queauseindel’œuvrelittéraire.Lemythepeutêtre«avouéetomnipré-sent»oufairedes«apparitionsenfiligrane»(dabezies2006:1185).or,marcelschwobs’yprendd’unemanièreassezoriginale:lemythequil’ainspiré,parleseulfaitqu’ilappartienneàlamythologieamérindienne,estpeuconnudeslecteurset,parconséquent,onnepeutpasdirequela transpositionest avouée.cependant, schwob laisse certains indicesdansletextequipermettentderetrouverlemytheoriginal.ildonneuneindication assez précise du lieu où se déroule l’histoire d’odjigh: «auborddelagrandemerintérieuredontlapointes’étendàl’estduminne-
1 termedésignanttouslesindiensd’amérique,aussibienceuxdel’amériquelatinequedesétats-unisetducanada.danscetarticle,ildésigneuniquementlesindiensdel’amériquedunord.

Lončar A.
132
sota»(schwob2002: 258).cetteprécisiongéographique(lagrandemerintérieureétanteneffetlelacsupérieuràlafrontièreentrelecanadaetlesétats-unis),n’apporterienàl’histoireentantquetellemais,réunieàd’autresélémentsdurécit,ellemetlelecteursurlavoiedumythepri-mitif.Lerituelreligieuxducalumetquelechasseuraccomplitfaitsurgirl’imaged’unamérindienetsonnom«odjigh»ressemblefortementaunomdelatribuindienneojibwaquioccupaitjustementlesterritoiresenquestionprèsduLacsupérieur.unefoisque,grâceàcesindices,lemy-theprimitifestretrouvé,onpeutconstaterqueschwob,quoiqu’ilchangeunnombreconsidérabled’éléments,gardel’essentieldelastructuredumytheet,s’iln’estpasavoué,iln’enestpasmoinsomniprésent.
il serait utile de raconter brièvement la version amérindienne dumytheafindepouvoirétudierplusfacilementleschangementsqu’intro-duitschwobdanssonrécit.
dansuneépoqueoùlaterreneconnaissaitquelefroiddel’hiver,leblaireauetsesamisdécidèrentd’allerjusqu’àl’endroitoùlesmontagnestouchent laterrecélesteafind’enrapporter lachaleur.arrivésà leurdestination, ils serendirentcomptequ’ilsnepouvaientpasypénétrerparceque laterrecélesteétaitprotégéeparunmurinvisible.aforcedecoups,lesanimauxréussirentàyfaireuntrouparoùilsrentrèrentdanslademeuredesdieux.maislesespritsvinrentleschasserdelà.Leblaireauinsistapourquelesanimaux,avantdes’enfuir,agrandissentletrouafinquelesespritsnepuissentpluslerefermeretilsyparvinrent.cependant, leblaireau, touchéparune flèche,mourut, souriantparcequ’ilavaitvul’étévenirsurlaterre.apparutenfinlegrandmanitouquieutdublaireau:illeressuscita,lesoignaetl’envoyavivredanslecielaudessusdelaterrecéleste,parmilesétoiles.
Lesmodificationsqu’introduitschwobpeuventsediviserendeuxcatégories.
1) modificationsduesaucontextehistoriqueousocio-culturel:mêmesi l’onpeutretrouvercertainsmythesou imagesmythiques
dansdescivilisationstrèséloignéesl’unedel’autre,lesmythesprimitifssontétroitement liésaupeupleouà la tribuqui lesacréés.Lemythe«exprimepourcettecommunautéquelques-unesdesesraisonsdevivre,unemanièredecomprendrel’universenmêmetempsquesasituationpropre dans tel contexte historique…» (dabezies 2006: 1184). il n’estdoncpasétonnantqueschwobaitdûintroduireuncertainnombredemodificationspouradapterlemytheauxlecteursoccidentaux.onpeutcompterdeuxmodificationsmajeures.
Lemytheamérindiencommenceparuneformulationtypique:«autempsoùlaterren’étaitqu’unhiverfroid…»onest,toutdesuite,intro-

La mort d’Odjigh de Marcel Schwob – rÉÉcriture d’un mythe
133
Nasl
e|e 19
• 2011 • 13
1-142
duit dans le tempsmythique, intemporel, situéhorsdu temps, quandlemondeétaitencoreàsacréation,tempsinconnuetinaccessibleauxhommes. la mort d’Odjighcommenceaussiparuneformulationtypi-que:«danscetemps,laracehumainesemblaitprèsdepérir.»(schwob2002:257).etmêmesilalonguedescriptionquisuit,décrivantunmon-deensevelisouslaglacen’estpastypiquepourunmythe,ellerestenéan-moinsdanslecadredutempsmythique.cependant,autoutdébutduquatrièmeparagrapheschwobmentionnelestroglodytes.unpeuplusloin on apprendqu’odjigh est un chasseur de loups qui vit dans unecaverne,et,enfin,leminnesotaetleLacsupérieursontfourniscommeprécisiongéographique.Lecontesemblequitter l’espace intemporelets’inscriredanslecadredelapréhistoire.etcependant,ilnes’agitlàqued’undécoroud’unfond,inspirédelapréhistoirequin’apasunegrandeimportancepourl’histoiremêmeetquiest,enréalité,uneconcessionaugoût,aussibiendel’époquequedel’auteurpourcetâgerévolu;d’oùladédicaceduconteàa.J.h.rosny,auteurdeLa guerre du feuetd’autresromansdontl’actionsesituedanslapréhistoire.
Ladeuxièmemodification estplus importante: lehérosmythiquen’estplusunblaireau,maisunhomme. il s’agit làd’unenécessitédueauxdifférencesentrelatraditionmythologiqueamérindienneeteuro-péenne.silesanimauxfontpartieintégrantedelamythologieamérin-dienneet sont souvent leshérosmythiquesqui créent etmodifient lemonde,dans la traditioneuropéenne, ils sontprincipalementreléguésdanslesfables,tandisquedanslesmythes,leshérossontdesdieux(an-thropomorphes laplupartdu temps) et, occasionnellement,deshom-mes.pourgarder ladimensionmythiquede l’histoire,schwobadoncdûanthropomorphiser sonhéros.cette substitutionpermetà l’auteurnonseulementderapprocherlerécitdelamythologieeuropéenne,maisaussidesuperposerauchasseurdeloupsamérindienl’imaged’unautrehérosmythique:l’histoired’odjigh,quiprendenpitiéleshommes,lesanimaux et la végétation en voied’extinction, qui entreprendun longvoyageafind’apporterlachaleursurlaterreetquisevoitpunipourcelaparlesdieux,nepeutquerappelerlemythedeprométhée.
outrelafiguredeprométhée,certainsélémentsrapprochentodjighdecelleduchrist.nousyreviendronsenplusdedétailsdans la troi-sièmepartiedecetarticle.ici,onsecontenterad’observerquecettetri-plesuperpositionodjigh/prométhée/christ,(toutenrestantpurementimplicite)jointeàlaformulation«danscetempslà»permetaulecteurdesesentirtoutdesuiteentraînédansunespacemythique,mêmes’ilneconnaîtpaslemytheamérindien.

Lončar A.
134
sischwobeuropéaniselemytheenremplaçantlehérosanimalparunhomme,iln’essaiepaspourautantdecacherl’origineamérindiennedel’histoire.aucontraire,ilyrajoutedesélémentsqu’onpourraitnommerde«couleurlocale»quirenvoientàlaculturedesindiensd’amérique.Leplusimportantd’entreeuxestlecalumetsacré.odjighs’ensertpourac-complirunrituelreligieuxcrucialpourleschémadumythe.ilpossèdeaussiunehacheenjadevertquiconstitue,aveclecalumet,commenousle verrons, undes éléments clésde l’œuvre. schwob fait accompagnersonhérospar troisanimaux,unblaireau(resteduhérosamérindien),unlynxetunloup.contrairementaumytheojibwa,oùilss’exprimentcommedesêtreshumains,cesanimauxsontprivésdeparole,maisleurprésencemuette,suivantodjighcommeuneombre,renvoieauxtotemsanimauxdelacultureamérindienne.
ainsi,onconstatequelesmodificationssocio-culturellesqu’intro-duitschwobagissentsimultanémentsurdeuxplansopposés:ellesren-dent l’histoireplusconformeà la traditioneuropéenneet elles accen-tuentl’origineamérindiennedumythe.
2) modificationsquiaffectentlaportéedumythe:dansaspects du mythe,mirceaeliadedéfinitlemythecommeune
réalitéculturellecomplexequi«raconteunehistoiresacrée;ilrelateunévénementquiaeulieudansletempsprimordial,letempsfabuleuxdescommencements.autrementdit,lemytheracontecommentgrâceauxexploitsdesêtressurnaturels,uneréalitéestvenueàl’existence…c’estdonctoujourslerécitd’unecréation».ildistingueparailleursdeuxty-pesdemythes:lesmythescosmogoniques–ceuxquiexpliquentlacréa-tiondumondedanssonensembleetlesmythesdesorigines–ceuxquiexpliquentlacréationd’unphénomène,unvégétal,unanimal,etc.
surcepointlemytheamérindienesttrèsclair:ils’agitd’unmythedesoriginesquimeten lumière lacréationou,plutôt, l’apparitiondessaisonschaudes–printemps/été–dansunmondeoùellesn’ontjamaisexisté.cemondeestbienvivantmais,neconnaissantquel’hiver,iln’esttoujourspascomplet.Laquêtedublaireauetsonsacrificepermettrontqu’unsystèmecycliques’instaurepourlapremièrefois.
il envadifféremmentdansLa mort d’odjigh.Lemondeauquel ilappartientadéjàconnul’étéetlecycledessaisons.Lavieétaitapparue,elleavaitfleuri,elles’étaitrépandueet,toutàcoup,elles’estfigéedanscetéternelhiver:«iln’yavaitplusdevégétation»(schwob2002:257),«lespoissonset lesbêtesdemeravaientpéri»(schwob2002:257),«parmilesenfantsdeshommesdeuxracesétaientdéjàéteintes»(schwob2002:257-285).c’estunmondequiaétévivant,maisquiestmaintenantmort.Lamissiond’odjighestdelerégénérerenrestaurantletempscyclique.

La mort d’Odjigh de Marcel Schwob – rÉÉcriture d’un mythe
135
Nasl
e|e 19
• 2011 • 13
1-142
schwobnouscontedoncunmythedelarecréationourégénérationdumonde.cegenredemythevientengénéralàlasuited’unmytheduca-taclysme(absent,enl’occurrence,maisnousenvoyonslerésultatfinal)parcequelemondeanciendoitêtredétruitpourqu’unordrenouveaupuisse être créé. schwob transformeunmythe des origines enmythecosmogonique,mythedelarecréationdumondeetnousallonsessayerdevoirdequelsressortssymbolico-dramatiquesilusepouryparvenir.
odjighestunchasseurdeloupsquivitdansunecaverne.c’estdesagrottequ’ilentreprendralelongvoyageverslenord.or,ungrandnom-bredepeuplesamérindienscroyaitquelespremiershommesétaientnésd’embryonsquiavaientmûridansdescavernes.plusgénéralement,danslesmythesdelacréation,lacaverneestl’archétypedel’utérus,l’endroitdelanaissance,delarégénérationetdelarecréation.ainsi,larégéné-rationdumonded’odjighs’annoncedéjàparcetactesymboliqueoùlechasseursortdesagrottepourentreprendresa longuequêteduprin-temps.noussommesenprésencedelarecréationdel’hommequidevraàsontourrecréerlemonde.
et, effectivement,odjighqui était chasseurde loups– schwob ledésigneaussicomme«tueur»–neseraplusceluiquivasemerlamort,mais celuiquivaapporter lavie. il entreprendsonvoyageparcequ’ila eu «pitié des choses animées» (schwob 2002: 258).dans le récit, lemotpitiéestmentionnécinqfois.cettegrandepitiéd’odjighnousren-voie aussi bien aumythe de prométhée qu’à l’histoire duchrist, touten restant enracinéedans la culture amérindiennepuisque, contraire-ment àprométhée et auchrist, qui se sont principalement intéressésauxhommes,odjigh«avaitpitiédumondedeshommes,desanimauxetdesplantesquipérissaient»(schwob2002:260).undesfondementsdelareligionamérindienneest,justement,cetteunitédumondehumain,animaletvégétal.
danslamêmephraseoùapparaîtlemotifdelagrotte,schwobin-troduitaussiunautreélémenttypiquedelaculturedesindiensd’amé-riquedunord.odjighpossèdeuneimmensehacheenjadevert.toutcommelehérosqui lapossède,cet instrumentdechasseetdeguerre,dontledesseinestdecauserlamort,devientuninstrumentquiengen-drelaviepuisquec’estaveccettehachequ’odjighréussitàpercerlamu-railledeglace.Lejadeestréputépoursaduretémais,cequiestencoreplusimportantenl’occurrence,c’estsacouleur:ilestvert.danstouteslescontréesqu’odjightraversedurantsonlongvoyage, lacouleurdo-minante,ouplutôtpratiquementlaseulecouleurexistanteestleblanc.c’estcouleurcouleurdepuretéetdechasteté,symbolisantuneterreànouveauviergeetprêteàêtrefécondéemais,enmêmetemps,associéeà

Lončar A.
136
laglaceetaufroidquirègnentpartout,couleurdelastérilité.or,laha-ched’odjighestdecouleurverte,couleurdelanature,duprintemps,delarégénérationengénéral.schwobattribuedoncauchasseur,d’emblée,lepouvoiretl’instrumentdelarégénération.
avant de quitter sa demeure,odjigh accomplit le rituel religieuxducalumetsacré.cerituelconfèreàl’histoiresadimensionmythique.dansladéfinitiondemirceaeliade,onavuquel’élémentprincipalquiconstitueunmytheestsoncaractèresacré– laprésencedesdieuxestindispensable.danslemythedublaireau,l’aspectsacréestévident:lesanimauxpénètrentdanslemondecélested’oùilssontchassésparleses-pritspuisleblaireauestressuscitéparlegrandmanitouenpersonne.
dansLa mort d’odjighlesdieuxn’apparaissentpas,maisilsn’ensontpasmoinsprésents.Lecalumetsacréest l’instrumentrituel sur lequelreposelaviespirituelledesamérindiens,c’estleurautel.Lesymbolismeducalumetestprobablementleplusrichedelacultureamérindienne.Lafuméedutabacestuneessencedivinequiserépandenmêmetempsdanslapoitrinedufumeuretverslecieloùdemeurelegrandesprit.safonctionestdouble:elleestoffrandepourlecréateuretelleluiportelaprièrepuisqu’elle s’élève vers le ciel et disparaît dans l’autremonde.Lorsqu’unamérindienaccomplit le rituelducalumet sacré, ilprie enmêmetempspoursonpeuple,pourlesanimaux,lesplantesetlaterre2.or,lafuméequis’échappeducalumetd’odjighestunsignedugrandespritquiinvitelechasseuràpartirverslenord.
onvoitquelafonctiondesélémentsdelareligionetcultureamé-rindiennequeschwobaintroduitsdansl’histoiren’estpastellementdedonnerlacouleurlocaleaurécit,maisd’introduirelemondespiritueletsacrédesamérindiensafind’érigersoncontepleinementenmythe.
odjighsemetenrouteverslenordetsevoitbientôtrejointpartroiscompagnonsanimaux:unblaireauàsagauche,unlynxàsadroiteetunloupderrière lui.ces animaux l’accompagneront pendantunbout dechemin.ils’agitd’animauxtotémiques,l’undesélémentslesplusconnusdelareligionamérindiennedontlafonctionestàlafoisdeguideretdeprotéger. Les caractéristiques des totems– en l’occurrence la ténacité,l’enduranceetl’agilité–viennents’ajouteràcellesduchasseur.
cestotemsontunetouteautresignificationsurleplanspirituel.Leblaireauest«unebêtedetanièrequivitprofondémentdanslesoletquiselaissetirerdestrousàreculons»(schwob2002:259)etpourcelailest
2 L’architectureducalumetesttrèssignificativesurcepoint:lefourneaudepierreducalumetreprésentelerègneminéral,latigedeboislerègnevégétaletlaplumed’aiglesuspendueaucalumetlerègneanimal.Lecalumetestfuméparleshommesquireprésententlerègnehu-main.

La mort d’Odjigh de Marcel Schwob – rÉÉcriture d’un mythe
137
Nasl
e|e 19
• 2011 • 13
1-142
souventassociéaumondesouterraindontilestparfoislemessager.Lelynxestconsidérécommeceluiquiconnaîtlessecrets,surtoutceuxquiontétéoubliésdansletempsetl’espaceetsontconsidérésperduspourtoujours.c’estpourquoi ilestsouventassociéaudondeclairvoyance,cemoyendeperceptionextra-sensoriel.Le«lynxauxyeuxinsondables»(schwob2002: 259) et «qui voit tout sur terre» (schwob2002: 260) adonclepouvoirdevoiràtraverslesobjets,lesmurs,laterreetmêmeaudelàdel’espaceetdutemps.etenfin,leloup,contrairementàlatradi-tionoccidentaloùdepuislemoyenâgeilestdevenusynonymedesau-vagerieetcruauté,représentantsouventl’incarnationdudiable,danslacultureamérindienneilatoujoursinspiréleplusgrandrespectetjamaislapeur.danslatraditionojibwalelouptoothestleguidedesâmesquientreprennentlevoyageversunmondemeilleur.
cestroistotemsrejoignentodjighporteurschacund’unmessage.Leblaireau,messagerdumondesouterrain,annoncelamortprochained’odjigh,sonsacrificenécessairepourquelemondepuisserenaître.Lelynx,perçantdesonregardlesfrontièresdutempsetdel’espace,vientannoncer la recréationdumonde.et le loupvient, en tantqueguide,l’accompagnerverslemondedel’au-delà.
unefoisarrivéàla«merintérieure»,odjighrépètelerituelducalu-metenincluantcettefoissestroiscompagnonsauxquelsilimprovisedescalumetsenglace.cettefoisaussilegrandespritsemanifeste:«laspiregrisequis’élevaitdevantleblaireaus’inclinaversl’ouest;cellequis’élevaitdevantlelynxsecourbaversl’est,etcellequis’élevaitdevantleloupfitunarcverslesud.maislaspiregriseducalumetd’odjighmontaverslenord.»(schwob2002:260).
ce rituel est de la plus grande importance car chacundes quatrepersonnagesestporteurdeplusieursvaleurs.chacund’euxreprésenteundesquatrepointscardinauxetàchaquepointcardinalcorrespondunesaison,ainsi:leblaireaudésignel’ouest,demeuredusoleilcouchantetdel’automne,àodjighappartientlenordetl’hiver,lelynxsevoitassi-gnerl’est,régiondusoleillevantetduprintempsetenfinauloupappar-tiennentlesudetl’été.enoutre,leblaireau,animaldumondesouterrainetdel’automne,pointeverslepassé,tandisquele lynxregardeversleprintempsetdoncverslefutur.ainsi,durantcerituelserejoignentlesquatrepointscardinaux,lesquatresaisons,lepassé,lefuturetleprésent.c’estàcetinstantques’annoncelarecréationprochaine:danscemondeoù le tempscycliquen’existeplus, les saisonset le tempsserejoignentpourêtrereconstituésetànouveau libéréspar legrandespritqui lesinviteà reprendre leurplaceau seindumonde.Leblaireauet le lynx

Lončar A.
138
suivrontleconseildesespritsetpartirontrespectivementversl’ouestetl’est.Leloupaccompagneralechasseurjusqu’aubout.
odjighreprendsonvoyageetavance«pendantdesheures,desjours,dessemainessansdoute,desmoispeut-être»(schwob2002:260)et«àlafindesarouteilestarrêtéparuneimmensebarrièredeglacequifermaitla coupole sombredu ciel commeune chaînedemontagne invisible»(schwob2002:260).cettecoupolequienfermelemondeetempêchelachaleurdeserependresurlaterreprésenteunecertainesymétrieaveclagrottequ’odjighquitteenentreprenantsonvoyage.commesilemondeétait enfermédansune immense grotte glacée qui devra être détruitepourqu’ilpuisserenaître.
Lechasseurestd’abordforcéàtaillerdesmarchesdanslaglace,puis,arrivéàlacrête,decreuserunemuraillebleue,verticaleaudelàdela-quelle onnepouvait aller.après plusieurs heures de ce dur labeur lahache de jade risque de se casser à cause du froid excessif et pour laréchaufferodjighestforcédel’enfoncerdanssacuisse.desgouttesdesangtombentsur laglaceet le loupaffamé les lècheavidement.cetteblessured’odjighrenvoienonseulementauxmutilationsduchristlorsdelacrucifixion,maisaussiàcellesdeprométhéequifutcondamnéàavoirsonfoierégénérépuisdévoréparunaiglepourl’éternité.
finalement,aprèscetteautomutilationsurlaquelleonreviendraunpeuplus bas,odjigh réussi à percer la glace et «il y eut un immensesouffledechaleur,commesilessaisonschaudess’étaientaccumuléesdel’autrecôté,àlabarrièreduciel»…«[odjigh]entenditbruiretouteslespetitespoussesduprintempsetilsentitflamberl’été»…«illuisemblaitque toutes les saisonsrentraientdans lemondepoursauver laviegé-néralede lamortpar lesglaces»(schwob2002:261).ainsi lachaleurpénètreenfinpourféconderlaterreetrestaurerlessaisonsetletempscycliquequis’étaitarrêté.mais,aumêmemoment,odjighestfoudroyédroitaucœur.ilmeurt«ledostournéaumondeverslequellessaisonsrentraient»(schwob2002:261).c’estlatroisièmefoisquelesdieuxsemanifestentdanscerécitmaiscettefoisaulieudelafuméeducalumetsacréilsutilisentlafoudre,symboleéterneldupouvoirdivinetaulieudeguiderlechasseurilslepunissent3.
3 ilestintéressantdeconstaterleparallélismequiexisteentrelahached’odjighetlafoudre,cesdeuxélémentsétantpresqueinterchangeables.dansnombreusesmythologieslesdieuxsevoientattribuerlafoudre,unehacheouunmarteau.cestroisinstrumentsontlemêmepou-voir,celuidevieetdemort.Lafoudreetlahachepeuvent,touteslesdeux,féconderlaterremaisaussibienladétruire.chezlesamérindienscedualismeestparticulièrementprésent:lahachesymboliselaguerreetlacolèremaisenmêmetempslafertilité.ainsilechasseurdeloup,grâceàsahacheenjadevertpossèdelemêmepouvoirquelegrandespritmaistandisqu’odjighutiliseralesienpourengendrerlavie,lesdieuxutiliserontleleurpourdonnerlamort.

La mort d’Odjigh de Marcel Schwob – rÉÉcriture d’un mythe
139
Nasl
e|e 19
• 2011 • 13
1-142
si lamortduchasseurestannoncéedès letitre, la façondontelleadvientestquelquepeusurprenante.danssonrécitschwobmodifielastructuretypiquequ’onretrouvedanslemytheamérindiendublaireaumaisaussidansceluideprométhéeouduchrist.Lasouffranceduhérosestsuiviedesamortpuisdesarésurrection.Leblaireauesttuéparlesespritsducielpuisressuscitéparlegrandmanitouàunevieparmilesétoiles.prométhée, aprèsavoirétécondamnéàavoir son foieéternel-lementdévoréparunaigle,etaprèsunsupplicedetrentemilleans,estpardonnéetlibéréparzeus.Jésusestcrucifiépuisressuscitépardieu.
or,odjigh est foudroyémais n’est pas ressuscité.cettemodifica-tionduschémaprovientdu faitque la fauted’odjighestdifférenteetinfinimentplusgravequecelledublaireauoudeprométhée.ceux-cidéfientlesdieuxentransgressantleursinterdictions.pourcelailssontpunispuispardonneés.odjigh,aucontraire,guidéparlegrandesprit,nes’opposepasàleurvolonté.Lechasseurestinvitéàentreprendresaquêteverslenord.ilestl’éluduciel–d’oùensapossessionlahacheenjadevert–destiné à rétablir le temps cyclique.cependant, lorsque latâchedebriser la glace étaitdevenue troppénible «soudainmécréantdespuissancessupérieures, [odjigh]avait lancé lecalumetsacrédanslesprofondeurs»(schwob2002:261).Lechasseurreniedonclesdieuxetcommetparcegestelaplusgrandefautequel’onpuissecommettrefaceauxpuissancesdivines.Latransgressiond’uneloidivinepeutêtrepardonnéemaisnierlesdieux,non.
cequ’odjighdevaitfairepourréussirsadernièretâche,celledebri-serlamurailledeglace,c’étaitunsacrificeauxpuissancessupérieures.ilauraitprobablementsuffitdelafuméeducalumetsacré,offrandetradi-tionnelledelareligionamérindienne(quiauraitpuréchaufferlahachetoutcommelesang)maisodjigh,ayantjetélecalumet,doitfaireleseulsacrificequ’ilpuisseencorefaire,celuidesaproprechair.ainsi,lechas-seurestpunipoursonmanquedefoilorsdel’ultimeépreuve.ilmeurtledostournéaumondequ’ilasauvéetlarésurrection,l’autreviequiavaitétélarécompensedublaireau,luiestrefusée.
Lerécitceterminesurl’imagedulouprongeantlanuqued’odjigh.si une telle fin peut paraître quelque peu surprenante, elle suggère larestitutiondu tempscyclique. «L’imagedu louprongeant lanuqueduchasseurs’inscritdanscesymbolismedutempslibéré.»(granger2005:7).Lecycledessaisonset,enmêmetemps,lecycledelavieetdelamortsontrestitués, ilsreprennent leurcours interrompu.L’ordredeschosesest rétabli et le loup totémique,deguideet compagnonqu’il avait étépendantqueletempss’étaitarrêté,reprendsafonctiondeprédateurauseindumonde.

Lončar A.
140
ainsis’achèvecerécitmythiquedeschwobetlaquestionquiseposed’embléeestenquellemesureils’agitréellementd’uneréécrituredumy-theamérindien?
sil’ons’entientàladéfinitiondemauricedominoquelaréécritured’untexte littéraire inviteà liredansuntexteunautre,oumêmeplu-sieurs autres textesqui affleurent implicitementou explicitement à sasurface,iln’yaaucundoutequedanslecasdeLa mort d’odjighils’agitderéécriture.cependant,est-ilsuffisantquel’onretrouvelesélémentsd’untextedansunautrepourparlerderéécriture?
dansMythocritique, pierre brunelmontre la quasi omniprésencedesmythesoudumoinsdesimagesmythiquesdanslacréationlittéraire.Ledegrédeprésencedumythedansun texte littérairevarie énormé-ment d’uneœuvre à l’autre: d’une réécriture délibérée dumythe, à satranspositiond’ungenreàunautre,àlarepriseseulementdelastruc-tureélémentairedumythejusqu’àl’évocationdumytheparunesimpleimageoumêmeunmot.mais,sil’onretrouveuneimagemythiquedansuntexte,onnepeutpaspourautantautomatiquementdirequ’ilyaréé-crituredumytheauquelelleappartient.toutaupluspeut-onparlerderéécriturelorsqu’aumoinslastructureessentiellesembleêtrerespectée.
qu’enest-ildanslecasdeLa mort d’odjigh?d’unepartlerécitdeschwobgardedeuxélémentsmajeursdumytheamérindien:laquêtedessaisonschaudesdansunmondeoùrègnel’hiveretlanécessitédebriserunemurailledeglacepouryparvenir.d’autrepart,laportéesymboli-quedumytheaétépleinementmodifiée–onestpasséd’unmythedesoriginesàunmythecosmogonique,lastructurearchaïquesouffrance–mort–résurrectionn’apasétécomplétéeetlerécitaétéstratifiégrâceàl’ajoutd’élémentsprovenantdumythedeprométhéeetduchristsanstoutefois assimiler leur portée symbolique. certes, même avec toutescesmodifications, le récit reste toujoursdansundomainepossibledelaréécriture.unauteurpeutréécrireunmytheavecdiversesintentions:ledémythifier,ledéconstruire,leréactualiser,etc.danstouscescas,cequiimportec’estqueletexteréécritsetrouveenrapportconstantaveclemytheoriginal. Lemythedeprométhée,par exemple, peut être al-téréàl’infini,jusqu’àêtrepratiquementméconnaissable,maislelecteur,connaissantbiencemythe,sauratoujoursmesurerl’ampleuretlacausedecesmodifications.
or,cen’estpaslecasdansLa mort d’odjigh, lemytheamérindienétantpeuconnudeslecteurs.peut-onencoreparlerderéécriturelors-quelelecteurn’estpasconscientquec’enestuneparcequeneconnais-santpaslepointdedépartilnepeutpaslecompareraupointd’arrivée?

La mort d’Odjigh de Marcel Schwob – rÉÉcriture d’un mythe
141
Nasl
e|e 19
• 2011 • 13
1-142
s’agit-il de réécriture lorsque l’auteur a délibérément choisi unmythepeuconnu?
dans lecasdeLa mort d’odjighonest tentédedirequ’au lieuderéécriture ilyarecréationd’unmythepuisque le lecteurestconscientqu’iladevantsoiunehistoiremythiquemaisilneconnaîtpaslemytheprimitif.
ils’agit làd’undesprincipauxattributsde l’artdemarcelschwob.L’écrivainnecroitpasquequoiquecesoitdenouveaupuisseêtrecréédans l’art. La seule chose qui distingue uneœuvre d’une autre est laforme.c’estpourquoischwobpasseunegrandepartdesontempsauxarchivesetà labibliothèquenationaleoù il trouve l’inspirationet lessourcesdesesœuvresfutures.qu’ils’agitderécits,delettres,d’articles,debiographiesoudemythes,schwoblestransforme,lesdéconstruitetreconstruit,lesréécritetsurtoutlesenrichitdesonimaginationabon-dante.Lesélémentsqu’ilutilisepourconstituerunrécitpeuventêtrere-trouvés–commec’estlecasiciaveclemytheamérindien–maisschwob,telunalchimiste,lestransformeenunecréationnouvelle,brillante,par-faitementautonomevis-à-visdesessources,mêmelorsquecelles-cisontconnues.ainsiLa mort d’odjigh,etplusgénéralementl’œuvredemarcelschwob, s’inscriventdans cet espace étroit entre réécriture et créationqu’onpourraitnommer«recréation»littéraire.
Bibliographie
barthes1957:r.barthes,Mythologies,paris:seuil.berg,vades 2002: c. berg, y.vades,Marcel schwob: d’hier et d’aujourd’hui,seyssel:champvallon.brunel1992:p.brunel,Mythocritique,paris:puf.brunel2006:p.brunel(dir),Dictionnaire des mythes littéraires,paris:hachet-te.champion 1927: p. champion, Marcel schwob et son temps, paris: bernardgrasset.dabezies2006:a.dabezies,desmythesprimitifsauxmytheslittéraires,inp.brunel(dir),Dictionnaire des mythes littéraires,paris:hachette,1177-1185.domino1987:m.domino,la réécriture du texte littéraire Mythe et réécriture,semen3/1987,http://semen.revues.org/53835.09.2010.eliade1963:m.eliade, aspects du mythe,paris:gallimard.granger:s.granger,l’imaginaire du corps dans l’œuvre de Marcel schwob (1897-1905): entre esprit fin-de-siècle et pensée sacrée,http://www.lettres-et-arts.net/histoire_litteraire_19_21_emes_siecles/91-marcel_schwob23.09.2010.

Lončar A.
142
hernandezguerrero2001:m-J.hernandezguerrero,Marcel schwob cent ans après,thélème:revistacomplutensedeestudiosfranceses,19,madrid:servi-ciodepublicacionesdelauniversidadcomplutensedemadrid,45-55.mills2003:a.mills(dir),Mythology: myths, legends & fantasies, sydney:glo-balbookpublishingtrembley1969:g.trembley,Marcel schwob faussaire de la nature,genève-pa-ris:Librairiedroz.schwob2002:m.schwob,Œuvres,paris:éditionsphébus.
Ана ЛончарОЏИГОВа СМРТ МАРСЕЛА ШВОБА – ОБНАВЉАЊЕ МИТА
РезимеПриликомтранспозиције једногмањепознатогмитаамеричкихИндијанацаупри-
повециОџигова смрт,МарселШвоб јебиопринуђендаизвршиодређенибројизменакакобипричуускладиосаевропскоммитологијом.Утомпроцесудошлоједопомерањазначењасамогмита,пасеможезакључитидаШвобневршисамопребацивањемитаизједнекултуреудругувећгапоновоствара.
Примљено: 4. 02. 2011.

143
УДКрад
Ljiljana MatićFaculté de philosophie, université de Novi sad
BERNARD DADIÉ ET L’INSPIRATIoN DES RÉCITS TRADITIoNNELS AFRICAINS
bernarddadiéracontedansunfrançaisimpeccablelatraditiondesonafrique natale etmanifeste le don incontestable d’un bon obser-vateurdesêtresetdeschoses,sasagesseetsonhumour.nousposons,qu’aprèsuneanalyseimpartiale,l’onpeutconclurequ’ilnefautpasmet-tredesigned’égalitéentrelalittératuresavanteetlanoblessedepensée;demême,qu’ilnefautpasétiquetterlalittératurepopulairedesimplisteetd’ignorante.encomparant la tradition littéraireécritedesocciden-tauxetlalittératurebaséesurl’oralitédespeuplesducontinentnoir,unlecteurattentifpeutdécouvrirmaintspointsquelesblancsetlesnoirsont en commun.nous tâcherons à démontrer l’importance des récitstraditionnels africains ennousbasant sur le romandebernarddadiéLe pagne noir.dansnotreétude,nousavonschoisideparlerd’aborddesContes agni de l’indénié rassemblésparmariusanon’guessanetensuiteduPagne noirdebernardb.dadié.notreobjectifestdemontrerlapuis-sancedel’expressionverbaled’unelittératuresanslettrespropreàceuxquelesoccidentauxnommentlessauvagesetdontlasagesseestmiseenlumièreunefoisécriteenlanguedesancienscolonisateurs.
Mots-clés: Littératuresavante,littératureoraleafricaine,récittradi-tionnelafricain,romancontemporainafricain
bernarddadiéracontedansunfrançaisimpeccablelatraditiondesonafriquenataleetmanifeste ledon incontestabled’unbonobservateurdesêtresetdeschoses,sasagesseetsonhumour.c’estenréconciliantlemerveilleuxde la fable, l’ironiquebestiairede la tradition, la gaietéd’unsavoirancienetlatendressed’unelonguemémoirequ’ilattirel’at-tentiondesblancssurlefaitquelesnoirsneméritentpascetteappel-lationméprisantede«sauvages»qui leurest souventdonnéeparceuxquiconnaissaientpeuoumaltoutelarichesseettoutelasagessedelalittératureoraleafricaine.
nous posons, qu’après une analyse impartiale, l’on peut conclurequ’ilne fautpasmettredesigned’égalitéentre la littératuresavanteetlanoblessedepensée;demême,qu’ilnefautpasétiquetterlalittérature

Matić Lj.
144
populairedesimplisteetd’ignorante.encomparantlatraditionlittéraireécritedesoccidentauxetlalittératurebaséesurl’oralitédespeuplesducontinentnoir,unlecteurattentifpeutdécouvrirmaintspointsquelesblancsetlesnoirsontencommun.noustâcheronsàdémontrerl’im-portancedesrécitstraditionnelsafricainsennousbasantsurleromandebernarddadiéLe pagne noir(dadié1970).
c’est à juste titre que, dans son essai Peau noire masques blancs,frantzfanonattirenotreattentionsurlefaitque«desblancss’estimentsupérieursauxnoirs.»(fanon1952:24).demême,«desnoirsveulentdémontrerauxblancscoûtequecoûtelarichessedeleurpensée,l’égalepuissancedeleuresprit»(fanon1952:24).Lemoyenidéalpourmon-trertoutelarichessedeleurtradition,deleurhistoire,deleursmythesetdeleursmœurs,c’estquelesnoirssedécidentàécrireenfrançais,voireen languedesblancs, cet élémentde compréhensionde ladimensionpour-autruidel’hommedecouleur.
dansnotre étude,nous avons choisi deparlerd’aborddesContes agni de l’indénié (ano1976) rassemblésparmariusanon’guessanetensuiteduPagne noirdebernardb.dadié.notreobjectifestdemontrerlapuissancedel’expressionverbaled’unelittératuresanslettrespropreàceuxquelesoccidentauxnommentlessauvagesetdontlasagesseestmiseenlumièreunefoisécriteenlanguedesancienscolonisateurs.
Leconte,enagniêhoa,estprisdanssonsenslepluslarge,compre-nantaussibienleconteausensstrictquelanouvelle,lalégende,lafableetlemythe.donc,unoccidentaldoitentendreparcontetoutrécitoraltraditionnelàcaractèrelittéraire,éthiqueoudidactique.ilétaitracontéauxveilléespourdivertir,maisaussipourtransmettredeshistoiressurdeshérosdel’histoiretribaleounationale,desmythesdelareligionani-miste,desditsdelaviequotidienne.safonctiondidactiqueconsistesou-ventàenseignerlamorale,demêmequedesfablesdesoccidentaux.
mariusanon’guessanaapportésacontributionàlacauseduconteagniausensgénériquedutermeenpublianten1972descontesenregis-tréssurlevifàamélékia,villagedemillehabitantsenviron,situéà17kmd’abengourou,capitaleadministrativedel’indéniéàl’estdelacôtéd’ivoire.ilaévitédelesromanceroudelespoétisercommelefontbiendesauteurs.donc,nousavonsunrecueildecinquantehuitconteschoi-sis,qui transmettent l’histoiredupeupleagni, ses légendesoù lesani-mauxparlentauxhumainsousecomportentenêtreshumainsdemêmequelesanimauxdanslesfablesdesoccidentaux.grâceauxcontesagni,nous apprenons leur éthique à proposde la vie en société, en familleouauménage lorsqu’ondiscute lesproblèmesde larépudiationoudel’adultère, par exemple. et bien sûr, l’un des personnages principaux

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
145
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
descontesagnidel’indénié,c’estl’araignée,cetespritmaléfiqueetruséconnusousl’appellationdekakouananzè.
L’indénié,ausensstrictestunpetitpaysdeformepresqueovoïde,enzoneéquatoriale.unevégétationcaractériséeparlaforêtdensecou-vrecepays.danslescontes,l’oncitefréquemmentlefromager,dontlesbranchespeuventservird’abriauxgéniesdelabrousse,auxégarésetauxbêtes sauvages; leparasolierdont lebois sertencoreà laconstructiondescasesdescampementsoudesbaignoiresdesfemmesdelacouchelamoinsaiséedelapopulation;lepalmieràl’huiledontlesgrainesentredanslaconfectiondela«saucegraine»,del’huiledetable,etdontlasèvefournitlefameux«vindepalme»communémentappelébanguiencôted’ivoire.
audiredemariusanon’guessan, la faune relativement riche secompose d’animaux et d’insectes de toutes tailles: «termites, oiseau-mouche,écureuil,léopard,diverssinges,éléphant,reptilesdetouteslessortesdontlefameuxpython,hérosdebiendescontes»(ano1976:12).
dansl’indénié,ilyaquatresaisonsquisesuccèdenttoutaulongdel’annéeetlerythmedestravauxchampêtressuitnaturellementceluidessaisonsencepaysdesplanteurs.
durant la grande saison sèche, on procède au débroussaillementdelaforêtenvuedelanouvelleplantation.enjanvieretenfévrier,onabatlesarbresduterraindébroussailléquel’onbrûleenmarsetenavril.d’avrilàoctobre,oncultiveetentretientleschamps.Leramassagedescabossessefaitenseptembre.Lescerisesdecafésecueillentennovem-bre.Lesproduitsvivriers,banane-plantein,taro,maïs,pimentrouge,to-mate,courgecomestible,gombo,oignon,igname,notammentsontdes-tinésàlaconsommationlocale.
toutescesactivitéschampêtresetcesproduitsde la terrecultivéesontmentionnés dans les contes agni, faisant le cadre obligatoire desaventuresdeshumains,desgénies,desbêtesetsurtoutdesaventuresdekakouananzè.
pourtoutoccidental,l’araignéeestunpetitanimalarticulé,àqua-trepairesdepattes,dontlesespècescommuneseneuropeconstruisentdestoiles,piègespourdesinsectes.cettedéfinitions’appliqueaussiauhérosdescontesagnide l’indénié,cescontespopulairesrecueillisparn’guessan, ainsiquepourkakouananzè, l’undespersonnagesprin-cipauxduPagne noirdebernardblindadié,écrivainivoiriendonnantune«versionsavante»descontestraditionnelsdesesancêtres.danslesdeuxversions,où l’araignée apparaîtdansvingt-deux contespopulai-res,voiredansseizecontessavantschezdadié,«dontlaplupartmettenten scène ce personnage ambigu, il s’agit de l’araignée toilière. si dans

Matić Lj.
146
lescontessonnomestécritavecuna(majuscule)ets’ilestdésignéaugenremasculin,c’estque,danslescontesagnidel’indénié,cetêtreestanthropomorpheetconsidérécommeunpèredefamille».(ano1976:55)mariusanon’guessanprécise:
il joue aussi le rôle du personnage que les ethnologues anglo-saxonsappellent‘trickster’etleurshomologuesfrançais‘décepteur’:unêtrefrêlequil’emportesursesadversairesgrâceàsonintelligenceetàsaruse.(ano1976:55)
s’ils’agitdescontespopulairesoudescontessavants,ilfautsouli-gnerlefaitquelesagnidel’indéniédonnentdifférentsnomsàl’araignéedeleurscontes:ekkenndaa,ndjandaa,koikouananz,ananze,nan-hann’daa.chezbernarddadié,ilestmentionnésouslenomdekakouananzè.
donc,nousvoici confrontésauxproblèmesde l’oralitéetdes ten-tationsd’uneécritureetd’unelectureautre;delatraditiondelaparoledesgriotsetdutextelittérairebasésurl’oralitéafricaineetexpriméenfrançais,lalanguedescolonisateurspermettantdetransmettrelesmes-sagesancestrauxauxoccidentauxhabituésdepuisdessièclesauxtextesimprimés.
commeleposentmaintschercheursoccidentaux,dansl’élaborationd’uneapprochespécifiqueaucontinentafricain,lesthéoriesdesalitté-raturefontcoïncidersesvéritésd’autonomiepolitiqueavecdesmarqueslittérairescenséesrappelersonpassé.Lesauteursafricainsontrecoursàlamémoirehistoriqueducontinent,croyantcettemémoireseuleca-pabled’enracinerlestextesdanslacultureafricaineetdeleurconférerune véritable authenticité. à l’observation pourtant, cette authenticitése formule toujours soit commeuneoppositionpolitique et idéologi-que auxvaleurs étrangères, soit commeune rupture esthétiqued’aveclesmodèlesoccidentaux.Les textes francophonesd’afriquede l’ouestoffrentl’imagedel’ancêtre africainqui,desavoix,continueraitd’habiterlestexteslittéraires.
haroldscheubaffirmequedestextesdefictionécritssurleconti-nentafricainressortissentdelamêmepoétiquequeleslittératurestradi-tionnelles,proféréesexclusivementparlavoix:
il existe une incontestable continuité dans la littérature africaine entreles performances orales et les productions écrites telles le roman et lapoésie.Laforcedestraditionsoralessemblen’avoirpointfaibli,àtraverstrois périodes littéraires: un lien réciproque a transformé ces moyensde communication en une forme unique que négligent les puissantesinfluencesdel’orientoudel’occident.(scheub1985:1)

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
147
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
madeleineborgomanoaffirmeque la littératuren’intervient,dansce sous-continent fortementmarqué par l’oralité, que pour permettrelaconservationetlafixationdelamémoirepopulaire.donc,pourelle,l’écrituren’estqu’unprocessusinsignifiant,unesimpleopérationdemise en paged’œuvresoriginellementdestinéesàêtreditesouproféréesselonlestechniquesdel’oralité:
en afrique, la plupart des textes n’ont longtemps existé que dans leurproférationetdanslaseulemémoiredesconteursetdesgriots,eux-mêmes(enprincipe),desporte-parole transportantdesmythes,des légendesetde l’histoire et non véritablement «auteurs».denos jours [l’écriture] semetauservicedel’oralitéqu’ellepermetdeconserverenlatranscrivant.(borgomano2000:80)
toutsepasse,seloncetteconceptiondutexte,commesiletexteas-suraitlacontinuitédelatraditionafricainepourdevenir«unepratiqueidéologique qui, au-delà des personnalités individuelles, conditionnel’identitécollective»(abastado1979:11)desécrivains.
L’oralitésecaractérisantparlapluralitédescritères,fonctionnecom-meunconcepthétérogène,composédedifférentsgenreslittéraires.seloncescritères,letermedelittératureoraleseveutuneréférenceauxtextesquiportentsurlacouverturelamentiondesgenresattendusparlespra-tiquestraditionnelles:contesetlégendes,épopées,proverbes,chantsetchansonsetdonsomena(ourécitsdechasseursmalenké).nouspouvonsenconclureque le typede lecturequi s’appliqueaux textesd’écrivainsquiontunlienavecl’afriquedoitpermettrederévéleressentiellementlacultureafricainequis’ycachesouslestraitsd’unefigureancestrale:
Lalittératured’écrivainsquiontuneattacheculturelleàl’afrique,élargitles connaissances culturelles et littéraires des lecteurs. en analysant cesécrivains en rapport avec certains concepts dans les religions africainestraditionnelles, ils peuvent clairement apparaître comme les canauxparlesquelslesancêtrestransmettentleurhéritageetperpétuentleurinfluencesurlesjeunesgénérations.(wilentz2001:352)
d’aprèsgaywilentz,endépitdeslangueseuropéennesetdelapra-tiquedel’écriture, la littératuredesafricainsestunespaceoùserecy-clentlesmodèleslittérairestraditionnels.ànotreavis,lesContes agni de l’indéniéetLe Pagne noirensontlapreuve.bernarddadié,néen1916etscolariséd’après lesystèmefrançais,sesertde la languedescoloni-sateurscommed’unearmepuissantepourdémontrer l’importancedeses racines africaines.nouspouvonsyvoir l’intentionde l’écrivainderejeterl’écolequ’ilconsidèrecommeleparadigmedupouvoircolonialdominant.selonpiusngandu,larecherchedel’oralités’effectue,dansles

Matić Lj.
148
instancesdudiscours littéraire,commedesenjeuxpouruneconquêteculturelle:
pour l’écolecoloniale, le texteécrit seramenait impérativementà la«loiécrite»,enoppositionavecl’oralitéqui,elle,prolongeaitl’héritagecultureletdoncdesservaitlesprojetsdelacolonisation.Le«littré-clerc»étaitavanttoutuncadreadministratifouuntechnicienquisesubordonnaitàl’ordrecolonialparsapersonnalitémoraleetculturelle.(ngandu1997:236)
pourl’écrivainafricain,satâcheétaitdeconcilierlaparoleetletexte;quantauxthéoriciens,eux, ilsontpourmissiondedébrouiller l’unionentre l’écriture et la parole traditionnelle qui l’incarne. partant de cesprémisses,nouspouvons constaterque le recueil des contesLe Pagne noir représente un jeu subtil d’appropriation d’une tradition orale auservicedelapromotiond’unordreintellectuelnouveau.malgrélefaitquecescontesnerévèlentpasleursorigines(àl’exceptiondelanoteàlapage151,expliquantquegnamiansignifiedieuenagni;oubien,lesincantationsserépétantlelongdulivre),ilsdécriventlacomplexitédesconversionsdestraditionsoralesdansl’écriture.nousvoyonsbienque,dansl’afriquedécolonialisée,lerôlesocialdecolonisationde«l’homo-généisation»del’universs’investitdansl’écriturepourtransformerl’écri-vainenunêtreambiguàchevalentrelapratiquedel’écritureetcelledelaparole:
Leromancierouestafricaindemeureétroitementtributairedesattitudes,destics,desfondsorauxdesconteurstraditionnels.sonstatutquidevraitthéoriquement, par le fait de l’écriture et par le système de la créationindividuelle, s’opposer à celui du conteur traditionnel, reste néanmoinsambigu.[…]ilyadans l’actedecréationmême,unecontinuitésubtile.[…] dans [le] contexte africain enmutation, les actes les plus intimesrestentmarquéesparlatradition.(koné1993:192)
maintscritiqueslittérairessesontintéressésautraitementlittéraireduconteafricainetontjustementcomparédescontesduPagne noiretdesContes agni de l’indéniépourdémontrer lepassagede la traditionà la littérature fictionnelle «du beau style» scolaire. françois bogliolos’intéresse surtout au personnage d’araignée, dont les aventures sontcommecellesdeLièvretrèsrépanduesaussibienenafriquequedanslesamériques:
araignée est surtout connue enafrique sous lenomdekakouananzé(chez bernarddadié par exemple);kakou est un nomagni (ghana etcôted’ivoire),ananzéestlenomnobledel’araignéechezlesagni,anansiestunnomashanti(ghana).(bogliolo1976)

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
149
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
mais,àladifférencedeLièvre,sesruses(qu’ilinventeleplussouventpoursetirerd’unesituationdifficileoùl’aconduitsaparesse)sontgros-sièresetéchouentmaintesfois;c’estunêtreperversetoublieuxmêmedesesdevoirsdepèreetd’époux,concluebogliolo.
françoise ugochukwu s’intéresse au dialogue dans Le Pagne noirdebernarddadiéetrelielescontesàlatraditiontribaleensoulignantl’importanceducoupleetdelafamilleétenduelorsquel’écureuildans«araignéeettortue»emploieletermede«frère»pourrappeleràl’arai-gnéequ’ilestdumêmevillagequesamère.donc,«liésàleurfamille,lesindividussontaussigroupésselonleuroccupation:leconteurnousparle,parexemple,desféticheurs,desforgerons,desmarchandsoudesculti-vateurs[pp.9,138,14,129].Lesgroupesd’âgeviennentencores’ajouteraufaisceauderelationsdel’individu»(ugochukwu1985:37).
c’estqu’auvillage,toutsefaitencommun.Lesmatronesetlesvoi-sinsaccourentaussibienpourlanaissancequepourlesfunérailles.pra-tiquement,toutaulongdelavie,cesvoisins,cesfrères,cesamis,serontprésents.c’estenfamillequekakouananzècultivesonchamp;c’estengroupequelesfemmesfontlacuisineauretourdeschamps.nouspou-vonsenconclureencoreunefoisquelaviedescontesafricainssedérou-leentrelabrousseetlevillageetbernarddadiés’inspiredelatraditionoralesansendonnerdesdétails.pourtant,aulecteurattentifn’échapperapaslaphraserévélatricedelaquatrièmedelacouverture:
avecévidence,cestextesmanifestentlarencontreheureused’unécrivainavec son monde, cette afrique du pays baoulé recréée à travers lemerveilleux de la fable, l’ironique bestiaire de la tradition, la gaîté d’unsavoirancienetlatendressed’unelonguemémoire.(dadié1970)
danslescontesagni,àlaveillée,leconteurcommenceparlaformu-leinitiale:«iln’estpasdemoi.»;«cen’estpasdemoi.»;«Jen’ensuispasl’auteur.»etl’auditoireluirépondpar«ilestdetoi.»oumieux«tuenesl’auteur.».àcetteformulepropreàl’agnifaitsuitel’introductionuniver-sellementconnuesituantlecontedansuntempsrévolu:«autrefois,ja-dis,encetemps-là».puissedéroulelerécitproprementditcomprenantpresquetoujoursuneouplusieurschansons.Lachansonrevêtplusieursformes:tantôtcomplainte,tantôtviveetjoyeuse,toujourslangoureuse,voirepoignantedanslanuitnoire.
mauricedelfosseposeque«l’artdebiendiresembled’ailleursinnéchezlaplupartdesnoirs,quiaimentparleretdontbeaucoupsontdouésd’unevéritableéloquence»(delfosse1925:84).
marius ano n’guessan confirme qu’au dire des informateurs, lafonctionessentielleduconteestdedivertir.mais,ilnefautpasoubliernonplusque«cettelittératureéminemmentpopulairereflètefidèlement

Matić Lj.
150
lespenséesetlessentimentsémotifsdontelleestl’émanationnaturelleetspontanée.[…]rienn’étaitmieuxenmesuredenouslivrerlessecretsdel’âmenègrequelescontes[…]danslesquelscetteâmes’épancheetsemanifestetoutentière».(delfosse1921:9)
tousleschercheursensontd’accord,leconteestrévélateurdebiendesréalitésethnologiques,maispaslemiroiroùcelles-cisereflétaienttrèsfidèlement.Leconteestconcisetromanesque,maisilnepeutpasconstituerl’uniquesourced’informationpourceluiquivoudraitétudiersérieusementuneethnieouunpersonnage.ilnefautpasoubliernonplusquelecontepeutoffriruneinstructionauxenfants,auxjeunesetauxadultes,àl’instardurécitpeul:«contecontéàraconter…».safonc-tiondidactiqueconsistesouventàenseignerlamorale:«Lescontesafri-cains,quantàeux,indiquentdesnormesdecomportementquidoivents’inscriredanslecadremêmed’unesociétécommunautaire…»(paulmeetseydou1972:76)quantauxvaleursuniverselles,lecontecondamnelemensongeetlevol,lesdeuxcaractéristiquestypiquesdekakouanan-zè.
etmariusanon’guessandeconclure:après avoir tiré la leçon morale, le conteur conclut son récit dedeux formules, l’une courante et claire, l’autre rare et énigmatique.habituellement,ils’établitentresonauditoireetluiunbrefdialogue:
−delàmonmensongevespéral,ditleconteur:−bravopourlemensonge!,répondl’auditoire.−d’accord!,conclutleconteur.(ano1976:32)
n’oublionspasnonplusquelecontejoueunrôledepsychodrame:ilaideàliquidercertainestensions.etn’guessandepréciser:
pourcefaire,onattribueàunêtrefrêleetinsignifiantintelligence,stupidité,ruses plus oumoins inavouables, et innocence à la fois.cet être tantôtmalfaiteur spontané, tantôt victime, qui résume la condition humaine,c’estèkendaa,l’araignée,lehérosdecontesagni.ilestundesdécepteurslespluspopulairesdescontesd’afriqueoccidentale.ilpousselafamiliaritéavecledieu–princepsjouantlerôledechefdevillagejusqu’àletraiterdegosse (batrankan), c’est-à-dire d’inexpérimenté, d’être dont l’intelligencen’estpasencoredéveloppée.(ano1976:33)
toutcequiestditpourleconteagni,estvalablepourLe Pagne noirdebernarddadié.
pourtant,boubakarydaiakitéposeque«dupointdevuedelafor-me,toutsepassecommesil’auteurduPagne noiravaitcherché,endé-tachantsestextesdeleurorigineethniqueettribale,àminimiserlelienentrelatranscriptionetlesoriginesculturellesdumodèle.Letextede-

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
151
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
meurebiensilencieuxsurlanatureetlessourcesdesrécits».(daiakité2003:118)pourtant,sil’onregardedeprèslescontesduPagne noir,lalittératuresavanterejointlecontepopulairedelatraditionakanbaouléenseservantdeformulesd’introductionetdeformulesdeconclusiondontnousavonsparléàproposdescontesagnidel’indénié:
Titre du conte Formule d’introduction Formule de conclusion«Lemiroirdeladisette»(7-17).
c’étaitunmiroirdanslequelilnefallaitpassemirersinon…(7)
etcommetouslesmensonges,c’estparvousquelemienpassepoursejeteràlamer(17).
«Lepagnenoir»(18-22).
ilétaitunefoisunefillequiavaitperdusamère(18).
ellesouritencoredusourirequ’ontrouvesurleslèvresdesjeunesfilles(22).
«Lacruche»(23-35).
ah!tuascassémacruche(23).
etc’estdepuisl’aventuredecettefemmequ’onnemaltraitepluslesorphelinsenpaysnoir(35).
«Labossedel’araignée(36-44).
su-boum-kaetletam-tams’enallaitparlaforêt(36).
maisdepuistoujoursretentitàmonoreillesu-boum-ka(44).
«L’enfantterrible(45-52).
autrefois,lesanimauxhabitaientensemble(45).
elleregarde,ellescrute,interroge(52).
«Lebœufdel’araignée(53-62).
dieuavaitunchampquiétaitremplideronces(53)
[…]lemoutonfutobligédeprendrelavilainelanguequ’ilaencore(62).
«L’araignéeetlatortue»(63-73).
c’étaitpendantlafamine,unefamineatroce(63).
perchésurlaplushautedescimes,ilcherchelepaysdel’écureuiloùrègnentl’abondanceetlapaix(73).
«Lesfunéraillesdelamèreiguane»(74-83.
iguanefilsetkakouananzèétaientdesamisdontl’amitiéaveclestempsreverdissait(74).
etc’estdepuiscesoir-làaussi,leuramitiéserompait(83).
«Legroinduporc»(84-96),
Leporcautrefoisavaitunetrompebelle,unebelletrompe(84).
etc’estdepuiscejour-làqueleporcalegroinquenousluiconnaissons(96).
«Lechasseuretleboa»(97-106).
unchasseurbienpauvreavait,aubordd’unfleuve,étendusespièges(97)
vousàsaplace,quelledécisionprendriez-vous?(106).

Matić Lj.
152
«Lavachededieu»(107-115).
surtout,hyène,ilnefaudrapastoucheraucœur,tum’entends?(107)
etc’estdepuiscejour-làquel’hyèneal’allurequenousluiconnaissons(115).
«Lesparentsdelachauvesouris»(116-120).
Lachauvesourisétaitseule,siseulequecettesolitude,nuitetjour,luipesait(116).
[…]c’esttoujourslafameuseaventuredelachauve-sourisqui,àsadernièreheure,n’eutaucunamipourenavoirtropvouludanssavie(120).
«Lechampd’igname»(121-132).
Lechamps’étendaitàpertedevue.etc’étaitlechampdekakouananzè(121).
etc’estdepuiscejour-làqu’onvoitdesaraignéessurlessources,lesrivières,lesfleuves(132).
«Ladot»(133-142).
vraiment!vraiment,[…]ilpassesouventdesdrôlesd’idéesparlatêted’undieu!(133)
c’estainsiquejenepuisavoirlamaindelafilleaînéededieuparcequej’avaisoubliélebôdoahdemouche(142).
«araignéeetsonfils(143-150)
étaitunmonstrequ’ilavait,kakouananzè(143).
depuis,ilattendlà,leretourdesonfilsquiunjour,decelieumême,partitvisitersonroyaume(150).
«L’hommequivoulaitêtreroi»(151-158).
unhommevoulaitêtreroi(151).
voulez-vousêtrecethommeheureux?(158).
maints critiques littéraires ont comparé la cultureorale et la pro-ductionécriteetLe Pagne noirdebernarddadiéleurservaittrèssou-ventdepointderepère.Jeandérivéinsistesurlefaitqueparmilestrèsnombreuxtypesderelationsquelacultureoraleafricaineapuentrete-niraveclaproductionécrite,«latranspositionenfrançaisécritparunécrivainreconnuetayantdesprétentionslittéraires,d’œuvresditesori-ginellementdansunelangueafricaine»(dérivé2004:1), leconteétaitlibrementadoptépourl’écrit.
bernarddadiéavécutoutesonenfancesousl’influencedesfran-çais.àvingtetunans,ilcommenceàpubliersespremierstextesanti-colonialisateurs,voulantcontribueràlasauvegardedestraditionsetdupatrimoinedesonpays.c’estpourquoiletitredurecueildesescontesestà la foissymboliqueetsignificatif.audirededérivé, lepagneest,avec le boubou, un vêtement emblématique du continent africain telqu’ilestvuparl’occident.
sa qualité même d’objet textile envoie en outre par métaphore à l’aidedetexte–onsaitqu’il s’agitde lamêmeétymologied’autantqu’ilexisteaussi en plusieurs cultures locales des analogies symboliques entre ledéroulementdelaparoleetletissage.[…]quantàl’adjectif‘noir’dutexte

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
153
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
dedadié,ilrenvoieimplicitementàl’ensembleducontinentsubsahariensuggéré commeétantun ensemble culturellementhomogène: lemondenoir.ils’agitbienentendud’unmythe,mêmesileconteestungenrequivoyagebeaucoupetdontonretrouvesouventlestypesetlesmotifsd’unesociétéàuneautre.alorsqueprécisémentlerépertoiredecultureoraleauntrèsfortancrageéthique,celui-cisetrouvegommédansletitre.(dérivé2004:1)
katjaschreibersupposeque l’auteurachoisi le titreàcausedesafonctionfolklorique,vulefaitquelesprotagonistesetmêmelesobjetsqui jouent un rôle dans ce conte sont d’origine typiquement africaine(schreiber1996:1-3)1.
nousavonsdéjàmentionnéque,desseizecontesdedadié,laplu-partmettentenscènelepersonnagedekakouananzè,symboleakandelaruseetdelafourberie.cepersonnageambiguaunesériedesuccès,qui,sousunanglecritique,peuventêtreluscommelapromotiond’unnouvelordresocialpourlequellaruseprendlepassurlerespectscru-puleuxdelamoraleetdestraditions.
pourconclure,nousnepouvonsquerépétercequenousavonsditaucommencementdenotrearticle:ilnefautpasmettredesigned’éga-litéentrelalittératurepopulaireetlalittératuresavante.pourtant,sanscontespopulairesancestraux, iln’yauraitpaseude littératuresavanteafricaine,baséesurl’oralité.
Bibliographie
abastado1979:c.abastado,Mytheset rituelsdel’écriture,bruxelles:éditionscomplexe.ano1972(1976):m.anon’guessan,Conte agni de l’indénié, abijan:impri-merienationale.bogliolo1976:f.bogliolo,contesnégro-africainsetcontesnégro-américains,Éthiopiques,8,octobre1976,siteréaliséavecspip,http://éthiopiques.refer.sn/spip.php?article51331.08.2010.borgomano2000:m.borgomano,Des hommes ou des bêtes,paris:harmattan.dadié1955(1970):b.b.dadié,Le pagne noir,paris:présenceafricaine.daiakité2003:b.daiakité,De la page d’écriture et du mythe de l’ancêtre et de la parole dans leroman francophone ouest africain,thèsededoctorat,Louisianastateuniversity.
1 voirschreiber(1996).

Matić Lj.
154
dérivé2004:J.dérivé,Letraitementlittéraireduconteafricain:deuxexempleschezb.dadiéetb.diop,semen,De la culture orale à la production écrite: litté-rature africaines,18,http//semen.revues.org/document2226.html31.08.2010.fanon1952:frantzfanon,Peau noire, masques blancs,paris:seuil.delfosse1921:m.delfosse,L’âme nègre,bruxelles:stock.delfosse1925:m.delfosse,Les Civilisations négro-africaines,bruxelles:stock.koné1993:a.koné,des textes oraux aux romans modernes,frankfurt:verlagfürinterkulturellecommunication.ngandu1997:p.ngandunkashama,rupture et écriture de violence: étudessurleromanetleslittératuresafricaines,paris:harmattan.paulmeetseydou1972:denisepaulmeetchristianeseydou,«Lescontesdes‘alliésanimaux’dansl’ouest-africain»,inRecherches en Littérature orale afri-caine,xii,45,paris:ehess,76-108.scheub1985:h.scheub,a review of african Oral Traditions and literature,28,2-3,1-72.schreiber 1996: katja schreiber, bernard dadié: Le Pagne noir. recueil decontesdespaysbaôlés,franceforum,universitätbremen,dossier:contesetlégendesafricains,1-3.ugochukwu1985:f.ugochukwu,LedialoguedansLe Pagne noirdebernarddadié,inÉthiopiques, revue négro-africaine de littérature et de philosophie,43,iiino4,14-37.http://éthiopiques.refer.sn/spip.php?article1482. 31.08.2010.wilentz 2001:g.wilentz, voices of theancestors through thewords ofwriters:teaching thediasporas fromanafricanculturalbase, inf.toyola(éd.),Palaver of african Literature,1.
Љиљана МатићБЕРНАР ДАДИЈЕ И НАДАХНУЋЕ ТРАДИЦИОНАЛНИМ
АФРИЧКИМ ПРИЧАМАРезиме
БернарДадијеизносинабеспрекорномфранцускомјезикутрадицијусвојероднеАф-рикеипоказујенесумњивидардоброгпосматрачабићâиствари,својумудростисвојудуховитост.Тврдимода јенаконнепристрасногиспитивањамогућезакључитикаконетребастављатизнакједнакостиизмеђуученекњижевностииплеменитостимисли;истотако,данетребаозначаватинароднукњижевносткаонаивнуиприглупу.УпоређујућиписанукњижевнутрадицијуЗападњакаикњижевностзаснованунаусменојтрадицијинародâЦрногконтинента,пажљивчиталацможедаоткријебројнезаједничкедодирнетачкеБелацаиЦрнаца.Покушаћемодапокажемозначајтрадиционалнихафричкихпри-чаослањајућисенароманБернараДадијеаЦрна прегача.Усвојојстудији,одабралисмодапрво говоримооПричама ањи из Инденије, које је сакупиоМаријусАноН’Гусан, апотомоЦрној прегачиБернараБ.Дадијеа.Циљнамједапокажемоснагувербалногизра-заједнекњижевностибезсловасвојственеонимакојеЗападњациназивајудивљацима,ачијамудростсеизносинавиделокадасенапишенајезикунекадашњихколонизатора.

Bernard Dadié et l’inspiration des récits traditionnels africains
155
Nasl
e|e 19
• 2011 • 14
3-15
5
Узакључку,желимодапоновимооноштосмореклинапочеткусвогаогледа:нетре-бастављатизнакједнакостиизмеђународнеиученекњижевности.Међутим,безпраде-довскихнароднихприча,небипостојалаученаафричкакњижевност,којасезасниванаусменојкњижевности.
Примљено: 28. 12. 2010.


157
УДКрад
Elena Dinevauniversité «st. Clément d’Ohrid» de sofia
L’IMAGe DouBLe De LA feMMe Vue PAr Le reGArD De L’ArTISTe
(étude comparée du roman Bruges-la-Morte et de la peinture de Hans Memling)
Loindechercheràexploreràfondlaproblématiquedumythenor-diquequiajouéaucoursdessièclesunrôleparticulièrementimportantdans la construction de l’identité dite «belge», nous nous focaliseronsdansnotre communication sur lamise enparallèledes esthétiquesdedeuxdesesplusconnusreprésentants:leromancierbelgegeorgesro-denbachetlepeintreflamandhansmemling.
notre tâche sera donc de mettre en évidence les stratégies et lesprincipes adoptés par les deux auteurs qui font que leurs esthétiques,sidifférentesqu’ellespuissentparaître, se trouventdansunrapportdedialectiqueperpétuellequi se fait voir essentiellementdans l’imagedelafemme.L’imagedelafemmetellequelelecteuretrespectivementlespectateurlavoientestd’abordetsurtoutlefruitdutravailacharnéduregard.danscetteoptiquejustementnousessayeronsdevoircommentlesdeuxtypesderegard–celuidel’écrivainetceluidupeintre–modu-lentcetteimage.
enfin, pour conclure, à travers l’analysedu rôleprimordial du re-gard,noustâcheronsdemettreenévidencelaperméabilitédelafron-tièreentrelalittératureetlapeinturequipermetaulecteurderelativisersoninterprétationdutexteparlebiaisdelapeintureet,respectivement,delapeintureparletexte.
Mots-clés:femme,littérature,peinture,regard,détail,imagedouble,fascination
onarépétéàplusieursreprisesquelalittératurebelgemisesurl’élémentpictural.etpourcause:lapeintureasansdoutejoué,d’unemanièreoud’uneautre,unrôleparticulièrementimportantdanslaconstructionetl’affirmationdel’identitédite«belge».conçueàlabasedumythenordi-que,lapeintureapleinementparticipé,aucoursdessiècles,àdesstra-tégiesdesurviedel’espacefrancophonedebelgiquequiaétéetquiest

Dineva E.
158
d’ailleurs toujoursconfrontéà l’influence,parfois très forte,ducentre,c’est-à-dire,deparis.
Loindechercheràexploreràfondlaproblématiquedumythenor-dique,nousnousfocaliseronsdansnotrecommunicationsurlamiseenparallèlededeuxdesesplusconnusreprésentants: leromancierbelgegeorgesrodenbachetlepeintreflamandhansmemling.
notre tâche sera donc demettre en évidence les stratégies et lesprincipes adoptés par les deux auteurs qui font que leurs esthétiques,sidifférentesqu’ellespuissentparaître,setrouventdansunedialectiqueperpétuelle.cemouvementdetransfertd’élémentsvariéscristallisedelamanièrelapluscatégoriquedansl’imagedelafemmequijouelerôled’unsoidisant«pont»entrelesdeuxauteurset,parlà,entrelalittératureetlapeinture.
L’imagedelafemmetellequelelecteuretrespectivementlespecta-teurlavoientestd’abordetsurtoutlefruitdutravailacharnéduregard.danscetteoptiquejustement,nousessayeronsdevoircommentlesdeuxtypesderegard–leregardfascinédehugues,lepersonnageprincipalduromanBruges-la-morte,etleregardmodérédupeintrehansmemling–modulentcetteimage.
outilparexcellencede l’appropriationduréeldans l’actedepein-ture,leregardestégalementlaforcemotricedelanarrationdansl’acted’écriture.sontravailprincipalpassepar laperceptionet ledéchiffre-mentd’unefoulededétailsquis’enchaînentpourdresserunportraitenfiligranedecequiestregardé.or,lerôledudétailchangenonseulementenfonctiondecequiestregardémaisaussideceluiquiregarde,cequenoustenteronsd’illustrerparlamiseenparallèledesdeuxauteursquinousintéressentaujourd’hui:lepeintrehansmemlingetl’écrivaingeor-gesrodenbach.Lesdeuxauteursnouslivrentdeuxtypesderegardsquiseressemblentautantqu’ilsdiffèrentetnousverronsbienpourquoi.
d’abord,et lepeintreet l’écrivainaccordentuneattention impres-sionnanteauparticulieretpartentàlaconquêtedudétail,cequicris-tallisesurtoutdansl’imagedelafemme.pourtant,relatifàlarechercheconstanted’équilibre et d’unicité chezmemling, le détail devient chezrodenbach l’agent principal qui disloque l’image en question tout enaccélérant l’aveuglement de celui qui regarde, notamment dehuguesqui,faceàJane,lesosiedesachèredisparue,perdtoussesrepères.Lesdeuxauteursexcellentdoncdanscequedanielarasseappelledanssonouvragele Détail: pour une histoire rapprochée de la peinture, ledétailiconique car «Le détail iconique c’est ce qui fait sujet, représentation,pousselaressemblancejusqu’aubout.»(<http://www.tentacules.net/in-dex.php?id=489>).Laquêtedelaperfectionqu’iltraduit,assurelacohé-

L’image double de la femme vue par le regard de l’artiste
159
Nasl
e|e 19
• 2011 • 15
7-164
rencedel’imagefémininechezmemling(mentionnons«Ledyptiquedemaartenvannieuwenhove»oubien«Lachâssedesainte-ursule»).
parconséquent,leregardquelepeintreportesurlafemme,estunregardmodéré:letravailméticuleuxsurledétailévoquelessurvivancesde laminiature dumoyen-age tout en suggérant une forme prélimi-nairede réalismequi s’annoncedéjàdans l’œuvredupeintre.danscesens,l’imagedelafemmechezluiestsurtoutlerésultatd’unlongpro-cessus d’individualisationprogressive entamé à l’époquede larenais-sancequi toucheà la représentationde l’hommesur le tableauengé-néral.memlings’inscritdoncdanslemouvementfondamentalpourlapeinturedelarenaissanceflamandequiva«deladescriptiondiscursiveverslaconcentrationsymbolique.»(panofsky2003:476).
situédansunrapportdecontinuitéparrapportaupeintre,roden-bachmène cette «concentration symbolique» à son terme.L’imagedelafemmedansleromanBruges-la-morterésultedansunelargemesurede la règle«aimerau-delàdupossible».cette règledéterminedema-nière explicite le comportementdehuguesviane, le veufquin’arrivepasàretrouverlaconsolationetlapaixdanssonâmeaprèslamortdesabien-aimée.cherchantsanscesseàreconstituerl’imagedelamorte,ilestamenéàvivresavietristeetsansaucuneétincelled’espoircommeunebêteprisеdans lesfiletsdesanalogiesqu’il tissedélibérément lui-mêmetoutaulongduroman.
afinderetrouversoncalme,ils’appliqueàtransposerl’imagedelafemmemortedansl’imagedelafemmevivante.cetterechercheconstan-tecommenceetprogresseparétapessuccessivesgrâceauregard.investiàl’extrêmedanssonsouvenir,hugueschercheduregardtoutautourdeluidesobjetsqui lui rappellent sabien-aiméedisparue.et, à forcedechercher,ilfinitparvoirsondouble:
tout à coup, tandis qu’il recomposait par une fixe tension de l’esprit etcommeregardantau-dedansdelui,sestraitsàdemieffacésdéjà,huguesqui,d’ordinaire,remarquaitàpeinelespassantssiraresd’ailleurs,éprouvaun émoi subit envoyantune jeune femmearriver vers lui. (rodenbach[1892],1977:28)
c’estlepointdedépartdutroubleémotionnelquis’installeradura-blementdansleforintérieurduveuf.c’estaussiledébutdudérèglementdesaperceptionvisuelle:àpartirdecemoment-làoùl’autrefemmeap-paraîtàl’horizon,leregarddehuguesbrouilleratouslesrepèresautourdeluiaupointdeneplussavoirdistinguerleréeletl’irréel.autrementdit,leregardduveufdevientprogressivementleregardde«l’artistefas-ciné»(frølisch1997:131),définitionqueJuliettefrølischformuleàpro-posdel’artistebalzacien.

Dineva E.
160
huguesestl’artistequitentedecréeruneimageparfaitedelafem-me.s’efforçantàsaisirlemoindredétailquifaitquel’inconnueressem-bleàsafemmemorte,leveufréduitdeplusenplusladistanceàpartirdelaquelleillaregarde:«enlavoyant[Jane]maintenantdeplusprès,detoutprès,nulledifférencenes’avéraitentrelafemmeancienneetlanou-velle.»(rodenbach[1892],1977:37,pourhugues).bienaucontraire,plusilregardeJane,pluselleluiapparaît«d’uneressemblancetotale,ab-solueetvraimenteffrayante»(rodenbach[1892],1977:30).
àforced’aspireràcapterlaperfectiondelafemmevivantequide-vrait être d’une identité absolue avec la femmemorte idéalisée à l’ex-trême,leregarddehugues,setransformeenunregardd’obsessionetdefascination.Leveufregarded’abordlamortede«l’œildelamonomanie,de l’idéefixe,de larechercheduchef-d’œuvreetde l’absolu.»(roden-bach[1892],1977:125)ensuite,ilprojettelemêmeregardsurJane,etavecplusd’insistanceencore,essayantdecalquerl’imagedelamortesurl’imagedelavivante:
maintenant,quandilsongeaitàsafemme,c’étaitl’inconnuedel’autresoirqu’ilrevoyait.elleétaitsonsouvenirvivant,précisé.elle luiapparaissaitcommelamorteplusressemblante.(rodenbach[1892],1977:19)
Jane,étantlacréationduregardfascinéquiestunregardd’amourobsessionnelplusqu’unecréationdelaraison,entresurscèneaudébutcomme«uneapparition» (rodenbach [1892], 1977: 26), comme«unevision»(rodenbach[1892],1977:32)quis’évanouit.hantéparlavisiondelajeunefemme«svelteetrapide»(rodenbach[1892],1977:31),hu-guesestcharmé.ilnesaitplusdistinguerlesdeuxfemmesquidevien-nentpourluiuneseule,etilesttotalementimpuissantdevantcequesesyeuxvoient:
hugues se trouve sans forces, tout l’être attiré, entrainé dans le sillagede cette apparition.Lamorte était làdevant lui; elle cheminait, elle s’enallait. il fallait marcher derrière elle, s’approcher, la regarder, boire sesyeux retrouvés, rallumer sa vie, ses cheveux qui étaient de la lumière.(rodenbach[1892],1977:31)
àforcederegarder,huguesvoituneimagedelafemmequisedé-doubledevantsesyeuxquisontprisdansleremousdeleursvisionsetde«leursapparitionsintermittentescommecellesdelalunedanslesnua-ges».(rodenbach[1892],1977:32).
danscesens,labeautédelafemmen’estplusunesourcedeplaisiresthétiquemaisdedésirobsessionnel.Lavivanten’estbellequejusqu’àcequeleregardfascinédehuguesydiscernelestraitsdelamortequirestejusqu’àlafinduromanlaréférencedelabeautéparfaite,maisaussipar-faitementsubjective,puisquevueparunseulregardquinepeutplusvrai-

L’image double de la femme vue par le regard de l’artiste
161
Nasl
e|e 19
• 2011 • 15
7-164
mentvoir.c’estlàjustementquelesesthétiquesdememlingetrodenbachdivergent:alorsquelepeintreporteunregardsurl’imagedelafemmequichercheà«l’embrasser»danssatotalité,lepersonnageprincipalduromanladisloqueenplusieurspetitsdétailsquil’empêchentd’yvoirclair.end’autrestermes,delafascination,huguespasse«audésirfinalementdedécouper[son]œuvre»(arasse1992:44),c.-à-d.lafemme.
a travers les descriptionsméticuleuses de la femme, qu’il s’agissede la femmemorteoubiende la femmevivante,huguesaffirmesansdouteuneattitudeartistiqueàsonégardplutôtqu’iln’yposeunregarddocumentaire.mais,àladifférencedememlingchezquil’enchaînementdesdétailsiconiquesrelatifàsonaspirationàsaisirladurée,confèreunelumièreintégraleàl’imageféminine,hugueslivreaulecteurunregardimpressionnistepar rapport à la femme.Ledétail se transformedoncenfragment,cequ’onvoitdansl’écritureparticulièrederodenbachqui«fuitletermegénéralenglobantl’objetdanssonentièreté,autantqueletermeprécisquilefixeetlelimitepourseservirdecelui-ci,l’effleurant,leprenantdebiais,suggèreplutôtqu’ilnedécrit.»(berg2004:<http://aelib.org.ua/texts/berg__rodenbach__fr.htm>).
aladifférencedememling,àtraversleregarddehugues,roden-bachneproposepasd’image intégralede la femme.L’intégralité chezluisenoiedansunemerdedétails,éclairésparlesjeuxconstantsdelalumière:
eh bien ! oui ! cette fois, il l’avait bien reconnue, et à toute évidence.ce teintdepastel, cesyeuxdeprunelledilatéeet sombredans lanacre,c’étaientlesmêmes.ettandisqu’ilmarchaitderrièreelle,cescheveuxquiapparaissaient dans la nuque, sous la capote noire et la violette, étaientbiend’unorsemblable,couleurd’ambreetdecocon,d’unjaunefluideettextuel.Lemêmedésaccordentrelesyeuxnocturnesetlemidiflambantdelachevelure.(rodenbach[1892],1977:27).
noussommesdoncenprésenced’unesorted’impressionnismeatta-chéàl’idéologiesymbolistequifaitquel’imagedelafemmes’éloignedeplusenplusdelaréalité.celasupposeuntravailparticulierduregard:«enappelantleregardàseposersuccessivementendiversendroitsdutableau,ledétailrythmeleparcoursdeceregardquisuit«lescheminsménagésdansl’œuvre»(arasse1992:149).
Le travail acharnédu regardpermetdedresserune imagedoublede la femme en filigrane.cette dualité se réalise à plusieurs niveaux.d’unepart,c’estauseinduromanquelelecteurlaperçoit.réfractéeparla«diaboliqueressemblance»(rodenbach:[1892],1977:34),lafemmepasseprogressivementdel’humainaudémoniaqueetcepassagedontleregarddehuguesestlepremieràrendrecompte,s’avèreétrel’axecentral

Dineva E.
162
autourduquels’organiseleromanBruges-la-morte.Laprisedeconscien-cedelafaussetédeJane,ladanseuse,enquihuguescroitretrouversonépousemorte,survientaumomentoùleveuffaitl’expériencedespou-péesrussesenfaisantlamettrevivantelesrobesdelamorte:
cetteminute,quandillaverrahabilléecommel’ancienne,devraitcontenirpour lui tout le paroxysmede la ressemblance et l’infini de l’oublimaiscettemêmeminute qu’il avait rêvé culminante et suprême apparaissaitpolluée,triviale(rodenbach[1892],1977:55)
apartirdecemoment,quiesteneffetunmomentcrucialdansleroman,leregardfascinédehuguessetransformeprogressivementetdemanièreinconscienteenunregarddésillusionné:
maishugues, sans s’apercevoir qu’il avait changé lui-même sa façonderegarder,confrontantavecunsoinplusminutieux,enimputaitlafauteàJaneetlacroyaitelle-mêmetoutetransformée.(rodenbach[1892],1977:67)
d’unefemmeidéaliséedanslamesureoùelleestlongtempsledou-bledelamorte,Janedevient«hautaineetglaciale»(rodenbach[1892],1977:98)etsestraitssedéforment.cettedéformationestflagranteàunpointtelqu’elleacquiertàlafinduromanunaspectpurementdémonia-queetcommenceàrired’un«rirecruel,découvrantsesdentsblanches,desdentsfaitespourdesproies.»(rodenbach[1892],1977:84).
departsonregard,huguesserévèlecertainementcommeunartiste,maiscommeunartistedontl’œuvrequiseconstruitdevantsespropresyeux,finitparledépasserprovoquantenluiuneffroitaraudant.dansleprojetmentalqu’ilélaboretoutaulongduroman,notammentdere-trouversonharmonieetsaplacedanslemondequi l’entoure,huguesattribueàJanelerôled’unmédiumquiluipermettedeleréaliser.or,leprojetduveufestfinalementvouéàl’écheccarlemonderéelauquelappartientlavivantes’avèreendésaccordtotalaveclemondeparfaitquiestréservéàlamorte.
cedédoublementdel’imagedelafemmedansleromansefaitvoirégalementdansl’œuvredememlingdanslamesureoùlepeintre,toutenpartantdel’imagedefemmeidéalequiestlavierge,tournedeplusenplussonregardverslafemmeréelle.Laremiseenvaleurdelafemmeréellequiestloind’êtreparfaitecommelavierge,seréaliseparunrap-prochement entre le sacré et le profane.L’individualisationde l’imageféminineabolitlesnormesdelabeautécanoniquepourysuppléerpetitàpetitlesnormesdelabeautéhumaine,cequ’onvoitdansleportraitdesibylla sambetha,parexemple.
or,àladifférencederodenbachoùlerapportentrelesdeuxaspectsde l’image enquestion est conflictuel par excellence et lui confèreun

L’image double de la femme vue par le regard de l’artiste
163
Nasl
e|e 19
• 2011 • 15
7-164
déchirementintérieuretunefatalitéextrême,chezlepeintrecedéchire-mentnes’estpasencoreproduit.memlingeffacetoutetracedefatalitépourlaissers’infiltrerdanssespeintureslasérénitéd’unvisagequirenaîtdesescendres.etrefemmeestdésormaisuneconditionsuffisantepourêtrepeinteaumêmetitrequel’homme.L’individualisationdelafemmeentantquetellemèneàl’accentuationdesestraitspurementhumainsquilarapprochentdelaréalitémêmedanssasainteté.
ainsi, alors que hugues décompose délibérément l’image de lafemmepourmieuxcerner ses traits,memlingconçoit la femme insé-parablement de son contexte qui est la réalité immédiate. autrementdit,memlingestnonmoinsquerodenbachà la recherched’un idéalparticulierdebeauté féminine.or,danscettequête lepeintreéliminetoutetensionetdramatismeàladifférencel’écrivaindontlepersonnageprincipal,hugues,sombrepresquedanslafolieparcequelemodèledefemmequ’ilconstruittoutaulongduromans’avère«incompatible»aveclaréalitéimmédiate.
enfin, instrument principal dans la construction de l’image de lafemme,leregardsuitlecheminementdecelle-ciquipassedelasancti-ficationàladémonisation.ainsi,del’esthétiquedel’écrivainàcelledupeintre,leregardnousestrévélédanstoussesaspects:simpleactededi-rigerlesyeuxversl’objetregardéoumanièredeleconsidérerparlebiaisdelapensée,ilnousestégalementprésentécommelemédiumprincipaldel’expressiondessentimentsetdesétatsd’âme.cequiplusest,enexa-minantlerôleduregarddansdeuxcontextesdifférentsdéterminésparlanaturerespectivementdel’œuvreromanesqueetdel’œuvrepicturale,nousavonsessayéd’accentuersurlefaitqueleregardestbeaucoupplusqu’unoutildeperception:ilpermetaulecteurd’allerau-delàdeslimitesimposéesparlelangagepurementtextueletparlà,derelativisersonin-terprétationdutextelittéraireparlapeintureetvice-versa.
Bibliographie
arasse1992:d.arasse,le Détail: pour une histoire rapprochée de la peinture,coll.«idéesetrecherches»,paris:flammarion.frølisch1997:J.frølisch,L’œilclair-obscur:debalzac,del’artiste,delafasci-nationetdeschoses in:Des hommes, des femmes et des choses, coll.«éditionsessaisetsavoirs»,paris:pressesuniversitairesvincennes,125-138.panofsky2003:e.panofsky,Les Primitifs flamands,coll.«35/37»,paris:ha-zan.todorov 2004: t. todorov, éloge de l’individu, coll. «essais», paris: adambiro.

Dineva E.
164
Ressources en ligne
berg, c. «Bruges-la-Morte» de g. rodenbach (lecture). <http://ae-lib.org.ua/texts/berg__rodenbach__fr.htm>.15.09.2010.Trouver Objet Caché. <http://www.tentacules.net/index.php?id=489>.16.10.2010.
Елена ДиневаДВОСТРУКА СЛИКА ЖЕНЕ ВИЂЕНА ОЧИМА УМЕТНИКА
(компаративна студија романа Bruges-la-Morte и слике Ханса Мемлинга)
Резиме
Безнамередапокушамодаистражимоупотпуностипитањенордијскогмитакојијетокомвековаиграовеомабитнуулогуустварањутзв.«белгијског»идентитета,усредсре-дићемосеуовомчланкунапоређењеестетикадвојицењеговихнајпознатијихпредстав-ника:белгијскогромансијераЖоржаРоденбахаифламанскогсликараХансаМемлинга.
Нашћезадатак,дакле,битидаукажемонастратегијеипринципекојесуовадваауто-раусвојили,акојичинедасењиховеестетике,такоразличите,налазеуодносунепреста-ногсучељавањакојесесуштинскивидиуслицижене.Сликажене,какојеузајамновидечиталаципосматрач,првенственоипресвега јерезултатупорноградапогледа.Утомсмислућемопокушатидавидимокакодватипапогледа–погледписцаипогледсликара–обликујутуслику.
Најзад,каозакључак,крозанализупримарнеулогепогледа,настојаћемодапокажемопропустљивостграницеизмеђукњижевностиисликарствакојаомогућујечитаоцударе-лативизујесвојетумачењетекстаузпомоћсликеи,обрнуто,сликеузпомоћтекста.
Примљено: 30. 01. 2011.

165
УДКрад
Marjana ĐukićInstitut des langues étrangères, université du Monténégro
LA PrATIque De L’ANTIroMAN DANS LeS VIeux RoMANS
Letermeantiroman estforgéparsorelauxviiesiècledansleBerger extravagant (1627)mais cettepratiquehypertextuelle connaît sonhis-toiredepuisleromancourtois.sansconnaîtrel’aspectthéoriquedecettepratique,desromanciersontréagicontre lescanons littéraires toutencréantunefictionromanesque.gérardgenetteapréciséetexpliquédesrelationshypertextuellesetdesnotionscritiquestellesquelaparodie,lepasticheoul’antiroman.Lecaractèremétatextueldel’antiromanestes-sentieldansleschangementsdessystèmesnarratifs.depuischrétiendetroyesàgide,l’antiromanindiquelesétapescardinalesdel’évolutionduroman,surtoutdanslesépoquesoùlathéorielittéraireignorelegenreromanesque.
Mots-clés:antiroman,hypertextualité,gérardgenette,charlesso-rel,chrétiendetroyes,évolutionduroman
depuislaparutiondePalimpsestesdegérardgenetteen1982lathéo-rielittéraireaobtenuunrépertoireprécisdesrelationshypertextuellesquiamodifiéetredéfinilessignificationsdesnotionsutiliséesetuséestellesquelaparodie,letravestissementoulepastiche.L’importancedecetteétudereposeaussisurlefaitquegenetteouvrelemondedesvieuxromansennousmontrantl’ingéniositéetlesavoirlittérairesdesanciensromancierssouventoubliéseteffacésaujourd’hui.partantdel’idéequechaqueœuvrelittéraireévoqueàquelquedegréunautretextelittéraire,genetteoffreuneclassificationstructuraleselonlarelationquis’établitentrel’hypertexteetsonhypotexte(imitationoutransformation).cetteclassificationstructuraleredevientfonctionnellequandilyintroduitlarépartitionselonlafonctionoulerégimequipeutêtreludique,satiriqueousérieux.
Laredéfinitiondesnotionspargenettedansledomainedecequiétaitconnusouslenomdel’intertextualitéadiminuél’incertitudeetleshésitationsdessens,problèmestoujoursprésentsdanslathéorielittérai-re.L’unedesnotionsetdesphénomènesacceptéeetélaboréeparPalimp-

Đukić M.
166
sestesestl’antiroman.forgéparcharlessorelauxviisiècle,l’antiromanétaitlesous-titredesonBerger extravagant(1627).parletitre,lesous-titre,lesremarquesetparl’histoireoùlehérossousl’influencedesro-manspastorauxperdlatête,leBerger extravagantmontred’unemanièreévidenteladiscussionhypertextuelle.bienquelaciblesoitleromanpas-toral,sorelmetencauseégalementlesautresconventionsromanesquesdel’époque–lalittératuresentimentale,allégorique,leromanhéroïque,leromangrec,etmême don quichotte.
sorelaimaginésonantiromancommelelivrequi«futletombeaudesromans»où il autilisé les situations, les conventions, lesperson-nagesetlesscènesdéjàdécritspardesromancierscélèbresouobscurs.comme ledit Jeanserroy (1981: 297), lanarrationde l’antiromandesorelestunecitationcontinue.
avecsorelonpeutdéjà trouvercertains traitsdugenre.endéve-loppantunehistoireoriginale,leromanouvretoutd’abordladiscussionhypertextuelleaveclarichessedelatraditionromanesque.pourremplircetobjectif l’auteurdoitêtreun lecteurassiduetbienaverti.Le talentd’historienduromanetdecritique littérairedesorelestmontrédansdeuxlivresla Bibliothèque française,1664,etDe la Connaissance de bon livre,1671.ensuite, l’antiromannepolémiquepascontreunseultextelittéraire,maiscontrel’ensembledesprocédésetdesconventionsdeve-nusladoxad’uneépoque.puis,danslediégèse,ilyaunhérosintoxiquéparlalecturedesromans.finalement,enl’absencedevraiecritiquelit-téraire,l’antiromans’élèvecontrelesromanscanonisésquisontentraindeperdre le caractère esthétique, selon le vocabulairedesformalistesrusses,etdecettemanièreilfonctionnecommelacritiqueduroman.
touscestraitsspécifiquessetrouventdansladéfinitiondegenette.selonsathéorie,l’antiromanestunepratiquehypertextuellecomplexe,quis’apparenteparcertainsdecestraitsàlaparodie,maissaréférencetextuelleesttoujoursmultipleetgénérique.sonhypotexteestdoncunhypogenre.Laressemblanceaveclaparodieestdanslerégimeludique,maisl’hypotextedelaparodieestuntextesingulier.ils’agitalorsdehé-rosvulgairesdel’antiromanquiviventdesaventuresanaloguesàcellesdeshérosdegenresnobles.cependant,genettesouligneunedistinctionimportante:danslaparodie,l’analogieestréelle,inconscienteetdiégé-tique, alors quedans l’antiroman, l’analogie estmétadiégétique, situéedansl’espritetlediscoursduhéros.pourgenette,l’antiromanestprocheégalementdupoèmehéroï-comique,quireposesuruncontrastesimi-laireentrel’histoireetlediscours.
Ledélireestleprincipalopérateurdel’antiromanparcequedanslecentredeladiégèsesetrouveunlecteurincapabledecomprendreque

La pratique de l’antiroman dans les vieux romans
167
Nasl
e|e 19
• 2011 • 16
5-170
lavien’estpasunromanetquiprendl’universromanesquepourréel.LehérosdeBerger,lebourgeoisLouis,changedenomenLysis,achètequelquesmoutonsettombeamoureuxd’unecertainecharite,toutcelaétantprovoquépar les romanspastorauxqu’il a lus.cette illusion,enl’occurrenceencouragéeparanselme,Lysislavitselonlespréceptesdugenre–ilconsultel’écho,ilchantesouslafenêtre,ilpartpourle(préten-du)forez,ilsejettecommecéladondanslesflotsd’unerivièrecroyantquec’estLignon,ilemploieunlangageprécieux,ilsedéguise,ilchasseledragon.L’effet réalisé est le rire selon lequel l’antiroman s’apparenteaux formes du burlesque. genette trouve d’autres opérateurs de cettepratique hypertextuelle: la mystification extérieure qui peut aggraverleseffets,leprocédédominantduBerger,puisl’imitationconsciente,lepasticheoulachargedanslesdiscours,billetsetpoèmeset,finalement,l’antiromanfonctionnecommelacritiquesérieuseetainsil’hypertextedevientlemétatexte.
L’élémentmétatextuelesten fait l’effetet le résultat leplus sérieuxdel’antiroman.danslespériodesoùiln’ypaseudecritiquelittéraire,l’antiromanremplitcevide.Lapreuvedecettefonctionestquelesciblessontdesœuvrescanoniquesoudessuccèscontemporains.ilnefautpascomprendre leshypotextes commedesœuvres attaquées,mais accep-tées,confirméescommecanonsparcequel’antiromannepolémiquepascontrelesoeuvresmineuresetmarginales.danslatraditionburlesque,ilfautriredeschosespresquesaintes,commec’étaitlecasdanslestra-vestissementsdehomère,devirgileoud’ovide.dansleromanduxviisiècle,l’antiromandésacralisel’astrée,ce«romandesromans»,maisaus-silesromanshéroïquesdemlledescudéryoulacalprenède,etd’uneépoqueprécédentelatraditionencorevivantedesromansdechevalerieet des romanspicaresques.grâce à l’activitémétatextuelle de l’antiro-man,onpeutsuivrel’évolutiondugenreromanesqueetlechangementdessystèmesnarratifs.
d’après cette critique textuelle, le chef-d’œuvre de sorel, l’histoire comique de Francion (1623,1626,1633)lestatutdel’antiromanmériteaussi.cetauteurmilitantcontrelesmauvaisromansavaitl’intentiondedémontrercommentonpeutencréerunbonquiselitavecplaisirenutilisantdesprocédésetdesmotifsdéjàconnus.dansFrancion, lero-mancierprofitedesscènesdechevalerie,apporteuntonpicaresque,uti-lisedesdéguisements,desreconnaissancesetautrespéripétiesbaroquesetluttecontrelepédantismeprécieux,maisenmêmetempsilyintègreles idées libertines contemporaines. Leplus important est qu’il établitainsiunenouvelletradition,celleduromancomique.

Đukić M.
168
L’écartdeladéfinitiondel’antiromanestquelehérosdeFrancion,bienquelecteurassidudesromansdechevalerie,apprendvitequelavien’estpasun romanetquitte ses illusions chevaleresques.L’absencedudélireetladiscussionhypertextuelle,quiestplusimpliciteetmoinsévi-dentequedansleBerger extravagant,marquentdoncconsidérablementl’existencedecetypedetexteselonsoncaractèremétatextuel,mêmesitoutes lesexigencesde ladéfinitionn’étaientpasremplies.avraidire,genetteluimêmenetrouvequetroisromansquisontdesantiromansproprementdits:don quichotte,leBerger extravagantetPharsamondemarivaux.
cependant,lestraitsessentielssontprésentsdansdenombreuxro-mansdedifférentesépoquesmarquantlespointscardinauxdel’évolu-tionlittéraire.quandonparledel’évolution,cetermeestcomprisdansle sens des formalistesrusses, comme le rétablissement de nouvellesécoleslittérairesquipossèdeuncaractèredynamique(v.b.eikhebaum1965:69),nullementcommeprogrès.aveccettesignificationnonstricte,Madame Bovaryestunantiromanetendiscussionhypertextuelleavecl’hypotextebalzacien.Lepersonnagelitdesromansetlavied’emmaof-frecertainsélémentsromanesques,telsqueleséducteurrodolphe,quidémarrelemécanismedelapertedusenspourlaréalité.ensacrifiantletonburlesque,leromandeflaubertconservelemécanismedel’antiro-manetdevientunerévolutiondugenre.onpeutajouterd’autresnoms,sterne,diderot,gide,maisilestunpeusurprenantdetrouverlestracesdel’antiromandansl’œuvredupremierromancierfrançais,chrétiendetroyes.
ilestconnuquechrétiendetroyesavecsescinqromansétablitletypeduromancourtois.ilquitte«lamatière»romaine(sesromansper-dusétaientsousl’influenced’ovide)auprofitdela«matière»bretonnedontilcréeunmonderomanesquequiserapendantdessièclesunmo-dèlederomandechevalerie,desromansmédiévauxfrançaisenproseaux romansespagnolsduxvetxvi siècledont le texte eidétiqueestamadis de gaule.L’amouret lesaventuressontdeuxaxesthématiquesparlesquelsleromanestdéfiniparrapportauxautresgenreslittéraires,surtoutauxchansonsdegeste.L’amourcourtois,lafine amor,laissedecôtélaconceptiondel’amourcommemaladie,commeuneforcefataleetdestructrice,présenteencoredanstristan et iseut.L’amourcourtoisestunchoixraisonnable,réservéàuneélitecapabledel’éprouveretdeletransmettreparunlangageraffinéetélégant.L’amourdevientunartd’aimerqueladameetlechevalierpeuventpartagerparcequ’ilsontlemêmecode.Lechevalierdoitfranchirdenombreuxobstacles–tuerundragon, défendre le château, vaincre dansun tournoi, pour accéder à

La pratique de l’antiroman dans les vieux romans
169
Nasl
e|e 19
• 2011 • 16
5-170
l’être aimé.Le conflit romanesque se trouveentre l’amouret ledevoirchevaleresque,maislafinheureuseestquandmêmeletopoiduromancourtois.
il s’agitdoncdumodèle,brièvementexposé,crééparchrétiendetroyes,maisl’auteurmédiévalmontrebeaucoupdetalentpourlesdis-cussionshypertextuelles.or,ilacréesonromanCligèsd’aprèstristan,avecletriocligès,sononclealiceetlafillefenice.maispourfenice,lafemmedel’onclen’apasdeconflitmoraletellechoisitainsil’hommequiaime-quiaducœur,qu’ilalecorps.egalement,chrétienparodielemotifdubreuvagemagique:lorsdelanuitnuptiale,aliceboitlapotionquidonneunefausseillusiondeplaisiretfeniceboitl’autrepourprovo-querunefaussemort.
pendantque lacritiquenommesouventCligèsanti-tristan,Perce-val, le dernier romandechrétiendetroyes ouvrenon seulement lesnouvellespossibilitésdel’artromanesque,maismetenquestionlemo-dèle qu’il a créé - le roman courtois. Les élémentsmétatextuels sontnombreuxdansleniveauthématiqueaussibienquedansleniveauduprocédé.toutd’abord,lehérosestanti-courtois,ilgranditdansl’igno-ranceetapprendlachevalerieaufuretàmesure;ainsipercevaldevientlepremierromand’apprentissage.Leroiarthurestmélancoliqueetlas,lechevalierdelatablerondegornemantdegortestironiqueenverslacérémoniedel’adoubement.ilmanqueégalementl’axecentral–l’amourexistemaischrétienmènecettehistoireversunethématiqueplusspiri-tuelleetmystiquecentréautourdugraal.iln’yaplusd’amourheureuxàlafinetlecoupleamoureux(ladameetlechevalier)n’estpluslefilprin-cipalthématique;mêmepercevaldécouvreunemélancolieenpensantàsablanchefleur,cequiestunmotifnouveau.del’amourromanesque.enfin,percevalcommetunpéchéensuivantlevœudesilencedesche-valiers–ilrestesansmotsdevantlegraal.
ilestévidentquepercevalestuntournantsignificatifdanslapoéti-quedechrétiendetroyes.Lepremierromancierconnumontrelacapa-citéd’unecritiquehypertextuelleenverstristan et iseut,maisilcréeaussiunesorted’antiromandontl’hypogenreestleromancourtois.ils’agitentoutcasd’unrareexempledelaconscienceromanesquequiluttecontrelesconventionsetlescanonsmêmes’ilétaitleurcréateur.
L’antiroman,notioncrééeparsorel,confirmécommenotioncriti-quegrâceàgenette,révèle lesétapesrévolutionnairesdugenreoùlesromancierséruditsmettentenquestiondesformestraditionnellespourlesremplacer.«toutesuccessionlittéraire»,écrivaittynianov,«estavanttoutuncombat,c’estladestructiond’untoutdéjàexistantetlanouvel-

Đukić M.
170
leconstructionquis’effectueàpartirdesélémentsanciens».(tynianov1965:68)
danscecombat,l’antiromanapparaît,d’aprèsJeanserroy,commelelaboratoireoùlesauteursdécouvrentlarichessedestechniquesnarrati-ves,desstructuresdurécitetlaréflexionsurleromandanslafictionduroman.ilfautêtretrèssensibleetreconnaissantparrapportàcespointsromanesquesoriginauxdel’histoirelittérairedontl’inventionetletra-vailmétatextuelontchangélegenre.
Bibliographie
eikhebaum1965:b.eikhenbaum,Lathéoriedelaméthodeformelle,in:théo-rie de la littérature, (textesdesformalistesrussesréunis,présentésettraduitspartzvetantodorov),collection«telquel»,paris:seuil,31-75.genette1982:g.genette,Palimpsestes,paris:seuil.serroy1981:J.serroy,Roman et réalité,paris:minard.tynianov1965:J.tynianov,del’évolutionlittéraire,in:Théorie de la littérature, (textesdesformalistesrussesréunis,présentésettraduitspartzvetantodo-rov),collection«telquel»,paris:seuil,120-137.
Mарјана ЂукићАНТИРОМАН КАО ПОСТУПАК СТАРИХ РОМАНА
РезимеФранцускироманописацШарлСорелјекаоподнасловсвогроманаНастрани пастир
првипутупотребиотерминантироман.КаокритичкипојамзадржаћегаЖерарЖенетучувенојстудијиПалимпсестикојаоткриваидефинишехипертекстуалнеодносе,амногепознатепојмове,каоштосупародија,травестијаилипастиш,редефинишеиосвјетљава.Антироманјепосебнаинтертекстуалнаоперацијакојомсеполемишенесапојединачнимтекстом,већсачитавимжанром.Романописцисвихепоха,одКретјенадеТроадоЖида,користили су овај вид десакрализације канона чиме антиромани постају кардиналнипунктовиуеволуцијижанра.
Примљено: 29. 01. 2011

171
УДКрад
Тamara Valčić BulićFaculté de philosophie, université de Novi sad
LEs ILLUsTREs FRANçAIsEs (1713) De roBerT CHALLE: ENTRE TRADITIoN ET MoDERNITÉ?
Les illustres Françaisesderobertchalle (1659 -1721), romanquiconnutunsuccèseuropéenremarquablependanttout le18esiècle,n’aétévéritablementredécouvertparlegrandpublicquedanslesannées60dusiècledernier.aucroisementd’unrecueildenouvellesetd’unromanparsonarchitecturecomplexe,cetteœuvreseprésenteàlafoiscommefruit d’une longue tradition et commeprécurseur des romans de l’èremoderne,ceuxdel’abbéprévost,dediderot,deLaclos,puisdebalzacetdestendhal.
c’estd’abordleréalismeetlenaturelduroman,«romand’actionetdepassion», appelémême«barbare»,qui fait l’objetd’unexamen toutparticulier,puisestétudiéelastructurepolyphoniqueduroman:ons’ef-forcedemettreenrelieflapluralitédesvoixnarratricesquisefontécho,ainsiquelatrèsfortecohésiondeshistoiresentreelles.nousnousinter-rogeonsàlafinsurlerôledesillustres Françaisesdanslanaissanceduromanmoderneenfrance.
Mots-clés:robertchalle,illustres Françaises,naturel,vérité,roman,histoires
Lesillustres Françaisesestuneœuvreaujourd’huilargementconnueenfrance:elleaétépubliéesansnomd’auteurpourlapremièrefoisàLahayeen1713,puisdeuxansplustardenfrance.c’estuneœuvrepriséeparbiendescontemporainsetluetoutaulongdu18esiècle:entémoigneunequinzained’éditionsaucoursdusiècle.c’estégalementuneœuvretraduiteenanglais,allemand,hollandais,adaptéeauthéâtreàplusieursreprises,puistombéedansl’oublijusqu’aumilieudusiècledernier1.denosjours,lapremièreéditionintégraleaétépubliéeparlessoinsdefré-déricdeloffreen1959,puisestparuel’éditioncritiquededeloffreetdecormieren19912.depuis,lesétudessurcelivreetsonimportancepourledéveloppementduromanfrançaissesontmultipliées:ildevientdès
1 ilexistetoutefoisdenotablesexceptionscommecelledechampfleuryquidanssonlivre(Le Réalisme,1857)louel’œuvreetsonauteur.(v.deloffre2001:215-217)
2 L’œuvreestdisponibleégalementenLivredepocheclassiquedepuis1996.

Valčić Bulić Т.
172
lorsclairquel’œuvredechalleaexercéuneinfluenceconsidérablesurdesauteurscommeprévost,marivaux,crébillon,Laclos.
son auteur, robert challe3 (1659-1721), est bourgeois issu d’unmilieu aisé, bien éduqué, grand voyageur4, investisseurmanqué,ma-rin et enfin écrivain. sonœuvre est variée: en tant que romancier ilest aujourd’hui connucomme l’auteurdes illustres Françaises etd’uneContinuation de l’admirable Don Quichotte(1713),maisilaégalementécritsonJournal de voyage aux Indes orientales 1690-1691 (1721,pos-thume)etunecritiqueacerbedel’église,profondémentanti-chrétienneetdéiste,lesDifficultés sur la religion proposées au P. Malebranche(termi-néesvers1712)5.
Le titred’illustres Françaises est en soiune revendicationdenou-veauté:l’auteursedonnepourtâchedequitterlesgrandsdomainesdel’imaginaire etdes contrées lointaines exploréespar sesdevanciersdugrandsiècle.aulieudenarrerledestind’unartamène,d’uncyrusoud’uneastrée,ilentendtraiterunsujetetdécrireunmondeprochesdulecteur.c’estainsiquelesfemmes–portantdesnomstypiquementfran-çaiscommeangélique,babet,silvie,manon–serontlesprotagonistesdesonlivre6.cesoucideréalismeestloind’êtreentièrementnouveau;ilsuffitdeserappelerlesromanscomiquesdesoreloudescarronquiontprécédélesillustres Françaises;souvent,toutefois,danscesromansqua-lifiésderéalistes,prédomineunenetteintentionparodiqueetburlesque,cequiestloind’êtrel’objectifdechalle.Lequalificatifd’«illustres»poursapart,nesuggèrepaslavaleurhistoriquedecesfemmes;leurgrandeurestdansleurdestinsingulieretleurpassionqu’ellessontdécidéesàvivrejusqu’aubout.
L’œuvredechalleestenpartieuneréactionàlafantaisiedesanciensromans;l’intentiondes’endémarquerestinlassablementrépétée.dèssapréface,l’auteurindiquequel’onnetrouvera«pointicidebraveàtouteépreuve,nid’incidentssurprenants;etcelaparcequetout,enétantvrai,nepeutêtrequenaturel»(challe1996:59).Lavéritédontparlel’auteurn’estpasunevéritématérielleméticuleusementobservée,unecopiedela réalité laplusbanale;bienaucontraire, ildéclareavoir fait «exprèsdesfautesd’anachronisme»etd’autresencore.(challe1996:59)Laques-tionneseposedoncpasentermesd’authenticitéetderéalitéhistorique,maisentermesdecrédibilitéetderéalisme«poétique».Larevendication
3 dontlenomaétédifféremmentorthographié,avecunsàlafinnotamment(chaslesetdeschalles).
4 ilavisitédenombreuxpays:l’acadie,lequébec,l’inde,lamartinique.5 cetexteestparuenversionincomplèteetsousunautretitreen1767,etadûattendre1970
pourêtrepubliéenversionintégrale.6 ils’enexpliqueégalementdanssapréface(challe1996:62).

Les illustres françaises (1713) de Robert Challe: Entre tradition et modernité?
173
Nasl
e|e 19
• 2011 • 171-179
devéritésedoubledusoucidenouveauté:lessourcesdechallenesontpoint livresques: «onne trouvera riennonplusd’empruntéd’ailleurs.touslesincidentsensontnouveaux,etdesource.»(challe1996:60).
challeentenddonccréerœuvremoderneetnouvelle,enplaidantpour unemorale plus naturelle car: «par des faits certains, on y voitétabli[e]unepartieducommercedelavie»(ibid:57)7.maisc’estéga-lementpourrépondreàl’avanceàdesaccusationsdemensongeportéescontreleromanengénéraldansla1èremoitiédu18esièclequechalleessaiedes’endémarquer.entémoignenotammentl’hésitationoumêmel’insouciancegénériqueexpriméeparl’auteurdanssapréface:«monro-man etmeshistoires, commeonvoudra les appeler…»8 (challe1996:57)alorsquelesous-titredonnéàl’œuvre,celuid’«histoirevéritable»(challe1996:65)parl’alliancedesdeuxtermescensésiciêtrepratique-mentsynonymes,confèreladignitéetlavéritéindispensablesàl’œuvre.ilconvienttoutdemêmedeserappelerquel’appellation«histoirevérita-ble»estbienconventionnelledanslesannéesoùpubliechalle9etrenvoiesurtout,noussemble-t-il,àl’exigencedevraisemblance,héritagedirectduclassicismefinissant.pourtant,endépitdesatentativedes’éloignerdecertainesconventionsromanesquesetdesstéréotypesdivers,expri-méedanssadéclarationd’intention,leromandechalleprésenteparfoisdes événementspouvantparaîtreassez invraisemblables–etpourtantvrais,nousassure-t-il-commelafameusescèned’unmariagecontractéaumomentetsurleslieuxdelaprononciationdesvoeuxmonastiques(challe1996:239-241).d’autresscènesextraordinaires,telsl’enlèvementoulaséquestrationdelafemmeaimée(challe1996:480-482),fontres-semblerlesillustres Françaisesàunromand’aventureouàuneaccumu-lationdefaitsdivers;onhésiteicientrel’invraisemblabledelafictionetceluidelaréalitébrute.
cetteconstanterevendicationdenouveautéestparticulièrenonseu-lementàl’auteurdulivre,elleestpropreauxpersonnagesduromaneux-mêmes.ceux-cimultiplientlesrappelsdelaprofondedifférencedeleurscaractèresparrapportàceuxdespersonnagesdesromansantérieurs.aulieudesecantonnerdansdebeauxrôlesdehéros«sansreproche»,lesprotagonistes,ancrésdansleurconditionsocialedebourgeoisnantisou
7 etilréitère:«lamoralequel’onpeutentirerestd’autantplussensible,qu’elleestfondéesurdesfaitscertains.»(challe1996:59)
8 c’estnousquisoulignons.9 commelesoulignerustin,les«histoiresvéritables»abondentencedébutdesiècle;certai-
nesontdesintentionsparodiquesouironiques,d’autresseprésententcommedevéritableschroniquesdutemps.(rustin1966:89-91).L’intentiondechallesembleêtretoutautre: lapeinturedesmœurs.

Valčić Bulić Т.
174
depetitsaristocrates, inclinentàavouer leurspropres travers10;à l’ab-senced’idéalisationdeleursrelationsavecautruis’ajoutentlacomplexitéetmême l’ambivalencede leurs sentiments.Lanouveautédes illustres Françaisesrésideégalementdanslareprésentationmimétiquedesper-sonnages;leursportraitsphysiques,notammentceuxdesfemmes,sontdétaillés,nuancésetvariésetenfinéloignésdesstéréotypesinstaurésparlatradition.Leportraitd’unpersonnagesecondaireleprouvebien:
elleétaitd’unetaillemoyenne; lapeauunpeubruneetrude; laboucheunpeu grosse;mais on lui pardonnait ce défaut en faveurde ses dentsqu’elleavaitadmirables;lesyeuxbrunsetétincelants;unpeumaigreetunpeuvelue;ettoujourspâle;toussignesquimontraientsonpenchantauxplaisirsdel’amour.(challe1996:559)
deplus,lesoucimimétiques’étendàdesnotationsd’atmosphère(v.challe1996:383,397)etàl’usagedelalangue:challeadoptelestyledelaconversation«purementnatureletfamilier»(challe1996:60),obéis-santàlafoisauxconventionsd’unenarrationoraleetsuivantsonproprepenchantpourlenaturel.
dans ce même esprit, la question de la vraisemblance des événementsracontésestsouventposée.d’unepart,lespersonnages-narrateurstententd’assurerleursauditeursdelavéracitédeleurspropresproposcommecenarrateurquine veut endémordre: «vous riez […]vous croyezque cedéguisementestunincidentderomanpurementinventé,iln’estpourtantriendeplusvrai.»(challe1996:213-214).d’autrepart,lesinterlocuteurss’autorisent le doute chaque fois que l’histoire semble prendre un tourexcessivement romanesque, ou que les sentiments d’un des héros decette histoire paraissent feints et empruntés; ailleurs encore, l’ironie estpratiquée: tout celapourdémasquer les procédéshabituels des romans.ainsienest-ildudéguisementprétendumentréussid’undomestique;undespersonnagesfémininsnefaitqu’enrire:«poursuivez[…]lepastelestvenufortàpropos,lesyeuxetlavoixnetiennentpointcontre.»(challe1996:214).uneautrehéroïne,indignéeparlefaitquesonamantsembletrouver ailleurs unmariage à sa convenance, s’écrie: «La résolution estd’unvéritablehérosderoman,[…]vousm’aimez,etvousconsentezd’enépouseruneautre».(challe1996:253)
Lanouveautéde l’œuvre, endehorsdunaturel et de la crédibilitévoulus,reposeessentiellementdanssastructure.bienquel’auteurs’ex-cuse de sa composition «embrouillée» (challe 1996: 61) et fantasque,car,nousdit-il,pourlaliaisondeseshistoiresilasuivi«lapremièreidée
10desprezdévoileàsesauditeursdesdesseinspeuavouablesconcernantmelledel’épineavantqueleurmariagesoitconclu:«étantseulavecelle,jefisinutilementcequejepuspouravan-cerlaconclusion.»(challe1996:318).v.desremarquessemblablesdedesfranssurlespri-vautésqu’ils’étaitpermisesavecsilvie(challe1996:449).

Les illustres françaises (1713) de Robert Challe: Entre tradition et modernité?
175
Nasl
e|e 19
• 2011 • 171-179
quim’estvenuedansl’esprit,sansm’appliqueràinventeruneéconomiederoman»(challe1996:61),lastructureinternedesillustres Françaisesestunestructureassezcomplexeetsavammentconstruite.Le livreesteneffetcomposéd’unrécitcadreetdesepthistoiresencadrées.procédétrèsancien,datantdesmille et une nuits,etenoccident,aumoinsdepuisboccace,aupremierabordinscritl’œuvredansunelonguetradition.Leprocédé estnéanmoins rajeuni: les règlesdenarrationdansun cercleferméetfixequ’estgénéralementlecerclededevisantsdanslesrecueilsdenouvelles antérieurs, tels le célèbredécaméron ou l’heptamérondemargueritedenavarre, sont ici considérablementmodifiées.dans lesillustres Françaises les retrouvaillesdequelquesamis–douze11 au to-tal,maisrarementtousréunis-quines’étaientpasvusdepuisplusieursannées,sedéroulentselonunrythmecapricieux:ils’agitd’uncerclequis’élargit,parfois rétrécit, augrédes jours etdes circonstances, commepourmimerlecoursnatureldeschoses,lavieelle-même.
ils’agiraitparconséquentd’unrecueildenouvellesetcelabienquelemotnesoitjamaisprononcéparchalle.L’œuvren’esttoutefoispasunesimple sériedenouvelles enserréesdans lanouvelle-cadre: l’entrelace-mentcommeprocédéintervienticiàdoubletitre.d’unepart,l’histoire-cadreet leshistoiresencadréessontentrelacées,dufaitquelesdestinsmisenscènesontceuxdecesmêmesdevisants–narrateursetnarra-taires;naturellement,dansleshistoiresencadréesapparaissentaussidespersonnagesétrangersàl’histoire-cadre,qu’ilsaientétédirectementim-pliquésdans laviedesdevisants-protagonistesoudesimplesconnais-sancesdecesderniersetdontledestinreprésentequelqueintérêtpourl’histoire.deplus,lesnarrateurs,tousdeshommes,aunombredequa-tre,relatentnonseulementdesévénementsdeleurproprevie,maisaussidelaviedeleursproches,dontilsconnaissentbienladestinée.certaineshistoiressontdoncracontéesparnarrateurdéléguéouinterposé;cerécitau2edegrésecaractériseparfoisparl’emploidela1epersonne:c’estlecasdel’histoiredeJussy,narréepardesfrans,etdecellededesprez,dont se chargedupuis.mais, comme le constate Jeanrousset,mêmelorsquelenarrateurutilisela3epersonne,ils’agitd’une1epersonnevoi-lée,masquée.(rousset1973)
qu’il s’agisse du narrateur central ou des narrateurs-devisants, aucund’entreeuxnepeutseprétendreabsolumentomniscient;ilssontcontraintsdejugerd’aprèslesapparencesetparconséquentpeuventmêmeêtredansleur tort; un personnage dit à un autre: ««… il y a dans votre histoire
11Leshommess’appellentdesronais,desfrans,dupuis,contamine,terny,Jussy,alorsquelesfemmessontmanondupuis,angéliquecontamine,mmedeterny,mmedemongey,mmedeLondéetmmedebernay.

Valčić Bulić Т.
176
desendroitsquevousn’entendezpasvous-même.»(challe1996:362)12;désireux d’être entièrement crus, les narrateurs éprouvent le besoind’accréditerleurrécitencitantleurssources13(challe:192,335);parfois,ilslaissentexprèsdeszonesd’ombrepourretarderleurrécit:«nousdironsuneautrefoisquelétaitlesujetdeleurconversationquifutassezlongue.»(challe1996:281)14.toussansexceptionsepermettentpourtantdejugerlesprotagonistesde l’histoirequ’ils sont en traindenarreroud’émettredeshypothèsessurlecoursquelesévénementsauraientpuoupourraientencoreprendre15:unefoisdeplusils’agitdemieuxmimerlavéritédelavie.
d’autrepart, leshistoireselles-mêmessontreliéesentreelles nonseulementparcequecesontsouventlesmêmesnarrateursquilesracon-tent16maiségalementparcequec’estleprocédédecirculationinterne,du retour des personnages d’histoire en histoire qu’utilise ici challe.c’estainsiquecertainsdestinss’éclairentau longdu livre:des indices,des annonces17 sur les événements, des germes d’intrigues sont livrésaulecteur,carlenarrateurdufaitdesaconnaissanceimparfaite,laissetouteunepartdemystèreetdesuspens.Lesrécitsdesunscomplètentalorsceuxdesautres,deséclairagesdifférentssontjetéssurunemêmehistoire.ilarriveaussiqu’unmêmepersonnagesedédoublepourjugersonpassé,ouquelerôledecertainspersonnagesetl’opiniondulecteursurleurcaractèresemodifientaufildeshistoires.deplus,lasociétédesdevisantsestouverteaudialogue,ellejuge,ellecorrige,elleinterprètelesévénements.Lanarrations’avèredecettemanièredevenirunequêtedesensàdesévénementsquin’enontpasetl’œuvredevientun«écheveauquisedévide»(coulet1967:314).
enfin,ledénouementdecertaineshistoiresn’estdonnéquedansledénouementdel’œuvretoutentière:c’estlecasdel’histoiredesilvieetdedesfrans;cettehistoireestl’exempleleplusfrappantdecettetechniquedeprogressionparà-coups,progressionaucoursdesdiscussionsaussi
12unautreexempleenestlaprétendueinfidélitédemanondupuisquin’estqu’unmalheureuxmalentendu(v.challe1996:127).
13«…etcen’estquedemademoiselledevougyquenoussavonslecommencementdecettescène.»(challe1996:192)(v.challe1996:335).
14icic’est lenarrateurcentralquiparle,mais lamêmeremarquevautpourlesnarrateursse-condsquisaventménagerunepartdesecretdevantdesnarrratairesquirisqueraientd’êtreoffensésoublessésparcertainesdécouvertes.
15«.. ilne me paraît pas vraisemblablequecontamine l’eût jamaisépousée, s’ilen fûtvenuàbout.[...]cetteobstinationme fait croirequ’elleavaitvéritablementvécusageaveclui»(chal-le1996:166,176).ouencore:«…uneamitiéqui,suivant toutes les apparences,dureraautantqueleurvie.»(challe1996:358)c’estnousquisoulignons.
16desronais,desfransetdupuisracontentchacundeuxhistoires(laleuretcelled’unautre).17Lesexemplesfoisonnent,n’envoiciquedeux:l’annoncedel’histoiredem.deJussypardes
fransetdelaviedissoluededupuisparmadamedecontamine,(challe1996:244).ensuiteplusieursannoncesdudénouementheureuxdel’histoirededupuis,(challe1996:74,280).

Les illustres françaises (1713) de Robert Challe: Entre tradition et modernité?
177
Nasl
e|e 19
• 2011 • 171-179
bienquedesrécitsautres18queceluiquileurestentièrementconsacré.enrevanche,lesortetmêmel’identitédecertainspersonnages,commeceluidelaveuve,maîtressedulibertindupuis,restentobscurs19,certai-nesintriguesrestentinachevéesmêmesilafinenestprévisible.touscesprocédésd’entrelacement,d’enchevêtrement,etdecohésion internedelamatièrenarrative,fontdesillustres Françaisesnonpasunrecueildenouvellesmaisunvéritableroman.
Lecaractère romanesqueet l’originalitéde l’œuvrene se réduisentpasnonplusàsastructure.bienquelesujetdesseptrécitsdesillustres Françaisessoitunsujetbanal,l’amourcontrariépourdifférentesraisons,celledeladisproportiondesfortunesoudel’inégalitédesnaissances,oubienl’amourprétendumentouvéritablementtrahi20, letraitementquechalleluiréservenemanquepasd’êtreintéressant.grâceàuneanalyseapprofondiedesactionsetdessentimentseffectuéeparlebiaisdurécitdesapropreaventureoudecelled’unautredelapartdunarrateur,oubienparleslettresdesprotagonistesquipermettentd’offrirdespeinturesdétailléesdelaviementaledespersonnages,ouencorepardesdialoguesà caractère scénique, challe parvient à rendre différents caractères etémotions.unepolyphoniedemoyenspropreauromanesticiàl’œuvre.
c’estdoncsurtoutlavéritéhumaine,àlafoislamisedesoncoeurànuetlatentativedediscernerdanslecœurdesautres,quipourtant,lui,resteimperméable,quisembleapporterunefraîcheurnouvelle.Leprincipal mobile des personnages est décidément la «chasse au bon-heur» frénétique: l’amour, représenté chezchalle commeun puissantélannaturel,faitdespersonnagesdes«forcesruséesoubrutales»(coulet1980:311)douéesd’une«sentimentalitésensuelle»(deloffre2001:219)exceptionnelle,d’unesensibilitéàfleurdepeau.d’oùdesmanifestationsdes sentiments bouleversant tout l’être: les pleurs en sont l’expressionla plus banale et des déluges de larmes sont versés, aussi bienpar lesprotagonistes des récits encadrés quepar les auditeursdu récit-cadre,souslecoupdesémotionsviolentes(cf.challe1996:97,272,315,319,
18desdétailsannonçantlesorttragiquedesilvieetdegallouin,sansdévoilerentièrementleurfauteapparaissentdèslapremièrehistoire.
19parexemple,lesraisonsdesaruptureavecdupuisrestentinconnues(challe1996:602);lepersonnagedelaveuvelui-mêmeestassezétonnantetbienmoinsconventionnelqueceuxdethéâtre,ellerefuselemariage.
20plusprécisément la 1e histoire est celled’unpère tyrannique etd’uneprétendue infidélitéféminine;laseconderacontelavertud’unejeunefillemodesteetsonmariage;la3erelateladuretéd’unpèrequidestinesafilleaucouvent,décisioncontrecarréeparladéterminationdelajeunefilledesemarieravecl’éludesoncœur;la4eestl’histoired’unegrossessehorsmariage,d’unraptetdelaconstancedesjeunesgensdanslemalheur;la5eraconteunma-riageclandestinetladuretédesparentsàl’égardsdeleursenfants,la6eestunehistoirecruelled’infidélitéetdevengeance,etenfinla7el’histoired’unlibertinconverti.

Valčić Bulić Т.
178
342,349,350).desréactionsphysiquesbienplusfortessontégalementreprésentées:angéliqueétait:«dansunabattementextrême,ayantunegrossefièvreetdesmauxd’estomacsivifs,qu’àpeinepouvait-ellepar-ler.»(challe1996:178)
untelélannaturelpousselesêtresdanslaréalisationdeleursdes-seinsauxdifférentesformesdeviolence;celles-civontjusqu’àlabarbarie:viols,séquestrations,vengeancesmeurtrières21;lelecteuresttransportéloindumondepolietgalantduromanclassique,rivalisantenperversitésavecceluideshistoirestragiques.Lesperversitésetlesviolencespeuventreleverd’ailleursexclusivementdupsychologique:levieuxdupuis,muparuneidéefixe,absorbéparsapassionunique,l’amourpossessifenverssafille,nereculedevantaucunchantageoustratagèmepourlagarder(challe1996:102):ilestunvéritablemonomane,commeleserontplustardlepèregoriotoulepèregrandetdebalzac.d’autrespersonnagesrecourentaussiàlamanipulation:unemultitudedejeux,de«comédies»sontorchestrésparlelibertindupuislejeune,cyniqueethypocrite,quipréfigurebienlepersonnagedevalmont,etd’autresencore.
ilrestequeLesillustres Françaisesest«uneœuvreàpart»(coulet1967:314)sanspostéritéimmédiate.amaintségards,elleestredevableàlatraditionnarrativeantérieure:challereprendàsoncomptecertai-nessituationsromanesquesetchoisitpourcadredesesrécitsunehistoi-re-prétexte.toutefois,sonœuvreestmoderneparlesoucidevéritéhu-maine:parlafocalisationsurunindividuàlarecherchedubonheuretdelui-même,lespersonnagesdecetteœuvreannoncentlespersonnagesstendhaliens (v.deloffre1959)et avantstendhal, ceuxd’unmarivauxoud’unprévost.Leprincipedeconstructionchoisiparchalleestpoursapartessentielpourlasignificationdel’œuvretoutentière:lacohésioninternedesonœuvre,c’estcelle-làmêmedelaComédie humaine,toutesproportionsgardées.Les illustres Françaises,c’estune«étoffequisetisse»devantlesyeuxdulecteur(coulet1967:314).
Bibliographie
challe1996:r.challe, illustres Françaises,présentationetnotespar Jacquescormieretfrédéricdeloffre,Librairiegénéralefrançaise,LeLivredepoche.coulet 1967:h.coulet,Le roman jusqu’à la Révolution, tome i:histoireduromanenfrance,paris:Librairiearmandcolin.
21Levocabulaireutiliséappartientauchamplexicaldelaviolence:«dur,barbare,violent,untigre,unebêteféroce…».

Les illustres françaises (1713) de Robert Challe: Entre tradition et modernité?
179
Nasl
e|e 19
• 2011 • 171-179
deloffre1959:f.deloffre,unmodepré-stendhaliend’expressiondelasensi-bilitédansleromanfrançaisdelafinduxviiesiècle,Cahiers de l’association internationale des études françaises,n°11,9-32.deloffre1967:f.deloffre,La Nouvelle en France à l’âge classique,paris:didier.deloffre2001:f.deloffre,unefondatrice:Lesillustresfrançaises,eighteenth-Century Fiction, transformations du genre romanesque auxviiiesiecLe,volume13,issue2,2001,article7.213-234.francalanza2001:e.francalanza,Laviolencedans lesillustres françaisesderobertchalle(1713),Imaginaire & Inconscient 2001/4,n°4,115-132.meletinski1996:J.meletinski,istorijska poetika novele,novisad:maticasrps-ka,biblioteka«koristirazonoda».rousset 1973: J. rousset,Narcisse romancier.essai sur la première personne dans le roman, éditionsJosécorti.rustin1966: J.rustin,L’Histoire véritable dans la littérature romanesqueduxviiiesiècle,Cahiers de l’association internationale d’études françaises18,89-102.
Tамара Валчић БулићЗНаМЕНИТЕ ФРаНЦУСКИЊЕ (1713) РОБЕРА ШАЛА:
ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНОСТИ?Резиме
Знамените ФранцускињеРобераШала(1659-1721),романкојијеимаовеликогуспехауЕвропитокомцелог18.века,широкачиталачкапубликаоткрилајепоновотекушезде-сетимгодинамапрошлогвека.Насредокраћиизмеђузбиркеновелаироманазбогсвојекомплекснеструктуре,оводелојеистовременоиплоддугетрадицијеипретходникро-манамодерногдоба,каоштосуроманиОпатаПревоа,Дидроа,Лаклоа,затимБалзакаиСтендала.
У овом раду пажња је посвећена прво полифоничној структури романа: настојалисмо да укажемона значај вишегласја, наративних гласова који семеђусобно допуњују,каоинаврлоснажнумеђусобнукохезијуприча;затимјереализамиприродностурома-ну,„романуакцијеистрасти“,названомчаки„варварским“,предметкраткеанализе.НакрајусмосезапиталиоулозиЗнаменитих ФранцускињаунастанкумодерногроманауФранцуској.
Примљено: 23. 02. 2011.


181
УДКрад
Marija Panić Faculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
ENTRE LA PuRIFICATIoN ET LA PuTRÉFACTIoN: L’EAu DANS LES BESTIAIRES FRANçAIS
MéDIéVAux
cetarticle traitede laprésencede l’eaudans lesbestiaires françaismédiévaux(xiieetxiiiesiècle)àtraversleurdescriptiondescompor-tementsdesanimaux,ainsiqueleursexplications.Lesliquidescorporelsapparaissantdanslecorpusinfluencent lavie(sonprolongementetsafin).L’eauestprésented’unefaçonapparemmentneutre(commeéten-dues,coursd’eauoufontaines),entantqu’habitatdesanimaux.toute-fois,l’eauparfoiscomportedesvaleursquiinfluencentlecycledelaviedes animaux. Lemilieu aquatique risqued’êtremême abject (chapitredel’ibis),puisqueplusieursstadesducycledelavieyfigurentàlafois.dans les interprétations, l’eau est leplus souvent explicitement liée ausacrementdubaptême,alorsquelesétenduessontdésignéescommelesincertitudesdecemonde.
Mots-clés:bestiaires françaismédiévaux,eau, ibis, foulque,milan,abjection
riches en sources1, les bestiaires français datant du xiie et du xiiiesiècleoffrentunemultiplevalorisationdesanimauxainsiquedumilieudanslequelilshabitent.L’eauydétientuneplaceimportante,étantdonnéqu’elleestprésentedansplusieurschapitres.nousnousproposonsd’es-quisser(d’unemanièrenullementexhaustive)unegammedevaleursat-
1 selonarnaudzucker(2004:25-28)lePhysiologosgrecque,ancêtredesbestiaires,estinfluen-céparlazoologieantique(aristote,ctésias,hérodote,plutarque,elien),l’ésotérismeégyp-tien,lamystiquejuive,l’exégèsealexandrineetlathéologiechrétiennedusalut;lePhysiologoslui-mêmea inspiré la littératurepatristiquegrecqueet latine(grégoiredenysse,basiledecésarée,ambroise).Lescompilationszoologiquesou lesencyclopédies(isidoredeséville,robinmaur,albertlegrand)témoignentd’unsavoirzoologiquedevenucommun.Lesbes-tiaires françaissontà leurtour inspiréspasdesversions latines.Leséditeursdesbestiairesfrançaisajoutentd’autressources;laversionlongueduBestiaireattribuéeàpierredebeauvais(quiajoutedenombreuxchapitresnouveau)est,seloncraigalexandarbaker,influencéparl’image du mondedegossouindemetz,elucidarium d’honoriusaugustodunensisetlaLettre du Prêtre jean (baker2003:44-134).

Panić M.
182
tribuéesàl’eaudanslecorpusexaminé:leBestiairedephilippedethaon(rédigévers1130),leBestiairedegervaise(audébutduxiiiesiècle), laversioncourteduBestiairedepierredebeauvais(avant1206),versionlongueduBestiaireattribuéeàpierredebeauvais(dontlarédactionsesitueentre1246et1260),Le Bestiaire divindeguillaumeleclerc(vers1210)etLe Bestiaire d’amourdericharddefournival(lesecondtiersduxiiiesiècle).
1. Liquides dans les «natures» des animaux et leur interprétationLesliquidesprésentésdansladescriptionducomportementdesani-
mauxsontnotammentlesliquidescorporels:sang,lait,semence,venin,salive.
depuis toujours présent dans les bestiaires (et entre autre, décritdanstouslesbestiairesfrançais),lechapitredupélicancompteparmidessymboleslittéraireschristiqueslesplusrenommés.cetoiseauressuscitesesoiseletsenlesarrosantdesonpropresang,issud’uneblessurequ’ils’estinfligée,aprèslesavoirpunispourleuringratitude;poursacharitéetpour sonsacrifice il est symboleduchrist.sonsangsortducorpspratiquementsous lesyeuxdu lecteur:«Le troisième jour, il s’ouvre leflancàcoupsdebecetsecouchesurlesoisillonsmorts,ilrépandlesangdesonflancsureux,etc’estainsiqu’illesressuscite»(pierredebeauvaiset al.1980:28),«(…)ilsoulèvesonaileets’ouvreleflancdesonbec,etdusangqu’ilenfaitjaillir,ilarroselespoussinsqu’ilatués,etc’estainsiqu’illesressuscite»(richarddefournival2009:219).Lesangapparaîtsousune formeexubérantechezunautreoiseau: l’hommeointpar lesangdelahuppe,oiseausymboledusoinpourlesparentsvieillis,serahantédanssesrêvesparlesdémonsquiluiferontpousserdescris(phi-lippedethaon120,baker2003:417).L’explicationenestquel’hommeesthantéparlepéché.danslesdeuxcas,lesangpermetlatransgressiond’unelimitefixe:entrelavieetlamort,entrelaréalitéetlerêve,lapaixetlestourments.
selonlatraditiondesbestiaires,labelettereçoitlasemencedumâleparlabouche,etenfanteparl’oreille(ouinversement,chezricharddefournival2009:179).Lasignificationenestquelesfidèlesreçoiventlasemencedelaparolededieu.celiquideestdoncincluscommeunfac-teurquimèneàlaprocréationetainsiàlacontinuationdelavie.
Lasalamandrechezphilippedethaon(97)esthabituéeàmonterlespommiersetàenvenimerlespommes;sielletombedansunpuits,elleenempoisonnel’eau.Lesserpentsfontpartieintégranteducortègedesanimauxdesbestiaires.sionestmordu,onmeurtimmédiatement,ouaprèsavoirgonflé,ouaprèsqueleserpentaitsucédusangdesavictime

Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux
183
Nasl
e|e 19
• 2011 • 18
1-192
(ayantdéposélavipèresursonsein,cléopâtremeurtdecetallaitement,enperdantdusang,philippedethaon103).
Lelaitmaterneln’estpasvisiblementprésentdanslesbestiaires.Lalicorne,s’apprivoisantuniquementdanslegirondelafilleviergedépo-séedanslaforêtparleschasseurs,estallaitéeparelledanslePhysiolo-gos (voirzucker2004:155). dans lesversions françaises, l’allaitementdisparaîtpourdonnerlieuàunerelationmutuelledanslaquellelabêteféroceestattiréeparleseindelavierge,ouparl’odeurdesavirginité.Lesbestiairesfrançaisaccentuentleseindelavierge,etnonpaslelaitexplicitement.(toutefois,sil’allaitementestpeuprésentdanslesbestiai-res,ilysubsiste,parexempledansletableauduhérissonquepierredebeauvaisdanslaversioncourtecompareàun«porceletencorenourriaulaitmaternel»,pierredebeauvaiset al.1980:30).
selonlaversionlongueduBestiaireattribuéeàpierredebeauvais,lasalivedel’hommeenétatdejeûnepeuttuerlecrapaudoul’araignée(baker2003:437).LamoelleducaladredansleBestiaire dephilippedethaonguéritlesyeux(112),cequiestdéchiffrécommelesacrementdubaptême.
ajoutonsuneautreapparitiondesélémentscorporels:chezpierredebeauvaisetricharddefournival, lechienremangecequ’ilavomietreprésenteleshommesqui,aprèss’êtreconfessés,retombentdanslepéché.
Lesliquides,faisantpartiedesnaturesdesanimaux,sontdoncparti-culièrementlesliquidescorporels.Leurimportancebiologiqueesténor-me,puisqu’ilsinfluencentlavieoulamort:ilsmènentàlaprocréation,ausoindelaprogéniture,àlamortouàlarésurrection.issusducorps,ilsviolentlalimiteentresondedansetledehors;dirigésversunautrecorps,uneautreentité,ilsinfluencentcetautrecorpsluiaussi.commel’indiquemarydouglas1994:122),cesontlesliquidesdangereux,ceuxquipeuventsouiller.toutefois,entantquefacteursbiologiques,cesli-quides ajoutent à une interactiondes animaux qui paraît ininterrom-pue.
2. L’eau dans les bestiaires: la géographie aquatiquecommeundesquatreéléments,présentaussidanslaBible,l’eaufai-
saitpartieduquotidienetdusavoirmédiéval.nousnousproposonsdesuivredeuxpistesde recherche:d’abord l’eau avec ses valeurs géogra-phiques(étenduesaquatiquesentantqu’habitatdesanimaux,oucoursd’eau, parfois nommés, et, d’unemanière plus rare, commeprécipita-tions).maisaussi,àcetteapprochegéographiques’ajouteuneautreréa-lité,celledesvaleursattribuéesàl’eau:selonlesinterprétationsexplicites

Panić M.
184
de l’allégorieetdans l’imageallégoriqueelle-même, l’eau(ou lemilieuaquatique)estpurificatrice,pernicieuse,oupeutrendre leschosesab-jectes.
2.1. eau comme étenduenombreusessontlesreprésentationsdesétenduesaquatiques,mais
plutôtentantqu’eaustagnante-merouétang–oucommefontaines.Les rivières sontplusprésentes comme les coursd’eaunommés,maisappartenantàununiverséloigné(quenil’auteurdubestiairenisonlec-teurneconnaissentdevue).L’étendueprésentéeest sans limites fixes,d’une profondeur qui n’est pasmesurée, dont l’intérieur reste caché2.L’eauestcomparéeauxincertitudesdecemonde;c’estexplicitementin-diqué,commeparexempledanslechapitreconsacréàlaserre:«Lamerestlesymboledenotremonde.»(pierredebeauvaiset al. 1980:26).demême, lamerde laquelle surgit labaleine représente lemonde.chezphilippedethaon(110), l’aiglevoitclair jusqu’aufonddelamer;unefoisencorelamerestinterprétéecommelemonde.
parpeurdudragon, l’éléphanteenfantedansunétang(oudans lamer).elleentredansl’eaujusqu’à«lahauteurdesmamelles»(pierredebeauvaiset al.1980:59),gardéeparl’éléphant.Leséléphantssontinter-prétéscommeadametevequisontchasséset«jetésdansl’étangpro-fondetdanslesvastesétenduesd’eaudecemonde,danslesgrandspérilsetlestourmentsquifonts’ynoyerbiendesgens»(pierredebeauvaiset al.1980:114).Lamerestunefoisencoreinterprétéecommelemonde:danslechapitresurleséléphantschezphilippedethaon,c’estdelamerquesortentlestempêtes,lespluiesetlemauvaistemps(quisignifieraientlarageetlespleurs).
Lareproductiondel’alérion,quin’apparaîtquedanslaversionlon-gueduBestiaire attribuée àpierredebeauvais (baker 2003: 408-410)dépendelleaussidel’eau.ceseigneurdesoiseauxpondsesœufsàl’âgedesoixanteans;aprèssoixantejoursdecouvaison,lesoiseletsnaissentetleursparents s’envolent, suivispard’autresanimaux,vers lamer,danslaquelleilsplongenttouslesdeuxetsenoient.Lesalérionsreprésententleshommesriches,lesdeuxœufssymbolisentlamortquiprendlecorpsetlamortquiprendl’âme;parlamer,ditl’auteur,ilfautcomprendrelefonddel’enfer.demêmepourleraphanay- luiaussiprésentépourlapremière foisdans laversion longue du Bestiaire attribuéeà pierredebeauvais–laprocréationnécessitelaprésencedel’eau:ilponddansla
2 surlemondeaquatiquedesbestiaires,voirJames-raoul2002.

Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux
185
Nasl
e|e 19
• 2011 • 18
1-192
meretlesoiseletsdemeurentàlasurfaceoudisparaissentverslefonddelamer.
parseslimitesdissimuléesetsonfondinconnu,uneétendued’eaudésignelemondeoùonrisqued’êtredésorienté;lescyclesdelaviepeu-vents’ydérouleroudépendredecemilieuaquatique.
2.2. eau comme repère géographiquetoutcomme lavilledehéliopolisdans lechapitreduphénix(cet
oiseauestparfoisaussisituéenarabie),l’indemajeureoùsontlesélé-phants,oul’indeoùsetrouvel’arbredespigeonsetdontlesdésertssonthabités par le griffon, les cours aquatiques esquissent une géographieimaginaire, fondéedans les textes sourcesdesbestiaires.aussi la fon-tainedel’aigleest-elleàl’est,larivièredesfourmissetrouveenethiopie,l’antulaboitdanslarivièreeuphrate,l’ibisestsituéprèsdunil,commelecrocodileoul’hydre,leraphanay habiteprèsdelamerarenoise.cesnomsnedécriventpasdavantagelesentitésaquatiques,maislesdotentd’unevraisemblance.
2.3. les précipitationsLe «savoir» atmosphérique ou climatique des animaux est spéci-
fique: l’autruche sait reconnaître,grâceàuneétoile, lemeilleur tempspourlaponte(aumoisdejuin,àcausedelachaleurdusoleil),lesfour-mis travaillent industrieusementpendant l’étépouravoiràmangerenhiver (gervaise précise que la fourmi sépare le froment de l’orge enaoût);l’éléphanteconçoitauprintemps,etlalouvemetbasenmai;l’ona-grebraiele25marspourl’équinoxe.Lesseulesformesd’apparitiondutempsatmosphériqueàpartcesbesoinsdenourritureoudeprocréationsont les tempêtes. La louve elle-mêmenemet bas que lorsqu’il tonne(mermier1977:89).unperroquetsagerestedanslaforêtetfuitlatem-pêtesachantquesesplumesenserontabîmées;unperroquetvilain,parcontre,nes’engardepasbienetrisquederestersansrefuge,commeunhommesurprisparlepéché,quiresteainsitoujoursaveclesdiablesdanslatempêtedel’enfer(baker2003:424-425).Lasirène,selonphilippedethaon (98), chante à l’apparitiondes tempêtes, etpleurequand il faitbeau (toutefois, elle séduit lesmarins quand elle veut se divertir). Lafoulqueplongelorsdestempêtesaugué.
on pourrait à la rigueur inclure la pierreunion chez philippe dethaon,quis’ouvrepourrecevoirlaroséecélesteets’uniràelle.
Letempsatmosphériquenefaisantpartiedudécordesdescriptionsdesbestiairesquerarement,onremarqueraquelestempêtesyjouentun

Panić M.
186
rôleimportantentantquefacteursquid’unemanièreprovisoirepertur-bentunsystème,sanstoutefoissembleryporterdegrandsdommages.
3. Les valeurs de l’eaudans lapartieprécédentedenotrearticle,nousavonsessayéd’es-
quisserlestraitsparlesquelsl’eausemanifestecommemilieuouétenduegéographique.toute créature étantnécessairementdotéed’une valeurchrétienne se prête à une interprétation. a ces valeurs apparemmentneutresde l’eau s’ajoutentcellesqui sontexplicitement,presquedès ladescription, teintéesd’unevalorisationchrétienne, l’unepositive (l’eauestsalubre)etl’autrenégative(l’eaureprésenteundanger).
3.1. une eau salubre partieintégrantedusacrementdubaptême,l’eauestliéeàcettesi-
gnificationdanslesexplicationsherméneutiquesdesbestiaires,oùsontnombreux les rappels aux chrétiens de se fier àdieu, dont la sagesseest reçuepar lebaptême.c’estdécritdirectement,oumentionnéche-minfaisantdanslesinterprétations(voirparexemplemermier1977:64,65,88,90).toutefois,danslesdescriptionsseules,c’estplusrarementlecasd’unemanièreexplicite.L’aiglerajeunit lorsqu’il trouvelafontaine:lorsqu’ildevientvieux,ilsebrûledevantlesoleil,puisils’envoleversl’estpourtrouverunefontaineoùilplongetroisfois;aprèscela,ilrajeunit.dans l’interprétation, l’eau est explicitement comparée à l’eaudu bap-tême,danslequellechrétienplongetroisfois:
prends garde, toi, chrétien, quel que tu sois, et toi, Juif ou païen, quies revêtu de tes vieux vêtements et dont les yeux du cœur sont pleinsd’inflammation: recherche la fontaine céleste dedieu, qui a dit: «celuiquin’estpasnéànouveaudel’eauetdusaint-esprit,celui-lànepeutpaspénétrerauroyaumedescieux.»celuiquiserabaptiséaunomdupère,dufilsetdusaint-esprit,etquiélèveralesyeuxdesoncœurversdieu,quiestlevraisoleildejustice,celui-làretrouveralajeunessetoutcommel’aigleetauraunevueaussiperçantequelasienne.(pierredebeauvaiset al. 1980:30)
Lecerfprenddel’eaudanssabouche,et la jettesurleserpentca-chédanssontroupourlepiétinerensuite.c’estlesignedelasagessedeparoledeJésus(«lafontainedelasagessedivine»,pierredebeauvaiset al.1980:54),etleserpent,ennemiducerfetreprésentantlediable,enpérit.L’eaudefontainedanslaquelleboitundragonchezgervaise(434)estpure,maisildoitvomiravantd’enboire;l’explicationenestquelesvraischrétiensdoiventseconfesseravantd’alleràl’église.

Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux
187
Nasl
e|e 19
• 2011 • 18
1-192
dans la version longue duBestiaire de pierre de beauvais (baker2003:443-444)ilexisteunarbredanslameroùviventlesoiseaux.s’ilstombentpar terre, ilsmeurent, tandis que s’ils tombentdans l’eau, ilssontsauvés.L’explicationenestqueceuxquinesontpaslavésparl’eaudubaptêmesontperdus.
danscesexemples,l’eauestexplicitementliéeàlafoichrétienneetl’influenceopéréeparl’eauestclairementvuecommesalubre.
3.2. une eau dangereuseLemilieuaquatiquepeutdissimulerundanger.celaarrivenotam-
mentlorsquel’eaun’estpasprésentéedanssonétatpur,maismélangéeàd’autreséléments.L’hydrequidéchirelecrocodiledudedanssecachedansdulimon.chezricharddefournival,lerenardsedissimuledanslamassecrééeparlabouedelaterrerougeafindetromperlesoiseaux,etparcetteruse,illesattrape.
dansladescriptiondel’antula,bêteférocedontlescorness’enlacentdanslesbranchesaprèsqu’elleabudanslarivièreeuphrate,cequilatue,l’eaudésigneexplicitementlevicedel’ivresse(philippedethaon);quantauxrameaux,ilsdésignentlesvicesducorps.Lasirènehabitedanslesbestiaires près de lamer (qu’elle soitmoitié femme,moitié oiseau oupoisson).
Lamerdissimulelabêtemarinebaleine,oulacovie;elleressembleàuneîledesable,cequiréussitàtromperlesmarins,quiymettentlefeu; alors la baleineplonge vers le fond, entraînant lenavire avec soi.demenuspoissonssonttrompéseuxaussi,cettefoisapparemmentavecplusdevolontédelapartdelabaleine:ilsluipénètrentdanslabouche(mermier1977:78).
dans le chapitreduchiendans leBestiaire depierredebeauvais,l’eau le trompe et il laisse tomber sonmorceaudepainoude viande:cette imagereprésente leshommes ignorantsoudépourvusderaison,quiperdentmêmecequileurappartientenconvoitantcequ’ilneleurappartientpas.
danscescas,l’eaureprésenteundangerpourlesanimauxprésentsdans les chapitres: soit elle dissimule ce qui représente unemenace àlavie,soitelleest liéeà l’utilisation(gustativeouauditive)dequelquechosedepernicieux.
3.3. une eau de putréfaction danslecommentaireduchapitredel’ibisdansleBestiaire divin de
guillaumeleclerc,charleshippeauconstate:«noustrouvonsicibien

Panić M.
188
maltraité l’oiseauque,pourdenombreuxmotifs, lesegyptiensavaientconsidéré commesacré» (hippeau1970:119).cetoiseau représentaitenegypteunefiguredubonsens,delasagessemême:ildétruisaitlesserpents,leursœufsetlesinsectes,laquantitédesanourrituredémon-traitsilaluneétaitdanssonpleinoudanssondécours,ilsavaitsepurgerlui-même(d’aprèshippeau1970:120-121),ou,ilsavaitprévoirlescruesdunil(selonzucker2004:225-228).toutefois,danslesbestiaires,ilestclairementetexplicitementdésignécommeimmonde.Ladescriptiondel’ibisparaîtimportantedanscesouvrages,puisqu’ellenemanquepasdeparaîtredanslesbestiairesfrançais(cetéchassierfigurantdanstouslesbestiaires,le Bestiaire d’amour dericharddefournivalmisàpart):no-tonsaussique lechapitreconsacréà l’ibisest toujoursd’une longueuraccentuée,quantàladescriptionainsiqu’àl’interprétation.voyons-enquelques-uns:d’abord,leBestiaire depierredebeauvais:
il existeunoiseauappeléybex3.de lui,physiologusdéclarequecen’estpasunoiseaupropre, car il vit exclusivementde charognesqu’il trouvesurlerivagedelamerouauborddescoursd’eau,etilrecherchenuitetjourlespoissonsmortsoulacharognequeleflotrejettepourriaurivage,cariln’osepaspénétrerdansl’eauparcequ’ilnesaitpasnager.etd’autrepart,ilnefaitaucuneffortpourapprendreànageràcauseduplaisirqu’ilprendàmangerdescharognes;pourcetteraison,ilnepeutallerdansleseauxprofondesoùlespoissonssontsains,etaucontraire,ilfuitleseauxpuresoùilpourraitvivreproprement(…).(pierredebeauvaiset al.1980:35-36)
ou,dansleBestiaire divindeguillaumeleclerc:ecoutezcequejevaisvousdired’unoiseau(aucunautrenepeutluiêtrecomparé) qui en latin est nommé ybex: je ne connais pas son nom enroman,maisilestdetrèsmauvaisevie:iln’enexistepasdeplussalenideplusmauvais.cetoiseauvittoujourssurlarived’unétangoudelamer,afindecherchers’ilpourraittrouverunecharogneoudupoissonpourri,carc’estdecettenourriturequ’ilserepaît.Lacharognequerejettelamer,homme,bête,poissonoumucosité,c’estcelaqu’ilattendouqu’ilmange,lorsque la charogne est parvenue jusqu’au rivage. L’ibis n’ose pas entrerdansl’eau,carilseraitincapabledenager,etilneveutpass’enpréoccuper,nimettredelapeineàapprendre,tantsanatureestmauvaise,ettantilestparesseux.affamé,ilattendauborddurivage.Jamaisilnepénétreradanslamer,ninemangeradubonpoisson.constammentils’attacheàl’ordure,carilnesesouciejamaisdepureté(…).(pierredebeauvaiset al. 1980:88)
apparaissentquelquesdonnéesdelaviedecetoiseau:
3 L’ibis(d’aprèsdeg.bianciotto).

Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux
189
Nasl
e|e 19
• 2011 • 18
1-192
1. L’ibisvitdansunespacemixte.Lesbestiaires lesituentprèsdel’eau(surlesrivagesdescoursd’eau,ouétangs,oumers);iln’estunoiseauniterrestreniaquatique.
2. ilnemangequede lapourriture (charognes,poissonsmorts).parseshabitudesalimentairesdecharognard,ilcompteraitsansdouteparmilescréaturesimpures.
3. il commet une transgression car il viole les habitudes alimen-tairesquiluisontinnées.ilpourraitmangerdelanourrituresaine,s’ilvoulaitapprendreànager.
4. toutefois, il semblecontentdanscetétatambigu, ilnemontrepasd’initiative.ildemeureainsidanscetétatmixte,dédoublé,non-dé-fini.
renforcépar l’environnementaquatiquedecetanimal, lesymboledel’ibisdanslesbestiairesestdéfiniparuneabsencedelimitesfermes.dans cette descriptionne figurent pas des cloisons étanches entre lesmilieuxterrestreetaquatique,entrecequiestsainetcequiestmalsain,entrelavraienatureetlaviedénaturée.cesymboleflotteentrelesenti-tésdésignéescommefermes,sansapparteniràaucuned’elles.L’eaupré-senteunedoubledimensiond’elle-même:sesprofondeurssontsalubres,rempliesdepoissonsain,etlesborduressontpourriesparlescharognesissuesdesesentrailles.cetteambigüitédel’espaceaquatique,oùunde-dansprofondestacceptableetpuralorsquesesbordures(contaminées,étantdesbordures)nelesontpas,ajoutentàl’atmosphèretroubledecechapitre.
danscecasnouspourrionsdésignerl’ibiscommeabject.Juliakris-teva:«ilyalà,dansl’abjection,unedecesviolentesetobscuresrévoltesdel’êtrecontrecequi lemenaceetqui luiparaîtvenird’undehorsund’undedansexorbitant,jetéàcôtédupossible,dutolérable,dupensable.c’estlà,toutprèsmaisinassimilable.»(kristeva1980:9)Lesformeslesplus rudimentairesde l’abjection sont, selonkristeva, ledégoûtd’unenourriture,d’undéchet,d’uncadavre.de toutemanière, c’estuneab-sencedesolidité,delimitesfixes:commeditkristeva,
cen’estdoncpasl’absencedepropretéoudesantéquirendabject,maiscequiperturbeuneidentité,unsystème,unordre.cequinerespectepasleslimites,lesplaces,lesrègles.L’entre-deux,l’ambigu,lemixte.(kristeva1980:12),
L’impropredemarydouglasetl’abjectdeJuliakristevasontcequipeutperturberunsystème;cequiexistedansleslimites,danslesambi-guïtés.représentantunsymboledéchu,ceblasond’animalsenourris-santd’orduressemblereprendretouteslesambigüitésd’unmondeàlafoisrégléetinconnu,explicableàlamanièrechrétiennemaisméconnu,

Panić M.
190
clairettroubleàlafois.selonarnaudzucker(2004:225-228),cesym-boleégyptiendesagesseestvisiblementdéchudanslechristianisme.
3.3.1.ibis,foulque,milan:abject/propre,outoutsimplementcharognardourapace
afind’examinerenquoilemilieuaquatiqueajouteàcetteabjectionde l’ibis, nous nous proposons de comparer trois oiseaux représentésdans lesbestiaires: l’ibis,charognardetaquatique(décritdanstous lesbestiaireshormis leBestiaire d’amour), le milan, charognardmais ter-restre(décrituniquementdanslaversionlonguedu Bestiaire attribuéeàpierredebeauvais),etla foulque,aquatiquemaispropre(présentedanstous les bestiaires excepté ceux degervaise et derichard de fourni-val).nouschercheronsàvoirenquoilafoulqueseprésentecommepuremalgrésonmilieuaquatique,ainsiquelesnuancesquirendentunmi-lan,charognard,moinsabject(siletermeestcomparable)qu’unibis.
Jevaismaintenantvousparlerd’unoiseauquiesttrèsbeauetpossèdedetrèsbonnesmanières.ildemeureconstammentaumilieudel’eau,etilesttrèsaviséettrèsintelligent.ildemeurecontinuellementsurlesétangs;ildisposesonnidaumilieudel’eauoubiensurlamer,entredespierres,dansunlieuinaccessibleàl’homme.ilrestetoujours,avecpersévérance,dansunseulendroit;ilnecherchepasuneseulefoisàlequitter,carilytrouvetoutcequiluiestnécessaire;etcependant,quandlefoulque4sentquedoitseproduirequelque tempête, alors il va se baigner àungué, y jouer etprendredesébats;puisilretourneàsademeure.ilnemangejamaisquedubonpoisson,etilnevitabsolumentpasdecharogne(…).(pierredebeauvaiset al.1980:103)
sil’habitatdelafoulqueestindiquédanslesbestiaires,c’estlasur-facede l’eauou lesrocs.toutefois,ellenefaitpas la transgression:cetoiseaunerésidepasdansleslieuxoùsemêlentdeuxmondes,oùs’opèreuneuniond’unemanièrepeuacceptable.ilnetransgressepasleshabi-tudesquiluisontpropres,ilnemangequedubonpoisson.ilestinter-prétécommehommesagefidèleàlaparolededieu.
Lemilan(escoufles)mangedel’ordure:phisiologes nos raconte che de sa nature, si dit que c’est uns molt ortoiseaus,car ilvitdemoltordecose:deratsetdesorris,etdeboiausdepoisonsetdebestes,etdetelsorduresqueongetehorsdesmaisonsdesbonesgens.quantcistoiseaxvoleetquiertsaproie,sicriesoventettornesoncoletregardetotenvoronluisorlaterreporveïrseilpeusttroverrat
4 dansnasvecherehesnousavonsrencontréetlaformeféminineetlaformemaxulinedunomfoulque.

Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux
191
Nasl
e|e 19
• 2011 • 18
1-192
ouboeloualtreordecaroignequeoneustgetéforsetqu’ilpeustprendretotabandoneement(…).(baker2004:527)
ce rapace et charognard, poussant des cris perçants, heureux detrouverdesboyauxd’animauxoudespourrituresquisontexpulséesdesmaisonspropres (oupieuses)est interprétécommediable. ilne laissepaslieuàuneexplicationsalubre;toutefois,ilnecommetpaslui-mêmeunetransgressionalimentaire,ilvitselonseshabitudesinnées.
L’ibis,quantàlui,nefaitqueflotterentrelesespacessolides:iln’estnicharognardnipêcheur,nioiseauterrestrenioiseauaquatique;selonl’interprétation,iln’estnidieunidiable,maisunhommepassifàl’égarddusalut.cetteimagenousparaîtunesynthèseducycledelavieélargi:puretéetnourrituresaine(profondeursde l’eau),besoindesenourrir(ibis),mortetdécomposition(poissonspourris),besoindesepurifier(l’eauelle-même,oulelavementdel’ibis),cequis’opèreàlafoisetcréeuneatmosphèreétouffante.ilparaîtaussiquelerapportquiexistesou-vententreplusieursélémentsdeschapitresdesbestiairess’opèreicientrel’ibisetl’eau,etqu’ilestmarquéparl’abolitiondeladistinctionrudimen-taireentrelededansetledehors,ainsiqueparlapassivité.
4. Conclusionnotrerecherchedémontrequel’eaudanslesbestiairesfrançaisporte
plusieurssignificationsetseprêteàunemultiplevalorisation.toutcom-melesliquidescorporelsquiinfluencentlecycledelavieetétablissentunlienentredeuxéléments(corpsvivants),l’eauparticipedanslecycledelareproduction(éléphant,certainsoiseaux),rajeunituncorps(aigle)ouestmeurtrièrepourunautre(serpent,crocodile).Lemilieutroubledurivageabritel’ibisainsiquesanourriture-poissonspourrisissusdel’eau–accentuantainsiunlienentreundedansetundehors,cettefoissous forme de stagnation. L’eau est souvent présente en tant qu’entitégéographiqueethabitatdesanimaux(mer,étang,fontaine),ainsiquere-présentativedeslieuxéloignés(rivièresquisontsouventnommées).Lesprécipitationsapparaissentellesaussisousformesdetempêtes.quantàl’interprétation,lesvaleursdel’eauoscillententreunevalorisationposi-tiveetsalubre(eaudubaptême,sagessedivine),etcellesoùelledésignelesinconstancesdecemonde.
Bibliographie
baker2003:c.a.baker,étude et édition critique de la version longue du bes-tiaireattribuée à Pierre de Beauvais,thèseparisivetphdrutgersuniversity.

Panić M.
192
douglas1994:m.douglas,Purity and Danger: an analysis of the concepts of pollution and taboo,London,newyork:routledge.gervaise,«LeBestiaire degervaiseéditéparpaulmeyer». <http://www.bes-tiary.ca/etexts/meyer1872/meyer1872.htm>.05.05.2010.hippeau1970:c.hippeau,le Bestiaire divin de guillaume, Clerc de Norman-die,genève:slatkine.James-raoul2002:d.James-raoul,inventaireetécrituredumondeaquatiquedans lesbestiaires in:d. James-raoul,c.thomasset (réd.):Dans l’eau, sous l’eau: le monde aquatique au Moyen age,paris:pressesdel’universitédeparis-sorbonne,175-226.kristeva1980:J.kristeva,Pouvoir de l’horreur. essai sur l’abjection,paris:éd.duseuil.mermier1977:g.r.mermier,Le bestiairede Pierre de Beauvais (version cour-te),paris:a.g.nizet.philippedethaon:thebestiaryofphilippedethaon,<http://www.bestiary.ca/etexts/wright1841/wright1841.htm>.05.05.2010.pierredebeauvais et al. 1980:pierredebeauvais et al:Bestiaires du Moyen age,misenfrançaismoderneetprésentépargabrielbianciotto,paris:stock+moyenâge.richarddefournival2009:richarddefournival,Le «Bestiaire d’amour» et la «response du bestiaire», publ., trad., présentation et notes pargabriel bian-ciotto,paris:honoréchampion.zucker2004:a.zucker,Physiologos: le bestiaire des bestiaires,grenoble:édi-tionsJérômemillon.
Марија ПанићОД ОЧИШЋЕЊА ДО ТРУЛЕЖНОСТИ: ВОДА У
ФРАНЦУСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ БЕСТИЈАРИЈУМИМАРезиме
Уовомеистраживањупроучавамостатускојиимаводауфранцускимсредњовеков-нимбестијаријумимаизxiiиxiiiвека.Честоприсутна,онапредставаљавидрудимен-тарнегеографијекаостаништеживотиња.Јављајусеиназивипојединихрекаилимора.Вредностикојеседодељујуводисуразнолике:одочишћења(светатајнакрштењаипо-ређењесаБожјоммудрошћу),прекоопасностикојаизњевреба,дотрулежностиизазор-ности(поглављеоибису).
Примљено: 23 .2. 2011.

193
УДКрад
Zorana KrsmanovićFaculté de philologie, université de Belgrade
LA DAMe Du LAc eT GALADrIeL: uN écho MéDIéVAL DANS LE sEIgNEUR DEs ANNEAUx
danscetravail,nousétudionslareprésentationdesdeuxfiguresfé-mininesimportantes,laféedameduLacdansleLancelot en proseetl’elfegaladrieldansleseigneur des anneauxdetolkien.nousanalysonsleursressemblancesetdifférences,ainsiquelesrôlesqu’elles jouentdanslesrécits,afind’examinersietcommenttolkienutiliselestechniquesmé-diévalesdelaconstructiondupersonnage,sansprétendreàconsidérerleromanmédiévalcommeunedesessources.Lesimagesdesadjuvantesmerveilleusessontambiguësetcomplexes,leurstraitséchappentauxlec-teursquisontobligésdelesrechercherdanslestextescomplémentaires.Lesprocédéslittérairesnesontpaslesseulséchosettracesmédiévauxdansl’œuvredetolkien.plusimportantencoreestlephénomènedemou-vancedestextes,unhéritageprécieuxdel’écrituremédiévale.
Mots-clés:dameduLac,galadriel,image,écrituremédiévale,litté-raturemouvante
Objectifs de la recherche, sujets et méthodesbeaucoupdechercheurssesontdéjàdemandés’ilétaitpossiblederap-procherleselfesdesféesmédiévales.1quiplusest,dansuneperspectiveplusgénérale,claireJardillier,quiaétudiécertainsaspectsdelaparentéentre l’œuvre detolkien et la littérature arthurienne, se trouve parmiceuxquiavaientremarquéunesimilitudeentrelafée,ladameduLac,et l’elfegaladriel (comp. Jardillier2007:148-149).pourtant, selon lesinformationsdontnousdisposons,lesujetintéressantdesliensentrecesdeuxpersonnagesfémininsn’apasencoreétéanalysésystématiquementetprofondément.c’estlaraisonpourlaquellenousavonschoisid’exami-nersietcommentJ.r.r.tolkienutilisel’héritagedel’écrituremédiévalepourconstruiresonpersonnagedansleseigneur des anneaux.
nostextesdebasesontleLancelot en prose,partiecentraleduvasteensembleromanesqueLancelot-graalouleCycle-Vulgate,dontlacréa-
1 v.parex.white-legoff(2007).

Krsmanović Z.
194
tion est située entre 1215 et 1230, et leseigneur des anneaux,œuvrecomplexedetolkien,médiévisteetécrivainanglaisdu20esiècle.nousnousréféronségalementàd’autrestextesdetolkienquinousontpro-curélesinformationssurgaladriel,ainsiqu’àsesmanuscritsposthumes,éditésparchristophertolkien.encequiconcernelestextesmédiévaux,notrerepèrecomplémentaireseraleromanfrançaismerlin en prose derobertdeboron,oùladameduLacestunefigureimportante.
Lebutdenotrerechercheestdetracerlespistesd’uneétudecom-paréesurl’elfegaladrieletlaféedameduLacquinousaideraitàcom-prendreleprocessusdecréationdel’imagedegaladrieldansleseigneur des anneaux,sansprétendreàconsidérerleromanfrançaisLancelot en prose commeune des sources d’inspiration directe de l’écrivain J.r.r.tolkien.nousproposonsunelectureimmanentedel’œuvretolkiniennequiviseàs’inscriredansuneréflexionsurlaréceptionetl’herméneutiquedelalittérature.nousobservonslesœuvreslittérairesanalyséescommedestextesouverts,enpartantdelaconstatationque«[…]lalittératureestunecommunicationdifférée,aléatoire(lesdestinatairesnepeuventjamaisêtreprécisémentidentifiésparl’auteur),etdèslors,lescodeses-thétiques(lesgenres)apparaissentcommedesmoyensdesurmonteroulimitercesaléasetcettedistance,etleurmiseenœuvre,commeunactedepragmatiqueindirecteouseconde»(fortier2002:465).
Analyse et résultats LanatureféeriquedeladameduLacestindubitable.outreladési-
gnationetl’explicationdunarrateur(micha1938:38)etdenombreusesétudesquitraitentdecesujet,entémoignentlesélémentssuivants:1)ledomaineaquatiquedanslaforêtaventureuse,lieudelamanifestationdumerveilleux,2)lablancheurdesonchevaletdeseshabits,3)sabeauté,jeunesseetsagesseextraordinaires,4)ledondelaprémonitionet5)lerôlededispensatricedesdonsmagiques.ilsnousontservidepointsré-férentielsprincipauxdansnotrecomparaisondelaféeduLacavecl’elfegaladriel.2
LadameduLacapparaîtlapremièrefoisdanslascènedel’enlève-mentdeLancelot(micha1980:38).Lenomdame du Lacrévèled’abordsonstatutsocial:elleestdésignéecommesuzerained’unfief,lacitéca-chéesousl’apparencedulacmagique(micha1980:44).enmêmetemps,leLacquis’attacheàLancelotsoulignesesdoublesorigines,humainesetféeriques,ainsiquelaparentéavecsamèreadoptive.Letitreféodaldela
2 ilestintéressantderemarquerquemyriamwhite-Legoffaretrouvédespointscommunssimilairesentrel’elfearwenetlaféemélusinedansl’articlecité(v.note1danscetravail).

195
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
3-20
2La dame du lac et galadriel: un écho médiéval dans le seigneur des anneaux
dameestencontrasteaveclavirginitédelafée,évidentedansleroman(elleaunamiqu’ellen’épousejamais)etconfirméedansd’autrestextesmédiévauxquisoulignentsaparentéavecdiane,ladéessevierge(comp.harf-Lancner2008:97-99).3
danslesconversationsoùlesmembresdelacompagnieévoquentleurséjourenLórien, ilsparlentrespectueusementetavecadmirationdelady galadriel, suzeraineduLothlórienetdupeupledesgaladhrim.pourtant, il serait faux d’attribuer au domaine elfique la valeur d’unquelconque fief médiéval, étant donné qu’un passage de l’histoire de galadriel et Celeborn souligneexplicitementquegaladrieletsonépouxn’ontpaschoisilestitresduroietdelareinequandilssesontinstallésenLórien(tolkien1998:317).Lordceleborn,leseigneurdeLórien,setrouveausecondplanparrapportàsonépouse,surtoutaprèsledépartdelacompagnie.ilestpossiblequeletitredelareinequegimliattribueàgaladriel,encomparantlabeautéduhelm’sdeepaveclaluminositédesesmains,traduisesonadmiration,peut-êtreaussisonamourpourelvish lady,comparableàl’amourcourtoisduchevalierpoursadame(tolkien1995:345,534).L’imagedegaladrielentantquereineelfiqueinvestied’unetâcheimportantedanslaguerredel’anneauetledestindelaterredumilieuestuneidéequiparaîts’êtredéveloppéelentementdansl’espritdetolkien,selonl’opiniondechristophertolkien(tolkien1998:294).4
Ledétaildelablancheurdeshabitsetduchevaldesdeuxfemmes,misenvaleurdanslesdeuxnarrations,n’estpasànégliger:c’estlacou-leurféeriqueparexcellence.Lenarrateurduseigneur des anneauxsouli-gnel’imagedelablancheuretdelalumièreparticulièreliéesàgaladriel,décritesdansdenombreusesscènes(grayhavens,mirrorofgaladriel,premièreapparitiondansletexteetsapremièrerencontreaveclacom-pagnie,swanboat),laquelleilévoqueetrépètedanslenomWhite lady(tolkien1995:345,363,503,664,1005etc.).L’insistancesurlacouleurblanchecommepartieintégrantedel’identitédel’elfeestcomparableàlacomposantesymboliqueimportantedel’identitédeladameduLac.dansladescriptionducortègedeladameduLacetl’armuredujeunebachelierLancelotavantl’adoubementdansleLancelot en prosedomi-nent les expressions liées à la couleurblancheet aux imagesde la lu-
3 v.égalementmicha1994:205;micha1980:41-43.4 «there is no part of the history ofmiddle-earthmore full of problem than the story of
galadrielandceleborn,anditmustbeadmittedthattherearesevereinconsistencies ‘em-beddedinthetraditions’;or,tolookatthematterfromanotherpointofview,thatroleandimportanceofgaladrielonlyemergedslowly,andherstoryunderwentcontinualrefashion-ings.»(tolkien1998:294)

Krsmanović Z.
196
mière,confirméesparlesenluminuresdanslatraditionmanuscritedelavulgatearthurienne(micha1980:258,266).
L’absencedeportraitdeladameduLacnenouspermetpasd’éta-blirunparallèlestrict.pourtant,étantdonnéquelemondeféeriqueesttraditionnellementconsidérécommeimmortel,cettecaractéristique lerapprochedeceluideselfes.galadrielest immortellecommetous leseldar; iln’estpasfacilededéterminersonâge, lesannées,paraît-il,nelaissentpasdetracesperceptiblessursonphysique(tolkien1995:534).Labeautéetlajeunessedelaféepeuventseliredansl’accumulationdesdésignations du type pucelle/demoiselle qui alternent avec celle de ladame,danslepassageoùlepersonnageestintroduitdanslanarration,oudansceluioùnouslisonslepointdevuedeLancelotquicomparelesqualitésdelareineetdesa«richedame»(micha1980:59,274).Letexteduseigneur des anneaux développeplusqueletextemédiévalcetteidéedelabeautédel’elfe,éternellementvivantedanslamémoiredesmem-bresdelacompagniedel’anneau.
L’étymologied’undesnomsdegaladrielseraitune jeune femme por-tant une guirlande éclatante(tolkin1993:472).5sinomen est omen,elleestprésentéecommeelfeauxcheveuxéclatantsetlumineux(=guirlan-de),d’unebeautééblouissante,admiréeethonoréetantparsonépouxcelebornquepar lenaingimli,«amoureuxcourtois»de ladameduLórien.Lescheveuxblondsetbrillantsentantquelieucommundelabeautédesféesmédiévalesbénéfiquesdel’occidentmédiéval,nelaisseaucundoute sur le fait quegaladriel soit une cousine lointaine de ladameduLac.
celan’estpas tout: leur ressemblancevaau-delàduphysique.Lesdeux personnages féminins de nos textes sont investis d’une sagesse,scientia,horsducommunetplusqu’humaine.entémoignentparexem-pleleurdonprophétiqueoubienl’aidequ’ellesapportentauxhérosprin-cipaux,Lancelot etaragorn,dans leurs entreprises.ainsi les «demoi-selles – avatars»6 de samère adoptive apparaissent-t-elles exactementlorsqueLancelotestsurlepointdecompromettresamissionetsavieensombrantdanslafolieouententantlesuicide,commesisa«deuxièmemère»avaitsucequisepassaitdansunespaceéloigné.celaestcom-parableà l’aptitudedegaladriel,doublede lamèremorte,às’adresseràaragornparlabouchedegandalf,quoiquespatialementéloignée,endevinantl’appuiqu’ildésireavantlabatailledécisiveduhelm’sdeep,oùilobtientàlafoisl’occasiondes’illustrerentantquechefdel’arméeet
5 v.l’appendixdusilmarilion,intitulé«dodatak,elementiukvenijskimisindarskimimeni-ma».
6 nousavonsempruntélesensdecettedésignationàharf-Lancner(2008:91).

197
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
3-20
2
d’assumerlaresponsabilitédeladéfensedesonpeupleentantqueroifutur(tolkien1995:759).sonpouvoird’agiràdistancepoursoutenirlamissiondel’autrehérosélusedédoubleetsemanifestedenouveauavecfrodo,dansl’épisodedushelob’sLair(tolkien1995:704).
ilseraitfauxdeprétendrequelafonctiondedispensatricedesdons,quepartagentladameduLacetgaladriel,jouelesmêmesrôlesdanslesrécits.pourtant,nousavonsremarquéquelesdonsparticuliers,offertsàaragorn,frodoetLancelot,sontintrinsèquementliésauprocessusdecréationdel’identitédeshérosprincipaux.LesaventuresoùladameduLacetgaladrielsontengagéesentantquefiguresmaternellessedérou-lent dans lesmondes instables et changeants sur lesquels pèse lame-naced’unegrandeguerreimminente.L’aideetl’appuiqu’ellesapportentàleursprotégéslesplusimportantspourlecoursdesévénements,soitl’histoire,sontparleuressencedemêmenature.sil’onacceptel’attitudeselonlaquellelaféerieagitenélémentrégulateurquiromptlesfiliationsacquises pour créer des héros vierges7, nous pourrions admettre quec’estlatâchequel’elfegaladrieldansleseigneur des anneauxpartageavecladameduLac.
nous ajouterions que le principe du choix des personnages prin-cipauxouprotagonistesserévèleégalementdifficileetréducteur,qu’ils’agisseduseigneur des anneaux ouduromanmédiévalLancelot en pro-se.nousavonsnéanmoinsétéobligésd’yrecourir,pournepasdépasserconsidérablementlecadredenotresujet.selonnous,cettemêmediffi-culté,voireimpossibilité,seraitundestraitsdistinctifslesplusimpor-tantshéritésettransmisdel’écrituremédiévaleromanesquedansl’œu-vredel’écrivainmoderne.
Leschémanarratifdel’exiletduretourduhérosdeJ.c.vonhahncontientquatreséquences(harf-Lancner1984:16):lanaissanceextra-ordinaireduhéros,sonenfanceobscureetcachée,sonretourtriomphal,sonaccessionàlaroyautéetsamortprématurée.8apart l’accessionàlaroyauté,lestroispremièressontcommunesàLancelotetaragorn:lesdeuxviventdansunmondeoùledangerpèsesurleurdestin,lesdeuxsont filsderoismorts,séjournentenexilésdansdespaysmerveilleux(Lacetrivendell-Lórien).L’enfanceetlajeunessed’aragorn,entantque«hérosélevéensecretdanslaforêt»(harf-Lancner2008:94)avantd’at-teindrel’âgeviril,peutsecomprendrecomme«uneformerationnaliséedel’enfanceféerique»(harf-Lancner2008:94)dujeuneLancelot.
7 citationempruntéeàharf-Lancner(2008:96).8 Leschémaestprisdeharf(1984:16).
La dame du lac et galadriel: un écho médiéval dans le seigneur des anneaux

Krsmanović Z.
198
alorsqueladameduLacassumelafonctiondefée-nourricièretou-teseule,elrondetgaladrielpartagentcettetâche.9aladifférencedeladameduLacquioffreauhérosuneautrevieenlesauvant,cerôleestas-suménonpargaladriel,maisparsonbeau-filselrond,substitutdupèred’aragorn.uneautredifférenceimportantenedoitpasêtrenégligée:ladamesupplantelamèrenaturelledeLancelot,alorsquel’elfen’estpaslamèreadoptived’aragorn,maisplutôtunsubstitutdemère.
grâce à leur «sagesse de cœur»10 l’elfe et la fée reconnaissent enfrodo/aragorn/Lancelotleurnaturedehéroshorspaire,vouésàundes-tinhorsducommundanslemondedesmortels.cependant,lesrésul-tatsdeleursinterventionsnesontpaslesmêmes:aragorn,vainqueurdesauron,finitparépouserlaprincesseelfiquearwenetdevenirroi.parcontre,Lancelotn’accèdepasautrôneetn’apasledroitdeparticiperauxaventuresdugraalàcausedesonamouradultèrepourlareinegueniè-vre,grâceauquelildevientleplusaccomplideschevaliersterriensetunpersonnagemythique.entantquesubstitutsdesmèresmortesouab-sentes,lesdeuxfiguresfémininesencouragentlesamoursdeleurspro-tégés,quidoiventleurservird’appuileplusfortdanslescombatsavecleursennemis.Laféeetl’elfedésirentvoirl’éluintégrédanslemonde,cequines’accomplitquedansunecertainemesure,parcequelesdeuxhé-rosportenttoujourslesmarquesdeleursecondenaturemerveilleuse.
L’héritierduroin’estpasleseulquinécessitelaprotectiondel’adju-vantemerveilleuse,lehobbitfrodoenaaussibesoin.cerôlesedédou-ble,galadrielprotègeleroietleporteurdel’anneau,deuxhérosdelaquête.Les«leçons»queladameduLacetgaladrieldonnentàLancelotetfrodoleurspermettentdeprendreconnaissancedeleurexistenceetde leurmissiondans lemondeet fonctionnentcomme«miroirsde laconnaissancesursoi-même»(cf.Longley2000:311-321).surcepointfrodoressemblesurtoutà l’enfantLancelot(cf.micha1980:248-256).Les doubles «enfantins» qui bénéficient de la protection de la femmemerveilleusedansleLancelot en prosesontLioneletbohort,deuxcou-sinsdeLancelot.
Lesnominationslady of lórien,lady of the Woodoulady of the elvessontgénéralementliésaudomainedupouvoirdegaladrieldanslaterredumilieu.danslecasparticulierdeshommesboromir,faramireteomer, ladésignationelvish lady témoigneausside lapeurque ladameduLórienettoutsonpeupleéveillentchezleshommes.boromirexprimesaméfianceenversgaladrieletsesbutsenévoquantleurpre-
9 oppositionnature-nourritureou inné-acquis/apprisdans lesœuvresmédiévalesest facile-mentapplicableàl’œuvretolkinienne,quipuisedanscefondslittéraireetculturel.
10nousemployonsl’expressiondanslesensqueluidonnem.white-legoff.

199
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
3-20
2
mièrerencontre(tolkien1995:345).sonfrèrefaramir,endépitdesonadmirationexceptionnellepourWhite lady,danslaconversationavecfrodoetsamdésignegaladrielcommeunesorcière,mistress of magic,belle,puissanteetdangereuseàlafois(tolkien1995:652,664).danssacomplainteàcausedelamortdesonfrère,ill’appellethe lady that dies notetconfirmel’imageinquiétantedel’elfequisaitliredanslescœursdesgens,dontlesmembresdelacompagnies’étaientdéjàrenducomp-te.11plustarddanslanarration,enaccusantgimlietsescompagnonsdelasorcellerieàcausedeleurséjourchezgaladriel,eomerprovoqueunequerelle avec ledéfenseurde l’honneurde ladameduLórien, lenaingimli(tolkien1995:422,429,513).L’interventionetl’attitudedegimlirappellentcellesd’aragorn,quiexposelamêmeidéedelabontédegaladrieletdesanaturebénéfiqueenvers lespeuplesnon-elfiquesdansunedisputeavecboromir,pendantleurséjourenLórien(tolkien1995:347,349).
tandisquelepouvoirdangereuxdel’elfeestmisenvaleurdansle seigneur des anneaux,lemêmetrait,sansêtreabsentduromanmédié-val,passe sous silencedans leLancelot en prose,mêmesi lenarrateuremploieletermedelanécromancieenexpliquantquelademoisellequienlevaLancelotétaitune fée(micha1980:38). ilnousestaussioffertunepréhistoiredeladameduLacquilalieàl’enchanteurmerlin.sonnomninienne,bientôtrévélé,suggèrefortementuneimageinquiétantede la fée,qui,devenueexperteenmagiegrâceà l’éducationdemerlinamoureux,emprisonnesonprécepteurdanslaforêtdedarnantes(mi-cha1980:39-43).12pourtant,dansLancelot en proseseul,l’imagedelaféeduLacestsurtoutliéeàsonrôlebénéfiqueentantqueprotectricedesonenfantLancelot.soncaractèreinquiétantréapparaîtetprendtoutesavigueurdansunautrepersonnageféeriqueducyclearthurien,laféemaléfiquemorgane.
Conclusion et discussion
tantdanslecasdeladameduLacquedansceluidegaladriel,l’am-bigüitéfondamentaledeselfesetdesféesestuntraitpertinentdesprin-cipalesnarrationsexaminéesoùlesdeuxpersonnagesféminins jouent
11v.tolkien(1998).12Le romanmédiéval enprose,merlin derobertdeboron,donneuneversiondétailléedu
contesurmerlinetninienne,enchangeantsonnomenviviane(v.micha1994:205-214.).viviane,élèveaiméedel’enchanteur,réapparaîtaussidansleCycle de la post-Vulgatedes14eet15esiècles(v.micha1994:221-225).
La dame du lac et galadriel: un écho médiéval dans le seigneur des anneaux

Krsmanović Z.
200
lesrôlesbénéfiquesquisontparleuressencelesmêmes:protectricesetadjuvantesdesforcesdubien,deshérosetdeleursmissions.Leurstraitsinquiétantssontplussaillantsdanslestextescomplémentairesauxquelsnousfaisonsréférencedanscetravail.notreanalyse adémontréqueleseultexteduseigneur des anneauxnesuffitpaspourquelelecteurpuis-seformeruneimagedel’elfe,demêmequeleseulLancelot en prose serévèleinsuffisantdanslecasdelafée.Lesdeuximagesdespersonnagesfémininsmerveilleuxquis’offrentauxlecteurssontcomplexesetambi-guës,d’unestabilitérelative.uneparentéentrelesféesmédiévalesetleselfesexistesansaucundouteetelleestencoreàexplorer,étantdonnéquetolkienempruntelescaractéristiquesspécifiquesdesféesmédiéva-lesqu’iltransformeetadaptedanssesœuvres.
uneévolutionduprocessusde lacréationcheztolkienestvisibledansl’interactiondesesproprestextesoùl’auteur,commeartiste,choi-sitdescouleurs-traitsdecaractèredynamiquementinstableduperson-nagedegaladriel,qu’ils’efforcedemettreenvaleur,toutenpuisantdansles fonds de l’héritage littéraire et de l’imaginairemédiéval. Lemêmephénomènedecommunicationentre les textesexiste,d’uneautrema-nière,dans leromanfrançaismédiéval: l’auteur-architecte(oubien lesauteurs) construitlaféeduLacenpuisanttantdanssonpropretextequedanslesfondsdelatraditionmythologique,folkloriqueetlittérairedumoyenâge.L’intérêtdesconjointuresquinaissentcommerésultatdessourcestextuellesplurielles,ainsiquelegoûtpourlesdétailssignifiantsqui fonctionnentcommesignespour le lecteurengagédans la lecturedutexte,enquêtedusensdurécitetdel’identitédupersonnage,sontlescaractéristiquesdesœuvresmédiévalesquirenaissentdansl’universdel’œuvredeJ.r.r.tolkien.quelquearbitrairequepuisseparaîtrecetteattitude,noussommesd’avisquetolkienécritenécrivainmédiévalgrâ-ceàl’innutritiondesprincipesdel’écrituredesromansmédiévaux.Lesétudesminutieusesduphénomènequenousvenonsderepérerdanscetravailpeuventoffrirdenouvellesréponsesàl’interrogationsurlerôledel’écrituremédiévaledansl’œuvredetolkien.
malgréladistancetemporellequisépareleromanmédiévaldel’œu-vredu20esiècle,malgrétouteslesdifférencesduesauxnarrationsdif-férentes, lareprésentationdegaladrielquenousavonscomparéeaveccelledeladameduLacestd’unegrandeimportancepourlaréceptionduseigneur des anneaux.Lelecteurquisuitlestracesquelesécrivainsnouslaissentdansleursmanuscrits,livresoutextes,estàmêmed’oubliers’il lituneœuvremédiévaleoucontemporaine.Ladistancetemporelleestlimitéeouaboliegrâceàl’artd’écrire.anotreavis,lephénomènedemouvancedes textesmédiévaux,définiparpaulzumthor comme«le

201
Nasl
e|e 19
• 2011 • 19
3-20
2
caractèredel’œuvrequi,commetelle,avantl’âgedulivre,ressortd’unequasi-abstraction,lestextesconcretsquilaréalisentprésentant,parlejeudesvariantesetremaniements,commeuneincessantevibrationetuneinstabilitéfondamentale»(zumthor1972:610),estplusuniverselqu’onnepense.ilsepeutquelephénomènesoitapplicableaux«livres»écriteset imprimésàdesépoquesqui sontplusprochesde lanôtre.peut-ondoncparlerd’une«littératuremouvante»?peut-onaffirmeraveccerti-tudequelaformeécritedutexten’estpasunegarantiedesastabilité?Lephénomèned’œuvreouverte,ouplutôtdetexteouvert,estperceptiblemêmedansnotreétudeducasdel’elfegaladriel,quineprétendpasàl’exhaustivité.cesaspectsdel’œuvre,ànotreavis,contribuentàcequeleslecteursressententce«parfumparticulier»13,cesubstratmédiéval,etnonseulementarthurien,toujoursprésentdansl’universdetolkien.
Bibliographie
aronetal.2002:p.aronetal.dictionnaire du Littéraire,paris:puf.bourgeois2003:c.bourgeois,Le seigneur des anneaux entre épopée arthurien-ne et essai sur les mythologies,htpp://www.pourtolkien.free.fr/recherche/bour-geois_introduction.html20.06.2010.harf1984:L.harf,LancelotetladameduLac,Romania,417,paris:sociétédesamisdelaromania,16-33.harf-Lancner2008:L.harf-Lancner,Le monde des fées dans l’occident médié-val,paris:hachetteJardillier2007:c.Jardillier,Leséchosarthuriensdansleseigneurdesanneaux,inLeocarruthers(dir.):Tolkien et le Moyen Âge,paris:cnrséditions,143-169.Longley2000:a.p.Longley,theLadyoftheLake:Lancelot’smirrorofself-knowledge,in:kbusby(éd.),Por le soie amiste». essays in Honor of Norris J. lacy,amsterdam-atlanta:editionsrodopib.v.,311-321.micha1980:a.micha,lancelot. roman en prose du XIIIe siècle(éd.critique),tomevii,genève:droz.micha1984:a.micha,lancelot, roman du XIIIe siècle,bibliothèquemédiévale10/18,tome2,paris:uniongénéraled’éditions.micha1985:a.micha,lancelot, roman du XIIIe siècle,bibliothèquemédiévale10/18,tome1,paris:uniongénéraled’éditions.micha1994:a.micha,robert de Boron: Merlin. roman du XIIIe siècle,paris:flammarion.tolkien19953:J.r.r.tolkien,the Lord of the Rings,glasgow:harpercollinsPublishers.
13L’expressionestempruntéeàJardillier(2007).
La dame du lac et galadriel: un écho médiéval dans le seigneur des anneaux

Krsmanović Z.
202
tolkien1998:J.r.r.tolkien,the unfinished tales,London:harpercollinsPu-blishers.tolkin19882:dž.r.r.tolkin,gospodar prstenova. Družina prstena,beograd:stilos.tolkin19882:dž.r.r.tolkin,gospodar prstenova. Dve kule,beograd:stilos.tolkin19882:dž.r.r.tolkin,gospodar prstenova. Povratak kralja,beograd:stilos.tolkin1993:dž.r.r.tolkin,silmarilion,beograd:esotheria. white-legoff2007:m.white-legoff,arwenetmélusine,amoureusesfééri-ques,ina.besson:actes du colloque de CrelID, Fantasy: le merveilleux médié-val aujourd’hui,etmyriamwhite-legoff(éd.),paris:bragelonne.http://www.modernitesmedievales.org/articles/myriam%20white%20Le%20goff%20/arwenm%e9lusine.pdf20.06.2010.
Зорана КрсмановићГОСПА С ЈЕЗЕРА И ГАЛАДРИЈЕЛА: СРЕДЊОВЕКОВНИ
ОДЈЕК У ГОСПОДаРУ ПРСТЕНОВаРезиме
Уовомрадупроучавамоприказивањедвејузначајнихженскихфигура,вилеГоспесаЈезерауЛанселоту у прозиивилењакињеГаладријелеуТолкиновомГосподару прстенова.Анализирамоњиховесличностииразлике,каоиулогекојеиграјууприповестима,какобисмовиделидалиикакоТолкинкористисредњовековнетехникеконструисањалика,безнамередапосматрамоовајартуријанскироманкаоједанодњеговихизвора.Сликечудеснихженапомагачасунеодређенеисложене,њиховаобележјаизмичучитаоцимакојиморајудаихтражеудодатнимтекстовима.КњижевнипоступцинисујединиодјециисредњовековнитраговиуТолкиновомделу.Јошзначајнијијефеноменпокретљивоститекстова,драгоценонаслеђесредновековногписања.
Примљено: 31. 01. 2011.

203
УДКрад
Jasmina NikčevićFaculté de philosophie - Nikšić, université du Monténégro
LES REPRÉSENTATIoNS DE LA cuLTure Grecque De 1780 à 1830
nousesquissons ici la formidablemutationdes représentationsdelagrèce des Lumières auromantisme. Les dichotomiesgrèce classi-que/grècemoderneasservie,grèceclassique/grècemoderne insurgéepuis indépendante sedéploientdansun imaginairequinecessede sedéconstruireetdesereconstruire.ettoutcecidansuncontextegéogra-phiquementambigu, impliquant toujours,de larévolutionfrançaiseàlamonarchiedeJuillet,d’inévitablesdécalages.ilsembledoncque,delarenaissanceàwinckelmannetdewinckelmannànosjours,lagrèceseprésentetoujourscommeespaceàredécouvrir,àrelireetparlàmêmeàreconstruire.delarenaissanceàl’âgeclassique,lesréférencesàlagrèceantique,àsonart,àsaphilosophieavaientfédérélescoursetleséliteseuropéennes.
parsesréférencesrécurrentesàathènes,àsparteetà laromeré-publicaine, larévolution françaiseavaitcherchéàoffriràuneeuropedominéeparses«tyrans»uneculturepolitiquecommune.Lasaturationdecesréférencesavaitaussi,ilestvrai,provoquéunrejetquel’onavaitpu croiredéfinitif, dumoinsdansunefrance condamnant laterreurrévolutionnaire.maisilyeutaussil’insurrectiongrecqueetledévelop-pementduphilhellénisme.cepremiermouvementdesolidaritéeuro-péenetmêmeinternationalavecunpeupleenluttepourlerespectdesesdroits,nousainterpellés.unespacedesolidaritévoiteneffetserejoin-dredeshommesquetoutoppose:l’âge,lepassépolitique,leschoixin-tellectuels,philosophiques, littérairesetartistiques.Lesreprésentationslespluscontradictoiress’ycôtoient:grèceclassique,etpaïenne,grècemoderne,chrétienneoulaïque,entoutcas,martyreethéroïque.
Mots-clés:grèceantique,grècemoderne,révolutionfrançaise,in-surrectiongrecque, indépendance,philhellénisme,chateaubriand,de-lacroix
enproposantl’étudedesreprésentationsdelagrèce–grèceentenduedanssadoubleacception:antiqueetmoderne–j’aisansdouted’abordréponduàdes impulsionspersonnelles, liéesàmaproprehistoireetàl’histoiredemagénération.acettedimensionpersonnelleetfamiliale,

Nikčević J.
204
donc affective, s’ajoutait la conscience d’une relation paradoxale: parl’histoire–lalonguehistoirepolitique,culturelleetreligieuse–,lagrècenousétaitprochemaisl’histoirecontemporaine,depuis1945,avaitin-troduitbiendesdistancesetdesséparations.
mesétudesde langueet littératurefrançaisesm’avaientconduiteàconstater,dumoinsdanslesœuvresquejeconnaissais,laquasiabsencede lagrècemoderne avantchateaubriand et surtout avanthugoquidansunrecueildepoésiesdontletitre–Les orientales–sembledissou-drelagrècedansl’ensembleplusvastedel’orient.
L’analysedesreprésentationsdelaculturegrecqueauxviiiesièclemontreque,danslesannées1780,dansledomainelittéraire,lecontactaveclagrèceantiqueestévidemmentuncontactmédiatisé.etlesmé-diationssontaumoinsaunombrededeux:ils’agitd’aborddelagrècetellequeromel’areconstruite,réécrite;ils’agitensuitedelagrècerevueparlexviiesiècleet,pourl’essentiel,parracine.
pourlapremièremédiation,biendesamalgamesetdesconfusionsjouententreathènes,sparteetrome:lesdémocratiesgrecquesantiquessont leplus souvent associées à larome républicaine et aux épisodeslesplusglorieuxdesonhistoire.cetamalgamenevautpasquepourlafrance.alfieri,legrandpoètedramatiqueitalien–deculturefrançaiseilestvrai–dontlesouvragesproprementpolitiques,dela Tyrannieetdu Prince et des Lettressontmarquésparl’admirationpouruneromerépu-blicaineexigeantequisembleseconfondreavecsparteparsondoublesoucidelibertéetdejustice,voired’égalité,expliquesonextrêmesensi-bilitéauxgrandsmodèlesdel’antiquité–grecsetromainsconfondus,ensoulignant l’importancede la lecturedeplutarque.L’amalgamedesmodèlesdémocratiquesethéroïquesgréco-latinssembleainsiavoirjouémassivementdanslasecondemoitiéduxviiiesiècle.madameroland,danssesmémoires particuliersrédigésdanslesprisonsdelaterreuràlaveilledesonexécution,en1793,évoqueraencesenssadécouverteexta-siée,quandelleétaitenfant,deplutarque.
pourmadamerolandetpouralfieri–dans laproblématiquequiestpropreàchacun–,ils’affirmelesoucidedépasserl’exaltationconfusedecesmodèles,indissociablementpolitiquesetéthiques,d’uneantiquitéoùlesrépubliquesgrecquesetlarépubliqueromaine,sontpratiquementsuperposées,voireassimilées.
intervientaussiladeuxièmemédiation,celledelavisionraciniennedelagrèce.maiscettemédiation,lavisionraciniennedel’antiquitégrec-que,impliquedepluslerelaisdevoltairetragédien.L’oeuvredevoltaire,etnotammentl’œuvrethéâtrale,aiciuneimportancemajeure.c’estparl’intermédiairedecetauteur(pourqui«l’antiquité,étaitsurtoutlexviie

Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830
205
Nasl
e|e 19
• 2011 • 20
3-214
siècle»),quej’aimesurél’importancedesmédiationsraciniennes.vol-tairepourtantn’hésitaitpas,dansl’undescatéchismesdudictionnaire philosophique(le Catéchisme du jardinier),àesquisserlestraitsd’ungrecphilosophe,indifférentauxavaniesdel’oppresseurturcfanatique.
L’Œuvredewinckelmann est à tous égards refondatrice: de l’his-toiredel’artetdel’archéologiecommenouslesavonstous,maisaussidecetampleetdynamiquemouvementeuropéen(ilembrasseaussilesjeunesetats-unis)qu’estlenéoclassicisme,quicouvriralesetatslesplusdivers demonuments d’inspiration grecque, de sculptures demarbreblancetdebronze.Œuvregénératricedenouveauxregardssurlagrèceelle-même et ses colonies (le sud de l’italie et la sicile), de nouveauxvoyagesengrèce-mêmeoù les inventairesdesruinesalternerontaveclesconstatsdesravages«modernes»deladominationottomane.winc-kelmann recommande une connaissance des œuvres antiques qui lesmetteenrelationavecleurcontexte(géographique,religieux,politique).cetteconnaissancenepeutselonluiqueconduireàlareconnaissancedeleurstatutdemodèleinsurpassable.
ilyauratrèsvite,commel’attestelesuccèsduVoyageen grèce du jeune anacharsisdel’abbébarthélémy(1788),unemodegrecquequiem-brasselecostumecommel’ensembledesartsdécoratifs.principalauteur,cegrandconnaisseurdelagrèceantique,grandlinguisteetconnaisseurnotammentdes langues arabe ethébraïque, antiquaire et érudit avantd’entreprendreune étude systématiquede la littérature classique,bar-thélémyafaitlechoixdelafictiontoutenmobilisantàsonservicesesamplesconnaissancesdupassédelagrèce.publiéen1788àl’issuedetrenteannéesd’études,leVoyage du jeune anacharsis,romanhistoriqueetrécitdevoyage,connutunimmensesuccèsetajouéunrôleimpor-tantdansladiffusiondesreprésentationsdelagrèceàlaveillemêmedelarévolution.(La«garde»delabibliothèquenationale(aveclamissiond’«accueilliretinstruirefraternellementlepeuple»)estdoncrestituéeàbarthélémyparcequecelui-ciaurait su lui-mêmerestituer,avecsonVoyage du jeune anacharsis, lesmodèlesrépublicainsdelagrèceanti-que,mêmesicetteannexionrévolutionnaireduVoyage du jeune ana-charsis,cettelecture«républicaine»del’œuvren’étaitpasfondée).
barthélémydonneunensembledereprésentationsplusspécifiquesdupeuplegrec,desontempéramentprésentécommebienparticulier.c’estprécisémentcettesensibilitétrèsoriginalequiauraitpermisquelespeuplesdelagrèceaienteuunehistoireaussiconvulsive,lesconduisantendespériodessibrèvesdelagrandeuràladécadence.
dans legrand dictionnaire demoreri et bien sûr, dans l’histoire d’une grecque modernedel’abbéprévost,lesgrecsmodernesapparais-

Nikčević J.
206
sentdonc,tantparleursituationpolitiquequeparleurhistoirepropre,d’unedéroutantesingularité.chrétiens,maisfoncièrementorientauxetopprimés,ilsconstituenttoutàlafoislemêmeetl’autre.poureux,iln’estaucuneperspectivederésurgencelibératrice,deruptureavecleurservi-tude.Lesdescendantsdespeuplesinventeursdelalibertésemblentainsipromisàjamaisàlaservitudequilesalièneetlesmodèle.
ainsicegoûtde lagrèceetplusglobalementde l’antiquité,om-niprésent d’un bout à l’autre du siècle, n’implique nullement, bien aucontraire,unaveuglementàl’égarddesdonnéescontemporaines.
maisc’estsansdouteenpoésieque leretourà l’antiqueest leplusimmédiatementetleplusmassivementperceptible.
Legoûtde lagrècechezandréchéniers’inscrit indubitablementdanscetteproblématique,mêmes’il revêtdeplusunedimensionper-sonnelleetaffective(andréchénierestnéàistanbuld’unpèrediplo-mateetd’unemèrequisedisaitgrecque).etmêmesicegoûttrèsfortparticipeaussidel’hellénismeambiant,andréchénierpréconisel’imi-tationdesanciens.
cetteimitationestselonluilaconditionsinequanonde«l’inven-tion»(c’estletitremêmed’ungrandpoèmelaisséinachevé)deformespoétiquesnouvellesetdontlabeautépourraêtrecomparéeàcelledeschefs-d’œuvreantiques.chénierambitionnedemettreenverslagran-deuretlespréoccupationsdelamodernité.
LesthèmesphilosophiquesdesLumièresvontenfaittrèstôts’intro-duiredanslespoèmesinspirésdel’antiquité:avecnotammentdénon-ciationdudespotisme,delatyrannieetdel’esclavagequ’ilsinduisent.1
deplus,pourandréchénier,lechoixdelagrèces’inscritaussidansunrefustrèsnetduchristianisme,refushéritédesLumières.
onsaitcommentlesrévolutionnairesontmultipliélesréférencesàl’antiquitéetàsesmodèlespolitiquesdémocratiquesgrecsetromains.et ceci pardelà les clivages.projets de calendrier, vêtements, arts dé-coratifs,misesenscènefestivesauxquellesasouventprésidélepeintredavid:toutattestequel’identificationauxcitésdémocratiquesantiques,etnotammentgrecques,auxcitoyenshéroïquesd’athènes,desparteetderomeajouéàpleindurantlarévolution.
cerêved’unerégénérationdansetparl’artaunedimensioneuro-péennetransnationale.Leretouràlagrèce,àsesformesetsesvolumesseveutretourauxleçonsd’unartvéritableparcequeprimordial,quin’apasconnuantérieurementl’écrancorrupteurd’autresmodèles.
adversairepolitiqueet idéologiquedeLaharpeau lendemaindethermidor,marie Josephchénierdont lepassé jacobincontrastesin-
1 cf.l’amplepoèmeinachevéHermès.

Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830
207
Nasl
e|e 19
• 2011 • 20
3-214
gulièrementavecladissidenceirréductibledesonfrèreandré,saluelecourscompletdeLaharpeetsollicitemêmepourl’ouvrageunprixdel’académiefrançaise.danssonanalyse du lycée de la Harpe,marieJo-sephchénierdénoncecependantavecvirulencelapartialitédeLaharpeàl’égarddelaphilosophieduxviiiesiècle,àl’égarddu«philosophisme»qu’ilaccused’êtreresponsabledelaterreurrévolutionnaire.
m.J.chéniersemetainsienscènecommegardienvigilantdel’hé-ritageantiquetantauniveaudesformesquedesthèmesetdesvaleurséthiques,philosophiquesetpolitiques(lesvaleursdémocratiques).
sapiècetimoléon quiexaltelefratriciderépublicain(timoléonéli-minesonfrèretimophanequiavouluabolirladémocratieàsonprofitpuisqu’il«prétendàl’empire»)constituaauxlendemainsdethermidorunepièceàchargedansleprocèsquecertainsjournalistesfirentàm.J.chénierjacobinet«nouveaucaïn»àproposdel’exécutiondesonfrèreandré.encetempsderévolutionetjusquesousl’empire,l’œuvredra-matiquedemarieJosephchénier(dontunpersonnage,levieilortago-rasévoquelagrèceberceauetfoyerdelalibertéetdel’égalitéàtraverslesâges),témoignedoncpleinementdel’auraetdelaprégnancedesmo-dèlesdémocratiquesdel’antiquitégrecque.
L’analysedel’œuvredechateaubriandmontreunvéritabletournant,mêmesilerapportquis’ydessineàlagrècedemeureambigu.
chateaubriand,dèssespremièresœuvresà lafindelarévolution(l’essai sur les révolutions, le génie du christianisme)refuselesmodèlesdémocratiquesgrecsdesannéesrévolutionnairesetdénoncelasatura-tiondecesréférencesàl’antiquitépolitiquequiontautoriséleplussou-vent la violence arbitraire.cependant, lamagiede ces références agittoujourssurchateaubriand,commeentémoignentles Martyrs,l’itiné-raire deParis à jérusalemet,bienplustard,lesoutienrésolumentpoliti-queetlaïcàlagrèceenluttepoursonindépendance.
à l’opposé donc demarie-Joseph chénier et de son discours demagnificationdes cités grecques antiques (qui a en fait valeur d’élogedelarévolutionfrançaiseetdeseshautsfaits),chateaubriandmontreenfaitquelarévolutionfrançaisenedoitnullementêtreassimiléeauxrévolutionsqui ontpermisd’ «établir les républiques» engrèce, auxrévolutions fondatricesdesparte etd’athènes etqu’elle est infinimentplusprochedelaseconderévolutiongrecquequiaprécipitélescitésdé-mocratiques, conquisesparphilippedemacédoine,dans la servitude.Leroiagisdesparte,exécutéauxcôtésdesamèreetdesonaïeulepouravoirtentéderétablirladémocratie,estquantàluiassimiléàLouisxvi.Lejeudecomparaisonsdelarévolutionfrançaiseaveclesrévolutionsgrecquesperturbeainsilesreprésentationscommunémentreçues.pour

Nikčević J.
208
chateaubriand,lafrancerévolutionnéen’arienàvoiravecathènesetsparteàleurapogée:elleest,selonlui,beaucoupplusprochedecescitésquandellesatteignentleurphasededécadence.
chateaubriandprocèdeenfaitàunecomparaisonsystématiquedesculturesantiques(aupremierrangdesquellessetrouvebiensûrlacultu-regrecque)etde laculturechrétienne.ilaffirmed’abordquedans lesdomainespolitiqueetéthique(ch. IV.des lois morales ou du décalogue)lechristianismeaunevocationàl’universalitéquen’ontjamaisprésentéelesreligionsdel’antiquité.
L’inférioritédelareligiongrecqueestparticulièrementsoulignée.aproposdudimanchechrétien,chateaubriandécrit:
Lagrèce,pourtantsipoétique,n’ajamaissongéàrapporterlessoinsdulaboureuroude l’artisanàces fameux instantsoùdieucréa la lumière,traçalarouteausoleil,etanimalecœurdel’homme.(chateaubriand1847:69)
Lesœuvresmêmesdevoltaire-pourtantennemidéclaréduchris-tianisme – permettent la même démonstration: seul le christianismeconnaîtlespassionsparceque,àladifférencedesreligionsantiques,ils’opposeàelles.Lusignan,levieuxcroisédeZaïre,latragédiedevoltaire,estinfinimentsupérieurdanslaconstructionmêmedesoncaractère,auPriamd’homère.etchateaubriandsemblesedélecterdefairedel’œu-vredеvoltaireunargumentmajeurenfaveurdelasupérioritéduchris-tianisme:
une religion qui fournit de pareilles beautés à son ennemi mériteraitpourtantd’êtreentendueavantd’êtredamnée.L’antiquiténeprésenteriendecetintérêt,parcequ’ellen’avaitpasunpareilculte.Lepolythéismenes’opposantpointauxpassions,nepouvaitamenercescombatsintérieursdel’âme,sicommunssouslaloiévangélique,etd’oùnaissentlessituationslesplustouchantes.(chateaubriand1847:216-217)
mais c’est évidemment dans un texte dont le titre ne nommepaslagrèce:L’itinéraire de Paris à jérusalemquelagrèces’imposeàcha-teaubriand.Lesélanschrétiensdechateaubriandnel’empêchenteneffetnullementd’admirerjusqu’auparoxysmelagrècepaïenne,lagrandeurdesonartetdesalittérature:
Jene connais rienqui soitplus à lagloiredesgrecsquecesparolesdecicéron:souvenez-vous, Quintius, que vous commandez à des grecs qui ont civilisé tous les peuples, en leur enseignant la douceur et l’humanité, et à qui rome doit les lumières qu’elle possède.Lorsqu’onsongeàcequeromeétaitautempsdepompéeetdecésar,àcequecicéronétaitlui-même,ontrouvedanscepeudemotsunmagnifiqueéloge. (chateaubriand2005:167)

Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830
209
Nasl
e|e 19
• 2011 • 20
3-214
forceestdeconstaterquedanscetterecherchedocumentaire,l’his-toire gréco-romaine l’emporte largement. en fait la grèce antique, samythologie,sonhistoireetsacultureconstituentbeletbienunobjectifmajeurdel’auteurdel’Itinéraire de Paris à Jérusalem.
maisilimportededissiperuneautresourcedeconfusion.entreunpasséidéaliséetunavenirinconnu,dansleprésentvirtuelouimaginairedel’itinéraire,«poèmesurL’orient»,d’aprèsLamartine,onnetrouvepasl’exotismeorientaltelqu’ilestdéveloppéchezlesnombreuxhéritiersdesmilleet une Nuitsquiontmisencirculationdemultiplesfantasmessen-sualistesouérotiquesquelebyrondeChilde harold(1820)oulehugodesorientales(1829)nevontpastarderàenrichirdesteintesflamboyan-tesduromantisme.Lesimagesexotiquesorientales,ausensromantiquedes termes«exotisme»et«orient», sontétrangèresàchateaubriandetlesraresexceptions2nefontqueconfirmerlarègle.
maisquellegrèceantiquechateaubriandretrouve-t-iletdansquelétatd’esprit?dèsledébutdelaséquence«grèce»del’Itinéraire,lagrèceantiqueestbienprésentéecommel’objetessentieldelaquêteduvoya-geur.maiscettequêteestsansespoirni illusion: levoyageursaitd’en-tréedejeuquelemondeantiqueestabolietquesaquêtenepeutavoird’autreobjetquedestraces.
j’allaischercherlesmusesdansleurpatrie,maisjenesuispasvirgile,etlesdieuxn’habitentplusl’olympe.(chateaubriand2005:81)
toutaulongduvoyageengrèce,àquelquesexceptionsprès,cha-teaubriandne cesserademesurer l’écart entre l’imaginaire prodigieuxissudelalecturedesanciens(oudesfablesinspiréesparlesanciens)etlaréalitédeslieux.
Lavéritablegrandeurdel’artreposesursonallianceaveclabeautééternelle,etchaquepartiedel’espacecomprendunmondequirenfermeunepenséeimmuable.L’artensoiexisteindépendammentdel’homme;l’univers,avantl’apparitiondugenrehumain,étaitungrandouvraged’artquiillustraitlagloiredesonauteur.encesens,observechateaubriand,les formes desmontagnes seraient l’architecture de la nature, les picssculptésparlafoudre,sastatuaire,lesombresetlalumièresapeinture,lebruitdesvents,desflotsetdelacréationentière,sonharmonie,etl’en-sembledetoutcela,sapoésie.encequiconcerneplusparticulièrementlesgrecs,l’artaétéuneapothéosedel’humanité.
Lediscoursdechateaubriandquantà l’avenirde lagrèceest lar-gement pessimiste. il promeut le tableau d’une grèce politiquement
2 oncitetoujoursàceproposlesmêmespassages:ladescriptionducimetièreturc,celledelacaravanedemenemen,enfinlascènedebivouacaubordduJourdain.

Nikčević J.
210
déchue, asserviepar ledespotismemusulmandesturcs, appauvrie etmême exsangue. L’auteur de l’itinéraire considère que l’aliénation dupeuplegrecquiaperdudelonguedatesaliberténepeutêtrequediffi-cilementréversible:
pasunbateaudansleport,pasunhommesurlarive;partoutlesilence,l’abandonetl’oubli.(chateaubriand2005:87)
Lefaitquelepeuplegrecaitoubliésonprestigieuxetglorieuxhéri-tageantiqueestabsolumentnégatifpourchateaubriand.ilnotequelesgrecsontcependantconservéleurreligion.maislecatholiqueauteurdugénie du christianismeestd’ailleursgénéralementironiquelorsqu’ilévo-queles«papes»-(popes)grecs.enfaitlepassébyzantinetorthodoxedelagrècen’intéressenullementchateaubriand.
nousretrouveronslesspécificitésdelapositiondechateaubriand(position laïque et réformatrice paradoxale pour l’auteur dugénie duchristianisme) dans son engagement aux côtés des philhellènes. cha-teaubrianddénoncelapolitiqueambiguëdelafrance,safausseconcep-tionde laneutralitéet renvoieà saNote sur la grèce età sesdiversesprisesdepositionàlachambredespairs.entantqueministreplénipo-tentiaireenprussepuisàLondres,puisministredesaffairesétrangères,chateaubriands’étaitenfaitalignésurlapolitiquedesongouvernement.cen’estqu’ens’éloignantduministèreenjuin1824qu’ileffectuasonre-tourpublicauphilhellénisme.
LalecturedelaNote sur la grèceattestequelepointdevuedecha-teaubriandsurl’indépendancegrecquefutrésolumentpolitique,quesonphilhellénismenefutquetrèssecondairementreligieux.chateaubriandrappelletoujoursl’apportcivilisationneletpolitiquedelagrèceantiqueavantlechristianismedelagrècecontemporaine.
quereste-t-ildelagrèceaprèslesusagesqu’enfitlaterreur?L’onsaitqueladictaturejacobinesaturasesdiscoursdelégitimations,deré-férencesauxrépubliquesgrecquesjustesetaustères(sparteplusencorequ’athènes).sielleaperdutoutelégitimitécommemodèlepolitique,lagrèceantiquedemeurecommeterredesorigines,foyerinitialetpeut-êtremêmeâged’or.danssonarticle«Levoyageengrèce,quêted’unpa-radisperdu»,hélènetatsopoulos-polychronopoulosmontrebiencetteinflexiondes représentationsde lagrèce. si l’histoiredes citésdémo-cratiquesde lagrèceantique intéressemoinsparceque tropmarquéeparsesusagesrévolutionnaires,lamythologied’unegrècetoutàlafoisapollinienneetdionysiennefascine.
mais il y eut aussi l’insurrection grecque et le développement duphilhellénisme.Lemouvementphilhellène,premiermouvementdeso-lidarité européen etmême international avecunpeuple en luttepour

Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830
211
Nasl
e|e 19
• 2011 • 20
3-214
lerespectdesesdroits,nousainterpellésàdoubletitre.cetespacedesolidaritévoitserejoindredeshommesquetoutoppose:l’âge,lepassépolitique,leschoixintellectuels,philosophiques,littérairesetartistiques.Lesreprésentationslespluscontradictoiress’ycôtoient:grèceclassique,etpaïenne,grècemoderne,chrétienneoulaïque,entoutcasmartyreethéroïque.
enfrance,lephilhellénismefuttoutparticulièrementrassembleuretpermitdedéplacerleslignesdepartagesocialesetpolitiques:bour-geoisetnobles,républicainsetroyalistespartagèrentlesmêmesindigna-tionsetlesmêmesferveurs.maislaparticipationaumouvementphil-helléniqueasansnuldoutepermisourévélébiendesévolutionsidéolo-giquesetpolitiques.Lecasdeclaudefauriel(1772-1844)estsansdoutetrès symptomatique de ces dynamiques idéologiques et politiques quiontmarquélesélitesintellectuellescontemporainesdelarestauration.eruditpolyglotte,appeléàdevenirlepremierhistorienromantiquedelalittératuremédiévale,orientaliste,claudefaurielajouéunrôleconsi-dérabledanslasensibilisationdupublicàl’insurrectiongrecqueparlapublicationen1824desesChants populaires de la grèce moderne.cetouvragemettait en valeur la tradition vivante d’une poésie populaire:leschantsklephtiques,balladeshéroïquesexaltant lescombatspour lalibertéetcontrelesoppresseursturcsmaiscélébrantaussilaviequoti-dienneetlesvertusdomestiques.
quandilécritlesorientales(lapremièreéditiondatede1826),vic-torhugoestencoreroyaliste.danslepoèmeNavarinquicélèbrelaba-tailledumêmenom,hugochantelagloiredelamonarchie:
gloire à nos fleurs de lys dont l’éclat est si beau !(hugo1882:14)
appel au combat et au châtiment, célébration de l’héroïsme desgrecsetdeleursalliés,condamnationsansnuancedesottomans:ceten-semblethématiquequel’onretrouvedansl’ensembledel’œuvredehugon’épuisepasletextedesorientales.L’appelàlarésistance,àlasolidaritéactiveparcourtlerecueil:
en grèce ! en grèce ! adieu, vous tous ! il faut partir !Qu’enfin, après le sang de ce peuple martyr, le sang vil des bourreaux ruisselle !en grèce, ô mes amis ! vengeance ! liberté !(hugo1882:16)
unvéritabledéfiestlancéàl’europechrétiennesomméed’interve-nirauxcôtésdesgrecs.
etcecaractèreorientalambigudesreprésentationsdelagrècemefrappait également quand je contemplais les célèbres tableaux dede-

Nikčević J.
212
lacroixdevenusemblématiquesdel’insurrectiongrecqueetdesarépres-sion.
delacroix, on le sait, fut le peintremajeur qui illustra, aumêmetitre que hugo dans les Orientales, l’insurrection grecque. ses deuxtableauxlesscènes de massacres de scio(1824)etLa grèce sur les ruines demissolonghi(1826)ontparticipéd’unecampagnedesensibilisationàlaterriblerépressionottomane.Lesscènes des massacres de scio révèlentla singularité du peintre par l’audace de la conception du tableau enhauteur, ce qui permet de donner plus d’espace et de profondeur ausujet,enplaçantlespersonnagesenarrière-planoùsedéroulentencoredescombats,tandisque
(…)lesvictimessontgroupéessurledevantdelatoileenunmurcompact,contre lequel l’œil du spectateur vient irrésistiblement buter. il lui estimpossibledesesoustraireàcettevisiondésolée.(sérullaz1996:43)
La tension chromatique, renforcée par la lumière sur un vastepaysagedominéparuncielclair,soulignel’omniprésencedudrame.
Lesscènes des massacres de scioreprésentent,entreautres, lerejetdesformulestraditionnelles.Leromantismededelacroixest,selonlesmotsd’arlette sérullaz (1996: 124), «pour lapremière fois, opposé auclassicismededavid».
L’image de la grèce insurgée, martyrisée mais finalementtriomphante,prenduneformeallégoriquetrèsachevéechezdelacroix.cerecoursàl’allégorieconnaîtsonaboutissementdanslatoileLa grèce sur les ruines de Missolonghi,égalementconnusousletitreLa grèce à missolonghi qui représente «l’hommage le plus éclatant rendu par unartistefrançaisàlacausedeshellènes.»(sérullaz1996:124)
delacroixmontre sa prédilection pour l’allégorie et exprime cettefoissonengagementrésoluducôtédesgrecs.
Lacompositionprendendéfinitivelaformed’unebannièremonumentale.(sérullaz1996:124)
Leparcoursquiaétélenôtredanscetravail–parcoursquirecouvrepour l’essentiel lesLumièreset le romantisme–apermis toutd’abordd’esquisserlaformidablemutation–avecsapartderessassement,ilestvrai–desreprésentationsdelagrèce.Lesdichotomiesgrèceclassique/grècemoderneasservie,grèceclassique/grècemoderneinsurgéepuisindépendantesedéploientdansunimaginairequinecessedesedécons-truireetdesereconstruire.
toutunimaginairedelagrèceserévèleainsifédérateur.cetima-ginairecommuns’avèreainsilevecteurdemultiplestransfertsculturelsquiontconcouruàl’élaborationd’unecultureeuropéennecommune.

Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830
213
Nasl
e|e 19
• 2011 • 20
3-214
Bibliographie
barberis1976a:p.barberis,à la recherche d’une écriture,tours:marne.barberis1976b:p.barberis,Chateaubriand. une réaction au monde moderne,paris:Larousse.berchet1992:J.-c.berchet,Levoyageuretlepoète.chateaubriandetladécou-vertedemondenouveaux,in:Bulletin de la société Chateaubriand,35,paris:sociétéchateaubriand, 35-39.charles-wurtz2002:L.charles-wurtz,desodes et Ballades auxorientales:versunelibrecirculationdelaparolepoétique,in:autour des orientales,paris:minard,59-78.chateaubriand1847:f.r.dechateaubriand, génie du Christianisme,paris:di-dotfrères,t.i.chateaubriand1978:f.r.dechateaubriand,essai sur les révolutions,texteéta-bli,présentéetannotéparmauriceregard,bibliothèquedelapléiade,n.r.f.,paris:gallimard.chateaubriand2005:f.r.dechateaubriand, itinéraire de Paris à jérusalem,paris:folioclassique,gallimard.chénier2001:m.-J.chénier,Théâtre, Charles IX, la Critique de la tragédie de Charles IX, De la liberté du théâtre en France, Henri VIII, Fénelon, Timoléon,introd.,notes,chr.etbibl.pargauthierambrusetfrançoisJacob,paris:gar-nier-flammarion.chénier 2005:a.chénier,Œuvres poétiques, t. I (Imitations et préludes; art d’aimer; Élégies),orléans:paradigmes.chetelat1971:e.chetelat,Les occidentales ou lettres critiques surles orientalesde M. Victor Hugo (1829),paris:L’archeduLivre.chupeau1977:J.chupeau,Lesrécitsdevoyageauxlisièresduroman,in:Re-vue d’histoire littéraire de la France,paris,536-553.clément1998:J.-p.clément,Chateaubriand,paris:flammarion.conroy1983:p.v.conroyJr.,imageclaire,imagetroubledansl’histoire d’une grecque modernedeprévost,in:studies on Voltaire and the eighteenth Century,n°217,187-197.cusset2002:c.cusset,LaLoide l’intérêtou lanaissancedusujetmodernedanshistoire d’une grecque modernedel’abbéprévost,in:Le travail des Lumiè-res,paris:champion,289-99.deisser1993:a.deisser,mythification,imitationetplagiatchezlesvoyageurs,in:gérard de Nerval et l’orient,actes du colloque international «le Voyage dans l’espace méditerranéen au xviiie et xixe siècle,collectionLittératuredesvoya-ges,paris:klincksieck,123-129.d’ormesson1982:J.d’ormesson,mon dernier rêve sera pour vous.une biogra-phie sentimentale de Chateaubriand,paris:Lattès.dube1988:p.h.eta.dube,Bibliographie de la critique sur François–rené de Chateaubriand1801-1986,paris:nizet.hugo1882:v.hugo,les Orientales, paris: éd.hetzel.

Nikčević J.
214
malakis1931:e.malakis,autourdel’itinérairedechateaubriand,in:Revue de littérature comparée,11,paris,755-762.moréri1671:L.moréri,Legrand dictionnaire historique ou le mêlange curieux de l’histoire sacrée et profane, parmreLouismoréri,prêtre,docteurenthéolo-gie,[2vol.in-f°,frontispiceetportraitgravé],Lyon.pinel1996:m.pinel,Lagrèceimaginairedechateaubriandàtraversl’itiné-raire deparis à Jérusalem, in:la redécouverte de la grèce et de l’Égypte au xviiie siècle et au début du XIXe siècle,nantes:publicationsdel’universitédenantes,107-115.prévost1999:L’abbéprévost,L’histoire d’une grecque moderne, paris:flamma-rion.raffin2002:s.raffin,Les orientales:Laréceptioncritiqueen1829,autour des orientales,paris:minard,107-38.sérullaz1996:a.sérullaz,delacroixet lagrèce, in:la grèce en révolte, De-lacroix et les peintres français (1815-1848),paris:éditionsde laréuniondesmuséesnationaux.
Јасмина НикчевићПРЕДСТАВЕ ГРЧКЕ КУЛТУРЕ ОД 1780. ДО 1830.
РезимеОсновна тема овога рада је радикална промјена представе о Грчкој у раздобљу од
просвјећености до романтизма. Дихотомије: класична Грчка/поробљена Грчка, класич-наГрчка/модерна,побуњена,потомнезависнаГрчка,појављују сеиразвијајуувиђењуФранцузаупроцесусталнедеконструкцијеиреконструкције.СвесетодешавауједномгеографскинејаснодефинисаномконтекстуупериодуодФранцускереволуциједоЈулскемонархије,санеизбежнимвременскимнеподударањима.ЧиниседакледасеодренесанседоВинкелманаиодВинкелманадонашихдана,Грчкадоживљавакаопросторкојиваљаизноваоткривати,поновочитати,асамимтимиреконструисати.
Од ренесансе до класичног доба за античку Грчку, њену умјетност и филозофију,превасходносусеинтересовалиевропскидворовииинтелектуалнеелите.НепрестанимпозивањемнаАтину,СпартуирепубликанскиРимФранцускареволуцијајежељеладаЕвропикојомсувладали„тирани“представи једандрукчијимоделполитичкекултуре.Усљедећемпериоду,укомејежестокоосуђиванаРобеспјеровадиктатура,интересовањезаГрчку,каоиињенуглед,знатносуопали.РадикалнизаокретувиђењуГрчкедоносиустанаккојијојприбављавеликесимпатијеуЕвропиичитавомсвијету.Борбаједногма-логнародазаслободууједињујељудеразличитих,пачакисупротнихопредјељења,штопогодујеклимифилхеленизмакојасепосебноосјећауФранцуској.СликаГрчкејетако-рећисвеприсутна:класичнаипаганска,модерна,хришћанскаилилаичка,онајеувијекхеројскаимученичка.
Примљено: 07. 02. 2011.

215
УДКрад
Ivan radeljkovićFaculté de philosophie, université de sarajevo
ÉCLATEMENT DANS LA PoÉSIE MoDERNE Au XIXe SIèCLE
Lapoésieconnaîtenfranceauxixesiècleuneévolutionjusqu’àcemomentjamaisvue,etunedescaractéristiquesdeceparcoursestécla-tementdesformes,éclatementduvers,éclatementdulangagepoétique,mêmeéclatementdusujetpoétique.Lespoètes«brisent»aussiunecer-taine idéede lapoésie (cela est surtout évident chezbaudelaire,rim-baudetmallarmé),maiscette«destruction»devientaussiunepossibilitéradicaledelacréationdunouveau.ellesignifielalibérationdesmoyensd’expression poétique. nous nous proposons, dans cet article, de lirel’histoiredelamodernitépoétiquedanslalittératurefrançaiseduxixesiècleàtraverslanotiond’éclatement,qui,paradoxalement,faitpreuvede progression et de continuité dans la poésie française de cette épo-que.ilsembleraitquecette«évolution»,quin’avaitpascessed’accélérer,aabouti,audébutduxxesiècle,àlacréationd’unepoésieradicalementdifférenteparrapportàcelledusiècleprécédant,surtoutparsonouver-tureaumondeexterne,àlaréalité,etautempsprésent.
Mot-clés: poésie moderne, xixe siècle, éclatement, révolte, rim-baud,mallarmé,réalité,présent
onpeutaffirmerquel’éclatementaexistédepuistoujoursdanslapoésie.parexemple,ronsardn’a-t-ilpasfaitéclaterlaformedel’ode,pourcréerunenouvelleformequi,dessièclesplustardserarepriseetnomméeode-lettepargérarddenerval?depuistoujoursonréadaptelesanciennesformespourcréerquelquechosedenouveau,surtoutsil’onlesemprunted’unepoésieécritedansuneautrelangue.toutdemêmequandonparledel’éclatementdanslapoésiemoderne,cetéclatementgraduelmaisplusoumoinsprogressif apparaît comme l’évolutionde lapoésiedepuis leromantisme.decepointdevue,l’éclatementpoétiquepourraitbienêtreunautrenomdelapoésiemoderne,puisquel’histoiredecelle-cisecom-posed’unesuitederuptures:lefaitquecetéclatementn’estpasrégulieretlinairetientdesaproprenature.
depuisleromantisme,depuisquel’édificedutempledugoûtetdelaperfectionclassiquesacommencédelentements’effriter,leshautesfor-

Radeljković I.
216
mesdel’épopéesontdevenuescommeimpossiblesàaccomplir,dansunmondeoùl’expériencehumaine elle-mêmesembletoujoursinaccom-plie,commes’illuimanquaittoujoursunonnesaitquoi.etl’onconnaîtlesambitionsdes«grandsromantiques»encequiconcernel’épopée.se-lonpatrickbesnier,
(…) l’opposition entreprose et poésiene tientplus fermementdans lespremièresdécenniesdu[xixe]siècle,cequidéveloppeuneambiguïtédontsouffrel’épopée.celle-ci,parailleurs,introduitunepratiquedufragmentquimet en question l’idée d’œuvre close et finie, c’est-à-dire à la limitel’idéedelaperfection.(berthieretal.2006:241)1
L’œuvreretranchéedutempsetdel’histoirenepeutplusrienappor-terdenouveaudans la littérature: les théoriciensromantiquescommemadamedestaëletstendhaln’ontpaseucesseàl’affirmer.etencore,sil’onpenseàl’épopéequicomptecommeunedesplusaccompliesduro-mantismefrançais,La Légende des siècles,elleseprojettesurl’humanitétoutentièreenvoulantrendrecomptedesesorigines,desesfinsultimesetdetoutcequisetrouveentrecesdeuxextrêmes.elledevientparlànécessairementdémesurée,etdoncfragmentaireetnonlinéaire.enper-dantlesrèglesquilalimitaient,l’épopéecommenceàsedissiper.
d’unautrecôté,l’époqueromantiqueavulanaissancedugenredepoèmeenproseavecgaspar de la Nuitd’aloysiusbertrand.cegenre,parsanaturemême,exprimeunecertainehésitationentrelapoésieetlaprose,etenmêmetempssituel’expériencelittérairedansdesfragments.danssapréface,bertrandprétendquelelivrevientdudiablelui-mê-me–gaspardelanuit,carsinonquimélangeraitleversetlaprose?(bertrand2003:18-22)pourcequiestdenerval,soitilalterneletexteprosaïqueavecdesvers,commeferaplustardrimbaud,soitilinscritsestransportslyriquesdirectementdanslaprose.danslasecondemoitiéduxixesièclelepoèmeenprosedevientlegenremoderneparexcellence,avecbaudelaire,Lautréamontetrimbaud,alorsquesonenjeu tourneautourdela«crisedevers»etmetenquestiond’unefaçonplusgénéralelelyrismesubjectif.cesonteneffetdes«petitsromantiques»commeonlesaappelés,ouencore«lesenfantsperdusduromantisme»quiannon-centlafiguredupoètemauditetaffirmentainsileclivagequicommenceà se creuser entre le poète et la société, surtout après la déceptionde1848.eneffet,lepoèteestdésormaisdeplusenplusbannidelacité(s’ilveutvraimentêtrelibre:qu’onpenseseulementaubannissementlittéraletinstitutionneld’hugo),maisunecertainelibertéluiestainsiparado-
1 v.aussi:georgespoulet,la poésie éclatée: Baudelaire/rimbaud,pufécriture,1980.

Éclatement dans la poésie moderne au XIXe siècle
217
Nasl
e|e 19
• 2011 • 215
-221
xalementlaissé,unespaced’exploration,dontonsaitquellel’importancequ’ilaeuparlasuite.
Après le romantismeLedevenirdelapoésiedepuisleromantismeestdoncconditionné
pardeuxgrands«événements»,ouprocessus,àsavoir ladistancetou-joursdeplusenplusgrandequeprennentlespoètes(etd’ailleurs,touslesartistes)parrapportàlasociété,etle«désenchantement»2quiacom-mencé à effacer les limites claires entre la poésie et la prose.dans ladeuxièmemoitiéduxixe siècle, à cesdeux facteurs importants va sejoindreuntroisièmequivaquelquefoislesassimiler:larévolte.
L’éloignementde lapoésiedesaffairesde lacitéetde l’histoireestexemplaire chez lesparnassiens, etpendant ce temps labohèmeanti-conformiste des groupuscules des «hydropathes», des «zutistes», des«Jemenfoutistes»etdesautres(pourlaplupartjeunespoètes)fragmentel’avant-gardepoétiquedecette époque, etmarque sonoppositionà lasociété sur leplande lamanièredevivre: c’estuneopposition surunmodemineur,maistellementimportantepourlapostérité,quihériteenquelquesortecetespritdedécadence.avanteux,c’étaitsurtoutbaude-lairequiseréclamaitdunon-conformisme.pourluionaffirmesouventquec’est lepremierdespoètesmodernes3,maiscen’estpasseulementparcequ’ilouvrel’èred’unepoésiehantéeparladestructionetparlare-chercheforcenéedunouveau,ouàcausedesa«décadence»,qu’ilauraitrépudié lui-même.ilyatoutunaspectéthiquede larévolteetde l’es-thétismeélitistedebaudelaire4.ilestpeut-êtrelepremieràarracherlacatégoriedubeauàcelledubien,aprèsdesmillénaires.onpeut sansdouteenconclurequ’il transforme le rôledupoète: la révoltedevientsonexigenceéthique,puisque,dans soncas, cette éthiqueconsiste en«extraire labeautédumal»pourmontrer lagrandeurde l’hommeré-voltéet créateur, célébrer labeautépour s’opposeraumaletgarder laluciditédesisyphepourfairefaceàl’inévitable(kovač1980:125–126).ilexistebienunmoidanslapoésiedebaudelaire,maisilexprimeunevolontéartistique,uneréflexionesthétiqueetéthique,unepo-éthique,etnonuneproblématiquepersonnelle.puisqu’ilrecherchelenouveauetserévoltecontrel’ancien,lepoèmesedoitderemettreenquestionchaque
2 nousrenvoyonsàcettenotiontellequel’adéveloppéepaulbénichou(2004).3 L’histoirelittérairesembleunanimedanscetteaffirmationdepuismarcelraymond,de Bau-
delaire au surréalismede1940ethugofriedrich,structure de la poésie moderne,publiépourlapremièrefoisen1956[Die struktur der modernen lyryk]
4 danilokišsoutenaitdansunessaisurbaudelairequelapoésieétaitpourcedernierenmêmetempsuneéthique,uneesthétiqueetunereligion(kiš1971:53).

Radeljković I.
218
foislapoésietoutentière,desortequ’illaréinventerachaquefoisàforcedelaréfléchiretdelacritiquer.c’estcommeçaquelelyrismedevientcritiquedanslamodernité.
deuxpoètesquiseréclamerontdelarévolteetdelarechercheobsé-danteettoujoursreprisedunouveau,autantqued’unecritiqueradicaledelapoésie,Lautréamontetrimbaud,parleursoutrancesetleursdéli-resporterontcelle-cijusqu’auxlimitesdeladissipation,etbienau-delàdesespropreslimites.aveclamonumentaleinsolencequilescaracté-rise tousdeux, ilsbrisent toutun imaginaireconventionneletconser-vateurdelapoésie.rimbaudassocieraauxvoyelles,commebaudelaireauxsons, lescouleurs.cependant,cesassociationssontmarquéesparl’arbitraireleplusvoulu:parcetarbitrairemême,ilfaitéclaterdesliensmétaphoriques,quiauparavantauraitétéporteursdesignification.se-lonmichelcollot:
enisolantetenexhibantcescomposantesnonsignifiantesdelalangue,illesdonneàentendreetàvoirdansleurmatérialité;(…)illeurfaitrejoindrenonseulementlamatièredumonde,maislesmouvementsdel’âmeetducorps.(1996:118)
qu’onpenseaussiauxcouleurscriardesdesimagesduBateau ivreoud’autrespoèmes:ellessemblent,parleurdisparitéetparlabrusqueriede leur juxtaposition avoir unemissiondene pas s’unifier, selonuneexpressiondegeorgespoulet(1980:158).ellessemblentplutôts’entre-choquer.ilestjustedesedemander,àleurpropos,sil’ondoitparlerdeladisharmonie.
cesdeuxpoètesontaussiradicalisélaquestiondelaproseetdelapoésieàtraversleurspoèmesenprose.chezLautréamont,c’estlaprosequidevientlyrique(enprenantlenommêmedesChants),tandisquecesontlesPoésiesd’isidoreducassequicritiquentlapoésieavecvéhémen-ce.rimbaudestsansdoutelepremieràavoirécritunepoésieenprosepleinementpositive,indifférenteàlacriseduversetdulyrisme,mêmes’ilasituécesexpériencesdansdesfragmentsfulgurantsdesillumina-tions.comme l’amontrépoulet, chaque illumination est une brusqueprisedeconscience,uneinterruptiondanslaquelleunnouveaumondeestcréé(1980:92-93).c’estrimbaudencorequiautilisélepremierleverslibredanscemêmerecueil,quoiquec’estverlainequiopèresub-tilementlasubversiondelamétriqueparsonchoixdel’impaireetnonseulement du vers libre,mais aussi du faux vers et des fausses rimes,en les incorporantdans ses recherchesdesharmonies raffinées et va-riées.moinssubtiletplusbrutalesttristancorbière,chezqui leverscommenceàlittéralementboiter,enguised’unricanementetd’unéchoironiquemaistragiqued’unmal-êtrevécu,etenmêmetempsréflexion

Éclatement dans la poésie moderne au XIXe siècle
219
Nasl
e|e 19
• 2011 • 215
-221
detouteuneculturequiboitesouslepoidsdelavieillerieetdel’hypo-crisie.
mallarméferaéclater lepoèmepourdissocier le langagepoétiquedesafonctionutilitairedecommunicationetdereprésentation,etpourfairedumêmepoèmelelieudel’avènement,delacréationd’unsenspur.sa recherche de l’absolu deviendra intellectuelle et tellement abstraitedanslesensdelanon-représentation(conio2003:49-51),qu’elledonneaupoèmequelquechosedeconcretdanssavirtualité.Lesaventuresdecestroispoètes‘maudits’peuventparaîtreicariennesouapocalyptiques,ellespeuventmarquerdeséchecsdeleurspoétiquesparticulièressil’onveut(parrapportàleursuccèsdansleurtemps),ellesn’enontpasmoinsouvertdes voiesnouvelles, les cheminsde lapoésiemoderneduxxesiècle,quisontceuxdupoèmeenliberté,parfoismêmedesmots en li-berté (lesurréalisme),voiredeslettresoudessonsenliberté(lelettrismeetc.)5.
pourtant chez mallarmé, autant que chez rimbaud, ce n’est passeulementlareprésentationouleversquisontmisenquestion(ouencrise),mais le sujetpoétique lui-même.désormais le sujetpoétiqueacessé d’être enfermé sur lui-même, et par conséquent le lyrisme cessed’êtreuneexpressiondelasubjectivité(déjàceprocessussembleavoircommencéavecbaudelaire),pourdevenirl’ek-stasedusujet(1996:118),pourlefairesortirdelui-même6.ilestdésormaisconscientdel’altéritéquiluiestinhérente.Lesrecherchespoétiquesmodernesexplorerontlaconscience impossible7dusujetpoétique,soitqu’ellesportentsur l’in-conscient,soitsurlemondeexterne.
pourcequiestdudésenchantement,ilestloind’êtrelafindelapoé-sie;pourcequiestdeladisparition élocutoiredecesujet,quidetoutefaçon,estun autre,elle le libère,maisunefois libre, ila laconscienced’être impossible.c’est l’impossibilité de dire, l’impossible de la poésiequidéfinitlamodernitéetouvredesvoiesdelapoésiemoderne.
5 «enévoluantversl’approfondissementdelapoésie,traversant,danslerétrécissementobliga-toiredumatériel,le poème(baudelaire),la phrase(verlaine)etsadestruction(rimbaud),le mot (mallarmé)etsadévalorisation(tzara),isidoreisouapporteLa LettRe»,Jean-Louisbrau, revue ur, n°1, 1951. cité depuis «Lettrisme» parmichèle aquien, in Jarrety et al.:2001.
6 voiraussim.collot(1989).7 J.-m.maulpoixparledu«sujetimpossible»(1996),etchrisiandoumetde«figureimpossi-
ble«dansl’article«poète»inJarrety et al.:2001.

Radeljković I.
220
Ouverture vers une nouvelle poésieaprèsavoirétudiél’évolutiondelapoésiemoderneauxixesiècleà
traverslanotiondel’éclatement,ilnousresteànousdemanderquelestlesensdecetéclatement,commentl’expliquerdanssalignegénérale?
s’agit-iltoutsimplementdeladestruction«dangereuse»delalitté-rature,oude ladévaluationdesvaleursmoralesoureligieuses?est-ceplutôtunsignedela longueet lenteévolutiondelapoésieetdecelle,beaucoupplusrapideetbrutale,dumonde?Lapoésiepeutévoluerparrapport aux changements ou aux situations dans la société,mais une«évolution poétique» est en vérité tributaire desmouvements lents etcontinus.Lesrupturesetlesnouveautésquicommencentlentementetdiscrètementàsefairecheminautourdu1900sontenquelquesorteleproduitd’unelonguematuration,et,nousosonsdired’unelonguedéca-dencedesvaleurslittérairesduxixesiècle.sil’onétait«décadent»verslafindusiècle,cettedécadenceapermisl’éclosiond’unepoésienouvelle,finalemententièrementlibéréedel’héritageromantique.
La poésie française du xixe siècle, dans ses grandes lignes, étaitorientéeverslerêve,verslepassé,versl’exotiqueetversl’absent.s’ilnousest permisde faireune généralisation réductrice, comme elles le sonttoutes,nouspouvonsconclurequelapoésieautourdu1900setourneducôtédelavie,duréel,d’uneintimitéspirituelleaveclemonde,d’unepré-senceauthentiquedansl’icietdanslemaintenant.ellecommenceàréa-liserlerêvederimbaudsurlapoésie‘objective’.commeleditunpoètede l’époquefernandgregh:«après l’écolede labeautépour labeauté,aprèsl’écoledelabeautépourlerêve,ilesttempsdeconstituerl’écoledelabeautépourlavie.»(berthier2006:287)
uneautretendance,quiexistaitengermedanslapoésieduxixesiè-cle,apparaîtdanslanouvellepoésie,etc’estl’idéedelalittératurecom-meexpérience.surtoutsousl’influencedewhitman,denietzscheetdebergson,cetteidéesefaitchemindansl’œuvredegide,deverhaerenetdeclaudel,entreautres.ilnes’agitplusdenoterunesagesse,faireréson-neruneévocationouuneprière(soit-elleunelitaniedesatan),maisdevivreleréel.bientôtils’agiradevivre,nonpasdesmomentsprivilégiés,maisle moment.

Éclatement dans la poésie moderne au XIXe siècle
221
Nasl
e|e 19
• 2011 • 215
-221
Bibliographie
baudelaire1975:c.baudelaire,Œuvres complètes,i,bibliothèquedelapléiade,paris:gallimard.bénichou2004:p.bénichou,L’école du désenchantementinRomantismes fran-çais II, paris:quartogallimard.berthieret al.2006:berthieret al., Histoire de la France littéraire. Modernités. xixe – XXe siècles,vol.iii,paris:puf.bertrand2003:a.bertrand,gaspard de la Nuit,paris:1001nuits.claudel1984:p.claudel,art poétique,paris:gallimard.collot1996:m.collot,«Lesujetlyriquehorsdesoi»inFigures du sujet lyrique,sousladir.dedominiquerabaté,puf,1996.conio2003:g.conio,l’art contre les masses: esthétiques et idéologies de la mo-dernité,Lausanne:L’âged’homme.corbière1973:t.corbière,Les amours jaunes,paris:gallimard.gide1917-1936:a.gide,Les nourritures terrestres,paris:gallimard.friedrich 1976: hugo friedrich, «baudelaire, le poète de la modernité», instructure de la poésie moderne,denoël/gonthier,paris,1976[die struktur der modernen lyryk,hamburg,1956.]Jarretyet al.2001:dictionnaire de poésie depuis Baudelaire,sousladir.demi-chelJarrety,puf,2001.kiš1971:d.kiš,Po-etika,beograd:nolit.kovač1980:n.kovač,upitna misao,beograd:prosveta.mallarmé2005:s.mallarmé,Poésies et autres textes,paris:Lgf.maulpoix1996:J.-m.maulpoix,quatrièmepersonnedusingulier,ind.rabaté(éd.), Figures du sujet lyrique,paris:puf.nerval1999:g.denerval,les Filles du feu, les Chimères et autres textes,paris:Lgf.poulet1980:g.poulet,la poésie éclatée: Baudelaire/rimbaud,paris:puf.raymond1940:m.raymond,de Baudelaire au surréalisme,paris:Josécorti.rimbaud1960:a.rimbaud,Œuvres,paris:classiquesgarnier.
Иван РадељковићПОЈАМ „РАСПРСКАВАЊА“ У МОДЕРНОЈ ФРАНЦУСКОЈ
ПОЕЗИЈИ xIx ВИЈЕКАРезиме
Францускапоезијаxixвијекадоживљава једнудотадневиђенуинеслућенуеволу-цију,а једнаодглавнихкарактеристикате (р)еволуције јефрагментација:пуцањефор-ми,пуцањестиха,пуцањепјесничкогјезика,пачакипјесничкогсубјекта.Пјесницитако„крше“такођеиједнуодређенуидејуотомештајепоезија,итојенарочитовидљивокодБодлера,РембоаиМалармеа,ното„уништавање“постајетакођеиједнарадикалнамо-

Radeljković I.
222
гућностзастварањеновог.Оноподразумјеваодређеноослобађањесредставапјесничкогизраза.Уовомчланку,нашанамјераједаизвршимоједночитањехисторијефранцускемодернепоезијеуxixвијекукрозпојам„éclatement“(пуцање,експлозија,распрскавање).То пуцање се парадоксално показало као прогресија која посједује свој континуитет уфранцускојпоезијитогдоба.Реклобиседајета„еволуција“,којасенепрестаноубрзава-ла,довела,напочеткуxxвијека,додостварањаједнепоезијекојајерадикалнодругачијауодносунаонупрошлогвијека,нарочитопосвојојотвореностипремавањскомсвијету,стварностиисадашњемвремену.
Примљено: 31. 01. 2011.

223
УДКрад
Henri Boyeruniversité montpellier iii
Pour uNe hISToIre SocIoLINGuISTIque De LA LANGue frANçAISe.
NORMATIVIsATION ET NORMALIsATION Du frANçAIS Sur LA LoNGue Durée
si l’onobserve ledéveloppementde la langue française, il estclairque la normativisation linguistique est allée depair avec lanormalisa-tion sociolinguistique, en relationavec lesorientationspolitiques et lesnouveauxbesoinscommunicatifsdel’etatmonarchiqueenconstructionaucoursduxviesiècle.et ilestnonmoinsclairque lesprocessusdenormativisation et denormalisationont accompagné l’unification lin-guistique du territoire, et l’ont doitmême penser qu’ils en ont été lesconditionsfondamentales.sibienquel’onpeutconsidérerquelesdeuxprocessus, l’un concernant les fonctionnementsnormésdu français etl’autre la relationde la langueduroi,puis cellede larépubliqueauxautres languesconcurrentes sont inspirésparunemême idéologie so-ciolinguistique,quel’onaqualifiéeailleursd’unilinguisme(voirparex.boyer2000)etquiaopérédèsl’émergencedufrançaiscommelanguedelacommunicationsocialeetsurlalonguedurée,selondeuxdimensionssolidaires: un unilinguisme intralinguistique qui impose de respecterl’intégritéde la langue française, sa«pureté»,etununilinguisme inter-linguistiquequiviseà imposer l’exclusivitésociétaledufrançaissur lesterritoiresdelafrance.
Mots-clés: politique linguistique, langue française, unilinguisme,patois, représentation sociolinguistique, idéologie sociolinguistique,normalisationsociolinguistique,normativisationsociolinguistique,épi-linguisme
parlerdenormativisationd’unelanguec’estfaireréférenceaupro-cessus appelé aussi communément codification ou si l’on se réfère auxanalyses de s. auroux, «grammatisation» au sens de: «processus quiconduit àdécrire et àoutiller une langue sur la basededeux techno-logies,qui sontencoreaujourd’hui lespiliersdenotre savoirmétalin-guistique:lagrammaireetledictionnaire»(aurouxdir.1992:28).c’estdoncfaireréférenceàladéfinitionetàlamiseenœuvreindispensables,pourunidiomequivise l’institutionnalisationcommelanguedeplein

Boyer H.
224
exerciced’unesociété,deformesnormées,aussibiendel’ordredelagra-phiequedelaphonétique,delasyntaxeoudulexique.enprincipeceprocessusqui,pourcequiconcernel’europe,s’estdérouléaucoursdesxve-xviesiècles(baggioni)sedoitd’êtreensynergie1avecleprocessusappelénormalisation2 lequel concerne l’extensiondes fonctions socia-lesd’unelangueetsonchampcommunicationnel.ainsiunelanguenepeutêtrepleinementnormalisée,c’est-à-direêtrelangued’enseignementet utilisée dans tous les domaines de la vie de la communauté que sielleaaupréalableéténormativisée,pourvued’unstandardetdenormesd’usageafférentes.
si l’onobserve ledéveloppementde la languefrançaise, ilestclairque la normativisation linguistique est alléedepair avec lanormalisa-tion sociolinguistique, en relationavec lesorientationspolitiqueset lesnouveaux besoins communicatifs de l’etatmonarchique en construc-tionaucoursduxviesiècle.etilestnonmoinsclairquelesprocessusde normativisation et de normalisation ont accompagné l’unificationlinguistiqueduterritoire,etl’ondoitmêmepenserqu’ilsenontétélesadjuvantsfondamentaux,sibienquel’onpeutconsidérerquelesdeuxprocessus,l’unconcernantlesfonctionnementslinguistiquesdufrançaisetl’autrelarelationdelalangueduroiauxautreslanguesconcurrentes,sontinspiréesparunemêmeidéologiesoiciolinguistique,quel’onaqua-lifiéeailleursd’unilinguisme(voirparex.boyer2000)etquiaopérédèsl’émergencedufrançaiscommelanguedelacommunicationsocialeetsurlalonguedurée,selondeuxdimensionssolidaires:ununilinguisme intralinguistique qui impose de respecter l’intégrité de la langue fran-çaiseetununilinguisme interlinguistiquequiviseàimposerl’exclusivitésociétaledufrançais.
Pas de concurrenceLa traduction de l’unilinguisme ici, c’est bien entendu l’unification
linguistique du territoire,quicoïncideavecl’histoiresociolinguistiquedelafranceetquiseconfondaveclaconstructiondel’etatnationalcom-mencéesouslamonarchie(dèssesdébuts),maisaccéléréesouslerégimerépublicain,àpartirdelarévolution.
cette histoire, c’est l’histoire d’une domination linguistique qui aconnuplusieursphases,depuisunétatdeplurilinguismeeffectif(etdeconcurrence sociolinguistiqueouverte, enparticulierdans ledomaine
1 maisparfoisdissociédansletempspourdesraisonsautresquesociolinguistiques.2 surlesconceptsdenormativisation-normalisation,singulièrementensituationdiglossique,
on doit se reporter à lamodélisation catalane de la sociolinguistique appliquée. voir parexemplearacil1965,vallverdú1980,boyer1991.

Pour une histoire sociolinguistique de la langue française
225
Nasl
e|e 19
• 2011 • 223
-234
littérairepourcequiconcernelalangued’oc)jusqu’àunétatcontempo-raindequasimonolinguisme(sil’onconsidèrel’héritageidiomatiqueetnonlesnouvellespratiquesquisurgissentàpartird’interventionsglot-topolitiquesmilitantes, commedans les «calandretas», les «bressolas»,les«ikastolas»oules«diwans»),enpassantpardiversstadesdepluridi-glossie.
siceprocessusd’unificationlinguistiqueatenduàimposerdurantl’ancienrégimelalangueduroicommeuniquelangueadministrativede l’etatmonarchique, il a imposéàpartirde larévolution la languefrançaisecommeseulelanguenationale. cetteimpositiontrouverasonexpressionjuridiquelaplusclairedanslesdernièresannéesduxxesiè-cle,aveccetteinscriptiondanslaconstitutionfrançaise,àl’occasiondelarévisionde 1992(motivéeparlaratificationdutraitédemaastricht):«Lalanguedelarépubliqueestlefrançais».ils’agitdésormaisdel’ar-ticle2delaconstitutionlequel,onlesait,semblefaireproblèmepourlasignaturedelaCharte européenne des langues régionales et minoritai-res.durantledébatàproposdelarévisionconstitutionnelle,lamajoritédesparlementairesréunisencongrèsontrejetéunamendementclaire-mentanti-jacobinmaissommetoutemodéré,quiproposaitd’ajouteràlaphrase«Lalanguedelarépubliqueestlefrançais»l’énoncé:«danslerespectdeslanguesetculturesrégionalesetterritorialesdefrance».
onmentionnesouvent,commedatedudéclenchementdelapoli-tiqued’unificationlinguistiquede l’etatmonarchiquefrançais l’ordon-nancedevillers-cotterêts,signéeparfrançois1eren1539.enréalité,ils’agitd’unrepèreplutôtadministratifmaisdevenueffectivementdatesymbolique:plusieursétudesconsacréesàcettepériodeendomaineoc-citanontmontréqu’avant1539,lamajoritédesactesnotariauxétaientrédigés en français et non plus en latin ou en vernaculaire (voir parexemplenacq1979).
enfait,c’estbienlarévolutionfrançaisequiestlemoment-clédelalégitimation d’uneunificationlinguistiqueenfaveurdufrançais,mêmesil’ambitiondecertainsrévolutionnairesdemettreenœuvreuneauthen-tique planification linguistique n’a pu se concrétiser à cemoment-là.(boyer,gardyéd.1985;schlieben-Lange1996;boyer1999)
onsaitque,dansunpremier temps,en1790, lesdécretsde l’as-sembléesonttraduitsdanslesdiverseslanguesdefrance(cf.l’entreprisedugasdans lesud)etqu’une importanteproductiontextuelledetypepropagandistepubliéedansceslanguesapparaîtunpeupartout,singu-lièrementendomaineoccitan(voirboyer,gardy,1989).cependant,aumêmemoment,l’abbégrégoirelancesacélèbreenquête(«unesériedequestionsrelativesaupatoisetauxmœursdesgensde lacampagne»)

Boyer H.
226
dont l’objectif fondamental est clairement énoncéaudétourd’unedesquestions(laquestion29):«détruireentièrementle(s)patois»(decer-teauetal.1975).
cemotde«patois»venaitd’êtreconsacréparl’encyclopédiecommeun désignant discriminatoire, stigmatisant pour les langues de franceautresquelefrançais,seulelanguereconnue«nationale».
enréalité,avecsonenquête,nonseulementgrégoirechercheàpren-dretoutelamesuredelapluralitésociolinguistique,maisilcondamneàtermecettepluralitécommeobstacleàunecommunicationpolitiquesatisfaisante, obstacledonc à larévolution. son rapportdemai1794,authentiquedéclarationdepolitiquelinguistique,développed’unecer-tainefaçonl’objectifdéjàinscritdansl’enquêtede1790,demanièreen-coreplusexplicite.L’intituléestonnepeutplusclair:«rapport sur lanécessitéetlesmoyensd’anéantirlespatoisetd’universaliserl’usagedelalanguefrançaise».
cetexteestunepiècedepremièreimportancedanslaquêtedel’uni-linguisme:
1.ilillégitimelepluralismelinguistique.Lapluralité,enlamatière,c’estledésordre.grégoireparlede30«patois»différents.ilajoutepourfrapperlesespritsquedanslescontréesméridionales,«lemêmecepdevigneatrentenomsdifférents»...cettepluralitédésordonnées’opposeàl’«usageinvariable»dufrançais.
2.ilillégitimelepluralismelinguistiquedupointdevuefonctionnel,dupointdevue communicationnel.L’usagerdu seul «patois»nepeutpascommuniqueravectouslescitoyens.demême,les«patoisdressentdesbarrièresquigênentlesmouvementsducommerceetatténuentlesrelationssociales».quiplusest,l’accèsaunouveaulangagepolitiquefaitproblème car «si dansnotre langue [= le français, seul dignede cettedénomination] lapartiepolitique est àpeine créée, quepeut-elle êtredansdes idiomes[qui] sontabsolumentdénuésde termesrelatifsà lapolitique»...
3.La seule langue légitiméeestdonc le français,pourdes raisonsfondamentalementpolitiques:c’est«lalanguedelaliberté»,laseulequipermettede«fondretouslescitoyensdanslamassenationale»àladiffé-rencedes«idiomesféodaux»:lefrançaisestlalanguedel’ordrenouveau,révolutionnaire,lespatoissontdessurvivancesdel’ordreancien.onsaitquecetargumentseralongtempsinvoqué.
unautredéputé,barère,avaitd’ailleursprononcé,dansunrapportprésenté au nom du comité de salut public un réquisitoire similairedevenu célèbre: «Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton;l’émigrationetlahainedelarépubliqueparlentallemand;lacontre-ré-

Pour une histoire sociolinguistique de la langue française
227
Nasl
e|e 19
• 2011 • 223
-234
volutionparleitalien,etlefanatismeparlelebasque.cassonscesinstru-mentsdedommageetd’erreur».
cependant,unseultexteréglementaireimportantenmatièred’usa-gelinguistiquefutadoptéparlaconventionàlasuited’unrapportdemerlindedouai(faisantréférenceàl’ordonnancedevillers-cotterêts):laloidu2thermidoranii(20juillet1794)quistipulaitqu’aucunactenepourraitdésormaisêtreécritqu’enfrançaisetquiprévoyaitdessanc-tionspénalespourlesinfractionscommisespar«toutfonctionnaireouofficierpublic,toutagentdugouvernement».
ainsi,malgrélerapportdetalleyrand(1791)à lasuiteduquelfutcréé le comité d’instruction publique chargé du développement desécolesprimairesà travers lafrance,malgré ledécretadoptéà la suitedurapportdebarèredéjà cité,quiprévoyait lanominationd’institu-teursdelanguefrançaisedanslesdépartementsnonexclusivementfran-cophones,cen’estquelatroisièmerépublique,unsiècleplustard,quimettraenœuvreaveclesuccèsquel’onsait,lapolitiquescolaired’uni-ficationlinguistiquerêvéeparlarévolution,grâceàl’institutiond’uneécolepubliquegratuite, obligatoireetlaïque.
Pas de dévianceils’agitde l’autrefacede l’unilinguisme françaisquinous intéresse
ici,complémentairedelaluttepermanente(etefficaceàpartirdelafinduxixèmesiècle)pourl’unificationlinguistique:l’obsessiondel’unifor-misation de l’usage de La langue,parlerespectscrupuleuxd’unenormeunique,dubonusage.etdureste,cen’estpasunhasardsil’ordonnancedevillers-cotterêtsestédictéedurant lesdébutsdelapériodedenor-mativisationdelalanguefrançaise,qued.trudeau(trudeau1992) faitallerde1529(datedelapublicationdeChamp Fleury degeoffroytory)à1647(datedelapublicationdesRemarques sur la langue françaisedevaugelas.
a.decrosse observe fort justement que «la politique linguistiqueénoncéeparfrançois1eretl’humanisme[…]verrouilleral’enceintedelanationsur l’etatet l’amourdela languefrançaise».etauxviiesiè-clese«produituneentréedéfinitivedel’etatdanslareprésentationdelalangue;centrageetnormerésorbenttouteincomplétudedelalanguefrançaisevis-à-visdes languessavanteset lagénéalogiedufrançaiss’ystabilisedanstouslesdiscourssurlebonetlevrai usage,quiprocède de l’hégémonie «étatique sur les usages de la communauté nationale»(de-crosse1986:174-175;jesouligne).
cediagnosticest largementpartagé:ainsig.schöni,parexemple,observequelexviiesièclegrammairienetsonreprésentantleplusmar-

Boyer H.
228
quant, vaugelas, auront une responsabilité considérable dans l’avène-mentd’attitudespuristesetfigéesfaceàlalangue.eneffet,deslorsquel’objectifprincipaldetellesentreprisesestdefournirdesrèglesd’usage,touteambitiondeculturesetrouverareléguéeàl’arrièreplanpourlaisserlechamplibreàunensembledeprescriptions,dontlesactuelles«chro-niquesdelangage»-etleurrefusdeprendreencompteleschangementsdansl’usage-sontleprolongement(schöni1988:25-26).
ph.caronetd.kibbeemontrentbiencommentetpourquellesrai-sons(peu«scientifiques»)vaugelasdanssapréfaceauxRemarques sur la langue française«[expliciteen1647]lemodèleabsolutistedesondéfuntpatron[richelieu],unmodèletrèscontestéparlemouvementdesfron-des»:«cettevisiondelanormequi,éjectantleparlement,placelacourduroienpositiondominante,lesbonsauteursengarant,[…]etenfinlagrammaireenultimerecourslorsqu’onnesaitpastrancher,acertaine-mentsasourcedansl’histoiredesrelationstenduesentrelesdeuxlieux-clésde l’exécutif, leroietsonconseild’uncôté, leparlementavecseschambrestechniquesdel’autre».
ainsi«dans ladeuxièmemoitiéduxviesiècle,etencoreplusaudébutduxviie,lepouvoirdupalaisetdelabourgeoisieparisiennedi-minueaupointoùonarriveàl’absolutismesousLouisxiiietLouisxiv.Lanormelinguistiqueesttrèssensibleaupouvoir,etlanormeexplicitéedanslestextess’alignedeplusenplussurcelledelacour[…].aprèsunepremièrepériodeoùlaréformedelajusticeacrééunenormetempérée,mitoyenneentrelacourduroietlacourduparlement,lacentralisa-tiondupouvoirchezlesbourbonsaprogressivementexclulalanguedupalaisdelanouvellenorme,enfaveurdelalanguedelacour.Lanormelinguistiquespontanéecèdeàlanormelinguistiqueexplicitée,unenor-mereflétantl’imagedel’autorité»(caronetkibbee,àparaître).
ceprocessus,fondateurdeslanguesmodernes,s’estdoncdéveloppéenfrancedemanièresingulière.onpeutdirequelalanormativisationasubidanscecasunedérive:aulieud’installerdesnormesgrammaticales,lexicales,orthographiques...ouvertes, indispensablesàlamaturitédelacommunautélinguistique,àlanormalisationdesesusages,onasacraliséune normedufrançais,onaidéaliséunusagepuristedelalangue,onainstitutionnalisé-etdoncsolidifié-lebonusage,etce,bienentendu,enphaseavec laconfirmationd’une tendanceprofondeà l’unificationethnolinguistiqueenfaveurduseul français(qu’onvientd’évoquer).ilestclairquele françaisetsonuniqueusagelégitimeontconjointementettotalementpartieliéeàl’etat,dèssonentréedansl’époquemoderne.L’unificationpolitico-administrativedelafrances’estincontestablementappuyéesuruneseule langueuniformisée.

Pour une histoire sociolinguistique de la langue française
229
Nasl
e|e 19
• 2011 • 223
-234
L’académiefrançaiseestcréée,parrichelieu,en1635:c’estprécisé-mentauxviiesiècle,âged’ordel’etatmonarchiqueabsolutiste,qu’onobservelemieuxcephénomènesingulierde«verrouillage»dela«gram-matisation»:unidéaldelangue(trèscirconscritdupointdevuesociolo-gique)tendàsefossiliseretonvoits’installersouslesplumesautoriséesla religiond’une langue françaisedontona crubondepenserqu’elleétait(déjà!)arrivée«auplushautpointdesonexcellence»(peletierdumans, 1549, citédansaurouxdir. 1992: 362).dès lors tout cequi vaapparaîtrecommeunemenacecontrelaperfectiondelalangueseraa priori refusé,rejeté,stigmatisé.
ce fétichisme de la langue, dénoncé par bourdieu et boltanski(1975),installédurablementdansl’imaginairecollectifdesfrançais(unauthentiquesur-moi sociolinguistique) est bien leproduitde l’unilin-guisme.etl’onpeutconsidérer,àlasuitedecequivientd’êtredit,quecetteconstruction idéologique estconstituéedequelquesreprésentations partagées,parfaitementsolidaires (boyer1990et1998;voirégalementmartinet1969,gardyetLafont1981,decrosse1986,knecht1993,hou-debine1994),quipeuventêtreainsiidentifiées:
- une représentationhiérarchiquedes langueshistoriques, selon la-quelleseulescertaineslangues(lefrançaisentoutpremierlieu)se-raientdotéesd’un«génie»etauraientplusqued’autresledroitd’êtreutilisées sans limitation d’espace ni de domaine et auraient doncvocationà«l’universalité».bienentendu,seloncettereprésentation,langues’opposeàdialecte;laplusbassedes«conditions»(linguisti-ques)étantenfrancelepatois,(c’est-à-direenfaitunenon-langue);
- unereprésentationpolitico-administrativedelalangue,qui,pourcequiconcernelefrançais,confondlangue«nationale»etlangue«of-ficielle»,netolèrequ’unautrestatut(d’uneclassepolitico-adminis-trativeinférieure),celuidelangue«régionale»(voire«locale»)etquiaobtenuunelégitimationconstitutionnelleen1992aveclefameuxénoncéde l’article 2: «La langue de larépublique est le français»(c’estmoiquisouligne);
- une représentationélitiste (fantasmée)deLa langue françaisequiconsidèreque l’étatdeperfectionqu’auraitatteintcettemêmelan-guenecesseraitdesedégrader.d’oùl’obsessionpuristed’un«bonusage» (denature profondément scripturale) qui vise à exclure lavariation/l’hétérogénéité(pourtantinhérentesàuneactivitélinguis-tiquecollectivenormale)sousdiversesdésignationsstigmatisantes:«charabia»,«petitnègre»,«baragouin»…ouàlesjugulerparrejetàlapériphérieàl’aided’uneopérationderepérage-codification.Lalangueestainsiposéecommeidéalementimmuable,inaltérable,in-

Boyer H.
230
dépendantepourainsidiredelacommunautéd’usagers,unelanguedontl’intégritéestsanscessemenacéede l’intérieurparsesusagers(certains?laplupart?deplusenplus?lesjeunessurtout?)etausside l’extérieur(parlesemprunts,parexemple:dansladernièrepériodelesempruntsàl’angloaméricain).
ces trois représentationsde base (il s’agit d’un dispositifminimalauquel peuvent s’intégrer d’autres représentations) s’articulent doncpourconstitueruneidéologiedontlavocationaété/estdepromouvoirl’unilinguismedanssesdeuxorientationssolidaires:interlinguistiqueetintralingualinguistique.
p.knechtobserveque«lanormalisation[si l’onadoptenotremo-délisation,ils’agiticidenormativisation]duxviiesiècle,quiamarquél’évolutiondufrançaismodernejusqu’ànosjours,aétébeaucouptroprestrictive» et que «si l’histoire de la norme française [s’était] dérou-léeselonunelogiqueinterne,àl’écartdescontraintesimposéesparlesstructuresdupouvoir»,«unautreobservateurquevaugelasauraitpusesituerdanslacontinuitéduxviesiècle,lorsquelesécrivainsplaidaientenfaveurdel’accueildemotsetdetournuresdetouteslesrégionspourenrichirlalangue,etconsidérerquelanormedulangagedefrancede-vaitpermettreàunplusgrandnombredes’yreconnaître»(knecht1993:79-82).
demêmea.martinetdéplorait-illeseffetsperversdel’unilinguis-mefrançaisendénonçantcequ’ilappelaitun«malthusianismelinguisti-queséculaire»desfrançais,nourrid’unpurismedesorigines,enmatièredenéologie.pourlui,sil’empruntàl’anglo-américainaétésiabondantdanslesdernièresdécennies,ilnefautpaschercherdecoupablehorsdefrance:cesontlesfrançaiseux-mêmes(sousl’influencedeleursgram-mairiens),quiontétéélevésdanslerespectdustatu quonormatif,danslacraintedeforgerdenouveauxmots,defairefonctionnerlaproducti-vitédusystème(martinet1969).
etenfaitl’entrepriseinstitutionnellerécente(derniertiersduxxesiècle)d’aménagement linguistique(terminologiqueenparticulier),qua-lifiée par c. hagège de néologie «défensive» (hagège 1987) n’est quel’aveud’uneimpuissancecollectivedelabase,d’unhandicapdesusagersdelalangue3.
3 apartirdudécretde1972«relatifà l’enrichissementdelalanguefrançaise»et lamiseenplacedesfameusescommissions de terminologie,plusieursdizainesd’arrêtésetdecirculairesde terminologieontétépubliésau Journal Officiel de la république Française concernantdenombreuxdomaines(santéetmédecine,informatique,audiovisueletpublicité,défense,urba-nismeetlogement,économieetfinance,géniegénétique,ingénierienucléaire,télécommunica-tions,sciencesettechniquesdel’agriculture,etc.).(Journalofficieldelarépubliquefrançaise1994)quediredesrésultatsobtenusparcetteentreprisede«néologiedéfensive»,ponctuéepar

Pour une histoire sociolinguistique de la langue française
231
Nasl
e|e 19
• 2011 • 223
-234
J’illustreraicetaspectdel’unilinguismesurlequeljeviensdem’at-tarder: lerefusde lavariation,duchangement, lepoidscoercitifde lanormepuriste,etjeleferaiàpartird’untextedepierrebourgeade,écri-
levotededeuxlois:laloibas-Lauriolen1975etlaLoitoubonen1994?s’ilestclairquelespeinesencouruespourinfractionàlaloibas-Lauriolétaientdérisoiresetdoncpeuefficaces,lapertinencesémiotiquedesnéologismesdesubstitutionproposésparlescommissionsdetermi-nologien’estpasdutoutunélémentaccessoire.
ainsi, si«baladeur»apus’imposer facilement(faceà«walkman»), si«parrainage»(«sponso-ring»)et«vtt»(«vélotoutterrain»:«mountainbike»)sontenbonnevoie,si«logiciel»estunfrancsuccès(faceà«software»),oncomprendaisémentque«présonorisation»n’aitpassupplanté«playback»pasplusque,dumoinsdansl’usagecourant,«messagepublicitaire»n’asupplanté«spot».

Boyer H.
232
vainprolixeetpolymorphenéen1927etdécédéen2009dontlanoto-riétén’ajamaisétéauzénithmaisquiajouisemble-t-il,d’unecertainereconnaissancedesescollèguesécrivains.curieusement,descendantdeJeanracine,parsamère…Ledétailestpiquant,sionl’associeàlatri-bune reproduite ci-après,publiéedans le célèbrequotidiendu soirLe monde (27mars1986),gardiencommechacunsait,d’unecertainetenuescripturale,enparticulierpourcequiconcernelalangue.
quediredececourttexte,entrediscoursépilinguistiqueplaisantetobservation grammaticale pointilleuse ? qu’il est révélateur de cet uni-linguismeversionnormativistedont la genèse est indissociablede l’ab-solutismemonarchiqueetqu’ilestduresteproduitenréactionàunfaitd’écritured’unpersonnagepolitiquedepremierplan,républicain,certes,etparticulièrement lettrémaisque leshumoristesavaientbaptisédieu.enquoi?encequ’ilsembleêtreissuprécisémentdelapression–del’ob-session-normativequihabiteenfrancetouthommedeplumedignedecetteappellationetquiprétendàlafonctiondegardiendelanorme.rele-verunefautecommiseparledieu-président,estpourluiundevoir.maisest-cebienunefaute?carsionrefusela«fauteparignorance»ainsiquela«fauted’inattention»,iln’yaplacequepourlefaitduprince…baptisé«lapsus».
ilyabienlàuneindulgencecoupablemaisquin’aenfindecomptesd’autrerésultatquede…légitimerlebonusageendonnantunbelexem-pledecesyndromebienfrançaisqu’estl’épilinguisme:latentationperma-nentedudiscoursélitistesurlalanguefrançaise.
unfaitsociolinguistiquerécentapuparaîtrecontrarierlaquêtejus-quelàsansfailledel’unilinguisme,enparticulierdanssadimensionin-tralinguistique:ils’agitdeladissidenceethnosociolinguistiquedesjeunesdespériphériesurbaines(plusparticulièrementdelarégionparisienne),la plupart nés dans des familles immigrées (d’origine maghrébine oud’afriquenoirebiensouvent)quiontentreprisdemaltraiteravecvirtuo-sitéetsystématicitélesnormesdufrançais(prosodiques,grammaticalesmaissurtoutlexématiques...),enparticulieravecl’utilisationdeprocédésargotiquesanciensouplusrécents:leverlan enpremierlieu(bachmannetbasier1984,méla1991,boyercoord.1997).néanmoins, ledispositif représentationneldontilaétéquestionplushautveillaitaugrain,sousdi-versesmodalités:pourcequiconcernela«languedescités»,lesmédias(écritsessentiellement)sesontchargésd’unabondant«cadrage»idéolo-giqueetsesontainsilivrésàune«codification»descontre-normes(augranddamdesdéviants)etfinalementàunstéréotypageenbonneetdueforme,essentiellementautourduverlan(boyer1994)…

Pour une histoire sociolinguistique de la langue française
233
Nasl
e|e 19
• 2011 • 223
-234
Bibliographie
aracil 1965: Ll.v.aracil,Conflit linguistique et normalisation dans l’europe nouvelle,nancy:cue.auroux(dir.)1992:s.auroux(dir.),Histoire des idées linguistiques, t.2,Liège:mardaga.bachmann,basier 1984:c.bachmann,L.basier,Le verlan: argotd’écoleoulanguedeskeums?,mots,8,paris:pressesdelafondationdessciencespoli-tiques,169-187.baggioni1997:d.baggioni,Langues et nations en europe,paris:payot.bourdieu1976:p.bourdieu,Lesmodesdedomination,actes de la Recherche en sciences sociales, 2-3,paris:editionsdeminuit,122-132.bourdieu,boltanski1975:p.bourdieu,L.boltanski,Lefétichismedelalangue,actes de la Recherche en sciences sociales,4,paris:editionsdeminuit,2-32.boyer1987:h.boyer,sociolinguistiqueetpolitiquelinguistique.L’exempleca-talan,etudes de Linguistique appliquée,65,paris:didiererudition,69-88.boyer,gardy1989:h.boyer,ph.gardyéds.,La question linguistique au sud au moment de la révolution française,Lengas,17-18,montpellier:sectionfran-çaisedel’associationinternationaled’etudesoccitanes.boyer1990:h.boyer,matériauxpouruneapprochedesreprésentationssocio-linguistiques,Langue française,85,paris:Larousse,102-124.boyer1991:h.boyer,Langues en conflit,paris:L’harmattan.boyer1994:h.boyer,Lejeunetelqu’onenparle,Langage et société,70,paris:maisondessciencesdel’homme,85-92.boyer(coord.)1997:h.boyer(coord.),Lesmotsdesjeunes.observationsethypothèses,langue française,114,paris:Larousse,126.boyer1998:h.boyer,Lapartdesreprésentationspartagéesdansladynamiquedesconflitssociolinguistiques,V Trobada de sociolingüistes Catalans (barce-lona,24-25avril1997),barcelona:generalitatdecatalunya-departamentdecultura,183-190.boyer 2000: h. boyer, ni concurrence, ni déviance: l’unilinguisme françaisdanssesœuvres,Lengas,48,montpellier:universitépaul-valéry,89-101.caron,kibeeet(àparaître):ph.caron,d.kibee,Lesimagesdel’autoritéenmatièredelangueenfrance(1453-1647),àparaître.decerteauet al.1975:m.decerteauet al.,une politique de la langue, galli-mard:paris.decrosse1986:a.decrosse,généalogiedufrançais:purismeetlanguesavan-te,in:m-p.gruenaiscoord,etats de langue,paris:fondationdiderot/fayard,159-201.gardy,Lafont1981:ph.gardy,r.Lafont,Ladiglossiecommeconflit:l’exempleoccitan,langages,61,paris:Larousse,75-91.hagège 1987: c. hagège, le français et les siècles, paris: odile Jacob, coll.points.

Boyer H.
234
houdebine1994:a.m.houdebine,del’imaginairedeslocuteursetdeladyna-miquelinguistique.aspectsthéoriquesetméthodologiques,Cahiers de l’insti-tut de linguistique de louvain, 20/1-2,Louvain-la-neuve:peetersetinstitutdeLinguistique,31-40.knecht1993:p.knecht,neutralisationdiatopiqueetsuspensiondel’histoiredanslanormogenèsedufrançais,Inventaires des usages de la francophonie: no-menclatures et méthodologies,JohnLibhey:paris.martinet1969:a.martinet,le français sans fard,paris:puf.mela1991:v.mela,Leverlanou le langagedumiroir,langages, 101,paris:Larousse,73-94.schlieben-Lange1996:b.schlieben-Lange,Idéologie, révolution et uniformité de la langue,Liège:pierremardaga.schöniet al.(dirs)1988:gschoeniet al.(dir.),La langue française est-elle gou-vernable ? Normes et activités langagières, neuchâtel et paris: delachaux etniestlé.trudeau1992:d.trudeau,les inventeurs du bon usage (1529-1647), paris:edi-tionsdeminuit.valleverdu1980:f.valleverdu,aproximació crítica a la sociolingüística cata-lana,barcelona:edicions62.
Анри БоајеЗА СОЦИОЛИНГВИСТИЧКУ ИСТОРИЈУ ФРАНЦУСКОГ
ЈЕЗИКА. ДУГОРОЧНА НОРМаТИВИЗаЦИЈа И НОРМаЛИЗаЦИЈа ФРАНЦУСКОГ
РезимеПосматрањемразвојафранцускогјезикајасносеуочавадасејезичка нормативиза-
цијаодвијалаупоредосасоциолингвистичком нормализацијом,ускладусаполитичкиморијентацијамаиновимкомуникативнимпотребамамонархијеуразвојутокомxviвека.Нијемањеприметнонидасупроцесинормативизацијеинормализацијепратилијезичкуунификацијутериторије,анамећесеидасубилиињенглавниуслов,дотледасеможесматратидасуовадвапроцеса–једанкојисеодносинанормирануупотребуфранцу-ског језика, а другина однос језикаКраља, а потоми језикаРепублике, према другимконкурентским језицима – надахнута истом социолингвистичком идеологијом, која јеквалификованакаоунилингвизам (видетинпр.boyer2000)икојаделаодсамогиздвајањафранцускогкао језикадруштвенекомуникацијеи тоудугорочномсмислу,премадве-масолидарнимдимензијама:интрајезичком унилингвизму,којинамећепоштовањеин-тегритетафранцускогјезика,његове„чистоте“,иинтерјезичком унилингвизму,којитежида наметне социјеталну ексклузивностфранцуског језика на целокупности територијаФранцуске.
Примљено: 28. 1. 2011.

235
УДКрад
Snežana GudurićFaculté de philosophie, université de Novi sad
L’EXPRESSIoN DE L’HYPoTHèSE EN FRANçAIS ET eN SerBe - uN APerçu GéNérAL 1
Lefrançaisetleserbe,appartenantàlamêmefamillemaisauxdif-férentsgroupes linguistiques,utilisent lesmodalitésdifférentesde l’ex-pressiondel’hypothèse.qu’ellesoitsituéedansleprésent,danslefuturoudanslepassé,ouqu’ellesoitréelle,potentielleouirréelle,l’hypothèseenfrançaispeuttoujoursêtreintroduiteparlemêmeconnecteur–si,etc’estauniveaudeformesverbalesetdelocalisateurstemporelsquel’onfaitladistinctiondel’époquedanslaquellel’hypothèsesesitue.Lechoixduconnecteursiàvaleursémantiquehypothétiquebloquel’utilisationdecertainesformesverbalesfrançaises.enserbe,ladistinctionentreunehypothèseréelle,potentielleouirréellesefaitdéjàauniveauduconnec-teurqui,unefoischoisi,permetoubloquel’emploidecertainesformesverbales.Lescasoùlesdeuxlanguesutilisentlesmêmesformesverbalespourexprimerl’hypothèseselimitent,engénéral,auxsituationsoùl’hy-pothèse,situéeauprésent,estconsidéréecommeréelle.pourlaforma-tiondesautrestypesdestructureshypothétiques,lesdeuxlanguesem-ploientlesformesverbalesdifférentes.cependant,certaineshypothèsesiréellesetpotentiellespeuventêtremisesenformesverbaleséquvalentedanslesdeuxlanguesmaisàconditionqu’onsupprimeleconnecteursi danslesstructuresfrançaises.
Mots-clés:syntaxe,hypothèse,propositionconditionnelle,français,serbe
1. Introductionen français ainsi qu’en serbe, les deux caractéristiques de l’hypo-
thèsesevoientfondamentales:l’unequiportesurledomainetemporeldanslequell’hypothèseenquestionestsituée(présent,passéoufutur)etl’autrequiportesurletypedel’hypothèse(réel,potentielouirréel)2.
1 radjeurađenuokviruprojektabr.178002ministarstvazanaukuitehnološkirazvojrepu-blikesrbijeJezici i kulture u vremenu i prostoru.
2 m.ivićproposeunetroisièmecaractéristiquecommefondamentalle-celleportantsurlesu-jetparlantetdéfinieàpartirdufaitsilesujetparlantpeutounepeutsavoirquelestlarelationduprocèsexpriméparleverbedelaprotaseaveclaréalité(v.ivić1983:146).

Gudurić S.
236
Lefrançaisetleserbeontdéveloppédesmoyensdifférentsdel’ex-pressiondel’hypothèsesuivantletypedurapporthypothétiqueexpri-mé.àcettefin,lefrançaisutiliseleconnecteursi,qu’onpeutconsidé-rercommeneutrequantautypedel’hypothèse,etlesformesdestempsverbauxdel’indicatifaveclavaleurmodaleainsiqu’uncertainnombredecompléments,pourlaplupartdetemps,maisaussidelieuetdema-nière(modificateursdel’énoncé).Leserbe,parcontre,faitladistinctiondutypedurapporthypothétiqueauniveauduconnecteurdéjà:d’unefaçongénérale,leconnecteurakoindroduitl’hypothèsediteréelle,kadl’hypothèseditepotentielleetdal’hypothèseappartenantautypeiréel.Leconnecteursiestutilisédanslesprotases(propositionsubordonnéehypothétique)quisituentl’hypothèseauprésent,aufuturouaupassé,tandisquelesconnecteursserbessevoientplusrigides:akopeutsetrou-verdanslesprotasesdontleprocèsestsituédanstouslestroisdomainestemporels(quoiqueakosoitrareencombinaisonaveclaformedufutur),kad3danslesprotasessituéeauprésentetaufutur,etdasetrouventdanslesprotasesdontleprocèsestsituéesdansleprésentoudanslepassé.
danslesdeuxlangues,lesdeuxprocès(celuidelapropositionprin-cipale–apodoseetceluidelapropositionsubordonnéehypothétique)formeunrapportparticulierdecauseetdeconséquence,etpeuventap-partenirsoitaumêmedomainetemporelsoitauxdomainestemporelsdifférents.
2. Le type réel du rapport hypothétiquece type est caractérisé par l’hypothèse qui est située dans le pré-
sentoudanslefuturetquiestconçuecommetoutàfaitréelle,probableet réalisable. Les deux langues témoignentune équivalence étonnantequantauxmodalitésdel’expressiondecetypedurapporthypothétique:lesconstructionslesplusfréquentessontcellesquiontleprésentdanslaprotaseetlefuturouleprésentdansl’apodose,maislesdeuxlanguespeuventégalementexprimerlemêmerapportavecle passé composé / le parfait(perfekat)danslaprotasetoutenconservantlefuturoulepré-sentdansl’apodose.
3 ilnefautpasconfondrekadtemporeletkadhypothétique.danslaphraseKad budeš došao (dođeš), ispričaću ti svekadestuneconjonctiontemporelle,parcontre,danslaphraseKad bi došao, ispričala bih ti sve,kadestuneconjonctionàvaleurhypothétique.L’emploidekadhypothétique impose leconditionneldans laprotase, tandisquekad temporelseconstruitaveclesformesdel’indicatif(présent,futurii).

L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général
237
Nasl
e|e 19
• 2011 • 23
5-24
5
constructionsfondamentales français serbeConnecteur si ако4
tempsverbaldslaprotase présent,(passécomposé) презент,футур,(перфекат)tempsverbaldsl’apodose présent,futursimple, презент,футур, impératif, (passé composé) императив, (перфекат)
exemples:А)Lescaslesplusfréquentssontceuxavecleprésentdanslapro-
taseetlefutursimple/futuroul’impératifdansl’apodose.protase:présent situveux, Акохоћеш,apodose:présent/Презент jetelesoffre. поклањамтиих.futursimple/Футур jetelesoffrirai. поклонићутиих.impératif/Императив donne-lesmoi. поклонимиих.
b)danslacombinaisonavecleprésentdanslaprotaseetleparfait(перфекат)dansl’apodoseenserbe,leparfaitobtientunevaleurmodaleetestmarquéparletraitdel’accompli,cequicorrespondàl’emploid’uneformeàvaleur«résultative»danslaphraseéquivalentefrançaise:
Ако дођеш, добро си дошао./ si tu viens,sois le bienvenu.(«tueslebienvenu»)Ако проговориш, завршио си. / si tu parles, tu es foutu.5 («tu as fini»)
c)La combinaison avec le futur dans la protasen’est pas typiquepourleserbecontemporain,maisc’estuneconstructionqu’onretrouvedans la langueparlée.sonéquivalent françaisauratoujours leprésentdanslapropositionsubordonnée:
Ако ћеш доћи, понеси ми своје белешке. / si tu viens, apporte-moi tes notes.Ако ћемо већ ићи у град, купићемо и новине. / si on va déjà en ville, on achètera/ on achète le journal aussi.
enfrançais,iln’estpaspossibledeplacerlefuturaprèsleconecteurhypothétique si. Le serbe ne connaît pas une restriction aussi stricte,bienquel’emploidufuturdanslaprotasenesoitpashabituel.
d)Laprotasefrançaise,taetcommele,peutconteniruntempsdupassé:enfrançais,c’estlepassécomposéquiexprimeunprocèsaccom-
4 enlangueserbe,ilyaencoretroisconnecteursintroduisantcetypedepropositionhypothé-tique::уколико,у случају даetли:Уколико узмеш/У случају да узмеш/Узмеш ли, кајаћеш се, уколико не узмеш/у случају да не узмеш/ не узмеш ли, опет ћеш се кајати./si tu en prends, tu regretteras, si tu n’en prends pas, tu regretteras aussi.Leconnecteurако,étantleplusfréquentdanslalangueserbecontemporaine,représenteleconnecteur-prototype.
5 Lefrançaisutiliselepassif,entreautre,pourdésignerlerésultatd’uneactionoud’unprocès.

Gudurić S.
238
plietenserbe,engénéralc’estleparfaitd’unverbeperfectif(engéné-ral,maispasforcément).Lesdeuxlanguesconserventdansl’apodoselestemps verbaux caractéristiques pour ce type du rapport hypothétique(futur,présent;passécomposé/parfait):
а)s’il est arrivé, on pourra / peut le faire ensemble. Ако је дошао, моћи ћемо / можемо то да урадимо заједно.
b)si j’ai bien compris, tu partiras demain / pars / tu a décidé de partir. Ако сам добро разумео, (от)путоваћеш / путујеш / одлучио си да отпутујеш сутра.6
dansl’exempleb)laconditionexpriméedanslaprotasen’estpaslacausedirectedelaréalisationduprocèsexprimédansl’apodose,c’est-à-direlerapportétablientrelaprotaseetl’apodosen’estpasunvéritablerapportdecauseetdeconséquence.autrementdit,lefaitquel’interlo-cuterpartiraounonnedépendpasdufaitquelelocuteuraoun’apascomprisl’énonciationenquestion.7
e)protase:enfrançais–présent +si enserbe–présent + ли situleveux, Желишлито,apodose Futur je te l’offrirai. ја ћу ти га поклонити.
suivant un contexte plus large ou une intonation particulière, ilestpossiblequelesegment«желиш ли то»prennelesensde«кад би желео».encecas-là,l’équivalentfrançaisseralaphrasesi tu le voulais, je te l’offrirais,appartenantautypepotentieldurapporthypothétique.
ilestànoterqueleprésentcombinéavec lidans laprotaseserbe,bloquel’emploiduconditionneldansl’apodose.c’est-à-dire,laconstruc-tionsuivanteestcorrecte:
Ако размислиш, могао би и да погодиш.enmêmetemps,laconstructionquisuitn’estpasacceptable:*Размислиш ли, могао би и да погодиш.pourqu’uneconstructionhypothétiqueintroduiteparlastructure
le présent+lisoitgrammaticalementcorrecte, lefuturestderègledansl’apodose:
Размислиш ли, погодићеш.
6 L’emploidétaillédesverbesperfectifsetimperfectifsdansdesconstructionspareillessortducadredecetarticle.pourplusdedétailsvoirКаtičić,sintaksa(1986:269).
7 pourplusdedétailsvoirl’articledeveravasićKondicionalne klauze sa nekonsekutivnom apo-dozom (vasić2000).

L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général
239
Nasl
e|e 19
• 2011 • 23
5-24
5
f)un cas particulier peut apparaître dans les situations où l’on al’apodoseentêtedephraseavecunimpératifetlaprotaseavecunpré-sent:
appelle-moi, s’il y a lieu. / Позови ме ако (за)треба. L’équivalentserbepeuts’approcherautypepotentielselonlecontex-
te(Позови ме ако (за)треба = ако буде потребно).dans l’exempleПозови ме кад затреба, le connecteurкад aune
valeurtemporelleetnonhypothétique(cf.note4).
3. Le type potentiel du rapport hypothétiqueLacaractéristiqueessentielledecetypeestquel’hypothèseestsituée
dansledomainedupossible,qu’elleestcontestée,cequimetendoutelaréalisationduprocèsexprimédanslapropositionprincipale.constructionfondamentale Français serbea)connecteur si кад,ако,уколико protase imparfait conditionneli apodose conditionnelprésent conditionneli
exemplesprotase:français–imparfait serbe–conditioneli situvoulais, Кад/(ако/)уколикобихтеоapodose:conditionnelprésent/conditionneljetelesoffrirais. јабихтиихпоклонио.
4. Le type iréel du rapport hypothétiquea)pour exprimer le rapport hypothétique irréel, le français ainsi
queleserbepeututiliserlamêmeconstructionquepourletypedurap-portpotentiel:
sphèredutypedurapporthypothétiquepotentiel:
1. s’il faisait beau demain, on pourrait aller se baigner. Кад би сутра било топло, ишли бисмо да се купамо.
2. sij’avaisletemps,jeleferais. Кадбихимаовремена,mogaobihtodauradim. / Kad bih imao vremena, урадио бих то.(Lerapport s’approchedeceluid’iréel–cesontlecontexteetl’intonation quiledéterminentplusprécisément.)
sphèredutypedurapporthypothétiqueirréel:

Gudurić S.
240
1. s’il faisait beau maintenant, on pourrait aller se baigner(maisilpleutencemoment). 1а.Кад би (садa) било топло, ишли бисмо да се купамо(ј’implique d’unefaçonimlicitequ’ilfaitfroidaumomentdelaparole). 1b.Да је (сада) топло, ишли бисмо да се купамо(да је топло=il nefaitpaschaud)
2. si j’avais le temps, je le ferais tout de suite.(implicationtacite:maisjen’aipasletemps). 2а.Кад бих имао времена, урадио бих то одмах(maisj’implique d’unefaçonimplicitequejen’aipasletemps). 2b.Да имам времена, урадио бих то одмах (да имам=немам/ je n’ai pas).
tandisquelefrançaisutiliselesmêmesformesverbalesetlemêmeconnecteurpourlesdeuxacceptionsdurapporthypothétiquedifférent,dontletypeestdéfiniparlesmodificateursspécifiquesdel’énoncé(dansnotreexemple,cesontlescomplémentsdetemps:l’adverbemaintenantetlalocutionadverbialetout de suite),leserbepeutdéterminerletypeparlechoixduconnecteur,cequiimposel’emploidelaformeverbalesprédéfiniedanslaprotase,maisn’entraînepaslechangementdelaformedansl’apodose.
Letypedurapportpotentielenserbeestmarquéparleconditioneli dans laprotase, par contre, le connecteur introduisant le type irréel(da)vaimposerl’emploiduprésentmodal.danslesdeuxtypeѕ,laformeverbaledel’apodoseestleconditionnel.
b) Le connecteurкад peut introduire une hypothèse absolumentiréelle,baséesuruneconditionimpossible.encecas-là,c’estlasémanti-quedesunitéslexicalesdelaphraseconditionnellequidéfinieletypedurapporthypothétiqueirréel:8
1. Кад би малине биле јабуке, лакше би се брале... si les framboises étaient des pommes, il serait plus facile de les cueillir.
2. Кад би баба била девојка, и она би се у коло хватала... si veille femme était jeune fille, elle aussi entrerait dans la danse.
Lastructurerelevantdurapporthypothétiquepotentielnecorres-pondpasàl’acceptioncognitivedel’énoncéétantdonnéquel’hypothèseexpriméedanslaprotasenepeutenaucuncasêtreréalisée.contraire-mentàl’indiceformel,ils’agitdoncicid’unrapporthypothétiqueirréelvul’impossibilitéabsoluedelaréalisationduprocèsexprimédansl’apo-dose.
8 plusdétaillédansВасић2000:177.

L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général
241
Nasl
e|e 19
• 2011 • 23
5-24
5
c)Le connecteur spécialisé pour l’introduction d’une hypothèseiréelleenserbecontemporain,da¸commeonl’adéjàmentionné,réduitlechoixdetempsverbauxdanslaprotaseàdeux:présentetparfait,se-lon que le procès est situé dans le présent ou dans le passé. en fran-çais,l’hypothèseiréelleestmarquéeparlechoixdelaformeverbale(leplus-que-parfait,sil’hypothèseestsituéedanslepassé,parl’imparfait+modificateurs syntaxiques (+contexte) si l’hypothèseest situéedans leprésent,v.iii.a)etb).
constructionsfondamentales
a)Lesdeuxprocèsaupassé
Français serbea) Connecteur si da protase plus-que-parfait parfait apodose conditionnelpassé conditionneli(ii)
si tu avais voulu, Da si hteo, tu me les aurais offerts. ti bi mi ih (bio) poklonio.
b)protase plus-que-parfait parfait apodose subjonctifplus-que-parfait conditionnel
si tout s’était arrêté là, Da je ostalo samo na tome, les habitudes sans doute sve bi prešlo u zaborav. l’eussent emporté.
c) protase subjonctifplus-que-parfait parfait(plus-que-parfait) apodose conditionnelpassé conditionnel(iouii)
l'ennemi aurait eu beau jeu, Neprijatelj bi nas (bio) gađao žestokos'il eût voulu de nous pour cibles. Da nas je (bio)uzeo na nišan.
d)protase subjonctifplus-que-parfait parfaitapodose subjonctifplus-que-parfait conditionneli
mes succès, s’il y eût assisté, Da ih je doživeo, ne l’eussent pas le moins Moji uspesi ga ne bi nimalo du monde ébloui. zadivili.
b)L’hypothèseauprésent,propositionprincipaleaupassé

Gudurić S.
242
Français serbeconnecteur si daprotase imparfait présent(modal, atemporel)apodose conditionnelpassé conditionnel
si tu étais plus intéligent, Da si pametniji, tu aurais déjà compris. već bi razumeo.
nb.Leverbeserbemoći –permetl'emploiparallèleduconditionneletduparfait:Da govorim italijanski, juče sam /bih mogao da pomognem našoj lektorki./ si je parlais italien, j’aurais pu aider notre lectrice hier.
c)L’hypothèseaupassé,propositionprincipaleauprésent
Français serbea) Connecteur si da protase plus-que-parfait parfait apodose conditionnelprésent conditionneli s’il avait lu ce livre, Da je pročitao tu knjigu, il comprendrait de razumeo bi o čemu quoi nous parlons. pričamo.
5. Un cas particulierLa caractéristique générale des protases françaises introduites par
siestqu’ellesnepeuventcontenirdeformesverbalesàradicalen–r;decefaitnifuturniconditionnelnesontutilisésdanscetypedeproposi-tions.
Lesprotasesserbesintroduitesparlesconnecteursкадetaкon’ex-cluentpasl’emploiduconditionnel.
celaneveutpasdirequ’unepropositionfrançaiseexprimantl’hy-pothèse ne peut en aucun cas contenir le conditionnel. La restrictionseformeauniveaudelastructuresiprotase + v en -rapodose,c’est-à-direlastructurequisous-entendlerapportdesubordinationentrelesproposi-tions.sionplaceunconditionneldanslapropositionexprimantl’hypo-thèse,lasuppressionduconnecteursiestobligatoireetdecettefaçononauraunsystèmededeuxpropositionsindépendantesjuxtapposées:

L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général
243
Nasl
e|e 19
• 2011 • 23
5-24
5
Je serais toi, je le ferais autrement. / Да сам на твом месту, ја бих то другачије урадио. / Кад бих био на твом месту, ја бих то другачије урадио.
6. ConclusionLes exemples présentés dans ce texte laissent évidents quelques
faits:1. Les propositions hypothétiques françaises introduites par si et
leurséquivalentsserbes,appartenantautypedurapporthypothétiqueréel, coïncidentаupointdevuede ladistributiondes tempsverbaux:danslaplupartdescas,lesdeuxlanguesontleprésentdanslaprotaseetlefuturouleprésentdansl’apodose,leserbefaisantunchoixparticu-lierduconnecteur.Ladifférenceentrelesdeuxlanguesapparaîtdanslescasoùlaprotaseserbecontientlefutur(constructionbienrarequoiqueprésentedanslalanguecontemporaine)cequin’estpaspossibleenfran-çais.
2. Les deux langues montrent plus de divergences dans l’expres-siondutypepotentieldurapporthypothétique.tandisquelefrançaisconservelemêmeconnecteur(si),leserbeaunchoixpluslarge,toutenayantcommetypiqueleconnecteurkad.Lesformesverbalesemployéesdanslaprotasesontdifférentespardéfinitiondanslesdeuxlangues,tan-disquecellesdel’apodosecooïncident.
3.àladifférenceduserbe,laprotasefrançaiseintroduiteparsinepeutjamaiscontenirlaformeduconditionnel.cependant,l’emploiduconditionnelestderègleencasquel’onsupprimeleconnecteursidelastructureprincipale + subordonné, cequiamèneàunestructureforméededeuxpropositionsindépendentesjuxtapposées.
4.Lefrançaisconservelemêmeconnecteur(si)etdéfinitletypedurapporthypothétiqueàl’aidedesformesverbalesetdesmodificateurs,leserbefaitlechoixdurapporthypothétiquedéjàauniveauduconnec-teur.
5.Le françaispossèdeunchoixdeformesverbalesbeaucouppluslargeque le serbequant à l’expressiondu rapporthypothétique situéedanslepassé,surtoutdanslalanguelittéraire.
6. parlaformecaractéristiquedutypepotentiel, lesdeuxlanguesexprimentle
rapporthypothétiqueirréel,enutilisantlesmodificateurs.ilestdifficiledeparlerdel’expressiondel’hypothèseenfrançaiset
enserbeense limitantàunedirectiond’analyse:du françaisauserbeouinversement,duserbeaufrançais.c’estlaraisonpourlaquellenotreanalysenesuitpasunedirectiondemanièreconséquentemaisachange,

Gudurić S.
244
detempsentemps,pourmettreenévidencecertainesstructuresserbestoutà faitparticulièresetdont la traductionpourrait s’avérerdifficile.nousnoussommesproposédeprésenterlestraitsgénérauxportantsurlesdifférencesetlesressemblencesdessystèmeshypothétiquesdanslesdeux langues, tout en laissantdecôté certainesutilisationsqui appar-tiennentsoitàlalanguearchaïque(utiliséeparcertainsécrivainsserbes)soitauxdifférentesvariantesstylistiquespeufréquentesdanslalanguecontemporaine.
Bibliographie
béchade 1986:h.d.béchade,syntaxe du français moderne et contemporain,paris:p.u.f.guillaume 1929:g.guillaume,Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps,paris:champion.imbs1968:p.imbs,l’emploi des temps verbaux en français moderne, essai de grammaire descriptive,paris:klincksieck.katičić1984-85:r.katičić, vrstepogodbenihrečenicaustandradnomjezikusrpskomilihrvatskom, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, xxvii-xxviii,novisad:Мaticasrpska,339-343.katičić1986a:r.katičić,sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Nacrt za gra-matiku,zagreb:Jazu–globus.katičić1986b:r.katičić,Novi jezikoslovni ogledi,zagreb:Školskaknjiga.vet1980:co.vet,Temps, aspects et adverbes de temps: essai de sémantique for-melle,genève:droz.petrović2002:n.petrović,Francuska glagolska vremena II: Imperfekat, aorist, perfekat,beograd:filološkifakultet–narodnaknjiga.stanojčić1997:Ž.stanojčić,Lj.popović,gramatika srpskog jezika,beograd:zavodzaudžbenikeinastavnasredstva.stevanović 1974:m. stevanović, savremeni srpskohrvatski jezik II, beograd:naučnaknjiga(drugoizdanje).stevanović 1975: m. stevanović, savremeni srpskohrvatski jezik I, beograd:naučnaknjiga.tanasić1996a:С.Танасић,Презент у савременом српском језику,Београд:ИнститутзасрпскијезикСАНУ.tanasić1996b:С.Танасић,Синтакса глагола, in:ПиперП.исарадници,Синтакса српског језика. Проста реченица,Београд:ИнститутзасрпскијезикСАНУ-Београдскакњига-Матицасрпска.vasić 2000: В. Васић, Кондиционалне клаузе са неконсекутивномаподозом,Јужнословенски филологЛВИ/1-2,Београд:ИнститутзасрпскијезикСАНУ,177-185.

L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général
245
Nasl
e|e 19
• 2011 • 23
5-24
5
wagner 1962:r.L.wagner, J. pinchon J,grammaire du français classique et moderne,paris:hachette-puf.wilmet1976:m.wilmet,Étude de morpho-syntaxe verbale,paris:klincksieck.wilmet1997:m.wilmet,grammaire critique du français,paris:duculot-ha-chette.
Снежана ГудурићИЗРАЖАВАЊЕ ХИПОТЕЗЕ У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ
ЈЕЗИКУ. ОПШТИ ПОГЛЕДРезиме
Иакофранцускиисрпскијезикприпадајуистојјезичкојпородици,оникористераз-личитаграматичкасредствазаизражавањехипотезештонечудибудућидаприпадајура-зличитимјезичкимгрупама.Билодајесмештенаусадашњост,будућностилипрошлост,билодајереална,потенцијалнаилииреална,хипотезасеуфранцускомјезику,уначелу,увекможеувестиистимконектором–si,доксеназнакевезанезавремеукојејехипотезасмештенадајуувидуглаголскихобликаивременскихлокализатора.Изборконектораsiсахипотетичкомвредношћублокираупотребапојединихфранцускихглаголскихоблика.Усрпскомјезику,дистинкцијаизмеђуреалне,потенцијалнеилииреалнехипотезеуводисевећнанивоуконекторакојиомогућавајуилиблокирајуупотребупојединихглаголскихоблика.Случајевиукојимадва језикаупотребљавајуисте глаголскеоблике заизража-вањехипотезесводесу,уначелу,наситуацијеукојимајехипотезапосматранакаореалнаусадашњостиилиубудућности.Заобликовањедругихтиповахипотетичкихструктура,два језика употребљавају различите глаголске облике.Ипак, појединеиреалнеилипо-тенцијалнехипотеземогусенаћиуистоветнимглаголскимформамауобајезика,алиутомслучајууфранцускомјезикугубисеконекторsi, нестајесубординиранереченичнеструктуре,адобијасесистемоддвејукстапониранеклаузе.
Примљено: 31. 1. 2011.


247
УДКрад
Mihailo PopovićFaculté de philologie, université de Belgrade
Le chAMP oNoMASIoLoGIque Du «TrANSferT De PoSSeSSIoN» eN frANçAIS
nous examinonsdans cet article les propriétés desprincipaux ac-tantsdutransfertdepossesionainsiquelesrelationsentreeux.Lesac-tantsindispensablesàchaqueprocèsdutransfertdepossessionsont:«ledonneur»,«l’acquéreur»et«l’objetdutransfert».Lesactantsaccessoires(maisobligatoirespourcertainesrelations)sont:«lacontre-valeur»et«ladurée».ilexistetroisrelationsfondamentalesentrelesactantsobligatoi-resquipeuventêtresommairementreprésentéesparlesverbesdonner, recevoiretéchanger.L’examendesverbessusceptiblesd’exprimercesre-lationsdémontrequ’ilyaentrecesverbesdenombreuxcasdeneutra-lisationdesdifférencesspécifiques,cequifaitressortirlesphénomènesd’hyperonymieetdesynonymie.
Mots-clés:échange,possession,actants,donneur,acquéreur,contre-valeur,durée
Lecentredenotreintérêtestleconceptduprocèsdu«transfertdepossession»,expriméparleverbe(v).ceprocèsexigeauminimumtroisactants1:a–«donneur»,b–«acquéreur»,etc–«objetdutransfert»,soit:Paul donne quelque chose à Pierre:a→c→b.
Lesactantspeuventêtreimplicites:- Tiens, je donne sans compter, moi. - et moi, je reçois de même, mon-
sieur. Oh! nous sommes tous deux des gens de bonne foi2.(Jedonneqqch.àqqn;jereçoisqqch.deqqn.)
Le simple impératifdonne ! sous-entend trois actants: toi,moi etl’objetdutransfert3.
1 nous employons ici le terme d’actant d’après la terminologie de L. tesnière. L’actantdésignelesêtres, leschosesetlesconceptsqui,demanièresdiverses,participentauprocèsexpriméparleverbe.Lesactantssonttoujoursdessubstantifsouleurséquivalents.ilssontindispensablespourqueleprocessusaitlieu,etilsremplissentlesfonctionsdusujetetdescompléments(direct,indirectoucirconstanciel)delaphrase.Lesverbessontcaractérisésparlenombred’actantsqu’ilspeuventavoir.dansd’autrestérminologies,l’onparledesplaces,oudesarguments.(L.tesnière,1959,pp.102,105etsq.).
2 a.r.Lesage,turcaret,ingR.3 parexemple,danslecontexte:- Tu veux une cigarette ? - Donne !

Popović M.
248
parmi les verbes désignant le «transfert de possession», que, parcommodité,nousappellerons«lesverbesd’échange»,ilyenaquipeu-ventavoirseulementunoudeuxactants:le temps change. l’arbre donne des fruits.mais,danscecas,iln’yapasdetransfert.
il est évidentque, du fait de leurpolysémie, ces verbesdésignentd’autresprocèsqueletransfert:Cela me donne envie de rire. Ils ont ob-tenu de très bons résultats.
Letransfertdepossessionayantlieuentredeuxactants,leprocèsin-verse(antonymique)estsous-entendu:a→bprésupposea←b(donnerprésupposerecevoir;offrir,accepterourefuser;vendre,acheter;etc.).
Lesème/possession/estenrelationdeprésuppositionparrapportauxautressèmesqualifiantlesverbesd’échange.c’est-à-direqueleverbeavoirpréexisteàcesverbes:pourpouvoirdonner,ilfautd’abordavoir4.cesèmesignifieaussi«avoirlepouvoirdedonnerquelquechose»:il lui a donné l’autorisation de partir.
Lesactantsa,betcsontindispensablespourleprocèsdutransfertdepossession,maisilsnesontpaslesseulsquiyparticipent.parexem-ple,danslaphrase:
Paul a vendu sa voiture à jean pour 4000 €.nousavonsunquatrièmeactant,d,quenousappellerons«contre-
valeur»,danslesenslepluslargeduterme.dansl’exempleLe président a récompensé Paul de sa loyauté en le nommant ambassadeur en grèce,l’ac-tantadonneàb(paul)l’objetdutransfertc(leposted’ambassadeur);badonnéàalacontrepartied(saloyauté).L’actantdcontientsouventuneidéedecause:paulaétérécompenséparcequ’ilavaitétéloyal;il a généreusement rémunéré le concours de ses assistants(illesarémunérésparcequ’ilsl’ontaidé).
dansl’exemple:Paul a loué son appartement à Jean pour 1000 € par mois, pour une
durée de deux ans.apparaîtunautreactant,e–«durée».donc,cinqactantssontsus-
ceptiblesdeparticiperauprocèsdel’échange,donttrois(a,b,c)sontobligatoires,etdeux(dete)quipeuventêtreaccessoires.
nousallonssoumettreàl’examenlesverbessusceptiblesd’exprimerletransfertdepossessionainsiquelespropriétésdesactantsa,b,c,dete.
ilpeutyavoirtroistypesderelationsentreaetb:i.a→b(pauladonnéungâteauàanne.)ii.a←b(paulareçuuncadeaudesongrand-père.)iii.a↔b(paulaéchangédestimbresavecJean.)
4 cf.la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
249
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
I. A → BL’archisémème de ce groupe de verbes est «faire en sorte que
quelqu’unaitquelquechose».Donner Lesémèmequiimpliquel’idéedutransfertdepossesionest«céder
gratuitement et volontairement lapropriétédequelque chose».donc,celaexclut,enprincipe,lesactantsdete:lapropriétéestcédéegratuite-mentetpourtoujours:
Il a donné un chocolat à sa petite nièce.L’objetdutransfert(c)peutêtreimplicite:elle donne aux pauvres.L’actantbpeutluiaussiêtreomis:Il donnerait sa chemise, tant il est généreux.oubien,lesdeuxactants,betc,sontsous-entendus:donner est plus doux que recevoir5.Lesactantsaetbontletraitsémantique/animé/6,/humain/ou/
non-humain/(Paul donne de l’avoine au cheval. l’oiseau donne la bécquée à ses petits.)
L’objetdutransfertpeutêtreconcretouabstrait.maischaquecom-plémentd’objetdirectneremplitpas forcément le rôledec.dans lesexemplessuivants,iln’yapasde«transfertdepossession»:
Paul a donné une gifle à Jean; Donne-moi ma robe de chambre ! L’actantcdoitavoirletrait/êtrepossédépara/.donc,cappartient
àa.Lesème/possession/d’unobjetdutransfertabstraitestàprendreausenstrèslarge:
il m’a donné sa parole qu’il paierait son dû. (ila saparole7; iladel’intégrité)
il m’a donné un renseignement.(ilétaitenpossessiondecerensei-gnement)
il nous a donné son opinion.(ilavaituneopinion)Le trait /possession/ attribué àunepersonnen’est pas impossible,
maisrelèveducontextehistorico-social:donner sa fille en mariage à un jeune homme8.
unsémèmededonnerpeutavoirl’actantd(«contre-valeur»).ainsidonnerentreenrapportdesynonymieavecacheter ouvendre:
je vous donne quatre mille euros pour votre voiture.
5 renan,vie de jésus,ingR.6 sinon,iln’yapasd’idéedetransfertetleverbeestcausatif:Cette odeur me donne la migraine.
Cet argument donne du poids à sa thèse.7 cf.N’avoir qu’une parole.8 cf.mon père m’a donné un mari(chansonenfantine).

Popović M.
250
Donnez-moi un kilo de pommes !L’actante(«durée»)peutluiaussiapparaître,cequirapprochedon-
neretprêter:Il ne rend jamais ce qu’on lui donne.enfrançaispopulaire,filerpeutêtresynonymededonner:il lui a
filé quelques pièces.Refilerpeutavoirlemêmesémème,maispeutaussiavoiruntraitdeplus:l’objetdetransfertn’apaslavaleurqu’ilestcenséavoir.donc,ilyauneintentiondélibéréedelapartdeadetromperb:On ma refilé un faux billet.Refilerpeutêtreunhyponymededonnerouvendre.
Transmettretransmettre ne contient que les actants a, b et c. L’opération de
transfertestfaiteparunevoielégale:Le donateur transmet au donataire la propriété des choses données9.
L’actantcpeutêtreconcretouabstrait.transmettreaunsensassezlargepourpouvoirêtresynonymededonner, céder, léguer et transférer.
Abandonnerceverbeexcluelesactantsdete.Letraitsémantiqueprédominant
est/renonciationàlapossession/:elle a abandonné sa fortune à ses neveux.AllouerL’actant a représente une personne ou une institution ayant une
autoritéréelle.L’actantcest«unesommed’argent»:[...] si jamais vous reprochez à un savant qui fait quelque honneur à
son pays de ne pas gagner la faible somme que l’État lui alloue [...]10.paranalogie,cpeutavoiruncontenupluslarge:Le commandement allié n’allouerait aux forces françaises qu’un mini-
mum de munitions11.L’actantdn’estpasexclu:en échange de l’œuvre que voici, je vous ai alloué une somme de trois
cents francs, […]12.ceverbepeutavoirl’actante:allouer un crédit à qqn.CéderL’actantcreprésenteunechose,unbien,undroitouunavantage.
Céderpeutavoirlestraits/volontairement/et/sanscontrepartie/:Je vous cède cet objet auquel je tiens pourtant beaucoup.cependant,cestraitsnesontpasobligatoires:
9 académie.10renan,questions contemporaines,ingR.11ch.degaulle,mémoires de guerre,intLF.12r.rolland,jean-Christophe,intLF.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
251
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
Il a été obligé de céder ses droits pour une somme dérisoire13.L’actantepeutluiaussiêtreprésent.dansCéder un bailtouslescinq
actantsinterviennent.Concéderdanslalanguecourante,ceverbecontientletrait/faveur/:accorder
qqch.àqqncommeunefaveur.L’actantaestuneautoritésupérieure.L’actantcpeutêtreunbien,undroit,unprivilège:
Les rois avaient concédé de grands privilèges à certaines villes14.danslalanguejuridique,concédercontientlesactantsdete(sou-
ventimplicites):Le gouvernement a concédé l’exploitation de cette mine à la compagnie
métalcop.GratifierLestraitssémantiquesspécifiquesdeceverbesont/desongré/et/
libéralité/.L’actantdestsouventabsent,maisilpeutêtresous-entenduoumêmeexplicite:
Je lui appris ensuite que le généreux Portugais, en me chargeant du portrait, m’avait gratifié d’une bourse de cinquante pistoles15 (sc. «pouravoirtransmisleportrait»).
DoterL’actantc représente enpremier lieuune sommed’argent, un re-
venu,maisaussiunbien,ettrèssouventilestimplicite:Napoléon a doté ses sénateurs.
L’actantbpeutêtreunepersonnemorale:Doter une fondation, un collège, un couvent.
L’actanteestenprincipeabsent,maisl’actantdn’estpasexclu:On lui doit la Bibliothéque. Ce ne fut pas une petite affaire. Il fallait
d’abord l’acheter, puis la placer, puis doter le bibliothécaire16.(bestdotépoursontravail,etceverbeesticisynonymedepayerourémunérer.)
RécompenserRécompenserpossèdetoujoursl’actantd,expliciteouimplicite:je l’ai récompensé des services qu’il m’a rendus.L’actantcpeutêtretoutobjetenpossessiondea:Récompenser qqn
en argent; en lui offrant un cadeau).Letrait/desongré/faitpartiedusémèmedeceverbe.
13synonyme:vendre.14académie,1835-1932.15Lesage,gil Blas,ingR.16stendhal,Vie de Henry Brulard,intLF.

Popović M.
252
RémunérerLesémèmederémunérerestsemblableàceluiduverbeprécédent,
maisilestplusprécis,l’actantc(implicite)étantrestreint:«argent»,cequirapprocheceverbeàpayer.
Il a bien rémunéré ses collaborateurs.L’actantd est aussi restreint: «travail» ou «service»:Rémunérer le
travail, le concours, la collaboration, les bons offices de quelqu’un.Rétribuerceverbeaunsémèmepluslargequerémunérer:«outrelesrémuné-
rationsduesetrégulières,ilpeuts’appliqueràdesrécompenses.»(gR).PayerPayercontienttoujoursl’actantd:l’onpayetoujourspourquelque
chose.cet actantpeutdésigner les choses lesplusdiverses:payer son dîner, sa chambre d’hôtel, ses études, un droit, des travaux dans son ap-partement.Lesactantsbetdsontintroduitstouslesdeuxdirectement:payer un marchand; payer une marchandise.L’actantcestpresquetou-jours«argent».
alorsqueleverberécompensercontienttoujoursletrait/desongré/,payerestneutresurcepoint.payera,donc,unsémèmepluslargequerécompenser,rémunérerourétribuer,etsilesactantscetddecesquatreverbesontdestraitssemblables,ilspeuventêtresynonymes:
Il a été payé / rémuneré / rétribué pour avoir fait ce travail. / Il a été récompensé d’avoir fait ce travail.
LéguerLégerdésigneuntransfertdepossessionsousuneformejuridique,
partestamentouparunautreactededernièrevolonté.L’actanteestex-clu.L’actantdpeutêtresous-entendu:
elle avait une rente de trois cent quatre-vingts francs, léguée par sa maîtresse17.(onpeutsupposer:pourunlongetfidèleservice).
offriroffrira,parmid’autres,troissémèmesquiconcernentl’échange.1.c=«cadeau».Lesactantsdetesontexclus:ma mère m’a offert
cette robe.L’action du verbe est réalisée et offrir a pour archilexème donner
(donnerencadeau).2.L’actionpeutêtreseulementréalisable,etoffrirseprésentecom-
mesynonymedeproposer.L’actantcpeutreprésenterunlargeévantaild’objets (offrir de l’argent, une cigarette, un verre, du pain et du sel…).Lesactantdetesontabsents:onoffresanscontrepartieetpourtou-jours.mais,l’onsupposequel’offrepeutêtreacceptéeourefusée:
17flaubert,Trois contes, un cœur simple,ingR.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
253
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
Il m’a offert de l’argent et je l’ai accepté / mais je l’ai refusé.etcelàfaitladifférenceoffriretdonner:*il m’a donné de l’argent mais
je l’ai refusé.3.L’actantdestprésent:Ce magasin offre un grand assortiment de marchandises à bas prix.offrir apparaîtcommesynonymedevendre.L’actionestenvisagée
commesusceptiblederéalisationounon:Il m’a offert mille euros pour ma vieille voiture, mais j’ai refusé.Prêterprêter sous-entend obligatoirement l’actant e (on prête pour un
tempsdéterminé):Je vous prête ce livre à condition que vous me le rendiez avant la fin de
la semaine.L’actantdpeutêtreincludanslesémèmedeceverbe.danscecas,
l’actant c représente généralement l’argent: prêter à intérêt, prêter sur gage, prêter à la petite semaine.
Louerceverbecontientobligatoirementlesactantsdete:lapossession
estcédéemoyennantunprixettemporairement:Paul a loué son appartement à des étrangers de passage.L’actantcestde l’ordreduconcret: louer une maison, un apparte-
ment, un local, une ferme, des voitures, des bateaux.Vendrevendrepossède toujours l’actantdetexclue l’actante:oncède la
possessionpourunprixetpourtoujours:Jean a vendu son appartement à Paul pour un million.L’actantcesttrèsdiversifié.ilpeutreprésenterlesobjetsconcrets,
non-animés:vendre du lait, vendre une maison,ouanimés,mêmehu-mains:vendre un esclave,lesobjetsdetransfertabstraits:vendre ses char-mes, ses droits, une charge, des actions, des indulgences.
mêmesicestprisausensmétaphorique,ils’agitd’untransfertdepossession:Il a vendu sa conscience / son honneur.L’onprésupposequea avait de la conscience / de l’honneur et qu’il s’en est dépossédé enéchangedequelquebienouquelqueprivilège.ilenestdemêmequandcreprésentedespersonnes18(trahir,dénoncer):judas vend jésus pour trente deniers19.
L’actantdestgénéralement«argent»,maisilpeutêtreprisausenspluslarge,surtoutsicestprisausensfiguré:il a vendu son âme pour quelques honneurs.
18cf.vendre père et mère.19ingR.

Popović M.
254
vendrereprésentel’archilexèmed’uncertainnombredeverbesquispécifientlesactantscetdetledéroulementdel’actionverbale:
Bazarder–sedébarrasserrapidementdel’objetdetransfert:si tu veux bazarder ta voiture, j’ai un acheteur20.
Brader–sedébarrasserd’unemarchandise,d’unbienàn’importequelprix:Il a bradé sa vieille voiture.
Coller–remettred’autoritéetsansrejetpossiblequelquechoseàquelqu’un:il voulait me coller ses vieilleries pour cinquante euros.
Colloquer–vendrepoursedébarrasser: je lui ai colloqué tous ces vieux bibelots21.
Liquider–vendredesmarchandiseàbasprixetentotalité:Liqui-der un stock.
Solder–vendreensolde,aurabais:j’ai soldé mes antiquailles.
II. A ← BLesenslepluslargedecegroupedeverbesest«êtremisousemettre
enpossessiondequelquechose».PrendreL’extensionsémantiquedeceverbeesttrèsgrande.pourqu’ilyait
untransfertdepossession,ilfautquel’actantbsoitinclusdansleprocès(implicitementouexplicitement), l’actantcétant toujoursprésent.Lerôledeaestactif,leconsentementdebn’estpasnécessaire:
Paul a pris ma veste.L’actantdpeutêtreprésent:le plombier m’a pris 100 € pour cette ré-
paration,ainsiquel’actante:J’ai pris ce livre à la bibliothèque.(onsous-entend«pouruntempsdéterminé»).
dufaitdesonextensionsémantique,prendrepeutapparaîtrecom-mehyperonymed’unnombredeverbes(acheter, emprunter, s’approprier, confisquer, voler…),maissonsensseratoujoursmoinsprécisqueceluideseshyponymes.parexemple,silecontextepermetlaneutralisationdes différences spécifiques, les verbes confisquer et voler peuvent êtreremplacésparprendre,parcequecelui-ciaunsensplusgénéraletunsémèmepluspauvre:
les policiers lui ont pris son arme. les voleurs lui ont tout pris.mais,commel’hyperonymenecontientpaslessèmesspécifiquesde
seshyponymes,àdéfautd’indicationscontextuelles,l’emploidel’hype-ronymen’estpassuffisammentprécisetpeutprêteràéquivoque:on lui a tout pris(confisquéouvolé?).
20ingR.21ingR.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
255
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
RecevoirRecevoirdésignelasimplemiseenpossessiondel’objetdetransfert.
L’actantarestepassif:Il a reçu cette montre de son grand-père.L’actantcpeutdésignertoutobjetmatérielounon-matériel(rece-
voir un paquet, une lettre, un cadeau, un privilège, un droit, la parole de qqn.).
Avoirpour pouvoir désigner le procès d’échange,avoir nécessite la pré-
sencedel’actantb,expliciteousous-entendue.J’ai eu cela de mon oncle.L’actantdpeutêtreprésent:J’ai eu cette voiture pour presque rien. - Va faire ton paquet, et je te mènerai chez M. de rênal, où tu seras
précepteur des enfants.- Qu’aurai-je pour cela ?- la nourriture, l’habillement et trois cents francs de gages22.ToucherL’actantaestpassif,maisà ladifférencederecevoir, l’actantcest
restreint,ilreprésentel’argentoutoutcequipeutêtreréduitàl’argent:Toucher une jolie somme, un pourcentage, des intérêts, des dividendes…
L’actantdpeutêtresous-entendu:toucher son salaire.onprésup-pose:pourletravailexécuté,etceverbedevientsynonymedegagner.
obtenirL’actantaaunrôleactif,ilchercheàobtenirquelquechose,oubien
ildésireouméritequelquechose:Il a obtenu un renseignement de son collègue.celafaitladifférenceentreceverbeetrecevoir,quiexprimeseule-
mentlefaitquel’objetdetransfertestparvenuàa,qu’il l’aitvouluounon:
j’ai reçu un paquet par la poste.vs*J’ai obtenu un paquet par la pos-te.23
etinversement,onpeutdireIl a facilement / difficilement obtenu cet argent,etnon*Il a facilement / difficilement reçu cet argent,bienquel’onpuissedireIl a obtenu cet argentetil a reçu cet argent,avecladifférencecauséeparl’attitudedea.
Acquériracquérirdésignelesimplefaitd’entrerenpossession.c’estpourquoi
l’actantbest implicite.L’actantcreprésenteunbienconcret:acquérir
22stendhal,Le Rouge et le Noir, L’associationpour ladiffusionde lapensée française,paris,1946,p.33.
23cf.aussi:Il a reçu une gifle. (*Il a obtenu une gifle).

Popović M.
256
une somme, des biens, une terre, un immeuble, une rente, une succession…cpeut évidemment être unnom abstrait (acquérir une réputation, la gloire),maisdanscecas,onnepeutpasparlerd’échange.ceverbeestneutrequantàl’actantd,onpeutdevenirpropriétaireàtitregratuitouonéreux:
l’on peut acquérir les billets sur la place, moyennant tant pour cent24.Se procurerse procurer sous-entend le rôle actif de l’actantadans l’entrée en
possession:il s’est procuré de l’argent.L’actantdn’estpasexclu:il s’est procuré un livre rare pour un prix
dérisoire.L’actantbestleplussouventimplicite.Hériterhériterest l’antonymeréciproquede légueretdésigne l’acquisition
d’unbienparvoiedesuccession.Lesactantsdetesontexclus,l’héri-tageestreçupourtoujoursetsanscontrepartie.
il a hérité une maison de ses parents.Lesactantsbetcpeuventêtreimplicites:Il a hérité une fortune. Il a hérité d’un oncle en amérique.Emprunteremprunter est l’antonyme réciproquedeprêter. L’actante est tou-
joursprésent,explicitementouimplicitement:J’ai emprunté sa perceuse à Paul, pour une semaine.J’ai emprunté ce livre à un ami.L’actantdpeutêtreprésent:Il a été obligé d’emprunter de l’argent à un taux scandaleux.Lesactantsboucpeuventêtreomis:j’ai emprunté 1000 €.il emprunte à tous ses amis.danslelanguefamilière,onemploieleverbetaper:il a tapé Paul de
vingt euros.LouerLemêmesignifiantdésignedeuxmouvementsopposés:a→beta
←b,c’est-à-dire lesdeuxsémèmesantonymessontcontenusdansunemêmeforme.
Il loue un appartement à un propriétaire mal commode. Lesactantsdetesontobligatoires(explicitesousous-entendus):J’ai loué cette voiture à une agence de location pour 20 € par jour.j’ai loué cette voiture pour les vacances.
24balzac,eugénie grandet,ingR.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
257
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
Acheteracheterpossèdetoujoursl’actantdquireprésenteunesommed’ar-
gent,tandisquel’actanteestexclu.ilestl’antonymeréciproquedeven-dreet,parlaprésencededetdutrait/légalement/,l’antonymecontrairedevoler(Je n’ai pas volé cela, je l’ai acheté)25.
mêmesil’actantcdésignequelquechosequinormalementn’estpasvénal, ilyauntransfert:jean a acheté le silence de Paul.(paulavait lepouvoirdegarderlesilenceetill’a«vendu»àJean).dansdescassem-blables,l’actantdpeutêtreautrechosequel’argent:
Jean a acheté le silence de Paul en lui donnant de l’argent / en lui assu-rant une promotion / en obtenant pour lui un poste important.
Volerceverbeestcaractérisépar l’absenceévidentede l’actantdetpar
letrait/illégalement/.L’actantbestdépossédédesonbienfrauduleuse-ment,àsoninsuoucontresongré.L’actantcpeutêtreconcret(voler de l’argent, un portefeuille, une montre)ouabstrait(voler une idée / un sujet à qqn).
volerabeaucoupdesynonymesfamiliers:barboter, chaparder, chiper, chouraver, faucher, faire, piquer, rafler…
ceverbeestl’hyperonymedenombreuxverbesdontlessèmesspé-cifiquesqualifientl’actantcetlamanièredel’actiondedéposséderb.
sil’actantcesthumain,l’actionestdésignéeparlesverbesenleveretkidnapper.
aucasoùcreprésenteuneœuvreartistiqueouscientifique,l’actionestnomméeparlesverbescopierouplagier.
Cambriolersignifievolerpareffraction.Pillerinsistesurlefaitquetouslesbienssontenlevésetquel’action
estfaiteavecviolence.Dérobermetl’accentsuruneactionfurtive.Escroquercontientlessèmesspécifiques/ruse/,/fourberie/et/abus
deconfiance/.Escamotercontientlessèmes/vitesse/et/dextérité/:un voleur lui
a escamoté son portefeuille en un tournemain26,etpeutavoirpoursyno-nymesubtiliser.
Ravirestcaractérisépar lessèmes/force/et/ruse/.ceverbepeutavoirl’objet(c)humain:Ce même roi que Triboulet pousse au rapt, ravira sa fille à Triboulet27.
25si d ne représente pas l’argent, acheter s’oppose à échanger: Tu as acheté ces billes? Non, je les ai échangées contre d’autres.(gr).
26ingR.27hugo,Le Roi s’amuse,intLF.

Popović M.
258
Confisquerceverbedésigneluiaussil’actiondedéposséderqqndeqqch,mais,
àladifférencedevoler,necontientpasletrait/illégalement/.L’actantaestuneautorité:
un des premiers actes du règne de Napoléon iii fut de confisquer les biens de la famille d’Orléans. On en fit un joli jeu de mots: «C’est le pre-mier vol de l’aigle»28.
Lesynonymedecesensdeconfisquerestsaisir(L’huissier a saisi tous nos meubles).
L’actantepeutêtresous-entendu:Le professeur a confisqué leurs télé-phones portables aux étudiants.(ilvalesleurrendreplustard).
sil’actantaestprisausenspluslargeets’ilfaitl’actionàsonprofit,confisquerdevientsynonymedes’emparerouvoler:elle [syra] confisqua pour les vendre les convois d’armes que nous adressions à la grèce29.
Soutirersoutirernepossèdedanssonsémèmelesème/illégalement/,mais
l’actionnepourraitpasêtrequalifiéedemorale.L’actantbnecèdepascdesonpleingré.autilisedesmoyensdétournés(chantage,pression,insistance,ruse,séduction)pourobtenirquelquechosedeb:
Il a soutiré de l’argent à son frère.ExtorquerLesème/sanslibreconsentement/estencoreplusprononcédansle
sémèmeduverbeextorquer.L’emploidelaforcepourobtenircn’estpasexclu:L’inquisiteur extorqua l’aveu du suspect en lui infligeant des suppli-ces.
L’actantdpeutparaître:un charmant secrétaire, en bois de rose et citronnier, qu’elle a réussi à extorquer pour trois cents francs30. (sc. Lesecrétaireenvalaitbeaucoupplus).
Priverceverbedésignel’actiond’empêcherquelqu’undeposséderquelque
chose,de luiôtercedont ildispose.L’actantdestexclu,mais l’actantenel’estpas.ceverbeestneutreàl’égarddessèmes/légalement/ou/justement/.Dépossédera lesenstrèsprochedepriver, tandisquedé-pouiller sous-entend l’emploi de la force pour priver quelqu’unde sapossession.
28s. freud, Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, traduit de l’allemand par m.bonaparteetledr.m.nathan,gallimard,1971,collection«idées,nrf»,p.52.
29about,La grèce contemporaine,intLF.30romains,les Hommes de bonne volonté,intLF.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
259
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
III. A ↔ BLesactantscetdsonttoujoursprésents,explicitementouimplici-
tement.ilspeuventsesouderdansunmêmeobjetaupluriel(Les joueurs ont échangé leurs maillots après le match).Letraitprincipaldecerapportestlaréciprocité:adonnecàbetbdonnedàa,ouareçoitddebetbreçoitcdea.
Échangeréchanger contientdans son sémème les verbesdonner et recevoir:
donnerunechoseetrecevoiruneautreencontrepartie.Lesactantsquiparticipentauprocèssonta,b,cetd
Lesujetpeutavoirletrait/pluralité/(a+b):les mariés ont échangé leurs anneaux.Quand on réconcilia l’abbé Delille et rivarol, à Hambourg, dans l’émi-
gration, ils n’imaginèrent rien de mieux que d’échanger leurs tabatières31.L’actantcestdanscecasluiaussiaupluriel.Lesujet(a)peutêtreausingulier,maislesdeuxautresactantssont
introduitspardesprépositions.L’actantbestintroduitparlaprépositionavec:J’ai échangé des timbres avec Paul.L’actantdestintroduitparlaprépositioncontre:il a échangé son vieux vélo contre une canne à pêche toute neuve.commeonpeutvoirdanscedernierexemple, l’actantbpeutêtre
implicite.L’actantcpeutêtreabstrait:ils ont échangé leurs idées.chaque objet du verbe échanger n’est pas forcément un objet de
transfert.dans:elles ont échangé un regard, Ils ont échangé une poignée de main,on
nepourrait pasparler de transfert depossession. L’actantcpeut êtretoutcequiestsusceptibled’êtrepossédéetd’êtredonné.
Troquertroquer désigne l’échange direct demarchandises, sans l’intermé-
diairedel’argent:Troquer son blé contre du maïs.ceverbeestunsynonymedeéchanger,mais,àladifférencedecelui-
ci,ilpeutêtreemployésansaucuncomplément:il troque.(sc.ilpratiqueletroc.)vs.*il échange.d’autrepart,s’iln’estpasemployéabsolumment,ildoitavoir lesdeuxcompléments(troquerccontred).sonobjetdetransfertnedésignepas les référentsdemêmeordre,de sorteque lesénoncés: Ils ont troqué leurs anneaux. Ils ont troqué leurs tabatières32
31sainte-beuve,Portraits littéraires,ingR.32demême, dans les cas qui ne désignent pas le transfert: *ils troquèrent un regard furtif.
vs.ils échangèrent un regard furtif.

Popović M.
260
pourraientsignifier,parexemple:ils ont troqué leurs anneaux [contre des tabatières].
Changer Changerpeutêtresynonymedeéchangeretdanscecas,lesactants
cetdsontexplicités:[...] il en [des lapins] mange tant qu’il veut et il en met de côté, à sa
cave, pour les changer après, contre des pommes de terre, avec ce vieux fou des Barettes33.
L’actantbestleplussouventimplicite:Changer des dollars contre des euros.Donneravec un objet second,donner peut être synonyme de changer ou
échanger:Donner un cheval pour / contre un âne. Donner un œuf pour un
bœuf.
IV. ConclusionL’actantaestlesujetduverbedelaconstructionactiveetparconsé-
quent,ilesttoujoursexplicite.ilpeutêtreimpliciteaupassif:Paul a été récompensé de son zèle.
apossèdeletrait/animé/,maispeutdésigneraussiuncollectifplusoumoinsabstrait(état,gouvernement,compagnie,autorité…).
L’actantba la fonctiondecomplément indirect: j’ai donné de l’ar-gent à Paul, Il a vendu sa voiture à Jean, elle a hérité cette maison de son oncle.commeleremarquep.Legoffic(1993:290),lanaturedececom-plémentdépenddesfacteurssémantiques:«Lecomplémentindirectestsenticommeplusessentieldansemprunter des livres à un amiquedansemprunter des livres à la bibliothèque;uncomplémentreprésentantuninanimé(et,a fortioriunlieu)estsentid’autantplusfacilementacces-soireetcirconstanciel».
mais,bpeutaussibienêtrelecomplémentdirect(objet):Napoléon a doté ses sénateurs, Paul a bien rémunéré ses collaborateurs, Il a gratifié le serveur d’un pourboire.oubien,lemêmeverbepeutavoirlesconstruc-tionsdifférentes:un pickpocket a volé son portefeuille à un touriste etun pickpocket a volé un touriste.
L’actantbpeut être le sujetdesverbesdésignant la réciprocitédutransfertseulementquandilestuniaveca:ils ont échangé des cadeaux(ils=a+b).
33giono,Regain,intLF.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
261
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
bestsouventimplicite:Il a reçu une lettre, Il a acheté une voiture,il a cédé ses droits d’auteur, Il a payé son dîner, Il a vendu sa maison.
L’actantbestenprincipeanimé,maisilpeutaussireprésenterdesinstitutions(Ils ont doté un hôpital, l’État a concédé l’exploitation de cette ligne de chemin de fer à une compagnie étrangère, J’ai légué tout par testa-ment à la ville34).
L’actantcestleplussouventlecomplémentd’objetdirect.quelquesverbesquiontl’actantbpourcomplémentdirectintroduisentcparunepréposition:gratifier un serveur d’un pourboire, doter un régiment d’ar-mes modernes, récompenser quelqu’un en argent.
selonlespropriétéssémantiquesdesverbes,l’actantcpeutdésignerdes référents non-animés ou, plus rarement, animés (vendre / acheter un chien / un esclave, voler un enfant, changer son cheval borgne pour un aveugle).ilpeutêtreconcretouabstrait(Les muses l’ont gratifié d’un talent exceptionnel, vendre des indulgences, recevoir des compliments, échanger des idées).ilestplussouventimplicitedanslarelationa→bquedanslarelationinverse:Il a été récompensé / rémunéré / payé, Il a hérité de son oncle.pourcertainsverbes,ildoitobligatoirementêtreex-plicité(avoir, toucher, obtenir).
L’actantdestuncomplémentcirconstanciel.ildésignetoutréférentquipeut jouer le rôlede «contrepartie»: objetmatériel, argent, travailexécuté, service rendu…cet actant estobligatoirement inclusdans lesémèmedecertainsverbes(récompenser, rémunérer, payer, louer, vendre, acheter, échanger, troquer). L’actantd estobligatoirement excludu sé-mèmedesverbesabandonner, hériter, voler, confisquer.ilesttrèssouventaccessoire(donner, allouer, céder, gratifier, prêter, prendre, avoir, acquérir, emprunter).ilpeutêtreexplicite(il loue un appartement pour 800 euros par mois)ouimplicite(Il loue un appartement, l’État concède l’exploita-tion de cette mine).quelquesverbesont lapossibilitédeconstructiondirecteded:récompenser des mérites de qqn, rémunérer les bons offices de qqn, payer son dîner).
L’actanteestuncomplémentcirconstancieldetemps.ilestobliga-toirepourcertainsverbes(prêter, louer, emprunter)etdanscecasilestexpliciteouimplicite.ilesttoujoursexcludusémèmedesverbescommeabandonner, gratifier, récompenser, léguer, offrir, vendre hériter, acheter, voler.certainsverbessontsusceptiblesd’avoircetactantd’unemanièreaccessoireetleplussouventimplicite:céder un bail, prendre un crédit.
Lestraitssémantiquesquicaractérisentlechamponomasiologiquedutransfertdepossessionsont:relationuniderctionnelleouréciproque,
34balzac,les Paysans,ingR.

Popović M.
262
sansouaveccontrepartie,pour toujoursouà titre temporaire, légale-mentouillégalement,debongréouàcontrecoeur.
ilyadesverbesd’échangequiontdesrelationsantonymiquesderé-ciprocitéprécises(léguer ‒ hériter, prêter ‒ emprunter, vendre ‒ acheter),tandisqued’autresréalisent lesrelationsantonymiquespardifférentesmodificationsdusémème.donneralesantonymesréciproquesaccepterourecevoir,etparlanégationdusémème,l’antonymecontrairegarder.silarelationantonymiquereposesurlesème/illégalement/,l’antonymeestvoler(Je ne lui ai pas donné cela, il me l’a volé).Loueralamêmeformepoursonantonymeréciproque.volerpeutavoirpourantonymesrendreourestituer[cequiaétévolé],respecter[lebiend’autrui](=nepasvo-ler),obtenirouacheter(Je n’ai pas volé cela, je l’ai obtenu / acheté),maisilestintéressantdeconstaterqu’iln’existepasdelexèmespécifiquepourlesémème«êtreprivédepossessiond’unemanière illégale»et l’onestobligéd’employerlaformepassiveduverbe:être volé35.Lesverbesdelarelationa↔b,quiestpardéfinitionréciproque,n’ontpasbesoind’an-tonymesréciproques,parcequesiaéchangecavecb,béchangec(oud)aveca.
L’examendesverbessusceptiblesd’exprimercesrelationsdémontrequ’ilyaentrecesverbesdenombreuxcasdeneutralisationdesdifféren-cesspécifiques,cequifaitressortirlesphénomènesd’hyperonymieetdesynonymie.
Bibliographie
Legoffic1993:p.Legoffic,grammaire de la phrase française,paris:hachette.picoche1986:J.picoche: structures sémantiques du lexique français,paris:na-than.popović2009:m.popović,leksička struktura francuskog jezika: morfologija i semantika,beograd:zavodzaudžbenike.gr: le grand robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue fran-çaise,9vol.,paris:Lerobert,1986;versioncd-rom,1992TlF: Trésor de la langue française,16vol.,paris:gallimard,1971–1994;ver-sioncd-rom,cnrseditions,2004.Lexis,paris:Larousse,2002.
35Lepassifetlanégationsontdesformesgrammaticalesdel’antonymie.

Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français
263
Nasl
e|e 19
• 2011 • 24
7-263
Михаило ПоповићОНОМАСИОЛОШКО ПОЉЕ „ПРЕНОСА ВЛАСНИШТВА“ У
ФРАНЦУСКОМРезиме
Упроцесупреносавласништваучествујуследећиактанти:a-давалац,b-прималац,c-предметпреноса,d-противвредност,e-трајање.Прватриактантасуобавезназасвеглаголекојимогуозначитипреносвласништва,апреосталадвасуобавезнисамозанекеглаголе,коддругихсеевентуалномогупојавити,доксукоднекихискључени.Мо-гућасутритипаодносаизмеђупрвадваактанта:a→b,a←bиa↔b.АктантАјеувекексплицитануактивнимконструкцијама,поштојесубјекатглагола.Онпоседујезначењ-скообележје/живо/,алиможеозначаватииколектив.Актантbможебитиимплицитан.Узависностиодглагола,онјеиндиректнаилидиректнадопуна,најчешћеобјекат.Озна-чава/живо/,алииинституције.Актантcјенајчешћедиректниобјекат,номожебитиипрепозиционалниобјекат.Означавареферентеизкласенеживогилиживог,конкретнеилиапстрактне.Можебитиимплицитан.Актантdједопунаприлошкогтипа,веомаши-рокесемантичкеекстензије.АктантЕјеприлошкадопуназавреме.Последњадваактан-тасучестоимплицитни.Семантичкаобележјакојакарактеришуономасиолошкопољепреносавласништвасу:једносмерностиреципрочност,бесплатноилиузнакнаду,заувекилипривремено,законитоилинезаконито,добровољноилинерадо.Међуглаголимакојиозначавајупреносвласништвауочавасевеликибројнеутрализацијаспецифичнихразли-ка,штодоводидопојавехиперонимијеисинонимије.
Примљено: 26. 1. 2011.


265
УДКрад
Veran StanojevićFaculté de philologie, université de Belgrade
LA CoNJoNCTIoN qUAND ET LES RELATIoNS TEMPoRELLES EN FRANçAIS
ce travail1 a pour but d’examiner des contraintes imposées parla conjonctionquand auxenchaînementsde formeQuand P, Q.nousconsidéronsnotammentcellesquin’interviennentpasdanslesséquen-cescorrespondantesdedeuxpropositionsindépendantespetq.nousconstatons que, sous certaines conditions, la conjonction quand est àmêmedemodifierlarelationtemporelleentredeuxpropositionsindé-pendantes.
Mots-clés:conjonctionquand,ordretemporel,relationsdiscursives,aspectverbal,passésimple,sémantique
1. Introduction
Loindeprétendreàuneanalyseexhaustivedelaconjonctionquand,nousavonsvouluexaminercertainesdesespropriétésquijouentunrôlenonnégligeable dans l’établissementde relations temporelles entre lespropositionsqu’elle relie syntaxiquement.unemanièred’aborder cettequestionestdecomparerl’interprétationdephrasesdutypeQuand P,Qàl’interprétationdesséquencescorrespondantesdepropositions(p,q),qu’ils’agissededeuxphrasessimplesoudedeuxpropositionsjuxtapo-séesoucoordonnées‘p(conj)q’.
nousnousborneronsàétudierlesrelationstemporellesquis’établis-sententrelessituationsdécritesparlesdeuxpropositionspertinentespetq.plusprécisément,nousnousdemanderonssiquanddansquand P, Q,changeoupréservelerapportchronologiqueentreleséventualitéseP eteq,introduitesparuneséquencesdepropositions indépendantes
1 cette recherche contribue au projet scientifique n° 178002 (Jezici i kulture u vre-menu i prostoru)financéparleministèredelascienceetdudéveloppementtechnologiquedeserbie.

Stanojević V.
266
p,q.2ils’avéreraquequandpeutchangerlarelationdiscursiveentrepetq,cequipeutavoirdesconséquencessurl’ordretemporeldesdeuxéventualitéspertinentes(ePeteq).
danslesexemples(1)et(3),ci-dessous,l’ordretemporeldeséven-tualitése1et e2 n’estpasaffectépar l’emploide laconjonction quand.defait,l’ordrechronologiqueentretenupare1ete2dans(1)et(3)estlemêmequeceluidesséquencesdesphrasessimplescorrespondantes(2)et(4).en(1),toutcommeen(2),c’est lasuccessiontemporelle(qu’onnotee1<e2),alorsqu’en(3)eten(4)c’estl’inclusiondee1danse2(notéee1⊆e2)quiestencause.
(1)quandpaulentra(e1),mariesortit(e2).e1<e2(2)paulentra(e1).mariesortit(e2).e1<e2(3)quandpaulentramarieregardaitlatélé.e1⊆e2(4)paulentra.marieregardaitlatélé.e1⊆e2Laconjonctionquandestdonccompatibletantavecl’expressionde
lasuccession,qu’aveccelledel’inclusiontemporelle.selonlestermesdesrelationsdediscours(voirLascaridesetasher,1993)ondiraquequandest compatible, entre autres, avec les relations deNarration en (2) oud’arrière-Planen(4).3celaétant,onsedemanderas’ilestpossiblededéduirel’ordrechronologiqueentreePeteqàpartirdusensqu’onattri-buegénéralementàcetteconjonctionetquiseréduitàl’expressiondelasimultanéitépriseausenslargeduterme(voirborillo,1988).
2. Ordre temporel et séquences de clauses indépendantes avantd’étudierlescontraintesqu’imposel’emploidelaconjonction
quandauxenchaînementsdeformeQuand P, Q,nousnousdemande-ronspréalablementquelssontlesfacteursdontdépendl’ordretemporeldes éventualités eP et eqdansune séquencede clauses indépendantesoudephrasessimplespetq.engros,ils’agitdedeuxtypesdefacteurs.cesontlestempsverbauxetleco(n)texte.sansentrerdansledétaildecette problématique, qui est un des sujets de prédilection des appro-chesdiscursivesmodernes(kampetrohrer,1983,vet1991,molendijk1985,Lascaridesetasher,1993),maisaussidelapragmatiquecognitive(moeschler1998,pekba,2004),nousnouscontenteronstoutjusted’il-lustrercesdeuxtypesdefacteursdanslessections2.1et2.2.
2 par rapport chronologique nous entendons les relations temporelles entre deux entitéstemporelles:l’antériorité,lapostérioritéetlasimultanéité.
3 Je ne considérerai pas ici le phénomène de la subordination inverse comme dans ma-rieregardaitlatéléquand,toutd’uncoup,unpasrapidese fit entendredansl’escalier.

267
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
La conjonction quand et les relations temporelles en français
1.1 les temps verbaux certainstempsverbaux(tv),commelepassésimple(ps)etleplus-
que-parfait(pqp),donnentdesinstructionsditesdiscursives(stanojevićetašić, 2008) concernant le rapport chronologique entre l’éventualitéqu’ilsintroduisentetl’éventualitéprécédemmentintroduitedansledis-cours.dansunesuitedephrasessimplesp,q, lepsinduit,pardéfaut,laprogressiontemporelle.celaveutdirequelerapportchronologiqueentreleséventualitésePeteqcorrespondpardéfautàl’ordredesphrasespetqquilesintroduisent.Larelationdiscursivequis’établitentrelesdeuxphrasesaupassésimpleestsoitlanarration(commeen5)soitlerésultat(commeen6)4.
(5)paulentra(e1).mariesortit(e2).(e1<e2)5
(6)paulinsultapierre(e1).pierrelefrappa(e2).(e1<e2)Leplus-que-parfaitinduitl’ordretemporelinverse(-ot),cequiex-
pliquelerapportd’antérioritée2<e1dans(7):6
(7)paulinsultapierre(e1).pierrel’avaitfrappé(e2).e2<e1cen’estpaslarelationd’explicationquidéclencheicil’usageduplus-
que-parfait.enfait,c’estplutôtl’inverse.Leplus-que-parfaitsélectionnel’interprétationquiestconformeàsoninstructiontemporelle,àsavoire-r-s,etqui,parcelamême,imposel’antérioritédee2parrapportàe1dans(7).cenepeutêtrelarelationderésultatparcequelerésultatsi-gnifieraitquel’ordretemporeldese1ete2seraitlemêmequ’en(6).iln’yaurait,danscecas,aucunedifférenceconcernantl’ordretemporelentreleplus-que-parfaitetlepassésimple,cequiseraitévidemmentcontre-intuitifetinexact.
2.2 Facteurs contextuels certainstempsverbauxnesontpasàmêmededéterminerunordre
chronologiqueparticulier à partir d’une séquencedephrases simples.ils’agit,notamment,dupassécomposéetdufutursimple.eneffet,cesdeuxtempssontneutresquantàl’ordretemporeldeséventualitésqu’ilsintroduisent.sansl’aided’uncontextetantlinguistiquequ’extralinguis-
4 certains auteurs comme moeschler (moeschler, 2000) rangent le résultat parmi lescasdelanarration,parcequedanslesdeuxcasonalemêmeordretemporel(celuiquicor-respondàl’ordredesphrasesquiintroduisentleséventualitéspertinentes).entenantsépa-réeslesrelationsdenarrationetderésultat,nousresteronsplusfidèlesautraitementplutôtclassiquedesrelationsdiscursivesproposéesdanslecadredelasdrt(asher,1993).
5 en (5) c’est le contexte qui décide de la relation discursive pertinente (narration ourésultat).
6 voir vetters (1996) pour une discussion des cas où le plus-que-parfait n’induit pasl’ordretemporelinverserelativementàl’éventualitéprécédemmentintroduite.

Stanojević V.
268
tique(ycomprisnosconnaissancesdumonde),onn’estpasenmesuredesavoirquelordretemporelentreéventualitéspertinentesesteffectif.considéronsicilecasdupassécomposé.7souvent,lorsquel’ordretem-poreldeséventualitésn’estpaspertinent, lepassécomposé(pc)est lameilleuresolution,cedonttémoignelepassagesuivant:
(8) J’ai poursuivimonéducation.J’ai bavardéavecdesmortelsauxarrêtsd’autobus,dansdesstations-serviceetdansdesbarsélé-gants. J’ai lu des livres. J’ai revêtu les costumes chatoyantsdesmagasinschics:leschemisesblanchesàcolmao,lesvestesdesa-farikaki,lessomptueuxblazersdeveloursgrisavecdesécharpesencachemire.Jeme suis poudrélevisageafindenepasmefaireremarquersousleséclairagesfluorescents.(rice1988:20)
ici, le narrateur n’introduit pas une suite ordonnée d’événements,sonbutétanttoutsimplementd’énumérerlesactivitésauxquellesselivrelepersonnageprincipal.
par ailleurs, deux propositions indépendantes au passé composé(pc)peuvententretenirtouslestypesderapportschronologiquesentreéventualités:lapostériorité(oulasuccessiontemporelle),lasimultanéitéetl’antériorité(oul’ordretemporelinverse).envoiciquelquesexemplesillustrantcestroistypesdechronologie:
(9) Lagardes’est levée(e1)ets’est dirigée(e2)verslasortie. (camus1957:14)
(10) Jeleurai demandé(e1)lapermissiondemeretirerdansleurautrepièce,oùjeme suis allongé (e2)surleurlitpourlire.arri-véàlamoitié,j’ai quitté(e3)leurmaisonenemportantlelivre.plantésousunréverbère,j’ai terminé(e4)malecture.puisj’aisoigneusementplacé(e5)levolumedansmapochedepoitrine.(rice,p.23)
(11) maisj’ai attendu(e1)danslacour,sousunplatane.Jerespiraisl’odeurdelaterrefraîcheetjen’avaisplussommeil.J’ai pensé(e2)auxcollèguesdubureau.(camus,p.23)
(12) J’ai quittémaretraitesouterraine(e1)l’andernier.deuxchosesm’yont poussé (e2).(…).(rice,p.12)
(13) Lanuita passé (e1).Jemesouviensqu’àunmomentj’ai ouvert(e2)lesyeux(…)(camus,p.21)
Lefaitqu’aveclepconpuisseavoirlasuccessiontemporelle(com-meen9et10),lasimultanéité(en11)etl’ordretemporelinverse(en12et13),suggèrentquelepcestneutrequantàl’ordretemporel.cesontdes facteursd’ordrecontextuelquidécidentdurapportchronologique
7 pourlefutursimple,voirašićetstanojević(2009).

269
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
entreéventualités.en(10)c’estlasuccessiontemporelledesévénementsdécritsparlespcenitalique.d’abord,lepronomrelatifoùetsonanté-cédentleur autre piècepermettentaulecteurd’inférerquelehérosnesetrouveplusdanslamêmepièce.oneninfèredoncquee2suite1dansletemps.toutcommelesenslexicalduprédicatquitter leur maison laconstructionparticipialearrivé à la moitiépermetau lecteurd’inférerqu’entree2ete3ils’estécoulédutemps,d’oùe2précèdee3.commeplanté sous un réverbèreprésupposeêtre dehors,ils’ensuitquelafindelalecturequiaeu lieusous leréverbèreenquestionsuitnécessairement lemo-mentoùlehérosdurécitquittelamaison.oneninfèrequee3précèdee4. finalement, l’emploi du connecteurpuis indique la postériorité dee5parrapportàe4.Lesenslexicaldesverbesse leveretse dirigersuffitpourdéduire l’ordree1<e2dans(9).
8pourcequiestde l’exemple(13),rienn’interditàcequej’ouvrelesyeuxavantl’aube,cequiest,d’ailleurs,l’uniqueinterprétationplausibledecetexemple.d’oùondéduitl’ordretemporelinverseen(13).idemdansl’exemple(12)oùiln’estpasdifficiledemontrerquee2précèdee1.defait,l’uniqueinterprétationplausibleduprédicatm’yont poussé est«m’ontpousséàquittermaretraitesou-terraine».enfin, dans l’exemple (11) les deux verbes d’activités aupcdénotentdeuxactionsquiserecouvrent.eneffet,riendanslecontexten’indiquenilasuccessionnilarégressiontemporelle.silepcimposaitpardéfaut laprogression temporelle, comme leps, la simultanéiténeseraitpasl’optiondisponibleen(11).voicidoncunargumentdeplusenfaveurd’untraitementselonlequellepcseraitneutrevis-à-visdel’ordrechronologiquedeséventualitésqu’il sertàdécrire. interprétéselon lestermesdelasdrt(Lascaridesetasher,1993)cefaitindiqueaussiquedanslecasdedeuxpc,àladifférencededeuxps,larelationdiscursivedenarrationn’estpas l’optionpardéfaut.Laneutralitédupcquantàl’ordretemporelpeutêtredémontréeaussipardesexemplescomme(14)oùlesdeuxordrestemporelssonttoutàfaitnaturelsetplausibles(e1<e2oue2<e1).enfait,jepeuxfrapperquelqu’unparcequ’ilm’ainsulté,maiségalement,jepeuxêtreinsultéparceluiquej’avaisfrappé.L’emploidupsdanscetyped’exemples(voir15)imposeraitlaprogressiontemporelle,c’est-à-direl’ordrechronologiquecorrespondantàl’ordredesphrases.
(14) paulm’ainsulté(e1).Jel’aifrappé(e2).(15) paulm’insulta(e1).Jelefrappai(e2).revenonsmaintenantàlaconjonctionquand.
8 avant de se diriger vers la sortie il faut se lever, ce qui explique la progression tempo-relledansl’exemple(9).
La conjonction quand et les relations temporelles en français

Stanojević V.
270
3. Des contraintes de quand dans la suite de ce travail nous examinerons quelques-unes des
contraintes imposéespar la conjonctionquand auxenchaînementsdetypeQuand P, Q.nousconsidéreronscellesquin’interviennentpasdanslesséquencesdedeuxpropositionsindépendantes(phrasessimplesoupropositionscoordonnéesoujuxtaposées).
3.1 quandp,qet intervalle temporel entre eP et eq Laconjonctionquandnetolèreaucunlapsdetempsexplicitement
mentionné entreleséventualitésdénotéesparpetqdansQuand P, Q.silamentionexplicited’unintervalletemporel,sipetitsoit-il,entreePet eq estparfaitement acceptabledans le casde séquencesdephrasessimples(voir16),cetintervalles’avèregênantpourl’emploicorrectdelaconjonctionquand(voir17).
(16)marieestentrée.paulestsortiquelquesinstantsplustard.(17)*quandmarieestentrée,paulestsortiquelquesinstantsplus
tard.L’expressionadverbialequelques instants plus tardpeutsecombiner
avecunepropositionsubordonnéeintroduiteparquand(quenousnote-ronsquand Pdanslasuitedecetravail),laquellefonctionnecommeunesorted’appositioncommelefaitremarquerborillo(borillo,1988:73).9
(18)quelques instantsplus tard,quandmarie est entrée,paul estsorti.
L’inacceptabilitéde (17)découledu faitquequelques instants plus tardsertàlocalisertemporellementl’éventualitédécriteparlaprincipale(est sorti),alorsquecettefonctiondelocalisationdevraitêtreassuréeparlaclauseenquand.nousrejoignonsicil’idéedepartee(1984)etdehin-richs(1986),selonlesquelslafonctiondespropositionsintroduitesparwhenenanglaisestdefournirlepointderepèretemporelpourlalocali-sationdel’éventualitédénotéeparlaprincipale.cepointderepèretem-porelestdéjàfourniparl’adverbialquelques instants plus tarden(17),sibienquelasubordonnéeenquanddoitréféreraumêmeinstantpourquelaphrasesoitacceptable.or,celan’estpaslecasde(17),cequiexpliquel’inacceptabilitédecetexemple,àladifférencedel’exemple(18).danscedernierexemplelasubordonnéetemporelleetl’expressionadverbialequelques instants plus tardco-réfèrent,sibienquequandPestàmêmedelocaliserdansletempsl’éventualitéqu’introduitlaprincipale.
9 L’adverbial quelques instants plus tard signale explicitement l’intervalle entre un mo-mentducontexteprécèdentetlemomentintroduitparlaclauseenquand.

271
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
ilest intéressantderemarquerque laconjonctionquandestdiffi-cilementacceptableavecdesséquencesdepropositionspetqquiim-pliquentun lapsde temps considérable entre epet eq.à ladifférencede(19),quiestparfaitementacceptableendépitdel’intervalletemporelentreePeteq,l’exemple(20)nel’estpas,parcequelemomentdénotéparquand Pnepeutplusservirderepèretemporelpourlalocalisationdel’éventualitédénotéeparlaprincipale(eq).
(19)J’aiplantéunegraine.elleapoussé.(20)*quandj’aiplantéunegraine,elleapoussé.cependantlesexemples(21)et(22),quiimpliquentaussiuninter-
valle temporel entre les deux éventualités pertinentes, sont tout à faitacceptables,selonl’avisdeplusieursdemesinformateurs.
(21)quandj’aimislesgrainesdeharicotsdansunbocald’eau(e1),ellesontgermé(e2).
(22)quandj’aimislesfleursdansl’eau,ellessesontredressées.L’acceptabilitédesexemples(21)et(22)estdûaufaitqu’ilsexpri-
mentmoins une relation temporelle qu’une relation causale entre lesdeux éventualités. La subordonnée enquand introduit plutôt la causequ’ellen’exprimeunerelationtemporelle.d’oùledécalagetemporelqui,autrement,serait intolérable(commeen20).ilsuffit,pours’enrendrecompte, de considérer les paraphrases approximatives des exemples(21)et(22),donnéessous(23)et(24).uneparaphraseanaloguede(20)n’auraitpasbeaucoupdesens(voir25).
(23)commej’aimislesgrainesdeharicotsdansunbocald’eau,ellesontgermé.
(24)commejelesaimisesdansl’eau,lesfleurssesontredressées.(25)??commej’aiplantéunegraine,elleapoussé.nousconstaterons,sansentrerdansuneélaborationpluspousséede
cetteidée,queledécalagetemporelimpliciteentreleséventualitésePeteq(dénotéesrespectivementparpetqdansQuand P,Q)n’estpossiblequesiunerelationcausales’établitentreePeteq.
3.1.1L’aversiondelaprincipalevis-à-visdupassécomposérésultatif
endehorsdel’incompatibilitédequandavecunlapsdetempsentreePeteq,saufsiquandexprimeunerelationcausale, ilyad’autresar-gumentsaussiquiétayentl’hypothèseselonlaquellequand Pintroduitlepointderéférencepourlalocalisationdel’éventualitédénotéeparlaprincipale.ils’agit,entreautres,del’inacceptabilitédupcrésultatifdanslaprincipale,commedansl’exemple(26):
La conjonction quand et les relations temporelles en français

Stanojević V.
272
(26)*quandmarieestrentrée,paulestsortidepuisdixminutes.L’interprétationrésultativedupcest sortiestimposéeparl’emploi
del’adverbialdepuis dix minutes, quisertàmesurer l’intervalledurantlequelestvalablel’étatrésultant‘êtredehors(paul)’,produitparl’accom-plissement de l’action de sortir. cet intervalle est calculé rétrospecti-vementàpartirdumomentde laparole(s).c’estdonc lesquiest lepointderéférencepourlepcrésultatif.10Lasubordonnéeintroduiteparquandréfèreàunmomentquinepeutcoïncideravecs,d’oùl’inaccep-tabilitéde(26).ilestànoterquelaséquencededeuxphrasessimples,toutesdeuxaupcrésultatif,esttoutàfaitacceptable(voir27).
(27)marieestrentréeetpaulestsortidepuisdixminutes.considéronsmaintenantl’exemple(28)quiestparfaitementgram-
matical et qui ne diffère de (26) que par l’emploi du plus-que-parfait(pqp)danslaprincipale.Lesensrésultatifdupqpétait sortiimposéparl’adverbialdepuis x tempsn’estpasenconflitaveclefaitquequand Pin-troduitlepointderepèrer.eneffet,rienn’empêchequ’unétatrésultant(être dehors)danslepassésoitactuelaumomentr,situédanslepassé.
(28)quandmarieestrentréepaulétaitsortidepuisdixminutes.il semble qu’un traitement correct des phrases de type Quand P,
q impose que lemoment de référence pertinent pour la localisationde l’éventualitédénotéepar laprincipale soit lemoment introduitparquand P.ensupposantquecelaestvrai,onpourraitdirequelaraisonpourlaquellequandn’admetpasdelapstemporelexplicite(niimplicitecommedansl’exemple20),estladifficultéqu’ilyauraitalorsàlocaliserl’éventualitédénotéeparlaprincipale.eneffet,ledécalagetemporelcrééparl’emploid’adverbiauxtelsquen instants/minutes plus tard/après,em-pêchelaprincipaledelocalisereqrelativementaupointderepère(eP)quefournitlasubordonnéeenquand.
considérons maintenant une autre propriété négative de quand,concernantsacompatibilitéaveccertainescombinaisonstemporelles.
3.2 quand exclut certaines combinaisons de temps verbaux Laconjonctionquandnetolèrepascertainescombinaisonsdetemps
verbaux. il s’agit notamment des combinaisons suivantes: 1. *quandP(imp),q(ps) et 2. *quand p(pqp),q(ps).donc, l’imparfait (imp) dansunesubordonnéeenquand,nesecombinepasaveclepassésimple(ps)
10Le pc dit résultatif n’est pas remplaçable par le passé simple, ce dernier n’exprimantjamaisl’étatrésultantd’uneactionpassée,valableaumomentquifonctionnecommer.

273
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
delaprincipale.idempourleplus-que-parfait(pqp)delasubordonnéeetlepsdelaprincipale:
(29)*quandlasalleétaitvide,lesportiersentrèrent.11(30)*quandmarieétaitsortie,paulrentra.12par contre, les séquences de phrases simples correspondantes
(voir31et32),avec lesmêmescombinaisons temporelles (‘imp,ps’et‘pqp,ps’),sonttoutàfaitnaturelles:
(31)Lasalleétaitvide.Lesportiersentrèrent.(32)marieétaitsortie.paulrentra.ilyadoncquelquechosequibloquel’usagedelaconjonctionquand
dansdesexemplescomme(29)et(30).nousferonsl’hypothèsequelacombinaisonquand imPn’estpasàmêmed’introduirelepointderé-férencepertinentpour la localisationde l’éventualité introduitepar laprincipale.étantanaphorique,l’imparfaitcherchesonpointderéférencedanslecontexteprécédent.or,commel’amontrépartee(1984),c’estlasubordonnéequidoitfournirunrepèretemporelpourl’interprétationdelaprincipaleetnonpaslecontextediscursifprécédent.13quantàlacombinaisonQuand PQP, Ps,elleestproblématiqueenraisonduconflitentrelarégressiontemporelle(ouantériorité)imposéeparlepqpetlaprogressiontemporelle(oupostériorité)signifiéeparlepsdelaprinci-pale.LesphrasesdeformeQuand PQP, IMP,neposentpasdeproblèmepuisquel’imparfaitàladifférencedupsnecréepasdeconflitvis-à-visdel’antérioritéimpliquéeparlepqp.commel’afaitremarquerborillo(1988),lescombinaisonsdeforme Quand PQP, IMPs’interprètentsoititérativement(commeen33),soitparinclusiontemporelle(commeen34).14celadépenddel’aspectlexical,lesachèvementsàl’imparfaitprivi-légiantl’interprétationitérative(commeen33).
(33)quandilavaitparcouruquelqueskilomètres,ils’arrêtait.(34)quandonluiavaitparlé,ilignoraittoutdelasituation.
3.3 quand modifie certaines relations discursives L’interprétationtemporelled’unesuitedephrasessimplesp,qpeut
êtremodifiée lorsque, toutes choses égales par ailleurs, on formeunephrasecomplexedetypeQuand P,Q.c’estnotammentlecasdeséquen-
11ilfaut:quand la salle fut vide…12ilfaut:Quand Marie fut sortie, Paul rentra…13dans le cas d’une itération, qui exige l’emploi de l’imparfait dans la principale, on doit
stipulerquec’estlecontextediscursifpluslargequifournitlerepèrepourlalocalisationdeséventualitésquiserépètentdansletemps.sinononnepourraitpasrendrecompted’exemplescommeQuand il sortait, il se sentait beaucoup mieux.
14danslecasdel’inclusion,lepsoulepcpeuventêtresubstituésaupqp.
La conjonction quand et les relations temporelles en français

Stanojević V.
274
cespps,qimp, lorsque la relationdiscursiveentrepetqn’estpascelled’arrière-plan.sic’est,parcontre,del’arrière-planqu’ils’agit, l’emploidequandnechangerienàlarelationd’inclusion(entreePeteq)qu’im-pliquel’arrière-plan(voir35et36):
(35)marierentra(e1).ilpleuvaitdehors(e2).e1⊆e2(36)quandmarierentra(e1)ilpleuvaitdehors(e2).e1⊆e2cependant,si larelationquis’établitentreppsetqimpestcellede
résultatoud’explication,alors,sionacceptel’enchaînementquand PPs, qimP,larelationdiscursivenerestepluslamême.iln’estpasdifficilederemarquerquelesphrasesdetypequand PPs,QimPinduisentlarelationd’arrière-plan.considéronslesexemples(37)et(38)quiillustrent,res-pectivement,lesrelationsderésultatetd’explication.
(37)Jeantournal’interrupteur(e1).Lalumièreéclatantel’éblouissait(e2).
(38)Jeanattrapaunecontravention(e1).ilroulaittropvite(e2).en(37) ladeuxièmephraseà l’imparfaitdécrit laconséquencede
l’actiondénotéeparlapremièrephraseaupassésimple.ondira,selonles termesdes relationsdiscursives15, qu’en (37) les deuxphrases éta-blissentlarelationderésultat.L’éventualitée2estcauséepare1,d’oùils’ensuitquel’éventualitée1n’estpasinclusetemporellementdanse2,maislasuitimmédiatement.certainschercheursparlent,danscecas,desi-multanéitéglobaleentree2etlasituationimpliquéepare1,qu’onpour-raitgloserpar«lalumièreêtreallumée»(molendijk,2002:98-101).en(38)c’estlarelationd’explicationquiesteffective,d’oùl’antérioritédee2parrapportàe1(e2<e1).cependant,siàpartirde(37)onconstruitunephrasedeformeQuand P, Q,larelationderésultatn’estplusdisponible.c’estlarelationd’arrière-planquis’établitalorsentrepetqetquiimpli-quel’inclusione1⊆e2:
(39)quand Jean tourna l’interrupteur (e1), la lumière éclatantel’éblouissait(e2).
L’exemple (39) signifie que la lumière, venant d’une autre source,éblouissaitdéjàJeanaumomentoùila tourné l’interrupteurenques-tion.16 La même transformation de la séquence en (38) produit unephrasepragmatiquementdévianteparcequ’ilestdifficiledejustifierlarelationd’arrière-plan(voirl’exemple40).enfait,l’établissementdecet-terelationn’estpasconformeànosconnaissancesdumondeselonles-quellespourrecevoirunecontraventionilfautd’abordarrêterlavoiture.d’oùladéviancepragmatiquede(40),quenousavonsnotée#.
15pouruneprésentationdesrelationsdiscursivesvoirborilloetal.(2003).16LaphrasepeutsignifierqueJeanaéteintlalumière.

275
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
(40)#quandJeanattrapaunecontravention(e1),ilroulaittropvite(e2).
L’exemple (37)n’est doncplus équivalent à (39), tout comme (38)n’estpaséquivalentà(40).cesobservationsempiriquesindiquentquela conjonctionquand dansQuand P,Q peutmodifier le rapport chro-nologiqueentreleséventualitésePeteq.ellelefaitencontraignantlesrelationsdiscursivesdisponiblespourunecombinaisondetempsdon-née.17cependant, celane signifiepasque la relation temporelleentredeuxéventualitésePeteqsoitprévisibleàpartirdusensprésumédelaconjonctionquand.si,eneffet,nousadmettonsquequandexprimelasimultanéitéentredeuxéventualités,nousdevonsadmettreaussiquecen’estqu’uneoptionpardéfaut,c’est-à-direenl’absenced’uneinformationplusforteimpliquantunrapportchronologiquedifférent.Leplus-que-parfait dans la principale peut fournir une telle information, commedanslesexemples(41)-(42):
(41)quandilrentra(e1),marieétaitsortie(e2).(e2<e1).(42)quandilseréveillait(e1), lesoleilavaitdisparu(e2).(e2<e1+
itération)qu’ils’agissed’unesituationd’occurrencesingulièrecommeen(41)
ou d’une itération comme en (42), l’éventualité introduite par le pqpprécèdecellequedécritlepsoul’imp.cependant,ilyadescasoùlepqpn’exprimepasl’antérioritéparrapportàl’éventualitéexpriméeparlasubordonnéeaups,commedansl’exemplesuivantempruntéàborillo(borillo,1988):
(43)ils avaient tous protesté (e1) quand la loi fut appliquée (e2).(e2<e1).
L’exemple (43)montreque lepqppeutexprimer l’antérioriténonpasparrapportàlapropositiontemporelle(quand P),maisparrapportàunautremoment situépostérieurementà l’éventualitédécritepar lasubordonnée.Lapropositiontemporelleserttoujoursderepèretempo-relpourlalocalisationdee1.maiscettefois-ci(e1)suitcerepère.c’estparcequelarelationdiscursivederésultatqu’oninfèredans(43)exigedetraitere1(laprotestationdetoutlemonde)commeuneréactionàe2(l’applicationdelaloi),cequiempêchequee1précèdee2,maisimposel’ordretemporelinverse.
17ainsi,pourlasuiteps,impaumoinstroisrelationsdiscursivessontdisponibles:l’arrière-plan,lerésultatetl’explication.Laconjonctionquandn’admetquel’arrière-planpourcettemêmesuitedestv.
La conjonction quand et les relations temporelles en français

Stanojević V.
276
3.4 quand et deux Ps (ou PC)siunesuitedepsexprimepardéfautlasuccessivité,c’est-à-direla
progressiontemporelle,commeleprétendentavecraisonkampetro-hrer(kampetrohrer,1983),laquestionseposedesavoirsilamêmere-lationestpréservéedanslesenchaînementsdeformequand PPs,QPs.18supposonsquelaconjonctionquandexprimelasimultanéitépardéfautetquesoninstructionestmoinsfortequecelledups.ondevraits’at-tendrealorsàcequ’unesuitequand PPs, QPssignalelaprogressiontem-porelle eP<eq.comme laproposition temporelle introduit lepointderéférencepourl’interprétationdelaprincipale,quelquesoitl’ordreef-fectifdespropositions(Quand P,QouQ, quand P),l’ordretemporeldeséventualitésrestelemême:eP<eq.cesprédictionssemblentconfirméespar les exemples (44)et (45), auxquels correspond la suitedephrasessimplesen(46).
(44)quandpaulentra(e1),marieseleva(e2).e1<e2(45)marieseleva(e2)quandpaulentra(e1).e1<e2(46)paulentra(e1).marieseleva.(e2).e1<e2cependantleschosessontpluscompliquéesquenelelaissentsup-
poserlesexemplesprécédents.pours’enconvaincreilsuffitdeconsidérerd’abordlecasdedeuxphrasessimples,commeen(47)et(48).Lasuitededeuxpsimpliquenormalementlaprogressiontemporelle(e1<e2),etcequelquesoitl’aspectlexicalduverbe.19L’interprétationnaturelledesséquencesen(47)et(48)seradonce1<e2.
(47)marieservitledîner(e1).ellechanta(e2).(48)marie traversa la rue (e1). elle s’assit sur le bord du trottoir
(e2).(49)quandmariepréparaledîner,ellechanta.cependant en (49), c’est la simultanéité etnonpas la progression
temporellequiesteffective.siunesuitedephrasessimplesp,qavecdesverbesduratifsetdynamiques(commeen47)aupsexprimepardéfautla successivité, c’est-à-dire la progression temporelle, la séquence cor-respondante introduiteparquand (Quand P,Q) s’interprètepardéfautcomme exprimant la simultanéité approximative (ou recouvrement).c’estparceque la conjonctionquand n’imposepas la successivité auxéventualitésqu’ellemetenrelation.danslesexemples(44)et(45)l’ordre
18par pps et qimp on note qu’une proposition p est au passé simple et qu’une propositionqestàl’imparfait.
19cependant,pourlesexceptionsvoirkampetrohrer1983;borilloetal.2004.

277
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
temporele1<e2provientdel’emploidesverbesperfectifs20etdufaitquelasubordonnéequand Pintroduitlepointderéférencepertinentpourlalocalisationdel’éventualitédénotéeparlaprincipale.cepointdere-pèreétantdonné,onsitueeqparrapportàePenfonctiond’uncertainnombredeparamètresdontlesplusimportantssont:lestempsverbaux,l’aspectlexical,l’instructiondelaconjonctionquand,etc.
Laconjonctionquandexprimepardéfautlarelationdesimultanéi-té,àmoinsquel’aspectlexicalouletempsverbalnes’yoppose.pourcequiestdestempsverbaux,c’estlepqpquiimposetypiquementl’ordretemporelinverse,alorsquelesverbesnonduratifsaupsprivilégientlasuccessivité.danslecasdesverbesduratifsetdynamiques(lesactivitésetlesaccomplissementsdevendler)l’interprétationprivilégiéeestlasi-multanéité,commedansl’exemple(49).Lorsqu’enexprimantlasimulta-néitéondécritunétatdechosesphysiquementimpossible,laphraseestinacceptable,commecelleen(50).pourpouvoirs’asseoirsurleborddutrottoirmariedoitd’abordparveniràl’autreboutdelarue.cependant,l’emploidelaconjonctionquandetdedeuxverbesdynamiquesdontlepremierestduratif,imposelasimultanéitéentrelesdeuxactions,cequin’estcependantpaspossibleen(50).sileprédicatdelaprincipaleexpri-meuneactionquipeutsedéroulerparallèlementaveccelledelasubor-donnée,laphrasedevientacceptable,commelemontrel’exemple(51):
(50)*quandmarietraversalarue,elles’assitsurleborddutrottoir.(51)quandmarietraversalarue,toutlemondelasuivitduregard.
4. ConclusionLaconjonctionquandprivilégielarelationdesimultanéitéapproxi-
mative.ellel’exprimepardéfaut,c’est-à-direenl’absenced’uneinstruc-tionplus forte impliquantunrapportchronologiquedifférent. il s’agitnotammentduplus-que-parfait,maisaussidel’aspectlexical.eneffet,lesverbesperfectifsnonduratifsprivilégientlarelationdesuccessivitéimmédiate,saufdanslecasdelavaleurcausaledequand.
touteslespropriétésdequandqu’onaexaminéesdanscetravailcor-roborent l’hypothèse selon laquellequand introduit lepointde repèrepourlalocalisationdel’actiondénotéeparlaprincipale.ils’agitdespro-priétéssuivantes:1)quandnetolèrepasdelapstemporelexplicite(etmêmeimplicitesaufsilarelationcausalepeutêtreinférée),2)L’aversiondelaprincipalevis-à-visdupassécomposérésultatif,3)quandexclutcertaines combinaisons de temps verbaux et notamment celles dans
20Les verbes entrer et se lever sont des achèvements selon l’ontologie de vendler (ven-dler,1967).
La conjonction quand et les relations temporelles en français

Stanojević V.
278
lesquellesquand Pade ladifficultéà introduire lepointderéférence,4)quandmodifiecertainesrelationsdiscursives enprivilégiantl’arriè-re-plandans lesconfigurationsdeformeQuand Ps, IMP.finalement,quandestàmêmedemodifierlarelationtemporelleentredeuxproposi-tionsindépendantesaupassésimplesid’autresfacteursn’interviennentpas(commel’aspectlexical).cettemodificationestenaccordavecsonsémantismedebase,àsavoirl’expressiondelasimultanéitéapproxima-tive.
Bibliographie
asher 1993: n. asher, reference to abstract objects in discourse, dordrecht:kluwer.ašić,stanojević2009:t.ašić,v.stanojević,Lefutur,l’ordretemporaletlesin-férencescontextuelles, entre sens et signification. Constitution du sens: points de vue sur l’articulation sémantique-pragmatique, paris:L’harmattan,27-41.borillo1988:a.borillo,quelquesremarquessurquandconnecteurtemporel,Langue française,77,paris:armandcolin,71-91.borilloetal.2003:a.borilloetal.,tenseandaspect,Handbook of French se-mantics,standford:csLi.camus1957:a.camus,L’etranger,paris:gallimard.hinrichs1986:e.hinrichs,temporalanaphorain:discoursesofenglish,Lin-guistics and Philosophy,9,netherlands:springer,63-82.hobbs2004:J.-r.hobbs,modélisationdudiscours:viséeetstructuresdudis-cours, in:c.gardent,f.corblin,interpréter en contexte,paris:hermes,196-227.kamp,rohrer1983:h.kamp,c.rohrer,tenseintexts,in:r.bäuerleetal.(eds),Meaning, use, and Interpretation of language,berlin:degruyter,250-269.kamp,reyle 1993:h.kamp,u.reyle,From discourse to Logic,dordrecht:kluweracademicpublishers.Lascarides,asher1993:a.Lascarides,n.asher,temporalinterpretation,dis-courserelationsandcommonsenseentailment,linguistics and Philosopohy,16,netherlands:springer,437-493.molendijk1985:a.molendijk,pointréférentieletimparfait,Langue française,67,paris:armandcolin,78-94.molendijk1991:a.molendijk,onquand-clauses,in:m.kasetal.(eds),Lan-guage and Cognition,1,groningen:moutondegruyter.molendijk2002:a.molendijk,Lastructurationlogico-temporelledutexte:lepassé simple et l’imparfait du français,Cahiers Chronos, 9,amsterdam:ro-dopi,91-104.

279
Nasl
e|e 19
• 2011 • 26
5-279
moeschler1998: J.moeschler,Les relationsentreévénementset l’interpréta-tiondesénoncés,in:J.moeschler&al.,le temps des événements. Pragmatique de la référencetemporelle,paris:kimé,293-321.moeschler2000:J.moeschler,L’ordretemporelest-ilnaturel?narration,cau-salitéettempsverbaux,in:J.moeschler,m-J.béguelin(eds.),Référence tem-porelle et Nominale: actes du 3e Cycle romand de sciences du langage, Cluny (15-20 avril 1996).berne:peterLang,146-159.parte1984:b.parte,nominalandtemporalanaphora,Linguistics and Philoso-phy,7,netherlands:springer,243-286.pekba2004:t.pekba,connecteursetrelationsdediscours:lescasde‘quand’,‘encore’ et ‘aussi’,Cahiers de linguistique française, 25,genève:université degenève,237-256.rice1988:a.rice,Lestat le vampire, traduitdel’anglaisparbéatricevierne,paris:albinmichel.stanojević,ašić2008:v.stanojević,t.ašić,semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku,kragujevac:fiLum.vendler1967:z.vendler,linguistics in Philosophy,ithaca:cornelluniversitypress,97-121.vet 1991: c. vet, the temporal structure of discourse: setting, change, andperspective,ins.fleichman,L.r.waugh(eds),discourse pragmatics and the verb: The evidence from romance,Londres/newyork:routledge,5-25.vetters1996:c.vetters,Temps, aspect et narration,amsterdam/atlanta:ro-dopi.
Веран СтанојевићВЕЗНИК qUAND И ТЕМПОРАЛНЕ РЕЛАЦИЈЕ У
ФРАНЦУСКОМ Резиме
У раду испитујемо улогу временског везника quand у интерпретацији реченица укојимаовајвезникфигурира.ПосебносеусредсређујемонасемантичкеразликеизмеђуреченицатипаQuand P, QиодговарајућихнизованезависнихклаузаP, Q.Показалисмодасеупотребомвезникаquandпододређенимусловимаможемодификовататемпоралнарелацијакојасеуспостављаупоменутимнизовиманезависнихклауза.Тонамјеомогући-лодабољесхватимонесамосемантичкидоприносовогвезниказначењуреченицакојеуводи,негоипринудекојепроизилазеизупотребенекихглаголскихвременаутаквимреченицама.
Примљено: 31. 1. 2011.
La conjonction quand et les relations temporelles en français


281
УДКрад
Tijana AšićFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
CoMMENT TRADuIRE LES EFFETS STYLISTIquES eT PrAGMATIqueS DeS TeMPS VerBAux?
ANALySe Du coNTe «PerIferIJSKI ZMAJeVI» De VIDoSAV STeVANoVIć eT De SoN
équIVALeNT frANçAIS1
danscetarticle,nousanalysonslesdifférentesfonctionsstylistiquesdestempsverbauxdansleconte«periferijskizmajevi»(«LesLoulousdebanlieue»)devidosavstevanović.nouspartonsdel’hypothèsequelestempsverbauxneserventpasuniquementàattribuerlaréférencetempo-relleauxévénementsracontésmaisaussiàlesreprésentersousdifférentspointsdevue.notrebutestnonseulementdedétermineretdécrireleseffetspragmatiquesdedifférentsemploisdecesexpressionsprocédura-lesdanslanarrationmaisaussidevoirsiestcommentceseffetspeuventêtrereproduitsdanslatraductionfrançaisedecetexte.
Mots-clés: tempsverbaux,aspect,sémantique,pragmatique,stylis-tique,narration,pointdevue,traduction,subjectivité,événement
1. Introductiondanscetravailnousnousproposonsd’investiguerdeuxterrainslin-
guistiques:àtraverslepremiernousessayeronsdecomprendreetd’ex-pliquerlerôledestempsverbauxdanslacréationdurythme,delamélo-dieetdesdétoursdelanarration.quantaudeuxième,ilnouspermettradedécouvrirsietcommentleseffetsstylistiquesetpragmatiquesdansleconteenserbepeuventêtrereproduitsdanssonéquivalentfrançais.cela nous aidera à comprendre l’importance des différences entre lesdeuxlanguesencequiconcernel’encodagedutempsetdel’aspect.deplus,encomparantl’orchestrationdestempsverbauxdansleconteori-ginaletdanssaversionfrançaisenousallonstesteràquelpointcelle-cireprésenteundéfipourletraducteur.
1 ce travail est effectué dans le cadre du projet scientifique n 178014 du ministère dessciencesdelaserbie

Ašić T.
282
2. sur le conteLeconte«periferijskizmajevi» («LesLoulousdebanlieue») paruen
1978danslerecueilportantlemêmetitre, estunrécitd’ambiance.eneffetl’intriguen’yestqu’unfilquitientdefinesanalysespsychologiquesetdesobservationsmélancoliqueset ironiquesdesonauteur:vidosavstevanovićydépeintunmilieudéfavoriséetl’époquedufauxsocialismedepuislaperspectived’unhommemarginaliséetmoralementdéchu.silathématiqueestassezordinaire,lestyledépasselecadreréaliste:onytrouvesouventdesélémentsfantasmagoriques.
Lerécitconsisteendeuxparties:danslapremière-quisepasseàbelgrade,lenarrateurquiestenmêmetempslehérosprincipal,décritsavisitedanslequartieroù,jadis,ilvivaitetexerçaitunsalemétier.Lethèmeprincipalestleconflitentresonpassé,représentésousformederéminiscences,etleprésentqu’ilestentraindedécouvrir,examineretdécrire.onestdevantunemosaïquededescriptions,d’introspectionsetderêves,grâceauquelonentredansledomaineduréalisme fantas-tique; cemondede réflexion et de rêverie est deux fois secouépar laréalité:lapremièrefoislorsquelehérosaperçoitsonpèredanslarueetladeuxièmefois lorsqu’ildécidederendrevisiteàsonex-copine,unefemmeauxmœurslibres.Leursretrouvaillessonttrèsfroidesetellenelelaissemêmepasentrerdanssamaisonàelle,sibienqu’ilest,pendantleurentretien,obligéderesteraudessousdesafenêtre.cetévénementinachevéetindéfinimarquelafindelapremièrepartie.
dansladeuxièmepartiedurécitl’histoirecentraleestinséréedansleconte-cadre:lenarrateursetrouvemaintenantdansunhôtelàberlind’où il rédigeune lettredans laquelle ildévoile saviede souteneur. ildécritsonmétiermalhonnête,parledesesrelationsavecdesgensdumi-lieu etenfin,relatesadernièreexpérience:sonbossluiaordonnéd’alleràberlinetpendantlevoyage,dansl’avion,ildécouvrequel’hautessedel’airestuneanciennecopineàlui;encoreunefoisilretourneàl’époqueoùilétaitunlouloudebanlieue.encoreunefoisl’histoireabordelesujetduconflitentreleprésentminableetlepassé«glorieux» dupersonnageprincipal.commesonanciennecopinenemontreaucunsentimentpourlui,iléprouvelebesoindes’alcooliseretfuitlaréalitéensomnolant.or,cetteatmosphèremorosededéception,demélancolieetdedésespoirestéclairéeparunrayondesoleil:àl’aéroportdebelgradeonluiaconfiéungarçonqui,selonsamémé,devaitallerenallemagnejoindresafamille.pendantlevollepetitestassisàcotédeluietilsentamentuneconver-sation.unefoisarrivéàberlin, lehéroset lebonhommeattendentenvain lesparentsde l’enfant: c’est à cemoment-làque tout change– lesouteneurdécidequ’ilvas’occuperdugarçonetilsvontensembleàla

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
283
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
rencontredelagrandeville,ensedirigeantversunfuturincertainmaisilluminéparl’amour.
3. sur le système de temps verbaux en français et en serbedansnostravauxportantsurlatemporaliténousavonsdémontré
qu’ilyatroisparamètresnécessairespourletraitementsémantiquedestempsverbauxenfrançais(stanojević,ašić2008).cesont:leparamètretemporel, leparamètreaspectuel et leparamètrediscursif.Lepremierparamètre désigne l’instruction des temps verbaux sur la localisationdel’éventualité(e)dansletemps.ensuivantlathéoriedereichenbach(reichenbach1947)nous supposons, en effet, qu’à chaque tempsver-balcorrespondunecombinaisondestroispointstemporels(e,rets2)surl’axedutemps.ilestpossiblededéfinirl’instructiontemporelledestempsverbauxaumoyendecestroispoints3.
L’instructionqueleparamètreaspectueldonneconcernelemodedereprésentationduprocessus.siletempsverbalprésenteecommeétantencoursaumoment/intervallerleprocessusestvucommeimperfec-tif.si,parcontreeestprésentécommeterminéàrleprocessusestvucommeperfectif.autrementditonar⊆epour l’aspect imperfectifete⊆rpourl’aspectperfectif(voirstanojević,ašić2008).
Le paramètre discursif concerne l’ordre temporel des éventualitésreprésentéesdans lediscours.eneffet, le tempsdans lediscourspeutavancer,reculeroustagner4.ilestimportantdenoterquecetyped’ins-tructionsdestempsverbauxestnondéductibledurapportentreeetr.
ils’ensuitquelestempsverbauxnedifférentpasuniquementselonl’information temporellemaisaussi selon lamanièredont l’éventualitéestreprésentéeetselonlarelationquilalieauxautreséventualitésdanslediscours.
aladifférencedufrançaisleserben’encodepasl’informationaspec-tuellegrammaticalement(parlestempsverbaux)maismorphologique-mentparlesaffixesmarquantletypeaspectuelduverbe-ainsionadespairsdeverbesdontunmembreesttoujoursaspectuellementdérivédel’autre(čitati – lire; PrOčitati – avoir lu; kupIti – acheter; kupOVati - être en train d’acheter.cecidit l’opposition imparfait–passé simpleestenserbemoderneremplacéeparl’oppositionlepassécomposédesverbesimperfectifs– lepassécomposédesverbesperfectifs.parconséquent,
2 s = lemoment de la parole; e = lemoment de l’événement; r = le point référentiel, parrapportauquelsesituelemomentdel’événement.
3 voici quelques exemples: Le présent: e,r,s; le passé composé: e-r,s; le plus-que-par-fait:e-r-s;l’imparfaitetlepassésimple:e,r-s(stanojević,ašić2008).
4 ainsi, avec le passé simple le temps avance, avec le plus-que-parfait le temps reculetandisqu’avecl’imparfaitletempsnebougepas.

Ašić T.
284
l’imparfait est presque tombé en désuétude et l’aoriste, qui apparaît àl’écritcommeàl’oral,esttoujourspragmatiquementmarqué.
4. L’emploi des temps verbaux dans le contedans son travail benveniste (cf benveniste, 1966) distingue deux
grandstypesd’énoncés,issusdedeuxtypesd’énonciations:a)ceuxquior-ganisentleursrepéragesparrapportàlasituationd’énonciation;l’énoncétrouvesesracinesdans l’actualitédes locuteurs ( je / tu / ici / mainte-nant ).c’estune«énonciationquisupposeunlocuteuretunauditeur,etchezlepremier,l’intentiond’influencerl’autreenquelquemanière».ils’agitduplandiscursifetpersonnalisé.b)ceuxquin’embrayentpassurl’actualitéénonciative,etqui«construisentdesrepéragesparunjeuderenvoisinternesàl’énoncé».ilparlealorsdeplansnonembrayésetd’histoire(ouénonciationhistorique).Lelocuteurn’intervientpasdanssonénoncé.
ilestànoterquev.stevanovićsesert,danssonprocédénarratif,destempsverbauxappartenantauplan historique de l’énonciation (l’ao-ristenarratif, l’imparfait, leplus-que-parfaitet leprésentcinématogra-phique5),maisaussiauplan Discursif d’énonciation:*leprésentperfectif,lepassécomposé,lefuturetl’aoristedelaréactionimmédiate6.celadit,onestàmischeminentrelanarrationoraleetécrite.deplus,l’écrivainutilisedespropositionsaverbalesmaisuniquementpourdécrirelaréa-litédesobjetsmatériauxdanslaquellesepromènelenarrateur,laréalitéquinefigurepasseulementcommeundécormaisquiestaussilasourcedesréflexionsmétaphoriquesetmêmedesescapadesoniriques.
iln’estpasdifficiledes’apercevoirquelestempsverbauxneserventpasseulementàsituerlesprédicatssurl’axedutempsmaisaussiàjouersurlesdifférentesperspectivesnarrativesetreprésentationsdesévéne-ments.
essayonsd’énumérer lesdifférents typesd’effetsobtenusgrâceauxvariationsdansl’emploidestempsverbaux.notonsquelepointdevue(ausensdegenette,1972)changetout letemps:nousverronsdanslasectionsuivantecommentlerécitnon-focalisédevientlavoixdelafo-calisationinterne7,bientôttransforméendescriptionviergeetobjective,quel’onpourraitqualifiercommefocalisationexterne.
5 il s’agit du présent utilisé pour représenter les événements passés d’une manière spéci-fique–commes’ilssedéroulaientdevantleslentillesd’unecaméra.
6 dans le discours oral l’aoriste est utilisé pour marquer la réaction émotionnelle auxévénementsrécents.atitred’exemple:Jao, ispade mi čaša! aï, j’ai laissé tomber un verre!
7 danssathéorienarratologique,g.genette(1972)faitladistinctionentrelesrécitsnon-fo-calisésetfocalisés,quipeuventavoirunefocalisationinterneouexterne.grosso modo,danslerécitnon-focalisé,lenarrateurenditplusquen’ensaitaucunpersonnage,danslecasdela

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
285
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
deuxièmementaveclestempsverbauxonpeutaccélérerlerythmenarratif-cequisepasselorsquel’aoristeouleprésentperfectifsontuti-lisés.onpeutaussibien le ralentir,c’est le rôledupassécomposédesverbes imperfectif et du présent cinématographique. ajoutons qu’onpeutégalementannulerlefluxdutemps,cequ’onobtientavecdesphra-sesaverbales.ils’ensuitquelestempsverbauxsontdespropulseursdudynamismenarratif.orleursfonctionsnes’épuisentpasdansleurpo-tentieldiscursif.nonseulementqu’ilsdirigentletondel’histoireracon-tée, ils le reflètent aussi.en fait, ils s’accommodent au styledenarra-tionquiesttrèsvarié:ilsvontdudiscoursneutreetnaturaliste,àtraversl’auto-ironieetlapseudo-pathétiquejusqu’àlaconfessiondesémotionsauthentiques.
finalement,lestempsverbauxserventàmarquerlesmomentsper-tinentsdans la trameet enquelque sorte à lier les thèmesprincipauxdanslerécit.ainsi,onpeutconstaterquelesévénements-clésontintro-duitsparl’aoriste–parexemplelorsquelehérosrencontreleflicàl’aé-roportoulorsquezorica,sonex-copine,s’adresseàlui,pendantlevol.quantàl’imparfait,tempsanachroniqueenserbe,ilestutilisépourren-drecomptedesétatspsychiquesaigusdesprotagonistes,àsavoirpourleseffetsdesubjectivisation.
nousaimerionssoulignerencoreunpoint:lepassécomposédéfec-tif(laformesansauxiliairequiconsisteuniquementenparticipepassé)apparaîtàdeuxmomentscruciauxdansleconte:lorsquelegarçonestintroduitdans l’histoire (sa grand-mère le confie auhérosprincipal àl’aéroportdebelgradeenluiexpliquantqu’ilvaenallemagnechezsesparents)etlorsque,àl’aéroportdeberlin,l’enfantserrelamaindunar-rateur–cemouvementsymboliqueindiquelecommencementdeleurtendreamitiéetpeutreleverd’unautrecontequiattendàêtreraconté.
5. quelques emplois spécifiques de temps verbaux dans le conte et dans sa traduction
5.1 Introductiondanscettepartienousprésenteronsplusieurscasd’emploisspécifi-
quesdestempsverbauxdansleconteafind’examinersietcommentleseffets stylistiques créés sont reproduits dans la version française. plusprécisément,nousanalyseronsdesdifférences subtiles engendréesparlesdifférentesmanièresdenarrerdeséventualitéspasséesenserbe: le
focalisationinterne,lenarrateuradoptelepointdevued’unpersonnagedel’histoire,tandisquedanslecasdelafocalisationexterne,lenarrateurenditmoinsquen’ensaitchaqueper-sonnage.

Ašić T.
286
passécomposé,leprésentperfectif,leprésentimperfectif,l’aoriste,l’im-parfaitetleconditionnel.
5.2 le contraste présent - passéil s’agitd’unescènepuissanteoù lenarrateur,unefoisarrivédans
sonancienquartier,rencontrelesnouveauxLoulousdebanlieue.illesobserveet lescompare,avecunecertainenostalgie, à sapropregéné-ration. Le contraste entre ces deux mondes est marqué lexicalement(par lesadjectifsantonymiques),maisaussiparunjeulinguistiqueoùoncontrastedesexpressionsprocédurales:lespronoms(onanousver-susils)etlestempsverbaux:lenarrateursesertdupassécomposédesverbesimperfectifspourdécrirelesanciensLoulousetduprésentpourdépeindrelesnouveauxfripons.enfrançaiscecontrasteestexpriméparl’oppositionl’imparfait-leprésent
1) mi smo bili golobradi, zalizanih kosa, opremljeni urednimtarzankama – ovi drugi su bradati, čupavi, kao da su ucmekalibricu.Nous autres étions rasés, les cheveux gominés, proprement habillés – ceux-là sont barbus et hirsutes, comme s’ils n avaient jamais vu de coiffeur de leur vie.choseintéressante,danslapropositionsubordonnéeenfrançaison
aleplus-que-parfaitetnonlepassécomposé,bienquedanslaprincipaleleprésentsoitemployé.
5.3 la focalisation internenous avons déjà mentionné que l’imparfait est en serbe tombé
endésuétudeetque lesphrasesoùilestemployésontstylistiquementmarquées.Lafonctiondecetempsverbalnepeutpasêtreréduiteàsesinstructionsaspecto-temporelles.eneffetsonemploiinvitelelecteur/destinataireàimaginerl’existenced’unsujetdeconsciencequiparticipementalementauxévénementsnarrés.par conséquentonestdansunesortedefocalisationinterne.ilestàsoulignerquel’imparfaitexpressifduserbeesttraduitparleprésentfrançais:
2) Trola beše poluprazna. le trolley est à moitié vide3) sva lica mi behu poznata. les visages me semblent connus. 4) lica im behu bleda. leurs visages sont pâles.

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
287
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
essayonsdedéchiffrercechoixdutraducteur.ilsemblequelatâcheprincipaledecelui-cin’estpasd’attribuerlaréférencetemporelleauxétatsenquestionmaisdemontrerquelehérosréagitauxscènesreprésentées.avecl’imparfait,quiestenfrançaisuntempsverbalnonmarquéetneu-treonauraiteudesdescriptions incoloresdesétatsdechoses.avec leprésentcinématographiqueonprésumeunspectateurbouleversé.
notonsquedanslaversionfrançaisel’imparfaitestutilisélorsquelehéros/narrateursetransposedanssonproprepassé.Ledéclencheurdesonemploiestl’adverbeautrefois.
5) autrefois nous venions tous y frapper dans l obscurité.
parcontredanslapartietrèsexpressiveoùlehéross’adresse,danssespensées,àsonex,sesparolesreprésentéessontaupassécomposé:
6) To si zaista bila ti! Bila si ista kao nekada, ali drukčija. Kako li sam ja tebi izgledao...? Kako si preživela taj susret sa klovnom što je iskočio odnekud i počeo da se krevelji?
Lerôledepassécomposéiciestdesignalerqueledialogues’effectuedansl’imaginationetaumomentdelanarrationetnondanslaréalitéetdansletempsdelafiction.danslaversionfrançaisecettetranspositionestgénéréeparl’imparfaitaveclesétatsetparlepassécomposépourlesverbesperfectifs.c’estgrâceaupassécomposéqu’onal’impressionquelehéross’adresseréellementàzorica;lafrontièreentrelevécuetl’ima-ginaires’efface:
6’) Tu étais la même qu’autrefois et pourtant différente. Quel air pouvais-je avoir à tes yeux, moi…? Comment as-tu pu supporter ce face à face avec un clown surgi d’on ne sait où et qui s’est mis soudain à baragouiner?
5.4 le temps principal de la narration dansleconteoriginalletempsprincipal,letempsquiformel’arma-
turedel’intrigueestlepassécomposéperfectif:ilestemployélorsquelesnouveauxévénementssontintroduits.
atitred’exemple,aumomentoùlehéross’approchedesnouveauxLoulous,onassisteàunesuited’événementsaupassécomposé:
7) Prišao sam im. Isprsio sam se, strpao ruke u džepove (...) Zapalio sam novu pljugunotons que le passé composé perfectif n’apporte pas de effetsstylistiquesspéciaux.

Ašić T.
288
dans la traduction française le temps principal est le présentnarratif:7’) Je m’approche d’eux. Je me redresse, j’enfonce mes mains dans mes poches (…) J’allume une autre sèche.ilsemblequeletraducteurinsistesurl’effetcinématographiquedu
présent,qu’ilveutralentirlecoursdesévénementspourattireretgarderl’attentiondulecteuretpourdonnerl’impressionquelenarrateurnousrelatelesmomentsqu’ilestentraindevivre.
5.5 le conditionnel d’itérationenserbe il y adeuxmanièresd’exprimer l’itérationdans lepassé:
soitonutiliselepassécomposéimperfectif,soitleconditionnelprésent.danslepremiercasondonneuneimageglobaleethomogènedel’en-sembledesprocessusrépétésqu’onreprésenteontologiquemententantque faits.dans ledeuxièmecasonmet l’accentsurchacunedesréali-sationsduprocessus.celadit,lelecteural’impressionquechacundesévénementsrépétésestautonomeetsedérouledevantsesyeux:
8) Čas bi poleteo napred i jedva se prikupio a čas zastao, zametnuo se i bavrljao u mestu - usput je ispuštao nekakav zvuk, nešto između grgotanja, šištanja i jaukaenfrançaisilyaunseulmoyend’exprimerl’itérationdanslepassé
–grâceàsanatureaspectuellel’imparfaitpeutdénoterlarépartitionré-gulièredesévénementsdansunintervallesituéavantlemomentdelaparole.cependantavecl’imparfait(voirašić,stanojević2010)onperdleseffetsdudynamiseetdefocalisation.c’estpourcelaquedanslatra-duction française leprésentcinématographiqueest employé–celui-cinousmetencontactaveclesépisodesparticuliersdesévénementsitérés;ilssedéroulentdevantnosyeux.parconséquentonpeutdirequelavi-vacitédel’expressionestpréservée:
8’) Tantôt il se précipite en avant se retenant de tomber, tantôt il s’arrête, se renverse en arrière et titube sur place en laissant entendre un petit son qui tient du grognement, du sifflement et du râle tout a la fois.
5.6 l’aoriste narratifvenons-enàl’aoriste,qui,dansleconteoriginalseglissedetemps
en temps dans la narration au passé composé. sa fonction stylistiqueestdemarquerlesévénementspsychologiquementtrèspertinentsdansl’histoire, les événements qui provoquent une réaction émotionnelle

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
289
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
aiguëdunarrateur:a titre d’exemple, il est employé lorsque le héros,àl’aéroport,tombesurunflicdangereuxqu’ilconnaît,oubienlorsqueleurconversationestcoupéeparlavoixduhaut-parleuretenfinquandzoricadécidedeluiadresserlaparoledansl’avion.ilsemblequel’aoristereflètelesturbulencesdesonâme:
9)upravo tada, kao naručen, natrča strašni Domaćinski,10) Zvučnik prekide razgovor ugodni, raziđosmo se kao što smo se i sastali. 11) Malo kasnije, ona (…) zaista dođe i stade (...) a mene zabole trbuh.
etantdonnéqu’enfrançaislepassésimpleestletempsessentieldelanarrationilnepeutpasproduiredeseffetsspéciaux.Letraducteuradoncencoreunefoisoptépourleprésentcinématographique:
9’) C’est juste alors que je tombe, comme un fait exprès, sur le grand méchant loup.10’) le haut-parleur interrompt cette plaisanteconversation.11’) Quelques instants plus tard, la voila qui revient … qui me fout une crampe dans l’estomac.
5.7 le passé composé défectif commeonadéjàindiquédanscetarticlelepassécomposédéfectif
marquedeuxévénementsquisontsuperficiellementépisodiques,maisquiontunegrande importancedans la sémantiqueprofondede l’his-toire.L’analogielinguistiquereflèteainsilarelationsymboliqueetméta-physiqueentredeuxmomentsoùlehérosdécouvreunnouveausensdesonexistence–lepetitgarçondontilvas’occuper:
12) Još u čekaonici mi neki bakut iz prošlog veka uvalio jednog tršavog klinju.13) Na ulazu me uhvatio za ruku i črsto je stisnuo.
danslaversionfrançaiselepremierpassécomposédéfectifesttra-duitparleplus-que-parfaitetledeuxièmeparleprésentcinématogra-phique:
12’) encore dans la salle d attente une mémé du siècle dernier m’avait confié un bambin tout frisé.
13’) Il me saisit la main et me la serre très fort.

Ašić T.
290
manifestement, le traducteurn’apas trouvédemoyenspourmar-quer,dansletextefrançais,cetteanalogieentrelaformeetlesens.
5.8 le discours indirect libreLediscoursindirectlibreestuneformelinguistiquehybriderepo-
santsurleprincipedepolyphoniediscursive(banfield1995):ilcontientdes marqueurs du discours direct (les tournures syntaxiques commel’interrogation,l’exclamation,laphraseaverbale,lapossibilitéd’employerlesinterjections,laprésencedesexpressionsdéictiquesspatialesettem-porelles renvoyant a hic et nunc, l’emploi libre des jargonismes)maisaussidudiscoursindirect(laréférencetemporellesefaitparrapportaumomentd’événementetnonparrapportaumomentd’énonciation,demêmelemoidulocuteuresttransforméentroisièmepersonne).grâceacesmécanismessémantiquesetpragmatiquesonal’impressionquelavoixdupersonnageetcelledunarrateur«s’enchevêtrent»,desortequ’onne sait jamais parfaitement si c’est le narrateur ouunpersonnage quiparle.desortequelelecteursetrouvetantôtaucentreettantôtdel’autrecôtéd’unsujetdeconscienceentrainderéfléchiretderéagir.
orcettesubjectivisationestannuléedanslediscoursindirectlibreutilisédansleconte«LesLoulousdebanlieue».c’estparcequ’ilnesertpasàreprésenterlemonologueintérieurmaislesparolesprononcéesàhautevoix.Lenarrateuryreprésentelamanièredontundespersonnagessadresseàluietenmêmetempssapropreréactionàcequ’ilentend.
14) Još u čekaonici mi neki bakut iz prošlog veka uvali jednog tršavog klinju sa ovolikim očima. Kao ide dijete, kod roditelja u Dojčland, neka budem dobar, kao što sam lijep, da ga isporučim na tamo njihovom jerodromu. Biće zauvar, pamtiće mi to dok je živa.
notonsquelenarratourannoncedanslaphraseintroductivequ’ils’agitdesparolesetnondesreflexionsrepresentées.cemouvementdis-cursifestencoresoulignépar laprésencede laparticulekao (comme) dont la fonction pragmatique est demarquer la citation non-litérale.notonsquedans lesparolesde lapersonnequi s’adresseaunarrateurlemodeimpératifestremplacéparlatournurespécifiquecontenantlaparticuleexhortativeneka etlesubjonctifbude. Letempsemployédanscetypespécifiquedudiscoursindirectlibreestleprésent.Letexteestenparleriékavien,ilcontientdeslexèmesdelaversionbosniaqueduser-bo-croate(zauvar)etaussidujargondespersonnesnon-éduqués(doj-cland, jerodrom).
essayonsdevoircommentcescaractéristiquessontréaliséesdanslaversionfrançaise.

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
291
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
14’) elle m’avait dit quelque chose du genre: l’enfant s’en va à deutchland chez ses parents; ils l’attendent à l’aéroport et si je suis aussi gentil que je suis beau je ne pourrais refuser de l’accompagner et de le leur remettre; je lui rendrai ce service dont elle me serait reconnaissante jusqu’à la fin de ses jours.
Lapremièrechosequiestmanifesteestqueletexteestauprésent,cequiestatypiquepourlediscoursindirectlibreenfrançais.ilnoussem-blequecechoixdutraducteurestlaconséquencedufaitqueleprésentnarratifestletempsfondamentaldelaversionfrançaisedececonte.deplus,c’estavec leprésentque lenarrateur indiquequ’ilestentraindetransmettrelesparolesetnonlespenséesd’undespersonnages.
enplus, la tournureexhortativeavecnekadans l’original estdanslatraductionremplacéeparunephrasehypothétiqueréelleoùona leconditionnelprésentduverbepouvoirdansl’apodosedontlafonctionestdetransmettrelamodalitédéontique.
ajoutonsenfinquedanslatraductiononnetrouvequ’unjargonisme(Deutchland)maislasyntaxedecepassageestmaladroiteetmonotone;sibienqu’onsentquecen’estpaslenarrateurmaisunautrepersonnagequiparle.
6. En guise de conclusionnousavonsmontréquelestempsverbauxjouentunrôletrès im-
portant dans lamultiplication demondes et de points de vue qui estlebutsuprêmede lacréationartistique.undesobjectifsessentielsdutraducteurestdecaptertousleseffetsstylistiquesetpragmatiquescréésparlesdifférentsemploisdestempsverbauxdansletexteoriginalpourlereproduireensuitedanslatraduction.
notreanalysecontrastiveamontréqu’iln’yapasdemappingbijec-tifentrel’ensembledestempsverbauxutilisésdansleconteoriginaletl’ensembledestempsverbauxutilisédanslatraductionatitred’exemplelesimparfaitsenserbenesontjamaistraduitsparlesimparfaitsfrançais.c’estparcequedanslalittératurelafonctionprincipaledestempsverbauxn’estpasd’attribuerlaréférencetemporelleauxprédicats(celle-ciétantcontextuellement inférée)mais de diriger l’orchestration desmélodiesdanslanarration.grâceàeuxlesévénementssubissentunchangementontologique:ilscessentd’êtredesentitésphysiquesetdeviennentdesen-titéspsychologiques,lesréflexionsdesmouvementsdel’âme.Letravaildulinguisteconsisteàdéchiffrercesmécanismesdetransformationensebasantsurdescritèresstrictementscientifiquesetdesparamètresdéfinis-sablestelsquel’aspect,lesrelationstemporellesetl’ordrediscursif.

Ašić T.
292
Bibliographie
ašić2008:t.ašić, espace, temps, prépositions, genève:droz.ašić, stanojević (2010):t.ašić,v. stanojević,aspectual coercionand someusesof tenses infrenchandenglish,english language and literature studies: structures across cultures ellssaC Proceedings, voL 1, beograd: filološkifakultet,47-59.banfield1995:a.banfield,Phrases sans parole: Théorie du récit et du style indi-rect libre,paris:seuil.benveniste1966:e.benveniste,Problèmes de la linguistique générale,tomei,paris:gallimard.blakemore 1987: d. blakemore, semantic Constraints on Relevance, oxford:blackwell.genette1972:g.genette,Figures iii,paris:seuil.maingueneau1986:d.maingueneau,eléments de linguistique pour le texte lit-téraire,paris:bordas.moeschleret al.1998:J.moeschleret al,Le temps des événements,paris:kimé.reichenbach1947:h.reichenbach,elements of symbolic logic, newyork:thefreeepress.saussure,sthioul1999:L.desaussure,b.sthioul,L’imparfaitnarratif:pointdevueetimagedumonde,Cahiers de Praxématique,32,montpellier:universitépaulvalérie,167-188.stanojević,ašić2008:v.stanojević,t.ašić,semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, kragujevac:fiLum.swart1998:h.deswart,aspectshiftandcoercion,Natural language and lin-guistic theory,16,amsterdam:springernetherlands,346-85.vetters1996:c.vetters,Temps, aspect et narration,amsterdam-atlanta:ro-dopi.

Comment traduire les effets stylistiques et pragmatiques des temps verbaux?
293
Nasl
e|e 19
• 2011 • 28
1-293
Тијана АшићКАКО ПРЕВОДИТИ СТИЛСКЕ И ПРАГМАТИЧКЕ ЕФЕКТЕ
ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА? АНАЛИЗА ПРИПОВЕТКЕ „ПЕРИФЕРИЈСКИ ЗМАЈЕВИ“ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА
И ЊЕНОГ ФРАНЦУСКОГ ЕКВИВАЛЕНТАРезиме
У овом чланку анализирамо различите наративне функције глаголских времена уприповеткиВ.Стевановића„Периферијскизмајеви“.Показујемодајецентралноприпо-ведачковремеуовојпричиперфекатадааорист,имперфект,несвршениисвршенипре-зентслужезастварањепосебнихстилскихипрагматичкихефеката.Другиаспектовоградајепоређењеоригиналаифранцускогпреводаприче–циљнамједаутврдимодалисуинакојиначинуфранцускомеквивалентуостварениефектикојеглаголскавременапроизводеуоргиналу.
Примљено: 3. 2. 2011.


295
УДКрад
[email protected]@yahoo.fr
Dragana Drobnjak, Ana TopoljskaFaculté de philosophie, université de Novi sad
TerMeS BoTANIqueS eT ZooLoGIqueS DANS Le frANçAIS ArGoTIque
Lefrançaisargotique,branchedelanguepopulairenourriedesvo-cabulaires professionnels et techniques, et argots de différentes popu-lationsmarginales,estricheenimagesetrenouvelleincessammentsesprocédésd’expression,spécifiquementsonlexique.nousn’étudionspasdansce travail sesorigines,maisnousanalysonsson lexique.àpartirdes listesdeplusieursdictionnaires, nousdécrivons lesnombreux casdel’utilisationdestermesbotaniquesetzoologiques,àl’aidedelaméta-phorenotamment.
Mots-clés: français argotique, termes botaniques, termes zoologi-ques
Lavariétéderegistresestunedescaractéristiquesdelalanguefrançaise.Lefrançaispopulaireetlefrançaisfamilier,deuxautresqualificatifsdufrançais«nonofficiel»sontsouventemployés,sansdistinction,commeéquivalents du français argotique, au gré du locuteur. cette frontièrequelquefoisfloueexistepourtant,lecontextefamilierétantbiensûrdif-férentdu français populaire et argotique. Le français populaire repré-sentel’étatnatureldelalangue,tellequ’elleseraitsansl’actiondesgram-mairiens(guiraud1958).Lorsque leregistrepopulairesecharged’ex-pressionsvenuesdumilieudeladélinquance,onparlealorsderegistreargotique.Lemélangedesclassesdanslasociétéfrançaiseactuellefaitqu’ilyaempruntsetbrassagedel’unversl’autre.
ceregistretoutcommeceluidufrançaispopulaireestun langageimagé,quelquefoischargéd’unvocabulaireagressifetvulgaire.Laten-danceactuelledel’argotprivilégiel’identitairesurlecryptique:lefran-çaiscontemporaindescitésenparticulieramoinsbesoindemasquersonmessagequedemarquerl’appartenanceàsongroupe.
tout en partageant avec le français populaire des tendances ainsique différentsmodes de formation linguistiques, et donc une grande

Drobnjak D., Topoljska A.
296
partieduvocabulaire, l’originalitédu françaisargotiqueconsisted’unepartenuneforteexpressivitédesmotsetexpressions,nuançantsavi-sionparticulièredumondeetdesonmilieu.d’autrepartilsedifférencieparl’emploidesmotstechniquesdésignantdescatégoriesetactivitésquisontpropresàunmilieu,àunargotspécifique.c’estainsiquesesontépanouisdifférentsargots(ouparlures argotiques)caractéristiquespourdifférentsgroupesprofessionnelsousociaux,ayantrapportàuncertainmodedevie,àunementalité,unesensibilité,unecultureparticulières.
L’argot permet de désigner certaines réalités par un langage dé-tourné,évitantlesmotsduregistrehabituel.partantdel’expériencedechacun,celangagepopulairenommeleschosesquenousconnaissonsdirectement ou indirectement avecuneprédilectionpour la concréti-sationde l’abstrait, ladégradationdes valeurs, lamoquerie et l’ironie.aujourd’hui commehier,on s’ingénueàdévoiler et exprimer tous lesvicesdelasociétécequiexpliquelapauvretéduvocabulaireargotiqueliéàlajusticeetàlabeautédequellenaturequ’ellesoit,etlarichessedulexiqueliéàcertainsdomainescommelalaideurphysiqueetmorale,lamisère, la sexualité, l’argent, la violence, les crimes, la drogue, etc. Ladureréalitéquotidienneréveillelebesoindeprésenterunevisioncomi-quedumonde,c’estlàunesourcedestrouvailleslesplusoriginalesdesmétaphoresironiques.
Le français argotique est un langage ouvert où lesmots changentfacilementdesensetquinesuitquedetrèsloinlesrèglesphonétiques,morphologiquesetsyntaxiquesdelalanguestandard.
nousnoussommesproposéicid’étudierlefrançaisargotiqueuni-quementcommeunvocabulaireàpart,plusparticulièrementlestermesbotaniquesetzoologiquespourmieuxdéterminerlaproductiond’ima-gesetd’expressionsqu’ils inspirent.Levocabulairede la languepopu-laireetargotiqueserenouvelantsanscessequelquefoissansaucunetraceécrite, le corpusquenousavonsdonné icine représentepasune listeexhaustive,maisilcontientdestermesquiontréussiàsubsistermalgréletemps.
Lamétaphoreestlemodeleplusprisédecréation,enlangueargoti-que,associantdeuxtermesappartenantàdeschampslexicauxdifférents.elletransmet,enrichitetnuancelapenséeremplissantainsilafonctioncryptologiqueaussibienqueludique.
Lamétaphoredansnosexemplessefondesurl’analogieentreuneplanteouunanimaletunepersonneouunautreélémentdelasociété,cetteanalogieétantdeforme(pruneauxpourtesticules)oudecompor-tement (traits de caractères). déjà certains noms génériques commel’animal (personne retorse, brusque dans ses attitudes), le bovin (per-

Termes botaniques et zoologiques dans le français argotique
297
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
5-3
02
sonneapathique), la bestiole (jeune sotte) et l’oiseau (individu louche)nous introduisentdans le règnedes imagesmétaphoriquesse référantauxpersonnes.
selon l’image initiale,nousdistinguonstroiscatégoriesseréférantauxpersonnes:
1) L’apparencephysiqueseulecréedesimagesdansl’espritdanscettecatégorie l’analogiede formeestexprimée tantpardes
termesbotaniquesquepardestermeszoologiques,parfoisseréférantàl’apparencephysiqueexclusivementmasculine,parfoisféminineousansdistinctiondesexe.
Lesmétaphoressuivantesexprimentl’obésitéoulamaigreur:unar-tichaut estunepersonnegrosseetrondouillarde,unegirafeunefemmetropgrandeetmaigre, uneaspergeestunepersonnegrandeetmaigre,unearaignéedésigneunefemmemaigreetmalbâtie,unhippopotame, un éléphant ouune baleineunepersonneénormeàladémarchemalas-surée,unmoustiqueunepersonnedetrèspetitetaille,un chenillon jeunepersonnedepetitetaille,une sauterelle unepersonnemaigreetsèche,auteintverdâtre.cesexemplesillustrentlefaitcitéplushautd’unepartquel’argotaimeàdégrader,d’autrepartquelesremarquesquenousfaisonssurl’aspectphysiqued’unepersonneimpliqueaussisouventnotreattitu-deenverscettepersonne.ainsi,nousnommeronsmoustique quelqu’unquenoustrouvonsnonseulementpetitdetaille,maisaussiinsignifiant.Laqualificationdebaleineseraappropriéepourunefemmenonseule-mentdetailleénorme,maisquin’apasnotresympathie.
nousreconnaissonslemêmemécanismedanslescassuivants,maisici lesmétaphores se réfèrent à une partie du corps: lesbabines pourunegrosseboucheoudeslèvrescharnues,la tomatepourunnezrouge,l’orangeoula mandarinepourdepetitsseins,le pamplemousseoul’ana-naspourdegrosseins.
Lemondedelasexualitéayantinspiréleshommesdetouttemps,lesanalogiesdanscedomainenemanquentpas.Lesexede la femmeestvucommeunabricot, un bégonia, une chatte, une figue, une moule, un écureuiletune langouste(chezunefemmerousse),une framboise, un hibiscus.celuidel’hommesecompareàune banane(pénisenérection),un bambou(pénislongetgros),un concombre(trèsgrospénis),un fla-geolet(pénislongetfin),un radis(petitpénisàboutrose),un kangourou (unpénisdetaillemoyenne).
uneimageinitialeprovoqueuneexploitationparsériesynonymi-que, ainsi à partir depoire désignant la tête, nous avons une série defruitsetdelégumes:cassis, pêche, fraise, citron, tomate, citrouille, courge,

Drobnjak D., Topoljska A.
298
ciboule, melon, pastèque. nousretrouveronsuneautresérieserappor-tantàlatêtedanslacatégoriereliantl’aspectphysiqueaucaractère.
2) Les traitsdecaractèreou lecomportementcréentdes imagesdansl’esprit
danscettecatégorielestermeszoologiquessontplusnombreuxquelestermesbotaniquesetvisentcertainsdéfautshumainsuniquementparanalogiedetraitsdecaractèreoudecomportementsansaucuneanalo-giedeforme,créantainsidestypes.
ainsilastupiditétrouvesesreprésentantsdans le dindon, le bœuf, la dinde, l’autruche, l’oie, la grue, puisqu’onconsidèrelecomportementdecesanimauxplutôt stupide.sanscauseapparente,nousretrouvonsquel-questermesbotaniquesassociésàcetraitdecaractèrecommela banane, la courge, le gland. sous les termesdebetterave oupoire une certainedosedenaïvetéestliéeàlastupidité.
Lamollessedecaractèresetrouveillustréeparle ver de terre, lache-nilleetlalarve,dontlafaçondesemouvoirnousfaitpenseràunhom-mes’abaissant,rampantdevantunsupérieur,etlechien,lachienne,étantconnucommeunanimalservileetobéissant.
unautretraitdecaractèrenégatif,laméchanceté,setrouvesousdesformesanimalescommele serpent, l’hyène,le chacal, le vautour, animauxdontonn’admirepaslecomportement,avecdesvariantesusantduhé-ronpourunhommeoudelachouettepourunefemme,ayantuncertainâgeetayantdéveloppéd’autresvices(aviditéethargne)quel’onchoisittoujoursenrapportavecl’apparencephysiquedelapersonne.
parailleurs,unhommeorgueilleuxseverraattribuél’épithèted’un coq ouunpaon,s’ilaimesepavanercommelui,oud’unpiafs’ilestaussiquelquepeubizarre.
L’entêtementestreprésentéparlamule(labourrique)réputéepoursa tête dure. L’âne rassemble plusieurs défauts et représente un espritlourdetgrossier,unignorantetunentêté.
le cochon, symbole de la gourmandise, désigne avecmépris unepersonnelibidineuse,jeuneouvieille,quiaimelesexeettoutcequiestsaleourépugnant.Le lapindésigneunhommetoujourschaud,maispastéméraire,le porc unhommesale,débauchéetméprisable,le requinunindividucupide,insensibleàlapitiéetàlareconnaissance,intraitableenaffaires.
Lecrocodiledénoncel’hypocrisie,l’oursetlecrapaudlamisanthro-pie,lafouinelacuriosité,lepapillonetlecaméléonl’inconstance,leche-vallagrossièretéetlabrutalité.
3) L’uniondel’apparencephysiqueetlestraitsdecaractèreoulecomportementcréentdesimagesdansl’esprit

Termes botaniques et zoologiques dans le français argotique
299
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
5-3
02
acôtédes termesdéjà citésdécrivantphysiquement la têted’unepersonne, nous distinguons dans cette catégorie des termes reliant àl’aspectphysiqueuntraitdecaractère.ainsipoire, pomme, patate, chouse réfèrentà la formede la tête,mais sous-entendentaussiuncertain«degré»destupidité,lechou parexemplecorrespondantàunepersonneplutôt écervelée, tout comme le chou-fleur se référant àunepersonnemolleauxoreillesdécollées.
L’avariceestévoquéeàl’aideduratetducrapaud,sansdouteaussiàcausedeleurphysiquepeuattrayant.Lecrapauddanslalangueargo-tiquesignifieaussiquelapersonneestdépourvuedebeautéetrepous-sante,contrairementàlalanguefamilièreoùilestemployé,ainsiqueleratd’ailleurs,commetermed’affection.le bœufdésigneunepersonneinintelligente, corpulente et hors d’état de se reproduire, le buffle unepersonneimpétueuse,violenteetmalélevée,le dinosaure unepersonneâgéeauxidéeslargementdépassées,avecungroscœuretunepetitecer-velle.
La femme a toujours beaucoup inspiré les hommes, qu’ils soientpoètesoucréateursdemots et expressionsargotiques.ainsi lapécoreestune femme sans intelligence etprétentieuse, ledragon une femmeacariâtre et intraitable, auxmanièresbrutales, sansurbanité, laperru-cheet lapieunecoquettebavardeetévaporée, lechameauunefemmeméchante,hargneuseetdésagréable,laguenonunefemmetrèslaideettrèspetite, lapanthèreuneépouseaumauvaiscaractèreet souventenfurie,ungrand cheval une femmegrandeet forteà l’alluremasculine,quiveutabsolumentpasseravanttoutlemonde,lagrenouille, lacrevette oula langouste unefemmeayantperdusesattraits,la chienne unefem-mechaude,la lapine unefemmeparticulièrementféconde,la louve unefemmecarnassière,autoritaireetcruelle,la poule unefemmeauxmœurslégères,quiselaisseentretenirparleplusoffrant.
Leshomosexuelsnonplusnesontpasépargnés.dansl’argotdespé-nitenciersle castor estunhomosexuelpassifousoncontraire,la gerboise unjeunehomosexuelsoumis, la libellule unhomosexuelparticulière-mentefféminé,l’ail unelesbienne.
quantauxparluresargotiquesnousnoteronslesdomaineslesplusproductifsaveclesélémentsdumondevégétalouanimal.dansl’argotdelaprostitutionnousretrouvonslalangouste pourlaprostituée,lalaitue(analogieavecl’expressionfaire des salades)quidésigneunedébutante,lecondor uneprostituéedeluxe,lamorue uneprostituéedebasétage,lehareng commelemaquereau, lemerlan etle poisson leproxénète.Leterme la biche,danscecontexte,n’arienàvoiravec«mabiche»,mais

Drobnjak D., Topoljska A.
300
désignevulgairementuntravestiessentiellementsud-américainquitra-vailledanslesboisetparlelentement.
Lemondedeladrogueprolifèreentermestoujoursnouveaux,maiscertains ont subsisté comme lamule ou la fourmi qui désignent avecméprisunpasseurdedrogue,grandoupetit,tandisque laguêpeet la guenon expriment lebesoindedrogue.nousdevinons icique l’undecessynonymes,probablementguenon,estapparuparpureanalogiedeformeavecletermeguêpe,phénomènetrèsfréquentenargot,commeleciteguirauddansd’autrescasdeformationdel’argotmoderne(oseille > osier, les assises > les assiettes, rade > radis).
Lestermesracistesabondentdanslefrançaisargotique:le pruneau estletermed’insulteetdedénigrements’adressantàunepersonnenoi-raude particulièrement ridée et fripée, la jonquille et le citron termesd’insultevisantunasiatique,le cormoran unisraélite,le melon oule fi-guier unmaghrébin, le homard unanglais(dont lapeauatendanceàrougircommelacarapacedeshomards).
certainesprofessionstrouventleurscorrespondancesdansdester-mesargotiques:le cobra pourunvigiledansunegrandesurface,le pou-let,leroussin, la bourrique pourunpolicier,des bœufs-carottespourdesinspecteursdel’inspectiongénéraledesservices,
le crabepourgardiendeprison,le gorille pourungardeducorps,le pingouinpourunavocatouhuissierenhabit,le corbeau pourunprêtre,l’éléphantpourunpersonnage importantdans lahiérarchie (fonction-naires,partispolitiques).
Lamajoritédesactivitéshumainessebasantsurl’argent,celvi-ciasaplacedanslevocabulaireargotique.Lechoixdecestermesnousparaîtmotivédufaitqu’autrefois lecommerceseréalisaitparunéchangedebiens: blé, avoine, épinards, oseille, radis, galette.
nousn’avonspasétéétonnéesdetrouverdenombreuxtermesdé-crivantlabagarreetsesrésultatscommechâtaigne(coupdepoing),pê-che (coup),avoine(voléedecoups),coquelicot(œiltuméfié).
Lephénomènedepolysémieestfréquentenlanguepopulaireetar-gotiquedufaitdumanquedesupportécrit.nousciteronsquelquester-mespolysémiques:une anguilledésigneunepersonnelongilignequ’onjuge insaisissable et confuse, mais également un pénis passablementlong,une couleuvre,àpartlaparesse,désigneunefemmeenceinte,une grue est à la fois l’insulte, quandmêmeunpeudatée,mais aussi unefemmeécervelée,n’ayantriendanslatêteetparfoiscupide,un ouistiti estenmêmetempslefilsdupatron(le singe),maissertd’insulteoudedénigrementpour toutêtrechétif etdisgracieux,une banane n’estpasseulementlepénisenérection,maisaussiunepersonnestupide,un coco

Termes botaniques et zoologiques dans le français argotique
301
Nasl
e|e 19
• 2011 • 29
5-3
02
estun individupas trèsmalinetunepersonnebizarrequipeutvousplacer en fâcheuse position, un crocodile est un être hypocrite et desvieillespersonnes.
Latroncationestundesprocédéscourantsdansl’argotetpeutassu-rerunrôlecryptologique.dansnotrecorpusiln’yaquedeuxexemples:navet (imbécile)>nave, oignon (anus)>oigne.
Lamajoritédestermescitésplushautparticipentaussiàlaforma-tiond’expressionsvariées.nousenciteronsquelques-unes:faire son bœuf(gagnerdel’argent;faireuneffet,unsuccèsbœuf),avoir la pêche(avoirde la chance, avoir la forme),perdre la ciboule (devenir fou,perdre latête),avoir du chien (avoirducharme),peigner la girafe (êtredésœuvré),avoir de la prune (avoirdelachance),pour des prunes (pourrien).nousentrouvonsd’autresquenousn’avonspasencorerencontréstels:bourré comme un coing(complètementivre),préparerquelque chose aux petits oignons(mijoter),avoir une araignée dans le plafond(êtreunpeufou),y a pas de lézard (iln’yapasdeproblème).danscesexpressionsnousremarquonsquel’emploidecertainstermesplutôtqued’autressembletoutàfaitarbitraire.
en guise de conclusion nous constatons que l’assimilation d’unhommeàuneplanteouàunanimalestpratiquementtoujoursdépré-ciative.cen’est que très rarement que l’on emploiera des termes avecuneconnotationpositivecommelion (hommeénergique,courageux)etgazelle(jeunefemmeélancéeetsipossiblenoire).
d’autre part, cette assimilation dans la dénomination des partiesducorpssefaitautantàl’aidedumondevégétalquedumondeanimal(babines, tomate, orange, mandarine, abricot, chatte, écureuil, kangou-rou).tandisqued’autrescaractérisationsdepersonnessefontplutôtàl’aided’unanimal(cochon, vache, chameau, bécasse, corbeau, singe).celas’étendmêmeà laqualificationdesactionsà l’aidedes termespropresauxanimaux:glander, blairer, lézarder,jacasser, crever, pondre.
cesdétailsnégatifsduphysiqueouducaractèred’unepersonneser-ventaussisouventàinsulter.pourtantcevocabulaireargotiqueestaussiuninstrumentpourdeseffetscomiques,desblaguesinnocentesjusqu’ausarcasmegrossier.
unetrèsgrandevariétédetermesbotaniquescorrespondantausexedel’hommeoudelafemme,témoigned’unegrandecréativitédanscedomaine.Letraithumainleplusreprésentéiciestlastupidité,ainsiqued’autresdéfautsdu caractèrehumain,mais surtout ceuxde la femme.c’est un univers où les réalités les plus richement représentées sontl’amourphysique,l’argent,latromperie,labagarre,lesdifférentesactivi-tésdéviantesdenotresociété.

Drobnjak D., Topoljska A.
302
Lamétaphoreestunmodedespluscourantsdelacréationcrypto-logique, aujourd’hui commehier, l’argotier cachepresque toujours lesmotssousdeschangementsdesens.
Bibliographie
caradec2001:f.caradec,dictionnaire du français argotique et populaire,paris:Larousse.gordienne2002:r.gordienne,Dictionnaire des mots qu’on dit «gros», de l’in-sulte et du dénigrement, courtry:horscommerce.guiraud1958:p.guiraud,l’argot, paris:puf.Larchey1996:L.Larchey,Dictionnaire de l’argot parisien, paris:Leséditionsdeparis-maxchaleil.
Драгана Дробњак, Ана ТопољскаБОТАНИЧКИ И ЗООЛОШКИ ТЕРМИНИ У
ФРАНЦУСКОМ ЖАРГОНУРезиме
Предметовоградачинетерминиизобластиботаникеизоологијекојисеупотребља-вајууфранцускомжаргону.Метафоричнопоистовећивањечовекасапојединомбиљкомилиживотињомпроистичеизсличностиобликаиликарактера,односнопонашања,иунајвећембројуслучајеванегативнојеобојено.
Примљено: 5. 2. 2011.

303
УДКрад
[email protected]@gmail.com
Andrej Fajgelj, Jovana FajgeljFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac /
Faculté des études de droit et d’affaires, université de Novi sad
LES SERBISMES EN FRANçAIS
Les emprunts lexicaux qui seraient issus du serbe sont rares enfrançais, surtout ceux quiméritent une place dans les nomenclaturesde dictionnaires généraux. souvent, le serbe n’est qu’un des candidatspour la langue source.c’est pourquoinous établissonsdes critères desélectionquinouspermettentderepérervingt-huitserbismeséventuels,donttreizeoùleserbel’emportesurd’autrescandidats,dontsixquisontintégrésdans lesdictionnaires:guzla,poljé,purification ethnique, tesla,vampire, zadruga. outre le calque phraséologique purification ethni-que, parmi les exempleson trouveunaller-retour (estavelle),unajoutdesens(autogestion),ouencoreunchangementdesensétonnantdansslave>esclave>ciao.une étudehistoriquedes exemples, centrée sur lespremièresmentions, fait apparaîtreun trait communqui sembleaussid’importancepourlescontactsinterculturelsengénéral.delasensationvampiriqueauxtravauxdeJovancvijić,àquiondoitseptexemplessurvingt-huit,c’estl’exceptionnelquipermetàunepetiteculturedes’impo-seràlagrande.unerecherchefuturedevraitallerau-delàdesdictionnai-respourétudierlesserbismesdirectementdansuncorpusdiversifié.
Mots-clés: emprunt lexical, lexicographie, lexicologie, histoire demots,interculturel,sociolinguistique,langueserbe,languefrançaise
L’épisodebibliquedelatourdebabelillustrelaséparationdeslanguesquiempêcheleurslocuteursrespectifsdecommuniquerlesunsaveclesautres.unepreuvequ’ellesrestentencontactmalgrélesdifférencesestofferteparlesempruntslexicaux.pourtant,cesmotsvoyageursnesontpaséchangésd’égalàégal,maispassentengénérald’unelanguedomi-nante(dupointdevueculturel,économiqueoupolitique)versunelan-guedominée.danslecasdescontactsfranco-serbes,desgallicismessontnombreuxetdéjàétudiés(v.klajn1998,drobnjak2008).danscetra-vail,nousnousintéressonsauxserbismes:cepetitnombred’empruntsquiparviennent,pourainsidire,ànagercontrelecourant.

Fajgelj A., Fajgelj J.
304
quelssontcesmotsexceptionnels?ont-ilsdeshistoires,desusagesoudesmotifsdifférents?
nousavonsrepérélesempruntsduserbeaufrançaisdansle trésor de la langue française informatiséet le grand robert de la langue fran-çaise(désormaisrespectivementtLfi,gr).d’autresdictionnairessontutilisés en vue d’une vérification et d’une comparaison:Larousse dic-tionnaire de français, le Nouveau Littré, legrand dictionnaire termino-logique,srpski elektronski rečnik1,Das große Wörterbuch der deutschen sprache,Wahrig Deutsches Wörterbuch, lo Zingarelli 2008: Vocabolario de la lingua italiana(respectivementLarousse,Littré,gdt,ser,duden,Wahrig,Zingarelli).
danslapremièrepartieduprésentarticlenousprésenteronsleshis-toiresdes serbismes trouvés,notamment les conditionsde leurentréedanslalanguefrançaise.dansladeuxièmepartie,dédiéeàladiscussion,nousnouspencheronssur lesdeuxprincipauxproblèmesméthodolo-giques,correspondantà ladouble identificationdesserbismes en fran-çais:proviennent-ilsvraimentduserbeetappartiennent-ilsvraimentaufrançais?
Vampirechronologiquement,lepremierempruntdontl’origineserbenil’in-
tégrationenfrançaisnesontpaslitigieusesestlevampire.L’internatio-nalismequel’onconnaîtestnéducontact–ouplutôtd’unchoc–inter-culturelentre lespaysansserbeset leurtoutenouvelle2administrationautrichienne.en1725, leproviseurimpérialaétémandéparleshabi-tantsd’unvillagepouruneaffairedeneufmortsmystérieuses.terrifiés,lesvillageoisaffirmaientqu’ils’agissaitenfaitdemeurtres.ilsaccusaientundéfunt,Petar Blagojević,delesavoircommisenrevenantdesatom-be.enserbe,maisd’origineincertaine,lemotpouruntelrevenantétaitvampir(comp.«povampiritise»danskaradžić1818,s.v. vukodlak).Leréticentproviseuradûserésigneràprocéderàl’exhumationpourytrou-ver,àsasurprise,d’apparentesconfirmationsduvampirisme.danssonrapportpubliéle21.7.1725danslejournalofficielWienerisches diarium (58:11-12),ilaffirmequelecadavreavaitlescheveux,labarbeetlesangtousfrais(«gantzfrisch»).aussi,inclut-ilentreparenthèseslapremièrementiondumotvampire:«vampyri».
1 dictionnaireélectroniquequiréunitlesversionspapierderečnik srpskohrvatskoga književnog jezika,novisad:maticasrpska,1967etrečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika,beograd:sanu,1956.
2 nouvelleettemporaire:delapaixdepassarowitz(1718)autraitédebelgrade(1739).

Les serbismes en français
305
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
03-3
14
aprèsque leshabitantsont enfoncéunpieudans le cœurdudé-funtetbrûlésesrestes,cetépisodes’estterminé.enrevanche,unepa-reilleexécutiond’unautrevampireprésumé,arnaut Pavle,n’empêcherapaslesmortsmystérieusesderecommencerquelquesannéesplustard.cettefois,l’engagementdesautoritésautrichiennesseraplusimportant.en1731/2,deuxmédecins,glaseretflückinger,ontétésuccessivementenvoyéspourinspecterl’affaire.Leursrapports3ontànouveauconfirméquelescorpsdesvampiresprétendusétaienteffectivementpréservés.Lesecondrapport,signépartroischirurgiensmilitaires,introduitmêmeuntermepourcetteconditiondescorps:das Vampyrenstand.Lanouvellefitsensationàvienne,etbientôteneuropeentière.Lemotserépandunpeupartout;onleretrouvedanslesystema NaturædeLinné(1758:31),danslebinômeVespertilio vampyrus,unechauve-sourisréputéesucerlesang.d’ailleurs,lesvampiresn’ontpasarrêtédefascinerdepuis.
guzlaLeserbe gusle estunplurale tantum féminindésignantun instru-
mentmusicalàcordes frottées,creusédansuneseulepiècedeboisetdestinéexclusivementàaccompagnerleschantsépiquespopulaires.Laforme italianisanteguzla indiqueque l’originedumot françaisdevraitêtrecherchéedansleViaggio in Dalmazia del’abbéfortis(1774),tra-duitenfrançaisquatreansaprès.L’œuvre,quiconstituerapendantlong-tempsl’unedesprincipalesréférencespourlesslavesdusud,comportelapremièrementiondumotquisoitaccessibleàunpublicoccidentalpluslarge.
a cette époque, la littérature populaire était à l’ordre du jour. Lapartiedeviaggioquiasuscité leplusgrand intérêtétaithasanaginica(l’épousedehasan-aga),uneballadeenregistréesur leterrain.goetheendonneuneexcellentetraductiondéjàen1775,ettroisansplustardherderl’inclutparmisesvolkslieder(chansonspopulaires).madamedestaëlécritàgoethequ’elleest«raviedelafemmemorlaque».entre1822et1827sortentlesrecueilsdeschantspopulairesserbes(vukkaradžić)etgrecs(claudefauriel),tandisqueLönrotcommenceleprojetdecol-lectequideviendraKalevala.c’estàcemomentprivilégiéquemérimée(1827)publiesamystificationla guzla,quicimenteralemotdansl’his-toirelittérairefrançaise.
3 «bericht des contagions-medicus glaser an die Jagodiner kommandatur», in: ham-berger1992:46-49;«berichtdesregimentfeldscherflückingerandiebelgraderoberkom-mandatur»,in:hamberger1992:49-54.

Fajgelj A., Fajgelj J.
306
Zadrugaaveclazadruga–typespécifiquedefamilleétendue–onpassedu
domainelittéraireaujuridique,carlemotattirel’attentiondupublicoc-cidentaldanslepremiercodecivilserbe.sonrédacteur,lejeuneavocatJovanhadžić,l’amodelésurlalégislationautrichienne,lecodenapo-léonetledroitromain.maisilprenaitsoindel’adapterauxusetcou-tumesdupeuple serbe.c’est ainsi qu’un chapitre entier estdédié à lazadruga,institutionencorecourante.Lecodecivilentreenvigueuren1844,etdepuisaugustedozon(1859:221-222),plusieursauteursfran-çaisutilisentlemot.
dans la période suivante, cependant que l’institution originaledisparaissait la sémantique dumot a évolué, incluant différents typesd’associations,dont lescoopératives(ser,s.v.zadruga).après1945,àl’occasiondelaréformeagraire,legouvernementcommunisteacréélacoopérative rurale de travail (seljačka radna zadruga), versionyougos-lavedekolkhoz.cesensparticulierestvenus’ajouteraussiàl’empruntfrançais:«coopérativesocialistedetravailetdeproduction»(tLfi,s.v.zadruga).
PoljéL’œuvrefondatricedelakarstologie,Das Karstphänomen,aétéécrite
parunsavantserbe,Jovancvijić(1893)4.maisunedesraisonaussiim-portantedel’originesud-slavedestermeskarstologiquescommedoline,poljé,houm,ouvala,ponoretbogaz(v.gavrilović1974:11,14-15)estlekarstdinariquequis’étendàtravers lespayssud-slaves.Logiquement,les premiers explorateurs empruntaient souvent lesmots locaux pourdécrirelesphénomènesdécouverts.c’estlecasdepoljé,utiliséen1880parlegéologueautrichienmojsisovicspournommeruntypedereliefkarstiquequ’ilvenaitderemarquerenbosnie-herzégovine(gams1974:55).Lemotsignifie«champ»enserbe,etparsessèmesde«plat»etde«vaste»sertaussiànommerlereliefenquestion(comp.Popovo poljeenherzégovine).consacréparcvijić,letermen’allaitpastarderàsepro-pagerparmilesgéologuesfrançais.
TeslaL’unitéd’inductionmagnétiquedanslesystèmeinternationald’uni-
tés,leteslaestunempruntplusrécent.ilaétéadoptéàlaréuniondelaconférencegénéraledespoidsetmesuresen1960,enl’honneurduphy-
4 Laprésenteconférencealieudanslaruequiportesonnom.

Les serbismes en français
307
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
03-3
14
sicienserbenikolatesla.Lenomdefamilleestissudel’outilhomonyme,tesla «herminette». L’usagemétonymique pourrait désigner la profes-sion,maisselonunetraditionfamilialeenregistréeparlebiographeJohno’neill (2007:12,13), il s’agitd’unsurnomliéà l’apparencephysique.ilarrivaitsouventque lesmembresde la famillehéritentdesdentsdedevantsigrandesetproéminentesqu’ellesrappelaientuneherminette.dansunepartiedesonautobiographiedédiéeàl’enfance,tesla(2006:7)décritlui-mêmecombienilredoutaitlesbisesd’unetantedontlesdeuxdentsdedevant«avançaientcommelesdéfensesd’unéléphant».
LeLittréetlegdtcitentunautreserbismeissud’unnompropre:pupinisation.L’inventeurduprocédé,unautresavantd’origineserbemi-hajlopupin,étaitcontemporainetcollèguedetesla.
Identification ethniqueilyadesempruntsfrançaisquisontdesserbismeséventuels,oùle
serben’estqu’undescandidatsautitredelalanguesource.c’estd’autantplusvraiquesouvent,enplusd’unelanguededépartoriginale,ilexisteuneouplusieurslanguesvecteurs,commec’étaitlecasavecl’italienpourguzla.
pourcesserbismes,lesindicationsétymologiquesdesdictionnaires,siellessontcitées,offrentsouventunedésignationgénérale(parexem-pleslave).maiscommentêtreplusprécis?
nousproposonstroiscritères.biensûr,lepremierestlalanguededépartoriginale.5bienquecesoitlecritèrelepluscertain,ilouvreuneperspectivediachroniquequiposedeuxproblèmes.d’abord,unrisquedeconfusionentrel’empruntetl’héritage.ensuite,lemotydevientunphénomènetrèscontingents’ilestconsidérédanssonintégralitétriadi-quesignifiant–signifié–référent.Ledeuxièmecritèreestplussimple:lalanguedeprovenanceimmédiate.parrapportaupremier,cettelanguese trouveà l’autreboutduparcoursde l’emprunt.Le troisièmecritèreestlalanguede développement.toutelanguequiauraitinfluencésoitlesignifiant,soit lesignifié,soit leréférent,auraitundroit,dirions-nousd’auteur,surcemot.
entrecescritèresilyahuitcombinaisonspossiblespourdéfinirsiune languedonnée est source d’un emprunt. Les réponses clairementnégativeetpositiven’ayantqu’unecombinaisonchacune6,leresteestré-servéauxdifférentesnuances.
5 ouaumoins«lapremièrelanguededépartidentifiable».6 L’identification optimale est réservée au cas où un mot est emprunté immédiatement
delalanguequil’avunaîtreetsedévelopper.cettelanguepourraittoujoursêtreconcurren-cée,maispassurpassée,pard’autreslanguescandidates.

Fajgelj A., Fajgelj J.
308
sil’onconsidèrel’exempledelaterminologiekarstologique,onre-marqued’abordquedansl’usageinternationalc’estleKarstallemandquil’aemportésurlesdésignationslocalesKras(slovène)etCarso(italien),probablement sous l’influence des recherches pionnières de l’école devienne.c’est donc la logiqueméritocratiquedu troisième critère (su-pra),nondanslechoixd’étymologie,maisdutermelui-même.LamêmelogiquesembleavoirpoussélesauteursdutLfi,LarousseetLittré(gremploi lagénéralisation«slave»)detraiterdolinedemotserbo-croate,mêmeplus résolument qu’ils ne le font pourpoljé. en comparant cesdeuxmots,onverraqu’ilsonteffectivementplusieurschosesencom-mun.premièrement,ils’agitdesseulstermesdecedomainequisoientinclus dans les nomenclatures des dictionnaires généraux.deuxième-ment,lesdeuxexistentdanslesdeuxlanguescandidates:slovèneetser-be.finalement,ilssontempruntésdelamêmefaçon:morlot,demêmequemojsisovic,introduitdolined’unelanguelocaleen1840.seulementcettefoislalanguelocaleestleslovène(gams1973:43-44).amoinsquecenesoitparsimplemanqued’informations,c’estl’usagedutermeparcvijić–ultérieurmaisplusinfluent–quifaitopterpourladéfinitionde«serbo-croate».parcontre,c’estlepremiercritèrequil’emportedanslanote«termed’origineturque»quegdtdonnepourbogaz,bienque letermesoitcrééparcvijićàpartird’unturcismeserbehomonyme.
uncasintéressantestoffertparl’article«heiduque»dutLfi,dontl’indicationétymologiqueaffirme:«emprunté(peut-êtreparl’intermé-diairede l’allemandheiduck ‘fantassinhongrois’)duhongroishajdūk,plurieldehajdū‘fantassin’,lui-mêmeempruntéduturchajdud ‘brigand’».d’autreslanguesnesontpasmentionnées,bienquecesbrigand-rebellescontrel’empireturcsoientunphénomèneinternational,oùlapartdulionétaitréservéeauxserbes.pourtant,danslesdéfinitionsetsurtoutlesexemples,c’estjustementlecontexteserbequiestmisenévidence.
demêmequeparmilesheiduques,paraît-ilquelesserbesontdomi-néparmilesesclaves.Lemotavaitd’abordsignifiéslave,maisaumoyenageilaprogressivementprislasignificationactuelledansdenombreu-seslangueseuropéennes:lat.méd.sclavus,gr.byz.σκλάβος,it.schiavo,all. sklave, angl. slave, es. esclavo, port. escravo... et jusqu’au saqalibaarabe.unediffusiond’autantplusfrappantequ’ellesefaitaudétrimentdesmotsexistants,mêmedansleslanguesenracinéesdansunetraditionesclavagiste,commelelatin.L’explication(v.verlinden1942:128)rési-deraitdansl’évolutiondel’esclavage,traduiteparundoubleglissementdesens.Lestermestraditionnelsontcommencéàdésignerunecondi-tionpluslibre(servus>serf)tandisqueslaveaprisleurplace.Lechoixdel’ethnonymeseraitdûàlaprédominancedespeuplesslavesdanslatraite

Les serbismes en français
309
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
03-3
14
aumoyenâge.or,àl’époqueduplusgrandépanouissementduterme(xiiies.)latraiteétaitconcentréeauxbalkansetauxpopulationsortho-doxes(verlinden1942:109,110,127).unehypothèseprudentesuggèreque la synonymie slave-esclave pouvait êtremotivéepar les faux amislatinsservus-serbus(v.Lukaszewicz1998:134,135).
selonlescritèresélaborésci-dessus,leserbeestaussicandidatpourl’originedevoïvode(àcôtédurusseetpolonais),paprika(àcôtéduhon-grois),moussaka, dinar, para etraki(àcôtédeslanguesbalkaniques,del’arabeetdupersan).
Lechoixentreleslanguescandidatesestplusdifficileàfaireàl’inté-rieurdudiasystèmeautrefoisappeléserbo-croate,d’autantplusqu’ils’estrécemmentélargien«bosniaque,croate,monténégrin,serbe».bienquel’individuationdes«langues»particulièressoitunequestionquidépassenotresujet,noussommesobligésd’expliquernotreusagedutermeser-bisme,quel’onveutàlafoisgénéraletspécifique.
dansl’emploigénéral,ildésignelesempruntsoriginairesdudiasys-tèmeentier,dans les cas–et c’est la situation lapluscourante–où ilestconsidérécommeuneseulelangue.Lemotpoljé,enregistréenbos-nie-herzégovinemultiethniqueetparticipantdanslatoponymiedina-rique des quatre nations respectives, constitue un exemple idéal.unedésignationpars pro totoparunedeslanguesnoussemblepréférableàunnéologismeou à une composition encombrante du genre «bosno-croato-montenegrino-serbisme». Le choix du serbe s’explique par desraisonshistoriques,d’abordlepremiertravaildestandardisation,opéréparvukkaradžić et adopté ensuiteparLjudevitgaj et lesvukoviens7commebaseducroate.
dans l’emploi spécifique le serbismesertànommerdesempruntsauserbeproprementdit,paroppositionauxautres langues,etenpre-mierlieuaucroate.celapermetuneprécisioncapablederendrecompted’unepartdesréalitéspolitiques,oùlesnationsrevendiquentleursiden-tités;d’autrepartdesréalitéslinguistiques,oùunempruntpeutêtrespé-cifiqueàunecommunauté.ilseraitprobablementaussidifficiledepar-lerd’unserbismedanslecasd’oustachi,qued’uncroatismedanslecasdetchetnik.mêmes’ilyavaitdescavaliersserbesdanslerégimentcroateauquelondoit lacravate, il serait sansdoutepertinentdequalifier cemotdecroatisme.egalement,s’ilyadesjoueursdeguzlacroates,lemotdevraitêtretraitédeserbisme(cequenefontpaslesdictionnaires8).Lebanexistedans lesdeux langues,avecune importancehistoriqueplus
7 réformateurs de la langue croate adeptes de vuk karadžić. Le représentant le plusimportantétaittomislavmaretić(1854-1938).
8 tLfietLittréproposentuneorigine«serbo-croate»,gretLarousse«croate».

Fajgelj A., Fajgelj J.
310
grandeencroate.ilfautsignalerquelapremièrementionécriteduvam-pirismevientducroate,maislemonstreestnommédifféremment(val-vasor1689:327-341).
passé une limite, les spécificités culturelles doivent quandmêmefairel’objetd’unegénéralisation.onpeutsedemanderparexemplesilesoucideprécisionjustifiedegarder«serbo-croate»,ladésignationoffi-cielledel’époqueyougoslave,pourlesempruntsdecetteépoque,commetitisme.
Types particuliers«d’oùvientcemot?»estdoncunequestionpluscomplexequ’onne
lecroit.nousavonsvucommentunmotturcdevientsymboledecom-batcontrelesturcs,commentlenomdontunpeuplesevante(comp.slava«gloire»)devientl’esclavepourlesautres.maislevoyagedeceder-niernes’arrêtepaslà.Lesalutciao,venudel’italien,estdérivédeschiavo(<sclavus) dans une construction signifiant «votre humble serviteur».dessalutationsdel’europecentralesontforméessurlemêmemodèle,maisàpartirdeservus (all.servus,hongroisszervusz /szia...).puisqueciaoestpasséaussienserbe, ily formeuntypeparticulierd’emprunt,appeléaller-retour.maisquelretour,aprèsplusd’unmillénaire,deuxin-ternationalisationsetdeuxchangementsdesensau-delàdetouterecon-naissance!
unautretermeintroduitparcvijić,estavelle,estungallicisme.Legéologuefrançaisbernardgèzeatracésonoriginejusqu’àlasourceho-monymedans l’hérault.pourtant,cettesourcenecorrespondpasà ladéfinitiondecvijić9.enfait,letermes’avèreêtrelerésultatd’unesuitedemalentendus:«malchoisiparfournet[...],reproduitavecuneerreurgéographiqueparmarteletmalcomprisausenshydrologiqueparcvi-jic»(gèze1987:105;gavrilović1974:14).néanmoins,ils’estétablidanslacommunicationscientifique,ycomprisenfrançais,oùilprésenteunaller-retour.
parmilesserbismesontrouveaussiuncalquephraséologique:pu-rification (épuration / nettoyage) ethnique.c’estunetraductionlittéraledusyntagmeserbeetničko čišćenjeemployéaudébutdesannées’90danslecontextedesguerresenex-yougoslavie.ilfaitsonapparitiondixansplustôtàl’occasiondesviolencessurlesserbesdukosovo,d’abordsouslaformeetnički čistoKosovo («lekosovoethniquementpure»),puisenformes dérivées. son usage international était sporadique jusqu’au 15
9 «[...] des fissures et des avens qui fonctionnent alternativement comme sources oucommegouffres»(gèze1987:105).

Les serbismes en français
311
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
03-3
14
mai1992,dated’uneconférencedepressedemargarettutwiler,porte-paroledudépartementd’étatdesétats-unis,elle-mêmemiseaucou-rant pargeorgekenney (1997). L’effet sensationnel que la nouvelle aprovoquéparsoncaractèrelugubreetinhumainn’estpassansrappelerlasensationvampiriqueduxviiiesiècle.
unautretyped’empruntparticulierparmi lesserbismesest l’ajoutde sens.dans les années 60 lemot françaisautogestion a enrichi sonchampsémantique–etravivésonemploi–paruneréférenceausystèmeautogestionnaireyougoslave.
Intégrationparmitouslesserbismescités,seulvampireestentièrementintégré
danslalanguefrançaise.ilnegardeaucunetracedel’origineserbedanssasémantique10etsamorphologie.ilproduitdesdérivés(gr:vampiris-me,vampirique,vampiriser),etfaitpreuved’unemploicourantdanslalanguecommune.al’autreextrêmeseraientlesmotsproprementétran-gers,nécessitantuneexplication,renduesouventmanifesteparlesglo-ses.11entrelesdeux,ontrouvetouteunegammedemotssuffisamment,maispasentièrementintégrés.ilspeuventavoirdesgraphies(voïvode,heiduque)oudesprononciations (poljé,zadruga) fluctuantes.Leursé-mantiquerenvoieaucontexteoriginal.ilssontliésauxlanguesdespé-cialités,àdesemploisanciens,littéraireset,généralement,pascourants(dont témoignent lesmarquesd’usages et les remarques lexicographi-ques).
une terminologiequine faitpas l’unanimitédistingue lexénisme–motproprementétranger–dupérégrinisme,qui«renvoieencoreàlaréalitéétrangère,maislaconnaissancedesonsensestsupposéeparta-géeparl’interlocuteur»(dubois1999:512).enprincipe,lenombredexénismesestillimité,carilincluttoutusaged’unmotétrangerquelcon-queaugrédesréalisations textuellesoudiscursives.uneétudesur lesempruntsdoit lesexclure,àmoinsdeseposerdesobjectifsutopiquesd’exhaustivité.or,pourdistinguerlesxénismesdespérégrinismesilfau-draitétablirunseuild’intégrationsuffisante–unetâchequin’estfaisablequ’approximativement.
danslaprésenteétude,nousnoussommesfiéssurtoutauxnomen-claturesdesdictionnaires cités.Ladistinctionquinous intéressey estdéjà opérée, le plus souvent selon une fréquenceminimale desmots
10La purification ethnique a largement perdu son lien avec le conflit yougoslave. pour-tant,lescalquesengénéralneconserventqu’unsouvenirdistantdelalangued’origine.
11dans ce travail, c’est le cas de vukovien (v. note 9). Le mot est morphologiquementadapté,maisgardelagraphieétymologiqueavec«u».

Fajgelj A., Fajgelj J.
312
dansuncorpus.pourtant,leseuilétaitbaissépourdesmotsrelevantdelaculturegénérale,decertainessourcesd’autoritéetdesterminologiesjugéesnécessairesaulecteuréduqué.
evidemment,l’intégrationd’unmotdansundictionnairen’égalepasl’intégrationdans la langue. en revanche, elle en est un garant fiable.c’estainsiquelesmotsdoline, poljéet tesla sontinclusàladifférencedesmotsplusraresetspécifiquesbogaz,estavelleetpupinisation.parcontre,onpeutsedemanderpourquoitLfipréfèreoustachiautchetnik?ouencoreest-ilpossiblequecertainsserbismesexclus,commeslivovitzoućevapčići12, soientmieux intégrésque,par exemple,guzla ouzadruga,maisn’ontpasprofitéduseuilbaisséauprèsdeslexicographes.dansunerecherchefuture,ilseraitintéressantdevérifierlesfréquencesdirecte-mentdansuncorpusplusdiversifié(celuidesdictionnairesétantsur-toutlittéraireetdidactique).
a la fin denotre étude, nous pouvons établir une liste de serbis-mes13:
autogestion, ban, bogaz, ćevapčići, ciao, dinar, doline, estavelle,guzla,heiduque,houm,moussaka,ouvala,pandour,paprika,para,po-ljé,ponor,pupinisation,purification ethnique, raki, slivovitz, tchet-niks,tesla,titisme,vampire,voïvode,zadruga.
pour conclure, lespetites languespeuvent «dominer» les grandes.cen’estpaslalogiquededominationquichange,maissadirection,dansdesconditionsexceptionnelles.
généralement,lesserbismesenfrançaisrestentpeunombreux,ra-resdansl’emploietlimitésauxdomainesspécifiques.certainssemblentbanalsetillustrentplutôtl’expansiondufrançaisverslesréalitésétran-gères(titresadministratifs,monnaie,platsetboissons...)quel’expansionduserbeverslefrançais.
enrevanche,uneétudeplusprofondedel’histoiredesmotsfaitap-paraîtreunexceptionneldifférent,oùl’accentn’estplussurleraremaissurleremarquable.cesserbismess’imposentparlevifintérêtqu’ilssus-citent auprès des publics respectifs: géologues pour lepoljé, littérairespourlaguzla,juristespourlazadruga...quantauvampire,sadiffusionetpopularitéconstituentunphénomènequiperdure.Lescontactsquiontrendul’empruntpossiblesonteuxaussiextraordinaires:imaginonslemédecinautrichienentraind’exhumerlespaysansmortsmaispeut-
12inclus dans Wahrig et duden. slivovitz apparait dans le Zingarelli, mais aussi dans leLaroussefrançais.
13Les exemples où selon notre analyse le serbe l’emporte sur d’autres langues candidatessontengras.sontsoulignésceuxquiintègrentlesnomenclaturesd’aumoinsdeuxdiction-nairesgénérauxcités.Lalisteexclutlesvariantes(voïvode/voyévode,purification/nettoyageethnique...)etlesdérivés(vampirisme,banat,autogestionnaire,titiste...).

Les serbismes en français
313
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
03-3
14
êtrevivants.oul’abbéitaliensursonvoyage,oulejeuneavocattrans-posant ledroitcoutumierenarticlesducodecivil,ouencore le jeunedoctorant serbe, auquelondoit septdesvingt-huit serbismes trouvés,surlepointdecréerunesciencenouvelleàvienne.
mêmesiunemarginalisationreste inévitable, tesla etpupinisationprouventquelevocabulairespécialisépeutêtrecelui,prestigieux,delasciencedepointe.Lecontexteinterculturelimposelesproportions,maispasleslimites.
Bibliographie
cvijić1893:J.cvijić,Das Karstphänomen: Versuch einer morphologischen Mo-nographie,wien:e.hölzel.dozon1859:a.dozon,Poésies populaires serbes,paris:e.dentu.drobnjak, 2008:d.drobnjak,Književni termini francuskog i italijanskog po-rekla u srpskom jeziku,thèsededoctorat,novisad:filozofskifakultetunive-rzitetaunovomsadu.dubois1999:J.duboisetalii,dictionnaire de linguistique,paris:Larousse.duden2000:Das große Wörterbuch der deutschen sprache.cd-rom,mann-heim:bibliographischesinstitut/f.a.brockhausag.fortis1774:a.fortis,Viaggio in Dalmazia,1-2,venezia:alvisemilocco.gavrilović 1974: d. gavrilović, srpska kraška terminologija, beograd: savezgeografskihinstitucijaJugoslavije.gams1973:i.gams, slovenska kraška terminologija,Ljubljana:zvezageografs-kihinstitucijJugoslavije.gdt: le grand dictionnaire terminologique, <http://w3.granddictionnaire.com/>,01.09.2010.gèze1987:b.gèze,Lesmésaventuresdessourcesdel’estavelleetdel’inversacenLanguedocméditerranéen, in:International journal of speleology,16(3-4),101-109.gr2005:le grand robert de la langue française.cd-rom,paris:Lerobert/bureauvandijk.hamberger 1992: k.hamberger,Mortuus non mordet: kommentierte Doku-mente zum Vampirismus 1689-1791,wien:turiaundkant.karadžić1818:v.s.karadžić,srpski rječnik,wien:p.p.armeniern.kenney1997:g.kenney,howmediamisinformationledtobosnianinterven-tion,in:living Marxism, april,London,12-13.klajn1998:i.klajn,vrsteromanizamausavremenomsrpskohrvatskomjezikuiputevinjihovogdolaska, in:Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku,41(1),69–89.Larousse:Larousse dictionnaire de français,<http://www.larousse.com/fr/dic-tionnaires/francais-monolingue>,01.09.2010.

Fajgelj A., Fajgelj J.
314
Linné1758:c.v.Liné,Caroli linnæi ... systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, syno-nymis, locis,1/2,holmiae:impensisLaurentiisalvii.Littré2008:le Nouveau Littré.cd-rom,paris:éditionsgarnier.Lukaszewicz1998:a.Lukaszewicz,desclavinisetsclavis...,in:dialogues d’his-toire ancienne,24(1),129-135.mérimée1827:p.mérimée,la guzla, ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l’Herzegowine, paris:f.g.Levrault.o’neill22007:J.o’neill,Prodigal genius: The life of Nikola Tesla,sandiego:thebooktree.ser2005:srpski elektronski rečnik.cd-rom,beograd:srbosof.tesla22006:n.tesla,My Inventions: The autobiography of Nikola Tesla,min-neapolis:filiquarianpublishingLLc.tLfi: le trésor de la Langue Française informatisé, <http://atilf.atilf.fr/>,01.09.2010.valvasor1689:J.w.valvasor,Die ehre des Herzogthums Crain,6,von der is-trianer sprache sitten und gewohnheiten,nürnberg:endter.verlinden1942:c.verlinden,L’originedesclavus=esclave,in:Bulletin du Can-ge: archivium latinitatis medii aevi, 17,97-128.zingarelli2007:lo Zingarelli 2008: Vocabolario de la lingua italiana.cd-rom,bologna:zanichellieditorespa.wahrig2003:Wahrig Deutsches Wörterbuch.cd-rom,gütersloh/münchen:wissenmediaverlag.
Андреј Фајгељ, Јована ФајгељСРБИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ
РезимеУфранцускомјезикупозајмљеницеизсрпкогсуретке,поготовоонекојесууврштене
уноменклатуреопштихречника.Семтога,српскијечестосамоједанодкандидатазаиз-ворнијезик.Изтогразлогасмоуспоставилимерилазаизборпомоћукојихсмоиздвојилидвадесетосаммогућихсрбизама,одтогатринаестсасрпскимкаопретежнимјезикомпо-рекла,одкојихсешестнаводеуречницима:guzla,poljé,purification ethnique,tesla,vampire,zadruga.Семфразеолошкогкалкаpurification ethnique,међупримеримасеналазииједнаповратна позајмљеница(еставела),једнододавањезначења(autogestion),илипакнеобич-назначењскапроменауslave>esclave>ciao.Увидуисторијатпримера,нарочитоњиховихпрвихпомена,откривазаједничкуцртуодзначајазаконтактемеђукултурамауопште.ОдвампирскепаникедорадоваЈованаЦвијића,комедугујемоседамоддвадесетосампри-мера,изузетностјеоноштоомогућавамањојкултуридасенаметневећој.Занекобудућеистраживањеостајезадатакдасесрбизмиистраженаширемкорпусу.
Примљено: 26. 02. 2011.

315
УДКрад
Jasmina Tatar-AnđelićFaculté de philosophie, université du Monténégro
INfINITIfS réGIS PAr LeS VerBeS De PERCEPTIoN: PRoPoSITIoNS SuBoRDoNNÉES ou SyNTAGMeS VerBAux coMPLéMeNTS De VerBe ?
nousnousproposonsd’examiner la questiondu statut syntaxiquedesconstructionsinfinitivesfrançaisesrégiesparlesverbesdepercep-tionquelagrammairetraditionnelleappellepropositionssubordonnéesinfinitives.
nousallonsd’abordtenterdedonnerunedescriptionsyntaxiqueetsémantico-logiquedelacomplexitédesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception, enfournissantuninventairedesstructuressyntaxiquessuivideleurinterprétationsémantique.
dansundeuxième temps,nous fournironsunprécisdeprincipa-les interprétations que les différents cadres théoriques ont accordé ànosconstructionsou,plusprécisement,lestatutactantieletfonctionnelqu’ilsontaccordéauxinfinitifsrégisparlesverbesdeperception.dansla volontédeprésenter cesdifférences théoriquesdemanière concise,nousallonsdiviserlesgrammairiensquiontétudiélaquestionentroisgrandsgroupes,enfonctiondeleurpositionnementparrapportàl’exis-tencedespropositionsinfinitivesenfrançais:
• grammairetraditionnelleounormative• grammairegénérativeettransformationelle• syntaxenontransformationnelleenconclusion,nousfaisonspartdenotreproprepointdevuequi
rejoint celvi des syntactitiens non-transformationnels et qui est basésuruneanalysesyntaxiqueetsémantiquedesconstructions infinitivesrégiespar lesverbesdeperception:apart les constructions infinitivesrégiéspar leverbevoir à la formepronominale, l’étatactuelde la lan-guefrançaisenepermettaitpasd’accorderlestatutdesyntagmeverbalaux construction étudiées, à la différencede la construction infinitiveintroduiteparleverbefactitiffaire.cettepositionesttestéeetconfirméeparlesexemplesdeleurtraductionenserbo-croate(bosnien/croate/monténégrin/serbe).
Mots-clés: infinitif, proposition infinitive, verbes de perception,syntaxe,traduction,serbo-croate,bcms
nousnousproposonsd’examiner laquestiondustatut syntaxiquedesconstructionsinfinitivesfrançaisesrégiesparlesverbesdepercep-

Tatar-Anđelić J.
316
tionquelagrammairetraditionnelleappellepropositionssubordonnéesinfinitives.nousallonsd’abord tenterdedonnerunedescriptionsyn-taxiqueetsémantico-logiquedelacomplexitédesconstructionsinfiniti-vesrégiesparlesverbesdeperception, enfournissantuninventairedesstructuressyntaxiquessuivideleurinterprétationsémantique.dansundeuxièmetemps,nousfournironsunprécisdesprincipalesinterpréta-tionsque lesdifférents cadres théoriquesont accordéànos construc-tions ou, plus précisément, le statut actantiel et fonctionnel qu’ils ontaccordéauxinfinitifsrégisparlesverbesdeperception.enconclusion,nousferonspartdenotreproprepointdevue,basésuruneanalysesyn-taxiqueetsémantiquedesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionetlesverbesfactitifsetdeleurtraductionenserbo-croate(bosnien/croate/monténégrin/serbe).
Inventaire des structures syntaxiquesnousprésenterons quelques exemples-types des constructions in-
finitives introduitespar lesverbesdeperceptiontirésde lapresse,destextesdes grammairiensqui ont étudié la question etdutrésorde lalanguefrançaise(v:http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)pourprocéderensuiteàlaprésentationdeleurinterprétationsémantique.
Lesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception(voir, regarder, entendre, écouter, sentir)serontclasséesenfonctiondunombredescomplémentsnonverbaux.noustenonségalementàrappelerquecepremier classementqui suit est basé exclusivement surdes critèressyntaxiques,lespossibilitésd’interprétationsémantiquedifférenteétantréservéesauparagraphesuivant.
Les structures à un complément:1. depuislecamp,ellesont vu pousserles colonies de peuplement
israéliennes.(Lemondediplomatiqueno576,mars2002,p.4)2. Je la regardais danser,hébétéetdésespéré.
(marsac,p.244)3. Leshabitantsétaientchezeuxoutravaillaientdansleurchamps
chacunvaquantàsesaffaires,quand,soudain,on ententit son-ner la cloche de l’église. (Lemondediplomatiqueno576,mars2002,p.3)
4. Lespromeneursécoutaient les oiseaux crierdanslesbranches.(marsac,p.9)

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
317
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
5. Léninesouffrait-ildesentir «sa» révolution glisser end’autresmains?(danell,p.38)
nous pouvons constater qu’il s’agit, à chaque fois, d’un ensembleconstituédedeuxverbesqu’unapprenantdu françaisdistingueraitdemanièresuivante:unverberégisseurouopérateur(verbedeperception)quinousinformesurlesujet,saplaceousonrôleparrapportaupro-cessus(quiestessentiellementuneperception)etlesrapportsentrelesactants,plusunverbeàl’infinitifquinousfournitl’informationséman-tiquesurlanatureduprocessusperçuparlesujetduverberégisseur.
une analyse syntaxique des exemples cités ci-dessus, sans tenircompteduniveausémantiqueoudelastructureprofonde1,nousamèneà conclure que les constructions infinitives étudiées représentent desstructuresverbalesconstituéesd’uneformeverbalepersonnelleetd’unverbecomplémentàl’infinitif.ellesontdessujetsexprimésetrégissentchacuneuncomplémentessentieldirect.dansnosexemplescescom-plémentssontreprésentésparquatresyntagmesnominaux les colonies de peuplement israéliennes (1), la cloche de l’église (3), les oiseaux (4) et «sa» révolution (5)etparunpronompersonnelobjet,àsavoirla (2). ce-pendant,lepositionnementdecescomplémentsn’estpasidentiquedanstouslesexemples.danslesexemples1,2et3,lastructureverbalecom-poséeressembleauxformesverbalesconstituéesd’unauxiliaireetd’unverberégietlescomplémentsessentielsresemblentàdescomplémentsdespériphrases.dans lesexemples4et5, lescomplémentssontposi-tionnésentrelesconstituantsverbaux,àsavoirleverbedeperceptionetl’infinitif,cequinousamèneàconclurequ’ilssontrégisparlesverbesdeperception.enmêmetemps,lesinfinitifsàleurdroiteprennentpo-sitiond’undeuxièmecompléméntd’objetduverberégisseur.sicesinfi-nitifspouvaientêtreremplacéspardesformesverbalespersonnelles,cescomplémentspourraients’analyserégalementcommeleurssujets.or,ladeuxièmepossibilitéd’analysepurementsyntaxiquedesexemples4et5estdetraiterlesyntagmenominalpositionnéentreleverberégisseuretl’infinitifdel’agentdel’infinitifdeparsapositionpréverbale.Lamêmelogiquepourraitnousameneràconclurequelepronompersonnelcliti-quedel’exemple2peutavoirlamêmefonction,celledel’agentdel’infi-nitifcliticisé,placéavantleverberégisseur.
1 terme de grammaire générative par opposition à «la structure de surface» auquel nousreviendronsplusloindansl’expositiondesdifférentesinterprétationsdel’origineconceptuelledesconstructionsinfinitivesrégiespar lesverbesdeperceptionet lesverbesfactitifs,etdeleurdérivationéventuelle.

Tatar-Anđelić J.
318
Lesstructuresàdeuxcompléments:6. ellesepoudra,écrasasurseslèvresunbâtonderougecomme
elle l’avait vu faire à Denise. (dabit,hôtelnord,1929,p.210danstLf).
7. Jemesouvinsmêmedesparolesque j’avais entendu prononcer à Patienceaussitôtaprèsl’événement.(sanddansgrevisse,p.1277)
8. (…) j’éprouvais une immense douceur à l’écouter frapper les persiennes de la chambre.(marsac,p.237)
9. Il les regarde la regarder.(J.sarmentdansgrevisse,p.1281).
10. Je la sentis serrer mon bras.(arland,dansgrevisse,p.1280)
11. J’ai déjà entendu/vu jouer ce morceau par Paul.(marsac,p.149)
danslesexemplespresentés, lesconstructionsinfinitivesrégissentchacune deux compléments essentiels. dans les exemples 6 et 7, l’unprendlaformeducomplémentdirect(cod)le (6) et les paroles, reprisparlerelatifque (7), etl’autrecelleducomplémentindirect(coi)intro-duitparlaprépositionà–Denise (6)etPatience (7).danslesexemples8et9,nousretrouvons lesconstructionsàdeuxcomplémentsdirects,respectivementle,les persiennes (8)etles, la (9).Lesdeuxconstructionsde l’exemple11 régissentchacuneuncomplémentdirect (ce morceau)etuncomplémentd’agent(ccd’agent)introduitparlaprépositionpar (Paul).
Ladiversitédesrelationsprésentéesentrelesconstituantsverbaux,nominaux et pronominauxdes constructions infinitives régies par lesverbesdeperceptionindiquelacomplexitédel’analysequiapparaîtdéjàauniveausyntaxique.
Interprétation sémantiquesimpleaupremiercoupd’oeil,l’analysesyntaxiquedesconstructions
infinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionestrenduepluscomplexepar l’introductionde ladimension logique,c’estàdirepar la tentatived’interprétationdétailléede leursignification.or, ildevientclairequelessyntagmesnominauxquenousavonstraitésdecomplémentsdirectsdans lesexemples1,2et3,decompléments indirects introduitspar laprépositionà danslesexemples6,et7etdecomplémentsd’agentintro-duitsparlaprépositionpardansl’exemple11,représententlesagents

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
319
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
oulessujetslogiquesdel’infinitif,sachantquelesujetduverberégisseur(verbedeperception)neprennepasdeparticipationactivedanslepro-cessusdésignéparl’infinitif.ilnefaitqu’observer,ressentir,constateretcledéroulementduprocessuscontrôléparsonsujetpropre(appeléaussicontrôleurdel’infinitifparLegoffic1994).danslesexemples4et5,lepositionnementdescomplémentsdirectsentrelesverbesintroducteursetl’infinitifpermetd’identifierplusfacilementleur«doublerôle»:celuiducomplémentque leuraccorde l’analysesyntaxiqueetceluidusujetlogiquedel’infinitifissudel’analyselogico-sémantique.
danslesexemples8,9et10lesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionontchacunedeuxcomplémentsdirects.Leuranalyselogiqueestfacilitéepardeuxfacteursinterdépendants.Lepre-mier, l’impossibilitéd’avoirdeuxcomplémentsessentielsdirects juxta-posés entraîne ledeuxième: ladisposition«physique»despronomsetdessyntagmesnominauxcomplémentsindiquelafonctionlogiquedupremiercomplément«monté».danscesexemples,lepremiercomplé-mentcliticisédevantleverbeopérateurreprésentel’agentdel’infinitif,tandisquelesecond,positionnéàdroitedel’infinitifdans8et10etàgauchedel’infinitifdans9représentesoncomplémentd’objetdirect.
Le fait que le sujet logique de l’infinitif se présente dans les rôlessyntaxiquesdifférents–celuiducomplémentdirectdans1,2et3,celuiducomplémentindirectdans6et7etceluiduccd’agentdans11–nefaitqueprouverlacomplexitédesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception.
ilestànoterque lesexemplescitésdanscechapitre, lesébauchesd’analysesyntaxiqueousémantico-logiqueetlespreuvesdecomplexitésontloind’épuiserlaproblématiqueposéeparlesconstructionsinfini-tivesrégiesparlesverbesdeperception.Leurrôleestd’ouvrirquelquesperspectivessurlaquestionetdejustifierl’intérêtdeleuranalysetemoi-gnépar l’attentionquedenombreux grammairiens y ontportée ainsiqueceluide l’étudedespossibilitésde leur traductionen serbo-croate(bosnien, croate,monténégrin, serbe).anotre avis, ces constructionsreprésentent un champ priviliégié de confrontation des différents ni-veauxd’analysegrammaticale.
Principales interprétations théoriques dans la volonté de présenter un précis concis des différentes
interprétations théoriques des constructions concernées, nous allonsdiviser les grammairiens qui ont étudié la question en trois grandsgroupes, en fonction de leur positionnement par rapport à l’existence

Tatar-Anđelić J.
320
despropositionsinfinitivesenfrançais,àsavoir:–grammairetraditionnelleounormative–grammairegénérativeettransformationelle–syntaxenontransformationnellenousnousproposonsd’exposerbrièvementlesprincipalesinterpré-
tationsquelesdifférentscadresthéoriquesontaccordéesànosconstruc-tions ou, plus précisement, le statut actantiel et fonctionnel qu’ils ontaccordé aux infinitifs régis par les verbes de perception. Le principalobstacleposéparcesconstructionsconsistedans ladifficultépour lesgrammairiens de faire correspondre la relation syntaxique «sujet-ver-be» et la relation sémantique «agent-action».La raisonprincipaledesdifférencesd’interprétationdurôlede l’infinitif consistedans le choixdesgrammairiensdedonnerlaprioritéàunedecesdeuxrelationsparrapportàl’autreouleurexplicationdurapportentrecesdeuxniveauxd’analyselinguistique.
Lagrammairetraditionnelleounormative(v.grevisse1993)aclassélesinfinitifsrégisparlesverbesdeperceptiondanslacatégoriedespro-positionssubordonnéesinfinitives,composantesdesphrasescomplexes,constituéesd’unesubordonnéereprésentéeparl’infinitifetsonsujetin-terprétatifetunepropositionprincipalereprésentéeparleverbeintro-ducteur (verbe de perception). selongrevisse, les infinitifs introduitsparlesverbesdeperceptionetceuxrégisparfaireoulaisserreprésententdeuxdestroiscas«canoniques»desinfinitifsprédicatsdelaproposition(pourletroisièmecas,v.grevisse1993:1277)2.
surlabasedecetteinterprétationdesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionetlesverbesfactitifs(causatifs),laphrase:
12.Jevoismesamissourire.est constituéed’unepropositionprincipalequi est je vois etd’une
propositionsubordonnéeinfinitivemes amis sourire.eneffet, lapositiondelagrammairetraditionnelledufrançaisest
baséesurl’analysedelapropositioninfinitivedelagrammairelatineetsesinfinitifscomplémentsduverbequiontleursujetàl’accusatif.danscecadrethéorique,unepropositioninfinitivedoitavoirunsujetpropreetexprimé,l’infinitifréginepeutpasêtreprépositionneletlaconstruc-tionnedoitpasexprimerlebut.
Lesgrammairesscolairesdufrançaisreprennentcetteinterprétationetconfirmentlestatutdepropositionauxinfinitifscomplémentsdesver-besdeperception.Lesappellationsaccordéesànosconstructionsdiffè-
2 il s’agit du verbe falloir lorsque le sujet propre de l’infinitif prend la forme de coi, telsque:«ilm’afalluvérifiertouslesmots»

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
321
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
rentenfonctiondesauteursetdesterminologiesofficiellesadoptéesparlesautoritésfrançaises,oscillantentre«subordonnéesinfinitives»,«pro-positionssubordonnéesinfinitives»etlaversionréduiteet,semble-t-il,laplusutiliséedansl’enseignementquiestcelledes«infinitives».toutescesétiquettes,provenantdel’analysetraditionnelle,sontsouventconsi-déréescommetroprestrictivespourlalanguefrançaise,etfontl’objetdenombreusesconstestationsthéoriques.
Lesreprésentantsdelagrammairegénérativeettransformationnel-lepartentdelastructureprofondedenosconstructionspourarriveràleursréalisationsdesurface,cellesquenousavonsprécédemmentanaly-sées.cependant,lesrépresentantsdelagrammairetransformationnellenesontpastousd’accordquandils’agitdelastructured’origineoudelaprésentationdenosconstructionsinfinitives.nousyrencontronsànou-veauledébatquiapourobjetl’existanceounond’unepropositionsubor-donnéeinfinitive,maiscedébatalieucettefoisauniveauconceptuel.ilestànoterquelesgrammairiensgénérativistesétaientparticulièrementattiréspaslesconstructionscausativesintroduitesparleverbefaire,dufaitdelasoudureexceptionnelleentreleverbeopérateuretl’infinitifquiseréflètedanslepositionnementdessyntagmesnominauxoupronomsclitiquesautourdecesdeuxéléments(v.kayne1977,bichakjian1979,ruwet1972,danell1979).
Lasyntaxegénérativeettransformationnelleaapportéuneimpor-tantecontributionàl’éclaircissementetàladéfinitiondesdifférentsas-pectsd’analysedesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeper-ceptionetlesverbesfactitifsfaireetlaisser.Lestransformationsdécritesontpermisauxenseignantsetauxapprenantsdufrançaislangueétran-gèred’appréhenderladifférenceentrelesniveauxsyntaxiqueetlogiqueenlessituantrespectivementdanslesstructuresdesurfaceetdebase.celaestparticulièrementimportantpourlesapprenantsbosniens,croa-tes,monténégrinsetserbesquin’ontpasdeconstructionséquivalentesdansleurlanguematernelle.
Lapositionprépondérantedelasyntaxecontemporainenontrans-formationnellesurlesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionpourraitêtrerésuméecommelaconstestationdalapositiontraditionnellequiyvoitlespropositionssubordonnéesinfinitivesainsique de la position de la grammaire transformationnelle et générativepourlaquellelesinfinitifsanalysésreprésententdesenchâssementsissusde lapropositionsubordonnéecomplétive.Lesgrammairienscontem-porainsn’adhèrantpasà lagrammairegénérativeyvoient lescomplé-ments du verbe introducteur (verbe de perception) que ce soient des

Tatar-Anđelić J.
322
complémentsessentiels,descomplémentsd’objetdoublesoupartiesdescomplémentsd’objetdirectuniques.
parmilesauteurscontemporainsquiontanalysélesconstructionsinfinitivesintroduitesparlesverbesdeperception,c’estflorencemer-cierLecaquimaintient le termede laproposition infinitive enpréci-santquel’infinitifyreprésente«unmoyendesubordination»(v.mercierLeca2005:157).danscecadre, la fonctionsyntaxiquedepropositionsubordonnéeinfinitivedanslecadredelaphrasecomplexeestcelleducomplémentd’objetdirect.cependant,lamêmeauteuretraiteenmêmetempscertainesdenosconstructionsinfinitivesde«périphrasesdevoix»avecunsensdenon-ingérenceoudenon-interventiontoutenprécisantqueladistinctionentrel’infinitifcentredepériphraseetdeceluienpro-positioninfinitiveconsisteencequelepremierconnaîtunchangementdesens3.
danssonanalysedesinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionsylviannerémi-giraud rejoint les auteursqui accordent auxproposi-tions infinitives la fonction des compléments d’objet directs du verbeopérateur,toutensoulignantladifférenceentreleniveaulogiqueetleniveaumorphosyntaxique d’analyse. elle explique cette différence parla nature verbo-nominale de l’infinitif de «la proposition infinitive»danslecadredelaquelleilconstitueunepropositionlogiqueavecsoncontrôleur.commelafonctiondusujetsyntaxiquedelaphraseestdéjàcouverteparlesujetduverbeopérateur,lesujetpropredel’infinitifsetrouvecontraintàenprendreuneautre.
dansleuranalysedes«cas»dessujetsinterprétatifsdesinfinitifsré-gisparlesverbesvoiretfaire,brousseauetrobergeconcluentquecessubstantifssont«descasrégimes»,etleprouventparlacliticisation(v.brousseauetroberge2000:chapitreiii).aveccetteanalysecontempo-rainequirappelleainsil’originelatinedenosconstructionsdanslestours«accusativus cum infinitivo», ces auteurs rejoignent les grammairiensquis’opposentauconceptdelapropositionssubordonnéeinfinitive.
en conformité avec son approche purement syntaxique, Le gofficrejette l’appellation «proposition subordonnée infinitive» et analyse lesconstructions infinitives régiespar les verbesdeperception commedescomplémentsdeverbeessentiels.pourcetauteur,lesinfinitifscomplémentsdeverbeperceptifoufactitifsontdes«prédicatsdel’objet»parparallèlismeaveclesstructurestraditionnellementappelées«attributsdel’objet»(v.Legoffic1993:177et277).
3 a ce titre, mercier Leca oppose Les meubles voient leur vernis s’écailler à pierre voitsophiepasser.

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
323
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
danssonétudesur lesconstructions infinitivesrégiespar lesver-besdepeception,fabricemarsacrejettelespropositionssubordonnéesinfinitivestraditionnellesetdéfendsonhypothèsequel’infinitifdecesconstructions, en dépit de son indépendance morphosyntaxique parrapportàsonsujetlogique,nedoitpasêtreanalysécommeledeuxiè-mecomplément(ouactantcomplétif)duverberégisseuroucommeleprédicatducomplémentd’objetdirectmentionnéeparLegoffic,maiscommeunepartieintégrantedel’uniqueobjetsyntaxiqueduverbedeperceptionmonocomplétifdirect.nouspartageonsentièrementsades-criptiondes infinitifs régispar les verbesdeperception:pourfabricemarsac,cesinfinitifssont«syntaxiquementunestructureproposition-nelleembryonnaire,àmi-cheminentrelesyntagmeverbaletlaproposi-tionfinie»(v.marsac2006:271).
a ladifférencedesgrammairiens traditionnelsquipriviliégient leniveau logiqueetdes transformationalistesqui se serventdes tranfor-mationspourmettreenrelationlesdeuxniveauxd’analysedesconstruc-tionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception,nousrejoignonslapositiondessyntactiensnontransformationnelsquidonnentlaprioritéàlarelationsyntaxiquesujet-verbeparrapportàlarelationsémantiqueagent-action.d’autrepartnousconsidéronsque l’étatactuelde la lan-gue françaisenepermetpasd’accorder le statutde syntagmeverbal àcesconstructions,àl’imagedelaconstructioninfinitiveintroduiteparleverbefactitiffaire.Lesseulscasoùnoustrouvonscestatutconfirmésontlesconstructionsquitémoignentd’unepertedevaleursémantiqueduverbedeperceptiontelsquelesconstructionsàverbevoirpronomi-nalisé.
ilestimportantdesoulignerquecesconstructionsinfinitivesàver-berégisseurpronominalisésontsouventinterprétées,deparleurvaleursémantique,commedesformesdediathèsepassive.ainsiLegofficsou-ligne-t-illerôleinvolontairedusujetduverbeintroducteuretindiquequecestours«concurrencentlepassif»(v.Legoffic1993:318).riegel,pellat et rioul classent les constructions infinitives introduites par se faire, se laisser, se voir, s’entendredanslesformesnonmorphologiquesdupassif(v.riegel,pellat,rioul1994:442).
13.paulsevoitrécompenserdesesefforts.(Legoffic,318).
pour lemoment, ces emplois similaires à la structureauxiliaire + verbe restent restreints par rapport aux emplois «classiques» souventinterprétés commedesphrasesà«proposition infinitive».nous tente-ronsdel’illustrerpardesexemplesdesconstructionsinfinitivesétudiées

Tatar-Anđelić J.
324
etleurstraductionsenserbo-croate(bcms)quiréflètentlanaturedesrapportssyntaxiquesetsémantiquesdanslesdeuxlangues.
Traduction en serbo-croate (BCMs)danslatraductiondesconstructionsinfinitivesintroduitesparles
verbesdeperception,lesverbesrégisseursdecesconstructionsgardentleurcontenusémantiqueprincipal.apartlescasoùcecontenuesttrèsfaible,voireinexistant,etoùilss’approchentdesvaleursd’auxiliaires,cesverbesrégisseurssontfacilementtraduisiblesenserbo-croate(bcms).deplus,lalangueserbo-croate(bcms),quiexprimel’aspectdemanièrelexicale,disposed’unerichessedeformesverbalesaspectuellescapablesde remplacer chacun des verbes régisseurs analysés. nous en donne-rons quelques exemplesnon exhaustifs, sachant que la problématiquede l’expressionde l’aspectdanscesdeux langues représenteunchampderechercheétenduquinefaitpasl’objetprincipaldenotreétude.ainsileverbevoir correspond-ilauverbevidjeti,maisilpeutégalementêtretraduitpargledati ou ugledati.Leverberegarder correspondàgledati,maisilpeutégalementêtretraduitparpogledati ou posmatrati, leverbeentendre correspondàčuti,mais ilpeutdevenirzačuti, načuti, etc.Leverbeécoutersetraduitprioritairementparslušati,maisildevientégale-mentposlušati, osluškivati etc.Leverbesentir désignantlaperceptionausensgénéralestleplussouventreprisparleverbeperfectifosjetitiousondoubleimperfectifosjećati.
mêmesilaproblèmatiqueprincipaledelatraductiondesconstruc-tions infinitives régies par les verbes de perception en serbo-croate(bcms)nesesituepasauniveaudesverbesrégisseursquitrouventfa-cilementleurséquivalentsserbo-croates(bcms),ilestànoterquelesconstructions infinitives régies par les verbes de perception sont trèssouventtraduitesparunverbesimplequinecomprendaucunevaleurperceptive.
Le traducteurqui souhaite transposer les constructions infinitivesfrançaisesrégiesparlesverbesdeperceptiondanslalangueserbo-croate(bcms) est principalement confronté à la problèmatique de complé-mentationdecesverbesenserbo-croate(bcms)quidiffèredelapra-tiquelinguistiquefrançaise.cetteprobèmatiqueestdueàladisparitiondel’infinitifcomplémentdesverbesdeperception,remplacémajoritai-rementparune formeverbalepersonnelle introduitepar les conjonc-tionskako, da, gdje.Lasyntaxeduserbo-croate,etplusrécemment,celledeslanguesbcms,neconnaîtpointlacatégoriesyntaxiquedespropo-sitionsinfinitivesquireprésente,commenousl’avonsdémontré,unvé-ritablechampdebattailledesgrammairiensfrançaisenfonctiondeleur

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
325
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
appartenancethéorique.enserbo-croate(bcms),lacomplémentationdesverbesdeperceptionne faitpas l’objetdecedébatpour la simpleraisonquecesverbesnesontpas,ouplutôt,nesontplussuivisdel’in-finitif.
Lesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperceptionpeu-ventêtretraduitesenserbo-croate(bcms)dedeuxmanièresprincipa-les:
– traductionpériphrastique– traductionparunverbesimplece sont en effet les traductions périphrastiques qui permettent
degarder etde transmettre entièrement l’idéepremièredes construc-tionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeperception.Lagrandemajoritédesexemplespériphrastiquessontconstituésdesverbesdeperceptionéquivalents suivis des verbes au présent de l’indicatif, introduits parles conjonctionskako etda. il s’agit làdes exemplesde traduction lesplus attendus et lesplus logiques,qui correspondentdeplusprès auxconstructionsoriginales.
14. Lieutenant parachutiste, david zonshein avait vu ses ca-marades s’emparer par la force de maisons et les détruire.(mdiii,4)
padobranski poručnik david zonšejn je video kako njegovi drugovi silom zauzimaju kuće i razaraju ih. (mdshiii,4)
15. Lagrandemassedes jeunesregarde défiler le cortège: ilsneveulent pa apparaître du côté des donneurs de leçondemo-rale...(mdi,18)
masamladihgleda u povorku kako prolazi:neželedastanunastranuonihkojidajulekcijeizmorala...(mdshi,16)
16. onlevoyait plastronnerdansunechambrepleinedeveloursetd’or.(mdii,24)
Videlo se kako leži u sobi punoj somota i zlata.(mdshii,20)
Lestraductionsparlesconstructionsinfinitivesfrançaisesdesexem-plesdesverbesdeperceptionserbo-croates(bcms)suivisduprésentdel'indicatifintroduitaveclaconjonctionkako sontnombreuseset,sem-ble-t-il,logiques.nousenciteronsdeuxquicontiennentuneaccumula-tiondesinfinitifs.
17. Slušam ihkako se vrte umalomprostoru kuhinje,otvarajuhladnjak, lupkaju zdjelicama, lončićima, tavicama, puštaju

Tatar-Anđelić J.
326
vodu iz slavine,pretaču voduuzdjelice iposudice,zveckaju priboromzajelo.(mbp,160)
Je lesentends aller et venirdans l’espaceexigude lacuisine,ouvrir le réfrigérateur, entrechoquer vaisselle, casseroles etpoêles, faire couler l’eau, la transvaser d’un récipient dansl’autre,faire cliqueterlescouverts.(mrsc,184)
18. voljelasampromatrati kako trzajemglavetjera muhe,kakoumornimočima lovi danjusvjetlost,navlačiprozirnučarapuna ruku,pogledom slijedi izdajničkeprugice, skida čarapu srukekaoskupocjenurukavicu,navlači čarapunadrvenu«glji-vu»,namještaprugicunasredinuisvjetlucavomkukicomsku-plja,jednupojednu,zalutaleočice.(mbp,101)
J’aimaislaregarder chasser unemouched’unmouvementdelatête,essayer decapter lesderniersrayonsde la lumièredujourenplissantsesyeuxfatigués,tendrelebastransparentsursamain pour y trouver l’échelle traître, puis l’enlever tel ungantprécieux,l’enfilersurun«champignon»enbois,l’échelletournéeverselle,etrattraperlesmaillesavecsonpetitcrochetlumineux.(mrsc,117)
suivent les exemples de traduction du français en bcms avec laconjonctionda:
19. ainsi,mmemiwatakeuchi,52ans,employéeàtempspartieldansuneuniversitéetmèrecélibatairevoit sa vie se rétrécircommeunepeaudechagrin.(mdiii,9)
takogđamivatakeuši,52godine,zaposlenasaskraćenimrad-nimvremenomnajednomuniverzitetuineudatamajka, vidi da se njen život neprestano sužava. (mdshiii,15)
20. sous-officierparachutisteshokisadéavait entendudessoldatsdesonbataillonraconteravecindifférencecommentilsavaienttuéungosseàkhanyounès.(mdiii,4)
padobranski potporučnim Šoki sade je čuo vojnike iz svogbataljona da ravnodušno pričaju kako su ubili jedno dete ukanJuni.(mdshiii,4)
voiciunexempledetraductionensensinverse,celuidelaconstruc-tionbcmsaveclaconjonctionda quiaététraduiteparlaconstructioninfinitivefrançaise:
21. otacpijanac,majkasavječnomglavoboljom,nikad je nijesam vidjela da se smije.(mbp,62)
Leurpèreétaitunivrogneetleurmèresouffraitconstammentdemigraine,je ne l’ai jamaisvue rire.(mrsc,72)

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
327
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
apart les traductionspériphrastiques «classiques» àdeux consti-tuantsverbauxduserbo-croate(bcms)quireprennentlesconstituantsverbauxfrançais,nousavonstrouvédenombreuxexemplesdetraduc-tionspériphrastiquesconstituéesduverbedeperceptioncorrespondantauverbefrançaisetd’unsubstantif,souventd’origineverbale,choisipourtraduireleprocèsdésignéparl’infinitif.cechoixcorrespondtrèsbienàlanatureverbo-nominaledel’infinitif,surtoutparcequelessubstantifsd’origineverbaledenosexemples sont suivisdesautres substantifsaugénitif,désignantlesujetlogiquedesinfinitifsfrançais:
22. Leshabitantsétaientchezeuxoutravaillaientdansleurchampschacunvaquantàsesaffaires,quand,soudain,on entendit son-ner la cloche de l’église. (mdiii,3)
stanovnici subili kodkuća, ili su radili napoljima; svako sebavio svojimposlom. iznenada suzačuli zvonjavu crkvenog zvona.(mdshiii,3)
23. depuis le camp, elles ont vu pousser les coloniesdepeuple-mentisraéliennes.(mdiii,4)
izlogorasu gledale stvaranje izraelskihkolonija.(mdshiii,4)
nousavonsdéjàindiqué,danslapartieintroductiveduprésentcha-pitre,qu’endépitdel’existancedesverbesdeperceptionéquivalentsauxverbesfrançais,lesconstructionsinfinitivesrégiesparlesverbesdeper-ceptionétaientsouventtraduitesenserbo-croate(bcms)parunverbesimple.voiciplusieursexemplesreprésentantcettemodalitédetraduc-tion:
24. enmargedel’utopiedelarépubliquedeslettresetdessavants,l’entre-deux-guerres voit s’installer une autre représentationdelaculture.(mdii,4)
namarginamautopijskezamisliodržaviknjiževnostiinauke,uperioduizmeđudvaratazavladaće jednadrugapredstavaokulturi.(mdshii,4)
25. Legroupepropriétairedecanal+acceptedevoir son capital passeràhauteurde54%danslesmainsd’actionnairesétrangers,notammentdesfondsdepensionanglosaxons.(mdi,25)
vlasničkagrupacijakanalapluspristalajeda54odstonjenogkapitalapređe urukeinostranihdeoničara,presvegauanglo-saksonskepenzionefondove.(mdshi,20)
26. il inaugure un cycle, des négociations dugatt en 1986 auprojetd’accordmultilatéralsurl’investissement(ami)en1998,

Tatar-Anđelić J.
328
quiverra croîtrelespressionspourlalibéralisationdu«marchédelaculture».(mdii,5)
timejenajaviociklus,odpregovoragatt-aiz1986.donacrtamultilateralnog sporazumaoulaganjima iz 1998. u kojem ćerasti pritiscizaliberalizaciju«kulturnogtržišta».(mdshii,5)
27. payésendollars,(…)lespêcheursrussesdekourilesont vu ces dernières années leurs revenus augmenter confortablement.(mdii,11)
plaćeni u dolarima ( …) ruski ribari sa kurila su proteklihgodinaznačajno uvećalisvojeprihode.(mdshii,10)
dans lesexemplesprécédents, lesconstruction infinitives françai-sesontététraduitesparlesverbeszavladati (régner), preći (passer), rasti (croître)etuvećati (augmenter).
Le choix du traducteur de se servir d’un verbe simple plutôt qued’unepériphraseavec leverbedeperceptionéquivalent impliquecer-taines restrictions sémantiques, que ce soit au détriment de la valeurperceptiveoudelavaleursémantiquedel’infinitif.Laréussitedelatra-ductiondépendeffectivementdelacapacitédutraducteuràreconnaîtrel’importancedecesdeuxvaleursdansletextefrançaisoùellepeutéga-lementvarier.
nousavonsdéjàmentionnédesemploispronominauxduverbevoirquiluifontperdresavaleurperceptive.ildevientalorsunauxiliairedediathèse.ilestnormalquelestraductionsdesexemplescontentantcesconstructionssoientprivésdelavaleurperceptive:
28. maisonparticiperaitdavantageàl’euphoriegénéralesi,lorsdeleursortieensalles,touslesfilmsse voyaient offrir lamêmechance.(mdi,25)
međutim, još više bismo učestvovali u opštoj euforiji ako bisvitifilmovi,kdstignuubioskope,dobili podjednakušansu;(mdshi,20)
29. aumêmemoment,l’historiennemariaschmidtconnuepouravoir «relativisé» l’holocauste, s’est vue doter d’un institutd’histoireetd’unposteduconseillèredupremierministre.
(mdi,7) istovremenojeistoričarkamarijaŠmit,čuevenaposvom«rela-
tivizovanju» holokausta, dobila ne samo sredstva da osnujenovistorijskiinstitut,negoimesosavetnicepredsednikavlade.(mdshi,7)

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
329
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
30. abordantlaquestiondefrontlorsd’unevisitedecedernieràtokyoenseptembre2000,m.yoshimomoris’était déjà vuop-poserunecourtoisemaistrèsnettefindenon-recevoir.
(mdii,11) postavljajućidirektnopitanjetokomposeteovogpotonjegtok-
ijuuseptembru2000,japanskipremijerg.Jošimomorijevećdobiokurtoaznu,alovrlojasnunameruneprihvatanja.
(mdshii,11)nousavons trouvéunexemple intéressantdumêmeverbesimple
utilisé pour la traduction dans l’autre sens, du serbo-croate (bcms)en français. Le verbe dobiti (recevoir) a été traduit en français par leconstructioninfinitiverégieparleverbevoir pronominalisé:
31. neštokasnijepojavilesusegumezažvakanjesasličicamafilm-skihglumaca.Jednomsam(odjednestarijedjevojčice,kojajeodlučiladaodraste)dobilaunasljedstvopravoblago:albumsasličicamaglumacaizgumazažvakanje.
(mbp,112) unpeuplustardsontapparuslespaquetsdechewing-gumavec
desphotosd’acteursàl’intérieur.unjour,je me suis vue offrir,(parunefilletteunpeuplusâgéequemoiquiavaitdécidédegrandir)unvéritabletrésor:unalbumavectouteunecollectiondecesimages.
(mrsc,132)enconclusion,nouspovonsaffirmerquececourtprécisdestraduc-
tionsenserbo-croate(bcms)apermisdetesteretdeconfirmernotrepositionsur lestatutsyntaxiquedes infinitifs introduitspar lesverbesdeperception:nousavonsprécédemmentrejointlapositiondessyntac-tiensnontransformationnelsaccordantlaprioritéàlarelationsyntaxi-quesujet-verbeparrapportàlarelationsémantiqueagent-action.nousavonségalementajoutéque l’état actuelde la langue françaiseneper-mettaitpasd’accorderlestatutdesyntagmeverbalàcesconstructions,àl’imagedelaconstructioninfinitiveintroduiteparleverbefactitiffaire.Lestraductionsenserbo-croate(bcms)l’ontconfirmé,danslesensoùellesgardentmajoritairementlastructurepériphrastiquedel’originalettrouvent des équivalents à ses deux constituants verbaux. Les traduc-tionsdes contructionsétudiéespar lesverbes simples en serbo-croate(bcms)sontmoinsfréquentesettémoignentdespertesparrapportautextedel’original.
Lesseulscasoùnousavonstrouvélestatutdessyntagmesverbauxconfirmé concernent les constructions qui témoignent d’une perte de

Tatar-Anđelić J.
330
valeursémantiqueduverbedeperceptiondéjàenfrançaistelsquelesconstructions à verbe voir pronominalisé. cette perte dans la languesourceestégalementconfirméeparlestraductionsdecesconstructionsenserbo-croate(bcms)pardesverbessimples.
Abréviations:
(mdi)–le Monde diplomatique, no568,juillet2001(mdshi)–le Monde Diplomatique, br005,jul2001(prevod–«politika»)(mdii)–le Monde diplomatique, no570,septembre2001(mdshii)–Le monde diplomatique,br007septembar2001(prevod–«po-litika»)(mdiii)–le Monde diplomatique, no576,mars2002(mdshiii)–Le monde diplomatique,br013,mart2002(prevod–«politika»)(mbp)–ugreŠićdubravka(2008),Muzej bezuvjetne predaje,fabrikakniga,beogradet(mrsc)–ugreŠićdubravka(2004),Le musée des redditions sans con-dition, traduction intégrale parmireillerobin, Librairiearthèmefa-yard
Bibliographie
biachakjian1979:b.biachakjian,Laconstructionfactitiveenfrançais:enchâs-sementouengendrement?», in:xiv Congresso internationale di linguistica e filologia romana,Napoli, 15-20 aprile 1974. atti.napoli:macchiaroli–amster-dam:benjamins,547-563.brousseau,roberge2000:a-m.brousseau,y.roberge,syntaxe et sémantique du français,montréal:fides,coll.champslinguistiques.danell 1979:k. J.danell,Remarques sur la construction dite causative Faire (laisser,voir, entendre, sentir) + infinitif,stockholm:almquist&wiksellinter-national.gardes-tamine2006:J.gardes-tamine,la grammaire – 2. syntaxe,paris:ar-mancolin.grevisse1993:m.grevisse,le bon usage,paris:deboeck/duclot.kayne1977:r.kayne,syntaxe du français – le cycle transformationnel,paris:seuil.Legoffic1994:p.Legoffic,grammaire de la phrase française,paris:hachette.marsac2006:f.marsac,Lesconstructions infinitives régiesparunverbedeperception,thèsepourledoctorat,umb,strasbourg.

Infinitifs régis par les verbes de perception: propositions subordonnées ou syntagmes verbaux compléments de verbe
331
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
15-3
31
mercier-Leca2005:f.mercier-Leca, 30 questions de grammaire française,paris:armandcolin.rémi-giraud 1988: s. rémi-giraud, l’Infinitif – une approche comparative,Lyon:pressesuniversitairesdeLyon.riegelet al.1994:m.riegelet al., grammaire méthodique du français,paris:puf.ruwet1972:n.ruwet,Théorie syntaxique et syntaxe du français,paris:seuiltesnière1959:L.tesnière,eléments de syntaxe structurale, paris:Librairiec.klincksieck
Јасмина Татар-АнђелићИНФИНИТИВНЕ ДОПУНЕ ГЛАГОЛИМА ПЕРЦЕПЦИЈЕ:
ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ИЛИ ГЛАГОЛСКЕ СИНТАГМЕ У ФУНКЦИЈИ ОБЈЕКТА ?
РезимеОвајрадимациљдапреиспитасинтаксничкистатусфранцускихинфинитивнихкон-
струкцијауведенихглаголимаперцепције,којетрадиционалнаграматиканазиваинфи-нитивнимреченицама.
Уњемуседајесинтаксичкиисемантичкиприказсложеностидатихинфинитивнихконструкцијакрознизпримјерасинтаксичкихструктураињиховогсемантичкогтума-чења.
Радтакођеразматранајзначајнијатеоријскатумачењапроучаванихконструкцијаили,прецизније,приказујетумачењафункционалнеулогеинфинитивакаодопунеглаголимаперцепције.Ужељидаштоконцизнијепредставимотеоријскеразликеподијелилисмограматичарекојисусебавилиовимпитањемускладусањиховимставомопостојањуинфинитивнихреченицауфранцускомјезику,наприпаднике:
• традиционалнеилинормативнеграматике• генеративнеилитранформационеграматике• нетрансформационесинтаксе.Нашличниставпоовомпитањусепридружујенетрансформационимсинтаксичари-
маизаснивасенасинтаксичкојисемантичкојанализиинфинитивнихконструкцијакаодопуниглаголимаперцепције:саизузеткоминфинитивнихдопунапрономинализованомглаголуvoir,тренутностањефранцускогјезиканедозвољавадасепроучаванеконструк-ције сматрају глаголским синтагмама, по угледу нањима сличне инфинитивне допунефактивномглаголуfaire.Овајставјеурадутестиранипотврђенпримјеримапревођењапроучаванихконструкцијанасрпскохрватски(босански/црногорски/хрватски/српски).
Примљено: 27. 1. 2011.


333
УДКрад
Altijana BrkanFaculté de philosophie, université de sarajevo
Paris 3 sorbonne-Nouvelle, lPP, université de Paris
ÉTuDE AÉRoDYNAMIquE DE LA NASALISATIoN CoNTEXTuELLE EN FRANçAIS ET EN BoSNIEN
notreétudeaconsistéenuneétudeaérodynamiquecomparativedelanasalitécontextuelle(propagationde lanasalitéanticipatoireetper-sévératrice)enfrançaisstandardetenbosnien.nousavonsvouluvoircommentsepropagelanasalitédanslesdeuxlangues.Lebutdel’étudeaaussiétédevoirs’ilexisteuneinfluenceéventuelledelalanguemater-nellesurlalangueétrangèreentermedenasalitécontextuelle.Lesdon-néesaérodynamiquesontétéprisesàl’aidedel’appareileva2(testonetal,1999),danslachambresourdedel’institutdeLinguistiqueetphoné-tiquegénéralesetappliquées(iLpga)àparis.ils’agitd’uninstrumentnon invasifpourmesurer ledébitd’airnasalet ledébitd’airoral.nosrésultatsontmontréqu’ilexisteunenasalitécontextuelledutypeanti-cipatoireetpersévératricedanslesdeuxlangues.nousavonsvuqu’ilyaplusderetard(doncmoinsdepropagationdufluxnasalanticipatoire)enfrançaisqu’enbosnien.quantàlapersévérationdufluxnasal,statis-tiquement,iln’ypasdedifférenceentrelesdeuxlangues.généralement,encequiconcernelesproductionsdelocuteursbosniensprononçantlesmotsfrançais,nousavonsobservéuneinfluencedelalanguematernellesurlalangueétrangère.
Mots-clés: aérodynamique,nasalité,débitd’airoral,débitd’airna-sal
Introduction 97%des317languesdelabasededonnéesupsidutilisentlanasalitécommeuntraitdistinctifpourcréeruncontrasteentreconsonnesoralesetconsonnesnasales.seulement1/5utilisentlanasalitépourdistinguerles voyelles oralesdes voyellesnasales (maddieson, 1984).Le françaisestunedeslanguesquipossèdentdanssoninventairephonologiquedesconsonnesnasalesetdesvoyellesnasales.Lebosnienn’apasdevoyel-lesnasalesphonologiques.c’estpourquoiilnousaparuintéressantdecomparerledegrédepropagationcontextuelledufluxnasal(progressiveetrégressive)danslesdeuxlangues.Lebutdenotreétudeaétédefaire

Brkan A.
334
uneétudeaérodynamiquedudegrédepropagationdufluxnasalcontex-tuelleenfrançaisetenbosnienetdecomparertroisproductions:3locu-tricesfrançaisesnativesrépétantdeuxfois56motsfrançais,3locutricesbosniennesrépétantdeuxfois56motsbosniensetlesmêmeslocutricesbosniennesrépétantdeuxfois56motsfrançais.
Lesquestionssontlessuivantes:1) quelestledegrédepropagationdufluxnasalcontextuelledans
cesdeuxlangues?2) les bosniens ont-ils une stratégie différente de réalisation
de la nasalité selon la langue qu’ils parlent (le bosnien ou lefrançais)?
pournotreétude,nousavonsutilisél’appareileva2(évaluationvo-caleassistée),instrumentnoninvasifpourmesurerledébitd’airnasalet le débit d’air oral.nous avons étudié l’empan aérodynamiquede lapropagationdufluxnasalanticipatoireetpersévératrice,lemomentoùledébitd’airnasalestàsonmaximumetuneéventuelleinfluencedelalanguematernellesurlapropagationdufluxnasalcontextuellelorsdelaproductiondesmotsfrançaisparleslocuteursbosniens.
1. La nasalité1. 1 Voyelle nasale et voyelle nasalisée
unevoyellenasaliséeestunevoyelleoraleréaliséeavecunvoiledupalais abaissé à causedu contexte; cela estdû au fait qu’elle est situéeavantouaprèsuneconsonnenasale.toutphonèmeoralpeutêtrenasa-lisédufaitdelaprésencedutrait«nasal»dansl’undesphonèmesenvi-ronnants.parexemple,danslemot«maman»,lepremier/a/peutêtreplusoumoinsnasalisédufaitducontextenasal.Lasecondevoyelledanslemêmemotestobligatoirementnasale.Laprésenceoul’absencedena-salisationsurcephonèmenesertpasàdistinguerlesensdedeuxmotscommec’estlecasdesvoyellesnasales.
1.2. Nasalisation anticipatoire et nasalisation persévératricequandonparleduphénomènede coarticulationanticipatoireou
régressive,levoiledupalaiss’abaissedurantlavoyellequiestsituéeavantuneconsonnenasale;silesensdelapropagationestverslagauche(lesegmentoralquiprécèdelephonèmenasaltendàêtrenasalisé).
Lacoarticulationestditepersévératriceouprogressivesilesensdelapropagation est vers ladroite (le segmentoral qui suit lephonèmenasaltendàêtrenasalisé).

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
335
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
généralementilestadmisquelesphénomènesdecoarticulationna-salesontpluslimitésdansleslanguesquipossèdentàlafoislesvoyellesnasalesphonologiquesetlesconsonnesnasales.ils’agitdel’hypothèsereprisedanslathèsedecohn(1990)dontlesrésultatsdel’étudeaérody-namiquecomparativesurlefrançaisetsurl’anglaisontmontréquelesvoyellesenanglaissontplussujettesàdesphénomènesdecoarticulationnasalequelesvoyellesoralesenfrançais.cettehypothèseestexpliquéeparlesoppositionsphonologiquesquiexistententrelesdeuxlangues.
Figure 1: Hypothetical phonetic output. Cohn, a., Phonetic and Phonological rules of Nasalization (1990; p. 89), Données phonétiques hypothétiques. Cohn, a., les règles Phonétiques
et Phonologiques de Nasalisation
cependant, d’autres études, celles de solé (1991) et notammentl’étudedeclumeck(1979),ontmontréquelesystèmedecontrastedesvoyellesdansunelanguen’avaitpasforcémentd’influenceprévisiblesurlapropagationdelanasalité.clumeck(1979)montrenotammentqu’enhindi,suédois,chinois,etfrançais,ilyavaitpeudenasalisationantici-patoiredanslesséquencescvntandisqu’enanglaisetenportugaisdubrésililyenavaitbienplus.cesrésultatsn’ontpaspuêtreexpliquésparlaprésenceounondesvoyellesnasalesphonologiquesdansleslanguescarparmileslanguesétudiéesdanscetteétude,cellesquipossèdentlesvoyellesnasalesphonologiquessontlehindi,lefrançais,leportugaisdubrésilcontrairementausuédois,lechinoisetl’anglaisquin’enpossèdentpas.d’oùl’intérêtdecalculerleshabitudescoarticulatoiresdanschaquelangue.
2. Méthodologie et matériel2.1 le matériel utilisé pour notre étude
Les données aérodynamiques (le débit d’air nasal et le débit d’airoral)ontétéprisesàl’aidedel’appareileva2(testonetal,1999),danslachambresourdedel’institutdeLinguistiqueetphonétiquegénéralesetappliquées(iLpga).

Brkan A.
336
unmasqueensiliconesoupleaétéutilisépourrécolterlesdonnéessurlefluxd’airoraletnousavonsutilisédesemboutsnarinairespourcapterlefluxd’airnasaldechaquenarine.Lesignaldeparoleestenre-gistréparunmicrophonesetrouvantderrièrelecapteurdedébitd’airbuccal.
Lastationeva2estreliéeàunordinateur,surlaquellesontadaptésdescapteursacoustiquesetaérodynamiquesainsiquedesinstrumentsdemesures.Letableaudecommandedecesinstruments,l’affichagedesrésultats et leurs calculs sontgéréspar l’ordinateur aumoyende logi-cielsspécifiques.Lespneumotachographesàgrille,inclusdanslapièceàmain,ontpermislamesuredesdébitsd’airoraletnasal.
2.2 les locuteurstroislocutricesfrançaises(Lf1,Lf2etLf3)nativeset3locutrices
bosniennes (Lb1, Lb2, Lb3) parlant français commepremière langueétrangère,âgéesde23à35ansontacceptédeservirdelocutrices.
2.3 le corpusLecorpusest composédesmotsquiontunegraphie similaireou
quasisimilaireenfrançaisetenbosnienetquicontiennentdesvoyellesoralesprécédéesetsuiviesdelaconsonnenasale/m/ou/n/.
parexemple:(français) (bosnien) décimal decimala limiter limitirati immuniser imuniziratiaumomentdelaconceptionducorpus,lapositiondel’accentenbosnienn’apasétépriseenconsidérationdansl’élaborationducorpus.onsaitcependantquelapositiondel’accentlexicalestimportante.
Lesmesuresportentsurlaconsonnenasaleetsonentourage(droit/gauche)vocalique.
parexemple,danslemot«panorama»,nousavonsprisdesmesuresdeduréeetdesmesuresaérodynamiquessurlaconsonne/n/ainsiquesur lesvoyelles /a/ et /o/de«ano»et sur la consonne /m/et lesdeuxvoyelles/a/de«ama».nousavonsmesurélapropagationdelanasalitésurlavoyellequiprécèdeetquisuitlaconsonnenasale.Lesmots(a,betc)ontétédisposésdansdeslistescontenanttroismotsparliste.Leslocuteursontreçulaconsignedelirechaqueséquencedetroismotssansreprendreleursouffle.ilsontlulesmotsd’aborddansl’ordrenormaletensuitedansl’ordreinverseafind’éviterlepluspossiblel’effetde«liste».ilestdifficiledes’affranchirdel’effetdelistenotammentquandlecor-

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
337
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
pusestprésentésurunefeuille.quandlesmotssontregroupéspar lelocuteur, lederniermotdela listeserainvariablementtouchéparunedéclinaisondufondamental.chaquemot finaldegroupeaégalementété luuneseconde foisendébutdeconstituantafinque l’effet listeneportepastoujourssurlemêmemot.
2.4 . analyse des donnéesLesdonnéesontétécalibréesautomatiquementparl’appareileva2.
La segmentationet l’étiquetagedu corpusont été faitsde façon semi-automatique avec le logiciel praat (boersma etweenink 1999) en-suite,nousavonspuvisionnerlesdonnéesàl’aided’unscriptevasurmatlab
nousavonsconsidéréledébutdudanquandcelui-cipassejusteaudessusdelalignedezéro,indiquantledébutdel’apparitiondefluxd’airnasal.nousn’avonspas tenu comptedudannégatif, qui est surtoutintéressantàcorréleravecdesmesuresarticulatoiresdemouvementduvelum.
concernantlafindudan,elleestfacileàdéterminerquandcelui-cipasseendessousdezéro.quandcen’estpaslecas,nousavonsadmisunseuildeplusoumoins10%parrapportauminimumdel’intervallequ’onluiadonnémanuellement.pourmesurerl’anticipationnousavonsmesuréledécalageentreledébutdudébitd’airnasaletledébutacousti-queduphonème.
pourmesurerlapersévérationdudébitd’airnasal,nousavonsme-suréledécalageentrelafindudébitd’airnasaletlafinacoustiquedelavoyelle.
Lepicdefluxnasalcorrespondàlavaleurmaxdedanen(dcm3).sapositionestestiméeparrapportàlafindelaconsonnenasale.
ensuite,afindepouvoirvisualisermieuxlesdifférencesdelanasali-sationcontextuelleentrelesdeuxgroupesettroisproductions:leslocu-teursfrançaisnatifsprononçantlesmotsfrançais,leslocuteursbosniensprononçantlesmotsbosniensetleslocuteursbosniensprononçantlesmotsfrançais,nousavonsalignélesmesuresgrâceàunautrescriptmat-lab(alignement).
3. Résultats3.1. Mesure de l’anticipation de flux nasal pour les trois groupes
(gF, gB et gBF) nousavonsmesuréledécalageentreledébutdudébitd’airnasalet
ledébutacoustiqueduphonèmenasal.

Brkan A.
338
Locuteur nombred’items anticipation(nbredecas)
retard1(nbredecas)
Loc.1gf 112 43 69Loc.2gf 112 56 56Loc.3gf 112 23 89total 336 122 214Loc.1gb 112 93 19Loc.2gb 112 24 88Loc.3gb 112 25 87total 336 142 194Loc.1gbf 112 89 23Loc.2gbf 112 33 79Loc.3gbf 112 50 62total 336 172 164ToTAL 1008 436 572
Tableau 1: les cas d’anticipation et de retard pour gF (locuteurs français prononçant les mots français), gB (locuteurs bosniens prononçant les mots bosniens ) et gBF (locuteurs bosniens
prononçant les mots français)
nousobservonsunnombreimportantd’anticipationsmaisaussideretardsdanslesdeuxlanguesetcheztousleslocuteurs.
voiciunexemplederetard:
Figure 2: mot français «économie» prononcé par un locuteur français. Du haut en bas: signal acoustique, spectrogramme, débit d’air nasal. On observera l’absence d’anticipation du flux nasal, avant la première consonne nasale, et la présence de flux nasal durant les deux dernières syllabes.
troislocuteursfrançaisettroislocuteursbosniensontrépétédeuxfois56motsetleslocuteursbosniensontrépétédeuxfois56motsfrançais.nousavonsdoncuntotalde(56x2x6+56x2x3=1008)mots,(336pourlegroupegf,336pourlegroupegbet336pourlegroupegbf).
1 ils’agitduretarddenasalisation,del’absenced’anticipationdufluxnasal.

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
339
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
nousobservonsmoinsderetardpourlegroupe(gb)quepourlegroupe(gf)danslecontextevcn.nousobservonsquelesproductionsdesmotsfrançaisparleslocuteursbosnienssontplusproches,quantauretard,deproductionsdesmotsbosniensprononcéspar les locuteursbosniensquedeproductionsdesmotsfrançaisprononcésparleslocu-teursfrançais(n=1008).Letestanovamontreunedifférencesignifi-cativepouranticipationentregf,gbetgbfstatview(n=1008)avecunevaleurdefde6,786etunevaleurdep<0,005.
Figure 3 créée par Matlab, alignement des mesures du debit d’air nasal montrant la tendance des locuteurs bosniens de réaliser presque le même retard en prononçant le mot bosnien et le mot
français en transposant ainsi leurs habitudes articulatoires de la langue maternelle dans la langue étrangère. l’exemple ci-dessus est le mot «mouche»: mot français (noir), mot bosnien «muha»
(rouge), mot français/bosnien (mouche). Du haut en bas: signal de la parole, debit d’air nasal. la ligne zéro correspond à la position d’alignement des données, c’est-à-dire le début de la consonne
nasale /n/ dans cet exemple-là.
Lavaleurdemoyennepourgfestde–29msecpourgb -15etpourgbf-15.ecarttypepourgf60msec,pourgb50etpourgbf53.ilestintéressantdeconstaterquelesmoyennespourgbetgbfsontexactementlesmêmes.
LetestpLsddefishermontredoncunedifférencesignificativeen-tregfetgbavecunevaleurdep<0,005.ilmontreaussiunedifférencesignificativeentregfetgbfavecunevaleurdep<0,005.parcontreilmontreunedifférencepassignificativeentregbetgbfavecunevaleurdep>0,05.donc,nousobservonsuneinfluencedelalanguematernellesurlalangueétrangèreentermed’anticipationdenasalisation.

Brkan A.
340
3. 2. Mesure de persévération du flux nasal pour les trois groupes (gF, gB et gBF) pourmesurerlapersévérationdufluxnasal,nousavonsmesuréle
décalageentrelafindudébitd’airnasaletlafinacoustiquedelavoyelleorale.Locuteur nombred’items persévérationdenasalisation
(nbredecas)Loc.1gf 112 110Loc.2gf 112 110Loc.3gf 112 112total 336 332Loc.1gb 112 112Loc.2gb 112 112Loc.3gb 112 112total 336 336Loc.1gbf 112 112Loc.2gbf 112 111Loc.3gbf 112 111total 336 334ToTAL 1008 1002
Tableau 2: les cas de persévération nasale positive et négative pour gF (locuteurs français prononçant les mots français), gB (locuteurs bosniens prononçant les mots bosniens) et gBF
(locuteurs bosniens prononçant les mots français)
nousobservonsunepersévérationdufluxnasalimportantedanslesdeuxlanguesetcheztousleslocuteurs.
envoiciunexemple:
Figure 4: mot bosnien «manipulirati» prononcé par un locuteur bosnien. Du haut en bas: signal acoustique, spectrogramme, débit d’air nasal. On observera la présence de flux nasal durant la
voyelle (fermée) /i/

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
341
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
nousn’observonspasdedifférenceimportantedepersévérationdufluxnasalsurlesvoyellesoralesprécédéesdeconsonnesnasales/m/ou/n/,doncdanslecontextecnventrelestroisgroupes.troislocuteursfrançaisettroislocuteursbosniensontrépétédeuxfois56mots.Leslo-cuteurs bosniens ont répété enplus deux fois 56mots français.nousavonsun totalde (56x2x6+56x2x3=1008mots. (336pour legroupegf,336pourlegroupegbet336pourlegroupegbf).Letestanovanemontrepasdedifférencesignificativeentrelestroisproduc-tionsavecunevaleurdef0,183etunevaleurdep>0,005.Letableaudesmoyennesmontreunemoyennede120msecpourlegf,117msecpourlegbet117msecpourlegbfavecécarttypede86msecpourgf,77msecpourgbet97msecpourgbf.ilesttoutdemêmeintéressantdeconstaterquelesmoyennespourgbetgbfsontexactementlesmêmescequinousinciteàpensericiaussiàuneéventuelleinfluencedelalan-guematernellesurlalangueétrangère.nombredemesures:1008;résidudansstatview:1005.
3.3. Comparaison de la position du pic de flux nasal (cours temporel du flux nasal) entre gF, gB et gFB pourmesurer lapositiondupicdenasalité,nous avonsdoncap-
pliqué la formule:positionmaxnaf (sec)–position initialephonème(sec).
troislocuteursfrançaisettroislocuteursbosniensontrépétédeuxfois56mots.troislocuteursbosniensontrépétédeuxfois56motsfran-çais.nousavonsdoncuntotalde(56x2x6+56x2x3=1008mots.(336pourlegroupegf,336pourlegroupegbet336pourlegroupegbf).
nousobservonsquelapositiondu picdefluxnasaldegbf(locu-teursbosniensprononçantlesmotsfrançais)serapprocheplusdudébutde laconsonnenasale /m/ou/n/alorsque lepicde fluxnasaldegf(locuteursfrançaisprononçantlesmotsfrançais)serapprocheplusdelafindelaconsonnenasale/m/ou/n/.(n=1008).Leslocuteursbosniensonttendanceàsuivrelaformedelacourbededébitd’airnasaldelalan-guematernelleenprononçantlesmotsfrançais.
Letestanovamontreunedifférencesignificativepourlapositiondupicdefluxnasalentregf,gbetgbfavecunevaleurdefde5,166etunevaleurdep<0,05.Letableaudesmoyennesmontreunemoyennede62msecpourgf,68pourgbet79pourgbfavecécarttypede70msecpourgf,60pourgbet76msecpourgbf.nombredemesures:1008;résidudansstatview:1005ilfautprendrecerésultatavecréservecarladifférenceentrelesmoyennesdegfetgbesttoutdemêmetrèsfaible.

Brkan A.
342
envoiciunexemple:
Figure 5: figure créée par Matlab (alignement des mesures du debit d’air nasal) pour le mot «panorama»: mot français (noir), mot bosnien (rouge), mot français/bosnien (bleu). Du haut en bas: signal de la parole, debit d’air nasal. la ligne zéro correspond à la position d’alignement des données, c’est-à-dire le début de la consonne nasale /n/ dans cet exemple-là. Nous observons que
les locuteurs bosniens ont tendance à suivre la forme de la courbe de débit d’air nasal de la langue maternelle en prononçant les mots français.
Conclusionnotreétudeaconsistéenuneétudeaérodynamiquecomparativede
lanasalitécontextuelle(propagationdelanasalitéanticipatoireetper-sévératrice)enfrançaisstandardetenbosnien.nousavonsvouluvoircommentsepropage lanasalitédans lesdeux languesetcomparer lesdonnéesde trois locutrices françaisesprononçant lesmots français ettrois locutrices bosniennes prononçant lesmots bosniens et lesmotsfrançais.généralement,encequiconcernelapropagationdelanasalitéanticipatoire etpersévératrice, lorsqu’ilsprononcent lesmots français,leslocuteursbosniensserapprochentplusdubosnienquedufrançais.cettedifférenceseraitpeut-êtreencoreplusgrandesilesmotsducor-pusn’avaientpasunegraphiesimilaire.Laplupartdutemps,ils’agitdemotsd’emprunt.Lapropagationdufluxnasalanticipatoires’estavéréeunpeuplus forteenbosnienqu’en français.seloncohn(1990), il estgénéralementadmisquelesphénomènesdecoarticulationnasalesont

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
343
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
pluslimitésdansleslanguesquipossèdentàlafoislesvoyellesnasalesphonologiquesetlesconsonnesnasales.dansnotreétude,nousavonsvuqu’ilyaplusderetard(doncmoinsdepropagationdufluxnasalan-ticipatoire)enfrançaisqu’enbosnien.quantàlapersévérationdufluxnasal,statistiquement,iln’ypasdedifférenceentrelesdeuxlangues.
encequiconcernelesproductionsdelocuteursbosnienspronon-çantlesmotsfrançais,nousavonsobservél’influencedelalanguema-ternelle.statistiquement,danslecasdepropagationdufluxnasalantici-patoireetpropagationdufluxnasalpersévératrice,lesmoyennesdegbetgbfontétéexactementlesmêmes.
nousavonsaussiétudiélapositiontemporelledupicdefluxnasaldurantlaconsonnenasaleetnousavonsobservéquelepicdefluxnasalpourlegroupedeslocuteursbosnienssetrouveplusprèsdudébutdelaconsonnenasaletandisquepourlegroupedeslocuteursfrançais,ilsetrouveplusprèsdelafindelaconsonnenasale.Lepicdefluxnasalpourlegroupebosniendelocuteurslorsqu’ilsprononcentlesmotsfrançaissetrouveplusprèsdudébutdelaconsonnenasaletoutcommelorsqu’ilsprononcent lesmotsbosniens.Là,nousavonsdoncaussiobservéuneinfluencedelalanguematernelle,quoique,statistiquementfaible.est-cequec’estdûaufaitquelalanguebosnienneestunelangueàaccent?celaferapartiedenosfuturesrecherches.
Bibliographie
amelot2004:a.amelot,étudeaérodynamique,fibroscopique,acoustiqueetperceptivedesvoyellesnasalesdufrançais,thèsedirigéeparmmeleprofesseurJacquelinevaissière,paris:universitéparisiii.61-114bakran1996:J.bakran,Zvučna slika hrvatskoga govora, zagreb:grafikaibis.baken 1987: r.J. baken, Clinical measurement of speech and voice, London:taylorandfrancis.benguerel 1974: a.p.benguerel, nasal airflow patterns and velar coarticu-lation in french, speech Wave Processing and transmission, 2, stockholm:publi:almqvist&wiksell,105-112.benguerelet al1977a:a.p.benguerelet al,velarcoarticulationinfrench:afi-berscopicstudy,J. of Phonetics, 5,tokyo:researchinstituteofLogopedicsandphoniatric,149-158.benguerel,et al1977b:velarcoarticulationinfrench:anelectromyographicstudy, J. of Phonetics, 5,tokyo:researchinstituteofLogopedicsandphonia-tric,159-168.clumeck1976:h.clumeck,patternsofsoftpalatemovementsinsixlangua-ges,J. of Phonetics, 4,tokyo:researchinstituteofLogopedicsandphoniatric,337-351.

Brkan A.
344
cohn1990:a.cohn,phoneticandphonologicalrulesofnasalization,Working Papers of the university of California, 76, Losangeles:workingpapersinpho-netics,87-135delattre1954:p.delattre,Comparing the phonetic features of english, French, german and spanish: an interim report,heidelberg:Juliusgroosverlag,23-43.delattre1966:p.delattre,studies in French and comparatives phonetics, Lon-don:moutonandco.delvaux et al 2008: v. delvaux et al, the aerodynamics of nasalization infrench,Journal of Phonetics, 36,bruxelles:elsevier,578-606fant11960:g.fant,acoustic theory of speech production,thehague: moutonandco.Jahicet al.2000:dz.Jahic,gramatika bosanskoga jezika, zenica:domstampe.Jelaska 2004: z. Jelaska, Fonološki opisi hrvatskoga jezika, zagreb: hrvatskasveučilišnanaklada.krakow1993:r.krakow,nonsegmentalinfluencesonvelummovementpat-terns:syllables,sentences,stressandspeakingrate,In Phonetics and phonology,5,renasandiego:academicpress,87-116.maddieson 1984: i. maddieson, Patterns of sounds, cambridge: cambridgeuniversitypress.maddieson,Ladefoged,2006: i.maddieson,p.Ladefoged,the sounds of the World’s languages,oxford:blackwellpublishing.ohalaetal1975:J.ohala,phoneticexplanationsfornasalsoundpatterns.innasalfest:Papers from a symposium on nasals and nasalization,ferguson,289-316.solé, ohala 1991: m.J. solé, J.ohala, differentiating between phonetic andphonologicalprocesses:thecaseofnasalization,actes du xiième Congrès in-ternational des sciences Phonétiques,3, aixenprovence,110-113.Škarić1990:i.skaric,Fonetika hrvatskoga književnoga jezika,zagreb:globus.vaissière1995:J.vaissière,nasalitéetphonétique,Colloque sur le voile patholo-gique,sociétéfrançaisedephoniatrieetgroupefrancophonedelacommunica-tionparlée.Lyon:Lasociétéfrançaised’acoustique,1-10.vaissière,amelot2008:J.vaissière,a.amelot,nasalité,coarticulationetanti-cipation,paris:universitédelasorbonnenouvelle-paris3,1-8.vaissière2006:J.vaissière,la phonétique,paris: quesais-je?,pressesuniver-sitairesdefrance.zerling1984:J.-p.zerling,phénomènesdenasalitéetdenasalisationvocali-que:étude cinéradiographiquepourdeux locuteurs,travaux de l’institut de phonétique de strasbourg, 16,strassbourg,241-266.

Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien
345
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
33-3
45
Алтијана БрканАЕРОДИНАМИЧКА СТУДИЈА КОНТЕКСТУАЛНЕ
НАЗАЛИЗАЦИЈЕ У ФРАНЦУСКОМ И БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУРезиме
Ималисмоциљдаурадимоједнуаеродинамичкукомпаративнустудијуконтекстуал-неназализације(регресивнеипрогресивне)уфранцускомибосанскомјезику.Занимаонасјетакођеревентуалниутицајматерњегјезиканастраниуоквируконтекстуалнена-зализације.Корпусзаанализусмоснимилиузпомоћeva2апарата(testonet al.1999),упросторијизапрофесионалноснимањеуИнститутузаопштуипримјењенулингвистикуифонетикууПаризу.Инструментнијештетанпоговорникеимјериназалнииоралнипротокзрака.Резултатиовогистраживањасупоказалидауобајезикапостојиирегре-сивнаи прогресивна контекстуалнаназализација. Регресивна контекстуалнаназализа-цијајебитнијаубосанскомнегоуфранцуском,стимдатребаиматинаумудасурезулта-типоказалидауобајезикаимамобитно„заостајање“назалногпротоказракауконтекстуvcn.Међутим,тозаостајањејевећеуфранцускомнегоубосанском.Штосепрогресивнеконтекстуалненазализацијетиче,статистикенепоказујубитнуразликуизмеђудвајези-ка.Уовомистраживањусмо,углавномусвиманализама,примјетилиутицајматерњегјезиканастрани.
Примљено: 27. 1. 2011.


347
УДКрад
Aleksandra StevanovićFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
ANALYSE SÉMANTIquE DES EXPRESSIoNS réGIoNALeS eT DeS MéTAPhoreS DANS Le
RoMAN TEsTAMENT De VIDoSAV STeVANoVIć eT DANS SoN équIVALeNT frANçAIS,
LE PRÉLUDE à LA gUERRE
cetravailseproposed’analyserleprocessusdelaconstructiondesmétaphoresdans lespremiers cinqcontesdu romantestament etdanssonéquivalentenfrançais,Le Prélude à la guerre.enmettantl’ac-centsurlesmétaphorescoloréesparlescouleursrégionales,nousvou-drions expliquer les raisons pour lesquelles l’équivalence totale existe.aussiessayerons-nousd’éclaircirdansquelscasunetraduction,telleuneparaphrase,existesansoublierquelestledevoirprincipaldutraducteur:transporter le sens,dans le sens littéraldecemot latin.notreanalyses’appuyeraitsurlathéoriecognitiveproposéeparmarkJohnson,georgeLakoffandmarktuner.
Mots-clés:raison,métaphore,concept,traduction,langue,litté-rature
1. L’introductionLeromanLe Prélude à la guerreesttoutàfaitunehistoiredesserbes,ilestcomplètementunemétaphoresurlaviedifficiledesserbes,surlasuiteconstantedesguerres,dessouffrancesetsinousvoulionslasituer,nouspourrionslasituerdansn’importequellerégiondelaserbie.unereprésentationdelavie,rempliedemythesetdecontesmagiques,unepelotededestinées, un conte sur le borddu rêve et de la réalité - unchamp inépuisablepournotre recherche.La languedumondequivitdansceromanestsemblableàcesgensquisontcommedescréaturesd’uncontedefées,maisquiexistentenréel.

Stevanović A.
348
2. La construction des métaphores2.1. le processus de la construction des métaphores
avecuneanalyseduprocessusde laconstructiondesmétaphoresoudesexpressionsrégionales,nousessayeronsdenousorienterverslatraductiondetoutescesexpressionsenoffrantuneexplicationthéori-que:quellessontlesraisonspourl’équivalencetotaleetcellespourl’uti-lisationde laparaphrase?dans touteétapedenotreanalyse ilne fautpasoublierdesconceptsetdesrésauxd’intégrationquisecachentdanstoutemétaphore.
Leshypothèsessapir-worfiennesinterprètentlerapportentrelapen-séeengéneraletlesdifférenteslangues.dedifférentesculturesinterprè-tentdifférementleschoses.maislescritiquesnousrappellent:mêmelesreprésentantsd’unemêmelangue,d’unemêmeculturepeuventconsidé-rerleschosesdifféremment.
2.2. la langue est un problème cognitifdanssonétudeturner(1996:57)penseque:«...lamétaphorefonc-
tionnedans toutes lespartiesde la conversationquotidienne.dans laraisonexistentdenombreusesopérationsquidanscecasnepeutl’em-portersurlesémotions,quiaccompagnentlesconversationsquotidien-nes.»(turner1996:57)
Lesopérationsquiaccompagnentlaconversationquotidiennesont:1.L’accèsauxsouvenirsrelevantspourcedontonparle2.Ladistinctiondessonsquifontlaconversation3.Leprocessusdelaconstructiondelaphrase(lespenséessetrans-
formentenphrase)4.Lechoixdesmots5.Lecadredurelevant6.filtrercequiadel’importancedecequinel’apas7.remplirlesvidesdiscursifs8.fairedesconclusionssurcequiestprononcé9.fairedesprésentationsmentalesdansleprocessusdudécodage
despartiesdel’énoncé,quisontmoinsconnues10.anticiperlesensdelaconversationcecaractèredelamétaphorepermetlapossibilitédeparaphraser
unemétaphoreparlemoyend’autresmotsprislittéralementounon;lamétaphores’analysedoncselondeuxmodalitésderelationsémantique;eneffet,l’expressionfonctionned’abordlittéralement.Leconceptdelamétaphorepeutpointerversdesressemblancesinédites,soitdequalité,

349
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
47-3
53
Analyse sémantique des expressions régionales et des métaphores dans le roman Testament de Vidosav Stevanović
destructure,delocalisation,soitdesituation,soitdesentiment,ricoeurpenseque«cetteaptitudeaudéveloppementdistinguelamétaphoredesautres tropes,quis’épuisentdans leurexpressionimmédiate.Laméta-phore,aucontraire,estcapabled’abordd’étendrelevocabulaire,soitenfournissantunguidepourdénommerdenouveauxobjets,soitenoffrantpourlestermesabstraitsdessimilitudesconcrètes».(ricoeur1975:241)maisl’extensionduvocabulaireestlemoindredeseffetsdecetteaptitudeaudéveloppement:parlavertudelaressemblance,nouspouvonsopéreravecdenouvellessituations.cetransfertdessentiments,dessignifica-tionsnouspermetdetraduireunemétaphoreparuneautremétaphorequiauplandelaformediffèrentcomplètement.
2.3. l’inconscient collectifdans tous les aspects que nous avons mentionnés il ne faut pas
oublierl’inconscientcollectif.celaveutdirequelapensée,l’idée,mode-lée,enveloppéedanslamétaphoren’estquelesommetduglacier.fau-connier(2002:77)souligneque«toutcequenousdisonsoupensonsestbasésurlamétaphore.elleestunréseauquitientnospenséesensemble.danstoutecultureexistentlesconcepts:lavie,lamort,l’amour,letemps,l’espace,lamesure,lamaladie,lanaissance,levide;ils’agitseulementdelamanièreparlaquellelesreprésentantsd’uneculturefontlescoquilla-gespourlesconcepts,cisèlentleursidées,leursexpériences,leurvécu.»(fauconnier2002:77)
Lasignificationestleproduitdudialogueentrelaréalitédel’indi-viduetlamanièreparlaquellesonexpérienceseformedanssaculture.Lasémantiquedecompréhensionnousrappelleaussiquedanslalittéra-turelesforcesduréseaudesmétaphoressontcoloréesparlescouleursdel’imagination,delafictiondel’auteur,aussi.
3. L’analyse des expressions régionales et des métaphoresnous avons analysé les expressions régionales aussi que lesméta-
phoresdanscinqpremièresimagesduromanLe Prélude à la guerre.enabondantenmétaphoresetenexpressionsrégionalesilnousoffrel’his-toired’unpeuple, inondéedans les coutumespaganesdemi-sauvages,demi-chrétiennes,lemondedespaganesquiontleurproprelangue,néedanslanaturequil’entoure.Leurlangueestpleined’uneforcesurrna-turelle-c’est pourquoi nous avons choisi ce roman.nous avons essayéd’analyserleréseaudesconceptsdanslesmétaphoresenserbequiestfaitdesimagesquisontnéesdanslepeupleserbepoursavoirsilatraductionest réussie.mais il existedesexpressionspour lesquelles le traducteur

Stevanović A.
350
n’apastrouvé,peut-être,lameilleuretraduction-enchoisissantmêmelaparaphrase.nousallonsvoirquelesensesttransmis,maisletraducteur,lui-même,auraitputrouverunemeilleuresolution.notreopinionaussi,ouvre-t-ellebiendesquestionsdanslechampdelatranslatologie.Lecasleplusdifficile-cesontlesexpressionsfaitespourlessermentsoulesinjurescequenousallonsmontrer.
3.1. l’analyse des premières cinq imagesdansnotreanalyse,nousutilisonslatraductiondemauricettebegić
etnicoledizdarevićduromantestament:(stevanović1986:10-30)1.biću senka među senkama - une ombre parmi les ombres(leconcept
delamort,facilementcomprisdanslesdeuxcultures,l’idéedelaviesé-pulcrale,enracinéedansl’inconscient)
2.tišina koja je gutala zvuke - un silence qui avalait les sons(l’imagedel’auteurfondéesurl’imaginationenutilisantleconceptdel’espace)
3. izgubljen u provaliji vremena - perdu dans l’abîme du temps (leconceptdutempsetdel’espace)
4.njeno lice bilo je izbrazdano borama - s on visage, creusé de rides(leconceptdel’espace,dutempsetdelavieillesse)
5.veliko drvo života - le grand arbre de la vie (leconceptdel’espaceetdutemps)
6.razjapljena usta pećina - les bouches béantes des grottes(leconceptdel’espace)
7.put su izlokale kiše - les pluies avaient creusé le chemin(leconceptdel’espace)
8.ogromni panjevi, izrasli posle biblijskog potopa - d’énormes troncs, poussés la après le déluge biblique(leconceptdelavieillesse,dutemps)
9.kao pleva na vetru - disperses comme la balle d’avoine au gré du vent(uneimagetypiquepourlarégionquiestliéeausol,auxtravauxdes champs-le traducteura traduit littéralement-unecomparaisonquipeutsecomprendrefacilement)
10.ovuda uvek nešto duva i neki djavo prolazi, malo šta pretekne-il y a toujours quelque chose qui souffle, un diable qui passe, peu de chose qui reste(enserbe,biendesexpressionscomportentlemotdiable,maispastoujoursausenslittéral-kojimujedjavo-qu’est-cequiluiprend...ou:quellemouchel’apiqué.ànotreavisnouspouvonslaissercetteimagecommel’auteurl’afait,maisnousaurionstraduitplutôt-toutessortesdechoses)
11.čačkam mečku gde ne treba - agacer l’ourse là où il ne faut pas(l’auteuralaissél’image,aveclemotféminin-l’oursepuisquec’estuneex-pressionrégionalequirappellebiendesassociationsbienqu’ilexisteen

351
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
47-3
53
françaisuneexpressionsemblable:ilnefautpaséveillerlechatquidort,ilnefautpastenterlediable;maisenchoisissantdelaissercetteexpres-sion,cettemétaphore,letraducteurnousmontrequ’ilconnaîtlaviedeshabitantsdekao,laviequotidiennedesserbesquiviventensembleaveclestziganes,quigrandissentenregardantlesoursdanser)
12.ne zvao se ja kako se zovem-croyez-moi(uneexpressiontrèsforteen serbe, le traducteur a traduit le sens-c’est le serment,mais un ser-mentplusfortpourlequel ilauraitputrouverl’équivalent:promettresesgrandsdieuxoubiendieum’enesttémoin)
3.2. les concepts-la base pour la métaphoreLalinguistiquecognitives’efforcededécouvrirquellessontlesvoies
sur lesquelles la raison lie lesdifférencesentre lesexpérienceshumai-nesetprouvequelaraisoninclineàlamétaphore.touteressemblance,mêmefondéesur lasubjectivité,entreunphénomèneaetunphéno-mènebpeutêtrelaraisonpourunemétaphorepuisquelesconceptsleslientdansleréseau.touteextensionsémantiquepeutservirdepointdedépartpourunenouvelleimage,uneexpressionouunemétaphore.
fauconnier(1994:35)penseque«Lasuitedesconceptsquifondentetforgentunenouvelleimage,telleunemétaphore,alescaractéristiquessuivantes:
1.Lesélémentsdesdeuxconceptsfondusnedoiventpasêtreobliga-toirementprésentsdanslanouvelleimage.
2.Laprojectiondesconceptsd’origineestd’unenaturesélective.3.denouvellesmétaphorespeuvent, ellesaussi,devenir la source
pourd’autresidées.4.Lanouvellemétaphoreoffreunestructurequipeutêtrecomplète-
mentdifférentedesonorigine.5.Lesidées,lesattitudes,lespenséesquisontnéesdansleproces-
susde lacréationd’unemétaphorepeuventnousmotiverdàmodifierlesconceptsd’origine,mêmelaconnaissanceet lepointdevuesurlesconceptslesplusgénéraux».(fauconnier1994:35)
Lapenséehumainetravaillesanscesse.marktuner(2002:67)sou-ligneque«...lessignificationsnesontpaslesobjetsemprisonnéssurlelieude laconceptualisation,maisellessontactives,dynamiques,vivesetsurtoutlittéraires.ils’agiticiduprocessusquiestl’undesprocessusfondamentauxdansledomainedesopérationscognitives...»
Laconcordancedessignificationsempruntéesdesespacesmentalesdansleprocessusdelacréationdelamétaphoreestfondéesurl’identifi-cationdesélémentsquiseraientlaliaisonentreleséléments.
Analyse sémantique des expressions régionales et des métaphores dans le roman Testament de Vidosav Stevanović

Stevanović A.
352
4. L’esprit littéraireparcontre,aulieudelasémantiqueobjective,markJohnsonpro-
poselasémantiquedelacompréhensionetlasignification-cequiestleplusimportantpourlatraductionetquiesttraitéetelleunehistoireen-racinéedanslaraison,dansl’imagination,danslaculture.Lasignifica-tionestleproduitquis’étenddupasséverslefuturreférantquelquefoisauxgroupesdesexpériencesouàd’autressymboles.
cet aspect de la théorie de la signification souligne la dimensionculturelleet ladimensiondelastructuredenombreusessignificationsdansunmêmemot.m.currie(2004:37)nousinforme:«...lalangueetlesmécanismesqui lamènent sontunprocessus actifde la construc-tion constante qui a comme résultat- l’établissement de l’identité desconcepts-toutceladansunprocessusplusgrandquis’appelle: lesres-semblancesetlesdifférences.nousnesommespascapablesdecapterlenombreinfinidedifférences-c’estlaraisonpourlaquellenouslesrédui-sonsàpluspetitesdifférencesouàplusgrandesressemblances.»
Lacompréhensiondelasignificationetsatraductionpeuventêtretraitées comme lamanièredenotre incorporationdans lemondequinousentoure.
nousvoyonsdansnosexemplesdesmétaphoresetdeleurstraduc-tionsque lesdifficultésapparaissentquandletraducteursemetàtra-duireunemétaphorequin’estpasconventionnelle,quiest,plutôtimagi-native,offrantunnouveaupointdevuesurl’expérienceetcomporteunenouvellesignification.
5. ConclusionsL’hommequivithic et nuncprendlaréalite,lafaitpasseràtravers
leprismedesconcepts,lacisèle,quelquefoisattentivement,quelquefoisparpurhasard,faituneexpressionouunemétaphore.
maintenant,c’est ledevoirprincipalde la translatologiededécou-vrirquelest lerapportentretestament etLe Prélude à la guerreparcequelapierreangulairedelatraductologieestlefaitquecen’estpasseu-lement la traductionentre lesdeux languesmais le transfertde touteslesinformationsconcernantlesdeuxcultures,soitils’agitdesconcepts,soit il s’agitdesexpériencespersonnelles.sur l’axequirelie l’individu-telunsujetquiportesapropreexpérienceaussiquesaculture,sonin-conscientetl’inconscientcollectifdesplacesréservéespouruneopinionstricten’existentpas.Lavisioncognitivedenotrepropositionestchoisiecommelabasepuisqu’elleoffreunstimulant,ilnoussemble,trèspositif,

353
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
47-3
53
pourlarévisiondesproblèmesquiconcernentlerapportentrelalangueetlalittérature.
Bibliographie
currie2004:m.currie,Difference,Londonandnewyork:routledge.fauconnier1994:g.fauconnier,Mental spaces. aspects of meaning costruction in natural language,London:cambridgeuniversitypress.fauconnier,tuner2002:g.fauconnier,m.turner,The Way We Think. Concep-tual Blending and The Minds Hidden Complexities,newyork:basicbooks.Johnson1987:m.Johnson,The Body in the Mind,chicagoandLondon:uni-versityofchicagopress.Lakoff1980:g.Lakoff,Metaphors We live By,chicagoandLondon:universityofchicagopress.ricoeur1975:p.ricoeur,La métaphore vive,paris:éditionsduseuil.stevanović1986:v.stevanović,Testament,beograd:srpskaknjiževnazadru-ga.stevanović1996:v.stevanović,Prélude à la guerre,paris:mercuredefrance.
Aлександра СтевановићСЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ЛОКАЛИЗАМА И МЕТАФОРА У
РОМАНУ ТЕСТаМЕНТ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА, И У ЊЕГОВОМ ФРАНЦУСКОМ ЕКВИВАЛЕНТУ LE PRÉLUDE à
LA gUERRE (ПРВИХ ПЕТ ПРИЧА)Резиме
Уовомерадупокушалисмодадамосемантичкуанализуметафораилокализамаукојој смо се ослањали на принципе когнитивистичке семантике тражећи одговоре напитања:укојимслучајевимапоклапањадвајуиливишепримарнихконцепатадолазидопотпунееквиваленцијеупреводу,аукојимјемогућасамопарафраза,иакојеметафорапримарнеприродезасновананаконцептимакојисесадржеуобемакултурама.Оваквимприступомодшкринулисмовратаједногвеликогпољаидејакојесуважне,какозатран-слатологију,такоизапреиспитивањеодносајезикаикњижевности.
Примљено: 20. 02. 2011.
Analyse sémantique des expressions régionales et des métaphores dans le roman Testament de Vidosav Stevanović

Stevanović A.
354

355
УДКрад
[email protected]@neobee.net
Nataša Popović, Jelena MihailovićFaculté de philosophie, uviversité de Novi sad /
Faculté des sciences, uviversité de Novi sad
LA PoLYSÉMIE DE LA PRÉPoSITIoN FRANçAISE DANs eT SeS équIVALeNTS SerBeS
dans la présente communication, nous nous sommes proposé decontribuer à la caractérisation sémantique de la préposition françai-sedans, en examinant ses emplois et ses significationspossibles et enconfrontant les structures françaises contenant cette préposition avecleurséquivalentsserbes.
enpartantdel’usagespatialdelaprépositiondans,nousavonses-sayéd’expliquersesautresemploisplusabstraits(le temps, lacause, lemoyenetlamanière)àl’aidedesnotionsintroduitesparvandeloise:l’in-clusion,ladépendanceetlazone d’influence.vuquecesnotionssesontmontréesinsuffisantespourjustifiercertainsusages,nousavonségale-menteurecoursàl’analysegéométrique.
notreanalyseamontréquelesstructuresutiliséespourl’expressiondes relations spatiales sont aussi transposées dans les usages abstraitsautantenfrançaisqu’enserbe.celaimpliquequelesusagesnonspatiauxsontenprincipedérivésdesrelationsspatialesdanslesdeuxlangues.
Mots-clés:prépositiondans,analysecontrastive,sémantique,fran-çais,serbe
1. Introductionnotreanalyseportesurlesvaleurssémantiquesdelaprépositiondansenpartantdesesemploisspatiaux.mêmesi,selonlalinguistiquecogni-tive, les emplois spatiaux sont considérés commeprimaires, ilnedoitpass’agirdeleurprimaritédiachroniquemaisdufaitquel’espaceestlanotionlaplusfacileàconceptualiser.parconséquent,lescritèresd’orga-nisationdesvaleursspatialesetnon-spatialespeuventêtresimultanés.(piper1988:255)
dansestoriginairementuneprépositionspatio-temporelle.Lorsqu’ils’agitdesonusagespatial,laprépositiondanssous-entendunespaceàtroisdimensions.àladifférencedecesanalysesgéométriques,lesana-lysestopologiquesprivilégientl’explicationparlanotiond’inclusionde

Popović N, Mihailović J.
356
la cibledansle site1.Laprépositiondansmetessentiellementenrelationdeuxnotionsdontl’uneestaupremierplan(lacible)etl’autreestmiseàl’arrière-plan(lesite).cesontdespointsdevueformels.
claudevandeloise,undeslinguistesquialargementcontribuéàlacaractérisationdes relations spatiales ad’abordproposéune approchefonctionnelledansl’interprétationdelaprépositiondans.
unedesthéoriesimportantesestaussicelledeLeeman(1999)quianalyse les possibilités distributionnelles de la préposition dans. ellesoulignequelesensprototypiquededansneprovientpasd’unevisiongéométriquenitopologique,maisd’uneidéedecontrôledelacibleparlesite.(Leeman1999:84)
franckeletpaillardessaientdecomblerleslacunesdesthéoriespré-cédentesselonlesquellesl’espaceestconsidérécommelavaleurcentra-ledesprépositionsdontd’autresvaleurs (non-spatiales) sontdérivées.(franckeletpaillard2007:9).ilsoptentpouruneapprochenoninstru-mentalequirassembletouteslesmanifestationsdesemploisquiformentl’identitéd’unepréposition.
dans cet article, nous allons essayer de considérer des emplois etdes significations possibles de la préposition dans en confrontant lesstructuresfrançaisessv+dans+snavecleurséquivalentsserbesetenexaminantletransfertdesvaleurssémantiquesdansleslanguesrespec-tives.étantdonnéquedansestoriginairementuneprépositionspatiale,notrepointdedépart sera l’hypothèsedu localisme, selon laquelle lesexpressionsspatialessontsémantiquementetgrammaticalementfonda-mentales.nousallonsessayerderépondreàlaquestionsuivante:est-cequelesensspatialdelaprépositiondanspeutêtreconsidérécommeunprototypedesesusagesnon-spatiauxetquelssontlesmécanismesselonlesquelssontdérivéssesusagesabstraits2?noussouhaitonsmentionnerque,comptetenuducorpuslimité,lalistedesvaleurssémantiquesquenousavonsdresséedanscetarticlen’estpasexhaustive.
2. quelques propos sur la polysémieLa polysémieestlecaractèred’unsignequipossèdeplusieursconte-
nus,plusieurssens(Lepetitrobert:1722).Lapolysémiedesprépositionsaététraitéeparcadiotquiproposedeuxcatégories:la polysémie verticaleetlapolysémie horizontale.seloncetauteur,lapolysémieverticalesous-entendquelessensmanifestésdanslesdiversemploissontcontextuelle-mentdéterminés;ilspossèdentunevaleurgénérale,constante,maisabs-
1 la cibleestl’entitéàlocaliseretle siteestl’entitélocalisatrice.cestermessontempruntésàclaudevandeloise.
2 cettenotionévoquetouslesusagesnonspatiaux(letemps,lamanière,lebut,etc.)

La polysémie de la préposition française dans et ses équivalents serbes
357
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
55-3
65
traite.Lapolysémie horizontalefavoriseundessensenluiattribuantlestatutdeprototype;lesautresemploissontdérivésselonlesmécanismesd’analogieetdemétaphore(cadiot1997:10).pourl’analysedelaprépo-sitiondans,lapolysémiehorizontales’estmontréeplusappropriée.
Lamétaphoreestunprocessuscognitifpar l’intermédiaireduqueloncomprendlesnotionsabstraitesàpartirdesnotionsconcrètes(LakoffetJohnsoncitésparklikovac2000:34).
3. Les usages spatiaux de la préposition dansdans le cadredes relations spatiales, la prépositiondans se range
parmi lesprépositions topologiques; elle désigne la localisation interne(enserbe:localisationdirecte,termeempruntéàpiper2001).cetterela-tiondénotelasituationd’uneciblequisetrouvedanslaportiond’espaceoccupéeparlesite(borillo1998:32).
entraitantdesusagesdelaprépositiondans,laplupartdeslinguis-tess’appuientsurlathéorielocalisteselonlaquelle«lesusagesspatiauxd’unmotsontplusfondamentauxquesesautresusagesquiensont,enpartie,dérivés.»(vandeloise1999:145)vandeloiseexpliquelesrelationsspatialesexpriméesparlaprépositiondansenintroduisantlestermes:lecontenantetlecontenu.
Larelationcontenant/contenuestunerelationextra-linguistiquedontlespropriétésessentiellessont:
a)bcontrôlelapositiondea;b)s’ilyadéplacement,asedéplaceversb,plutôtquel’inverse;c)bentourea;d)bprotègea;e)bcachea,etc.(vandeloise1999:149)
dansl’exemplesuivant:ilm’afaituncadeau,unjolibraceletenargentdans une petite boîte.(po:51)pokloniomijejednulepusrebrnunarukvicuu maloj kutiji.(zr:35)
touteslespropriétéscitéessontrespectées(mêmesipourjustifierl’usa-gedelaprépositiondans,celles-cin’ontpasobligatoirementbesoindel’être)etc’estpourcelaquecetemploipeutêtreconsidérécommepro-totypique.
Larelationcontenant/contenuestlaplusappropriéequandils’agitdesobjetsmatériels.parcontre,elles’estmontréeinsuffisantepourdé-crire des relationsplus abstraites (par exemple, des relations entre lesentitésspatiales)etc’est laraisonpour laquelle ila introduit lanotiondedépendance(vandeloise1999).parlasuite,ilamodifiésonapprocheenlaqualifiantdedynamiqueetenintroduisantsesextensions: ladé-

Popović N, Mihailović J.
358
pendancematérielleet lazone d’influence3(vandeloise2001citéparL.sarda).nousallonsessayerdevoirsicesnotionspourraientnousaideràexpliquerlesusagesabstraitsdelaprépositiondansenlescombinantaveclesanalysesgéométriques.
3. 1. Quelques remarques sur la nature du site:pourl’interprétationsémantiquecorrectedesrelationsspatialesex-
priméespardans,ilestnécessairedeprendreenconsidérationlanaturedusite.
a. Lesiteestunobjetimmobile,plusgrandquelacible;danslaplu-partdescas,ilesttridimensionnel.
etpuisj’enfermeàclefcepapier-làdans un tiroir.(pp:52)azatimtajpapirićzaključamu ladicu.(mp:43)
La perception du site peut être différente en français et en serbe.comparonslesexemplessuivants:
Jejouaisdans la rue.(po:12)igraosamsena ulici.(zr:7)
enfrançais,larueestperçuecommeunespacetridimensionnel (larue étant bordée d’édifices, fermée et dénotant la notion de volume),alorsqu’enserbec’estunespacebidimensionnel,ouvert,considérécom-meunesurface.cette oppositionrésulte«delafaçondontchaquecom-munautésocioculturelleperçoitsonespace.»(charaudeau1992:436)
ilestintéressantderemarquerquelaconstructiondans la ruepeutparfoisêtreinterprétéedifféremment.
J’aicommencéàcourirdans la rue.(po:20)počelasamdatrčimniz ulicu.(zr:13)
en la confrontant avec son corrélat serbe niz + acc, on s’aperçoitqu’un trait sémantique est particulièrementmarqué: la rue est perçuecommeunespacebidimensionneldontlalongueur suggèreledéplace-mentdelacibleàtraverslasurfacedusitedansladirection«verslebas».Leverbedemouvementquiprécèdelesyntagmeprépositionnelyjoueunrôlesignificatif.
danslatraductiondecetteconstructionenserbe,onrencontreaus-silesstructures:
3 La dépendance matérielleestunerelationoùlacibledépenddusitenonseulementpoursalocalisationmaisaussipoursonexistence-même.Lazone d’influenceestunconceptd’aprèslequellacibleestaffectéeparl’entitéspatialedanslaquelleellesetrouve;ex.Lenavireestdansletriangledesbermudes.(sarda2010:4)

La polysémie de la préposition française dans et ses équivalents serbes
359
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
55-3
65
-kroz+acc-quiexprimeleparcoursàtraverslesite,c’est-à-direledéplacementunidirectionnelquis’effectueàl’intérieurdusiteperçudanscecas-làcommetridimensionnel:
dans les ruelles,ellemarchaitàgrandpas.(po:26)Kroz uličicejehodalakrupnimkoracima.(zr:17)
-Øinstr -quidénoteunespaceplusgrand,sans limitesdéfinies.(piperidr.2005:248)
J’aimarchédans les ruelles.(po:76)hodalasamulicama.(zr:54)
b.Lesitepeutêtre interprété,enfrançaisetenserbe,commeuneétendueillimitéequiinfluencelecomportementdelacible(vandeloise1999:153).
ilyavaitdescorbeauxdans le ciel.(po:210)bilojegavranovana nebu.(zr:150)
La structure na + locatif indique la surface du site sans limites.«mêmesilesiten’opposepasdefrontièresauxmouvementsdelacible,cettedernièrenepeutlequitter.cetypedecontenantnecontrôledoncpas lecontenupar la rigiditéde ses frontièresmaispar sonétendue.»(vandeloise1999:153)
Lesconstructionsdans le parkingetdans le cimetièreévoquentunespacetridimensionnelenfrançais,alorsqu’enserbecetespacepeutplu-tôt être conceptualisé commebidimensionnel grâce à son étendue, cequijustifiel’emploidelaprépositionnaquiseréfèreàlasurfacedusite.
ilsontarrêtélechryslerdans le parking.(po:235)zaustavilisukrajslerna parkingu.(zr:172)
Jesentaisquedans ce cimetièrej’étaistoutprèsd’elle.(po:52)osećalasamdasamna tom grobljubilablizunje.(zr:36)
c. ilpeutyavoirplusieurssitesdemêmetypequisontéparsdansl’espace.La traductionenserbeest lastructurepo + instr; lechoixduverben’estpaspertinent.
J’aicontinuéàvolerdans les magasins.(po:51)nastavilasamdakradempo radnjama.(zr:35)
onamarchétoutelajournéedans les collinespleinesdevieuxjardins.(po:228)hodalismoceodanpo okolnim brežuljcimagdejebilomnogobašta.(zr:163)

Popović N, Mihailović J.
360
4. Les usages abstraits de la préposition dans
danscettepartie,nousallonsprésenterlesusagesabstraitsdelapré-positiondansenessayantdevoirdequellemanièreonpeutexpliquerlefaitquesesusagesspatiauxs’étendentauxautresusages.
4.1. le tempsLaprépositiondanspeutaussimarquerlalocalisationtemporelle.J’aiquittél’hôteldans l’après-midi.(po:294)u toku popodnevasamnapustilahotel.(zr:212)
danslecadredelacatégoriesémantiquedetemporalité,nouspou-vonségalementdistinguer la cible et le site.danscecas, legroupedemotsquiestconsidérécommecibleestd’habitudeuneproposition(J’aiquittél’hôtel).Lasituationqu’elledénoteestlocaliséeparlesitequiest,engénéral,unenotiontemporelle(l’après-midi).
ondistinguedeuxemploistypiquesdelaprépositiondans:a.Lacibleestsituéeàl’intérieurdel’intervalletemporeldésignépar
lesite.dans sa jeunesse,ilavaiteuenviedefaireduthéâtre.(etr:49)u mladostiježeleodabudeglumac.(str:45)
La notion d’inclusion explique l’usage temporel de la prépositiondanscequiconfirmelathèselocaliste.
Lesconstructionsfrançaisestrouventleurscorrélatsserbesdanslesstructuressuivantes:
-u +Loc-lalocalisationtemporelledirecte:Leslampesdelaruesesontalorsalluméesbrusquementetellesontfaitpâlirlespremièresétoilesquimontaientdans la nuit.(etr:27)uličnesvetiljkesusetadnagloupalileiodnjihsupobledeleprvezvezdekojesusebilepojavileu noći.(str:25)
- tokom + gen -lalocalisationtemporelledirecteavecl’idéedepas-sagedu temps; cedernier étantperçu commeunenotiondynamique(piperetal.2005:154)
J’arriveraidans l’après-midi.(etr:7)stićićutokom popodneva.(str:5)
nouspouvonsremarquerqu’enfrançaisl’intervalleestperçudel’in-térieur,alorsqu’enserbeoninsistesurlepassagedutemps(tokom=aucoursde).

La polysémie de la préposition française dans et ses équivalents serbes
361
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
55-3
65
-odet + ngen-lalocalisationtemporelledirecte,avecunactualisa-teurdéictique(adjectifdémonstratif,adjectifnuméralcardinal).
dans les premiers joursoùelleétaitàl’asile,ellepleuraitsouvent.(etr:9)Prvih danaudomu,čestojeplakala.(str:7)
c’estunpeupourcelaquedans la dernière annéejen’ysuispresqueplusallé.(etr:9)neštoizbogtoga,poslednje godinegotovonisamvišeniodlaziotamo.(str:7)
L’équivalentleplusfréquentdelaconstructiondans+notiontem-porelleestlaconstructionserbeu+Loc,quenousavonsdéjàrencontréedansl’usagespatial;elledénotelanotiond’inclusionaussidanslesem-ploistemporels.Lesautreséquivalentsserbesprésentésci-dessus,cha-cunàleurmanière,évoquentégalementcettenotion.
b.Lacibleestsituéeàlafindeladistancetemporelle,c’est-à-direaumomentquicorrespondàlabornedroitedusitetemporel:
marcvavenirdans cinq minutes.markćedoćiza / kroz pet minuta.
Leséquivalentsserbespeuventavoir laformesuivante:za+acc/kroz+acc.Lesdeuxconstructionsmarquent la longueurde laduréedansletemps,ainsiquelapostériorité.(piperetal.2005:223)L’emploidelaprépositionkrozn’estpastotalementappropriéparcequ’iln’indi-quepaslafindelapériodetemporellemaisplutôtlepassageàtraverscettepériode.
notreanalyseamontréqueletemps,entantqu’unenotionunidi-mensionnelleetlinéaire,reprendenpartielarelationd’inclusionquiestcaractéristiquedel’espace.nousavonsconstatéqu’iln’yapasdeparallé-lismeabsoluentreletempsetl’espace.
Cas particuliers:dansnotrecorpusnousavonsrelevéquelquesexemplesquipour-
raient être qualifiés de spatio-temporels. L’exemple ci-dessous désigneuniquementlanotiondetemps:
nousparlionsdans la nuit.(po:84)pričalebismonoću.(zr:59)
enrevanche,danslesphrasessuivantes:onavaitroulélongtempsdans la nuit.(po:47)dugosmosevozilikroz noć.(zr:32)

Popović N, Mihailović J.
362
Jemefaufilaisdans la pénombrejusqu’aulit.(po:50)prikradalabihseu polumrakusvedokreveta.(zr:34)
ilnes’agitpasdelapuretemporalité.c’estlesémantismeduverbequirajoute à la temporalité une interprétation spatiale de la constructionprépositionnelledans la nuit.Lesverbesutiliséssontdesverbesdemou-vement(rouler,se faufiler)quiévoquentlepassageàtraverslesite.
4. 2. la causeLanotiondecauseestétroitementliéeàlatemporalité.Lapréposi-
tiondansintroduitunecausequiprécèdelaconséquence,elleinduiticilanotiondeprécédence.(vandeloise1999).
dans sa fureur,ilacassélevase.
Lastructuredans+snexprimantlacauseapouréquivalentserbelaformeu+locatifquiestqualifiéede«uzrok efektor».c’esttoujoursunétatpsychologiqueou(psycho)physiologique[ici:lafureur]quiapparaîtcomme «moteur» d’une conséquence, c’est-à-dire d’un nouvel état oud’uneaction(inconsciente)del’agent.(kovačević1988:100)4
dans ma naïveté,jelesprenaispourdesprincesses.(po:34)Jasamihu svojoj naivnostismatralaprincezama.(zr:23)
Lefaitquele«site»représenteunecauserenvoieàlanotiondezone d’influence.Lacible(l’action)estinfluencéeparl’étatpsychologiquedé-signéparlesite.
4. 3. le moyenLemoyen comme valeur sémantique de la prépositiondans peut
êtreexpliquépar lanotiondecontrôle.Le sitecontrôle lapositiondelacible,cequiévoqueunedespropriétésparlesquellesestexpliquéelanotiond’inclusion.
…uneliassededeuxmilledollarsserréedans un gros élastique.(po:96)...svežanjsadvehiljadedolarauvezanelastičnom trakom.(zr:68)
L’équivalentserbedelastructuredans+snexprimantlemoyenestl’instrumental sanspréposition; c’est «omogućivački (spoljašnji) instru-mental»[cetermeestdûàmilkaivić].ildésignelemoyenquin’estpasunepartieintégrantedel’agentdansleprocessusd’uneactionmaisqui
4 «efektorjetuuvijekpsihološkoili(psiho)fiziološkostanjekojesejavljaspontanimizazivačemposljedice:novogstanjailireakcijske(nesvjesne)akcijeagensa.iefekatiefektorsutakovezanizasferuistogbića.ovajtipuzročno-posljedičneveze,budućičulnonespoznatljiv,korakjedaljeodčulno-konkretnogmišljenjakauzalneveze.»(kovačević1988:100-101)

La polysémie de la préposition française dans et ses équivalents serbes
363
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
55-3
65
estplusoumoinsautonomeparrapportàl’agentetquipermetlaréali-sationd’uneaction.(piperetal.2005:714)
4. 4. la manièreLaconstructiondans+sn(le«site»)introduitunecirconstancede
l’actionprésentéeparla«cible»:àcemoment,uncamionestarrivédans un fracas de chaînes et d’explosions.(etr:29)utomtrenutkunaišaojejedankamionuz strahovit tresak lanaca i prasak motora.(str:26-27)
danscetexemple,lefracasestproduitparlecamion,ilestinhérentàsonavancée.«(...)dansétablitunerelationqu’onpourraitdireméro-nymiqueentrecequiestrelatédanslecomplémentetcequerapportesoncotexte:lefracasestprésentécommeun‘ingrédient’del’arrivée,in-grédientintrinsèque(...)»(Leeman1999:77)toutcelarenvoieàlano-tiond’inclusion.
Lecorrélat serbeest laconstructionuz+acc;elle sertàmarquer«uneco-existencetemporelleentredeuxentitéstemporellesautonomesquipartagentcertainespartiesdeleursduréesetquisontthématique-mentcohérentes.»(ašić2006:147)
5. Conclusion dans cet article,nous avonsprésenté ladiversitédesusagesde la
prépositiondans.enpartantdesonusageprototypique(spatial),nousavons essayé d’expliquer ses autres emplois, plus abstraits, à l’aide desnotionsintroduitesparvandeloise:l’inclusion,ladépendanceetlazone d’influence.pourjustifiercertainsusages,cesnotionssesontmontréesinsuffisantesetc’estlaraisonpourlaquellenousavonseurecoursàl’ana-lysegéométrique.
parmilesvaleursabstraites,nousavonsrelevé:letemps,lacause,lemoyenetlamanière.danstouslescasmentionnés,l’élémentquisuitlaprépositiondansdéterminelavaleursémantiquedecettepréposition.
notreanalyseamontréquelesstructuresutiliséespourl’expressiondes relations spatiales sont aussi transposées dans les usages abstraitsautantenfrançaisqu’enserbe.celaimpliquequelesusagesnonspatiauxsontenprincipedérivésdesrelationsspatialesdanslesdeuxlangues.
ilnoussemblenécessairedemeneruneétudecomplémentairesurce phénomène. La question qui se pose est la suivante: est-ce que lesvaleurs sémantiques dérivées des relations spatiales par analogie sontdifférentesenserbeetenfrançaisàcausedeladifférenteconceptualisa-

Popović N, Mihailović J.
364
tiondel’espacedanslesdeuxlanguesrespectives?Laraisond’unetelleconceptualisationrésidepeut-êtredanslesdomainessocioculturel,géo-graphique,historiquequipermettraientdecomprendrecesdifférenceslinguistiquesàtraverslarelationquel’hommeentretientaveclemondequil’entoure.
Bibliographie
ašić2008:t.ašić,espace, temps, prépositions,genève:droz.ašić2006:t.ašić, Lesusagestemporelsdelaprépositionuzenserbeetleurséquivalentsenfrançais,Nouveaux cahiers de linguistique française,27,genève:facultédesLettres,141-160.borillo1998:a.borillo,L’espace et son expression en français,paris:ophrys.cadiot1997:p.cadiot,les prépositions abstraites en français,paris:armandcolin.charaudeau1992:p.charaudeau,grammaire du sens et de l’expression,paris:hachette.franckel,paillard2007:J.-J.franckel,d.paillard,grammaire des prépositions. tome 1,paris:ophrys.klikovac2000:d.klikovac,semantika predloga. studija iz kognitvne lingvis-tike,beograd:filološkifakultet.kovačević1988:m.kovačević,uzročno semantičko polje,sarajevo:«svjetlost»ООurzavodzaužbenikeinastavnasredstva.Leeman1999:d.Leeman,Dans un juron, il sauta sur ses pistolets:aspectsdelapolysémiede laprépositiondans,Revue de sémantique et Pragmatique,6,orléans:pressesuniversitairesd’orléans,71-88.melis2003:L.melis,La préposition en français,paris:ophrys.piper1988:p.piper,Languageinspaceandspaceinlanguage,Yugoslav general Linguistics(miloradradovanović,ed.),amsterdam/philadelphia:benjamins,241-263.piper2001:p.piper,Jezik i prostor,beograd:bibliotekaxxvek.piper et al. 2005: p. piper et al., sintaksa savremenog srpskog jezika: Prosta rečenica,beograd:institutzasrpskijeziksanu,beogradskaknjiga-novisad:maticasrpska.sarda, L. les adverbiaux prépositionnels en dans: exploration en corpus de la notion de contenance. < http://edel.univ-poitiers.fr/corela/document.php?id=2645>.15.10.2010.vandeloise1986:c.vandeloise,L’espace en français,paris:éditionsduseuil.vandeloise1999:c.vandeloise,quanddansquittel’espacepourletemps,Re-vue de sémantique et pragmatique,6,orléans:pressesuniversitairesd’orléans,145-165.

La polysémie de la préposition française dans et ses équivalents serbes
365
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
55-3
65
le nouveau Petit robert.Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1998).sousladirectiondeJosetterey-debove,etalainrey.paris:dictionnairesLerobert.
Corpus:(etr) camus2005:a.camus,L’étranger,paris:folioplusclassiques.(str) kami2009:А.kami,stranac,beograd:paideia.(md) sand1973:g.sand,la Mare au Diable,paris:gallimard.(Đb) sand1998:Ž.sand,Đavolska bara,beograd:paideia.(pp) desaint-exupéry,a.2001:a.desaint-exupéry,le Petit Prince,paris: folio.(mp) desentegziperi1997:a.desentegziperi,mali princ,beograd:divit.(po) Leclézio2002:J.-m.g.Leclézio,Poisson d’or.paris:folio.(zr) Leklezio2004: J.-m.g.Leklezio,Zlatna ribica.beograd:ne&bo: tragovi.(na) breton1998:a.breton,Nadja,paris:gallimard.(nap) breton1999:a.breton,Nađa.beograd:nolit.
Наташа Поповић, Јелена МихаиловићПОЛИСЕМИЈА ФРАНЦУСКОГ ПРЕДЛОГА DANs И ЊЕГОВИ
СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИРезиме
Овајрадимациљдапредочисемантичкекарактеристикефранцускогпредлогаdans,посматрајућињеговеупотребеимогућазначењакрозпоређењефранцускихструктуракојегасадржеињиховихеквиваленатаусрпскомјезику.
Полазећи од просторне употребе предлога dans, покушали смо да разјаснимо ап-страктнијеупотребепопутвремена,узрока,средстваиначина,користећисепојмовимакојејеувеоВанделоаз(инклузија,зависност,зона утицаја).Поштосепоказалодапомоћуовихпојмованемогудасеобјаснесвеупотребе,прибеглисмоигеометријскојанализи.
Наша анализа је показала да се структуре којима се изражавају просторни односиподједнакокористеиуапстрактнимупотребама,какоуфранцускомтакоиу српскомјезику.Тојошједномпотврђуједасууобајезиканепросторнеупотребеизведенеизпро-сторних.
Примљено: 27. 1. 2011.


367
УДКрад
Vesna KrehoFaculté de philosophie, université de sarajevo
quI EST LE TRADuCTEuR ?
dansleprésentarticlejemeproposederéflechirsurlafigurecen-traledel’opérationtraduisante,letraducteur,étantdonnéqu’unegrandepartiedelaréflexionthéoriques’intéresseprincipalementàlatraductionentantqu’actetraductifd’uncôté,etàson«produitfini»,del’autre.decettefaçon,enmettantl’accentsurleprocessustraduisant,sesfonction-nementsetsesenjeux,onaparfoisignoréquelatraductionestunacted’interprétationtrèssubjectif,conditionnéparleschoixetlesgoûtsper-sonnelsdutraducteur.appuyéesurlaréflexionthéoriqued’uncôté,etsur une certaine expérience de la traduction, de l’autre, jem’intéressenotammentàcet«agent»detraduction,àsavoirceluiquiagit,intervientdanslaproductiondutextetraduit.vuqueleprocessusdetraductionsedérouledanslatêtedutraducteuretquec’estàluiquerevientlatâchedifficilederestituerl’œuvreoriginale,personnen’estautoriséàleréduireaurôled’unsimple«relais»oud’humblemédiateur.
Mots-clés: statutde traducteur;processus traduisant; fidélité et li-berté en traduction; traducteur– ré-créateurouco-auteur; traducteur–relais,médiateur
avantdeseconstituerentantquedisciplineplusoumoinsautonome,la théoriede la traduction, la traductologie, faisaitpartiede la théorielittéraire,delalinguistique,delathéoriedelacommunication,orientéeprincipalementversleprocessustraduisant,sesfonctionnementsetsesenjeux,commes’ilnes’agissaitqued’unprocessusautomatiquesoumisàunsystèmederèglesdonnéesunefoispourtoutes.d’autantplusqu’unegrandepartiedelaréflexionsurlatraductionaétéfaitepardesthéori-ciens,àsavoirdesnon-traducteurs.maisthéorisersurleprocessustra-duisantdansl’abstraitsignifieignorerquelatraduction,toutengardantlecaractèred’un«discourscontraint»,estenmêmetempsunacted’in-terprétation fortementsubjectif, conditionnépar leschoixet lesgoûtspersonnelsdutraducteur.cequinousintéresseici,c’estenpremierlieucet«agent»detraduction,àsavoirceluiquiagit,opère,intervientdanslaproductiondutextetraduit.or,quiestletraducteuretquelleestsapositionàl’égarddutexteàtraduire?

Kreho V.
368
cettemêmequestion,poséeparantoinebermandanssonlivresurlestraductionsdupoèteélisabéthainJohndonne,aétéamenéeparlaconscience«quepourcomprendrelalogiquedutextetraduitnoussom-mesrenvoyésautravail traductif lui-mêmeet,pardelà,autraducteur».(berman1994:73)decettefaçon,l’accentestmissurle«sujettradui-sant»,contrairementàlaplupartdespratiquesantérieuresquis’intéres-saientprincipalementàlatraductionentantqu’actetraductifd’uncôté,etàson«produitfini»,c’est-à-direletextetraduit,del’autre.demêmeque,devantuneœuvrelittéraire,onsedemandequienestl’auteur,demême,devantunetraduction,onsedemandequienestletraducteur.mais,souligneberman,lesdeuxquestionsontdifférentesfinalitésetdif-férents contenus.tandisque la question sur l’auteur concerne tout cequiestélémentsbiographiques,psychologiquesetautres,«[…]laviedutraducteurnenousconcernepas,eta fortiori sesétatsd’âme.[…]letra-ducteurresteceparfaitinconnuqu’ilestencorelaplupartdutemps».ceàquoions’intéresseprincipalement,cesontlesinformationsgénéralessursa«véritable»profession,sursescompétences,surl’ensembledesestraductions,surleslanguesqu’ilmaîtrise,etc.et,àl’inversedel’auteur,onnesaitriendu«processusgénétique»detraduction,onneconnaîtpasleshésitations, lespréférences, lesoptions,bref,riendece«dramedu traducteur». ainsi, la question initiale «qui est le traducteur ?», àpremièrevuedepurerhétorique,s’avère-t-ellebeaucouppluscomplexequ’elleneparaîtaupremierabord.elleexigeuneréfléxionapprofondiesur lesmécanismesopérationnelsduprocessusdetraductionetsur lerôledutraducteurdansleurmiseenplace.
Le traducteur, son statut et sa tâcheLe statut de traducteur, sinon suspect dumoins ambigu, sa pré-
tenduepositiond’entre-les-deux(langues,cultures,civilisations),entre«trahison» et «fidélité» lui ont pendant longtemps assigné une placemarginale,toujoursàl’ombredel’œuvreoriginaleetdesonauteur.wal-terbenjamin,desoncôté,endéfinissantlatâchedutraducteur,refused’abordlahiérarchieécrivain-traducteur.selonlui,cettetâche
[…] consiste à trouver dans la langue dans laquelle on traduit «cetteviséeintentionnellequiéveilleenellel’échodel’original».comment?endistinguantcequirelèvedelalanguedecequiestessentieldansletexteàtraduire.Laviséeneconcernepaslalanguedanssatotalité,maisseulementcertainescorrélationsdeteneurslinguistiques.ellen’estpas,commepourl’écrivain,uneplongéedanslaforêtdulangage,ellesetientdehorsetsansypénétrer,maiselleyfaitrésonnerl’original.ainsi,selonw.benjamin,si

Qui est le traducteur ?
369
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
67-3
72
laviséedel’écrivainestpremière,naïve,intuitive,laviséedutraducteurestdérivée,dernière,«idéelle».(oseki-dépré1999:103)
et pourtant, dans la perception commune, le traducteur reste cetéternelsecondquiest,selonfranzrosenzweig,censé«servirdeuxmaî-tres» (texte-source d’un côté, et texte-cible, de l’autre), «passer» d’untexteàl’autre,faisantfiguredece«pont»imaginaire,censéunirlesdeuxlangues,cultures,civilisations.maisilfaudrait,ànotreavis,passerau-delàdesmétaphoresspatiales(commecettemétaphoredepont),dufaitmêmequeletraducteursetrouvedans ceslangues,civilisations,cultu-res,etc.,etnonpasdansunespaceindéfini.toutcommelatraduction,letraducteuraeupendantlongtempslaconditionancillaireet,commeledécrit,nonsansamertume,antoineberman,«ilseveutécrivain,maisn’estqueré-écrivain.ilestauteur–etjamaisl’auteur.sonœuvredetra-ducteurestuneœuvre,maisn’estpasL’Œuvre.»(berman1984:19):
et aussi, […] après tant de réussites, tant de chefs-d’œuvre, tant deprétendues impossibilités vaincues, comment l’adage italien traduttore tradittore peut-ilencore fonctionnercommeun jugementderniersur latraduction?(berman1984:15)
réduitausimple«relaisdesnormesdudiscourssocialetde l’ins-titution que les instaure et les sanctionne» (brisset 1990: 199), le tra-ducteurn’apparaîtquecommequelqu’unquiobéitauxnormesetdontl’activitéestdéterminée«parl’état(relatif)d’ouvertureoudefermeturede lacultureréceptrice»etnon«par ledésirde ‘révéler’ausenspleindutermel’œuvreétrangère»(berman1994:58).ilestévidentquecetteapprochedésignéecommefonctionnalistenietouteautonomiedel’actede traduire, en portant ses préférences sur les «normes» littéraires delacultureréceptrice,sur l’intégrationdel’ouvreétrangèreau«polysys-tèmerécepteur».etletraducteur?commesileprocessusdetraduction,fortementindividualisé,souventintuitif,nereposaitpassursespropreschoix,sursapropreconceptiondelafidélitéetdelalibertéàl’égarddutexteàtraduire.etc’est justementdansseschoix,danscettemargedemanoeuvre,querésidentl’artetlaresponsabilitédutraducteuret,parlàmême,lecôtésubjectifdelatraduction.
d’autrepart,lanotionmêmede«fidélité»,ambiguëetsujetteàcau-tion,compriseetrespectéeàchaqueépoquedefaçondifférente,apourconséquencedifférentesstratégiesdel’actetraductif.dequelleespècedefidélités’agit-il?personneneconteste l’injonctionprincipalederesteraussiprèsquepossibledel’originalmais,enmêmetemps,setenir«[…]àégaledistancedesdeuxextrêmesquesontlaparaphraseetlatraduc-tionlittérale»(drydeninsteiner1978:241).or,fidélitéàqueldegréetàquelsniveaux?fidélitéàqui,àquoi?toutescesquestions,etencore

Kreho V.
370
beaucoupd’autres,lancentundéfiautraducteurquidoitmesurertouslesgainsetlespertespossibles,enassumantlapleineresponsabilitédesesdécisionsetdeseschoix.paradoxalement, lanotiondefidélitéen-traînecelledelibertéentraduction,cariln’yapasdevéritableantino-mieentrelesdeux.celaditquel’alternative«fidélité»ou«liberté»estenréalitéforcéeetpeulogique.
L’alternative ainsi posée est fausse car chacun de ces termes, ‘fidélité’,‘liberté’,ambitionnedes’appliqueràl’ensembled’untexte,alorsquetoutetraductioncomporteunealternanceentredescorrespondances(fidélitéàlalettre)etdeséquivalences(libertéàl’égarddelalettre).(Lederer1994:83)
danslaperceptiongénérale,réduitaurôled’un«relais»oud’hum-blemédiateur,letraducteuralongtempsfigurécommeundoublefami-lierdel’auteur(sonsimulacre?),commeun«médiateurévanouissant»ouunefigurefantomatique.maisons’estrenducomptequedévelopperunethéoriede la traductiondans l’abstraitsignifieoublierque lepro-cessussedérouledanslatêtedutraducteuretquec’estluietpersonned’autrequidécidedelaphysionomiedutextetraduit.pourcetteraison,l’imagetraditionnelledutraducteurservantdepontentredeuxlangues,cultures,civilisations,n’embrassepasentièrement«lemystèredutrans-fertdesignification»(steiner1978:237),du faitmêmeque leproces-susdetraductions’opèredansdeuxlanguesqueletraducteurhabite,setrouvant«àl’intérieur»dutexteoriginal.pourassurerlaréussitedesonentreprise,letraducteur«prendpossessiondel’objetaprèsenavoirprisconnaissance»,il«s’installedanssontexteets’yfaituneplace.donc,ilaprisconnaissance,ilaprisconscience,etensuiteilprendpossession.»(herbulot1991:101)decettefaçon,endépitdenombreusescontrain-tes,ilcréeuneœuvretoutàfaitindividuelle,empreintedesapersonna-lité,desespréférences,desesoptions.
Lapratiquedelatraduction,étroitementliéeàlapratiquedeslan-gues,delalittérature,delacultureengénéral,assuretoutessortesd’échan-gesinterculturelsetintralinguistiques,cequilaplaceparmilesactivitéslesplusimportantsdansl’histoiredescultures.maischaqueépoqueasapropreidéedelatraduction,vuquecelle-ciestchangeante,relative,façonnéeselondifférentesconceptions traductives,différentshorizonsd’attente.or,elleestdéterminéeparl’ensembledesdiscourshistorique,social,littéraire,idéologiquedel’époqueenquestion.toutefois,entantquemoded’ouvertureàl’étranger,d’«épreuvedel’altérité»(berman1984:75),latraductionjoueunrôletrèsimportantdansledéveloppementdeslittératuresetdesculturesdans lesquelleson traduit.onconnaîtbienl’influencebienheureusedes traductions sur la culture et la littérature

Qui est le traducteur ?
371
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
67-3
72
allemandesdelafinduxviiiesiècle(antoinebermanenalonguementparlé).
etpourtant,touteslesréflexionssurlatraductionentantquepro-cessustraductifd’uncôté,etsurlatraductionentantquerésultatdeceprocessus,del’autre,négligetrèssouventl’agentdeceprocessus-letra-ducteur.celui-cisetrouvegénéralementrefoulé,occulté,sous-jacent,etceladansunprocessusdontledéroulementetsonrésultatnedépendentquedelui.ilafallubeaucoupdetempspourquelatraductionelle-mê-meatteigneseslettresdenoblesse,etencorepluspourqueletraducteursoitreconnucommeré-créateur,co-auteuràpartentière.d’ailleurs,lesauteurseux-mêmesonttoujoursétésoupçonneuxàl’égarddestraduc-teurs,necroyantpasàlapossibilitéqueceux-cipuissentpréservertou-teslesvaleursdeleursœuvres.
ilestévidentque,examinéecommepratiqueetcommerésultat,latraductionconcerned’uncôtél’œuvreàtraduire,etdel’autreletraduc-teurpuisquesans lui iln’yapasdeprocessus traductif.dans lemêmesens,inêsoseki-dépréaffirmequelathéoriedelatraductionnepeutpassecontenterseulementduproduitfini,c’est-à-diredutextetraduit.carc’estautraducteurquerevientlatâchedifficilederestituerl’œuvreoriginaledanstoutesonépaisseurdesignesetdanslapluralitéinfiniedesignifications,enseposanttoujoursunemêmequestiond’importanceprimordiale:commentsaisiretrecréerlesenslittéraireàpartirdusensmatériel et littéral ?tout en étant exposé à toutes sortesde contrain-teset,enmêmetemps,responsabledesdeuxcôtés–auprèsdel’auteur,auprèsdesonpublic,voiremêmeresponsabledetouteslesfaiblessesdel’auteur.car,siunetraductionobtientunlargesuccèsauprèsdupublicetdelacritique,c’estàsonauteuretàsonéditeurquereviennenttousleshonneurs;silesuccèsmanque,c’estgénéralementletraducteurquis’attiretouteslesfoudresettouteslesimprécations.
peut-on imaginer la traduction automatique de textes littéraires ?aprèsdenombreusestentativesdechercheurspourtrouverlaréponseà cette question, on s’est vite rendu compte que la traduction-machi-nes doit se passer de textes littéraires car le caractère imprévisible delapenséehumaine,lebagagecognitifetl’ensembledel’imaginairehu-maindépassentlargementledomained’applicationdesmachines.bref,lefonctionnementd’unemachinen’estenaucunefaçoncomparableaufonctionnementmentaldel’hommeetiln’yaquelatraductionhumainequipuissesaisirlamultiplicitédestyles,deregistres,deconnotations,depolysémies, toutun langage figuréqu’unprocessusdedécodageauto-matique,siperfectionnésoit-il,nepourrajamaisrestituerdanstoutesacomplexité.d’autantplusqueletravaildutraducteurs’appuiesouvent

Kreho V.
372
sursonintuition,surquelquechosequivaau-delàdesmots,au-delàdesphrasesetdesstructuressyntaxiques.onsemettrafacilementd’accordsur lesavantagesde l’ordinateurdans leprocessusde traduction,maisils’agittoujoursdelatraductionhumaineassistéeparl’ordinateur.quel’onveuilleounon,lefacteurhumain-letraducteur–resteralafigurecentrale de l’opération traduisante, toujours en quête de ses lettres denoblesse.
Bibliographie
berman1995:a.berman,Pour une critique des traductions: John Donne,paris:gallimard.berman1984:a.berman,L’épreuve de l’étranger.Culture et traduction dans l’al-lemagne romantique,paris:gallimard.Larbaud1997:v.Larbaud,sous l’invocation de saint jérôme,paris:gallimard.Lederer1994:m.Lederer,La traduction aujourd’hui,paris:hachette.la liberté en traduction.actesducolloqueinternationaltenuàl’e.s.i.t.les7,8et9juin1990,réunisparm.Ledereretf.israel,didierérudition,paris.oseki-dépré1999:i.oseki-dépré,théories et pratiques de la traduction litté-raire,paris:a.colin.steiner1978:g.steiner,après Babel.une poétique du dire et de la traduction,paris:a.michel.
Весна КрехоКО ЈЕ ПРЕВОДИЛАЦ?
РезимеУовомсечланкужелимпозабавитицентралномфигуромпреводилачкедјелатности,
преводиоцем.Будућидаседобардиотеоријскемислизанимазачинпревођења,сједне,ињегов „финалнипроизвод“, с друге стране, стављајућиакцентнапреводилачкипро-цес,његовофункционирањеициљеве,понекадсегубиизвидада јепревођењекрајњесубјективан интерпретативни чин, увјетован личним избором и укусом преводиоца.Ослањајућисекаконатеоријскумисао,такоинаизвјесноискуствоупревођењу,својесамзанимањеусмјерилауправонатог„агенса“превођења, тј.надјелатникаупроцесунастајањапријевода.Какосепроцеспревођењаодвијауглавипреводиоца,текакоовомеприпадатешкизадатакпоновногуспостављањатекстаоригинала,небигасесмјелосво-дитинаулогуобичног„релеја“илипукогапосредника.
Примљено: 01. 02. 2011.

373
УДКрад
Irène Kristevauniversité de sofia
DÉFoRMATIoNS INCoNSCIENTES EN TRADuCTIoN
cetarticleseproposed’étudierlesrapportscomplexesqu’entretien-nentlatraductionetlapsychanalyse,affectéestouteslesdeuxparl’ac-tiondel’inconscient.
Lestroisvoletsd’analysecherchentàrépondreàunesériedeques-tions,notamment:Lapsychanalyseserait-elleenmesuredefourniruneexplicationplausibleàcertainsphénomènesincompréhensiblesobser-vésdanslapratiquetraductionnelle?saurait-elleéviterauxtraducteursdecommettrecertainstypesd’erreurs?Lathéoriedelatraduction,poursapart,éluciderait-ellelanaturedecette«chose»quiassurelaréussitedelatraduction?etparconséquent,contribueràlaproductiondebonnestraductions?
Lesréflexionsetlesargumentsexposés,quis’appuientsurquelquesexemplesdedéformationsrelevéesdans lapratique traductionnelledel’auteur,permettentd’avancerquelapsychanalysepourraitsoutenirleseffortsdéployésparlathéoriedelatraductionpourprendreconsciencedes limitesdesonobjet,etd’envisager l’interprétationdesrêvesetdesactesmanquéscommeuneclépotentiellededécodagedusens.Lapriseenconsidérationdel’actiondel’inconscientpourraitréduire,enoutre,la productionde faux-sens et prévenir certainesdéformations traduc-tionnelles.
Mots-clés:déformations,erreurs,inconscient,psychanalyse,traduc-tion
L’activitépsychiqueinconsciente,révéléedanslesécritsfreudiens,mani-festedeshomologiesavecd’autreschampsdusavoir.elleaffecteenpre-mierlieulalinguistiqueetparconséquent,lathéoriedelatraduction.ilestbienconnuquesigmundfreudarticulelesformationsdel’incons-cient,àsavoirlesrêves,leslapsus,lesactesmanqués,lesmotsd’esprit,commeunlangage,etleurinterprétationcommeunetraduction.
du point de vue psychanalytique, le traducteur éprouve toujoursuneespèced’attraction-répulsionpourletexteàtraduire:d’hainamora-

Kristeva I.
374
tion1,auraitditJacquesLacan,pourl’autreécriture,l’autrelangue,l’autreculture.bref,pourl’autredanssadifférence.acôtédudésirconscientdebiencernersonobjetafindesaisirl’insaisissableenlui,touttraducteurpossèdeledésirinconscientdeledétruirepourl’approprier.cedésirin-conscientsemanifestepardessymptômesconcrets:lesdéformations.etlesdéformations,onlesaitbien,sontdesexpressionsdeviolence.ainsi,letraducteurexerceraitinévitablementunedoubleviolence:sursapro-prelangueetsurlalangueétrangère.
partantdelaprémissedel’utilitépratiquedel’apportdelathéoriepsychanalytiqueàl’analysedeserreursetdesactesmanqués,macom-municationchercheralesréponsesàquelquesquestions:Lapsychanaly-sepourrait-ellefourniruneexplicationplausibleàcertainsphénomènesincompréhensiblesobservésdanslapratiquetraductionnelle?sesaver-tissements éviteraient-ils aux traducteursde commettre certains typesd’erreurs et dedéformations ? La théoriede la traduction elle-mêmesaurait-elleéluciderlanaturedecette«chose»quiassurelaréussitedelatraduction,etparconséquent,contribueràlaproductiondebonnestraductions?
Jevaisdoncessayerd’articulerlesrapportscomplexesqu’entretien-nent la traduction et l’herméneutique psychanalytique en trois tempsquiportent respectivement sur la confrontationde l’acteanalytiqueetdel’actedetraduire,lerapportentrelaviolenceetlatraduction,etlesmanifestationsdel’actiondel’inconscientdansl’actedetraduire.
Acte analytique vs acte de traduire depuissesorigines,lapsychanalysevoitdansletravaildetraduction
unepossibilitépourprésentersousformelinguistiquelenonmanifestequ’est l’inconscient.La«psychanalyseentretientsansdouteunrapportencoreplusprofondaveclatraduction,danslamesureoùelleinterrogelerapportdel’hommeaveclelangage,leslanguesetlalanguedite«ma-ternelle»d’unemanièrefondamentalementdifférentedecelledelatra-duction. interrogationquis’accompagned’uneréflexionsur l’œuvreetl’écritureappelée,detouteévidence,àbouleverserpeuàpeunotrevisiondecelles-ci»(berman1984:283).Latraduction,poursapart,trouvedesrepèresdanslaréflexionpsychanalytique.L’actedetraduireestunacteconscientquidoittransmettreàlafoisl’expressionexplicitedutexteet
1 LenéologismeforgéparJacquesLacantraduitl’ambivalencedel’affectdansl’ordredusavoir.selonLacan (1975:84), l’amourest indissociablede lahaine:plus l’amourest fort,plus lahaineestintense.

Déformations inconscientes en traduction
375
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
73-3
82
toutcequ’ilcontientdelatent. L’affinitéentrelatraductionetlapsycha-nalyserésidenotammentdanslechampd’actiondunonmanifeste2.
L’acteanalytiqueetl’actedetraduiresupposenttouslesdeuxl’inte-ractioncomplexedu«conflitdesinterprétations»3.eneffet, le«conflitdes interprétations», tel qu’il est relancé dans les années 60 par paulricœur, implique la rivalitédeplusieurs interprétationsqui cherchentà s’affirmer lesunesauxdépensdesautres.L’opération traduisanteestfondamentalepourledéploiementdudiscoursanalytiquedontledes-tindépenddusensdéclenchéparlejeudel’interprétation.d’autrepart,aussibienconscient qu’inconscient,letravaildetraductionesttoujoursplurielparceque le texte,pour reprendre lemotdeumbertoeco,estune«machineàinterprétation»(eco2001:6).
La traduction,comme lapsychanalyse, impliqueundouble trans-fert,à la foishorizontaletvertical: lepremierdésigne la transpositiond’untexted’une languedansuneautre, lesecondindique le transportd’unparadigmecultureld’uneépoqueàuneautre.maisàladifférencedutransfertanalytiquequiestsoitimaginaire(cequ’imaginelesujetsursonanalyste),soitsymbolique(l’actedeparoleàproprementparler),letransfertinterlinguistiqueesttoujoursréel.dotéd’unsens(Lacan1994:135),letransfertpsychanalytiquedemandeunchoix.enplus,ilesttou-joursambivalent:letransfertpositifregardelessentimentsd’amitiéoud’amourdupatientpoursonanalyste,letransfertnégatifsuscitedessen-timentsd’agressivitéoud’hostilité.Letransfertentraductionopèreluiaussideschoixconditionnéspardesjustificationssémantiques.
si«letransfertanalytique…estl’occasiond’unerencontre»(vanier1996:77),celledel’analysteetdesonpatient,latraductionestenvisagea-blecommelelieudelarencontredutexteoriginaletdutextetraduisant,delalanguesourceetdelalanguecible,delacultureétrangèreetdelapropreculture,delavisiondumondedel’autreetdelavisiondumondedutraducteur.cetterencontreprésenteungrandinvestissementaffectif.Leprocessusdetraduction,bienentendudansunemoindremesureparrapportautransfertpsychanalytique,n’estpasdépourvud’affectspositifsetnégatifs,«d’oùunesortede«transfert»,amourethaine,dequiestensituationdetraduire,sommédetraduire,àl’égarddutexteàtraduire(jenedispasdusignataireoudel’auteurdel’original),dela langueetde
2 Le non manifeste est nommé différemment par les théoriciens modernes de la traduc-tion: «l’insaisissable» (walterbenjamin), le «non-dit» (Jeanbollack), voire «l’esprit» (frie-drichschleiermacher).
3 Le «conflit des interprétations», relancé par l’herméneutique philosophique, et notam-mentparpaulricœur,impliquelarivalitédeplusieursinterprétationsquicherchentàs’affir-merlesunesauxdépensdesautres.

Kristeva I.
376
l’écriture,duliend’amourquisignelanoceentrel’auteurdel’«original»etsaproprelangue»(derrida1998:212).
or,siletransfertpsychanalytiquesedéfinitcommeunétataffectiféprouvépourunobjetétenduàunautreobjet,l’actedetraduiresepré-sentecommeuntransfertsémantiqueetexpressifd’unelangueversuneautre.Letraducteur«inspiré»exprimepourainsidiresa«passion»pourletexteétranger,enluirestantaffectueusementfidèle.ilfaitdeseffortspourlerespecter,enrenonçantàsonegopours’ysoumettre,enassu-mant sesplaisirs etdéplaisirs.Le traducteurqui «transporte» le texte,c’est-à-direunfragmentdelalangueétrangèredanssalangue,estcensétransporteraussilesémotionsetlessentimentsportésparcetexte.encesens,ileffectueàlafoisuntransfertsémantique,untransfertcultureletuntransfertaffectif.parcontre,conscientdelarépercussionpossibledans l’actede traduirede sespropres affects,provoquéspar le texte àtraduire,ildevraitessayerdelestenirsouscontrôle.
ayantcomprisl’importancedelatraductiondanslacurepsychana-lytique,freuds’interrogesouventsursanatureetsaplaceauseindelapenséeanalytique.ilécrit,notammentdansune lettreadresséeàwil-helmfliess,justeavantlaparutiondel’Interprétation des rêves:«Ladé-faillancedelatraduction,c’estcequis’appellecliniquementrefoulement.Lemotifdecelui-ciesttoujoursunedéliaisondedéplaisirquiseprodui-raitpartraduction,commesicedéplaisirprovoquaituneperturbationdelapenséequin’admettraitpasletravaildelatraduction»(citéd’aprèsthis,thèves1982:41).Ledéplaisirestdoncunesensationintrinsèqueàtoutepratiquetraductionnelle.ilrésultetantdelaprisedeconsciencedesinsuffisancesetdel’appauvrissementdelatraductionparrapportàl’original,quede laconfrontationentre ledésirdu traducteurde fairedesonmieuxet lescontraintes imposéespar lesnormesdesaproprelangue.
Violence et traductionpourdonnerl’impressionquesatraductionaétédirectementrédi-
géedanssalanguematernelle,letraducteurexerceconsciemmentouin-consciemmentdelaviolencesurl’objetdesondésir,commediraientlespsychanalystes,àsavoirletexteoriginal.onpeutrepérertoutdemêmedesdegrésdeviolencedifférentsenfonctiondugenredel’ouvrageàtra-duire.evidemment, legenre littérairesupposantdeparsonessence lemajeurdegrédeviolencedemeurelapoésie.d’autrespart,maltraitantsaproprelangueafindepréserverlafidélitéàl’original,ilarriveautraduc-teurdefairesaignerlesmots,pourpériphraserlafameusemétaphoredepierreklossowski(1993).maisc’estplutôtrare.

Déformations inconscientes en traduction
377
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
73-3
82
ainsi,latraductionquitémoigned’undésirdevientenmêmetempsleterraind’unedoubleviolencevis-à-visdesdeuxlangues.elleestpo-tentiellement sujette à des déformations conscientes et inconscientes.ces tendances déformantes se résument grosso modo à deux grandsgroupes demodifications du texte source,matérialisant la dialectiquedel’excèsetdudéfaut.Lestransformationspar excèssemanifestentparlesdiversrajouts,commentaires,périphrasesexplicatives,déplacements,recoupes, concordances superflues sous prétexte de clarification. Lestransformationspar défautapparaissentdanslesenlèvements,lesomis-sions, les simplifications, toujours sous lemêmeprétexte.henrimes-chonniccomplètececlassementpardeuxautrestypesdedéformations:«Latraductionprocèdecourammentàcesquatremodesdedistorsions,quicorrespondentauxquatretypesdemonstres:lesmonstresparexcès,lesmonstrespardéfaut,ceuxparrenversementd’organes,ceuxquipré-sententunepartied’uneautreespèce»(meschonnic1999:164).antoineberman(1999:52-68)évoquelanécessitéderepérerlesdéformationsenpuissancequimenacentlatraductionpouréviterautraducteurdecom-mettrecertaineserreursouaumoinsessayerdelesréduire.
outreparlestendancesdéformantesconscientes,l’espacedelatra-ductionestsouventenvahipardestendancesdéformantesinconscien-tes (eco 1985: 237). pour illustrer ce phénomène inexplicable ration-nellement, jevaisrecouriràunexempleconcernant l’undespremiersprojetsdetraduction,réalisésenbulgarieàl’époqueduréveilnational.paradoxalement,l’originaldelapremièretraductiondufrançaisverslebulgare,publiéeen1837,n’estpas français,maisaméricain: il s’agitdel’essaiThe way to wealth(1758)debenjaminfranklin qu’ilpubliesouslepseudonymederichardsaunders,dontletitrefrançaisestLa science du bonhomme richard ou Moyen facile de payer des impôts(1778).Latra-ductionaccompliepargavrilkrastevicprésentequelquesparticularités:letraducteuravaitdesconnaissancesinsuffisantesdufrançais(iln’avaitfaitquesixmoisdefrançais), la traductionbulgareestplusprochedel’originalaméricainquedutextefrançais,sonlangagereflètel’étatdelalanguebulgaredel’époque.touteces«bizarreries»pourraientêtreexpli-quéessoitparlefaitqu’entantquenationsjeunes,lanationbulgareetlanationaméricaineprésentaientplusdesimilitudesetétaientbienloinduraffinementfrançaisdel’époque,soitparl’actiondel’inconscient.
maislesétrangetésnes’arrêtentpaslà.krastevicexposesesprinci-pesdetraductiondansunepréfaceoùilconfesseavoirétépousséparledevoirpatriotique,avoirrecherchélaclartéetlaperfection,avoirutiliséla langue courante, c’est-à-dire le langagedes femmes, avoir fait relireletexte parsonmaître,raïnopopovic,quin’étaitpasfrancophone.il

Kristeva I.
378
avoueenfinêtrecontraireàlabulgarisationdutextequil’auraitrenduméconnaissable: quelque chose d’exceptionnel pour une époque où labulgarisation incarnait laréactioncontre l’influenceétrangère.rappe-lonsquec’étaitletempsdescontestationsdeladominationottomaneetdelaformationdelanation,oùtouteslesmanifestationsculturellesim-pliquaientenquelquesortedesenjeuxpolitiques.Labulgarisationdestextestraduitssedétachaitdonccommelemajeurproblèmedelatra-ductionàcetteépoquequimettaitenévidencelafonctionutilitairedestextes traduits, remaniés et actualisés à la limitedupossible (kristeva2008:396-397).
sommetoute,malgrélesimperfections,voirelesdistorsionsqu’ellecomporte, la traductiondegavrilkrastevic témoignede son couraged’aller à contre-courant de la tendance dominante pour défendre son«projet» de traduction. Le paradoxede sa traduction consiste dans lacontradictionentreceprojetassezclairetbiendéfinietsonrésultatdé-formé.acommencerparletitrechoisi,Мудрост добраго Рихарда(La sagesse du bonhomme richard),quirévèledéjàunedoubledéformationparrapportautitreoriginaletautitrefrançais.
Manifestations de l’action de l’inconscient dans l’acte de traduirecertaineserreursdetraductionpeuventêtreexpliquéesparleman-
quedeconcentration,lahâte,lasous-estimationdeladifficultédutexte,etc.d’autresdemeurenténigmatiques.Lareconnaissancedel’actiondel’inconscientsurlavieconscientepermetsonusagedanslapratiquedel’interprétationetdelatraduction.evidemment,ilnes’agitnid’uneana-logieimmédiateentrelerêveetlelangagenid’unecomparaisondirectedu langage onirique et des langues existantes,mais plutôt d’un usagemétaphoriqueduparadigmedel’inconscient.
Lesmanifestationsclassiquesdel’inconscientpourlapsychanalysesontlesrêves,lesactesmanqués,lesmotsd’esprit.envisageantl’incons-cientcommeuneespècede langage,sigmundfreudconsidère l’inter-prétationdesrêves(1900)commeuneespècedetraduction.Lesactesmanqués, observe-t-il dans la Psychopathologie de la vie quotidienne(1901-1904),désignentnonseulementlesratésdelaparole,delamé-moireetdel’action,maisaussilesaccidentsdulangageetdufonctionne-mentpsychiquedetoutesorte.etantuncompromisentreuneintentionconscienteetundésirinconscientdusujet,ilssontconcevablescommedessymptômesd’unmalaiseinconscient.ilsprésententtoujoursunesi-gnificationcachée.freudexplique,dansLe mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (1905),lanaturedumotd’espritcommeunjugementludi-quequisupposeàlafoislacondensationetlamodificationdumotpar

Déformations inconscientes en traduction
379
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
73-3
82
unajout.Latechniquedumotd’esprit jouesur ledoublesensdumotmodifié,enexploitantlatensionentresonsenslittéral(manifeste)etsonsensmétaphorique(latent).
touttraducteurapuressentirlui-mêmel’actionredoutabledel’in-conscientqui apparaît à travers les lapsus, lesnon-sens, lesomissionsinvolontaires, lesmotsmaldéchiffréspourdiversesraisons.Jevaises-sayerdeprouverqu’enmatièrede traduction, les erreursd’écritureoudelecture,etlesactesmanquéssontdesmanifestationsdel’activitédel’inconscient.
Jevaisdoncpoursuivremesréflexionssurl’aspectocculté,incom-préhensible, inconscientde l’actede traduire, enm’appuyant surdeuxerreurs que j’ai faites moi-même. dans lе premier extrait, j’ai traduit«voyeur»par«пътник»(«voyageur»).
Leregarddedianesurprisesebaignantdanslaforêttransformelevoyeurencerf.(quignard1996:114-115)Погледътнаизнанаданата,къпещасевгоратаДианапреобразявапътникавелен.(Киняр2000:62)
apparemment, j’aimal luunmotd’une importance capitalepourlasignificationdutexte.Jenepeuxpasattribuercetteerreurdecontre-sensniàl’ignorance(latraductiondumotneposeaucunproblème;lecontextenonplus:d’ailleurs,bienconnu,lemythededianeetactéonestunivoque)niàl’inadvertance(ilestpossibledemanquerdeconcen-trationlorsdel’unedeslecturesdutextemaisl’actedetraduireenexigeplusieurs;j’excluraidoncd’embléelemanquesystématiqued’attention).Lesexplicationsquejepeuxdonneraprès-coupsontlessuivantes:l’er-reurest lerésultatsoitd’unmanquedeconcentrationdel’espècedelacompulsionderépétition(peuprobable),soitd’unerésistanceautexte(peuprobablecarj’aimebeaucoupetjeconnaisbiencetextedepascalquignard),soitnotammentd’unactemanquédûàl’actiondel’incons-cient.c’estbiencettedernièreexplicationquimesembleplausible.
voilàl’autreexemple:c’est la concordance entre les structures objectives et les structurescognitives,entrelaconformationdel’êtreetlesformesduconnaître,entrelecoursdumondeetlesattentesàsonpropos,quirendpossiblecerapportau monde que husserl décrivait sous le nom d’«attitude naturelle» oud’«expériencedoxique»–mais enomettantd’en rappeler les conditionssocialesdepossibilité.(bourdieu1998:14-15)
Тъкмосъгласуванетомеждуобективнитеипознавателнитеструкту-ри,междупотвърждаванетонабитиетоиформитенапознанието,междусветовнияходиочакваниятапонеговповодправивъзможновзаимоотношението със света, описвано от Хусерл под името «ес-

Kristeva I.
380
тественанагласа»или«доксическиопит»,ноизпускайкидаприпом-нивъзможнитесоциалниусловиязанего.(Бурдийо2002:17)
La fâcheuseconfusionentre«conformation»(«съформиране»)et«confirmation»(«потвърждаване»)estencoreplusennuyeusecarelleconduitàlapertedujeulinguistiqueentre«conformationdel’être»et«formesduconnaître».Lapertedelaracinecommunede«forme»etde«conformation»etdupréfixecommunde«concordance»etde«confor-mation»,danslatraduction,acommeconséquencel’aplatissementdelaphraseetladestructiondusens.
ainsi,malgré les efforts du traducteur de rester fidèle à «la lettredel’œuvre»,ilpeutseretrouverdanslasituationdela«femmedenon-recevoir»4.encesens,antoinebermanaraisondeconseillerautraduc-teurde«semettreenanalyse»pour«repérerlessystèmesdedéformationquimenacentsapratiqueetopèrentdefaçoninconscienteauniveaudeseschoixlinguistiquesetlittéraires»(berman1984:19).ilmesemblece-pendantqu’ilfaudraitentendrecettemiseenanalyseplutôtcommeuneauto-analysequiaideraitletraducteuràrespecterlecadredelatraduc-tion,àélucidersesidéessurl’usagedesnormeslinguistiques,àprendreconsciencedesrisquespotentielsdedéformation,àtenirsouscontrôlelesassociationslibresauprofitdutravaildetraduction.
pourconclure,onpeutdireque,sansincorporerl’interprétationdesrêvesetdeserreursàlasciencedulangage,lathéoriedelatraductiondevraitnéanmoinssensibiliser letraducteurà l’actionde l’inconscient.Lapriseenconsidérationdecetteactionpourraitréduirelaproductiondefaux-sensetprévenircertaineserreurs.Lapsychanalysepourraitsou-tenirleseffortsdelathéoriedelatraductionpourserendrecomptedeslimitesdesonobjetetenvisagerl’interprétationdesrêvesetdeserreurscommeunpotentieldedécryptagedusens.
denosjours,laréflexionsurlatraductionnepeutdoncplusfaireabstractiondel’herméneutiquepsychanalytiqueetdudiscourssurl’in-conscient.pourmeneràbiensatraduction,letraducteurdevraitremplircertaines exigences.connaissantbien l’état actuelde sa langue, ildoitd’abordpuiserdanstoussesregistres,toutenessayantdel’enrichirpardenouveauxempruntsounéologismes,etn’ayantpaspeurdetransgresserlescontrainteslinguistiquesouculturellesencasdenécessité.ensuite,ildoitêtreconscientdelarésistanceàlatraductiondesaproprecultureetdelapartdeviolencesurlalanguematernelleinévitablementcomportéepartoutetraduction.and last, but not least,ilnedoitpasoublierquele
4 JacquesLacan analyse cemotd’esprit forgépar l’unde ses patientsdans sonséminaire v (1998:121-139).

Déformations inconscientes en traduction
381
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
73-3
82
texterecèleaussidestendancesinconscientes,propresàsonauteur.Letraducteurdoitêtreextrêmementprudentvis-à-visdecestendancesetessayerdelesdécelersansleslaisserconditionnersespropreschoix.
Bibliographie
berman1984:a.berman,L’épreuve de l’étranger,paris:gallimard.berman1999:a.berman,la traduction et la lettre ou l’auberge du lointain,paris:Leseuil.bourdieu1998:p.bourdieu,La domination masculine,paris:Leseuil.Бурдийо2002:П.Бурдийо,Мъжкото господство,прев.ИренаКръстева,София:ЛИК.derrida1998:J.derrida,Psyché: Inventions de l’autre,paris:galilée.eco1985:u.eco,lector in fabula ou de la coopération interprétative dans les textes narratifs,paris:grasset.eco2001:u.eco,experiences in translation,toronto:universityoftorontopress.freud 1900:s.freud, die traumdeutung,Leipzig&vienna:franzdeuticke.freud1904(2004):s.freud, Psychopathologie de la vie quotidienne,paris:pe-titebibliothèquepayot.freud1905(1992):s.freud, Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient,paris:gallimard.klossowski1993:p.klossowski,préfaceàlatraductiondel’énéide,paris:an-drédimanche.kristeva2008:i.kristeva,delapulsiondetraduireauxlimitesdel’interpré-tation,in L’homme dans le texte,(dirigépard.mantchévaetr.kountchéva),sofia:pressesuniversitaire«saintclémentd’ohrid»,390-398.Lacan1975:J.Lacan,le séminaire. livre XX. encore,paris:Leseuil.Lacan1994:J.Lacan,le séminaire. livre IV. la relation d’objet,paris:Leseuil.Lacan1998:J.Lacan,le séminaire. livre IV. les formations de l’inconscient,pa-ris:Leseuil.meschonnic1999:h.meschonnic, Poétique du traduire,paris:verdier.quignard1996:p.quignard,Le sexe et l’effroi,paris:gallimard(Киняр2000:П.Киняр,Секс и ужас,прев.ИренаКръстева,София:ЛИК)this,thèves1982:b.this,p.thèves,commentpeut-ontraduirehafiz…oufreud?,Meta: journal des traducteurs,27/1,montréal:Lespressesdel’univer-sitédemontréal,37-59.vanier1996:a.vanier,Éléments d’introduction à la psychanalyse,paris:na-than.

Kristeva I.
382
Ирена КристеваНЕСВЕСНА ПРЕИНАЧЕЊА У ПРЕВОЂЕЊУ
РезимеЦиљовогачланкаједапроучисложенеодносепревођењаипсихоанализе,будућида
суиједноидругоповезанисанесвесним.Тринивоаанализетежедаодговоренанизпитања,наиме:дали јепсихоанализау
стању дапружиприхватљивообјашњење запојединенесхватљивепојавепримећене упреводилачкојпракси?Можелионаутицатинапреводиоцедаизбегнуодређенитипгре-шака?Далитеоријапревођењаумедарасветлиприроду„оноганедокучивог“штообе-збеђујеуспехпревода?Ида,самимтим,допринесестварањудобрихпревода?
Изложенаразматрањаиаргументи,ослањајућисенапримерепреиначењапреузетихизпреводилачкепраксеауторкечланка,омогућавајудасепретпоставидапсихоанализаможедаподржинапреткетеоријепревођењаусмислуспознавањаграницасвогпредме-та,каоидасеразмотритумачењесноваиомашкикаопотенцијалникључдекодирањазначења.Поврхтога,разматрањеутицајанесвесногмоглобидасмањи,измеђуосталог,грешкеупревођењуидапредупредипојавупојединихпреиначења.
Примљено: 25. 1. 2011.

383
УДКрад
Ana VujovićFaculté de formation des maîtres, université de Belgrade
APPreNTISSAGe Précoce D’uNe LANGue éTrANGère1
L’enseignement/apprentissageprécocedeslanguesétrangèresàl’écoleprimaire(etmêmematernelle)estundesthèmeslesplusactuels.c’estaussiunedesperspectiveslesplusintéressantesdeladidactiquedeslanguesvivantesetundesmeilleursinstrumentspourréaliser leplurilinguismedontonnecessedeparler.c’estpourquoidenombreuxpayssontentraindefaireungrandeffortpourpromouvoirlemultilinguismeenintroduisantlapremièrelangueétrangèredès lespremièresannéesde l’écoleprimaireetmêmeàl’âgepréscolaire.pourpouvoirlefaire,ilfaudraitd’abordsensibiliser les responsablespolitiquesde tous lesniveaux et legrandpublic, ensuite les enseignants et les parents, pour venirenfinaux jeunesenfantsdont lesréactionset lamotivationdé-pendentbeaucoupdel’attitudedeleursparents.chaquepaysde-vraitaussidéfinirunepolitiquelinguistiquebienclairequiserait,à long terme, dans l’intérêt de ses citoyens.mais la disparitiondufrançaisdansleprimairedanscertainesdenosrégions(no-tammentenvoïvodine)entraîneladiminutiondeceuxquil’ap-prennentdanslesecondaireetencoreplusauniveaudesétudessupérieures.
Mots-clés:apprentissageprécoce,écolematernelleetprimai-re,plurilinguisme,sensibilisation,motivation
faut-il toujours prouver l’importance d’apprentissage de l’une langueétrangère?surtoutdansunmonded’unemobilitéaccruedelapopula-tionactiveetdesmouvementsmigratoires.toutlemondeestaucourantdes documents du conseil européen concernant l’objectif vers lequel
1 cetarticlefaitpartied’unprojetfinancéparleministèredelasciencedelarépubliquedeserbie intitulé«Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspi-tanja»,numéro179020d,pourlapériode2011-2014.

Vujović A.
384
aspirent tous lespaysmembresde l’union,mais lesautresaussi, etcesont lescompétencesdechacundans trois languesvivantes,dontuneest la languematernelle. en plus, adopter le code linguistique de soninterlocuteurétranger,c’estaussis’ouvriràsacultureetluireconnaîtreledroitd’avoiruneautrereprésentationdumonde.ilyabeaucoupd’exem-plesquiprouventcechangementd’attitudeàl’égarddeslocuteursdonton apprend la langue.Lescanadiensontmené avecdes anglophonesdenombreusesexpériencesd’apprentissagedufrançais:ceux-cisesontmontrésensuiteplustolérantsàl’égarddesfrancophones.(morice2005:112)eneffet,pourapprendreuneautrelangue,ilfautsemettreàlapla-cedel’étranger;endéveloppantcettefacultéd’empathie,onfaitpreuvedetoléranceetl’onapporteégalementsacontributionàlapaixentrelespeuples.commelesélèveschoisissentleplussouventlalanguequileurplait,quiadansleuresprituneimagepositiveetquileurestfamilière,ilestnécessairedelesinitierauxdifférenteslangues.ilseraitaussiutilequ’ilsentrentaucontactavecdeslocuteursdediverseslangues,maiscen’estpastoujoursfacileaveclesélèvesd’untrèsjeuneâge.
danslemondeactuel,lamajoritédesêtreshumainsestbi-oupluri-lingueouvitdansdescommunautésbi-ouplurilingues,c’est-à-diredansdes sociétés avec plusieurs variétés linguistiques sur un seul etmêmeterritoire.danslesannées80déjà,onestimaitque60%delapopulationmondialeétaitaffectéparl’uneoul’autreformedeplurilinguisme.etils’agissaitdesrégionsdumondecaractériséesparlestauxdecroissancedémographiquelesplusélevés.«cen’estdoncpasl’unilinguisme,maisbienleplurilinguismequireprésentelecasprototypique;lebilinguismeenestunevariante,alorsquel’unilinguismereprésenteuncaslimiteduplurilinguisme, dû à ces circonstances culturelles particulières.osonsfaireunpasdeplus:L’unilinguismeest,enfait,unedéviationdelarègle;l’unilinguisme est commeunemaladie.mais c’est, heureusement, unemaladiecontrelaquelleilyadesremèdesefficaces:l’éducationplurilin-gueetl’enseignementplurilingue.»(Lüdi2005:13)Lanotiondecompé-tenceplurilingueetpluriculturelleapparaîtdansleCadre européen com-mun de référence:«unmêmeindividunedisposepasd’unecollectiondecompétencesàcommuniquerdistinctesetséparéessuivantles languesdontilaquelquemaîtrise,maisbiend’unecompétenceplurilinguesetpluriculturellequienglobel’ensembledurépertoirelangagieràdisposi-tion».(conseildel’europe2000:129)
L’enseignement/apprentissageprécocedeslanguesétrangèresàl’éco-leprimaire(etmêmematernelle)estundesthèmeslesplusactuels.c’estaussiunedesperspectiveslesplusintéressantesdeladidactiquedeslan-

Apprentissage précoce d’une langue étrangère
385
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
83-3
93
guesvivantesetundesmeilleursinstrumentspourréaliserleplurilin-guismedontonnecessedeparler.
mentionnonsquelquesquestionsfréquentesconcernantl’apprentis-sageprécocedeslanguesétrangères:est-cequelalanguematernelleestmenacéeparlecontactprécoceavecd’autreslangues?est-cequecetap-prentissagepeutavoirdesconséquencesnégativessurledéveloppementémotionnel,socialetcognitifdesenfants?
dans les années60déjàdes équipesautourducanadienLambertontconstruitdestestsdontlesrésultatsontmontréquelesenfantsbi-lingues possédaient une flexibilitémentale supérieure, une faculté deraisonnementabstraitaccrueetplusindépendantedesmots,cequilesaidaitdanslaconstructiondeconcepts.parconséquent,onpeutatten-drequ’unenvironnementbilingue(etsipossiblebiculturel)faciliteraitledéveloppementdel’intelligence,enparticulierdel’intelligenceverbale.depuiscetemps,denombreusesrecherchesprouventquelesenfantsbi-linguesdisposentd’unefacultédepenséecréativeaccrue,imaginentplusfacilement unemultitude de réponses, ont unemeilleure compétenceanalytique,perçoiventmieuxlesfacteurssituationnelsdelacommunica-tion,obtiennentdemeilleuresperformancesdanslestestsdeperceptionspatialeetc.cesavantagesdesenfantsbilinguespourraient s’expliquerpardesexpériencesculturellesplusvariéesetparlanécessitédechoisiretd’alternerentredeuxlangues.selonvigotsky,l’enfantbilingueaunecapacitéd’abstractionaccrueetuneplusgrandefacilitéàmanipulerlescatégoriescarilestconscientdelarelativitédelagrilleconceptuelleàtraverslaquelleunelangueparticulièreverbaliselemonde.(Lüdi2005:15)Lesenfantsbilinguessontsouventpluscréatifs,plusintelligents,plusflexiblesdans leur comportementverbal etplus compétentsdans leurcomportementsocial.
mais leschosesnesontpasaussisimples,carilyaunevariétédedéfinitionsetunevariétédubilinguisme.certainsauteursdistinguentunbilinguismesimultané(lorsqu’unenfantacquiertdeuxL1avantl’âgedetroisansdansunmilieubilingue,etc’estcequ’oncomprendleplussouvent quand on parle du bilinguisme) et un bilinguisme successif(lorsqu’unenfantacquiertuneL2aprèsleseuildetroisouquatreans,leplussouventdefaçonspontanéeetnaturelledansl’interactionaveclemilieusocial;parfoisà l’aidededispositifspédagogiquesvariés) (Lüdi2005:16).d’autrespensentquecedeuxièmecasn’estpasunbilinguisme,carlesconditionsnesontpasréuniespourquel’apprenantpuissemaî-triserlalangueenseignée.(delefosse2005:47)
etc’estjustementlecasquinousintéresseparcequ’ilseréalisedansdesgroupesdejeuxauniveaupréscolaireetdansdesclassesdelangues

Vujović A.
386
formelles à l’école. cet apprentissage précoce d’une langue étrangère(certains l’appellent le bilinguisme), peut être stable et s’affermir avecl’âge.
Laplupartdesgenss’imaginentdescompétenceslinguistiquessépa-réesdanslecerveau,cequin’estpasvraicarL1etL2créentunsystèmecommun:L2seconstruitsurunebaseconstruitedans l’acquisitiondeL1. (Lüdi 2005: 17) il fautbien savoirque toutes les formesdubilin-guisme ne représentent pas automatiquement des avantages, mais cesontsurtoutlescasdesminoritéslinguistiqueshistoriquesouimmigréesoud’unenvironnementsocialdéfavorable.onnerencontrepasdecasd’enfantsquiperdentlamaîtrisedeL1(quiestenmêmetempsleurlan-guematernelleet la languede leurcommunauté,c’est-à-dire la languenationale)àcausedel’apprentissageprécoced’unelangueétrangère.cedangerexistedanslecasdeslanguesd’immigrationdévalorisées.
ilestévidentquetouslesenfantsnepeuventpasêtrenaturellementbilingues,doncilsdoiventapprendreuneL2danslecadredusystèmeéducatif.contrairementàl’acquisitionnaturelledansl’enfance,quiréus-sittoujours,l’enseignementformel,mêmeprolongé,nemènepasnéces-sairement àunebonnemaîtrisede la langue enseignée.mais les spé-cialistespensentqu’unenseignementplusprécocedonnedemeilleursrésultats.
c’estpourquoidenombreuxpays sont en trainde faireungrandeffortpourpromouvoir lemultilinguismeen introduisant lapremièrelangueétrangèredès lespremièresannéesde l’écoleprimaireetmêmeà l’âgepréscolaire.c’estaussi lecasde laserbieoù,àpartirde l’annéescolaire2003/2004(avecunepausependantl’annéescolaire2004/2005),onintroduitunelangueétrangèreentantquedisciplineobligatoirepourtouslesélèvesdelapremièreclasseduprimaire.avantcettedatedéjàlefrançaisétaitprésentàpartirdelapremièreclassedansl’écoleexpé-rimentale«vladislavribnikar»àbelgrade.danslesannées70,ceten-seignementexpérimentaldu françaisàpartirde lapremièreclasseduprimaire se réalisait dans six écoles élémentaires2, et aujourd’hui, onapprend le françaisàpartirde lapremièreclassedansquatreécolesàbelgrademais,dansunplusgrandnombred’écoles, lefrançaisesten-seignéentantquedeuxièmelangueétrangère.ilesttrèsdifficile,voireimpossible,deseprocurerleschiffresexactspourbelgrade,encorepluspourlerestedelaserbie,carlesdonnéesduministèredel’éducationnesemblentpastrèsfiablesetrécentes.Lefrançaisdisparaîtpresquedansleprimaireenvoïvodine,cequiinfluencesadisparitiondanslesecondaire
2 il s’agit des écoles «prva proleterska brigada», «Josif pančić», «siniša nikolajević»,«perapopovićaga»,«isidorasekulić»,«vladaobradović-kameni».

Apprentissage précoce d’une langue étrangère
387
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
83-3
93
etpuisaussiauniveauuniversitaire.enserbie,ilyaenviron750profes-seursdefrançais(dont400danslesecondaire)et550étudiantssurtroischairesdefrançais(àbelgrade,novisadetkragujevac).
d’après nos connaissances, le français n’est enseigné, en ce mo-ment,àbelgradequedansdeuxécolesmaternellesprivées(«zmaj»et«Čarolija»).ilyaquelquesannées,ilaétéenseignédansuneécolema-ternellepublique(«vila»),maisceprogrammeaétéannuléàcausedufaibleintérêtdesenfantsetdeleursparents.
unelangueétrangère(presquetoujoursl’anglais)faitpartieducur-susdansdenombreusesécolesmaternellesenserbie,notammentdansdegrandesvilles.eneffet,auniveaupréscolaireils’agitseulementdelasensibilisationdestoutpetitsaumultilinguismeetaumulticulturalisme.promouvoirunbilinguismeprécocenesignifienullementvouloirensei-gnerunelangueétrangèreàdesenfantsdetroisouquatreans,maislesexposeràuneautrelanguequelaleur,lesplongerdansunbainlinguis-tiqueafindelessensibiliseràl’altérité.ilestnécessairequecetapprentis-sagesefasseavecleconsentementetlaparticipationdesparentsetquel’enfant lui-mêmesoitmotivéet intéressé.puisqu’uneL2seperdaussivitequ’elleaétéacquise,pourmainteniretdéveloppercettecompétenceilfautcontinueravecsonapprentissagedèsledébutdel’écoleprimaire.
selonlesobjectifsexprimésdansdesdocumentsdelacommissioneuropéenneetduconseildel’europedatantde1996,lesélémentsclésd’unepolitiqueéducationnelleconcernantleslanguesvivantesdevraientêtrelessuivants:
–commencerplustôt,auplustardaudébutdel’écoleprimaire;–nepasviserunbilinguismemaisdesrépertoiresplurilinguesmul-tiples;renonceraumythedel’acquisition«parfaite»d’unelanguesecondeenfaveurdel’élargissementcontinud’unrépertoiremul-tipledynamique;
–créerdespontsentrelalanguematernelleetleslanguessecondesetprendrecommepointdedépartl’idéed’unrépertoireglobalàdévelopperàl’aided’unepédagogieintégréedeslangues;
–viser des compétences partielles (par exemple des compétencesoralesouécrites,decompréhensionoudeproductionseulement)quitiennentcomptedesbesoinsactuelsréelsdesapprenants;
–inclurelapréparationdesapprenantsàdifférentesformesdel’in-teractionexolingue,eninsistantsurleurautonomiepourconti-nueràapprendretoutaulongdelavie.(Lüdi2005:28)
c’estpourquoiilestindispensabledesensibiliserd’abordlesensei-gnantsetlesresponsablespolitiquesdetouslesniveaux.enfin,cesont

Vujović A.
388
les enseignants et leurs associations professionnelles, les responsablespédagogiques, lesparentset lesélèvesquiauront lederniermot.ilnefautpasnégligerl’importancedel’attitudedesparentsetdetoutelaso-ciétéenvers les languesétrangèresengénéral,etplusparticulièrementenverslalanguequel’enfantdevraitapprendreàl’école.cequisemblebienimportantestlaculturecourante,laculturecomportementaleouleculturel(dontparlerobertgalisson).cesfacteursd’ordresociocultureletpsychologiquejouentunrôletrèsimportant,surtoutpourlechoixdelalangue.
ondevraitpenserauchangementdestructuresdelaformationdesenseignantsdes languesétrangères(aussibienquedesprofesseursdesécoleshabilitésàl’enseignementd’unelangueétrangère)carlesmétho-desduprimaireetdusecondairedivergent.al’heureactuelle,lesprofes-seursdesLeneconnaissentpassuffisammentlesspécificitésdutravailaveclespetitsenfants,cequiprouvelanécessitéd’organiserlaformationcontinue régulière, avec de nombreux exemples pratiques. contraire-mentàlasituationenfrance,oùlesenseignantsduprimaireetdusecon-daireneseconnaissentpasparcequ’ilsnetravaillentpasdanslesmêmesinstitutions,enserbie lesenseignantsdesLetravaillentdans lemêmeétablissementquelesprofesseursdesécolesetcesontcespremiersqui(danslaplupartdescas)assurentlescoursdeslanguesétrangères.donc,lacoordinationentreeuxestpossibleetonpourraitmêmeenvisageruneformation continue commune. La coopérationde ces enseignants desniveauxdifférentspourraitêtrecomplémentaireetmutuellementfruc-tueuse,surtoutdansledomainedesméthodesd’enseignement,pourquel’apprenantpuisseacquérirtoutaulongdesonapprentissageunegam-medestratégiesd’apprentissagequiseraientlabasedesonapprentissagetoutaulongdelavie.
ilyaunegrandediversitédeformationspour lesenseignantsquin’ontpastoujoursconsciencedeladifficultédel’enseignementàcetâge.onpourraitseposerquelquesquestions:quelcontenuchoisir(surtoutauniveaupréscolairepour lequel lesprogrammesnationauxn’existentpas chez nous); quels objectifs voudrait-on atteindre; comment arti-culerlalanguematernelleetétrangère;commentaborderlescontenusconcernantlacultureétrangèreetl’intercultureletc.unenseignementdecetypeest lourdàgéreretrequiertbeaucoupdequalités:patience,disponibilité,ouvertured’esprit,compréhension,rigueur,dynamismeetcréativité.
Lesprogrammesdel’enseignementprécocedes languesétrangères(surtoutpourlepréscolaire),centrésplutôtsurlasensibilisation,man-quentdeprécisionetdetransparence.bienqu’ilsaimentl’approchelu-

Apprentissage précoce d’une langue étrangère
389
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
83-3
93
dique,lesenfantstrouventquel’enseignementprécocen’estpastoujourssuffisammentstructuréetsystématique.ilsaimeraientfairedesdevoirsàlamaison,maisl’exclusivitédel’oralaudébutdel’apprentissage,lapri-mautéduludiqueetl’absenced’unestructurationtraditionnelleneleleurpermettentpas.Lesparentsseplaignentdenepaspouvoiraiderleursenfantscarilsnecomprennentpaslaméthodedelasensibilisation.
Lesmatériauxd’apprentissagereflètentlaconceptionméthodologi-que.Lepointcentralrestelerôledel’écrit,lerôledel’abstractiongram-maticaleetdesconnaissancesàacquérir.c’estpourquoilesmanuelsde-vraientêtrelefruitd’unecoopérationd’enseignantsdeslanguesétrangè-res,despédagoguesetdesprofesseursdesécoles,dontlesconnaissancesconcernentsurtoutlacompétencepédagogiqueetéducative.etantdon-néledéveloppementpsychiquedel’enfant,lestroisbesoinsessentielsdechaqueenfantsont:lejeu,l’expressionphysiqueetverbaleetlaconnais-sancedesoi-mêmedanslescontactsaveclesautres.c’estpourquoil’éla-borationdesmatériauxpédagogiquespourl’enseignementprécoced’unelangueétrangèredevraitfaireattentionàceséléments,enn’oubliantpastoutcequiestdudomainedel’interculturel.(vujović2010:18)
parmilesfacteursquiinfluencentlapréparationetlaconceptiondelaleçononpourraitrelever:
–lemanuelet/oulemédia–matériauxpédagogiques;–lesméthodes–sensibiliser,jouer,oral/écrit;–les objectifs – performances cognitives/linguistiques, objectifspsychologiques-affectifsetsociaux;
–lesélèves–leursbesoins,attitudes,réactions,tendances,capacitésetcompétences,maisaussilesopinions,lesdécisionsetlesactivi-tésdesparents;
–le contenu linguistique et culturel – structures qui ne peuventpassedécrireencatégoriestraditionnellementutilisés(commelagrammaire,levocabulaireetc.);
–l’institution–sonorganisation,tradition,coopérationavecd’autresinstitutionsdupaysouàl’étranger;
–l’enseignant–sescompétences,formation,attitudes,coopérationavecd’autrescollègues;
–évaluationdesconnaissances,desaptitudes,desattitudes.pour lesenseignantsquientrentdans l’enseignementprécocesans
êtresuffisammentpréparés,ilseraitutiledaconnaîtrequelquessitesquipourraientleurservirdepointdedépart:
1. edufLe:http://www.edufle.net/rubrique41.html- cesite publieplusieursarticlesetfichespédagogiquesconsacrésàl’enseigne-

Vujović A.
390
mentdufrançaisprécoceetproposeunesélectiond’activitésetd’exercicesenligne;
2. edunet:http://www:edunet:ch/3. aupaysdescontes:http://www.contepourenfant.com/4. il était une fois (franc-parler): ttp://www.francparler.org/par-
cours/conte.htm#contesaililfautconsacrerbeaucoupd’attentionàl’élaborationdesactivitéset
destechniquesdestinéesàfaciliterl’expressionoraleet,plustard,écrite.Lesenseignantsdevraientavoirenvied’aborddelesélaboreroud’adap-tercellesquiexistentdéjàauxbesoinsdeleurpublicetàleursituationd’enseignement.ilfautcréerdessituationsquipermettraientauxappre-nantsunapprentissageintéressant,stimulantetutilepourlacommuni-cationquotidienneetpourlasuitedel’apprentissage.
pouravoirquelquesidéesàexploiterenclasseonpourraitconsulter,entreautres,lessitessuivants:
–caramaxlatortue:http://www.caramax.com/–bbc, apprentisage précoce du français: http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/en_france_all_flash.shtml
–correspondants francophones: http://www.momes.net/amis.html
–correspondants francophones avec "franceworld": http://www.franceworld.com/fw3/
–dis pourquoi papa (expliquer des expériences): http://dispour-quoipapa.free.fr/experience.htm
–encrier:http://lencrier.net–françaventure:coursdefrançaisparniveauenligne:http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html
–grandatelierdespetitspoètes:http://www.ac-nancy-metz.fr/pe-titspoetes/
–Lire,écrire,dessiner:http://www.jecris.com/sommaire.html–machinesàhistoires:http://www.clicksouris.com/machine.htm–paroles d'enfants " enfandises": http://www.enfandises.com/ac-cueil.php
–paroles.net(chansonfrancophone):http://www.paroles.net/–page des chansons populaires françaises: http://www.geocities.com/vienna/choir/7173/index.htm
–proverbes français: http://www.geocities.com/zoodesmots/pro-verbes.html

Apprentissage précoce d’une langue étrangère
391
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
83-3
93
–tibao:http://www.tibao.com/–unsouterraind'enfer(romanillustré):http://lencrier.net/usde/in-dex.htm
onpourrait penser à certaines conditions qu’il faudrait respecterpourquel’apprentissageprécocedeslanguesétrangèressoitréellementfructueuxdansuncontexteéducatifcommelenôtre:
–éviterdedemanderàunenfantdetraduired’unelanguedansuneautre,carilestpossiblequ’àcetâgel’enfantpensedanschaquelan-gueetn’apasconsciencedepasserdel’uneàl’autre;
–s’assurerd’unemaîtrisesuffisantedelalangueorale(notammentàl’écolematernelle)avantdepasseràlalectureetàl’écriture(danslesdeuxlangues).
–quandilentredanslaclassedelangueétrangère,l’enfantappar-tientàsaproprecultureetilestinfluencéparcelle-ci-ilfaudraitqu’ildeviennecapabled’ensortirpours’ouvrirversunautresys-tèmelinguistiqueetculturel.c’estpourquoiondevraitintroduiredesélémentsdelacultureétrangèredèsledébutdel’apprentissaged’unelangueétrangère,enn’oubliantpasleurintérêtpourlabonnemotivation.
–choisir la thématiqueselon l’âge, lescapacitéset lesbesoinsdesapprenants.
–créerdanslaclasseunclimatdefranchise,detoléranceetdecoo-pération.
–favoriserletravailcollectifouparpetitsgroupes,lesexercicesdesimulationetdecréativité,lesdiscussionsetleséchangesdansunecommunicationaussiauthentiquequepossible.
–insistersurlamotivationludique,sebasersurl’envieetleplaisirdejouer–lesenfantss’appliquentdavantagedansleurapprentis-sageenprenantplaisiràjoueraveclesmots,lesphrasesetlestex-tesqu’ilscréentindividuellementetcollectivement.
–toutescesactivitésimpliquentdelapartdel’enseignantunchan-gementde rôle etd’attitude. il devient avant toutunanimateur,une personne ressource – une espèce de dictionnaire ambulantquelesenfantspeuventconsulteràchaquemoment.
enguisedeconclusion:L’apprentissageprécocen’estplusmisendoute,aucontraire, il est
engénéralappréciépar legrandpublic.tout lemondeendiscute: lespédagogues,lespsychologues,lesenseignantsdeslanguesétrangères,lesparents, les apprenants.pourtant, il restedenombreusesquestionsde

Vujović A.
392
savoircommentlepromouvoir.ilestsûrquelesuccèsdecetapprentis-sagetientengrandepartieauxstructuresscolairesetàlaformationdesenseignantsquidemeureunaspectprimordialde l’initiationaux lan-gues.dansnotresystèmescolaireonseheurteàunautreproblèmequiexigedesanalysesplusprofondes–celuiduchoixde la langueétran-gèrequiseraappriseàl’âgeprécoce,maisaussiplustard.etcelaentredansledomainedelapolitiquelinguistiquedenotrepays(s’ilenexisteune!)etentrainedenombreusesquestionsauxquellesilestdifficilederépondre.quandonréfléchitàlapositiondelalanguefrançaisedansunpays(commec’étaitlecaslorsduséminaireinternational«évolutionsetperspectivesdesétudesdefrançaisetenfrançaisdanslazonebalkans/europedusud-est»quiaeulieuaumoisdemai2010àathènes),ilestindispensabledecomprendrequel’apprentissagedufrançaisauniveauuniversitaireneserapaspossiblesansl’apprentissagedufrançaisàpar-tirdujeuneâge–desécolesprimairesetsecondaires.
Bibliographie
conseildel’europe2000:conseildel’europe,Cadre européen commun de réfé-rences pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer,paris:didier.delefosse2005:J.-m.odéricdelefosse,acquisition/apprentissagedulangageetdeslangues:uneapprochesocioconstructiviste,apprentissage précoce d’une langue étrangère et bilinguisme,nantes:universitédenantes,crini,45-59.Lüdi2005:g.Lüdi, L’enfantbilingue: chanceou surcharge ?,apprentissage précoce d’une langue étrangère et bilinguisme, nantes: université de nantes,crini,11-32.morice2005:m.-a.morice,commentaiderlesélèvesàeffectuerunchoixdi-versifiédeslanguesétrangères?,apprentissage précoce d’une langue étrangère et bilinguisme,nantes:universitédenantes,crini,111-118.vujović2009:a.vujović,interkulturalnepredstaveuudžbenicimafrancuskogjezika,Pedagogija,2,beograd:forumpedagogasrbije,276-286.vujović2010:a.vujović,elementistranekultureuudžbenicimafrancuskogjezikazamlađiuzrast,inovacije u nastavi,1,beograd:učiteljskifakultet,17-26.

Apprentissage précoce d’une langue étrangère
393
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
83-3
93
Ана ВујовићУЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА МЛАЂЕМ УЗРАСТУ
РезимеНастава/учењестранихјезиканапредшколскомиосновношколскомузрастујеједна
однајактуелнијихтемаинајзанимљивијихперспективаметодикенаставестранихјезика,каоиједаноднајбољихначинадасеостваривишејезичносткојојсетежиусавременомсвету.Тојеразлогштосумногеземљеучинилевеликинапордапромовишувишејезич-ностуводећинаставу/учењестранихјезикаупрвегодинеосновногобразовања,пачакинапредшколскиниво.Дабисеовајциљмогаоостваритипотребнојенајпредаовупотре-бу схвате и прихвате читава јавност, одговорни у руководећим структурама друштва,наставници,родитељиидеца,чијаћемотивацијаувеликојмеризависитиодставањи-ховихродитеља.Имајућиувидудугорочниинтерессвојихграђана,свакадржавабимо-ралајаснодадефинишесвојујезичкуполитику.Нестајањефранцускогјезикауосновнимшколамаунекимнашимрегионима(посебноуВојводини)запоследицуимасмањенбројонихкојитајјезикучеусредњемивисокомобразовању.
Примљено: 26. 1. 2011.


395
УДКрад
Claudine PontHaute École Pédagogique du canton de Vaud, lausanne
ENTRER DANS L’ÉCRIT: RECHERCHE MENÉE EN MATerNeLLe. LorSque LeS APProcheS D’éVeIL
Aux LANGueS Se coNJuGueNT à ceLLeS De L’eNSeIGNeMeNT – APPreNTISSAGe De LA
LECTuRE. quELquES RÉSuLTATS.
danscetarticle,l’auteuredécritunerecherchemenéede2007à2009dansledomainedeladidactiquedufrançais.celle-civisaitàrepérerleseffetsd’approchesplurilinguessurl’apprentissagedufrançais,languedescolarisation, les résultats des travauxpisa sur la lecture ayant incitéeneffetàdévelopperuneréflexiond’ordredidactiquesur lespremiersapprentissagespuisqu’ilsontmisenévidencedesrésultatstrèsmoyens,danscedomaine,desélèvesscolarisésensuisse.
menéedansdixclassesduniveaupré-scolaire,cetterechercheviseàcernerlesavantagesd’uneapprocheincluanttouteslescomposantesdel’entréedansl’écritconjointeàuneperspectived’éveilauxlangues,pourl’apprentissagedelalecture.
desrésultatsd’ordrequalitatif,concernantundesdispositifsmétho-dologiquesexpérimentés,sontprésentésetmisendiscussion.
Mots-clés: enseignement-apprentissage de la lecture, approchesplurilingues,enseignementpré-scolaire,relationsfamilles-école
Propos liminairesLarechercheprésentéeci-dessousaétémenéeenétroitecollabora-
tionavecalinerouèche,professeure-formatriceendidactiquedufran-çaisàlahep1,vaud.
1. Contexteensuisse,commedanslamajoritédespaysenvironnants,lesensei-
gnantssontappelésàintervenirdansdesclassesdeplusenplushétéro-
1 haute école pédagogique du canton de vaud, institut de formation des professeurs desecolesetdesprofesseursdusecondaire.

Pont C.
396
gènes,enparticulierauxniveauxlinguistiqueetculturel.cesdixderniè-resannées,danslecantondevaud2parexemple,lapopulationscolaired’origineétrangèreaaugmentéde8%,passantde22,4%en2000à30,1%en2009(scris,dgeo,2009).Lesenjeux liésàcetteréalitétouchentplusieurs champs: social, linguistique (candelier, 2003), voire éthique(gieruc, 2007) et institutionnel (moreau, 2004). ainsi, des questionsaussidiversesquecelledelaplaceaccordéeparl’écoleàunepartimpor-tante-lalangueetlaculture-del’identitéd’uneforteminoritédesesélèvesoucelledel’efficacitédusystèmescolaireontàtrouverréponse.
L’uer(unitéd’enseignementetderecherche)«didactiquedufran-çais»delahepducantondevaudarécemmentréalisédeuxrecherchessurleseffetsdesapprochesplurilinguesdansl’apprentissagedelalanguedescolarisation.uned’entreellesconcernelesélèvesde5-6ans«L’entréedanslalecturedetouslesélèves»etl’autrelesélèvesde8-10ans«réflé-chiràlalanguedel’écoleens’appuyantsurleslangues».
entoiledefonddelaprésenterecherche,deuxaspectsdupaysagescolairesontconvoqués,àsavoirlapriseencomptedeladiversitélin-guistiquedanslestextesofficielsainsiquelesconséquencesdesrésultatsde l’étudepisa.notre pratique de formatricea constitué la troisièmemotivationpourlamiseenplacedecetterecherche.
1.1. la prise en compte de la diversité linguistique dans les textes officiels en1998,lerapport«conceptgénéralpourl’enseignementdeslan-
guesensuisse»rédigéparungrouped’expertsàlademandedelacdip-conférencesuissedesdirecteurscantonauxdel’instructionpublique-,aposélesfondementsd’unenouvelleapprochedel’enseignementdeslanguesensuisse.pourlapremièrefois,lespréoccupationsliéesàl’en-seignementdelaL1etdesL2scolairesainsiqu’àlapriseencomptedeslanguesdelamigrationentraientenrésonancedansundocumentoffi-ciel.
reprenantlesconclusionsdecerapport,laciip3,danssadéclara-tiondu30janvier2003,aarrêtéuncertainnombredeprincipesetdethèsesd’applicationpromouvantenparticulier ledéveloppementd’ap-prochesplurilinguesdans l’apprentissagede la languede scolarisationauxniveauxpréscolaireetprimaire.plusrécemment, ledocumentré-digéà l’intentiondes enseignantsdesuisse romande, «enseignement/apprentissagedufrançaisensuisseromande»(ciip2006)mentionnela
2 La confédération helvétique comprend vingt-trois cantons; vaud est un des quatrecantonsfrancophones.
3 conférenceintercantonaledel’instructionpublique.

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
397
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
réalitédeladiversitélinguistiqueainsiquel’importancedelaréflexionsurlalangue.demême,leper-pland’etudesromand-(ciip2010)inclutles«approchesinterlinguistiques»commechampd’activitédeladisciplinedufrançais.
1.2. les études PIsaLesrésultatsdelarecherchepisa2000ontmisenévidencedesré-
sultatstrèsmoyensenlecturepourlesélèvesdesuisse.ilsontégalementrappelé la corrélation existant entredesdifficultésd’apprentissagedesélèvesetdeuxvariables,à savoir l’appartenanceàunecatégoriesocio-professionnellepeuélevéeetuneorigineculturelleetlinguistiqueétran-gère,lecumuldesdeuxfacteursaccroissantbienévidemmentlesrisques(rosenberg2003:7).
Leconstatd’uneréussitedifférenciéeselonl’originelinguistiquedesélèvesestégalementpointépardaeppenetal.(daeppenetal.2009)quirelèventquelesélèvesfrancophonessontproportionnellementplussou-ventpromusencyp24quelesallophones-selonlesannées,lapropor-tiondesélèvesallophonesmaintenusencyp1estjusqu’àtroisfoisplusélevéequecelledesélèvesfrancophones-sanspourautantétablirquelalanguematernelleconstituel’obstaclemajeuràlapromotionscolairedesélèves.
2. Cadre théorique: deux domaines concernéspuisqued’unepart,laréussitedel’apprentissagedel’écritestunpré-
dicteurreconnuduparcoursscolaireetlesenseignantsassurantl’ensei-gnement/apprentissagede la lecturedoiventcomposeravec l’ensembledes facteurscognitifs,sociauxetculturelsconvoquésdanscetappren-tissageetque,d’autrepartl’écoleapourmissiondeprendreencomptelaréalitélinguistiqueetculturelledetouslesélèvesquiluisontconfiés,notrecadrethéoriqueseradouble:goigoux(goigoux1998)principale-mentpourlescomposantesdel’apprentissagedelalectureetcandelier(candelier2003)ainsiqueperregauxetal.(perregauxetal.2004)pourceuxliésauxapprochesplurilingues.
4 correspondancestructuresvaudoises,structuresfrançaises:cin(cycleinitial)=msetgscyp1(cycleprimaire1)=cpetce1cyp2(cycleprimaire2)=ce2etcm1

Pont C.
398
2.1. entrer dans l’écrit: travailler plusieurs composantes La lectureestunprocessus interactif,ceconstatestunanimement
reconnupar les chercheurs (giasson2000;goigoux1998). il importedonc,pourenseignerlalecture,deconnaîtrelesgrandeslignesdupro-cessus.
2.1.1.modèlederolandgoigoux«aucuneétudecomparativedesméthodesdelecturen’ajamaisdon-
néderésultatspermettantd’affirmerlasupérioriténettedeteldispositifméthodologiquesurtelautre.nonpasquetouteslespratiquessevalent,bienaucontraire,maisparcequelaseulevariable«méthode»,tropgros-sièreetmaldéfinie,n’estpasunevariablepertinente«(goigoux1998:84).partantd’uneanalysedespratiqueseffectivesdesmaîtres,goigouxconstate que «lesmodalitésd’enseignementdu systèmede correspon-dancegrapho-phonologiqueneconstituentqu’unepetitepartiedesca-ractéristiquespermettantd’opposerentreellesdiversesapprochesmé-thodologiques»(ibid.).ilfondedèslorssonmodèlesurquatrecompo-santesissuesdesprincipauxcontrastesmisenévidenceparl’observationdespratiquesdesenseignants:
–ladynamiqued’acculturationàlalangueécrite;–l’acquisitiondesdifférentesprocéduresd’identificationdesmots;–lacompréhensiondestexteslongs;–laproductiondetextes.Lesquatrepôlesdumodèlefonctionnentensynergie,cequideman-
deàl’enseignantd’élaborerdesséquencesd’apprentissageéquilibréesetcomplémentaires concernant lesmots, les textes et lesœuvres tant auniveaudelalecturequedelaproductiontextuelle.
iln’yapasderéponseuniverselleàlaquestiondel’enseignementdela lecture.chacundes ingrédients delafigure1entredans lacompo-sitiondecetapprentissageetc’estàl’enseignantdedoserlemélangedemanièreéquilibrée.pourgiasson:
dansuneapprocheéquilibrée, l’enseignant respecte le rythmedesenfants,choisitlessupportsdelectureappropriés,intègrelessituationsdelecturefonctionnelleetlessituationsd’enseignementexplicite,alternelessituationsdecommunicationetlesmomentsdestructuration.pourgéreruneapprocheéquilibrée,l’enseignantdoitpouvoircomptersursacompétenceprofessionnelle,quiluipermetdejugerdelameilleurefa-çonderépondreauxbesoinsdesélèveseuégardauxconnaissancesac-tuellesenmatièred’enseignement-apprentissagedelalecture.(giasson2004:30)

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
399
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
2.1.2.apprentissagedel’écritenL2dans un environnement linguistiquement hétérogène, un facteur
additionnelestàconsidérer:pourdenombreuxélèves,l’écritsedéclinedansuneautrelanguequecelledelafamille.perregaux(perregaux1994)ydécèleunobstacleauxcausesessentiellementsymboliquesetposelaquestionducoûtpsychiquedecetteacculturation.eneffet,lesapprentis-sagesenrelationaveclalanguesedistinguentdeceuxd’autressavoirsencelaqu’ilsimpliquentfortementdesfacteurssocio-affectifsetculturels,facteursqui affecterontdemanièredéterminante laqualitéde cet ap-prentissage.acesujet,castellotietmoore(castellotietmoore2002:12)soulignentl’importancedesreprésentationssocialesdeslanguessurlesapprentissageslangagiersetn’hésitentpasàreconnaître«unrôlecentral,danscesreprésentations,pourlalangue-culturesourcedesapprenants,celle-ciconstituantenquelquesortelemètreétalonaumoyenduquellesautreslangues-culturesserontappréhendées». danscetteperspective,lalégitimationdelaL1desélèvesallophonesdevientunpré-requispourtoutenseignementefficacedelalanguescolaire.cainetdepietro(cainetdepietro1997)parexemplesoulignentl’existencedesliensentrelesreprésentations et lamotivationde l’apprenant.de son côté,armand(armand2008:72)relèvequelanon-reconnaissancedelalanguedelaL1del’élèvepeutsetraduireparune«insécuritélinguistique»,unsen-timentdediscrimination,unebaissedel’estimedesoi,ainsiquepardesdifficultésàtransférerdesacquiscognitifsetlangagiersd’unelangueàl’autre.
Figure 1. Composantes de l’apprentissage de la lecture selon goigoux (goigoux 1998)

Pont C.
400
2.1.3.unedoubleacculturationpourgoigoux (goigoux 2004: 41), l’acculturation définie comme
le travail d’appropriation et de familiarisation avec la culture écrite,sesœuvres,sescodeslinguistiquesetsespratiquessocialesestunedesconditionsnécessaires à l’apprentissagede la lecture chez tous les en-fants.cependant,pourl’enfantallophone,ceprocessussedoubled’uneautre forme d’acculturation, au sens anthropologique: celle de l’entréedansl’écritdansunelangueautrequecelledesafamille.Latransgressionsymboliqueque représente l’acculturationdansune tierce languen’estpas exemptede risques et peut, dans certains cas, générer sentimentsd’infériorité, angoisse, agressivité et désinvestissement scolaire (abou1981;berry 1989).comme le soulignenicolet (nicolet 2003), la res-ponsabilitédesenseignantsestdoncengagéedansledéveloppementdeliensentrelesapprentissagesscolairesetl’histoirepersonnelleetsocialedesélèves.relevonsquecettedoubleacculturationconcerneégalementenpartielesélèvesfrancophonesdontlemilieuestpeufamiliariséàlaculturedel’écrit.
2.2. l’Éveil aux languescetteapprocheestunedesquatreentréesdes«approchesplurielles
deslanguesetdescultures»5quitoutesmettentenœuvredesactivitésd’enseignement-apprentissageimpliquantàlafoisplusieursvariétéslin-guistiquesetculturelles(candelier2007).Lesapprochesd’eveilauxlan-guesquiontprisleurracineengrande-bretagnedanslesannéesqua-tre-vingtssedéclinentdedifférentesmanièresd’unpaysàl’autre:eoLe(éducationetouvertureauxlanguesàl’école)ensuisse,evLang(éveilauxlanguesàl’écoleprimaire)enfrance,eLodiL(éveilaulangageetouvertureà ladiversité linguistique)aucanada.ellespoursuiventce-pendant toutes lesmêmes objectifs: le développement de représenta-tionsetd’attitudespositivesfaceàladiversitélinguistique,lamotivationàapprendreleslangues,ledéveloppementd’aptitudeslangagièresetmé-talangagièresetl’acquisitiondesavoirssurleslangues(candelier2003).elless’adressentà l’ensembledesélèves,queceux-cipossèdentuneouplusieurslanguesautresquecelledel’écoleetnesesubstituentdoncpasàl’enseignementdeslanguesmaisl’accompagnent.cesapprochespeu-vent constituerune réponsepossible auxcaractéristiquesparticulièresliéesàl’entréedansl’écritpourlesélèvesallophones(cf.points2.1.2.et2.1.3.)
5 Les trois autres entrées sont «l’approche interculturelle», «la didactique intégrée deslangues»et«l’intercompré-hensionentreleslanguesparentes».

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
401
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
2.2.1.articulationformation/recherchedanslecadredeleurformationd’enseignantsauxcyclesprimaires,
lesétudiantsdehepdoiventélaboreretexpérimenterdans leurstagedesactivitésincluantlesapprochesd’eveilauxlangues,lesobjectifspou-vantenêtreaussibiend’ordrelinguistiquequesociolinguistique.avecconstance,depuisplusieursannées,lesobservationsdesétudiantssouli-gnentl’apportdecespratiquesencequiconcerneenparticulier:
–l’éveildel’intérêtpourleslangues- […] ils sont attentifs à des points que nous travaillons en
français.nousexerçonslescaractéristiquesdusingulieretduplu-rielenfrançaisetcesontdesélémentsqu’ilsremarquentdanslesautres langues.nous observons que les élèves développent uneobservationpluspointuede leur langue. (étudiante en stageencyp1,2006)
- ilsontmêmeapportédesdocumentsbilinguesenclasse…(étudianteenstageencin-cycleinitial-,2007)
–lacollaborationaveclesparents- […] j’ai pu travailler une collaboration avecdeuxmamans
étrangères(étudianteenstageencyp1,2004)–lavalorisationdeslanguesprésentesdanslaclasse
-depuiscetteactivité, lesélèveséchangent trèssouventdesmotsdansleurlangued’origine;ilslesapprennentàleurscama-rades,leurenexpliquantlesensetlaprononciation.Jusqu’alors,certainsélèves,principalementalbanophones,refusaientdepar-ler leur languematernelle à l’école. (étudiante en stage encin,2004)
–lamotivationdesélèvespourl’apprentissage- J’ai surpris maintes fois les élèves reprendre en chœur la
chanson(frèreJacquesenplusieurslangues),notammentsurlestrajetsquenousavonsfaitsàpied.danscesmoments,ilsenchaî-naientlestroisversions.Lorsdel’apprentissagedelaversionan-glaise, l’élèveanglophoneaétémisàcontribution; ilm’aaidéeàl’apprendreàsescamarades.(étudianteenstageencin,2007).
3. hypothèse de recherchea notre connaissance, une seule recherche (armand 2008) a été
conduitedansuneperspectiveplurilinguepourl’entréedansl’écrit,suruneduréedecinqmois.constatant,d’unepart, l’importancede l’effet«durée» (armand 2008; candelier 2003) et connaissant, d’autre part,l’étatdelarechercheentermesdedémarchesefficacespourl’entréedansl’écrit,nousavonschoisidemenercetterecherchedurantdeuxans,danslecycledestoutpremiersapprentissages.pour l’enseignement/appren-

Pont C.
402
tissagedelalecture,outrelesactivitésliéesauxdémarchesd’eveilauxlangues,nousnoussommesinspiréepartiellementdumodèledegoi-goux(goigoux1998)toutentraitantlesdeuxvoletsdel’acculturation(cf.point2.1.1.)
Laquestionderechercheétaitlasuivante:quels sont les effets sur l’apprentissage de la lecture-écriture, de
démarchesd’eveilauxlanguesmenéesdurantdeuxansaupré-scolairelorsqu’ellesprennentencomptelesdimensionslinguistiquesetsociolin-guistiques?
3.1. Dispositif méthodologiquecette recherche-action s’est déroulée dans dix classes du cin du
cantondevaudsynthèsedudispositifméthodologique(voirci-dessousledétaildu
tableau)population cin/1
–cinqclassesexpérimentales(38élèves)–cinqclassestémoins(42élèves)
durée août07-Juin09activités huitséquencesd’enseignement-apprentissagedans
uneperspectiveplurilinguehuit«sacsd’histoires"
collectededonnées
elèves:pré-tests(automne07);post-tests(juin09)–domainesd’investigation:connaissancesliéesàlalectureetrelationsauxlangues(représentationsetsa-voirs)
enseignantes:–fiche-bilanautermedechaqueséquenced’ensei-gnement-apprentissageetdechaquepassagedu«sacd’histoires»–entretiensemi-dirigéenjuin09
parents:–commentairesinscritsdansun«Livred’or»lorsdechaquepassaged’unsacd’histoires–réuniondeparentsautermedel’expérience,danschacunedesclassesayantparticipéàlarecherche

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
403
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
3.1.1.collectededonnées
pourlespré-tests,àlarentréescolaire2007,touslesélèvesontpar-ticipé à des pré-tests portantnotamment surdes aspectsmétaphono-logiques(reconnaissancedelarime,catégorisationdemotsetdenon-mots),surlaconnaissancedeslettresetlalecturedemotsainsiquesurlaconnaissancedulexique(wppsi)6
enjuin2009,unedeuxièmepassationaétéréalisée,enrichied’itemsconcernantd’unepartlacapacitédesélèvesànommerlalanguecom-munescolaireainsiquecellesutiliséesdanslesfamillesetd’autrepartdequestionstouchantl’ouvertureàladiversitéetlesreprésentationssurleslangues.
3.1.2.Lesactivités:desséquencesd’enseignement-apprentissagedel’écritetdessacsd’histoire
3.1.2.1. séquences d’enseignement/apprentissageaunombredehuit,cesséquencesontétéconçuespourpoursuivre
conjointementlesobjectifsliésauxapprochesplurilinguesetàceuxdel’apprentissage.ellesontététravailléesenmoyenneàraisond’uneheurehebdomadairependantlesdeuxannéesducycle.nouschoisissonsmal-grélecaractèreunpeuartificieldeladémarche,dedéclinerl’ensembledesobjectifsséparément,enrelationd’unepartavec lesobjectifsvisésparlesapprochesd’eveilauxlanguesetd’autrepartavecceuxassignésauxapprentissagesdel’écrit,dansleper7(ciip2010).
objectifsd’apprentissagepoursuivisdansleshuitséquencesd’ensei-gnement(axe entrée dans l’écrit)
–mémoriserlesprénomsdescamarades–écriresonprénom–chanterunchantouréciterunecomptine–classerlesimagesd’unerecettedansl’ordrechronologique–produireuntextebrefàpartirdesimagesd’unerecetteenutilisantlelexiqueapproprié(dictéeàl’adulteoutextederéférence)
–saisirlesressemblances/différencesentredesmessagespictogram-miquesetdesmessagesécrits
–identifierlesrimesetlessyllabesd’attaque–rédigerdesphrases,dansunalbum,pour légenderdes illustra-tions
6 wechslerpreschoolandprimaryscaleofintelligence7 per:pland’étuderomand.

Pont C.
404
–copierunecomptineouunchantdanssaproprelangue.– Joueravecdes sonsdansdifférentes languesafinde favoriser ledéveloppementdelaconsciencephonologique
objectifsd’apprentissagepoursuivisdansleshuitséquencesd’ensei-gnement(axe Éveil aux langues)
–sesaluerdansdifférenteslangues–associerlesdifférenteslanguesdelaclasseauxélèves–écrireun«bonjour»danschacunedeslanguesdelaclasse–classerleslanguesdelaclasseparfamille– reconnaître une comptine chantée dans une des langues de laclasse
–reconnaîtreunénoncédansunedeslanguesdelaclasse–apparierlesénoncésdesystèmesgraphiquesdifférents–représentergraphiquementlamultiplicitédesfamillesdelangues–nommerquelqueslanguesdelafamilledeslanguesromanes–réciterunecomptineenplusieurslangues
3.1.2.2. Huit «sacs d’histoires»
Les «sacs d’histoires», projet initié en grande-bretagne puis dé-veloppéparmontréal, encouragent ledéveloppementd’activitésde li-téracieen famille.cedispositifdont lesobjectifs sedéclinenten troispoints-légitimationdeslanguesprésentesenclasse,développementdel’axe «acculturation», encouragement des liens école-parents - permetdeviser«l’étayageréciproquedesapprentissageslinguistiquesdansdescontextesplurilingues»(perregaux2006:27).danscetterecherche,ilseprésentesouslaformed’unsaccontenantunlivrebilinguefrançais/unedestreizelanguesreprésentéesdanslessixclassesdugroupeexpérimen-taletdetroisjeux,créésparlesenseignantes,enrelationavecl’ouvrage8.L’albumestdansunpremiertempsluenfrançaisenclasse,puislesaccirculedefamilleenfamille.
4. Résultatsdesdonnéesqualitativesontétéanalyséesautermedelapremière
annéepuisde la secondeannée.elles concernent levolet«sacsd’his-toires»,àpartirducorpusdesréactionsdeparentsrecueilliesdansles
8 dansleconceptinitial,uncddel’histoiredansleslanguesdelaclasseestinséré.pourdesquestionsdetempsetdefinances,nousyavonsrenoncé.

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
405
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
«Livresd’or»ainsiquedeceluidesfiches-bilancomplétéesparlesensei-gnantes,aprèschaqueséquence(huitautotal).d’autresdonnéesquanti-tativessontencoursd’analyseetneferontpasici,l’objetd’unecommu-nication.
4.1 enseignantespourlespremiers«sacsd’histoires»,lesréactionsdesfamillesontété
contrastées:lesmilieuxfamiliersdel’écritontd’embléeadoptéladémar-chealorsquedansdescontextesmoinsfavorisés,l’intérêtaétémoindre.uneévolutions’estcependantdessinéedanscesmilieux,aufuretàme-suredudéroulementdel’expérienceetautermedelasecondeannée,les«sacsd’histoires»étaientexploitésdanstouteslesfamilles.
Lesenseignantesrelèventégalementunecollaborationvivifiéeaveclesparentsqui,pourcertains,sontintervenusenclassepourprésenterl’universcultureldeleurenfant.
troisièmeconséquence,enrelationaveclesdeuxvoletsdudispositifméthodologique,uneconnaissanceaccrue,parlesenseignantes,duni-veaudelaL1deleursélèvesainsiquedesconnaissancessurleslangues,delapartdetouslesélèves:«J’aimerai le livre en français et en espagnol, la langue de Juan».
4.2. Parentsdenombreuxparentsontcomplétéles«Livresd’or»etplusdedeux
cents témoignagesont été consignés entre2007 et 2009.ce rituel surdeuxansapermisd’installerdeshabitudesetl’analysefinedelaprove-nancedescommentairesmetenévidenceunintérêtgénéraldesfamilles,toutes classes sociales et langues confondues.«evan est arrivé en cou-rant avec le sac; il est toujours content». «Merci, avec l’espoir de recevoir encore une autre histoire!». «Nous n’avons pas trouvé le cahier pour les commentaires et gaspard a demandé: -est-ce que la maîtresse sait que c’est si chouette?-».
Lestémoignagesdesparentspermettentdedocumenterdesconstatsdanstroischampsdistinctsquesont
a)larelationàlaL1b)l’intérêtpourleslanguesc)ledéveloppementdeliensdeplusieursordres.a)larelationàlaL1:ducôtédelaL1,dèslespremiersmois,despa-
rentsattestentdudéveloppementdecompétencesdanslalangued’ori-gine«Kim et moi avons trouvé cette histoire très tendre et ça a été un bon exercice pour elle étant donné que son papa est espagnol et qu’elle entend

Pont C.
406
souvent parler espagnol à la maison. elle a découvert de nouveaux mots qu’elle ne connaissait pas. Merci!». La deuxième année, à la faveur dudéveloppementdel’écrit,chezlesélèves,apparaissentdestémoignagesattestantd’écritsdans la langued’origine:«les jeux ont beaucoup plu à eleonora, surtout celui où il faut reconstituer le titre. elle a ainsi aussi appris à l’écrire en italien». c’estdurantlasecondeannéequ’apparaîtim-plicitementchezlesparentslaprisedeconsciencedelalégitimitédelaL1,ycomprisdansleséchangesaveclesenseignantes.ainsi,plusieurstémoignages bilingues (français/espagnol, français/serbo-croate, fran-çais/portugais,français/allemand)sontrédigés.
b) le développement de l’intérêt pour les langues: ce résultat déjàabondammentdocumentédansd’autres recherches,n’est pasune sur-prise:«C’est avec étonnement que j’ai constaté que Chloé avait choisi l’his-toire en italien alors que personne ne parle cette langue chez nous. l’esprit d’ouverture est acquis, je pense!», «Killian aime beaucoup entendre les lan-gues de ses copains de classe».
c)ledéveloppementdeliens:troisgenresdelienssontfréquemmentévoqués: les liens tissés avec les origines linguistiques familiales «un joli moment de jeu avec l’arrière-grand-mère d’origine zurichoise. Merci beaucoup», lesliensintra-familiaux«J’ai beaucoup aimé les jeux avec mes deux grandes sœurs» «Toute la famille a participé et nous avons bien aimé l’histoire sur la fabrication du pain» etlesliensécole-famille«Nous vous remercions infiniment de pouvoir introduire l’espagnol à l’école» «merci de nous donner à partager des jeux interactifs qui permettent en jouant de travailler un peu avec eux».
5. Discussion des premiers résultats d’ordre qualitatifLesrésultatsprésentés,rappelons-leneconcernentqu’undesvolets
dudispositifméthodologique les «sacsd’histoires» en relationprinci-palementavecl’axe«acculturation»ou«projetdelecteur»dumodèledegoigoux.ilsappellentquelquescommentaires:
1. silesliensentrelareprésentationsocialedeslanguesainsiquesesconséquencespourl’élèvesontenrelationaveclesappren-tissageslangagiers(castellotietmoore2002;depietroetcain1997)onespère,àterme,uneffetdesapprochesplurilinguessurl’apprentissagedelalecture.
2. sil’interdépendanceentreL1etL2(cummins2001)estavérée,ledéveloppementdescompétencesde laL1relevépar lesen-seignantesetpar lesparentsbénéficieraà l’apprentissagede lalecture.

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
407
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
3. s’ilestdifficiled’évaluerl’impactréeld’unerelationfructueusefamille/école sur lamotivationà l’apprentissagedesélèves,onestendroit,paranalogieà larelationthérapeutiquedansuneperspectivesystémique,d’envisageruneffetbénéfiquedecelle-ci.
4. si, comme le relèventarmand et al. (armand et al. 2008), lestatuthiérarchisédes langues et ladévalorisationde certainesd’entreellespeuventrendredifficilelerapportdesélèvesentreeuxetconséquemment lagestionde laclassepar l’enseignant,l’attentionportéeaupluralismeetlareconnaissancedelalanguedes élèves -marqueur identitairemajeur -pourraient faciliterlesapprentissages.
6. ConclusionLadémarcheprésentéereposesurl’immersiondel’équipederecher-
chedanslaréalitééducativeetsurunva-et-viententreapprochesthéori-quesetpratiques.concernantlesélèves,lespremiersrésultatsindiquentque laprise en comptedes languesde la classe valorisant chacun, estpropiceauxapprentissagesetsoutient l’acceptationdesdifférences.encequiconcernelesparents,lapratiquedes«sacsd’histoires»permetdenouerune relation renforcéequipromeutunebonne communicationdanslepartenariatfamille-école.
Letémoignaged’uneparticipanteàlarecherche,confirmelespers-pectivespropresàlarecherche-actiondanssesdimensionsdeproduc-tiondeconnaissancesetdechangementsdelaréalitéparl’action:«J’aiunemeilleurevisiondecequipeutêtrefaitaprèsl’avoirvécuetpartagéavecd’autresenseignantesetd’avoirpleind’outilspourcontinuercetteexpérience.».
Bibliographie
abou1981:s.abou,l’identité culturelle, paris:anthropos.armand2008:f.armand,entrerdansl’écritencontexteplurilingueetdéfa-vorisé:développerlescapacitésmétaphonologiquesetsensibiliseràladiversitélinguistique,in:The Canadian Modern language review/la revue canadienne des langues vivantes,vol.65-1,toronto:pressesdel’universitédetoronto,61-87.armandetal.2008:f.armand,d.dagenais,L.nicollin,Ladimensionlinguis-tiquedesenjeuxinterculturels:del’eveilauxlanguesàl’éducationplurilingue,in:Éducation et francophonie, xxxiv-1,montreal:aceLf,177-196.

Pont C.
408
candelier2003:m.candelier(dir.),l’éveil aux langues à l’école primaire. evlang: bilan d’une innovation européenne,bruxelles:debœck.candelier2007:m.candelier(dir.), CaraP, Cadre de référence pour les appro-ches Plurielles des langues et des Cultures,strasbourg:centreeuropéenpourleslanguesvivantes.castellotti,moore2002:v.castellottietd.moore,Représentations sociales des langues et enseignement,strasbourg:conseildel’europe.cain,depietro1997:a.cain,etJ.-f.depietro,Lesreprésentationsdespaysdontonapprendlalangue:complémentfacultatifoucomposantedel’appren-tissage?,in:les langues et leurs images,neuchâtel:irdp,300-307.cdip1998:Concept général pour l’enseignement des langues en suisse,bern:cdip.ciip2003:déclaration de la CiiP relative à la politique de l’enseignement des langues en suisse romande du 30 janvier 03,neuchâtel:ciip.ciip2006:enseignement/apprentissage du français en suisse romande, orienta-tions,neuchâtel:ciip.ciip2010:Plan d’études romand, neuchâtel:ciip. cummins2001: J.cummins,language, Power and pedagogy. Bilingual Chil-dren in the Crossfire, new-york:multilingualmatters.daeppenetal2009:k.daeppen,g.gieruc,p.ricciardiJoos,analyse et évo-lution des décisions de fin d’année, du CIN au degré 9, en 2005-06 et 2006-07, Lausanne:ursp.giasson2000:J.giasson,la compréhension en lecture, bruxelles:deboeck.giasson2004:J.giasson,etatdelarecherchesurl’interventionauprèsdeslec-teursendifficulté,in:revue des HeP de suisse romande et du Tessin. N°1. neu-châtel:cdhep,27-35.gieruc2007:g.gieruc,quelle place pour l’allophonie et la diversité culturelle à l’école?, Lausanne:ursp.goigoux1998:r.goigoux,oùilestquestiondepratiquesetdeméthodesdelecture,in:Voies libres N°2, paris:nathan,48-59.goigoux2004:r.goigoux,méthodesetpratiquesd’enseignementdelalectu-re,in:revue des HeP de suisse romande et du Tessin. N°1. neuchâtel:cdhep,37-56.moreau2004:J.moreau,Compétences et facteurs de réussite au terme de la sco-larité, analyse des données vaudoises de PIsa 2000, Lausanne:ursp.nicolet2003:m.nicolet,processusen jeudans lamiseenmargescolaireetsocialedesélèvesmigrants, in:Le parcours scolaire et de formation des élèves immigrés à «faibles» performances scolaires,berne:cdip,34-41.perregaux1994:c.perregaux,les enfants à deux voix, des effets du bilinguisme sur l’apprentissage de la lecture,berne:peterLangs.a.perregauxetal.2003:c.degoumoëns,d. Jeannot, J.-f.depietro,c.perre-gaux,Éducation et Ouverture aux langues à l’ecole, neuchâtel:ciip.

Entrer dans l’écrit: recherche menée en maternelle
409
Nasl
e|e 19
• 2011 • 3
95-4
09
perregaux2006:c.perregaux,Les sacsd’histoires: commentdévelopperdespratiqueslittéraciquesbilinguesentrel’écoleetlafamille,in:Interdialogos, 1/06,Lachaux-de-fonds:associationinterdialogos,27-29.rosenberg2003:s.rosenberg,unproblèmequidepuis longtempsattendsasolution,in:le parcours scolaire et de formation des élèves immigrés à «faibles» performances scolaires,berne:cdip,7-11.scris,dgeo.recensementscolaire(documentnonpublié).
Клодин ПонУЧИТИ ПИСАЊЕ: ИСТРАЖИВАЊЕ СПРОВЕДЕНО У
ОБДАНИШТУ. КАДА СЕ ПРИСТУПИ ЈЕЗИЧКОГ БУЂЕЊА УДРУЖЕ СА ПРИСТУПИМА ПРЕДАВАЊА – УЧЕЊА
ЧИТАЊА. НЕКОЛИКО РЕЗУЛТАТА. Резиме
Уовомчланкуауторкаописујеистраживањеспроведено2007-2009.годинеудоменудидактикефранцускогјезика.Онојеималоциљдаодредиучинкевишејезичнихпристу-панаучењефранцускогјезика,језикашколовања,будућидасурезултатирадоваpisaочитањуподстакли,уствари,дасеразвиједидактичкоразмишљањеонајранијимучењи-ма,поштосуонапоказалаосредњерезултатеученикакојисешколујууШвајцарској.
Спроведеноудесетразредапредшколскогузраста,овоистраживањеимациљдапо-кажепредностиприступакојиукључујесвекомпонентезапочињањаписањапридодатогперспективијезичкогбуђењарадиучењачитања.
Квалитативнирезултати,којисеодносенаједанодиспитиванихметодолошкихди-спозитива,овдесупредстављениипродискутовани.
Примљено: 09. 02. 2011.


411
УДКрад
[email protected]@unil.ch
Yves Érard, Thérèse JeanneretÉcole de français langue étrangère, université de lausanne
Du JouRNAL DE SÉJouR CoMME JEu De MIroIr DANS L’APPreNTISSAGe D’uNe
LANGue éTrANGère
danscetarticle,noustraiteronsdelamanièredontdesétudiant(e)s non francophones vivant et étudiant à Lausanne, ville francophone,parlentdeleursdifficultésàcomprendreetàdonnersensàdesexpres-sions ou à des expériences culturelles qu’ils rencontrent dans leur viequotidienne.ennousappuyantsurcequ’ils racontent,nous tenteronsdecaractériseretdedéfinircequereprésententlesexpressions«jecom-prends»et«jenecomprendspas»énoncéesparunepersonneétrangèreàunelangueetàuneculture.nousmontreronsquelacompréhensionestunprocessusdialogiqueouinteractionnel,qu’elleestmiseenœuvreenétantadressée(enl’occurrenceàunenseignant)etqu’elleentraînesondestinatairedansleprocessus,l’amenantàregarderavecd’autresyeuxsapropreculture.
dans une deuxième partie, nous verrons que l’incompréhensionpeutêtreentenduecommeunenon-appartenanceàunecommunautélangagière.
dansunetroisièmepartie,nousverronsquel’enseignantn’apasunecompréhensiontransparentedesaproprecommunautélangagière,ques’il est unmédiateur pour aider un(e) étudiant(e) à être compris, lui-mêmepeut apprendrequelquechose sur sapropre langueet,partant,surlui-même.
Lesdonnéessur lesquellesnousnousappuieronssont issuesd’uneactivitéécrite(rédactiond’unefiched’observation)liéeàunjournaldeséjourproposéeparunenseignantdefrançaislangueétrangère.
Mots-clés:compréhension,socialisationlangagière,usage,pragma-tisme
1. Arrière-plan théorique de l’étudehistoriquement la didactique des langues étrangères a identifié deuxtypesdecontextedanslesquelslalangueétrangèreétaitapprise:lami-grationetl’école,end’autrestermesonaschématisélesconditionsd’ap-prentissageen«naturelles»ouaucontraire«scolaires».Lamigrationim-

Érard Y., Jeanneret T.
412
pliquaitl’apprentissagedelalanguelàoùelleétaitparlée,parlecontactaveclasociété,letravailetdanscertainscas,l’intégrationsociale.L’écoleimpliquaitl’apprentissagedelalangueloindel’(des)endroit(s)oùelleétaitparlée,parunenseignementfondésurdesexplicationsetdesexer-cices, le cas échéant sur des tentatives de reproduction en classe desconditionsdel’apprentissage«invivo».cettevisionréductriceaétépro-gressivementdéconstruiteàpartirdesannées80.unedescontributionsfondamentalesauxréflexionssurlescontextesd’apprentissageestdueàdabène(1994)qui,enproposantlesdénominationsdecontexte homo-glotteouhétéroglotte1pourdésigner lestatutde la langueàapprendre(languedu lieudans le contextehomoglotte) apermisdedissocier letyped’apprentissage(guidéounonguidé)et lecontextedans lequel ils’opérait:dansunlieuoùlalangueétaitparléeseule,parléeàcôtéd’uneautre,seulementprésente,totalementabsente,etc.
La question desmodes d’apprentissage (conscient vs inconscient,explicitevs implicite)mis enœuvredans les situationsoù l’apprentis-sageestguidéounonguidéaétéamplementdiscutéedanslecontexte,notamment,deladistinctiondekrashen(1985)entreacquisitionetap-prentissage.dans l’acquisition, lesprocessus sont inconscientset sous-tendusparlanécessitédelacommunication;ilsmènentàuneconnais-sanceintuitivedelalangueétrangère.aucontraire,dansl’apprentissagelesprocessussontconscients,lesujetconnaîtlesrèglesetpeutenparler(voirparexemplehuot&schmidt1996,pourunediscussionexhaustivedesquestionsdeconscienceetd’activitémétalinguistiqueendidactiquedeslanguesétrangères).
pour nous qui enseignons le français en contexte homoglotte2, laquestioncrucialeestde savoircomment lesétudiant(e)svenus se for-merdansnotredépartementvontparveniràarticuler les connaissan-cesqueleurapprentissageguidédufrançaisleurpermetdeconstruireavec celles qu’ils vont développer dans leurs interactions «naturelles»avecdesautochtones.eneffet,loindesuivrel’hypothèsedekrashensurl’impossibilitéd’associerdesprocessusconscientset inconscientsdansl’apprentissaged’unelangueétrangère,nouscherchonsàcréerpournosétudiant(e)s les meilleures conditions possibles d’articulation de cesdeuxmodesd’apprentissage.
pourfairecomprendrelesenjeuxdenotreréflexiondanscedébatsurladistinctionentrel’acquisitionnaturelled’unelangueétrangèreet
1 dansunpremiertemps,dabèneaproposélesdénominationsdecontexte endolingueouexo-lingueavantdepréférerlestermeshomoglotteetalloglotte/hétéroglottepouréviterlapolysé-mie.
2 Lausanneestunedesgrandesvillesdelarégionfrancophonedelasuisse.

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
413
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
son apprentissage institutionnel, nous aimerions situer très concrète-mentnotreproposdansledébatactuelsuscitéparlamiseenœuvreducadreeuropéencommunderéférencepourleslangues.cetexte,deparsadiffusionetmalgrésonmanqued’inscriptionacadémique,peutfour-nirunbonpointd’appuipoursaisir lesdifficultésquepeutposeruneoppositiontropnetteentreapprentissagesscolaireetextrascolaired’unedeuxièmelangue.
danssespremièreslignes,lececrintroduitunedistinctionentrel’apprentissage scolaireet extrascolaired’une langue.cettedernière setraduit paruneopposition entre, d’un côté, un apprenant qui suit uncursusscolairedurantlequelsonapprentissagedelalangueseraévaluéetcertifiéet,del’autre,unindividuquivitdesexpériencesextrascolairesqu’ilpourrarecueillirdansunportfolioencomplémentdesesvalida-tionsofficielles:
àcetégard,l’appréciationetl’évaluationdesconnaissancesetdessavoir-faire devraient pouvoir tenir compte de l’ensemble des circonstances etexpériencesoù ces connaissances et savoir-faire semettent enplace. Leprojetd’unPortfolio (Portefeuille européen des langues)permettant àunindividud’enregistreretdeprésenterdifférentesfacettesdesabiographielangagière va biendans ce sens. il s’agit en effet d’y fairemention, nonseulement des certifications ou validations officielles obtenues dansl’apprentissage de telle ou telle langue, mais aussi d’y enregistrer desexpériencesplusinformellesdecontactavecdeslanguesetculturesautres.(cecr:133)
cettevisiondel’expériencehumaineaquelquechosedeschizophré-niqueencequ’ellelaissepenserquel’onpeutclairementdistinguerl’ex-périencescolairedel’expérienceextrascolaire,àplusforteraisonquandles expériences sont contemporaines, comme c’est le cas en contextehomoglotte. L’idée que seule la première serait dignede certificationsou de validations officielles alors que la deuxièmene ferait l’objet, aumieux,qued’unsimplecompterenduseraitcontre-productivedansuncontextecommelenôtre.reléguerainsilapersonneparletruchementdesonexpérienceindividuelleàjouerunrôleaccessoiredanssonappro-priationd’unenouvellelanguepourlalivrercomplètementparlebiaisde son expérience scolaire aux jugements et évaluationsd’institutions–quisesontdonnécommeobjectifdedresserunelistedecritèresob-jectifs,exhaustifsettransparents,surlabasededescripteursdelalangueàapprendre–poseproblèmeautantdupointdevuedelacitoyennetéeuropéennequeveutpromouvoir lececrquedupointdevuede laconceptiondel’acteursocialetdesonrapportauxlanguesetàleurap-prentissage.Ladichotomieapprenant/individucristallise,ànotresens,ledésircontradictoired’évaluerl’apprenantdelamanièrelaplusobjec-

Érard Y., Jeanneret T.
414
tiveàpartird’unelistedecritèreslesplusstandardiséspossibleetdeva-loriserdanslemêmetempslaspécificitéd’unparcoursd’apprentissageindividuel inscritdansuncontexteparticulier.plus labalancepencheducôtéd’unecertificationdont l’institutionest seulegarante,plus lesapprenantsseconformerontauxnormesstandardiséesetmoinslesindi-viduspourrontfairevaloirlasingularitéd’unapprentissage,privilégiantlaconformitéauxattentesinstitutionnellesplutôtqu’unecertaineauto-nomiedanslesréponsesindividuellesàdonneràdessituationstoujourssingulières.
danscecontexte,ledébatquis’estactuellementengagésurlama-nièrede comprendre ce que lececrentend exactementpar la pers-pectiveactionnellequ’ilpréconisepourl’enseignementdeslanguesnousparaîtexemplaire.Ladiscussionsefocalisebiensouventsurl’indétermi-nationdelanotiond’actionsanss’apercevoirquecettedernièreimpliqueuneindéterminationcorollairedeladéfinitiondusujetdecetteaction.L’explicitation de lamanière dont on conçoit l’acteur social dans uneperspectiveactionnelleestunenjeuéminemmentpolitiqueausensoùildoiténoncerlanaturedelarelationdel’individuàlacommunauté.sansapprofondirlaquestion,iln’estpasdifficiledevoirquel’ondessineunefigurebienétrangeducitoyenenséparantartificiellementunapprenantsoumisauxjugementsetauxévaluationsde l’institutiond’unindividudontonprêchel’autonomietantqu’ellerestedansunestricterelationàsoi-même(possibilitédes’autoévaluer,d’avoirunretourréflexifsursoi-mêmedanssabiographielangagière,etc.)alorsquedansunedémocra-tiecedevraitêtrel’institutionquisesoumetàunacteursocialdansunerelationquidevraitd’embléeêtrepublique.
enfait,lececrfaitcoïnciderdeuxconceptionstrèsdifférentesdusujet sous la formed’un côtéd’un sujet de l’action (l’apprenant) et del’autred’unsujettranscendantal(l’individu).Latensionentrecesdeuxconceptionsincompatiblesrejointl’indécisionquitraversetoutlececrentre une approche communicative et une approche actionnelle de ladidactiquedeslangues.commelesoulignentlescommentateurs,ilestdifficilededéterminersilaperspectiveactionnelleducadresetrouveenruptureouencontinuitéavecl’approchecommunicativequil’aprécédéedanslechampdeladidactiquedeslangues.commelececrserefuseàdonnerexplicitementdesréférencesàuncourantpédagogiquequel-conque(puren2002),laquestionresteindécidableetilsemblebienqu’ilfaillesimplementserésoudreàconstaterqu’ilexisteenlamatièredeuxinterprétationsconcurrentesducadre(Liria&Lacan2009).
Lalecturequivoitdanslecadreunecontinuitédel’approchecom-municationnelleconsidèrequel’apprenantadesbesoinscommunicatifs

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
415
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
quel’enseignementd’unelangueapourbutdesatisfaire.cetteconcep-tionde la langue etde sonapprentissage est fonctionnelle au sensoùellesupposequ’unelangueremplitcertainesfonctionsdecommunica-tiondontilestpossibled’établirlaliste.apprendreunelangueconsistedèslorspourunepersonneàs’approprierlesmoyensdecommunicationlangagiersqui lui fontdéfaut. il suffitalorsdedresserune listedecesmoyensetdelesproposersousformed’objectifsd’apprentissage.suivantceraisonnement,l’ambitiontaxinomiqueducecrpeutàbondroitêtreinterprétéecommeladignehéritièredel’approchecommunicationnel-le:
LechoixpourleCadre d’uneprésentationtaxinomiqueconstitueàcoupsûrunetentativepourtraiterlagrandecomplexitédulangagehumainendécoupant la compétence langagière selon ses différentes composantes.ceci nous renvoie à des problèmes psychologiques et pédagogiquesd’importance. La communication met tout l’être humain en jeu. Lescompétences isolées et classifiées ci-après se combinent de manièrecomplexepourfairedechaqueindividuunêtreunique.(cecr:9)
maisonpeuttoutaussibienprendreausérieuxl’intentiondéclaréed’opterpouruneperspectiveactionnelle.elleseradès lorscentréesurl’acteursocialentantquepersonneunique.
en tant qu’acteur social, chaque individu établit des relations avec unnombretoujourscroissantdegroupessociauxquisechevauchentetqui,tousensemble,définissentuneidentité.dansuneapprocheinterculturelle,un objectif essentiel de l’enseignement des langues est de favoriser ledéveloppement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de sonidentitéenréponseàl’expérienceenrichissantedel’altéritéenmatièredelangue et de culture. il revient aux enseignants et aux apprenants eux-mêmes de construire une personnalité saine et équilibrée à partir desélémentsvariésquilacomposeront.(cecr:9)
notre lecture considère la perspective actionnelle affichée parle cecr comme une véritable rupture par rapport à une approchecommunicative. c’est pourquoi, nous privilégierons une approchecurriculaire qui met l’accent sur l’individu d’emblée en lien avecune communauté et non pas isolé en proie au solipsisme ou à uneréflexivitéproblématiquequilelaisseseulaveclui-même.danscecadre,l’apprentissaged’une languedoit êtredécrit, ànotre sens, commeunetentative pour un nouveau venu d’accéder à une autre communautélangagière.Lesenseignantsjouentalorslerôleprimordialdemédiateurspourlapersonnequiveutapprendre.
ainsi,plutôtquededéplorerl’influencedésormaisincontournableducecrdans le domaine de l’enseignement des langues, il s’agit d’y

Érard Y., Jeanneret T.
416
voiràl’instardepuren(2009)oudepéris(2009),uneoccasiondedéfi-niruneperspectivevéritablementpragmatique.nouspouvons,pourcefaire,nous inspirerdesdixprincipesquicaractérisent lepragmatismeselonshustermanen les transférantaudomainede l’apprentissagedeslanguesétrangères.ils’agiraitdecaractériserlaperspectiveactionnelleenutilisantlesdixthèmesqueshusterman(2010:59)jugeconstitutifsdupragmatisme:
1)lanaturechangeante,ouverteetcontingentedelaréalité;2)leprimatde l’action,de lapratiqueetdes intentionsde l’êtrehumain jusquedansle domaine de la pensée théorique; 3) un naturalisme non réducteur,respectueux de la place du corps; 4) une approche anti-cartésienne,opposée à la recherche de certitude et au dualisme cartésiens; 5) lanécessitédelacommunauté,considéréecommeuneconditionnécessairedelaquêtedesavoiretdel’accèsausens;6)uneorientationempiristequireconnaît lerôledel’expérienceetdel’expérimentationdansledomainedelacognitioncommedanstouslesautreschampsdel’activitéhumaine;7)uneorientationquiprivilégiel’avenir;8)uneattitudemélioristeenversla théorieet lapratique;9)uneapprocheholistiquequimet l’accentsurlacontinuitéplutôtquesurledualismeetquiabordelasignificationetlacroyance en rapport avecdes totalités appréhendéesdans leur contexte;10)unpluralismequivaloriseladiversitédespratiques,desvaleursetdessignifications.
dans cetteoptique, lesbesoins langagiersde l’apprenantnepour-raient être listésdemanière exhaustive sous formededescripteurs endehorsd’unepratiquelangagièresituée.Laconceptioncommunicativequivoudraitqu’ilexisted’uncôtéunsujetetdel’autreunelanguequiseraitextérieureautantàlapersonnequil’enseignequ’àlapersonnequil’apprendestuneillusion.
c’estpourquoiilestprimordiald’étudierlesensquelesapprenantsdonnentàleurapprentissageparcequ’ilaétébienmontré,parexemple(norton1995), que l’investissementdans cet apprentissage estdépen-dantdelamanièredontl’apprenantparvientàabandonner«desfaçonsd’êtreetdeshabitusqu’iladûincorporeràunmomentdonnéafind’enacquérird’autresqui luisemblentpluspertinentsàunautremoment»(degaulejac2009).
degaulejacparled’untravaildesubjectivationquichangelerap-portaumonde.cette«entreprise»joueunrôledécisifdanslamanièredontleprojetd’apprentissagefaitsenspourlesujetetdoncdansletempsetl’applicationqu’ilvamettreàleréussir.
c’est laraisonpour laquelle,dans ledépartementdefLeoùnoustravaillons,nouscherchonsàrecueillirdesdonnéessurlamanièredontlesétudiant(e)s(quiviennentd’unequarantainedepaysdifférentspour

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
417
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
apprendre le français) adaptent leur subjectivitéd’acteur social enen-trantdansunenouvellecommunautédepratiquelangagière.L’idéeest,pouramenerlesétudiant(e)sàarticulerdesressourcesissuesdescultu-resscolaireetextra-scolaire,defaireémergerleslignesidentitaires,avecleursrupturesetleurscolmatagesdontnousfaisonsl’hypothèsequ’ellesinfluentde façondécisivesur l’investissementdans l’appropriation: lesexpériencesvécues,lesidentitéssocialesdesétudiant(e)sdoiventavoirunstatutàl’école,ilfautlesameneràcomprendrecommentleursoppor-tunitésdeparleretdes’intégrersontstructuréessocialement.
2. Nos données: des fiches d’observationainsidansuncoursd’introductionàlaculturefrançaiseetfranco-
phonedontl’objectifest–notamment–d’apprendreauxétudiant(e)sàrepérer et à analyser les représentations socioculturellesquiont coursdans lemonde francophone,principalement ensuisse romande et enfrance,uncollèguedemande-t-ilauxétudiant(e)sderédigerunefiched’observation. il s’agitd’inviter les étudiant(e)sàuneposture réflexiveparrapportàuneexpériencevécued’écartoudemalentenduculturel.Lasélectiondel’expérience,puissonélaborationsouslaformed’untex-teen font lamatièred’un travail académiqueque l’étudiant(e) soumetàsonenseignant3.L’objectifgénéralpoursuiviestd’offrirl’occasionauxétudiant(e)sl’occasiondeseforgerdesméthodesdetraitementdel’in-terculturel.
Lesdonnéessurlesquellesnousbasonsnotreréflexionsurcequ’estlacompréhensionsontainsitiréesdecettepratiquelangagièredelafi-ched’observation.Les fiches élaboréespar les étudiant(e)s àpartirdeleursobservationssontcorrigéesetcommentéespar l’enseignant(voirlesexemplesci-dessous).nousavonsainsiaccèsauxnégociationsentrel’étudiant(e)etsonenseignantportantsurlesensàattribuerauxanec-dotes,observations,épisodesquel’étudiant(e)metenévidencecommereprésentativedelaréflexionqu’ileffectue.
3. Observer la compréhension ?Lesrécitsquefontlesétudiant(e)sd’écartsculturelsfourmillentde
situations d’incompréhension. ils donnent ainsi accès à de multiplesexemplesdecequeveutdirenepascomprendredansunapprentissaged’unelangueseconde.enlesobservantdeprèsnouspourronsnousfaireune idéedecequeveutdire comprendreetnepas comprendre.c’est
3 merci à alain cernuschi d’avoir mis à notre disposition les données patiemment réu-niesdanssesenseignements.

Érard Y., Jeanneret T.
418
entantqu’acteursocialquel’étudiant(e)avécul’expérience,c’estentantqu’étudiant(e)qu’illarelateàsonenseignant(e).eneffet,lesficheséla-boréesparlesétudiant(e)sàpartirdeleursobservationssontcorrigéesetcommentéesparl’enseignant.
Lesfichesd’observation,quivontnousservird’exemplespourmon-trercequeveutdirecomprendredansuneperspectiveinspiréeduprag-matisme,illustrentcommentl’apprentissaged’unenouvellelanguepeutsesitueràl’interfaced’uneinstitutionscolaireetd’uncontexte«naturel»,cequiest,commenousl’avonsditplushaut,crucialpournousquiensei-gnonslefrançaisencontextefrancophone.Lafiched’observationnouspermetd’appréhenderavecprécisionleparcoursquimènel’étudiant(e)vers la compréhension d’unmalentendu interculturel qu’il a vécu.ceprocessus de compréhension n’est pas mental. au contraire, il se dé-roule sous nos yeux selon les étapes suivantes: l’incompréhension del’étudiant(e)surgitquandlapratiquelangagièrenevaplusdesoi.cetteperted’évidencemèneensuiteàunetentativedetrouveruneraisonàcequiparaîtsoudainétrange.désormais,l’apprenantesttirailléentredeuxpratiqueslangagièresdiscordantes,l’unedesacultured’origineetl’autredesacultured’accueil.aveclacompréhensiond’unenouvellepratiquelangagièreapparaîtdoncunchoixentrecequel’individunevoyaitpasetcequ’ilvoitmaintenant.sarésistanceousonconsentementàapprendredépenddecequ’iljugebienoumal.L’apprentissaged’unelangueadoncuncôtééthiqueetcomporteaussiunelimiteendeçàdelaquelleonnepeutpasallerpourdesraisonsquitouchentauxlienslesplusprofondsqu’onatissésavecsalanguematernelleetavecsonidentité.
cettepratiqueparticulièredelafiched’observation(aveclescorrec-tionsproposéesparl’enseignant)nousdonneainsiaccèsauxmalenten-dusque racontent les étudiant(e)s,mais aussi à l’accorddans l’activitémême de la relation dumalentendu entre étudiant(e)s et enseignant.notreprésentationsesitueraàcesdeuxniveauxdelacompréhensionenessayantdelesdistinguer.c’estdanscettepratiquequepourraientalorsêtredéterminéslesbesoinslangagierscommecequipermettraitausujetd’accéderàlacommunautélangagièrequ’ilsouhaiterejoindre.

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
419
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
4. Examen des exemples4.1. Incompréhension linguistique ou culturelle
dansl’exemple,uneétudiantehongroiserelatedanssafiched’obser-vationunmalentenduàproposdusensdifférentqu’ellesdonnaientaumot«travailler»qu’elleavécuavecunedesesamiesfrancophonesqu’elleavaitinvitéeàdîner.exemple1
pour l’étudiante, il s’agit d’un problème interculturel. pour l’ensei-gnant,parcontre,ilnes’agitqued’unproblèmelinguistiqueetpluspré-cisémentlexical:
L’étudiante et l’enseignantne s’entendent pas sur la nature de l’in-compréhension.pour l’étudiante, le sensqu’il fautdonneraumot tra-vailleresttrèsclairementliéàsonusage.elleditexplicitementqu’ellenediraitpastravaillerpourétudier alorsquesonamieemploielemotdanscesenset lecomprenddanscesens.sasurpriseest lamarquedesonincompréhensionquiportenonpassurlesensqu’ilfautattribueràdesmots,maissurlesensqu’ilsprennentparrapportàuneaction:

Érard Y., Jeanneret T.
420
danssescommentairesdutravail, l’enseignantindiquequelema-lentenduest,àsesyeux,linguistiqueetquesarésolutionrelèvedoncdelaconsultationd’undictionnaire.L’étudianteautilisélemot«travailler»ensebasantsurlesusagesenhongroisoù,apparemment,leverberen-voieexclusivementautravailsalarié.poursoninterlocutrice,aucontrai-re,onutiliseleverbetravaillerpourdésignertouteactivitéintense.maisnoustrouvons-nousicidansunmalentendurelevantd’unesorted’inter-férence lexicalehongrois-français?non, iln’ypaserreurde l’étudiantehongroise,ilyanoncompréhensiondel’usagedetravaillerenfrançais.Lanon-compréhensionest ici étroitement liéeà la situation.danscetexemples’opposentdoncdeuxconceptionstrèsdifférentesdelasignifi-cation.pourleprofesseur,chaquemotaunesignificationendehorsdetoutusage,pourl’étudiante,non.
L’interprétationdel’étudiantes’accordebienàunpointdevueprag-matiquequiconsidèrequelesensd’unmotcorrespondàsonusage.decepointdevuel’incompréhensionportesurunedivergencedanslespra-tiques.ilmetàjourundésaccordquiexisteaussidanslacommunautéfrancophone.danssonlivreLa place,annieernauxdécritcettemêmeincompréhensionquiexisteentreelle(étudiante)etsonpère(ouvrier,puispetitcommerçant)quiserefuseàdonnerlenomdetravailauxlon-guessoiréesd’étudesdesafille.cetteincompréhensionquiaffecteleurrelation toutau longduromanmontreàquelpointundésaccordsurunmotpeutêtreprofondetnepeutserésoudresimplementenouvrantundictionnaire; ilmontreaussi àquelpoint il est illusoiredevouloirséparercequirelèvedelaculturedecequirelèvedelalanguedanslespratiqueseffectivesdulangage.
cesdivergencesdevuesentrel’étudianteetl’enseignant–parcequ’ilsamènentlesinterlocuteursànégocierleurinterprétationdumalenten-du,contribuentàpermettreàl’étudiantedesesituerauseindelacom-munautédepratiqueàlaquelleellechercheàappartenir:enl’amenantàcomprendrelemalentendu,l’enseignantcontribueàcréerlesconditionsdesonintégration.

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
421
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
4.2. Ne pas être comprisdans l’exemple précédent, nous avons vu que comprendre une
phrasenevoulaitpasdirecomprendrelesmotsquilacomposent,maiscomprendreunepratiquelangagièred’unecertainecommunautélanga-gière.Lacompréhensionaquelquechosedeculturel.elledépenddelafamiliaritéqu’unindividuentretientavecunecommunautédepratiquecommenouspouvonslevoirdansl’exemplesuivant:
exemple 2
ici, l’étudianteguatémaltèquenesaitpascequeveutdire«lecom-post»,maiscommedansl’exempleprécédentlesensdumotestliéàunusage.sic’estsabelle-mèrequirévèlelarègleenbrisantcequiesttou-joursallédesoipourelle,c’estsonmariquitentedeluienfairecom-prendrelesraisons.Larelationàl’ancienneetàlanouvellecommunautélangagièretientàdesrelationsaffectivesquipeuventexpliquerlafrus-trationetlagêne:

Érard Y., Jeanneret T.
422
danscecasd’incompréhension, ilyaunchocentre leshabitudesdedeux communautésdepratiquesdifférentes, cequi affecteprofon-démentlapersonne.sejouealorsunconflitdeloyautéenversl’uneetenversl’autre.àquellecommunautévoudrait-elleappartenir?dansla-quelleaimerait-elleêtrecomprise?ici,l’étudiantedécided’adopterl’usa-geducompost.ellelefait,dit-elle,parcequ’elletrouveçabien.c’estladimensionéthiquedontnousavonsparléplushaut.
maiscommenousallonslevoirmaintenant,lechangementn’estpastoujourspossibletantnotrelanguematernellenousadonnéunesecon-denaturedontilesttrèsdifficiledesedéfaire.
4.3. limite de la compréhensionexemple 3L’exempleprécédentmontrebiencomment l’apprentissagedusens
dumotestliéàlacompréhensiondesonusage.ilmontreaussiquecetapprentissageestliéàuneadhésionéthiqueauxusagesd’unecommu-nauté. il a, par contre, le défaut de laisser penser que l’adoption d’unnouveau comportement langagier (lié au «compost») dépend unique-mentdelarelationqu’unapprenanttisseavecsanouvellecommunauté(enl’occurrenceavecsonmariousabelle-mère).maisl’adoptiond’unenouvellemanièred’êtreenrapportavecunenouvelleidentitélangagièrenedépendpasuniquementdefacteurssociaux,ellepeutaussiheurter«lanature»quenousavonshéritéedenotrelanguepremière.
dans l’exemplequi suituneétudianterussedécrit sesdifficultésàdire«bonjour,commentçava?»aveclemêmetonqu’unfrancophonedesuisseromande.
L’enseignantnecomprendpastrèsbiencequeveutdirel’étudiante.ilécritainsienmarge«pourriez-vousladécrire,cettemanière?».L’in-compréhensiondesacommunautéd’accueilquilaconsidèrecommeunefemmemalpoliesedouble,ici,del’incompréhensiondel’enseignantquinevoitpaslemalentenducultureldontparlel’étudiante:

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
423
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
alorsquel’étudiantemontrecommentletond’uneexpressioncom-me«bonjour,commentçava?»aunedimensionsocialepuisquelefaitdenepasl’adoptervousfaitpasserpourquelqu’undemalpoli,l’ensei-gnantnevoitpasenquoilanaturecorporelledelavoixhumaineaunrapportaveclaparolehumained’unpointdevueculturel(social):
surcettedeuxièmeversiondutravail,l’étudianteajoutedesremar-quesauxremarquesdel’enseignantenréaffirmantsondésirdemettreenrapportnatureetculture.L’enseignantnel’entendtoujourspasets’entientàunestrictedichotomieentrenatureetculture:
danslatroisièmeversiondesontravail,l’étudianteexpliquesesré-ticencesàl’égarddecettemanièredes’exprimerainsiqueletempsqu’illuiafallupourl’accepter(saformulationporteencorelamarquedeseshésitations):

Érard Y., Jeanneret T.
424
puiscommeleluiademandél’enseignant,l’étudianteessaiededé-crireunpeuplusprécisémentcequ’elleentendparpetitevoix.dansleparagraphe ci-dessous, ellemontre commentdans le langage la signi-fication ne peut pas être séparée de l’expression. La petite voix va depairaveclesourirequivadepairavecle«bonjour».Lelinguistiqueetle culturelnepeuventpas être séparés, le sujetparlant a incorporé salangue,celuiquiveutl’apprendredoitentrerdansunenouvellepeau…ounon.unelanguequel’onapprenddevientunesecondenature.sil’onveutenapprendreuneautre,ilfautquenotrenouvellepeausefasseàl’ancienne.pourl’étudianterusse,celan’ariend’évident:
danssacorrectionl’enseignantreformuleenmargecequeveutdirel’étudiante.ilproposeleterme«indissociabilité»pourdécrierlerapportentreexpressionverbaleetexpressioncorporelle.ilentreainsidans leraisonnementdel’étudiantepours’accorderavecelle.
ilnecomprenaitpascequevoulaitdirel’étudiantepar«petitevoix»dansladeuxièmeversiondesontravail:

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
425
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
danslatroisièmeversion,illacomprendetadhèreàsonpropos:
ConclusionL’examendenosexemplesnousapermisdemettreenévidencele
caractèreprocessueldelacompréhension:dansunpremiertemps,l’ac-teursocialestconfrontéàuneexpériencequiluifaitperdrel’évidence,l’allantdesoidudéroulementdel’interaction.danssarelationdecetteperted’évidence, il estamenéà tenterdecomprendre lespratiquesdel’(des)autochtone(s).pourlescomprendreildoitentrouverdesexpli-cations.unefoiscetteactivitéderationalisationeffectuée,l’acteursocialpeutaccepterlapratiqueetl’adopter.
conçudecettemanière, l’apprentissaged’unelangueétrangèreestune socialisationquientrainedeprofondesmodifications identitaires.nousavonsainsimontréaprèsvygotskiqueleprocessussocialparle-quelunnouveaumembred’unecommunautéessaiedes’intégreràunenouvelle communauté langagière implique une profonde transforma-tion. il fautnoterdeplusquecette transformationaffecte l’enseignantégalement,eneffet,pasplusquel’étudiant(e), ilnepeutsesituerdansunlieuquisesitueraitendehorsdulangagequileconstitueautantqu’ilconstituelacommunautélangagière.
Lesconséquencesdidactiquesdecettemanièredeconcevoircequesignifie«jecomprends»ou«jenecomprendspay»nepourrontêtreenvi-sagéesicidemanièredétaillée.ilfautnéanmoinssoulignerlestransfor-mationsquesubissentlesactivitéslangagièresdecompréhensionécriteetoraledansuneperspectiveactionnelleou–commenousavonspréféréladénommer–pragmatique:lacompétencedecompréhensionsemani-festeàtraversdesactivitésetnonpluspardesprocessusmentaux:pourl’évaluer,ilfautdonctrouverdesmanièresdepermettreàl’utilisateurdelamanifester.decepointdevue,lafiched’observationestunélémentcentrald’undispositifd’enseignementdelalangueétrangère.

Érard Y., Jeanneret T.
426
Bibliographie
dabène1994:L.dabène,Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des lan-gues: les situations plurilingues,paris:hachette.degaulejac2009:v.degaulejac,Qui est «je»?,paris:Leseuil.huot&schmidt1996:d.huot,&r.schmidt,conscienceetactivitémétalin-guistique,quelquespointsderencontre,in:acquisition et interaction en Langue étrangère,8,89-128.krashen1985:s.krashen,The Input Hypothesis: Issues and Implications,Lon-don:Longman.norton1995:b.norton,socialidentity,investment,andlanguagelearning,in:TesOl Quarterly,29,9-31.péris2009:e.m.péris,L’éducationpourl’autonomie:unnouveaumodèled’en-seignement?in:p.Liria&L.Lacan,L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues: Onze articles Pour Mieux Comprendre et Faire le Point, barcelone:difusión–centrederechercheetdepublicationdelangues–maisondeslan-gues,101-118.puren2002:c.puren,perspectivesactionnellesetperspectivesculturellesendidactiquedeslangues-cultures:versuneperspectiveco-actionnelle–co-cul-turelle,in:Les langues modernes,96,55-71.puren2009:c.puren,Lanouvelleperspectiveactionnelleetsesimplicationssurlaconceptiondesmanuelsdelangue,in:L’approche actionnelle dans l’ensei-gnement des langues: Onze articles Pour Mieux Comprendre et Faire le Point, barcelone:difusión–centrederechercheetdepublicationdelangues–mai-sondeslangues,119-137.shusterman2010:r.shusterman,whatpragmatismmeanstome,in:Revue française d’études américaines,124,59-65.
Ив Ерар , Терез ЖанреО ДНЕВНИКУ БОРАВКА КАО ОГЛЕДАЛУ У
УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКАРезиме
Уовомчланку,бавићемосеначиномнакојинефранкофонистуденти(студенткиње),којиживеистудирајууЛозани,франкофономграду,говореосвојимтешкоћамадараз-умејуидадајусмисаокултурнимизразимаилиискуствимакојесусрећуусвакодневномживоту.Ослањајућисенањиховеречи,покушаћемодаокарактеришемоидефинишемоштапредстављајуизрази„разумем“и„неразумем“кадаихизговористранацнанекомје-зикуиунекојкултури.Показаћемодајеразумевањедијалошкиилиинтеракцијскипро-цес,дајезапочетообраћањем(уовомслучајупредавачу)идаувлачипримаоцаупроцес,наводећигададругимочимагледанакултурукојојприпада.
Удругомделу,видећемоданеразумевањеможебитисхваћенокаонеприпадањејед-нојјезичкојзаједници.

Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère
427
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
11-427
Утрећемделу,видећемодапредавачнематранспарентноразумевањесопствене је-зичкезаједнице,ида,ако јеонмедијаторкојипомажестуденту(студенткињи)дабудесхваћен,ионсамможенештонаучитиосвомсопственомјезикуи,следственотоме,осамомесеби.
Чињенице на које ћемо се ослонити произашле су из писане активности (писањезапажања)повезанесадневникомборавкакоју јепредложиопредавачфранцускогкаостраногјезика.
Примљено: 11. 02. 2011.


429
УДКрад
Tatjana Šotra-KatunarićFaculté de philologie, université de Belgrade
uN eSPAce VerBAL De ThéâTre à DIDAcTISer: LE CAS DE IoNESCo
L’espaceverbaldeionescoextrêmementriche,s’estmontrépertinentauxfinsdidactiquespourletravaillinguistiqueetlittéraireàunniveauavancé(académique).Lesjeuxdulangageionesquienpermettentàl’en-seignantuneutilisationéclectiquedesapprochesdidactiquesetouvrentàl’apprenantdifférentespossibilitésd’exercicesphonologiques,morpho-syntaxiques,sémantiquesetheuristiques.
Le but de notre approche didactique vise à développer chez l’ap-prenant les stratégies de lecture d’un texte dramaturgique de ionesco,d’ouvrirdespistesdecommunication,d’interprétationetdetraitementdes textespardifférentesméthodesdidactiques (cognitive, interactive,structuraliste, pragmatique), par étapes: exercices de perception oraleetvisuelle,deproductionoraleetécrite,d’improvisationetc.)L’essaidedidactisationde l’espaceverbalde ionescoest censéhausserchez l’ap-prenantlamotivationd’apprentissage,transformerunapprenant/lecteurpassifenlecteur/co-producteuractif.
parcettecommunication,nousvoulonsfaciliterl’apprentissagedelalanguefrançaiseetsuggérerunenseignementconformeauxprincipesdeladidactiquedenosjours.
Mots-clés: langageabsurde,didactiser,communication interactive,stratégiesdelecture,perceptionhiérarchisée,interprétationorale/écrite
IntroductionL’espaceverbaldethéâtre,vusousl’angledel’enseignement/apprentissa-gedeslanguesétrangèresàunniveauavancé(académique)s’estmontrécommeunmaterielpertinantàêtredidactisédanslebutd’acquisition/apprentissagedesstructuresdelalangue,desfaitsculturelsetlittéraires,et à la fois, des compétences communicatives. Le théatre de l’absurdedeionesco,unereprésentationvivantedel’impuissanceduverbeetdelacrisedelacommunucationinterpersonnelle,peutservir,paradoxale-ment,auxfinsdidactiquesdudévéloppementdesactivitéscommunica-tivesenclassecentréessurl’apprenant.

Šotra-Katunarić T.
430
Ladidactisationd’untextedethéâtredeionesco,permetàl’ensei-gnant demettre en oeuvre des outils pédagogiques quimobilisent lacompréhension, la négociation et l’expression du sens et à l’apprenatd’utiliser la langue cible pour exprimer ses compétences acquises oupourreproduireletextemêmesurlascène.
bienqu’untextepourlethéâtresoitécritavanttoutpourêtrejoué,c’estpar lebiaisde la lectureque les intéressésentrentdanssonespa-ceverbal.c’estsur leprojetdela lecturequ’unenseignanthabilepeutdéployer les pratiques inspiréespar les théoriesde la parole: le struc-turalisme, la théoriede lacommunication, lapsychologiecognitive, lalinguistiquepragmatique.pourébaucheruneapprocheéclectiquepourlaquelleopteladidactiqued’aujourd’hui,nousn’allonsqu’enmentionnerquelques-unesquisontdécisivespourladidactiquedaladeuxèmemoi-tiédu20esiècle.
Lesapprochesdidactiqueaxéessurlalecturepuisentleurstehniquesàpartlestructuralismelinguistique(desaussure)etlathéoriedelacom-munication(Jacobson),dans la théorie fondéesur lesactesdeparoles(austin1962etsearl1969),danslathéoriedel’énonciation(benveniste1966),dans l’esthétiquedelaréception(Jaus1978)et laphénoménolo-giedelalecturequitraitedel’interacionentrelelecteuretletexte(iser1976,eco1979), lathéoriedudiscours,(ducrot1984), la linguistiquetextuelle (maingueneau 1990, adam 1991, kerbrat-orecchioni 1999,culioli2000).Lecognitivisme,àsontouryadonnésacontributionim-portante surtout avec les recherches sur les stratégies d’apprentissage,dontlespremiersessaisremontenten1975(stern,rubin)etprouvent,parlasuite,leurefficacité(o’malley,chamot,1990)dansuncadreinsi-titutionnel.
Lediscoursthéâtralàcausedesanaturedialogiquepeutêtreconsi-déréecommeundocument(pseudo-)authentiquequipréparelesap-prenantsaujeuet«quilesdétendentdevantlesdifficultéslinguistiquesdonnéessousformesdérisoires»(cornaire/germain1999:71).Lesjeuxdulangagedeionescodidactisésfavorisantleprincipeludiquepeuventtransformerlaclassedelangueenunlieuprivilégiéoùl’apprenanttoutenpassantparlesétapesd’unetriplerelationinteractive,apprenant-en-seignant,apprenant-texte,apprenant-apprenant,développesonaptitudeàlacommunication..
ainsi,enfaisantlesva-et-viententretouslesplansdes«lecturesin-teractives» (cicurel1991), l’apprenant«s’ouvreà lapluralitéde ses ré-ceptions, construt lui-même progressivement le sens» (iser 1997: 49)d’un texte dramaturgique, «approfondit ses connaissances, éveille saconscience», (iser1997:50).aucoursdesonexpérience intaractive il

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
431
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
développe dans lamêmemesure les stratégies de l’expression orale etl’habiletéd’interprétationsoriginalesetcréativesdel’oeuvrethéâtrale.
didactiseruntextedethéâtreaaussisoncôtépratique:onpeutdo-serlesséquencesconvenablement,endispenserenpetitesquantitéspourlesexploitersoitenvued’unetâcheàcourtterme(micro-lecture,jeuxderôleenclasseetc),soitenvued’unetâchede«prolongementàlongterme»(macro-lecture,lecturesàplusieursreprisesàlamaisonoujeudethéâtreetc).
Les savoirs stratégiques: apprendre à apprendre, apprendre à lireL’expériencepratiqueaconfirméqu’endidactiquedeslanguesétran-
gères,engénéral,l’acquisitiondessavoirsstratégiquesfacilitelesprojetspédagogiques.certainesstratégiesd’apprentissage(apprendreàappren-dreetapprendreàlire)peuventavoirchezl’apprenantuneffetcompen-satoireparrapportàsescomposanteslinguistiqueslimitées.
parmilesrecherchessurlesstratégiesd’apprentissage,nousoptonspourlatypologiedeo’malleyetchamot(o’malley,chamot1990:137-139)quis’estmontréepertinentedansnotreessaidelecturesinteractivesexecutéssurlecasdeionseco.
La tâche «d’apprendre à lire» appuyéepar les stratégies: «métaco-gnitives,cognitivesetsocio-culturelles»exige l’élaborationdes lecturesparétapesauxobjectifsbienprécis.L’enseignantengagel’apprenantàlaréflexionàhautevoix,àprendrelaparole,àfairedescommentaires,deshypothèses,desliaisonsassociatives,àposerdesquestionsàproposdutexte.toutescesactivitéslangagièresinteractivesautourdutextenede-mandentpasnécessairementdeconnaissancespréalablesliéesauxdo-mainesréferentiels,àlamatièremême(enl’occurence,surlethéâtredel’absurde,surionescoousafilièrelittéraire).Lelecteurainsiguidéserarassuréàentrertoutseuldansdesrecherchespluscomplexes,àenpro-duiredesinterprétationsorales,écritesoujouées.
passons en revue les stratégies d’apprentissages (v. cyr 1998: 39)pourvoirensuiteleurfonctionnementpratique:
Primo: les stratégies métacognitives développent, avant tout, lecontrôledesactivitésdelectureparlestechniquessuivantes:l’anticipa-tionoulaplanification, l’attentiongénéraleetsélective, l’identificationd’unproblème,l’autogestion(ouautocontrôleduprocessusdelecture),l’autoévaluation.
secundo: les stratégies, dites, cognitives, introduisent l’apprenantdans«uneinteraction(constante)aveclamatière,etluiapprennentdestechniquesspécifiquesquil’aidentàdévoilertouteslescouchesdutexte,àsavoir:larépétition,l’utilisationderessources,leclassement,laprise

Šotra-Katunarić T.
432
denotes,ladéductionoul’induction,lasubstitution,lerésumé,letrans-fertdesconnaissances,l’inférence.
tertio:pourcequiestdesstratégiessocio-affectivesellesimpliquent«l’interactionavecuneautrepersonne»danslebutdeclarifier/vérifierseshypothèsescequisous-entendunecoopération(untravailàdeux,pargroupe),uncontrôledesémotions,unautorenforcement.
L’usagedecesstratégiesparl’apprenantliéaulangagedesanti-hérosionesquiensélargitseshorizonslinguistiques,fixeetclarifiesesconnais-sancesphonologiques,lexicales,synatxiquesousémantique.Lespropossurl’espaceverbalionesquienimprévisibledeviennentuninstrumentdesocialisationetdecoopération.
La première étape: une micro-lecture iteractive (enseignant-lecteur-texte):
poursensibiliserl’apprenantàuntextedel’absurde,pourlemettreàmêmelasourcedulangageionesquien,nousproposonsladidactisa-tiond’unextraitdelaCantatrice chauve,piècemodèledu«tragiquedulangage»,(ionesco1966:63-64).ils’agit,ici,delascènefinaleoùl’inco-hérence(lexicale,syntaxiqueetsémantique)dudialogueabsurdeatteintsonpointdeculminationetoù,par l’effetdecontraste ionesquiences«dérapagesverbaux»sontrécompensésparlacohérencesonore.
m.smith:Jem’envaishabitermacagnadansmescacaoyers.mmemartin:Lescacaoyersdescacaoyèresdonnentpasdescacahouè-tes,donnentducacao!Lescacaoyersdescacaoyèresdonnentpasdescaca-houètes,donnentducacao!mmesmith:Lessourisontdessourcils,lessourcilsn’ontpasdesouris.mmemartin:touchepasmababouche!m.martin:bougepaslababouche!m.smith:touchelamouche,mouchepaslatouche.mmemartin:Lamouchebouge.mmesmith:mouchetabouche.m.martin:mouchelechasse-mouche,mouchelechasse-mouche.m.smith:escarmoucherescarmoucher!mmemartin:scaramouche!mmesmith:sainte-nitouche!m.martin:t’enasunecouche!m.smith:tum’embouches.mmemartin:saintenitouchetouchemascartouches.mmesmith:n’ytouchezpas,elleestbrisée.m.martin:sully!m.smith:prudhomme!mmemartin,m.smith:françois.

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
433
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
mmesmith,m.martin:coppée.mmemartin,m.smith:coppéesully!mmesmith,m.martin:prudhommefrançois.mmemartin:espècedeglouglouteurs,espècesdeglouglouteuses.m.martin:mariette,culdemarmite!mmesmith:khrishnamourti,khrishnamourti,khrishnamourti!m.smith:Lepapedérape!Lepapen’apasdesoupape.Lasoupapeaunpape.mmemartin:bazar,balzac,bazaine!m.martin:bizarre,beaux-arts,baisers!m.smith:a,e,i,o,u,a,e,i,o,u,a,e,i,o,u,i!mmemartin:b,c,d,f,g,l,m,n,p,r,s,t,v,w,x,z!mmemartin:del’ailàl’eau,dulaitàl’ail!mmesmith, imitant le train:teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff, teuff,teuff,teuff,teuff!m.smith:c’est!mmemartin:pas!m.martin:par!mmesmith:Là!m.smith:c’est!mmemartin:par!m.martin:i!mmesmith:ci!Tous ensemble, au comble de la fureur, hurlent les uns aux oreilles des autres. la lumière s’est éteinte. Dans l’obscurité on entend sur un rythme De plus en plus rapide:tousensembLe:c’estpasparlà,c’estparici,c’estpasparlà,c’estparici,c’estpasparlà,c’estparici,c’estpasparlà,c’estparici,c’estpasparlà,c’estparici,c’estpasparlà,c’estparici!les paroles cessent brusquement. De nouveau, lumière. M. et Mme Martin sont assis comme les smith au début de la pièce. la pièce recommence avec les Martin, qui disent exactement les répliques des smith dans la Ire scène, tandis que le rideau se ferme doucement. rideau.
dansunpremiertemps,onprocèdeàlahiérarchisationdelaper-ceptiondel’apprenantetàlapratiquedesonactivitélangagièreàpartirdespremièresobservations.
Lorsduvisionnementglobal(quifaitpartiedesstratégiesmétaco-gnitivesstimulant l’attentiongénéraleet sélective) l’apprenantconstatedessignestypographiquesdifférents,marqueursdedeuxtypesd’énon-ciation: «extra-scénique» (gardes-tamine, pellizza 1998: 121) - oùl’énonciateur/auteurs’adresseaulecteur(les3didascalies,caractèresenitalique)et«intra-scéniques»(lediscoursdesinterlocuteurssurlascène,

Šotra-Katunarić T.
434
caractèred’imprimerie).L’apprenantestcencéreconnaîtred’embléelali-gnededémarcationentredeuxsituationsdecommunication.
s’ilestengagéàobserverl’organisationdesrépliqueséchangées,par«une lecturebalayage»(cicurel1991:16) ilpourrafairesespremièressuppositionssurlacommunicationintra-scénique(entrelespersonna-ges). il est flagrant qu’elle explose et devient un échange de répliquesquin’ontpasdecontenuinformationnel,estfaitededialoguesencoq-à-l’âne,derépétitionsdeboutsdephrases,desyntagmes,demotsetdesonsparfoisincompréhensibles.
par l’usage de l’outil pédagogique «la conversation frontale» l’en-seignantstimulel’apprenantauxactivitésoralesliéesàuneobservationsuperficielleducôtéformeldutexte.ilauraàdonnersescommentairessur:
–letypedecommunication(s’ils’agitd’uneséquencemonologale,dialogaleoumultilogale)
–larelationentrelespersonnages(reconnaîtrelaprésencededeuxcouples,lessmith/lesmartin)
–l’ordredeleurprisedelaparole(alternancerégulière,nombreetnaturedesrepliques)
–laduréedeleursrépliques(assezbienpartagée)–lamodalisation(selonlessignesdeponctuation:assertion,inter-jection,négation)
–lesonomatopées(teuff, teuff, teuff)–les lieux problématiques au niveau lexical (la désagrégation desmots en lettres – voyelles et en consonnes, les répliques dem.smithetdemmemartin)
–lesséquencesderépétionsetd’accumulationsgraphiques–lelieuproblématiqueauniveausyntaxique(les8énoncés,consi-tuantsd’uneseulephrase).
La deuxième étape (interaction lecteur-texte-autres personnes): dansundeuxièmetemps,àl’aidedesstratégiescognitiveslelecteur
seramenéversuncontactplusapprofondiavecletexteetilferauntra-vailindividuel(oupargroupe)surlecorpustextuel.pourdéchiffrerlessignificationsetendéduire lesconclusionssur lesens,aulieudes’ap-puyeruniquement sur ses impressionspersonelles ildevra trouver lesfaitsmatérielsdutextepourjustifierseshypotèses.
pendantcetteétape,centrée toujourssurdes tâchesàcourt terme(travailenclasse)lelecteurpasseauxmicro-lecturesetaux«micro-ana-

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
435
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
lyses», (adam1991: 161-168).comme les stratégies cognitives impli-quentuntravailconcret l’apprenant ferades lectures fragmentairesenprenantdesnotespoursaisir,aufuretàmesure,lefildelastructuredecetteséquencedialogiqueauniveaudel’énonciation,delaphonologie,du lexique et de la syntaxe, auniveaude l’incohérence sémantique etthématique,durythmedudébitetc.donc,l’apprenant/lecteurseraame-néà faire,puisantdanssesconnaissances linguistiquesanterieurs,desclassements, des regroupements, des substitutions, des analogies, desétiquetages.toutletempsilestguidéparl’enseignantquiluidonnelesindicationspourqu’ilfocalisesaperceptionsurtouslesindicesdansletexte.enmêmetemps,ilcommuniqueavecd’autrespersonnesenclasse,ilvérifieetrépètecertainsfaits,lesmémorise,lessélectionne.encouragéparlemêmeprojetcommundelecture,ilfait,donc,touteunesériedemicro-lecturesparcouches,eninteractionpermanenteavecletexteetlesautrespersonnes.
dirigé par l’enseignant vers les lectures interactives sur les plansmultiplesl’apprennanttrouveradesinformationsprécisesenvued’unediscussionultérieure.
Lalecturesurleplandel’énonciation, luirévèle:–quecettesuited’énoncésestfortementdénuéededéictiquespor-teurs de la communication. La relation entre les interlocuteursn’existe pratiquement pas: l’absence de déictiques de personne:Je–tuouvousdepolitesseestévidente,àpartunseulexempleà laformedel’impératifà lamodaliténégativeduverbetoucherpronnoncécommeun«acteréactif»(charaudeau,maingueneau2002:18)quin’arienàvoiraveclecontexte:«N’y touchez pas»(laréactionà ladéclarationdeMme Martin: sainte Nitouche touche ma cartouche).Lesénoncéssontau–delàdelarelationJe–tu,ilsn’ontpasderôlecommunicationnel.récitéssurunrythmerapide,sans progression d’information, ils ne sont qu’un rabâchage, enfonctiondumaintiendelarelationsocialeabsurdedansunespaceaffectifvide.
–laprésencededeuxdéictiquesspatiaux(làetici)dansledialoguefinal,àdoubleconnotation,l’uneréelle(liéeàl’espacedel’énoncia-tion)etl’autreévoquantletragiquecosmique.
La lecture sur le plan phonologique, lors de laquelle l’apprenantaura:
–àidentifierladensitéphoniquedueauxallitérationsetauxasso-nancesdansdesjeuxdemots(faireundécompte)quiproduisentdes chaînes homophoniques pour vérifer l’hypothèse sur la so-noritépoétiqueetl’effetcomiquedessyntagmes(Mariette, cul de

Šotra-Katunarić T.
436
marmite! le pape dérape! le pape n’a pas de soupape. la soupape a un pape. Bazar, Balzac, Bazaine! Bizarre, beaux–arts, baisers! De l’ail à l’eau, du lait à l’ail !)
–à les classerd’après lesdominantesphoniques (les répliques à 2dominantesphoniques«ca»et«co»: Quelle cascade de cacades, 8 fois; Cactus, Coccyx ! coccus ! cocardard ! cochon ! etc)
–àremarquer ledoubleeffetauniveausémantiquedûsà lacoïn-cidencephonologiquedessyntagmesquin’ontpaslemêmecôdegraphique:C’est pas par ici... =ses pas par là... et,parlasuite,uneidentificationdu restede l’énoncéparvenant commeun echo ...c’est par ici≈ ses pa(s) (r) ici
–Lalecturesurleplanlexical/syntaxique, oùildevra:–chercherdansledictionnaireetdénoterlesmotsrares(cacaoyer,
cacaoyère, escarmoucheur etc.), lessyntagmesnominauxamalga-més(de l’ail à l’eau, du lait à l’ail, quelles cascades de cacades),dis-tinguerlesnéologismes(glouglouteurs, glouglouteuses,etc.)etleursens.
–souligner l’effetnéfastepour le sensd’une inversiondans l’ordredesconstituantsdesphrases(le pape n’a pas de soupape. la soupa-pe a un pape,) quiproduitunestructuresyntaxiqueparfaitementcorrecte,maisasémantique.cetypedeperturbationssyntaxico–sémantique à l’effet comique représente le principe fondamentaldudiscoursdel’absurdeionesquien.
–ladélocalisationverticaledesconstituantsd’unephrasesousuneforte pressionde l’angoisseduvide aumoment final d’énoncia-tion:M. s: C’est !(présentatifincomplet)Mme: Pas !(adverbedenégation)M. Martin: Par !(préposition)Mme smith: là !(adverbe,lepremierdéictiquespatialquirétablitcettesituationdel’énonciationintra-scénique)M. smith: C’est !Mme Martin: Par !M. Martin: I! (la syllabation du deuxième déictique spatial, dé-compositionphonologique)Mme smith: Ci! (fin du deuxième déictique spatial qui terminecettesuitede8quasi-répliques)
–noterlarecompositionlinéairedeceséléments(énoncéfinalré-pété6fois)quisedensifientetrésonnentenécholalie;ilspeuventsetraduirecomme:«àlarechercheinutiledelasortie».

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
437
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
Lalecturesurleplansémantique/thématique:– laconotationdesrépliquesfinalesdécomposéessurleplanthé-
matiquepeuventêtresaisiescommedescrisausecoursdesper-sonnes cherchant la sortie (le tragiqueontologique– l’hommeincurrablementperdudanslevidedel’existence)
– noterlesautresmomentsdulangagedésagrégésetleurconnota-tion(«a e i o u» à3repriseseterminantparlaconsonnedehautefréquence «i» suivie de «b,c,d...) lamort de la pensée dans duvivant,leplushautdegrédutragiqueionesquien).
– reconnaître les 3 éléments intertextuelsdissociés en6 énoncésavec2croisements(l’évocationdesullyprudhomme,poètefran-çaisdelafindu19emesiècle,parnassien,lepremierlauréatduprixnobel en littérature en1901, etdefrançoiscoppée,dra-maturgeetromancierfrançais,soncontemporain)etl’évocationtriplementrépétédekhrishnamourti (philosopheetéducateurindienmorten1986,àl’origined’unenouvelleécolephilosophi-quequirenvoiel’hommeàsaproprepenséeetsonproprecom-portement).cen’estqueparlecontextequ’onpuissecomprendrecesélémentsintertextuels:lafutilitédesnomspropresconnussilelangageestvidéd’esprit.
Lalecturesurleplanstylistique– reconnaîtrelaréférenceformellequeionescofaitàladramatur-
gieclassique:laprononciationdudialoguefinalimitelafomedestichomythie
– noterlenombredesrépliquesrimées,desallitérationsetdesas-sonnancespourvérifierleseffetduhallopoétiqueetducomiquedulangagequidevraientcontrebalancerlemanquedesens.
– noterleprincipeionesquiendontilconstruitlestournuresmé-taphoriques:lesglissementssémantiquesdulittéralverslerap-porté: espèces de glouglouteurs, espèces de glouglouteuses! (l’as-sociationdessémèmesde l’ordrevolailler–humain);ouencore:Mariette, cul de marmite! suivide la réplique: Khrishnamourti, Krishnamourti, Krishnamourti! (juxtapositiondes idéesde l’or-drebanal–philosophique)
Lalecturesurleplanpragmatique –suivres’ilyauneanalogiepragmatiqueentrelesfaitsénonciatifsetlesactions.Lasituationd’énonciationfinaleconçuecommeunesortededispute«rituelle»(adam1991:111)peutdevenir l’objetd’unerecherchedurapportentrele«dit»etle«fait»:voirquelspa-ramètres sonoresdecette ritualisation(répétitions,accélerationsdudébit,syllabationsouvocalisationsdesmots)traduisentquels

Šotra-Katunarić T.
438
états affectifs (bouleversments, énervements, suffocations, apha-sie),quelsmouvements,gestes,mimiques.
aforcedesuivreladécompositiondecediscoursthéâtralsi l’ap-prenant accomplit ses tâches à court terme en classe il est conduit àconfirmerouàrenoncerà seshypothèsessur ladestructiondusystè-mepensée-langage.pourcontrôlerconfirmer,ourenoncerà ses idéesetsesémotions,pour«s’autorenforcer» ilest forcément introduitdansl’interactionavecceuxdesonalentoursimmédiat,aucoursdelaquelleil adopte les techniquesde coopérationdes stratégies socio-affectives.contrairementàcequisepasseaveclediscourssurlascènequisefige,lesactivitésdéclenchéesparlalectureàdiversniveauxmènentl’appre-nantauseindelacommunicationinteractive.
La troisème étape – essais de macro-lectures (iteraction lecteur-texte)
Les démarches pédagogiques de la lecture autonome font appel àl’observation,à l’apréhension,à lacognitiondetexteetdesastructurecomplexe.
L’approchestructuraliste,quisupposequelesensestimmanentàlastructureetqui,avanttout,imposeuneanalyseformelleglobal,adonnéàladidactiquedelalectureunnombreconsiderabled’outilsetdenou-vellestechniques.ilsserventaumêmeobjectif:sensibiliser l’apprenantàdesdonnéesdel’ensembledutexte,luiapprendrelesstratégiesd’unemacro-lecture pour l’approcher aux sensmultiples et à l’esthétique del’oeuvre.
L’enseignant continue, donc, à instruire l’apprenant comment ob-serverlacomposition,découvrircertainesloisdanslamacro-structure,trouverlesgrandeslignesdelapièce,l’enchaînementetlalongueurdesscènesetdeséquences,leschangementsderythme,lesindicesdelocali-sationspatiale.Lesstratégiesdelectureunefoisacquises,l’apprenantre-courtàl’élaborationdesplansdelecture,àlamisedel’ensembledutexteenschémasou«entableaux»(«lalecturetabulaire»,adam1991:193).
Lalecturedutextedramatiqueexigeunetripleplanification:ducodeécrit,ducodesonoreetducodescénographique.Letravaildeschéma-tisation exigede l’apprenantuneperception concentrée auxdifférentsniveauxdudiscoursthéâtraletdenouvelleslecturesinteractives,(cettefois-ci,l’interactionsecréesurl’axelecteur-texte)
Lalecturesurleplanglobal

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
439
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
- le schémanarratif: structure (uncoupleanglais, lessmith,at-tendsesamisàdîner;lesinvités,undeuxièmecoupleanglais,lesmartin,arrivent;laservanteestaffairéepourlesservir;pendantqu’ilsdiscutentunpompier inattenduentreetperturbe la soi-rée;lasoiréesetermineenpêle-mêlequis’arrêtebrusquement;la scène finaleest la répétitionde la scèned’ouvertureavec lesmartinàlaplacedessmith).
- le schémadramaturgique: définir les séquences scéniques (xientout,délimitéesparlesentréesetlessortiesdespersonnages);analyser leplandesrépliques(longueurdesénoncés,massedemots,laprogressionsyntaxique,l’alternancedesénoncés,lapri-sedalaparoleparlesprotagonistesetc.);percevoirlesséquen-ces-clés(l’arrivéedesmartin,l’arrivée/ledépartdupompier);lechangementdurythmedujeu(entrées/sortiesdelaservanteetdupompier);accélérationdurythme-lepicdutragiqueexisten-tiel(scènefinalexi),
- leschémathématique:lafréquenceetlarépétitiondethèmes,laprogressionthématique,àpartirdelaroutineanodinejusqu’autragiquedel’ennui,(autermesheidegeriens,représentationvi-vante dunéant), la signification des thèmes dans la situationénonciative donnée, les superpositions et les juxtaposition dutragique/comiqueetc),
- classifierlesthèmescentrauxàconnotationstragiques:letragi-que individuel (existentiel, ontologique, cosmique), le tragiquesocial(ducouple,desrelationsfamiliales,desrelationsconven-tionnelles),
- classificationdeseffetscomiquesdebasetdehautniveauxselonbergson:«lecomiquedesformesetdesmouvements»(bergson1969:22-23),celuidecirque(gagsderépétitionsgestuellesetvo-cales),etlecomiquedesituationetlecomiquedemots(bergson1969:51)(jeuxdemotsrecherchés,quiproquo,calemboursver-sifiés,ironies,etc.),lecomiquedecaractère(«inadaptationdelapersonneàlasociété»,bergson1969:101).
–leschémadesituations énonciatives intra–scéniques:–analyserlesdéictiquesdepersonnes(quiparleàqui),l’activitédialogique
–découvrir les indicesde«la subjectivité (aliénation)dans le lan-gageetdes luiexdeses inscriptions»(kerbrat–orecchioni2002:39–163):travailsurlessubstantifs,lesverbesetlesadjectifs(ob-jectifs,subjectifs,évaluatifs,affectifsetc)lesadverbes

Šotra-Katunarić T.
440
–analyserles«apostrophes»(lafaçondontlelocuteurinterpellesoncolocuteurpourdéterminerlesrelationsinterpersonnelles),etlesrapportsdeslocuteursaveclaréalité,pourrepérerlesglissementdusensversl’absurd)etc.
–leplanpragmatique:–reperage des types d’actes de parole (information,menace, pro-messe,débat,dispute),etleurseffetspotentielsscéniques
–«l’étudedesrelationsexistantentrelessignesetleursutilisateurs»(kerbrat–orecchioni2002:205).
unelecture expressive–travailsurlalectureàhautevoixdupointdevuedidactiquede-mandelestechniquesdel’oralisationcorrectedetouslesparamè-tresparaverbaux(intonation,rythme,mouvementsvocauxetc)cequicorrespondenprincipeàl’entraînementàunebonnepronon-ciation, et une lecture expressive à l’appropriationde signifiantsnon–verbaux (pauses, cris, onomatopées etc.) comme le diraiteco(1979:92)onpeutdéciderdelasignificationd’uneénoncia-tion verbale d’après « /.../ des éléments tonémiques, la situationsociale(et)legeste(qui)peuventintarvenirenpriorité».
Lalecturesurleplanscénographique–repéragedesindicesexplicitesetimplicites,prétextespotentielsdeladispositiondesprotagonistessurlascène,deleursmouvements,gesticulation,mimiques
–notificationdel’ordredesapparitions/disparitionsdespersonna-ges,desindicationssurledécoretc.
Lalecture extratextuellesil’apprenantestforméenbonlecteurilsauralorsdesalecture,ma-
nipuler facilement toutes lesstratégiescognitivesmentionnéesycom-prisletransfertdesconnaissances.ainsi,La Cantatrice chauveàpartirdesessignificationsvirtuellespeut–elleluioffrirunlargechampd’élé-ments liés aux contextes encyclopédiques, littéraires, philosophiques,théâtraux,artistiques,qu’illiradansletexteetqu’ilpourraréinterpréterd’unemanièrecritique.
endidactiquedefLelarechechedessavoirsencyclopédiquesfaitpartiedes tâches àprolongement à long terme, c’est–à–diredu travailautonomehorsclasse.toutdépenddel’anglesouslequellelecteurabor-deletexte.ducoup,parseslecturesprolongéesunbonlecteurpeutlierlaproductiondramaturgiquedeionescoauxautresdomainesderéfé-rence,àsavoir:

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
441
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
–augenre«duthéâtredel’absurde»etsesreprésentantsdel’époque(beckett,adamov),
–authéâtresurréalisteetàtouteunegénérationà«l’écritureautoma-tique»,à la lignéed’écrivains,dramaturgesetpoètesqui l’avaientcréée(àpartirdeJarry,apollinaire,vitrac,cocteauetautres),
–augroupedepataphysiciensetauxiconoclastesmarquésparl’idéeconductrice sur lemondedunon–sensdans lequelonvit (dontionesco estundes représentants éminent)parmi lesquels:borisvian, raymond queneau, Jean baudrillard, marcel duchamp,maxernst,Jeanmiro,Jacquesprévertetautres,
–augroupe,nédumêmemouvement, intituléouLipo,(l’ouvroirdeLittératurepotentielle).certainsdestextesdeionescosontévi-dementanticipateursde«l’écritureàcontraintes»quipassionneraqueneau,georgesperec,calvinoetautres.
–àlagrandetraditionfrançaisecarnavalesqueetcelledelarenais-sance,àlalittératuredugenreburlesqueoùlesauteurscommelegrandrabelais, par exemple, commencent à faire des jongleriesaveclalangue,
–ou encore, lire ionesco comme un dramaturge postmoderniste,prédécesseur d’unnovarina et de son théâtre de la parole, sonthéâtrevide, incarnationde la vied’aujourd’huiqui estdevenue«uneapocalypseabsurdeetjoyeuse»(solers2002:9).
En guise de conclusion Lethéâtredeionescodeparsanaturepolyvalenteouvreunelarge
perspectivedelapluralitédereceptionsetd’interprétationsfantaisistes.notreapprochedidactiquen’apasd’autreambitionquedeproposer
aux enseignants/apprenants un points de vue qui ne prétendpas êtrel’approchecléd’entréedansl’espacevebraldenotreauteursouventmalcompris.parcetteprésentationdestratégiesdelecturesinteractivessurlecasdeionesco,nousvoulionsconduirel’apprenantàpénétrercoucheparcouchedanssonoeuvre,àutiliserspontanémenttoutesesconnais-sancesantérieures,àélargirsonchampsperceptif,às’entraineràréflé-chirauxproblèmes linguistiques,à repérer lesambiguïtés,àexaminersonintuitionlinguistique,àdresserseshypothèsessurlathématiquedel’absurde,àrésoudrelesdifficultésendiscutantaveclesautres,àadop-terunehabilitédedécomposeretderecomposer lesstructuresetd’enporterdesjugements,àhaussersescritèressuruneæuvred’art,àformersongoûtesthétique.enintégrantlesnouvellesconnaissancesilestcensé

Šotra-Katunarić T.
442
acquérir en français langueétrangèreunecapacité langagièrepourenraisonneretdiscuterenoraletparécrit.
enunmot,l’objectiffinaldenotreapprochedevraitmenérl’appre-nantàla«réorganisationdesastructurecognitive»(cornaire,germain1999:41),àtrasformerunapprenant/lecteurpassifenlecteur/co-pro-ducteur actif ce qui est le but suprêmede tout apprentissagedes lan-gues.
Bibliographie
adam1990:J-m.adam,éléments de linguistique textuelle, Liège:mardaga.adam1991:J-m.adam,langue et littérature,paris:hachette.benveniste1966:é.benveniste,Problème de linguistique générale, 1,paris:gal-limard.bergson1969:h.bergson,le rire, paris:puf.cicurel1991:f.cicurel,Lectures interactives en langues étrangères, paris:ha-chette.charaudeau,maingueneau2002:p.charaudeau,d.maingueneau,dictionnai-re d’analyse du discours,paris:seuil.cyr,germain1998: p.cyr , c.germain,les stratégies d’apprentissage, paris:cLeinternational.cornaire,germain1999:c.cornaire,c.germain,le point sur la lecture,pa-ris:cLeinternational.eco1979:u.eco,lector in fabula,paris:éditiongrasset&fasquelle.gardes-tamine,pellizza1998: J.gardes-tamine,m-a.pellizza,La construc-tion du texte,paris:armancolin.ionesco1954:e.ionesco,théâtre i,paris:gallimard.ionesco1966:e.ionesco,Notes et contre-notes,paris:gallimard.iser1997:w.iser,L’actes de lecture, Liège:madraga.kerbrat-orecchioni 1999: c. kerbrat-orecchioni, l’Énonciation, paris: ar-mandcollin.kramsch1984:c.kramsch,Interaction et discours en classe de langue,paris:credif/hatier.maingueneau1994:d.maingueneau, l’Énonciation en linguistique française,paris:hachette.o’malley,chamot1990:J.w.o’malley,a.u.chamot,Learning strategies in se-cond language acquisition,cambridge:cambridgeuniversitypress.paveau,sarfati2003:m.-a.paveau,g.-e.sarfati, Les grandes théories de la lin-guistique,paris:armandcolin.

Un espace verbal de théâtre à didactiser: le cas de Ionesco
443
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
29-4
43
novarina2003:ph.solers,drôlededrame,in: Le drame de la vie,coll.poésie,paris:gallimard,9-12.
Татјана Шотра-КатунарићДИДАКТИЗОВАТИ ПОЗОРИШНИ ВЕРБАЛНИ ПРОСТОР:
СЛУЧАЈ ЈОНЕСКОРезиме
Јонесковвербалнипросторизузетнобогат,показаосепогоднимзареализацијуди-дактичких циљева везаних за лингвистичке и књижевне анализе текста на универзи-тетскомнивоу. Јонескове језичкеигреомогућавајунаставникукоришћењееклектичкогдидактичкогприступа,астудентуотварајуразличитемогућностизавежбенасвимниво-има:фонолошком,морфосинтаксичком,семантичком,хеуристичком.
Циљ нашег дидактичког приступа тежи ка томе да код студента развије ефикаснестратегијечитањаЈонесковогпозоришногтекста,даотвориновеоквирезакомуникацијуиинтерпретацијуираднатекступутемразличитихдидактичкихпоступака(когнитив-ни,интерактивни,структуралистички,прагматички)итопоетапамарадећина:вежбамаперцепције/рецепцијеусменеивизуелне,продукцијеусменеиписмене,интерпретацијеитд).
Покушај дидактизације Јонесковог вербалногпростора требалобида код студентаподигнепрагмотивацијезаучење,дапреобразипасивногстудента/читаоцауактивногчитаоца/копродуктора.
Оваквимпредлогомжелелисмодаолакшамоучењефранцускогкаостраногјезикаидаприлагодимонаставуграматике/књижевностипринципимаданашњедидактике.
Примљено: 11. 02. 2011


445
УДКрад
Biljana StikićFaculté des lettres et des arts, université de Kragujevac
L’ACquISITIoN Du FLE ET LA CoMPÉTENCE DIScurSIVe: Sur LA MAîTrISe DeS GeNreS
DISCuRSIFS à L’oRAL
Le présent article traite la problématique de la compétencediscursiveetlamaîtrisedesesgenresprincipauxàl’oralenclassedefLeàtravers l’analyseducadreeuropéencommunderéfé-rencespour les langues etdes résultatsde certaines recherchesdans le domaine.alors que lamaîtrise des genres prend assezfacilementuneformeduprojetde laperspectiveactionnelle, leprincipedecoopérationditmaximesconversationnelles,quifaitpartieintégrantedelacompétencediscursive,exige,semble-t-il,d’autrescapacitésdesapprenants.
Mots-clés: fLe, compétence discursive, genres discursifs,françaisparlé,maximesconversationnelles,cecr
Lediscoursetladescriptiondufonctionnementdelalangueeninteractionsontàl’heureactuelleundesprincipauxchampsderecherchesdanslecadredelalinguistiquepragmatique.ilestànoterqueleprincipalpointcommundesdiversesapproches(philosophesdulanguageanglo-saxons,modèlecognitiviste,écolefrançaise)estlapriseencompte,dansl’analysedel’échangelangagier,dephénomènesintervenantdansl’interprétationdesénoncés,maisquenilasyntaxenilasémantiquenetraitent:notionsdecontexteetdesituationdecommunication,connaissancesd’arrière-planetinformationsextra-linguistiques,attributionderéférentsetdésambiguïsa-tion,déterminationdelaforceillocutionnaire,etc.Lapragmatiquepermetainsiderendrecomptedeprocessusnonspécifiquementlinguistiquesdel’interprétationdesénoncés(bracops2005:75).
1. Les compétences pragmatiques et le CECRLesrésultatsdecesapprochesetanalysessereflètent,dansunecer-
tainemesure,surladidactiquedeslanguesétrangèresdontl’orientation

Stikić B.
446
actionnelleavance,entreautre,ledéveloppementdestroiscompétencesdecommunicationlangagières.ellescomprennent,àleurtour,lescom-pétencespragmatiques(compétencefonctionnelleetcelledeconceptionschématique)parmilesquellescelleditediscursiveserévèlenotammentimportante en classedefLe.ellepermet à l’apprenantd’ordonner lesphrasesenséquencesafindeproduiredesensemblescohérents;ildoitêtrecapabledemanipulerlesprincipesselonlesquelslesmessagessontorganisés, structurésetadaptés.cettedéfinitionsimplifiéede lacom-pétence discursive embrasse pourtant des connaissances et capacitéssurplusieursniveauxtouchant lediscours, tellesquesonorganisationlogiqueet thématique, lestyleet leregistre(cecr2000:96).cequ’ilnefautpasnégligerc’estuneétroiteinterdépendancedescompétencespragmatiques,notammentlaforteliaisondelacompétencediscursiveetcelleditefonctionnelle:lastructurationd’undiscoursn’estqu’uneétapeduprocessuscommunicatifsuivieparuneautreétaperelativeàl’utilisa-tiondesmessages.deplus,onpourraitparlerdeleurimprégnationsurunedeséchellesduplandesmicro-fonctions(ouvrirledébat,prendrelaparole,etc.).
quantàl’échelleglobaledesniveauxcommunsderéférencesa1-c2,c’estàpartirduniveaub1qu’onexigelaproductiond’undiscourssim-pleetcohérentsurdessujetsfamiliers,alorsquelapleinecompétencediscursivedoitêtremaîtriséeauniveauc1oùl’apprenant-utilisateurex-périmenté«peuts’exprimersurdessujetscomplexesdefaçonclaireetbienstructuréeetmanifestersoncontrôledesoutilsd’organisation,d’ar-ticulationetdecohésiondudiscours»(cecr2000:25).L’échelled’as-pectsqualitatifsdel’utilisationdelalangueparléeconcernel’étendue,lacorrection,l’aisance, l’interactionetlacohérence.pourcequiestdeladernière,onpartdepuisleniveaub2oùl’apprenantutiliseunnombrelimitéd’articulateurspourliersesphrasesenundiscoursclairetcohé-rent bienqu’il puisse y avoir quelques «sauts»dansune longue inter-vention,tandisqueleniveauc2estl’étapedeproductiond’undiscourssoutenucohérent:l’apprenantutilisedemanièrecomplèteetappropriéedesstructuresorganisationnellesvariéesainsiqu’unegammeétenduedemotsdeliaisonsetautresarticulateurs.L’aisanceappartientauxniveauxc:depuisunespontanéitépresquesanseffortjusqu’àundiscoursnatu-relpendantlequelonestcapabled’éviterlesdifficultésoudelesrattraperavecassezd’habiletépourquel’interlocuteurnes’enrendepresquepascompte(cecr2000:28).
Larevuedece«paysageréglementaire»noustémoigned’unegran-de attention que la nouvelle orientation didactico-pédagogique prêteau développement des compétences langagières chez les apprenantsd’une langueétrangère.mais, c’est à la fois le témoignaged’unchamp

L’acquisition du FLE et la compétence discursive: sur la maîtrise des genres discursifs à l’oral
447
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
45-4
52
derecherchesassezouvertoùl’ons’attendàrépondreprécisémentàdenombreusesquestionstoutàfaitpratiques,c’est-à-direlesappliquerenclassedefLe.LesauteursduCadre européen «n’ontmis en reliefquel’importancede laproblématique»des genresdiscursifs enbloc, alorsque lesdidacticiens la traitentplusprofondémentet ladéveloppent.ilfautconstaterquelesrésultatsdiffèrentselonlesapprochesetcontextesd’apprentissaged’unelangue.aussideschercheursdonnent-ilsunecer-tainepréférenceàlacompétencediscursiveàl’écrit,àsavoiràlamaîtrisedesgenresécritsquisontasseznombreux.L’oralestuncodedistinctquiasespropresmodalitésdefonctionnementetnousletrouvonsparticu-lièrementutileauprocessusdel’insertiondel’axeprincipaleducecr-cequiestlapédagogieduprojetetl’apprenantentantqu’acteursocial.et pourque celui-ci devienneun acteur social déjà en classedefLe,ilfautqu’ilaitl’expériencedansdessituationsqu’onl’onpourraitnom-mer«sociales»etquiexigentuneviveparticipationdesapprenants,enincluantnonseulementleurscapacités langagièresetcommunicatives,maistoutesleursactionsdeniveauxvolitifsetcognitifs.
2. Un coup d’œil sur les caractéristiques des genres discursifsperçuentantquecatégorisationde lacommunicationverbale,un
genrediscursifconstitueuneunitécommunicativeetlinguistiquecom-poséedesegments,dontlafonctionestd’effectueruneactionlangagière.pourcequiestdesgenresdiscursifsàl’oral,leurlisten’estpascomplète,maisonadmetgénéralement l’existencededeuxtypesdegenres:ceuxquidéterminentletypedel’interactiondonnée(lecadresituationneldel’échange)etceuxquisontresponsablesdesactivitésdiscursivesauxquel-lesrecourentlessujetsparlantsdansuneinteractiondonnée,àsavoirlesoutilslinguistiquesparlesquelslesinterlocuteurstransmettentleursin-tentions.àladifférencedesgenresàl’écrit,lecodeoralestétroitementliéaucontexteextralinguistiquedel’échangeetpourcelamoinsexplicitequel’écrit.sadynamiqueprovientaussidenombreuxinachèvements,defauxdéparts et des autocorrections.parminombreux typesd’activitésinteractivesàl’oral,onréaliseleplussouventlaconversation,ladiscus-sion,ledébatetl’interview.Laconversationreprésentelaformelapluscourantedel’échangeverbal.ellesefondesurleprinciped’égalitéentrelesinteractantsetsecaractériseparunefortesymétriedesplacesentrelesparticipantsà laconversation.cequidistinguelaconversationdesautresgenresdiscursifsàl’oral,c’estsoncaractèrelégerquisemanifestepardesrires,différentesintonationsauseind’unmêmeéchangeetdesindices d’harmonisation des propos des interlocuteurs. La discussion,commeun cas particulier de la conversation, est plus focalisée sur lafonctionargumentativedudiscours: les interlocuteursagissent lesuns

Stikić B.
448
surlesautresdanslebutd’imposerleurspropresopinionsàproposd’unsujetparticulier.Ladiscussionpeutêtreorientéesoitverslacoopération(rechercherunconsensus)soitverslacompétitivité(débouchersurunedispute).Ledébatconstitueuntypedediscoursparticulier.ilestplusformeletplusorganiséqueladiscussionparceque,mêmes’ils’agittou-joursdedébattreunequestion,ilsedérouledansuncadreplusprécisé-mentdéfini.salongueuretdurée,lenombredeparticipants(ycomprislepublic),l’ordredestoursdeparole,demêmequelesujetdel’échange,sontfixésàl’avance.deplus,lafinalitédudébatestpurementexterne:en ralliant le public à ses opinions, on combatmieux son adversaire.L’interviewsecaractériseparladissymétriedesrôlesinteractionnelsdesesparticipants:l’intervieweurapourtâchederecevoirdel’interviewécertaines informationset celui-cidoit les lui fournirpar ses réponses.celainfluenceaussisastructure:elleestbeaucoupmieuxstructuréequelaconversation,ilyamoinsdechevauchementsdeparole,moinsd’in-dicateurspragmatiques,moinsdephrases inachevées,àsavoirc’estunensemblebeaucouppluscohérent(kucharczyk2009:79).
2.1. la compétence discursive en classe de langue
tous ces genres ou activités interactives, qui sont présents depuislongtempsenclassedelangue,peuventêtretransposésdansunprojetdontlesréalisateurssontlesacteurssociaux,c’est-à-direlesapprenantseux-mêmes.Lapédagogieduprojetcomprendtoujoursuncertainnom-bred’étapesdontlaréalisationpasseàtraversdestâchesàaccomplir(ter-mepropreàl’orientationdidactiquedeslanguesdepuislesannées1990).Leprojetrelatifàundesgenresdiscurifsàl’oraladoncsastructurequine s’opposeaucunementauxprojetsde typeactionnel; il comprend lamiseensituation,laproductioninitiale, lesdifférentstypesd’exercicesainsiquelaproductionfinale.bienqueleprojetdoiveêtre«uneœuvredidactiquespécifique»desapprenants,c’esttoujoursl’enseignantquisechargedelapréparationdumatérieletdudéroulementprévuduprojet.eneffet,lesapprenantsvonts’engager,leplussouventpargroupes,dansla conceptionet la réalisationduprojet, sous formed’uneproductionlangagièreorale(etécrite)d’ungenredéfinià l’avanceparl’enseignantquipartdesconnaissancesdesapprenants,deleursreprésentationsini-tialesdugenrechoisi,etlesdirigeverslamaîtrisedescompétencesenvued’uneproductionfinale.
2.1.1. Lamiseensituationcetteétapeesttoujourscelledepréparationetd’initiationdansun
genrediscursifchoisi(pourdesraisonspratiquesc’estledébat).elledoit

L’acquisition du FLE et la compétence discursive: sur la maîtrise des genres discursifs à l’oral
449
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
45-4
52
êtreconsidéréecommelaplusimportantepourunbonaboutissementduprojetpuisqu’ils’agitdestâchesincluantleprocédédereconnaissancedecaractéristiquesdugenre,sonidentificationousadécouverte.danslesmeilleuresconditionsd’apprentissaged’unelangueétrangère(excep-télapossibilitéd’assisteràundébatauthentique),l’enseignantseprocureunmatériel audio-visuel prototypiquedu genre qui sera présenté auxapprenants.mais, leplussouvent lesconditionsde travailnesontpasoptimalesetl’onn’utilisequ’undocumentsonoreou,aupisaller,uncor-pusdetextesquidevraêtreanimé.aprèsunpremierrepérageduma-tériel, l’enseignantdiscuteavec lesapprenantsde leurs représentationssurlegenre,cequiexclutunrepéragerelatifàdesformeslinguistiques.c’estvraimentunemiseensituationoulaphasedesensibilisation.Latâ-chedusecondrepérageseraitenrichied’unsupporttextuelenformedequestionnaireoudegrillesàremplir,unesortededispositifd’interpréta-tiondudébat,avecdesnotionsconcernantsescaractéristiquesprincipa-lesàconstater(participants,sujet,toursdeparole,atmosphère,certainesformeslinguistiques,etc.).
2.1.2. Laproductioninitialeelledevraitêtreprécédéed’uneprésentationdel’objectifduprojetet
desformesdetravail.Lespremièresproductionsconcernenttoujours l’essentield’undé-
bat: c’estun sujetquiopposedeuxadversaires.pourcette raison, l’en-seignantchoisitunsujetdetelgenrequiestenmêmetempsfamilieretintéressantauxapprenants,àsavoirquelquechosede«trèsimportant»pourqu’ilspuissentenexprimerleuravis.aprèsavoirdivisélaclasseendeux(lesunsquisont‘pour’etleurs‘adversaires’),l’enseignantdistribueunsupporttextuelavecdesquestionspourchaqueapprenant,quiser-viradebasededébatdirigéparl’enseignant.cettetâchen’estriend’autrequ’un essai pendant lequel émergent toutes les sortes de fautes,maisaussilavolontédesapprenantsprendrepartàun«jeucommun».c’estlaséquencedidactiquependantlaquelleondécouvreledébatenprati-que,maisilfaudral’expliquer,lacorriger,lamaîtriser,cequiappartientàl’étapeduprojetrelativeauxexercices.
2.1.3. exercicesils peuvent embrasser différents types d’activités ou de tâches, en
particulier cellesqui touchent lematériel linguistiquenécessairepourparticiperefficacementàundébat.Laconnaissancedecertainsgroupesd’actesdeparole,parexemple,yestindispensable.aussil’enseignantin-siste-t-ilsurd’autresquestionsconcernantle lexiqueet lesbesoinsdes

Stikić B.
450
apprenants.Leplus souvent,onprocèdeà ladidactisationd’undocu-mentaudio-visuelousonoredonnépourqu’ildoitsoumettreàuneana-lyse de caractéristiques du genre, c’est-à-dire du cadre situationnel del’échangeetdesoutilslinguistiquesparlesquelslesinterlocuteurstrans-mettentleursintentions.ilfautsoulignerquelaprofondeuretl’exhaus-tivitédecetteactivitéglobalecomprenantdestâchesvariéesàremplirdépenddeplusieursfacteurs,telsquelesparticularitésetlecontenududocumentparrapportauxconnaissanceslangagièresdesapprenantsetleurscapacitéscognitives.
2.1.4. Laproductionfinaleil s’agitde l’aboutissementduprojet cequipermetd’appliquer les
connaissancesacquiseslorsdesétapesprécédentesetdefaireuneéva-luation sommative. en travaillant en groupes, les apprenants aurontquelquestâchesàaccomplirdontlaprincipaleestlaproductiond’undo-cumentdugenreétudiéquiserviradesupportpendantlaprésentationoraleàlaclasse.cequiestd’unegrandeimportancedanscettephasec’estlerespectdescaractéristiquedegenre.vuleprogrèsdesnouvellestech-nologies, ilestdésirableque laprésentationsoitenregistréepourfairepartieduportfoliodesapprenants.celaveutdirequecedocumentde-vientàlafoisunesortedematérielpédagogiqueexploitablededifféren-tesfaçonsparlesapprenants,àsavoirdansdessituationsd’apprentissageexigeantl’amplificationdeleursconnaissancessurlesgenresdiscursifsàl’oraloubienentantquematérielutilepourd’autresapprenants.
3. Les maximes de grice en classe de langued’aprèslececr,lacompétencediscursiveconcerneaussileprincipe
coopératif(oudecoopération)degrice:«chacundesinterlocuteurss’ef-forcedecontribueràlaconversationdefaçonrationnelleetcoopérativeafindefaciliter l’interprétationdesénoncés.»rappelonsquelesmaxi-mesconversationnellesrégissentlesrapportsentrelesinterlocuteursquiparticipentàuneconversationcommuneetfontdoncpartieintégrantedechacundesgenresdiscursifsà l’oral.pourcetteraisonellesdoiventêtreinclusesdansleprocédédemaîtriseparlesapprenants,maisd’uneautrefaçonvuleurscaractéristiquesetniveauxderéalisation.
Lamaximedequantitéordonnequechaqueintervenantdoitdon-nerautantd’informationsquenécessaireetpasplus:unmanqued’infor-mationsestpréjudiciableà lacommunication,maisunepléthored’in-formationspeut faire dévier la conversation vers des points dedétail,ouamener l’interlocuteuràconclureà tortquecetexcèsestdûàuneraisonparticulière.Lamaximedequalitérecommandequetoutecontri-

L’acquisition du FLE et la compétence discursive: sur la maîtrise des genres discursifs à l’oral
451
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
45-4
52
butiondoitrépondreauxconditionsdevéridicitéetdebien-fondé:cha-queintervenantdoitêtresincère(doncnepasmentir),etparleràbonescient,c’est-à-direavoirbonnesraisons(despreuves)poursoutenircequ’ilaffirme.Lamaximederelationoudepertinencechargequecha-queintervenantdoitêtrepertinent,parleràpropos,àsavoirémettredesénoncésenrelationaveccespropresénoncésprécédentsetavecceuxdesautresintervenants,tandisquelamaximedemanièreoudemodaliténeconcernepluscequiestdit,maislamanièredontleschosessontdites:chaqueintervenantdoits’exprimerclairement,sansobscuriténiambi-guïté,avecconcisionetenrespectantl’ordrepropiceàlacompréhensiondesinformationsfournies(bracops2005:77-78).bienqu’ellesoitnéces-saire,lamaîtrisedesmaximessembleêtreparticulièrementdifficileenclassedelangueauxobjectifsgénérauxetd’unniveaudeconnaissancesinférieuràb1.ilfautyajouterl’âgedesapprenants,àsavoirleurscapa-citésindispensablespourreconnaîtreetappliquerceprincipedecoopé-ration.
4. ConclusionLamaîtrise des genresdiscursifs à l’oral dans le cadrede la com-
pétence discursive fait partie des projets de la perspective actionnellequelesapprenantsentantqu’acteurssociauxréalisentenclassedefLe.bienqu’ilssoientàlafoislesréalisateursduprojet,lerôledel’enseignantestd’unegrandeimportancenotammentenphasedesapréparationetdel’initiationaugenre.Lestâchesàremplirs’adaptentauxbesoinsdesapprenantsettiennentcomptedescaractéristiquesdesgenresdepuislamise en situation jusqu’à l’aboutissementduprojet. L’acquisitionde lacompétencediscursiveconcerneaussileprincipedecoopérationquisereflètedans lesmaximesdegrice.vu leurscaractéristiques, il semblequeleurmaîtriseintentionnelleappartienneàunniveauplusélevéd’ap-prentissaged’unelangueétrangère.
Bibliographie
beacco 2004: J.-c. beacco, trois perspectives linguistiques sur la notion degenrediscursif,Langages,153,paris:Larousse,109-119.bracops2005:m.bracops,Introduction à la pragmatique: les théories fondatri-ces: actes de langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée,bruxelles:deboeck.cecr2000:cecr,un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer,conseildelacoopérationculturelle,comitédel’éducation,divisiondeslanguesvivantesdestrasbourg,paris:didier.

Stikić B.
452
kucharczyk2009:r.kucharczyk,verslacompétencediscursiveàl’oralenclas-sedefLe,synergie Pologne,6,krakow:gerflint/instytutneofilologiiakade-miapedagogiczna,77-89.roulet1999:e.roulet,uneapprochemodulairedel’enseignement-apprentis-sagedelacompétencediscursive,in:actas do 40 encontre Nacional do ensino das Linguas vivas no ensino superior em Portugal,porto:faculdadedelettrasdauniversidadedoporto,19-27.
Биљана СтикићУСВАЈАЊЕ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ДИСКУРСНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ОВЛАДАВАЊЕ
ДИСКУРСНИМ ЖАНРОВИМА У ГОВОРНОМ ФРАНЦУСКОМ
РезимеУовомрадусеразматрапроблематикадискурснекомпетенцијеиовладавањењеним
основнимусменимжанровимауразредуфранцускогкаостраногјезика,путеманализеЗЕРОЈ-аипојединихрезултатаистраживањаудатојобласти.Доксеовладавањежанро-вимарелативнолакоостварујеуоквируразреднихпројекатаакционеперспективе,прин-ципкооперацијетј.конверзационемаксиме,којесусаставнидеодискурснекомпетен-ције,захтевајуинекедругеспособностиученика.
Примљено: 31. 01. 2011.

453
УДКрад
[email protected]@gmail.com
Ivona Jovanović, Aleksandar MilivojevićFaculté de tourisme et d’ hôtellerie, université du Monténégro / Faculté de
tourisme et d’ hôtellerie, université du Monténégro
LA forMATIoN DeS GuIDeS-INTerPrèTeS Au MoNTéNéGro-éLABorATIoN D’uN référeNTIeL
DE CoMPÉTENCES
Lemonténégrodevientcesdernièresannéesunedestinationtouris-tiquedeplusenplusrecherchéesurlemarchéfrançais.afindemieuxrépondreauxdemandesdenombreuxvisiteursfrançaisdésirantdécou-vrirlepatrimoinedupays,lesagencesréceptivesontbesoindeplusenplusdeguides-interprètesmaîtrisantlefrançais.
enpartantdesdonnéesstatistiques,cetarticleapourobjectifd’iden-tifierlescompétenceslangagièresnécessairesqu’unguideinterprètede-vraitposséderafindepouvoirassurerenfrançaislaprésentation,l’inter-prétationetlavalorisationdupatrimoinemonténégrin.
aumoyendelaméthodecomparative,deuxdispositifsdeformationdeguidessontprésentéssuivisd’unmodèled’évaluationdecompétenceslangagièresrecommandéparlafédérationeuropéenned’associationsdeguides.finalement,unréférentieldecompétencesélaborépourlesgui-des-interprètesestproposé.
Mots-clés:guidetouristique,compétenceslangagières,languefran-çaise
IntroductionL’économiedumonténégroestessentiellementorientéeversledévelop-pementdutourismeentantqueproduitstratégiquedupays.Lesreve-nusdutourismereprésentent16%duproduitnationalbrutetlesecteurtouristiqueestégalementdeloinleplusimportantemployeurdupays.
selonlesdonnéesrécentesdel’institutnationaldelastatistiquedumonténégro(monstat),lamajoritédesvisiteursétrangers1provientdelafédérationderussie,maislestouristesfrançaissontenaugmenta-tionpermanentedepuislesdernièresannées.en2009,33000visiteurs
1 Les touristes en provenance des républiques ex-yougoslaves n’ont pas été pris en consi-dération.

Jovanović I, Milivojević A.
454
françaisontréalisé194000nuitées,cequireprésentaituneaugmenta-tionde32%parrapportàl’annéeprécédente.en2010,enpleinecriseéconomiquedanslepays,lenombredenuitéesdestouristesfrançaisaaugmenté à 260 000, ce qui représente de nouveauune croissance deplusde30%parrapportàl’annéeprécédente.selonlesdéclarationsdel’ambassadricedefranceaumonténégrodominiquegazuidanslequo-tidiennational«pobjeda»endécembre2010,laclientèlefrançaiserap-porteaumonténégroenmoyennede15à20millionsd’eurosparan.Lacompagnieaériennenationale«monténégroairlines» témoigneégale-mentdel’affluxdevisiteursfrançais.eneffet,entroisans,lenombrederotationsdesvolspodgorica-paris-podgoricaettivat-paris-tivataplusquedoublé2.
en analysant Le rapport de réalisation d’excursions culturelles des visiteurs étrangers au monténégro3,ons’aperçoitquelesclientsfrançaissont les plus importants «consommateurs» d’excursions. pendant leurséjouraumonténégro,chacund’entreeuxréalise2,2excursions,cequilesdistingueconsidérablementdesautresclientseuropéens.selonuneenquête réalisée par l’organisation touristiquenationale, 62%de visi-teursfrançaisavaientchoisi,aumonténégro,en2008,devisiterlessitesayant une valeur historique et artistique. contrairement aux visiteursprovenantde l’europedunord etde l’ouest (allemands, scandinaves,autrichiens),quichoisissentdavantageunedestinationafindepouvoiryprofiteressentiellementdusoleiletdesplages,lesfrançaissontbeau-couppluscurieuxlorsqu’ils’agitdeladécouvertedupatrimoineculturelethistorique.d’oùunedemandeaccruecesdernièresannéesdepresta-tionsdevisitesguidéesainsiquedeguides-interprètesqualifiésenlan-guefrançaise.
actuellement, leministèredu tourismemonténégrin (en collabo-rationavec les facultéschargéesde laprocéduredecandidatureetdesépreuvesd’admissiondesguides-interprètes)neparvientpasà formerle nombre suffisant de guides compétents qui seraient enmesure derépondre auxbesoinsdumarché francophone.de ce fait, les agencesdevoyage localessontsouventcontraintesd’importer lesguidesman-quantsdespaysvoisins(serbie,croatie,bosnie...).afinderemédieràcettesituation,nousavonsestiméqu’ilétaitindispensablederéactuali-serlescontenusd’enseignementdesguides,notammentlesprogrammesconcernant l’enseignementet l’évaluationdes languesétrangères. dans
2 102volsontétéréalisésen2007;208volsen2010.3 Les données proviennent de «adriatic express», la plus importante agence de voyage
aumonténégro,quiaccueilleplusde27000clientsparan.

La formation des guides-interprètes au Monténégro-élaboration d’un référentiel de compétences
455
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
53-4
64
cesens,laréalisationd’unprojetderéférentieldestinéàlaformationdeguides-interprètesnousasembléindispensable.
Les épreuves d’admission et la formation des guides-interprètes au Monténégro
La formationdesguides-interprètesaumonténégrorelèvedumi-nistèredutourisme,lequelorganiseannuellement,encollaborationaveclesfacultésdetourismeetd’hôtelleriedekotoretdebar,desépreuvesd’admissionsuiviesdecourspréparatoiresàunexamenenvuedel’ob-tentiondelacarteprofessionnelledeguide-interprètenational.cetexa-men, organisé conformément aux règles du programme promulguéesparleministèredutourisme,consisteenonzeépreuvesdontl’uneestenlangue(s)étrangère(s).aprèslapublicationdesrésultats,leministredutourismedélivreauxcandidatsadmislediplômenationaldeguide-in-terprète(pouruneouplusieurslanguesétrangères),valablesurl’ensem-bleduterritoiremonténégrin.
L’unedesconditionsd’inscriptionestunebonnepratiquede l’uneoudeplusieurs langues étrangères, ceque les candidatsprouvent lorsdesépreuvesd’admission.contrairementàdenombreuxautrespays,iln’estpasindispensableaumonténégroquel’unedeslanguesétrangèressoitl’anglaisouuneautrelangueinternationale.Lerèglementactuelpré-ciseque lecandidatdoit fairepreuved’une«bonnepratique»de l’uneoudeplusieurslanguesétrangères.celle-ciestévaluéeparuntestsousformeécrite,ainsiqu’àl’oral,devantunjuryconstituéd’enseignantsdelangueétrangèredelafaculté.
enréalité,l’examend’entréeconsisteenunebrèveprésentationécri-teducandidat suivied’unentretiendirigéde10mnen langueétran-gèreavecl’examinateur.L’enseignantévaluesilecandidatestenmesuredeseprésenteràl’écritetdecommuniqueraveclestouristesétrangersen leur fournissantunmaximumd’informationsspécifiques. il évalueégalementlaprononciationducandidat,laphonétique,laprosodieetlafluiditédelaparole.
Les conditions d’admission et le programme de formation en langues étrangères des guides-interprètes en France
contrairement aumonténégro, où jusqu’à présent une réelle for-mationuniversitairedeguides-interprètesn’apasencorevulejour,unedizained’universitésfrançaisesorganisentleurformationsurunanoudeuxsemestres.alorsqu’ilsuffitd’êtretitulaired’undiplômedebache-

Jovanović I, Milivojević A.
456
lieraumonténégropourêtrerecruté,lesprérequispourêtreadmisenfrance sont un diplômenational ou d’état sanctionnant deux annéesd’études après le baccalauréat dans les domaines de l’histoire de l’art,archéologie,médiation culturelle, communication, tourisme-loisirs oulangues étrangères. afin de s’inscrire en france, dans lamajorité desuniversités, les candidatsdoivent également avoirunebonnepratiquedeslanguesétrangères(dontobligatoirementl’anglais)etpasserunen-tretienportantsurlaculturegénérale.àl’universitédeParis-est mar-ne la vallée parexemple,surunvolumede636heuresd’enseignementthéorique,unmodulede192heuresestréservéàl’apprentissagedeslan-guesétrangèresappliquéesautourisme.L’anglaisestobligatoirementlapremièrelangueétrangèretandisqueladeuxièmelangueétrangèreestauchoixdescandidats(ilsontlapossibilitédechoisirentrel’allemand,l’italienoul’espagnol).Laformationdesguides-interprètesàl’université d’angers,organiséesurunan,correspondà60ects,dont20ectssontréservésauxlanguesétrangères.Leprogrammed’enseignementprévoitl’entraînement des candidats aux techniques de l’expression théâtrale,ainsi qu’à la présentationdupatrimoinehistorique et culturel en lan-gueétrangère.àl’universitédeLyon2,sur614heuresd’enseignementconsacréesàlaformationdesguides,68heuressontdédiéesàl’enseigne-mentdel’anglaiset54heuresàladeuxièmelangueétrangère.Lesappre-nantss’entraînentàpratiquerunelanguegrammaticalementcorrecteetacquièrentunvocabulairecultureldebasepropreàunecivilisationafindepouvoir l’adapter àdes situationsdeguidage.pendant les coursdelanguesétrangères,lescapacitésd’expressionoralessontprivilégiées.
Les compétences langagières requises et les principes généraux d’évaluation à la F.E.g
afind’évaluerdefaçonpertinentelescompétenceslangagièresdesfutursguides,laFédération européenne d’associations de guides touris-tiques(feg),fondéeàparisen1986,prescritladuréeainsiquelana-ture des épreuves. L’examenqui dure de 30 à 40minutes au total, estrépartien4épreuvesquiportentprincipalementsurlacompréhensionetlaproductionoraleainsiquesurlacompréhensionécrite.enpartantduprincipeque lemoyende travaild’unguideestessentiellement«lemicro»etqu’iln’aqu’exceptionnellementbesoindes’exprimerparécriten langue étrangère, lafega considéréqu’iln’étaitpas indispensabled’évaluerlaproductionécrite.
partiea: entretiendirigéayant traitàdes situationsde laviequoti-dienneetdeguidage

La formation des guides-interprètes au Monténégro-élaboration d’un référentiel de compétences
457
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
53-4
64
dans cette première partie qui dure environ 10minu-tes, il s’agit d’évaluer les compétences langagières généralesducandidat.Lecandidatestamenéàrépondreauxquestionsconcernantdenombreuxaspectsdumétierdeguide-inter-prèteainsiqu’auxquestionsquotidiennesquipeuventluiêtreposéesparuntouristeétranger.
partieb: monologuesuivi
Lecandidatdoiten5à10minpréparerunbrefexposésurunthèmeauchoix(parexemple,présenterlepatrimoinecultureld’uneville,uneéglise,unédifice,unpaysage,etc.).ila5minàdispositionpourleprésenteraujury.ilpeutseservirdenotes,sanslesliretoutefois.sonexposédoits’adres-serauxvisiteursétrangers,toutenétantvarié,intéressantetamusant.L’examinateurpeutuneoudeuxfoisinterromprelecandidatafindeluiposerdesquestionsouluidemanderdesexplicationssupplémentaires.
partiec: traductionorale
danscettepartiequidureenviron7minutes,lesexami-nateurs donnent au candidat undocument authentique enlanguematernelled’unecentainedemots,qu’ildoitlire,tra-duireetexposerenlangueétrangère.Lecandidata2minutesàsadispositionpourseprépareravantlatraductionorale.
partied: compte-rendud’untexte
aprèsavoirluen3minutesuntexteauthentiquede250mots environ en languematernelle (provenant d’un guide,d’une brochure touristique, etc.), le candidat dispose de 5minutespourréaliseruncompte-renduoraldutexteenlan-gueétrangère.ildoitutilisersespropresmotssanstoutefoismodifierlecontextegénéralducontenu.L’examinateurpeutdonneréventuellementaucandidatdesexplicationssupplé-mentaires,aucasoùilluisembleraitquelevisiteurétrangerneseraitpasenmesuredecomprendrelesujetprincipal.
aucoursdesépreuves,lesexaminateurs(lejuryestcomposéd’unexaminateurnatifetd’unguide-interprèteexpérimenté)semettentenpositiondevisiteursétrangersquinecomprennentpaslalanguelocale.ilsexigentducandidatunecorrectiongrammaticaleainsiqu’unénoncécohérent, un débit régulier et une prononciation claire. toutefois, uncertainnombredepetites fautessyntaxiquespeutêtretoléré.Levoca-

Jovanović I, Milivojević A.
458
bulairedoitêtresuffisammentrichepourquelecandidatpuissedema-nièreauthentiquedonnerunedescriptionpréciseetintéressantedusitevisité.
Élaboration d’un projet de référentiel destiné aux guides-interprètes au Monténégro
afindepouvoirrépondreàl’environnementconcurrentieldutou-rismeetà lademandeaccruedeprestationsdevisitesguidées, ilnousasembléindispensabledeconstituerunréférentieldestinéàlaforma-tiondesguides.ils’agitd’uninventaired’activitésprofessionnellesetdecompétenceslangagièresquelesapprenants-futursguides-devraientindispensablementmaîtriser.Leréférentielconstitueégalementunoutilquipermetd’évalueretdevaliderdescompétencesainsiquedeprescriredesprestationsdeformation.ilestutilisableàpartird’unesoixantained’heuresdefrançaisgénéral.
Lorsdel’élaborationduréférentielenquestion,lesauteursn’ontpaspris uniquement en considération les éléments de compétences pro-fessionnelles liésaumétierdeguide-interprète,maisaussiceuxliésaumétierd’accompagnateurdegroupes,s’agissantdeprofessionssimilairesayantdenombreuxpointscommuns.
Lagrilleduréférentielquisuitestdiviséeentroiscolonnesrelatantles:
1. objectifs professionnels (compétences générales d’un guide etcompétencesculturelles)
2. objectifscommunicatifs3. objectifs linguistiques (compétences langagières: grammaire,
lexiqueetvocabulaire)
objectifsprofessionnels(savoirsetsavoir-faire)
–connaîtrel’histoire,lepatrimoinematériel,immatérielet/ounaturellocal–rechercher,identifieretvaloriserlesatoutsdevotreville,devotrerégion,
devotrepays–Êtrecapablederechercheretdemaîtriserlesélémentsculturelsetlinguis-
tiquesquiserventàorganiserunevisite–connaîtrelecadreréglementairedelaprofessiondeguide–savoirplanifierleshorairesdesvisitesetdudéroulementdelajournée–savoirorganiserdesinformationsetpréparerunevisitecommentée

La formation des guides-interprètes au Monténégro-élaboration d’un référentiel de compétences
459
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
53-4
64
–savoirchoisir,présenter,justifierl’intérêtd’unitinéraire–savoirévaluerletempsetlesdistances–savoircommuniqueroralementavecdesclientsenmettantenapplication
lescritèresdelacommunicationprofessionnelle–savoiranimerlegroupe–savoirtenirl’attentiondugroupetoutlelongdevisite–savoirtraiterdessituationsdélicates–savoirs’adapteraupublic–savoircaractériserlegroupedevisiteurs
objectifscommunicatifs
–accueillir–prendrecontact
*seprésenter,souhaiterlabienvenue*présenterenbrefleprogrammedevisite
–informer–renseigner
*surlesformalitésdupays*surleshorairesdelavisite*renseignersurl’histoired’unevilleoud’unerégion,parlerdesonéconomie
–Localiser,situer *indiquerlaposition,lelieu,larégion,laroute,l’itinéraire*expliqueràl’aided’unplan,d’unecartegéo-graphique
–présenter,décrire,nom-mer
–raconter,commenter–indiquer–apprécier
*unpays,unerégion,uneville,unsitetou-ristique,unmonument,unclimat,unévè-nementhistorique,uneréservenaturelle,unrestaurant,unhôtel*raconterlégendes,anecdotes,épisodescu-rieuses
–expliquer–argumenter
*lesraisonsdudéroulementdesfaitshistori-ques*lesraisonséventuellesd’unmalentendu*lesraisonséventuellesd’unproblème
–conseiller,proposer–recommander
*proposerdesactivités,*recommanderunrestaurant,unhôtel,unsiteàvisiter

Jovanović I, Milivojević A.
460
objectifslinguistiquesgrammaire Lexiqueetvocabulaire
expressionspour:
*indiquerlaposition(parrapportauspec-tateur:à votre gauche, en face de vous…,parrapportàd’autreslieux:devant, derrière, un peu plus loin…)
*indiquerladatedeconstruction(la construction a été terminée en..., il a été construit, il date, il remonte…,souslerègne,entre le 12ème et le 15ème siècle…)
*indiquerl’affectationactuelled’unédificeoud’unmonument(il abrite le musée… il est utilisé pour…)
*sesituerdansletemps(en+année,de…à,au+siècle,sous+nomdusouverain)
*exprimerladurée:(pendant/durant,de-puis,ilya)
*bienvenue*salutation*remerciement*Lesformulesdepolitesse
*statistiques*chiffres*motsetexpressionspourparlerdel’économie,delapolitique*vocabulairedelalocalisation,delagéographie,del’histoire
*motstechniquesliés:-aupatrimoinehistoriqueetculturel(archéologie,histoiredel’art,religion),-àlagastronomie-aufolklore-àladescriptiondespaysagesetàlafloreetfaune
*Lestempsdupassé(passécomposé,impar-fait,passésimple)
*Lespropositionsrelatives(avecqui,que,dont,où)
*L’expression«c’est…qui,c’est…que…pourmettreenreliefcertainsélémentsdelaphrase)
*L’actifetlepassif
*Lesverbesetadjectifsutilesàladescription
*Lespronomspersonnelsenety
*motsetexpressionspourparlerdel’industrie,del’agriculture,pourévoquerunelégende
*motsetexpressionsliésauxac-tivitésculturellesetauxactivitéssportives

La formation des guides-interprètes au Monténégro-élaboration d’un référentiel de compétences
461
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
53-4
64
ConclusionL’environnementextrêmementconcurrentieldutourismenécessite
uneconstanteaméliorationdelaqualitédesproduitsdemanièreàré-pondreefficacementauxbesoinsetauxattentesdesclients.pouramé-liorercettequalité,l’undesfacteursdécisifsestsansaucundoutelafor-mationprofessionnelleetlinguistiquedessalariés,précisémentcelledesguidestouristiques.
Laclientèlefrancophoneestdeplusenplusprésenteaumonténégro.essentiellement intéresséepar lepatrimoinematérielet immatérieldupays,elleestsurtoutorientéeversletourismeculturel.Lescitésmédié-valesdulittoralmonténégrin,richesenhistoireethéritagearchitectural,demeurent particulièrement considérables dans les bouches dekotor.L’undesenjeuxprincipauxdanslaformationdesguides-interprètesestdoncl’acquisitiond’unvocabulairetechniqueliéeessentiellementàl’his-toiredel’art,àlareligion,ainsiqu’àl’architecture.
decefait,aprèsavoirenvisagéetdéveloppéunréférentieldecom-pétences«général»,ilnousasembléutiledeprésenterenannexedecetarticlequelquespagesd’unoutilsupplémentaireconcernantlaformationdesguidesinterprètesaumonténégroetl’améliorationdeleurscompé-tenceslexicales.ilestquestiond’unpetitglossairefranco-monténégrinconstituéessentiellementdemotstechniquesspécifiquesliésàl’héritagecultureletarchitectural,dontl’élaborationestlerésultatd’unerechercheetd’uneanalysedebesoinsélaboréessurleterrain,aumonténégro,en2007.
Annexe
glossairespécialiséfrançais-monténégrin,destinéauxguides-interprè-tesaumonténégro:abside n.f apsida ;l’abside d’une cathédraleabsidiolen.f mala apsida, nadograđena na glavnu apsidu ; les absidioles des églises romanes ;arc n.m lûk, svod;L’arc de cerclekružni luk ; l’arc brisé slomljeni luk ;arcade n.f arkada, niz lukova na stubovima;arcades n. f. pl galerie à arcades pokrivena galerija ;arcature n.f reljef u oblikuniza manjih ukrasnih arkada;arc-boutant n.m potporni poluluk (gotski stil)arche n.m 1. kovčeg;L’arche de NoéNojeva barka 2. svod, lučni svod,prolaz ; les arches d’un pont, d’une passerelle architrave n.f horizontalna greda koja se oslanja na stubove;

Jovanović I, Milivojević A.
462
« les scènes figurées sur l’architrave de Ciborium Illustrent la vie de saint Tryphon ....» archivolte n.f zasvođeni luk ; često u formi više koncentričnih, bogato dekorisanih lukova smeštenih iznad velikih crkvenih vrataargentn.m srebro ;argentéposrebren, srebrnast autel n.m oltar, žrtvenik ; može biti u obliku kamenog ili drvenog stola ; Maître autel, l’autel principal d’une église ;baie n.f otvor vrata il prozora ; vrata, prozor;la baie grillagée du reliquaire dans la Cathédrale de saint Tryphonbalustrade n.f ograda ;la balustrade d’un balcon, d’une galerie, d’une terrasse balustren.m mali stubac na balkonu, balustradi ;baptistère n.m krstionicabaroque n.meta. Barok ;Barokni;le style baroque ; sculpture, peinture, art baroquebas-côté n.m bočni brod jedne crkve, obično sa nižim krovombasilique n.f bazilika; crkva; brod crkve, dugački prostor pravougaonog oblika prema kome je i nastao naziv bazilika; bazilikalna crkva; hrišćanska bazilika; La Basilique saint Pierre de Romebastion n.m bastion, utvrđena kula; bifore n.fetadj. Bifora, prozor sa dva lučna otvora (na crkvama) ; Fenêtre bifore, trifore ; les bifores gothiques du palais Drago à Kotor ; blason n.m grb (države, grada, porodice)cariatide n.f statua žene, služi kao stub podupirač;cathédrale n.f katedralachantre n.m crkveni pevač, pojacchapelle n.f kapela ; deo crkve sa oltaromchapiteau n.m kapitel, glava stuba ;châsse n.f kivot, ćivot, kovčeg sa svetačkim moštima;choeur n.m 1. hor, horska pesma; horski prostor u crkvi 2. oltarski prostorciboire n.m putir, pehar sa poklopcem u kome se čuva naforaciborium n.m baldahin (od drveta, kamena, mermera…) koji prekriva oltar ;le grand ciborium en marbre dans la Cathédrale de saint Tryphon……………….
angen.m anđeoangéliquea. anđeoskiapostoliquea. apostolskiapôtren.m apostol;les douze apôtres de Jésus- Christapparitionn.f pojava, prikaz, priviđenje ;

La formation des guides-interprètes au Monténégro-élaboration d’un référentiel de compétences
463
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
53-4
64
apparition de jésus-Christ aux rois mages Bogojavljenje apparition de la viergearchangen.m arhanđeo, arhanđel; les archanges gabriel, Michel et raphaëlarchevêchén.m nadbiskupija, arhiepiskopija;archevêquen.m nadbiskup, arhiepiskop;archidiocèsen.m mitropolija ascensionn.f uspinjanje ; Fête de l’ascension, Jour de l’ascension Vaznesenje Gospodnje (40 dana posle uskrsa)baptême n. m. krštenje; Le Baptême de jésus-Christ par saint jean-Baptistebénédictinn.m benediktinac bénédiction n.f blagoslov, blagosiljanje ; Bénédiction d’un bateau ; bénir v. blagosloviti, blagosiljatibénit, ea. blagosiljan, posvećen ; eau béniteSveta vodica ;pain bénitnafora l’église d’Ozana bénite à Kotor calendriern.m kalendar ; Calendrier Julien ou vieux calendrier ; Julijanski ili stari kalendar (kalendarsrpske,ruskei bugarskepravoslavnecrkve) Calendrier grégorien ou nouveau calendrier ; Gregorijanski ili stari kalendar;canonisationn.f kanonizacija, čin proglašavanja svecem ; Canoniserkanonizirati ;catéchismen.m veronauka ;Catéchiserpredavati veronauku……………..
Bibliographie
delattre2008:m.delattre,monténégro-Lederniereldoradoméditerranéen,le Point,no1874,paris:sebdoLepoint,46-50.gilbotić2009:t.gilbotić,monténégro-unenouvelleperleeneurope,univers des voyages - le magazine des professionnels, 138,paris:universdes voyages, 16-35.Jovanović,vitić 2007: i. Jovanović,a.vitić,changes in tourisme education:bestpracticesintouristguideprogram,conferenceproceedings,ixinterna-tionalconference:strategicdevelopmentoftourismindustryinth21thcen-tury,2007,ohrid,macedonia.milivojević 2007:a.milivojević,la formation des guides interprètes à Kotor (Monténégro): Élaboration d’un glossaire spécialisé français-monténégrin,mas-ter2soutenuensept.2007,montpellier,france

Jovanović I, Milivojević A.
464
mirguet2009:o.mirguet,Lemonténégros’ouvreautourisme,L’écho touristi-que,2900,antonyfrance:groupeindustrieservicesinfo/etai,19-24.rr2008:r.r.,Lemonténégroveut faire saplace sur lemarché français,Le quotidien du tourisme,18sept.2008,clichy:Larivière,7.richard,2003:s.richard,fegLanguagetestingpolicypaper,<http/www.feg-touristguides.com>.12.01.2005.zakon o turizmu rcg, član 28 stav 3 (službeni list rcg br.29/2004 od30.4.2004),pravilnikoprogramu,sastavuispitnekomisijeinačinupolaganjastručnogispitazaturističkogvodiča.
Sitographie
<http://www.univ-mlv.fr/fiches/css_licpro.php?diplome=87>.12.01.2005.<http://www.univ-angers.fr/formation.asp?id=edngi1&langue=1>.16/09/2010.<http://ghhat.univ-lyon2fr/tourisme>.10.09.2010.fegoralLanguageproficiencytest2004,teststandard,<http/www.feg-tou-ristguides>.12.01.2005.
Ивона Јовановић, Александар МиливојевићОБУКА ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА У ЦРНОЈ ГОРИ И ИЗРАДА
КАТАЛОГА ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈАРезиме
ЦрнаГоракаотуристичкадестинацијапоследњихгодинајесветраженијанафран-цускомтржишту.Какобиштобољеодговориленазахтевемногобројнихфранцускихту-риста,којипресвегажеледаупознајукултурнуиисторијскубаштинуовеземље,водећетуристичкеагенцијепотражујусвевећибројводичазафранцускијезик.
Базирајућисенастатистичкимподацима,овајрадимациљдаидентификујепотребнејезичкевештинекојимаједанводичморадаовладакакобимогао,наквалитететанначин,дапредставииистакнекултурно-историјсконаслеђеЦрнеГоренафранцускомјезику.
Урадусуупоредоприказанадвамоделапокојимасевршиобукаводичакаоимо-дел евалуације језичкихвештинакојипрепоручујеЕвропска асоцијација удружењату-ристичкихводича.Коначно,презентиранјекаталог језичкихкомпетенцијанеопходнихзаобављањепословатуристичкогводича.
Примљено: 30. 1. 2011.

465
УДКрад
Isidora MilivojevićFaculté de philosophie, université du Monténégro
L’éMerGeNce De L’INcoNScIeNT DANS L’APProPrIATIoN De LA LANGue éTrANGère
L’étrangetéséduisantedelalangueétrangère,cetteautrelanguequiest inconnue,maisque le sujetdésire faire sienne, attire-t-elle le sujetparlantparcequ’elleparledecetinconnudelui-même:del’inconscient?Larencontreavecd’autreslanguesetculturespourraitdonnerlapossi-bilitéausujetdevivredesexpériencesqu’iln’apasvécuesaumomentdesafondationentantquesujet.ainsi,lecontactaveclesystèmesonored’unelangueétrangèreoudeslanguesétrangèrespourraitoffriruneidéede la complétude qui est impossible dans la languematernelle.mais,commentl’inconscientpourrait-ilêtreactualiséparlalangueétrangère?commentcetteautrelanguepeut-elleparlerdenous?
notrebutaétéderépondreàcesquestionsetdevoiraussi:commentla didactique des langues prend-elle l’inconscient comme une partieconstituantedusujetparlant?
Mots-clés:sujetparlant,psychanalyse,didactiquedeslangues
«j’ai erré dans des déserts désertéset j’ai connu le silence des déserts immenses.
j’ai entendu un étrange silenceet j’ai vu des mirages sans âge.
J’ai croisé ton regard, étranger,et j’ai aimé son étrange douceur.
J’ai lu ta différence, étranger,et j’ai aimé son étrange couleur.
J’ai entendu ta voix, étranger,et j’ai aimé son étrange étrangeté.
J’ai étreint ta douleur, étrangeret j’ai aimé sa familière âpreté.
Je t’ai aimé, étranger,et j’ai reçu ton âme.
alors, j’ai oublié mon étrange différenceet j’ai appris ta ressemblance étrangère.

Milivojević I.
466
j’ai attendu tes dissonances étrangèreset j’ai reconnu ton ascendance familière.
j’ai partagé pour les chanterles harmonies étranges de ton art étranger.»
sabineraillard
cette étrangeté séduisante,mystérieuse, de la langue étrangère qui sedonned’abordcommeuncorps sonore,commeunemusiquenourried’harmonies étranges, ouvre la porte de l’inconnu, la porte de ce quefreudnommaitlapulsiondeconnaissance.aconnaîtresilesautreslan-guestraduisentlesautresvérités, longtempscachéesetcherchéesdansdes«lointainsintérieurs»dusujetparlant.
1. «L’étrangeté» comme la partie constituante du sujet parlantvenantaumondel’hommeadûacquérirtantdechosesdudehors
pourfairepartiedelasociété,entreautreslalangue.baigné d’abord dans la pluralité des sons qu’il échangeait avec sa
mère,lepetitd’hommesetrouvaitdansunétatdepolylinguismequisecaractériseparlacapacitédeproduiredessonsdetoutesleslangues.
cetagencementdesons,d’odeurs,decouleurs,de lumière,«quinesontlàquepour lui», renvoieàune identificationpremière, archaïque, entrecorps et langage, agencementnouéà travers le corpsde l’enfantdans laconfusion avec le corps maternel: non pas langue maternelle, mais la«langue-du-maternelle», languedelarelationprimordialemère/ infans,languedelaconfusionoriginaire.(prieur2004:53)
maisl’enfantadûaussitôtréduiresescapacitésphonématiques,sor-tirdecetespacesensorielpourincorporerlalanguedite«maternelle»,quiest loindecellequ’il échangeaitavec samère,carcette langueestavanttoutuninévitablehéritagesocial.
L’acquisitionde la langue, lanomination, la symbolisation,ont si-gnifiéalorslerefoulementdecetteexpériencefusionnelle,maisaussiledétachement,laséparation,lacoupured’aveccetteexpérience.
ainsi,pourdémêlerlatotalitédesujetparlant,ilfaut,commeleditatienzamerino(2002),faireappelaufonctionnementdecetteombredupsychismequiprendlenomd’inconscient.
nousdevonsicinousposerunequestion:«quelssontlesprocessusquiontaboutiàcequ’unévénementpsychiqueconcretaitpuêtrevécu,parlesujetparlant,commeétranger,c’est-à-direpourquoicettepartiequ’onappellel’inconscientest-elleréduite,engénéral,àuneombredupsychisme?»

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
467
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
chaqueêtrehumain,toutaulongduprocessusdeconstructiondel’espèce,areçudeuxhéritages:d’uncôtél’héritagebiologique–psycho-physique–quechaquepetitd’hommeporteavecluiàsanaissance;del’autre,l’héritageculturel–social–quiestceluiquelenouveau-néren-contredanslesformesdeviedelacommunautéoudescommunautésquilereçoiventàsanaissance.Lanaturehumaine,pourcequitoucheàl’espèceelle-même,estainsiuneréalitéscindéeparcequeleprocessusd’hominisationindividuelestunesortedegreffagedelanaturehumainesocialementhéritée–extérieureausujet–surlanaturehumainebiolo-giquementhéritée–intérieureausujet.
deuxforcesalorsdominentdupointdevuedusujet:sociale–ex-terneetindividuelle-interne.
decefait,lesujetnepeutdire«je»quedanslestermesdel’autre,c’est-à-dire dans les termes de l’ordre culturel qui le nomme, qui luidonneunnometquinommeaussilemilieuphysiqueetsocialenviron-nant.
Lenouveau-né,pouraffirmersasingularité,mêmesicelanoussem-blecommeunparadoxe,estcontraintderenonceràtouteslesdemandesquisurgissentdesadimensionbiologiquementhéritéedesoncorps,etilsatisfaitcesdemandesselonlesrèglesculturellesquifontpartiedel’hé-ritagesocialquil’aaccueilli.
Leprixdeceparadoxeauquelilestconfrontéestlaviedanslasur-face,entantque«persona»1dansunmilieusocial,c’est-à-direlaviesouslemasque qui cache des vérités profondes sur son être originaire, lesvéritésquinedisparaissentpasmaisquisontenlui,toujoursenlui,sau-véesdansunesortederéservoir,dansunesorted’espaceoublié,refouléquicherchetoujoursàsedireetànousdire.
cetombredepsychisme,s’appellerait-ellele«subconscient»?–cetermeemployéparlapsychologieetdontl’étymologienousditqu’ilestlapartiesoumiseauconscientouest-elleplutôtlaconséquencedecetteviedonnéepouruneautrevie,etdontlestracessetrouventmêmein-conscientia, c’est-à-diredans le conscient, les tracesqui lui échappent,quisedéplacent,quisecondensentetquifontleretouretagissentsurla conscience, et qui, loind’être soumises à la conscience, la régissentconstamment.
1 il est intéressant de constater une certaine opposition sémantique entre l’étymologiedumot:personne etlasignificationqu’elleaaujourd’hui.danslerobertontrouveladéfini-tionsuivante:«L’individudel’espècehumaine,considéréentantquesujetconscientetlibre.» L’étymologienousditquelemotlatinpersona désignait«lemasquedethéâtre».pourentrerdanslasociété,l’hommedoitrespectercertainesloisquiluisontimposéesparlasociétéetainsi,dansun,certainsens,ilestobligédeporter«lemasque»pourdevenirsujetsocial,cequiestenoppositionaveclanotiondelibertéconfirméedansladéfinition.

Milivojević I.
468
cette dimension constituante du sujet parlant - l’inconscient est une«demandenonsatisfaitemaistoujoursprésente–et–,pressante,entantque lettre envoyée en attente de réponse, indéfiniment» (merino 2003:305-329).L’inconscientpeut être considéré aussi comme«un savoir quenousnesavonspasmaisquinoussaitetquiopère inlassablement(…)»(merino2003:305-329).
c’est pourquoi il cherche toute faille pour s’énoncer, pourdonnerunenouvellechanceàlatraductionéchouée.
cette traduction échouée cherche à se dire à travers les rêves, leslapsus,lesfantasmesmaisaussiellepeutchercherànousdirequelquechosed’intimedenous-mêmesàtraverslaparoled’unemélodieétrangemaisfamilièredelalangueétrangère,lamélodiequ’onaccepteouqu’onrefuseparcequ’ellemet enmouvement la vérité denotre être, sauvéedansl’inconscient.
Lesujetdel’inconscientcherchealorsdanschacunedesbrèchesdumoiconscient,ducorpsetdelaréalitéexterne,lapossibilitédesatisfac-tiondel’échecdetraduction.
L’échec de traduction vient de ce que, venant aumonde, le petitd’hommeseraincapabledetraduirepourlui-mêmeunepartiedesmes-sagesdel’autre,iln’arriverapasàtraduiredestrousdesens,etlerésultatdecesimpassesaboutirainévitablementàcettedimensionconstitutivedusujethumain–l’inconscientquiestcommeunesortederéserveoùs’accumulentlestracesdecesexpériencesdesymbolisationéchouéesetquichercheconstammentàsemanifesteretàatteindrefinalementunsens.
atraverslesbrèchesdumoiconscient,cette«étrangeté»quiestl’in-conscient,affectelemoietlecorpsparleplaisir,l’angoisse,lahonte,lajoie…lesémotionsquiseproduisentparle transfertdequelquechosedupassénonrésoluàun«objet»duprésent.
Le transfertpourrait êtrepris ici commeundispositifquimetenprésencedesbribesdemémoiredusujetparlant,c’est-à-direquimetenmouvementsoninconscient,le«ça»quiparledelui.
ainsi,commeonavu,l’êtredelaparole,lesujetparlantapparaîtdi-visécar,selonlaformuledeLacan,lelangagecauselesujetetlecauseentantquedivisé,c’est-à-direayantunconscientetuninconscient.
telétaitleprixquel’hommeadûpayerpouraccéderau«code»,pours’aliénerdanslediscoursde l’autre,pourcommuniquer(dulatincommunicare –semettreencommunavec);alorsexisterhorssoi,ex-ister,estsinequanonpourexisterhumainement.
cettedimensionde l’étrange et de l’étranger qui constitue le sujetparlantest à l’originemêmede lapsychanalyse.L’inventeurde lapsy-

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
469
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
chanalysesigmundfreud,danssesÉtudes sur l’hystérie(1983-1985)ex-pliquequ’ilfaut«segarderdecroirequeletraumatismeagitàlafaçond’un«agentprovocateur»quidéclencheraitlesymptôme,quicontinue-raitd’existerd’unemanièreindépendante.mieuxvautdirequeletrau-matismepsychiqueet,par lasuite,sonsouvenir,agissentà lamanièred’uncorpsétrangerqui,longtempsencoreaprèssonirruptioncontinueàjouerunrôleactif»(freud1952:3-4).
decefait,lapsychanalysereconnaîtcetteréalité«étrange»,dumoinsenlareconnaissant,larend-ellemoinsétrangère,carellesaisitcetteal-téritécommeunepartieconstituantedusujet lui-même.ellen’adoncpaspourobjectifderéduireausilencecettedimensiond’étrangeté,maisdepermettreausujetdeprendrelaparolepourreconnaîtrecettepartiecommesienne.
donnerlaparoleàcettedimensionétrangère,danslechampdelapsychanalyse,celanesignifiepasseulementl’identifier,maissurtoutlareconnaîtrecommefaisantpartiedenotrepropreidentité.
Lessignifiants,quin’ontjamaiscessédesignifieretquisontdestra-cesdecetteconstructiondesenséchouée,cherchentunenouvellevoiedesignificationquileurdonneraenfinuneréponsesatisfaisante.
ces profondeurs de l’inconscient, ce «lointain intérieur», peuventtrouverleursressortsdanslarencontreavecles languesdesautresquioffrentdesoccasionsmultiplesdetransfert.
ma langue est celle quim’apparaît alors lointaine– comme inaccessible(…)alorsquelalanguediteétrangèredupoèmeexistantest,elle,là–touteprocheetviveetactive…m’imposantsaprésenceetsuscitantmondésir.(ducros2004:9-22)
mais comment la langue de l’autre peut-elle vraiment parler denous?
2. L’espace de l’appropriation des langues comme un lieu de transfertLecheminquimèneunnouveaunéversl’homus societas,qu’ilest
appeléàdevenir, estunchemind’appropriationparsoncorpsducodecultureldanslequelilbaigne,appropriationquidurerajusqu’àsamort.onavusupraquelesujethumainestunsujetcomplexeetcommel’en-visagelapsychanalyse,un«sujetdivisé»:ilaleconscient(sonhéritagebiologique–établiaveclecodeculturel–l’héritagesocialqu’ilreçoitàsanaissance)etl’inconscient(latraceetlacicatricedecequ’iladûrépri-merpourêtresocialementaccepté).

Milivojević I.
470
L’inconscient contientune structurede langage,mais ses effets semanifestentsurleterraindela languec’est-à-diresurceluidulangageparlé.
afindedistinguerlalanguedel’inconscientdelalanguedanssonacceptationlinguistiqueLacanutiliselenéologismedela«lalangue»quidésigne la languede la vérité profondede chaque sujet, celle qui s’estconstruiteparleséchangesdevoix,degestes,deregardsentrelamèreetl’enfant.La«lalangue»estcellequichercheetquis’efforced’émergerdupassé,àtraverslesactesmanqués,lesjeuxdemots,pournousparlerdelavéritédusujet.
Larencontreavecd’autreslanguesetculturesvadonnerlapossibi-litéausujetdevivredesexpériencesqu’iln’apasvécuaumomentdesafondationentantquesujetetcenouvelespacesignifiel’opportunitéderéapparitionetderéparationdecequinepouvaitpasêtrecomprisettraduit.
ainsi lecontactavec le systèmesonored’une langueétrangèreoudeslanguesétrangèrespourraitoffrir l’occasion,pourlesujet,d’unre-touràcetteépoqueprimitiveoù«lalangue»s’estconstituée.decefait,leslanguesetlesculturessecondespeuventoffriruneidéedelacomplétudequiestimpossibledanslalanguematernelle,toutcommeellespeuventprovoquerlerefuscarellesrouvrentlesblessuresqu’oncroyaitferméesetdontonneveutriensavoir.
onpeutdirealorsquelessituationsdecontactdeslanguesetcultu-rescréentunespacetransférentielparcequequelquechosedel’incons-cientvientàpouvoirsedire.
Lecontactdes languespourraitsusciterdesattitudespositivesen-verslalangue,c’est-à-direuneimpulsionpourapprendrelalangueautre,carlesujetpeutavoirl’impressionqu’àtraverscettelanguequelquecho-sedel’inconscient,quelquechosedesonpassénonsatisfaitpeuttrouverunesolution.
une langue peut aussi créer chez un sujet des attitudes négativesquiaurontpourconséquencedesobstaclesàl’apprentissage,carcequiémergedupassé,del’inconscientestdouloureuxpourlesujet,etilnevoudrariensavoirsurcequiafaitémergercettesouffrance,c’est-à-dire,ilnevoudrariensavoirsurcettelangue.
Lesaffectsetlesémotionssuscitésparlarencontreavecd’autreslanguesquelalangue-culturematernellen’ontrienàvoiravecelles,maisaveccequisurelleesttransféré.(merino2004:23-66)
cequitémoignedecetteémergencedel’inconscientdanslarencon-treavecleslanguesetculturesétrangèrescesontlesaffectsetlesémo-tionscommeleplaisir,lahonte,l’angoisse,lajoie,larépulsion,l’attrac-

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
471
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
tion…c’est pourquoi le premier contact avec une langue, c’est-à-direavec soncorps sonore, avec savoix, joueun rôleprimordial car cettedimensionphoniqueestjustementlesourceduplaisiroududéplaisir,de l’amour ou de la haine car c’est enmême temps la reconnaissanceensoidequelquechosedenouveauqu’onaimeouqu’oncraintetqu’onpeutnierourefoulerencoreunefois.
decefait,merinopenseque«Lapassionpourlaculturedel’autre,c’estunepassiondesoi,passiondecequedesoil’ondécouvrepareffetdecetteautreculture.naturellement,laculturedel’autreestunecultureautreetdanscettemesure, ellepermetdesvécusautresaussi.» (2004:23-66).
c’estpourquoionparleen termesde«fascination»oude«séduc-tion»pourl’autreculture.celapeutexpliquerlamystérieusefacilitéquecertainsontpourl’apprentissagedeslanguesétrangèresainsique,aucasoùletransfertestnégatif,lesdifficultésqu’éprouventd’autresapprenantspours’approprierunelangueétrangère.
Ledésirdelalangueétrangèreapparaîtalorsàl’insudusujet,etilestsouventcachéderrièreuneformulationdela«motivation».
apprendre une langue étrangère n’est pas seulement un besoin etunedemande,mais véritablementundésir.cedésir de savoir quin’arienàvoir avec le savoir comme l’écritLacan (1969): « il y aquelquepartunevérité,unevéritéquinesesaitpasetc’estcellequis’articuleauniveaudel’inconscient.c’estlàquenousdevonstrouverlavéritésurlesavoir.»
ainsi,lesujetespèreretrouversavéritédansl’autrelangue.unevé-ritéquivalefasciner,ouunevéritéquifaitpeur.celadépend,commeonl’amentionnésupra,desémotionsquiseproduisentparle transfertdequelquechosedupassénonrésoluàun«objet»duprésent.
desépreuvesempiriques,oùl’étrangetéapparaîtmêmecommeunmétier, on pourrait les chercher dans les «cas littéraires» de tous cesauteursquiontabandonnéleuridiomematernelpourécrireleursœu-vresdansuneautrelangue.
Lesécrivainsquisesontexprimésenplusd’unidiome,parfoisenrefusantleuridiomematernel,sonttrèsnombreuxetàtraversleursœu-vreslittérairesceux-ciontexprimé,demanièreplussignificativelepro-blèmedupassageentrelanguematernelleetlangued’adoption.
nousavonsainsiunexemplebienconnudeLouiswolfson(1970),cefameuxschizophrènequi,pourfuirlepouvoirdesamèresurluiàtra-versl’anglais,sepassionnepourleslangues.«ilsouffred’«allergiepsy-chique»à«sa languematernelle»,etnecessed’ydisséminerdesmots,desphrases,deslocutionsenlangueétrangère.»(prieur2004:53).

Milivojević I.
472
donc,cequ’onobservechezwolfsonc’estunerelationdedestruc-tionenverslalanguematernelle.
Lecasdesamuelbeckettestdifférent.cetécrivaind’origineirlan-daisetrouverarefugeenfranceetdanslalanguefrançaisepourfuirunerelationpossessiveettyranniqueavecsamère.
maisbeckettutilise la langue française commeune sorted’espacetransitionnel,c’est-à-direquelaclédudrameintérieurdebeckettn’estpaslerejetetladestructiondelalanguemèreetl’adoptiondelanou-vellelangue,maisunallerretourlinguistique,unedynamiquecirculaired’unelangueàl’autre.
car,commeleditcasement(1982:194):«Leparcourscirculairedebeckettnelereconduitpaslàd’oùilestparti,maislàoùiln’avaitpuêtreauparavant.»
Lesraisonspour lesquellescertainsécrivainsontécritetontvécudans l’autre langue sont différentes: exil, amour, haine, deuil, ruptureavecl’origine.ainsinabokovpassedurusseàl’anglais,kunderadutchè-que au français.pourcioran, changerde langue, c’est «s’affranchirdel’origine»,«sedébarrasserdupoidsdenaissance».
onavuiciquelalangueétrangèrepourraitêtrelelieudetransfertoùquelquechosed’autrevientàsedire.Lalangueétrangèrepourraitêtrelemoyendedécouvriretdelaisserparlernotrepropreréel(Lacannedisait-ilpasque«l’inconscientétaitleréeldusujetentantquetroué»?).
cequinousintéresseàcepointdenotretravailc’est:comment ladidactiquedeslanguesconsidèrecetteréalitéconstituantedusujetqu’estl’inconscient,c’est-à-direcommentprend-elleencomptelesfacteursaf-fectifsetémotionnelsquisont,entreautres,déterminantsdansl’appren-tissagedeslangues?
3. La dimension de l’inconscient, comme la partie constituante du sujet parlant, en didactique des languesdanslaréflexionsurl’apprentissageetl’acquisitiondeslangues,l’ad-
jectif«inconscient»apparaîtassezsouventsansquelapsychanalysesoitconvoquéepourautant.
Leplussouvent inconscient doitêtreentenducomme involontaire, non délibéré, ouautomatisé;parexempleonopposel’apprentissage,quiseraitunprocessus formel etconscient, etl’acquisition quiseraitunproces-sus inconscient;toutefoisdansdestravauxrelativementrécents,unepri-seencompte,mêmetrèsmodeste,delapsychanalyse,dansl’espacedeladidactiquedeslangues,semblesefairejour.onpeut,parexemple,faireréférenceàdeuxlivrespubliésen1998(cLeinternational),celuidepaul

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
473
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
cyrsurles stratégies d’apprentissage, etceluidemaddalenadecarlosurl’Interculturel, oùlapsychanalyseestexplicitementmentionnée.
4. Émergence de la question des langues en psychanalyseil faut aussi dire que si la didactique des langues tâtonne encore
quandelleparledel’inconscient,lapsychanalysenes’estposéequetardi-vementlaquestiondurapportauxlanguesétrangères.celaestd’autantplus étonnant si on sait que les premiers analystes ont été confrontéspersonnellementauproblèmeduchangementdelangue.presqueaucund’entreeuxn’avaitfaitsonanalysedanssalanguematernelle,et,danslaviennedutempsdefreud,illeurarrivaitrarementd’avoirlamêmelan-guematernellequeleurspatients.
freudlui-mêmeévoquel’effortquereprésententpourluilesséancesavecsespatientsanglaisouaméricains.
pourtant, onne trouvedans l’œuvredefreud aucun écrit théori-queabordantlaquestiondeslangues,maisseulementquelquesnotionsponctuellessurlerecoursàdeslanguesdifférentes.mêmelecasd’annao.,(les études sur l’hystérie,publiéesparfreudetbreuren1893),dontles symptômes hystériques s’accompagnent de l’abandon de sa languematernelle,l’allemand,auprofitdel’anglais,nedonnepaslieuàuneré-flexionthéoriquesurcesujet.
c’estseulementdanslesannées1930,aumomentoùbeaucoupdepsychanalysteseuropéensémigrentenraisondel’avènementdunatio-nal-socialismeenallemagne,queparaissentlespremierstextesimpor-tantssur laquestionde l’usagede la languematernelleoud’uneautrelanguedansletraitementpsychanalytique.
Les ressources très abondantes d’une littérature psychanalytique– recensées par la psychanalyste Jacqueline amati-mehler dans sonouvragela Babel de l’inconscient,pourraitnous serviràdonnerquel-quesexemplesparticulièrementsignificatifsconcernant ledomainedel’inconscientdanslepassaged’unelangueàl’autre.
avantlesannées1930,untextenousmontrecequepeutprésenterpour l’inconscient le fait de parler une langue étrangère. il s’agit d’untexte de s. ferenczi, publié en 1910– 1911, et intituléMots obscènes. Contribution à la psychologie de la période de latence.
ferenczi considère lesmotsobscènes commeun sous-ensemble àl’intérieurdelalangue,unesortedelanguedanslalangue,parcequese-lonlui,ilstémoignentd’unétattrèsanciendenotrerapportaulangage,oùlesmotsétaienttrès liésaucorps,chargésd’élémentsmoteurs,d’oùleurpouvoir.quelquechosedenotrehistoire laplus intimeseraitdé-

Milivojević I.
474
poséedanslalangued’enfance,indissociabled’elle,etseraitrevécudansl’expériencedel’auditionoudel’articulationdecertainsmots.
c’estcequeconfirmeferenczidansunelettreàgroddeckoùilluiraconte un rêve qu’il qualifie de «purement hongrois», dans lequel ilchanteunechansonhongroise.Lesassociationsdurêveurmontrentquecertainsémoisérotiquesdel’enfancesesontcommeinscritsenluidanscettelangue.donc,lessentierssecretsdudésird’unsujetseraienttracésenluidansunelangueparticulière,etnepourraientêtresuivisquedanscettelangue-là;c’estpourquoiferenzisoulignel’importancedelaforceexpressivedecesmotsmêmes,parcequ’ilssontrévélateursdesmouve-mentsderégression.
onvoitquelesoriginesdenotrehistoireaffectiveetsexuellesese-raient inscrites ennousdansune langueparticulière, quin’est pasdutoutneutre,dontnousserionscapablesderaviverlatraceparlechange-mentdelangue.
dèslors,l’abandondelalanguematernelleauprofitd’uneautrelan-guepourraitêtrereprésentéentermesdebénéfices.
c’est dans cette perspective d’un bénéfice du changement de lan-gueques’inscriventlespremiersauteursquisesontintéressésàlaques-tion,puisqu’ilssoulignentsurtoutl’aspectdedéfenseetderésistancequecomportel’usaged’uneautrelangue,d’unelangued’adoption.onprendici le termededéfense dans la significationqui lui estdonnéedans lathéoriefreudienne:uneopérationvisantàsupprimer,oudumoinsàré-duiretoutemodificationquimetendangerl’intégritéetlaconsistancedumoi.
parmi ces auteurs, on pourrait citer e. buxbaum, psychanalysted’origineallemandeémigréeauxétats-unis.ellerapporteplusieurscasde patientes allemandes émigrées à l’adolescence aux états-unis, quicomprennentl’allemandmaisrefusentdeleparler.L’analyseadonclieuenanglais,maislorsqueaucoursdutraitement,certainssouvenirsd’en-fancesontramenésàlaconscience,lerecoursàl’allemands’impose.ce-pendant lesmotsallemands se rapportantaucorpsetà ses fonctions,mêmesilesmotsdel’enfanceexprimentlatendressedanslesrapportsaveclesparents,sontprononcésavecdifficulté.
danslamêmeperspective,krapf,psychanalysted’origineallemandeinstallé enargentine, s’intéresseau sens inconscientdupassaged’unelangue à l’autre chez ces patients polyglottes. son expérience cliniquel’amèneàconclureque lepassageàuneseconde languereprésenteunprocessusdéfensifcapable de garantir une certaine distance émotionnelle et une maîtrise à l’égard des vécus instinctuels infantiles.

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
475
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
changerdelanguepeutsignifieraussichangerdepeau.celanousestconfirméparunarticleparuen1950intitulé«Lalanguematernelleetlamère»danslequelgreensonrapportelecasd’unepatientedelan-guematernelleautrichienne, installéedepuis longtempsenamérique.ellefaitsonanalyseenanglais.trèsattachéeàsonpère,elledétestesamèreaupointdenejamaisavoirpul’appeler«mutter».elleconfie:«J’ail’impression,sijeparleallemand,quejedevraismesouvenirdequelquechosequejepréfèreoublier[…].enallemand,jesuisuneenfantsaleeteffrayée;enanglaisjesuisunefemmenerveuseetraffinée.»
onvoiticiquececonflitpsychiqueinfantiles’estinscritdanslalan-guematernelle,poussantl’individuàchercheruneautreidentitéàtra-verslalangued’adoption.
dansunmémoireintituléapprentissage d’une langue étrangère et re-lation à la langue maternelle (1987)etdansunarticleintitulé«Lalangueétrangèreentreledésird’unailleurs etlerisquedel’exil» (1991),revuz,entantqueprofesseurdelangueetanalyste,insistesurcettepossibilitéofferte par la langue étrangère d’un changement de personnalité. elleévoquepar exempleun adolescent qui, étudiant le russe, se choisit leprénomdeBoris,etqui,souscenom,serévèleungrandséducteurlorsd’unvoyagelinguistiqueàmoscou,alorsqu’ilnel’estpasdutoutsoussonidentitéfrançaise.
maiscepassagesalvateurd’une langueà l’autreaparfoisuncoût.beaucoupdepsychanalystesparlenteneffetdeclivagechezleurspatientspolyglottes.un textedetzvetantodorov, «bilinguisme,dialogismeetschizophrénie»rendparfaitementclaircequepourraitêtrececlivage.tzvetantodorov,néenbulgarieetvivantàparis, racontecommentàl’occasion d’un congrès, il est retourné, après dix-huit ans d’absence,dans sonpaysnatal. il exprime comment ce séjour a représentépourluiuneexpérience de malaise et d’oppression psychique.ilapressenticemalaisedèsavantsondépart,enpréparant le textedesacommunica-tion,oùilabordaitlaquestiondelavaleurdunationalisme.sapersonna-lité française l’induisaitàtenirundiscours,maissaconnaissanceintimedelaculturebulgarel’engageaitàtenirundiscourscontraire.danssesconversationsavecdesamisilraconte:
ma double appartenance ne produit qu’un résultat: à mes yeuxmême,ellefrapped’inauthenticitéchacundemesdeuxdiscours,puisquechacunne peut correspondre qu’à la moitié demon être; or je suis double. Jem’enfermedenouveaudans lesilenceoppressant[…].Laparoledoubles’avèreunefoisdeplusimpossible,etjemetrouvescindéendeuxmoitiés,aussiirréellesl’unequel’autre.(mehleret al.1994:66)

Milivojević I.
476
onpeutcitericil’exempledecheng,quiracontecomment,diviséentrelechinois,languedesonpaysnatal,etlefrançais,languedesapa-tried’adoptionoùilaété,selonsesproprestermes,parachuté,àl’âgedevingtans;ilvitsonbilinguismecommeunexilintérieur:
venutardaufrançais[…],jemerendaiscomptequejenepouvaisyinvestirquelapartlucide,raisonnable,sanscesseanalysantedemoi-même,alorsquecetteautrepart,chargéededésir,defantasmesetdetoutlepassévécu,aétérefouléedansunelanguequej’avaisrarementl’occasiondeparleretdontsurtoutjenepratiquaisplusl’écriture.(mehleret al.1994:66)
ces propos decheng sont intéressants pour plusieurs raisons: ilsillustrentclairementcequepeutêtreleclivageliéaumultilinguisme,etilssoulignentaussicommentlalanguematernelleestchargéedesouve-nirs,dedésirs,d’affects.c’estàcetitre,onl’avuqu’ellepeutêtrerejetée,fuie,dansundésirdelangueétrangère.c’estàcetitreaussiqu’ellepeutfairel’objetd’unattachementtelquel’appropriationd’autreslanguessetrouveraempêchée.
onpourrait,pourterminer,jeterunpeudelumièresurlesdifficul-tés, les inhibitionsde l’appropriationde langueétrangère.c’estsibonyquidansson livreentre-deux (1991)nousdonneunexempled’empê-chementd’ordreinconscientàl’appropriationd’unelangueétrangère;ils’agitducasoùlalangued’origineestinterdite;alorscefantômedelan-guebarrel’accèsàtouteautre.
cet enfant de parentsmaghrébins vivant en france, père âpre et blessédans son rapport au français qu’il conteste et qu’il envie à la fois,mèredépressiveenferméedanssafamilleabsente,dansson«chezelle»lointainoùsondésirestrestéenotage.L’enfantcoincé,ensuspens,nereçoitdesonoriginepourl’irriguerquedesfluxsecsouamers.iléchoueà«apprendrelefrançais».est-cesamanièredepayerunedetteàsonorigine-ouàsalangue«première»,l’arabe-,dettedanslaquellesesparentssonteux-mêmescaptifs?danscecas,lafauteoulemanqueenverslalangueseconderéinscritouremarquelafauteenverslapremière(l’arabe)[…].sil’onrendàlapremièresaforceperdue,lepassageselibèreverslalangueseconde.(sibony1991:33)
il y a aussi tous ceuxpour qui l’attachement à la langue-mère oùseconstruitl’identité,nepermetqu’uneappropriationimparfaited’uneautrelangue.encecaslàonpeutparlerdelafidélitéàlalanguemater-nelle.
greensondanssonarticle«La languematernelleet lamère» sou-ligneque l’acquisitiond’unenouvelle langue implique l’introjection de nouveaux objets,d’oùdesdifficultésd’acquisitionsi lesujetadumalà

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
477
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
renoncerauxpremiers.c.revuzfaitremarquerqu’articulerdesphonè-mesquin’existentpasdanslalanguematernellesupposeunerégressionquipourraitêtreangoissantepourcertains.pourd’autres,articulerdesphonèmesquelamèreneprononçaitpasestimpossible.icisontmisesenévidenceladimensiondeplaisiroraldansl’articulationdelalangueétrangèremaisaussi l’importancede la figurede l’autre-enseignantounon-enseignantdequi l’onreçoit la langue.il fautbienque larelationd’amourtransférentielstimuleledésirdes’identifieràluipourquel’onpuisses’appropriersalangueendépassantsespremièresidentifications.
Conclusionil y abeaucoupde choses àdire encore à cepropos.ona essayé
icid’aborderbrièvementdesquestionstrèscomplexesquitouchentl’in-conscient et l’appropriationdes langues,même siona inévitablementrisquédelessimplifier.onatentéaussidemontrer,àtraversunretourverslapsychanalyse,quel’autrelangueesthautementinvestiedesignifi-cationetdedésir,etquel’appropriationd’unelanguenousmobilisedanstoutnotreêtredesujet.
decepointdevue lapsychanalysepermetunapprofondissementnécessairedelaréflexionsurcequeladidactiquedeslanguesappelleparexemplelamotivation,lesdifficultésd’appropriation,lesinhibitions…
qu’est-cequ’onproposeàlafindecediscours?onneproposepasiciauxprofesseursdedevenirdespsychana-
lystesmaisentenantcomptedel’inconscient,«leprofesseurgagneraàêtre spécialement attentif au sensdesblocagesd’apprentissagede cer-tainsélèvesetdelapassionaveclaquellecertainsautressevouentàlarencontreaveclalangueétrangère».
a) ainsil’enseignantdevras’efforcerd’offrirauxélèvesuncadred’ap-propriationdelalangueétrangèresuffisammentriche,diversifié,modulé,pourquechacunpuisseavoirsachance,pourqueledé-sirdechacuntrouvelapossibilitéd’avoirunlieuoùseposer.
b)L’enseignantauraintérêtàêtreattentifàl’émergencedudésirdesapprenantsouauxobturationsdecedésir,c’est-àdireauxtrans-fertspositifsounégatifs,explorantàpartirdelàleschangementsnécessairesdanslecadredidactiquepourquelespremierspuis-sentsesouteniretlessecondssedissoudre.
ainsi, levéritablerecentrageaffectifsur l’apprenant– lesujetpar-lantdansl’espacedeladidactiquedeslanguessignifieraitleconsidérercommeunindividusingulier,sensible,complexe,c’est-à-diretelqu’ilestvraimentdanslaréalité,avecsonconscientetsoninconscient.

Milivojević I.
478
Bibliographie
anderson1999:p.anderson,l’appropriation de l’autre langue: espace du sujet,paris:pressesuniversitairesfranc-comtoises,LesbellesLettres.demore2004:d.demore,perteet(ré)découvertedesoidans l’autre langue,traverses - Impensés de la linguistique, 6, montpellier:Lacis,«sérieLangagesetculture»,publicationsdeL’universitémontpellieriii,85-93.freinet1966:c.freinet,essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation,neuchâtel(switzerland):delachauxetniestlés.a.Laplance,pontalis1998:J.Laplance.etJ.-b.pontalis,Vocabulaire de la psycha-nalyse,paris:puf,quadrige.merino,riano2004:J.L.merinoetx.a.gonzalesriano,attitudeslinguisti-quesetincidentscritiques.uneétudequalitativedanslaprincipautédesastu-ries(espagne),Traverses - Impensés de la linguistique, 6, montpellier:Lacis,«sérieLangagesetculture»,publicationsdeL’universitémontpellier iii,23-66.merino2003:J.L.atienzamerino,L’émergencedel’inconscientdansl’appro-priationdeslanguesétrangères,ela (etudes de linguistique appliquée),131,paris:didier-erudition,305-329.mehleret al.1994:J.a.mehleret al.,la Babel de l’inconscient,paris:pressesuniversitairesdefrance.nasio2001:J.-d.nasio,Cinq leçons sur la théorie de Jacques lacan,collection:petitebibliothèquepayot.prieur1996:J.-m.prieur,le vent traversier, Langageetsubjectivité,série«Lan-gageetcultures»,upv,montpellieriii.prieur2004:J.-m.prieur,linguistique barbare, Lacis,publicationsdel’uni-versitépaul-valéry,montpellieriii.sibony1991:d.sibony,entre-deux, paris:seuil.
Исидора Миливојевић ИСПОЉАВАЊЕ НЕСВЈЕСНОГ У ПРОЦЕСУ ПРИСВАЈАЊА
СТРАНОГ ЈЕЗИКАРезиме
Далинаснекистранијезик,којијошувијекстојинаразини„непознатог“,икојибис-можељелидаприсвојимо,привлачибашзатоштоговориоономенеспознатомунама:несвјесном?Сусретсастранимјезикомикултуромједнајеодмогућностидаседоживеискуствакојасунампромаклаутренуткунашегодрастањаиформирањаличности.Сто-га,самконтактсмелодијомнекогстраногјезикаилистранихјезика,можедаприуштиономекојиговоринекистранијезикутисакцјеловитостикојунијемогаодадосегненаматерњемјезику.
Међутим,каконашенесвјесноможедабудеизраженокрозстрани језикикакотај„другијезик“можедаговорионама?

L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère
479
Nasl
e|e 19
• 2011 • 4
65-4
79
Нашциљ,уједноиосноваовогарада,биласууправоовапитањанакојасмонастојалидадамоодговоре.Истотако,осврнулисмосенадидактикустранихјезикасажељомдаоткријемокакоовадисциплинаузимауобзир„несвјесно“каосаставнидиоличности.
Примљено: 28. 1. 2011

АУТОРИ НАСЛЕЂА

481
Nasl
e|e 19
• 2011
Laurent Bazin estdoyendelafacultédesLanguesetdesétudesinternationalesàl’universitédever-sailles-saint-quentin-en-yvelines.spécialistedelittératurefrançaiseduxxème;nom-breusespublicationsenétudeslittéraires,histoiredesidéesetdesformes,endidactiquedelalittératureainsiqu’enétudesinterculturelles.
Jelena Novaković estprofesseurtitulaireetchefdudépartementd’étudesromanesàlafacultédephilo-logiedebelgrade.elleenseignelalittératurefrançaiseetfrancophoneeteffectuedesrecherchesdansledomainedesrelationsfranco-serbes.elleatraduitdesœuvreslitté-rairesetthéoriquesfrançaisespourlesquelleselleareçudesprix.elleestlerédacteurenchefdelarevueFilološki pregled.elleco-dirigelapartieserbedesprojetsderecherches«nadrealizamievropskeintegracije»(institutzaknjiževnostiumetnostubeogradu–cnrsparis)et«translationresearchproject»(ceacs)etparticipeauprojet«srpskaknjiževnostu evropskomkulturnomprostoru» (institut za književnost i umetnost).elleaorganiséplusieursconférencesnationalesetinternationales.elleestl’auteurdesouvragessuivants:Priroda u delu Žilijena graka (1988),Bretonov nadstvarni svet(1991),u traganju za jedinstvom (1995),Na rubu halucinacija. Poetika srpskog i francuskog nadrealizma (1996),Ivo andrić i francuska književnost(2001),Tipologija nadrealizma(2002),Intertekstualnost u novijoj srpskoj poeziji. Francuski krug(2004),Recherches sur le surréalisme (2009),Intertekstualnost andrićevih zapisa(2010).elleapubliéplusde200articles.
Pavle Sekerušestactuellementvice-présidentdel’universitédenovisadpourdesrelationsinterna-tionales.ilestprofesseurtitulairedudépartementdesétudesromanesdelafacultédephilosophieoùilenseignelalittératurefrançaise.élèvedecomparatistefrançaisdaniel-henripageaux,pavlesekerušestadeptedelaméthodecomparatiste–imagologie.Laplupartdesestextestraitelesproblèmesdel’imagedel’autre,del’identité,desnationa-lismesculturels.commeprofesseursilaenseignédansplusieursuniversitéseuropéen-nes.ilestauteuroucoauteurdeplusieurslivres:Connaître nos voisins, Image de l’autre dans les littératures des Balkans(2002), Les slaves du sud dans le miroir français(2002),Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. a critical survey(2007)Cyprien robert, un slavisant français du XIXe siècle(2009).
Ivana Živančević-Sekerušestactuellementvice-doyennepourlesrelationsinternationalesetlascienceàlafacultédephilosophiedel’universitédenovisad.professeurtitulaireaudépartementdelit-tératureetlangueserbe,elleestauteurd’environsoixante-dixarticlessurdiverssujetsdanslesdomainesdel’histoiredeslittératuresetculturessudslaves.sonapprochedesproblèmeslittérairesestessentiellementcomparatisteetcouvrelesproblèmesderepré-sentationsdel’autre,lesmanifestationsidentitairesetlesnationalismesculturelsdanslesbalkanseteneurope.elleaparticipéàdenombreusesconférencesdanslepaysetdanslemonde.commeprofesseurelleaenseignédansplusieursuniversitéseuropéennesàmünster,amsterdam,gdansk,cracovie,prague,budapestetaparticipédenombreuxprojetseuropéens.elleestauteuretcoauteuràdeplusieurs livres:L’image de l’autre dans la littérature des Balkans(2002),self-portraits - variations imagologiques(2004),Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters

482
(2007),Comment décrire une différence? l’image de l’autre dans la littérature serbe(2009),miscellanea littéraires sudslaves(2009).
Julien Roumette estmaîtredeconférencesàl’universitédetoulouselemirail.directeurdelasérie«ro-maingary»dansLa revue des Lettres modernes(éditionsminard).auteurd’uneétude sur la Promesse de l’aube (ellipses,2006),iladirigéromain gary, l’ombre de l’Histoire,Littératuren°56(pressesuniversitairesdumirail,2007).ilestégalementl’auteurd’unesynthèse:Les poèmes en prose (ellipses,2001).auteurd’unethèsededoctorat(Le temps mode d’emploi,universitédeparis7,1999)etdenombreuxarticlessurgeorgesperec.ilaégalementpubliéCalcutta après michaux(éditionsdel’aube,2003).
Katarina Melic estmaîtredeconférencesàlafacultédeslettresetdesartsàkragujevacoùelleensei-gnelalittératureduxixeetxxesiècle.elleafaitsesétudesgraduéesàlafacultédephilologieàbelgradeetpostgraduéesaucanada(universitédecarleton,universitédequeen’s).elleasoutenusathèsededoctoratàl’universitédequeen’sàkingston(ca-nada).sesprincipauxdomainesderechercheetd’enseignementconcernentlalittératureduxixeetduxixesiècle,lafemmedanslalittérature,lerapporthistoire–littératureetlalittératuredel’exil.auteured’uneétudesurlerapporthistoire–littérature,ellepublierégulièrementdanslesrevuesacadémiques.
Ljiljana Petrović enseignelalangueitalienneàlafacultédesartsdeniš.sesdomainesd’intérêtportentsurl’influencedutraumadeguerredansleromanfrançaisetitalienduxxesiècle,letémoignagelittéraire,laréécrituredel’histoire,l’aspectmythiqueetmétaphysiquedanslaprésentationlittérairedesévénementshistoriques,leromanfrancophone,lethéâtrefrançaisduxviieetduxixesiècle.elleapubliédesarticlessuralessandrobaricco,J.m.g.Leclézio,pierrecorneille,lesécrivainsfrançaissurlascèneduthéâtredenišauxixesiècle.
Justyna Zycha fait unmaster en lettresmodernes françaises (2007), ainsi qu’en lettresmodernespolonaises(2008)danslecadred’étudesindividuellesetinterdisciplinairesenscien-ceshumainesdel’universitédevarsovie.actuellement,elleestdoctoranteàl’institutd’étudesromanesdel’universitédevarsovie,oùellepréparelathèsesurl’influencedelapsychanalysesurlacritiquelittéraireenfrance,etelletravailledanslecentredeLangueetdeculturepolonaisespourétrangersPolonicumàl’universitédevarsovieoùelleenseignelepolonaiscommelangueétrangère.elleaécritplusieursarticlessurlalittératurefrançaiseetpolonaiseduxxesiècle,dontontdéjàétépubliésentresautres:«Lalanguebecquetienne,existe-t-elle?ousurlebilinguismedebeckett»danslarevuetekstualia (no1,2010)et«LemotifdionisiaquedansCinq grandes odesdepaulclaudel»dansletravailcollectifDionysos. Mythe, littérature, philosophie, science sousladirectiondet.drewniaketd’a.dittmann (nysa−görlitz2009).elleaégalementsarubriquedanslarevueKwartalnik Polonicumoùelleécritdestextesdevulgarisationscientifiquesurlalangueetlaculturepolonaises.

483
Marija Džunić-Drinjaković estprofesseurassociéàlafacultéd’économiedel’universitédebelgrade.ellepoursuitdesrecherchessurlalittératurefrançaiseetcomparée,théorieetpratiquedelatraduc-tionetlanguedespécialité(économie).sestravauxsontpubliésdansdiversesrevueslittérairesserbesetfrançaises(Filološki pregled,Letopis matice srpske,gradina,Cahiers du centre interdisciplinaire deméthodologie,slavicca Occitania, Cahiers Octave Mirbeau, eidôlon…),ainsiquedansdesactesdecolloquesauxquelselleaprispart.elleestno-tammentl’auteurdedeuxouvrages:Polyphonies narratives(ikzs,2007)etFantastično i humor u pripovedačkom postupku Marsela emea (ikzs, 2008).elle a aussi traduitplusieursouvragesdufrançaisenserbe.
Biljana Tešanovićestmaîtredeconférencesenlittératurefrançaiseàlafacultédeslettresetdesartsdel’universitédekragujevac.elleobtientunemaîtrisedelangueetlittératurefrançaiseàbelgrade,puisunemaîtrisedeslettresmodernesàlasorbonne,ainsiqu’undeaàparisviii.ellesoutientsathèsedenouveaudoctoraten1998,égalementàparisviii.sesprincipauxdomainesderechercheetd’enseignementconcernentlalittératureduxviiesiècle,celledelasecondemoitiéduxxesiècle(enparticulierbeckett,sarrauteetcioran),lasémiotiquedel’écoledeparis(principalementdudiscours)etl’adaptationcinématographique.auteured’unemonographiesurbeckett,ellepublierégulièrementdanslesrevuesacadémiques.
Ana Lončarenseigneàl’écolesupérieured’hôtellerieoùelledonnedescoursdefos–hôtellerie.parallèlement,ellepoursuitsesétudesenlittératurefrançaise:en2008elleasoutenusathèsedemastersurvictorhugoetelleestentrainderédigerunethèsededoctoratportantsurlanouvelleduxixesiècle.
Ljiljana Matić estprofesseurtitulaireaudépartmentd’étudesromanesàlafacultédephilosophiedel’universitédenovisad.sesdomainesd’intérêtsontlalittératurefrançaiseduxxesiècleetlalittératurefrancophone.elleaétélapremièreenex-yougoslavieàfairefigurerauprogrammeobligatoiredesétudesàsafaculté,lecourssurlalittératurefrancophone(leromanquébécoiscontemporain).elleaétél’undesmembresfondateursdel’asso-ciationdeLittératureetdecultureyougoslavie–canada.elleaétévice-présidentedel’associationyougoslavedesétudescanadiennesde1987à2006.elleaparticipéauxcolloquesorganisésparcetteassociationenserbie.elleapubliédenombreuxlivres.elleestaussitraductriceetcritiquelittéraireayantpubliéplusdecentdixarticlesdanstrente-septpayssurquatrecontinents.
Elena Dineva aterminéen2007unelicenceen«Lettresfrançaises»àl’universitédesofia«st.kli-mentohridski»suiviparunmasteren«étudessurlesfrancophonies»qu’elleaterminéen2009.danslecadredecemaster,elleapudécouvrirlalittératurefrancophonedebelgiqueparsesnombreuses lecturesqui luiontpermisdes’ouvrirsurdenouvellesperspectivesdonnantlieuàunemiseenparallèledel’artetdelalittératureauxquelselleporteunintérêtparticulier.ainsi,afind’approfondirsesconnaissancesencesmatières,
Nasl
e|e 19
• 2011

Milivojević I.
484
elleacommencé,en2010,undoctoratenlittératuresfrancophonesàl’université«clé-mentd’ohrid»desofiadanslecadreduquelelleenvisaged’écrireunethèseconsacréeaurapporttexte–imagedanslecontextedelalittératurefrancophonedebelgique.
Marjana Djukićestmaîtredeconférenceàl’universitédumonténégro(institutdesLanguesétrangères,départementdetraduction)oùelleenseignelalittératurefrançaise.spécialistedelanarratologiefrançaise,ellearédigédenombreuxarticlesconcernantlerôledelathéoriedansl’analyselittéraireetdansl’enseignementdelalittérature.elleapubliérécemmentŽan ruse, Teorija romana(ikzs,2010).elleestcoauteur(avecradojkavukčević)duprojetinternationalLa critique littéraire aujourd’hui (Književna kritika danas, podgo-rica,institutzastranejezike,2004),rédactriceenchefetsélectricedeL’anthologie de la nouvelle française contemporaine(podgorica,ars,2003).
Tamara Valčić Bulić estmaîtredeconférencesetenseignelalittératurefrançaiseàfacultédephilosophieànovisad.afaitsesétudesdeLettresmodernesàlasorbonne-parisivetdesétudesdelangueetdelittératurefrançaisesàlafacultédephilologiedebelgrade.asoutenusathèsededoctoratsurlatraditionnarrativebrèvedelarenaissanceen2009.elleapubliéplusieursarticlesdansdesrevuesnationalesetàl’étranger.sesintérêtsportentsurtoutsurlatraditionnarrativebrèvedelarenaissance,lesrécitsdevoyage,lepoèmeenprose.
Marija Panićestassistanteetdoctoranteàlafacultédeslettresetdesartsàkragujevac.aprèsavoirfaitsesétudesàbelgrade,genèveetkragujevac,elletravaillesursondoctoratconsacréauxbestiairesfrançaismédiévaux.elleaégalementeffectuélesrecherchessurvoltaire,henrimichauxetnégovanrajic.
Zorana Krsmanović elleenseigne la littérature françaisemédiévaleaudépartmentd’étudesromanesà lafacultédephilologiedebelgrade,oùelleasoutenusathèsedemaîtrise sens et fonction du mythe de Tristan dans l’œuvre de Chrétien de Troyes en2007.elleprépareactuellementsathèsededoctorat,intituléeLes premières versions du Lanceloten prose du 13e siècle et la poétique du roman.sondomainederechercheestlalittératurefrançaisemédiévaleetlalittératurecomparée.
Jasmina Nikčević enseignelalittératurefrançaiseàlafacultédephilosophieànikšić(monténégro).elles’intéressetoutparticulièrementàlalittératurefrançaisedel’époqueromantique,maissesdomainesd’intérêt sont aussi les rapports culturelsdespaysbalkaniques avec lafrance,l’écritureféminine,lalittératurefrancophone,latraductionetladidactiquedeslanguesétrangères.elleaobtenusondiplômedeprofesseurdelangueetlittératurefran-çaiseàl’universitédebelgrade;lemasteretledoctoratèslettresàl’universitéFrançois rabelaisdetours.

485
Ivan radeljković assistantenlittératurefrançaiseàlachairedefrançaisdelafacultédephilosophieàsarajevodepuis2006,ils’intéresseparticulièrementàlapoésiemodernefrançaise.ilafaitunmasterd.e.a.en2005àl’universitéparis8,oùilprépareactuellementunethèsededoctoratsurlaréalitédanslapoésiedecendrars,reverdyetapollinaire.auteurd’articlesdiverssurlacritiqueetl’histoirelittéraire(parustousdanslarevueNovi izrazàsarajevo),ilestaussitraducteur(Bosnie, la mémoire à vifd’isabellewesselinghetarnautvaulerin,paruchezbuybookàsarajevoen2006).
Henri Boyerestdocteurd’etatèsLettresetscienceshumaines(1990).Leestsociolinguiste,pro-fesseurdesciencesdu langageà l’universitémontpellier iii.depuis1998 ildirige leLaboratoiredipraLang(ea739).ilestparailleursresponsabledumasterrecher-chedesciencesdulangage.de1990à1993iladirigél’institutfrançaisdebarcelone.fondateurdescollections«sociolinguistique»et«Langueetparole»chezL’harmattan,ilestmembredeplusieurscomitésderédactionderevues(Mots. les langages du poli-tique;laRevue des Langues Romanes,etudes de linguistique appliquée, lengas. revue de sociolinguistique…);ilestco-fondateuretactuellementresponsabledelarevuetravaux de didactique du français langue étrangère.ilest l’auteurdeplusieursouvrages(etdenombreuxarticles)parmilesquels:Langues en conflit(L’harmattan,1991),de l’autre côté du discours. recherches sur le fonctionnement des représentations communautaires(L’harmattan,2003),langue et identité. sur le nationalisme linguistique(Lambert-Lucas,2008),etadirigédiversespublicationscollectives,commeparexemple:stéréotypage, stéréotypes: fonctionnements ordinaires et mises en scène(L’harmattan,2007;5tomes),Hybrides linguistiques. genèses, statuts, fonctionnements(L’harmattan,2010),Pour une épistémologie de la sociolinguistique(Lambert-Lucas,2010).Lesorientationsdesonac-tivitéscientifiqueetdesesinterventionssontlessuivantes:recherchessociolinguistiquessurladynamiquedesreprésentations/stéréotypesetattitudesdansuncertainnombredeconfigurationslinguistiqueseneuropeetenamériquelatine,enrelationavecdesproblématiquesidentitaires;étudesetexpertisesconcernantlespolitiqueslinguistiquesetéducativesmisesenœuvredansdessituationsconflictuellesdeplurilinguisme;ana-lysessociosémiotiquesdesfonctionnementsdudiscoursmédiatique.
Snežana Gudurić afinisesétudesdelangueetlittératurefrançaisesàlafacultédephilosophiedenovisadetasoutenusathèsedemagistèreàlafacultédephilologiedebelgrade,filièrescienceduLanguage.elleapréparésathèsededoctoratdanslecadreduprogrammetempusàl’institutdelinguistiqueetdephonétiquegénéralesetappliquéesàl’univesitéparisiii–sorbonnenouvelleetl’asoutenueàlafacultédephilosophiedenovisad.professeurd’universitéd’étudesromanes,elleapubliéplusde50articlesenlinguistiquegénéraleetappliquée,ainsiquedeuxlivres:de la nature des sonsetPhonétique et Phonologie de la langue française.elleestpremiercoauteurdesmanuelsdelanguefrançaisepourl’écolesecondairele français…J’aime! 1et2etdelaPhonétique et Phonologie française. Cahier d’exercices,etsecondcoauteurde laPhonologie de la langue serbe.ellecollaboreauxprojetslaDescription et la standardisation de la langue serbeetl’encyclopédie serbeetdirigeleprojetLes langues et les cultures dans le temps et dans l’espace.elleestmembreducomitéderédactiondesrevuesscientifiquesRevue annuelle de la Faculté des Lettres de Novi sadetjournal of Linguistic studies detimisoara,présidentdel’associationde
Nasl
e|e 19
• 2011

486
Linguistiqueappliquéedeserbieetresponsabledudépartementd’étudesromanesàlafacultédephilosophiedenovisad.
Mihailo Popović enseignelalexicologiefrançaise,l’histoiredelalanguefrançaiseetlasyntaxefrançaiseà lafacultédephilologiedebelgrade. il s’intéresseparticulièrement auxproblèmesde lexicologieetdesémantiquefrançaisesetserbo-croates,à l’ancienfrançaisetauxcontacteslinguistiquesentrelefrançaisetleserbo-croate.
Veran Stanojevićafaitsesétudesdefrançaisàlafacultédephilologiedebelgrade.en2004,ilasoutenuunethèsededoctoratenlinguistiquedescriptive,formelleetautomatiqueàl’universitéparis7-denisdiderot.promuaurangdeprofesseurd’universitéen2010,ilenseignelalinguistiquefrançaiseàlafacultédephilologiedebelgrade.entantqueprofesseurinvitéilenseigneaussiàlafacultédeslettresetdesartsdekragujevac.ilestl’auteurdetroislivresdontles noms de nombre en français: essai de sémantique formelleet,avect.ašić, sémantique et pragmatique des temps verbaux en français,ainsiquedenombreuxarticlesparusdansdesrevuesnationalesouinternationales.aplusieursreprises,ilaétéinvitéàdonnerdesconférencesenmatièredesémantiqueformelleàl’universitéparis4-sorbonne,àl’universitédegenèveetàl’universitédeneuchâtel.sestravauxdere-cherchesportentsurlasyntaxeetlasémantiquedesdéterminantsdunom,surlestempsverbauxenfrançaisetenserbeetsurl’acquisitiondestempsverbauxdufrançais.
Tijana Ašić estprofesseurdelinguistiquegénéraleetfrançaiseàlafacultédeslettresetdesartsdel’universitédekragujevac.elleapubliédeuxlivres(espace, temps, préposition, 2008;genève,drozet(avecv.stanojević)la sémantique et pragmatique des temps verbaux en français, 2006/2008;fiLum,kragujevac)etunecinquantained’articlesdansdesrevuesinternationalesetnationales.t.asićestlauréateduprixcharlesbally(universitédegenève)etdenaylorprize(ohiostateuniversity).sesdomainesderecherchesontlasémantique,lapragmatique,lasociolinguistique,lastylistiqueetl’histoiredessciencesdulangage.
Dragana Drobnjak afinisesétudesdelangueetlittératurefrançaisesàlafacultédephilosophiedenovisadoùelleasoutenusesthèsesdemagistèreetdedoctorat.elleestactuellementmaîtredeconférenceaudépartementd’étudesromanesàlafacultédephilosophiedenovisadetenseignelalexicologieetlamorphosyntaxedelalanguefrançaise.elles’intéressesurtoutàl’analysecontrastivedufrançais,del’italienetduserbe,collaboreauxprojetsLes Littératures et les Cultures en ContactetLes langues et les cultures dans le temps et dans l’espace.elleapubliéplusieursarticles,entreautresL’adaptation sémantique des termes littéraires français en serbeetle genre des emprunts français en serbe.
Ana Topoljska afinisesétudesdelangueetlittératurefrançaisesàlafacultédephilosophiedenovisadoùelleasoutenusathèsedemagistère(Les constructions passives en français et leurs équivalents en slovaque et en serbe).entrelesannées1985-1995,elleatravaillécomme

487
assistanteetlectriceàlafacultédephilosophiedenovisad,elleestactuellementse-crétairedudépartementd’étudesromanesàlamêmefaculté.elles’intéressesurtoutàl’analysecontrastivedufrançais,slovaqueetserbe.co-auteurdesmanuelsdefrançaispourl’écolesecondairele français…J’aime!1 etle français…J’aime!2,elleaprésentéplu-sieurscommunicationsàdescolloquesnationauxetinternationauxetpublié5articles.ellecollaboreauprojetLes langues et les cultures dans le temps et dans l’espace.
Andrej Fajgelj diplômédelafacultédephilosophiedenovisadelacontinuésesétudesenfrance,àl’universitépaulvaléry–montpellieriii,oùilasoutenusathèse«phraséologieetidéologiecomparéesdans l’artde l’épopée:homère, chansonsdegeste,gouslé»aveclamentiontrèshonorableavec félicitations. ilestmaîtredeconférencesà lafacultédeslettresetdesartsàkragujevacoùilenseigneenparticulierl’histoiredelalanguefrançaise.
Jovana Fajgelj diplôméedelafacultédephilosophiedenovisad–départementd’étudesromanes,elleaeffectuéle master2«théorieetméthodologiedelalangueitaliennepourlesétudiantsétrangers»àl’università degli studi di Roma«torvergata»enitalie.elleestemployéeàlafacultédesétudesdedroitetd’affairesànovisadcommeprofesseurdeslanguesfrançaiseetitalienne.sesdomainesd’intérêtsontlesliensentrecesdeuxlanguesro-manesetlaméthodiquedel’enseignementdeslanguesétrangères.
Jasmina Tatar Andjelić enseigneaudépartementdefrançaisdelafacultédephilosophiedenikšić,universitédumonténégro,ainsiqu’àl’institutdeslanguesétrangèresàpodgoricadanslecadreduprogrammedeformationdesinterprètes-traducteurspourlalanguefrançaise.elleafaitsesétudesdefrançaisàl’universitédenovisad,serbie,puisàl’universitéstendhalàgrenoble,france.elleasoutenusathèsedetroisièmecycleenlinguistiquefrançaiseàl’universitédenovisad.elleasoutenusathèsededoctorat,intituléeConstructions infinitives régies par les verbes de perception et les verbes factitifs faire et laisser et leur traduction en serbo-croate (bosnien, croate, monténégrin, serbe) en décembre 2010 àl’universitédestrasbourgsousladirectiondeJean-christophepellat.elleaparticipéàdenombreuxcolloqueslinguistiquesnationauxetrégionaux.elleesttraductricedu«courrierdesbalkans»,portailfrancophonedesbalkansdepuisplusdedixans,tra-ductriceassermentéeetinterprètedeconférencepourleslanguesfrançaiseetitaliennedepuisdelonguesannées.
Altijana Brkanpoursuitsesétudesendoctoratdepuis2009sousladirectiondeJacquelinevaissièreàl’iLpga(paris3-sorbonnenouvelle).aprèsavoirobtenusonmaster2dephonétiqueen2009àl’iLpgaentantqueboursièredugouvernementfrançais,elleacommencésontravaild’assistante-prof.dephonétiqueetphonologiedufrançaisà lafacultédephilosophieàsarajevo.sathèseportesurlacomparaisondutraitnasal,notammentl’ampandel’anticipationdenasalité(phénomènedecoarticulation)enfrançais,bosnienetanglais.Ladeuxièmepartiedesathèseportesurladidactiquedufrançais,lebutétantdevoirdansquellemesurelesapprenantsdufrançaislangueétrangèrevonttransposer
Nasl
e|e 19
• 2011

488
leurshabitudesarticulatoiresdelalanguematernelledanslalangueétrangère.Lebutultimedesesrecherchesestl’écritured’unouvragepourladidactiquedufrançaisquifa-voriseral’apprentissagedelaprononciationdufrançaislangueétrangèreenintroduisantdenouvellesméthodesquiutilisentdeslogicielscommepraat,winpitch,winsnoorietwavesurfer.
Aleksandra Stevanović estdoctoranteenlinguistiqueàlafacultédeslettresetdesartsàkragujevac.elletra-vailledanslecadredesrecherchessémantiques,stylistiquesetpragmatiques.sonsujetderecherchepourledoctorat(L’analysesémantiquedesmétaphoresetdelacomparai-sondansleromantestamentdevidosavstevanovićetdanssonéquivalentfrançais,Le Prélude à la guerre) portesurtoutsurlamétaphore.
Nataša Popović travaillecommeassistanteaudépartementd’étudesromanesàlafacultédephiloso-phiedenovisad.en2009,elleasoutenusathèsedemagistèreintituléeLes valeurs des prépositions françaises à et de au niveau du syntagme verbal et leurs corrélats en serbe.ellefaitundoctoratportantsurl’expressiondelacausalitéenfrançaisetenserbe.sesdomainesd’intérêtsontlamorphosyntaxe,lasyntaxe,lasémantique,l’analysecontras-tiveetlalinguistiqueappliquée.
Jelena Mihailović estprofesseurdefrançaislangueétrangèreàlafacultédessciencesetàlafacultéd’éco-nomieàl’universitédenovisad.elleaétéengagéecommeassistanteàlafacultédeslettresàkosovskamitrovicade2008à2009.elleasoutenusonmémoiredemasteren2009:les modalités de l’expression de la relation spatiale en français et ses corrélats en serbe(aspect statique).actuellement,ellefaitsesétudesdoctorales;sesdomainesd’intérêtsontlasémantique,lapragmatique,lesétudesconstrastivesetlefrançaisdespécialité.
Vesna Kreho estmaîtredeconférencesàlafacultédephilosophiedel’universitédesarajevo.elleenseigne la littérature françaiseaudépartementdes langueset littératures romanes.Lalittératurefrançaiseduxviiesiècle,etnotammentlethéâtrebaroqueetclassique,constituel’essentieldesesrecherchesscientifiques.Laversionremaniéedesathèsededoctoratsoutenueàl’universitéparisiv-sorbonneaétépubliéesousletitretravestisse-ments génériques. l’Interférence des genres dramatiques dans le théâtre français de 1628 à 1634. elleatraduitplusieursouvragesdesauteursfrançaistelsquesimonedebeauvoir,robertantelme,michelleperrot,etc.
Irène Kristeva estprofesseureassociéeauprèsdudépartementd’étudesromanesàlafacultédesLettresclassiquesetmodernesdel’universitédesofia.elleyenseignelathéoriedelatraduc-tionet laLittérature françaisecontemporaine.titulaired’undoctoratdesémiologiedutexteetdel’image,délivréparl’universitédeparis7,elleestl’auteurnotammentdePascal Quignard: la fascination du fragmentaire(L’harmattan,2008)etPour com-prendre la traduction(L’harmattan,2009).quelquesétudesetarticlestraductologiquesrécents:«delapulsiondetraduireauxlimitesdel’interprétation»(2008);«(po)éthique

489
delatraduction»,«perspectivesherméneutiquesdelatraduction»,«walterbenjamin:traductionetpluralitélinguistique»(2009);«Jacquesderrida:lacatastrophedebabel»,«herméneutiquedelatraduction»,«L’éthosdutraducteur»(2010).traductricedufran-çaisetdel’italien,elleatraduitetsupervisé,entreautres,desœuvresdeLeopardi,pascal,quignard,bourdieu,bobbio,deleuze,derrida,eco,foucault,ricœur.auditricelibredel’associationespace analytique.
Ana Vujovićestprofesseur à lafacultéde formationdesmaîtres àbelgrade.elle s’intéresseplusparticulièrementàladidactiquedefLeetdefos,aussibienqu’àl’utilisationdesélé-mentsdelaculturedansl’enseignementdeslanguesétrangèresetauxrelationsfran-co-serbes. elle est l’auteure dedeuxmonographies (elementi francuske civilizacije u udžbe nicima francuskog jezika, savremena francuska kultura) et d’unmanuel conçupourlesétudiantsdesfacultésdeformationdesmaîtres(L’éducation en France),aussibienqued’unesoixantained’articlestraitantdifférentesquestionsdelalinguistiqueetdeladidactiquedufrançais.elleestmembredelarédactiondelarevueinnovations dans l’enseignement.
Claudine Pontengagéedenombreusesannéesdansl’enseignementdufL2,elleatrèstôtexpérimenté,demanièrepragmatique,lesbénéficesdelapriseencomptedelalangued’originedesélèvespourl’apprentissagedufrançais.professeure-formatriced’enseignants–formationinitiale,formationcontinueetformationcomplémentaire–àlahauteécolepédagogi-queducantondevauddepuis2002,elleestparticulièrementconcernéeparlesréponsesquepeuventapporterlesapprochesd’éveilauxlanguesauxdéfisd’unesociétépluricul-turelle,enparticulierenquiconcernelaréussitescolairedetouslesélèves.
Yves Érard estdirecteurducoursdevacancesdel’universitédeLausanne.ilestaussimaîtred’en-seignement etde recherche à l’ecolede français langue étrangèrede l’universitédeLausanne.enfin,ilenseignelefLeàl’écolematernelle.sesrecherchess’organisentsurlesdeuxaxescomplémentairesquesontl’acquisitiondelalanguepremièreetl’acquisi-tiond’unelangueseconde.yveserarddéveloppeuneapprochewittgensteinienne(«newwittgenstein»)del’acquisitiondulangagechezl’enfant.
Thérèse Jeanneret est professeureassociéededidactiquedufrançaislangueétrangèreàl’universitédeLau-sanne.ellecoanime,avecraphaëlbaroni,ungroupederecherchesurlesbiographieslangagièresdontl’undesobjectifsestd’étudierlesliensentrereprésentationssocialesetinvestissementdansl’apprentissagedelalangueétrangère.Linguisteetdidacticienne,sestravauxtraitentd’aspectsdescriptifsetdidactiquesdufrançaisoraleninteractionetdufrançaisécrit.
Tatjana Šotra-Katunarićestmaîtredeconférencesdepuis2005,etenseigneàlafacultédephilologieaudépar-tementd’étudesromanesdepuis1996:elleyestresponsabledescoursetduprogramme-didactiquedufLe.elleesttitulaired’undoctoratde3ecycleenlittératureestconsacré
Nasl
e|e 19
• 2011

490
authéâtredeionescoetd’undoctoratd’etatendidactiquedufLe,consacréàl’expres-sionoraleen françaisdesapprenants serbophones .elleapubliédeux livresconsa-crésàladidactiquedufLesousletitre:Kako progovoriti na stranom jeziku,(beograd,2006)etDidaktika francuskog kao stranog jezika,(beograd,2010).autitredelectricedeserbeetdechargéedecivilisationsetculturesdesslavesdusud,elleaenseignéàl’universiténancy2,départementderusseetdeserbo-croatede2003à2005.tatjanaŠotra-katunarićestmembredel’associationdestraducteurslittérairesdepuis1980;elletraduitetpubliesestraductionsenserbedesoeuvresdesécrivainsfrançais(ionesco,barthes,genette,besson).présidentede l’associationdesprofesseursde françaisdeserbiedepuis2009.
Biljana Stikićtravailleàlafacultédeslettresetdesartsdekragujevacentantquemaîtredeconfé-rencesetenseignante-chercheusedansledomainededidactiqueetculturedufrançaislangueétrangère.elleaparticipéàplusieursjournéesetcolloquesscientifiquesinter-nationaux.vusaspécialisationenhistoiredufLeenserbie,laplupartdesestravauxconcernentledomainementionné.
Ivona Jovanović estmaîtredeconférencesàl’universitédumonténégro,àlafacultédetourismeetdel’hôtelleriedekotoroùelleenseignele FLeetLes langues et civilisations.elles’intéresseparticulièrementàladidactiquedufosetelleestauteurd’unmanueldestinéauxélèvesdeslycéesspécialisésdansletourisme:«Bienvenue au monténégro»(podgorica,2008).sesdomainesd’intérêtsontégalementletourismeculturelainsiquelesliensculturelsentrelafranceetlemonténégroau19èmeetaudébutdu20èmesiècle.publications:enseignement des langues étrangères et développement du tourisme et d’hôtellerie au mon-ténégro,belgrade,2007;traces de la culture française et développement du tourisme cultu-rel à Cetinje,capitale historique du Monténégro,madrid,2009;La princesse darinka et la cour du Monténégro à la française, novisad,2007;Le guide touristique et gastronomique Michelin - une publication qui a cent ans,belgrade,2010;L’enseignement de la langue et de la littérature française dans l’institut de jeunes filles «impératrice marie» à Cetinje (1869-1913),tours,2008;tourisme et valorisation des chemins de fer - approches compa-rées du Monténégro et de l’auvergne,kotor2010;traductionetpublicationdupremierguidetouristiquedumonténégropubliéenfrançaisàmarseilleen1901:«Le guide de Cettigné»(kotor,2009).ivonaJovanovićestégalementresponsabledelaformationdesguidesinterprètesaumonténégro.
Aleksandar Milivojević a terminé les étudesdeLangueet littérature françaisesaudépartementdes languesromanesàl’universitédenovisad,en2005.àl’université«paul-valéry»-montpellier3,ilasoutenulemémoiredemaster2professionnelLa formation des guides interprètes à Kotor (Monténégro): Élaboration d’un glossaire spécialisé franco-monténégrin,portantsurlapratiqueprofessionnelledefrançaissurobjectifsspécifiques.ilestassistantàlafa-cultédetourismeetd’hôtellerieàkotor,oùilenseignelefrançaislangueétrangèreetlefrançaisdutourisme.sesdomainesd’intérêt:besoinslangagiersdesguides-interprètes;besoinslangagiersspécifiquesàd’autressalariésdusecteurtouristique,relatifsaupublicfrancophone.parallèlement,ilexercelemétierdeguidetouristiqueenlanguefrançaise,spécialisépourlesrandonnéesetlesséjoursculturels.publications:enseignement des

491
langues étrangères et développement du tourisme et d’hôtellerie au monténégro,belgrade2007;Monténégro, une nouvelle destination sur le marché français,belgrade,2009.
Isidora Milivojevic aterminésesétudesdelangueetlittératurefrançaisesaudépartmentd’étudesroma-nesàl’universitédenovisad,en2005.al’université«paul-valéry»-montpellier3,elleasoutenusonmémoiredemaster2«L’énergiedelaparoleexploréeparlacréationthéâtrale»,portantsurladimensiondusujetparlantetdesaplacedansladidactiquedeslangues,ainsiquesursonexpressivitéglobaledanslapratiquethéâtraleenfLe.elleestentraindedéveloppersonprojetdethèsesurlesujet«notrevoixenlangueétrangère»,quifavoriserauneapprochepluridisciplinairedansl’appropriationdelavoixd’uneautrelangue.avecsongroupe«prkosdrumski»,elleécritdelamusiqueetdelapoésie.
Nasl
e|e 19
• 2011


493
УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ
1.Радовитребадабудудостављениелектронски,уприлогу–као отворени документ (word), на електронску адресу редакцијеНаслеђа:[email protected].
2.Дужина рукописа:до15страница(28.000карактера).3. Формат: фонт: times new roman; величина фонта: 12;
размак између редова:before:0;after:0;Linespacing:single.4.Параграфи:формат:normal;први ред: увучен аутоматски
(col1).5. Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово
(препоручујемо) и презиме(на). Име и презиме домаћих аутораувексеисписујеуоригиналномоблику(акосепишелатиницом–сасрпскимдијакритичкимзнаковима),независноодјезикарада.
6. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно наконимена и презимена наводи се пун (званични) назив и седиштеустановеукојој јеауторзапослен,аевентуалноиназивустановеукојојјеауторобавиоистраживање.Усложениморганизацијаманаводисеукупнахијерархија.Ако јеауторавише,анекипотичуизистеустанове,морасе,посебнимознакамаилинадругиначин,назначитиизкојеоднаведенихустановапотичесвакиодаутора.Функцијаизвањеауторасененаводе.
7. Контакт подаци: Адресу или електронску адресу ауторставља унапоменуприднупрве страницечланка.Ако је ауторавише,дајесесамоадресаједног,обичнопрвог.
8. Језик рада и писмо: Језикрадаможебитисрпски,руски,ен-глески,немачки,францускиилинекидругиевропски,светскиилисловенски језик, раширене употребе умеђународнојфилолошкојкомуникацији. Писмо на којем се штампају радови на српскомјезикујестећирилица.
9.Наслов:Насловтребадабуденајезикурада;требагапоста-витицентрираноинаписативеликимсловима.
10. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања,методе,резултатеи закључак.Требадаимаод100до250речиидастојиизмеђузаглавља(наслов,именааутораидр.)икључних

494
речи,наконкојихследитекстчланка.Апстрактјенасрпскомилинајезикучланка.[Техничкепропозицијезауређење:формат– фонт:timesnewroman,normal;величина фонта:10; размак између редова–Before:0;after:0;Linespacing:single;први ред–увученаутоматски(col1).]
11.Кључне речи:Бројкључнихречинеможебитивећиод10.Кључнеречидајусенаономјезикунакојемјенаписанапстракт.Учланкуседајунепосреднонаконапстракта.[Техничкепропозицијезауређење:формат– фонт:timesnewroman,normal;величина фонта:10; први ред–увученаутоматски(col1).]
12.Претходне верзије рада:Акојечланакбиоизложеннаску-пуувидуусменогсаопштења(подистимилисличнимнасловом),податакотометребадабуденаведенупосебнојнапомени,приднупрвестранечланка.Неможесеобјавитирадкојијевећобјављенунекомчасопису: ниподсличнимнасловомнитиуизмењеномоб-лику.
13.Навођење (цитирање) у тексту:Начинпозивањанаизвореуоквиручланкаморабитиконсеквентанодпочеткадокрајатек-ста.Захтевасеследећисистемцитирања,преовлађујућиунауциојезику:
...(Ивић2001:56-63)...,/(в.Ивић2001:56-63)...,/(уп.Ивић2001:56-63).../М.Ивић(2001:56-63)сматрада...[наводникеиполунаводникеобележаватинаследећиначин:„“/’‘]
14. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране укојој се налази коментарисани део текста. Могу садржати мањеважнедетаље,допунскаобјашњења,назнакеокоришћенимизво-римаитд.,алинемогубитизаменазацитиранулитературу.[Технич-кепропозицијезауређење:формат–footnotetext;првиред–увученаутомат-ски(col1);величина фонта–10;нумерација–арапскецифре.]
15. Табеларни и графички прикази: Табеларни и графичкиприказитребадабудудатинаједнообразанначин,ускладуслинг-вистичкимстандардомопремањатекста.
16.Листа референци (литература):Цитираналитератураоб-ухватапоправилубиблиографскеизворе (чланке,монографијеисл.) и даје сеискључиво у засебномодељкучланка, у виду листереференци.Литературасенаводинакрајурада,пререзимеа.Рефе-ренцесенаводенадоследанначин,азбучнимодносноабецеднимредоследом.Акосевишебиблиографских јединицаодносенаис-тогаутора,онесехронолошкипостављају.Референцесенепреводенајезикрада.Саставниделовиреференци(ауторскаимена,насловрада,изворитд.)наводесенаследећиначин:
[закњигу]Јакобсон1978:Р.Јакобсон,Огледи из поетике,Београд:Просвета.

495
[зачланак]Радовић2007:Б.Радовић,Путевиопереданас,Крагујевац:Наслеђе,7,Крагујевац,9-21.
[заприлогузборнику]Радовић-Тешић 2009: М. Радовић-Тешић, Корпус српског језика уконтексту савремених језичких раздвајања , у: М. Ковачевић (ред.),Српски језик, књижевност, уметност,књ.i,Српскијезикуупотреби,Крагујевац:Филолошко-уметничкифакултет,277-288.
[зарадовештампанелатиницом]Бити1997:v.biti,Pojmovnik suvremene književne teorije,zagreb:maticahrvatska.
[зарадовенастраномјезику–латиницом]Лајонс 1970: J. Lyons, semantics I/II, cambridge: cambridge universitypress.
[зарадовенастраномјезику–ћирилицом]Плотњикова 2000: А. А. Плотникова, Словари и народная культура,Москва:ИнститутславяноведенияРАН.
Радовеистогаутораобјављенеистегодинедиференциратидо-дајућиa,b,cилиа,б,в,нпр.:2007a,2007bили2009a,2009б.
Ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: Симић, Остојић;акоихимавише:послепрвогпрезимена(апрегодине)додатиet alилии др.
Ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године,нпр.:
Лич²1981:g.Leech,semantics,harmondsworthetc.:pinguinbooks.[Техничкепропозицијезауређење:формат– фонт:timesnewroman,nor-mal;величина фонта:11; размак између редова–Before:0;after:0;Linespa-cing:single;први ред:куцатиодпочетка,аосталеувућиаутоматски(col1:опцијаhanging,саменијаformat)]
ПоступакцитирањадокуменатапреузетихсаИнтернета:[монографскапубликацијадоступнаon-line]
Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датумпреузимања.Нпр.:veltman,k.h.augmented Books, knowledge and culture.‹http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.02.02.2002.
[прилогусеријскојпубликацијидоступанon-line]Презиме,имеаутора.Насловтекста.Наслов периодичне публикације,да-тумпериодичнепубликације.Имебазеподатака.Датумпреузимања.Нпр.:dutoit,a.teachinginfo-preneurship: student’sperspective.asLiB Proceedings,february2000.proquest.21.02.2000.
[прилогуенциклопедијидоступанon-line]Име одреднице. Наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датумпреузимања.Нпр.: tesla, nikola. encyclopedia Britannica. ‹http://www.britannica.com/ebchecked/topic/588597/nikola-tesla›.29.3.2010.

496
17.Резиме:Резимерадајестеуствариапстрактнадругомјезикунакојемнијерад.Акојејезикрадасрпски,ондајерезимеобавезнонаједномодсловенскихилисветскихјезика.Резимеседајенакрајучланка,наконодељкаЛитература.Преводкључнихречинајезикрезимеадолазипослерезимеа.[Техничкепропозицијезауређење:формат– фонт:timesnewroman,normal;величина фонта:11; размак између редова–Before:0;after:0;Linespacing:single;први ред–увученаутоматски(col1).]
18. Биографија: У биографији, која не треба да прелази 250речи, навести основне податке о аутору текста (година и месторођења,институцијаукојојјезапослен,областиинтересовања,ре-ференцепубликованихкњига).
УредништвоНаслеђа

проф.дрТијанаАшић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
доц.дрКатаринаМелић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
проф.дрЈеленаНоваковић,Филолошкифакултет,Београд
проф.дрВеранСтанојевић,Филолошкифакултет,Београд
проф.дрПавлеСекеруш,Филозофскифакултет,НовиСад
проф.дрСнежанаГудурић,Филозофскифакултет,НовиСад
проф.дрЛоранБазен,УниверзитеВерсај-Сен-Кантен-ан-Ивлин,
ФранцускаДоц.дрЖилијенРумет,
УниверзитетТулузЛеМирај,ФранцускаПроф.дрАнриБоаје,
УниверзитетМонпеље3,Францускапроф.др.ИренКристева,
УниверзитетуСофији,Бугарскадоц.дрВеснаКрехо,
УниверзитетуСарајеву,БоснаиХерцеговинадоц.дрМарјанаЂукић,
УниверзитетуЦрнојГори,ЦрнаГорапроф.дрТерезЖанре,
УниверзитетуЛозани,Швајцарска
drtijanaašić,facultédeslettresetdeslangues,kragujevacdrkatarinamelić,facultédeslettresetdeslangues,kragujevacdrJelenanovaković,phd,facultédephilologie,belgradedrveranstanojević,phd,facultédephilologie,belgradedrpavlesekeruš,phd,facultédephilosophie,novisaddrsnežanagudurić,phd,facultédephilosophie,novisadLaurentbazin,phd,universitédeversailles-saint-quentin-en-yvelines,franceJulienroumette,phd,universitédetoulouseLemirail,francehenriboyer,phd,universitédemontpellieriii,franceirènekristeva,phd,universitédesofia,bulgarievesnakreho,phd,universitédesarajevo,bosnieetherzégovinemarjanaĐukić,phd,universitédumonténégro,monténégrothérèseJeanneret,phd,universitédeLausanne,suisse
Уређивачки одбор тематског броја / Le comité de rédaction de la thématique

Уредништво/editorial BoardДраганБошковић/draganbošković
главни и одговорни уредник/editor in Chief
Проф.дрБранкаРадовић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Доц.дрСањаПајић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Проф.дрРадмилаНастић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Доц.дрКатаринаМелић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Проф.дрАнђелкаПејовић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Проф.дрТијанаАшић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Доц.дрМајаАнђелковић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац
Проф.дрПерсидаЛазаревићдиЂакомо,Универзитет„Г.дАнунцио“,Пескара,
Италија.Проф.дрАлаТатаренко,
ФилолошкифакултетУниверзитета„ИванФранко“,Лавов,Украјина.
Проф.дрМихајРадан,Факултетзаисторију,филологијуи
теологију,Темишвар,РумунијаПроф.дрДимкаСавова,
Факултетзасловенскуфилологију,Софија,Бугарска
Проф.дрЈелицаСтојановић,Филозофскифакултет,Никшић,ЦрнаГора
prof.brankaradović,phd,facultyofphilologyandarts,kragujevacdr.sanjapajić,assisstantprofessor,facultyofphilologyandarts,kragujevacprof.radmilanastić,phd,facultyofphilologyandarts,kragujevacdr.katarinamelić,assisstantprofessor,facultyofphilologyandarts,kragujevacprof.anđelkapejović,phd,facultyofphilologyandarts,kragujevacprof.tijanaašić,phd,facultyofphilologyandarts,kragujevacdr.majaanđelković,assisstantprofessor,facultyofphilologyandarts,kragujevacprof.persidaLazarevićdigiacomo,phd,theg.d'annunziouniversity,pescara,italia.prof.allatatarenko,phd,facultyofphilology,“ivanfranko”nationaluniversityofLviv,ukraineprof.mihajradan,phd,facultyofLetters,historyandtheology,timi-soara,romaniaprof.dimkasavova,phd,facultyofslavicstudies,sofia,bulgariaprof.Jelicastojanović,phd,facultyofphilosophyinnikšić,montenegro
Секретар уредништва/editorial assistantАнкаРистић,Филолошко-уметничкифакултет,Крагујевац

Лектор/ProofreaderЈеленаПетковић/Jelenapetković
Лектор за француски језик / Proofreader for frenchВладимирПавловић,МариБаније/vladimirpavlović,mariebannier
Преводилац/TranslatorЈасминаТеодоровић/Jasminateodorović
Ликовно-графичка опрема/Artistic and graphic designСлободанШтетић/slobodanŠtetić
Технички уредник/Technical editorНенадЗахар/nenadzahar
Издавач/PublisherФилолошко-уметничкифакултет,Крагујевац/
facultyofphilologyandartskragujevacЗа издавача/Published by
СлободанШтетић/slobodanŠtetićдекан/dean
Адреса/AddressЈованаЦвијићаб.б,34000Крагујевац/Jovanacvijićab.b,34000kragujevac
тел/phone(++381)034/304-277e-mail:[email protected]
www.filum.kg.ac.rs/aktuelnosti/nasledjeЖиро рачун(динарски)
840-1446666-07,партија97Сврхауплате:Часопис„Наслеђе“
Штампа/PrintГЦИнтерагент,Крагујевац/gcinteragent,kragujevac
Тираж/Impression300примерака/300copies
Наслеђеизлазитрипутагодишње/Nasleđecomesoutthreetimesannually
Издавање овог часописа финансијски помаже Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

cip–КаталогизацијаупубликацијиНароднабибилиотекаСрбије,Београд
82
НАСЛЕЂЕ : часопис за књижевност, језик, уметностикултуру / главнии одговорни уредникДраган Бошковић. – Год. 1, бр. 1 (2004)- . - Крагујевац(ЈованаЦвијићабб):Филолошко-уметничкифакултет,2004-(Крагујевац:ГЦИнтерагент).-24cm
Трипутагодишњеissn1820-1768=Наслеђе(Крагујевац)cobiss.sr-id115085068