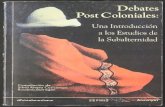Les Approches Postcoloniales Et La Recherche Juridique 2014-10-09
description
Transcript of Les Approches Postcoloniales Et La Recherche Juridique 2014-10-09
-
Universit dOttawa
Les approches
postcoloniales et la
recherche juridique ou de la citation de posie innu dans les travaux de recherche portant sur
le droit
Charlotte Chicoine-Wilson
Document denseignement utilis dans le cadre du cours Mthodologie de la
recherche juridique, le 9 octobre 2014.
-
1
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Les approches postcoloniales : une tentative de dfinition(s)
Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqu ?
Avant toute chose, il faut souligner que ladjectif postcolonial pour qualifier lapproche dont il est question ici ne fait pas consensus. Les auteurs ne sentendent pas sur le sens lui donner ni mme sur le fait quon devrait lutiliser certains proposent de parler plutt dtudes anti-coloniales, d-coloniales ou encore mta-coloniales. On dbat galement sur le fait quil sagisse dune thorie ou pas. Ce serait davantage une (ou des) approche(s), un rseau dides ayant en commun de sintresser la colonisation et ses impacts passs et contemporains.
Le postcolonialisme est une approche multidisciplinaire un hybride de thories et de rflexions provenant de plusieurs disciplines. Cette thorie sest dabord principalement au sein des tudes littraires. Cette origine littraire a deux avantages fondamentaux pour les tudiants en droit. Dabord, elle permet de justifier quon prfre parfois la lecture de romans postcoloniaux celle, plus aride il faut ladmettre, douvrages juridiques1. Par ailleurs, et cela est plus important quil ny parat premire vue, cela permet de citer de la posie innu dans nos travaux acadmiques. titre dexemple, je trouve que les vers suivants de la potesse Natasha Kanap Fontaine feraient une merveilleuse pigraphe, en plus dtre simplement puissants :
Il y a dans le fondement du monde Une ecchymose2
Les approches postcoloniales se sont ensuite tendues aux sciences sociales notamment la sociologie et les sciences politiques. Les juristes ne sy sont intresss quassez rcemment et la littrature ce sujet est surtout en anglais. Dautres disciplines sont aussi reprsentes : par exemple, Frantz Fanon, un auteur fondamental pour les approches postcoloniales et un acteur des luttes de dcolonisation africaines, tait psychiatre de formation. Ces travaux portaient donc notamment sur les effets de la colonisation sur la subjectivit des individus la subissant. Dans son ouvrage Peau noire, masque blanc il a identifi le phnomne dintriorisation du sentiment dinfriorit par le colonis.
Mais revenons cette tentative de dfinition. Ceux dentre vous verss dans les tudes latines pourraient tre tent de conclure que les approches postcoloniales renvoient ltude de l aprs colonialisme. Mais a, ce serait simple, nest-ce pas ? En fait, la plupart des auteurs sentendent pour dire que le prfixe post ne doit pas tre entendu dans son sens chronologique ni non plus comme une simple opposition (anti-colonial).
1 Mes suggestions personnelles et non exhaustives de lectures non-juridiques sont les suivantes : The Bone
People par Keri Hulmes, En attendant la monte des eaux par Maryse Cond, Sula par Toni Morrison, Mmoire de feu par Eduardo Galeano, Sundogs, Ravensong et Daugthers are foreever par Lee Maracle, Ourse bleue par Virginia Psmapo et Footnotes in Gaza par Joe Sacco. 2 Natasha Kanap Fontaine, Manifeste Assi, Mmoire dencrier, 2014.
-
2
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Ladjectif postcolonial renvoie plutt lide de dpassement, de transcendance. Les approches postcoloniales regrouperaient donc les travaux qui veulent aller au-del du colonialisme. Pour les tudes postcoloniales, il ny a pas de coupure nette entre la priode coloniale et celles des indpendances qui a suivi la vague de dcolonisation en Amrique latine, en Afrique et en Asie. Lexprience de la colonisation a transform les socits touches et bien que certains tats aient pu gagner leur indpendance vis--vis de leur mtropole, les effets du colonialisme se font encore sentir et continuent de marquer les rapports entre les tats, mais galement au sein des tats. En plus, pour plusieurs socits ayant subi la colonisation, il ny a pas eu dindpendance. Cest le cas des peuples autochtones au Canada, aux tats-Unis, en Australie, etc. Les tudes postcoloniales sintressent donc gnralement aux effets passs et contemporains de la colonisation, aux rapports de pouvoir qui en dcoulent, aux effets de marginalisation et dhybridation. Cest le volet critique de cette approche, qui dnonce lexclusion produite par le colonialisme. Il y a galement un volet post-critique aux tudes postcoloniales, qui sintresse aux moyens de dpasser les effets de la colonisation3. Ils sintressent notamment aux processus et aux luttes de dcolonisation, aux luttes contre lexclusion sociale, aux moyens dvelopps par les peuples ou les individus pour gurir de la colonisation4.
Lapplication dune approche postcoloniale au droit
Les approches postcoloniales ne permettent pas uniquement de justifier la lecture de posie innu pendant la rdaction de son mmoire, mais fournit galement des outils prcieux afin danalyse critique du droit. Selon Souleymane Bachir, les tudes postcoloniales sont pour les disciplines un moyen de faire un retour sur elles-mmes, de sinterroger sur les rapports de pouvoir quelles vhiculent5. Ainsi, les approches postcoloniales prsentent une critique du droit comme instrument de domination. Plus particulirement, ces approches proposent de mettre en lumire la manire dont le droit a servi et continue de servir des intrts coloniaux. Le terme droit rfre ici au droit produit par les tats et par les institutions internationales, cest--dire ce quon appelle parfois le droit officiel .
3 Jemprunte lexpression post-critique au sociologue du droit Boaventura de Sousa Santos. Santos
propose dadopter a post-critical reconstructive stance afin dtudier diverses expriences utilisant le droit des fins contre-hgmoniques dans Towards a New Legal Common Sense. Law, Globalization, And Emancipation, 2e d., Londres, Butterworths Lexis Nexis, 2002 la p. 460. 4 Voir notamment les travaux de Taiaiake Alfred et de Jeff Corntassel sur la resurgence autochtone. Par
exemple, Corntassel, Jeff, Re-envisioning resurgence: Indigenous pathways to decolonization and sustainable self-determination (2012) 1:1 Decolonization: Indigeneity, Education & Society vol.1, no.1, 86. 5 Souleymane Bachir, lors dune table ronde sur les tudes postcoloniales:
http://www.dailymotion.com/video/xrfcnu_que-sont-les-etudes-post-coloniales-1-3_news. Voir galement Homi K. Bhabha, The Location of Culture, Routldge, 2004 aux p. 46-47.
-
3
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Les approches postcoloniales partagent plusieurs postulats avec dautres approches critiques du droit, notamment les critical legal studies, avec lesquelles il partage une critique du positivisme libral :
- Lgalit formelle promue par le positivisme libral est source dingalit relle; - Le positivisme ne remet pas en question la lgitimit du droit tatique colonial
bien quil soit fond sur la force; - Le positivisme libral porte sur le droit une vision partielle, subjective et
ethnocentrique.
Dans le domaine des tudes juridiques, on peut dire que le postcolonialisme sert notamment :
- Remettre en cause la prtendue neutralit du droit officiel; - Mettre en lumire les intrts servis par le droit officiel; - Prendre en compte le rle du droit sur des questions telles que laltrit,
lidentit, lexclusion sociale, la mondialisation et le racisme - viter de perptuer des rapports de pouvoir ingaux, producteurs dexclusion
sociale, faute de les avoir remis en question.
Plus prcisment, voici quelques exemples de critiques formules lgard du droit officiel par les approches postcoloniales:
- Mise en lumire du rle du droit dans lappropriation par les puissances europennes de territoires dj occups : thories de la dcouverte, de la terra nullius.
- Mise en lumire de la manire dont le droit se drobe lorsquil pourrait servir appuyer les revendications des peuples autochtones ou coloniss6.
- Remise en question du caractre universel du droit international, notamment du droit international des droits de la personne7.
- Critique du droit international, qui est un produit des socits europennes, et de certains de ses concepts fondamentaux : souverainet, intgrit territoriale, tat8.
- Mise en lumire du rle du droit dans la dfinition et la construction des identits subalternes9.
6 Voir notamment Roy, Alpana, Postcolonial Theory and Law: A Critical Introduction (2008) 29 Adel.
L. Rev. et Gathii, James Thuo, Imperialism, Colonialism and International Law (2007) 54:4 Buffalo Law Review. 7 Panikkar, Raimon, Is the Notion of Human Rights a Western Concept ? (1982) 30 Diogenes 75 et
Santos, Boaventura de Sousa, Vers une conception multiculturelle des droits de lhomme (1997) 35 Droit et Socit 79. 8 Anthony Anghie, The Evolution of International Law: Colonial and Postcolonial Realities (2006) 27:5
Third World Quarterly 739.
-
4
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Exercice pratique : analyse postcoloniale de la Dclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Lexercice propos aux tudiants consiste analyser la Dclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones10 partir des critiques du droit formules par les approches postcoloniales11.
Questions pour lancer la rflexion
- Quels principes et concepts de droit international retrouvent-on dans la Dclaration ? Dans quels buts ? Avec quels effets ?
- Quels sont les effets de la Dclaration au regard des rapports de pouvoir entre les tats et les peuples autochtones ?
- Quels sont les lments sur lesquels les rdacteurs de la Dclaration ont refus de transiger ? Pourquoi ? Quels intrts sont servis ?
- Est-ce quun instrument concernant un autre groupe aurait t rdig de la mme manire ?
Quelques pistes de critiques de la Dclaration
Prambule
Estimant galement que les traits, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations quils reprsentent, sont la base dun partenariat renforc entre les peuples autochtones et les tats
Pourtant les traits sont fortement critiqus comme contribuant au maintien de statu quo, au partage ingal du pouvoir entre tat et peuples autochtones12. Articles 3 et 4
Article 3 Les peuples autochtones ont le droit lautodtermination. En vertu de ce droit, ils dterminent librement leur statut politique et assurent librement leur dveloppement conomique, social et culturel.
9 Roy, Alpana, Postcolonial Theory and Law: A Critical Introduction (2008) 29 Adel. L. Rev.
10 Organisation des Nations Unies, Dclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
Rs. AG/61/295, 107e sance plnire, 13 septembre 2007. 11
Voir lexcellent article de Jeff Corntassel ce sujet : Partnership in Action? Indigenous Political Mobilization and Co-optation during the First UN Indigenous Decade (19952004) (2007) 29 Human Rights Quarterly 137. 12
Voir notamment Glen S. Coulthard, Subjects of empire: Indigenous peoples and the "Politics of Recognition" in Canada dans May Chazan et al (dir), Home and Native Land. Unsettling Multiculturalism in Canada, Toronto, Between the Lines, 2011, p. 31 et Corntassel, Jeff, Indigenous Governance amidst the Forced Federalism Era , communication prsente lors du Tribal Law and Government Conference, 13 fvrier 2009, en ligne : < http://www.corntassel.net/articles.htm>.
-
5
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Article 4 Les peuples autochtones, dans lexercice de leur droit lautodtermination, ont le droit dtre autonomes et de sadministrer eux- mmes pour tout ce qui touche leurs affaires intrieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activits autonomes.
Larticle 4 limite la porte de lautonomie reconnue larticle 3 aux affaires internes des peuples autochtones. Voir galement larticle 46 qui limite encore davantage la porte de ces dispositions.
Article 6
Tout autochtone a droit une nationalit.
Les membres des peuples autochtones se sont parfois vu refuser la citoyennet des tats dans les frontires desquels ils se trouvaient, se voyant ainsi privs des droits reconnus aux citoyens. Larticle 6 vient donc garantir le droit la citoyennet et aux droits qui en dcoulent. Cependant, certains peuples autochtones refusent davoir le statut de citoyens dun tat auquel ils ne se reconnaissent pas appartenir. De plus, certaines obligations viennent avec le statut de citoyen, par exemple le service militaire. Les autochtones peuvent ne pas dsirer se voir astreindre des obligations impliquant de servir un tat qui par ailleurs les oppriment et les marginalisent.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de dvelopper et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualit, traditions, procdures ou pratiques particulires et, lorsquils existent, leurs systmes ou coutumes juridiques, en conformit avec les normes internationales relatives aux droits de lhomme.
Lexercice de la justice autochtone est rendue conditionnel au respect des normes internationales des droits de la personne. Lorigine europenne de ces normes nest plus prouver et applique strictement, cette condition peut limiter grandement lautonomie judiciaire des peuples autochtones. De plus, dexiger une telle condition tmoigne de lignorance de mcanismes de protection des individus et de la communaut propres aux peuples autochtones.
Article 46(1) Aucune disposition de la prsente Dclaration ne peut tre interprte comme impliquant pour un tat, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer une activit ou daccomplir un acte contraire la Charte des Nations Unies, ni considre comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de dtruire ou damoindrir, totalement ou partiellement, lintgrit territoriale ou lunit politique dun tat souverain et indpendant.
-
6
Les approches postcoloniales et la recherche juridique Charlotte Chicoine-Wilson
Cet article vient limiter considrablement la porte des droits enchsss dans la Dclaration en prvoyant une interprtation du droit lautodtermination qui ne menace pas la souverainet et lintgrit territoriale des tats13.
13 Il sagit dun bel exemple du blunting dont parle Corntassel dans Partnership in Action , la p.
140.