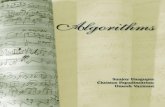Latentationduchristdh
-
Upload
federation-afp -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Latentationduchristdh

1
DH/ 18.08.09
Culte du dimanche à
La tentation du Christ Texte proposé : Lc 4, 1-13 I La tentation du Christ dans les différents évangiles Cet épisode est ignoré de l’évangéliste Jean, comme celui du baptême de Jésus qui le précède dans les synopti-ques. Il est relaté par ceux-ci de assez différemment : si Marc ne lui consacre que deux versets (1, 12-13), les récits de Mathieu (4, 1-11) et de Luc (4, 1-13) sont plus complets et pourtant proches l’un de l’autre. Luc (qui s’adresse à des non juifs) inverse l’ordre des deuxièmes et troisièmes tentations par rapport à Mathieu (qui s’adresse à des juifs) pour finir au sommet du temple de Jérusalem, sans doute pour souligner l’importance de la ville où Jésus terminera Son ministère ter-restre. On considère généralement que Mathieu et Luc, qui rédigèrent leurs évangiles indépendamment l’un de l’autre, disposaient, en plus de sources propres à chacun (les récits de l’enfance, absents chez Marc, relatent des événements tota-lement différents chez Mathieu et Luc), non seulement de l’évangile de Marc, antérieur d’au moins vingt ans, mais aussi d’une compilation de récits de la vie de Jésus, inconnue de Marc, appelée la Source ou Q (de l’allemand die Quelle, la source, cette théorie ayant été pour la première fois émise par des théologiens allemands au XIXème siècle) ; ainsi s’expliquerait le fait que certains récits paraissent rapportés de façon similaire dans ces trois évangiles, alors que d’autres sont relatés différemment chez Marc d’un côté et chez Mathieu et Luc de l’autre. II Place de la tentation du Christ au sein de son ministère terrestre La tentation de Jésus suit immédiatement Son baptême par Jean-Baptiste. Après avoir été intronisé Fils de Dieu, par la voix de Celui-ci même, et avoir reçu son Esprit Saint, matérialisé par la colombe, Jésus se retire au désert pour 40 jours, second acte de son ministère terrestre. C’est cet événement que nous célébrons sous le terme de Carême, période qui s’achève avec la Semaine Sainte, la commémoration sur une seule année liturgique de l’ensemble des trois ans du ministère de Jésus-Christ conduisant à ce télescopage de la célébration du commencement et de la fin du ministère de Jésus. III Analyse du texte (de Luc) 1°) Jésus a reçu avec Son baptême l’Esprit et c’est conduit par l’Esprit qu’au retour du Jourdain, Il séjourne au désert. De même, c’est avec la puissance de l’Esprit qu’après ce séjour au désert, Il retourne chez les Siens en Galilée et Sa première prédication dans la synagogue de Nazareth porte sur le 1er verset du chapitre 61 du prophète Ésaïe L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction, prophétie dont Il s’attribue à Lui-même l’accomplissement. Luc place clairement les trois premiers moments du ministère terrestre de Jésus sous le signe et le contrôle du Saint-Esprit. Si la suite du récit évangélique nous présente un Jésus apparemment plus autonome de Ses décisions, Celui-ci ne manque pas une occasion de répéter qu’Il est là pour accomplir la volonté de Son Père comme, une dernière fois, durant la prière solitaire sur la Mont des Oliviers qui précède Son arrestation (Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise, Lc 22,42). Pour Luc, aucun doute, Jésus est bien en mission divine sur terre. 2°) Le désert, dans la littérature hébraïque, n’est pas un lieu ordinaire. C’est le lieu originel, le champ premier du monde, encore vide et informe. Mais c’est aussi celui à la surface duquel plane le souffle de Dieu et où la Parole de Dieu

2
donne forme et vie à toutes choses, appelant chacune par son nom. C’est le lieu où se manifeste l’amour premier de Dieu. 3°) Les quarante jours de jeûne dans le désert, après un baptême dans l'eau, rappellent les quarante ans de traver-sée du désert par les Hébreux sortant de la mer Rouge. Plus généralement, le chiffre quatre symbolise la plénitude humaine et terrestre, c’est-à-dire la stabilité : les qua-tre points cardinaux de la terre (carrée), les quatre murs de la maison, les quatre pieds de la table. Quarante est une exten-sion du chiffre quatre qui symbolise, selon qu’il évoque une durée ou un état, la maturation ou la maturité : l’embryon est formé au quarantième jour de la grossesse, le Déluge dure quarante jours et quarante nuits, le temps que disparaisse l’ancien monde et qu’apparaisse un monde nouveau, Isaac se marie à quarante ans, les Hébreux séjournent quarante jours au désert, avant que Dieu ne les conduise dans un pays ruisselant de lait et de miel, Élie fuyant la colère de Jézabel mar-che quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu à Horeb, etc. . Pour Jésus, ces quarante jours au désert, seul à seul avec Lui-même, vont Lui permettre de voir clair en Lui-même, de S’affranchir de tout ce qui Lui avait été inculqué par Sa famille et Son entourage, d’intérioriser Sa mission, en un mot d’exorciser Ses propres démons, comme l'exige la vérité de l'Incarnation. Jésus fut-il ainsi tenté ou éprouvé ? Le latin, et les langues qui en dérivent, distinguent entre l’épreuve, venue de Dieu, et la tentation, venue du diable, alors qu’en grec, comme en hébreux, il n’y a qu’un mot pour les deux concepts. 4°) Bien des années avant la rédaction des évangiles, Saint-Paul avait déjà opposé Adam et Jésus (Rm 5,12-21). Notre récit illustre cette opposition : a) Adam commence sa vie en un lieu prospère, le paradis d’Eden, alors que Jésus, né dans une crèche, commence Son ministère au désert aride. b) Dieu crée Adam à Son image et à Sa ressemblance ; malgré ce, le démon le séduit en lui annonçant que s’il mange le fruit défendu, il sera comme Dieu. Jésus, Fils unique de Dieu, Se dépouille de Sa condition pour prendre la condition et l’apparence d’un fils de l’homme, d’un serviteur. c) Le démon séduit du premier coup Adam par la nourriture (la satisfaction de ses sens) ; bien que rassa-sié, le premier homme succombe. Le démon prétend en faire de même avec Jésus ; mais bien qu’affamé par quarante jours de jeûne, Celui-ci le repousse fermement par trois fois, proclamant par trois fois Son attachement à l’observance des Écritures. d) Ainsi, en succombant à la tentation et en transgressant le commandement de Dieu, le premier homme a introduit dans le monde, la mort et la corruption. […] par un seul homme, dit Saint Paul, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes. Jésus-Christ, par sa victoire sur toutes les tentations et grâce à la sainteté de Sa vie humaine, dépourvue de tout péché et donc exempte de condamnation, a pu racheter et justifier l’humanité entière en la sauvant de la mort et de la corruption. IV Les enseignements du texte 1°) Qui sont les acteurs et spectateurs de ce récit : . Jésus Lui-même, bien sûr, . le Saint-Esprit, . le diable. Luc ne fait allusion ni aux anges (contrairement à Marc et Mathieu), ni aux bêtes sauvages (contrairement à Marc). Toujours est-il que cet épisode n’a pas de témoin simplement humain (contrairement à la Transfiguration). On peut donc se demander comment cet épisode est parvenu à la connaissance des rédacteurs des évangiles, par deux voies différentes qui plus est, puisque manifestement Mathieu et Luc ont trouvé leur inspiration non pas dans le récit fait par Marc, mais dans la Source, comme nous l’avons vu plus haut. 2°) Si l’historicité de ce récit, repris par les trois synoptiques, n’est pas évidente, c’est que sa portée symbolique est considérable.

3
Placé avant le début du ministère de Jésus auprès des hommes, ce récit indique, en négatif, comment Jésus se refusera à intervenir auprès des humains. Il met également en garde l’Église et le Chrétien contre des tentations toujours actuelles. a) première tentation La première tentation rappelle celle d’Adam au jardin d’Eden ; elle porte sur la nourriture et sur la façon dont l’homme doit se nourrir. Le diable propose à Jésus, qui en a le pouvoir de par sa nature divine, de transformer une des pierres du désert en pain (Mathieu dit les pierres du désert). Jésus pourrait ainsi se rassasier après quarante jours de jeûne. Mais, une telle transformation aurait aussi le mérite d’apporter définitivement une solution au problème, endémique, des famines dont souffraient les populations de cette époque et dont souffre toujours l’humanité actuelle. Mais Jésus n’est pas venu se subs-tituer aux hommes dans la solution de leurs problèmes et combler leur inquiétude du lendemain : leur apporter une nourri-ture purement matérielle ne résoudrait pas ces problèmes, car l’homme ne se nourrit pas seulement de pain (Dt 8,3, d’où est extraite cette citation, ajoute mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur). Cette citation renvoie à l’épisode de la manne que Dieu avait donné à manger au peuple d’Israël pendant sa traversée du désert, ce qui pourtant n’avait pas suffit pour que ce peuple ne doute encore de son Dieu tout de suite après (Ex 16 et 17). Durant Son séjour terrestre, Jésus ne viendra en aide qu’à un nombre très limité de personnes et le plus souvent à l’occasion d‘une rencontre individuelle. Il saura, le moment venu, multiplier les pains pour nourrir la foule en face de lui, venue L’écouter, et il partagera Son pain lors de Son dernier repas avec ceux qui L’entourent. La vocation première de l’Église, comme du Chrétien, n’est pas de prendre en charge globalement et collectivement toutes les difficultés de l’humanité, mais de proclamer la Parole de Dieu et, plus spécialement, que le salut (matériel comme spirituel) résulte d’une rencontre avec le Seigneur au travers de l’autre. Certes, il n’est pas question de se détourner de son prochain et l’on juge l’arbre à ses fruits (Lc 6, 43-44), mais ce que l’on appelle communément les œuvres ne sont que les fruits du salut et non sa cause. b) deuxième tentation Le diable conduit Jésus plus haut (Mathieu dit sur une très haute montagne) et lui fait voir tous les royaumes de la terre. Pour les contemporains de Luc, la terre était non seulement carrée, mais plate et seuls les obstacles naturels (mon-tagnes, vallées, mers) empêchaient de la voir toute entière. Mais, à condition de trouver et d’escalader la montagne plus haute que les autres, il n’y avait pas de raison que l’on ne puisse contempler la terre dans son entièreté. Le diable offre à Jésus le pouvoir sur toute la terre et la gloire des royaumes qui la composent. Le diable considè-re pouvoir offrir ce pouvoir pour la bonne raison qu’il lui appartient pour lui avoir été remis (par la défaillance d’Adam) et qu’il peut donc en disposer comme il l’entend. Ainsi, Jésus pourra être le messie temporel et triomphant qu’attend de-puis si longtemps le peuple d’Israël et accomplir sa mission sans avoir à subir la Passion et la mort. Simple détail, il convient au préalable que Jésus l’adore, c’est-à-dire reconnaisse sa suprématie, et se soumette à son pouvoir suprême, ainsi que le fit Adam autrefois. On ne peut dire de façon plus claire que le diable n’a que le pouvoir qu’on lui reconnaît et que croire que le pouvoir est la source du salut est démoniaque. Certes, toute autorité vient de Dieu a dit Saint-Paul, mais le besoin d’un pouvoir terrestre découle de notre infirmité originelle et ne saurait y remédier. Aucune théocratie n’a ja-mais fonctionné de façon satisfaisante, quelle que soit la divinité dont elle était censée respecter et faire respecter les commandements. c) troisième tentation Pour finir (chez Luc), le diable conduit Jésus au faîte du Temple de Jérusalem et tente de Le convaincre que s’Il se jette en bas, les anges de Dieu interviendront pour Lui éviter tout dommage. Pour renforcer sa crédibilité, le diable s’appuie, pour la première fois, sur deux citations des Écritures. Combien de fois les prophètes, puis Jésus lui-même, ont-ils fustigé le peuple d’Israël qui, lorsqu’il ne s’adonnait pas aux cultes idolâtres (à commencer par celui du veau d’or, Ex 32), restait enfermé dans un respect purement formel de la Loi sans vouloir en comprendre l’Esprit ? Deux enseignements me semblent pouvoir être tirés de cette troisième tentation : - le diable aussi connaît les Écritures et toute personne qui les cite avec aisance n’est pas nécessai-rement l’envoyé de Dieu. Les Écritures ne nous sont un secours que lorsque nous pouvons nous y référer nous-mêmes, parce que nous avons consacré le temps nécessaire à leur étude et à leur compréhension. Respecter les commandements de Dieu, c’est débord faire l’effort de les comprendre ;

4
- Dieu a voulu que l’homme évolue dans un monde où il puisse prévoir la portée de ses actes, et ainsi assumer son libre-arbitre. Un univers prévisible, c’est un univers régi par des règles, au premier chef desquelles figu-rent les lois de la physique. Ainsi, au premier chapitre de la Genèse, verset 28, Dieu invite l’être humain, homme et fem-me, à dominer la terre, c’est-à-dire à faire l’effort de découvrir ces lois et à rechercher comment les mettre à son profit. La troisième tentation nous explique clairement que Dieu entend ne pas intervenir dans la vie des hommes en contradiction avec ces règles, miraculeusement ou par magie. Certes, les miracles existent, les Écritures en relatent un certain nombre, d’autres sont survenus depuis, mais, hormis un ou deux cas mythiques, ils interviennent toujours dans le cadre de nos lois ordinaires ; le plus souvent, le vrai miracle n’est pas l’événement lui-même, mais la rencontre qui l’a permis. 3°) Ce passage est l’un de ceux sur lesquels les Réformateurs se sont appuyés pour élaborer leurs grandes affirma-tions : - par les Écritures seules (scriptura sola). À chaque tentation, Jésus n’oppose et n’a à opposer que la seule Parole, - par la foi seule (fidei sola). Jésus ne fait rien, il manifeste simplement sa confiance en Dieu et en Son enseignement, car la foi en Dieu, c’est précisément la confiance en Sa puissance sans éprouver le besoin de Lui en demander des preuves, - par la grâce seule (gratiæ sola). Jésus ne triomphe du diable que par la grâce de Dieu Son Père, dont Mathieu symbolise la présence par Ses anges, - en toutes circonstances, à Dieu seul la gloire (Deo soli gloria). C’est bien parce que Jésus ne veut rendre gloire qu’à Dieu seul, qu’Il ne peut accepter la gloire des royaumes terrestres que Lui fait miroiter le diable. 4°) Constatons enfin que la victoire du Christ n’est pas définitive : toutes tentations possibles épuisées, le diable d’écarte de Lui jusqu’au moment fixé (la Passion et, principalement, la prière sur le Mont des Oliviers, juste avant Son arrestation). Le diable est toujours à l’œuvre, les tentations du Christ sont les nôtres et les humains y sont toujours sujets ; puissent les Chrétiens les reconnaître et les repousser, avec l’aide de Dieu et de Sa Parole. Amen