Jacques de Cock, Marat Et Le Vrai Nom Des Choses, Mots, 1990, Núm. 23, Pp. 111-114
Click here to load reader
-
Upload
miguel-angel-garcia-hernandez -
Category
Documents
-
view
13 -
download
3
Transcript of Jacques de Cock, Marat Et Le Vrai Nom Des Choses, Mots, 1990, Núm. 23, Pp. 111-114

Jacques De Cock
Marat et le « vrai nom des choses »In: Mots, juin 1990, N°23. pp. 111-114.
Citer ce document / Cite this document :
De Cock Jacques. Marat et le « vrai nom des choses ». In: Mots, juin 1990, N°23. pp. 111-114.
doi : 10.3406/mots.1990.1525
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1990_num_23_1_1525

Jacques De Cock
Marat et le « vrai nom des choses »
Jean-Paul Marat termine la rédaction des Chaînes de l'esclavage à Londres en 1774, où cet ouvrage paraît en langue anglaise sous le titre The chains of slavery. Vingt ans après, une édition française verra enfin le jour. En février 1793, dans les numéros 111 et 115 du Journal de la République française, l'Ami du peuple lance un appel pour que le patriote auquel il a cédé son exemplaire des Chains of slavery lui permette de le consulter x, ce qui laisse supposer qu'au moment où il a publié le texte français des Chaînes de l'esclavage, Marat n'était peut-être pas lui-même en possession de l'ouvrage anglais publié, qu'il aurait donc travaillé pour son édition de l'an I sur base d'un document manuscrit2.
Quoi qu'il en soit, le fait est que les deux textes publiés en 1774 et 1793 présentent d'importantes variantes qui n'ont pas été étudiées. Et l'on doit jusqu'ici se contenter de mentions explicites de l'époque révolutionnaire, présentes dans le texte français, pour attribuer certains textes ou passages à la révision de 1792-1793 plutôt qu'à la rédaction d'origine. Aller plus loin signifierait comparer les deux textes paragraphe par paragraphe, pour en inférer les enseignements que Marat a tirés de la Révolution et qu'il a donc ajoutés à son précis politique. De cette comparaison méthodique des deux éditions, annoncée en complément à notre
1. « AVIS. Le citoyen auquel j'ai cédé l'exemplaire anglais des Chaînes de l'esclavage : The chains of slavery, est prié de vouloir bien renvoyer son adresse à l'auteur, n° 30 rue des Cordeliers, qui lui demande la permission de consulter cet ouvrage. Comme c'est un libraire, dont le nom m'est inconnu, auquel il a été remis, je prie tous les citoyens de cette profession qui prendront lecture de cet avertissement de vouloir bien le communiquer à leurs confrères » (Journal de la République française, n° 115, du jeudi 7 février 1793).
2. R. C. H. Catterall, « The credibility of Marat », American Historical Review, 1910, p. 24-35.
Ill

édition des Oeuvres politiques, 1789-1793 x, extrayons ce passage où Marat s'attarde sur l'usage des mots.
Le thème est traité dans la version anglaise, au chapitre 41, « False Idea of tyranny », où il est présenté sous une forme concise :
« They never give to things the real names. They term the art of governing,, that of spreading everywhere terror and desolation ; they call magnificence pageantry and odious prodigality ; they cover usurpations under the fair names of extension of power, addition of privileges and new prerogatives acquired by the crown ; extorsions, rapacity, robberies under that of conquest ; craft, duplicity, treachery, perfidiousness, treason under that of the art of negociating ; and outrages, murders, poisoning under that of acts of great policy. Thus they succeed in destroying that impression of horror which the bare sight of those actions ever excites in the spectator* 2.
Dans la version française, c'est après »Fausse idée de la tyrannie » qu'intervient un sous-titre autonome : »Dénaturer les noms des choses« . Ce texte se voit donc attribuer une importance nouvelle, tant par son extension que par sa mise en valeur dans l'articulation de l'ouvrage :
Peu d'hommes ont des idées saines des choses, la plupart ne s'attachent même qu'aux mots. Les Romains n'accordèrent-ils pas à César, sous le titre d'empereur3, le pouvoir qu'ils lui avaient refusé sous celui de roi. Abusés par les mots, les hommes n'ont pas horreur des choses les plus infâmes, décorées de beaux noms, et ils ont horreur des choses les plus louables, décriées par des noms odieux. Aussi l'artifice ordinaire des cabinets est-il d'égarer les peuples en pervertissant le sens des
1. J.-P. Marat, Oeuvres politiques, 1789-1793, Bruxelles, Pôle Nord, 1989, Texte et guide de lecture établis par Jacques De Cock et Charlotte Goëtz, 1 vol. paru, 5 vol. à paraître.
2. « Ils ne donnent jamais leur noms réels aux choses. Ils appellent art de gouverner celui de répandre partout terreur et désolation ; ils appellent magnificence apparat et odieuse prodigalité, ils couvrent les usurpations sous les noms propres d'extension de pouvoir, addition de privilèges et nouvelles prérogatives acquises par la couronne ; extorsions, rapacité, vols sous celui de conquête ; astuce, duplicité, tricherie, perfidie, trahison sous celui de l'art de négocier ; et outrages, meurtres, empoisonnement sous celui des actes de haute police. Ils réussisent ainsi à détruire cette impression d'horreur que la vision nue de ces actions excite toujours chez le spectateur ».
3. La preuve qu'ils ne crurent jamais avoir fait ce qu'ils venaient de faire, c'est que lorsque César essaya de se faire poser le diadème sur la tête, ils cessèrent leurs acclamations (note de Marat).
112

mots, et souvent des hommes de lettres avilis ont l'infamie de se charger de ce coupable emploi. En fait de politique, quelques vains sons mènent le stupide vulgaire, j'allais dire le monde entier. Jamais aux choses leurs vrais noms. Les princes, leurs ministres, leurs agents, leurs flatteurs, leurs valets appellent art de régner celui d'épuiser les peuples, de faire de sottes entreprises, d'afficher un faste scandaleux et de répandre partout la terreur ; politique, l'art honteux de tromper les hommes ; gouverne- ment,\di domination lâche et tyrannique ; prérogatives de la couronne, les droits usurpés sur la souveraineté des peuples ; puissance royale, le pouvoir absolu ; magnificence, d'odieuses prodigalités ; soumission, la servitude ; loyauté, la prostitution aux ordres arbitraires ; rébellion, la fidélité aux lois ; révolte, la résistance à l'oppression ; discours séditieux, la réclamation des droits de l'homme ; faction, le corps des citoyens réunis pour défendre leurs droits ; crimes de lèse-nation, les mesures prises pour s'opposer à la tyrannie ; charges de l'Etat, les dilapidations de la cour et du cabinet ; contributions publiques, les exactions ; guerre et conquête, le brigandage1 à la tête d'une armée ; art de négocier, l'hypocrisie, l'astuce, le manque de foi, la perfidie et les trahisons ; coups d'Etat, les outrages, les meurtres et les empoisonnements ; officiers du prince, ses satellites ; observateurs, ses espions ; fidèles sujets, les suppôts du despotisme ; mesures de sûreté, les recherches inquisitoriales ; punitions des séditieux, le massacre des amis de la liberté. Voilà comment ils parviennent à détruire l'horreur qu'inspire l'image nue des forfaits et de la tyrannie.
En s'opposant avec vigueur à « l'entreprise modérée de déstabilisation du langage patriotique » 2, Marat intervient avec un objectif identique à celui que poursuivent, par exemple en août 1791, les Révolutions de Paris : « Un piège... consiste à substituer au mot vieilli ď 'aristocrates, celui de modérés, et à la qualification de patriotes, , celles de factieux, de séditieux, $ incendiaires, et quelques fois même de brigands » 3.
Au linguiste d'interpréter. Quant à moi, je suis assez tenté de
1. La grandeur du crime est la seule différence qu'il y ait entre un conquérant et un brigand. Toutefois, nous respectons ceux qui volent à la tête d'une armée et nous méprisons ceux qui volent à la tête d'une simple bande ; telle est même la fausseté de nos idées, que nous n'avons aucune autre règle pour distinguer un criminel d'un héros. De là le mépris que nous avons pour les petits délinquants et l'admiration que nous avons pour les grands scélérats ; mais c'est du crime que doit être tirée leur distinction. Camille, Scévola, André Doria s'immolant pour leur patrie, sont des héros ; mais Alexandre et César n'étaient que d'atroces malfaiteurs au-dessus de la crainte du supplice (note de Marat).
2. Jacques Guilhaumou, La langue politique et la Révolution française, Paris, Méridiens-Klincksieck,1989, p. 74.
3. Cité par J. Guilhaumou, ibid., p. 75.
113

relever cette phrase, déjà présente dans le texte anglais et ramassée sous une forme curieuse, ultra-concise et non grammaticale dans le texte français : « Jamais aux choses leurs vrais noms ».
Hérésie, dira le linguiste, s'il s'agit d'une exigence : on peut opposer un langage nouveau à un langage ancien, comme on oppose une légitimité nouvelle à une légitimité ancienne.
La revendication du vrai nom des choses s'apparente de ce point de vue à celle d'un « langage vrai », d'une parole spontanée, que le « dernier des hommes » - pour parler comme George Orwell - maintient face à l'envahissement de la société civile par l'Etat. Or, dans nos sociétés modernes, caractérisées par l'omniprésence de l'Etat, il ne saurait être question d'une « vérité » des choses. L'Etat est la seule vérité des choses, il n'y a de raison que politique ; quant à la société civile, elle est noyée dans l'océan de l'Etat, ses raisons sont parcellaires, individuelles, anarchiques.
Pourtant, dans son analyse de la langue comme partout, toujours Marat recherche cette vérité au-delà des formes, toujours il pousse l'attention jusqu'aux choses.
Vision passéiste ou force spécifique ? Son analyse de la langue est en tout cas à mettre en parallèle
avec son approche caractéristique des modes politiques — monarchie ou république — car l'une et l'autre peuvent à ses yeux être le visage du despotisme. Question toujours cruciale deux cents ans plus tard et qui donne à Marat une pertinence théorique indéniable, car, s'il n'est pas un politicien, quel politique !
Ce qui définit sans doute plus que tout la théorie politique de Marat, c'est la conviction permanente que toutes ces formes, empreintes de la raison politique, en définitive de l'Etat, sont des formations historiques, c'est la revendication permanente d'une société au-delà de l'Etat...
Toute notre attention doit donc se porter sur ce sous-titre d'apparence anodine qui ne dit pas : « Dénaturer le sens des mots » mais « Dénaturer les noms des choses ». Seule la prise en compte de telles nuances de pensée permet de rendre compte de la théorie politique de l'Ami du peuple.
114


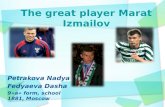
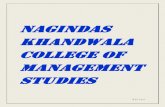



![Weiss, Peter - Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat [Marat-Sade].pdf](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf9943550346d0339c7bfa/weiss-peter-persecucion-y-asesinato-de-jean-paul-marat-marat-sadepdf.jpg)











