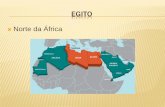À LA - Gremgrem.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/07/Cahier07.pdf · Tr:!r{y*, plus.ieurs traoaux de...
Transcript of À LA - Gremgrem.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/07/Cahier07.pdf · Tr:!r{y*, plus.ieurs traoaux de...

Les Cahiers du GREM
no7
AVIS PRÉSEHTÉ AU Ii,IINISTÈNC DE LACULTURE À PROPOS DU RAPPOHT DU GROUPEDE TRAVAIL §UR LA RÉFORHE DU CURRICULUM
I}ITITULÉ:
nÉaFFmMER L,É,coLE: PBEÂ, DRE LE uIRAGEDU SUCCÊS
Éruor nÉeLsÉe EH leez
Greupe de redrerche sur l'fiucation et les muséesUnivereiüé du Québæ à Montnéal
Mai 1998

Tous droits réseraés
@ Groupe de recherche sur l'éducation et les musées
P:p9t legul- Bibliothèque nationale du euébec, 1998Dépôt légal- Bibliothèque nationale du Canad,a,199g
ISBN 2-922471-06-0
de catalogage avant (Canada)
université du Québec à Montréal. Groupe de recherche surI'éducation et les musées
. _Aüs présenté au Ministère de la culture à propos du rapport$y Gloup_e de travail sur la réforme du curricui,r- ir,titrlc.'É.éuffi"*"" .
l'école -- Prendre le visage du succès : étude réalisée enl997
(Les cahiers du GREM; no 7)Comprend des réf. bibliogr.
tsBN 2-922411-06_0
1. Histoire - Étude et enseignement - euébec (province).2. Histoire -Programmes d'études.3-' Musées -Aspect édlcatif - euébec (province). r. Allar4 Mcher,194&II. Québec (Province). Ministère de la culture et des
"o--.rr,i.utions. lll.Titre. IV. Collection.
D16.4.C3U811998 w.7'0714 c9&%0509-5
-**-*.-----
,,,:,1,,,:".. i ulfli' ,,
Tous droits de reproduction, d'éditiorç de traductiory d,adaptatiory dereprésentatioru en,tof$té,:, "r.purtie,
sont réservés en exclusivité pour tousles-pays. La reproduction d'un extrait de cet ouwlg! par quelque procédé que cesoit, tant électronique que mécaniqu"1. ". partiüli;._p; piré;;pie oü parmicrofilm, est interdite ians l'autorisation ecrite du croupô de reËherche surl'éducation et les musées, Université du Québec à Montré+ Curu-portut" gggg,succursale Centre-Ville, Monhéal (euébec) H3C 3pg.
ili

ü
Avant-propos
?rpuit la création, en 1981, du Groupe de recherche sur l,éducationles musées (GREM), ses membres o,nt réarisé prusieurs recherches
?f: ,conduit plusieurs études. Les données iecueillies ont serrit'etaboratxon de nombreux mémoires ou thèses, efv la rédaction
etetà
de
à
Tr:!r{y*, plus.ieurs traoaux de recherche menés par les membres deGREM n'ont jamais été publ.iés-.intégralement. C'elst pour pallier cettec.ar?nce que nous aTrons décidé de les réunir dais ui, collectionintitulée <<Les Cahiers du GREM». Les chercheurs pou.rront ainsiaaoir accès à des données inédites qui pourraient leur être utiles dansla poursuite de lgurs propres traoaix, thoq* cahier sera plubtié à unnombre limité d'exemplaires et s-e.ra- aendu Lu prix coîttant. on pourrase les procurer sur demande à l,ad.resse ,uiaalnfu,
i' onï-Ât'i-îîntribuél'analyse et à la synthèse de questiont"proprrs à r,éducation muséare.
Çr9upe de recherche sur r'éducation et res muséesDépartement des sciences de l,éducationUnioersité du Québec à Montréalc.P. 88SSSucc. Centre VilleMontréal (Québec)HsC 3P8Télécopieur: (St 4) 987-4608
Michel Allard, Directeur du GREMMai 1.998
-.r'

TABLE DES MATIERES
iiiiiii.' e,lJÏrirc dans I'enseignement des autes matièrec...irrllt
rqrErË'rrçrlrçuL LIE§ auüËs mauere§"'. ..........4
1liii
', Zf L€s savoirs essentiels.. ........4
r, ,. A2 Modifications à 4porter au curriculum........... . . ... .6i" ""'v
lll lltnrUtæ<istoiredanslhcquisitiondescompétencesditesfiansversales............7
tf Lj5*Éreoomme matière d,enseignement............ ...........gl.llâ,domaine de I'univers social et I'histoire. ............g42 Mesures favorables à I'enseignement de lhistoire ..................94-3 Réserves manifestées............ ..... l0
4.3.11-e, temps imparti à ltristoire ................ 10
4.3.2 Réunion avec d'autes disciplines ..... I 1
4.3.3I,e, contenu des programmes........ ........ 13
4.3.4 Histoire fourre-tout ............. 14
§. tlne omission de aille: les ressouræs éducatives extÉrieures à l'école.................. 16
C.uclusion ........ 1g
nffiences ...... 19
---'-t'
'\.,

INTRODUCTION
Nous avo'ns lu le rapport du Groupe de tavail sur la réforme du curriculum intitulé Râffirmerl'école' Prendre le virage du succès, en portant une attention particuliàe aux considérationsrelatives à l'enseignement de thistoire. Nous vous faisons part de nos réflexions et de noscommentaires en eqpérant quTls connibueront d'une maniàe positive à la mise en oeuwe de laréforme proposee.
Dans un premier temps, nous formulerons quelques remarques quant à la conception de laformation axée sur I'approche culturelle. Puis, nous nous attarderons à discuter de la place réserrréeà I'histoire dans I'enseignement des auües matières.
r{qs nous pencherons par la suite, sur le rôle assigné à l'enseignement de l,histoire dansfiaoqui§tion de compétences dites üansversales.
î{qls commenterons, ensuite, la place résenrée, dans le curriculum proposé, à l,histoire commemaffiEre d'enseignement.
Errfrn, nous nous pencherons sur une omission, à note avis, de aith à savoir: l,utilisation parflÉoole des ressources éducatives extérieures.
I. L'APPROCIIB CULTTJRELLE
It'e ræport du Groupe de üavail sur la réforme du curriculum accorde une place importanæ àI@oche culturelle en général età I'histoire en particulier.
I-a rerrue des attentes relatives à la mission d'éducaüon témoigne de I'importance accordée à Iacrrtrûtre. Quelques exemples illustreront notre propos. Iæs auteurs du rapport soulignent qu,il fautrùausser les exigences de l'école. À cet égard, il y a:
- næessité d'augmenter le bagage culturel des pogrammes d'études;
- necessité dhugmenter le contenu de cerAines matièrres dont I'histoire @.23).
C'est dans cetæ perspective qu' *il faut réquilibrer certains contenus & prognmme afin dep€rmetfre une connaissance plus complète des productions culturelles" (p.26). Iæ programmedhist'oire lui-màne, remaryuent les auteurs, ne fait pas iulsez de place aux productions culturelles

I
4
,er üffireoæs époques. (p.26). De plus, pour établir les bases d'une formation continue, il faut
& une attention particuliàe au développement de I'intérêt pour la culture chez l'élève @.27).
M, h revrle des atænæs relatives à la réforme du curriculum met en relief I'importance de la
d'rnfiiime. cmsidéree, dans la formation des élèves, comme un élément essentiel mais quelque peu
ilriCfiûEF Cme preoccupation ne peut que rehausser la place accordée à la culture à titre de partie
rrymæ ûr cuniculum d'études. Elle témoigne d'une volonté de refaire de l'école, un lieu de
ûEME-
Elü iffit ne se confine pas au plan des intentions mais se concrétise dans plusieurs des
mmnrurndations formulfus par les auteurs du projet de rÉf«nme. En effet, ils notent que, lors de
rmnn êlûçation, "le programme doit ême pen$ de façon que l'approche culturelle soit présente»
lptll.Mais qui plus est, certaines pratiques d'évaluation doivent ête corrigées pour rehausser le
@$car culturel de I'ecole (p.93). Enfin, " le renforcement de l'approche culturelle dans les
müqlammes d'études, (p.112) devra influencer les programmes de formation des maîfres
§rmme toute, on peut retrouver de nombreux exemples, à travers le rapport, de lar@oraissance de I'importance de la dimension culturelle définig selon les auteurs du
rspptrt <... comme l'appropriation par les nouvelles générations, des savoirs de la culture qui
rm$iûmt le propre de lêfe humain et qui sont I'essence du mon& où il nous faut viwe, monde
Wm'r' n'est plus naturel mais culturel» (p.25). En fait, la culture constitue le lien reliant les différentes
gffiations. C'est un héritage que les hommes se Earlsmettent en I'enrichissant. À cet égar{ on ne
pem dadtrâer aux intentions du groupe de Eavail. Mais comment ces intentions se Eaduisent-ils
dsms les Éformes proposees?
]. L'HISTOIRE DANS L'ENSEIGNEMENT DES AUTRES MATIÈRES
Auant détrblir, potr chacune des matières du curriculum, les savoirs dits essentiels, les auteurs du
trogramme inscrivent la compréhension de u J...1 I'organisation de I'eqpace et du temps» (p.47)
fmi les apprentissages élémenaires conférés à tout programme d'études. Brel la dimension
eryæ-temps est placee sur le même pied que l'apprentissage de la lecture ou du calcul.
2.1 I-es savoirs essentiels
Celte préoccupation se refiouve dans la description des savoirs dits essentiels proprcs à chacun des
grands domaines d'apprentissage. (Notons que ltrnivers social compte parmi les cinq domaines
remus.) Une phrase résume fort bien, à notre avis, la position du comité: "L'histoire de 1a science,
-d#

,les üts, n'est-ce pas ainsi I'histoire d'êfies humains qui cherchent à depasserdrques, quitte à s'en débarrasser?r, (p.29).
DhsF'èsoommentcetteaffirmation se concrétise dans chacun des grands domainesde type disciplinaire. Nous étudierons, dans une autre section de ce rapport, le
&lbivers social qui comprend s@ifiquement I'histoire.
wnellc
n primoine qü nous met au jour @.a8). Elle doit comprendre l'étude des oeuwesi. [---J révèlent des préoccupations et des goûts d'une êpoque, d,un pays,. (p.49)
&latechnologie, des sciences et des mathématiques
&lffilgi,e
d|'Es de frire variant à tavers les âges, on peut viser à «montrer I'importance desfus la production économique des hommes (histoire) t...1» (p.50).
f;rs*nws
1liii|ilii'ilF* & .replacer les découvertes scientifiques dans leur conrexre social, (p.50).Li, ii,;lli,t:
;i,i;;; tadûnatiqrcsliii'li'''
iiii'i. llr d.roe moderne a commencé quand aux impressions qualitatives ont été substituées des
foryint de "methe en conûact les élèves avec les crréations artistiques du patimoine culturel deÈ-qirÉ et de leur prqpre paÿs [...]" (p.53).
Lc dbeloppement perconne I
* ls hrs visês pour as§rrrer le développement de la personne, par la découverte des valeurs [...],G1mt dans toutes les disciptines (p.54).

6
'ry4'gi^rnxrcm spatio'temporelle apparaît comme une dimension essentielle de tous les grands
'hrc' I{ors ne pouvons qu'adhérer à ce principe. En effet, il importe de replacer dans leurre mæ§ les actions de lhomme. Elles ne sont pas le fruit d'une génération spontanée. IlillûÇffiWqræ les élèves comprennent et relativisent I'objet de leurs études que cet aqpect de IalrurapÉst dans toute formation.
@-.8 tfdüfications à apporter au cumiculum
Mi hr ffireux changements proposés au conûenu des programmes actuels, il convient querÜlu h ùmaine du développement personnel, de présenter " J...1 un enseignement culturel desffihlàoompærdu debut du secondaire" (p.63).
M kr nodifications à apporter aux matiàes du curriculum afin de rehausser leur contenulet mlignons les suivantes:
* 5x #nrçeis, langue d'enseignement « [...] initiation arD( richesses cglturelles du paüimoineHsr-- tu Quebæ et des pays de la francophonie [...], (p.134).
uu @tæ moderne: ..accorder une place à des éléments de civilisaüon,. (p.135).
* {n morhématiques : "Et, les programmes d'études dewont donner des indications permettantümTir à &s perspectives histori{ües» (p.135).
* Gr r.;Éqces: la perspective sociale devra ête présente (p.136).
,"Trt Gm rfts il imporæ de tenir compte des " [...J productions significatives pasÉes t...1, (p.1371.
ffi. ftistoire est incluse dans le contenu de certaines compétences dites tanwersales. À tirc'{hqndÊsr en information scohae et professionnelle il faut faire l',.Histoire des métiers et des@üùrns» (p.12S); dans l'apprentissage aux nouvelles technologies de l,information et de la@mication (NTIC), il conüent de s'arrêter à leur histoire et à leur évolution (p.13I).
h me h dimension espace-temps ne se limite pas aux objectifs poursüüs par les grandsmEô'trH d'ryprentissage, elle se conctétise en s'intçgrant au contenu disciplinaire & touæs les]Füfli?cs incluses dans le prograrnme d'étude. C'est à l'histoire en particulier que reüent cette tâche.m" Fmet de souligner les apports culturels passfu et & replacer chaque matière dans sonmmnrFq'frs C'est à note humble avis, un immense progrès par rapport aux programmes actuels. IlWE que Ïhistoire déborde le cadre éroit et souvent limitatif d'une matière s@ifique. Il fautp @ue élève développe sinon le Éflexe du moins Ïhabitude de se poser devant chaque

hr $§ions suivantes: Qu'est-ce qui est arrivé auparavant? Dans quel contexte, cetter sine't-elle? Iæ rapport du groupe de tavail ne conduirait qu'à cette seule réforme du
qulm grandpas en avant serait franchi.
[.ü fIÂcE DE L'HISTOIRE DANS L'ACQUISITION DES COMPÉTENCBSNltrS TRANSVERSALES
ù* contenus disciplinaires des matières inscrites dans le curriculum d'éfudes, les auteurstü ù réforme proposent d'inclure des compétences dites ûansversales « [...1 en ce sens
ûftrmt ête présentes dans toutes les acüütés de l'école, discipünaires ou nonitcg et qu'elles doivent êfie promues par tout le personnel de l'école, (p.32).
Uires prwosent 1a §rpologie suivante (p.55,122):
; hrærFéænces inællectuelles;
* ermpftenoes méthodologiques;
* furr:r[Éreîces liées à la socialisation;
* hqémces dans le domaine de la langue.
ffircnçdwrsistentces compétences dites fiansversales, il faut attendre jusqu,à la page 64 duqFtpour lhpprendre. Iæs auteurs entendent par cette expression: "[...] la capacité de transposerhÜffireats domaines d'activiÉs un savoir acquis dans un oontexte particulier. C,est en raison&qEcræteristique qubn qualifie cette comstence dite tanwersale, (p.64).
r|harfi;tim soulève quelques interrogations: la capacité de hansposition n,est-elle pas l,un des1diFrfift visés par toutes les matières? Est-ce que thpprentissage du calcul ou de la læture fontÉ fu owrpéænces hansversales?
Ut-'qre 3 du rapport propose quelques éléments pour aider à définir le contenu des compétenoesEnusales Pæmi les thèmes proposéq I'histoire occupe une place de choix.
eGftL lhistoire,liee à la geographie ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté, est proposée à tine&lriil dancrage aux compâences hansversales suivantes:
fuion à la consommation (p.123);
*hcariorn à la citoyenneté (p. 125);
"I

sion internationale (p. 129).
Ltirtoire devient aussi le point d'ancrage avec d'auffes matières pourplusieurs aufres comftencesmansvefsaleS:
- éùrcation relative à I'environnement (p.125);
- éducation aux médias (p.127);
- eürcation inter culturelle (p.128).
Ltistoire est aussi considéree, à I'instar de toutes les matières, comme un point d'ancrage pour
thoqui§tion de comt'tences méthodologiques (p. 130).
I es auteurs démontrent bien que I'histoire doit occuper une place dans un processus de formation.
ÈIqs reiterons noEe accord avec la volonté de pnoposer I'examen du passé comme un processus
propre à tout apprentissage.
Touæfois, en voulant faire la matiàe dite de thistoire, lepoint d'ancrage de plusieurs compétences
træsrersales, n'y a-t-il pas danger que cette matiàe ne devienne une espèce de fourre-tout? Car,
chaque sujet possède sa propre histoire? Mais alors, une interrogation surgit: est-ce que I'histoire
ounme matière distincte a sa place dans un curriculum? Ne derrrait-elle pas êne intégÉe, comme le
proposent les auteurs du rapporf à toutes les matières inscrites au programme d'études? Bref, en
plus de nous questionner sur la nature même des compétences fianwersales, f inclusion de cette
nowelle notion dans un curriculum d'études soulève de nouveau un débat ayant porn objet la place
è lhistoire dans I'enseignement?
4. L'EISTOIRE COMMB MÀTIÈRE, D'ENSEIGNEMENT
4.1 Le domaine de I'univers social et lrhistoire
Les auteurs du rapport sur la réforme du curriculum reconnaissent qu'un des grands domaines
d'apprentissage de type disciplinaire a pour objet l'univers social:
* [...] à l'école, il faut out'rller les élèves pour leur permette de viwe en êEes humains dans une
société d'autant plus complexe qu'elle est plus humaine" (p.52). Cette tâche est confiee plus
s@ifiquement à I'enseignement des sciences humaines qui doivent " [...] rendre l'élève libre par
rapport à cet environnement en le lui faisant comprendre pour lui p€rmettre dÿ mieux agir" (p.52).
- compffier des connaissanoes qui permetænt de dégager le sens de son histoire nationale;

roalpuEr des connaissances qui permettent de comprandre dans ses grandesfuitmnement de la société;
ùtr à comprendre la mise en place de cette société et de ses institutions (enpditiquesl;
ai(b à comprendre les rêalités qui constituent I'homme comme ête social;
ei& à compren&e les relations entre la geographie, l'économie, I'histoire;
&dopper le sens de thistoire;
qnryir à I'histoire du monde.
9
lignes le
particulier
Iliat que.les auteurs du rapport affirment que «[æs apprentissages ici üÉs concernent certes les
si:nces humaines et en particulier thistoire, mais aussi la littératurg les arts, les techniques, les
rciilcÊs et même les langues étangères dont on ne doit pas nfuliger l'apport culturel" (p.53). Ilfrrt 5ut de même reoonnaître que des objectifs de nature et de portée différenæs sont assignés à
feaseignement de l'histoire. Certains, dbrdre purement disciplinaire, relèvent de la contemplation
hdis que d'autes conduisent directement à I'action. Réitércns nore crainæ déjà exprimee
péédemment: n'y a-t-il ps dangerque I'enseignement de l'histoire devienne un immense fourre-
§rt? .Qui üop embrasse, mal éteint», dit le proverbe.
Au surplus, en affirmant que «L'école doit aider ceux et celles qui grandissent dans une culture à y
üouver leur identitê sinon ils tébucheront dans leur quête de §gnifications. Cependan! se fixer un
æl objectif, c'est ren&e incontournable la connaissance I'hisüoire nationale" (p.35), n'y a-t-il pas
danger de détourner I'histoire de ses fins propres? Certes, I'histoire et en particulier I'histoire
nationale peuvent conüibuer à frouver une identité mais I'inverse est aussi vrai. La ligne est ténue
entre lhistoire et la pro'pagande. On doit se méfier de I'enrôlement d'une discipline au profit d'une
cause. Il faut craindre cette intention sans doute fort louable dans l'eqprit des auteurs du projet de
réforme mais qü risque de ëraper en cours de route. Nous recommandons de réviser les objectifs
assignés à thistoire en évitant d'en faire une discipline au service d'une cause si noble soit-elle.
4.2 Mesures favorables à I'enseignement de I'histoire
Plusieurs mesures sugg#es par les auteurs du rapport seront bénéfiques pour I'enseignement de
lhistoire:
- l'histoire sera dorénavant enseignée à tous les degrés des ordres primaire et secondaire sauf au
premier cycle du prhnaire où, toutefois, parmi les éléments fondamentaux, on compte «une
première approche... des rythmes temporels et des éléments spatiaux» (p.66);

l0
- I'histoire fait partie des matières dont la réussite est obligatoire pour obtenir le diplôme de
secondaire (p.100);
- la présentation des programmes d'études sous forme d'objectifs et de sous-objectifs sera
abandonnée (p.81). Cette mesure permetm de mieux présenter les programmes d'histoire qui,
sous la forme actuelle, semblent se résumer à un ensemble de dates et d'événements' Elle ne
peut que relever la qualité de I'enseignement de lhistoire;
- les examens ne pren&ont plus la forme de questions à choix de réponses multiples. Forme qui
faisaitdelhistoireunamalgamededateseldefaits. Leretour aux qtæstions ouve,rtes ne poura
qu'êEe bénéfique à I'enseignement de I'histoire (p.95);
- les réformes proposées dans l'élaboration et l'approbation des manuels (p.78 et 88) favoriseront
la publication d'instuments pédagogiques qui tiendront compæ des plus récentes innovations.
Nous ne pouvons qu'applaudir à toutes ces mesures qui, dans les fait§' ænsacrent fimportance de
I'enseignement de thistoire et ne pourront qu'améliorcr sa qualité.
4.3 Rêserves manifestées
4.3.1 I* temps imparti à l'histoire
Dans 1e progrrrmme actuel, les sciences humaines devraient êhe enseignées à I's&e primaire à
raison de deux heures par semaine même si dans les faits plus de 70% b enseignants leur
consacîent moins de temps (p.68). La rrêforme retire le trio histoire, gfugraphie, éducation à la
citoyennetê du prognmme dêtudes ôu piremiu syc,le (tàe ef 28, anrléE§) et te réduit à une ($ heute
semaine aux auües degÉs du primaîre. Cette mesure perpétue leur classement fmi les matières
{i1ss «petites". L'ajout dune heure dite d'enrichissement mise au programme selon la bonne
volonté des écoles, nous apparalt un üeux pieux compte tenu de llmporhnce que les parents
accordent au français, à Ïanglais et aux mathématiques. On peut alas s'inErroger si les sciences
humaines seront enseignées. Iæ peu dTmportance qubn lern ëvolue ænredit les intentions
manifestées par les auteurs du rapport à leur égard
Au premier cycle secondaire, on note une hausse du temps consacrÉ à I'enseignement de ces
disciplines. En fait, au premier cycle, on leur consacrera 5 cours de 3 ou 4 heures alors que dans le
programme actuel, on leur accorde deux cours de 4 heures. Au second cycle du secondaire, c'est le
statu quo.

llBrcf, l'ensignergrt fu scicnæs hoaines sa renfqoé à l'mùe smdaire. Tqrefois, il fautcainüe hr dispuitkn ù programme de I'orrdrc primaire ao@e Enu du peu de Emps qui leur estiryrti.
4.3.2 Rétnion atec d'aûres disciplirus
Ilans la réfsme proposée, I'histoire n'est plus considérée comme une matière autonome. Elle est
bujorns liée à dauües disciplines. Remarquons quâ I'ordre pnmaire cela ne change rien à lasinration acûrelle sauf que lbn peut se demander pourquoi I'appellation n sciences humaines,di§pamît alors que les enseignants la comprennenl C'est contibuer à Ia confusion.
A I'ordre seoondaire, passe encore la réunion avec la géographie car tout événement se situe dans
I'espace et dans le temps (encore §agit-il de geographie humaine) ou encore avec l'économie car [eprqgrammeactuel se ésume à des notions comptèæment désincamees.
Touæfois, on propose aussi de réunir à I'histoire, l'éducation à la citoyenneté dont le contenu se,rait
le suivant:
"Enseignement notamment axé sur l'étude des institutions et de leur fonctionnemen! sur les droitsde la personne, sur les rapports sociaux, sur la compréhension inær culturelle et internationale,l'éducation à la citoyenneté derrra s'intégrer, pour une bonne part à l'enseignement de I'histoire».(p.62),
Certains éléments du contenu de cetæ matière sont aussi présentés comme compéænces
fransversales notarnment la compréhension inter culturelle et intcrnationate, l'éducation à lacitoyenneté (annexe 3).
On assigne à l'éducation à la citoyenneté les buB suivants:
- " [...] rendre la personne consciente de ses &oits et de ses respursabilités à l'fuard d'autrui etde la collectivité en géné,ral" (p.126).
- préparer " [...] à I'exercice d'une citoyenneté active t...1» (p.126).
- " [...] promouvoir les valeurs démocratiques à lTntérieur de l'éablissement scolaire et dans lasociété en général, (p.126).
I-a réunion de lhistoire avec l'éducation à la citoyenneté soulève à tout le moins quelques
interrogations d'autant que les auteurs du projer de réfmme affirment euê! « t...1 si le socle
t.
-ri
I

I
t2rassmbleur que doit proposer l'école est celui d'un vouloir-üwe partagé, le vouloir-üwe en&mocratie, ce socle doit être, pensons-nous, également celui de la mémoire de l,histoire, (p.35).
orlhistoire consiste à établir, décrfue et interpréter les évârements passés. Il faut les comprendreea eux-mêmes avant de cerner comment ils peuvent aider à compren&e le présenr on n,enseignepas les mathématiques à des fins d'éducatio,n économique bien qu'elles puissort indirectement ysen'k' De la même façon, on n'enseigne pas l'histoire à des fins d,éducation civique (Allard,1967)' Lhistoire peut autant conduire à apprécier qu'à déprécier la democratie. euelques tentativesd'un enseignement de I'histoire axé sur des objectifs autres que cerx propres à la discipline elle-même ont connu des ratés. Rappelons-en quelques_unes:
- les programmes d'histoire d'avant 1966, visaient des objectifs d,ordre patiotique et religieuxc'est-à-dire ""' développer la fierté de I'enfant et de I'adolescent dêtre canadien mais pasn'imporùe lequel mais un canadien d'origine française et de foi catholique, (Allard, M. 1g7g,p.32.). A-t-on atteint ces objectifs?
- dans les années 1960, B. Hodgetts dans son ouwage Quelte culture? euet hcrttagepréconisaitun enseignement des études canadiennes afin de plomouvoir par la compréhension mutuelleI'unité du pays. eu'est-ce qui en est résulté?
- avant L964 la philosophie néothomiste imprégnait toutes les sciences humaines dont laphilosophie et lhistoire. Elle fut remplacee dans les années 1970-19g0 par le cadre d,analysemaniste. Quels sont les résultats?
Iæs exemples ne manquent pas. On ne peut subordonner I'enseignement de lhistoire à des finspolitiques sans risquer d'obtenir des résultats inverses à ceux attendus. Lhistoire doit êo,eenseignée en elle-même, en espêrant que les érèves sauront mieux compr:endre ra société danslaquelle ils vivent, qu,ils utiliseront leurs connaissanoes pour effætuer des choix éclairés, pourdévelopper letr conscience ciüque. c'est le plus loin où un système d,éducation peut aller.L'histoire, c'est d'abord un savoir et non une action.
Dans cette perqpective, il convient de Éparer I'enseignement de l,histoire de l,education à lacitoyenneté.

I
134.3.3 Iz contenu des progrornmes
. À I'ordreprimaire
ræs auteurs du projet de réforme proposent que le contenu du programme dhistoire, de geographieet d'education à la citoyenneté soit réviÉ " [...] et harmonisé avec le programme du secondaire,(p'61) c'est-à-dire * [".] débuær une initiation aux contenus relatifs à la préhistoire et à l,Antiquitéqui seront vus au debut du secondaire,, (p.141). IVIais quel sera ce contenu?
consistera-t-il en celü de I'actuel contenu du premio module du programme d,histoire desecondaire I qui porte sur I'histoire et ses matériaux? ce contenu axé sur la notion d,histoire sera-t-il adapté à des élèves de 10-11 ans? Nous en doutons, d'autant que ces notions font appet à un hautniveau d'abstaction.
consistera-t-il en l'étude de la paleontologie qui, dans l'ordre chronologique adopté à l,ordresecondaire, précède celle la préhistoire? Nous en doutons car encore là le conænu relève trèssouvent d'hypothèses requirent une capacité d'absûaction que les élèves de l,ordre primaire nepossèdent pas.
consistera-t-il en une adaptation du programme actuel qui ponte sur le milieu local (3e année), laregion (4e annee), le Québec (5e annee), le canada (6e annee)? lvlais alors comment lier cescontenus à la préhistoire?
A nofe avis, il importe d'folaircirle contenu de du proglramme de l,ordre primaire tout en laissantune grande liberté aux enseignants en autant qu'ils tiennent compte du stade de développementmental des élèves, de leur capacité d'abshaction et de leurs intérêts en corrélation avec la naturemême de thistoire.
. À I'ordre secondaire
Les auteurs du projet de réforme préconisent un retour à une taditionnelle approche de twechronologique' En secondaire 1 et 2, le contenu sétalerait de la préhistoire à l,époquecontemporaine et en secondaire 3 et 4, il couwirait l'histoire nationale depuis les grandesdecouvertes jusquâ nos jours. En fait, on prcpose une approche du plus loinain au plus proche,même si on a déjà démonûé à maintes reprises qu'une telle approche ne correspond ni audéveloppement intellectuel, ni aux intér,rêts des élèves.
ræs favaux du professeur l-efebwe depuis §on ouvrdg e Histoire et mythologie (lg6g)jusquâ sonplus récent intitulé De l'enseigræmcru de l'histoire (1995) démontrent clairement l,impossibilité

l4ontologique pour les élèves de suiwe un tel programme et ce, peu imporæ les moyens didactiqueset les sfategies d'enseignement et d'apprentissage adoptées pour les mettre en oeuwe.
Selon læfebwe
Il faut voir qye.p que r'érève peut faire de mieux pour progresser enhistoire, c'est. d'exfrir-ner y 'p,rgpre experiàce des hommes et dumonde, et ce, à partir de ses intêrêts rponüoe*, uu ,oÿen oèJqu"rtio6qu'il se pose.
Ia chose devrait crever les y-er.rx, la pédagogie de thistoire doitp.rocéderde la nature même de I'his'toire,'deË Ëenôàe Âêiri". -On
rudit bien des fois, mais ce fut,chaque fod;po* proposer, pour imposerà I'enseignan! du même souîflg iio.ns"ig'n"r"nt en conüadiction avecce beau princrpe. @.167)
Encore une fois, la présente proposition de programme tombe dans le même piège. on veutrehausser I'approche historique dans toutes les matières tout en demeurant assez flou sur le contenumais du même souffle on veut imposer, du moins au secondaire, un contenu prédéterminé auprogramme spocifique d'histoire. Contenu chronologique qui,dans le passé, a conduit à de piètesrésultats.
4.3.4 Histoirefouffe-touî
Nous avons déjà signalé, à l'occasion de la discussion de la définition et de la description ducontenu des comt'ænces dites fransversales, le danger que l'histoire deüenne une matiàe fourre-tout' si on ajoute, selon les auteurs du programme, quï faudra en plus des contenusgeographiques et économiqueg rehausser le contenu culturel (p.136) et tenir compte n ...d,une partdes recommandations formulees dans le rapport Iacoursière e! d,aufre part pour intégrer lesnouveaux éléments relatifs à l'éducation à la citoyenneté, (p.141), ce danger s,aggrave.
L'enseignement de l'histoire pourra sombrer dans un encyclo6disme qui escamotera la réflexionet la démarche au prrofit du cumul de connaissances souventres fois dépassées ræs élèves s€rontalors plus enclins à poser la fatidique question. "À quoi sert lhistoire,? Rappelons avec lhistorienMichel Brunet (1968) « [...] que les jeunes ne sont pas intéressés au passé pour lui même. Ils n,ontpas' en général, une vocation d'antiquaires ou de oollectionneurs. Ils nhccepteront détudier lepasÉ que si cette étude leur apporte un enrichissement personnel et des connaissances qui lesaideront à mieux æmprendre le comportement des hommes virant en société. car, ne l,oublionspas, les jeunes sont hès pragmatiques. Ils veulent savoir quelle est I'utilité des matiàes qu,on leurenseigne. Peut-on les en blâmer?, (p.44).

15
En.fait, il faut fonder l'enseignement de thistoirg comme on semble vouloir le faire dans les autres
programmes, sur des préoccupations actuelles. Dailleurs, les auteurs du @sent rapport font eux-
mêmes la démonstration de ce principe Dà te chryire 1, ils procèdent à un rappel historique de la
situation acfirelle des prograrnmes d'études. À plusieun reprises, notamment aux pages 76,89, 9t,
ils ont recours à l'hisoire pour replacer une question prticuliàe dans une perqpective historique.
Nest-ce pas une fapn exemplaire de faire de I'histoire?
Bret nous croyons quil importe de réviser le contenu proposé du programme dtristoire du
secondaire.

t6
S. UNB O1IISSION DE TAILLB: LES RESSOI]RCES É»UCaTIVESEXTÉRIEURES A L'ECOLE
Les auteurs du projet de réforme comptent les nouvelles technologies de I'information et de la
communication OITIC) au nombre des compéænces dites transversales. Toutefois, ils ne disent
mot de l'apprentissage par et aux ressources éducatives extérieures à l'école bien qu'au plan de la
démarche d'apprentissage, (questionnement, développement du sens critique, niveaux de
comprétrension), elles s'apparentent aux NTIC'
Au cours des derniàes années, les ressources éducatives extérieures à I'ecole se sont
considêrablement dévelo,ppées. Noûons en particulier le cas des institutions muséales. Iæur nombre
a considérablement augmenté. Elles sont repandues sur tout le territoire du Québec. Elles sont de
plus en plus frequentées. Elles ont développé des programmes éducatifs dont plusieurs à f intenüon
des étèves des or&es primaire et secondaire. Plusieurs ont même mis sur pied des senrices
éducatifs (Allard et Læfebbre lgg7).Toutefois, on ne les mentionne pas dans te présent rapport bien
qu'elles conviennent à touæs les disciplines, bien quelles se fondent str une approche
d'apprentissage favorisant le contact non pas avec labstrait mais le concret. Dailleurs, le
programme d'études &, tgz4proposait que chaque école primake (il n'est pas encore question du
secondaire abandonné aux collèges classiques) posÉdât son prqprre musée. Car, avançait-on,
certaines matiàes s'enseignant mierx à partir dbbjets De plus, préændaiton, certains élèves
comprennent mieux en voyant ou en manipüant des objets'
Ce qui frap,pe en enüant dans une institution muséalg c'est fimportance acærdée au sen§ de la
vue. Certes, les musées offrent aux visiteurs des üsites guidfus ou encore des audio-guides.
Ass'rémenq dans plusieurs d'enEe eux, on peut entendre de la musique et mêmg qtrelquefois,
sentir des odeurs, toucher aux objets ou manipuler des diqpositifs interactifs. Bref, on peut avancer
que tous les sens sont sollicités. Toutefois, ils ne le sont pas également et ils le sont afin de
renforcer la pe,rception visuelle. C'est d'abord et surtout par I'oeil que l'on üsite un musêe'
D'ailleurs, plusieurs reche,rches ayant pour objet les habiletés inællectuelles mises en oeuwe au
mu$e (Allard, I-arouche, Meunier, l»6, t995,1994, Dufresne-Tassé et Iæfebwe, 1996, Forest,
1gg4, weltzfairchild, 1gg4) démonrent que peu importe lâge des visiteurs, rhabileté la plus
exercée est celle d'observer. Bref, au musée, c'est I'objet qui fonde l'apprentissage
Or, Ienseignement dispensé à l'école est fondé d'abord sur l'apprentissage par la compréhension
de concepts. on part de lhbstrait pour aller vers le conctet.

t7
L'école, contrairement aux institutions muséales, fait d'abord appel au sens de l'ouie. Bien
entendu, on utilise de plus en plus des moyens visuels tels des représentations, des films, des
vidfus etc. Assurément, au secteur professionnel, une grande partie de I'enseignement se dispense
sous forme de fiavaux pratiques axés sur la manipulation. Toutefois, tous ces moyens agissent
ootnrtle support à un enseignement dispensé d'abord au moyen de la voix. Or, te discours favorire
I'apprrentissage par le concepq les mots n'étant en définitive qu'une représenAtion de la réalité.
Suite aux recherches conduites par kfontaine (1984), on admet volontiers Ia segmenation de la
poprlation enEe visuels et auditifs. On peut alors logiquement se poser la question suivante:
lTmportance accordée par l'école au sens de lbuïe ne serait-elle pas l'une des causes importantes de
féchec scolaire et par voie de cons{uence du décrochage? Si la réponse s'avérait positive, ilfaudrait remodeler toutes nos méthodes d'enseignement. Une profonde mutation s'avérerait
indispensable.
La professeure Rachel Desrosiers, dans un magisfral ouwage consacré à I'enseignement et
Itémisphàe droit (1993), remarque que, dans I'enseignement taditionnel, ce sont principalement
les ressources de I'hémisphère gauche axé sur la transmission de connaissances objectives et 1e
développement de la porÉe critique qui surt sollicitês de la part de Ïfuole.
Toutefois, pour que chaque élève se développe de façon totale et optimale, il faut selon la
professeure Desrosiers, que ses aptitudes sur le plan de I'imagination, de f intuition, de la
créativite, de l'émotion soient stimulees. À cet égæ4 etle pnopose des sfiatégies d'enseignement
suscqtibles d'activer l'hémisphère droit. Or, les objets et plus spécifiquement les oeuwes d'art
exposés dans les musées ne font pas uniquement appel à la penÉe critique du visiæur. Elles
s'a&essent à l'affectivité et solliciænt f imagination du visiæur. En ce sens, I'institution muséale
autant sinon plus que l'école permet de développer toutes les facettes de l'êEe humain. C'est
pourquoi, il convien&ait d'accorder une place importante, dans les programmes d'études, aux
institutions muÉales ou assimilées
C'es! à nofie avis, une grave lacune du présent projet de réforme. En somme, I'institution mu#ale
favorise un mode & connaissance inverse à celü habituellement mis en oeuwe à Ïfoole. tr importe
de leur accorder une place dans le curriculum d'études.
a

18
CONCLUSION
Au terme de cetæ brève analyse oitique du projet de réforme du curriculum d'études des ordres
primaire et secondaire du Quebec, il faut reconnaîfie lintâêt manifesté par les auteurs à insérer une
approche diæ culturelle.
Dans cette approche, l,histoire occupe une prace de choix d'abord dans la description du contenu
des autes mæières puis dans cerle des compéænces diæs transversales. cette volonté est d'autant
prusimportantequelre permet de replacer le contenu disciplinaire des matières scoliaires dans leur
contexte spatio-temporel et de le relativiser. Iæ contenu propo§é napparaît plus comme le fruit
d,une génération spo,ntanêe mais comme le produit d'une l0ngue maturation qui s'incarne dans la
c,lture de la sociéré en géné,ral et de celle du Québec en particulier. ceüe importance accordée à
rhistoire se fraduit aussi par la place atribuée à cette discipline qui sera prÉsenæ à presque tous les
degÉs du curriculum'
Toutefois, il faut deplorer que re programme d'histoire, particuliàement celui de rordre secondaite'
soit lié à celui de ïeducation à la citoyenneté. Grand est le risque de faire de cette discipline un objet
sinon de propagande du moins de défenseur d'une idéologie particuliàe. sans prêtendre que
l,histoire puisse êfie totalement objective, il apparaît fort discutable de l'utiliser au profit d'une
cause aussi nobre et aussi louable soit-e[e. ce,rtes, une meineure connaissance du passé peut
conduire à une meilleure connaissanæ du présent mais pas nécessairement à une meilleure
compréhension du système politique et à une plus grande adhésion aux prrincipes qui I'animenl
I1 faut aussi questionner l,imprécision du corrtenu du programme dlétr,rdes dhistoire proposê pour
l,ordre primaire et re retour, à r,ordre secondaire, à r'imposition d'une traditionnelle @uence
chronologique qui, par le passe, a conduit à de pièfies résultats'
Enfin, soulignons que re présent rapport ne rêsenre aucune place à r'utilisation des lieux éducatifs
extÉrieurs à récole. sratfuie aussi imporhnte à metre en prace q.e les nowelres technologies de
finformatio,rr et de la communicationn si l,on veut pocéder à une réforme du crrrriculum qui le
ren&aitplusapteàsatisfaireauxdifférentsstylesd'appentissage.
Bref, cette rêforme mériæ d'êfie implantée à condition toutefois de procedo à cerains ajustemefits'
Au'ement, l,enseignement de ïhistoire po,rrait frcilenrent rctomb€r dans les ornièBs où il âait
enliÉ avant la mise en place des programmes cadres'
-i,Ùx,I-. rriilrnlflnIjrii