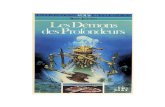TRANSFORMATIONS DANS LES VALUES ET LES STRUCTURES DE LA SOCIETE: NOUVEAUX DEFIS POUR LES SERVICE...
-
Upload
andre-beaudoin -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of TRANSFORMATIONS DANS LES VALUES ET LES STRUCTURES DE LA SOCIETE: NOUVEAUX DEFIS POUR LES SERVICE...

TRANSFORMATIONS DANS LES VALUES ET LES STRUCTURES DE LA SOCIETE: NOUVEAUXDEFIS POUR LES SERVICE SOCIALAuthor(s): André BeaudoinSource: Canadian Journal of Social Work Education / Revue canadienne d'éducation en servicesocial, Vol. 3, No. 2 (Summer/Eté 1977), pp. 3-19Published by: Canadian Association for Social Work Education (CASWE)Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41668792 .
Accessed: 16/06/2014 04:07
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Canadian Association for Social Work Education (CASWE) is collaborating with JSTOR to digitize, preserveand extend access to Canadian Journal of Social Work Education / Revue canadienne d'éducation en servicesocial.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

TRANSFORMATIONS DANS LES VALUES ET LES
STRUCTURES DE LA SOCIETE: NOUVEAUX DEFIS
POUR LES SERVICE SOCIAL1
André Beaudoin Ecole de service social Université Laval
SUMMARY Starting from the view-point that our present
era is one of modernity crisis, the author analyses major changes that have taken place in our society's values and structures and the challenges that these changes are raising for social service. He uses the present situation in Quebec as an illustration.
As for changes in values, equity, according to which different rewards should be granted to people because of innate or acquired differences, is gradually replaced by equality which contends that the sharing of rewards should be pretty well the same between all people. The institutional models of self-expression are more and more replaced by models which find their roots in people themselves. The social relationship model which seems to gain an increasing popularity emphasizes people's qualities rather than the position they hold in the social organization.
As for structural changes, the economy is experiencing a growth crisis where the redistribu- tion models of resources are questioned. The occupational structure reflects the domination of a number of those holding power over the work force; the work relations crisis in the public sector is threatening the State functions themselves. At the political level, we are witnessing an increasing dissatisfaction towards elected governments.
In this evolutionary context, social service must redefine its own basic concepts. To do this, it seems that neither a functionalist reference model, nor a marxist model would be appropriate. We should rather look at activist and humanist reference patterns, leaving aside societal concepts that are overly guided by natural and biological sciences to accommodate a concept of history as a dialectic process, while insisting on the role of critical analysis and proposing social guidance as well as a strategy for the development of society.
La société dans laquelle nous vivons traverse une période de crise. Il y a au moins accord sur cette constatation s'il n'y a pas consensus sur l'interprétation de l'importance et de la signification du phénomène. En dépit de certains points de vue différents qui soutiennent que cette crise n'est que passagère, limitée dans sa perspective, et la résultante directe des progrès que nous continuons de faire2, je soutiendrai un point de vue quelque peu différent en montrant que la crise que nous traversons est vraiment réelle dans son impact; elle représente un mouvement vers une transforma- tion profonde et globale de la société. La modernité et ses manifestations telles que nous les avons vécues jusqu'à maintenant en sont à leur terminaison, comme le mentionne Etzioni3. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous retournons en arrière, mais la société dans laquelle nous sommes, est en train d'être remplacée par un nouveau type de société dans le cadre d'une révolution
'Conférence prononcée à l'occasion de la réunion annuelle de l'Association Canadienne des Ecoles de service social, Université Laval, Québec, le 23 mai 1976. 2Ce point de vue assez répandu dans plusieurs milieux de notre société (hommes politiques, hommes d'affaires, bureaucrates, etc.) est bien illustré dans le volume de Zbigniew Brezezinski, Between Two Ages: America's Role in The Technethronie Era (New York: Viking Press, 1970). 3Amitai Etzioni - "The Crisis of Modernity. Deviation or demise?" International Journal of Comparative Sociology volume 16 (March/ June 1975) p. 1-18.
3
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

globale. La société québécoise servira surtout ici de point de départ à mes réflexions, même si je prends pour acquis que la société canadienne et les autres sociétés occidentales n'échappent pas à ces considérations.
Plus précisément, je veux d'abord analyser un certain nombre de trans- formations majeures qui se sont pro- duites dans les valeurs et les structures de notre société. Je considère que les transformations actuelles sont à la base d'une redéfinition de l'humain et de son bien-être et l'occasion d'une réarticula- tion de la société dans laquelle l'insis- tance n'est plus mise sur la place occupée par l'individu dans l'organisa- tion sociale mais plutôt sur une structure de société où la nature des relations entretenues entre les personnes devient l'aspect important.
J'analyserai ensuite les défis que représentent ces transformations pour le service social. Une telle analyse est particulièrement importante parce que je reconnais comme d'autres l'ont fait4, que le service social est intimement relié aux forces et dynamismes qu'on retrouve dans la société.
Transformations des valeurs Considérons d'abord la question des
transformations profondes des valeurs qui sont à la base de notre société. Depuis quelques années, si je prends le Québec comme illustration, on a vu s'élever plusieurs voix pour souligner la crise des valeurs que nous traversons: citons entre autres LUCIER5,
CLICHE6, CHAMPAGNE7, ADAM8, LEVESQUE9, Fernand DUMONT10 pour n'en mentionner que quelques- uns11. Certains ont même été alarmistes et ont souligné que cette crise des valeurs risquait d'entraîner le Québec dans le chaos et la décomposition à cause de la dissolution de la fibre morale et spirituelle de la société qu'elle représente12. A l'autre extrême, il est apparu à d'autres observateurs qu'il n'y a que peu de fondements aux différents mouvements de protestation et de con- testation qui se font jour dans la société; pour plusieurs, il ne s'agit que de mouvements sporadiques suscités par des minorités qui ne représentent que peu les opinions de l'ensemble.
Il apparaît, toutefois, si on fait une analyse plus complète et articulée de la situation, qu'on peut avancer des hypothèses d'explication qui ont des racines beaucoup plus profondes et qui mettent en cause certains fondements
4Voir en particulier le volume de Nathan Edward Cohen - Social work in the American Tradition (New-York, Holt Rinehard and Winston, 1958). 5Pierre Lucier - "La crise des valeurs au Québec - Une problématique encore à établir" dans Relations volume 36, no 41 3 (Mars 1976) p. 70-74.
6Robert Cliche - Causerie au Collège Jean de Bréboeuf, le 19 janvier 1976, compte-rendu publié dans Le Devoir 20 janvier 1976. 7Maurice Champagne - "Dangereuse crise des valeurs au Québec" dans La Presse 15-16-17 janvier 1975. 8Marcel Adam - "Le Québec doit retrouver le sens des valeurs spirituelles et morales" dans La Presse , 18 janvier 1975. 9Georges-Henri Levesque - Causerie prononcée devant l'Association des Commissaires Industriels du Québec, à Rivière-du-Loup dans Le Devoir, 1 octobre 1975. ,0Fernand Dumont - "Il faut recharger les institutions" dans Revue Notre-Dame no 11 (spécial), décembre 1975, p. 16-28. nVoir aussi Jérôme Choquette - Discours devant la Chambre de Commerce de Montréal le 11 novembre 1975, dans Le Devoir 12 novembre 1975; Mgr Paul Grégoire - Allocation au Club Richelieu "Tendances Religieuses dans l'Eglise d'aujourd'hui" dans La Presse 16 janvier 1976; "La crise des valeurs au Québec" no 1 1 de la Revue Notre-Dame, décembre 1975. 12Pierre Lucier op. cit. p. 70.
4
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

même de la société. Il y a d'ailleurs eu des transformations majeures dans les manifestations de ce phénomène.
Avant d'aborder le contenu même de ces transformations, il convient d'en présenter brièvement les principales manifestations. Manifestations principales
Si l'on prend la situation québécoise, il apparaît que lçs premières manifesta- tions de ces changements dans les valeurs se sont d'abord produites dans le discours au cours des années 50: à preuve les écrits de l'époque par PELLETIER13, TRUDEAU14, FILION15, et d'autres. La période de la "révolution tranquille" du début des années soixante peut être caractérisée comme une tentative de mettre en application ces nouveaux schèmes: il y a eu l'extension de l'accès à l'éducation, l'universalisation de la sécurité sociale (régime des rentes et autres formes de sécurité de revenu) et la nationalisation de l'électricité qui consacrait la reconnaissance de l'Etat entrepreneur. L'analyse de ce mouvement a d'ailleurs été interprétée comme le réalignement des élites de la bourgeoisie québécoise autour d'un schème de pensée renouvelé.16
Au cours de la même période, on assiste parallèlement à un effort massif
d'organisation du monde du travail. Après la grève de l'amiante de 1949, le mouvement de syndicalisation des travailleurs s'accentue de plus en plus: 1950 et 1960, le nombre de syndiqués passe de 236,399 à 354,300; entre 1960 et 1970, il passe de 354,300 à 587,223: en 1973, il était à 745,461 17 et en 1976, on peut estimer ce nombre à environ 800, 00018. Le droit de grève accordé aux employés de la fonction publique à partir de 1963 est à la base d'une nouvelle définition non seulement des rapports de travail entre employeurs et employés, mais entre l'Etat et ses employés. Au début des années 1970, la force du travail devient en mesure de manifester dans l'action les revendica- tions qu'elle soutient. Toutefois, comme le souligne David,
"Après que la transformation d'appareils d'Etat désuets ait été accomplie et que l'exercice de certains droits démocraiques (électoraux et syndicaux) ainsi que l'accès aux bénéfices de certaines institutions (de santé, d'éducation) eurent été concédés, un net durcissement dans les rapports entre le pouvoir politique et le mouve- ment syndical s'est manifesté et n'a fait que s'accentuer depuis 1966 parce que le mouvement ouvrier poursuit sa lutte pour l'élargissement des droits démocratiques mais l'Etat ne peut aller plus loin dans ses concessions."19
En même temps, sur le plan politique, un cheminement parallèle se réalise: le nationalisme québécois qui, au début des années 60, était surtout un mouvement de discussion d'idées, devient de plus en plus un mouvement
13Voir par exemple P.E. Trudeau - A propos de "Domination économique" dans Cité Libre vol. 20 (Mai 1958) p. 9-16; "Un manifeste démocratique" dans Cité Libre (Octobre 1958) p. 1-31. 14Voir par exemple Gérard Pelletier "Réflexions sur l'état de siège" dans Cité Libre vol. 16 (Février 1957) p. 32-40; "Crise d'autorité ou crise de liberté?" Dans Cité Libre vol. 2 (Juin-Juillet 1952) p. 1-10. l5Dans divers éditoriaux du journal Le Devoir au cours des années 1950. ,6Hélène David - "L'état des rapports de classe au Québec de 1945 à 1967" dans Sociologie et sociétés vol. VII, no 2: p. 33-63.
17Statistiques diverses sur le syndicalisme obtenues grâce à l'amabilité du professeur Jean Sexton du département de relations industrielles, Université Laval. l8Estimé établi à l'aide d'une conversation avec Jean Sexton, professeur au département de relations industrielles. Mes remerciements. 19Hélène David - "L'état des rapports ... op. cit" p. 62.
5
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

d'action politique avant de devenir un parti politique qui a recueilli une bonne partie du vote populaire aux dernières élections, malgré les efforts articulés des systèmes d'action en place contre ce mouvement.* Dans un article récent, François-Pierre GINGRAS fait ressortir de façon claire comment dans son cheminement, le nationalisme québécois s'est transformé au cours des dernières années en un projet social et politique articulé20.
Sur le plan des valeurs, ces manifestations entraînent un abandon de plus en plus évident de certaines valeurs du passé: abandon du mono- lithisme religieux, du refoulement de la sexualité, du respect aveugle de l'autorité, pour n'en mentionner que les plus importantes. De plus en plus, de nouvelles formes de dissidences et de mécontentement se manifestent. La jeunesse est le premier groupe à re- mettre en cause les modèles tradition- nels de pensée. Le mouvement d'abord restreint, marginalisé, et assez peu arti- culé prend de plus en plus d'ampleur et s'élargit de plus en plus.
Malgré le fait qu'au cours des der- nières années et jusqu'à récemment, une certaine accalmie superficielle paraissait s'être produite, malgré des désengagements assez massifs dans le nombre des participants, malgré le fait qu'on a voulu donner des interpréta- tions qui tendaient à le définir comme un phénomène marginal et l'oeuvre de minorités extrémistes, malgré les efforts de récupération, la vague de fond que constituent les transformations que représente ce phénomène, prend plus
d'ampleur et devient de plus en plus profonde. Il est vrai qu'il y a énormé- ment de divergences dans ces manifesta- tions, mais elles ont toutes une caractéristique commune: elles insistent sur la nécessité du changement en profondeur dans le système existant. Il est aussi vrai que plusieurs de ces mouvements sont conduits par des minorités. Mais il faut se demander, comme le mentionne Etzioni21, dans une interprétation semblable de la réalité américaine, combien de per- sonnes, parmi celles qui apparaissent désengagées, adhèrent déjà aux nou- velles valeurs et nouvelles formes d'ex- pression de la vie en société exprimée par ces minorités? Quelles sont celles qui, sous des apparences actuellement désengagées, isolées ou marginales, sont finalement tout à fait disposées à appuyer ces revendications et à appuyer ces changements? La lutte syndicale des derniers mois au Québec ne peut que nous laisser très songeur à ce sujet: entre 1972 et 1976, il apparaît y avoir eu des changements majeurs dans l'opinion publique face aux luttes conduites par le front commun. Lorsque, massivement, les salariés défient l'autorité civile, lorsque des lois deviennent impossibles à appliquer, comme ce fut le cas de deux lois récentes au Québec, lorsque l'Etat semble avoir perdu la confiance d'une bonne partie des citoyens, il est évident que des changements majeurs sont en cours.
Le conenu des transformations Ce n'est pas tout de s'interroger sur
les manifestations du phénomène, il est aussi nécessaire de donner une attention particulière à son contenu. Qu'est-ce qui
*Le Parti Québécois forme d'ailleurs le gouverne- ment du Québec depuis le 15 novembre 1976.
20François-Pierre Gingras - "L'idéologie indépendantiste au Québec: de la revendication nationale au projet social" Cahier International de Sociologie L IX (1975) pp. 273-284.
2,Amitai Etzioni - "The Crisis of Modernity" op. cit. p. 5.
6
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

est en train de changer dans les valeurs? De nouvelles valeurs sont-elles privi- légiées? J'avancerai trois hypothèses d'explication qui m'apparaissent le mieux illustrer le contenu des trans- formations de valeurs qui se produisent actuellement. Ces hypothèses sont les suivantes: 1ère hypothèse: La valeur "égalité" prend de plus en plus la place de la valeur "équité" dans la conception de la régulation des rapports entre les hommes. 2e hypothèse: De plus en plus, dans l'expression de soi, par les personnes, l'importance est accordée à l'impulsion plutôt qu'à une expression inspirée de modèles institutionnels. 3e hypothèse: Le mode privilégié de relation entre les hommes se veut de plus en plus centré sur une orientation qui respecte les désirs, les sentiments et les attitudes des personnes plutôt qu'un mode de relations défini par la place qu'ils occupent dans l'organisation sociale.
Nous voulons élaborer sur chacune de ces hypothèses.
De l'équité à l'égalité La nécessité d'avoir un principe
organisateur qui sous-tend les rapports existant entre les différentes unités sociales pour leur assurer la plus grande cohésion n'est pas un problème nouveau et sa formulation remonte ausi loin qu'à Hobbes au XVIIe siècle22. C'est là une considération macro- scopique qui est à la base de l'organisation de la société, du maintien de l'autorité et de la régulation des rapports entre les différents groupes qui composent cette société.
Depuis longtemps, le principe de l'équité comme valeur de régulation des rapports entre les hommes a occupé une place largement dominante dans notre société.23 Ce principe et les valeurs qui les sous-tendent ont été énoncés dans un contexte d'échange entre les hommes avec le but de régulariser des attitudes trop auto-centrées et égoistes. La norme de régulation ou de justice que sous- tend la valeur d'équité, établit que des récompenses plus considérables sont accordées aux personnes dont la con- tribution est plus importante. Ainsi, Homans déclare qu'une personne "dans une relation avec une autre s'attend à des profits . . . qui pour chacune vont être proportionnels à ses investisse- ments"24. En conséquence, si une per- sonne consacre plus d'investissements dans une chose qu'une autre personne, elle doit normalement en retirer des bénéfices plus grands. Ainsi, on est en face d'une situation de bénéfices ou récompenses déterminés par la nature des investissements. Si on généralise
22T. Hobbes - Leviathan New-York: Meridian, 1966 (Publié initialement en 1961).
23Ce principe a été exposé de nos jours surtout par des auteurs suivants: George C. Homans Social Behavior: Its Elementary Forms New- York, Hartcourt, Brace B. world, 1961; J.S. Adams - "Inequities in Social Exchange in L. Berkowity (ed) Advances in Experimental Social Psychology" (vol. 81) New-York, Academic Press, 1965; W. Bell "A Conceptual Analysis of Equality and Equity in Evolutionary Perspective" American Behavioral Scientist vol. 18 (1974), no. 1, p. 8-35; une telle conception sous-tend aussi certains rapports canadiens et québécois: cf. Comité Spécial du Sénat - La pauvreté au Canada. Ottawa Imprimeur de la Reine, 1971; Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social - Le développement - Tome /. Quebec, Government Quebec, 1971, p. 205-216. 24George C. Homans - Social Behavior: op. cit p. 44 (traduction de l'auteur); voir au Québec la citation suivante: "La justice distributive demande aux sociétés de distribuer à leurs membres les ressources dont elles disposent, proportionnellement à leur mérite et à leurs besoins" cf. Rapport de la Commission d'Enquête sur la santé et du bien-être - op. cit. p. 205.
7
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

cette conception de l'équité pour l'ensemble de la société, on a un schème de valeurs sociétales de base qui appuie le principe d'accorder des récompenses différentes dans la société selon les différences de contribution. "Ainsi, comme le souligne Bell, des "attentes" de récompenses différentes peuvent être la conséquence tant de différences acquises, telles que les habiletés, l'ex- périence l'instruction, et la connais- sance que de différences attribuées par la nature, telles que le sexe, l'âge et la race"25. Déjà, depuis longtemps, il y a un rejet de plus en plus généralisé dans notre société de cette tendance à diviser les ressources de la société selon des différences attribuées par la nature (vg. le sexe, l'âge, la race, ou l'intelligence) même si le problème est loin d'être solutionné. Cette valeur n'est plus acceptée comme principe organisateur des relations entre les unités sociales26.
Quant à la deuxième dimension du principe qui affirme que des récom- penses plus considérables doivent être accordées à ceux qui fournissent des inputs plus grands en terme d'expertise, d'instruction, de connaissances, elle a continué d'être à la base de la régulation des échanges entre les unités sociales dans une société de type capitaliste comme la nôtre. Elle est d'ailleurs partie intégrante des schèmes fonctionnalistes d'explication qui sont largement répandus dans notre société et qui ont été jusqu'à maintenant dominants en service social. La valeur de l'équité occupe une place prépondérante dans la régularisation des échanges et des
rapports entre les hommes. Comme l'ont montré plusieurs auteurs27, il est tout à fait nécessaire à la société et à son développement que de telles récom- penses supérieures soient accordées à ceux qui font des investissements plus considérables parce que c'est seulement de cette manière qu'on peut s'assurer que d'autres vont être capables de faire les mêmes investissements plus tard.28
Toutefois, si on s'attarde à analyser un peu les principes qui sont à la base des contestations et des revendications qu'on retrouve de plus en plus chez plusieurs groupes de la société, on s'aperçoit qu'il y a une remise en question fondamentale d'une telle solu- tion d'équité. Le principe d'équité devient de moins en moins reconnu comme naturel, inévitable ou même fonctionellement nécessaire pour réglementer la société et les personnes face à la distribution des ressources. Pour plusieurs, cette valeur est le reflet d'un modèle culturel et historique propre aux agents du système capita- liste qui est le nôtre29. Ce système aboutit à l'isolement, l'individualisme êt la compétition dans les relations entre les humains et empêche la communion, le collectivisme et la coopération. L'alternative proposée est donc celle de l'égalité.
Le principe de l'égalité est une valeur de remplacement à la base des rapports entre les unités sociales. Dans sa sub- stance, la valeur "égalité" - même si
25W. Bell "A Conceptual ... op. cit. p. 18 (traduction de l'auteur). 26Le volume de Miller et Roby constitue une bonne approche à cet aspect du problème. S. M. Miller and Pamela Roby - The Future of Inequality. New-York, Basic Book, 1970.
27Voir par exemple R. Davis and W.E. Moore - "Some Principles of Stratification American Sociological Review, vol. 10 (1945) p. 242-249. 28C'est aussi le point de vue exprimé par Elaine Walsters and L.A. Piliavin. Equity and the Innocent bystander Journal of Social Issues vol. 28 (1972) no. 3, pp. 165-189. 29Edward E. Sampson "On Justice as Equality" dans Journal of Social Issues vol. 3 1 (1975), no. 3, p. 49-50.
8
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

elle a été la plupart du temps étudiée par son contraire, l'inégalité - contient comme élément de départ l'idée que les investissements différentiels ne consti- tuent pas une base légitime pour assurer des récompenses différentes. Le partage entre les récompenses doit être assez semblable selon les personnes. Ce n'est pas à dire que l'égalité requiert l'homo- généisation des personnes: ces dernières peuvent être différenciées selon l'âge, le sexe, l'autorité, les habiletés, la compé- tence, l'expérience, etc., mais ces diffé- rentiations ne débouchent pas sur un accès différent aux ressources de la société. Toutes les personnes ont des droits égaux sur les ressources exis- tantes.
Dans notre société d'ailleurs, comme dans plusieurs autres sociétés occiden- tales, la valeur d'égalité paraît donc en train de prendre la place de l'équité dans la régulation des rapports entre les humains même si son contenu n'est pas encore complètement défini. Cela apparaît particulièrement évident dans plusieurs composantes du système du "Welfare State" moderne: au Québec, l'accès à l'éducation gratuite pour tous, les assurances sociales et la loi sur les services de santé et les services sociaux en constituent des exemples. Malgré les difficultés de ces tentatives et leurs imperfections, elles peuvent être vues comme des illustrations d'une tendance plus accentuée vers l'acceptation de cette valeur d'égalité. Toutefois, elle est maintenant en train d'être transposée dans d'autres domaines de relations existant dans la société. C'est là que la remise en question est la plus fonda- mentale et qu'on peut parler de "crise de la modernité" parce que les bases même des rapports entre les humains qui constituent les fondements de notre société sont mis au défi: selon toute apparence, cette crise ne sera solu-
tionnée que par l'établissement de nou- veaux fondements dans les relations d'égalité entre les hommes.
Des modèles institutionalisés d'expres- sion de soi aux modèles impulsifs
La deuxième grande hypothèse de transformation dans les valeurs con- cerne l'expression de soi. Si on accepte, comme l'a déjà indiqué Blumer30 que l'expression de soi est l'extériorisation de la conception qu'une personne a d'elle-même et la façon dont une per- sonne peut définir ses qualités et se situer par rapport à l'ensemble de la société, il apparaît y avoir eu, au cours des dernières décennies, un changement majeur dans la conception de l'expres- sion de soi. Alors qu'auparavant, on accordait une importance très forte à une expression de soi basée sur des modèles ou des idéaux institutionalisés, les types les plus valorisés d'expression de soi sont maintenant ceux qui prennent leurs racines dans la personne elle-même ou autrement dit dans ses impulsions31.
Les principaux éléments du contenu de ces transformations peuvent être décrits comme les suivants: (1) Antérieurement, l'expression de soi qui était encouragée se basait sur l'adhésion par un individu à des idéaux nobles et grands qui dictaient les stan- dards de sa conduite, spécialement face aux obstacles; actuellement, l'expres- sion de soi est perçue comme vraiment réelle quand une personne accomplit une action parce qu'elle juge important
30Herbert Blumer "Sociological Implications of the thought of George Hubert Mead" American Journal of Sociology vol. 71 (March 1966) pp. 535-548. 3,Ralph H. Turner "The Real Self: From Institution to Impulse" American Journal of Sociology, vol. 81, (1975) no. 5, pp. 989-1015.
9
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

de le faire selon ses propres normes qui rendent cette action acceptable. Ce n'est pas parce que l'action est bonne ou mauvaise, noble ou courageuse ou l'inverse selon des normes extérieures qu'elle choisira de la faire, mais plutôt parce qu'elle y croit personnellement. (2) Il y a eu aussi transformation dans la tendance à insister sur le fait que le "soi" ou la personnalité est quelque chose qu'on peut développer, créer, atteindre ou réaliser et qu'en consé- quence, on peut se définir des objectifs et travailler à leur réalisation. On retrouve maintenant plutôt une ten- dance à considérer le "soi" comme étant quelque chose à découvrir, à rechercher et à identifier. Dans cette perspective, on ne considérera pas anormal que des personnes abandonnent l'école ou le travail pour chercher et découvrir ce qu'elles sont réellement. (3) Le troisième élément concerne l'importance accordée aux normes de comportement. Alors qu'antérieure- ment on accordait plus d'importance aux normes prescrites et privilégiées par les modèles définis de l'extérieur et objet de consensus, l'importance semble de plus en plus être accordée à des normes qui sont définies par les personnes elles- mêmes selon ce qu'elles considèrent être le plus acceptable. (4) Les types d'accomplissement qui ont tendance à recevoir plus d'attention sont ceux qui favorisent l'expression autonome et spontanée de la personne plutôt que les accomplissements mesu- rables et évaluables par des critères extérieurs, comme c'est le cas dans la société de production. (5) Alors que l'expression de soi sous le modèle institutionnel favorise une orientation vers le futur, de plus en plus, une orientation centrée sur le présent semble être au coeur des modes d'expression de soi.
Il serait sans doute possible d'ajouter d'autres éléments pour illustrer davan- tage l'importance de plus en plus grande accordée à l'expression de soi centrée sur les impulsions. Ceci apparaît néan- moins suffisant pour démontrer l'exis- tence de cette nouvelle orientation de valeur: cela se traduit d'une manière toute particulière lorsqu'on parle de la forme de "nouvelle sensibilité" dans la culture32 et aussi de l'expression d'une troisième conscience33.
Il y a déjà une certaine évidence empirique de ces constatations en psy- chologie sociale; Zürcher34 a constaté, par exemple, que les étudiants s'iden- tifient de moins en moins à des rôles et statuts institutionalisés; ils valorisent plutôt des modes d'expression de soi centrés sur des orientations qui accordent d'abord de l'importance aux attitudes, aux sentiments et aux désirs de la personne sans référence à des modèles pré-définis. Une illustration de sens commun qui me paraît appropriée à ce niveau se base sur la constatation qu'en prenant contact avec un étranger, au hasard de circonstances (je l'ai d'ailleurs vérifié lors de récents voyages) on s'adresse de moins en moins à lui en lui demandant d'où il vient, ce qu'il fait, s'il est marié, ou de n'importe quelle autre matière du genre, mais de plus en plus, on essaie de nouer connaissance avec lui à travers l'expression de ses goûts et de ses sentiments.
En résumé, la nouvelle valorisation de l'impulsion se caractérise par la spontanéité, par le rejet des artifices de
32Daniel Bell "Quo Warranto?" Public Interest Vol. 33 (December 1975) p. 59. 33Ralph H. Turner "The Real . . ." op. cit. p. 999. 34Lewis A. Zürcher " Alternative Institutions and the Mutable Self: "An Over- View" Journal of Applied Behavioral Science vol. 9 (2-3) (1972) p. 369-380.
10
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

la société et de ses hiérarchies crées de toute pièce, par le besoin d'exprimer librement son enthousiasme ou son indignation, et par la capacité éton- nante de se montrer étonné ou aba- sourdie devant l'inacceptable.
Un modèle de relations sociales centrées sur les qualités des personnes plutôt que sur la place qu'elles occupent dans l'organisation sociale
En continuité avec l'insistance accordée à une expression de soi qui donne plus d'importance à l'impulsion, dans les modèles de relations entre les humains, il y a une tendance nouvelle à accorder plus d'importance aux qualités de la personne qu'à la place qu'elle occupe dans l'organisation sociale. Cette transformation doit être vue dans la continuité des deux premières. Les humains sont essentiellement à la re- cherche de solidarité et c'est d'ailleurs dans son insertion à l'intérieur de cette recherche de solidarité qu'il y a possi- bilité d'établissement de relations inter- personnelles et de relations entre les groupes. Dans la société antérieure, les solidarités de groupe se construisaient autour de la nécessité de protection mutuelle et autour de la production. En effet, c'était les besoins de la protection contre les dangers qui amenaient des groupes à lier et à établir des liens de relations entre eux. Petit à petit, ces modes de protection ont été institu- tionalisés à l'intérieur de la société. La même constatation peut être faite sur le plan de la production: il n'y a pas si longtemps la préoccupation centrale des gens était de produire efficacement les biens qu'ils jugeaient nécessaires à leur subsistance. Cette organisation de la production impliquait des modes de relations basés sur les familles étendues, sur le voisinage (la corvée en est un exemple) ou sur les petites commu-
nautés. Dans ce contexte^ les modèles de relations valorisés étaient ceux qui encourageaient des habitudes de travail disciplinées; les aspirations privilégiées se centraient sur la motivation au travail et les règles régissant les relations à l'intérieur des unités sociales favori- saient l'intégration des membres à ces unités.
A mesure que la production est devenue le propre d'organisations spé- cialisées et segmentées, les liens d'inté- gration qui s'établissaient entre les différentes unités sociales basées sur la place occupée dans cette organisation primaire de la production sont devenus de plus en plus faibles et indirects. De moins en moins, la place occupée par la personne dans l'organisation de la pro- duction constitue la base des relations sociales.
Au fur et à mesure que la consomma- tion des biens et la satisfaction des besoins prsonnels l'emporte sur la pro- duction des biens, d'autres caractéris- tiques que celle de la place occupée dans l'organisation de la production prennent une importance de plus en plus grande comme source de rapports entre les unités sociales. De plus en plus, on insiste sur l'expression et l'affirma- tion des goûts personnels et des qualités qui constituent l'essence même des per- sonnes; la base des relations qui s'éta- blissent entre les humains se situent autour des besoins de consommation des individus avec comme conséquence que ce sont les qualités des personnes dans ce schème de consommation plus que leur position dans le système de production qui prend de l'importance.
Transformations dans les structures de la société
En plus des transformations dans les valeurs que nous venons de considérer, il s'est aussi produit au cours des
11
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

dernières décennies un certain nombre de transformations majeures dans les structures même de la société. Les conditions de la réalité économique, politique et sociale ont été substan- tiellement et profondément modifiées sous plusieurs aspects.
Il serait évidemment impossible de faire une description complète et une analyse quelque peu poussée de toutes les transformations structurales de la société dans la courte période de cet exposé. C'est pourquoi, je me conten- terai d'expliciter quelques-uns des élé- ments les plus importants de ces trans- formations.
Economie Sur le plan économique d'abord,
examinons ce qu'ont été les dernières décennies. Le développement écono- mique a été très considérable au cours des années qui ont suivi la guerre dans la plupart des pays occidentaux capita- listes. Inspiré des principes Keynesiens à la base du laissez-faire, le capitalisme comme système économique a été fleurissant avec un taux de croissance élevé. Cette croissance en même temps qu'elle était liée à des développements technologiques était aussi la résultante de facteurs conjectureis favorables. Comme le remarque Toffler dans un article récent35 la croissance de l'éco- nomie capitaliste et sa conséquence, la modernité, ont été la résultante privi- légiée de l'accès aux matières premières, de la présence de l'énergie (en parti- culier, le pétrole), de l'utilisation de technologies électro-mécaniques, de concentrations urbaines considérables, de la présence des mécanismes de communication de masse et du déve-
loppement de valeurs axées sur la consommation. Dans cette perspective, la production a été de plus en plus spécialisée et sectorisée et elle est de- venue de plus en plus routinière avec comme conséquence évidente et mani- feste la concentration industrielle de plus en plus forte et la main mise de la part d'un groupe de plus en plus restreint et interrelié sur l'ensemble des mécanismes de la production écono- mique non seulement au niveau d'un pays mais à un niveau multinational. Cela a été rendu possible grâce à une balance commerciale favorable sur le plan international, balance qui était souvent créée par l'exportation dans les pays sources d'approvissionnement, de matériaux essentiels vendus à des prix forts et contrôlés par des cartels et monopoles.
Toutefois, la crise du pétrole suscitée par l'OPEP a montré la fragilité et a surtout fait ressortir les problèmes de cet ordre économique; elle a contribué, en particulier, à faire réaliser à certains des pays exportateurs de matières pre- mières la force qu'ils pouvaient con- stituer face aux pays qui dépendaient d'eux dans leur approvisionnement en matière première.
Si on considère maintenant la situa- tion interne des différents pays occiden- taux, y inclus le nôtre, on peut constater un développement parallèle du système du "Welfare State" introduit pour contrebalancer les effets négatifs de ces développements accentués du capita- lisme. C'est ainsi que, des mesures de sécurité sociale et d'accès aux services sociaux ont été obtenues à la suite de luttes soutenues par les syndicats et différents mouvements sociaux. Ces gains sont maintenant partie intégrale de la société actuelle et il faut les concevoir comme des acquis. Néan- moins, la crise de croissance et de
35 Alvin Toffler "The American Future is Being Bumbled Away" The Futurist vol. 10, no 2 (April 1976) p. 97-102.
12
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

redistribution des ressources que nous traversons actuellement remet en cause toute cette structure économique un peu comme dans le problème de la somme zero "(zero-sum game)" dans la théorie des jeux. En effet, quand la croissance ralentit ou est bloquée à cause de forces extérieures, les forces économiques se centrent sur la redistribution d'un pro- duit national qui devient jusqu'à un certain point statique: dans cette per- spective, les gains de l'un sont directe- ment dépendants des pertes de l'autre. Ce problème est particulièrement séri- eux car il devient de plus en plus certain qu'il débouche sur une confrontation directe entre ce qui a été acquis en fait de bien-être et la croissance économique.
Structure occupationnelle Il y a aussi eu des transformations
majeures dans la structure occupation- nelle au cours des dernières années. Le temps ne permettant pas de faire une analyse complète des changements qui se produisent dans l'ensemble du Ca- nada36, je me contenterai d'indiquer comment s'est transformée la structure de la main d'oeuvre québécoise en me référant à certaines analyses faites par Dorval Brunelle37.
Dans la perspective de l'évolution capitaliste des rapports de production que nous venons d'identifier, la carac- téristique dominante dans les transfor- mations de la structure occupationnelle a été l'extension du salariat. Au Québec,
en 1951, 78.6% (1,136,000 travailleurs) de la main d'oeuvre était salariée38. Dans tous les groupes occupationnels, la proportion des salariés a considé- rablement augmenté. Même chez le groupe des administrateurs et direc- teurs, l'augmentation du nombre des salariés peut être interprétée en bonne partie par la disparition des petits entrepreneurs individuels qui accom- pagne le processus de concentration industrielle.
Une deuxième transformation d'im- portance dans la structure occupation- nelle du Québec est la diminution relative très importante des cols bleus qui sont passés de 57.8% de la main d'oeuvre en 1951 à 40.6% de la main d'oeuvre en 1971; au contraire, le groupe des cols blancs qui représen- taient 27% de la main d'oeuvre en 1951 en représentent 39.5% en 1971. Entre 195 1 et 197 1 , il y a une augmentation de 90% dans le nombre des cols blancs; il y a donc eu chez l'ensemble de travailleurs salariés une permutation du rapport cols blancs et cols bleus qui est fondée sur l'extension considérable des occupa- tions de bureau et de vente suite à la bureaucratisation des appareils privés et gouvernementaux. En même temps, les travailleurs intellectuels ont plus que doublé entre 1951 et 1975, passant de 96,000 à 235,000; ils représentent main- tenant 12.0% de la main d'oeuvre globale (comparativement à 6.6% en 1951) et deviennent ainsi une nouvelle force sociale pour la définition des rapports dans la société.
Toutefois, la situation dans la struc- ture occupationnelle des administra- teurs-directeurs méritent qu'on s'y attarde un peu plus parce qu'elle est une illustration de la concentration des
36On pourrait avantageusement consulter l'étude faite par Frank T. Denton et Sylvia Ostry Relevés chronologiques de la main d'oeuvre canadienne Ottawa, Bureau Fédéral de la Statistique, 1967; ou Sylvia Ostry Différences provinciales du taux d'activité. Ottawa, B.F.S., 1968. 37Dorval Brunelle - La structure occupationnelle de la main ďoeuvre québécoise, 1951 - 1971 Sociologie et sociétés vol. 7, no 2, Nov. 1975, pp. 67-88. 38Dorval Brunelle op. cit. p. 73-74.
13
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

pouvoirs qui semblent en voie de se produire dans notre société. Alors qu'entre 1951 et 1961, le nombre des personnes détenant des postes d'admi- nistrateurs-directeurs est passé de 108,000 à 138,000 environ illustrant une augmentation du nombre de chargés de pouvoir par rapport à leurs subordon- nés39, entre 1961 et 1971, ce nombre est descendu à 103,000 pour une diminu- tion de 35,000. On peut sans doute affirmer qu'à cause de changements dans les définitions du recensement de 1971 un certain nombre de directeurs et d'administrateurs se retrouvent inclus dans d'autres catégories occupation- nelles. "Mais, comme l'affirme Bru- nelle, l'élément d'explication le plus important est le processus de hiérarchi- sation des rapports de pouvoir qui fonde à la fois la concentration et la centralisation du pouvoir en même temps que la multiplication de petits empires bureaucratiques avec leurs pe- tits potentats"40. Il apparaît donc à partir de ces indications que la structure occupationnelle reflète la domination d'un nombre de plus en plus restreint de détenteurs du pouvoir sur la force du travail.
Les relations de travail Mais, - et cela nous apparaît parti-
culièrement important - en même temps que cette domination et cette concentration du pouvoir se manifes- taient, la force du travail maintenant constituée d'un plus grand nombre de cols blancs et de travailleurs intellec- tuels, s'organisait elle aussi. De son côté comme nous l'avons d'ailleurs indiqué précédemment, le syndicalisme a connu
39La même constatation est faite pour l'ensemble du Canada par Sylvia Ostry The Occupational Composition of the Canadian Labour Force. Ottawa, D.B.S. 1967, p. 1. 40Dorval Brunelle op. cit. p. 77.
14
un essor considérable au Québec comme dans d'autres sociétés occiden- tales, ce qui est quand même une indica- tion de l'organisation des travailleurs parallèlement à la montée de la con- centration industrielle, à la présence de la force des multinationales et à la montée des empires bureaucratiques d'Etat. Toutefois, ce syndicalisme qui a d'abord établi une forme de relation de travail basée surtout sur un syndi- calisme industriel, s'est transformé au Québec au cours des dernières années avec la montée du syndicalisme dans les secteurs publics et para-publics et la réunion des différents syndicats en un Front commun devant l'Etat em- ployeur. Le syndicalisme est mainte- nant devenue une force dont l'ampleur dépasse largement les seules bases des relations de travail dans notre société.
En conséquence, il m'apparaît im- portant de souligner que cette montée syndicale et la force imposante qu'elle représente, constitue un des éléments majeurs de la redéfinition de la fonction de l'Etat dans notre société. En effet, la conception même de l'Etat est remise en cause par la crise des relations de travail que nous traversons actuellement. L'Etat ou son gouvernement, quelqu'il soit, ne peut être longtemps à la fois législateur, responsable du respect de l'ordre, employeur et s'acquitter de toutes ces tâches en même temps et vraiment rendre justice à la force que constituent les travailleurs. Les change- ments qui se sont produits dans la situation des relations du travail au cours des dernières années et qui, à mon avis, ont déjà commencé à se transposer dans le secteur de l'industrie (la grève de United Aircraft et celle de l'amiante à Thetford Mines en paraissent des in- dices) m'amènent à croire que rapide- ment la force organisée du travail devra être non seulement reconnue mais elle
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

devra être directement impliquée dans le gouvernement de la société.
Aspects politiques des transformations La nouvelle dynamique des rapports
de force du point de vue économique, les changments de la structure occupa- tionnelle et le nouveau pouvoir des relations du travail que nous venons de constater contiennent plusieurs aspects politiques qui servent à alimenter la nécessité d'une nouvelle base de légiti- mation et de pouvoir à l'Etat. En effet, la plupart des sondages d'opinions sur le sujet réalisés au Québec, au Canada et aux Etats-Unis41 nous révèllent que de plus en plus de gens sont insatisfaits et remettent en cause le système politique actuel; plusieurs s'en désengagent et ne veulent plus agir parce qu'ils en contes- tent la légitimité. Dans cette perspec- tive, nous sommes dans une crise poli- tique majeure, car sans légitimation, le pouvoir devient mis à nu et affaibli parce qu'il doit être utilisé trop fré- quemment. En conséquence, les gens deviennent de plus en plus aliénés et à cause de cette faiblesse du leadership politique, il y a pratiquement impossibi- lité d'avoir un leadership qui a suffi- samment de force pour mobiliser les citoyens dans l'accomplissement de leurs différentes tâches sociales.
Une certaine quantité de volontariat, de légitimation et de consentement de la part de la majorité des citoyens - est essentiel42. Dans des sociétés comme la nôtre où le niveau d'information est assez grand et où il y a un certain éveil politique et une certaine implication des
citoyens, il est de moins en moins possible de faire appel à certains mythes plus ou moins sorciers pour soutenir des mesures plutôt arbitraires ou même tyraniques. Il devient de moins en moins possible de faire appel aux principes de la légitimation d'un ordre politique qui étaient ceux de ses fondateurs pour le maintenir; à moins que le pouvoir ne puise sa force dans une légitimation continuellement renouvelée, il s'épuise et ne peut plus être exercé. La crise politique des dernières années m'appa- raît être le reflet de cette situation.
Je pourrais compléter cette vue des transformations par beaucoup d'autres dont certaines sont de caractères plus microscopiques mais tout aussi réélles: transformations au niveau de la famille, transformations dans les relations maîtres-élèves, transformations dans le bénévolat, etc. Toutes ces transforma- tions pourraient être vues sous l'angle de leur impact sur la société, mais j'aimerais plutôt terminer en spécifiant et en élaborant sur les implications de ces transformations pour le service social.
Défis pour le service social Il n'est pas besoin de souligner très
longtemps que les transformations dans les valeurs et les structures de la société que nous avons présentées aux para- graphes précédents constituent de par leur nature même des défis majeurs auxquels le service comme action so- ciale intentionnelle ne saurait échapper. Le service social devra à plusieurs niveaux travailler à la redéfinition de ses propres schèmes de valeurs dans la perspective de cette orientation de rem- placement de la valeur équité par celle de l'égalité, en tenant compte aussi de l'importance plus grande accordée aux impulsions dans l'expression de soi et dans l'établissement de schèmes de
15
4lAmitai Etzioni "Crisis ..." op. cit. Sans avoir fait une analyse détaillée pour le Canada et le Québec, il nous paraît possible de postuler que les mêmes constatations s'appliquent à peu de chose près. 42Amitai Etzioni "Crisis . . ." op. cit., p. 77.
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

relations sociales qui donnent plus d'importance aux qualités de la per- sonne qu'à sa place dans l'organisation sociale. Face aux transformations des structures, il sera essentiel au service social de prendre parti dans le chemine- ment de la société future. Les transfor- mations des structures de la société et leur point de trajectoire sont assez d'éléments pour avancer que la crise sociétale que nous traversons actuelle- ment est une indication des transforma- tions majeures et globales qui sont en train de se produire dans la société. Nous pouvons faire l'hypothèse que ces transformations se situent dans la direc- tion d'une plus grande actualisation des personnes en même temps qu'une nou- velle importance accordée aux collecti- vités d'appartenance; il est possible que les valeurs humanistes et de communion entre les hommes, définies par la contre- culture constituent une serre-chaude de nouvelles valeurs personnelles et cultu- relles de l'avenir. Où se situera le service social face à ces défis? La réponse nous appartient.
Pour ma part, tout en reconnaissant l'importance des éléments mentionnés précédemment, je soutiens même que le défi majeur du service social déborde les frontières spécifiques des transforma- tions que nous avons décrites précé- demment et suppose une redéfinition de ses fondements mêmes. Il est essentiel que le service social, comme interven- tion intentionnelle dans la société, ait un schème conceptuel de référence qui serve de base à son action. Ce défi ne paraît pas avoir été jusqu'à maintenant relevé.
En effet, la plupart des schèmes de référence utilisés en service social pour expliquer le changement et servir de base à l'intervention ont été inspirés d'une explication fonctionnaliste de la
société. Comme l'a montré Smith43, la théorie du changement social tel qu'exposé par les principaux exposants du fonctionalisme se fonde sur une série de postulats concernant la société qui peuvent être remis en cause à la lumière de la réalité actuelle. Ce sont les suivants: Io Le fonctionalisme dont s'inspire le
service social considère la société d'une manière organiciste et holis- tique et s'intéresse aux processus intégratifs et désintégratifs de la société;
2° Il n'y a pas de différence entre les processus qui servent à maintenir la société et ceux qui servent à la changer. Le concept d'équilibre étant central et considéré au plus comme équilibre dynamique, le service social se situe beaucoup plus exclusivement parmi les agents de contrôle de cet équilibre;
3° Le fonctionalisme étudie les relations existant entre les parties et le tout en ce qui concerne leur interdépendance et leur contribution respective, la perspective historique comme un élément essentiel du changement est plutôt mise de côté;
4° Les différents concepts de dimen- sions développementales sont utilisées plutôt à des fins de classifi- cation des différentes unités sociales qu'à des fins d'explication; en con- séquence, le fonctionalisme ne fournit pas au service social les con- cepts nécessaires pour expliquer le développement;
5° Le changement est vue comme un phénomène endogène qui est le résultat de trois principaux processus qui n'apparaissent pas rendre compte
16
43 A.D. Smith - The Concept of Social Change A Critic of the Functionalistic Theory of Social Change, London, Routledge & Kegan Paul, 1973.
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

des transformations que nous avons analysées précédemment. Ces trois processus sont les suivants: (a) la dif- férentiation sociale est le principal moteur du changement; (b) l'intégra- tion ou la ré-intégration est la réponse normale aux effets négatifs de la différentiation; (c) l'adaptation aux sous-systèmes de la société se fait avec une efficacité accrue en raison d'un progrès qu'on assume constant. Une telle conception du changement
conduit à voir l'intervention du service social surtout dans la perspective de l'adaptation et de la ré-insertion des unités sociales mises de côté par le système, et de la ré-équilibration de sous-systèmes dans une situation de déséquilibre temporaire dans leur orienttion vers le progrès.
En raison de ces insatisfactions avec la théorie fonctionaliste comme cadre de référence pour l'intervention en service social, le schème d'explication marxiste s'est présenté avec beaucoup d'attrait comme base pour situer l'intervention du service social44. Ce shème est d'autant plus attrayant que Marx est probablement celui qui a le mieux expliqué l'évolution de la société capitaliste et en particulier, plusieurs des aboutissements que nous retrouvons dans notre société. C'est ainsi que les différentes transformations dans les structures sociales que nous avons présentées précédemment apparaissent plus facilement compréhensibles grâce à un schèma
d'explication marxiste: c'est là le cas des concentrations de production, de leur contrôle par des minorités, et la création de classes sociales de plus en plus larges comme résultante du capitalisme et de sa forme d'organisation de la production. Toutes ces constatations nous apparaissent vraies et présentes dans notre société: en ce sens, je pense que Marx a très bien posé le problème de l'évolution du capitalisme et de la société qui en résulte. Il a été capable de conceptualiser les tendances structurelles de la société capitaliste: notre société est l'aboutissement des prédictions de Marx sur l'évolution de la production en société capitaliste.
Mais si Marx a bien énoncé les conditions de structuration de la production de la société capitaliste, je pense qu'il n'a pas réussi à formuler les conditions selon lesquelles le changement dans la société- peut effectivement prendre place. Le changement dans la société n'est pas une conséquence naturelle de l'évolution de la production. D'ailleurs, Lenin tout en adhérant au marxisme a trouvé la nécessité de faire une distinction entre les tendances structurelles de l'organisation de la société et la capacité des groupes qui la composent à s'organiser effectivement. Mais c'est surtout Weber45 qui a élaboré cette distinction qui a montré qu'il n'y avait pas liaison entre l'existence de classes sociales et leur action organisée en vue du changement. Plus précisément, d'autres sociologues46 et en particulier
44Une illustration de cette orientation au Québec est la publication suivante: CAP St-Jacques et Maisonneuve - Dossier: service social, Montréal, 1972. Un autre exemple de cette tendance est l'étude EZOP-Québec: cf. en particulier Gérald Doré et als L'idéologie du réaménagement urbain à Québec, vol. 4, Québec, Conseil des Oeuvres et de bien-être de Québec, 1972.
45Max Weber, Economy and Society Tr. and ed. by Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminster Press, 1968. 46E.A. Tiryakian, "Neither Marx nor Durkheinn . . .perhaps Weber". Am. J. Social 81: (June 75) p. 1-33; Reinhard Bendix "Inequality and Social Structure: A Comparison of Marx and Weber". Amer. Social Review 39; (April 74) p. 149-161.
17
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Raymond Aron ont repris des distinctions similaires47.
Les sociétés capitalistes occidentales comme la nôtre, malgré le fait qu'elles réalisent en bonne partie les prévisions de Marx quant à l'organisation de la production, ne nous apparaissent pas démontrer la présence et l'organisation d'un prolétariat unifié comme base de la transformation de la société. Il apparaît donc qu'un schème conservateur inspiré d'un marxisme orthodoxe utilisé à la base d'un schème d'action, tout en décrivant adéquatement la société actuelle ne peut servir de base à la réalisation du changement et ne peut être utilisé comme schème de référence d'intervention. Un tel schème aboutit, comme l'a constaté Revel dans son volume "Ni Marx ... Ni Jésus "48 à une attitude par laquelle l'important semble moins d'agir face à des situations intolérables dans la société que de prouver d'une manière triomphante que notre société jour après jour s'en va vers la réalisation des prédictions de Marx. Une telle attitude est une erreur et contribue à renforcer chez plusieurs un sentiment d'aliénation qui empêche d'arriver aux changements essentiels nécessaires dans les rapports de force entre les groupes sociaux.
Il est donc clair que ni un schème inspiré du fonctionalisme, ni un schème inspiré du marxisme ne peuvent être satisfaisants comme schème de référence à l'intervention du service social. Le défi majeur du service social est donc de développer et d'adhérer à un schème de référence qui puisse soutenir son intervention. Nous avons avantage
à nous inspirer des efforts tentés en ce sens par certains auteurs comme Hostelet49, Kortarbinsky50, Etzioni51. Ces efforts de conceptualisation, comme Dahlström les a exposés plus récemment52 essaient de définir le changement selon une approche activiste et "humaniste". Les principaux aspects au départ de cette approche sont les suivants: (Io) Elle implique une attitude scept-
ique à l'égard d'un parallélisme métaphorique avec les sciences naturelles ou le développement historique conçue comme une maturation organique ou une extension de l'évolution bio- logique53;
(2°) Elle se base sur une conception de l'histoire comme un processus dialectique où l'homme crée l'histoire et l'histoire crée l'homme. Il y a aussi une relation dialectique entre les hommes et la société dans laquelle les hommes créent la société et la société crée les hommes. Une telle conception exclut une conception naturaliste de l'homme comme déterminé par la nature ou par son histoire: elle
47Raymond Aron - Les étapes de la pensée sociologique { Paris, Gallimard, 1967) p. 184-193. 48 Jean-François Revel, Ni Marx, ni Jésus , (Paris, 1970).
49Georges Hostelet. L'investigation scientifique des faits d'activité humaine avec application aux sciences et aux techniques sociales 2 vol. Paris, Marcel Rivière et Cie 1960. 50Tadeusz Kotarbinski, Praxiology An Introduction to the Sciences of Efficient Action. New York: Pergamon Press, 1965. 5,Amitai Etzioni The Active Society. New York: The Free Press, 1968. 52B. Dahlstrom "Developmental Direction and Welfare Goals: Some Comments on Functionalistic Evolutionary Theory about Highly Developed Society " Acta Sociologica, vol. 17, 1 (1973), p. 3-21. 53A Comparer au point de vue de R.A. Nisbet. Social Change and History. Aspects of Western Thought of Development. New York, 1969.
18
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

reconnaît plutôt la capacité de dépasser les conditions d'existence telles que les rôles et les normes et les restrictions matérielles54;
(3°) Elle met l'insistance sur la fonc- tion de la critique dans l'analyse scientifique laissant de côté les idées de neutralité de valuer;
(4°) Elle inclut la possibilité d'un guidage sociétal et de stratégies pour le développement. Ceci implique qu'on postule que l'homme est un être conscient
capable d'auto-réflexion sur ses actes et qui a des capacités de se transformer lui-même à l'aide des informations et des connaissances qui lui sont accessibles et qu'il développe aussi la capacité de transformer son environnement55.
C'est là un défi de taille qui nous est lancé par les nouvelles valeurs qui se font jour dans la société et par les transformations dans les structures: elles nous montrent l'acuité de certaines situations face auxquelles le service social doit avoir les bases pour agir.
54A comparer avec Jean-Paul Sartre, "Question de méthodes" dans Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960.
55A. Etzioni. The Active . . .op cit.; W. Bread. The Self Guiding Society. New York: The Free Press; F.L. Bates, "Alternative Models for the Future of Society: from the Invisible to the Visible Hand." Soc. Forces 53 (S. 74) p. 1-11.
19
This content downloaded from 62.122.73.250 on Mon, 16 Jun 2014 04:07:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions