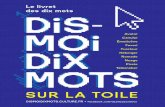toile, 70 x 57 cm) -...
-
Upload
truongthien -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of toile, 70 x 57 cm) -...
© Bruno Le Bail
1
Reproductions n°17 et n°18 (Rubens, Le Traité d’Angoulême, huile sur toile, 394 x 295 cm) et (Cézanne, Nature morte avec l’Amour en plâtre, 1894, huile sur
toile, 70 x 57 cm)
La puissance de la diagonale, il faut regarder les diagonales chez Cézanne, c’est une architecture sur laquelle repose les plans. Le basculement frontal est diagonal. Nous avons dans les deux toiles une composition similaire bien qu’inversée. La naissance de la diagonale chez Rubens part effectivement en bas à droite et traverse le tableau avec un dynamisme supersonique. Ce bras masculin qui se prolonge par un deuxième membre supérieur féminin, est d’une beauté exceptionnelle. C’est un véritable coup de poing qui nous emmène au-delà de la toile. Chez Cézanne la naissance de la diagonale part en bas à gauche et traverse, elle aussi la toile avec force. Suivons ces deux diagonales, elles sont toutes les deux partagées par un rapport foncé et clair. Le clair en dessous et le foncé au-dessus. L’espace est délimité en deux masses distinctes. A mi-parcours des diagonales, nous avons un pilier de soutien: La reine en blanc chez Rubens et l’Amour en plâtre chez Cézanne. Quelques centimètres plus loin, une bifurcation vers une élévation, la colonne pour Rubens et la toile posée sur la table qui fait office de colonne pour Cézanne. Ce qui induit un effet courbe de forte tension sur la diagonale. L’assise est importante dans les deux œuvres, observons la surface où repose l’amour en plâtre et le sol chez Rubens. Rubens utilise les marches pour amener la diagonale tandis que Cézanne préfère le basculement frontal.
Rubens va vers l ’é lévation, Cézanne tend vers l ’effondrement pour arr iver au même résultat : Le chef d’œuvre.
© Bruno Le Bail
2
La précision : « Faire un tableau, c’est composer » disait Cézanne Poussin a été déterminant dans les recherches de Cézanne. Il voulait faire du Poussin sur nature. Qu’entendait-il par-là ? Poussin avait une vision quasi mathématique de la peinture. Il était obsédé par le ton juste, le rapport entre la forme et le fond. C’était un peintre d’atelier, pour mieux maîtriser son sujet il fabriquait des figurines en cire qu’il habillait pour éviter tout mouvement du modèle qu’il éclairait à la bougie, encore une fois pour se concentrer uniquement sur la mise en place de ses rapports de tons. Poussin distinguait deux sortes de regards. Celui naturel, qui n’a d’autre but que de nous faire voir et celui qu’il nomme le prospect, qui est la connaissance de la chose observée. Le prospect dépend de trois choses, savoir de l’œil, du rayon visuel et de la distance de l’œil à l’objet. On retrouve la même obsession chez Cézanne. L’inverse, en ce qui concerne le sujet, mais la même recherche dans la mise en forme. Cézanne va se confronter aux changements incessants de la lumière sans tomber dans le piège de l’impression.
I l va peindre cette distance entre l ’œil et le motif .
Il existe chez eux la même rigueur dans l’observation et la construction.
Quand on observe ces deux œuvres que remarque-t-on ? Tout d’abord, il y a ce rapport à l’horizontalité. Il faut comprendre les vides chez Poussin, c’est dans cette rythmique que Cézanne va puiser. Imaginons maintenant que l’œil va observer uniquement les rapports au vide. Chez Poussin, ce sont des espaces dans les espaces qui découpent l’œuvre et donne une ponctuation, une rupture, un souffle. Il y a un mouvement qui suit dans un premier temps l’horizontalité (de la gauche vers la droite) puis, qui va s’éclater en triangle en fin de parcours.
© Bruno Le Bail
3
Reproductions n°19 (Poussin, Bacchanale devant un terme, huile sur toile, 104 x 142.5 cm), Reproduction N° 20
Cézanne, Paysage provençal près les Lauves, 1904 06, huile sur toile, 65 x 80 cm).
Chez Cézanne, on pénètre aussi par la gauche, les vides (blanc du support) suivent également l’horizontalité avant de dévier en triangle. Nous avons en commun une diagonale partant en haut à gauche et finissant en bas à droite. Cézanne construit autour de ces vides, le dernier plan posé remet en cause l’ensemble de l’œuvre, véritable casse tête, mais c’est le moyen pour aboutir à cette logique. La Vérité est dans ce présent et non dans la mémoire. Cézanne utilise l’accident, comme un jazzman utilise l’improvisation. Poussin est symphonique, c’est à dire qu’il fige le sujet pour mieux cerner les oppositions d’espace, il fixe le temps. Nous avons chez les deux maîtres la même exigence des tonalités, les couleurs froides en opposition aux couleurs chaudes. Jeu subtil entre les ocres et les bleus. Ce qui est très curieux, malgré leur opposition quant à aborder le sujet c’est ce sentiment que l’on éprouve face à ces deux toiles,
elles semblent être dans un non-lieu, hors du temps
Merleau-Ponty disait ceci : «I l faut réapprendre à voir » . Cézanne a vu, il a vu plus loin que ses contemporains. Il était conscient, lucide dans son isolement :
© Bruno Le Bail
4
«Je suis le primitif d’un art nouveau ».
Cézanne voulait étonner Paris avec une pomme, cette pomme est devenue le symbole de la modernité. Le voir est, le non voir n’est pas. Cet électron libre à été subversif, parce qu‘il a su utiliser son propre déplacement dans le temps, véritable révolution picturale: L’ESPACE-TEMPS. La peinture est optique ne l’oublions jamais. « Le fini fait l’admiration des imbéciles », disait-il. Cela mérite réflexion, surtout aujourd’hui où nous sommes saturé d’images où le fini n’a jamais été aussi défini. Je vous laisse maintenant dans le silence, sans mot, face à cette cathédrale de modernité, ce monstre de peinture :
Les Grandes Baigneuses
Reproduction n°21 (Les Grandes Baigneuses, 1906, huile sur toile)
© Bruno Le Bail
5
Principaux ouvrages de référence : Conversations avec Cézanne, Macula, 1978. Cézanne, Correspondance, Grasset, 1978. L’œil et l’Esprit, Merleau-Ponty, Folio essais, 1993. Ecrits et propos sur l’art, Henri Matisse, Collection Savoir, 1972. L’intermédiaire de Philippe Sollers, Editions du Seuil, 1963. Table des i l lustrations : Reproduction n°1 (Cézanne, Portrait de l’artiste vers 1875, huile sur toile, 64 x 53 cm, Musée d’Orsay, Paris). Reproductions n°2 et n°3 (La mort de Sadarnapale de Delacroix, huile sur toile, 392 x 496 cm, Musée du Louvre, Paris) et (La Grande Odalisque de Ingres, huile sur toile, 91 x 162 cm, Musée du Louvre, Paris). Reproduction n° 4 (Cézanne, Nature morte : pommes et biscuits, 1879-1882, huile sur toile, 46 x 55 cm, Musée d’Orsay, Paris). Reproduction n° 6 (Cézanne, La Montagne Sainte Victoire, 1904-1906, huile sur toile, 63.5 x 83 cm, Kunsthaus, Zurich). Reproduction n° 6a Pollock Reproduction n° 6b Monet Reproduction n° 6c Sherrie Levine Reproduction n° 7 (De Staël, Agrigente, huile sur toile, 114 x 146 cm, Musée de Grenoble, Grenoble). Reproduction n° 8 (Matisse, La piscine 1952, gouache découpée sur papier et montée sur toile de jute, en deux parties : 230.1 x 847.8 cm et 230.1 x 796.1 cm, The MOMA, New York). Reproduction n° 9 (Picasso, Métamorphose, 1928, plâtre, 22.5 cm, Musée Picasso, Paris). Reproduction n°10 (Giacometti, Grande Femme II, 1960, bronze, 277 x 32 x 58 cm, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence). Reproduction n° 11 (Cézanne, Le vase bleu, 1883-1887, huile sur toile, 61 x 50 cm, Musée d’Orsay, Paris). Reproduction n° 12 (Cézanne, Les joueurs de cartes, 1890-1906, huile sur toile, 47.5 x 57 cm, Musée d’Orsay, Paris). Reproduction n°13 (Cézanne, Femme à la cafetière, 1890-1894, huile sur toile, 130 x 97 cm, Musée d’Orsay, Paris ). Reproduction n°14
© Bruno Le Bail
6
(Matisse, intérieur rouge, nature morte sur table bleue, huile sur toile, 1947, 116 x 89 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf) p. 455 Reproduction n° 15 (Cézanne, Nature morte, pommes sur un dressoir, 1902-1906, aquarelle, 48.6 x 62 cm, Dallas Museum of Fine Arts.). Reproduction n° 16 (Picasso, tête d’homme, 1914, collection privée). Reproduction n°17 (Rubens, Le Traité d’Angoulême, huile sur toile, 394 x 295 cm, Musée du Louvre, Paris). Reproduction n°18 (Cézanne, Nature morte avec l’Amour en plâtre, 1894, huile sur toile, 70 x 57 cm, Courtauld Institute Galleries, Londres). Reproduction n°19 (Poussin, Bacchanale devant un terme, huile sur toile, 104 x 142,5 cm, Musée du Louvre, Paris). Reproduction n°20 (Cézanne, Paysage provençal près les Lauves, 1904-1906, huile sur toile, 65 x 80 cm, The Philips Collection, Washington). Reproduction n°21 (Cézanne, Les Grandes Baigneuses-1906, huile sur toile, -1906, huile sur toile, 208.3 x 251.5cm. The Barnes Fondation, Merion ).