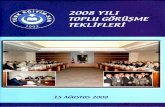Tes Spec 4 Slsbtes
-
Upload
miguel-mariano -
Category
Documents
-
view
9 -
download
1
Transcript of Tes Spec 4 Slsbtes

1
ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)
1. L'HOMME DANS SON TEMPS
CHRONOLOGIE POLITIQUE 1792-1795 : Convention. 1795-1799 : Directoire. 1799-1804 : Consulat. 1804-1814 : Empire. 1814-1830 : Seconde restauration des Bourbons avec Louis XVIII (1814-1824) et Charles X (1824-1830).
1830-1848 : Monarchie de Juillet (Louis-Philippe 1er). 1848-1852 : IIème République (Louis Napoléon Bonaparte). 1852-1870 : Second Empire (Louis Napoléon Bonaparte devient Napoléon III). 1870-1940 : IIIème République.
Alexis de Tocqueville ressemblerait à un petit personnage fluet se frottant les yeux pour regarder un champ de ruines, celles de l'Ancien Régime, puis se retournant et considérant le bâtiment tout neuf de la démocratie, en construction, il chercherait à distinguer l'architecture derrière les échafaudages provisoires. Né en 1805, il est issu d'une très vieille famille aristocratique de Normandie, qui faisait partie de l'élite cultivée et du gouvernement : son arrière grand-père, Malesherbes, avait été ministre de Louis XVI dont il accepta, par fidélité, d'être l'avocat devant la Convention, ce qui lui valut d'être guillotiné. Les parents d'Alexis se refusèrent à émigrer, ils furent emprisonnés sous la Terreur et sauvés de l'échafaud par le 9 Thermidor en 1793-94 (chute de Robespierre). Sa mère en resta très atteinte. Sous la Restauration, son père fut préfet, successivement de plusieurs départements, avant de devenir pair de France. Cette tradition légitimiste fut brisée quand Alexis vit Charles X et toute sa famille fuir honteusement en 1830. Selon ses propres mots, il avait « ressenti jusqu'à la fin pour Charles X un reste d'affection héréditaire, mais ce roi tombait pour avoir violé des droits qui m'étaient chers ». Et encore : les Bourbons « se sont conduits comme des lâches et ne méritent point la millième partie du sang qui vient de couler pour leur querelle ». Après des études de droit, pendant lesquelles il suivit les cours d'histoire de Guizot, il fut nommé juge auditeur au tribunal de Versailles en 1827. Dans ce poste sans rémunération, Alexis s'initia à la procédure et fit un apprentissage des réalités de la vie sociale. En 1830, il prêta serment à Louis-Philippe, à contrecoeur; puis il demanda un congé et une mission du ministère de l'Intérieur pour aller aux États-Unis étudier le système pénitentiaire, mission officielle mais gratuite, elle aussi. Les prisons étaient en effet un des grands problèmes de société de l'époque. Mais ce n'était pour lui et pour son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, qu'un prétexte ou plus précisément «un passeport» : tous deux voulaient découvrir l'Amérique. Beaumont s'intéressait aux États-Unis, tandis que Tocqueville les prenaient comme le meilleur exemple disponible de démocratie : « J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique; j'y ai cherché une image de la démocratie elle-même. » En vérité, ce qu'ils cherchent à s'expliquer, c'est eux-mêmes. Ils veulent comprendre qu'elle peut être la place et le rôle d'un jeune noble dans la société démocratique. Ils resteront en Amérique jusqu'au 20 février 1832, soit près de dix mois. Ils firent des séjours prolongés à New York (société de négociants et de banquiers), à Boston (société « aristocratique »), à Philadelphie (capitale intellectuelle), à Washington (institutions fédérales), mais aussi au Canada (Montréal et Québec), à Pittsburgh (grande industrie métallurgique naissante à laquelle ils ne firent pas attention), à Memphis. Là, ils virent une tribu d'indiens Chactas qu'on chassait de leur territoire pour les parquer dans une réserve : « Il y avait dans l'ensemble de ce spectacle, un air de ruine et de destruction, quelque chose qui sentait un adieu final et sans retour : on ne pouvait y assister sans en avoir le coeur serré (...). C'est un singulier hasard que celui qui nous a fait arriver à Memphis pour assister à l'expulsion, on peut dire à la dissolution d'un des derniers restes de l'une des plus célèbres et plus anciennes nations américaines » (lettre à sa mère, 25 décembre 1831). De là, ils descendirent en bateau sur le Mississippi jusqu'à la Nouvelle Orléans où ils furent saisis par le contraste entre les Français qu'ils y rencontraient et les Français du Canada visités quelques mois plus tôt : ici des petits blancs vivaient misérablement en faisant cultiver leur lopin par des esclaves noirs, occupant leur temps à chasser et à fumer avec la mentalité de pauvres petits hobereaux français ; là-haut, des paysans entreprenants, durs à la tâche, luttant contre une nature rebelle. Les mêmes Français transformés par deux climats différents et deux sociétés contrastées. En remontant de la Nouvelle Orléans, ils eurent l'occasion de fréquenter les gentilshommes du Sud, d'observer l'esclavage et de déplorer la condition des noirs et des métis. De retour en Europe, nos deux jeunes voyageurs s'attaquent chacun à leur oeuvre Beaumont fait l'essentiel du travail pour produire leur rapport de mission : Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France (1833) et un roman Marie ou l'esclavage aux États-Unis. Tocqueville s'attaque à son grand oeuvre De la démocratie en Amérique, publié en deux volumes en 1835, puis en 1840 avec un énorme succès qui lui valut d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques à trente-trois ans et enfin à l'Académie française en 1842. Cette extrême précocité confond le lecteur. La démocratie qui a tous les traits d'une oeuvre de maturité a été écrite par un jeune homme de trente ans ! C'est donc un jeune prodige qui est accueilli dans les salons du Faubourg Saint-Germain où il rencontre les célébrités de sa génération : Vigny, Hugo, Mérimée, Michelet, Musset, etc., société brillante où sa timidité le maintient sur la réserve. En 1836, il se décide à épouser une Anglaise, Mary Mottley, qu'il connaît depuis 1828, contre l'avis de sa famille et des ses amis, qui lui conseillent une alliance plus brillante; mais les États-Unis l'ont convaincu qu'un mariage est une affaire de coeur et non de convenance. Il continue à voyager pour compléter ses observations et ses réflexions comparatives. Dès 20 ans, il avait été en Italie et en Sicile avec son frère, il y revint passer un hiver à Sorrente, en 1850. Il traversa plusieurs fois la Manche pour des séjours plus ou moins longs en Angleterre et en Irlande : en 1857 sa notoriété lui valut d'être ramené à Cherbourg par une unité de la Marine royale britannique. En Suisse, il étudia la vie politique des cantons, et, grand marcheur, fit de longues randonnées pédestres avec son cousin Louis de Kergorlay. L'Allemagne l'attira par deux fois. Enfin, pour faire rapport à la Chambre des députés, il fit deux séjours en Algérie. Les voyages d'étude étaient à la mode. En 1839, Tocqueville est élu député de Valognes, circonscription où se trouve son château et son domaine, et en 1849 président du conseil général de la Manche. Pendant dix ans il partagea son temps entre le Parlement et sa circonscription où il mena campagne trois fois, tout en continuant à travailler à ses manuscrits. Il écrit à un ami: «Je me suis remis sérieusement à mon livre et je bâtis une magnifique étable à cochons. Laquelle de ces deux oeuvres durera plus que l'autre? Hélas je n'en sais rien, en vérité. Les murs que je donne à mes cochons sont très solides. » À Paris il est un député actif. Il fit plusieurs rapports sur la question d'Orient, sur la réforme des prisons, sur l'abolition de l'esclavage et sur l'Algérie pour laquelle il cherchait une solution d'avenir en s'inspirant de ses réflexions sur la colonisation américaine.
CONCEPTS A CONNAITRE ET A SAVOIR UTILISER
Liberté – égalité � Voir le 2.3 et le 3.2. du polycopié. Individualisme � Voir le 2.2 et le thème 3. Despotisme démocratique � Voir le 2.2, le 2.3 et le 2.4 du polycopié. Tyrannie de la majorité � Voir le 2.3 du polycopié.
ACTUALITE ET PROLONGEMENTS
Représentation politique � Voir le IV du polycopié, notamment Crozier et Grémion. Société démocratique et uniformisation des comportements � Pas détaillé (parallèle avec le 2.3). Voir le IV avec Bourdieu et le thème 3. Opinion publique � Pas détaillé (parallèle avec le 2.4).

2
En janvier 1848, il prononça un grand discours prémonitoire où il dénonce la décrépitude du régime et s'inquiète du « vent de révolution » qui agite le pays. Il vit intensément la révolution de février et les journées de juin. Ses Souvenirs sur cette période sont un de ses meilleurs écrits; il s'y livre avec passion à une réflexion sur la France et sur la politique. Réélu triomphalement par le suffrage universel, il revient à l'Assemblée constituante où il participe à la rédaction de la Constitution. En 1849, il sera ministre des Affaires étrangères dans l'éphémère gouvernement Barrot. Il prend Gobineau comme directeur de cabinet, ce qui n'empêchera pas leur désaccord sur le problème des races. Après le coup d'Etat de Louis-Napoléon, il est emprisonné et il se proclame un farouche adversaire de l'Empire naissant : « Ce qui vient de se passer à Paris est abominable (...) du moment où l'on a vu apparaître le socialisme, on a dû prévoir le règne du sabre. L'un engendrait l'autre. La nation en ce moment est folle de peur des socialistes et du désir passionné de retrouver le bien-être; elle est incapable et, je le dis bien à regret, indigne d'être libre. » On voit que l'homme d'étude était un homme de passion politique et que les convictions qui conduisirent le jeune homme aux États-Unis étaient toujours brûlantes chez l'homme mûr chargé d'expérience, de renommée et d'honneurs. Il consacra les cinq dernières années de sa vie aux recherches qui aboutirent à son second grand oeuvre, L'Ancien Régime et la Révolution. Depuis longtemps il voulait comprendre l'enchaînement des événements révolutionnaires, et dans ce but il voulait commencer par comprendre le gouvernement et l'administration monarchiques, en même temps que la société d'Ancien Régime. Pour cela il s'installa à Tours où il travailla dans les archives à interroger les documents, comme il avait interrogé ses informateurs aux États-Unis. Il eut beaucoup de mal à faire mûrir son analyse. Il publia en 1856 la première partie et mourut en 1859 en laissant l'ouvrage inachevé.
BILBIOGRAPHIE
Les principales oeuvres de Tocqueville ont été publiées aux éditions Gallimard à la Bibliothèque de la Pléiade et aux éditions R. Laffont en collection Bouquin. De la démocratie en Amérique, 1835 et 1840 L’Ancien Régime et la Révolution, 1856 (première partie).
II. L'OEUVRE On peut lire l’oeuvre de Tocqueville de plusieurs manières. La première est d'y voir une description sociologique de la société américaine et de la société française d'Ancien Régime : les classes, les rapports sociaux, les institutions locales sont bien décrites. Cette version de Tocqueville a fait son succès auprès des Américains et demeure la lecture obligée de tout voyageur qui part outre-Atlantique, comme de tout étudiant en histoire du XVIIIe siècle. La deuxième lecture est celle de la science politique: Tocqueville, disciple de Montesquieu, analyse le fonctionnement de la monarchie française et de la démocratie américaine, les rouages institutionnels et administratifs, l'esprit public, les moeurs des citoyens, le triomphe de la liberté et les menaces qui pèsent sur elle. Nous ne prendrons ici aucun de ces deux points de vue, mais seulement celui du sociologue généraliste qui cherche des schémas d'analyse transposables dans les sociétés contemporaines. Tocqueville est animé par une passion : la liberté. Il rêve d'une société où la liberté serait donnée à tout citoyen. Par ailleurs, il constate la progression de l'égalité des conditions. Toute son oeuvre est donc une méditation dominée par ces deux mots. Comment faire triompher la liberté et comment assurer la cohésion d'une société fondée sur l'égalité? L'égalité ne se conçoit pas sans la liberté car l'homme ne saurait être libre s'il est soumis à un autre homme. En cela Tocqueville est un fidèle héritier de la philosophie politique du XVIIIe siècle. Il y ajoute une dimension dynamique qui est essentielle: « Les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté... mais ils ont pour l'égalité une passion insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. » L'étude de l'égalité ne peut évidemment être menée sans référence à l'inégalité. Chez Tocqueville, on pourrait presque toujours remplacer aristocratie et démocratie par hiérarchie et égalité puisqu'il analyse les progrès de l'égalité après la disparition des ordres féodaux. En cela, il est une référence fondamentale et unique parmi les sociologues. Les classes et la stratification ne peuvent se comprendre que situées dans une société d'idéologie égalitaire alors que l'Ancien Régime était une société inégalitaire, comme les castes de l'Inde, et non simplement hiérarchisée. Ainsi s'explique que Tocqueville ait envisagé d'écrire un livre sur l'Inde, qu'il ait lu les livres disponibles à son époque et qu'il ait réuni des matériaux abondants mais sans jamais arriver à un début de rédaction. L'Inde lui fournissait en outre un sujet de réflexion sur les problèmes de la colonisation. Louis Dumont, le grand indianiste, dans son livre Homo hierarchicus se réfère à Tocqueville: « Si l'égalité est conçue comme donnée dans la nature de l'homme et niée seulement par une mauvaise société, comme il n'y a plus en droit différentes conditions ou états, différentes sortes d'hommes, ils sont très semblables et même identiques, en même temps qu'égaux. ( ... ) là où règne l'inégalité, il y a autant d'humanités distinctes que de catégories sociales » (p. 30). Plus loin, il insiste : « Chez les sociologues et les philosophes, si le mot "hiérarchie" est prononcé, il semble que ce soit à contrecoeur et du bout des lèvres, comme correspondant aux inégalités inévitables ou résiduelles ( ... ). Tocqueville, par contraste, a certainement le sentiment d'autre chose, mais la société aristocratique dont il conservait le souvenir était insuffisante pour lui permettre d'éclaircir ce sentiment» (p. 33). Telles étaient les questions qu'il avait en tête en s'embarquant pour les États-Unis. Moins clairement formulée au départ, une troisième question se déduit des deux premières, question essentielle pour tout sociologue : qu'est-ce qui fait qu'une société tient ensemble? Quelle est la nature du ciment, du lien qui rassemble les

3
individus? Les philosophes des Lumières, de Hobbes à Rousseau, inventèrent un contrat social mythique qui aurait mis fin à l'état de nature, ou à la guerre de tous contre tous. Mais pour le sociologue, la question n'est pas philosophique, elle relève de l'analyse de la société et de son architecture. Dans l'Ancien Régime, la puissance du souverain, la domination de l'aristocratie et le magistère de la religion suffisaient à répondre à la question. Qu'ils le veuillent ou non, les sujets du roi, les manants des seigneurs et les ouailles du curé devaient se soumettre, de gré ou de force. La Révolution ayant fait sauter ces carcans, comment la démocratie pourrait-elle être capable de tenir les rênes assez fermement pour que le cheval ne s'emballe pas à nouveau, comme en 1789?
2.1. LA RELIGION COMME CIMENT SOCIAL. La réponse la plus facile que s'est donnée Tocqueville est la religion. Lui-même était agnostique1. Élevé par une mère très rigoriste qui s'était mal remise de son emprisonnement sous la Terreur, à seize ans il avait vécu une crise profonde et avait rejeté toute croyance. Il n'en pensait pas moins que la religion était nécessaire pour tenir le peuple en repos. D'accord en cela avec la plupart des ses contemporains qui cherchaient à rechristianiser la France et avec Marx pour qui la religion était l'opium du peuple. « Après ce carnage de toutes les autorités dans le monde social (...) il faudra des soldats et des prisons si on abolit les croyances. » En deux mots : le gendarme et le curé. On est surpris qu'un esprit aussi pénétrant ait pu écrire une telle banalité, qui traînait dans tous les journaux et dans les conversations de salon de l'époque. « Que faire d'un peuple maître de lui-même, s'il n'est pas soumis à Dieu? » Telle était la question. « J'avais vu parmi nous l'esprit de religion et l'esprit de liberté marcher presque toujours en sens contraire. Ici je les retrouvais intimement unis l'un à l'autre : ils régnaient ensemble sur le même sol. » Aux États-Unis, il découvrit des institutions religieuses locales, indépendantes de l'État. La religion pouvait être le fait du peuple et non de ses autorités, ni de la hiérarchie, ni d'un pape. Par conséquent, elle était compatible avec la démocratie. «On ne peut pas dire qu'aux États-Unis la religion exerce une influence sur les lois ni sur le détail des opinions politiques, mais elle dirige les moeurs, et c'est en réglant la famille qu'elle travaille à régler l'Etat. » La religion doit être considérée comme la première des institutions politiques des Américains qui confondent christianisme et liberté, confusion étrange pour qui avait été élevé dans le catholicisme après la Révolution. La séparation complète du politique et du religieux, de l'Église et de l'État, était l'explication de cette surprenante contradiction pour un Européen habitué au principe que la religion du Prince doit être celle de ses sujets. Séparation essentielle dans un pays où la diversité des confessions est à l'origine même de la constitution du pays, puisque ce sont des membres de sectes en rébellion contre le pouvoir qui sont venus se réfugier en Amérique pour y vivre leur foi en toute indépendance. Tocqueville remarque par ailleurs une différence essentielle entre le catholicisme européen et les confessions chrétiennes américaines, y compris le catholicisme : « Les prêtres américains n'essaient point d'attirer et de fixer tous les regards de l'homme vers la vie future; ils abandonnent volontiers une partie de leur coeur aux soins du présent; ils semblent considérer les biens du monde comme des objets importants quoique secondaires (...) tout en montrant sans cesse aux fidèles l'autre monde comme le grand objet de ses craintes et de ses espérances, ils ne lui défendent pas de rechercher honnêtement le bien-être dans celui-ci. » De cette manière, le christianisme est donc en parfait accord avec le souci majeur de réussite économique qui motive les Américains. Nous voici proches de Max Weber. Religion, démocratie et activité économique vont de pair aux États-Unis mieux qu'en Europe, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui encore les Américains soient en grande majorité très dévots alors qu'en Europe la pratique religieuse s'est restreinte à une faible minorité, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Aussi Tocqueville montre, avant tout le monde, qu'il n'y a pas de conflit irrémédiable entre modernité et religion puisque ce qui s'observe en Europe ne s'observe pas aux États-Unis. Le rapport entre l'État, l'économie et les institutions religieuses peut seul expliquer cet extraordinaire contraste, qu'il a mis en lumière et qui demeure aujourd'hui encore, sans doute le contraste le plus fort entre les deux bords de l'Atlantique.
2.2. QUELLE CLASSE DOMINANTE ? Par quoi remplacer l’aristocratie, qui disparaît, pour gouverner la société civile? Toute sa méditation sociale est une longue réflexion sur la noblesse, une comparaison entre son rôle en France et en Angleterre et son absence aux États-Unis. En effet, il affirme : «Je parle des classes; elles seules doivent occuper l'histoire », phrase inattendue que tout lecteur attribuerait à Marx, or elle est de Tocqueville! En France, il distingue la noblesse, la bourgeoisie et la paysannerie, mais il a quelque mal à percevoir les ouvriers, tant l'industrie lui est étrangère. Elle était encore dans l'enfance en France et il est passé à côté d'elle aux États-Unis, sans s'y arrêter. Dans une longue comparaison entre les aristocraties anglaise et française au XVIIIe siècle, il voit que la française s'est laissée déposséder par la monarchie de tous ses pouvoirs pour conserver ses honneurs et ses privilèges - tandis que l'anglaise a su prendre la pleine propriété de ses terres, moderniser son agriculture, conserver le pouvoir local et enfin s'investir dans l'industrie. Les aristocrates anglais surent 1 Personne qui croit que l’esprit humain est inaccessible. On ne peut pas comprendre l’origine, la destinée et l’essence des choses.

4
conserver leur pouvoir tout en payant leurs impôts, tandis que les français perdaient le leur pour garder leurs privilèges et être exemptés d'impôts. En Angleterre, l'aristocratie a su conserver son pouvoir en s'unissant « intimement » à la classe moyenne. En France, à l'inverse, la noblesse a laissé le pouvoir à l'administration royale et à la bourgeoisie, elle s'est exclue elle-même du pouvoir. Contrairement à une idée répandue, les bourgeois pouvaient s'anoblir et pénétrer dans la noblesse en achetant des offices ou des terres nobles. « Si les classes moyennes d'Angleterre, loin de faire la guerre à l'aristocratie, lui sont restées si intimement unies, cela n'est pas venu surtout de ce que cette aristocratie était ouverte mais plutôt de ce que sa forme était indistincte et sa limite inconnue (...). La barrière qui séparait la noblesse de France des autres classes, quoique très facilement franchissable, était toujours fixe et visible, toujours reconnaissable à des signes éclatants et odieux à qui restait dehors (...). C'est ce qui fait que le tiers état, dans ses doléances, montre toujours plus d'irritation contre les anoblis que contre les nobles. » Dès lors, une fois le Roi décapité, quelle classe peut prendre le pouvoir? Aux États-Unis, Tocqueville découvre que la classe moyenne peut gérer une société démocratique. Cela grâce à un caractère, pour lui, très surprenant de la société américaine : «La société marche toute seule et bien lui en prend de ne rencontrer aucun obstacle; le gouvernement me semble ici dans l'enfance de l'art. » Alors, dans une société plus ancienne, plus complexe, entourée de voisins belliqueux, la classe moyenne sera-t-elle capable de gouverner? Voici sa réponse: « Il y a une chose que démontre invinciblement l'Amérique et dont j'avais douté jusqu'à présent : c'est que les classes moyennes peuvent gouverner un État. Je ne sais si elles se tireraient à leur honneur de situations politiques bien difficiles. Mais elles suffisent au train ordinaire de la société. Malgré leurs petites passions, leur éducation incomplète, leurs moeurs vulgaires, elles peuvent évidemment fournir l'intelligence pratique, et cela se trouve suffisant. » Cette citation explique bien l'ambivalence de Tocqueville à l'égard de la démocratie : d'un côté, il rêve du triomphe de la liberté et de l'égalité, d'un autre, il craint que la médiocrité en soit le prix. Marx répondra que le souffle historique viendra du prolétariat. Pour Tocqueville, en attendant que le peuple (les paysans et les ouvriers) pénètre dans la société politique, la classe moyenne gouvernera. Aux États-Unis, elle est constituée de petits entrepreneurs et de petits propriétaires comme en France, mais aussi de salariés, autre découverte pour Tocqueville : « Les serviteurs américains ne se croient pas dégradés parce qu'ils travaillent, car autour d'eux tout le monde travaille. Ils ne se sentent pas abaissés par l'idée qu'ils reçoivent un salaire, car le Président des États-Unis travaille aussi pour un salaire. On le paie pour commander aussi bien qu'eux pour servir. Aux États-Unis les professions sont plus ou moins pénibles, plus ou moins lucratives, mais elles ne sont jamais ni hautes ni basses. Toute profession honnête est honorable. » Par conséquent, la classe moyenne comprend et comprendra de plus en plus de salariés; ce qui la modifiera radicalement: la nouvelle classe moyenne salariée, que Simmel « inventera » en Allemagne à la fin du siècle et que les sociologues contemporains ont eu tant de mal à prendre en compte, est déjà présente chez Tocqueville. « Si l'objet principal du gouvernement n'est point de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère; alors égalisez les conditions et constituez le gouvernement de la démocratie. » La société démocratique sera donc une société où les différences sociales seront de moins en moins marquées, et où chacun poursuivra ses intérêts particuliers et cherchera, avant tout, à assurer son bien-être personnel. Il n'y aura pas de place pour les grandes passions, ni pour les actions grandioses, ni pour la gloire. Visiblement Tocqueville se désole de ce qu'il prédit et dont il a trouvé le modèle à New York dès son arrivée sur le sol américain. C'est une société de négociants où tout le monde actif est dévoré par la soif de s'enrichir. Il en résulte une mobilité des positions extraordinaire pour le jeune aristocrate français habitué à la stabilité héréditaire des conditions : « Un Américain prend, quitte, reprend dix états dans sa vie, il change sans cesse de domicile et forme continuellement de nouvelles entreprises. » Il y a moins de différence entre la vie des hommes et des femmes qu'en Europe. La femme est sur pied dès sept heures du matin, les jeunes filles sont très libres et reçoivent les jeunes gens sans gêne. Les fiançailles les réunissent et le mariage est une décision personnelle qui relève de l'inclination des fiancés. Certes, nos deux voyageurs trouvèrent plus de quant à soi dans la société de Boston qu'à New York, mais sans différence majeure.
2.3. LIBERTE ET EGALITE, LE TYPE IDEAL DE LA SOCIETE DEMOCRATIQUE. Ainsi, touche après touche, se construit le modèle, le type idéal wébérien, de la société démocratique qui va se développer en Europe sur le modèle de l'Amérique. Mais ici, elle doit s'édifier sur les décombres des vieilles sociétés féodales et monarchiques, au lieu qu'outre-Atlantique, elle n'était embarrassée d'aucune précédente, sauf l'esclavage dans le Sud. La passion de la liberté s'est emparée des peuples d'Europe après la Révolution française, mais elle y est bridée par toutes les institutions politiques et sociales. 1848 lui donnera un nouveau souffle, notamment en Italie. « La liberté n'exécute pas chacune de ses entreprises avec la même perfection que le despotisme intelligent mais, à la longue, elle produit plus que lui (...). Elle répand dans tout le corps social une activité, une force, une énergie qui n'existe jamais sans elle et qui enfante des merveilles. » Voilà une affirmation majeure qui lie le développement de la libre entreprise et du capitalisme au bon fonctionnement de la démocratie.

5
La liberté ne saurait triompher seule, c'est de la passion de l'égalité que Tocqueville attend le renfort nécessaire et décisif. Car l'égalité renferme en soi un mécanisme qui est le ressort même des sociétés démocratiques : plus l'égalité progresse, plus les inégalités deviennent insupportables, et par conséquent la lutte contre les inégalités se poursuit et entraîne le progrès continu de l'égalité. Telle est la loi qu'a formulée Tocqueville et qu'il nous faut donc appeler «loi de Tocqueville» qu'il a lui-même formulée ainsi : «le désir d'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande ». Il a donné plusieurs illustrations de cette loi : « pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux pour le peuple de France que partout ailleurs? » La réponse est simple et paradoxale : parce qu'ils y étaient déjà largement allégés et assouplis. Par exemple, la corvée féodale était « rare et douce » en France alors qu'en Allemagne, elle était « universelle et dure ». Le servage demeure encore vivant en Autriche et en Prusse, alors que le paysan français « n'avait pas seulement cessé d'être serf, il était devenu propriétaire foncier». En Allemagne même, c'est en Rhénanie, où les paysans étaient libres, que la Révolution a fait son chemin. C'est parce que les pouvoirs seigneuriaux étaient allégés qu'ils étaient devenus insupportables aux paysans et qu'ils ont été une des causes des soulèvements révolutionnaires. D'une manière générale, c'est lorsqu'un pouvoir despotique cherche à se libéraliser qu'il devient le plus vulnérable et qu'il doit s'attendre à des révoltes. Tout allégement d'un pouvoir fait entrevoir la possibilité de réclamer un allégement supplémentaire. C'est le principe même de la frustration relative que les psycho- sociologues américains «découvriront» dans les années 1940 :
«Le mal qu'on souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès qu'on conçoit l'idée de s'y soustraire» «Un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et comme s'il ne les sentaient pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s'en allège. » « Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer. »
Disciple de Montesquieu, Tocqueville se demande quelle doit être la vertu des citoyens pour que la démocratie ne se pervertisse pas. L'ambition de chacun est le ressort de l'activité économique, s'enrichir entraîne l'augmentation des inégalités, et la démocratie doit en permanence rétablir l'équilibre égalitaire. Le principal danger de corruption de la démocratie se trouve donc dans le désintérêt des citoyens pour la chose publique, accaparés qu'ils sont par leurs petites ambitions de réussite économique et de bien-être quotidien. Tout naturellement, ils ont tendance à se replier sur leurs intérêts individuels et le confort matériel et affectif de leurs familles. Alors ils laissent le champ politique libre aux ambitions despotiques et sont même prêts à s'en remettre de leur paix personnelle et politique aux gouvernements qui seront naturellement tentés d'en abuser et de concentrer tous leurs pouvoirs en leurs mains. Le despotisme est le danger majeur qui menace la démocratie, danger qui est en germe dans l'omnipotence de la majorité. « Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement la majorité d'un peuple a le droit de tout faire et pourtant je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même? ». Ce règne de la majorité peut être tyrannique et étouffer l'indépendance des individus et par conséquent se retourner contre la démocratie, danger auquel la société américaine n'échappe pas. C'est la tyrannie de l'american way of life, du qu'en dira-t-on. La république de Weimar s'abandonnant aux mains fermes de Hitler est l'exemple historique qui a réalisé la prédiction de Tocqueville. « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme (...). Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. » On croirait entendre une Mme Thatcher dénoncer les maux de l'État-providence travailliste et toutes les critiques de notre société contemporaine qui redoutent que le lien social se distende et que l'anomie l'emporte. Il faut souligner ici que pour Tocqueville, le risque de despotisme ne vient pas de l'inégalité des conditions mais au contraire de l'égalisation des conditions. C'est parce que tous les citoyens sont égaux et qu'ils ne sont pas organisés dans des corps intermédiaires, qu'ils sont prêts à se soumettre à un pouvoir fort qui parait les décharger de tout ce qui n'est pas leurs intérêts particuliers. Ce paradoxe sera repris sous une forme différente par Simmel. De même, la guerre n'a pas sa place dans le train-train de la société démocratique. En temps de paix, on ne pense pas à la guerre et quand elle se produit, les démocraties perdent les premières batailles, mais ensuite elles se mobilisent complètement jusqu'à la victoire. Dans un passage prophétique, il annonce les guerres mondiales du XXe siècle : « La guerre, après avoir détruit toutes les industries devient elle-même la grande industrie, et c'est vers elle que se dirigent alors de toutes parts les ardents et ambitieux désirs que l'égalité fait naître. C'est pourquoi ces mêmes nations démocratiques, qu'on a tant de peine à entraîner sur les champs de bataille, y font quelques fois des choses prodigieuses. » Un siècle avant l'événement, n'est-ce pas une allusion à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale? La mécanique des institutions politiques doit être agencée pour éviter ces écueils. Les institutions fédérales remplissent bien cette fonction puisque l'équilibre est assuré entre les deux assemblées du Congrès et la

6
présidence. De plus, les partis sont des partis de gouvernement et non des partis animés par des convictions idéologiques; leurs rivalités et leur alternance au pouvoir assurent l'équilibre démocratique.
2.4. LA DEMOCRATIE LOCALE. Par ailleurs, Tocqueville découvre en Amérique l'importance de la démocratie locale et la multiplicité des associations. Le futur président du conseil général de la Manche compare la vitalité de la vie politique locale américaine avec la faiblesse de la commune française qu'il qualifie de véritable cadavre, Il admire que les citoyens américains se sentent responsables de leurs villages et de leurs cités et qu'ils créent des associations pour gérer leurs problèmes collectifs, au lieu de s'en remettre à l'État comme les Français. Enfin il attache une grande importance à la liberté de la presse dont il craint les excès, mais qui sont moins graves, selon lui, que l'absence de presse libre. Entre la liberté totale et la suppression de la presse, il ne voit pas de solution intermédiaire, et par conséquent il est pour la liberté. Une Constitution forte et équilibrée, une démocratie locale vivante et active et une presse aux aguets sont les trois conditions pour que la démocratie ne dégénère pas. Trois conditions qui supposent de bonnes moeurs.
2.5. LES MOEURS Pour Tocqueville, les moeurs ne peuvent être séparées des institutions puisque ce sont les hommes qui font vivre les institutions. Pour une fois, il a donné une définition de la notion qu'il utilise : « J'entends ici l'expression de moeurs dans le sens qu'attachaient les Anciens au mot mores; non seulement je l'applique aux moeurs proprement dite, qu'on pourrait appeler les habitudes du coeur, mais aux différentes notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d'eux, et à l'ensemble des idées dont se forment les habitudes de l'esprit. » Autrement dit, en langage sociologique moderne, les normes et les valeurs, les opinions et les attitudes, et l'idéologie en général. Partant de France en Angleterre puis aux États-Unis, voyageant en Allemagne, ensuite en Italie, il accumule dans son carnet de voyage une foule de notations sur la façon d'être et de penser de chaque peuple. Cette façon de voir la société est proche du culturalisme qui se développera chez les ethnologues, notamment américains, dans les années quarante. Mais le culturalisme est statique; il décrit des moeurs, une culture comme immuable, tandis que Tocqueville associe l'analyse des moeurs avec le changement. Certes il décrit les moeurs, le rituel social, les manières, la politesse, en aristocrate qui déplore de les voir s'affadir; il craint « qu'au milieu des petites occupations incessantes de la vie privée, l'ambition ne perde son élan et sa grandeur; que les passions humaines ne s'y apaisent et ne s'y abaissent en même temps, de sorte que chaque jour l'allure du corps social devienne plus tranquille et moins haute ». Ainsi explique-t-il « pourquoi on trouve aux Etats-Unis tant d'ambitieux et si peu de grandes ambitions ». Il craint que les sociétés démocratiques « ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes moeurs de telle sorte que le genre humain s'arrête et se borne, que l'esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d'idées nouvelles, que l'homme s'épuise en petits mouvements solitaires et stériles, et que tout en remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus». Aujourd'hui encore, des publicistes qui annoncent à grand fracas la fin de l'histoire s'épargneraient ce ridicule en s'apercevant que la crainte de Tocqueville n'est pas mieux fondée hier qu'aujourd'hui. La démocratie suppose de bonnes lois et de bonnes moeurs, et celles-ci sont plus importantes que celles-là pour maintenir une démocratie saine. Tocqueville assigne aux moeurs une sorte de rôle d'infrastructure dans la société; elles sont le fondement de la société et ont leur dynamique propre; elles influencent les lois et les institutions plus que l'inverse. Certains passages suggèrent que les moeurs évoluent plus lentement que les structures sociales, ce qui expliquerait que la Révolution ait bouleversé toute l'architecture de la société française, sans modifier profondément sa culture. « Si la noblesse française a cessé d'être une classe, elle est restée une sorte de franc-maçonnerie dont tous les membres continuent à se reconnaître entre eux par je ne sais quels signes invisibles, quelles que soient les opinions qui les rendent étrangers les uns aux autres ou même adversaires. » Ce mécanisme explique que, malgré les bouleversements politiques, économiques et sociaux en France et aux États-Unis, ses descriptions demeurent si actuelles et que les observateurs contemporains le citent si fréquemment, notamment les sociologues américains et français, Raymond Aron, Michel Crozier et bien d'autres. La Révolution a été une mise en accord des lois et des institutions avec l'évolution des moeurs. Celles-ci ont été forgées dans des institutions monarchiques qui ont brisé ce qu'il y avait de proto-démocratique dans la gestion des collectivités paysannes et dans les rapports « paternalistes » entre seigneurs et paysans. Il y a de longs développements sur les rapports entre maîtres et serviteurs qui sont beaucoup plus directs et même chaleureux dans une société aristocratique que dans une société démocratique européenne. Aux États-Unis, en revanche, les rapports entre maîtres et serviteurs sont établis par un contrat clair et précis, qui fixe à la fois le salaire et les tâches que le domestique doit accomplir. Ce rapport de salariat n'est pas entaché d'un souvenir de soumission à un maître. Récemment Philippe d'Iribarne a repris ce thème en s'inspirant directement de Tocqueville.

7
En Europe, répétons-le, la démocratie s'est édifiée sur les ruines d'un État monarchique et d'une société aristocratique. Tandis qu'aux États-Unis la démocratie locale a été le produit des moeurs des premiers immigrants. Les institutions des États comme celles de la Fédération, à leur tour, sont issues de la démocratie locale. Autrement dit, aux États-Unis, ce sont les moeurs qui ont inventé la démocratie sans aucune contrainte antérieure, tandis qu'en Europe la démocratie doit combattre ce qui reste de féodalité et de « despotisme monarchique » dans les moeurs et les institutions.
2.6. LE CHANGEMENT SOCIAL La force du modèle de Tocqueville vient de ce qu'il analyse la société en mouvement, soumise à des forces et faisant jouer des mécanismes qui assurent son dynamisme. Il a résumé son jugement sur la Révolution française en une phrase célèbre: «Tout ce que la Révolution a fait, se fût fait, je n'en doute pas, sans elle; elle n'a été qu'un procédé violent et rapide à l'aide duquel on a adapté l'état politique à l'état social, les faits aux idées, les lois aux moeurs. » Autrement dit, les tendances à l'oeuvre sous l'Ancien Régime, se sont poursuivies et la Révolution n'est pas une rupture mais au contraire une continuité : « La Révolution a achevé soudainement par un effort convulsif et douloureux, sans transition, sans précautions, sans égards, ce qui se serait achevé peu à peu de soi-même à la longue. » Face aux mouvements de fond qui animaient la société française, les institutions restèrent immuables et même se sclérosaient. Les classes se muaient en castes au lieu de s'ouvrir à la promotion comme en Angleterre. Pour faire sauter ce carcan, seule une révolution, « un procédé violent et rapide », permettait de retrouver une souplesse nécessaire à la poursuite de l'évolution. L’enrichissement du XVIIIe siècle donnait une plus grande importance à la vie économique qui, aux mains des bourgeois, devint de plus en plus déterminante. Les paysans, qui avaient depuis le XIIe siècle un droit stable et héréditaire sur leurs terres, voulaient s'affranchir des droits féodaux dans l'ambition d'arriver à une propriété pleine et entière. La réaction féodale et le renforcement des droits seigneuriaux furent une cause directe des révoltes paysannes et de la Révolution. En abolissant la seigneurie, la nuit du 4 août achevait l'évolution et ouvrait la possibilité d'un droit de propriété plein et entier tel qu'il sera défini dans le Code civil. Au cours du XIXe siècle, bourgeois acquéreurs de biens nationaux et nobles grands propriétaires reprirent le contrôle des terres à travers le métayage et le fermage. Et simultanément, les paysans recommencèrent leurs efforts pour reprendre la maîtrise de leurs terres jusqu'à ce que la loi du fermage et du métayage de 1947 leur donne satisfaction. La Révolution et la nuit du 4 août ne sont qu'une étape d'un long cheminement depuis l'Ancien Régime jusqu'au XXe siècle. Au cours d'un voyage en Angleterre il note : «Si l'on appelle révolution tout changement capital apporté dans les lois, toute transformation sociale, toute substitution d'un principe régulateur à un autre, l'Angleterre est assurément en état de révolution ( ... ). Mais si on entend par révolution un changement violent et brusque, l'Angleterre ne me paraît pas mûre pour un semblable événement. » Une classe bourgeoise intellectuelle se développait dans les villes, constituée de juristes et de propriétaires éclairés qui lisaient les livres des philosophes et se réunissaient dans des sociétés savantes. Or cette classe, se voyant refuser l'accès aux honneurs par la noblesse et au pouvoir par l'administration monarchique centralisée, était prête à prendre la tête du mouvement révolutionnaire. La rédaction des cahiers de doléances lui en fournit la première occasion. Toute nourrie d'idées générales et n'ayant aucune expérience du pouvoir ni de la gestion publique, elle était prête à accueillir toutes les utopies et toutes les folies. Au contraire « dans les sociétés démocratiques, il n'y a guère que de petites minorités qui désirent les révolutions; mais les minorités peuvent quelquefois la faire». Notamment « les révolutions militaires qui ne sont presque jamais à craindre dans les aristocraties sont toujours à redouter dans les nations démocratiques ». Et enfin cette phrase prophétique : « Si l'Amérique éprouve jamais de grandes révolutions, elles seront amenées par la présence des Noirs sur le sol des États-Unis, c'est-à-dire que ce ne sera pas l'égalité des conditions, mais au contraire leur inégalité qui les fera naître. » S'il avait vécu plus longtemps, il aurait vu la réalisation de sa prévision dans la guerre de Sécession en 1861. Dans la France de l'Ancien Régime, la centralisation des pouvoirs et le renforcement de l'État sont déjà à l'oeuvre. Parce que les États-Unis sont encore une nation politique dans l'enfance, la société lui paraît y « marcher toute seule » ; mais il prévoit que là-bas aussi la tendance centralisatrice de l'État démocratique fera son effet. Et, en effet, le pouvoir fédéral s'est considérablement renforcé au XXe siècle. Il résume ainsi le mécanisme : « Deux révolutions semblent s'opérer de nos jours en sens contraire, l'une affaiblit continuellement le pouvoir, l'autre le renforce sans cesse. À aucune autre époque de notre histoire il n'a paru ni si faible, ni si fort. » Y a-t-il propos plus actuel à notre époque? L'État perd ses prérogatives régaliennes en même temps que l'Etat-providence gère de plus en plus intimement la vie des citoyens. Cette marche vers le renforcement de l'État au détriment des communes et des provinces est une de ses analyses les plus fortes. Il consacre un chapitre entier aux pays d'état et au parlement du Languedoc pour montrer l'importance d'un pouvoir intermédiaire entre le roi et les communes. La dépossession des assemblées de villages de tout pouvoir et le rôle de plus en plus étendu des intendants lui paraissent néfastes. Tout remonte à Versailles et les communes ne sont plus que des cadavres. Ce trait fondamental du gouvernement de France n'a fait que se renforcer par la

8
suite avec la création des préfets par Napoléon, puis par le suffrage universel et la pénétration de la politique au village sous la Troisième République. Tocqueville aurait été très surpris du retournement de la Ve République qui refuse de regrouper les communes en municipalités de canton, puis crée des régions et enfin, en 1982, donne aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux la préséance sur le préfet, représentant de l'État (lois Deferre ou lois de décentralisation). Ce retour au local, un siècle et demi après ses analyses, l'aurait stupéfié et rempli de satisfaction. Si Tocqueville ne s'est jamais intéressé ni à l'économie ni à l'industrie pour en faire un champ de ses analyses descriptives, il ne les a pas pour autant ignorées, mais il en a une vision plus abstraite, livresque pourrait-on dire. Sauf sur un point, le développement du paupérisme qu'il a observé en Angleterre et sur lequel il revient dans De la démocratie en Amérique en 1840. Comme ses contemporains, il était convaincu que le développement industriel entraîne la paupérisation des ouvriers et l'enrichissement des capitalistes : « Dans le même temps que la science industrielle abaisse sans cesse la classe des ouvriers, elle élève celle des maîtres. Tandis que l'ouvrier ramène de plus en plus son intelligence à l'étude d'un seul détail, le maître promène chaque fois ses regards sous un plus vaste ensemble. » Reprenant l'analyse d'Adam Smith sur la division du travail : « Que doit-on attendre d'un homme qui a employé vingt ans de sa vie à faire des têtes d'épingle? » Et plus loin, cette esquisse d'une théorie de l'aliénation : « son oeuvre lui échappant, il finit par se désintéresser de lui-même; il s'en détache; il se désiste en quelque sorte; ou plutôt il se transporte tout entier dans son maître », ou son utopie a-t-on envie d'ajouter. D'un côté, paupérisation du prolétariat, et d'un autre, l'apparition d'une nouvelle aristocratie. «A mesure que la masse de la nation tourne à la démocratie, la classe particulière qui s'occupe d'industrie devient plus aristocratique (...). Il semble qu'on voie l'aristocratie sortir par un effort naturel du sein même de la démocratie. » Il compare cette nouvelle aristocratie de l'argent à l'ancienne, celle de la naissance, et naturellement il préfère la seconde. « L’aristocratie manufacturière de nos jours, après avoir appauvri et abruti les hommes dont elle se sert, les livre en temps de crise à la charité publique. » En effet, « le manufacturier ne demande à l'ouvrier que son travail, et l'ouvrier n'attend de lui que son salaire ». Au sein de cette nouvelle aristocratie ne règne plus l'égalité entre nobles : «Les privilèges de quelques-uns sont encore très grands, mais la possibilité de les acquérir est ouverte à tous; d'où il suit que ceux qui les possèdent sont préoccupés sans cesse par la crainte de les perdre ou de les voir partager; et ceux qui ne les ont pas encore veulent à tout prix les posséder, ou, s'ils ne peuvent y réussir, le paraître. » Et l'on se trouve ramené à « la loi de Tocqueville ».
2.7. SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE La sociologie de la connaissance occupe une large place dans la seconde partie de La Démocratie en Amérique. Comme le dit François Furet : « A travers l'étude successive du mouvement intellectuel, des sentiments et des moeurs, Tocqueville s'attaque à la question la plus importante des sciences sociales, celle sur laquelle nous n'avons pas cessé de vivre depuis : quel est le rapport entre la production des idées et des représentations et les autres niveaux de l'existence sociale. C'est la question que, presque à la même époque, le jeune Marx cherche à résoudre aussi. » Tocqueville se demande pourquoi la science s'est développée en même temps que la bourgeoisie. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les savants cultivaient une science pour le plaisir de l'esprit. Il cite Plutarque : « Archimède a eu le coeur si haut qu'il ne daigne jamais laisser par écrit aucune oeuvre de la manière de dresser toutes ces machines de guerre; et, refusant toute cette science d'inventer et de composer machines et généralement tout art qui rapporte quelque utilité à le mettre en pratique, vil, bas et mercenaire, il employa son esprit et son étude à écrire seulement des choses dont la beauté et la subtilité ne fut aucunement mêlées avec nécessité. » De même, Tocqueville déplore que Pascal ait abandonné ses recherches scientifiques et techniques pour se consacrer à la recherche de Dieu et « mourir de vieillesse avant quarante ans. Je m'arrête interdit, et je comprends que ce n'est pas une cause ordinaire qui peut produire de si extraordinaires efforts. » Par « ordinaire » Tocqueville entend bien commandé par la société et non un penchant personnel. Ainsi, dans les sociétés aristocratiques, aucun lien n'est établi entre la science et la technique, la première étant réputée noble et la seconde vile, parce que du ressort des vilains. Dans les sociétés démocratiques, au contraire, « les hommes sont toujours mécontents de la position qu'ils occupent, et toujours libres de la quitter, ils ne songent qu'aux moyens de changer leur fortune ou de l'accroître. Pour des esprits ainsi disposés, toute méthode nouvelle qui mène par un chemin plus court à la richesse, toute machine qui abrège le travail, tout instrument qui diminue les frais de production, toute découverte qui facilite les plaisirs et les augmente, semblent le plus magnifique effort de l'intelligence humaine. » Il peut évidemment y avoir d'autres causes aux progrès de la science et de ses applications techniques, mais Tocqueville formule en toute rigueur un modèle causal théorique, à la fois en termes d'individualisme méthodologique et de logique de fonctionnement de la société démocratique. Il argumente les mécanismes intermédiaires qui s'engrènent pour produire cette innovation décisive qui fera le triomphe de la société industrielle et de la démocratie.

9
Jouant ensuite, selon son habitude, de la comparaison, il découvre le mécanisme inverse en Chine : « Lorsque les Européens abordèrent, il y a trois cents ans, en Chine, ils y trouvèrent presque tous les arts, parvenus à un certain degré de perfection, et ils s'étonnèrent qu'étant arrivés à ce point, on n'eut pas été plus avant! » Il l'explique par le fait que la science chinoise était morte, si bien que les techniciens les plus savants ne pouvaient plus progresser par l'application de découvertes scientifiques, évolution exactement inverse de l'Europe depuis la Renaissance. Poursuivant la même démarche, il esquisse une sociologie de l'art qui est moins rigoureusement formulée. Le paragraphe suivant illustre la démarche ethnographique de Tocqueville. « Lorsque j'arrive dans un pays et que je vois les arts donner quelques produits admirables, cela ne m'apprend rien sur l'état social et la Constitution politique du pays. Mais, si j'aperçois que les produits des arts y sont généralement imparfaits, en très grand nombre et à bas prix, je suis assuré que, chez le pays où ceci se passe, les privilèges s'affaiblissent et les classes commencent à se mêler et vont bientôt se confondre. » S'agissant de la littérature, il avance la même hypothèse en une formule lapidaire : « La démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes industrielles, elle introduit l'esprit industriel au sein de la littérature. » Malheureusement cette hypothèse est mal argumentée puisque le chapitre qu'elle débute est réduit à une page. Visiblement, obnubilé par son mépris pour la vie intellectuelle et artistique américaine, Tocqueville généralise hâtivement à la démocratie en général. Son point de vue de Français et d'aristocrate l'induit en erreur et lui fait négliger de rechercher une contre-épreuve. Pour résumer, on pourrait dire que le « paradigme » de Tocqueville est une alliance entre sa passion de la liberté et une inquiétude sur les conséquences de l'égalité qu'il a considéré non comme une situation mais comme une dynamique, là est son trait de génie.
III. LA METHODE La méthode intellectuelle de Tocqueville est indéchiffrable. Personne n'a pu décrypter la façon dont il raisonne, ni comment il sait distinguer dans la réalité qu'il observe ce qui est essentiel pour son analyse. Qu'avait dans la tête le jeune homme de vingt-six ans qui s'embarquait au Havre en 1831 ? Une passion pour la liberté et la conviction que les progrès de l'égalité étaient inexorables? Voilà qui ne suffit pas. Dans une lettre à son ami Kergorlay, il écrit: « Il y a dix ans que je pense une partie des choses que je t'exposerai tout à l'heure. Je n'ai été en Amérique que pour m'éclairer sur ce point. » Écrite en 1835, cette lettre veut bien dire qu'à vingt ans il avait déjà tout prêt son système de questionnement. Vient immédiatement à l'esprit le mot de Sainte-Beuve: « il a commencé à penser avant d'avoir rien appris ». Et François Furet poursuit par une comparaison avec Marx : «Les concepts de Marx à n'importe quelle époque de l'histoire de sa pensée ne sont jamais simples. Héritage remanié de la philosophie allemande, ou produits transformés de l'économie politique anglaise, ils ne doivent rien à l'expérience existentielle de Marx, et presque tout à sa pensée sur d'autres pensées. Au contraire, chez Tocqueville, le socle du système n'est pas intellectuellement construit: c'est une évidence empirique transposée, au niveau abstrait, sous la forme des progrès irréversibles de l'égalité (...). Son outil analytique central est moins l'égalité que les représentations de l'égalité, au double niveau de la norme sociale et des passions individuelles. » À la différence de Marx qui cherche à expliquer l'origine et le destin du capitalisme, Tocqueville ne s'intéresse pas aux origines; il pose comme un axiome le développement de la démocratie et le progrès de l'égalité des conditions. Idée répandue à l'époque mais dont il se sert comme d'un postulat indémontrable à partir duquel il construit son système en prenant les sociétés aristocratiques comme contrepoint. C'est tout lui-même qui est en cause: un aristocrate d'Ancien Régime saisi par la passion de la liberté cherche à comprendre la société dans laquelle il vit. Toute son oeuvre peut être lue comme une réflexion sur la noblesse et sa place dans une société démocratique, une réflexion sur soi-même, en quelque sorte. Comme les ethnologues qui partent étudier une tribu lointaine pour mieux comprendre leur propre société.
3.1. LE TERRAIN La méthode de travail de Tocqueville est celle de l'ethnologue de terrain qui veut comprendre la tribu qu'il étudie comme un tout, comme un système social cohérent. Comme un ethnologue, il prépare un questionnaire avant d'interroger un informateur et rédige immédiatement un compte-rendu de la conversation. Comme un bon enquêteur, il griffonne sur le vif dans des carnets portatifs, puis rédige des cahiers chronologiques et enfin des cahiers par grands thèmes qui donnent des versions plus argumentées des « interviews ». Chaque compte-rendu est précédé par un portrait bref de l'interlocuteur. Il explique clairement les disciplines de l'enquêteur. Primo, noter immédiatement les observations : « Lorsqu'il nous vient une idée, si à l'instant nous ne la fixons pas sur le papier, nous sommes presque sûrs de ne la revoir jamais ; si, lorsque nous nous adressons à un homme spécial, nous ne savons pas lui imposer sur le champ les questions les plus utiles, c'est comme une occasion perdue. »

10
Secundo : « Écouter tout le monde sans prendre parti (...). L'important est de se mêler avec le plus d'individus possibles et en mettant naturellement chaque homme sur ce qu'il sait le mieux, d'en tirer en peu de temps tout ce qu'il peut donner (...). Porter l'interlocuteur à développer le plus possible sa pensée. » Sur l'ethnologue, il a l'avantage de disposer d'une ample documentation imprimée. Au cours de ses séjours dans les grandes villes il continue les lectures commencées à Paris et poursuivies pendant la longue traversée. Il lit les grands hommes, Jefferson et Madison, les constitutionnalistes, Story et Kent, les fédéralistes. Partout où il passe, il réunit des brochures sur la gestion municipale, l'administration, etc. De retour en France il dispose donc d'une moisson énorme: documentation imprimée et notes de terrain. Il lui faudra près de trois ans de travail pour exploiter toutes ses données, les mettre en ordre et construire son argumentation. Un an d'enquêtes pour trois ans d'exploitation et de rédaction, c'est encore la routine conseillée à tout étudiant qui prépare une thèse. Pour L'Ancien Régime, il travaillera de la même manière, à l'aide des ouvrages publiés et surtout des archives qu'il «interrogera» à Tours en 1853, comme il a interrogé ses informateurs américains. Il interrogera aussi des gens âgés qui ont vécu leur jeunesse sous l'Ancien Régime. Pour compléter son information sur le système féodal et ce qu'il en reste en Allemagne, il y passera quatre mois en 1854. Mais cette fois-ci, avant de chercher les preuves, il possède l'argument auquel il réfléchit depuis trente ans et qu'il a discuté sous tous ses angles avec son père et avec d'autres contemporains. L'ouvrage qui paraîtra en 1856 résume ainsi sa méthode : « Il faut entremêler la trame des idées à celle des faits; dire assez des seconds pour faire comprendre les premières et obtenir du lecteur qu'il sente l'intérêt ou l'importance de celles-ci, et cependant ne pas écrire une histoire proprement dite... J'entrevois, ce me semble, l'objet que je veux peindre; mais la lumière qui l'éclaire est vacillante et ne me permet pas encore de saisir assez bien l'image pour pouvoir la reproduire » (lettre à Gustave de Beaumont). Itération perpétuelle entre l'observation et l'interprétation théorique, puis le retour de la conceptualisation à la description : grâce à cet aller et retour, la compréhension s'affine et devient plus pénétrante. Cette démarche lui est possible parce qu'il ne se préoccupe pas de la cause première de l'état social qu'il analyse. Il prend la réalité historique telle qu'il la voit et cherche à la modéliser. En cela il est proche de Max Weber: il a construit un type idéal de la démocratie. Tandis que Marx est obnubilé par le fondement technique et économique de l'évolution historique. Ce mépris pour la cause première est la grande novation qu'il apporte à la réflexion sociale et c'est ce qui fait de lui le sociologue le plus moderne qui soit. Il cherche dans le social l'explication du social et en cela il est le précurseur de Durkheim. Ni économisme, ni géographisme, ni psychologisme, l'agencement du social, tel qu'il résulte de l'histoire, est une explication qui se suffit à elle-même. Raymond Boudon a voulu faire de Tocqueville un précurseur de l'individualisme méthodologique. En effet, dans ses analyses il met en scène les individus et leur donne un rôle moteur dans la dynamique sociale.
3.2. HOMOLOGIES DE STRUCTURES Sans la formuler explicitement Tocqueville suit une démarche analytique qui sera celle de Max Weber. Après avoir décrit une institution ou des comportements, il construit un type idéal abstrait en choisissant dans la réalité les éléments qu'il juge essentiels, structurants dirions-nous aujourd'hui. Ensuite il retrouve des structures analogues dans d'autres institutions et dans d'autres comportements d'où il tire un autre type idéal. Très souvent, il confronte une structure visible, institutionnalisée et une structure sous-jacente, latente qu'il a su identifier derrière les apparences. Enfin il compare les deux types idéaux et s'interroge sur les analogies de structure. Au sein d'une même société, s'il retrouve les mêmes structures dans différents domaines, il en déduit que c'est la structure dominante, explicative du fonctionnement de cette société. Par exemple, il affirme: «L'Ancien Régime est là tout entier: une règle rigide, une pratique molle; tel est son caractère. » Or ce caractère survivra à l'Ancien Régime et demeure caractéristique de l'administration française contemporaine telle que la décrivent Michel Crozier et Pierre Grémion. C'est donc un caractère de la société française tout entière. Si l'on passe de l'analyse d'une société à la comparaison de deux sociétés, ce ne sont plus les homologies qui sont utilisées mais au contraire les contrastes qui permettent de préciser mieux encore l'originalité de chaque type idéal national. En fin de compte, Tocqueville aimerait pouvoir caractériser chaque société nationale par un trait simple d'où se déduirait l'ensemble de sa structure. Dans la même démarche, Tocqueville cherche le plus souvent une contradiction entre deux principes et trouve dans cette contradiction le principe dynamique qui fait évoluer la société. Si la règle rigide était appliquée partout de la même façon et avec la même rigidité, la société serait entièrement sclérosée. C'est le jeu entre règle rigide et application molle qui est le ressort de la vitalité et de l'unité française. Autre exemple de cette recherche du jeu d'éléments compensateurs. L'Ancien Régime ne connaissait que «deux façons d'administrer: dans les lieux où l'administration était confiée à un seul homme, celui-ci agissait sans le concours d'anciennes assemblées; là où il existait des assemblées comme dans les pays d'état ou dans les villes (...) l'assemblée administrait elle-même ou par des commissions temporaires qu'elle nommait ». Ainsi s'explique que la Révolution soit directement passée de l'autorité monarchique au gouvernement d'assemblée sous la

11
Convention : elle ne connaissait pas les liens possibles entre ces deux formes de légitimité. « Distinguer sans les disjoindre, le pouvoir qui doit exécuter de celui qui doit surveiller et prescrire, cette idée qui paraît si simple ne vint point, elle n'a été trouvée que dans ce siècle. »
3.2. TENDANCE ET COMPARAISONS « Quant à moi, lorsque je considère l'état où sont déjà arrivées plusieurs nations européennes, et celui où toutes les autres tendent, je suis porté à croire que bientôt parmi elles, il ne se trouvera plus de place que pour la liberté démocratique ou la tyrannie des Césars. » Cette phrase prophétique, qui paraît décrire l'Europe du début du XXe siècle, résume sa vision de l'histoire et surtout sa démarche intellectuelle. D'abord l'observation des nations, ensuite la comparaison entre leurs états, enfin une vision prospective sous forme d'une alternative. Implicitement, Tocqueville est évolutionniste et même fataliste. « Il croit à l'inévitable, et cet inévitable est la marche des sociétés vers la démocratie » (François Furet). En cela, il est comparable à Marx qui croyait au développement inexorable du capitalisme. Mais en même temps, il croit que l'avenir n'est pas fixé et il pense que la démocratie est menacée par le despotisme, le totalitarisme dirions-nous aujourd'hui. Sa passion pour la liberté le rend optimiste mais son analyse de la société égalitaire le rend pessimiste. Sa pensée procède par une série d'alternatives : aristocratie/démocratie, césarisme/démocratie; liberté/égalité, etc. Ces alternatives sont soit diachroniques (dans le temps), soit synchroniques (à un temps donné). Les tendances vont vers l'égalisation des conditions et la centralisation du pouvoir d'où peut résulter soit une vraie démocratie, si les moeurs sont bonnes et les citoyens actifs, soit un despotisme de la majorité puis une oligarchie ou même un chef charismatique, si les citoyens se désintéressent du gouvernement et de la politique. Dans les comparaisons, il oppose toujours deux situations, deux pays, principalement la France et l'Amérique, mais aussi la France et l'Angleterre, très rarement il joue sur trois terrains d'observation, France, États-unis, Angleterre. Ces alternatives sont abstraites, ce sont des étalons pour jauger la réalité et non des réalités historiques, leur multiplicité même montre bien que ce sont des outils d'analyse et rien d'autre, jamais des descriptions concrètes ni des analyses réifiées. À l'aide de ces outils, il cherche dans la réalité des cas sur lesquels il pense enrichir ses notions pour en faire des modèles, des types idéaux: l'aristocratie anglaise, la démocratie américaine, l'autocratie tsariste. Après quoi, il se retourne vers la France et confronte son état social à ces modèles. Ainsi il joue de l'analyse structurale statique pour comprendre le mouvement historique et il voit dans la structure le ressort qui lui donne son dynamisme. Et il revient toujours à des comparaisons entre deux situations du type : « En Amérique on a des idées et des passions démocratiques; en France, nous avons encore des passions et des idées révolutionnaires. » Par ailleurs, Tocqueville établit plusieurs distinctions au sein d'une société. Il distingue la société civile et la société politique, mais ne parle pas d'économie. Il oppose les faits aux idées, les lois aux moeurs. Il conçoit donc toute société comme régie par des logiques différentes mais en même temps par un principe unique, et c'est ce principe qu'il recherche. IV. POSTERITE ET INFLUENCE Tocqueville n'a pas eu de postérité, il n'a pas créé d'école et son héritage n'a été ni assumé ni transmis par personne. L'observateur des États-unis a été admiré pour sa lucidité, notamment par les Américains. Le libéral passionné de liberté a été invoqué par tous les libéraux. L’analyste constitutionnel a été utilisé par les politistes. Mais il a fallu attendre un siècle pour que le sociologue soit reconnu comme tel en France, grâce à Raymond Aron. Aux États-Unis, il était considéré comme un ancêtre par les sociologues, mais un ancêtre qu'on révère plus qu'on n'utilise. En France, à Sciences Po, il était enseigné dans l'histoire des idées politiques comme un libéral à côté de Benjamin Constant, entre Bonald et Marx. Mais à la Faculté des Lettres, il était inconnu, tant des philosophes que des sociologues; et les historiens ne prêtaient guère attention à son interprétation de la Révolution. Raymond Aron, en 1965, le prendra comme l'un des sept ancêtres de la sociologie moderne et le situera, malgré la chronologie, entre Marx et Durkheim, après Montesquieu et Comte, avant Pareto et Weber. Jusqu'à la génération présente, la sociologie française a toujours été fille de la philosophie. La filiation noble a toujours été Auguste Comte et Durkheim. Les empiristes, Le Play et Tarde, ont toujours été marginalisés depuis Durkheim. Or Tocqueville n'est en rien philosophe au sens français et universitaire du terme. Raymond Aron, lui-même, a mis en valeur et commenté le penseur politique plus que le sociologue. En 1967, mettre sur un pied d'égalité Marx et Tocqueville dans Eléments de sociologie surprenait le lecteur de l'époque. La crise du marxisme et le renouveau des idées libérales firent redécouvrir Tocqueville qui devint la référence et la citation obligée des dissertations de potache et du discours des hommes politiques, même du président des États-unis. Le prix Tocqueville décerné tous les deux ans à Valognes pour couronner un grand penseur a été décerné successivement à Raymond Aron, David Riesman, Louis Dumont, François Furet... parmi d'autres.

12
Cette percée tardive dans le débat d'idées et cette reconnaissance universelle n'a pas été accompagnée d'une influence clairement discernable dans les travaux des sociologues. Sans doute parce que la méthode de Tocqueville ne se prête pas à une routinisation comme il a été souligné ci-dessus. Les auteurs qui lui font le plus explicitement référence sont les analystes de la culture française, qu'ils soient français ou étrangers, pour montrer que la France demeure elle-même à travers les siècles, et les bouleversements qu'elle met en scène : immuable et changeante. La centralisation des pouvoirs et l'ingouvernabilité du peuple ont été illustrées par Alain Peyrefitte dans Le Mal français. Michel Crozier a décrit le cloisonnement de la société française et l'incapacité des Français à coopérer par peur du face à face; ce qui amène toutes les décisions à remonter dans l'échelle hiérarchique jusqu'au niveau central, ministériel, au cabinet du roi.
L'administration française : Crozier continuateur de Tocqueville « Les pages vigoureuses que Tocqueville consacrait à cette ‘administration réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l'administré qu'il ne l'était lui-même, sans cesse active et stérile’, paraissent tout aussi actuelles qu'à l'époque où il les écrivit. Certaines de ses remarques pourraient très bien servir de rapport introductif pour un groupe de discussion de jeunes fonctionnaires réformateurs. (...) Il faut donc bien en conclure à l'existence de quelques constantes de comportements, ou plutôt de rapports humains, propres au fonctionnement de la machine administrative française, qui ont survécu à l'épreuve du temps et au bouleversement des techniques, des croyances, des moeurs et des objectifs au moins apparents du milieu. Nous avons cru pouvoir attribuer le maintien de telles constantes à l'existence d'un système de relations homéostatiques extrêmement stables que nous avons appelé modèle bureaucratique français. Résumons brièvement ce système. C'est naturellement un système extrêmement centralisé. Mais le sens profond de cette centralisation, que tous les observateurs s'accordent à reconnaître, n'est pas du tout de concentrer un pouvoir absolu au sommet de la pyramide, mais de placer une distance ou un écran protecteur suffisant entre ceux qui ont le droit de prendre une décision et ceux qui seront affectés par cette décision. Le pouvoir qui tend à se concentrer effectivement au sommet de la pyramide est un pouvoir surtout formel, qui se trouve paralysé par la manque d'informations et de contacts vivants. Ceux qui décident n'ont pas les moyens de connaissance suffisants des aspects pratiques des problèmes qu'ils ont à traiter. Ceux qui ont ces connaissances n'ont pas le pouvoir de décision. Le fossé entre les deux groupes, ou plutôt entre les deux rôles, se reproduit presque fatalement. Il constitue un excellent moyen de protection pour les supérieurs qui n'ont pas à craindre de pâtir des conséquences de leurs décisions et pour les subordonnés qui n'ont pas à redouter l'intrusion de leurs supérieurs dans leurs problèmes. Cette tradition de centralisation est liée à une autre caractéristique moins souvent reconnue, mais tout aussi essentielle, la stratification. Les administrations françaises sont très fortement stratifiées selon les lignes fonctionnelles, mais surtout hiérarchiques. Les passages de catégorie à catégorie sont difficiles et les communications entre catégories, mauvaises. À l'intérieur de chaque catégorie, la règle égalitaire prévaut et la pression du groupe sur l'individu est considérable. Un tel système présente des avantages certains de stabilité, de régularité et de prévisibilité. Mais, en même temps, il est extrêmement rigide et sécrète naturellement la routine. Puisque les subordonnés ont intérêt à bloquer les informations, les supérieurs, qui n'ont pas les moyens de connaître de façon pratique les variables essentielles qui devraient être prises en considération, auront naturellement tendance à s'appuyer sur des règles abstraites ou à s'autoriser de précédents pour prendre leurs décisions. Centralisation et stratification constituent de telles barrières à la communication que les conséquences des décisions "bureaucratiques" mettront longtemps à apparaître. Le système ne peut pas se corriger en fonction de ses erreurs. Il a tendance à se refermer constamment sur lui-même. Pour parer aux difficultés d'un tel mode d'organisation, les dirigeants doivent s'efforcer de tout prévoir et de tout régler à l'avance. Mais comme ils ne peuvent naturellement y réussir, le système doit tolérer de nombreuses exceptions qui se constituent et se reconstituent constamment autour des zones d'incertitude qu'il ne parvient pas à éliminer. Les fonctionnaires qui doivent faire face à ces situations ne manquent pas de tirer parti de l'occasion qui leur est ainsi donnée pour affirmer leur pouvoir au sein du système et contre lui, et c'est ainsi que se créent et se maintiennent des féodalités et des privilèges qui paraissent absolument inadmissibles, aussi bien aux dirigeants du système qu'au reste de ses membres. (...) Enfin puisque toute adaptation locale n'est jamais considérée que comme un palliatif provisoire, une entorse aux principes imposée par les circonstances, et non comme une expérience ou une tentative de réforme capable d'apporter un progrès, le changement ne peut se produire que quand la somme des erreurs et des inadaptations est devenue si considérable qu'elle menace, sinon la survie, du moins l'équilibre de l'ensemble du système. Le changement prend alors la forme d'une crise qui ébranle l'ensemble du système, mais maintient ses principes et sa rigidité. »
Michel CROZIER, La Société bloquée, Paris, Le Seuil, 1970. Philippe d'Iribarne insiste sur l'opposition entre noble et vulgaire qui oblige chaque Français à se prévaloir de sa noblesse et à la protéger.
La logique de l'honneur selon Philippe d'Iribarne Dans son étude comparative sur les modes de gestion de trois entreprises, française, américaine et hollandaise, Philippe d'Iribarne utilise Tocqueville pour expliquer la logique de l'honneur qui caractérise les relations entre individus, les moeurs des dirigeants et des salariés français. Tandis qu'aux États-Unis ces relations se caractérisent par un échange fair entre égaux, les tâches de chacun étant scrupuleusement définies dans un contrat, les Hollandais parviennent à combiner une forte affirmation de l'individu et l'exigence d'un consensus. La « manière française de vivre ensemble» reprend toute une série de thèmes tocquevilliens qui ont été analysés ci-dessus, notamment l'opposition entre noble et roturier sous-tend tous les jugements sur les activités et les hommes. Cette logique de l'honneur fait qu'un exécutant ne saurait accepter une tâche qu'il juge inférieure à sa compétence et donc à sa dignité. En lui proposant cette tâche, son supérieur le bafoue et le traite de roturier, ce qui lui est insupportable: « l'honneur commande avant tout de ne pas s'abaisser, de ne pas "s'avilir", de ne pas "se plier". Évoquant la soumission au Roi que l'on rencontrait sous l'Ancien Régime, Tocqueville insiste à maintes reprises sur le fait que, malgré un grand "degré de soumission", elle ne constituait nullement un "abaissement honteux", car on n'y trouvait nulle "bassesse du coeur" ( ... ) et il évoque l'image méprisable de l'obéissance servile, apanage du courtisan et du laquais, à laquelle toute âme qui n'est pas corrompue refuse de s'abaisser» (pp. 79-81). Philippe d'iribarne s'interroge en conclusion sur ce maintien des formes anciennes à travers les transformations profondes de la société. Et il retrouve Tocqueville qui affirme que les moeurs sont la structure la plus stable d'une société: « Il y a eu la nuit du 4 août... Et pourtant la logique des ordres, des corps et de l'honneur a largement survécu. Chaque fois que cette logique a été balayée par un mouvement violent de révolte, accompagné d'enthousiasme pour l'idée d'égalité des conditions et d'homogénéité de société, elle a refait surface. Pierre Bourdieu analyse de la même manière la Noblesse d'Etat fondée sur la théorie du don qui réconcilie démocratie et méritocratie.

13
L' analyse du pouvoir de l'administration préfectorale telle que Pierre Grémion l'a menée sous le titre du Pouvoir périphérique reprend et modernise l'analyse fouillée de Tocqueville sur les rapports des intendants, d'un côté avec le gouvernement et de l'autre avec les syndics des paroisses. Déjà l'intendant cherche des accommodements avec les usages locaux sans enfreindre la règle nationale : « Il brise rarement la loi, mais chaque jour il la fait plier doucement dans tous les sens, suivant les cas particuliers et pour la plus grande facilité des affaires. » En conclusion, « la loi n'était pas changée, la manière de l'appliquer variait tous les jours ». La description du corps des Ponts et chaussées est une introduction aux travaux de Jean-Claude Thoenig. En conclusion, on peut s'interroger sur ce qui fait l'extraordinaire actualité que Tocqueville a trouvé depuis vingt ans. Après la brutale désaffection qu'a connue le marxisme, il offrait une vision libérale de la société qui a séduit les doctrinaires du néolibéralisme. Le regain d'intérêt pour la philosophie politique l'a porté. Tant et si bien qu'il est cité aujourd'hui comme une référence obligée, comme un signe de reconnaissance, et en cela il a pris la place de Marx, parfois chez les mêmes auteurs. Pour le sociologue, l'extraordinaire présence de ses textes vient certes de la force de sa pensée, mais aussi de sa préoccupation constante pour l'actualité politique. Dans ses Souvenirs, écrits en 1850, deux ans après les événements, il s'interroge rétrospectivement sur son discours prémonitoire de janvier 1848. A lire ce discours aujourd'hui, il annonce la Révolution qui va éclater en février, or Tocqueville fait cette réflexion : « L'événement m'a plus promptement et plus complètement justifié que je ne prévoyais (...). Non, je ne m'attendais point à une révolution telle que nous l'allions voir; et qui eut pu s'y attendre? J'apercevais, je crois, plus clairement qu'un autre, les causes générales qui préparaient l'événement, mais je ne voyais pas les accidents qui allaient le précipiter. » Ce retour sur soi exprime en fait l'une des limites majeures de la compétence du sociologue: il n'est pas de son ressort de prévoir les événements. Par définition, le sociologue analyse le fonctionnement normal de la société puisqu'il cherche à dégager des régularités et à décrire des tendances. Or, les événements sont d'ordre historique, ils résultent d'un enchaînement imprévisible de faits, dont chacun est anodin mais qui font boule de neige pour arrêter le cours normal de la vie sociale. On reproche fréquemment aux experts de science sociale, économistes, politistes ou sociologues, de ne pas être capables de prévoir, reproche mal fondé sinon l'histoire serait prévisible et la liberté humaine réduite à la vie personnelle et domestique. Le journaliste qui commente chaque jour l'événement est mieux armé que le sociologue et, en effet, le 20 février, Émile de Girardin annonce à des amis que « dans deux jours la Monarchie de Juillet n'existera plus ». Tocqueville commente aussi cette prédiction : « Cela nous parût à tous hyperbole de journaliste, et l'était peut-être en effet, mais l'événement en fit un oracle. »










![TES 4156-4 2012-2013 [Compatibility Mode]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/587740241a28ab39348b64cb/tes-4156-4-2012-2013-compatibility-mode.jpg)