Spiritualité et réalisme merveilleux dans la littérature ... · iii Cette étude permet la mise...
Transcript of Spiritualité et réalisme merveilleux dans la littérature ... · iii Cette étude permet la mise...

Spiritualité et réalisme merveilleux dans la littérature caribéenne francophone: la (re)construction d’une identité
by
Sébastien Sacré
A Thesis Submitted in Conformity With the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
Département d’Études Françaises University of Toronto
© Copyright by Sébastien Sacré 2010

ii
Spiritualité et réalisme merveilleux dans la littérature antillaise : la
(re)construction d’une identité
Sébastien Sacré
Doctor of Philosophy Degree
Département d’Études Françaises University of Toronto
2010
Résumé
Si pour les ethnographes les mythes sont essentiels à la survie de toute société, cela pose
problème quand on considère la Caraïbe et la rupture de l’esclavage. Une étude de la littérature
antillaise réaliste merveilleuse nous montre que si les romans sont imprégnés par la spiritualité et
le folklore, nous n’y trouvons aucun mythe des origines. Comment une société peut-elle subsister
sans ces éléments fondamentaux ? Combinant une approche mythocritique à une mythanalyse
des œuvres d’auteurs antillais contemporains, nous émettons cette hypothèse : en s’inspirant de
multiples héritages, ils se constituent une identité par la reconstruction de mythes spécifiquement
antillais.
Vu l’absence de romans antillais contemporains dans les études du magical realism et du
réalisme merveilleux, notre première partie explore ce dernier concept pour en proposer une
nouvelle catégorisation : le réalisme mystique. Notre deuxième partie examine les principes
narratifs des romans en se demandant comment les auteurs parviennent à concilier un double
héritage oralité/écriture et à sauvegarder leur identité. Notre dernière partie illustre enfin
comment, par l’utilisation de schémas mythique spécifiques et un recentrement sur l’île natale,
les textes mettent en place sa (re)mythisation.

iii
Cette étude permet la mise à jour de nouveaux paradigmes dans la littérature antillaise
contemporaine. Elle montre comment le réalisme mystique est une modalité rattachée au magical
realism qui, combinant réalisme historico ethnographique et folklore local, s’applique
spécifiquement à la région des Antilles. Dépassant l’impossibilité théorique de transition de
l’oralité vers l’écriture, nous révélons aussi que l’utilisation de l’ « oraliture » par les écrivains et
le rôle de « guerriers de l’imaginaire » associé à certains d’entre eux propose une harmonisation
oralité/écriture de même qu’une sauvegarde identitaire. Enfin, nous voyons qu’un certain nombre
de romans réalistes mystiques proposent, outre une mise à distance de l’Afrique et de la France,
un nouveau mythe originel centré sur la traversée de l’océan et un passage matriciel par la cale
des négriers. Nous voyons également comment, loin de territoires d’acculturation comme les
plantations, les auteurs développent une restructuration mythique de l’espace, notamment par une
mise en valeur de la nature primordiale devenue propice à une renaissance identitaire.

iv
Remerciements
Je tiens à remercier mon directeur, le professeur Alexie Tcheuyap, ainsi que les
professeures Angéla Cozea et Suzanne Crosta, membres de mon comité, pour leur aide précieuse
et leurs conseils lors de la mise en œuvre de ce projet. Leurs connaissances, leur soutien, leur
enthousiasme et leur générosité ont fait de cette thèse une expérience enrichissante et
inoubliable. Je suis également reconnaissant au professeur Cilas Kemedjio pour ses
commentaires et conseils avisés.
Mes recherches ont pu être menées à bien grâce au soutien financier de l’Université de
Toronto, tout particulièrement son département d’Études Françaises et la School of Graduate
Studies, de même que la fondation Katie Keeler.
Enfin, je remercie ma compagne, Élise Morin, mes parents, José et Christiane Sacré et ma
famille (sans oublier Bakku), pour leur soutien durant ces dernières années. Cette thèse n’aurait
pu être réalisée sans leurs précieux encouragements.
Pour m’avoir tant appris, m’avoir ouvert les yeux au monde et m’avoir montré le chemin,
je voudrais remercier ceux qui, passés de l’autre côté, ont rejoint les Invisibles sans pour autant
nous quitter: mon mentor Frederick Ivor Case et ma grand-mère bien-aimée, Mady Bosserelle, à
qui je dédie cette thèse.

v
Table des Matières
RESUME .....................................................................................................................................................II
REMERCIEMENTS ................................................................................................................................ IV
TABLE DES MATIERES..........................................................................................................................V
LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES................................................................................................. XI
INTRODUCTION .......................................................................................................................................1
PREMIÈRE PARTIE
(RE)DÉFINIR LE RÉALISME MERVEILLEUX: POUR UNE
PERSPECTIVE CARIBÉENNE
CHAPITRE 1 LE REALISME DANS LES ROMANS REALISTES MYSTIQUES.........................24
1 APPLIQUER LA TERMINOLOGIE...............................................................................................24 1.1 DIFFICULTE DE DEFINITION ...........................................................................................................24 1.2 REALISME OU VRAISEMBLANCE? ..................................................................................................27 1.3 PREMIERES DIFFICULTES ...............................................................................................................29
2 LE REALISME ET LE MERVEILLEUX: REPRESENTATION IDENTITAIRE OU
ANTINOMIE? ...........................................................................................................................................31 2.1 PROBLEMATIQUE DU POINT DE VUE DU LECTEUR ET DE L’AUTEUR ..............................................31 2.2 LE RÉALISME, LE MONDE ANTILLAIS ET LE REGARD OCCIDENTAL...............................................33
3 LE REALISME HISTORIQUE ET ETHNOGRAPHIQUE DANS LES ROMANS ..................35 3.1 HISTOIRE ET REALISME..................................................................................................................35 3.2 VALEUR ET FONCTION DU REALISME ETHNOGRAPHIQUE..............................................................39 3.3 VALEUR ET IMPORTANCE DU REALISME ETHNOGRAPHIQUE .........................................................43

vi
CHAPITRE 2 MISE EN PERSPECTIVE DE LA MAGIE ET DU MERVEILLEUX......................48
1 REALISME MAGIQUE OU MERVEILLEUX ? UNE DISTINCTION PROBLEMATIQUE.48 1.1 PRESENTATION DU PROBLEME ET HYPOTHESE ..............................................................................48 1.2 HISTORIQUE DES TERMINOLOGIES.................................................................................................50 1.3 UN MODE DE REPRESENTATION ENTRE SPECIFICITE ET UNIVERSEL..............................................53
2 DEFINIR LA MAGIE ET LE MAGIQUE ......................................................................................65 2.1 LE MAGIQUE, LA MAGIE ET LEUR APPLICATION DANS LES ROMANS .............................................65 2.2 LA MAGIE ET LA PRESENCE DES ESPRITS .......................................................................................66 2.3 LA MAGIE COMME PHENOMENE ETHNOGRAPHIQUE......................................................................70
3 PREMIERE APPROCHE DU MERVEILLEUX ...........................................................................72 3.1 LE MERVEILLEUX CLASSIQUE........................................................................................................72 3.2 LE REALISME MERVEILLEUX SELON ALEJO CARPENTIER .............................................................76 3.3 LA VISION MERVEILLEUSE DE JACQUES STEPHEN ALEXIS............................................................80
CHAPITRE 3 POUR UNE REDEFINITION DU MERVEILLEUX...................................................84
1 LE MAGIQUE, LE MERVEILLEUX ET LES MYTHES ............................................................84 1.1 LA PENSEE MAGIQUE EN LITTERATURE : UNE CONVENTION ? ......................................................84 1.2 UNE PENSEE MAGICO-RELIGIEUSE RATIONNELLE ?.......................................................................88 1.3 UN REALISME MERVEILLEUX ONTOLOGIQUE ET MYTHIQUE .........................................................91
2 LA QUESTION ETHNOCULTURELLE........................................................................................94 2.1 LE REALISME MERVEILLEUX ET L‘IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DES MYTHES..................94 2.2 LE PRINCIPE DE ‘LIMINALITY’ ET L’IMPORTANCE DE LA SPIRITUALITE ........................................98 2.3 METTRE EN VALEUR LA DIFFERENCE CULTURELLE PAR LE FOLKLORE ET LA SPIRITUALITE ......100
3 NOUVELLE APPROCHE, NOUVELLE DEFINITION.............................................................101 3.1 LE PROBLEME DU TERME « MERVEILLEUX » DANS LA LITTERATURE ANTILLAISE .....................101 3.2 LA PERCEPTION DU REEL ET LE VECU ANTILLAIS ........................................................................104 3.3 INTRODUCTION D’UN « REALISME MYSTIQUE » ANTILLAIS ........................................................107

vii
DEUXIÈME PARTIE
MYTHES ET ROMANS, ORALITÉ ET ÉCRITURE: SPÉCIFICITÉS ET
PARADOXES DU RÉALISME MYSTIQUE
CHAPITRE 4 LES REPRESENTATIONS DE L’ORALITE HISTORIQUE DANS LES ROMANS
ANTILLAIS .............................................................................................................................................117
1 L’ORALITE ANTILLAISE : UN SYMBOLE DE SURVIE........................................................118 1.1 LE « TRANSBORD » ET LA SURVIE IDENTITAIRE ..........................................................................118 1.2 LE CONTEUR ET LA TRANSMISSION DE L’ORALITE DANS LE CADRE DE LA PLANTATION............121 1.3 LA MARQUE DU MAITRE...............................................................................................................127 1.4 MENSONGES ET FALSIFICATIONS : LES REPRESENTATIONS DE L’ECRIT DANS LES ROMANS.......129
2 FONCTIONS PREMIERES DE LA PAROLE DANS LES ROMANS ANTILLAIS...............133 2.1 L’ORALITE ET LE CONTE COMME SOULAGEMENTS......................................................................133 2.2 LA PAROLE : CARACTERISTIQUE HUMAINE ESSENTIELLE ET OUTIL DE SAVOIR .........................136 2.3 LA PRESERVATION DE L’IDENTITE ET DE LA MEMOIRE CULTURELLE .........................................139
3 PAROLES MAGIQUES, PAROLES SACREES ..........................................................................142 3.1 LE QUIMBOIS ET LE POUVOIR DE LA PAROLE DANS LES ROMANS...............................................142 3.2 PAROLE, SURNATUREL ET SPIRITUALITE .....................................................................................145 3.3 LA PAROLE SACREE DANS LES ROMANS ANTILLAIS ....................................................................149
CHAPITRE 5 DE L’ORALITE A L’ECRITURE : UNE IMPOSSIBLE TRANSITION? .............155
1 ECRIT ET ORALITE : UNE OPPOSITION TRADITIONNELLE ..........................................156 1.1 ÉVOLUTION DE L’ECRITURE ET RUPTURE CULTURELLE DANS LE MONDE ANTILLAIS.................156 1.2 DU CONTEUR A L’ECRIVAIN : LE REFUS DE LA CONTINUITE........................................................160 1.3 ORALITE ET ECRITURE : UNE OPPOSITION REELLE OU ESTHETIQUE ? .........................................166
2 DE L’ORALITE VERS L’ECRIT : LA NOUVELLE LITTERATURE ANTILLAISE ..........170 2.1 QUELQUES NUANCES SUR L’IMPOSSIBLE TRANSITION DE L’ORAL VERS L’ECRIT .......................170 2.2 S’ADAPTER ET ACCEPTER LE CHANGEMENT................................................................................172 2.3 L’ORALITURE ET LA LITTERATURE ANTILLAISE CONTEMPORAINE .............................................173
3 LE ROMAN COMME MANIFESTATION ECRITE DE LA PAROLE ...................................178

viii
3.1 LE ROMAN ANTILLAIS COMME « RECIT » ....................................................................................178 3.2 LES MARQUES DU CONTE ET DE L’ORALITE DANS LES ROMANS..................................................181 3.3 LE NARRATEUR, LE LECTEUR ET L’ORALITE ...............................................................................184
CHAPITRE 6 LE CONTEUR ET LE MARQUEUR DE PAROLE, LA CREATION D’UN
MYTHE ANTILLAIS .............................................................................................................................189
1 LE CONTEUR : UNE FIGURE ESSENTIELLE DE L’IDENTITE ANTILLAISE ................190 1.1 POUVOIR DE LA PAROLE, POUVOIR MAGIQUE : DISTINGUER LE CONTEUR DU QUIMBOISEUR.....190 1.2 UNE FIGURE SYMBOLIQUE DE LA RESISTANCE ............................................................................195 1.3 UNE FIGURE LITTERAIRE MYTHISEE ? .........................................................................................198
2 CONTEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : EVOLUTIONS ET TRANSFORMATIONS
DANS SOLIBO MAGNIFIQUE .............................................................................................................202 2.1 D’UNE FIGURE MYTHIQUE A UNE FIGURE TRAGIQUE ?................................................................202 2.2 PROBLEMATIQUE : UNE DISPARITION OU UNE TRANSFORMATION DU CONTEUR? ......................204 2.3 FONCTIONS DU CONTEUR DANS LE CONTEXTE ANTILLAIS : HYPOTHESES ..................................207
3 LE « GUERRIER DE L’IMAGINAIRE » ET LA CREATION DES MYTHES.......................210 3.1 CHAMOISEAU ET LE « MARQUEUR DE PAROLES » ......................................................................210 3.2 LE « GUERRIER DE L’IMAGINAIRE » ............................................................................................214 3.3 LE MARQUEUR DE PAROLES ET L’ECRITURE DES MYTHES DANS LES ROMANS : HYPOTHEES .....220
TROISIÈME PARTIE
LA RECONSTRUCTION MYTHIQUE ET IDENTITAIRE DE LA TERRE
NATALE DANS LES ROMANS ANTILLAIS
CHAPITRE 7 NI AFRICAIN NI FRANÇAIS: LA REECRITURE D’UNE GENESE ANTILLAISE
...................................................................................................................................................................229
1 REDEFINITION DE L’ORIGINE HISTORIQUE DANS LES ROMANS ANTILLAIS ........230 1.1 REPRESENTATIONS DE L’AFRIQUE DE LA NEGRITUDE A LA CREOLITE ......................................230 1.2 L’AFRIQUE ENTRE LE VAGUE ET L’OUBLI ...................................................................................234

ix
1.3 LA MISE A DISTANCE DE L’ORIGINE HISTORIQUE DANS LES ROMANS .........................................240 1.4 LE REJET PAR L’ORIGINE..............................................................................................................244 1.5 RAPHAËL CONFIANT ET LE REGARD SUR L’INDE ET LA CHINE ..................................................247
2 SPIRITUALITE ET IDENTITE ANTILLAISES EN METROPOLE .......................................252 2.1 L’EXIL VERS LA FRANCE ET LA DECOUVERTE DE L’ALTERITE ....................................................252 2.2 FANTASME, ACCULTURATION ET ALIENATION DANS LES ROMANS DE GISELE PINEAU..............256 2.3 LE RETOUR MAGIQUE VERS LA TERRE NATALE ...........................................................................260
3 LE TRANSBORD, LE NAVIRE NEGRIER ET L’OCEAN DE LA TRAVERSEE : MISE EN
PLACE D’UN MYTHE DES ORIGINES.............................................................................................264 3.1 HISTOIRE ET ARCHETYPE.............................................................................................................264 3.2 CARACTERISTIQUES THEMATIQUES DU MYTHE ANTILLAIS DES ORIGINES..................................268 3.3 L’OCEAN, LA RENAISSANCE ET L’UNITE IDENTITAIRE ................................................................274
CHAPITRE 8 UNE ILE DE SOUFFRANCE: LE MYTHE ET LA TERRE NATALE..................280
1 LES DIFFICULTES DE L’IDENTIFICATION A LA TERRE NATALE ................................282 1.1 LES DIFFICULTES DE L’APPARTENANCE A UNE TERRE NON ORIGINELLE ....................................282 1.2 L’INFERIORISATION LITTERAIRE DES ANTILLES..........................................................................287 1.3 L’EXOTISME ET LES EFFETS DE LA COLONISATION......................................................................290 1.4 L’ILE PRISON ET L’ANTI-EXOTISME .............................................................................................294
2 L’ « EN HAUT » ET L’ « EN BAS » : RETROUVER SA PLACE DANS LE MONDE
ANTILLAIS .............................................................................................................................................297 2.1 DU SYSTEME DES PLANTATIONS A LA CANNE A SUCRE : UN MYTHE MONSTRUEUX DES ORIGINES ?
…………………………………………………………………………………………………. 297 2.2 MYTHES ET FOLKLORE DANS LA VILLE ANTILLAISE ...................................................................304 2.3 DE LA FUITE DU MARRON A LA SEPARATION DU MONDE ANTILLAIS...........................................308 2.4 UNE DIVISION SYMBOLIQUE DU MONDE ......................................................................................311
3 LA MORT, LE REALISME MYSTIQUE ET L’IDENTITE ANTILLAISE ............................315 3.1 LA MORT ET LE RETOUR AUX ORIGINES ......................................................................................315 3.2 TI JEAN L’HORIZON ET LE MONDE DES MORTS EN AFRIQUE ET AUX ANTILLES ..........................317 3.3 REALISME MYSTIQUE, MORT ET IDENTITE AUX ANTILLES..........................................................323

x
CHAPITRE 9 L’HOMME ET LA NATURE: DE LA RE-MYTHISATION DE LA TERRE
ANTILLAISE A LA NOTION D’IDENTITE ......................................................................................331
1 MARRON, QUIMBOISEURS ET L’ISOLEMENT MAGIQUE DE LA NATURE................332 1.1 LE QUIMBOISEUR : DE L’HERITAGE AFRICAIN A L’IDENTITE ANTILLAISE...................................332 1.2 LE MARRON : UNE FIGURE HISTORIQUE ET LITTERAIRE ..............................................................338 1.3 LA MISE EN PLACE DU MYTHE DU MARRON.................................................................................342 1.4 LE MARRON COMME MYTHE ANTILLAIS ......................................................................................346
2 NATURE SAUVAGE ET PRIMORDIALE : DU REFUGE DU MARRON AU REFUGE DE
L’IMAGINAIRE .....................................................................................................................................348 2.1 LA NATURE: REFUGE DES ESPRITS ET DU SURNATUREL ..............................................................348 2.2 UNE NATURE VIVANTE ET PERSONNIFIEE ...................................................................................352 2.3 DE L’ANIMISME TRADITIONNEL A L’UNIVERSALITE....................................................................354 2.4 LA CROISEE DES MONDES ET LE REFUGE DE L’HOMME ANTILLAIS .............................................356
3 L’HOMME ANTILLAIS, LA NATURE ET LA TRANSCENDANCE : UN ULTIME ESPOIR
IDENTITAIRE ? .....................................................................................................................................359 3.1 LE LIEN PHYSIQUE A LA NATURE ET LE CHEMINEMENT INITIATIQUE..........................................359 3.2 L’EAU ET LE RETOUR MATRICIEL A LA NATURE..........................................................................363 3.3 PATRICK CHAMOISEAU ET L’ECRITURE DE LA QUETE IDENTITAIRE ...........................................366
CONCLUSION ........................................................................................................................................376
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................383
DOCUMENT ANNEXE I .......................................................................................................................401
DOCUMENT ANNEXE II .....................................................................................................................402

xi
Liste des documents annexes
Journal France-Antilles, Jeudi 25 Février 1965.
Journal Clartés, No 103, Samedi 3 Janvier 1948.

1
Introduction
Le mythe et la culture antillaise
Situation de départ : la rupture et l’histoire
Toute société humaine, quelle qu’elle soit, a besoin de mythes, d’un lieu mais aussi d’un
temps des origines. Puisque les mythes constituent une « somme de savoir utile » (Eliade, 1988 :
157) et d’actes déjà accomplis dont on doit s’inspirer pour une expérience pleinement humaine,
l’oubli ou la destruction de cette « mémoire collective » (Idem.) relèveraient, pour tout individu,
du désastre. Sans origine à laquelle se raccrocher, celui-ci perdrait inévitablement sa substance
et son identité. La région Caraïbe, et en particulier des îles comme la Guadeloupe et la
Martinique, est au cœur de cette problématique car son histoire est d’abord celle d’une rupture :
l’esclavage. Pendant plusieurs siècles, cet enlèvement a été suivi d’une longue et éprouvante
traversée de l’océan dont les seules issues possibles étaient, pour les captifs, le suicide, la mort
ou la dépersonnalisation imposée par un Code Noir (1685) déclarant « les esclaves êtres
meubles » (Sala-Molins, 2006 : 178). Il y a donc eu une histoire commune pour ces peuples
africains qui, arrachés de force à leur terre natale, ont été réduits en esclavage. À la souffrance
de ces « populations issues de la rapine, de la violence », de ces « corps lacérés, écorchés,
martyrisés, démembrés, éparpillés puis reconstitués vaille que vaille » (Gracchus, 1986 : 35),
s’est ainsi ajoutée une violence sociale, spirituelle et culturelle. Familles et individus ont ainsi

2
fait l’expérience d’une acculturation1 accentuée par les viols, les humiliations et la destruction
des liens sociaux et des structures familiales et dont on n’a que quelques rares témoignages, dont
celui d’Ottobah Cugoano : «les épouses sont arrachées avec violence des bras de leurs maris.
Les esclaves sont-ils livrés à leurs tyrans, les pères, les mères pressent leurs enfants contre leur
sein, les baignent de larmes. Il ne leur est pas permis de pleurer longtemps ; l’oppresseur les
enlève ; ils perdent tout, jusqu’à l’espérance de se revoir » (cité par Salas-Molin, 2006 :105).
Comme tous les documents étudiant l’esclavage, ce témoignage montre comment chaque aspect
du système esclavagiste n’avait qu’un seul but, l’anéantissement des individualités, afin de
réunir les esclaves sous deux éléments jugés essentiels par les colonisateurs français : la religion
catholique (qui a suscité la disparition d’anciens rites et contes africains devenus incompatibles
avec la foi nouvelle) et la langue française qui, basée sur l’écriture et le Livre (la Bible), a eu des
effets dévastateurs sur l’oralité traditionnelle. Devant un tel processus de déshumanisation, on
peut se demander si les croyances et les rites originels de ces esclaves ont pu se transmettre et se
conserver au fil du temps, s’ils se sont adaptés ou s’ils ont, au contraire, carrément disparu.
Selon Robin Horton, cette problématique est d’autant plus importante dans le cas de cultures
dites traditionnelles car celles-ci souffrent de ce qu’il appelle une « situation fermée » qui, par
l’absence de la notion de savoir alternatif, les menace de destruction :
Dans les cultures traditionnelles, il n’y a aucune conscience de savoirs alternatifs au système théorique
établi tandis que dans les cultures à orientation scientifique, la conscience de savoirs alternatifs est très
vive […] L’absence d’une conscience de savoirs alternatifs a deux conséquences : – d’un côté, il
encourage l’acceptation totale de la théorie établie et empêche toute interrogation sur cette théorie qui
1 Pour le terme « acculturation » nous nous référerons à l’approche de Melville H. Herskovits qui, dans Acculturation. The Study of Culture Contact, la définit comme les phénomènes qui résultent de la rencontre directe de deux cultures différentes, et les changements qui en résultent dans les systèmes culturels des deux groupes ou de l’un d’eux.

3
devient, dès lors, « sacrée » ; – d’autre part, tout défi à la théorie établie est une menace de chaos et
provoque une inquiétude profonde. (Horton, 1990: 55).
Théoriquement, les principes d’acculturation pratiqués par le système esclavagiste (ou, après la
fin de l’esclavage, par l’influence de la Métropole) auraient donc remis en cause tous les aspects
sociaux et culturels des populations déportées ou dominées2 tout en menaçant de chaos la survie
d’éléments culturels et identitaires aussi essentiels que les mythes et la spiritualité. Cependant, si
l’on se pose la question, essentielle, du devenir identitaire et culturel de ces « corps bricolés »
(Gracchus, 1986 : 35), il serait faux de croire que Le Code Noir, le système plantationnaire et
l’influence française ont complètement effacé la mémoire culturelle de ces peuples déportés.
Comme on peut le lire dans la conversation entre La Roche et Senglis dans Le Quatrième Siècle
d’Edouard Glissant, ces populations « transmettent toujours quelque souvenir de leur ancien
état» (Glissant, 1997a: 58). En effet, malgré le passage du temps, l’esclavage et l’intégration à la
France, une partie des anciennes croyances a survécu aux multiples épreuves de l’Histoire –
notamment grâce à ces « petits dieux montés à bord, cachés au fond des vaisseaux négriers sous
forme d’effigie, de statuette, voire sans aucune forme du tout, simplement présents dans les
cœurs » (Henry Valmore, 1988: 12) – et on en retrouve encore aujourd’hui des traces dans les
contes et les romans antillais. Ainsi, si la mémoire culturelle a été, dans les cas les plus extrêmes
d’acculturation, réduite à l’état de « traces, ou sous forme de pulsions ou d’élans » (Glissant,
2002 : 42) ou si elle a, sous la contrainte, poussé les populations transbordées à « critiquer (à
désacraliser) sous les parages de la dérision ou de l’approximation ce qui, dans l’ancien ordre
des choses, était le permanent, le rituel, la vérité de son être » (Ibid. : 41), la situation extrême de
2 Un système semblable, quoique bien moins violent, a également accompagné la fin de l’esclavage quand de nouveaux migrants tels les engagés Indiens ou les immigrés Chinois et Syriens ont dû se plier aux exigences culturelles des forces au pouvoir et subir une forme d’acculturation qui, bien que moins violente que l’esclavage, a été néanmoins, comme nous le verrons plus loin, bien réelle.

4
l’esclavage a pourtant permis, par certaines libertés3, la survie d’une forme de mémoire
culturelle dont témoignent aujourd’hui la richesse de la religion Vodou en Haïti ou la vitalité de
la littérature antillaise contemporaine. Comme le notent, entre autres, Simonne Henry Valmore,
Édouard Glissant ou encore Melville Herskovits, le passage de l’Afrique aux Caraïbes n’a donc
pas été une rupture totale mais a permis une forme de continuité spirituelle, mystico-religieuse,
basée par exemple sur un phénomène de transmission du savoir ou un sentiment de lutte contre
l’autorité coloniale : « the reluctance to accept slave status might also have encouraged the
slaves to retain what they could of African custom to a greater extent than would otherwise have
been the case » (Herskovits, 1959 : 86). Cette forme de résistance, facilitée et encouragée par
l’oralité, la mémoire et par la forme même de la magie (qui est «almost by its very nature
adapted to ‘‘going underground’’, and was a natural prop or revolt » [Ibid. : 138]) a donc été un
moyen de survie identitaire et culturelle. Ainsi les esclaves n’ont pas subi leur condition en
silence et, même si l’article 16 du Code Noir interdisait les réunions ou regroupements, ils se
réunissaient quand même « de façon très désordonnée aux débuts des expériences coloniales ; de
façon de plus en plus méthodique au fur et à mesure que les habitations se multipli[ai]ent et les
ateliers, que le nombre d’esclaves augment[ait], que, loin des plantations, les marrons
s’organis[ai]ent » (Sala-Molins, 2006 : 122). C’est ainsi qu’il y a eut des révoltes avant même la
création du Code Noir et que, entre réalité et exagération, la peur des sorciers et de la vengeance
des esclaves par l’empoisonnement des maîtres et du bétail s’est peu à peu répandue. C’est aussi
à ce moment qu’une forme de « pouvoir parallèle, braqué contre l’autorité blanche » (Ibid. :
123) a commencé à animer une part de la vie des esclaves, en particulier par l’intermédiaire de
conteurs inspirés à la fois par leurs origines ainsi que par leur douloureuse condition.
3 Comme le note Melville Herskovits, les libertés accordées aux esclaves n’étaient pas toujours les mêmes: « the freedom of the slaves to conduct their own services without white supervision was always greater than their freedom to work or organize politically» ( Herskovits, 1959 : 137).

5
Considérant cette situation complexe, nous pouvons nous demander : comment, de la rupture à
la traversée, de l’acculturation esclavagiste à la révolte et de la fin des plantations à la
modernité, les mythes originels ont survécu, se sont-ils transformés ? Entre mémoire et oubli,
l’étude des conséquences de l’esclavage sur la mémoire culturelle apparaît comme essentielle
dans l’étude de l’identité antillaise. Si cette rupture identitaire irrémédiable est un fondement
pour tous ceux qui descendent des esclaves et sont nés aux Antilles, engendre-t-elle pour autant,
dans les romans, un vide de la mémoire culturelle ou, au contraire, la richesse et la diversité
d’une véritable identité antillaise ?
Par leurs utilisations de contes, d’un folklore et d’une spiritualité antillaise, ainsi que par
leur représentation de la période esclavagiste et de ses conséquences, il se pourrait que les
romans réalistes merveilleux antillais constituent un exemple culturel intéressant. Écrits par des
auteurs fascinés par les notions d’origine, d’identité et d’appartenance, ces romans pourraient en
effet nous permettre d’étudier les conséquences de l’esclavage, les fonctionnements de la
mémoire culturelle et la notion d’identité antillaise contemporaine. C’est ainsi que, suivant cette
ligne directrice, notre étude se focalisera sur les manifestations du mythe, de la légende et du
conte dans les romans réalistes merveilleux antillais, ainsi que sur les éventuelles (re)créations
ou adaptations de ces éléments à un milieu spécifiquement antillais. En effet : comment ces
marques de culture, de l’identité d’un peuple, ont-elles traversé les tentatives d’acculturation
imposées par l’esclavage pour se retrouver dans les romans réalistes merveilleux ? Ont-elles
survécu intactes? Se sont-elles transformées ? Avant d’aller plus loin dans l’approfondissement
de ce questionnement, il conviendrait d’abord de définir le mythe et ses caractéristiques
principales qui, pour être tout être parfois confondues avec celles du conte ou de la légende, en
diffèrent sensiblement.

6
Le Mythe et sa définition
D’après les études menées par les ethnologues et anthropologues, le mythe possède, dans
le monde contemporain, différentes définitions qui, par leur tendance à le percevoir comme une
fiction, déforment sa valeur originelle. C’est une réalité complexe et multiple, une « dramatic
human tale » (Chase, 1960 : 128) interprétable de différentes façons. La définition
ethnographique la plus répandue insiste cependant sur le caractère sacré du mythe qui : « relate
un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘‘commencements’’
[…]. En somme, les mythes décrivent les diverses, et parfois dramatiques, irruptions du sacré
(ou du ‘‘sur-naturel’’) dans le Monde » (Eliade, 1988 : 16-17). Considéré comme une histoire
sacrée, le mythe est également une « histoire vraie » parce que, comme le précise Eliade, il se
réfère toujours à des réalités: « le mythe cosmogonique est ‘‘vrai’’ parce que l’existence du
monde est là pour le prouver » (Ibid. 17). Cette distinction est particulièrement intéressante dans
le contexte de l’esclavage et du monde antillais contemporain puisque deux visions du
mythe semblent s’y opposer: l’approche des sociétés traditionnelles qui les considèrent comme
vrais et donc « vivants » ; et l’approche « occidentale » qui ne les perçoit que comme des
fictions, des histoires inventées, à l’image des mythes urbains4 (aussi appelés légendes urbaines)
étudiés par certains sociologues comme Edgar Morin (La Rumeur d’Orléans) ou des folkloristes
comme John Harold Brunvand (The Vanishing Hitchhiker). Selon Eliade, les mythes seraient
ainsi, comme les légendes urbaines, associés à une « fictionalisation » qui remonterait au
processus de démythisation apparu chez les Grecs depuis Xénophane qui, le premier, a critiqué
les expressions mythologiques liées à la divinité telles qu’elles étaient, par exemple, utilisées par
4 Il s’agit de récits transmis le plus souvent oralement et qui sont aujourd’hui très répandus en Europe et en Amérique du Nord. Des aventures macabres qui, même si elles sont toujours arrivées « à l’ami d’un ami » sont cependant considérées comme de pures inventions auxquelles on ne croit qu’un temps.

7
Homère. Le mythos a donc été opposé très tôt au logos puis à l’historia, si bien qu’il a perdu
toutes ses valeurs religieuses et métaphysiques. C’est ainsi qu’il y a, en Occident5, une
différence essentielle entre le mythe et l’histoire, mais aussi entre le mythe et les sciences, si
bien que, pour l’homme moderne occidental, le volcanisme n’est pas le fait d’un dieu travaillant
à sa forge, ou le réveil d’un dragon, mais un phénomène géologique. Devenant des « histoires
fausses » ces phénomènes ont ainsi perdu leurs valeurs surnaturelles et symboliques ainsi que
leur portée dans la conscience populaire. Bien évidemment, cette « fictionalisation » n’est pas
universelle : il suffit de lire des romans réalistes merveilleux caribéens comme L’Homme au
Bâton d’Ernest Pépin ou Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre pour se heurter à une
vision non-occidentale du folklore et des mythes dans laquelle les créatures folkloriques et les
rituels magiques sont perçus comme des réalités par les narrateurs et les personnages.
Le Mythe vu par les sociétés « traditionnelles »
Il y a donc plusieurs façons de percevoir le mythe – aussi bien en littérature que dans le
quotidien – et la vision du mythe comme fiction n’est pas universelle, comme on peut le voir
avec le phénomène zombi en Haïti. Si les histoires concernant ces individus humains privés de
leur âme sont, avant de devenir des sujets de romans, des récits oraux ou des rumeurs à la
manière des mythes urbains occidentaux, leurs interprétations mythiques et spirituelles peuvent
cependant être très différentes. En effet, comme on peut le voir dans le roman Hadriana dans
tous mes rêves de René Depestre, certains considèrent le zombi comme la manifestation d’une
maladie mentale ou comme une image métaphorique de l’esclavage alors que d’autres, comme
une partie de la population haïtienne, ne doutent pas de son existence. Pour de nombreux
5 En parlant de l’Occident nous nous référerons, étymologiquement, à la partie du monde qui est au couchant, donc l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord.

8
individus, en effet, il fait partie du quotidien et les journaux mentionnent souvent l’histoire de
familles retrouvant par hasard, dans le jardin d’un bokor, le zombi d’un proche qu’ils croyaient
mort et enterré. Ainsi, selon les principes de la pensée mythique traditionnelle, les zombis sont
réels et c’est cette croyance qui rend possible leur existence dans les romans :
Car c’est en fonction de ces croyances que sont possibles les récits sur ces personnages ou leurs actions. Il
n’y a de zombification possible que dans le cadre de la croyance vodouesque à une division de l’âme
humaine en petit et gros bon-anj et donc à la possibilité de se saisir de l’une de ces deux forces pour
commander au destin d’un être humain (Laroche, 2002 : 15-16).
Si le principe de croyance est là, notons cependant que les récits de zombification ne racontent,
contrairement aux mythes, aucune histoire originelle ou sacrée. Ils peuvent avoir des
significations historiques, culturelles et sociales qui leur permettent de quitter la sphère de la
croyance religieuse pour mobiliser la croyance des Haïtiens « vodouisants ou non, de manière
consciente ou inconsciente » (Ibid. : 16), mais ils n’ont en aucun cas une valeur sacrée à
proprement parler. Cela ne les empêche cependant pas d’influencer, tout comme les mythes,
certains aspects de la vie ou de la société et de fournir « des modèles de conduites humaines et
[de] conf[érer] par la même signification et valeur à l’existence » (Eliade, 1988 : 12). On le voit
ainsi dans le Code Pénal Haïtien qui, même s’il ne mentionne pas le mot zombi, n’en condamne
pas moins les différentes étapes du rituel de zombification :
Art. 246.- […]
Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de
substances qui sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins prolongé, de quelque
manière que ces substances aient été employées et quelles qu'en aient été les suites. Si, par suite de cet état
léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié assassinat.- C. pén. 241 et suivant. Ainsi
mod. Loi 27 Oct. 1864.

9
En Haïti, le zombi et son rituel font donc partie de la vie, du foyer familial jusqu'à l’État
lui-même, ce qui le rend réel pour une partie de la population. Notons que ce genre de
phénomène est présent dans toutes les Antilles et qu’on en retrouve des exemples dans différents
journaux de la Martinique et de la Guadeloupe. C’est ainsi que le journal France-Antilles du
jeudi 25 février 1965, annonça la mort de Faustin Homat, surnommé « Gran-Zongle », « le plus
grand sorcier de la Martinique » (cf. Annexe 1). Des histoires folkloriques qui, bien qu’elles ne
soient pas des mythes, illustrent cette différence principale entre la pensée mythique occidentale
et l’approche des sociétés traditionnelles.
Distinguer les mythes, les contes et les légendes et le folklore
Parler des mythes, semble-t-il, conduit souvent à parler des légendes, des contes ou du
folklore, des notions qui, sans une définition appropriée, tendent à se confondre dans le langage
courant et qu’il conviendrait de différencier. Prenons d’abord la notion de folklore qui, comme
le mythe, semble n’être qu’un terme fourre-tout. De l’anglais folk : peuple et lore : science,
savoir, le folklore peut se définir comme l’ensemble des productions collectives émanant d’un
peuple, se transmettant d’une génération à l’autre par voie orale (avec des contes, des récits ou
des croyances) ou par l’exemple (avec les rites de la vie quotidienne). Cette définition se
rapproche de celle de Maximilien Laroche qui le décrit comme « people’s wisdom, a shared
understanding of one’s truth » (Laroche, 1994 : 341) et comme une substance à la base du
processus créatif « in the sense of oral and popular traditions that inspire writers [and] that are
used as models for their own work» (Ibid. : 341-342). Il y aurait ainsi un lien entre les mythes et
le folklore puisque « le contenu même du folklore est de nature mythique, non qu’il constitue
une mythologie organisée en système, mais plutôt un matériau mythique avec lequel on peut
créer des formes diverses à fonctions multiples » (Belmont, 1989 : 601). Nous retrouvons donc
ici un des principes créatifs que l’on retrouve à la base des romans de notre corpus qui, comme

10
avec le phénomène zombi, utilisent des éléments folkloriques même si ceux-ci n’ont pas de
valeur mythique.
Une autre distinction qui n’est pas toujours évidente à faire est celle qui différencie les
mythes des légendes. Bien que souvent confondues, ces deux types de narrations se
différencient d’abord par leur forme puisque « la légende est d’abord ce qui mérite d’être lu, ce
qu’il faut lire (en latin, legendum). [Si bien qu’e]lle possède donc nécessairement une forme
écrite » (Walter, 2005 : 59) à laquelle s’ajoute une utilisation du merveilleux et une certaine
portée spirituelle et morale. Ce rapport à l’écrit plutôt qu’à l’oral est important dans le contexte
de notre recherche puisqu’il rapproche la légende de l’histoire et que, comme nous le verrons,
les romans de notre corpus combinent précisément écrit et oralité. Cette différence va même
plus loin puisque si le mythe se déroule en des temps immémoriaux et imprécis, la légende se
déroule le plus souvent dans un lieu et un temps précis et réels. Elle est soit d’inspiration
historique récente – ce qu’Isidore Okpewho appelle la « historic legend » (Okpewho, 1983 : 60)
– soit de création ancienne et mythique – ce qu’il nomme la « ‘mythic’ legend » (Ibid : 61).
Cette distinction est donc importante puisque, par leur mention de dates ou de lieux avérés ou,
au contraire, par leur indétermination les romans de notre corpus pourraient, dans leurs jeux
entre mythes et histoire, se rapprocher des deux types de légendes proposés par Okpewho.
Le conte, quant à lui, propose une définition bien différente. Récit principalement oral, il
est par là même proche du mythe: « le conte est avant tout ce qui se raconte. Il peut rejoindre sur
ce plan le mythe ethnoreligieux dont la fonction première n’est pas d’être fixé par l’écriture
mais d’être commémoré rituellement par une liturgie dans un temps et dans un espace sacrés »
(Walter, 2005 : 60). De plus, contrairement à la légende et à l’histoire, les contes se déroulent,
comme les mythes, en des temps et des lieux imprécis ou imaginaires : « here, the creative
imagination can afford to be liberated of the constraints of time and rationalization » (Okpewho,

11
1983 : 65). N’étant cependant que « purely imaginary, having no other aim than the
entertainment of the hearer and making no real claim on his credulity» (Chase, 1960 : 130), le
conte ne propose donc pas, comme le mythe, un récit sacré mais une histoire profane et parfois
didactique à la manière des histoires que l’on retrouve dans le recueil Au temps de l'antan :
contes du pays Martinique de Patrick Chamoiseau. La différence avec le mythe n’est cependant
pas totale. En effet, malgré ces différences le conte serait, par un procédé évolutif, une
« probable rémanence de mythe [qui] continue d’avoir une vie orale indépendante malgré
d’éventuelles transpositions écrites » (Walter, 2005 : 60). Malgré ces quelques rapprochements,
la différentiation entre ces deux types de récits est cependant loin de faire l’unanimité puisque si
certains mythologues comme Dumézil ne différencient pas complètement les mythes et les
contes, d’autres comme Mircea Eliade les opposent. Ainsi, pour ce dernier, si les mythes sont
considérés dans les sociétés traditionnelles comme des histoires vraies mettant souvent en place
des oppositions cosmologiques ou métaphysiques, les contes, au contraire, seraient des histoires
fausses mettant en place des oppositions sociales ou morales. Ces deux éléments se
différencieraient donc par leur contenu mais également par la façon dont ils sont
racontés puisque « tandis que les ‘‘histoires fausses’’ peuvent être racontées n’importe quand et
n’importe où, les mythes ne doivent être récités que pendant un laps de temps sacré… » (Eliade,
1988 : 22).
Pour résumer, le mythe est donc principalement une croyance qui, comme l’indique
André Jolles dans Formes simples, précède toujours la légende et le conte. Originel, il les fonde
et les inspire si bien que la légende serait une plongée du mythe dans le temps de l’Histoire et
que le conte serait, au contraire, « une sorte de mythe dégradé ou profané, émietté et disséminé »
(Walter, 2005 : 61) notamment, comme l’a remarqué Evguéni Mélétinski, par la
démythologisation de l’action. Si comme l’a vu Vladimir Propp, le conte merveilleux est

12
mythique car « dans sa genèse, [il] se fonde sur le mythe » (Mélétinski, 1970 : 212), les contes
pourraient être perçus comme des palimpsestes dans lequel se cache une mythologie sous-
jacente. À la lueur de ces éclaircissements, la complexité des romans de notre corpus commence
à apparaître : puisant dans le folklore, les romans semblent à première vue mêler le caractère
historique de la légende (par leur ancrage dans l’histoire) et l’imaginaire des contes à un aspect
relativement profane. Plus complexe qu’il n’y paraît, ce mélange serait lié à la nature même des
éléments narratifs composant les romans qui, par leur nature, fusionneraient ou évolueraient
d’une forme à l’autre.
Le problème de la notion de mythe aux Antilles
Si les définitions du mythe sont relativement claires, la notion elle-même pose
cependant, dans le contexte antillais, un problème. En effet, si les mythes racontent une origine,
une création du monde, on peut noter que c’est précisément cette notion d’origine qui a été
historiquement bouleversée par la colonisation des îles, la rupture de l’esclavage puis par la
départementalisation. On le voit d’abord dans l’espace géographique et culturel originel des îles.
Originellement peuplées de Caraïbes ou Arawaks, qui n’ont, après leur extermination par les
colons, laissé pratiquement aucune trace. Par conséquent, ces îles virtuellement sans mythes ni
civilisations, quasiment vides d’histoires et de spiritualité ont été prises en main par les colons
européens et leurs esclaves africains. Cet élément est essentiel car c’est ce qui distingue la
situation des Antilles françaises de celle d’îles ou de pays dans lesquels esclaves et Amérindiens
ont pu être en contact ou, comme à la Dominique, dans lesquels des communautés
amérindiennes « existent » encore. Par bien des aspects, il apparaît donc que la colonisation des
Antilles est très différente des colonisations de l’Amérique du Sud ou de l’Afrique, dans
lesquelles les civilisations et sociétés présentes à l’arrivée des colons ont été envahies sur leurs
propres terres. Ces territoires colonisés n’étaient donc pas vides comme les Antilles mais déjà

13
chargées de mythes et d’histoires. Leurs cultures, présentes sous la forme de monuments, de
villes ou de manuscrits, étaient si profondément enracinées dans l’espace qu’elles n’ont pas été
éliminées par la colonisation. C’est ce que l’on le voit par exemple avec le Popol Vuh, un livre
de mythologie Quiché qui, malgré sa traduction en espagnol, a survécu à la colonisation. Ainsi,
à part quelques rares traces amérindiennes sous la forme de poteries, de vocabulaire ou encore
de technique de pêche il n’y a, dans le cas des Antilles françaises, nulles racines culturelles
véritables: arrivant sur une terre sans mythe, les colons et leurs esclaves n’ont pu évoluer
culturellement qu’à partir de la rupture initiale et du système colonial. De ce fait si, comme le
propose Raphaël Confiant, « le mythe fonde l’autochtonie » (Confiant, 1998 : 9) parce qu’il
fonde l’origine des peuples et déroule une généalogie tout en légitimant la présence des hommes
sur leur sol, le cas Antillais pose un problème particulier :
Le monde créole […] n’a pas élaboré de discours des origines car justement ces dernières furent
brouillées, malaxées, remodelées de manière anarchique et imprévisible dans le formidable maëlstrom de
la créolisation selon l’expression d’Édouard Glissant (1981). Ici, point d’origine fabuleuse, de connivence
avec les Dieux (ceux des Amérindiens et des Nègres seront détruits par ceux du Blanc qui, en
l’occurrence, se comporteront en créatures diaboliques). Point de prestige, de généalogie, de lignage sacré,
de « sang bleu », de « quartiers de noblesse ». Mais le mélange absolu, la bâtardise, l’oubli, la honte ou la
dissimulation des origines (Confiant, 1998 : 9-10).
Si le folklore caribéen regorge de créatures et d’êtres surnaturels, les mythes des origines
n’apparaissent pas et semblent absents. Dans les romans réalistes merveilleux de notre corpus
aucun mythe ne raconte, par l’intervention des dieux ou d’êtres surnaturels, les origines
africaines des esclaves, leur enchaînement à l’esclavage ou l’origine de leurs maîtres. De plus,
aussi loin que peuvent remonter les romans, ils ne présentent jamais le temps primordial des
origines, celui des dieux. Au contraire, ils se déroulent tous, sauf peut-être Ti Jean l’Horizon,
dans un passé historique relativement récent, ne remontant presque jamais au-delà du temps de

14
la traversée ou de la plantation. Ainsi, au-delà de l’Histoire connue, celle des livres, aucun
mythe des origines ne semble s’appliquer aux sociétés décrites dans les romans. Pour les
générations qui n’ont pas été transbordées depuis l’Afrique mais qui sont nées dans les îles
caribéennes, la notion d’origine se révèle alors problématique : en devenant leur lieu de
naissance – et donc leur origine – ces îles ont fait perdre à l’Afrique, l’Europe, l’Inde, la Chine,
la Syrie ou le Liban leur statut de terre d’origine. Contrairement aux définitions classiques du
mythe, les origines des populations des Antilles sont donc non pas sacrées mais profanes et ont
été créées en des temps relativement récents (et non primordiaux) par des humains (et non des
dieux ou des êtres surnaturels). Loin de toute notion de mythe, les sociétés antillaises sont donc
des cultures essentiellement « jeunes » nées de la période coloniale et d’un vide culturel
préexistant. Sans origine mythique définie, acculturées, elles seraient théoriquement incapables
de se tourner vers leur passé : « the inhabitants of the Caribbean have everything to invent, as
they cannot return to a particular culture or tradition» (Praeger, 2003 : 1-2). Dans ce contexte
particulier, la problématique est donc la suivante : comment les auteurs ont-ils fait face au
manque de mythes originels, si essentiels au renforcement identitaire de toute civilisation, quand
leurs ancêtres « ne disposai[en]t d’aucune bibliothèque, ni mémoire de griots, ni vieux chants de
trouvères, ni sagas dénombrées » (Chamoiseau, 1997 : 192), quand la société dont ils sont issus
a dû subir les effets de la colonisation et de l’esclavage et quand des générations d’esclaves ne
sont plus sont nées en Afrique mais dans la Caraïbe ? Comment une identité et une culture
antillaise ont-elles pu naître et se développer dans leurs romans ?
C’est en suivant cette ligne directrice et la notion de quête identitaire que nous tenterons
de voir comment, au-delà d’une créativité pure, les romans antillais reprennent certaines figures
mythiques ou encore certains aspects de l’Histoire afin de les « mythiser » par l’écriture réaliste
merveilleuse. Nous verrons ainsi comment, dans leurs multiples questionnements historico-

15
culturels, ces romans illustrent les théories de Maximilien Laroche sur « l’homme
américain » (terme prenant en compte tout le continent) qui, parce qu’il a été forcé de
recommencer son histoire, s’efforce dans ses œuvres « de découvrir le sens de ce
recommencement » si bien que toutes ses « fabulations, même à partir de faits vécus, ne doivent
pas, compte tenu de la jeunesse de son expérience historique, être prises pour autre chose que
cette tentative d’interprétation de son nouveau destin » (Laroche, 1970 : 231). Etudiant les
romans antillais, nous allons donc tenter de voir comment les auteurs utilisent la littérature, les
mythes et le folklore afin de fonder une origine permettant de légitimer leur présence dans
l’histoire et la géographie antillaise. Ainsi, si les mythes au sens anthropologique du terme
semblent absents des romans réalistes merveilleux, nous proposerons une première hypothèse :
s’ils relatent des événements originels ayant modifié la condition humaine et si l’esclavage est
un événement originel qui, bien qu’historique, a également modifié la condition humaine des
populations transbordées, peut-être que ce dernier pourrait avoir un rôle mythographique.
Pouvons-nous tisser un lien entre les caractéristiques de l’esclavage aux Antilles et le concept de
mythe des origines ? Suivant cette hypothèse, nous chercherons ainsi à voir comment, suite aux
conséquences de la rupture de l’esclavage, le but premier des romans réalistes merveilleux serait
une forme de représentation et de redéfinition identitaire qui, dans le cas de notre étude, se
focaliserait essentiellement sur l’utilisation et la (re)production des mythes par les auteurs et leur
rapport à l’identité et à la mémoire culturelle.
Pour une problématique
L’utilisation du réalisme merveilleux dans les romans caribéens francophones et leurs
références au folklore et aux mythes témoignent de son importance dans cette littérature et ne
manque donc pas de soulever une question cruciale : quelle peut être la valeur identitaire de ce
type de roman pour une culture caribéenne qui, entre le vingtième et le vingt-et-unième siècle,

16
s’est largement laissée influencer par la modernité ? Partant du sentiment que l’importance des
mythes dans les romans caribéens francophones a été jusqu’alors sous-estimée par la critique et
que leur lien avec le réalisme merveilleux et l’identité culturelle n’a jusqu’alors jamais été
clairement théorisé, notre objectif principal sera ainsi de démontrer comment, par la (re)création
de mythes, ces productions littéraires légitiment et transmettent une identité culturelle
spécifique, directement liée à leur contexte historique et socioculturel. Ainsi, si cette littérature
nous apparaît d’abord riche en contes et en légendes et pratiquement vide de mythes des
origines, nous verrons cependant qu’elle est en pleine (re)création de mythes originels
spécifiques, liés à l’arrivée des populations transbordées d’Afrique et à leur enchaînement au
système esclavagiste. Ce projet d’étude se veut donc à la fois littéraire et culturel et tentera de
créer un lien entre les conséquences de la rupture originelle de l’esclavage sur la pensée
populaire/mythique/identitaire des auteurs et ses effets sur la pratique littéraire antillaise. Il nous
permettra également de voir comment le « réalisme merveilleux », dont nous examinerons la
typologie, participe, comme le mouvement de la Créolité, à la (re)construction et à la
(re)découverte de l’identité caribéenne par ses auteurs. Nous verrons également comment,
(ré)écrivant leur histoire, leurs mythes et leur identité, ces auteurs leur donnent des valeurs
nouvelles à la société antillaise. Bien plus que la simple addition des identités multiples qui la
composent, nous verrons comment celle-ci n’est non pas une diaspora, mais un peuple à part
entière, toujours lié à son origine historique : « Nous ne sommes pas une diaspora. Nous
sommes des peuples à part entière, mais nous n’oublions pas pour autant que la plus grande
partie de nos ancêtres provenaient d’Afrique noire et que bon nombre, sinon la majorité, des
créations culturelles créoles portent la marque indélébile de la terre d’où nos pères furent
arrachés » (Confiant, 2007 : en ligne). Entre mythes et littérature, notre approche théorique
apparaît alors : il s’agira d’abord d’opter pour une approche « mythocritique » qui tiendra pour
« essentiellement signifiant tout élément mythique, patent ou latent» (Chauvin, Walter, 2005 :

17
7). Tout en dévoilant un certain système qui, sans intégralement se retrouver dans chaque
roman, intègre un courant plus vaste, une dynamique fortement inspirée (mais ne dépendant pas
toujours) d’un mouvement littéraire et culturel comme la Créolité, cette approche mythocritique
se combinera à une « mythanalyse » qui nous permettra de faire à la fois « une investigation de
la littérature » (Ibid. : 40) et « une étude de la société contemporaine » (Idem.) et donc de
déterminer les objectifs réels de l’écriture dans les romans antillais réalistes merveilleux
contemporains.
Positionnement historico-culturel
Si le rattachement de la Guadeloupe et de la Martinique à la France en 1946 est une date
essentielle dans l’histoire des Antilles, la fin des années cinquante, avec l’élection de François
Duvalier à la tête de la République d’Haïti (en 1957) et le développement des processus de
décolonisation à travers le monde ont également été un tournant dans tous les empires
coloniaux. De même, si l’on se tourne plus spécifiquement vers les discours politiques et
littéraires de la fin des années 50 on observe qu’entre le discrédit de l’idéologie universaliste de
la Négritude et l’échec des promesses de la départementalisation, la société antillaise est entrée
en crise et ses écrivains ont commencé à se tourner vers d’autres valeurs comme l’Antillanité de
Glissant dans les années soixante, puis la Créolité de Bernabé, Chamoiseau et Confiant dans les
années quatre-vingt. Tout en incluant Édouard Glissant et en abordant Aimé Césaire et des
auteurs comme Alejo Carpentier et Jacques-Stephen Alexis, notre étude se veut cependant
contemporaine et se focalisera donc essentiellement sur les auteurs de la Créolité (leurs romans
et leurs écrits théoriques) et sur les auteurs qui, sans s’y associer, en sont proches. En effet, si la
Négritude césairienne perçoit l’Afrique comme le continent-mère des intellectuels caribéens et a
ainsi ouvert de nouvelles voies dans l’étude de l’identité culturelle, celle-ci n’a cependant pas
entièrement rendu compte de la grande diversité des métissages culturels et identitaires en

18
Guadeloupe ou en Martinique. C’est la raison pour laquelle nous nous intéressons ici aux
œuvres d’auteurs plus récents qui, par les aspirations globales de la Créolité ou caribéennes de
l’Antillanité (un système de déplacements latéraux et de rhizomes différents des racines fixes
décrites par Césaire) unifient les cultures caribéennes par l’expérience commune de l’esclavage
et/ou de la langue créole. Si l’approche des Créolistes (pour qui les métissages culturels seraient
une des clefs de l’identité créole6) est critiquée par Glissant (pour qui le monolinguisme de la
Créolité, s’il unit par la langue les peuples créolophones est cependant discriminant car il
ignore « les histoires antillaises : ce qui nous unit aux Jamaïcains et aux Portoricains, par-delà
les barrières des langues » [Glissant, 2002 : 825]), nous laisserons cependant de côté cette
question de la langue créole pour limiter l’étendue de notre recherche. Ciblant une identité
spécifique, nous nous limiterons donc aux seules Antilles sans nous ouvrir aux communautés
francophones hors de la région Caraïbe. Notre but n’est en effet pas de déterminer quelle théorie
est validée par la littérature contemporaine mais de voir comment l’Antillanité et/ou la Créolité
viennent appuyer nos propres conclusions. Pour les mêmes raisons théoriques et du fait de notre
souci de relever une spécificité antillaise, nous limiterons également notre étude des œuvres
originaires d’Haïti. Indépendante depuis 1804, soumise à de nombreuses dictatures et à une
pauvreté qui ont poussé de nombreux auteurs à l’exil, la situation haïtienne est en effet très
différente de celle de la Guadeloupe et de la Martinique qui, intégrées en 1946 à leur pays
colonisateur sans avoir connu d’indépendance, proposent un milieu plus favorable aux
nombreux écrivains qui y résident. Spécifiquement centrée sur le roman antillais, cette étude
nous poussera donc, indirectement, à nous demander quel type de sentiment communautaire se
retrouve dans les romans réalistes merveilleux : un sentiment communautaire caribéen ?
6 Une identité qui sera non pas limitée aux Caraïbes comme le pensait Glissant, mais universelle.

19
Antillais ? Ou au contraire plus largement créole ? Ce questionnement nous conduit ainsi à
choisir une bibliographie particulière, centrée sur des romans 1) originaires essentiellement de la
Guadeloupe et de la Martinique (certains romans haitiens pourront cependant être utilisés pour
appuyer certains points littéraires), 2) de la période correspondant à l’Antillanité et à la Créolité,
3) appartenant totalement ou en partie, par l’utilisation du folklore, au genre réaliste
merveilleux. Du roman Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant à L’Esclave vieil homme et le
molosse de Patrick Chamoiseau en passant par Moi Tituba, Sorcière… Noire de Salem7 de
Maryse Condé, La Grande Drive des esprits de Gisèle Pineau, La Panse du chacal de Raphaël
Confiant, Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre ou encore Ti Jean l’Horizon de
Simone Schwarz-Bart, nous aurons ainsi des romans qui, bien que proposant indépendamment
les uns des autres des écritures, des objectifs et des représentations spécifiques à leurs auteurs,
pourraient bien partager une même quête identitaire et des objectifs communautaires similaires.
Plan de la recherche
L’objectif principal de cette étude cherchera donc à montrer comment des mythes sont
actuellement en (re)construction au coeur des romans réalistes merveilleux et comment ceux-ci
contribuent à la recherche identitaire des auteurs et à la préservation d’une mémoire culturelle
antillaise. Pour ce faire, nous envisagerons ainsi trois grandes parties analysant trois grands
aspects des romans antillais, elles-mêmes divisées en trois chapitres plus spécifiques. Avant de
nous lancer dans une étude approfondie du rapport entre la (re)création des mythes et son
rapport à l’identité, il nous faudra avant tout clarifier une situation confuse de la critique
littéraire contemporaine, qui a souvent tendance à confondre réalisme magique et réalisme
merveilleux. En effet, si les analyses du réalisme merveilleux incluent parfois des œuvres non
7 Désormais nous ferons référence à ce texte par le diminutif « Moi, Tituba… »

20
caribéennes et réalistes magiques, nous pouvons remarquer que le réalisme merveilleux
caribéen, lui, semble être en général absent des études du magical realism : « manifestement, la
survivance de la notion de réalisme merveilleux dans l’océan mondial du magical realism
relève, tout comme le cinéma d’auteur ou la banane Antilles, de l’exception culturelle et,
partant, de l’espèce en voie de disparition » (Scheel, 2005 : 12). De plus, puisque le terme
réalisme merveilleux remonte aux œuvres d’Alejo Carpentier et de Jacques-Stephen Alexis il se
pourrait que, à la lueur des publications les plus récentes d’auteurs comme Patrick Chamoiseau
et Raphaël Confiant, le terme nécessite une approche plus contemporaine. Postulant ainsi que ce
mode de représentation a évolué, mais aussi que le terme « merveilleux » ne correspond qu’à
une vision occidentale des phénomènes quotidiens de la réalité caribéenne, cette première partie
aura deux objectifs: différencier le réalisme magique du réalisme merveilleux, et proposer une
(re)définition « caribéenne » de ce dernier en l’analysant comme une manifestation de la
spécificité caribéenne francophone.
Après cette première approche du réalisme merveilleux dans les romans de notre corpus,
nous nous pencherons, dans notre deuxième partie, sur le style d’écriture de ces romans et sur
leurs nombreuses références aux contes et à l’oralité qui, préconisée par la Créolité, jouent avec
les formes des récits dans lesquels s’exprime un degré d’identité culturelle. Nous analyserons
ainsi comment les romans antillais, pris entre une certaine « oralité » traditionnelle et l’écriture,
représentent dans les romans caribéens une dualité entre « langue des mythes » et « une langue
du roman » qui contribuerait à mettre en valeur et poser l’identité. Envisageant ensuite les
différences entre la parole ritualisée, la parole contée et la parole sacrée et analysant le mythe du
Conteur, nous tenterons de voir si l’on pourrait considérer les romans antillais comme des
contes ou, au contraire, des mythes, c’est-à-dire des réservoirs utiles à la mémoire culturelle
antillaise contemporaine. Ce questionnement nous poussera, enfin, à reconsidérer la position des

21
auteurs caribéens en tant que « marqueurs de paroles » et à nous demander si l’écriture ne
permettrait pas une forme de transcendance qui, au-delà de la dualité « écriture/ oralité »,
restructurerait l’imaginaire et conditionnerait l’être.
Cette étude de la forme des romans nous conduira à la troisième partie de cette thèse et à
l’analyse des mythes et de la spiritualité dans la trame des romans et leur rapport à l’identité
antillaise. Nous penchant sur les notions bouleversées par l’esclavage de terre des origines, nous
analyserons de quelle manière les auteurs caribéens contemporains proposent, dans leurs
œuvres, une reconstruction mythique de la notion d’origine. Si notre premier objectif sera de
voir comment les mythes de la terre d’origine se forment par une réécriture du rapport à
l’Afrique, à la France et à la terre natale, nous verrons cependant que ces tentatives se heurtent à
la nature même de cette terre historiquement associée à la souffrance de l’esclavage. Étudiant la
notion de « mythisation » de l’espace historique antillais – notamment par le recentrement des
romans sur la nature antillaise primordiale – nous constaterons ainsi comment nous pourrions
voir, après la recréation d’un mythe cosmogonique, la mise en place par certains romans des
fondations d’une identité antillaise par un travail sur les représentations d’une nature
primordiale, mythique et sacrée.
Nous conclurons alors notre étude en envisageant comment la littérature réaliste
merveilleuse antillaise et ses représentations de son continent mythico-spirituel pourraient être,
comme le Vaudou haïtien, perçues comme des figures essentielles du sentiment communautaire,
constituant une part inaliénable de la culture et de l’identité. Un rapprochement qui nous
permettra de voir dans ces deux systèmes (l’un religieux, l’autre artistique) le langage propre
d’un peuple placé dans des conditions historiques, culturelles et sociales qui concoure au
développement d’une conscience identitaire spécifiquement antillaise.

22
Première partie
(Re)définir le réalisme merveilleux : pour une perspective
caribéenne
Puisque notre recherche porte sur les romans réalistes merveilleux caribéens
francophones, il convient de situer notre corpus dans le mouvement littéraire qui l’englobe. Sur
le plan de la critique littéraire, une simple définition ne semble pourtant pas suffire et il apparaît
rapidement que les études du réalisme merveilleux se heurtent inévitablement à un autre terme
critique, le magical realism, généralement associé aux écrits postcoloniaux anglophones ou
hispanophones. De plus, un parcours critique révèle une inégalité dans l’utilisation des
terminologies. En effet, si le magical realism (le réalisme magique dans sa traduction française)
est populaire et largement utilisé par la critique internationale, le real maravilloso (le réalisme
merveilleux) apparaît moins fréquemment, comme s’il avait été complètement assimilé.
Prenons, par exemple, l’ouvrage collectif édité par Lois Parkinson Zamora et Wendy B. Faris,
Magical Realism : Theory, History, Community. Sur les 23 articles de l’ouvrage, on ne trouve le
terme réalisme merveilleux que dans le titre de deux articles d’Alejo Carpentier. Dans son étude
comparatiste, Réalisme magique et réalisme merveilleux : des théories aux poétiques, Charles
W. Scheel s’étonne de cette catégorisation qu’il observe également dans un autre ouvrage
collectif édité par Xavier Garnier, Le Réalisme merveilleux, dans lequel « l’éditeur n’explique
par pourquoi il choisit de coiffer par l’appellation unique de “réalisme merveilleux” une série

23
d’études dont deux seulement se réfèrent à celui-ci, alors que cinq autres incluent le terme
“magie” ou “magique” dans leurs titres » (Scheel, 2005 : 23). De même, malgré ces différentes
terminologies, les textes concernés semblent suivre des schémas narratologiques relativement
semblables. Devant ces confusions théoriques, et avant d’aller plus loin dans l’étude des romans
antillais de notre corpus, il conviendrait donc de se demander quels pourraient être les liens ou
les différences entre le réalisme merveilleux et le magical realism. Ces différentes terminologies
sont-elles dues à différents types d’écritures du réel ou, au contraire, s’appliquent-elles à un
même type de littérature ? Le réalisme merveilleux est-il une spécificité caribéenne du magical
realism, ou un genre à part ?

24
Chapitre 1 Le réalisme dans les romans réalistes mystiques
1 Appliquer la terminologie
1.1 Difficulté de définition
Le premier fait théorique qui apparaît dans l’application d’une définition du réalisme
dans les romans réalistes merveilleux est que ce terme, le réalisme, ne peut en aucun cas
chercher à redéfinir la notion de réel. En effet, la première chose qui apparaît lorsqu’on entame
une approche du terme « réalisme » est qu’il s’agit d’une notion extrêmement complexe.
Cependant, de façon très générale, les multiples définitions que l’on en trouve partagent en
majorité l’idée que le réalisme, en littérature, est l’invocation/évocation de la réalité dans et par
le texte, sans préciser si la nature de cette réalité relève du monde des idées ou du monde de
l’expérience. L’approche la plus directe, la consultation d’un dictionnaire, propose différentes
définitions du réalisme comme 1- La doctrine platonicienne, 2- une conception de l’art qui
refuse d’idéaliser ou d’épurer le réel, 3- une tendance à décrire les aspects grossiers du réel ou,
pour finir, 4- l’attitude de celui qui tient compte/apprécie le réel avec justesse. En partant de
cette dernière définition, qui est probablement la plus fréquemment utilisée, on s’aperçoit
qu’elle peut être associée à celle qui la précède : l’appréciation juste du réel peut en effet se
rapprocher de la représentation crue de la réalité dans l’art. C’est ce que l’on retrouve, par
exemple, dans la représentation des violences et des abus subis par les esclaves dans des romans
comme Moi, Tituba… de Maryse Condé ou dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant :
« Dans la cale cependant l’odeur s’épaississait. L’eau charriait des pourritures, des excréments,

25
des cadavres de rats » (Glissant, 1997a : 25). Le terme s’applique ainsi aux romans qui
présentent un réalisme pictural, ce que l’on peut ensuite rapprocher de la deuxième définition
puisqu’il arrive souvent que cette représentation crue du réel finisse par présenter des éléments
de violence, de vulgarité ou d’excès tels les viols ou les tortures infligées aux esclaves. Ces
éléments illustrent ainsi les principes de l’école réaliste qui a, bien souvent, fait scandale par ses
représentations d’éléments extrêmes ou déviants. C’est ce que l’on retrouve dans de nombreux
romans caribéens décrivant la cruauté des maîtres esclavagistes comme par exemple Moi,
Tituba… de Maryse Condé, dans lequel des hommes masqués violent Tituba avec un
bâton : « un autre releva ma jupe et enfonça un bâton taillé en pointe dans la partie la plus
sensible de mon corps en raillant : – prends, prends, c’est la bite de John Indien ! » (Condé,
1986 : 144). De manière générale il y aurait donc, à la base du réalisme, un refus d’embellir le
réel et de le montrer tel qu’il est, quitte à en représenter son horreur. On peut ainsi remarquer
que ces descriptions sont abondantes dans les œuvres de notre corpus : qu’il s’agisse de la vie
des esclaves (Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant), de celle des engagés Indiens (La Panse
du chacal, de Raphaël Confiant), de la vie en France (L’Exil selon Julia, de Gisèle Pineau) ou de
la vie quotidienne de certains quartiers (Texaco, de Patrick Chamoiseau), les romans ne
cherchent en effet jamais à embellir le réel par la création de mondes utopiques. Ils restent
toujours extrêmement proches de la réalité historique et sociale du quotidien d’hier ou
d’aujourd’hui. Ce réalisme s’oppose ainsi à la tendance romantique d’idéaliser et représente,
comme nous allons le voir, ce qui est vrai « dans les faits », que ce soit dans la représentation de
l’histoire et de la société, de la représentation d’une expérience individuelle ou, comme chez
Zola, d’une forme de « réalisme social ».
Comme le propose Margaret Doody qui, dans The True Story of the Novel, part du
concept hégélien selon lequel le réalisme décrit l’illusion créée par le roman (qui, par nature

26
implique la fiction et l’imaginaire), le réalisme serait non pas un genre (comme le naturalisme
ou le romantisme) mais un mode permettant une représentation plausible de la réalité. En effet,
puisque l’on trouve des éléments réalistes dans une grande variété de romans, sans que ceux-ci
appartiennent à un mouvement spécifique, on peut en conclure que « realism is […] not a single
style and has no specific vocabulary of its own, except in contrast to styles and vocabularies
employed by other modes of writing in any given age » (Stern, 1973 : 52). Si nous appliquons
cette idée de base aux œuvres antillaises de notre corpus, la notion de réel et de mode réaliste
pourra se révéler paradoxale, voire même problématique. En effet, dans une culture où les
mythes et le folklore peuvent être perçus à la fois comme des réalités ou comme des fictions,
une question se pose : qu’est-ce qui est réel ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Comme le note Claire L. Dahon dans son étude sur le réalisme africain, il y a entre
l’homme des sociétés traditionnelles et l’homme occidental, des attitudes fondamentalement
différentes envers le réel. De même, si le réalisme en Occident est basé sur la notion que chaque
individu peut découvrir la vérité par la raison et les sens, ce n’est pas le cas en Afrique
subsaharienne où « les gens n’ont pas abandonné d’anciennes façons de penser ou de voir le
monde : l’invisible et le visible coexistent, le surnaturel se manifeste aujourd’hui sans que
l’homme puisse toujours prévenir ses interventions » (Dehon, 2002 : 16). Appliquant cette
distinction au monde caribéen, nous pourrions également l’appliquer à notre propre recherche.
D’ailleurs, une problématique identique concernant la notion de réel se retrouve dans Le
Discours antillais d’Édouard Glissant. Pour lui, une des principales difficultés rencontrées par
les écrivains est leur façon de rendre compte du réel, particulièrement dans le domaine caribéen
puisque « le réalisme, théorie et technique de la reproduction littérale ou "totale", n’est pas
inscrit dans le réflexe culturel des peuples africains ou américains » (Glissant, 2002 : 342). De
ce fait, les représentations réalistes africaines – et, par extension, caribéennes – pourraient, en

27
littérature, apparaître comme de pâles copies des originaux européens si elles ne prennent pas un
certain recul critique par rapport à la dimension supplémentaire, surnaturelle, du monde. À ces
dimensions s’en ajoute une autre, que Glissant définit comme une dimension « d’histoire non
évidente » (Idem.) reprise et décrite par les théoriciens de la Créolité comme un type d’histoire «
dessous les dates, dessous les faits répertoriés » (Bernabé, 1989 : 38), échappant aux chroniques
coloniales et à l’histoire officielle. Selon Glissant, ce fait risque d’entraîner, dans les
représentations simples du folklore et des mythes, ce qu’il appelle une « folklorisation
simplifiée » (Idem.) nocive à une représentation fidèle du monde. Nous pouvons donc avancer
ici que l’appelation de réalisme pur ne conviendrait pas à la description de l’écriture caribéenne
ou à toute écriture postcoloniale1 dont les histoires particulières ne sont pas seulement
imprégnées par l’Histoire, mais par toutes sortes d’éléments culturels qui la constituent, comme
les mythes et le folklore. Ce serait pour cette raison, soutient Glissant, que des auteurs comme
Jacques Stephen Alexis et Gabriel García Márquez ont, pour et par l’élaboration de leurs romans
réalistes merveilleux (et/ou magiques), dépassé les notions du réalisme à l’occidentale. Ce
dépassement du réalisme aurait ainsi participé, aussi bien dans les littératures caribéennes que
dans les littératures africaines et américaines, à l’apparition d’un phénomène de dualité par
rapport aux perceptions du réel.
1.2 Réalisme ou vraisemblance?
S’il semble évident que, sous l’effet de la fiction et du principe d’écriture, les « histoires
officielles » et les personnages historiques comme Tituba ne sont pas exactement identiques à
1 Pour le terme « postcolonial » nous nous basons sur la définition qui est proposée dans l’introduction de l’étude,
The Empire Writes Back qui associe à ce terme des littératures et cultures « affected by the imperial process from the moment of colonization to the present day » (Ashcroft, Griffith, Tiffin, 2002 : 1).

28
leurs doubles littéraires, il ne faut pas pour autant rejeter le terme « réalisme ». En effet, pour
certains critiques, si l’écriture ne produit pas du réel mais une illusion du réel, il est important
qu’il y ait toujours une certaine vraisemblance par rapport à celui-ci, terme que l’on peut relier
au projet réaliste qu’étudie Philippe Hamon dans son essai « Un discours contraint », qui
propose l’hypothèse d’un pacte de lecture lecteur/auteur, reposant sur un cahier des charges
composé de sept éléments :
1. le monde est riche, divers, foisonnant, discontinu etc. ;
2. je peux transmettre une information (lisible, cohérente) au sujet de ce monde ;
3. la langue peut copier le réel ;
4. la langue est seconde par rapport au réel (elle l’exprime, elle ne le crée pas), elle lui est « extérieure » ;
5. le support (le message) doit s’effacer au maximum (la « maison de verre » de Zola) ;
6. le geste producteur du message (style, énonciation, modalisation) doit s’effacer au maximum ;
7. mon lecteur doit croire à la vérité de mon information sur le monde. (Hamon, 1982 : 132-133)
Cette approche du vraisemblable est particulièrement intéressante car elle s’accorde avec la
définition du réel proposée par Maximilien Laroche selon qui celui-ci serait « non pas ce qui est
mais ce que nous voyons ou plutôt ce que nous racontons puisque nous ne connaissons jamais
de réalité qu’à travers une vision et puis un discours » (Laroche, 1987 : 125). L’auteur pourrait
être donc perçu comme un illusionniste puisque, comme Maupassant l’affirme dans son étude
sur le roman publiée avec son roman Pierre et Jean : « faire vrai consiste donc à donner
l’illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire
servilement dans le pêle-mêle de leur succession » (Maupassant, 1998 : 43). Il est donc essentiel
que l’auteur donne une représentation qui, même si elle est illusoire par l’action même de la
littérature, suive une certaine logique vis-à-vis du lecteur et ses propres perceptions du monde.
De ce fait, l’écriture réaliste pourrait alors être perçue comme un accord tacite : le lecteur croit
en l’univers que lui présente l’auteur, dans la mesure où celui-ci ne s’éloigne pas trop de la

29
réalité objective. Un problème se pose alors dans le contexte des romans réalistes magiques et
réalistes merveilleux, connus pour leur utilisation du surnaturel : que se passe-t-il si l’univers
représenté s’éloigne de la réalité objective ?
1.3 Premières difficultés
La notion de réalisme dans les romans antillais pose ainsi certains problèmes,
notamment dans la représentation des lieux de l’action, la Guadeloupe et la Martinique. Terres
natales – et donc centres du réalisme – des Guadeloupéens et des Martiniquais, les Antilles sont
au contraire, pour les lecteurs occidentaux, des lieux étrangers, souvent imprégnés d’exotisme.
Si l’on suit l’étude de Philippe Hamon, cet exotisme ne va pas dans le sens du réalisme dans
lequel « les références à un ailleurs (exotisme) seront […] réduites, et le héros réaliste voyagera
sans doute fort peu loin de son milieu : l’Histoire viendra à lui, plutôt que lui n’ira chercher
l’Histoire (des histoires) » (Hamon, 1982 : 137). Ainsi, si certains personnages de romans
caribéens voyagent à cause de l’esclavage ou de migrations (comme Tituba qui se retrouve à
Boston ou les personnages de Gisèle Pineau qui émigrent vers la France), la plupart d’entre eux,
comme Télumée, dans le roman de Simone Schwarz-Bart ou Hadriana Siloé dans le romans de
René Depestre, ne quittent jamais la région Caraïbe. Cette notion d’exotisme est
particulièrement intéressante dans le cas des romans antillais car elle ne se manifesterait, dans le
cas du réalisme, qu’au contact des lecteurs occidentaux. C’est ainsi qu’apparaît la question du
point de vue, essentielle à notre (re)définition du réalisme merveilleux : si lecteur, auteur,
narrateurs et personnages ne partagent pas, dans un même roman, une perception identique du
réel, celle-ci se révèlera problématique quand on en viendra à la distinction des mythes comme
histoires vraies/fausses.

30
Si l’on s’en tient aux théories de Philippe Hamon, on remarque que l’écriture des romans
caribéens semble par bien des aspects s’éloigner des canons du mode réaliste, ne serait-ce que
par la nature narratologique d’un grand nombre d’entre eux qui, comme Ti Jean l’Horizon ou
Chronique des sept misères, sont racontés à la manière de contes et sont très portés sur l’oralité :
« Messieurs et dames de la compagnie, les trois marchés de Fort-de-France (viandes, poissons,
légumes) étaient, pour nous djobeurs, les champs de l’existence » (Chamoiseau, 2004 : 15). Or,
nous dit Guy Larroux, le discours raconté est la forme la moins mimétique du réalisme puisque
les narrateurs ne s’effacent pas comme ils le devraient mais entreprennent de raconter des
histoires dans lesquelles ils s’impliquent. De ce fait, on peut dire que le réalisme, dans les
romans réalistes merveilleux antillais, n’est pas lié au style de la narration et aux narrateurs
puisque ceux-ci y sont omniprésents, souvent sous la forme de conteurs. Ceci est en opposition
avec le roman réaliste traditionnel dans lequel les narrateurs recherchent une neutralité vis-à-vis
de la narration et remettent même leur existence en cause puisque le récit « prend l’apparence du
vraisemblable dans la mesure où l’auteur, abandonnant son omniscience, délègue son pouvoir
non à un narrateur privilégié (qui serait son double), mais aux personnages qui deviennent les
relais de l’information » (Becker, 1992 : 107). Cette définition ne peut donc pas s’appliquer aux
romans antillais puisque ceux-ci privilégient souvent des narrateurs qui, ayant été directement
témoins de ce qu’ils racontent, prennent parfois le nom de l’auteur lui-même, comme dans
Solibo Magnifique. Faisant fi des contraintes de la vraisemblance et du retrait nécessaire aux
romans réalistes, ces narrateurs/conteurs n’hésitent pas à se manifester dans leurs textes, que ce
soit dans Moi, Tituba…, Ti Jean l’Horizon ou encore La Grande Drive des esprits: « ce que je
vais présentement vous narrer doit, à jamais, rester enfoui dans un pli de mémoire. Écoutez,
mais ne rapportez point ! Domptez vos langues ! […] Sachez que je raconte pour éclairer mais,
tout au fond, je ne veux croire » (Pineau, 1999 : 161). À cette inadéquation au réalisme s’en
ajoute une autre, plus importante encore : si le contrat réaliste suppose que l’auteur doit éliminer

31
de son texte tout ce qui peut diminuer la croyance en l’univers représenté, il faudrait en conclure
qu’il ne peut en aucun cas y insérer des éléments surnaturels. Or ce sont là des éléments
omniprésents dans les romans réalistes merveilleux antillais. Ce simple fait les rend donc, d’un
point de vue réaliste, incohérents : Tituba ne devrait pas être capable de raconter son histoire
après sa mort, Ti Jean ne devrait pas pouvoir traverser l’espace et le temps en se faisant avaler
par une créature fantastique et Mina ne devrait pas, dans Chair Piment, voir sa sœur morte. Ces
phénomènes surnaturels ne s’accordent donc nullement avec la définition du réalisme et sont
ainsi, en toute logique, à l’origine du deuxième terme qui caractérise ce type d’écriture : le
merveilleux. Mais ce terme décrit-il adéquatement la nature de ces phénomènes ? L’oxymore
est-elle valide d’un point de vue littéraire et culturel ?
2 Le réalisme et le merveilleux: représentation identitaire ou antinomie?
2.1 Problématique du point de vue du lecteur et de l’auteur
La question du réel reste donc problématique et se complexifie davantage lorsqu’on
prend en considération le point de vue de l’auteur, dont le regard peut être différent de celui du
lecteur puisque « dès qu’on parle de mimesis, de reproduction du réel, on introduit un Moi, un
regard qui cadre, choisit, résume, ordonne, explique, donne un sens à l’inorganisé, à ce qu’on vit
dans le désordre et l’absence de signification » (Becker, 1992 : 104). S’il y a un regard au
niveau de la réception de l’œuvre, celui du lecteur, il y a donc un autre regard, celui de l’auteur,
au niveau de sa production. Ce regard organise la réalité du monde ou la réfracte selon différents
angles de perception qui doivent, idéalement, coïncider avec ceux du lecteur. Or ce regard sera,
dans le contexte des romans de notre corpus, antillais. Il ne correspondra pas forcément à celui
des lecteurs ou des critiques pour qui la perception de la magie et de la spiritualité sera peut-être

32
différente. Ainsi, par exemple, si les romans antillais renvoient à une certaine réalité
sociologique et si l’auteur renvoie les lecteurs à un type de paysage connu, évoque des
personnages historiques célèbres ou introduit une créature folklorique, on peut logiquement se
demander: pour qui ces personnages seront-ils célèbres et pour qui cette créature sera-t-elle
connue ? On retrouve une problématique semblable dans le roman africain, dans lequel le
lecteur occidental, non africain, « se voit forcé d’accepter comme ‘‘réaliste’’ la magie des
sorciers ou le pouvoir des grigris dans lesquels il ne croit guère » (Dehon, 2002 : 13). La
représentation intégrale du monde, incluant ses dimensions culturellement spécifiques et,
parfois, surnaturelles, est donc problématique dans les romans réalistes merveilleux puisqu’elle
inclut toutes sortes d’éléments du folklore et de la spiritualité avec lesquelles les lecteurs, même
antillais, ne sont pas forcément familiers.
Cette distinction va même plus loin quand on considère les études de Mircea Eliade sur
la perception occidentale des mythes. Pour ce dernier, si la spiritualité et les mythes de sociétés
traditionnelles transmettent aux individus « des modèles de conduites humaines et confère[nt]
par là même signification et valeur à l’existence » (Eliade, 1988 : 12), il est évident que leurs
perceptions de la réalité seront très différentes de celles du monde occidental, dans lequel ces
mythes ont perdu leur force. Les romans risqueraient alors de passer pour réalistes pour certains
et tout simplement surnaturels ou merveilleux pour d’autres. Cette observation nous permet
donc de supposer que si la culture caribéenne et la culture occidentale sont culturellement et
spirituellement différentes, leurs notions même de réel, et leurs manifestations dans les romans,
pourraient ne pas être les mêmes, surtout si « la manière de voir une image résulte d’une
culture » (Dehon, 2002 : 17). Il ne faudrait cependant pas généraliser et penser que tous les
Antillais croient au folklore et que tous les occidentaux n’y croient pas et se rappeler que les
Antilles françaises font partie des Départements d’Outre-Mer, ce qui implique, en plus d’une

33
forte spiritualité, une pénétration constante de la culture française au sein des cultures locales, et
donc un contact permanent entre les deux valeurs du mythe. De ce fait, tout en étant paradoxal,
le terme « réalisme merveilleux » serait donc également représentatif d’un état de culture: si, par
son refus d’embellir, le réalisme qui le constitue fonctionne comme « une réaction universelle (à
l’idéalisme, à l’académisme, etc.) traversant l’histoire de la littérature » (Larroux, 1995 : 13), ce
dernier s’oppose aussi clairement aux éléments surnaturels que l’on retrouve en permanence
dans les romans antillais. Il semblerait ainsi que le réalisme merveilleux fonctionne comme le
miroir de ces sociétés antillaises qui, prises dans les ambivalences d’une dualité née de l’histoire
et de ses conflits socioculturels, tentent de se donner une voix propre, une représentation (ou une
facette) de leur réel. Malgré l’oxymore qui les constitue, les termes « réalisme merveilleux » et
« réalisme magique » n’illustreraient donc pas vraiment un genre littéraire délimité par des
règles précises, mais peut-être un « mode », ce qui expliquerait qu’il s’applique à des littératures
d’origines différentes.
2.2 Le réalisme, le monde antillais et le regard occidental
Basé sur une oxymore, le réalisme merveilleux antillais représenterait donc la société
antillaise et ses dimensions : son aspect colonial et une « petite tranche du monde qui ne figurait
pas dans les livres, car les blancs avaient décidé de jeter un voile par-dessus… » (Schwarz-Bart,
1998 : 37). Ce paradoxe, que l’on retrouve au cœur de ces sociétés caribéennes (qui sont,
comme nous l’avons vu dans notre introduction, influencées à la fois par la rationalité et
l’Histoire mais aussi par la conscience mythique et les contes), ne peut donc pas se limiter à une
représentation unidimensionnelle du monde. Si le folklore, la spiritualité et les mythes font
partie de la culture antillaise, une représentation réaliste de ce monde devrait donc le représenter
dans son intégralité, avec ses zombis, ses bizangos et ses dorliis, si bien qu’oublier leur

34
existence serait donner une image incomplète de ces cultures. Par contre, en suivant le même
raisonnement, appliquer le terme de « réalisme » aux populations occidentales ou
occidentalisées, devrait soit ignorer ces éléments spirituels et folkloriques, soit les mentionner
comme des « histoires fausses ». Nous observons ainsi dans plusieurs romans antillais de notre
corpus une apparente dichotomie comme, par exemple, dans L’Homme au bâton d’Ernest Pépin
ou dans Chair piment de Gisèle Pineau dans lesquels deux réalismes s’opposent : si le fameux
dorliis de L’Homme au bâton est une réalité pour certains personnages, d’autres, occidentaux ou
personnages « occidentalisés », y voient un phénomène imaginaire : l’excuse d’une jeune fille
n’osant avouer avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Même chose dans le roman de
Gisèle Pineau dans lequel le fantôme enflammé de Rosalia qui suit Mina de la Guadeloupe à la
France est perçu comme une hallucination par certains – en France et dans les milieux
occidentalisés – et comme une réalité par d’autres (en particulier dans le milieu rural
guadeloupéen). Cependant nous observons vite que tous les romans antillais ne suivent pas cette
dualité. Ti Jean l’Horizon et Moi, Tituba…, par exemple, optent ainsi pour un regard plus
franchement surnaturel, dans lequel l’existence des esprits et des créatures du folklore n’est pas
remise en cause (sauf, éventuellement, par les lecteurs). D’autres encore, comme Hadriana dans
tous mes rêves ou Le Quatrième siècle mettent en scène des personnages qui, placés entre les
deux pôles de ces croyances opposées, vivent dans le doute. Le monde ne serait donc pas, dans
les romans antillais, monolithique : ni simplement réaliste, ni purement merveilleux/magique, il
n’est pas non plus uniquement basé sur une dichotomie. Cette complexité du regard sur le réel
antillais est très semblable à celles que l’on retrouve dans le réalisme magique, dans lequel « the
writer confronts reality and tries to untangle it, to discover what is mysterious in things, in life,
in human acts […] the discovery of the mysterious relationship between man and his
circumstances » (Leal, 1995: 121-122). Ainsi, la réalité antillaise telle qu’elle est représentée
dans les romans (même dans les œuvres d’un même auteur) est plus complexe qu’une simple

35
oxymore : les romans ne sépareraient pas narrateurs et lecteurs par des gouffres
d’incompréhension en mettant en opposition deux perceptions du réel. Ils ne laisseraient pas non
plus, par leur utilisation du folklore, des vides qui empêcheront pour le lecteur occidental ce que
Philippe Hamon appelle la prévisibilité des contenus. Par la multiplicité des regards qui, dans un
même roman ou d’un roman à l’autre, s’opposent, se correspondent ou se complètent ; par des
personnages qui croient, refusent de croire, doutent ou encore par des personnages qui n’ont
aucune idée de la nature du folklore, les auteurs antillais décriraient ainsi, par le regard sur les
mythes et la spiritualité, toute la complexité du monde antillais et de ses représentations. Il n’y
aurait donc, dans ces romans réalistes merveilleux, ni acceptation totale, ni renoncement, ni
rupture avec les croyances et la littérature (orale) du passé ou avec le réel contemporain car ces
éléments, dans leur grande diversité, semblent faire partie intégrante de la sensibilité caribéenne.
S’éloignant ainsi de toute pureté littéraire théorique, il se pourrait bien que le réalisme
merveilleux antillais base sa définition et sa nature non plus uniquement sur la littérature même
et une opposition classique entre réalisme et surnaturel, mais également sur une approche
ethnographique de la perception du réel.
3 Le réalisme historique et ethnographique dans les romans
3.1 Histoire et réalisme
Comme nous l’avons vu dans notre introduction, la rupture occasionnée par la
déportation de l’esclavage et le système de plantations a eu jusqu’à nos jours de nombreuses
conséquences sur la mémoire culturelle des Antilles françaises. Ainsi, quand on recherche une
approche ethnographique et sociale de cette période historique du point de vue des esclaves eux-
mêmes, des témoignages, on n’en trouve que peu de traces écrites : que ressentait l’esclave pris

36
dans la cale du navire négrier ? Que pensait le marron face à l’océan bloquant sa fuite ? Cette
absence d’informations vient principalement du fait que les récits d’esclaves eux-mêmes,
comme celui d’Olaudah Equiano, sont extrêmement rares et que, comme le note Éric Williams,
les écrivains de la période esclavagiste ne mentionnaient que très rarement les esclaves: « most
writers of this period have ignored them. Modern historical writers are gradually awakening to
the distortion which is the result of this » (Williams, 1994: 197). Ainsi, à part les descriptions
contemporaines reconstituées par certains auteurs, en particulier en littérature, on en sait très peu
sur les croyances et la spiritualité des premiers esclaves. Celles-ci demeurent en partie
inaccessibles aux historiens qui, par leur intérêt pour l’Histoire plutôt que pour « les histoires »,
suivent une méthodologie qui « ne leur donne accès qu’à la Chronique coloniale » (Bernabé,
1989 : 38). Comme nous l’avons envisagé plus haut, les écrivains suivraient, quant à eux, une
chronique différente, celle des esclaves : « nous sommes Paroles sous l’écriture » (Idem.). S’ils
ne sont pas à proprement parler des historiens ou des sociologues, les auteurs antillais auraient
cependant leur mot à dire quant au réalisme historico-social et à la reconstruction du passé dans
leurs romans et utiliseraient un type de réalisme se manifestant à travers les multiples
descriptions et représentations des sociétés caribéennes et de leurs histoires. Ainsi, au-delà des
phénomènes surnaturels, du folklore et des grandes dates de l’Histoire, ce type de réalisme
s’ancrerait dans les romans par ses représentations de l’esclavage et de ses conséquences, ainsi
que par la vie dans les plantations et dans les communautés rurales ou urbaines. Mais la
présence de tels éléments est-elle suffisante pour dire que certains romans réalistes merveilleux
antillais sont également des romans historiques et ethnographiques ?
Comme avec le réalisme, qui dit réalisme historique ne veut pas forcément dire roman
historique puisque la littérature ne fait pas purement de l’Histoire : « le roman est œuvre
d’imagination, le vrai dans l’art ne suit pas les mêmes règles que dans une étude historique »

37
(Dehon, 2002 : 133). Puisque les romans antillais ont, par leurs références à la période coloniale
et à l’esclavage, un certain lien avec l’Histoire, on pourrait donc supposer que l’Histoire exerce
sur eux une influence réaliste. C’est d’ailleurs ce que propose Philippe Hamon puisque, selon
lui, « le texte réaliste privilégiera sans doute le texte profane (l’Histoire), qu’il situera aussi
proche que possible de son lecteur » (Hamon, 1982 : 137). C’est ainsi que les romans caribéens
apportent et révèlent, par leur utilisation de divers cadres sociohistoriques, une information
réaliste sur l’histoire et la société caribéenne. C’est ce que l’on trouve dans des œuvres qui,
comme L’Homme-au-Bâton d’Ernest Pépin et La Vierge du Grand Retour de Raphaël Confiant,
s’inspirent d’événements réels du passé (ou plutôt de faits divers) et qui révèlent certaines
réalités historiques vérifiables comme en témoigne l’article du journal Clartés du samedi 3
janvier 1948 : « en route le cortège… d’abord les petits, puis de plus grands et de plus grands
encore jusqu’au char, traîné à bras d’hommes, sur lequel est hissée Notre-Dame. À sa suite,
l’Évêque de la Guadeloupe et le Maire de Pointe-à-Pitre, puis des hommes et des hommes
encore » (cf. Annexe II). Dans le même ordre d’idées, l’authenticité historique des descriptions
de l’esclavage dans les romans de Maryse Condé ou Édouard Glissant peut être vérifiée à l’aide
de documents de l’époque coloniale comme le Code Noir de 1685 ou d’ouvrages plus récents
comme Les Traites négrières d’Olivier Pétré-Grenouilleau et Capitalism and Slavery d’Eric
Williams. Nous pouvons ainsi constater de quelle manière la souffrance des esclaves dans les
navires négriers ou la vie sur les plantations décrites dans les romans correspondent aux réalités
historiques dans les moindres détails. Nous voyons ainsi, par exemple, comment les baptêmes
d’esclaves « en série » (Glissant, 1997a : 89) organisés par les colons dans des romans comme
Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant correspondent à l’article 2 du Code Noir qui impose
que « tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion
catholique, apostolique et romaine » (Sala-Molins, 2006 : 94). Suivant cette constatation, il
semblerait qu’il y ait non pas rupture mais continuité directe entre l’écriture romanesque et le

38
réel historique sans que l’un prenne le dessus sur l’autre puisque « les œuvres parlent
effectivement du monde, mais leur énonciation est partie prenante du monde qu’elles sont
censées représenter. Il n’y a pas d’un côté l’univers des choses et d’activités muettes, de l’autre
des représentations littéraires détachées de lui qui en seraient une image» (Maingueneau, 1993 :
19-20). De ce fait fiction et réalité, roman et histoire sont, dans les romans antillais réalistes
merveilleux, irrémédiablement liés.
Ainsi, même si les romans contiennent des erreurs ou des distorsions par rapport aux
événements originaux et s’ils ne décrivent pas forcément des plantations ou des personnages
ayant réellement existé, ils continueront cependant à revendiquer leur droit de dire le
vrai puisque « le romancier n’est pas un historien, mais un raconteur d’histoires que le lecteur
accepte comme vraies, tout en sachant qu’elles ne le sont pas, parce qu’elles lui donnent
l’illusion du vrai » (Becker, 1992 : 107). Il y a donc, dans les romans réalistes merveilleux, un
mélange entre l’Histoire et les histoires individuelles, une illusion produite par le romancier en
« multipliant les petits faits vrais qui n’interfèrent pas avec l’intrigue mais créent l’impression
du vrai en contribuant à donner au récit un air d’authenticité » (Becker, 1992 : 127). On retrouve
ainsi en abondance dans les romans une réalité qui, si elle ne peut pas se référer aux
connaissances du lecteur (occidental ou occidentalisé), peut cependant se vérifier de plusieurs
façons. Il y a d’abord l’utilisation de noms de villes, villages et autres lieux géographiques réels,
parfois pour soutenir le réalisme de lieux inventés. Nous remarquerons en effet que presque tous
les romans se déroulent dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, dans leurs villes et
villages, mais jamais en terre imaginaire, si bien que tout village, toute plantation ou tout lieu
inventés se perdent au milieu de la topographie réelle : le village nommé « Piment » que l’on
retrouve dans le roman Chair piment de Gisèle Pineau existe-il vraiment ? Est-il imaginaire ou
est-il trop petit pour figurer sur une carte ? La question n’a pas d’importance du moment que la

39
description du village reste proche de la réalité des villages guadeloupéens. Une fois encore, ce
qui compte est la vraisemblance. C’est en suivant un principe identique que certains auteurs
utilisent des figures historiques qui, comme Tituba dans le roman de Maryse Condé ou encore
Aimé Césaire dans Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau, servent à valider le
réalisme et à renforcer l’existence des autres personnages. Ainsi le réel et la fiction s’allient-ils
autour d’une quête commune de la vraisemblance qui, chez Maryse Condé par exemple, se base
à la fois sur l’Histoire, la tradition et une forme d’imaginaire basé sur des faits
invérifiables: «une vague tradition assure qu’elle fut vendue à un marchand d’esclaves qui la
ramena à la Barbade. Je lui ai offert, quant à moi, une fin de mon choix » (Condé, 1986 : 278).
De l’utilisation de lieux historiques à celle de personnages réels, il y a donc dans les romans
réalistes merveilleux une alliance, une harmonie entre fiction et réalité très similaire à celle qui
semble exister entre le réalisme et le surnaturel.
3.2 Valeur et fonction du réalisme ethnographique
En dépassant la notion d’Histoire, et en nous penchant sur les milieux socioculturels
représentés par les romans (comme par exemple celui de l’esclavage et du système des
plantations) nous pouvons supposer que les romans que nous étudions font également partie
d’un réalisme ethnographique puisque « l’ancrage du récit dans le réel et son authentification
sont aussi réalisés par le renvoi à une réalité sociologique » (Becker, 1992 : 17). En effet, il
apparaît que les auteurs caribéens, comme les auteurs réalistes ou naturalistes classiques, puisent
à de nombreuses sources pour restituer la culture de leurs pays et qu’il y a en eux « de
l’ethnologue qui s’entoure de garants, d’informateurs, parfois de véritables agents de
renseignements » (Larroux, 1995 : 98). Cette hypothèse se vérifie quand on constate que le
rituel ashanti décrit par Maryse Condé dans Moi, Tituba… dans lequel le placenta de la mère de

40
Tituba est « enterré […] sous un fromager » (Condé, 1986 : 17) est comparable à l’histoire
véritable d’Élima, une petite fille née coiffée2, mentionnée par Simonne Henry Valmore dans
son ouvrage Dieux en exil : « le cordon ombilical a été enterré au pied d’un corossolier dans le
jardin créole de la grand-mère […] pour préserver l’enfant des malveillances, on lui a donné à
boire une partie du voile qui recouvrait sa tête » (Henry Valmore, 1988 :75). Pour aller plus loin,
on remarque que ces deux événements correspondent aux rituels africains mentionnés par John
Mbiti dans African Religions and Philosophy, dans lesquels le placenta ou le cordon ombilical
est enterré sous un arbre pour symboliser la séparation de l’enfant et de sa mère: « these
symbols of attachment between mother and child are disposed of by being buried or kept near
the house or place of the child’s birth » (Mbiti, 1969 : 113). La même exactitude ethnographique
se retrouve vis-à-vis des manifestations du vaudou dans les romans de René Depestre ou des
descriptions des rituels et des croyances hindoues ou chinoises dans les romans La Panse du
chacal et Case à Chine de Raphaël Confiant. Ainsi, en plus d’être historique, le réalisme des
romans caribéens serait donc également ethnographique puisqu’il reproduit des réalités
ethnologiques impliquant différents rituels et pratiques magiques et des « systèmes de
représentation de la nature, de l’homme et de la société tels qu’ils se cristallisent dans des
mythes, des récits, des théories ou encore des savoirs multiples » (Berthoud, 1992 : 223).
Comme l’explique René Depestre, ce type de sensibilité caribéenne n’est cependant pas toujours
conscient : « je ne savais pas le valoriser [le merveilleux], je ne savais pas non plus son
importance, je le vivais à l’époque sans en avoir conscience, ça faisait partie de ma sensibilité,
comme ça faisait partie de la sensibilité de tous les Haïtiens » (cité par Munro, 2003 : 153).
Ainsi, si l’Histoire et l’ethnographie pures proposeraient plutôt une représentation de l’histoire
2 Comme d’ailleurs Léonce dans le roman de Gisèle Pineau La Grande Drive des esprits qui, étant également né coiffé, a le don de voir au-delà du visible et de communiquer avec sa grand-mère décédée.

41
coloniale et de la vie quotidienne au travers d’une distance temporelle, le réalisme merveilleux
des romans de notre corpus illustreraient donc, par leur représentation du local et de perceptions
spécifiques, une réalité telle qu’elle est vécue (ou a été vécue) au quotidien pas les populations
concernées, généralement oubliées ou à peine mentionnées par l’Histoire. Il y aurait donc non
plus un réalisme simple basé sur les faits et le réel mais un réalisme du regard antillais qui, pris
dans sa complexité, intègre à la fois une perception du réel et du surnaturel.
Cependant cette utilisation de l’ethnographie ne doit pas non plus être excessive puisque,
comme avec l’Histoire, un excès de savoir risquerait de faire quitter aux textes leurs objectifs
premiers pour en faire des textes spécifiquement ethnographiques ou didactiques. Or, « un
roman n’est pas un ouvrage d’anthropologie et n’est pas le lieu adéquat pour expliciter la
grammaire implicite qui préside à l’exécution de tout rituel » (Garnier, 1999 : 38). De ce fait, les
descriptions des rituels magico-religieux devraient poser, dans les romans, un problème qui ne
devrait être défini que dans une perspective romanesque. Comme Césaire l’avait déjà noté, il
devrait donc y avoir un lien fusionnel entre le contenu et le contenant: « non pas un contenu
fourré dans un contenant, mais si on tient à ces mots, un contenu qui détermine son contenant,
un contenu ouvrier de son contenant, plus exactement de son contour » (Césaire, 1956 : 6), si
bien qu’il doit y avoir, entre la fiction du roman et la réalité ethnographique, un équilibre délicat
à maintenir par le texte. Si l’écrivain agit comme un ethnologue et que son texte n’est pas un
texte ethnographique à proprement parler, celui-ci devrait avoir une valeur autre que la simple
représentation du réel par l’écrit. L’acte d’écriture et son origine seront, par exemple, essentiels
dans les romans de Patrick Chamoiseau qui, comme les auteurs de la Créolité, se fait un devoir
de rester au plus près de la réalité et du quotidien pour mieux les préserver : « Patrick
Chamoiseau est d’une génération […] qui a porté son attention sur le détail du réel antillais. Le
détail ? Il faudrait plutôt dire la masse inextricable du vécu, l’interrogation des sources du

42
langage et de l’histoire, le débroussaillage de ce que j’ai nommé notre antillanité, tellement
présente et menacée » (Glissant, 2004 : 3). Cette proximité des auteurs par rapport à leur sujet
ethnographique implique donc plus qu’une simple retranscription du réel. En effet, ce qui les
intéresse est le vécu, l’expérience et le témoignage. Comme dans le cas du roman africain, les
scènes descriptives ayant trait à l’ethnographie traduiraient alors certains sentiments profonds de
leurs auteurs « face à l’évolution des mœurs et face à la disparition des modes de vie » (Dehon,
2002 :86) tout en forçant les « lecteurs à mesurer le chemin parcouru ou à méditer sur la
relativité et la persistance des coutumes » (Idem.). De ce fait, il y aurait un discours spécifique
derrière les descriptions ethnographiques des romans caribéens francophones. C’est là une
tendance qui n’est ni nouvelle, ni l’exclusivité des auteurs de la Créolité. En effet, si elle se
manifeste chez certains auteurs africains, on en retrouve également des traces dans la préface de
Ainsi parla l’oncle de Jean Price-Mars: « nous avons longtemps nourri l’ambition de relever aux
yeux du peuple haïtien la valeur de son folklore. Toute la matière de ce livre n’est qu’une
tentative d’intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline de l’ethnographie
traditionnelle » (Price-Mars, 1973 : 43). Il y aurait donc à la base des romans caribéens
francophones utilisant la mémoire culturelle de leurs îles, un désir de reconnaissance et de
préservation de certaines coutumes disparues ou sur le point de disparaître qui témoigneraint des
visages oubliés du paysage socioculturel antillais. C’est là un sentiment que nous retrouverons
tout au long de cette étude, notamment dans les représentations symboliques du conteur, du
marqueur de parole, du « guerrier de l’imaginaire » ou encore dans les représentations de la
nature antillaise primordiale.

43
3.3 Valeur et importance du réalisme ethnographique Dans son article sur Ina Césaire intitulé « Ethnographical Fiction/Fictional
Ethnographies : Ina Césaire’s Zonzon Tête Carrée », Samantha Haigh s’intéresse à l’aspect
ethnographique de l’œuvre de l’auteur qu’elle perçoit comme un précurseur trop souvent ignoré
de la Créolité puisqu’elle a, bien avant ce mouvement, utilisé le réalisme ethnologique comme
un moyen de préserver et de rendre à la culture antillaise une certaine force. C’est ce que l’on
constate avec sa pièce de théâtre Mémoires d’Isles, Manman N. et Manman F. (1985) qui est
basée sur l’histoire de ses grand-mères et sur un certain nombre de conversations enregistrées
auprès de femmes martiniquaises. Comme Ina Césaire l’a elle-même indiqué dans le programme
de sa pièce, elle a été motivée dans son entreprise par son désir de populariser ses recherches et
de les diffuser au public le plus important possible: « il s’agit, pour plus d’un chercheur
travaillant sur son propre territoire, de restituer au peuple – notre peuple en la circonstance – qui
demeure le sujet de la recherche, l’objet même de notre démarche : la prise en compte de nos
valeurs, de nos contradictions, de notre passé, de notre devenir » (citée par Makward, 1992 :
135). On retrouve un commentaire semblable dans un entretien donné par Patrick Chamoiseau
en 1987, suite au succès de son premier roman Chronique des sept misères. Il confie en effet à
son interlocutrice que son but n’était en aucun cas d’introduire la vie des djobeurs dans le vieux
marché de Fort-de-France comme une forme d’exotisme destiné aux lecteurs métropolitains,
mais d’explorer « toute une infinité de réalités » (Broussillon, 1988 : 20) de l’imaginaire créole
afin de se détacher de « l’extériorité du regard » (Ibid. 21) et donc de donner une vision plus
créole du monde antillais. Ce type de représentation s’oppose ainsi à celui d’un certain nombre
d’auteurs qui, comme les « doudouistes » que critiquent les auteurs de la Négritude et de la
Créolité, avaient pour habitude de représenter le monde caribéen d’un point de vue étranger en
jouant le jeu des stéréotypes occidentaux et dont le : « regard sur eux-mêmes reproduisait celui
des voyageurs occidentaux […] Toute relation intime à ces magnifiques paysages se voyait

44
ignorée ; seule se considérait une exaltation de surface conforme à la vision extérieure des
conquérants de ce monde » (2002 : 51). Il apparaît donc que, plutôt que de se concentrer sur des
stéréotypes ou de produire des écrits simplement didactiques, l’approche d’Ina Césaire et des
auteurs de la Créolité qui lui ont succédé chercherait à donner une voix à ceux qui n’en ont pas,
en plus de raconter les dessous de l’histoire coloniale. Mettre ainsi les romans au service de
ceux dont ils témoignent rappelle les idées de Michel Leiris pour qui « ethnology can divest
itself of its colonial associations if it is put in the service of those whom it takes as its object of
study » (Haigh, 2001: 76).
Si le rôle du roman n’est pas, au départ, d’être ethnographique, et si le but de
l’ethnographie n’est pas, initialement, de donner une voix aux peuples étudiés, le réalisme
ethnographique aurait ainsi un rôle de révélateur qui permettrait de combiner ces deux objectifs
et d’utiliser l’ethnographie dans les romans pour combler certains vides et donner une voix à
ceux qui l’avaient perdue: « J’étais et j’en suis toujours persuadée : l’ethnologie ne peut accéder
à son rôle de révélateur que si elle sort du ghetto des spécialistes […]. [Il faut] sortir du strict
champ de travail ethnologique et ‘‘ré-écrire certains non-dits’’ » (Ina Césaire, citée par
Makward, 1992 : 135). L’utilisation du réalisme ethnologique se verrait ainsi justifiée dans la
réécriture fictive que permettent les romans qui, tout en se penchant sur tout ce qui est en dehors
des grands systèmes, s’intéressent majoritairement aux détails (historiques, folkloriques,
sociaux) oubliés ou ignorés afin de les remettre en perspective. C’est ainsi que dans Zonzon tête
carrée Ina Césaire s’intéresse non pas à une histoire spécifique, mais à une succession de
personnages originaires de Gros-Morne, un « bourg sans-histoire» (Césaire, 1994 : 30), que
Chamoiseau s’intéresse à un quartier comme Texaco, que Condé s’intéresse à Tituba, un
personnage historique presque oublié ou que Raphaël Confiant, dans Case à Chine, s’intéresse à
la communauté chinoise de Martinique. Il y aurait donc dans les romans le désir de combler un

45
vide, de réparer un oubli ou de rendre leur légitimité à certains aspects du vécu historique ou
ethnographique antillais. Cet attachement au réalisme ethnographique ou historique n’est
cependant pas le seul objectif des auteurs puisque, comme nous le verrons tout au long de cette
étude, il ne les empêchera de dépasser le réel afin de lui donner, par le réalisme merveilleux, une
valeur mythique ou symbolique. En effet, si ces représentations ethnographiques cherchent à
donner une voix, elles n’en demeurent pas moins, comme le note James Clifford, des
« representations of dialogue » (Clifford, 1988 : 25) par la nature littéraire des œuvres. Cet état
de fait nécessite une certaine vigilance par rapport à la position de l’auteur/ethnographe vis-à-vis
de lui-même, des autres et de son texte. On retrouve cette problématique dans les œuvres de
Patrick Chamoiseau qui, sous les traits du « marqueur de paroles », s’implique dans les histoires
sur lesquelles il travaille, comme dans le roman Solibo Magnifique. Au lieu de s’effacer comme
il devrait le faire dans n’importe quel texte réaliste ou dans n’importe quel écrit ethnographique
– afin de laisser la parole à l’Autre – l’auteur-personnage n’hésite pas à donner son avis, à
clarifier certains points, bref à perturber le document réaliste ou ethnographique original :
« prétendu ethnographe, je vivais sans plus de distance l’engourdissement des heures chaudes en
m’affalant dans les brouettes comme les djobeurs » (Chamoiseau, 2005b : 44). Ces
représentations d’une réalité ethnologique n’ont pas pour but de remplacer l’ethnographie mais
permettent cependant de transmettre un regard et une vision spécifique du monde tout en
assurant les points d’ancrage du texte dans le réel avant les manifestations du surnaturel. C’est
pour cette raison que nous remarquons que, de manière générale, la situation socio-historique la
plus fréquente des romans de notre corpus situe ceux-ci dans le passé et dans des régions
rurales, sur des plantations ou encore en pleine nature, ce qui facilite l’apparition du folklore et
de la spiritualité dans les romans. C’est ce que l’on observe dans La Panse du chacal de Raphaël
Confiant, Ti Jean l’Horizon de Simone Schwarz Bart ou encore Le Quatrième Siècle d’Édouard
Glissant. Si la ville est parfois présente comme dans Texaco de Patrick Chamoiseau ou

46
L’Homme au bâton d’Ernest Pépin, nous observons que les populations qui y sont décrites sont
encore très influencées par les campagnes, quand elles n’en sont pas directement originaires. De
même, on peut noter que les personnages originaires de France ou des villes sont généralement
minoritaires, ce qui favorise d’autant plus l’apparition du merveilleux.
La littérature caribéenne comme objet, de même que les récits que l’on y trouve, illustre
donc abondamment l’idée que la connaissance des cultures et des histoires antillaises transmises
par le réalisme ethnographique sont essentielles à différents niveaux. On le constate tout d’abord
dans l’intrigue des romans eux-mêmes comme avec le préfet qui, dans L’Homme au Bâton
d’Ernest Pépin, tente de comprendre le vent de folie qui souffle sur la Guadeloupe. De plus,
comme l’exprime Samantha Haigh à propos de Zonzon tête carrée d’Ina Césaire, le texte ne doit
pas expliciter toutes ses nuances culturelles aux lecteurs, sous peine de devenir trop
ethnographique ou d’être perçu comme exotique: « the entire text therefore demands a
considerable effort of understanding. Unlike traditional ethnography, Césaire’s ethnographical
novel refuses to make its findings entirely clear, and thereby guards against the western reader’s
assumption of ready access to the ‘exotic’ culture on display » (Haigh, 2001: 84). On pourrait
ainsi appliquer cette approche aux œuvres de notre corpus qui, tout en faisant un certain nombre
de références culturelles, font également acte de résistance contre un exotisme toujours prêt à
ressurgir en évitant une surabondance d’explications3. Réalistes par leurs nombreux aspects
historiquement et ethnographiquement vérifiés, les romans antillais garderaient donc certains
aspects hermétiques en évitant une surabondance d’explications et l’apparition de l’exotisme
3 Ce manque d’explications n’est cependant pas généralisé puisque la plupart des romans proposent des notes en bas de page ou des glossaires explicatifs de certains termes et notions. Cependant, ces explications étant succinctes, il y aura toujours une différence entre ceux qui, natifs des Caraïbes, ont toujours entendu parler des zombis, des dorliis et autres Invisibles présents dans les romans antillais et ceux qui les découvrent pour la première fois par les romans.

47
dans des textes qui, liés à la spiritualité et au folklore, pourraient expliquer pourquoi le réalisme
des romans se voit lié au terme « merveilleux ».

48
Chapitre 2 Mise en perspective de la magie et du merveilleux
1 Réalisme magique ou merveilleux ? Une distinction problématique
1.1 Présentation du problème et hypothèse
Bien que nous ayons envisagé les liens de parenté et les différences entre réalisme
merveilleux et réalisme magique d’un point de vue historique et ethnographique, il semble que
la critique littéraire s’obstine à appliquer ces termes à un seul et même type d’écriture associé
depuis une cinquantaine d’années à la littérature postcoloniale. Qu’il soit merveilleux ou
magique, ce mouvement littéraire a pourtant permis le développement d’une fiction mais aussi
d’une critique multiculturelle. S’appliquant à différentes cultures non occidentales et visant à
renverser les visions européocentristes du monde, il aurait permis aux cultures concernées de se
(ré)affirmer par l’écriture : « Magical Realism radically modifies and replenishes the dominant
mode of realism in the West, challenging its basis of representation from within. That
destabilization of a dominant form means that it has served as a particularly effective
decolonizing agent» (Faris, 2004: 1). S’appuyant sur des spiritualités locales ou des mythes
universels, sur l’imaginaire pur des auteurs ou s’inspirant d’une mémoire culturelle malmenée
par des siècles d’esclavage, le réalisme magique et le réalisme merveilleux sont donc une forme
de lutte contre un modèle de civilisation imposé par d’autres. Malgré leurs ressemblances, leurs
liens et la similarité de l’oxymore qui les définit, ces deux termes ont, pourtant, des origines
différentes. Dans la critique littéraire le terme de réalisme merveilleux est ainsi le plus souvent

49
associé à la région Caraïbe (dans le cadre des œuvres du Haïtien Jacques Stephen Alexis et du
Cubain Alejo Carpentier) et, dans le cadre de la critique littéraire, aux études de Maximilien
Laroche sur Haïti. Le magical realism, au contraire, semble ne s’appliquer qu’aux auteurs et aux
œuvres d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Inde mais aussi, selon certains critiques, à des
œuvres nord-américaines, européennes, et même japonaises. Comme en témoignent quelques
rares études comparatistes comme celle de Charles W. Scheel, ce n’est pas là l’unique différence
entre les deux termes. Bien qu’érudite, l’approche de Scheel ne s’applique qu’en partie à notre
propre recherche car elle suit un désir d’universalisation qui s’accorde mal à notre tentative de
mise en valeur d’une identité spécifique1. Nous le voyons en particulier lorsqu’il argumente en
ces termes : « si l’art authentiquement latino-américain consiste à représenter des “croyances et
des systèmes de pensée non-occidentaux” ne devrait-il pas rejeter la catégorie du roman même,
genre dont le caractère pernicieux est bien connu et dont j’imagine qu’il débarqua dans le
nouveau monde dans le sillage de Cortez et des Jésuites ? » (Scheel, 2005 : 29-30). Bien que
logique et légitime, la question de Scheel ne semble pas prendre en compte la nature complexe
et multiple de certains pays anciennement coloniaux (ou, comme dans le cas des Antilles
françaises, encore sous influence occidentale) qui se sont formés et développés à travers le
métissage socioculturel. En effet, qui dit postcolonial ne dit pas forcement rejet catégorique de
tout ce qui est colonial. Bien au contraire, comme nous le verrons dans notre deuxième partie, le
livre fait, aux Antilles, partie d’un héritage commun. C’est pour cette raison que, délaissant les
études narratologiques déjà proposées par d’autres, le but général de notre étude sera de
percevoir de quelle manière le réalisme merveilleux et le réalisme magique permettent, à
l’époque de la mondialisation et du « village global » (Scheel, 2005 : 30), de renforcer les traits
1 Par là, nous suivons également la réflexion d’Édouard Glissant qui dénonce justement l’universel comme généralisant.

50
culturels d’un peuple en pleine lutte identitaire, notamment par l’utilisation de divers éléments
de sa mémoire culturelle. Nous chercherons ainsi à remettre en perspective le terme réalisme
merveilleux – qui semble disparaître de la critique contemporaine au profit du réalisme magique
– et à expliquer pourquoi les théories du réalisme magique, si elles ne mentionnent que peu
d’ouvrages caribéens (principalement Alejo Carpentier, Jacques Stephen Alexis et Wilson
Harris), semblent carrément ignorer les romans antillais contemporains. Une première hypothèse
pourrait envisager que, puisque les études du magical realism sont le plus souvent en anglais ou
en espagnol, il ne s’agit que d’un simple problème de langue et que les textes en français sont
écartés car ils sont moins accessibles aux chercheurs anglophones ou hispanophones. Mais alors
pourquoi trouve-t-on dans les études du réalisme magique des œuvres écrites en allemand
comme Die Blechtrommel (Le Tambour) de Günther Grass ou en japonais comme Nejimaki-dori
kuronikuru (Chroniques de l’oiseau à ressort) d’Haruki Murakami? Si la langue d’écriture et le
pays d’origine ne sont pas à l’origine de la distinction, comment pourra-t-on différencier
réalisme magique et réalisme merveilleux ? Pourquoi ces terminologies s’opposent-elles
spécifiquement par « magique » et « merveilleux » ?
1.2 Historique des terminologies
Le premier élément important que l’on note quand on étudie la chronologie des termes
réalisme magique et réalisme merveilleux est que, historiquement, la distinction entre les deux
est loin d’être évidente. Si le terme réalisme magique a surtout été employé pendant l’explosion
de la littérature latino-américaine dans les années soixante et si l’expression magischer
Realismus a été pour la première fois utilisée par Novalis, la plupart des ouvrages s’accordent à
penser que son origine théorique remonte à 1925, en Europe, sous la plume du critique d’art
allemand Franz Roh, dans son ouvrage Nach-Expressionismus, Magischer Realismus :

51
Probleme der neuesten Europäischen Malerei. Notons ici un premier fait important : à l’origine,
le terme n’a pas été formulé dans un contexte littéraire mais dans la tentative de décrire le style
pictural Neue Sachlichkeit (Nouvelle objectivité). Il a été utilisé pour décrire comment cette
manifestation du post-expressionnisme incarnait la « calm admiration of the magic of being, of
the discovery that things already have their own faces» (Roh, 1995: 20) tout en représentant, «
in an intuitive way, the fact, the interior figure, of the exterior world » (Ibid.: 24) de même que
« the miracle of existence in its imperturbable duration: the unending miracle of eternally
mobile and vibrating molecules » (Ibid.: 22). Mise en place par Roh, cette représentation du réel
rappelle certains éléments que nous retrouvons dans les écrits d’Alejo Carpentier sur le real
maravilloso qui, comme nous allons le voir, décrivent une terre latino-américaine
ontologiquement magique. Un peu plus tard, pendant les années quarante et cinquante, le terme
magical realism a une fois encore été utilisé pour décrire les œuvres de certains peintres
américains comme Ivan Albright, Paul Cadmus et George Tooker avant d’être finalement utilisé
en littérature. Ce fait nous pousse donc à prendre certaines précautions quant au lien qui existe
entre deux modes d’expression et de représentations aussi distincts que la peinture et la
littérature. En effet, si écriture et peinture peuvent avoir des points communs, leurs implications
sont cependant très différentes. C’est pour cette raison que le réalisme magique devrait donc être
d’abord perçu comme un concept théorique général et qu’il serait maladroit d’appliquer de
façon directe les notions artistiques de Roh à la littérature sans une transition adéquate.
Cette adaptation est généralement attribuée au vénézuélien Arturo Uslar-Pietri qui a
utilisé le terme dans son ouvrage de critique littéraire hispano-américaine Letras y Hombres de
Venezuela, publié en 1948 : « what became prominent in the short story and left an indelible
mark there was the consideration of man as a mystery surrounded by realistic facts. A poetic
prediction or a poetic denial or reality. What for a lack of another name could be called magical

52
realism » (cité par Leal, 1995: 120). Après la peinture, nous constatons donc que le terme a été
en premier associé à la littérature sud-américaine. Dans son ouvrage, Uslar-Pietri s’intéresse en
effet aux relations et à l’influence du roman Macunaíma du Brésilien Mário de Andrade – basé
sur les recherches de l’auteur sur la culture, le folklore, la musique et le langage des populations
indigènes du Brésil (ce qui nous rappelle les œuvres réalistes magiques et merveilleuses) – sur
les écrivains vénézuéliens. Cependant, les données se complexifient car c’est après cette
première apparition du terme réalisme magique que le terme réalisme merveilleux est apparu,
sous l’appellation « Lo real maravilloso americano », dans une publication d’Alejo Carpentier
parue dans El Nacional de Caracas. Ce texte est d’autant plus essentiel qu’il a ensuite servi de
préface à la première édition de son célèbre roman El reino de este mundo (1949) dans lequel ce
réalisme merveilleux, associé à certains traits culturels typiques de la région caraïbe tel le
vaudou haïtien et la santería cubaine, prend une valeur plus idéologique qu’esthétique.
Les termes ont ensuite suivi leurs propres chemins : le terme réalisme merveilleux s’est
popularisé quand Miguel Ángel Asturias a obtenu le Prix Nobel de littérature en 1967 et le
terme réalisme magique, de son côté, est devenu à la mode à partir de 1955, avec la conférence
d’Angel Flores sur « Magical Realism in Spanish American Fiction ». C’est en effet dans cette
communication que Flores a établi l’origine du réalisme magique dans Historia universal de la
infamia de Jorge Luis Borges, publié en 1935 : « with Borges as pathfinder and moving spirit, a
group of brilliant stylists developed around him. Although each evidenced a distinct personality
and proceeded in his own way, the general direction was that of magical realism » (Flores, 1995:
113). La terminologie a été ensuite approfondie par Luis Leal, qui, dans son article « El realismo
mágico en la literatura hispanoamericana » paru en 1967, a reproché à Flores son manque de
définition claire : « his was a voice in the desert, though since then the term has been used
repeatedly without being precisely defined » (Leal, 1995 : 120). Selon ses analyses le réalisme

53
magique ne serait alors ni une littérature du réel, ni une littérature du magique mais, comme
dans le réalisme merveilleux d’Alejo Carpentier, et comme nous le verrons dans nos propres
recherches, «an attitude toward reality that can be expressed in popular or cultural forms, in
elaborate or rustic styles, in closed or open structures » (Leal, 1995: 121). De ce fait, si nous
observons que le réalisme magique et le réalisme merveilleux se confondent souvent dans les
approches critiques, les deux termes ont cependant été, à l’origine, utilisés séparément : l’un
plutôt dans des écrits divers, aussi bien sud-américains que nord-américains, russes et japonais
(après avoir été utilisé en peinture) ; l’autre plus spécifiquement dans les écrits caribéens, (avec
Carpentier et Alexis, qui ont également inséré leurs réflexions théoriques dans leurs œuvres
romanesques). On peut alors se demander si l’absence de Maryse Condé, Édouard Glissant,
René Depestre ou encore Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau dans les études littéraires
pourrait simplement s’expliquer par le fait que le réalisme merveilleux ne s’applique qu’aux
œuvres caribéennes. Mais alors pourquoi Carpentier, Harris et Alexis sont-ils mentionnés dans
les études du réalisme magique? Devant cette problématique, il conviendrait de se demander si
cette absence des auteurs a une origine théorique ou culturelle et si les Antilles francophones et
leur culture n’auraient pas encore, comme le propose Glissant, « imposé à l’autre l’image de
[leur] réalité » (Glissant, 2002 : 823).
1.3 Un mode de représentation entre spécificité et universel
Comment expliquer la grande popularité du réalisme magique et sa présence dans une
grande variété de littératures à travers le monde ? Au-delà de la distinction géographique, le
réalisme magique inclurait-il le réalisme merveilleux ? Si l’on considère la critique

54
contemporaine et la présence du réalisme magique dans des littératures d’origine, d’aspects2 et
de langues très différents, il semblerait que, comme avec le réalisme, nous n’avons pas
un « genre » à proprement parler, mais plutôt un « mode » : « magical realism, just like the
fantastic, is a literary mode rather than a specific, historically identifiable genre, and can be
found in most types of prose fiction. It does not refer to a movement, which is characterized by
particular historical and geographical limitations and a coherence which magical realism lacks »
(Chanady, 1985: 16-17). Même si un certain nombre de critiques peuvent nier cette
caractéristique, préférant associer le réalisme magique à certaines cultures spécifiquement
postcoloniales, nul ne peut nier que le réalisme magique ne se limite désormais plus à
l’Amérique Latine et au mouvement anticolonial. Depuis des précurseurs comme Gabriel García
Márquez (Cien años de soledad, Colombie) et Mikhail Bulgakov (The Master and Margarita,
ex-URSS), on le retrouve effectivement, de nos jours, dans la littérature de toutes sortes de pays
comme le Japon (les romans d’Haruki Murakami), le Nigéria (The Famished Road de Ben
Okri), le Canada (Not Wanted on the Voyage de Timothy Findley), les États-unis (Beloved de
Toni Morrison) mais aussi le Mexique (Como agua para chocolate de Laura Esquivel) et bien
d’autres encore, qui semblent témoigner d’un élargissement progressif des paramètres de ce
mode d’écriture3. La critique littéraire, qui a suivi ces évolutions, s’est d’ailleurs focalisée sur
divers aspects du mode réaliste magique selon les époques. Ainsi, si les premières approches
critiques, comme celle d’Ángel Flores en 1955 ou celle de Luis Leal en 1967, se penchaient plus
sur le réalisme magique en tant que technique littéraire, les travaux critiques des années quatre-
2 C'est-à-dire que certains romans peuvent contenir des éléments du réalisme magique sans pour autant être considérés comme des romans réalistes merveilleux à proprement parler. Le roman Things Fall Apart de Chinua Achebe, dans lequel le « magique » est présent sans être évident, partage d’ailleurs les critiques littéraires qui ne parviennent pas à clairement le catégoriser. 3 Cet élargissement est même devenu une technique commerciale puisque: « writers have been distanciating themselves from the term while their publishers have increasingly used the term to describe their works for marketing purposes» (Bowers, 2004: 1).

55
vingt et quatre-vingt-dix se sont plutôt focalisés sur les rapports qu’entretiennent le réalisme
magique et la société mais aussi, et surtout, sur l’idéologie postcoloniale des pays émergents.
Les travaux les plus récents, quant à eux, tendent de leur côté à se recentrer sur l’élargissement
géographique et culturel de ce mode de représentation devenu un véritable phénomène littéraire
mondial.
Cependant, malgré ces tentatives de rapprochement et d’harmonisation, il est intéressant
de noter que, confrontés à la question de leur association avec le mouvement réalisme magique,
les auteurs antillais n’hésitent pas à s’en éloigner, voire à carrément rejeter toute association
littéraire. Maryse Condé, par exemple, avoue n’avoir jamais été influencée par le réalisme
magique sud-américain : « je n’ai absolument pas été influencée par les auteurs sud-américains.
[…] Moi personnellement, je n’ai aucune affinité avec le réalisme magique ; cela ne correspond
pas du tout à mon type d’imagination » (citée par Clark, 1989 : 116). Patrick Chamoiseau, quant
à lui, propose l’idée que, même si l’imaginaire latino-américain et l’imaginaire antillais puisent
dans un même univers, ils auraient cependant des expressions littéraires différentes:
Lorsque je lis un roman latino-américain, je ressens qu’on parle du même univers. Pourtant, ce qui doit
alimenter le réalisme merveilleux antillais doit être vraiment antillais, créole. Le risque est que nous
puisions dans un imaginaire latino-américain. Je crois que notre univers sensible est le même, et les
structures racia[les] sont fondamentalement les mêmes. Mais l’expression de ce frottement du merveilleux
et de la réalité doit se faire, en ce qui concerne les Antilles, selon des modalités légèrement différentes.
(cité par Pausch, 1994 : 155)
Le « réalisme merveilleux » serait-il donc une variante géographique et culturelle du réalisme
magique, ou les auteurs se distancent-ils afin de se donner une spécificité ? On retrouve une
distinction de ce type dans les études de Maximilien Laroche qui, même s’il ne mentionne aucun
des auteurs de notre corpus, indique lui aussi la possibilité une spécialisation caribéenne du

56
réalisme merveilleux qui « doit se définir à partir du réalisme socialiste qui ne devient
merveilleux qu’à partir du moment où un Caribéen a voulu inscrire sa différence dans l’espace
du réalisme européen. Il en va de même pour le réalisme magique où l’hispano-américain
entend inscrire magie dans le réalisme ibérique » (Laroche, 1987 : 11-12). Cette définition qui
associe le réalisme magique aux pays hispanophones d’Amérique Latine et le réalisme
merveilleux aux îles francophones est très intéressante car elle se base en partie sur la notion
d’une volonté de se différencier d’un mouvement réaliste européen et donc d’une volonté de
spécificité. Parmi les nombreux critiques et chercheurs du réalisme magique ayant cherché à
distinguer celui-ci de modes voisins, on peut noter la tentative d’Irlemar Chiampi (dans son
ouvrage El realismo maravilloso) de créer une forme hybride du réalisme merveilleux et du
réalisme magique appelée realismo maravilloso hispano-americano qui ignore cependant la
littérature caribéenne non hispanique, ou encore les travaux narratologiques d’Amaryll Chanady
(Magical Realism and the Fantastic) qui a cherché à faire une distinction entre le fantastique4 et
le réalisme magique. Ainsi, si réalisme magique et réalisme merveilleux sont proches et si les
auteurs caribéens français ne se réclament pas du réalisme magique, cela nous incite à pousser
un peu plus loin nos recherches afin de voir de quelle manière et à quel moment ces modes de
représentation ont commencé à différer l’un de l’autre et, surtout, si cette catégorisation réalisme
magique/réalisme merveilleux reste pertinente vis-à-vis de la littérature caribéenne francophone
contemporaine.
4 Considéré par Louis Vax et Roger Caillois comme l’intrusion brutale et scandaleuse du phénomène surnaturel
dans le monde réel, le fantastique est également défini par d’autres comme « l’hésitation éprouvée par un être qui
ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel» (Todorov, 1970 : 29).

57
Comme nous l’avons dit, certains chercheurs comme Charles W. Scheel ou Margaret L.
Heady5 ont, dans des études récentes, envisagé départager les deux modes. Bien
qu’intéressantes et préférant des approches postmodernistes ou purement narratologiques, ces
études ne se sont cependant pas véritablement penchées sur les éventuels contextes historiques,
sociaux qui pourraient être à l’origine de la création et de l’utilisation de ces modes de
représentation. Elles se différencient ainsi d’études qui, comme l’ouvrage collectif Magical
Realism : Theory, History, Community, ont au contraire abordé les aspects ethnoculturels du
réalisme magique. Cependant, malgré leurs différentes approches, nous remarquons que ces
ouvrages font apparaître plusieurs éléments qui nous permettent de tisser certains liens
significatifs entre le réalisme magique et le réalisme merveilleux. Ainsi, comparant les deux
modes, on s’aperçoit d’abord que ceux-ci se rejoignent autour de leur utilisation d’un code
réaliste dans leurs narrations dans lesquelles « descriptions detail a strong presence of the
phenomenal world » (Faris, 1995 : 169). Ce code réaliste, qui est également utilisé par Charles
W. Scheel pour définir le réalisme merveilleux et le réalisme magique qui, tous deux, illustrent
« la co-présence […] d’un code réaliste et d’un code narratif » (Scheel, 2005 : 105), nous permet
de différencier le réalisme merveilleux et le réalisme magique du merveilleux pur. Faisant partie
intégrante des deux modes et fonctionnant avec le surnaturel, le code réaliste fait ainsi naître,
dans les deux cas, l’image très particulière d’un monde double. Dans le mode réaliste
merveilleux comme dans le mode réaliste magique, le « code réaliste » s’oppose ainsi,
systématiquement, à un « code non-réaliste » par l’intrusion du surnaturel qui peut prendre
toutes sortes de formes, de la métaphore « littéralisée » aux manifestations des mythes et du
folklore. Tout en étant surnaturels, ces événements s’inscrivent alors « pour chaque œuvre
5 Dans sa thèse de doctorat intitulée From Marvelous to Magic Realism : Modernist and Postmodernist discourses of Identity in the Caribbean Novel.

58
concernée, dans une logique narrative tout aussi rigoureuse que le code réaliste parallèle »
(Scheel, 2005 : 108), une remarque qui correspond bien aux utilisations du surnaturel qui, dans
les romans antillais, suivent une logique spirituelle, folklorique ou magique. Scheel propose
cependant une première séparation des modes quand il tente de distinguer le réalisme
merveilleux – qui opposerait un « code réaliste » à un code « du mystère » (comme avec Regain
de Jean Giono et son « lyrisme un peu inquiétant d’une campagne à moitié sauvage » [Scheel,
2005 : 109]) – du réalisme magique qui opposerait, quant à lui, un « code réaliste » à un code
« du surnaturel » (comme avec Le Passe Muraille de Marcel Aymé « un absurde humoristique
dans un contexte urbain parisien » [Idem.]). Bien qu’intéressante, nous noterons cependant que
cette distinction ne peut s’appliquer à notre propre approche pour deux raisons : premièrement
parce qu’elle se base sur la distinction de romans français (et non antillais ou postcoloniaux) et,
deuxièmement, parce qu’elle ne prend pas en compte la notion d’approche culturelle et se
penche plutôt sur une distinction contenu/contenant. Basée sur des romans français, la
distinction de Scheel ne semble en effet accepter la notion de surnaturel que pour le réalisme
magique, alors que le réalisme merveilleux ne se distinguerait que par son style « lyrique ». Sa
distinction s’applique donc difficilement aux romans de notre corpus, qui se basent toujours sur
un jeu des notions de réel et de surnaturel dans un cadre identitaire et culturel.
Directement liée à la résolution/fusion des codes antinomiques, la présence du narrateur
et son absence de surprise devant les phénomènes est un autre trait commun aux deux modes
que nous étudions. En effet, si Amaryll Chanady proposait une distinction essentielle basée sur
un critère de résolution/non résolution de l’antinomie, entre le mode fantastique et le mode
réaliste magique, son étude relève un élément essentiel : si le mode fantastique se caractérise par
l’absence d’explication du phénomène par le narrateur (qui ne peut accepter ce qu’il perçoit), ce
n’est pas le cas du narrateur des romans réalistes magiques qui, en ignorant l’antinomie, accepte

59
sans surprise le phénomène surnaturel comme un phénomène ordinaire. Dans les romans de
notre corpus, c’est ce que l’on retrouve par exemple avec Tituba qui, face à sa mère décédée, ne
montre aucune surprise: « c’était ma mère. Je ne l’avais pas appelée et je compris que
l’imminence d’un danger la faisait sortir de l’invisible » (Condé, 1986 : 31) ou comme Mina
qui, dans Chair piment, doit accepter et s’habituer aux apparitions de l’esprit de sa sœur : « à
son réveil, la Rose était toujours là revêtue de ses mêmes flammes. Alors il fallut bien se retenir
de crier et s’habituer aux apparitions » (Pineau, 2004 : 14). Mais pouvons-nous dire, comme le
fait Scheel, que l’absurdité n’est pas tant dans le phénomène lui-même que dans le « narrateur
fantasque [qui] en résolvant une antinomie criante par l’esquive […] la fait endosser au
lecteur » (Scheel, 2005 : 111)? Si comme le propose Scheel le réalisme magique place
l’antinomie sur l’axe de communication, il ne prend pourtant pas en compte l’hypothèse d’un
type de pensée (représentée par le narrateur et/ou l’auteur antillais) qui, sans être nécessairement
fantasque, ne ferait que placer les lecteurs face à une perception du monde qui, tout en étant
autre, s’en réfère à une forme de pensée réelle, traditionnelle et dans laquelle les mythes peuvent
être perçus comme des réalités. Ainsi, si de nombreux romans réalistes magiques intègrent à la
narration une trame surnaturelle « clairement isolable de son environnement réaliste dans le
discours du récit, en dépit des efforts d’un narrateur imperturbable voire pince-sans-rire, vers un
traitement discursif égal des deux codes » (Scheel, 2005 : 113), ce ne sera pas le cas dans les
romans de notre corpus dans lesquels cette trame fait partie du réel. Cohérente d’un point de vue
ethnographique (tout en restant surnaturelle d’un point de vue occidental) elle sera en effet
toujours liée à la perception traditionnelle du folklore. Au-delà des tentatives de définition, nous
remarquons aussi que les romans antillais ne fonctionnent pas selon le principe d’une simple
antinomie. En effet, s’il n’est pas surprenant de voir apparaître, dans les romans, les esprits des
morts, il arrive cependant que des personnages aient peur ou soient surpris devant certaines
manifestations effrayantes concernant non pas la (sur)nature du phénomène, mais plutôt son

60
hostilité et ses dangers. Nous le voyons dans Hadriana dans tous mes rêves avec « une
autozombie en liberté ! » (Depestre, 1988: 21) ou dans le roman réaliste magique The Famished
Road: « I looked at their short arms, limp at their sides, and my head nearly fell off in fright
when I discovered that all of them without exception had six fingers » (Okri, 2003: 91).
Cependant nous avons également dans les romans antillais des situations dans lesquelles les
personnages ou les narrateurs (souvent des personnages occidentaux ou des « occidentalisés »)
refusent de croire à l’existence de ces phénomènes surnaturels :
Le préfet se racla la gorge. Il ne pouvait croire à cette histoire d’Homme-au-Bâton. « Un conte à dormir
debout ! Tout juste bon pour effrayer les enfants ! Il est vrai que les Antillais se comportent souvent
comme de grands enfants, mais tout de même ! Qui oserait prêter foi à des récits où il était question
d’enfant-crapaud, de femmes enceintes par des moyens surnaturels ? Il faut raison garder. Vous y croyez
vous à ces balivernes ? (Pépin, 2005 : 151)
Ce type de rejet décrit par Pépin nous rapproche du «scandale de la raison » du fantastique dans
lequel le phénomène pose problème : « the same phenomena that are portrayed as problematical
by the author of a fantastic narrative are presented in a matter-of-fact manner by the magical
realist» (Chanady, 1985: 24). Ainsi, puisque le réalisme magique est généralement associé aux
textes dans lesquels « les événements surnaturels sont systématiquement traités comme s’ils
étaient naturels » (Scheel, 2005 : 92), nous remarquons que les romans antillais ne sont pas
purement réalistes magiques. Si ces romans antillais que nous étudions utilisent surtout ce
système dans lequel les esprits sont acceptés sans surprise, nous avons aussi parfois un
questionnement qui, théoriquement, remettrait en question l’effet magico-réaliste : « si le
narrateur questionnait la véracité des vues inhabituelles du protagoniste, l’effet magico-réaliste
serait détruit et le récit tomberait dans la catégorie de l’onirique ou de l’hallucinatoire » (Ibid. :
95). En effet, si ce principe du réalisme magique s’applique à quelques romans réalistes
merveilleux de notre corpus, ce n’est pas le cas de romans comme Hadriana dans tous mes

61
rêves, La Grande Drive des esprits et L’Homme au Bâton dans lesquels les narrateurs et les
personnages n’hésitent pas à s’opposer et à réagir face aux phénomènes. En effet, qu’il s’agisse
de l’existence des zombis, des « invisibles » ou des dorliis les narrateurs du réalisme
merveilleux marquent souvent leur refus de croire: « le récit de Scylla Syllabaire laissa mes
copains et moi sans le souffle. Quel talent pour travestir la vérité ! Quel flagrant délit
d’arrangement du réel ! Qu’attendais-je pour rétablir les faits comme je les avais intensément
vécu au mois de novembre précédent ? » (Depestre, 1988 : 32). C’est aussi ce que l’on retrouve
avec la narratrice de La Grande Drive des esprits qui, élevée en ville, se montre extrêmement
sceptique vis-à-vis des phénomènes dont elle parle, bien que son amitié avec Célestine, la fille
de Léonce, permette au surnaturel de s’infiltrer dans son récit : « peut-être croyez-vous qu’il
s’agit là d’une affabulation et que cette scène hâtivement brossée ne reflète point la vérité vraie.
C’est ainsi qu’on me l’a narrée » (Pineau, 2001 : 112). Plus qu’un fait de narration, la réticence
est également, dans les romans, la représentation d’un fait culturel en rapport direct avec la
question identitaire. Que la solution proposée par les narrateurs soit merveilleuse (comme par
exemple dans Ti Jean l’Horizon, Moi Tituba, sorcière noire de Salem) ou en suspens entre le
réalisme et le merveilleux, les manifestations surnaturelles et les réactions des narrateurs sont
donc, dans les romans antillais, nombreuses et variés. De l’absence de surprise devant le
phénomène au refus du phénomène, les romans proposent même parfois un sentiment de doute
relativement proche du fantastique. C’est ce que l’on voit par exemple dans L’Homme-au-
Bâton, La Panse du chacal ou Hadriana dans tous mes rêves: si Hadriana n’a pas été zombifiée,
est-ce parce ce n’est que le phénomène n’existe pas ou parce que le bokor qui a tenté de la
posséder à fait une erreur6 ? Le mystère reste entier. Le mode réaliste merveilleux antillais ne
6 Comme le dit Hadriana : « quelque chose avait foiré dans les calculs à papa Rosanfer. Il n’est pas arrivé à capter mon petit bon ange » (Depestre, 1988 : 186).

62
fonctionne donc pas uniquement sur le rejet réaliste, les « doutes de ce que l’on voit, doutes de
ce qu’on nous dit de ce que l’on voit » (Grivel, 1992 : 27) du genre fantastique ou sur
l’acceptation que l’on retrouve dans le merveilleux. Dépendant en partie d’une double identité
antillaise – prise entre le rationalisme à l’occidental de certains personnages et la croyance au
folklore qui en touche d’autres – le réalisme merveilleux représente également, dans un
foisonnement de perceptions, le regard de tout ceux qui restent indécis ou n’ont aucune
connaissance du phénomène.
Selon Scheel, la dernière grande différence entre réalisme magique et réalisme
merveilleux viendrait de la réticence contre « l’exaltation auctoriale », cette différence
essentielle liée à l’attitude de l’auteur qui se profile derrière son narrateur. Dans le cas du
réalisme magique, celui-ci se démarquerait par son absence, sa réticence à se manifester dans le
texte et par « l’éventuel désarroi d’un lecteur aux prises avec une narration problématique,
puisque le narrateur traite de manière résolument égale deux codes traditionnellement distincts »
(Scheel, 2005 : 114). Les romans suivant ce type de représentations devraient donc suivre un
principe de narration proche du mode réaliste, dans lesquels les narrateurs disparaissent en
adoptant la perspective et les croyances de leurs personnages, quelles qu’elles soient : « he must
eliminate all textual signs of subjectivity which would invalidate the content of his account »
(Chanady, 1985 : 102). Si on remarque ainsi que des romans Moi, Tituba… et Ti Jean
l’Horizon, semblent suivre ce modèle puisque les narrateurs n’y remettent ainsi jamais en
question l’existence des phénomènes présentés et décrits, ces romans ne sont cependant jamais
dépouillés de toute subjectivité. Au contraire, comme nous allons le voir dans notre deuxième
partie, la présence des narrateurs dans les romans, et leur fonction proche de celle des conteurs,
est une des spécificités de l’écriture réaliste merveilleuse antillaise. Les romans antillais
seraient-ils donc plus proches du réalisme merveilleux ? Au contraire du réalisme magique le

63
narrateur aurait, selon Scheel, une toute autre présence dans le texte réaliste merveilleux. S’y
démarquant par sa présence, voire son omniprésence intrusive dans le discours narratif (au-delà
de ce que l’on trouve habituellement dans la narration d’un récit), ses manifestations seraient
une forme d’exaltation contaminant le discours des personnages tout comme celui du
narrateur/auteur, sans pour autant obligatoirement produire du réalisme merveilleux. Ainsi, si
nous avons dans le réalisme magique des événements surnaturels décrits avec la même
indifférence que des événements ordinaires, le réalisme merveilleux ferait au contraire preuve
d’une véritable fusion du réalisme et du surnaturel dans laquelle, plus que de simplement
raconter une histoire, le narrateur transmet une vision émerveillée sans souci d’objectivité.
Scheel applique ainsi cette vision aux œuvres d’Alejo Carpentier qu’il décrit comme pétries
d’exaltations anticoloniales, et au roman Le Flamboyant à fleurs bleues de Jean-Louis
Baghio’o : « dans la droite ligne du real maravilloso americano de Carpentier, l’action des
héros du FFB reflète la démesure (réelle) de l’environnement tropical » (Ibid. : 192). Pour
Scheel, donc, le réalisme merveilleux serait avant tout une affaire de style narratif qui n’aurait
rien à voir avec la nature du phénomène ou l’identité culturelle. Si cette forme de poétisation
pouvait s’approcher des images mystiques de la nature que l’on retrouve au cœur de L’Esclave
vieil homme et le molosse : « j’enviais ces racines qui pénétraient le sol, loin. Elles plongeaient
sous terre pour mieux atteindre le ciel. Je m’évertuais à me vider l’esprit pour mieux leur
ressembler » (Chamoiseau, 2005 : 121) ou à la démesure des actions de Ti Jean qui « devait un
jour bouleverser soleil et planètes » (Schwarz-Bart, 1998 : 33), le réalisme merveilleux de
Scheel ne s’appliquera qu’à peu de romans de notre corpus. De même, si ses théories supposent
une forte présence du narrateur par ses effets de style qui nuisent au réalisme, elles ne
mentionnent pas vraiment la présence de contes racontés aux lecteurs ou les interventions
directes des narrateurs dans les récits, très fréquentes dans les romans antillais. Placés entre deux
extrêmes, les romans réalistes merveilleux antillais se situent ainsi dans un « entre-deux »

64
d’incertitude puisque aucune règle ne s’y applique vraiment et puisque chaque élément
surnaturel qui s’y déroule peut y être perçu comme surprenant ou tout à fait banal selon la
perspective de celui qui le perçoit. Le mode d’écriture caractérisant la littérature antillaise serait
donc un mode intermédiaire n’appartenant ni au réalisme pur, ni au doute du fantastique, ni à
l’acceptation du merveilleux. Placé entre deux perceptions, l’une occidentale, l’autre
traditionnelle, il pousserait le lecteur complice à choisir une voie intermédiaire : « un lecteur qui
lit et écoute en même temps ; qui lit le français et écoute le créole ; qui voit le réel, l’expression
déjà là mais entend la merveille, la révolution qui s’en vient » (Laroche, 1987 : 31).
Aussi intéressante que soit la distinction de Scheel et par-delà son mérite de vouloir
« transcender les limites culturelles, historiques ou géographiques dans lesquelles les locutions
concernées ont parfois été enfermées » (Scheel, 2005 : 119), nous remarquons donc que, par son
souci de transcendance et son désir d’unification, celle-ci nie les spécificités identitaires et
culturelles des littératures concernées, et donc les voix qui s’y appliquent. Nous voyons alors
que si les romans antillais suivent certaines caractéristiques des deux modes (notamment
l’utilisation d’un code réaliste, la représentation d’un monde double, une absence relative de
surprise face au phénomène et une forte présence du narrateur plus axée sur l’oralité que sur le
style), ils les dépassent et les complexifient. Ainsi, si le réalisme merveilleux et le réalisme
magique présentent une dichotomie, un monde double à la fois réaliste et « surnaturel » (du
point de vue occidental), les réactions vis-à-vis de cette dichotomie sont cependant enrichies de
nombreux points de vue intermédiaires qui dépassent la simple distinction mythes réels/mythes
morts. Cette remarque nous pousse ainsi à revoir les termes «magique » et « merveilleux » sous
un nouveau jour, non pas narratologique mais culturel. Suivant cette voie ethnographique,
identitaire et culturelle, nous tenterons ainsi de voir si nous pouvons distinguer le réalisme

65
magique et le réalisme merveilleux et, surtout, si nous pouvons envisager une (re)définition,
peut-être plus antillaise, de ce dernier.
2 Définir la magie et le magique
2.1 Le magique, la magie et leur application dans les romans
Si nous nous basons sur une définition générale, on note que la magie est avant tout l’art
de produire des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Cette notion est intéressante du
point de vue de la double perspective culturelle antillaise de base (le croire/ne pas croire) que
l’on retrouve enrichie de nombreuses perspectives dans les romans. Si certains individus
considèrent la possession par les lwas ou la capacité de marcher sur des charbons ardents
comme des phénomènes réels alors que d’autres seront incertains, d’autres encore penseront
qu’il y a un « truc », une habile illusion. Si nous considérons ensuite une définition
ethnographique de la magie, celle-ci est généralement définie comme un ensemble de procédés
d’action et de connaissance à caractère secret par lesquels des individus (souvent des initiés, des
figures religieuses ou spirituelles) entreprennent de modifier le cours naturel des choses. Au-
delà de la notion de surnaturel ou d’illusion, la magie peut donc être également définie comme
une influence sur le monde, c’est-à-dire « un moyen de contrainte mystique, capable d’assurer
automatiquement l’incarnation de nos vœux » (Baudry, 1992 : 8). La magie est donc une
pratique qui, ethnologiquement, consiste à agir sur les signes afin de modifier une situation,
mais aussi une destinée, ce qui implique l’idée d’une lutte : « la magie, elle, en tant que force
actuelle, entre dans un combat avec d’autres forces actuelles dont l’issue est toujours
incertaine » (Garnier, 1999 : 51). C’est ce que l’on retrouve dans des romans où les
quimboiseurs et les bokors cherchent à modifier les forces en présence, comme par exemple

66
dans le roman Moi, Tituba…, dans lequel Tituba cherche à forcer le destin et l’amour de John
Indien ou à provoquer la mort de Susanna Endicott en utilisant à la fois les rituels magiques et
l’influence des esprits qui l’entourent. On le voit également dans Hadriana dans tous mes rêves,
dans lequel la tentative de zombification d’Hadriana a pour but la possession de son corps
contre sa volonté, ou encore dans Ti Jean l’Horizon, dans lequel Ti Jean utilise des objets
magiques pour ramener le soleil. À première vue, donc, la notion de « magie » s’appliquerait au
réalisme merveilleux antillais.
2.2 La magie et la présence des esprits
Si les romans antillais font référence à la magie comme pouvoir et influence, celle-ci est,
bien plus souvent, liée à la présence des esprits, très communs dans des œuvres comme Chair
piment, La Grande Drive des esprits, Ti Jean l’Horizon et surtout Moi, Tituba…. Cette présence
magique des Invisibles, des esprits des morts, est une image essentielle dans notre approche du
réalisme merveilleux antillais, car elle nous permet de le différencier en partie du réalisme
magique, généralement lié cette notion de magie comme simple influence, sans intermédiaire.
En effet, si l’on a, d’un côté, une pensée magique qui «tend à dépersonnaliser le monde invisible
qui n’a plus d’autre fonction que d’être un réservoir de forces magiques, de mana » (Garnier,
1999 : 68) et de l’autre une pensée religieuse qui « renforce les éléments de personnalité qui
sont dans les événements pour les convertir en personnes » (Bergson, 1990 : 184), il apparaît
que les romans caribéens de notre corpus – dans lesquels on retrouve très souvent des esprits
mais également de la magie « simple » – se placeraient plutôt à l’intersection de ces deux
pensées. Tituba doit par exemple invoquer les Invisibles pour certaines actions, mais elle est
également capable d’agir seule pour guérir. De même Mina fait, dans Chair piment, une
différence nette entre la malédiction de nymphomanie dont elle est la victime et l’intervention

67
de l’esprit qu’elle appelle à son aide : « Mon Dieu ! La Rose ! Délivre-moi ! Je n’ai pas peur.
Mes yeux me trompent, se répétait-elle. Il n’y a rien de vrai dans ce que je vois… je ne sens pas
leurs mains sur moi » (Pineau, 2004 : 345). Si le monde antillais semble, comme nous le verrons
plus loin, lui-même magique et propice aux manifestations du surnaturel, l’omniprésence des
esprits cataloguerait cependant les romans du côté de la « pensée magico-religieuse » qui, nous
dit Xavier Garnier, se développe dans un monde « rempli d’intentionnalités, de volontés »
(Garnier, 1999 : 72). Par cette présence des esprits les romans antillais de notre corpus
représenteraient donc un monde où, comme l’écrit Maryse Condé « tout vit, tout a une âme, un
souffle » (Condé, 2004 : 22) et se différencierait du monde « magique » car ce dernier est « tout
entier défini par le caractère immédiat et efficace de son pouvoir [et] est, de par sa neutralité,
indifférent au monde visible » (Garnier, 1999 : 72). Ainsi si la magie comme pouvoir n’est pas
toujours manifeste dans les romans antillais (et dans des romans réalistes magiques comme The
Famished Road et The Palm-Wine Drinkard), la magie dite « motivée » est, quant à elle,
commune. C’est ce que l’on retrouve par exemple dans la tradition africaine étudiée par John
Mbiti :
Those who practice witchcraft, evil magic and sorcery are the very incarnation of moral evil. They are, by
their very nature, set to destroy relationships, to undermine the moral integrity of society, and to act
contrary to what custom demands. Therefore such people are also instruments of natural evil – at least
people associate them with it, so that when accidents, illnesses, misfortunes and the like strike, people
immediately search for the agents of evil, for witches, for sorcerers and for neighbours or relatives who
have used evil magic against them (Mbiti, 1969: 213)
Comme l’homme africain, l’homme caribéen représenté dans les romans de notre corpus
considère ainsi presque toujours une certaine intentionnalité derrière les événements de sa vie :
« Célestina désignait des esprits, des méchants, des zombis, des sorciers, des houngans d’Haïti,
des magies et des messes à vieux nègres. Le mal s’inscrivait dans chaque éclair de vie, dans

68
chaque frémissement, dans le moindre soupir » (Pineau, 1999 : 186). Ainsi, en cas de malheur,
de maladie ou de mort, on se tourne souvent vers le maléfice et l’intention de nuire d’une tierce
personne. On le voit dans La Grande Drive des esprits ou dans Chair piment, dans lesquels les
la nymphomanie des personnages est causé par des malédictions, ou dans cet autre exemple tiré
de Ti Jean l’Horizon : « Jean l’Horizon devint comme fou devant le maléfice, où chacun avait
reconnu la marque et la griffe, le coup de patte unique de l’Immortel » (Schwarz-Bart, 1998 :
28). Cependant, si ce type de manifestation correspond à certaines œuvres réalistes magiques
(The Famished Road et The Palm-Wine Drinkard, par exemple), ce n’est cependant pas le cas
des œuvres les plus emblématiques de ce mode littéraire dans lesquelles, si les esprits sont
parfois présents, l’idée d’intentionnalité l’est bien moins, comme dans Como agua para
chocolate de Laura Esquivel, dans lequel deux personnages s’enflamment d’amour sans
intervention extérieure, ou encore dans Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias, dans lequel
la transformation en animal, tout en respectant le folklore, ne nécessite pas l’intervention des
esprits et se produit plutôt par effet de métaphore littérale:
La nuit, une fois rentré à l’auberge des ses courses à travers les localités et les foires (il s’arrêtait partout
où il y avait des foires), il contemplait à la lumière de la lune son ombre, son grand corps efflanqué comme
une cosse de haricot, avec l’éventaire par-devant à hauteur de l’estomac, et c’était comme s’il avait vu
l’ombre d’une sarigue… Ainsi, d’homme, il devenait animal à la lumière de la lune, il devenait sarigue
avec une poche par-devant pour mettre ses petits (Asturias, 1987 : 131)
Cette absence d’intentionnalité est aussi présente avec la fameuse scène du filet de sang
« vivant », dans Cien años de soledad:
Un filet de sang passa sous la porte, traversa la salle commune, sortit dans la rue, prit le plus court chemin
parmi les différents trottoirs, descendit les escaliers et remonta les parapets, longea la rue aux Turcs, prit
un tournant à droite, puis un autre à gauche, tourna à angle droit devant la maison des Buendia, passa sous

69
la porte, traversa le salon en rasant les murs pour le pas tacher les tapis, poursuivit sa route par l’autre salle
[…] (Marquez, 1995 : 143)
Si ce passage iconique de l’œuvre réaliste magique de García Márquez illustre de quelle manière
on trouve, dans le monde ordinaire, un autre monde aux propriétés magiques, la relative
intentionnalité du sang n’a rien à voir avec le folklore local, les mythes, les Invisibles ou les
ancêtres. Selon cette distinction, les romans réalistes merveilleux antillais sont donc proches
d’un aspect spécifique des romans réalistes magiques mettant en scène des esprits agissant
directement dans les romans, le plus souvent selon leur propre volonté, comme dans The
Famished Road de Ben Okri ou dans The Palm-Wine Drinkard & My Life in the Bush of Ghosts
d’Amos Tutuola. Ainsi, si nous ne pouvons pas encore déterminer précisément les différences
entre le réalisme magique et le réalisme merveilleux, nous pouvons cependant déterminer qu’il
existe au moins trois types principaux de représentation de cette magie auxquelles les romans
peuvent appartenir. Il y a d’abord la magie pure et impersonnelle, que l’on retrouve par exemple
dans les cas de métaphores littérarisées ou des manipulations magiques qui ne touchent aucun
folklore, aucune croyance particulière mais qui semblent être le produit de l’imagination de
l’auteur : le nez énorme de Saleem dans Midnight’s Children de Salman Rushdie, le filet de
sang « magique » de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez ou encore les recettes
« magiques » de Tita dans Como agua para chocolate. Puis il y a la magie comme phénomène
qui découle d’une force magique inhérente au monde, qui ne passe pas par l’intermédiaire d’un
monde invisible et qui circule au sein même du réel. C’est le cas de certains rituels opérés par
Tituba, dans le roman de Maryse Condé et des personnages utilisant les plantes ou autres rituels
naturels. C’est aussi le type de magie que l’on trouve en partie dans Ti Jean l’Horizon dans
lequel les pouvoirs du héros et les objets magiques qu’il utilise semblent intrinsèquement
magiques (même si les esprits sont présents dans le roman). Enfin il y a la magie qui, basée sur

70
la spiritualité traditionnelle, est liée à un type de magie « d’intention », associée à une volonté
issue des esprits qui l’habitent et qui peuvent être maîtrisés par la force du rituel magique, par la
prière et le sentiment religieux. Nous pouvons ainsi voir que si les romans réalistes magiques
peuvent utiliser les trois modes de la magie, les romans réalistes merveilleux de notre corpus, au
contraire, semblent se limiter aux esprits et au monde de la pensée magico-religieuse qui,
rappelons-le, fait partie des mythes et donc de la pensée folklorique traditionnelle.
2.3 La magie comme phénomène ethnographique
Comme avec la notion de réalisme, la notion de magie et son rapport au folklore nous
conduisent une fois encore vers l’ethnographie. Suivant les similitudes que l’on peut trouver
entre les manifestations magiques des romans réalistes magiques et réalistes merveilleux, il
apparaît que la magie et ses manifestations correspondent très souvent, dans les romans, à des
réalités ethnographiques. Comme l’indique par exemple Charles Lancelin dans son ouvrage La
Sorcellerie des campagnes, la magie présente un certain nombre de traits que l’on retrouve à la
fois dans les traditions occidentales et caribéennes, mais aussi une forme d’universalité qui
expliquerait que l’on puisse retrouver, dans des romans d’origines très différentes, des
représentations similaires de la magie. Comme avec le schéma de transmission du chamanisme
décrit par Mircea Eliade dans son ouvrage Le Chamanisme et les techniques archaïques de
l’extase, la magie peut être perçue comme la possession d’un pouvoir transmis d’une génération
à l’autre, ou le résultat d’une initiation par le biais d’autres sorciers ou de livres sacrés/secrets.
Cependant, l’idée générale de la magie telle qu’on la retrouve dans les romans présente une
définition vaste, fluctuante et difficile à simplifier et qui est difficile d’appliquer à la critique
littéraire :

71
To theorists of culture and literature, the term and the phenomenon it denotes have proven vexingly
impossible to pin down, whether in its politics or aesthetics. Magic can mean anything that defies
empiricism, including religious beliefs, superstitions, myths, legends, voodoo, or simply what Todorov
terms ‘the uncanny’ and ‘marvellous’ fantastic. Realism, seen from the perspective of magic, is one or any
way of grasping reality outside the matrix of what is by now disdained conventional realism […] The tri-
continental and multi-media labyrinthine genesis of magical realism only adds fuel to the already
confusing fanfare of fire for theorists and critics who attempt to make sense of, articulate and contextualize
the politics and aesthetics of this alternately names ‘mode’, ‘genre’ or ‘style’ of expression (Ouyang, 2005:
14).
Le « magique » en littérature est donc tellement divers et répandu que nous nous
retrouvons devant un problème terminologique qui rappelle si bien les définitions du terme
« réalisme » que vouloir étudier des romans africains, caribéens français ou latino-américains
selon une perspective comparative pourrait paraître paradoxal. C’est pour cette raison que,
devant cette masse de textes d’origines et influences culturelles diverses, il conviendrait peut-
être d’analyser la niche dans laquelle le réalisme merveilleux antillais se situe par rapport à
l’arborescence du réalisme magique. Cela nous permettrait de nous détacher d’une tradition
persistante, celle de toujours prendre les textes latino-américains comme base de départ pour la
critique : « the insights gained from research on Spanish American magical realism […] have
served as the theoretical core for the analysis of non-Spanish American texts that combine the
fantastic and the real in speaking of reality » (Ouyang, 2005: 16). Cherchant ainsi une
(re)définition du réalisme merveilleux, notre objectif sera de voir comment des écrivains issus
de cultures antillaises peuvent exprimer, dans leurs œuvres, des « mentalités populaires » qui
acceptent diverses formes de mythes et de manifestations surnaturelles et comment, par
conséquent, leur mode d’écriture peut être représentatif d’une culture et d’une identité
spécifiquement antillaise. Ainsi, après avoir étudié la notion de réalisme puis celle de magie,
nous nous retrouvons devant la notion de « merveilleux » et son lien à la culture populaire, les

72
contes ou le folklore. Or, étudier le merveilleux revient souvent à étudier le mythe, et vice versa
tant les deux éléments sont liés et tant le merveilleux est un des éléments essentiels du
mythe: « gorgé d’éléments et de faits qui transgressent les lois du monde empirique, le mythe
est, plus que le conte et la légende, l’un des lieux privilégiés du merveilleux » (Vincensini,
2005 : 237). Le mythe est donc le terreau du merveilleux, dans lequel celui-ci s’exprime
pleinement. Analysant la deuxième particule de l’oxymore « réalisme merveilleux », nous nous
retrouvons donc devant un des principaux aspects de notre questionnement. Or, qu’est-ce que le
merveilleux ? En quoi s’applique-t-il aux œuvres de notre corpus et à la culture populaire?
3 Première approche du merveilleux
3.1 Le merveilleux classique
Le mot « merveilleux », apparu en français au XIIe siècle, évoque immédiatement, de
nos jours, les contes de fées et les légendes traditionnelles ainsi que le terme fantasy qui, comme
l’indique Jacques Goimard dans son étude Univers sans limites : critique du merveilleux et de la
fantasy, regroupe un certain type de récits utilisant le genre merveilleux. Traditionnellement,
c’est Aristote qui est considéré comme le premier théoricien du merveilleux. Il a en effet
employé dans plusieurs passages de La Poétique le mot thaumaston, qui signifie à la fois
« étonnant » et « admirable », et qui a été traduit par mirabilia en latin – qui implique un
étonnement mêlé de crainte ou d’admiration – puis par maraviglioso en italien pour aboutir au
mot merveilleux en français, au douzième siècle. Pour résumer, on peut donc définir le
merveilleux comme « ce qui produit un effet de surprise, ou suscite l’admiration, ou les deux à
la fois » (Audet, 1973 : 21), et qui est provoqué par le surgissement d’une présence étonnante
qui suspend le cours habituel du quotidien. Ce type de définition a été repris par Alejo

73
Carpentier pour qui « all that is strange is marvelous » (Carpentier, 1995b : 102). Contrairement
au merveilleux pur, nous n’avons pas non plus dans les romans antillais de topographies
merveilleuses qui, comme dans les chroniques de Narnia de C.S. Lewis ou The Lord of the
Rings de J.R.R. Tolkien, sont radicalement autres. Les romans antillais se déroulent toujours
dans le monde réel et empirique : en France, en Guadeloupe et en Martinique même, et plus
rarement en Chine, en Afrique et en Inde. Il n’y a que le roman Ti Jean l’Horizon de Simone
Schwarz-Bart qui, s’inspirant des contes d’un des personnages emblématiques du folklore
caribéen, Ti Jean, semble en partie s’appliquer à cette définition. S’il ne décrit pas des terres
purement imaginaires, le roman se déroule cependant sur des terres réelles (la Guadeloupe,
l’Afrique et la France) qui, placées dans le ventre d’une créature surnaturelle, sont transfigurées
par le mythe. Le roman fait ainsi figure d’exception au milieu de notre corpus d’œuvres qui,
fixées dans un mode historique et ethnographique, ne trouvent leur place ni dans le merveilleux
pur ni dans le fantastique pur, mais à leur croisement, sur une terre bien réelle oscillant entre le
doute, le croire et le ne pas croire.
Le merveilleux naît donc de la surprise et de l’apparition d’un phénomène étrange. Si,
tout comme le magique, il est en rupture avec le code réaliste, il diffère de lui par sa nature: le
magique se réfère en effet plus à l’ordre du monde et au phénomène lui-même alors que le
merveilleux, par l’étonnement qu’il provoque, naît de la réaction, du sentiment éprouvé face au
phénomène « surnaturel » et de sa remise en cause d’une « certaine conception convenue de la
vérité » (Dumont, 1973 : 11). Cette notion de vérité reste quant à elle paradoxale et rejoint la
définition du mythe dans les sociétés traditionnelles. En effet, si le réalisme et le fantastique
considèrent le surnaturel comme un scandale de la raison, et si le fantastique se nourrit du doute,
le merveilleux fonctionne différemment, en mettant la raison et le savoir de côté. Dans le
merveilleux il est ‘convenu’ que les événements inexplicables et étranges sont le fait des dieux,

74
de magiciens ou qu’ils répondent à des pensées mythiques. Il semblerait donc qu’à l’origine du
mot « merveilleux » et son utilisation en littérature, la notion de surprise et de crainte s’applique
aux lecteurs plutôt qu’aux personnages. C’est ce que Denis Mellier soutient quand il reprend la
théorie du scandale de Roger Caillois:
Là où l’élément surnaturel ne fait plus scandale mais est pleinement accepté comme partie de l’univers
fictionnel, là où le contenu de la fiction donne une cause à sa présence et explique alors les relations que
les personnages entretiennent avec les éléments surnaturels, bref, là où la surnature semble s’être
« naturalisée », nous sommes dans le domaine du merveilleux. (Mellier, 1999 : 37)
C’est exactement ce qui se passe dans les romans antillais de notre corpus, dans lesquels
l’apparition de phénomènes surnaturels ne provoque presque jamais de réactions d’incrédulité
ou de surprise de la part des personnages, comme on le voit par exemple avec Léonce faisant
face à l’esprit de sa grand-mère dans La Grande Drive des esprits : « ‘‘Pourquoi es-tu ici,
granman ?’’ Octavie hésita un moment. ‘‘Je suis descendue en ces lieux pour te conseiller.
Écoute !’’ » (Pineau, 1999 : 128). Ainsi, si le merveilleux s’attache aux « univers où la magie et
les pouvoirs occultes expliquent et causalisent le surnaturel » (Mellier, 1999 : 37), nous voyons
qu’il en va de même dans le réalisme magique, et encore plus dans le réalisme merveilleux, dans
lequel, nous venons de le voir, les esprits des morts causalisent encore plus le surnaturel. La
ressemblance s’arrête cependant là puisque ces derniers se différencient inévitablement du
merveilleux pur par leur « code réaliste ». De même, nous l’avons vu, le réalisme merveilleux
n’est pas uniquement basé sur une dichotomie puisque tous les personnages – qu’ils soient
caribéens comme Tituba, antillais occidentalisés comme Mathieu dans Le Quatrième Siècle ou
occidentaux « antillanisés » comme Hadriana dans le roman de René Depestre – ne perçoivent
pas le folklore de la même façon. Ce qui sera surnaturel pour les uns ne sera pas forcement
surnaturel pour les autres. À la lumière de cette définition, il est intéressant de noter que cette

75
absence de surprise du personnage ou du narrateur que l’on retrouve dans le merveilleux est un
des éléments essentiels des définitions du réalisme magique et du réalisme merveilleux. De plus,
comme le genre fantastique n’est pas dans l’objet mais « toujours dans l’œil » (Ponneau, 1990 :
36), nous revenons au concept que la perception et la réaction vis-à-vis du phénomène
surnaturel semblent en grande partie liées non seulement à la nature de celui-ci mais aussi à la
diversité des perceptions que narrateurs et personnages ont du folklore et des mythes locaux.
Réalisme magique et réalisme merveilleux se recoupent ainsi en ce point précis qu’ils
n’appartiennent à aucun « mode pur » tel le fantastique, le réalisme ou le merveilleux, mais en
empruntent de nombreux aspects. De l’absence de surprise du merveilleux au rejet réaliste du
surnaturel en passant par le doute du fantastique, le réalisme merveilleux (et certains romans
réalistes magiques) est donc un mode littéraire complexe qui, tout en faisant partie du réalisme
magique, serait cependant plus centré sur le folklore local plutôt que sur un surnaturel universel,
stylistique ou tout simplement inventé. Essentiellement construit sur le jeu « monde réel/ monde
du folklore et des mythes vivants », le réalisme merveilleux antillais présenterait un jeu sur les
perceptions plus complexe qu’il n’y paraît. Un jeu dans lequel plusieurs réalités se
juxtaposeraient en permanence entre ce qui est perçu comme merveilleux, et qui produit
l’étonnement, pour les uns et perçu comme réel pour les autres. La réception des œuvres se
retrouverait donc en pleine ambiguïté : « de là cet espace commun, réel et merveilleux, où
l’autre et moi tronquons sans cesse des points de vue sur le monde. L’espace de la réception de
l’œuvre réaliste-merveilleuse est donc un espace plein d’ambiguïté, d’incompréhension,
d’ignorance quand il ne s’agit pas de méconnaissance délibérée » (Laroche, 1987 : 134). Le
réalisme merveilleux antillais se définirait ainsi comme l’espace des regards qui s’opposent par
rapport aux diverses interprétations d’une même réalité, contrairement au réalisme magique qui
choisit le point de vue surnaturel sans s’en détacher. Ainsi, si le réalisme magique serait surtout
le mode de l’imaginaire et de la créativité, le réalisme merveilleux est spécifiquement le mode

76
du surnaturel ethnographique, du folklore et des contes populaires qui, comme avec des romans
comme The Famished Road et My Life in the Bush of Ghosts et certains types de merveilleux
occidentaux, suppose une adhésion de l’esprit au surnaturel. Il en sera ainsi du zombi et du
dorliis comme du loup-garou occidental qui « n’est plus un surnaturel de convention ; les gens y
croient et s’imaginent qu’il a une existence vraiment réelle » (Lacourcière, 1973 : 82). Il s’agit
d’un type de perception qui se double d’une perception occidentalisée qui permettra une forme
de vision stéréoscopique du réel antillais, d’une vision non pas faite d’oppositions et de rejets
mais de parallélisme et de superposition. C’est là un arrangement du réel littéraire qui donne,
par son utilisation du folklore, une véritable profondeur au monde antillais, même si le terme
« merveilleux » et son association aux notions de surprise et d’étonnement et d’admiration
s’appliquent imparfaitement aux romans de notre corpus.
3.2 Le réalisme merveilleux selon Alejo Carpentier
Si l’on retourne aux origines du terme réalisme merveilleux, on observe que les
contributions d’Alejo Carpentier et Miguel Ángel Asturias dans leurs romans El reino de este
mundo et Hombres de maiz, tous les deux publiés en 1949, sont souvent considérées comme
annonciatrices du réalisme magique, qui aurait ensuite trouvé sa forme idéale dans le roman
emblématique de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (1967). Il conviendrait alors,
avant d’aller plus loin, de revoir à quoi correspond le réalisme merveilleux traditionnellement
associé aux romans caribéens d’Alejo Carpentier et de Jacques Stephen Alexis, dont les travaux
sont importants aussi bien au niveau théorique7 qu’au niveau de la mise en pratique de ces
7 Carpentier a écrit trois essais sur le sujet, publiés sur une période de plus de 25 ans : la préface de son roman El reino de este mundo en 1949, une version élaborée de ce prologue, « De lo real maravilloso americano », publiée

77
théories dans leurs propres romans. Dans son essai « De lo real maravilloso americano »,
Carpentier suggère en effet que le merveilleux n’est pas, comme le mouvement surréaliste
européen, une attaque en règle des descriptions conventionnelles de la réalité telle qu’elle est
perçue mais, au contraire, une nécessaire amplification de la réalité, inhérente dans la nature et
culture américaines:
The marvelous begins to be unmistakably marvelous when it arises from an unexpected alteration of
reality (the miracle), from a privileged relation of reality, an unaccustomed insight that is singularly
favored by the unexpected richness of reality or an amplification of the scale and categories of reality,
perceived with particular intensity by virtue of an exaltation of the spirit that leads it to a kind of extreme
state [estado límite] (Carpentier, 1995a: 86).
Le monde est donc imprégné par une réalité merveilleuse née de la richesse du réel ou d’une
perception plus intense de celui-ci si bien que, dans le cas des Antilles, cette richesse pourrait
avoir pour origine les rapports historico-culturels avec l’Afrique, l’Inde, etc. et leurs influences
magico-religieuses. Décrivant ses voyages dans le monde, dans la Caraïbe (en particulier en
Haïti), Carpentier écrit dans son essai de quelle manière les cultures européennes et leurs rituels
ont perdu leur spiritualité et leur magie alors que, dans la Caraïbe, le merveilleux est
omniprésent : « I found the marvelous real at every turn » (Carpentier, 1995a : 87). Il va même
plus loin dans son autre essai, « The Baroque and the Marvelous Real », puisqu’il propose l’idée
que cet aspect merveilleux serait inhérent aux réalités humaines et naturelles de l’espace et du
temps. Il propose ainsi l’image d’un merveilleux qui, comme le baroque, serait né naturellement
des différentes réalités historiques, géographiques, démographiques, qui ferait partie de
en 1964, puis le texte d’une conférence donnée à Caracas sur le baroque en 1975 ; Alexis a, quant à lui, écrit « Prolégomènes à un manifeste du réalisme merveilleux des Haïtiens » en 1956.

78
l’identité américaine et qui nous permettrait de voir l’Amérique (et donc les Antilles) comme
une terre ontologiquement magique. Coexistant avec l’idée de réel, cette idée d’un merveilleux
inhérent et ontologique pourrait nous conduire sur une nouvelle piste de recherche. Ainsi, si
certains chercheurs comme Charles W. Scheel ont critiqué cette définition d’un merveilleux
uniquement américain en l’accusant de nier une partie de la littérature européenne dans laquelle
« les forces telluriques, mystiques et païennes imprègnent encore les mentalités et les modes de
vie » (Scheel, 2005 : 48), nous nous opposerons à ce désir d’universalisation qui, basé sur des
aspects uniquement littéraires, nie les spécificités culturelles des manifestations du réalisme
merveilleux et n’en distingue pas les diverses voix. Suivant notre propre approche
socioculturelle, nous soutenons au contraire que si le merveilleux est universellement présent en
littérature, son utilisation diffère selon les conditions politiques, sociales et culturelles de leurs
lieux d’origine. Ainsi, si les auteurs européens utilisent des mythes dans leurs œuvres, ceux-ci
n’auront pas la même valeur que ceux utilisés par un auteur antillais puisque ces auteurs sont
issus de milieux très différents, issus de l’oppression généralisée de l’esclavage, de la
colonisation et, dans le cas des Antilles françaises, de la départementalisation. Ces événements
ont bouleversé la survie, l’adaptation et la création des mythes et du folklore originel qui ont
connu des tensions particulières et ont acquis par le procédé de la création littéraire, des valeurs
spécifiques. Reconnaissant qu’il est possible de rapprocher des modes d’écritures qui, bien
qu’apparemment semblables d’un point de vue littéraire, ont des origines et des objectifs
identitaires et culturels très différents, nous opterons cependant pour une méthode opposée qui,
se focalisant sur la nécessité des peuples antillais de se (re)définir par leur littérature, cherchera
à étudier les spécificités culturelles et identitaires de leur mode d’expression réaliste
merveilleux.

79
C’est en suivant ce mode de pensée que nous nous apercevons que, plus que simplement
littéraire, le mode d’écriture qu’utilise Carpentier prend une valeur idéologique en plus de sa
valeur culturelle: « so that the original rhetoric of magical realism in the Caribbean is bound up
with a type of nationalism that seeks to revalue the African heritage in popular
Caribbean culture, as well as to persuade the reader of the frequent occurrence of the
astonishing, magical events in this region» (Ormerod-Noakes, 1997: 216). Au-delà de
l’approche purement narratologique, les œuvres de Carpentier et d’auteurs réalistes merveilleux
originels comme Asturias seraient donc poussées, par leur utilisation du réalisme merveilleux, à
chercher un point de vue différent de l’eurocentrisme dominant en se basant, non pas sur les
réalités alternatives du mouvement Surréaliste avec lequel ils ont eu des contacts privilégiés,
mais dans les mythes et la spiritualité de leurs communautés d’origine qui forment une réalité
différente de la réalité européenne (bien que celle-ci puisse également être magique). Le roman
El reino de este mundo, basé sur la propre expérience de Carpentier lors de son séjour en Haïti
en 1943, propose ainsi un regard multiple sur le monde. Si on trouve dans le roman un certain
nombre de métamorphoses, décrites de manière tout à fait naturelle comme celles de Mackandal
et Ti Noël « fatigué de ses hasardeuses métamorphoses, Ti Noël fit usage de ses pouvoirs
extraordinaires pour se transformer en oie et partager la vie du troupeau qui s’était installé sur
son domaine8 » (Carpentier, 1980 : 181), celui-ci s’écarte également en partie de la pensée
traditionnelle en mettant en doute la survie magique de Mackandal dans une des scènes cruciales
du roman. En effet, si pour les esclaves, Mackandal se libère de ses liens et s’envole avant de se
fondre dans la foule des esclaves, le narrateur nous indique que les colons français et les soldats
haïtiens sous leurs ordres ne voient, au contraire, qu’une simple exécution sans intervention du
surnaturel. Par son double regard, Carpentier illustre ainsi l’ambivalence du mode réaliste
8 Cette transformation n’est pas sans rappeler celle du nahual en sarigue dans Hombres de maíz d’Asturias.

80
merveilleux, placé entre deux antinomies, mais aussi de quelle manière, dans son roman, « the
world of the Afro-Caribbean ‘subaltern’ becomes the magical black archive9 hovering within
the white, empiricist narrative of a slave rebellion » (Hart, 2005 : 3). Ainsi, selon Hart, il n’y a
pas mélange des cultures mais superposition puisque « the archive of the novel is, indeed, not
expressed in terms of a syncretistic vision for it runs counter to white history and white
knowledge» (Idem.). Cependant, Carpentier n’utilisera pas toujours le terme de « réalisme
merveilleux », qu’il remplacera par le terme « baroque » dans les années 60, terme qui, selon
lui, résume plus parfaitement la situation culturelle du continent Américain et de son art. Ainsi,
si le terme « merveilleux » est, selon nous, aussi inadéquat que le terme « baroque » dont les
origines remontent également à des arts visuels, Carpentier a bel et bien ouvert la voie du
réalisme merveilleux d’aujourd’hui par son aspect culturel, sa dualité du regard sur un
phénomène et sa description d’une terre ontologiquement magique, que nous allons voir dans
notre étude.
3.3 La vision merveilleuse de Jacques Stephen Alexis
Si les liens théoriques reliant Alejo Carpentier et Jacques Stephen Alexis ne sont pas
évidents à déterminer, il est cependant intéressant de constater de quelle manière critiques et
écrivains ont tendance à les associer. C’est ce que fait par exemple Glissant dans sa préface de
Chronique des sept misères dans laquelle il n’hésite pas à rapprocher Patrick Chamoiseau, Alejo
Carpentier et Jacques Stephen Alexis, trois auteurs qui, selon lui, se retrouvent autour d'un art, le
réalisme merveilleux, qu’il perçoit comme « le ferment d’une littérature du baroque dont
9 Hart précise que: « the term archive is used here to mean a cultural and linguistic set of knowledge paradigms which allow individuals or social groups or nations to assert and create identity» (Hart, 2005: 3)

81
l’Amérique du Sud a donné d’éclatants exemples » (Glissant, 2004 : 4) Or, l’approche du
réalisme merveilleux par Jacques Stephen Alexis – auteur à la fois caribéen et francophone –
peut paraître relativement différente. S’étant particulièrement intéressé à Haïti et au Vaudou
ainsi qu’à la culture haïtienne dont il note les siècles de brassages culturels, ses travaux
présentent en effet certaines particularités. Son « Prolégomènes d’une esthétique du réalisme
merveilleux des Haïtiens » par exemple, présenté à la Sorbonne en 1956, propose de percevoir
le merveilleux comme une forme d’imagerie populaire surtout liée aux peuples d’origine
africaine mais également comme un syncrétisme influencé par les origines françaises et
amérindiennes de l’île. Ses théories donnent donc au réalisme merveilleux une portée culturelle
et politique qui lui permettra, comme l’indique Michael Dash, dans son article « Way Out of
Negritude », de sortir du mouvement de la Négritude en se plaçant sur le plan de l’esthétique
plutôt que sur celui de la psychologie ou de l’idéologie (que l’on retrouve dans les mouvements
de la Négritude et l’Indigénisme). Influencé par Carpentier, qui se limitait à la littérature, Alexis
place alors les arts (littérature mais aussi la peinture et la musique, la danse et les contes
populaires oraux) dans une perspective plus générale, non plus seulement haïtienne, mais
caribéenne et américaine, créant un lien direct entre la perception populaire du merveilleux et
l’engagement des artistes:
Qu’est-ce donc le Merveilleux sinon l’imagerie dans laquelle un peuple enveloppe son expérience, reflète
sa conception du monde et de la vie, sa foi, son espérance, sa confiance en l’homme, en une grande justice,
et l’explication qu’il trouve aux forces antagonistes du progrès? Le Merveilleux implique certes la naïveté,
l’empirisme sinon le mysticisme, mais la preuve a été faite qu’on peut y envelopper autre chose […],
l’incitation à la lutte pour le bonheur. Les combattants d’avant-garde de la culture haïtienne se rendent
compte de la nécessité de transcender résolument ce qu’il y a d’irrationnel, de mystique et d’animiste dans
leur patrimoine national, mais ils ne croient pas qu’il y ait là un problème insoluble. (Alexis, 1956 : 267).

82
La mission de l’artiste est donc, selon Alexis, de puiser dans l’esthétique populaire afin de
produire des œuvres faites pour le peuple. Une esthétique merveilleuse qui se défend de tout
primitivisme, tout en proposant une tentative de traduire aussi exactement que possible le
merveilleux du réel par l’imagination. Il est ainsi intéressant de noter que contrairement à
Carpentier qui oppose la culture européenne à la culture latino-américaine, Alexis a une
perception bien plus politique du phénomène puisqu’il oppose une culture populaire à une
culture bourgeoise plus attirée par l’Occident en général. Au-delà de la notion de classe
bourgeoise, qui est trop politique pour notre approche ethnographique, on peut remarquer que le
réalisme merveilleux des romans antillais contemporains a également hérité des théories
d’Alexis. Bien qu’il se base surtout sur les héritages africains, occidentaux et amérindiens et que
son approche soit plus esthétique que culturelle, elle repose néanmoins, comme nous allons le
voir, sur une somme de savoir populaire et, par extension, sur les mythes en (re)construction qui
les constituent.
Si les études du réalisme magique ignorent le terme réalisme merveilleux et si les
quelques rares études narratologiques comparatistes sur le réalisme magique/réalisme
merveilleux ont certaines difficultés à y intégrer les romans antillais, l’approche purement
stylistique ne donne que peu d’indices. En fait, devant la diversité et la complexité du réalisme
merveilleux ou du réalisme magique qui, dans leur rapport au réel, au magique et au
merveilleux, prennent de multiples visages, le désir de vouloir unifier ces littératures sous une
appellation unique semble présomptueux. D’un continent à l’autre, d’une culture à l’autre, les
motivations et les manifestations du réalisme merveilleux sont si diverses que tout regroupement
souffrirait de simplification. Ainsi conviendrait-il d’examiner le réalisme merveilleux dans le
contexte des phénomènes ethnographiques qui l’accompagnent. Cette approche spécifique qui
va d’abord nous mener à revoir le terme « réalisme merveilleux » afin de proposer une

83
terminologie plus appropriée à ses spécificités culturelles nous permettra ainsi de déterminer
comment, dans les romans antillais, ce mode d’écriture reflète la vie antillaise qui, s’associant à
la spiritualité et au folklore, est essentiel à une (re)construction identitaire.

84
Chapitre 3 Pour une redéfinition du merveilleux
1 Le magique, le merveilleux et les mythes
1.1 La pensée magique en littérature : une convention ?
Comme nous l’avons entrevu avec la pratique de l’écriture ethnographique, il y a une
grande différence entre l’utilisation et la pratique de la magie dans la vie quotidienne, qui
disparaît petit à petit, et sa représentation dans les romans antillais qui, au contraire, se maintient
et semble se développer. Cette différence passe essentiellement par les rapports qu’entretiennent
le monde vécu et le monde fictionnel dans lequel les représentations de la magie n’auraient pas
pour seul but la réalité ethnographique mais, peut-être, un désir didactique de préservation d’un
patrimoine. Pour Glissant, en effet, la pensée magique, « s’établit à partir de croyances enfouies
dans le passé commun. C’est un partage du présent. Mais elle prolifère aussi de ce que le présent
échappe, se dérobe sous vous » (Glissant, 2002 : 776), si bien qu’en analysant les romans il
faudra donc non pas adopter l’approche de l’ethnologue mais celle du critique. En effet, si
l’ethnologue étudie le réel, l’écrivain le (re)crée dans ses romans pour l’étudier et le
questionner: « le monde fictionnel n’est une création que s’il entre en résonance avec le monde
vécu, non en lui ressemblant, mais en le questionnant. On voit mal l’intérêt d’un roman s’il n’est
une façon de penser le monde. Penser le monde de façon romanesque, c’est faire apparaître le
sens d’une époque » (Garnier, 1999 : 2). Ainsi, si en règle générale les ethnologues comme
Mircea Eliade, Alfred Métraux et Laënnec Hurbon expliquent et commentent la pensée magico

85
religieuse, il est rare que les auteurs fassent de même. Prenons par exemple René Depestre et
son étude du phénomène zombi dans Hadriana dans tous les rêves : « le phénomène zombie se
situerait au confluent des courants de magie qui, dans différentes cultures de la planète, ont
déposé des œufs fantastiques dans les nids des cultes agraires auxquels le vaudou et sa
‘‘vauderie’’ singulière sont apparentés » (Depestre, 1988 : 126). Au-delà des apparences, cette
analyse n’est pas gratuite ni purement ethnographique et sociale, comme elle le serait pour
Hurbon, car elle entre dans le questionnement du personnage principal, Patrick. Celui-ci écrit
cette étude car tout au long de son enquête sur la mort supposée d’Hadriana et la disparition de
son corps, que tout le monde attribue à une zombification, il cherche à s’expliquer sa propre
culture et sa propre identité. De même, dans la plupart des romans, les auteurs font fonctionner
la pensée magique et le folklore à travers leurs personnages ou lui donnent un sens symbolique,
identitaire ou culturel. On le voit ainsi par exemple dans Moi, Tituba…, roman dans lequel
Tituba est confrontée à l’adaptation de sa pensée magique entre la Barbade et Boston ; dans Ti
Jean l’Horizon dans lequel le voyage magique dans le corps de la Bête est, comme nous le
verrons plus loin, un voyage identitaire ; ou encore dans L’Homme-au-Bâton d’Ernest Pépin, qui
étudie les manifestations d’un dorliis dans les villes et le monde contemporain : « que faire
d’une jeune plante meurtrie qui jouait avec la folie douce ? On l’expédia en France car comme
on le sait les « esprits » n’enjambent pas les eaux » (Pépin, 2005 :77-78). Les éléments de ce
dernier exemple sont importants car ils impliquent que ce roman, comme d’autres, ne présente
pas une pensée magico-religieuse pure, et donc « fermée », sans point de vue extérieur, mais au
contraire une vision double. Prenant en compte la vision occidentale et traditionnelle du folklore
caribéen, Pépin théorise ainsi le rapport Antilles-France : que la jeune fille soit folle, qu’elle ait
imaginé l’intervention d’un dorliis pour expliquer la perte de sa virginité ou qu’elle en ait
réellement été la victime, elle est envoyée en France. Une solution doublement pratique puisque,

86
si elle y sera soignée, elle pourra aussi y cacher la honte de sa situation… et échapper aux
esprits par la même occasion.
Par l’effet de la littérature, ce monde des esprits, (qui est donc une théorie pour les
anthropologues et une réalité pour certaines tranches de la population antillaise), n’en est donc
pas nécessairement une réalité pour les auteurs. Pour eux, magie et spiritualité sont d’abord des
outils littéraires qui se donnent, par l’écriture, une épaisseur et une dimension nouvelles.
Marques culturelles, patrimoine identitaire, elles leur permettent également d’interroger le réel
sur un autre niveau: « avec le roman, la magie devient le point sensible d’une interrogation sur
le réel, et son complément, l’irréel » (Garnier, 1999 : 5). Ainsi, que certains auteurs comme
Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau se définissent dans leurs romans ou leurs essais comme
des auteurs anthropologues1 ou que d’autres utilisent la magie comme métaphore culturelle ou
comme détail de leurs romans, la magie et le folklore seront toujours présents dans les romans,
même les plus réalistes. Ils sont une composante incontournable de l’identité antillaise et
auraient alors deux valeurs qui se superposent, l’une ethnologique et l’autre littéraire. De ce fait,
on pourrait les définir, comme le fait Maryse Condé, comme des conventions de la littérature
antillaise:
Je me suis beaucoup amusée en décrivant la réconciliation entre l’esprit de Liza et celui d’Elaïse autour du
vieil Albert. Bien que la croyance aux esprits soit un phénomène culturel de nos sociétés dont je ne me
moque pas entièrement. Disons que je le sais, il ne peut pas y avoir de roman caraïbe sans présence de
l’invisible et que j’en rajoute, un peu par dérision (citée par Pfaff, 1993 : 104-105)
1 Raphaël Confiant étudie dans ses romans les communautés minoritaires (par exemple les engagés indiens dans La Panse du chacal, les immigrants chinois dans Case à Chine) et Patrick Chamoiseau se représente souvent dans ses romans comme un anthropologue muni d’un enregistreur en panne (dans Chronique des sept misères et Solibo magnifique).

87
Les manifestations du monde invisible dans le roman de Maryse Condé sont donc en partie
causées par un désir ethnologique, la fidélité à une certaine convention, mais aussi une
oscillation entre la dérision et la prise au sérieux de ces phénomènes culturels qui, même s’ils ne
sont pas au cœur du récit, sont toujours présents. Même les romans sans dorliis ni esprits
mentionnent avec beaucoup de naturel, à un moment ou à un autre, la pensée magique, le
folklore ou la spiritualité. On le voit par exemple dans La Rue Cases-Nègres, « C’était
d’ailleurs, comme je devais l’apprendre ensuite, un cas de ‘‘quimboisement’’, un sort que jadis
un galant dedaigné et blessé dans son orgueil avait jeté à Mam’zelle Délice » (Zobel, 2002 :
140), ou dans Zonzon tête carrée, « [pour Zonzon] les affaires du sacré échappent aux mortels
tout comme celles des mortels sont inaccessibles au sacré. Et c’est foutrement bien ainsi! »
(Césaire, 1994: 18). Repoussant les frontières du roman, la pensée magique peut donc aider au
questionnement de l’identité culturelle sans pour autant malmener la notion de réel. Ainsi, à
l’exception de romans comme Ti Jean l’Horizon ou Moi, Tituba… qui prennent nettement le
parti d’un surnaturel décrit comme « normal » du point de vue antillais, on remarque que, dans
la plupart des romans, les accidents ou maladies qui y sont décrits sont plausibles et rationnels et
que, si leurs causes n’étaient pas magiques, ils auraient des explications réalistes. Prenons par
exemple la dépression de Victor dans Chair piment: « cela faisait des années qu’il survivait avec
sa dépression. Depuis toujours, selon lui […]. Même en prenant des médicaments, elles ne
disparaissaient jamais tout à fait, les idées noires » (Pineau, 2004 : 100). Selon le regard qu’on y
porte dans le roman, cette dépression peut être une maladie ou le résultat d’une possession par
des esprits. Littérairement parlant, ces esprits pourraient même être une matérialisation
symbolique du phénomène de dépression, dans lequel on voit souvent les individus
métaphoriquement2 hantés ou possédés par des pensées négatives ou des souvenirs
2 Remarquons ici un emboîtement intéressant : la possession par des esprits négatifs est à la fois une métaphore

88
traumatiques. Cependant, que les esprits soient une métaphore, qu’ils fassent partie du folklore
ou qu’ils soient réels, leur existence sera, aux Antilles, toujours considérée comme un
événement naturel faisant partie du quotidien. Nous pourrions alors nous demander : si la
mention du monde invisible est une convention de la culture antillaise pouvons-nous, malgré la
multiplicité des regards, parler de réalisme ?
1.2 Une pensée magico-religieuse rationnelle ?
La magie prend donc, dans les romans, la valeur une interprétation des phénomènes. Elle
est représentation, mais aussi un moyen d’interprétation permettant d’expliquer le monde, aussi
bien par le surnaturel et par la raison que par le symbole. C’est ainsi que l’homme-au-bâton qui
hante le roman d’Ernest Pépin est tout à la fois un esprit antillais, l’incarnation folklorique d’une
peur, l’incarnation d’une figure masculine tyrannique et agressive, mais aussi un moyen
d’excuser un certain nombre de comportements : « L’Homme-au-Bâton tombait à point nommé
pour laver tant d’humiliations, de mensonges, de tromperies dans une eau purificatrice » (Pépin,
2005 : 93). Les romans antillais présentent donc presque toujours plusieurs explications aux
phénomènes folkloriques, sans jamais entièrement en élucider la nature. Si bien que certaines
des œuvres de notre corpus ne semblent ni complètement confirmer ni rejeter l’existence du
phénomène, évitant ainsi de se placer dans une perspective unique, réaliste ou surnaturelle, ou
encore dans le doute. Les phénomènes font partie de la culture et de l’identité antillaise et les
romans ne cherchent pas à confirmer ou à nier leur existence. Ainsi, si le dorliis de L’Homme-
littérale typique du réalisme magique, mais aussi une manifestation d’un élément de la spiritualité antillaise ainsi que de la spiritualité mondiale puisque de très nombreuses cultures et religions font mention de possession par des esprits.

89
au-bâton peut être un violeur, un esprit, un fantasme ou une excuse, le roman ne donne aucune
explication définitive, surnaturelle ou réaliste, tout comme Hadriana dans tous mes rêves se
termine sans confirmer ou nier l’existence des zombis. Rajoutons que même si certains des
romans de notre corpus, comme par exemple Moi, Tituba… (dont la narratrice est l’esprit de
Tituba) ou Ti Jean l’Horizon (dans lequel la réalité de la Bête est reconnue, puisque le soleil a
disparu sur toute la planète), se situent au-delà de cette dichotomie et présentent spécifiquement
l’aspect surnaturel du monde antillais, ils ne le font que parce qu’ils suivent le parcours de
personnages qui y sont spécifiquement rattachés. Or il y a aussi, dans Moi, Tituba… et Ti Jean
l’Horizon, des individus qui doutent ou qui ne croient pas. Cependant, comme le monde du
réalisme merveilleux est un monde qui demeure caché, les personnages de ce type sont rarement
en contact avec lui. Ainsi, comme l’explique Robin Horton à propos de la pensée traditionnelle
africaine (que l’on pourrait appliquer au milieu traditionnel antillais et donc aux romans), le
monde invisible serait en fait, tout comme la pensée scientifique occidentale, une pensée
théorique qui se base sur le réel pour l’expliquer. Cet aspect est essentiel dans les romans
réalistes merveilleux qui décrivent presque toujours des événements apparemment surnaturels,
mais logiques et réalistes dans leur système de pensée traditionnel (de même que dans un
système de pensée rationnel). Esprits et autres créatures folkloriques suivent tous une certaine
logique folklorique : le rituel de zombification a un déroulement bien spécifique, tout comme
chacun sait, par exemple, que les créatures de la nuit ne se manifestent jamais en plein jour et
que, comme avec les mofwazés, le soleil leur est nuisible. Ainsi, si la pensée magique africaine
et, par extension, la pensée magique antillaise ne sont pas « rationnelles » du point de vue
occidental, elles n’en ont pas moins leur propre rationalité puisque « la fonction intellectuelle de
ses esprits et de ses dieux (tout comme celle des atomes, ou des ondes entre autres) est
l’extension de la vision des causes naturelles » (Horton, 1990 : 48).

90
Il apparaît alors que le mythe fait au niveau de l’Histoire et de la notion d’origine, la
pensée magico-religieuse le fait au niveau des romans. De même, si l’Histoire et l’analyse
ethnographique représentent la raison, le mythe et la pensée magico-religieuse représenteraient
l’interprétation magique et symbolique du monde. Ainsi, comme le mythe le fait pour une
société traditionnelle, les événements surnaturels – par leur fidélité à la spiritualité et au folklore
– expliqueront l’origine d’un événement ou d’un état : si des femmes perdent mystérieusement
leur virginité, c’est la faute à un véritable dorliis ou à un « dorliis de circonstances », et si Mina,
dans le roman Chair piment, souffre de nymphomanie, c’est à cause de sa nature propre ou du
pouvoir d’un quimboiseur : « toi, je voulais pas que tu ne connaisses, que t’en sois privée…
Vingt ans de malédiction que j’avais demandés pour toi… Vingt ans… » (Pineau, 2004 : 305).
Cette double appartenance de la culture antillaise la différencie de la pensée traditionnelle qui,
sans ouverture et laissée à elle-même, n’est pas consciente de « savoirs alternatifs » (Horton,
1990 : 55). Comme nous l’avons dit, il y a en effet presque toujours, dans les romans antillais,
au moins trois explications pour chaque phénomène : une approche ethnographique qui
explique ; une explication rationnelle née de la pensée scientifique qui analyse ; et une pensée
magique qui, au contraire, « n’appréhende pas le réel comme un objet [et qui] rajoute du réel à
ce réel, elle élargit le réel pour lui donner une cohérence logique » (Garnier, 1999 : 11). De ce
fait, s’il y a dans les œuvres réalistes magiques et réalistes merveilleuses, une constante
antinomie entre réalisme et le magique/merveilleux et entre la pensée occidentale et la pensée
traditionnelle, celle-ci n’est pas toujours nette et définitive. Cette opposition a beau être née du
contexte de l’esclavage, de la colonisation et de la rupture/confrontation historique entre deux
cultures, elle ne prend cependant pas le pas sur le réel. Ce type de romans antillais s’oppose
ainsi à des œuvres qui, choisissant exclusivement une culture plutôt qu’une autre, laissent de
côté la part identitaire. C’est le cas par exemple de Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez, roman dans lequel les tribus amérindiennes restent dans la périphérie de l’intrigue ou

91
de Hombres de maiz de Miguel Ángel Asturias qui ne se concentre que sur le côté amérindien
de la culture guatémaltèque3. Contrairement au genre fantastique qui révèle un monde inquiétant
en opposition avec l’idée du réel, les romans réalistes magiques pourraient alors être décrits par
leur représentation de « two conflicting, but autonomously coherent, perspectives, one based on
an ‘enlightened’ and rational view of reality, and the other on the acceptance of the supernatural
as part of everyday reality» (Chanady, 1985: 21-22). À part quelques rares exceptions comme Ti
Jean l’Horizon, Moi, Tituba… et L’Esclave vieil homme et le molosse4, les romans antillais, au
contraire, portent en eux un regard multiple sur le monde, dans lequel on note deux visions
nettes : celle née de la rationalité traditionnelle et celle née d’une rationalité scientifique. La
question de la pensée magico-religieuse, qui est au cœur du réalisme merveilleux, est donc un
élément essentiel du questionnement du réel, de l’irréel mais aussi, comme nous le verrons tout
au long de notre étude, de l’identité. Le réalisme merveilleux serait-il donc une mise par écrit de
cette pensée magico-religieuse antillaise qui, élargissant le réel, lui donnerait une certaine
cohérence?
1.3 Un réalisme merveilleux ontologique et mythique
Si l’on en vient plus spécifiquement aux mythes, il apparaît que les romans antillais ne se
réfèrent pas toujours aux trois types de mythes utilisés par le réalisme magique: « there are
really three kinds of myth which come into play : Classical, Christian and indigenous Latin
American » (Shaw, 2005 : 47). Dans les romans antillais, les mythes grecs classiques sont
3 Bien que prenant principalement le point de vue du monde surnaturel, Ti Jean l’Horizon et Moi, Tituba… sont cependant placés, par leur utilisation du réalisme ethnographique et historique, au cœur de l’antinomie. 4 Des romans choisissant un regard plus spécifiquement antillais ou, comme nous le verrons tout au long de cette étude, un regard universel et magique sur le monde.

92
absents (ou leur présence n’est pas, comme des situations œœdipiennes, évidente au premier
coup d’œil) et les mythes indigènes originels ont été, dans les îles françaises, exterminés très tôt
sans qu’ils ne puissent laisser de traces mythiques. De même les mythes africains, indiens ou
chinois, s’ils sont parfois mentionnés dans une conversation ou dans les pratiques religieuses des
personnages, n’agissent pas dans les romans. Ils ne sont que des données ethnographiques si
bien que, en fin de compte, les seuls mythes possibles sont, comme nous le verrons dans la suite
de cette étude, ceux créés par les auteurs. Les mythes et leur utilisation seraient-ils donc un autre
moyen de différencier les deux modes de représentation du réel ?
Dans son essai «Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern
Fiction », Wendy B. Faris introduit deux types de distinctions intéressantes au sein du réalisme
magique. Dans la première, originellement introduite par Jean Weisgerber, il y a deux types de
réalismes magiques : le premier serait « scholarly » et le second mythique/folklorique. La
deuxième distinction, développée par Roberto González Echevarría, distingue un réalisme
magique épistémologique du réalisme magique ontologique. Ces deux distinctions permettent
ainsi de déterminer deux sous-genres du réalisme magique, avec d’un côté des romans qui,
comme Cien Años de soledad, laissent les cultures tribales locales hors de la narration, et de
l’autre des romans qui, comme Hombres de Maíz, actualisent le passé mythologique. En
appliquant cette distinction aux écrits de la Caraïbe francophone, il apparaît que ceux-ci sont
d’abord mythiques par leur création de mythes5 et par leurs narrations saturées de folklore et de
références aux contes. Il apparaît qu’ils sont également, comme l’avait vu Carpentier,
ontologiques : comme on peut le constater dans La Grande Drive des esprits ou dans Moi
Tituba…, les morts n’ont pas leur monde à eux, mais se déplacent au cœur du réel, au milieu des
5 Un fait que nous tenterons de démontrer dans nos deux prochaines parties.

93
vivants, sans que ceux-ci puissent nécessairement les voir. La terre antillaise, où « tout vit, tout a
une âme, un souffle » (Condé, 2004 : 22), est donc ontologiquement magique par
l’omniprésence des Invisibles et de la spiritualité qui, comme nous le verrons dans notre
dernière partie, l’imprègnent. Cela confirme donc que le réalisme merveilleux n’est pas un mode
de représentation distinct du réalisme magique, mais une de ses variantes culturelles, ce qui
expliquerait que l’on puisse trouver des différences entre les œuvres d’un même auteur. Ainsi, si
l’on voulait étudier les phénomènes surnaturels dans deux œuvres réalistes magiques de Gabriel
García Márquez comme Cien Años de soledad et Del Amor y otros demonios, on s’apercevrait
que la différence entre les deux romans provient de la valeur de leurs phénomènes surnaturels :
si dans le premier roman les manifestations du merveilleux n’ont pas d’explication culturelle
(c’est-à-dire que la pluie de fleurs ou les tapis volants n’ont aucune relation aux mythes
purement sud-américains mais ont des origines diverses) le deuxième roman, au contraire, est
profondément ancré dans les croyances et la spiritualité locales. Dans le cas de Cien Años de
soledad, les mythes bibliques que l’on y trouve donnent une « universal significance to the story
of Macondo » (Shaw, 2005 : 52). Dans Del Amor y otros demonios, au contraire, le roman lui-
même a été inspiré à l’auteur par un conte local que lui racontait sa grand-mère. Il apparaît en
effet que la condition de Sierva María peut être expliquée ethnologiquement, par les croyances
catholiques, par la spiritualité des esclaves qui ont élevé la fillette. Un principe de « réalisme
folklorique » absent de certains types de romans réalistes magiques comme Cien Años de
soledad qui propose des histoires « that resemble classical or biblical myths […] characters who
are reminiscent of mythical heroes […] [and] certain stories [that] have a general mythic
character […] in that they contain supernatural elements…» (Echevarría, 1990: 53). Ainsi, chez
Márquez, aucun mythe ne prend le dessus sur les autres : « no single myth or mythology
prevails » (Echevarría, 1990: 53). On ne retrouve pas de mélanges semblables dans les romans
antillais. Variantes culturelles du réalisme magique, leur tonalite mythique indique clairement

94
qu’ils sont plutôt influencés par des thèmes et des structures mythiques et folkloriques en accord
avec la tradition et les croyances locales. À ce contenu folklorique s’ajoutent parfois des valeurs
mythiques plus générales comme le cheminement initiatique de Tituba ou de Ti Jean qui, dans le
roman de Simone Schwarz-Bart, doit accomplir une quête initiatique faite de souffrances et d’un
cycle vie/mort après avoir été avalé par une bête mythique. Le réalisme merveilleux utilise ainsi
le mythe de la même manière qu’il utilise la magie : il en fait un outil littéraire qui, tout en
structurant les récits et la pensée, est utilisé par les auteurs pour faire passer un discours qui, à la
manière du réalisme ethnographique, est directement lié au folklore et à la mémoire culturelle et,
donc, à la question de l’identité.
2 La question ethnoculturelle
2.1 Le réalisme merveilleux et l‘importance de la connaissance des mythes
Réalisme magique et réalisme merveilleux auraient donc un certain nombre de points
communs pour qu’on puisse les associer et voir le second comme une ramification du premier.
Le réalisme merveilleux antillais serait un réalisme magique spécifiquement ontologique et
mythique qui serait, en plus, spécifiquement basé sur un folklore et une spiritualité antillais, une
terre ontologiquement magique et une multiplicité de perceptions de ces phénomènes. Il s’agit
donc d’un système complexe qui, tout en représentant un état de culture ambivalent, permettrait
aux auteurs de préserver la dimension magique de leurs mondes puisque, peu importe le point de
vue qu’adopte le lecteur, le narrateur ou le personnage, ces mondes décrits de manière réaliste
contiennent toujours une dimension « autre » issue du folklore. Bien que d’origines culturelles
différentes, réalisme magique et réalisme merveilleux ne s’excluent pas et révèlent les mystères
de l’existence qui se cachent derrière le quotidien. Cependant, si le réalisme magique se veut un

95
mode postcolonial plus « généralisé », le réalisme merveilleux se voit, par ses spécificités
antillaises, lié à une application locale spécifique. L’élément essentiel de cette approche est donc
que le folklore a, dans le réalisme merveilleux, sa place au creux du réel puisque la pensée
magique traditionnelle qui l’imprègne fonctionne comme une science explicative qui donne du
monde une image non pas double, comme les deux faces d’une pièce, mais symbiotique. Le
réalisme merveilleux fait ainsi partie d’une dimension du monde que les auteurs eux-mêmes
doivent être capables de saisir :
Let us keep in mind that in these magical realist works the author does not need to justify the mystery of
events, as the fantastic writer has to. In fantastic literature the supernatural invades a world ruled by reason
[…]. In order to seize the reality’s mysteries the magical realist writer heightens his senses until he reaches
an extreme state [estado límite] that allows him to intuit the imperceptible subtleties of the external world,
the multifarious world in which we live (Leal, 1995: 123).
De ce fait, si le réalisme magique et le réalisme merveilleux se positionnent dans cette niche qui
sépare les deux perceptions du réel, le réalisme merveilleux déterminera sa spécificité par la
nature folklorique des phénomènes qui s’y manifestent, fidèles aux croyances populaires, mais
aussi par les multiples perceptions de ces croyances.
Pour les lecteurs comme pour les personnages, le savoir ethnographique présente ainsi
un aspect quasiment « pédagogique » : si dans les romans réalistes le savoir n’a pas de valeur
réelle pour les personnages, celui-ci est au contraire essentiel au développement et à la survie
des personnages des romans réalistes merveilleux. Bien souvent dans les récits, ce savoir permet
aux personnages de survivre. C’est le cas avec l’éducation/initiation magique de Tituba ou de Ti
Jean qui leur sauve plusieurs fois la vie, ou avec le savoir ancestral qui, dans La Panse du
chacal et Le Quatrième Siècle, permet une certaine survie identitaire. Cependant, il ne faut pas
se limiter aux personnages : ce savoir transmis par le réalisme ethnographique apparaît tout

96
aussi essentiel pour le lecteur, le critique ou encore l’écrivain ou le chercheur. Il permet en effet,
comme le mythe, d’interpréter mais aussi de donner un sens à un grand nombre d’actions
humaines (comme les rituels religieux et les éléments surnaturels présents dans les romans
caribéens), et donc de comprendre leurs valeurs. De ce fait, on peut imaginer que les romans ont
une valeur proche de celle des mythes car ils sont, eux aussi, des réservoirs de savoir utiles à la
mémoire culturelle. Ces faits établis, nous pouvons supposer que, ethnologiquement mais aussi
littérairement parlant, les mythes et leur valeur (pour ceux qui y croient ou qui les utilisent dans
leurs œuvres) ne devraient pas être mal interprétés par ceux qui entrent en contact avec les
œuvres. Il apparaît en effet évident que toute erreur d’interprétation de la symbolique ou de la
valeur de ces mythes pourrait avoir, en cas de contact culturel (soit réel, soit littéraire), des
conséquences dramatiques. Nous l’avons vu, les mythes sont des faits de culture qui permettent
d’interpréter et de donner un sens aux conduites humaines. Or, « une structure mythique peut
être totalement étrangère à l’horizon d’attente d’un public quand il s’agit de mythe importé
d’une autre culture et rendu accessible grâce à une traduction » (Chevrel, 2005 : 290). Pour
appuyer son exemple, Chevrel cite le romans Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias qui,
par son utilisation des traditions du Popol Vuh, incite le lecteur européen « à s’informer d’autres
théologies ou théogonies que celles auxquelles il est habitué, tant l’écart est grand, et il n’est
alors pas du tout sûr que la parole mythique lui ‘‘dise’’ ici quelque chose » (Ibid. : 291). Cet
écart, quand il est trop important, pousse parfois les auteurs à expliquer certains aspects de leurs
œuvres, comme le font par exemple René Depestre avec les zombis dans son roman Hadriana
dans tous mes rêves ou, dans un registre différent, Victor Segalen avec les mythes polynésiens
dans Les Immémoriaux. Ainsi, les mythes ne sont pas toujours en parfait accord les uns avec les
autres et, bien au contraire, tracent des différences et des séparations essentielles d’une culture à
l’autre: « dans les cultures traditionnelles, le Dit du mythe fondateur servait surtout à maintenir
l’Autre à l’opposé de soi, à se légitimer face à lui, à se construire en rupture avec lui »

97
(Chamoiseau, 2002 : 194). C’est un schéma que l’on retrouve partout et en tout temps à travers
l’histoire humaine : le rituel d’une culture autre est mal compris car il est basé sur des mythes
inconnus et souvent difficiles à (re)connaître, comme par exemple les sacrifices humains chez
les Aztèques et la perception de ceux-ci par les conquistadores qui s’est terminée en massacres
et en acculturations. Une incompréhension se traduit aussi, et souvent, par la domination d’une
pensée sur une autre, comme on peut l’observer dans le roman Moi, Tituba sorcière… de
Maryse Condé : puisque Tituba soigne par les plantes et n’a pas peur des chats, elle est
considérée comme une sorcière maléfique par les puritains, qui se basent sur leurs propres
croyances pour la juger. Même chose dans Chair piment de Gisèle Pineau : il y a ceux qui
croient que les esprits des morts peuvent se manifester aux vivants et ceux qui considèrent ces
apparitions comme des manifestations de la folie. Ainsi, les manifestations folkloriques et
mythiques dans les romans réalistes merveilleux relèveraient d’un certain type de sensibilité et
de perception incluant toutes les dimensions du réel antillais, qu’elles soient surnaturelles ou
non et d’une connaissance des mythes. De ce fait, si le surnaturel ne s’oppose pas au réel dans le
réalisme magique, le surnaturel et la raison ne s’opposent pas nécessairement dans le contexte
du réalisme merveilleux puisque si certains ne croient pas au dorliis ou aux zombis, ils les
connaissent pourtant et connaissent leur valeur pour ceux qui y croient car ces récits expliquent
le monde. Ainsi, plutôt que de porter à confusion, les métaphores étranges et telluriques du
premier chapitre du roman décrivent en fait, pour celui qui connaît les mythes guatémaltèques
ou qui a lu le Popol Vuh, le rêve des origines amérindiennes selon lequel « self and other
interpenetrate, submerged in the same immanent, presubjective and preobjective milieu » (De
Castro, 2004 : 464). De la même manière, les confusions peuvent s’éclaircir dans de nombreux
romans caribéens : l’image du serpent présente dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant
n’est pas une image de Satan ou du mal mais fait référence au culte du serpent Dâ, incarnation
de Dâgbé dans les croyances du Dahomey ; même chose avec le zombi du vaudou qui n’est pas

98
un mort dévoreur de chair humaine, mais un individu vivant dont le petit bon ange, la « force de
lumière et de rêve d’une personne » (Depestre, 1988 : 127), a été emprisonné par un sorcier.
Ainsi, il nous semble extrêmement important de noter ici que la sensibilité des auteurs au
réalisme ethnologique permet une forme de rationalisation qui explique les rituels et croyances
de ces pays. Cette sensibilité transmet également, par les phénomènes surnaturels du folklore, la
pensée mythique elle-même, encore vivante et ses significations profondes. C’est ainsi que
d’une analyse des éléments du mythique dans les romans, notre étude va tenter de dévoiler un
certain système dont la mythanalyse nous aidera à interpréter les objectifs.
2.2 Le principe de ‘liminality’ et l’importance de la spiritualité
La présence du folklore au cœur du réel antillais, qu’il soit réel ou non, engendre dans le
réalisme merveilleux le principe généralement associé au réalisme magique de liminality. Cet
élément, qui décrit l’absence de hiérarchie entre le surnaturel et le réel dans un roman est en
effet essentiel dans l’équilibre du monde concerné dans lequel, par la multiplicité des regards, ni
le « surnaturel » ni le réalisme ne l’emporte vraiment. En effet, que le zombie soit réel ou non, il
existe pour beaucoup et le Code Pénal Haïtien est là pour le prouver en interdisant toute
tentative de zombification. De même, que les Invisibles existent ou non dans les romans, leur
existence n’est jamais remise en question. Il y a donc un véritable équilibre dans les romans
dans lesquels tout, en fin de compte, dépend de la notion de croyance. Ce principe de liminality
fait aussi apparaître, dans le cadre de notre propre étude, de quelle manière la connaissance des
mythes et de leurs valeurs est essentielle à l’équilibre culturel du réalisme merveilleux par son
effacement des vides herméneutiques et des incohérences pour un lecteur considérant ces
cultures comme « exotiques », tout comme pour un lecteur local ne connaissant
qu’imparfaitement sa culture. Si l’absence de connaissance folklorique entraîne des difficultés

99
de compréhension et un déséquilibre du principe de liminality (sans connaissance de la magie, le
lecteur aura tendance à favoriser la raison), ce principe empêche aussi, idéalement, toute aide et
toute explication à la lecture : « an explanatory introduction would induce a rationalizing
narrator and destroy the effect of unmediated focalization by a ‘primitive mentality’ » (Chanady,
1985 : 43) tout en attirant l’attention des lecteurs sur « the strangeness or even impossibility of
certain events and beliefs» (Ibid. 149). Il faut donc préserver la pensée mythique originelle sans
pourtant l’expliquer, ce qui n’est pas toujours le cas dans certains romans antillais qui, parfois,
se permettent une note explicative en bas de page ou dans le corps du texte. Les lecteurs iront-ils
tous compléter leurs connaissances dans des ouvrages de référence ? Si cet appel au folklore et à
la pensée magique sert, comme chez les auteurs de la Créolité, à préserver une mémoire
culturelle, il aurait donc peut-être aussi pour but de révéler des manques, des lacunes pouvant
entraîner une absence de compréhension ou une vision déformée, stéréotypée d’un réel dont on
ignore les spécificités:
Si le réalisme merveilleux pose un problème de représentation et on pourrait dire de défense, toute quête
d’identité est défensive, il pose aussi un problème de réception […]. L’on met en doute qu’un homme
puisse voler et on s’étonne que Toni Morisson nous parle d’hommes volants dans ses romans. Elle
réplique que pour les Noirs étasuniens, parler d’hommes volants est affaire coutumière. On pourrait
ajouter qu’en Haïti aussi n’importe qui vous parlera des bizangos qui volent, des zobops qui se
transforment en n’importe quoi : voiture, oiseau… (Laroche, 1987 : 133).
Parler des éléments folkloriques traditionnels est donc, dans les œuvres du réalisme magique et
du réalisme merveilleux, une façon de défendre son identité mais aussi de proposer, par le texte,
la représentation d’une pensée traditionnelle qui se perd, ou de provoquer la réflexion par le vide
et la confusion.

100
2.3 Mettre en valeur la différence culturelle par le folklore et la spiritualité
Si l’on se focalise sur la nature même de la spiritualité dans les romans, nous pouvons un
peu mieux distinguer comment le réalisme merveilleux est plus spécifiquement antillais que le
réalisme magique. En effet, si comme le propose Donald L. Shaw, « it is not necessary for the
myths employed by the Latin American magical realists to be so intrinsically Latin American »
(2005 : 48), ce n’est pas vraiment le cas des écrivains caribéens francophones qui, s’ils utilisent
un folklore et une spiritualité différents, ne semblent jamais les emprunter à une culture
différente de la leur. Qu’ils soient d’origine africaine, chrétienne, hindoue comme dans La
Panse du chacal de Raphaël Confiant ou chinoise comme dans Case à Chine, du même auteur,
ceux-ci ne sont jamais de pures inventions. Par cet aspect, les œuvres caribéennes se
rapprochent donc, comme nous l’avons vu, de romans réalistes magiques comme The Famished
Road de Ben Okri (avec son héros abiku), ou de Hombres de maiz de Miguel Ángel Asturias,
qui sont ontologiques et mythiques par leurs références aux mythes (le Popol Vuh) et au folklore
(les esprits). Par contre, ils se distancient d’œuvres plus « magiques » comme les romans de
Salman Rushdie, Gabriel García Márquez, Laura Esquivel, qui illustrent plus spécifiquement la
magie par des métaphores « littéralisées » par le récit et par leurs jeux sur le langage. En effet,
ce qui pourrait passer pour de pures inventions dans les textes réalistes merveilleux sera toujours
extrait du folklore caribéen qui, comme nous l’avons dit, rationalise le monde magique pour qui
les connaît, comme dans Solibo Magnifique où « Chamoiseau has taken as his starting point the
popular belief that a corpse unwilling to be buried can become so heavy that no one can lift it »
(Ormerod-Noakes, 1997 : 221). À cette fidélité au folklore, qui donne une valeur aux œuvres,
s’ajoutera un autre aspect essentiellement antillais du réalisme merveilleux qui sera au cœur de
la suite de notre étude : la présence de mythes originels qui, oubliés ou modifiés par
l’expérience de la rupture et de l’esclavage, sont en perpétuelle (re)création dans les romans.

101
C’est là un fait littéraire bien moins évident dans les romans réalistes magiques, issus de cultures
envahies et non déportées, dont les mythes ont pu survivre plus facilement. Par son aspect
ethnographique et la multiplicité des regards, le mode réaliste merveilleux ne peut donc plus
accepter dans sa terminologie un terme qui présuppose l’étonnement et la surprise produites par
le texte. En effet, par bien des aspects, les phénomènes dits « merveilleux » ne s’opposent pas,
dans les romans, à certains aspects du réalisme antillais. Terme antinomique, le réalisme
merveilleux serait alors révélateur d’une situation difficilement applicable au réel antillais dans
lequel un phénomène surnaturel peut être à la fois réaliste et surnaturel. Devrait-on alors
envisager une autre terminologie, plus proche de cette particularité culturelle?
3 Nouvelle approche, nouvelle définition
3.1 Le problème du terme « merveilleux » dans la littérature antillaise
Le terme réalisme merveilleux, en littérature, est donc indissociable d’une certaine
variété de perceptions. Or c’est là un piège conceptuel puisque « la perception merveilleuse de
la réalité exige un regard étranger, ‘‘du dehors’’ » (Ponte, 1988 : 100). Tout change donc dans
notre approche du réalisme merveilleux, quand on considère que le merveilleux dépend du
regard : comme nous l’avons vu dans sa définition, il y a à la base du merveilleux un sentiment
d’admiration, de fascination et de crainte, des sentiments qui laissent deviner un certain degré de
subjectivité étrangère pour laquelle le merveilleux n’est pas un état de nature : « le merveilleux
suppose le travail de l’écrivain, d’une part, le regard de celui qui le perçoit, de l’esprit qui le
juge, du cœur qui ‘‘s’étonne’’ de l’autre. Le merveilleux est donc un effet de sens… »
(Vincensini, 2005 : 239). Ainsi, si le roman réaliste merveilleux s’inscrit, par son aspect réaliste,
dans une tradition littéraire classique, tous les éléments qui donnent au réalisme merveilleux son

102
côté « merveilleux » feraient paradoxalement référence, comme on le constate dans le roman
africain, à un fond commun de croyances qui les rend en fait crédibles et réalistes: « ce qui rend
tous ces récits crédibles, c’est que le merveilleux emprunte ses images non à l’inconscient
individuel du griot, mais au fond traditionnel commun à tout le groupe ethnique » ( Koné, 1985 :
49) : Tituba peut parler après sa mort parce qu’elle est un esprit et que les esprits peuvent
communiquer avec les vivants. Le schéma inverse fonctionne également dans d’autres
romans puisque le phénomène surnaturel peut s’expliquer par la raison et l’approche occidentale
de ces mythes : le papillon violeur d’Hadriana dans tous mes rêves et le dorliis de L’Homme-
au-bâton, par exemple, pourraient être des excuses surnaturelles trouvées par des jeunes filles
honteuses d’avoir succombé trop tôt aux plaisirs de la chair, tout comme le zombi ne serait
qu’un « schizophrène en état de stupeur catatonique de type hystériforme » (Depestre, 1988 :
98). La riche identité caribéenne, prise entre l’héritage français des colons et l’héritage
traditionnel importé d’Afrique par les esclaves et les héritages intermédiaires, pourrait donc
s’appliquer aux romans dans lesquels chaque événement, bien qu’il soit interprété de deux, voire
trois, façons différentes, est toujours majoritairement « réaliste » du point de vue de la culture
antillaise et de la connaissance du folklore. Cet aspect de la perception du phénomène et du
croire/ne pas croire est essentiel dans la pensée d’Alejo Carpentier qui, si elle a été critiquée par
certains, n’en représente pas moins une des interprétations du merveilleux quotidien:
To begin with, the phenomenon of the marvelous presupposes faith. Those who do not believe in saints
cannot cure themselves with the miracles of saints […]. This seemed particularly obvious to me during my stay in
Haiti, where I found myself in daily contact with something that could be defined as the marvelous real. I was in a
land where thousands of men, anxious for freedom, believed in Mackandal’s lycanthropic powers to the extent that
their collective faith produced a miracle on the day of his execution (Carpentier, 199a5: 86-87).
Ainsi, s’il n’y a pas de surprise ou d’étonnement face au merveilleux, c’est parce que
celui-ci fait partie de la vie de tous les jours des sociétés décrites et qu’il n’est donc pas perçu,

103
selon la définition, comme merveilleux. De même, ceux qui n’y croient pas le connaissent et ne
sont pas surpris d’en entendre parler comme les parents d’Hadriana à la « mort » de leur fille. Le
merveilleux devient donc familier et perd de sa force:
Tout au fond d’eux-mêmes, ils avaient le sentiment que la sorte de fable grivoise et lugubre que la femme
mettait tant de fantaisie à raconter appartenait sans doute au romancero funéraire d’Haïti. Tout compte fait,
s’agissant du merveilleux de la mort, côté du destin commun à l’espèce, des gens différents d’origine et d’éducation
pouvaient toujours s’y reconnaître. Elle avait partagé avec André cette ouverture d’esprit bien avant la tragédie qui
détruisit leur foyer (Depestre, 1988 : 51).
Cet aspect essentiel a été, nous l’avons vu, en partie théorisé par Jacques Stephen Alexis
qui explique comment la relativité de l’existence des populations du Tiers Monde (et le regard
que ces populations portent sur elles-mêmes) transpose le merveilleux au sein de la vie
quotidienne, contrairement aux sociétés mécanisées où les mythes perdent de leur valeur. De ce
fait, le terme « merveilleux » comme produit de la surprise ou de l’étonnement, n’exprime donc
qu’un phénomène autre et s’exprime alors comme la réception d’une culture autre. Il serait donc
inexact de parler de réalisme « merveilleux » dans une culture et une littérature dans laquelle la
notion n’existe pas et serait au contraire le produit d’une perception étrangère. Il semblerait
donc que notre distinction entre les sociétés où les mythes sont morts et les sociétés où les
mythes sont encore vivants, se manifeste encore ici et que le terme « merveilleux » ne
s’applique qu’à une vision occidentale des œuvres. Une problématique terminologique s’est
également posée pour le réalisme magique, comme le propose Alfred J. López :
‘Magical realism’ a European term applied to a ‘non-European’ literature, a literature which, despite the
assimilating effects of the ‘Third World cosmopolitan’ status bestowed upon its originary authors, retain its
irreducible difference, its mark or alterity, which only begs the question : What of this act of naming, of the
boundary or mark of a text written by, say, a Latin American author, imposed upon it from without, in a futile
attempt to categorize and thus ‘understand’ it by this process of naming – which is already itself an act of

104
appropriation, a bid to harness the wild, ‘exotic’ text within a reasonable European critical framework – to ‘master’
the other’s difficult text? Here the act of naming emerges as an allegory of a colonial fantasy: the mastery of
reading as a reading of mastery (López, 2001: 143).
Les romans antillais ne seraient ainsi réalistes et merveilleux que du point de vue
occidental, dans lequel les manifestations des esprits, des zombis et autres créatures folkloriques
sont foncièrement impossibles, surprenantes et étonnantes alors qu’ancrées dans la culture et le
quotidien, elles demeurent « réalistes » pour ceux qui y croient comme pour ceux qui n’y
croient pas.
3.2 La perception du réel et le vécu antillais
Si certains critiques du réalisme magique tentent de définir son aspect surnaturel par le
fait que ce dernier utilise des phénomènes que, nous dit Faris, « we cannot explain according to
the laws of the universe as we know them » (Faris, 1995 : 167), nous ne pouvons nous empêcher
d’y voir une autre perception purement occidentale de ce « we » qui ne connaît ni ne comprend
la spiritualité et les mythes qui sont omniprésents dans les romans et tiennent une part
essentielle dans les intrigues : si Azaro voit des esprits dans The Famished Road de Ben Okri,
tout comme Tituba voit Man Yaya et ses parents dans le roman de Maryse Condé, c’est parce
que l’un est un abiku et que l’autre a été initiée à la magie. De la même manière, si Goyo Yic,
dans Hombres de maíz, se transforme en opossum, c’est parce que cet animal est son nahual, la
manifestation de son essence spirituelle. Ainsi, dans le réalisme merveilleux mais aussi dans le
réalisme magique (dans sa version mythique et ontologique), les mythes et le folklore sont
omniprésents et expliquent les mystères du monde présents dans les romans, ce qui a pour
conséquence de placer le réalisme magique à l’intersection de deux mondes, l’un magique et
l’autre réaliste, « we experience [in magical realist novels] the closeness or near-merging of two

105
realms » (Faris, 1995 : 172) et de placer le réalisme merveilleux dans un monde
ontologiquement magique qui, comme dans Hombres de maíz, The Famished Road mais aussi
Moi, Tituba…, Chair piment et les autres, exclut l’idée de deux mondes séparés. Il y aurait ainsi,
dans le réalisme merveilleux (et dans le réalisme magique ontologique et mythique), un seul
monde dont les parties ne seraient pas visibles par tous, au contraire de romans comme
Midnight’s Children de Salman Rushdie ou Como agua para chocolate de Laura Esquivel, dans
lesquels il n’y a pas forcément de superposition des mondes, mais seulement des manifestations
magiques. Dans les œuvres du réalisme merveilleux (mythique, ontologique) on retrouve donc
une forme de réel double qui, nous l’avons vu, se concentre essentiellement sur la description de
la vie, de la spiritualité et de la culture des campagnes6, dans lesquelles cette identité spécifique
semble spécifiquement se manifester. C’est également ce que suggère Wendy B. Faris, pour qui
le réalisme magique tend à se concentrer « on rural settings and to rely on rural inspiration »
(Faris, 1995 : 182). Les réalités « historico-sociales » et ethnographiques qui définissent les
spécificités des romans antillais joueraient donc le jeu du réalisme merveilleux, qui trouverait
son origine spécifique dans les conditions sociohistoriques antillaises.
Selon Édouard Glissant l’esclavage et ses effets sont des faits qui ont eu des
conséquences uniques dans l’histoire et il faudrait ainsi le distinguer d’autres types
d’oppressions ou de persécutions puisqu’ « il y a différence entre le déplacement (par exil ou
dispersion) d’un peuple qui se continue ailleurs et le transbord (la traite) d’une population qui
ailleurs se change en autre chose, en une nouvelle donnée du monde » (Glissant, 2002 : 41). Cet
argument illustre de quelle manière l’histoire de la Caraïbe, la création et l’évolution de sa
culture et de sa spiritualité sont, par les effets de l’esclavage, très différentes de celles d’Afrique
6 Tituba, Télumée, Ti Jean, Léonce, Papa Longoué et autres personnages des romans caribéens francophones
vivent en effet dans les campagnes de la Guadeloupe ou de la Martinique…

106
ou d’Amérique Latine. Aux Antilles, seules l’imagination et l’oralité auraient permis la survie
de la culture et de la spiritualité. Dans les pays du réalisme magique, au contraire, la culture a pu
survivre par l’architecture, par des documents écrits comme le Popol Vuh ou les livres du
Chilam Balam, ou par des formes d’hybridation entreprises par des colonisateurs ayant permis «
[the] survival of some preconquest elements of Maya religion » (Sigal, 2000 : 30). Pour
résumer, si les auteurs des romans réalistes magiques et leurs personnages vivent et écrivent sur
la terre de leurs origines (que ce soit un pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud), ce n’est pas le
cas des auteurs et personnages caribéens puisqu’ils sont, originellement, des populations
déportées et réduites en esclavages. Or nous l’avons vu : depuis le mouvement de la Négritude
et son regard vers l’Afrique et le regard universaliste de la Créolité, les mouvements littéraires
antillais ont évolué pour graduellement se tourner vers les mythes et la spiritualité afin d’isoler
les traces d’une « complex culture of survival which was the response of the dominated to their
oppressors » (Dash, 1973 : 200). Ce phénomène aurait donné naissance à un type de contre-
culture de l’imagination spécifiquement caribéenne qui aurait ensuite donné naissance à une
identité antillaise.Cele-ci, tout en rejoignant la branche mythique et ontologique du réalisme
magique, aurait cependant, par ses origines et de son développement sociohistoriques, une voix
spécifique. C’est pour cette raison que les romans réalistes merveilleux et certains romans
réalistes magiques pourraient être perçus comme des créations culturelles nécessitant, pour se
légitimer, des liens avec le passé et un retour à une mémoire culturelle ancestrale. Un type
d’invention culturelle qui, issue de cultures sans Popol Vuh, ni traces physiques évidentes du
passé ancestral effacé par la rupture de l’esclavage, a poussé les écrivains antillais à recréer des
mythes des origines afin de perpétuer leur mémoire culturelle.

107
3.3 Introduction d’un « réalisme mystique » antillais
Si le réalisme merveilleux n’est pas « merveilleux », il nous faudrait donc, avant d’en
étudier les spécificités, trouver une terminologie plus représentative de ses caractéristiques
propres, représentant non pas une réalité illogique et problématique, mais une logique tout
simplement autre, non occidentale mais tout aussi cohérente. Ainsi, pour résumer, nous avons
vu que le réalisme antillais est une forme d’écriture ethnographique également
mythique/folklorique et ontologique. Nous avons ainsi été plus loin en abordant l’idée qu’il n’y
aurait pas deux mondes, l’un réaliste et l’autre surnaturel, mais bien un seul monde
naturellement magique. Ce grand principe suppose ensuite que certaines parties de ce monde
échappent aux perceptions ou demeurent dans l’ombre, et que la réalité dont il est rendu compte
dans les romans est une réalité qui élargit vers l’invisible dans laquelle le « surnaturel » est en
symbiose avec la vie quotidienne. Cela suggère, comme pour le roman africain, non pas un
certain parallélisme entre deux mondes qui se côtoient, mais des dimensions d’un même monde
dont les limites restent difficiles à clairement déterminer: « il y aurait une dimension spirituelle
des choses, totalement immanente à celles-ci, invisible mais réelle. Les magiciens peuvent agir
sur le monde » (Garnier, 1999 : 70). Ainsi, le monde magique apparaît dans les romans comme
un système de forces réelles et contiguës au monde visible, comme on le retrouve dans certains
écrits de Senghor qui, dans Négritude et humanisme, définissent le monde magique comme plus
réel que le monde visible: « il est animé par les forces invisibles qui régissent l’univers et dont le
caractère spécifique est qu’elles sont harmonieusement liées par sympathie, d’une part, les unes
aux autres et, d’autre part, aux choses visibles ou apparences » (Senghor, 1964 : 262). Cette idée
résume parfaitement ce que nous avons vu jusqu’à présent et, en particulier, l’image de la magie
telle qu’elle se présente dans le roman Moi, Tituba…: une magie universelle, une force
spirituelle présente partout, à la Barbade comme à Boston et qui sous-tend le réel. C’est une

108
notion qui, nous l’avons vu, rappelle certaines croyances animistes orientales comme celle du
mana et qui suppose que le monde est ontologiquement magique. Cet aspect est d’ailleurs
souligné par Senghor qui cite Eliphas Lévi pour qui « il n’y a qu’un dogme en magie, et le
voici : le visible est la manifestation de l’invisible, ou, en d’autres termes, le verbe parfait est,
dans les choses appréciables et visibles, en proportion exacte avec les choses inappréciables à
nos sens, invisibles à nos yeux » (Senghor, 1964 : 262). Suite à ces observations, il devient
évident que parler avec des esprits, croiser un zombi ou voir un bizango sont des phénomènes
non pas incroyables mais conformes à un aspect de la culture locale et auxquels le terme
réalisme merveilleux ne s’appliquerait que par principe, se réclamant surtout d’une vision
occidentale de ces cultures et de ces littératures pour laquelle ces manifestations de l’invisible ne
sont que des fictions. Ces différentes constatations nous amènent à une observation
intéressante : les romans réalistes merveilleux antillais sont réalistes parce qu’ils parlent des
deux réalités du monde caribéen qui font toutes deux partie de son identité. Les romans sont
également réalistes parce que, dans ces romans, le monde réel explique le monde magique et
vice-versa et ce malgré les fluctuations au sein même des romans qui, tout en donnant une
image semblable du réel ethnographique et de l’histoire, se différencient plus largement dans
leur utilisation du merveilleux et du mythe. On le voit dans Hadriana dans tous mes rêves de
René Depestre ou encore L’Homme-au-Bâton d’Ernest Pépin, deux romans qui ne s’engagent
vers aucune conclusion définitive et préservent la raison et la force du folklore. On le voit aussi
dans des romans comme Ti Jean l’Horizon de Simone Schwarz-Bart et L’Esclave vieil homme et
le molosse de Patrick Chamoiseau, ou encore Moi, Tituba… de Maryse Condé qui sont plus
directement merveilleux et symboliques.
Comment déterminer, en un ou deux mots, une terminologie pour cette réévaluation du
merveilleux dans la Caraïbe ? Nous pouvons une fois encore nous tourner vers les études de

109
Senghor qui mentionne l’idée intéressante d’une image « sous-réaliste » du monde magique « en
ce sens qu’elle exprime la réalité qui sous-tend les apparences [et qu’] elle est l’expression du
monde mystico-magique » (Senghor, 1964 : 280). Cependant, si le terme de « sous-réalisme
caribéen » décrit très exactement ce que nous recherchons, la préposition « sous », si elle ne
mentionne aucune spiritualité, semble cependant impliquer une idée de hiérarchie et de qualité
de ce réalisme, qui serait inférieur ou placé « sous » le réalisme, niant ainsi le principe de
liminality. Un type de pensée que l’on retrouve également dans les théorisations du réalisme
magique : « In magical realism key events have no logical or psychological explanation. The
magical realist does not try to copy the surrounding reality (as the realists did) or to wound it (as
the Surrealists did) but to seize the mystery that breathes behind things » (Leal, 1995: 123).
Cependant, l’idée est intéressante car elle rappelle également la pensée vivante, originelle qui se
cache derrière le mythe et qui constitue une forme de sous-pensée qui s’applique au mythe
comme le sous-réalisme au réel caribéen, sans idée de hiérarchie :
On a longtemps voulu croire que le mythe était une illusion primitive, née d’un emploi naïf du langage. Il
faut plutôt comprendre que le mythe relève, non tant d’une pensée archaïque dépassée, mais d’une Arkhe-
Pensée toujours vivante. Il procède de ce qu’on peut appeler l’Arkhe-Esprit, qui est, non pas un esprit
arriéré mais un Arrière-Esprit qui, conformément au sens fort du terme Arkhe, correspond aux formes et
forces originelles, principielles et fondamentales de l’activité cérébro-spirituelle, là où les deux pensées ne
sont pas encore séparées (Morin, 1986 : 169).
Comme le mythe, cet arkhe-réalisme rendrait donc compte d’une réalité hypothétique et idéale
de la culture caribéenne, dans toutes ses contradictions entre mythes réels et mythes fictifs.
Laissant un instant de côté ce terme, nous pouvons nous tourner vers le dictionnaire où toutes
sortes de mots relatifs au « caché » pourraient nous être utiles. On a ainsi « mystérieux » un
terme qui porte l’idée du caché et du secret mais qui est bien trop commun et le mot « sibyllin »,
poétique mais difficile à employer. On pourrait cependant envisager trois mots qui semblent

110
relativement appropriés. Il y a d’abord « occulte », du latin occultus qui signifie caché et qui,
dans la langue commune, décrit ce qui est caché et inconnu par nature. Nous avons aussi
« cryptique » provenant du latin crypticus et du grec kruptos qui signifie également « caché ».
Cependant leur sens reste, dans la langue commune, un peu ambigu : on pense à la popularité
d’un terme comme « les sciences occultes » dans les médias ou aux recherches
« cryptozoologiques » qui, dans leur quête de « créatures cachées » ont reçu un certain nombre
de regards circonspects. Ainsi, si l’on veut dépasser la vision occidentale du terme « réalisme
merveilleux », préciser et dépasser le terme géographique « réalisme caribéen » et mentionner la
face cachée et sacrée du monde sans impliquer la hiérarchie du « sous-réalisme », nous
proposerons peut-être de parler, outre d’arkhe-réalisme, d’un « réalisme mystique » auquel on
pourra éventuellement ajouter « antillais7 », terme qui, même s’il souffre également des idées
populaires envers le mysticisme, est relativement approprié puisque il désigne ce qui est relatif
au mystère, à une croyance cachée, supérieure à la raison et qui est en relation avec le domaine
religieux.
Les romans de notre corpus, par leur habile mélange de réalisme historique/
ethnographique et de surnaturel, proposeraient donc, par l’écriture, un double regard sur le
monde antillais. Un regard à la fois réaliste et rationnel, mais aussi mystique, le terme de
« merveilleux » n’étant que le produit du regard occidental. Le réalisme mystique étant un mot
fourre-tout ne pouvant jamais véritablement exprimer une vision du monde (comme nous
l’avons vu avec le réalisme), il faudrait prendre cette tentative d’élaboration d’une nouvelle
terminologie avec précautions. En effet, s’ils s’approchent plus de la réalité littéraire que
« réalisme merveilleux », les termes « réalisme mystique (antillais) » ou arkhe-réalisme n’auront
7 Puisque nous nous limitons, dans cette étude, aux Antilles.

111
avant tout qu’un but pratique : l’illustration d’une spécificité qui sera essentielle à notre tentative
d’illustration d’une identité et d’une légitimité antillaises.
Conclusion de la première partie
On observe ainsi que le réalisme magique et le réalisme merveilleux sont deux entités
littéraires distinctes mais voisines. Ethnographique et historique, le réalisme merveilleux
antillais que nous avons baptisé « réalisme mystique antillais », tel que l’illustrent les romans
caribéens francophones que nous avons étudiés, est donc d’abord définissable par son utilisation
des mythes, de la spiritualité, mais aussi des cultures locales perçues sous l’angle d’un arkhe-
réalisme représentant le monde dans son intégralité réaliste et mythico-folklorique. Par ces
aspects, ce réalisme mystique rejoint un courant qui constitue un des sous-genres du réalisme
magique, celui d’une écriture à la fois mythique et ethnographique par ses descriptions réalistes
des sociétés, des rituels, des croyances et des mythes, mais aussi ontologique par le caractère
ontologique de sa magie. Le réalisme mystique, partie intégrante du mode réaliste magique, se
détache cependant par sa représentation ambivalente de la pensée magico-religieuse qui,
imprégnée par le monde des esprits, permet aussi à une forme de magie ontologique de se
manifester, différente de la magie inventée par les auteurs réalistes magiques. Il s’agit d’un
monde où se manifestent les Invisibles qui, considérés comme des fictions en Occident, font
cependant partie du quotidien appartiennent à une forme de rationalité folklorique antillaise.
Cette rationalité excluant toute surprise et rendant caduque la particule « merveilleux », elle ne
serait plus qu’un terme occidental appliqué à la réalité caribéenne. On pourrait alors parler dans
le cadre de la littérature antillaise, d’un simple « réalisme caribéen » présentant une sous-réalité
magique et cachée, qui sous-tend le réel ou, pour éviter tout sens de hiérarchie, parler d’un

112
« arkhe-realisme » ou d’un « réalisme mystique antillais » constitué de mythes vivants et liés à
la spiritualité. Cependant, il ne s’agit pas d’une terminologie entièrement nouvelle qui cherche à
révolutionner les études du réalisme magique et du réalisme merveilleux. Il s’agit plutôt, par
cette redéfinition, de mettre en lumière, dans le courant réaliste magique, une manifestation
spécifique du réel et de la magie présente dans la Caraïbe, mais aussi en Amérique Latine et
dans d’autres pays anciennement coloniaux : une forme de réalisme liée à une spiritualité
mythique, ontologique que l’on pourrait probablement étudier et retrouver dans une large variété
de romans d’horizons différents et qui tendraient cependant tous à décrire le monde comme
possédant une sous-réalité mystico-mythique et une profondeur cachée. Dans le cas des Antilles
françaises et de leur histoire particulière, ce mouvement prendrait une valeur plus spécifique
encore, lié à une réalité parfois oubliée et à une culture en lutte contre l’acculturation qu’il nous
reste à découvrir et dont le rapport, essentiel, à l’identité est le point de focalisation de notre
recherche.

113
Deuxième partie
Mythes et romans, oralité et écriture : spécificités et
paradoxes du réalisme mystique
Le mythe traditionnel est, nous l’avons dit, avant tout une histoire sacrée et orale liée au
mystère des origines ancestrales, mais aussi le domaine privilégié de l’expression d’un
sentiment du mystico-merveilleux. Théoriquement, si ce type de mythe s’appliquait aux romans
antillais, il devrait nous parvenir imprégné et soutenu par une forme littéraire qui, en retour, se
verrait imprégnée par lui sous forme d’inquiétudes historiques, culturelles ou
sociales concernant par exemple la notion d’origine. Si un simple aperçu des romans antillais
nous permet de remarquer l’absence des mythes (au sens traditionnel), les auteurs de notre
corpus font cependant, dans leurs œuvres, de nombreuses références à l’oralité et aux contes.
Cette écriture de l’oralité – associée à certaines théories récentes qui, comme celles de la
Créolité, préconisent un retour à une forme d’oralité « afin d’investir l’expression primordiale
de notre génie populaire » (Bernabé, 1993: 36) – proposerait donc, malgré l’absence de mythes,
une forme de continuité culturelle « sans laquelle l’identité collective a du mal à s’affirmer »
(Idem.). Apparemment, l’oralité romanesque et l’utilisation des contes pourraient être
hypothétiquement perçues comme un élément essentiel de la survie et de la régénération
identitaire antillaise. À première vue, il semblerait en effet que, face à la disparition des mythes
originels, la majorité des romans aient fini par graviter autour de contes, d’histoires profanes ou
de fragments de contes, racontés par certains personnages ou par les auteurs eux-mêmes. C’est

114
ce que l’on voit, par exemple, dans « l’histoire de l’oiseau qui se moquait des frondes du
palmier » (Condé, 1986 : 16) racontée par Tituba, dans les contes racontés par La Reine Sans
Nom dans Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, ou encore dans le roman
Ti Jean l’Horizon, entièrement basé sur un personnage du folklore caribéen. Les romans se
présenteraient donc en général comme des récits ne prenant pas en compte les mythes originels
mais qui utiliseraient et mentionneraient des contes – ces histoires présentant un aspect
« utilitaire » et se traduisant « parfois par une moralité, parfois par une recommandation
pratique, ailleurs encore par un proverbe ou une règle de vie » (Benjamin, 2000 : 119). La
présence des contes en tant qu’« histoires fausses » (par opposition aux mythes comme
« histoires vraies ») se rapprocherait ainsi de la nature des romans qui, au-delà de leurs
réalismes ethnographiques et historiques, restent des œuvres de fiction. Par conséquent, le
rapprochement du roman et du mythe serait, quant à lui, bien plus improbable puisque les
conditions d’énonciation de ce dernier sont, nous l’avons vu, très spécifiques : « chez beaucoup
de tribus, ils [les mythes] ne sont pas récités devant les femmes ou les enfants, c’est-à-dire
devant des non-initiés. Généralement, les vieux instructeurs communiquent les mythes aux
néophytes, pendant leurs périodes d’isolement dans la brousse, et ceci fait partie de leur
initiation » (Eliade, 1988 : 21). De ce fait, si les contes sont des histoires fausses proposées à un
public profane, il serait plus logique de les associer au roman et à son lectorat traditionnel
puisque les mythes, ces histoires sacrées considérées comme vraies, destinées à un public
spécifique d’initiés, perdraient théoriquement leur valeur sacrée si on venait à les intégrer à des
œuvres de fiction.
Cependant, aussi intéressante qu’elle puisse paraître, cette hypothèse semble une fois
encore incertaine car si on retrouve certains éléments du conte dans les romans antillais, on y
trouve également certains aspects du mythe : les transmissions d’un savoir sacré entre

115
personnages (notamment entre Tituba et Man Yaya, dans Moi, Tituba sorcière noire de Salem
de Maryse Condé ou entre Ti-Jean et Wademba dans Ti Jean L’Horizon de Simone Schwarz-
Bart) ou encore des schémas d’initiation spirituelle et magique de type mythique (comme nous
le verrons plus loin, de nombreux personnages passent par des souffrances, des morts
initiatiques et un contact avec les esprits). De plus, si les mythes eux-mêmes n’apparaissent
jamais directement et ne sont jamais nommés à la manière des contes, les histoires et
expériences des ancêtres et de certains personnages prennent souvent valeur d’histoires
exemplaires, comme l’histoire des familles Longoué et Béluse racontée par Papa Longoué dans
Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant. De ce fait, la présence de diverses spécificités
littéraires issues de contes ou de mythes pose un certain nombre de questions et le rapport entre
les contes, les romans et les mythes se complique quand on se penche sur la nature même de
cette oralité romanesque. En effet, si l’on en croit Eliade, mythes et contes n’ont pas la même
valeur partout et, selon leurs origines, il leur arrive même de se confondre : « souvent les mythes
sont mélangés aux contes […] ou encore ce qui revêt le prestige du mythe dans une tribu ne sera
qu’un simple conte dans la tribu voisine » (Eliade, 1988 : 244-245). Ainsi, nous pouvons nous
demander si un phénomène identique ne se manifesterait pas dans les romans antillais. Les
auteurs différencient-ils les mythes et les contes ? Pourrait-on justifier l’absence de mythes
africains dans les romans antillais par leur mélange ou leur transformation en contes ? Qu’il
s’agisse de mythes ou de contes, le rapport oralité/littérature pose certains problèmes essentiels
dans l’étude des romans antillais. C’est pour cette raison que nous allons à présent tenter
d’aborder la question du paradoxe écriture/oralité dans les romans réalistes mystiques antillais et
ses éventuelles conséquences vis-à-vis de l’écriture romanesque et de la question de l’identité.
Pourquoi les romans antillais contemporains et les théoriciens de la Créolité donnent-ils une
place si importante à l’oralité, aux mythes et aux contes ? Quels sont les effets de l’oralité sur
l’écriture des romans ? Pourraient-ils, par leur utilisation de l’oralité prendre la valeur de mythes

116
ou de contes ou, au contraire, l’écriture donnerait-elle à ces formes habituellement orales une
valeur nouvelle ? Afin de répondre à ce questionnement, notre deuxième partie se proposera
d’étudier, dans les trois chapitres qui la constituent, les diverses manifestations, représentations
et utilisation de l’oralité dans les romans. Nous nous pencherons ainsi, dans notre quatrième
chapitre, sur les manifestations et valeurs historiques de l’oralité dans les romans de notre
corpus. Ces observations nous permettront d’aborder, dans un cinquième chapitre, les rapports
conflictuels entre cette oralité et le principe d’écriture, tels qu’ils sont perçus par les écrivains,
ce qui nous permettra enfin d’étudier, dans le dernier chapitre de cette partie, la manière dont les
romans permettent, par l’utilisation de l’oralité romanesque, la (re)création de mythes et la
(re)construction de l’identité antillaise.

117
Chapitre 4 Les représentations de l’oralité historique dans les romans
antillais
Des premiers jours de l’esclavage jusqu’aux romans contemporains, l’oralité a toujours
tenu une importance essentielle dans la culture et l’identité culturelle antillaises. Elle semble,
par son omniprésence dans les romans et par son lien avec les mythes, les contes, inévitablement
liée à la culture antillaise et à ses multiples questionnements identitaires. Or la nature même des
romans pose un important problème : elle coupe le narrateur de son public et fait perdre à
l’oralité sa forme originelle. Devant cette métamorphose d’un moyen de communication devenu
symbole identitaire, on pourrait se demander : dans les romans, quelle valeur peut avoir l’oralité
traditionnelle par rapport à l’écriture? Quels problèmes identitaires et culturels présente-t-elle ?
Les auteurs antillais ayant été relativement productifs à ce sujet, nous allons ainsi tenter, dans ce
chapitre, de répondre à ces questions en nous concentrant sur les diverses représentations de
l’oralité et de l’écriture dans les romans antillais. Nous verrons aussi comment celles-ci
permettent à leurs auteurs d’illustrer l’importance historique et identitaire de ces phénomènes
culturels ainsi que leur valeur quasi-mythique.

118
1 L’oralité antillaise : un symbole de survie
1.1 Le « transbord » et la survie identitaire
L’oralité est un des éléments essentiels de la survie identitaire caribéenne. C’est là un
fait que l’on retrouve dans un grand nombre de romans et d’études littéraires
d’auteurs/chercheurs comme Ina Césaire, Édouard Glissant ou encore Raphaël Confiant et
Patrick Chamoiseau1. Nées d’une incertitude originelle créée par l’esclavage, par le transbord et
par le nouveau commencement infligé par l’acculturation esclavagiste, la culture et l’identité
antillaises n’ont en effet laissé aucune trace matérielle de leurs origines. Devant ce vide, des
questions se posent : quelles ont été les premières paroles prononcées par les esclaves en
débarquant sur cette terre qui allait, pour les générations suivantes, devenir leur nouvelle
origine ? Historiquement, il n’en reste aucune trace. Personne ne sait ce qu’ont pensé ou ce
qu’ont dit les premiers esclaves en voyant la terre antillaise pour la première fois. C’est ce
silence de l’Histoire qui a poussé des auteurs comme Confiant et Chamoiseau à étudier ce vide
sur lequel l’histoire ne dit rien, sur lequel il n’y a aucun témoignage, si bien qu’il est devenu
silence:
La nouvelle terre apparaît dans le silence du cri. On est huilé en silence. On débarque en silence. On
regarde en silence ces moutonnements de verts, ce soleil quelque peu familier. On perçoit en silence toutes
les langues coloniales qui elles-mêmes, entre elles, commencent à s’emmêler […]. En quelle langue se
noue ce mutisme ? Et quelle est sa littérature ? (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 40).
Or, comme on le voit dans les romans antillais ou dans les études ethnographiques, que ce soit
sous la forme de « petits dieux montés à bord, cachés au fond des vaisseaux négriers sous forme
d’effigie, de statuette, voire sans aucune forme du tout, simplement présents dans les cœurs »
1 Voir par exemple l’ouvrage Lettres créoles de Patrick Chamoiseau et de Raphaël Confiant.

119
(Henry Valmore, 1988: 12), ou sous la forme affaiblie de « pulsions ou d’élans » (Glissant,
1997a : 42), ces esclaves ont pu vaincre cet oubli et ce silence, et ce en partie grâce à
l’acculturation esclavagiste qui aurait paradoxalement « encouraged the slaves to retain what
they could of African custom to a greater extent than would otherwise have been the case »
(Herskovits, 1959 : 86). Cherchant ainsi à combler un silence plus historique que littéral, les
auteurs tentent, en représentant dans leurs romans des personnages esclaves, de réactiver une
parole disparue et oubliée et d’illustrer cette survie identitaire par la parole. Ces représentations
des premiers esclaves, de leurs pensées et de leurs discours dans les romans ont une fonction
essentielle car elles permettent aux auteurs d’illustrer comment, malgré cette absence de
témoignages historiques, la substance même de ces paroles et de ces histoires originelles a bel et
bien survécu. Représentations culturelles de l’identité antillaise, ces histoires orales originelles
ont donc, historiquement et ethnologiquement, une importance essentielle dans la culture
antillaise, allant même jusqu’à structurer la réalité quotidienne. Comme on peut le voir dans
l’étude de Lilian Pestre de Almeida, « Oralité et création dans la production caribéenne :
Guillén, Césaire et quelques autres ou Devinette et comptine, son et ponto : formes populaires et
orales, puériles et initiatiques » basée sur Études créoles d’Alex Louise Tessonneau, contes et
mythes auraient conservé jusqu’à aujourd’hui leurs distinctions et valeurs traditionnelles et ce
jusque dans le déroulement de certaines cérémonies, comme la veillée funèbre en Haïti dans
laquelle on retrouve à la fois le temps du mythe et le temps du conte entre « a) le moment, à
l’intérieur de la case, où le père savane ou le hougan recommande le corps, cérémonie
accompagnée par des prières et des chants ; b) le moment, en apparence, profane, à l’extérieur
de la case, où l’on tire les contes » (Pestre de Almeida, 1988 : 232). Cette différence revient
essentiellement à la conservation de la distinction sacré/profane avec, d’un côté le « père
savane », le personnage religieux qui s’occupe de l’âme et du défunt et du sacré et, de l’autre,
les vivants, faisant face à la mort de manière profane en racontant des contes et en répondant à

120
des devinettes. Cependant, comme l’explique Raphaël Confiant dans Les Maîtres de la parole
créole, si les esclaves ont pu, malgré leurs conditions de vie, conserver cette « parole de nuit »,
celle-ci ne constitue qu’une moitié de l’héritage africain qui incluait aussi les griots. Ces
personnages à la fois « historiens des cours africaines [et] hagiographes patentés » (Confiant,
1995: 7), dont la parole se disait de jour et qui appartenaient aux classes élevées, ont en effet
perdu leur fonction lors de la traite esclavagiste et ses conséquences socioculturelles. Cette
situation, bien que dramatique aurait cependant favorisé la survie de l’autre moitié de l’héritage
africain, celle des « lanceurs de devinettes, [des] conteurs d’histoires drôles, [et des] amuseurs
publics qui, eux, n’exerçaient que la nuit venue » (Idem.). Si l’on en croit Confiant, cette notion
a eu des conséquences cruciales sur la nature de l’oralité aux Antilles : elle explique pourquoi,
premièrement, les contes ne se racontent qu’à la nuit tombée et pourquoi, deuxièmement, on ne
trouve dans ces récits « nulle mention des noms de personnes ou de lieux évoquant de manière
précise l’Afrique perdue » (Idem.). Ainsi, si les esclaves étaient originellement des Africains
déportés ayant dû réinventer leur existence et ne possédant comme bagage culturel que leurs
mémoires et leurs histoires, cette oralité, ces mythes et ces contes devraient donc être perçus
comme des fondements épistémologiques, des bases de la connaissance essentielles à la survie
identitaire, en particulier dans le cadre du système des plantations.
Des romans aux études culturelles, les auteurs antillais insistent donc sur le fait que par
la force de ses mythes et de ses contes – essentiels à la mémoire et dans lesquels s’exprime un
certain degré d’identité culturelle – cette parole survivante a permis la survie d’une identité,
devenant ainsi le seul moyen dont les esclaves disposaient pour transmettre leur héritage perdu,
pour rappeler le passé et, symboliquement, les forces laissées derrière eux dans le pays
d’origine. Cette parole, imprégnée de contes et d’une spiritualité aurait une telle importance que,
comme le propose Michèle Praeger, elle aurait même fini par faire partie de l’histoire antillaise

121
et ce malgré son contenu oral et mythique : « The new Caribbean historiography will have to
consider the fact that this historical nature is linked to legends, customs, orality. It is through
oral transmission from generation to generation that the history of the slave trade and the
maroons has been accounted for » (Praeger, 2003: 48). Ainsi, si la culture et l’histoire antillaise
ont, dès leurs origines, fonctionnées très étroitement avec les mythes et les contes oraux, nous
pouvons imaginer que ce n’est pas un hasard si, malgré son aspect réaliste, la littérature
antillaise en contient de nombreux éléments. Rejoignant le questionnement de notre première
partie, la présence d’éléments aussi opposés que l’écriture et l’oralité dans un même mode
littéraire nous ramène au réalisme mystique, dont la fusion paradoxale des termes qui le
constituent illustre précisément l’identité antillaise. Suivant cette hypothèse, l’oralité dans les
romans ne serait plus uniquement le fait des contes, ludiques et divertissants. Rejoignant fiction
et réalité ethnographique, ces histoires pourraient bien avoir une valeur semblable à celle du
kont haïtien décrit par Maximilien Laroche comme « la matrice de la culture haïtienne, l’espace
où se représentent les formes symboliques de la réalité quotidienne » (Laroche, 1989 : 74).
Ainsi, si l’oralité a été essentielle dans la première étape dramatique du système esclavagiste,
l’arrachement à la terre natale et la traversée de l’océan en bateau, elle l’a été encore plus dans
le monde acculturateur des plantations de canne à sucre.
1.2 Le conteur et la transmission de l’oralité dans le cadre de la plantation
Bien évidemment, les contes, les mythes et autres histoires n’ont pas survécu pour se
transmettre, intactes, des origines de l’esclavage à nos jours. Comme l’illustrent les auteurs dans
leurs romans, ces paroles ancestrales ont dû subir non seulement le transbord et l’exil mais aussi
la souffrance et l’acculturation du système des plantations, ces épicentres de l’esclavage et du
pouvoir colonial. En effet, c’est dans ces lieux privilégiés de l’oppression que la révolte et

122
l’expression de la première parole ont succédé au silence et à la cale du navire dans laquelle,
selon les auteurs de la Créolité2, seul le cri pouvait s’exprimer :
Dans la cale c’est l’impossible, on y est suspendu aux mémoires africaines, figé en suspens dans l’essence
initiale […]. Dans la cale, on ne peut que crier puis se tendre au silence d’un effondrement sans fond. Mais
sur l’habitation, une existence-zombie emporte les ethnies, les Traces-mémoires, les dieux, dominants
dominés, on se mêle et s’emmêle et on dérive ensemble dans les proliférations mutantes (Chamoiseau,
2002 : 183-184).
Dans ce monde fermé sur lui-même, dans lequel l’écriture est limitée à de rares érudits, il
semble naturel que l’oralité, seul moyen de transmission du patrimoine culturel, se soit
développée. Si à la cale du navire correspondaient le silence et le cri, c’est dans la Plantation et
dans le système esclavagiste, nous disent les ethnographes et les auteurs antillais, que va
finalement s’exprimer la parole. C’est ainsi que le conte prend une valeur essentielle,
universelle, qui s’applique parfaitement au contexte antillais puisque, comme le propose Walter
Benjamin : « quand on ne savait plus vers qui se tourner, le conte portait conseil, et quand la
détresse était à son comble, il offrait le secours le plus prompt » (Benjamin, 2000 : 141). De ce
fait, face à l’acculturation, il n’y aurait pas eu de continuité culturelle sans ces fondements
épistémologiques essentiels qui ont permis de transmettre l’identité culturelle : « l’acte de
survie. Dans l’univers muet de la Plantation, l’expression orale, la seule possible pour les
esclaves […]» (Glissant, 1990 : 82-83). Ainsi, si les esclaves ne disposaient, contrairement aux
colons français, « d’aucune bibliothèque, ni mémoire de griots, ni vieux chants de trouvères, ni
sagas dénombrées » (Chamoiseau, 2002 : 192), la parole est venue, pour eux, non pas de livres
ou de manuscrits, mais de ces hommes « laminés (et de ceux qui les martyrisaient) dont
2 Ils ont d’ailleurs été accusés par certains critiques de nier toute parole aux esclaves avant leur arrivée aux Antilles.

123
l’énergie vitale, aveugle, erratique, tendait indéfinie à l’organisation » (Ibid. 193). Transfigurant
ces hommes, la parole a fait d’eux des conteurs, ces figures omniprésentes dans les romans et
l’imaginaire antillais. Elle a fait d’eux des personnages essentiels à la transmission de l’oralité et
qui seraient, selon les auteurs, plus que les simples héritiers d’une culture africaine lointaine. En
effet, spécifiquement antillais malgré son origine, le conteur serait « dans sa parole et dans ses
stratégies, riche de l’Amérique précolombienne, de l’Afrique et de l’Europe » (Chamoiseau,
Confiant, 1999 : 47). Si l’on en croit les études des auteurs de la Créolité, le conteur ne serait
donc pas un personnage simplement africain mais un individu qui, pour survivre, a dû s’adapter
aux conditions particulières de la culture antillaise, prise entre des origines africaines, les
vestiges de la culture amérindienne et de l’oppression d’une culture occidentale :
Si le conteur, au départ, se souvient du griot africain et balbutie une parole africaine, il devra rapidement,
pour survivre et déployer sa résistance, se trouver son langage. Langage qu’il habitera de vestiges caraïbes,
car il y trouve déjà fonctionnelle une lecture de cette terre nouvelle. Langage aussi qu’il prendra aux
colons car il faut admettre, par-delà toute nécessité de les utiliser, la fascination-répulsion qu’exercent sur
le vaincu les valeurs culturelles du vainqueur (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 46).
Dépassant la simple antinomie Afrique/Occident, la parole originelle a donc été forcée de
s’adapter pour sa survie après la rupture d’avec la terre natale. Basée sur des souvenirs directs,
ceux des premières générations d’esclaves venus d’Afrique, puis sur les souvenirs d’histoires
racontées par les générations nées aux Antilles, elle s’est enrichie des cultures en présence pour
développer une résistance et une valeur bien différente de celle de l’écriture dont faisaient usage
les colons.
Limitée à certains individus, cette « écriture originelle antillaise » n’avait en effet, du
temps de l’esclavage, aucun objectif de transmission identitaire mais, tout au contraire, un but
pratique et essentiellement colonial, celui de «mieux asseoir la conquête des isles »

124
(Chamoiseau, Confiant, 1999: 32). Ainsi si aux premiers temps des colonies les maîtres étaient
essentiellement préoccupés par la conquête, la domination écrite et les comptes, les premiers
esclaves et leurs descendants avaient, de leur côté, une préoccupation bien plus culturelle : la
lutte pour la préservation identitaire. Dans les romans antillais, cette lutte est incarnée par deux
figures emblématiques de la culture, le marron et le conteur, dont les réactions face à l’esclavage
ont été diamétralement opposées. En effet, si les marrons avaient entrepris une révolte physique
par la fuite et la lutte armée, le conteur avait, au contraire, entrepris une révolte verbale, celle de
la parole:
L’héritier du cri sera le Nègre marron (celui qui échappa aux habitations pour réfugier sa résistance dans
les mornes), mais l’artiste du cri, le réceptacle de sa poétique, le Papa de la tracée littéraire dedans
l’habitation sera le Paroleur, notre conteur créole. C’est lui qui, en plein cœur des champs et sucreries,
reprendra à son compte la contestation de l’ordre colonial, utilisant son art comme masque et didactique
(Chamoiseau, Confiant, 1999 : 43)
Née du milieu coercitif de la plantation, dans lequel il était tout simplement interdit de
s’exprimer, l’expression orale du conteur n’a pourtant pas été originellement un art pour deux
raisons. Tout d’abord le conteur, son instrument de lutte discrète, était considéré non pas comme
un créateur d’histoires, mais comme quelqu’un les répétant: « longtemps marginalisés, grands
oubliés des études menées par les ethnologues et les folkloristes, les conteurs ont jusqu’à une
période récente souffert d’une image surannée. Absents de recueils et autres corpus de contes,
les conteurs ont généralement fait figure de simples répéteurs dont seul le dire importait »
(Ramassamy, 2006 : 296). De plus, la fonction originelle de l’oralité et les circonstances de son
apparition n’avaient pas, elles non plus, de prétentions artistiques : « nocturne, à moitié
clandestine, et […] ambitionnant seulement de résister [elle] ne se [tiendra] pas pour expression
d’un art» (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 51-52). Cependant, cette absence d’intentionnalité
artistique n’en fut pas moins en totale liberté vis-à-vis du monde de la plantation. En effet, se

125
demande Maryse Condé, « dans quelle mesure ce maître du dire [le conteur] n’est-il pas aussi
maître de la creation qui sous-tend le dire? » (Condé, 1987 : 13). Comme le suggère Walter
Benjamin, le conteur marquerait le récit tout comme « le potier laisse sur la coupe d’argile
l’empreinte de ses mains » (Benjamin, 2000 : 127). Ainsi, plutôt que de figer la communauté
sur le passé ancestral et la répétition, ces conteurs auraient également été des individus créatifs
renouvelant « sans cesse leurs répertoires face aux générations et aux situations nouvelles »
(Ramassamy, 2006 : 296). Par l’imaginaire, la parole des contes a permis aux esclaves de lutter
contre leur condition servile et de symboliquement vaincre les maîtres, comme dans les contes
de Compère Lapin qui finit toujours par vaincre par la ruse des personnages incarnant
symboliquement la force et l’autorité. D’ailleurs, comme l’explique Raphaël Confiant, ce
personnage (qui, dans les contes africains en langue wolof, se nommait Leuk) a évolué depuis
ses origines pour s’adapter aux réalités du monde esclavagiste antillais. Originellement
personnage dont l’action visait « à préserver et à renforcer la cohésion du groupe, du village ou
de la tribu » (Confiant, 1995 : 8), il a développé, dans le monde des plantations, une philosophie
adaptée, « faite de ruse, d’hypocrisie et de cynisme » (Idem.) et lui permettant de survivre. Il y a
donc dans cette adaptation plus qu’une simple répétition, d’autant que ce personnage permettait
non seulement « une échappatoire par la ruse et la violence qui ne remettent pas le système
esclavagiste en cause » (Idem.) mais aussi une échappatoire par « l’imaginaire » (Idem.).
Cependant, cette relative créativité ne semble pas faire du conteur un créateur à part entière.
Selon Confiant, en effet, peu de conteurs créent de nouveaux contes et la grande majorité
d’entre eux s’éloignent rarement de la geste de Ti Jean ou des histoires de Compère Lapin : « Le
conteur créole est donc le ressasseur d’une mémoire forcément fragile, sans cesse menacée mais
dont tout un chacun, conteurs et assistance, sait au plus profond de lui qu’elle est l’indispensable
lien avec les origines de la communauté, aussi brouillées et obscures soient-elles » (Confiant,
1995 : 14). Contestation de l’ordre colonial, poétique de la résistance culturelle et de la survie

126
après la rupture, la parole du conteur serait néanmoins, selon les auteurs de la Créolité, à
l’origine de la tracée littéraire.
Il y a donc dans l’histoire du peuple antillais telle qu’elle est représentée par les auteurs
dans leurs romans et leurs études culturelles, un vrai relais de la parole. Ainsi, si les contes, les
mythes et les paroles originelles ont pu survivre à la traversée de l’océan, les tentatives
d’acculturation sur les Plantations n’ont pas été plus efficaces. Comme l’explique Melville
Herskovits, les conteurs étaient en effet souvent tolérés par les maîtres eux-mêmes: « the
attitudes of the masters toward song and dance and folk tale varied throughout the New World
from hostility and suspicion through indifference to actual encouragement » (Herskovits, 1959 :
138). Ainsi, qu’ils le tolèrent ou non, les colons et les maîtres savaient que les conteurs
existaient sur leurs plantations, si bien qu’ils ont fini par devenir des figures « officielle[s] »
(Chamoiseau, Confiant, 1999 : 76) et reconnues, plus ou moins bien tolérées, et ce même si leur
rôle de préservation et de transmission identitaires allait à l’encontre des principes de
l’acculturation coloniale. Si l’on en croit Chamoiseau et Confiant, leur existence aurait même
permis une forme d’équilibre communautaire entre les maîtres et leurs esclaves, comme un
premier pas vers un renouveau identitaire : « La liberté cachée du conteur fut le lieu d’une
positivité collective et mentale. Elle permit aux Africains de demeurer des hommes, aux Békés
de ne pas se retrouver seuls dans une dévastation génocidaire, aux apports culturels ultérieurs de
s’équilibrer au cœur même d’une identité neuve » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 80). Ces
quelques constatations, présentes dans divers essais et romans des auteurs de la Créolité,
permettent aux auteurs de revenir sur certains aspects de l’oralité traditionnelle et sur ses
bienfaits plus ou moins symboliques. Des bienfaits qui, s’ils sont au cœur de nombreux romans
antillais, restent cependant difficiles à évaluer historiquement puisque nous n’avons aucune
trace, aucun témoignage authentique d’esclaves qui nous permettraient de les étudier. N’ayant

127
donc comme source d’étude de la valeur de l’oralité au temps de l’esclavage que des romans,
nous commençons à voir comment les romans tendent parfois à remplacer certains aspects
invérifiables de l’Histoire pour en proposer une version qui, bien que réaliste, se voudra
néanmoins alternative, s’intéressant à ce qui se trouve sous la chronique coloniale.
1.3 La marque du maître
Si l’on quitte la représentation de l’oralité pour en venir à la représentation de l’écriture
dans les romans et les études des auteurs antillais, il est intéressant de noter que, dans l’analyse
historique qu’ils en font, les auteurs de la Créolité (en particulier Chamoiseau et Confiant dans
Lettres créoles) illustre le caractère non littéraire et négatif des premiers écrits produits en terre
antillaise pour les opposer aux représentations rebelles de l’oralité et des premiers conteurs.
Chamoiseau et Confiant expliquent ainsi de quelle manière la fréquence de l’illettrisme, à
l’époque de l’esclavage, ne favorisait pas la créativité littéraire des colons : « le premier constat
c’est que l’habitation, comme sans doute la grande plantation, n’a pas besoin d’écrivains, elle
n’a besoin que de scribes. […] souvent, du colon à l’esclave – et malgré toutes exceptions –
l’habitation est analphabète » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 50). De plus, nous disent encore
ces théoriciens, les écrits de ceux qui savaient manier l’écriture avaient un but principalement
pratique et colonial, pris entre la rédaction de relations de voyage et de registres coloniaux :
« Les Relations de voyage ont un but pratique au même titre que les livres de compte des
habitations ou les registres d’état civil : permettre aux Européens de mieux asseoir la conquête
des isles » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 32). Cette écriture occidentale, aux objectifs
coloniaux, ne correspond pas aux idéaux littéraires décrivant habituellement l’écriture comme
l’expression d’une liberté, loin de toute formalité scripturale. Il n’y avait donc nul désir, nulle
liberté dans ces registres, dont le but était de classer et d’organiser le monde. Même chose pour

128
les relations de voyages (généralement écrites par les jésuites et les dominicains) qui, même si
elles décrivaient un nouveau monde, n’en avaient pas moins, comme les registres, un « caractère
inventorial […] à mi-chemin entre la description et l’écriture » (Chamoiseau, Confiant, 1999 :
31). Or cet aspect inventorial et classificateur est particulièrement important car, selon
Chamoiseau et Confiant, il n’a permis ni création d’une forme littéraire à proprement parler, ni
une tradition d’écriture « créatrice » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 31). Figée et normée, cette
écriture première était également métropolitaine puisque son principal souci était d’organiser,
soupeser et évaluer le nouveau monde à partir d’un centre lointain, la France et Paris, à partir
duquel tout était jugé : « elle régente le monde neuf et l’aventure nouvelle. Elle pèse des poids
d’un centre lointain qui veut tout ramener aux lois de ses fondements » (Idem.). Dans de telles
conditions il semble donc évident que la souffrance vécue par les esclaves, dont parlent
aujourd’hui les auteurs dans leurs romans, n’avait, à l’époque de l’esclavage, aucune valeur pour
la société coloniale. Puisque ces esclaves étaient décrits par le Code Noir comme des meubles,
pourquoi les colons se seraient-ils intéressés à une représentation de ces esclaves, de leurs
souffrances individuelles et à une reproduction de leurs témoignages? Sa quantification n’ayant
pas d’intérêt économique, cette souffrance n’était donc pas décrite, se réduisant ainsi à des séries
de chiffres et de statistiques : « Et pendant ce temps, les registres fonctionnaient ! Venir, la
canne, mourir. Tu consultes les vieux papiers, voilà ce que tu vois : venir, la canne, mourir »
(Glissant, 1997a : 253). Essentiellement coloniales, les premières traces de l’écriture aux
Antilles sont donc représentées par les auteurs de la Créolité (qui l’ont longuement théorisée)
comme une forme de « non-écriture » ou de « non-littérature » diamétralement opposée à
l’oralité créatrice et rebelle des conteurs. Le roman Solibo Magnifique propose ainsi un exemple
frappant de cette différence en réduisant la mort de Solibo, qui est l’objet de tout le roman et de
son mystère, à un procès-verbal qui, en plantant froidement le décor, ouvre le roman.

129
Cette notion de créativité se serait maintenue des origines, qui n’étaient pas
volontairement artistiques, jusqu’à nos jours puisque « la re-création, la création, l’invention
sont pour les conteurs contemporains une nécessité » (Ramassamy, 2006 : 296). Ramassamy
précise ainsi comment les chercheurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître cet aspect de
la créativité des conteurs, en mentionnant par exemple comment Parry et Lord « soulignaient en
1960, dans l’ouvrage The Singer of Tales, que le conteur, à l’inverse du perroquet qui répète ce
qu’il a appris par cœur, apprend, compose, créée et transmet oralement » (Idem.). Les auteurs de
la créolité, opposant systématiquement les premiers écrits antillais, purement administratifs, aux
premières paroles antillaises, d’abord rebelles puis créatives et involontairement artistiques, on
peut comprendre pourquoi ils sont souvent, dans leurs essais et romans, revenus sur ce point
historique : la différence entre ces deux moyens d’expression est un élément essentiel de leur
recherche identitaire. En effet, si les créolistes insistent sur le fait que les registres coloniaux
n’avaient rien d’artistique, nous voyons de quelle manière ils proposent l’hypothèse que les
premières formes « narratives » et artistiques aux Antilles auraient été produites non pas par les
colons français mais par les esclaves et leurs descendants. Ainsi, les origines de l’art narratif aux
Antilles ne remonteraient pas aux premiers écrivains antillais copiant des œuvres de la
Métropole. Elles seraient plutôt nées de cette parole des conteurs surgie pendant les souffrances
de l’esclavage, la nuit, pendant le sommeil des maîtres. C’est là un fait qui remet directement en
question des influences culturelles françaises sur l’identité antillaise.
1.4 Mensonges et falsifications : les représentations de l’écrit dans les romans
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, cette écriture coloniale et non créative a
beau se vouloir une autorité dominante, un instrument de catégorisation et d’affirmation de la
possession coloniale, elle ne représente pas toujours, dans les romans, la vérité et la raison. Si

130
tous les auteurs n’ont pas, comme Chamoiseau et Confiant, mis en valeur dans des essais son
vide artistique par rapport à l’art du conteur, nombreux sont ceux qui ont représenté ses aspects
négatifs. En effet, entre enlèvements, faux papiers et contrefaçons de signatures, l’écriture
implique souvent, dans les romans antillais, le mensonge et la duperie. Radjiv en fait par
exemple l’expérience dans le roman La Panse du chacal, qui s’attarde sur les cas de
falsifications de signatures : « Il s’agit d’un faux ! Je peux prouver que ma signature a été
contrefaite » (Confiant, 2005 : 164). Dans les romans, l’écriture s’applique aussi aux esclaves
qui sont réduits à des listes de chiffres dans les registres des maîtres ou aux contrats qui
indiquent l’appartenance d’un homme au pouvoir et au bon vouloir d’un autre. On le voit par
exemple dans Aurore d’Ernest Moutoussamy ou encore dans La Panse du Chacal avec les
contrats des engagés Indiens qui, à cause de leurs dettes, deviennent pour eux une condamnation
à ne jamais revoir leur terre natale. Négative, l’écriture est donc mal perçue dans les romans qui
l’associent historiquement (et symboliquement) aux colons occidentaux alors que l’oralité, plus
libre et ouverte, s’associe dans les mentalités à l’esclave puis à l’homme antillais: « l’écrit
demeurait affaire de loi, d’église et d’école. Nous préférions le bouche-à-oreille, la radio bois-
patate et les grandes palabres sur la place de la Victoire. Le ti-banc du conteur nous asseyait sur
le dos du songe et nous naviguions dans la parole, marins perdus cherchant la formule magique
du salut » (Pépin, 2005 : 31). Aussi puissante et autoritaire qu’elle puisse être, l’écriture
s’illustre donc par ses erreurs, ses mensonges et son principe réductif par lequel l’existence des
individus se résume à un bout de papier. Cet aspect réducteur peut d’ailleurs être l’occasion pour
certains personnages comme Chen-Sang – le « Chinois marron » du roman Case à Chine – de
s’approprier l’identité d’un autre en lui volant ses papiers et d’échapper à la justice, révélant
ainsi les incohérences d’un tel système. Par rapport à ces inadéquations de l’écriture, l’oralité est
ainsi, bien souvent, représentée comme une alternative saine aux marques de l’écrit. Mieux, elle
se propose parfois comme une alternative plus véridique, aux valeurs plus fortes. On le voit par

131
exemple dans Ti Jean l’Horizon, quand Wademba montre un mousquet à Ti Jean en lui
expliquant son origine : « L’homme s’appelait Obé et c’était mon ami, je m’honore de le dire.
Tout bonnement comme ça : Obé. Tu as appris les petites lettres à l’école, mais tu ne trouveras
ce nom dans aucun livre, car c’était le nom d’un valeureux, un nègre de bien même » (Schwarz-
Bart, 1998 : 63). Il s’agit donc d’une parole entendue, une parole d’expérience qui n’a rien à
voir avec l’organisation scientifique des faits, l’Histoire et ses lacunes qui, nous l’avons dit,
représente rarement avec précision les sociétés d’esclaves. Cette présentation du savoir
alternatif, cette dualité, ne manque pas de créer des confusions pour certains personnages qui se
trouvent parfois déchirés par leurs propres contradictions nées de leur métissage culturel. C’est
le cas, par exemple, de Patrick qui, dans Hadriana dans tous mes rêves, est déchiré entre sa
pensée rationnelle qui lui a été enseignée à l’école et la croyance populaire au phénomène zombi
dans laquelle il baigne au quotidien. C’est aussi le cas dans le roman Le Quatrième Siècle
d’Édouard Glissant, dans lequel un Mathieu égaré tente « de faire avancer l’histoire, de mettre
en ordre les événements […] » (Glissant, 1997a : 34) et voit entrer en conflit sa pensée
occidentalisée et « l’éblouissement né des paroles de Papa Longoué » (Glissant, 1997a : 34).
Entre deux opposés culturels, entre deux manifestations du savoir, il semblerait donc que naisse
une certaine confusion que la nature même de l’oralité et de l’écriture, entre vérités officielles et
créations imaginaires, entre Histoire officielle et histoires individuelles, ne semble pas capable
d’éclaircir.
Les auteurs antillais ont donc beau, dans leurs romans et leurs études, mettre en valeur
l’origine orale et poétique de l’imaginaire antillais par rapport aux premiers écrits coloniaux, il
semble important de rappeler que l’écriture demeure un élément culturel essentiel, même si ses
représentations sont souvent négatives. Instrument de justification essentiel vis-à-vis des
instances officielles, gouvernementales et occidentales, l’écrit est l’incarnation d’une forme

132
d’autorité qui s’oppose clairement aux récits oraux qui, eux, sont souvent perçus comme n’ayant
aucune valeur légale. On le voit par exemple dans Les Derniers Rois Mages de Maryse Condé,
dans lequel l’authenticité des origines de Spéro est remise en doute car elle n’est pas dans les
registres, « vous n’avez aucune preuve de ce que vous avancez. Si votre histoire était vraie, nous
en aurions eu vent. Le prince Oualino a tenu le journal très fidèle des dernières années de son
père. Il n’y a jamais fait mention de cette naissance » (Condé, 1995 : 130), ou encore dans Le
Quatrième Siècle d’Édouard Glissant, dans lequel Mathieu, victime de cette domination du
document écrit, pense initialement qu’il peut se dispenser d’entendre Papa Longoué lui raconter
ce qui a déjà été écrit dans les livres (sans imaginer que celui-ci peut lui apporter des
informations supplémentaires, voire contradictoires) : « ‘Plus vite, papa, plus vite, ça c’est
connu, j’ai lu les livres !’ » (Glissant, 1997a : 24). Ethnographiquement, le premier argument à
proposer quant au rapport de force entre l’écriture et l’oralité est, bien évidemment, celui de la
domination coloniale et de l’imposition d’un système sur l’autre, conséquence du choc culturel
entre esclaves africains et maîtres occidentaux. Ce conflit culturel se serait ainsi résolu par la
domination de l’occident, de sa culture de l’écrit et de sa mythologie démythisée et par une
victoire du « logos » sur le « mythos », du livre sur la tradition orale :
[Les] survivances des mythes et des comportements religieux archaïques, bien que constituant un
phénomène spirituel important, n’ont eu, sur le plan culturel, que des conséquences modestes. La
révolution opérée par l’écriture a été irréversible. Dorénavant, l’histoire de la culture ne tiendra compte
que des documents archéologiques et des textes écrits. Un peuple démuni de cette espèce de documents est
considéré un peuple sans histoire (Eliade, 1988 : 199).
Cette réflexion nous permet de comprendre la raison de l’omniprésence des récits de voyages et
autres chroniques coloniales et la relative absence de témoignages directs de l’expérience de
l’esclavage. Elle nous permet aussi de comprendre pourquoi, dans les romans de notre corpus,
Mathieu ne croit pas toujours Papa Longoué et pourquoi, dans le roman Les Derniers Rois

133
Mages par exemple, personne ne croit aux origines royales de Spéro : l’oralité ne possède pas la
force et l’importance attribuées à l’écrit. Par conséquent il semble presque naturel que, par
rapport à cette « officialisation » de l’écriture, tout témoignage oral soit, dans les romans,
associé à la définition du kont haïtien, c’est-à-dire comme à une non vérité, « un récit auquel il
est demandé ostensiblement de ne pas croire » (Laroche, 1978 : 207). Ainsi, malgré la multitude
de ces représentations négatives, les romans ne peuvent ignorer l’importance de l’écriture par
rapport à l’oralité. Bien que perçue comme négative, elle fait partie de l’héritage antillais au
même titre que l’oralité. Devrions-nous donc nous en tenir à l’idée que tout récit oral devrait
être considéré comme inférieur à toute manifestation de l’écriture ? Avant d’aller plus loin, il
nous faudrait nous pencher un moment sur la valeur ethnographique de l’oralité pour les sociétés
d’esclaves telles qu’elles sont représentées dans les romans.
2 Fonctions premières de la parole dans les romans antillais
2.1 L’oralité et le conte comme soulagements
Quel était le sentiment des esclaves vis-à-vis de l’oralité ? Que ressentaient-ils en
écoutant les contes ? S’il n’existe pas de témoignages originaux, les contes et les mythes sont
cependant toujours présents dans les romans antillais, qui en illustrent les diverses valeurs
identitaires et spirituelles, notamment leur capacité de soulagement. Transmis d’un personnage à
un autre, les mots peuvent en effet jouer un rôle dans le bien-être des individus, comme
l’exprime par exemple Tituba dans le roman de Maryse Condé : « des mots. Rien parfois ne vaut
les mots. Souvent menteurs, souvent traîtres, ils n’en demeurent pas moins des baumes
irremplaçables » (Condé, 2004 : 133). Les paroles semblent ici se rapprocher des contes et de
leur aspect profane et ludique qui divertit, rassure et amuse et produit un effet positif chez les

134
personnages, en enjolivant les «craintes anciennes pour rehausser la vie… » (Schwarz-Bart,
1998 : 42). Plus encore qu’un soulagement, l’oralité devient même, pour ceux qui l’écoutent,
une force salvatrice:
La parole, force vive mais force maîtrisable par l’homme, instrument de sa puissance et moyen de sa
survivance, est la source de ce plaisir de raconter des histoires, de poser des devinettes, de tirer des kont,
comme on dit en Haïti, donc de rire et de s’amuser, au beau milieu de la veillée funèbre, tout à côté du
mort dont on veille le cadavre (Laroche, 1989 : 70).
On trouve une illustration de ce fait dans le roman Moi, Tituba…, quand Tituba s’aperçoit que la
parole permet, par son aspect fictionnel, une forme de survie: « Peut-être étaient-ce ces paroles
qui tenaient debout les femmes, les hommes et les enfants. Qui les aidaient à faire tourner les
roues de pierre de la vie » (Condé, 2004 : 182). Ce sont aussi des paroles qui, dans Chair Piment
de Gisèle Pineau, permettent à Mina et à Melchior de se raconter l’histoire de l’ancêtre Séléna et
de « survivre » en échappant à leur quotidien: « il se lançait, soudain soulagé d’échapper à ce
qu’était sa vie sur terre, heureux de prêter sa bouche à un morceau d’épopée familiale qu’il
narrait en se redressant au fur et à mesure […]. Son visage s’illuminait et il se trouvait lui-même
émerveillé par l’histoire tant de fois narrée » (Pineau, 2004 : 43). Le caractère positif de ces
histoires est particulièrement important pour la culture et l’identité caribéennes car, comme
l’indique Melville Herskovitz, il aurait en partie permis leur survie. En effet, n’ayant pas
toujours été rejetées et condamnées pas les maîtres des plantations, ces histoires, contes ou
mythes, auraient pu survivre à la clandestinité et dépasser les frontières ethniques pour
influencer les maîtres eux-mêmes : « the quiet with which tales are told, plus their appeal to the
whites as stories for children, made the retention of this element of African culture as ubiquitous
as it is in the New World» (Herskovits, 1959 : 138). On trouve un tel échange culturel historique
dans le roman Moi, Tituba…, dans lequel Tituba, remarquant que personne n’avait « jamais

135
chanté de berceuses, raconté de contes, empli l’imagination d’aventures magiques et
bienfaisantes » (Condé, 2004 : 67) à Betsey Parris et Abigail Williams, décide de leur raconter
des histoires pour éveiller leur imagination et égayer leur quotidien. C’est peut-être là, dans cet
échange de paroles par delà les notions de culture, que l’on retrouve un des aspects les plus
essentiels de la parole comme outil de rassemblement humain. On le voit également quand
Tituba, incapable de se confier, raconte à Hester un conte parlant indirectement d’elle-même,
comme si le récit d’une fiction profane adoucissait la cruelle réalité de sa propre vie. Ce rapport
entre la fiction orale et le vécu est un autre aspect important des contes traditionnels que l’on
retrouve dans le milieu antillais: « la particularité de la littérature orale tient à la corrélation du
récit et du vécu, qui lui donne un sens. Le vécu anime le récit, qui, en retour, donne forme au
vécu » (Garnier, 1999 : 3). Il y a donc dans ce roman une représentation universelle du conte et
de la parole comme « le milieu, l’élément de l’humanité, le logos qui rend l’homme semblable à
l’homme et fonde la communication » (Ricoeur, 1964 : 58) puisqu’il y a non seulement une
communication entre les individus d’une communauté particulière, mais entre les communautés
elles-mêmes, ne serait-ce que le temps d’une histoire. Cette communication est donc un premier
pas vers la connaissance de l’autre. C’est ce qu’illustre par exemple le personnage d’Hadriana
dans le roman Hadriana dans tous mes rêves. La jeune femme ayant été élevée en écoutant les
histoires traditionnelles de sa nourrice, a une perception authentique de la société haïtienne dans
laquelle elle vit. Ainsi, quand Hadriana est zombifiée, les histoires qu’elle entend autour d’elle
ne lui semblent pas incroyables mais familières : « elle a raconté l’histoire du papillon Balthazar
Granchiré. J’étais projetée dans un conte d’autrefois, pareil à ceux que Félicie, la vieille
servante, me ‘‘tirait’’ avant mon sommeil de petite fille » (Depestre, 1988 : 152).
Le soulagement qu’offrent les contes et la parole n’est donc pas seulement d’ordre
ludique, mais peut aussi avoir une fonction identitaire. Comme on le voit dans Moi, Tituba…

136
ceux-ci permettent également d’illustrer une certaine appartenance, un signe de reconnaissance
pour ceux qui ont été séparés de leurs proches et arrachés à leur origine. Nous le voyons quand
Abena et Yao, les parents de Tituba, se retrouvent et échangent des contes afin de retrouver un
semblant d’unité culturelle, perdue dans le navire négrier:
Elle ne cessa pas de pleurer. Alors, il lui releva la tête et interrogea :
- Est-ce que tu connais l’histoire de l’oiseau qui se moquait des frondes du palmier ?
Ma mère ébaucha un sourire :
- Comment pourrais-je ne pas la connaître ? Quand j’étais petite, c’était mon histoire favorite. La mère de
ma mère me la contait tous les soirs.
- La mienne aussi… Et celle du singe qui se voulait roi des animaux ? Et il monta au faîte d’un iroko pour
que tous se prosternent devant lui. Mais une branche cassa et il se retrouva par terre, le cul dans la
poussière…
Ma mère rit. Elle n’avait pas ri de longs mois. (Condé, 2004 : 16)
Entre son aspect ludique et son aspect bienfaisant, le conte a donc, dans les romans, un ancrage
dans le réel dont il s’inspire. Cette importance du réel peut nous pousser à nous demander si,
dans les romans, ce réel antillais tout empreint du vécu de l’esclavage et de l’acculturation a une
influence sur les histoires orales (en les modifiant ou en leur faisant dépasser leurs valeurs
traditionnelles) ou si celles-ci n’ont qu’une valeur d’illustration d’un fait ethnographique.
2.2 La Parole : caractéristique humaine essentielle et outil de savoir
Une étude superficielle des contes tels qu’on les retrouve racontés par les personnages
dans les romans de notre corpus révèle que, malgré une certaine tradition, ceux-ci n’ont pas
toujours les valeurs traditionnelles auxquelles ont pourrait s’attendre. Il arrive même que, dans
certaines circonstances spécifiques, ils se confondent avec les valeurs du mythe. Si l’on prend
par exemple la relation entre Abena et Jennifer Davis, décrite au début de Moi, Tituba…, on

137
peut remarquer un exemple intéressant de ce phénomène de transformation. En effet, si l’aspect
ludique des contes ashanti racontés par Abena (la mère de Tituba) plaît à sa jeune maîtresse, ces
contes font aussi figure d’invocation et de protection, ce qui les rapproche de la valeur du
mythe: « Elle rameutait à leur chevet toutes les forces de la nature afin que la nuit leur soit
conciliante et que les buveurs de sang ne les saignent pas à blanc avant le lever du jour »
(Condé, 2004 : 14). Une lecture plus approfondie des romans nous permet d’observer d’autres
manifestations de ce phénomène qui semble donner une importance presque « vitale » à l’oralité
dans le contexte antillais. C’est ainsi que dès les premières pages de son roman Ti Jean
l’Horizon, Simone Schwarz-Bart met en valeur l’importance de cette parole qui a, pour le
peuple antillais, une valeur assimilable au souffle de vie : « Voyez-vous, c’étaient des hommes
de sable et de vent, naissant de la parole et mourant avec elle » (Schwarz-Bart, 1998 : 13). Ceci
pourrait expliquer qu’un personnage comme Solibo, dans le roman de Patrick Chamoiseau,
meure d’une « égorgette » de la parole quand il ne peut plus s’exprimer librement. Souffle de
vie, principe d’identité, la parole est aussi perçue comme un don, comme l’exprime Ti Jean lors
de sa conversation avec Maïari: « Le premier don que la nature m’ait fait, c’est la voix… la voix
humaine, compagnon… » (Schwarz-Bart, 1998 : 174). Ce don essentiel permettra également à
Papa Longoué, qui insiste sur l’importance essentielle du savoir transmis oralement, de survivre
symboliquement par les mots qu’il a transmis à Mathieu, « un jeune plant par lequel vous avez
des racines dans la terre du futur » (Glissant, 1997a : 19). Pourquoi l’oralité acquiert-elle, dans
les romans, une telle importance? Comme nous le dit Glissant, « un peuple ne supporte pas très
longtemps à la fois une aliénation brutale ou insidieuse de son arrière-pays culturel et une
réduction systématique de son système de production » (Glissant, 2002 : 335), si bien que
l’oralité est, en tant qu’élément culturel et identitaire, représentée dans de nombreux romans
antillais comme un élément essentiel de lutte contre cette aliénation et un moyen de transmission
du savoir – entre les personnages mais aussi entre les romans antillais, leur environnement

138
socioculturel et leurs lecteurs. Ainsi, si à la sortie d’Ainsi parla l’oncle, Jean Price-Mars se
demandait ce que les auteurs pourraient faire de la richesse folklorique et culturelle caribéenne,
nous avons une illustration dans les romans réalistes mystiques de certains auteurs qui utilisent
largement cette richesse.
Nous le voyons également dans Lettres créoles où Patrick Chamoiseau et Raphaël
Confiant remontent le temps afin de mettre en valeur la parole de l’esclave-conteur originel sur
la plantation pour y replacer l’origine de l’art narratif, de la « tracée littéraire » aux Antilles.
S’illustrant par des personnages cherchant non seulement à combler les lacunes mythiques et
historiques, mais aussi à retrouver une forme de mémoire culturelle en luttant contre les
tentatives d’acculturation directe (l’esclavage) et indirectes (la départementalisation), le procédé
d’utilisation du patrimoine folklorique et culturel caribéen permettrait aux romans d’agir sur son
rapport aux lecteurs. Ce patrimoine sera ainsi utilisé par certains auteurs comme une véritable
dynamique créatrice : « nous savons que chaque culture n’est jamais un achèvement mais une
dynamique constante chercheuse de questions inédites, de possibilités neuves, qui ne domine
pas mais qui entre en relation, qui ne pille pas mais qui échange » (Bernabé, 1993 : 53). De ce
fait, en plus d’être un élément culturel et identitaire, la parole serait, dans les romans et par
l’écriture des romans, un outil pédagogique. Comme les contes avant eux, les romans antillais
pourraient donc, dans leur transmission du savoir, constituer un apport culturel aux lecteurs
puisque « his “magical” storytelling nonetheless highlights the historical meanings of Creole
folktales, meanings that he locates in a pedagogical function of sorts » (Seifert, 2002: 219). En
effet, puisque de nombreux romans traitent du passé de l’esclavage et des conditions de vie dans
les plantations de canne à sucre, nous pourrions supposer qu’ils ont, par leur réalisme historique,
une certaine valeur didactique et, comme nous allons le voir dans notre dernière partie, une
fonction de réécriture du rapport à la terre natale antillaise. Aussi, si le réalisme ethnographique

139
des romans réalistes mystiques permet d’apporter un certain nombre d’informations culturelles
authentiques aux lecteurs, pourrait-on dire que, par un effet de mise en abîme, l’oralité a dans
les romans, un rôle semblable pour les personnages. Romans et oralité auraient-ils, malgré leurs
divergences et leurs associations à deux mondes différents, un but semblable au cœur des
récits ?
2.3 La préservation de l’identité et de la mémoire culturelle
La notion de transmission du savoir dans les romans caribéens aurait donc, en dernier
lieu, un lien direct avec la question de l’identité. Permettant non seulement de reconnaître autrui
mais aussi soi-même et de reconstituer un lien identitaire, la parole et les contes permettraient
aussi aux personnages des romans antillais de s’ancrer dans le réel (malgré l’absence d’Histoire
engendrée par l’esclavage que supposent les colonisateurs). C’est là une forme de lutte
identitaire que l’on observe, par exemple, dans Ti Jean l’Horizon. Dans ce roman, les contes
permettent en effet à ceux d’« En-haut » de maintenir une histoire ancienne et de conserver les
souvenirs d’une Afrique spatialement et temporellement lointaine. C’est cette pratique qui
permet à leur identité originelle de survivre malgré l’adversité et l’oubli général : « tous les
soirs, les farouches s’asseyaient en bordure du plateau, face aux lumières tremblantes de la
vallée, et racontaient à leurs enfants des histoires d’animaux d’Afrique, histoires de lièvres et de
tortues, d’araignées qui agissaient et pensaient comme les hommes et mieux qu’eux, à
l’occasion » (Schwarz-Bart, 1998 : 17). Ils s’opposent ainsi à ceux d’ « En-bas », plus nettement
influencés par la culture occidentale et pour qui, comme Patrick dans Hadriana dans tous mes
rêves et Mathieu dans Le Quatrième Siècle, les livres et leurs vérités ont plus d’importance que
les paroles. Cette importance du rapport identité/oralité est également présente dans le roman de
Patrick Chamoiseau L’Esclave vieil homme et le Molosse, dans lequel le vieux marron semble se

140
nourrir de cette parole de conteur et des souvenirs oubliés qui lui donnent chair et esprit. Sans
cette oralité, il ne serait qu’une victime de l’acculturation esclavagiste parmi d’autres, une
coquille vide, sans identité: « La parole du Papa-conteur l’emporte vers des confins étranges.
Elle lui donne une chair dans la chair des autres, des souvenirs qui sont ceux de tous et qui les
animent tous d’aphasiques lancinances » (Chamoiseau, 2005a : 47-48). C’est ainsi que, dans les
romans, les histoires familiales comme celle de la rivalité Longoué/Béluse, ou de la famille de
Léonce dans La Grande Drive des esprits et les histoires religieuses comme le Ramayana, toutes
orales, sont essentielles aux personnages et à leur identité: « avec elle, ils récitaient aussi
l’épopée millénaire du Ramayana, luttant contre les cendres de la mémoire, pathétiques,
dérisoires et sublimes tout à fois dans le maelstrom de la créolisation » (Chamoiseau, Confiant,
1999 : 56).
Dépassant la structure traditionnelle du conte, la parole prend même parfois, dans les
romans, une valeur directe de préservation de la mémoire ou de transmission du savoir et de
l’expérience. Ne racontant pas toujours des histoires, elle transmet des expériences directes ou
des souvenirs de sensations qui, sans elle, seraient perdues. Elle devient, du moins en partie,
préservation de l’expérience brute. C’est ce que l’on retrouve par exemple dans Le Quatrième
Siècle quand Papa Longoué se « souvient » de l’odeur des navires négriers, l’expérience directe
d’un de ses ancêtres qu’il n’a lui-même pas connue mais qui, transmise de génération en
génération, lui a été racontée par sa mère et qui permet un voyage semblable au déplacement
métaphorique de Ti Jean en Afrique : « Je la sens, cette odeur. Stéfanise ma mère me l’a
enseignée, elle la tenait de son homme. Apostrophe qui la tenait de Melchior qui la tenait de
Longoué lui-même le premier monté sur le pont du négrier » (Glissant, 1997a : 27-28). Nous
revenons ainsi à cette problématique que nous avons mentionnée plus haut concernant les traces
et témoignages des premiers temps de l’esclavage. Si les livres d’histoire mentionnent

141
l’expérience des esclaves dans les navires négriers et en décrivent tous les détails, ce ne sont pas
des témoignages directs de ceux ayant vécu cette traversée. Ainsi, il ne reste historiquement
quasiment pas de témoignages écrits des premiers temps de l’esclavage, il semblerait que, dans
les romans, l’oralité (qui relève du conte ou du mythe) soit également le produit d’une forme
d’identité communautaire, un témoignage qui, essentiel, doit se transmettre devant le silence de
l’Histoire. Bien que fictive, l’expérience du premier Longoué est identique à celle vécue par
tous les esclaves. Absente des textes écrits, cette expérience transmise de génération en
génération est une marque identitaire essentielle. Cependant, si elle se transmet de personnage à
personnage dans les romans, sa vraisemblance historique peut également toucher les nombreux
lecteurs que suppose l’écriture romanesque. Il y a donc là, évoqué par le roman, un sentiment
communautaire que l’on retrouve aussi, curieusement, dans la constante interaction entre les
conteurs et leur public: « en répondant ‘‘É cric, É crac’’ l’auditoire du conte créole, constitué,
du temps de l’esclavage, d’un public hétéroclite, dit ‘‘nous’’ formant ainsi une unité » (Casas,
2001 : 321). Nous pourrions ici imaginer le même phénomène se produire entre les écrivains et
leur public : celui de la transmission d’un savoir à travers des témoignages symboliques. Il
semble donc qu’à travers les romans, l’utilisation de l’oralité tend à leur faire perdre leur
dimension ludique pour leur donner une valeur bien plus spécifique. Contrairement à leurs
valeurs traditionnelles, ceux-ci ne seraient plus, dans les romans antillais, uniquement destinés à
faire rire ou à rassurer et, accessoirement, à éduquer, mais tenteraient surtout de se recentrer sur
cet aspect éducatif lié au passé et, comme certains mythes, à l’origine. Cependant, si l’on
retrouve dans les romans des traces ou des fragments de contes et si les romans proposent
parfois certaines valeurs qui en sont proches, noius avons vu que les mythes en tant qu’histoires
originelles (racontées dans les romans ou sous forme de fragments) en sont absents. Cela veut-il
dire que nous n’en trouverons ni traces ni signes dans les romans ou que, au contraire, l’ecriture
leur a donné une forme différente de l’oral ?

142
3 Paroles magiques, paroles sacrées
3.1 Le quimbois et le pouvoir de la parole dans les romans
Traditionnellement, dans la pratique comme dans le folklore, la parole est régulièrement
associée aux manifestations d’un certain pouvoir magique. Dans son ouvrage Les mots, la mort,
les sorts, résultant de recherches dans le bocage normand, Jeanne Favret-Saada explique par
exemple que, dans les divers dispositifs de ritualisation employés par les sorcières pour
désenvoûter leurs clients, la parole est un élément essentiel. Ce qui est valable dans le bocage
normand l’est aussi ailleurs, et c’est pour cette raison que l’on retrouve dans les romans antillais
cette image du quimbois et de sa parole se manifestant non seulement comme un savoir ou une
information, mais aussi comme un pouvoir, si bien qu’elle est un élément essentiel du rapport
entre le quimboiseur et son patient : « la parole est précisément un élément central du dispositif
thérapeutique mis sur pied pendant la séance et par le biais duquel le quimboiseur dicte à son
patient la marche à suivre pour guérir de son mal » (Curtius, 2006 : 270). C’est ainsi que l’on
retrouve, dans de nombreux romans antillais, une représentation spécifique du pouvoir de cette
parole qui a une valeur spirituelle et qui est respectée et crainte pour sa puissance : « attachés,
plus qu’ils n’eussent voulu l’avouer, à leur muette recherche, ils redoutaient surtout
l’irrémédiable puissance des mots dits à haute voix, – s’en remettant pour le reste à leur
commune rumination des choses denses et obscures du passé » (Glissant, 1997a : 15). On
retrouve ainsi, spécifiquement dans Le Quatrième Siècle, un quimboiseur qui a une conscience
claire de la puissance de la parole et de son rôle par rapport à ceux qui l’écoutent. Cependant,
s’il cherche à apprendre le langage des marrons afin de communiquer avec eux le premier,
Longoué pense, au contraire, qu’il n’est pas nécessaire que les marrons apprennent en retour sa
langue à lui : « en revanche, ce n’était pas nécessaire qu’elle connût ses mots à lui ; et il n’était

143
pas fâché d’assurer son prestige d’Africain, en partageant le moins possible sa science du pays
d’au-delà des eaux » (Glissant, 1997a : 110). Cet acte correspond à ce que Joyce Leung décrit
comme « un ésotérisme à maintenir pour garder le pouvoir exclusif [que l’on retrouve dans]
d’innombrables sociétés théocratiques où les prêtres gardent la langue ésotérique pour le
maintien du pouvoir sur les masses : la préservation de sa propre langue est la sauvegarde du
savoir et du pouvoir exclusifs […] » (Leung, 1999 : 62).
La parole a donc, dans la tradition et dans les romans antillais, une certaine autorité et
une certaine force que conteurs et quimboiseurs manipulent selon leurs objectifs, qu’ils soient
magiques ou non. Elle est aussi un instrument de relation ou d’affirmation de soi par rapport à
autrui. On le voit ainsi avec Yao qui, dans Moi, Tituba…, donne à Tituba un nom qui n’est ni
ashanti ni occidental. Cet acte lui permet de se détacher du lieu dans lequel sa fille adoptive se
trouve et de libérer son esprit de toute contrainte esclavagiste. Par la parole, il révèle le pouvoir
de ses mots et affirme sa liberté: « ce n’est pas un prénom ashanti. Sans doute, Yao en
l’inventant, voulait-il prouver que j’étais fille de sa volonté et de son imagination. Fille de son
amour » (Condé, 2004 : 17). La parole de Yao, au cœur de son rituel traditionnel, est donc un
acte de rébellion contre la tradition et l’ordre établi. Parfois même un personnage peut-être si
possédé par la force de l’oralité qu’il deviendra lui-même, par-delà la mort, Parole. C’est ce que
l’on observe à la fin de Moi, Tituba…, dans lequel sa chanson est chantée à travers son île
natale, ou dans le roman Solibo Magnifique dans lequel la parole de Solibo et sa façon de parler
sont tout ce qui reste de lui après sa mort. Si personne ne se souvient exactement de qui il était
en tant que personne, tout le monde se souvient de cette parole omniprésente qui a fait de lui une
véritable incarnation de l’acte de parole :
À terre dans Fort-de-France, il était devenu le maître de la parole incontestable, non par décret de quelque
autorité folklorique ou d’action culturelle (seuls lieux où on célèbre encore l’oral) mais par son goût du

144
mot, du discours sans virgule. Il parlait, voilà. Sur le marché aux poissons où il connaissait tout le monde,
il parlait à chaque pas, il parlait à chaque panier et sur chaque poisson. S’il y rencontrait une commère
folle à la langue, disponible et inutile, manman ! Quelle rafale de blabla… Aux billards de la Croix-
Mission, au vendredi du marché viande […] Solibo parlait, il parlait sans arrêt […] on s’assemblait pour
l’écouter alors que pas un cheveu blanc n’habitait sur ses tempes, et le tafia n’avait même pas encore rougi
ses yeux […] qu’un silence accueillait l’ouverture de sa bouche : par-ici, c’est cela qui signale et consacre
le Maître. (Chamoiseau, 2005b : 26-27)
Tous les personnages ne fonctionnent cependant pas de la même manière et il arrive que certains
s’illustrent parfois par une parole défectueuse associée à une absence de pouvoir. Cet aspect est
particulièrement symbolique dans La Grande Drive des esprits avec les descriptions du
bégaiement de Célestina, survenu suite à un manque de parole échangée avec son père : « Elle
se rappelait aussi – c’était au mitan de la guerre – comment elle s’était mise à bégayer, à jamais,
quand son père cessa de lui parler, de la porter sur ses épaules et puis, petit à petit, de la voir,
comme si elle était devenue tout à fait transparente » (Pineau, 1999 : 144). Décrite comme
« insoutenable » (Idem.) et altérant la parole, cette saccade de la parole la rend en effet
impuissante et indésirable pour les hommes, qui la fuient. Dans d’autres cas, les personnages
silencieux sont parfois associés au pouvoir, ou à l’idée de pouvoir, comme on le voit par
exemple dans L’Esclave vieil homme et le molosse dans lequel les silences du vieil esclave sont
paradoxalement interprétés par les autres esclaves comme une preuve de pouvoir et nourrissent
les rumeurs à son sujet3: « son silence tisonne les esprits. On lui attribue des pouvoirs et des
forces. On le traite en connaissant, capable d’infirmer le venin des Bêtes-longues et d’arracher
aux plantes les vertus opposées du remède à-tous-maux et du poison total » (Chamoiseau,
2005a : 25). Cependant, malgré ces exceptions, celui qui parle est, dans les romans, celui qui
3 Dans ce cas, il ne s’agit pas du pouvoir de la parole mais, au contraire, de son absence, qui est un des moteurs de la rumeur, elle même nourriture de la parole.

145
sait et qui détient une connaissance du monde et de son fonctionnement. Papa Longoué dans Le
Quatrième Siècle, Man Yaya dans Moi, Tituba sorcière noire de Salem, Octavie dans La
Grande Drive des esprits, Solibo dans Solibo Magnifique sont ainsi des personnages essentiels
et sortant de l’ordinaire. Gardiens de la Parole, d’un savoir ancestral, ils possèdent par ce savoir
une certaine autorité sur les communautés dans lesquelles ils évoluent. Ils connaissent les secrets
de l’histoire et du passé comme Papa Longoué qui raconte à Mathieu (curieusement, plus
comme un griot qu’un amuseur public) l’historiographie des familles Longoué et Béluse, ils
manipulent le présent en racontant des histoires et des contes comme Solibo, alors que d’autres,
comme Man Yaya (Moi, Tituba…) ou Man Octavie (La Grande Drive des esprits) ont une
connaissance profonde du monde physique et du monde des Invisibles. Ce sont donc des
personnages auxquels le savoir et les spécialisations, et surtout leurs capacités à transmettre
cette connaissance par voie orale, donnent un pouvoir et une autorité sur la communauté. Ce
pouvoir va même, parfois, jusqu’à se manifester physiquement pour entrer dans le domaine du
surnaturel et de la magie.
3.2 Parole, surnaturel et spiritualité
Traditionnellement, la parole et la magie sont étroitement liées. Ceci est vrai non
seulement dans la formulation de paroles magiques et des incantations (que l’on retrouve
abondamment dans la tradition, le folklore et les représentations populaires), que dans l’idée que
ce sont les mots eux-mêmes qui ont un pouvoir: « the fact that oral people commonly and in all
likelihood universally consider words to have magical potency is clearly tied in, at least
unconsciously, with their sense of the word as necessarily spoken, sounded, and hence power-
driven » (Ong, 2002 : 32). Cependant, les mots « magiques » seuls ne suffisent pas et le simple
fait de les prononcer ne peut pas changer le cours naturel du monde. Dans les romans antillais,

146
les représentations de la force de l’oralité résident en effet dans la façon dont cette parole est
structurée et surtout dans son intégration à un rituel d’une précision parfois extrême. La pratique
magique a ainsi un lien essentiel à la Parole, sans laquelle elle ne pourrait pas exister, si bien
qu’elle peut souvent être perçue comme une forme d’art ou de science:
Le rite magique est fixé dans les plus minutieux détails. La moindre inobservance le rend caduc. Pour les
rites oraux, changer le mot traditionnel ou simplement l’intonation ; dans le rythme manuel, se tromper de
main ou de doigt ; dans les deux cas changer le rythme de l’opération, c’est non seulement ne rien obtenir
du résultat désiré mais aussi réveiller des puissances hostiles (Rony, 1966 : 12).
Traditionnellement, au-delà de son aspect surnaturel, la pratique magique et le rituel sont
relativement structurés dans lesquels la parole, la connaissance et le contrôle des mots et des
gestes jouent un rôle essentiel. La crainte que ces mots peuvent inspirer viendrait ainsi de leur
rareté mais aussi de leur association aux figures du pouvoir ésotérique qui, comme les
quimboiseurs, sont les seuls à pouvoir les maîtriser: « il semble que les hommes n'ont aucun
contrôle sur la portée véritable des mots qu'ils prononcent. A cause de cette impossibilité de
contrôler l'influence des mots, la parole est crainte » (Buchet Rogers 443).
Si l’oralité peut avoir une fonction informative dans le contexte de la transmission d’une
connaissance ainsi qu’une fonction d’autorité par la crainte qu’elle peut inspirer, elle a aussi,
dans les romans réalistes mystiques, une fonction performative. Dans la pratique magique
traditionnelle, en effet, le mot parlé est généralement imprégné d’une certaine force magique, si
bien que, souvent, dire quelque chose revient à le faire : « comme le geste, la parole et acte :
proférer l’incantation, c’est éveiller les forces […] invoquer, c’est évoquer […] » (Baudry,
1992 : 22). Cet aspect essentiel de la parole comme force manipulable pouvant influencer le
cours du réel est un des points importants dans les romans réalistes mystiques de notre corpus et
dans leur utilisation du folklore. On le voit par exemple dans le choc culturel qui oppose les

147
engagés indiens aux anciens esclaves dans La Panse du chacal de Raphaël Confiant dans lequel
les engagés Indiens s’étonnent de cette force de la parole qui, prise pour le réel par certains,
n’est que superstition pour d’autres: « Les Nègres, superstitieux dans l’âme, les désignaient
ainsi, persuadés que le seul fait de prononcer le mot « serpent » pouvait en faire surgir un devant
soi » (Confiant, 2005 : 231). On retrouve généralement ce type de fonctionnement dans la
tradition narrative orale, qui fonctionne presque comme un catalyseur magique de la parole :
« Toute la tradition narrative orale (et pas seulement en Afrique) est saturée de surnaturel. Tout
se passe comme si les magiciens, les sorcières, les objets merveilleux, qui hantent les récits,
tenaient leurs pouvoirs de l’oralité elle-même » (Garnier, 1999 : 2-3). Au-delà des récits, il
apparaît que, dans les romans, la parole ritualisée possède elle aussi un pouvoir essentiel lié aux
conditions de son énonciation. C’est ainsi que, par exemple, la parole sert à l’invocation des
esprits en les poussant à se manifester : « Quelques mots suffisent à les rameuter, pressant leurs
corps invisibles contre les nôtres, impatients de se rendre utiles » (Condé, 2004 : 23). Cette force
de la Parole s’illustre encore plus clairement dans les rituels eux-mêmes, auxquels elle donne
une certaine énergie magique. En effet, comme le note plusieurs fois Tituba dans le roman de
Maryse Condé, certaines potions et concoctions n’auront aucun effet tant que la parole ne leur
aura pas transmis un certain pouvoir. Ainsi, même si elle voyage de la Barbade à Boston puis de
Boston à Salem, elle pourra continuer à produire les mêmes rituels en utilisant des ingrédients
locaux car sa spiritualité s’appuie « davantage sur les forces que sur les choses » (Condé, 2004 :
88). Ce qui compte vraiment est son utilisation du pouvoir de sa propre parole qui donne à ses
concoctions leur pouvoir: « Je concoctais des drogues, des potions dont j’affermissais le pouvoir
grâce à des incantations » (Condé, 2004 : 25). On retrouve une représentation semblable dans Le
Quatrième Siècle d’Edouard Glissant ou Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau, dans
lesquels la voix des conteurs a un pouvoir et une puissance presque hypnotique : « Mathieu pour

148
la première fois se retrouva cerné par le pouvoir du quimboiseur, sans loisir d’étudier le vrai »
(Glissant, 1997a : 47).
Cependant, malgré leur force, les mots et la parole n’ont qu’un pouvoir limité qui,
comme pour le conteur et son public, ne peuvent qu’influencer leur environnement immédiat.
Ainsi, si la parole peut modifier le temps, comme le fait Tituba en faisant souffler le vent lors de
son retour à la Barbade, elle ne peut modifier le cours de son destin, connu seulement des
Invisibles qui la suivent (sa mère Abena et son père Yao et surtout Man Yaya) et dont les
« prédictions », comme celle de Man Octavie dans La Grande Drive des esprits, se vérifient tout
au long du roman. Pour d’autres, cependant, la parole n’est pas toute puissante et n’est pas non
plus un outil de lutte efficace pour influencer le cours de l’Histoire. On le voit par exemple avec
Iphigène dans Moi, Tituba…: « L’avenir appartient à ceux qui savent le façonner et crois-moi,
ils n’y parviennent pas par des incantations et des sacrifices d’animaux. Ils y parviennent par des
actes » (Condé, 2004 : 251). Ce phénomène se retrouve au niveau individuel dans le roman Le
Meurtre du Samedi-Gloria de Raphaël Confiant, dans lequel Romule Beausoleil, qui a suivi une
forme d’initiation magique, ne pourra gagner ses combats de damier qu’en utilisant sa force
physique. De même, le savoir transmis par Longoué à Mathieu n’a de force que quand il éveille
la conscience de l’enfant et quand il guide ses choix et actes politiques dans un autre roman de
Glissant, La Lézarde. Bref si la parole a, dans les romans antillais, un certain pouvoir de
connaissance, d’autorité et de manipulation magique du réel, elle est également ce qui conduit à
l’action. Il est donc important de noter qu’elle n’est pas le seul outil dont peuvent disposer les
personnages dans leurs luttes. Elle a souvent une force en soi, mais elle est parfoi associée, dans
trois des romans de notre corpus, à une force spécifique relevant des mythes traditionnels : le
destin.

149
3.3 La parole sacrée dans les romans antillais
Aspect traditionnel des mythes, la notion de sacré se manifeste en particulier dans Ti
Jean l’Horizon de Simone Schwarz-Bart dans lequel, au-delà des différents pouvoirs et objets
magiques que Ti Jean utilise dans sa quête, de ses décisions et de ses actions, sa victoire
dépendra en partie d’une force semblable au destin à laquelle il ne peut échapper. Comme nous
l’avons vu, les romans antillais représentent souvent l’oralité comme instrument de la pratique
magique ou comme instrument d’autorité ou de savoir, alors que certains, comme Ti Jean
l’Horizon, vont plus loin, jusqu’à rejoindre le mythe. Dans son étude de l’oralité
« Creolist Mystification : Oral Writing in the Works of Patrick Chamoiseau and Simone
Schwarz-Bart», Alexie Tcheuyap revient par exemple sur la notion de destin qui, dans les
romans, est incarnée par les paroles de Wademba qu’il qualifie de tyrannique. En effet, par son
omniprésence et par sa force, l’oralité de ce personnage nous ramène à une des caractéristiques
des textes sacrés : « what all myths know and convey is that the word has the power to
create and that it can alter existences. Several basic texts of modern thought are actualizations of
oral discourse : a word that conditions, predicts, and acts » (Tcheuyap, 2001: 53). C’est pour
cette raison, explique Tcheuyap, que dans Ti Jean l’Horizon tous les mouvements du héros sont
connus avant qu’ils ne se déroulent et que toutes ses aventures sont reliées à la satisfaction d’un
déterminisme originel, d’une histoire écrite d’avance et qui doit s’accomplir. En effet, plus que
la composante d’un rituel, on s’aperçoit que les paroles de Wademba ne se contentent pas
d’annoncer la suite du récit, mais que « his word is knowledge, knowledge is power, and power
action » (Tcheuyap, 2001 : 53). Ce fait est illustré dans le roman, lors de la rencontre entre Ti
Jean et Wademba :
– je ne serai plus là quand les choses arriveront, dit-il, et tu n’auras personne pour te guider de la voix;
mais ceci est un bracelet de connaissance et il parlera pour moi. Il ne parlera pas toujours d’une voix

150
distincte et tu seras parfois obligé de te guider tout seul. Cependant, chaque fois qu’il parlera d’une voix
distincte, il te faudra suivre scrupuleusement ce qu’il te dit, quoi qu’il t’en coûte, et même s’il t’ordonne de
te jeter du haut d’un précipice… (Schwarz-Bart, 1998 : 70-71).
La parole de Wademba est sacrée, intemporelle et autoritaire : elle ne se base pas sur le présent
mais se projette sur l’avenir et vers un ailleurs inaccessible au héros. Ti Jean l’Horizon n’est
cependant pas le seul roman à utiliser cette notion de destin et de parole sacrée. On en retrouve
un exemple dans Moi, Tituba… de Maryse Condé, dans lequel les Invisibles, et en particulier
Man Yaya, ont une perception claire de l’avenir et du destin de Tituba : « Voilà que tu vas être
entraînée de l’autre côté de l’eau… » (Condé, 2004 : 31). C’est là un destin dont, malgré ses
pouvoirs, elle n’a pas connaissance et auquel elle n’échappera pas et qui ne semble accessible
qu’aux Invisibles : « sans doute observait-elle là le début de l’accomplissement de ma vie. Ma
vie, un fleuve qui ne peut être entièrement détourné » (Ibid. 30). Ces esprits des morts ont donc,
dans les romans, une connaissance plus grande du fonctionnement du monde mais ne sont pas
pour autant capables d’agir ou d’influencer le cours des événements. C’est ce que l’on note dans
La Grande Drive des esprits de Gisèle Pineau, dans lequel Man Octavie apparaît après sa mort
et fait preuve d’autorité et impose ainsi à Léonce le nom de son premier enfant, tout en lui
rendant son don et en lui prédisant son avenir et celui de sa famille:
Écoute, mon fils ! Célestina sera ton aînée. Ne lui donne pas d’autre nom ! Un ti-mâle viendra en second,
mais il n’est pas pour cette terre. Dis à ta chère de prendre patience, de pas pleurer trop d’eau, parce
qu’une paire lui sera envoyée, un peu avant son dernier fruit. Zot ké ni kat ti moun ! N’en demande pas
davantage au Seigneur ! C’est ton dû, point… Ah ! J’oubliais : je te rends ton don que ta manman t’avait
soustrait. Prends-en grand soin ! Ne le galvaude pas et fais-en bon usage ! J’ai parlé. (Pineau, 2001 : 87-
88).
Ce type de parole, qui se conclut par un « j’ai parlé » catégorique, prend presque, comme avec
Wademba, valeur de parole « whose bearer is not merely its witness or annunciator, but its

151
author » (Tcheuyap, 2001: 53). Cependant, si Man Octavie annonce l’avenir et a le pouvoir de
rendre à Léonce son don, elle dépend elle aussi d’une puissance supérieure, de nature divine,
puisqu’elle ne permet pas directement à la femme de Léonce d’avoir des enfants. Ceux-ci lui
sont en effet « envoyés », ce qui indique que la parole de Man Octavie n’est que la transmission
d’une parole plus vaste et mystérieuse, intemporelle (elle dépasse le présent) et mythique
(d’origine divine). La Parole aurait ainsi, dans certains romans antillais, une valeur mythique et
sacrée. Cet aspect va même plus loin puisqu’il participe, dans Le Quatrième Siècle par exemple,
à la reconstruction du vide originel par la (re)construction du passé et de l’histoire mythique des
ancêtres. On s’en aperçoit dans le roman quand Mathieu demande à Papa Longoué non pas de le
soigner physiquement mais de lui réciter son passé, ce qui représente une forme de soin d’ordre
identitaire et spirituel. L’enfant veut en effet connaître ce passé qui, par ses aspects exemplaires,
explique l’origine des Béluse et des Longoué, de leurs conflits ancestraux et de leur présence en
terre antillaise. Dépassant la simple recherche d’information, la parole de Papa Longoué va,
comme avec les mythes traditionnels, actualiser le passé et le faire vivre à Mathieu qui, le temps
du récit, va être contemporain du temps de ses ancêtres, de ses origines :
Quand il fait que Papa Longoué accepte d’informer le jeune homme, Glissant déplace les champs et les
perspectives d’analyse du quimbois. Il en explore la portée spirituelle. Il se prononce ainsi contre la
démarche typique de l’individu qui consulte pour atteindre des objectifs ponctuels mais qui, après la visite
chez le quimboiseur, ne cherche pas à développer une foi (Curtius, 2006 : 270).
On remarque ici que cet échange de paroles, qui se fait dans un lieu isolé entre une figure
d’autorité incarnant le pouvoir des mots et un « disciple », reproduit la situation traditionnelle de
la transmission des mythes. Ainsi, racontant l’origine des Béluse et des Longoué et comment
cette histoire influence le présent de Mathieu, Papa Longoué joue le jeu du mythe en donnant à
cette parole échangée autour d’un feu, à l’écart de la civilisation, une dimension sacrée. Il s’agit

152
là d’un schéma que l’on retrouve dans un certain nombre de romans incluant l’idée de destin, de
retour à l’origine par la parole, ou de l’expérience du passé4. La présence de ce type de parole
témoignerait donc, dans les romans, de l’idée que, loin d’avoir disparu sous la domination
esclavagiste, les mythes et la parole sacrée qui leur est associée continuent d’exister. Née du
premier cri de l’esclave dans les entrailles du négrier cette parole aurait donc, dans les romans
(de par la force magique qui lui est associée et sa valeur historique et spirituelle), évolué pour
prendre des formes nouvelles et plus adaptées au réel antillais: « le Sacré ne disparaît pas avec
l’oubli des Amérindiens, l’arrachement à l’Afrique ou le prolongement, en Caraïbe, du rêve
européen. Le Sacré n’est pas écrasé, dispersé, aboli par la domination. Il se recompose comme
quête d’une altérité, d’une nouveauté qui nie la domination » (Danroc, 2002 : 244).
Ces notions concernant les mythes et le sacré posent cependant quelques problèmes,
notamment par leur inscription dans les romans. Si l’on en croit Mircea Eliade, l’écriture a une
fonction réductrice par rapport aux origines orales du sacré puisqu’ « en se manifestant, le sacré
se limite et s’ ‘‘historicise’’» (Eliade, 2001a : 157). Par leur forme écrite les romans auraient
donc, théoriquement, une fonction de désacralisation et de démythification qui pourrait
expliquer l’absence des mythes originels. Cette théorie ne fait cependant pas l’unanimité
puisque, pour certains, le passage par l’écrit permettrait au contraire une re-sacralisation et une
re-mythification des textes qui, « fixés » par l’écriture, se maintiendraient dans les consciences
au lieu de disparaître. Un peu comme l’oralité originelle née de l’esclavage, l’écriture
permettrait donc, elle aussi, de préserver et de re-créer le matériel mythique et sacré : « L’écrit
créole vit dans la complexité ; il dit n’être là que pour suppléer une parole qui s’éteint ; mais il
4 On retrouve ce type de relation entre Wademba et Ti Jean, entre l’esclave vieil homme et la pierre caraïbe (L’Esclave vieil homme et le molosse) et entre l’Ancêtre et ceux qui veulent retrouver le lien avec leurs racines indiennes (La Panse du chacal).

153
est plus que cela, il est inventeur d’un nouveau langage et traducteur de mythes. Il rejoint, en
cela, la notion de sacré et d’éternel présent mythique qu’il avait tout d’abord remis en question »
(Barjon, 2002 : 196). Associée à une écriture généralement perçue, dans de nombreuses
mythologies, comme le signe visuel de l’Activité divine et de la manifestation du Verbe, la
parole sacrée pourrait donc également être le vecteur de mythes nouveaux, différents, qui
pourraient être présents sous des formes adaptées aux spécificités historico-culturelles du monde
antillais. C’est là un phénomène que nous allons analyser dans notre prochain chapitre qui,
plutôt que de se contenter de l’oralité, étudiera comment les auteurs transcendent les mythes par
l’écriture. Ce phénomène, s’il existe, permettrait ainsi à la littérature d’avoir non plus une
fonction didactique à la manière des contes mais également une fonction de sacralisation,
permettant un « rassemblement de la communauté autour de ses mythes, de ses croyances, de
son imaginaire ou de son idéologie » (Glissant, 2002 : 330)5. Comblant une absence, un vide
mémoriel, la (ré)écriture d’une origine mythique et historique offrirait ainsi aux communautés
antillaises une forme d’enracinement qui nous rappelle les idées de Jean Price-Mars. Celui-ci
avait justement proposé, dans Ainsi parla l’oncle, l’idée que les manifestations de l’oralité et du
folklore dans les romans sont un reflet de la communauté antillaise et que l’écriture romanesque,
dans son traitement du sacré et des mythes, joue un rôle dans la représentation et la sauvegarde
de l’identité caribéenne : « Rien ne saura empêcher que, contes, légendes, chansons venus de
loin ou créés, transformés par nous, soient une partie de nous-mêmes à nous-mêmes révélée,
comme une extériorisation de notre moi collectif […] Ils constituent d’une façon inattendue et
ahurissante les matériaux de notre unité spirituelle » (cité par Laroche, 1994 : 342). Cette notion,
si elle a été appliquée au folklore caribéen préexistant, n’a cependant jamais été mise en rapport
5 Contrairement à l’ouvrage littéraire qui, dans sa portée la plus large, a une fonction plus occidentale, « fonction de désacralisation, fonction d’hérésie, d’analyse intellectuelle, qui est de démonter les rouages d’un système donné, de mettre à nu les mécanismes cachés, de démystifier » (Glissant, 2002 : 329-330).

154
avec les mythes nouveaux (re)créés par les auteurs contemporains. Or, comme nous allons le
voir dans la suite de cette étude, la création de mythes nouveaux par les auteurs joue également
le jeu du sacré pour le renouvellement d’un sentiment identitaire antillais.
Les auteurs antillais mettent donc en place, dans leurs romans, une véritable mise en
valeur de l’oralité. Insistant sur ses aspects identitaires dans le contexte des plantations et des
acculturations du Code Noir ils tissent, tout au long de leurs romans, une symbolique de l’oralité
qui, par ses aspects salvateurs, semble parfois rejoindre le mythe. Cette parole des premiers
conteurs nés de la nuit esclavagiste est ainsi représentée comme la première forme artistique
antillaise. D’abord didactique puis sacrée et influencée par certains aspects du mythe comme la
notion de destin, cette parole se diffuserait dans les romans pour leur redonner une valeur
mythique et sacrée. Symbole de lutte, de survie et de renouveau elle s’opposerait ainsi,
symboliquement, à l’écriture, l’instrument stérile du colonisateur, dont les seuls buts étaient,
historiquement, la possession et la classification. Cependant, tout comme nous l’avons vu avec
la définition du réalisme mystique, le monde antillais n’est pas bâti sur une simple dualité et
représente un paradoxe : l’oralité a beau symboliser la révolte, la première expression identitaire
antillaise, nous nous retrouvons cependant à étudier des romans, des textes écrits. Il semblerait
ainsi que cette oralité, irrémédiablement liée aux mythes, au cri et à la révolte discrète de
l’esclave, ait fini par rejoindre l’écriture, généralement associée aux cultures occidentales.
Comment expliquer un tel passage ? L’oralité serait-elle condamnée à se dissoudre dans l’écrit ?

155
Chapitre 5 De l’oralité à l’écriture : une impossible transition?
Entre une écriture dominatrice, officielle et implacable et une oralité rebelle et cachée, le
réel littéraire antillais se retrouve à l’intersection de deux modes de représentation du monde
hérités des tensions originelles de l’esclavage. Dans le domaine littéraire, ces conditions
originelles particulières posent certains problèmes stylistiques, théoriques et culturels sur
lesquels les auteurs antillais sont souvent revenus. En effet, comment mythes et contes antillais
ont-ils pu passer de leurs formes traditionnelles orales à une forme écrite généralement associée
aux colons français ? Pourquoi transmettre ces histoires par des romans au lieu d’utiliser leur
forme orale traditionnelle ? D’une certaine manière, ce transfert d’une forme « rebelle » à la
forme « dominante » pourrait passer comme une défaite de l’oralité face au mode de
représentation occidental. Devant une telle constatation, on pourrait se demander ce qui peut
pousser les auteurs à abandonner ce mode oral, symbole de créativité artistique, que pratiquaient
les premiers conteurs, pour un mode aux origines stériles, purement pratiques, associé aux
colons. Est-ce un mouvement sur lequel ils n’ont aucun contrôle ? Est-ce un choix conscient ?
Nous penchant sur les rapports de l’écrit et de l’oral dans les romans antillais, nous allons tenter
de voir, dans ce chapitre, comment les auteurs antillais utilisent cette opposition traditionnelle à
des fins théoriques et comment ils mettent en place un « mythe » de la mort de l’oralité.
Dépassant ces notions de base, nous verrons enfin comment ils parviennent, notamment par
l’utilisation de l’« oraliture », à dépasser cette dichotomie écrit/oral pour transfigurer, par l’écrit,
mythes et contes originels, notamment par la création d’une figure mythique antillaise : le
conteur.

156
1 Ecrit et oralité : une opposition traditionnelle
1.1 Évolution de l’écriture et rupture culturelle dans le monde antillais
Historiquement, le premier argument à proposer quant au rapport de force entre
l’écriture et l’oralité est celui de la domination coloniale et de l’imposition d’un système sur
l’autre, conséquence du choc culturel entre esclaves africains et maîtres occidentaux. Ce conflit
culturel – qui a, selon Benjamin, entraîné une valorisation du fait historique et une chute du
« cours de l’expérience » (Benjamin, 2000 : 115) – se serait résolu par la domination de
l’Occident, une victoire du « logos » sur le « mythos », et par une apparente absence d’histoire
puisque « un peuple démuni de cette espèce de documents [le document écrit] est considéré un
peuple sans histoire » (Eliade, 1988 : 199). De même, la transition de l’oralité vers l’écriture est
bien souvent perçue comme un passage obligé dans la société contemporaine puisque, pour fixer
l’intérêt de l’homme moderne, tout « héritage traditionnel oral doit être présenté sous la forme
du livre… » (Eliade, 1988 : 199). Historiquement et culturellement, il semble donc que le
mouvement « oralité écriture » ait été, et soit encore aujourd’hui, un phénomène naturel et
inévitable, « mais un autre passage a lieu aujourd’hui, contre lequel nous ne pouvons rien. C’est
le passage de l’écrit à l’oral» (Glissant, 2002 : 330-331). En effet, si le mot d’ordre général de la
fin du système des Plantations puis de la départementalisation a été, après l’acculturation de
l’esclavage, de « devenir français » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 88), l’homme antillais s’est
retrouvé devant un choix entre deux cultures et identités principales généralement illustrées par
des oppositions binaires du type oralité/écrit, le créole/le français, les campagnes/les villes.
Comme l’indiquent les auteurs de la Créolité, ce choix culturel, partiel ou complet, s’est
présenté comme une triple rupture : « on passe de l’oral à l’écrit, c’est une rupture par l’énoncé ;
on passe de la langue créole à la langue française, c’est une rupture par la langue ; on passe du

157
conteur à l’écrivain, c’est une rupture par accélération » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 89-90).
Cette rupture, que l’on retrouve dans la thématique de nombreux romans, s’illustre en effet par
un processus apparemment inéluctable de décréolisation affectant « tous les domaines du réel et
pas seulement celui des pratiques langagières » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 95). Selon
Confiant et Chamoiseau, le conteur s’oppose donc à l’écrivain et la production littéraire
antillaise contemporaine serait prise dans une absence d’alternatives dans laquelle l’écriture est
dominante. Ainsi, après les luttes identitaires et culturelles incarnées par les conteurs, le
domaine si répandu de l’oralité antillaise aurait fini par être dominé par le français, une langue
élitiste, très peu parlée à l’époque de l’esclavage et encore moins écrite en-dehors des villes
mais qui, grâce à l’entreprise coloniale et à la départementalisation, a eu une influence
déterminante dans l’histoire des « lettres créoles ».
L’écriture semble donc, par son apparente différence totale d’avec l’oralité, faire de la
rupture un passage obligé. En effet, il y a entre les deux une différence trop importante pour
permettre un simple passage de l’oralité à l’écrit, ou du récit au roman : « ce qui distingue le
roman du récit (et de l’épopée au sens étroit), c’est qu’il est inséparable du livre. […] La
tradition orale, qui constitue le fonds de l’épopée, est d’une tout autre nature que ce qui donne
corps au roman [qui] ne provient pas de la tradition orale, et n’y conduit pas davantage »
(Benjamin, 2000 : 120). De ce fait les romans, en tant que représentations écrites, seraient une
marque de la colonisation, en rupture totale avec l’oralité traditionnelle des Antilles. On le voit
par exemple avec Édouard Glissant pour qui l’écriture, par sa fixité et sa permanence, ne serait
qu’une immobilisation des mots, de la parole et de l’esprit, mais aussi un acte de possession,
d’imposition du regard colonial et non une force en elle-même. Théoriquement, les romans
s’opposent donc à l’oralité dont le but premier est de combler le manque, la rupture originelle
puisque « passer de l’oral à l’écrit, c’est immobiliser le corps, le soumettre (le posséder). L’être

158
dépossédé de son corps ne peut atteindre à l’immobile où l’écrit s’amoncelle. […] Dans cet
univers muet, la voix et le corps sont la poursuite d’un manque » (Glissant, 2002 : 405). Cette
idée de la possession par l’écrit, si elle rappelle les contrats et registres, rappelle aussi le principe
de base de la colonisation : « la première écriture a devancé la prise de possession, puis l’a
accompagnée, puis l’a observée, puis l’a célébrée, puis l’a justifiée» (Chamoiseau, 2002 : 116).
Des récits de voyages aux écrivains doudous, ce type de prise de possession a eu un certain
nombre de répercussions particulières, notamment au travers des clichés et autres
stéréotypes1qui, diffusés pendant la période postcoloniale, actualisaient le regard « possesseur »
sur les Antilles en le figeant par l’écriture. Traditionnellement, il y aurait donc dans le monde
antillais deux systèmes de représentation correspondant à deux modes d’expression dont l’un –
oral, rebelle, authentique – aurait disparu au profit d’un autre – écrit, colonial, stéréotypé. Force
envahissante, dépossédant l’oralité d’elle-même, l’écriture est donc historiquement représentée
comme une forme d’expression dominante face à une oralité originelle dont il ne reste que peu
de traces puisque ses défenseurs eux-mêmes écrivent principalement des romans.
Cette influence n’est pas toujours vue d’un bon œil par les auteurs antillais qui théorisent
souvent sur la colonisation de l’oralité par l’écriture et sur les conséquences dramatiques d’une
telle transition. Pour Édouard Glissant par exemple, le choix entre ces deux types d’expression
opposés par nature permettrait de créer, dans la littérature antillaise, une alternative négative qui
aurait des conséquences catastrophiques sur l’oralité. Selon lui, l’oralité perd inévitablement de
sa valeur et de sa substance originelles : « le mouvement se fait donc vers l’écrit.
Malheureusement, il s’accompagne d’un mouvement inverse : la langue parlée tend à se
stéréotyper. La pratique de l’image, de la parabole, disparaît peu à peu du créole quotidien. Si
1 La fameuse « nonchalance doudoue » ou l’image sexualisée de la femme antillaise.

159
c’est là le tribut à payer pour l’entrée dans l’écrit, on se demande si la chose en vaut la peine »
(Glissant, 2002 : 719). Il s’agit donc ici d’un type d’écriture qui, sans se définir clairement, ne
représente plus aucune spécificité culturelle définie, ne serait plus qu’une alternative entre deux
aspects indésirables. Pris entre une « langue maladroite […] qui littéraliserait la phrase
française ; ou bien une langue savante, truffée des mots du vieux créole depuis longtemps tombé
en désuétude et qui ne répondent à rien du réel » (Idem.), les romans antillais auraient donc
produit, selon Glissant, une forme écrite ne relevant ni du niveau de l’écriture française, ni de
celui de l’oralité antillaise, si bien que c’est toute l’architecture culturelle antillaise qui a été
touchée par cette dualité. Perdant ainsi le contact avec leur monde originel, celui de l’oralité,
certains auteurs et théoriciens comme Glissant et Chamoiseau n’hésitent pas à considérer
l’omniprésence du livre et de l’écriture comme une oppression et une acculturation : « Je ne
percevais du monde qu’une construction occidentale, déshabitée, et elle me semblait être la
seule qui vaille. Ces livres en moi ne s’étaient pas réveillés ; ils m’avaient écrasé »
(Chamoiseau, 2002 : 47). À celle-ci s’ajouterait la transformation forcée de l’oralité et
l’imposition d’un regard non antillais si bien que le passage de l’oralité à l’écriture serait un
élément indésirable aux conséquences potentiellement dramatiques. En effet, se demande
Chamoiseau, « comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à
d’images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? » (Chamoiseau, 2002 : 17).
Historiquement, on peut observer les conséquences de ces choix chez les premiers écrivains
antillais qui, en cherchant à copier la France et ses courants littéraires (comme le romantisme),
tendaient à « littéraliser » la phrase française alors que d’autres, comme les écrivains doudous
qui dominaient le début du XXe siècle aux Antilles, tendaient à utiliser des formes créoles et des
stéréotypes exotiques trop éloignés de la réalité antillaise. C’est contre ces auteurs et en réaction
devant de semblables pratiques que les auteurs antillais contemporains, et encore plus ceux du
mouvement de la Créolité, ont tenté de réagir en apportant à leurs romans un souffle nouveau,

160
recentré sur l’identité antillaise et l’utilisation d’éléments culturels comme l’oralité et le folklore
et ce, malgré un passage obligé par l’écriture.
1.2 Du conteur à l’écrivain : le refus de la continuité
Il y a donc dans l’histoire de la tracée littéraire antillaise une évolution née d’une rupture
et contre laquelle il est difficile de lutter : le livre serait donc un passage obligé vers la
modernité, annonçant, comme dans Solibo Magnifique, la fin du conteur et, si l’on en croit les
auteurs de la Créolité, la mort de la parole. Ces auteurs insistent donc spécifiquement sur l’idée
de rupture et, pour eux, aucun écrivain antillais n’est armé pour prendre le relais de la parole
ancestrale puisque, après les conteurs traditionnels, « ce fut donc une manière de silence : la
voie morte » (Bernabé, 1993 : 34-35). En effet, pour Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et
Raphaël Confiant, le conteur est, contrairement à l’écrivain, une figure spécifique du système
plantationnaire si bien que, « quand le système des plantations se décomposa, la parole du
Conteur fut immobilisée » (Chamoiseau, 2002 : 188). Cette théorie, qui propose que la fin du
système plantationnaire a causé la fin des conteurs, est d’ailleurs illustrée par les auteurs dans
des romans comme Solibo Magnifique : « Solibo est en fait mort de la fin d'un monde auquel il
ne pouvait survivre, monde de la parole liée à celui de l'exploitation de la canne à sucre et où la
vie sociale prenait place autour des "habitations" ou plantations » (Perret, 1994 : 825). Confiant
va même plus loin en soutenant que le conteur ne peut être une figure moderne car il a été
« incapable de se reproduire, d’évoluer et de s’adapter à la modernité qui affecte les îles depuis
une cinquantaine d’années » (Confiant, 1995 : 14). Personnage historique et culturel
exclusivement « endémique » du monde des plantations, le conteur aurait donc fini dans une
impasse sans transfert possible vers l’écrivain, bien que celui-ci utilise le folklore et les contes
dans ses œuvres. Face aux incertitudes de leur héritage, sans ancêtre direct pour les guider ou les

161
inspirer, ce serait, en fin de compte, le caractère figé de l’écriture (critiqué par Glissant) qui
aurait servi de refuge aux écrivains : « nos écrivains passés n’ont pas pris le relais du conteur car
c’était impossible. Les certitudes de l’écriture (ce poids millénaire de codes et de métriques)
s’étaient offertes à eux comme un refuge » (Chamoiseau, 2002 : 197). Cependant, si Glissant et
les Créolistes s’accordent sur la notion de rupture et l’impossibilité de transfert naturel de
l’oralité vers l’écrit, ils reviennent aussi longuement, dans leurs romans et leurs essais, sur les
obstacles que rencontre l’utilisation de l’écriture. On le voit en particulier dans Solibo
Magnifique dont l’intrigue est centrée sur un conteur, Solibo, évoluant dans un monde antillais
dans lequel l’oralité se meurt. Outre ce personnage qui est au centre de l’intrigue, le problème
principal de la transition conteur/écrivain apparaît quand le narrateur, un personnage nommé
Patrick Chamoiseau (et se décrivant comme un « marqueur de parole ») cherche à recueillir la
parole de Solibo pour la préserver par l’écriture. Malgré ses bonnes intentions, il se retrouve très
vite face au problème que pose la représentation de l’oralité par l’écriture: « comment écrire la
parole de Solibo ? En relisant mes premières notes du temps où je le suivais au marché, je
compris qu’écrire l’oral n’était qu’une trahison, on y perdait les intonations, les mimiques, la
gestuelle du conteur, et cela me paraissait d’autant plus impensable que Solibo, je le savais, y
était hostile » (Chamoiseau, 2005b : 225). Selon ce narrateur, confondu dans ce roman avec
l’auteur lui-même, il y aurait une impossibilité d’écrire l’oral sans le trahir. D’ailleurs Solibo
lui-même, comme Glissant dans Le Discours antillais, met en garde ce narrateur contre
l’écriture qui est pour lui synonyme de fixité, de platitude et de mort, contrairement à la parole
qu’il perçoit comme mouvement et vie : « "Cesse d’écrire kritia kritia, et comprends : se raidir,
briser le rythme, c’est appeler sa mort… Ti-Zibié, ton stylo te fera mourir couillon…" »
(Chamoiseau, 2005b : 76). Le roman cherche donc à expliquer que, par leurs formes différentes,
l’oralité et l’écriture demeurent incompatibles, notamment parce que la relation du conteur à son
public, qui n’existe pas dans les romans, est un élément essentiel du conte : « participer à la

162
performance d’un conteur, c’est comprendre que le rapport entre le conteur et son auditoire est
et reste incontournable » (Ramassamy, 2006 : 298). Par l’écriture, acte solitaire par excellence,
le roman est donc, théoriquement, tout le contraire du conte (naturellement oral et
communautaire), mais aussi du mythe parce qu’il « renvoie également à l’individu et non
[comme le mythe] à la collectivité, aussi bien pour ce qui touche à la création du récit qu’à sa
consommation, forcement profanes […]» (Siganos, 2005b : 112). Au-delà de leurs formes
(qu’elles soient orales ou écrites), il y aurait même une différence dans le contenu des histoires
transmises. C’est ce que propose également Walter Benjamin quand il explique comment « le
conteur emprunte la matière de son récit à l’expérience : la sienne ou celle qui lui a été rapportée
par autrui. Et [comment] ce qu’il raconte, à son tour, devient expérience en ceux qui écoutent
son histoire » (Benjamin, 2000 : 120-121) alors que l’écriture d’un roman, au contraire,
exacerbe « dans la représentation de la vie humaine, tout ce qui est sans commune mesure »
(Ibid. 121). Ainsi, si l’on en croit ces constatations, l’oralité et écriture seraient si
diamétralement opposées qu’il ne pourrait y avoir de mythe écrit et que l’écriture elle-même
pourrait être perçue comme la mort de ces mythes. Cependant, comme avec l’étude du réalisme
mystique, tout n’est pas simplement antinomique dans la littérature antillaise contemporaine, et
encore moins dans ses romans réalistes mystiques qui, malgré leur caractère écrit, utilisent de
nombreuses marques de l’oralité. S’il n’y a apparemment pas eu de transition entre le conteur et
l’écrivain, on pourrait alors se demander pourquoi on retrouve ces marques orales et
folkloriques dans les romans antillais.
Supposant que l’oralité est bien souvent contaminée par l’écrit et que, en retour, les
écrits des auteurs contemporains sont également influencés par l’oralité, nous pourrions
légitimement espérer voir ce rapport d’influence non pas comme une perte, mais comme une
transformation de l’écriture par l’oralité et inversement. Cependant un problème se pose : même

163
s’il y a probablement un métissage de l’oralité et de l’écriture, et si le but de cette dernière n’est
pas de « sauver » l’oralité mais plutôt, comme nous l’avons vu avec le réalisme ethnographique,
d’en rendre compte, il apparaît que, en plus de refuser l’héritage du conteur, certains auteurs
considèrent comme problématique ce mouvement qui se fait de l’oral à l’écrit. Pour Édouard
Glissant, par exemple, le problème vient de la nature même du texte littéraire qui, par rapport à
l’oralité, est essentiellement productrice d’opacité : « parce que l’écrivain, entrant dans ses
écritures entassées, renonce à un absolu, son intention poétique, tout d’évidence et de sublimité.
L’écriture est relative par rapport à cet absolu, c’est-à-dire qu’elle l’opacifie en effet,
l’accomplissant dans la langue. Le texte va de la transparence rêvée à l’opacité produite dans les
mots » (Glissant, 1990 : 129). On s’en aperçoit par exemple dans un autre passage de Solibo
Magnifique dans lequel le narrateur exprime comment l’écrit opacifie et réduit cette oralité pour
la perdre totalement: « Si bien, amis, que je me résolus à en extraire une version réduite,
organisée, écrite, sorte d’ersatz de ce qu’avait été le Maître cette nuit-là : il était clair désormais
que sa parole, sa vraie parole, toute sa parole, était perdue pour tous –––– et à jamais »
(Chamoiseau, 2005b : 226). Ainsi, comme le soutient par exemple Jean-Pierre Durix dans
Mimesis, Genres and Post-Colonial Discourse, Deconstructing Magic Realism, l’écriture ne
serait qu’une version diminuée de l’oralité : « in a printed book, the word is, to some extent,
fossilized, or at least contact between teller and ‘listener’ is more distanced and mediated by the
printed page» (Durix, 1998: 32). Il y a là un paradoxe car si les auteurs antillais décrivent
l’oralité comme inimitable et perdant irrémédiablement de sa substance en passant par l’écrit, ils
continuent pourtant d’utiliser l’écriture pour s’exprimer. Ils vont même parfois, comme Patrick
Chamoiseau dans Au temps de l'antan : contes du pays Martinique, jusqu’à écrire ou retranscrire
des contes, ces histoires orales par excellence. Les Maîtres de la parole créole de Raphaël
Confiant va encore plus loin. Dans cette anthologie, les histoires orales de vingt-six conteurs ont
été réunies grâce à des enregistrements qui ont ensuite été retranscrits au plus près par Confiant.

164
Appuyées de photographies et basées sur des enregistrements, cet ouvrage essaie ainsi de
reproduire au plus près les jeux de langue et le rapport au spectateur. Cependant, une fois
encore, notons que malgré tous ces efforts, une seule chose manque : la voix. Néanmoins,
Confiant ne prétend pas, dans cet ouvrage, révolutionner l’écriture de l’oralité et son but,
clairement indiqué dans la préface, est que « grâce à l’écriture sera préservé à travers les siècles
un peu de la magie de la parole [des] vieux conteurs traditionnels » (Confiant, 1995 : 15).
L’écriture prend ainsi une importance essentielle par rapport aux mythes puisque « la
transmission par l’écriture d’un mythe en fait, d’emblée, un objet historique, alors qu’un mythe
transmis oralement échappe à l’histoire » (Brisson, 1976 : 4). Ce concept nous ramène une fois
encore aux notions envisagées avec le réalisme ethnographique du réalisme mystique, qui se
veut témoignage et préservation d’un patrimoine puisque l’écriture permettrait une meilleure
conservation et une meilleure observation de ces mythes. Confiant soutient d’ailleurs cette
théorie quand il considère la survie des contes collectés par l’association « Konté Sanblé » qui,
enregistrés sur cassette, devraient être publiés afin de les sauver. Malgré ce désir de préserver un
patrimoine, Confiant et Chamoiseau ne sont cependant pas les premiers à avoir voulu préserver
des contes et à s’être heurtés aux difficultés du transfert oralité/écriture. Lewis Seifert, par
exemple, mentionne dans son étude « Orality, History and “Creoleness” in Patrick
Chamoiseau’s Creole Folktales », de quelle manière Charles Perrault avait, en 1697, lui aussi
tenté de transférer des contes depuis leur oralité traditionnelle vers l’écrit dans Histoires ou
contes du temps passé, avec des moralités, un recueil dans lequel il a incorporé des éléments de
l’oralité, mais dans lequel le passage de l’écrit à l’oral est demeuré problématique :
As Catherine Velay-Vallantin has masterfully shown, however, this incorporation is also a mutilation of
the “primordial orality” of storytelling. Beyond transforming fluid oral versions into singular, authoritative
texts (as indeed many literary fairy tales do), the Mother Goose Tales meld elements from very different
cultural provenance and create a factitious orality that aims to disguise Perrault’s writerly manipulation

165
(179–80). The effect of these transformations, according to Velay-Vallantin, is to project an “ambivalent
attitude of fascination and rejection” vis-à-vis orality (180). If such an “attitude” is due in large part to
Perrault’s own ambivalent relation to both the aesthetics and the purveyors of the oral tradition of his time,
it nonetheless raises suspicions about any literary fairy tales that are deliberately modeled on oral
storytelling, such as Chamoiseau’s Creole Folktales. (Seifert, 2002: 215)
Ainsi, si la plupart des auteurs antillais utilisent des éléments de l’oralité dans leurs romans et si,
comme nous pouvons le voir dans la thématique de Solibo Magnifique, certains cherchent à la
mettre en valeur, ou encore tentent de sauvegarder la forme originale de cette histoire, ils
continuent d’admettre une certaine impuissance dans leur propre travail d’écriture. En effet,
comme l’indique Solibo lui-même en commentant l’œuvre Manman Dlo contre la fée
Carabosse (écrite par Patrick Chamoiseau le narrateur et Patrick Chamoiseau l’écrivain), il
semble y avoir une distance infranchissable physique et temporelle entre cet écrit dominant et
l’oral dominé, une séparation que l’écrivain devrait idéalement tenter de réduire voire même de
supprimer :
(Solibo Magnifique me disait : « Oiseau de Cham, tu écris. Bon. Moi, Solibo, je parle. Tu vois la
distance ? Dans ton livre sur Manman Dlo, tu veux capturer la parole à l’écriture, je vois le rythme que tu
veux donner, comment tu veux serrer les mots pour qu’ils sonnent à la langue. Tu me dis : Est-ce que j’ai
raison, Papa ? Moi, je dis : on n’écrit jamais la parole, mais des mots, tu aurais dû parler. Écrire, c’est
comme sortir le lambi de la mer pour dire : voici le lambi ! La parole répond : où est la mer ? Mais
l’essentiel n’est pas là. Je pars, mais toi tu restes. Je parlais, mais toi tu écris en annonçant que tu viens de
la parole. Tu me donnes la main par-dessus la distance. C’est bien, mais tu touches la
distance… ») (Chamoiseau, 2005b : 52-53)
Les romans antillais semblent donc se retrouver devant un dilemme particulièrement
difficile posé par des formes littéraires et des manifestations socioculturelles (l’écrit et l’oral)
apparemment irréconciliables dans le contexte antillais. Devrait-on en déduire, comme les

166
auteurs semblent le faire dans leurs romans, que tous les écrits antillais reproduisant l’oralité
sont des échecs, des ersatz de leurs formes d’origine ? Ou, au contraire, devrait-on voir les
tentatives de représentation de l’oral par les auteurs comme des formes artistiques à part
entière ?
1.3 Oralité et écriture : une opposition réelle ou esthétique ?
Si l’écriture et l’oralité, traditionnellement liées à deux entités culturelles distinctes sont
pour certains dissemblables et dissociables, nous ne nous contenterons cependant pas de ce point
de vue spécifique aux auteurs de la Créolité. En effet, il y a dans leurs romans trop d’influences
folkloriques et orales pour que l’on rejette toute possibilité de transfert. Comme ont pu le
montrer certains chercheurs comme Ruth Finnegan ou Maximilien Laroche, l’opposition entre
l’oralité et l’écriture proposée par les Créolistes ne serait en fait pas complètement admissible et
pourrait n’être, en fin de compte, qu’un jeu littéraire. Comme le propose Alexie Tcheuyap en
étudiant les romans de Patrick Chamoiseau, cette opposition écrit/oral ne serait donc pas une
obligation, une conséquence dramatique de l’influence coloniale, mais un « esthetic game […]
for in the novel the oral and the written are indeed linked » (Tcheuyap, 2001 : 45). Si, selon
Chamoiseau, le conteur connaissait l’écriture et « éprouvait son emprise impérieuse »
(Chamoiseau, 2002 : 196), Ruth Finnegan, propose qu’il y a bien une possibilité de continuité
entre oralité et écriture puisque « there is no deep gulf between the two: they shade into each
other […] and there are innumerable cases of poetry which has both “oral” and “written”
elements. The idea of pure, uncontaminated “oral culture” […] is a myth » (Finnegan, 1992:
24). De ce fait, si un des actes principaux du mouvement de la Créolité a été de se désoler de la
mort de l’oralité et de son impossible passage vers l’écrit mais aussi de rejeter tout lien entre
l’écrivain et le conteur, ce point de vue ne fait pas l’unanimité puisque certains chercheurs

167
restent persuadés que l’écriture et l’oralité sont en fait reliés par les écrivains et que la mort des
conteurs n’a pas entraîné la mort de la parole, bien au contraire.
Comme le propose encore Alexie Tcheuyap dans son étude, les romans comme Solibo
Magnifique et Ti Jean l’Horizon ne seraient pas de purs produits littéraires nés de l’oppression
coloniale puisque l’on y trouve, dès leurs premières pages, les marques du récit oral
traditionnel : « their enunciation is not historical, and we participate in a proliferation of voices,
introducing the subjectivity of the traditional tale […]» (Tcheuyap, 2001: 45). De ce fait, nous
pourrions proposer que la représentation d’une oralité pure et originelle, disparue et impossible à
reproduire parfaitement, relèverait, dans les romans qui en font mention, d’une forme de mythe.
Illustrant une opposition symbolique à l’origine de l’existence du monde antillais – l’opposition
entre les premiers conteurs et les premiers écrits coloniaux – la rupture oralité/écriture est en
effet une source d’inspiration, une conduite à suivre pour les auteurs, qui reproduisent dans leurs
écrits cette situation à l’origine de leur histoire et de leur identité. En plus d’être esthétique,
l’opposition traditionnelle entre l’écriture et l’oralité pourrait également avoir une fonction
politique et identitaire puisqu’elle est, pour les auteurs, un moyen d’exprimer leur opposition à
l’influence coloniale et aux acculturations contemporaines dans la société antillaise. Si l’on se
penche de nouveau sur les théories d’Édouard Glissant, nous pouvons observer un fait
intéressant qui pourrait expliquer ce refus d’accepter le passage de l’oral vers l’écrit : le fait que
cette opposition soit un des aspects essentiels de la culture antillaise. En effet,
C’est dans la Plantation que, comme dans un laboratoire, nous voyons le plus évidemment à l’œuvre les
forces confrontées de l’oral et de l’écrit, une des problématiques les plus enracinées dans notre paysage
contemporain. C’est là que le multilinguisme, cette dimension menacée de notre univers, pour une des
premières fois constatables, se fait et se défait de manière tout organique. (Glissant, 1990 : 89)

168
Comme nous le voyons dans la grande majorité des romans antillais, la culture et la littérature
antillaises perçoivent la tradition orale comme une de leurs caractéristiques essentielles. C’est là
un des aspects qui, historiquement, leur a permis de s’opposer à l’acculturation et de résister à
une censure mais aussi de reconstituer des histoires en réaction contre l’Histoire imposée par les
cultures occidentales. Illustrée dans les romans, cette oralité s’efforce également d’affirmer des
images propres à une expérience antillaise. Selon ce point de vue, il semble facile de
comprendre le positionnement théorique et politique des auteurs vis-à-vis de l’écrit, qu’ils
perçoivent comme oppressif, dominant et vis-à-vis de l’oralité, qu’ils perçoivent comme
traditionnelle et sur le point de disparaître. Avant d’être théoriques et littéraires, les théories de
l’impossibilité du passage de l’oral à l’écrit seraient donc culturelles, nées de la réaction contre
l’oppression esclavagiste originelle, symbole de la première parole à l’origine de la création
imaginaire aux Antilles. Ainsi, la défense de l’oralité et le rejet de l’écriture seraient une forme
de passage obligé pour l’affirmation identitaire même si l’écriture, au même titre que l’oralité,
est une partie de l’héritage antillais.
N’étant figés ni dans une écriture inspirée des romans occidentaux, ni dans une tentative
de transcription de l’oralité, les romans antillais utilisent, contrairement au mythe de la lutte
oralité/écriture, une grande variété d’aspects de l’écriture, de l’oralité, du réalisme et du
mystique pour produire des œuvres qui, comme nous l’avons vu dans notre première partie,
seraient bien plus que la simple opposition du regard occidental et du regard antillais
traditionnel. Hypothétiquement, écriture et oralité fusionneraient donc pour produire et inspirer
des œuvres spécifiquement antillaises. Ainsi, comme le note Xavier Garnier par rapport à
l’apparition du roman en Afrique coloniale, le passage de l’oralité vers l’écrit ne serait non plus
l’imposition coloniale d’un système de représentation (l’écrit) par rapport à un autre (l’oral)

169
mais une réinvention littéraire, un nouveau mode d’expression, adapté à une situation
particulière :
Si le roman naît en Afrique sous la période coloniale, c’est peut-être parce qu’en imposant aux sociétés
africaines un ordre qui leur est étranger, la colonisation fait apparaître une dualité au sein même du vécu,
dualité qui pose la question du sens du monde. L’apparition du roman, comme forme écrite du récit de
fiction, est davantage la réinvention d’une forme adaptée à une situation nouvelle que l’importation pure et
simple d’un genre littéraire (Garnier, 1999 : 4).
Adaptant cette réflexion aux Antilles, il apparaîtra alors qu’il n’y a pas eu de rupture véritable
ou de disparition de l’oralité suivie d’une apparition du roman sans lien de continuité apparent
entre les deux. Au contraire, lors du passage de l’oralité à l’écrit il y aurait eu, après les
premières impositions coloniales, un principe d’adaptation qui permettrait, dans les romans
antillais, une réinvention de l’oralité par l’écriture. Les auteurs antillais sont obligés d’utiliser
l’écriture malgré ses dangers potentiels, mais ils ne devraient jamais totalement se détacher de
l’oralité « car la seule manière selon [lui] de garder fonction à l’écriture (s’il y a lieu de le faire)
[…] serait de l’irriguer aux sources de l’oral. Si l’écriture ne se préserve désormais des
tentations transcendantales, par exemple en s’inspirant des pratiques orales et en les théorisant
s’il le faut, je pense qu’elle disparaîtra comme nécessité culturelle des sociétés à venir »
(Glissant, 2002 : 331). Plutôt que d’être indépendante, l’écriture se laisserait donc influencer par
l’oralité et c’est cette fusion des opposés qui permettrait aux deux de se réinventer, en particulier
par ce mode d’écriture que certains appellent l’oraliture et qui pourrait bien jouer un rôle crucial
dans la réinvention de l’oralité dans la littérature antillaise.

170
2 De l’oralité vers l’écrit : la nouvelle littérature antillaise
2.1 Quelques nuances sur l’impossible transition de l’oral vers l’écrit
Tout n’est donc pas si extrême dans cette séparation entre l’écriture et l’oralité. En effet
l’écriture a beau, aux Antilles, séparer symboliquement deux façons de penser et de représenter
le monde, aucun des deux modèles ne pourra cependant devenir le modèle unique. Comme en
témoignent les romans antillais, l’oralité semble toujours présente à un degré ou à un autre si
bien que ces œuvres font partie d’un fait culturel contemporain et universel : « today primary
oral culture in the strict sense hardly exists, since every culture knows of writing and has some
experience of its effects. Still, to varying degrees, many cultures and subcultures, even in a high-
technology ambiance, preserve much of the mind-set of primary orality » (Ong, 2002: 11). Cette
constatation est importante pour notre étude car elle démontre que, bien que les auteurs antillais
soient en rapport constant avec leur passé et leurs origines dans leurs romans, et bien qu’ils
cherchent toujours à rappeler ce passé dans leurs œuvres, ils ne cherchent pas à imiter les
conteurs d’antan ou les écrivains de Métropole mais cherchent leur propre voix. Il est donc
possible que les mythes et littératures puissent fonctionner ensemble, l’écrit se montrant ainsi
plus comme un support différent de l’oralité:
Dans la plupart des civilisations, le mythe est étroitement lié à l’émergence d’une littérature vernaculaire.
Les premiers textes littéraires sont souvent la transposition écrite et édulcorée de traditions mythiques
orales. Toutefois, si le mythe entre toujours dans la littérature, la littérature ne se réduit jamais au mythe
qu’elle peut véhiculer, pas plus d’ailleurs que le mythe ne se réduit à la littérature. (Walter, 2005 : 263)
Parler d’une opposition binaire oralité/écriture dans la culture antillaise contemporaine serait
une erreur, puisque les deux méthodes narratives peuvent s’interpénétrer. De ce fait, nous
pourrions envisager l’hypothèse suivante: issus d’une culture mixte, utilisant des éléments de
l’oralité au milieu de textes écrits, les romans antillais se placeraient à l’intersection de l’écriture

171
et de l’oralité, de deux modes de représentation du réel que la tradition associe généralement à
une opposition coloniale entre les maîtres, occidentaux et dominateurs, et leurs esclaves de
descendance africaine.
Cependant, quoique certains pensent que l’écrit tue l’oralité ou que d’autres pensent que
le transfert se fait sans problème, il est évident que le passage de l’oralité à l’écrit engendre un
certain nombre de changements (apports ou pertes) par rapport aux récits originaux, même si les
positions des chercheurs sont, à ce sujet, variables. Certains insistent ainsi sur le fait que la
vérité première du mythe tient à son oralité, à sa gestuelle et à son contact au public et que sa
fixation par l’écrit serait une forme de perte ou une « trace universalisante du Même, là où l’oral
serait le geste organisé du Divers » (Glissant, 2002 : 330-331). D’autres, au contraire, n’en
restent pas à une simple dichotomie et se demandent si, en fin de compte, le passage de l’oral à
l’écrit ne serait pas une évolution naturelle, « l’occasion d’une autre forme de poïétique
mythique, prolongeant la créativité spontanée de l’oralité » (Wunenburger, 1994 : 12). Ainsi,
contrairement aux théories sur la mort du mythe et de l’oralité, nous pourrions également voir
dans cette transition, une transformation de l’oralité (et donc du mythe) qui, au-delà de la simple
retranscription de contes, lui permettrait de survivre. Mieux, la forme écrite permettrait
également aux mythes de ne plus dépendre uniquement de l’oral, mais de s’adapter à toutes
sortes de formes littéraires pour finir par s’y fondre: « hébergé par la littérature, le mythe peut
s’adapter à toutes les formes de l’expression littéraire (théâtre, poésie ou roman). Il se fond alors
dans le texte littéraire au point de ne plus être clairement discernable » (Walter, 2005b : 263).
Cette notion ouvre une nouvelle piste pour notre étude des mythes car s’ils se fondent dans les
romans, cela pourrait expliquer pourquoi, contrairement aux contes nommés par les personnages
ou cités sous forme fragmentaire, ils semblent absents des romans. Comme nous allons le voir
dans la suite de cette étude, les romans ne sont en effet pas, comme Les Maîtres de la parole de

172
Confiant, des transcriptions littérales de contes, et le transfert vers l’écrit et les romans du mythe
traditionnellement oral et sacré ne pose plus autant de problèmes que les auteurs ont pu le laisser
croire dans leurs essais.
2.2 S’adapter et accepter le changement
Comme nous l’avons dit, l’oralité et les contes originels étaient des marques identitaires
essentielles du temps de l’esclavage puisqu’ils ont permis aux esclaves de survivre aux
acculturations et autres souffrances qui leur étaient infligées. Incapables de prendre le relais du
conteur et se réfugiant dans les « certitudes de l’écriture » qui étaient les symboles du maître, les
premiers écrivains antillais ont été obligés d’utiliser cette écriture dominante et de reprendre
certains modèles littéraires occidentaux. D’une certaine manière, il semble que, tout comme
l’émergence du conteur antillais a été nécessaire et essentielle à l’époque de l’esclavage, le
passage de l’oralité à l’écriture ait été, lui aussi, nécessaire pour les premiers écrivains (au moins
jusqu’à la départementalisation et les années 50 et 60). On peut en effet supposer qu’elle a eu
pour ces auteurs « passés » une importance bien spécifique, en rapport direct avec leur époque et
leurs besoins. C’est ainsi que, si l’oralité et l’écriture, issus d’époques et de besoins différents,
ne semblent pas directement applicables aux littératures antillaises d’après la
départementalisation, on peut remarquer que c’est leur fusion qui répond aux besoins des
auteurs contemporains. En effet, face à l’omniprésence de l’écrit et du français comme langue
d’écriture dans les Antilles d’aujourd’hui les auteurs/conteurs antillais utilisent un système
littéraire spécifique pour exprimer leur identité : non pas les récits oraux traditionnels, ni des
romans inspirés de mouvements littéraires occidentaux, mais des romans dans lesquels on
retrouve une forte présence de l’oralité sous forme écrite. Alors que les premiers écrivains
antillais n’ont pas pu prendre le relais du conteur et se sont essentiellement concentrés sur

173
l’écriture de romans inspirés des productions littéraires européennes, nous pourrions supposer
que les auteurs contemporains – qui utilisent l’oralité en plus de l’écriture – ont tenté de prendre
un double relais : celui du conteur originel et celui de la première littérature antillaise. Comme
nous allons essayer de le démontrer dans les prochaines pages de cette étude, la culture
occidentale s’est toujours imposée en maître, mais les écrivains antillais contemporains –
devenus français, opposés aux doudouistes et respectant l’importance culturelle de l’oralité –
auraient donc, à leur façon, continué dans leurs romans la lutte contre le totalitarisme intellectuel
et l’acculturation identitaire en maniant dans leurs romans deux héritages distincts : « deux
langues m’avaient été données, comme m’avaient été données la parole du Conteur et son
oraliture, la littérature et ses siècles d’écriture » (Chamoiseau, 2002 : 282). Contrairement à
leurs prédécesseurs – les conteurs nés de l’oppression esclavagiste et les écrivains ayant connu
la fin de l’esclavage et la forte influence littéraire de la Métropole – les auteurs antillais
contemporains utiliseraient comme outils de leur propre préservation et de leur lutte identitaire
les différentes caractéristiques de l’oralité des conteurs ainsi que l’écriture des écrivains
« occidentalisés ». Ces éléments ont ainsi permis à l’oralité de ne pas disparaître mais, au
contraire, de se transformer et de se diffuser par de nouveaux moyens: « l’oral, l’oraliture sont
là, dans le monde et en moi, et leur génie retrouve d’inattendus éveils dans les nouveaux
médias » (Chamoiseau, 2002 : 197).
2.3 L’oraliture et la littérature antillaise contemporaine
Des récits de voyages aux écrivains doudous, des influences culturelles françaises aux
stéréotypes coloniaux, le vécu antillais et sa représentation écrite sont longtemps restés
problématiques. Ce n’est qu’à une période récente et grâce à une série d’œuvres faisant partie de
ce que Chamoiseau et Confiant appellent la « nouvelle tracée des lettres créoles » (Chamoiseau,

174
Confiant, 1999 : 117) que serait apparue une écriture, et donc une littérature, plus typiquement
antillaise. Selon les auteurs de la Créolité, cette « nouvelle tracée » serait apparue à travers deux
ouvrages particuliers : d’abord en 1925 avec Ainsi parla l’oncle de Jean Price-Mars, un ouvrage
analysant toutes les composantes de la réalité haïtienne et qui a marqué le début de
l'appropriation de l'imaginaire populaire par les écrivains haïtiens, puis en 1939 avec la
publication de l’œuvre poétique d’Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal qui, avec ses
prises de conscience identitaires et ses réflexions sur la condition des Noirs, a participé à la
naissance du mouvement de la Négritude. Cette « nouvelle tracée », en s’éloignant
progressivement des écrivains maniant exotisme et stéréotypes coloniaux, se serait développée à
partir de ces deux ouvrages jusqu’à la « naissance », pendant l’entre-deux guerres, du roman
créole francophone contemporain dans lesquels des auteurs comme Raphaël Tardon, Joseph
Zobel, Jacques Roumain et Jacques-Stephen Alexis, ont commencé à valoriser et à défendre les
apports africains et « créole nègre » à la culture caribéenne. Si ces auteurs ont ouvert la voie à la
littérature antillaise d’aujourd’hui, tous n’ont pas suivi le même chemin, certains préférant une
voie plus résolument moderne, notamment dans l’utilisation des contes. Dans son article « Un
Avatar du conte guadeloupéen : le récit de type nouveau », Ina Césaire fait référence à un
groupe d’intellectuels guadeloupéens qui aurait tenté, dans les années 70, de « vilipender l’une
des expressions les plus anciennes de la littérature orale antillaise : le conte traditionnel »
(Césaire, 1987 : 97). En oubliant que le conte est avant tout une création esthétique et que son
origine est culturellement symbolique de la lutte contre l’acculturation, cette représentation
n’aurait pas permis à ce type de récit de survivre: « incapables de déchiffrer la symbolique
propre au conte antillais, les tenants du Récit de Type Nouveau l’en avait cru dépourvu »
(Idem.). Cette tentative de modernisation est tombée dans l’oubli, alors que le conte traditionnel
a continué à s’enrichir et à se diversifier, comme en témoignent les romans de notre corpus,

175
restés plus proches de la tradition par leur utilisation de diverses formes de l’oralité et
d’éléments issus du folklore local.
Plutôt que d’être perçue comme une trahison ou une fixation sur le passé, cette
utilisation des formes de l’oralité dans l’écriture est donc très présente dans les études littéraires.
Cette forme fusionnelle entre ces deux modes d’expression que l’on appelle généralement
« l’oraliture » (terme forgé par Ernst Mirville dans les années 1970) traduit très bien, selon
Maximilien Laroche, « un parallélisme de la littérature et de ce qu’on appelait ‘littérature
orale2’ » (Laroche, 1991 : 15). L’oraliture se définirait comme le produit du passage de l’oralité
à l’écriture, puis de l’écriture à la littérature. Reportant dans la langue écrite le principe de la
« double scène de la représentation haïtienne » (phénomène étudié par Laroche qui divise
l’identité haïtienne entre la communauté dans son pays d’origine et la diaspora née de l’exil et
de l’immigration), l’oraliture présenterait elle aussi une dualité entre l’écrit et l’oral3, ce qui,
dans les romans, crée également une « double scène de la représentation écrite» (Laroche,
1991 : 20) entre deux espaces, deux modèles (pour simplifier : le modèle Caribéen et le modèle
Occidental) qui, tout en s’opposant, seraient pourtant au cœur de l’identité antillaise. Cette
opposition culturelle binaire, peut paraître simpliste quand on prend en considération la grande
variété de cultures qui ont fondé les Antilles, mais elle se base sur les deux cultures
« fondatrices », celles qui ont eu les plus fortes influences culturelles. Optant pour « la voie du
milieu » dans laquelle fusionnent deux modes d’expression successifs de la culture antillaise,
l’oraliture permettrait donc aux auteurs antillais de ne plus avoir à choisir entre une littérature
2 Néologisme servant à distinguer ce type d’écriture de la littérature pure et de la « littérature orale » qui, au sens ethnologique du terme, désigne « African epics; tales told by griots (African storytellers); sayings; proverbs; riddles; songs; and religious, medical, technical, and artistic knowledge transmitted orally, often in an anonymous way, from generation to generation » (Praeger, 2003: 96-97). 3 Prenant aussi en compte, dans certains, la dualité langue créole/langue française, que nous n’étudierons pas ici.

176
proche de celle des doudouistes qui avaient pour unique modèle et inspiration la littérature
française et une autre qui, entièrement créole et ne disposant que de peu de références littéraires,
devait chercher ses points de référence dans l’oralité.
Phénomène contemporain, applicable aux littératures utilisant les formes de l’oralité
dans leurs textes, l’oraliture ne devrait pas être perçue comme une contamination culturelle ou
une acculturation. Au contraire, comme le propose Laroche, ce type de passage d’une tradition à
une forme « autre », plus moderne, devrait plutôt être perçu comme une évolution culturelle et
identitaire :
Il faut s’apercevoir que passant de l’oral à l’écrit, si tant est qu’il s’agit là simplement d’une évolution
technologique des moyens d’expression et de communication, on passe d’une tradition à une modernité et
à une postmodernité dont les caractéristiques sont moins d’être des progrès absolus que des combinaisons
ou plutôt des réorganisations de plus en plus efficaces de l’utilisation de la voix et de l’écriture, de l’oralité
et de la littéralité (Laroche, 1991 : 18).
Plutôt que de se montrer incapable de représenter un système d’oralité disparue, cette écriture de
l’oralité – l’oraliture – proposerait en fait une synthèse culturelle de la situation paradoxale des
Caraïbes d’aujourd’hui, prise entre deux mondes et deux représentations. De ce fait, toujours
selon Laroche et les auteurs de la Créolité, l’oraliture proposerait à la littérature antillaise une
(re)définition et une (ré)affirmation modernes de son identité, tout comme le conte le faisait à
l’époque révolue de l’esclavage en servant d’exutoire aux esclaves et en fonctionnant comme
une réécriture à contre-courant de leur expérience: « L’Histoire est réécrite afin de permettre à
‘‘Compère Lapin’’ de vaincre les puissants (représentés par le roi en général), qui trouvent en

177
lui un maître de la ruse » (Schon, 2003 : 45)4. L’oralité originelle des contes a donc pris, du
temps de la plantation, l’apparence d’un type de « littérature » qui, tout en exprimant des
interdits et certains fantasmes vis-à-vis de la situation de l’esclavage, a surtout pris valeur de
lutte, d’outil de rébellion et d’affirmation identitaire. Par ses aspects spécifiques, il peut donc
sembler logique que, ancré dans une période historique précise, ce conte ne s’applique plus à la
société antillaise d’aujourd’hui de la même manière qu’il s’appliquait à la société l’esclavagiste.
Peut-être pourrions-nous trouver son équivalent moderne dans les textes utilisant l’oraliture, ce
phénomène littéraire contemporain, qui se réclame des mêmes origines ?
L’oraliture créole naît dans le système des plantations, tout à la fois dans et contre l’esclavage, dans une
dynamique questionnante qui accepte et refuse. Elle semble être l’esthétique (dépassant ainsi l’oralité,
simple parole ordinaire) du choc de nos consciences encore éparses et d’un monde habitationnaire où il
fallait survivre (résister-exister pour les uns, dominer pour les autres). Cette oraliture va s’affronter aux
« valeurs » du système colonial (fardeau de la civilisation, légitimation de l’extinction du Caraïbe, de la
condition du Nègre esclave, pensée de l’Un…), et diffuser souterrainement de multiples contre-valeurs,
une contre-culture (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 473).
Figure de transfert, l’oraliture pourrait donc être théoriquement perçue, dans les romans
contemporains, comme une forme de contre-culture héritière de ces contes antillais d’origine, en
lutte contre les influences françaises et les multiples acculturations dont souffrent encore
aujourd’hui les sociétés antillaises. Ainsi, semble-t-il, l’oraliture tente de faire disparaître la
dualité traditionnelle oral/écrit, tout en se basant sur elle afin de contrecarrer les spécificités
occidentales de l’écriture pour contribuer à la production d’une littérature authentiquement
4 Cet aspect des contes est essentiel à plus d’un titre car, tout en proposant une réécriture de l’histoire, ces contes antillais allaient même jusqu’à s’opposer aux règles littéraires du conte occidental. En effet, si dans les contes occidentaux les héros sont des vertueux qui finissent toujours par vaincre, ce n’est pas le cas en Martinique et en Guadeloupe où « les contes créoles a-moraux dominent le champ littéraire populaire » (Schon, 2003 : 46) et dans lesquels les héros doivent employer une ruse souvent amorale pour vaincre.

178
antillaise. Son utilisation ne serait donc pas à percevoir comme une défaite, une impossibilité de
transcrire l’oralité, comme s’en désolent les auteurs antillais. Sans chercher à la remplacer,
l’oraliture contemporaine réinvente une oralité qui lui est traditionnellement opposée pour
l’intégrer à sa propre structure et ainsi proposer non pas une imitation de l’oralité mais un type
nouveau d’écriture. Au-delà de ces aspects stylistiques, pourrait-on donc supposer que
l’oraliture, dans son utilisation du réalisme mystique serait un instrument permettant aux auteurs
antillais de proposer une redéfinition de leur identité ? Afin de répondre à ces questions, il nous
faudra étudier plus en profondeur la nature de l’oralité et ses manifestations dans les romans.
3 Le roman comme manifestation écrite de la parole
3.1 Le roman antillais comme « récit »
Nous concentrant sur la notion d’oralité et d’écriture, le premier élément essentiel
rapprochant l’oralité des contes des romans antillais de notre corpus que nous allons ici noter est
le suivant : les romans antillais ont beau être des textes écrits, ils n’en restent pas moins des
récits. Par récit nous entendons, selon la définition généralement acceptée, la relation écrite ou
orale de faits qui, vrais ou imaginaires, appartiennent à la fiction romanesque. Un simple regard
sur les textes de notre corpus confirme en effet que la quasi-totalité des romans réalistes
mystiques/merveilleux sont en fait des histoires racontées par des narrateurs ou des personnages.
Ceux-ci peuvent être en contact direct avec l’intrigue et les événements, comme on le voit par
exemple avec Moi, Tituba…: « Voilà l’histoire de ma vie. Amère. Si amère » (Condé, 2004 :
267). Nous avons un autre exemple dans Solibo Magnifique, dans lequel le narrateur se confond
avec l’auteur, puisqu’ils se nomment tous les deux Patrick Chamoiseau : « cette récolte du
destin que je vais vous conter eut lieu à une date sans importance puisque ici le temps ne signale

179
aucun calendrier » (Chamoiseau, 2005b : 25). Ces narrateurs peuvent également ne pas faire
directement partie de l’histoire et leur identité peut demeurer plus vague, comme dans Ti Jean
l’Horizon, « L’île où se déroule cette histoire n’est pas très connue » (Schwarz-Bart : 1998 : 11)
ou encore dans L’Esclave vieil homme et le molosse : « au démarrage de cette histoire, chacun
sait que cet esclave vieil homme va bientôt mourir » (Chamoiseau, 2005a : 18). Parfois, le
narrateur peut également retracer sa propre expérience et rapporter celle des autres, comme le
fait la narratrice dans La Grande Drive des esprits qui souligne les rencontres qui l’ont poussée
à écrire : « 1960. J’étais une jeunesse de dix-sept ans en ce temps-là. Un frais baccalauréat
placardé sur mon front. […] Je promenais mon oisiveté dans toute la Guadeloupe, un appareil
photo Rolex en bandoulière – récompense pour mes lauriers – et, au fond de l’esprit, un vaste
projet d’album inédit sur les cases créoles » (Pineau, 1999 : 43). La présence de narrateurs
racontant directement leurs histoires sous forme de récits est un des facteurs les plus significatifs
de la présence de l’oralité dans les romans. C’est par cet aspect que les écrivains, par le biais de
leur narrateur, prennent une fonction assez proche de celle des conteurs d’antan, comme le note
par exemple Lewis Seifert par rapport aux œuvres de Patrick Chamoiseau :
In keeping with the persona of the Creole conteur (storyteller), Chamoiseau’s narrator also reproduces
many features of oral storytelling, such as call and response (“cric . . . crac”), formulaic introductions and
conclusions, parenthetical self-reference, enumerations, and onomatopœia (among others). At the same
time, Chamoiseau’s storyteller proves to be conversant with the techniques associated especially with
writing, including syntactically complex structures, literary figures, omniscient interiority, and “round”
characterization. (Seifert, 2002 : 214-215)
Dans le même ordre d’idées, le roman La Grande Drive des esprits de Gisèle Pineau est un autre
exemple de l’influence de l’oralité sur les romans puisque, au-delà de l’acte de raconter, on y
trouve divers éléments typiques de l’oralité romanesque, comme par exemple l’expression de
certains sentiments transmis par la narratrice tout au long de la narration : «Voyez ! Je tremble

180
encore à la seule évocation de ce jour imbécile » (Pineau, 1999 : 180). Cette narratrice va même
parfois jusqu’à interpeller directement ses lecteurs : « J’ai pleuré une petite fois quand il m’a
dit… Mais ça ne vous regarde pas ! » (Pineau, 1999 : 184). Il y a donc, comme on le voit, une
forme de communication entre les narrateurs de certains romans antillais et leurs lecteurs et ce
même si, comme nous l’avons déjà envisagé, la nature écrite de ces œuvres fige le rapport initial
traditionnel et empêche un type de communication que l’on retrouverait dans les contes oraux
dans lesquels le public peut intervenir et répondre directement aux conteurs. De même, la nature
écrite de ces récits aura ses propres caractéristiques essentielles puisque, dans les romans, les
mots impliquent un sens et une symbolique littéraire que l’on ne trouve pas dans les contes, dans
lesquels la parole est, au contraire, « toujours employée […] pour les jeux, les acrobaties et les
feintes (passaj) que les mots permettent entre eux. C’est en cela seulement que le conte peut être
‘‘communion’’ et ‘‘appeler par sa convention la collaboration et la participation de tous’’ »
(Affergan, 1983 : 33). Indépendamment, l’oralité permet une communion et un jeu sur les mots
et la parole, alors que l’écriture et la lecture ne permettent pas la création d’un lien
communautaire typiquement associé à l’oralité classique. L’oraliture, au contraire, permettrait
par sa forme écrite de donner aux récits un sens et un symbolisme. Comme le propose Alexie
Tcheuyap, les marques essentielles du conte, comme le fameux « Yé cric ! Yé crac ! » (Pépin,
2005 : 188) que l’on trouve par exemple à la dernière ligne de L’Homme-au-Bâton, ne
contribueraient plus, dans les romans, au sens communautaire originel bien que, dans ses
dernières lignes, il se rapproche du conte traditionnel. En effet, sauf pour les adresses au lecteur
ou pour sa valeur ethnographique et réaliste, on ne peut s’attendre à ce qu’une phrase
spécifiquement utilisée par rapport à un public dans un contexte oral ait une fonction identique
dans un roman. De même le « ô amis » des premières lignes du roman Solibo Magnifique n’a
plus sa fonction originelle d’adresse au public, mais présente tout simplement aux lecteurs un
certain nombre d’attentes plus ou moins symboliques : « In fact, the use of incipits by the Creole

181
tale teller has the function of programming, of thematic and narrative preparation » (Tcheuyap,
2001: 46). Ainsi, malgré un but principal identique, celui de raconter une histoire, romans et
contes auraient deux manières très différentes de le faire. Si les objectifs de ces récits sont
différents, nous pourrions nous demander comment leurs formes, qui s’inspirent essentiellement
d’un même principe, l’oralité, parviennent cependant à se combiner malgré leurs différences.
3.2 Les marques du conte et de l’oralité dans les romans
La classification des contes, créoles ou non, pose toujours problème et les multiples
études semblent le prouver. Certains chercheurs comme Anca Bertrand, par exemple, groupent
les récits antillais en trois classes, les récits fantastiques, les récits d’animaux et les récits de la
vie quotidienne, alors que d’autres, comme Joëlle Laurent et Ina Césaire, ont proposé, de leur
côté, d’utiliser une classification par sujet, ce qui les a conduits à une classification en cinq
catégories : contes sorciers, contes érotiques, contes d’animaux, contes humoristiques et geste
de Ti-Jean. Ces deux perceptions et approches des récits posent un certain problème puisque
aucune théorie ne semble prendre le dessus sur les autres. De plus, il est tout aussi difficile de
donner une définition exacte et rigoureuse de ces contes qui, comme nous l’avons vu dans notre
introduction, peuvent tendre vers la légende, le mythe ou encore la fable, tout en oscillant aussi,
alternativement, entre la réalité historique, le merveilleux ou le mythe. Bref, la classification des
mythes antillais, tels qu’ils apparaissent dans les romans et dans la culture antillaise, serait une
entreprise complexe et probablement non définitive qu’il serait difficile d’aborder ici.
Cependant, si les personnages des romans de notre corpus mentionnent souvent les contes et
n’hésitent pas à en raconter, on pourra se demander si les romans eux-mêmes sont influencés par
leur forme. Ainsi, si l’écrivain n’est pas exactement l’héritier du conteur mais a pris sa place de
« raconteur », peut-on dire que les romans antillais se rapprochent des contes de par leurs

182
valeurs symboliques et culturelles, ainsi que par leurs références aux mythes et au folklore ?
Comme nous l’avons déjà envisagé, ce rapprochement du conte et du roman est à première vue
problématique : le conte est une œuvre orale, plutôt courte, qui s’organise autour d’une morale,
d’un certain didactisme plus ou moins explicite alors que le roman est, au contraire, une forme
littéraire écrite, plus longue mais aussi plus vaste, dans laquelle on retrouve divers modes
d’écriture, dont le conte lui-même. À première vue, il peut sembler naturel de penser que si les
auteurs antillais s’inspirent des contes oraux créoles pour écrire leurs romans, ce serait avant
tout une tentative pour eux de retrouver ou de reprendre contact par l’écrit avec l’esprit des
contes oraux traditionnels. Ils reproduiraient ainsi cette oralité par le récit et en transmettant au
lecteur la voix du conteur par l’intermédiaire du narrateur du texte écrit.
Romans et contes auraient ainsi, malgré les différences essentielles dans leurs natures et
dans leurs contextes d’énonciation, certains points communs. Comme le précise par exemple
Rolande Honorien-Rostal dans le contexte caribéen, le terme kont est, malgré son homophonie
avec le « conte », très différent de ce dernier puisqu’il « signifie dans son acception la plus
large, récit, narration. C’est un synonyme de istwa (histoire) » (Honorien-Rostal, 2002 : 17).
Ainsi, il semblerait que ce terme se réfère non pas à un type de récit extrêmement précis mais,
de manière générale, à tous les genres oraux à caractère fictif. Du coup, le rapprochement de
deux éléments apparemment différents – le conte antillais et le roman – ne semble plus aussi
aberrant si le point le plus important d’un kont (le récit, la narration ou l’histoire) se rapproche
de celui de la fiction romanesque, qui est précisément de raconter une histoire. Ce
rapprochement est encore plus évident si, comme le propose encore Rolande Honorien-Rostal,
les frontières entre le conte et le roman sont perméables :
C’est ainsi que le conte envahit le champ du roman. La problématique à laquelle sont confrontés les
conteurs, se répercute dans l’écriture du roman. Le conte contamine le champ du roman. La construction

183
du personnage est infléchie par la figure du conteur. Le rythme, la thématique, la poétique et l’esthétique
du conte imprègnent le roman. (Honorien-Rostal, 2002 : 48)
Il y aurait donc, entre ces deux modes de représentation, une forme de contamination qui
expliquerait que l’on retrouve de nombreux aspects du conte dans les romans. Des aspects qui,
par le phénomène de l’oraliture, pourraient « survivre » à leur extraction de l’oralité et
pourraient coexister au sein d’un type de récit aussi structurellement différent que l’écrit. Il
arrive même qu’un roman se montre particulièrement fidèle à l’ « oralité créole » et aux contes,
allant jusqu’à s’inspirer de leur structure. Comme le démontre par exemple Maximilien Laroche
en analysant Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau, il ne suffit plus d’utiliser la formule
« Yé cric ? Yé crac! » pour en reproduire l’effet dans un roman puisque celui-ci a ses propres
moyens d’expression:
The Caribbean tale begins by asking the question ”Krik?” and concludes in the same way only after a
sudden movement to and fro between “over there” where the storyteller was kicked and “here” where he
speaks. The imaginary trajectory, the fictional journey of the storyteller’s discourse is that of a toing and
froing from here to over there then back to here. It is a circular course that brings us back to the point of
departure only after an inventory, an inquiry leading to a discovery, and the cleaning up of a mystery. This
is precisely what happens at the end of Solibo magnifique when the narrator returns to the police station
where it all began (Laroche, 1994: 346).
Nous voyons ainsi que le roman antillais se rapproche des contes par toute une série de petits
procédés textuels, structurels et narratifs et que, comme le conte traditionnel, le roman antillais
«ne recule pas devant des procédés qui dramatisent l’action ou la ritualisent : d’où l’usage des
répétitions et des hyperboles » (Toureh, 1986 : 218). On y trouve par exemple l’utilisation de
majuscules qui donnent une certaine force à des mots comme « la Bête » (Schwarz-Bart, 1998 :
89) dans Ti Jean l’Horizon, « le Maître-béké » (Chamoiseau, 2005a : 27) ou « l’Habitation »
(Ibid. 19) dans les romans de Patrick Chamoiseau, ou encore l’utilisation de répétitions

184
cycliques comme le « on pendit ma mère » (Condé, 2004 : 20) que l’on retrouve dans le roman
Moi, Tituba sorcière noire de Salem de Maryse Condé. C’est là une série d’éléments qui, dans le
roman, permettent de souligner une action ou d’insister sur des phénomènes particulièrement
importants, comme les interrogations et les exclamations, omniprésentes dans les romans, ou
encore les sous-entendus des trois points qui terminent la plupart des paragraphes dans Ti Jean
l’Horizon de Simone Schwarz-Bart.
3.3 Le narrateur, le lecteur et l’oralité
Contrairement au réalisme des romans occidentaux dans lesquels, nous l’avons vu dans
notre premier chapitre, le narrateur est invisible ou discret, nous remarquons que, dans la plupart
des romans antillais de notre corpus, nous retrouvons un narrateur/conteur qui, tout en
s’adressant à son public/lecteur, fait basculer le roman traditionnel vers le récit et vers une
certaine interactivité. Plutôt que de juste raconter des histoires, les narrateurs s’y investissent
directement et, par ce va et vient, parviennent à créer un lien direct entre eux-mêmes, le lecteur
et le monde antillais. On le voit par exemple dans Chronique des sept misères de Patrick
Chamoiseau dans lequel le conteur raconte une histoire au public présent et aux lecteurs, une
histoire dont, en tant que djobeur, il fait partie : « Messieurs et dames de la compagnie, les trois
marchés de Fort-de-France (viandes, poissons, légumes) étaient, pour nous djobeurs, les champs
de l’existence » (Chamoiseau, 2004 :15). On retrouve également ce phénomène avec le
narrateur de Solibo Magnifique qui s’adresse aux lecteurs et à son personnage principal ou avec
Tituba qui, décédée à la fin du roman de sa vie, ne peut logiquement s’adresser qu’au lecteur
lui-même, « mon histoire véritable commence où celle-là finit et n’aura pas de fin » (Condé,
2004 : 267). Tout en figeant la parole de Tituba et en lui permettant de se répéter à chaque
lecture, l’écriture offre alors au personnage une histoire sans fin très proche de sa propre

185
condition d’esprit immortel. Les réflexions directes de la narratrice de La Grande Drive des
esprits au lecteur créent même, parfois, des paradoxes intéressants dans le roman. Jouant le ton
de la confidence quand elle raconte l’histoire de Célestina, elle demande au lecteur de ne pas la
divulguer… bien que cette histoire soit publiée dans un roman et sera donc révélée autant de fois
qu’il sera lu: « Ce que je vais présentement vous narrer doit, à jamais, rester enfoui dans un pli
de mémoire. Écoutez, mais ne rapportez point ! Domptez vos langues ! » (Pineau, 1999 : 161).
Par un jeu de narration, le roman ne prétend pas en être un, mais se voudrait plutôt comme une
confidence de la narratrice au lecteur. En produisant des narrateurs distincts et humains qui
s’adressent directement aux lecteurs, les auteurs antillais mettent ainsi en place, dans leurs
romans, un sentiment de confidence et d’intimité entre leurs personnages et leur public en
renforçant, par toutes sortes d’interpellations, l’implication des lecteurs dans l’histoire. Ces
intégrations au récit reproduisent ainsi, autant que le permettent les romans, un équivalent écrit
de la relation qui, dans les contes oraux, s’établit entre le conteur et son public.
Notons également que, en plus de s’adresser aux lecteurs, les romans les impliquent
parfois directement dans les récits et leur donnent également certaines responsabilités vis-à-vis
de leur perception de ces histoires qui ne sont pas toujours à prendre pour des vérités mais aussi,
parfois, comme un certain regard sur le monde. C’est le cas par exemple du roman La Traversée
de la mangrove de Maryse Condé, dans lequel, par la multiplicité des points de vue, Sancher et
ceux qui participent à sa veillée sont perçus différemment selon le regard qui les observe. Ce
procédé littéraire permet à leurs histoires personnelles et à leurs vies de demeurer opaques aux
yeux du lecteur, qui ne peut recueillir que des bribes de vérité parmi ces « diverses voix
narratives qui, chacune, donnent [sic] leur interprétation d’une même réalité » (De Souza, 2000 :
831). Cette notion rappelle un des principes essentiels des contes et de tout récit oral : le fait
qu’il n’existe pas une histoire fixe, mais plusieurs histoires dépendant de facteurs très variés.

186
C’est exactement ce que l’on trouve dans La Traversée de la mangrove dans lequel « chaque
personnage dit ici son histoire, et aucun ne dit toute l’histoire » (Perret, 1992 : 200).
Contrairement aux romans « classiques » dans lesquels les faits sont généralement fixes, il y a
donc dans les récits antillais réalistes mystiques et leur jeu des perspectives, autant
d’explications qu’il y a de points de vue, comme l’illustre également Chronique des sept
misères de Patrick Chamoiseau : « vous en donner cette version nous a fait un peu de bien, si
vous venez demain vous en aurez une autre, plus optimiste peut-être, quelle importance ? »
(Chamoiseau, 2004 : 240). Ainsi, il semblerait que ce qui compte n’est pas la vérité que
contiennent les histoires, mais les histoires elles-mêmes, et l’utilisation que chacun en fait, un
phénomène que nous avons vu dans notre étude du réalisme mystique et la multiplicité des
regards que l’on y trouve et qui, refusant de se fixer, laissent aux lecteurs une libre interprétation
de leurs mystères.
Par leurs multiples incertitudes quant au réalisme et au surnaturel, par les voix et les
regards qui s’y écrivent, certains romans posent le problème de ce savoir oral qui, contrairement
au savoir écrit qui devrait être réaliste, vérifiable et figé, peut être manipulé à loisir et embelli
par les narrateurs et les personnages. On retrouve ce phénomène dans Les Derniers Rois Mages
dans lequel les «cahiers de Djéré » ont été écrits non pas selon les critères rigoureux de
l’écriture traditionnelle mais « en s’aidant de ses souvenirs réels et imaginaires et de ce que lui
avait appris Romulus » (Condé, 1992 : 82). Debbie, la femme de Spéro se raccroche ainsi à
l’histoire de l’ancêtre de Spéro pour compenser son absence d’histoire personnelle et d’origines
précises. Profitant de cet ancêtre inespéré – dont beaucoup doutent dans le roman –elle lui donne
un aspect très personnel:
Il n’y pouvait rien, si Debbie remplissait la tête de l’enfant avec ces histoires anciennes et qu’il fallait
oublier. Elle les embellissait à sa fantaisie. À l’entendre, le grand-père Djéré n’était plus un bâtard que

187
l’ancêtre avait laissé avec sa servante de mère comme un ballot de linge sale dans une villa d’un faubourg
de Fort-de-France, mais le fils d’une jeune demoiselle, fine fleur de la bourgeoisie martiniquaise qui
n’avait pas eu le cœur de quitter son papa, sa maman et son île. (Condé, 1992 : 34-35)
Ainsi, par leur nature réaliste mystique/merveilleuse, par leurs multiples interprétations, leurs
multiples regards, leur absence d’explications fixes et déterminées, les romans antillais
reprendraient certains aspects essentiels de l’oralité et des contes traditionnels, en proposant des
romans non pas figés, mais au contraire ouverts, divers, multipliant les regards, les explications
et les solutions. Ces romans ont ainsi beau être des œuvres écrites, ils n’en ont pas moins de
nombreux aspects de la liberté et de l’efflorescence de l’oralité. Principalement des récits
imprégnés de nombreuses marques du conte et de l’oralité, les romans antillais auraient un profil
bien spécifique fortement influencé par ces formes originelles et rebelles bien différentes des
traditionnelles rigidités de l’écrit et du réalisme historico ethnographique. Pris entre deux façons
de raconter des histoires et de voir le monde, pris entre deux extrêmes rassemblés par le ciment
de l’oraliture, les romans antillais présentent ainsi une façon très particulière de voir le monde,
loin de toute tradition orale ou écrite classique.
D’une représentation magique, sacrée et quasi mythique de l’oralité traditionnelle au
rejet de toute possibilité de transition vers la modernité, nous avons vu que les auteurs antillais
cherchent constamment à mettre en valeur leur passé ancestral et les premiers conteurs, ces
premiers artistes antillais luttant contre l’écriture coloniale et stérile. Rejetant cependant toute
possibilité de lien avec eux et rejetant toute possibilité de représenter l’oralité par l’écrit, ils se
heurtent cependant à leurs propres contradictions. En effet, si l’oralité et les contes étaient un
moyen de survie pour les premiers esclaves et si l’écriture était un moyen de survie
postcoloniale pour les premiers écrivains antillais, ces modèles ne pourront être reproduits à
l’identique par les auteurs contemporains. Ne luttant ni contre l’esclavage ni contre

188
l’acculturation française et la départementalisation, leurs objectifs d’écriture sont donc différents
de leurs modèles et c’est pour cette raison que leurs romans prennent une voie différente. Se
réclamant de cette double ascendance historique, les romans antillais contemporains sont ainsi
des œuvres écrites imprégnées par d’omniprésentes marques de l’oralité. Reprenant toutes sortes
de principes oraux et les intégrant dans leurs récits écrits, ils pratiquent une écriture de l’oralité,
ce que certains appellent l’oraliture et qui, en faisant fusionner deux types de narrations. Ainsi,
si les romans antillais contemporains se veulent modernes tout en s’inspirant de traditions sans
en dépendre complètement, nous pourrions nous demander quel est leur traitement des mythes,
ces histoires traditionnelles et ancestrales. Ces romans jugent-ils de l’imaginaire mythique
antillais en fonction d’une perte et d’une distance par rapport à des formes originelles qui,
comme les mythes d’origine, sont désormais perdues ? Ou, au contraire, s’intéressent-ils aux
adaptations et aux créations nouvelles de cet imaginaire ? C’est ce que nous allons voir dans
notre prochain chapitre, qui étudie comment l’oralité permet la mise en place, dans les romans,
de nouveaux mythes de l’oralité, non pas africains ou occidentaux, mais spécifiquement
antillais.

189
Chapitre 6 Le conteur et le marqueur de parole, la création d’un mythe
antillais
La notion de mythes comme des histoires « vraies », fondatrices et surtout servant de
modèle aux cultures qui se les transmettent posent certaines questions essentielles par rapport
aux romans réalistes mystiques de notre corpus. Les romans antillais que nous étudions
contiennent des contes oraux ou des fragments de ceux-ci et reprennent, dans leurs narrations,
de nombreuses formes de l’oralité par l’utilisation de l’oraliture, leur permettant de réconcilier
deux visages des Antilles. Ceci a permis aux auteurs de mettre en valeur dans leurs romans une
représentation de l’oralité originelle de manière mythique, en lui (re)créant une histoire
fondatrice et en lui opposant l’écriture. La forme des romans et leur utilisation de l’oraliture sont
directement influencées par cette oralité originelle, mais elles ont en retour influencé la
représentation de l’écrivain lui-même et de son rôle dans la société, différent, selon lui, du
conteur d’antan. Ainsi, ce qui nous intéresse à présent est la manière dont les auteurs mettent en
place, malgré leur rôle apparemment différent du conteur, des figures littéraires incarnant
certains aspects mythiques de l’identité antillaise. Analysant la figure du conteur antillais, nous
allons tenter de voir comment, par l’écriture romanesque et l’utilisation du symbolisme associé à
l’oralité originelle, celle-ci prend certaines caractéristiques mythiques pour devenir un mythe
antillais non pas originel comme les mythes traditionnels, mais entièrement créé et mis en valeur
par les romans. Tranchant avec celle de l’écrivain comme « marqueur de paroles » nous verrons
comment elle permet une illustration directe de cet autre mythe antillais produit par les romans

190
contemporains : celui de l’incapacité du romancier à reprendre le flambeau de son illustre
prédécesseur. Analysant la mise en place de cette dichotomie écrivain/conteur, nous tenterons de
voir comment ces « guerriers de l’imaginaire » contribuent à l’image de l’oraliture dans les
romans, en permettant à l’oralité de survivre et aux mythes de se voir non pas trahis, mais
transfigurés par l’écriture.
1 Le conteur : une figure essentielle de l’identité antillaise
1.1 Pouvoir de la parole, pouvoir magique : distinguer le conteur du quimboiseur
Entre conteur et quimboiseur, le statut de certains personnages romanesques antillais
reste parfois difficile à déterminer. En effet, si la nature des conteurs est de raconter des histoires
et des contes, c’est aussi une des fonctions des quimboiseurs qui, en plus de leur maîtrise de
l’oralité, ont également une profonde connaissance de la spiritualité et de la magie. Alors qu’un
personnage comme Solibo est bien défini par un statut unique, celui de conteur, d’autres
personnages comme Papa Longoué restent plus complexes puisqu’il raconte des histoires à
Mathieu tout en étant décrit comme quimboiseur : « Mais les yeux étaient insoutenables, d’avoir
repéré à la fois les subterfuges du présent et les lourds mystères d’antan. Quant à l’avenir, son
état de quimboiseur indiquait assez que papa Longoué en était le maître » (Glissant, 1997a : 16).
Il peut donc parfois être difficile de déterminer si conteurs et quimboiseurs sont des figures
distinctes ou, au contraire, des figures culturellement semblables. Cette absence de distinction
pourrait éventuellement venir des origines de l’esclavage aux Antilles, de la rupture originelle et
de l’acculturation puisqu’avec le transbord, les individus transbordés avaient perdu tout signe
distinctif de leur origine, toutes traces de leurs pouvoirs et de leurs influences sociales. A cela
s’ajoute le fait que le conteur antillais est, nous l’avons vu, né spécifiquement de l’esclavage si

191
bien qu’il n’est plus le descendant direct d’une figure africaine : «who appears on the plantation.
He is Creole and not African » (Seifert, 2002 : 217). Mais si cela décrit le conteur, qu’en est-il
de ces quimboiseurs? Les romans ne nous éclairent pas à ce sujet et se concentrent au contraire,
comme pour les conteurs, sur les origines antillaises des quimboiseurs et sur l’acculturation et le
traumatisme du transbord plutôt que sur leurs origines africaines. Ainsi, si l’on sait par exemple
que le premier Longoué, arrivé aux Antilles sur un navire négrier, avait une certaine
connaissance de la pharmacopée et si l’on connaît l’origine du conflit avec Béluse, son identité
d’avant le transbord reste difficile à déterminer, comme celle de Man Yaya dans Moi, Tituba…
dont on ne sait qu’une chose, qu’elle était « une Nago de la côte » (Condé, 2004 : 21). La notion
d’origine reste généralement vague et insaisissable : « the very notion of origin, whether
anthropological or territorial, like Derrida’s écriture, remains elusive and deferring » (Praeger,
2003 : 43). Par cette rupture, conteurs et quimboiseurs ne seraient donc pas le résultat du
transfert de figures africaines en terre caribéenne, mais bel et bien des figures « endémiques »,
spécifiques des Caraïbes et donc des Antilles.
Cependant, si l’on considère des personnages romanesques emblématiques comme
Wademba dans Ti Jean l’Horizon, Papa Longoué dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant,
ou Man Yaya dans Moi, Tituba…, nous avons un exemple frappant de la coïncidence des
caractéristiques du conteur et de celles du quimboiseur. D’après les études ethnographiques, on
pourrait même rapprocher ces deux types de personnages de l’image générale du chaman
traditionnel gardien de la littérature orale, des traditions et du langage:
Chez les Bouriates, les chamans sont les principaux gardiens de la riche littérature héroïque orale. Le
vocabulaire poétique d’un chaman yakoute comprend 12000 mots, alors que son langage usuel – le seul
que connaisse le reste de la communauté – n’en comporte que 4 000 (H.M. et N.K. Chadwick, The Growth
of Literature, III, p.199). Chez les Kazak-Kirghizes, le baqça, « chanteur poète, musicien, devin, prêtre et

192
médecin, parait être le gardien des traditions religieuses, populaires, le conservateur de légendes vieilles de
plusieurs siècles » (Eliade, 1983 : 41-42).
Ainsi, dans les romans comme dans les études ethnographiques, nous voyons que les
quimboiseurs/chamans et les conteurs ont tous une place de pouvoir et de respect dans la société
et que cette position est directement liée à leurs connaissances des mythes et de la parole. Le
pouvoir de la parole du conteur rejoignant le pouvoir effectif du quimboiseur, ceux-ci semblent
alors se confondre: « aujourd’hui encore, on […] confère [au conteur] un indicible pouvoir.
Dans les quartiers, il est souvent très proche du quimboiseur quand il n’est pas quimboiseur lui-
même » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 82). Mircea Eliade confirme cette proximité en
rappelant que les chamans sont, en effet, les « principaux gardiens de la riche littérature orale »
(Eliade, 2001a : 100). La comparaison ne s’arrête pas là et touche même la nature magique de la
parole du conteur. Selon la tradition, si le chaman peut, comme le quimboiseur, entrer en contact
avec le passé et les ancêtres et les mettre en contact avec les vivants, comme Man Yaya dans
Moi, Tituba…, Léonce dans La Grande Drive des esprits ou encore Ti Jean et Wademba dans Ti
Jean l’Horizon, le conteur a, dans les romans antillais, une capacité semblable, celle de faire
vivre le passé et les ancêtres par sa parole. Transmetteurs et témoins de la souffrance, les
conteurs donnent, comme le chaman, une voix aux esprits oubliés tout en guérissant ceux qui
viennent les rencontrer :
La gorge resserrée sur quelques impossibles, sans participer aux appels du Conteur, il lui lance sa présence
comme une main silencieuse. Il lui offre son esprit, des spectres de souvenances, des douleurs
prophétiques qui chatoient dans chaque bout de sa chair ; sa chair, cette virulence maintenue inerte à
laquelle le Conteur sait toujours s’abreuver. (Chamoiseau, 2005a : 49).
Cette fonction du conteur/quimboiseur est également présente chez le chaman tel que le décrit
Eliade : « comme le malade, l’homme religieux est projeté à un niveau vital qui lui révèle les

193
données fondamentales de l’existence humaine, c’est-à-dire la solitude, la précarité, l’hostilité
du monde environnant » (Eliade, 1983 : 39) et qui permet, elle aussi, de soulager et guérir par la
force des mots.
Malgré ces ressemblances il y a cependant un aspect essentiel qui différencie le conteur
et le quimboiseur et sur lequel nous reviendrons: la différence entre la création d’histoires et la
répétition/reproduction de mythes et d’histoires préexistantes. En effet, comme le note Eliade,
« ce ne sont pas les chamans qui ont créé, tout seuls, la cosmologie, la mythologie et la
théologie de leurs tribus respectives ; ils n’ont fait que l’intérioriser, l’ ‘‘expérimenter’’ et
l’utiliser comme itinéraire de leurs voyages extatiques » (Eliade, 1983 : 216). Ainsi, comme le
chaman, le quimboiseur n’aurait pas un rôle direct dans la création des mythes et des
cosmologies, et il apparaîtrait que son rôle soit en fait plus clairement spirituel et mystique. En
cela, il se différencie du conteur qui, lui, serait plutôt un créateur. Mieux, comme l’indique
Chamoiseau lui-même, le conteur possède un avantage sur le quimboiseur, et ce même si ces
deux figures ont tendance à se confondre : « aujourd’hui, Conteurs et Quimboiseurs sont liés. Ils
procèdent d’une même résistance. Mais le Conteur dispose d’un avantage, il ne relève pas des
seules mémoires africaines mais de toutes les mémoires qui se sont échouées là en mille traces
mobiles. De toutes malédictions et damnations anciennes que l’on a oubliées. Il doit inventorier
ces silences émiettés » (Chamoiseau, 2002 : 183). Mystique, guérisseur, dépendant des savoirs
africains et de la communauté marron, le quimboiseur serait donc, si l’on en croit Chamoiseau,
différent du conteur dans sa façon d’aborder l’identité, les mythes et leur survie. En contact avec
un autre monde, le quimboiseur fonctionne et travaille, comme Léonce, Wademba, Man Yaya
ou Tituba, à partir d’une substance physique (la Nature antillaise) et spirituelle (les esprits des
morts) nécessitant son isolation au milieu de la nature antillaise, à l’écart de la communauté et
du monde moderne. C’est là un aspect que l’on retrouve dans la tradition chamanique puisque

194
«le futur chaman se singularise progressivement par un comportement étrange ; il cherche la
solitude, devient rêveur, aime flâner dans les bois ou les lieux déserts, a des visions, chante
pendant son sommeil, etc. » (Eliade, 2001a : 97-98). C’est exactement ce que l’on constate avec
le personnage de Melchior Longoué qui aime vivre en aliénation par rapport à la société des
marrons dans laquelle il évolue : « solitaire, il y cherchait peut-être le même pullulement de vie
qui le fortifiait dans les bois » (Glissant, 1997a : 148). On le voit également avec Man Yaya qui,
dans Moi, Tituba…, vit à l’écart de la société des esclaves. Évoluant au contraire en société, au
milieu des autres, le conteur a, quant à lui, un lien plus direct à la parole, la politique et
l’imaginaire et son but principal serait de divertir mais aussi de libérer l’esprit. De même, chez
le quimboiseur/chaman, le procédé de transmission du savoir ne dépend pas de la créativité, de
l’imagination et de la transmission à une communauté, comme chez les conteurs, mais de la
somme d’un savoir à préserver, transmise d’un individu à l’autre. C’est ce qu’on remarque dans
la relation entre Papa Longoué et Mathieu Béluse, qui repose sur la transmission d’un savoir et
la nécessité de créer un lien générationnel, une transmission de savoir : « C’était qu’il fallait
disposer d’un descendant, choisi, élu. Un jeune plant par lequel vous avez des racines dans la
terre du futur. C’était cela. Se raccrocher à demain par les forces de la jeunesse » (Glissant,
1997a : 19). Nous le voyons, quimboiseur et conteur se confondent parfois dans les romans par
leur lien à l’oralité, et ils se basent sur la survie des mythes, des contes et des rituels religieux
pour faire face à l’acculturation et tous deux ont perdu tout lien avec leurs origines africaines
ancestrales, cependant leurs manifestations culturelles sont, dans les romans, différentes. En
effet, si les quimboiseurs et les conteurs cherchent à protéger la culture et l’identité par une
survie du savoir, ils agissent cependant à différents niveaux : le conteur est un homme comme
les autres, qui agit en public, au niveau de l’identité et de l’imagination et dont le pouvoir est
dans la parole, alors que le quimboiseur, plus proche de la figure du chaman, travaille au niveau
de la spiritualité et du corps physique dans l’isolement de la nature et ne recherche pas de

195
contact avec la société humaine. Cependant, alors que le conteur est « the direct ancestor of the
French Caribbean writer» (Seifert, 2002: 217), nous avons vu que les auteurs nient toute
continuité, probablement parce qu’ils sont apparus à une époque différente de la leur et dans des
conditions spécifiques. Pourrait-on également supposer que les auteurs refusent de s’identifier
aux conteurs parce qu’ils en font dans leurs romans une figure mythique à laquelle ils
refuseraient de toucher ?
1.2 Une figure symbolique de la résistance
Nous avons vu l’importance de l’oralité dans le monde antillais, son rôle crucial dans la
survie identitaire et l’importance ethnographique et sociale de la figure du conteur comme
symbole de la lutte contre le silence de l’oppression coloniale. Cependant, hors des romans
antillais qui considèrent le conteur comme un personnage exceptionnel, le porte parole de tout
un peuple, « notre conteur est le délégué à la voix d’un peuple enchaîné, vivant dans la peur et
les postures de survie » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 76), les ouvrages « scientifiques » ou
« historiques » ne les mentionnent que par leur fonction générale. Aucun nom spécifique n’est
mentionné et il n’est pas fait mention de conteurs historiquement importants comme il est fait
mention de marrons comme Mackandal. Si le conteur n’a été considéré que comme un
reproducteur de paroles, puisant dans les traditions orales communes, et non comme un créateur,
il a toujours souffert des pressions et de la domination de l’écrit. Les conteurs étant des
personnages historiques ayant vécu dans un monde où la transmission orale de la parole était
dominée par l’écrit des registres, on peut comprendre leur absence des livres d’histoire officiels
et la difficulté d’une reconstitution des origines de l’oralité. Si les ouvrages écrits laissent
toujours des traces, l’oralité, elle, se perd si elle n’est pas continuellement soutenue par la parole
ou la mémoire :

196
The purely oral tradition or primary orality is not easy to conceive of accurately and meaningfully. Writing
makes ‘words’ appear similar to things because we think of words as the visible marks signaling words to
decoders: we can see and touch such inscribed ‘words’ in texts and books. Written words are residue. Oral
tradition has no such residue or deposit. (Ong, 2002: 11)
C’est à ce point précis, devant cette absence de traces historiques, que la littérature entre en
scène en reconstituant, en donnant la vie à cette figure caribéenne dont on ne sait que peu de
choses. On peut ainsi supposer que c’est parce que le conteur antillais a existé mais qu’il n’a pas
laissé de traces que les auteurs antillais lui (ré)écrivent une origine dans le contexte colonial –
son apparition à la tombée de la nuit, dans la plantation – pour que, d’un simple détail de
l’histoire, il redevienne le symbole essentiel de la survie qu’il a été pour l’identité caribéenne:
Le jour, il vit dans la crainte, la révolte ravalée, le détour appliqué. Mais la nuit, une force obscure l’habite.
Une levée atavique brise la carapace sous laquelle il s’embusque. D’insignifiant il s’érige au mitant des
cases à Nègres, papa-langue de l’oralité d’une culture naissante, maître-pièce de la mécanique des contes,
des titimes, des proverbes, des chansons, des comptines qu’il élève en littérature, ou plus exactement en
oraliture. Réceptacle, relais, transmetteur ou plus exactement propagateur d’une lecture collective du
monde, voici notre conteur créole (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 72-73)
Esclave ou individu antillais d’apparence normale, se noyant dans la population générale de
jour, il se transforme la nuit venue quand il retrace les liens entre le passé et l’avenir. Ce rôle
essentiel explique que sa présence soit, dans les romans antillais, importante voire même
obligatoire (la quasi-totalité des romans antillais contiennent des conteurs ou y font référence à
un moment ou à un autre). Au-delà de son apparence simple, passe-partout, la profondeur et
l’importance de ce type de personnage lui ont permis de devenir, un peu à l’image du folklore
antillais, un passage obligé de tout roman.

197
De nombreux auteurs les mentionnent et insistent sur leur importance, cependant
Chamoiseau et Confiant l’ont quasiment élevé au rang de figure nationale dans leur étude
Lettres créoles. Ils notent ainsi dans tout conteur quatre fonctions essentielles :
Le conteur est d’abord celui qui donne une voix au groupe. Il n’est pas un créateur en suspension, mais
bien le délégué d’un imaginaire collectif auquel son art s’ajoute. […] L’oraliturain fut aussi, dans les
premiers temps, gardien des mémoires… Celui qui débarquait après l’utérine traversée se retrouvait dans
une situation où son nom, sa religion, sa langue, ses valeurs, son explication du monde étaient soit
invalides, soit en grande part inopérationnels. Il ne débarquait pas dans un autre pays mais dans une autre
vie. […] Distraire fut aussi l’une de ses fonctions. […] Enfin, verbaliser la résistance, selon les modalités
déjà vues. (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 80-81)
En plus des fonctions traditionnelles du conte qui, comme nous l’avons vu, se propose de
distraire, le conteur possède également d’autres talents essentiels qui font de lui un pilier de la
survie de la mémoire dont il est le gardien et qu’il maintient en vie, à la manière du quimboiseur
(qui, lui, maintient en vie le monde spirituel et son rapport avec les hommes). Mentionné dans
beaucoup de romans, théorisé par les Créolistes comme une figure symbolique d’espoir, de lutte
et de renouveau, le conteur est celui qui, face à la mort, la souffrance physique, psychique et
culturelle permet de lutter contre les silences de l’acculturation. Il est ainsi, par sa position
culturelle, une alternative au marron (sur lequel nous reviendrons) qui, ayant fui la plantation,
représente la révolte physique. Bien qu’étant pris au cœur de la Plantation et de l’acculturation
esclavagiste, le conteur parvient cependant à une véritable alternative culturelle par la
production d’histoires subversives qui, comme celles de Compère Lapin, s’opposent
discrètement à la société coloniale en minant les bases du status quo qu’elle impose. Comme
l’indique Praeger, le conteur effectue ainsi une forme de marronnage intellectuel et identitaire :
« Papa Longoué has installed marronnage in the very heart of the plantation. His speech
(parole) is even more subversive as it is not immediately understood. During the day he is

198
discreet, anonymous, but at night in his own domain he becomes opaque to the master »
(Praeger, 2003: 47). Figure récurrente, passage obligé des romans, le conteur est une incarnation
de l’identité antillaise. C’est ce qui permet à Chamoiseau d’en faire une figure de la Créolité en
exprimant cette dernière dans toute sa diversité : « Tout le monde hante ma parole, les fantômes
caraïbes et les belles Arawaks, les esclaves dans leurs diversités, mais aussi les Maîtres, tout
comme les immigrants qui débarquent chaque année. Moi, Conteur, je donne parole aux voix
égarées. Mon corps se charge des gestes, des chants, des danses » (Chamoiseau, 2002 : 185).
Les premiers conteurs antillais avaient-ils conscience de leur héritage ? Étaient-ils porteurs de
ces multiples paroles ? Sans traces écrites ou orales originelles, il reste difficile de le prouver,
mais on peut penser que cette récurrence symbolique du personnage fait partie des effets
littéraires recherchés par les auteurs antillais et en particulier ceux de la Créolité dans leur
travail de (re)mise en valeur d’une identité antillaise et de la mise en place de ce qu’on pourrait
appeler une « Genèse » spécifiquement antillaise.
1.3 Une figure littéraire mythisée ?
Le Conteur pourrait-il être perçu comme un mythe antillais ? Cela est bien possible,
surtout quand on s’arrête aux théorisations des auteurs de la Créolité qui y voient une des
origines essentielles de la culture et de la littérature antillaises d’aujourd’hui et pour qui il serait
un des créateurs originels de l’identité antillaise: « le Conteur, né d’un désordre d’hommes et
tout projeté dans des liens à créer, est inventeur de peuple » (Chamoiseau, 2002 : 187). Puisque
tout mythe est une histoire vraie qui raconte une origine et la manière dont quelque chose est
venu à l’existence, on pourrait avancer que par son existence réelle, son apparition dans la nuit
esclavagiste, la force presque magique de sa parole, sa fonction d’« inventeur de peuple » et de
la créativité antillaise originelle, le conteur pourrait effectivement être pris comme un mythe

199
antillais. Par définition, il serait une figure culturelle et identitaire essentielle dont les auteurs
d’aujourd’hui s’inspirent, un mythe, même s’il n’a pas une origine ancestrale et surnaturelle
comme les mythes traditionnels. De ce fait, à cause de la rupture originelle qui a empêché la
survie des mythes ancestraux, on dira qu’il n’est pas un mythe traditionnel, mais qu’il est le
produit de circonstances nouvelles, spécifiquement antillaises:
Sa parole n’émergeait pas des lignes d’une Genèse ou d’un mythe fondateur, ni d’une Histoire ramifiée
dans des chants littéraires, elle n’avait que le trouble du bateau négrier, l’éblouissement sanglant des
désastres coloniaux, l’emmêlé des histoires venues de tous les territoires. Elle n’était sous tutelle d’aucun
Sacré, mais se voyait hantée par de multiples Sacrés aux « vérités » tremblantes. (Chamoiseau, 2002 : 193)
Né du transbord des esclaves, son origine n’est donc pas ancestrale et n’est pas non plus le fait
d’entités surnaturelles ou de dieux mais coïncide néanmoins aux toutes premières heures de
l’histoire coloniale de toute la région des Antilles. Dans cette région (re)créée par l’histoire
coloniale et son absence de mythes originels amérindiens, occidentaux ou africains, l’émergence
du conteur pourrait faire figure de mythe historique puisqu’il est ancré dans le réalisme
historique et ethnographique des romans. Cependant, ce qui fait du conteur une figure encore
plus mythique est probablement le fait que s’il est une figure historique attestée, il n’en reste
aucune trace puisqu’il a été « renvoyé aux oubliettes de l’histoire et de nos inventaires »
(Confiant, Chamoiseau, 1999 : 75). Sans preuve matérielle directe de leurs histoires et de leurs
pensées, si ce n’est que par les représentations d’écrivains prenant le relais des bribes
historiques dont se servent les historiens, le conteur originel reste aujourd’hui, comme le note
Diana Ramassamy, une figure mystérieuse : « plongé dans la clandestinité pendant les périodes
sombres de l’esclavage, le conteur créole reste encore entouré de mystères » (Ramassamy,
2006 : 295). C’est face à ce manque originel, ce vide partiel de l’histoire que, dans certains de
leurs ouvrages et dans leurs romans, Confiant et Chamoiseau recréent souvent, par l’écriture

200
romanesque, la scène « originelle » de la naissance de cette parole créole. Comme dans les
mythes, cette scène originelle que l’on retrouve surtout chez les auteurs de la Créolité est la
répétition d’un même modèle : le conteur est apparu autrefois, entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle, parmi les cases d’une grande plantation de canne à sucre alors que le maître dormait et
que toutes les lumières de l’habitation étaient éteintes. Les esclaves étaient réunis et attendaient
celui qui, malgré son allure banale, se révélait possédé par une force nocturne le transfigurant.
On retrouve ainsi, par exemple, une illustration de ce modèle dans L’Esclave vieil homme et le
molosse:
La Papa-conteur de l’Habitation était un bougre assez insignifiant (un nègre-guinée à petits yeux au corps-
planche et au dos un peu courbé). Il se transformait en prenant la parole (grands yeux, corps épais et dos à
belle équerre). Il aspirait la vie autour de lui pour sustenter son verbe. Et ce verbe, il éveillait la vie. Il
parolait et faisait rire. Et le rire déployait les poitrines, les amplifiait. Les haines, les désirs, les cris perdus
et les silences de tous s’exprimaient par sa bouche. (Chamoiseau, 2005a : 47)
Cet exemple est presque identique au modèle « originel » qui, présent dans un certain nombre de
romans, prend presque toujours une forme similaire, et qui a été résumé et « théorisé » par
Chamoiseau et Confiant dans leur ouvrage collectif Lettres créoles comme la répétition d’un
modèle mythique. On le voit ainsi avec des personnages comme Solibo dans le roman de Patrick
Chamoiseau, Papa Longoué dans Le Quatrième Siècle, Tituba dans Moi, Tituba… ou encore
Wademba, dans Ti Jean l’Horizon. On pourrait ainsi dire qu’en s’inspirant de faits historiques
correspondant aux origines du monde antillais (et repris par la plupart des auteurs dans leurs
romans) et en imaginant par l’écriture les faits manquants à l’origine de l’oralité, les auteurs des
Lettres créoles ont proposé la (re)création d’un modèle mythique là où il y avait un vide partiel
de l’Histoire. Au-delà cette mise en théorie d’un phénomène historique et littéraire, Confiant et
surtout Chamoiseau développent également cet archétype mythique dans leurs romans, ce qui

201
pourrait bien expliquer que Patrick Chamoiseau utilise une majuscule quand, dans L’Esclave
vieil homme et le molosse, il se réfère au « Conteur » (Chamoiseau, 2005a : 52).
Ainsi, le conteur a beau être un individu normal, pris comme les autres dans les misères
et les acculturations de l’esclavage et ne pas être d’origine divine ou surnaturelle, il n’en
possède pas moins, dans les romans réalistes mystiques, un certain « pouvoir » de parole qui lui
fait quitter les frontières du réel historique pour entrer dans l’aspect « mystique » des romans.
On le voit par exemple avec la voix de Solibo, dans le roman de Patrick Chamoiseau, « sa voix
vivait dans son front, dans ses joues, habitait ses yeux, sa poitrine et son ventre : une Force »
(Chamoiseau, 2005b : 81) ou celle de papa Longoué dans Le Quatrième Siècle : « […] c’est ce
que pensait Mathieu, au fond obscur de son être, quand le vertige de la mémoire se dessaisissait
de lui ; non pas de la mémoire elle-même, mais certes l’éblouissement né des paroles de papa
Longoué » (Glissant, 1997a : 34). Cette parole permet également à Solibo de communiquer avec
les animaux (un autre trait du chamanisme), notamment avec les serpents, comme quand il
sauve Man Goul d’une bête-longue : « le Magnifique saisit la bête-longue d’une main à l’aise. Il
la fourra dans un sac et lui souffla des paroles inaudibles tandis qu’il l’emportait » (Chamoiseau,
2005b : 75), indiquant ainsi au narrateur étonné que « ("chaque créature n'est en réalité qu'une
vibration à laquelle il faut simplement s'accorder") » (Ibid. 76). Le roman de Chamoiseau va
même plus loin puisqu’il donne à la parole une souplesse, une force d’adaptation presque
surnaturelle, qui font se fondre le conteur dans son environnement textuel immédiat: « Oiseau
de Cham, je ne me noierai jamais. Dans l'eau je deviens eau, devant la vague je suis une vague.
Je ne me brûlerai pas non plus, car le feu n'enflamme pas le feu » (Chamoiseau, 2005b : 75-76).
Cet aspect rappelle l’approche religieuse et mystique de Maximilien Laroche par rapport au
conteur haïtien : « le narrateur présent et visible du kont traditionnel haïtien est en quelque sorte
l’analogue du Iwa dont la puissance est une délégation du Dieu lointain » (Laroche, 1989: 83).

202
Moyen de transmission d’un message ou d’une parole, le conteur est ainsi, dans les romans,
l’incarnation d’un principe qui le dépasse. Dans Le Quatrième Siècle, par exemple, Papa
Longoué devient symboliquement, par son nom, le porteur du message de révolte, du refus du
silence, le cri : « oué en créole signifiant le cri. Longoué incarne alors ce cri. Il est lui-même ce
long cri, ce long oué, son corps est l’espace d’une parole vivante et d’une mémoire» (Curtius,
2006 : 270). Dépassant sa simple fonction de conteur, Solibo devient aussi, d’une manière un
peu différente, le symbole de la fin de l’oralité : tout en rappelant « Soliman le Magnifique », le
nom Solibo Magnifique n’a qu’une homophonie de nom avec cette figure historique puisque
rien dans la vie ou la déchéance de ce conteur n’est véritablement magnifique, si ce n’est sa voix
et ses contes qui lui donnent toute sa valeur. Notons d’ailleurs que, comme une élection,
c’est « un vieux conteur (un brutal paroleur) qui, l’entendant un samedi au marché, le cria
Magnifique » (Chamoiseau, 2005b : 79). De ce fait, le conteur est une figure essentielle de la
culture antillaise, tout comme il est une figure importante de la culture mondiale. Comme
l’indique Walter Benjamin, le conteur devrait « être mis au nombre des maîtres et des sages
[car] il sait donner un bon conseil, non point, comme le proverbe, dans quelques cas, mais,
comme le sage, dans un grand nombre de cas. Car il lui a été donné de remonter tout le cours
d’une vie » (Benjamin, 2000 : 150).
2 Conteurs d’hier et d’aujourd’hui : évolutions et transformations dans Solibo Magnifique
2.1 D’une figure mythique à une figure tragique ?
Tout puissant et important qu’il soit, le Conteur n’est cependant pas éternel. Figure
mythique des origines de l’oralité et de la création imaginaire antillaise, il a cependant fini par
mourir – physiquement et métaphoriquement – quand, à la fin de l’esclavage, l’écroulement du

203
système plantationnaire puis la départementalisation ont entraîné, par l’avènement du français
écrit et oral, la disparition des conteurs. Ainsi de nos jours, aux Antilles et ailleurs, il apparaît
que le conteur n’est plus aussi présent et familier qu’on pourrait le penser : « il est à nos yeux
déjà un phénomène lointain, et qui s’éloigne de plus en plus » (Benjamin, 2000 : 114). De
même, comme en témoigne l’article de Diana Ramassamy, si les Antilles voient aujourd’hui une
renaissance contemporaine du conteur et si l’on retrouve également des conteurs ailleurs dans le
monde, comme par exemple au Québec, il ne s’agira que de la version moderne d’un modèle
ancien qui s’appliquait à un mode de vie différent d’aujourd’hui. En effet, comme l’illustre le
roman Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau, à travers la mort symbolique de son
personnage qui « avait vu mourir les contes, défaillir le créole, il avait vu notre parole perdre de
cette vitesse que pas un de nos maîtres ne pouvait écouter, il se voyait aussi saisi par cette
fatalité qu’il avait cru pouvoir vaincre » (Chamoiseau, 2005b : 224), le transfert direct et
immédiat du conteur traditionnel vers le monde moderne reste problématique puisque ce dernier
appartient à un monde disparu. Ce fait pourrait expliquer pourquoi les conteurs meurent dans de
nombreux romans, à mesure que le temps passe et que le monde évolue. C’est ce qui arrive à
Wademba ou encore à Papa Longoué qui, à leur mort, laissent derrière eux un vide : « "les
derniers souvenirs qui s’en vont. Nous aurons du mal à retrouver les origines" » (Glissant,
2003 : 196), « cent et cent ans que tu as quitté ton village, Wademba, vieux guerrier, et
maintenant tu rentres chez toi nous abandonnant à l’obscur » (Schwarz-Bart, 1998 : 61). Le
roman Solibo Magnifique est particulièrement exemplaire de ce phénomène car si l’image du
conteur se renforce à travers le roman, ce mouvement est cependant irrémédiablement brisé à la
fin quand Solibo est symboliquement tué par la mort des contes et de l’oralité et son incapacité à
se faire entendre dans un monde antillais moderne qui prive chacun de « la faculté d’échanger
des expériences » (Benjamin, 2000 : 115) et que le destin de l’oralité aux Antilles conduit à une
fin irrévocable. La mort de Solibo coïncide ainsi symboliquement, dans le roman, avec celle de

204
l’oralité, de laquelle il dépend et qu’il tente, en vain, de défendre jusqu’au bout. En effet, si la
disparition du système plantationnaire a entrainé la fin d’un monde puisque « les valeurs
culturelles accumulées dans le cadre du système des Plantations (traditions orales, contes,
coutumes, gestuel, folklore, etc.) ont tari ou disparu avec l’émiettement de ce système »
(Glissant, 2002 : 286), le conteur n’a plus sa raison d’être. Cette mort est d’ailleurs
particulièrement symbolique, voire même symbiotique quand on remarque comment, tout au
long du roman, la disparition de l’oralité dans la société antillaise entraîne l’effacement presque
littéral du personnage, comme s’il en était une incarnation: « [les policiers] avaient découvert
que cet homme était la vibration d’un monde finissant, pleine de douleur, qui n’aura pour
réceptacle que les vents et les mémoires indifférentes, et dont tout cela n’avait bordé que la
simple onde du souffle ultime » (Chamoiseau, 2005b : 227). Personnage mythique,
emblématique, Solibo est donc également un personnage tragique, victime du temps, des
changements et des évolutions inévitables de la culture antillaise puisque, mourant d’une
« égorgette » de la parole, il meurt de son incapacité à être ce qu’il devrait être : l’expression et
la transmission d’une parole, une incarnation de l’identité antillaise.
2.2 Problématique : une disparition ou une transformation du conteur?
Si les auteurs parlent de la mort du conteur et de l’impossibilité du transfert « conteur
auteur », doit-on dire que la figure quasi mythique et originelle du conteur traditionnel a
complètement disparu ? Pour certains chercheurs la chute du conteur serait le passage obligé
avant un renouveau : « l'expérience de la chute apparaît aussi comme une condition essentielle
de l'apprentissage de la parole, impliquant donc un dynamisme de remontée vers la maîtrise, la
Force, même si celles-ci restent vulnérables, comme tout acquis humain » (Perret, 1994 : 827).
Pour d’autres, cette théorie prend des aspects bien plus spécifiquement politiques vis-à-vis de

205
l’influence française aux Antilles puisque, pour eux, cette théorie symboliserait également la fin
d’une tradition causée par la colonisation, la départementalisation et l’acculturation
contemporaine créée par les médias occidentaux:
His death represents Chamoiseau’s intense concern over the death of folk tradition. For several decades,
French programs have dominated the television screens of the Overseas Department of France, not simply
providing entertainment but also holding up French cultural models to the Francophone Caribbean. So the
teller of folktales has fallen out of fashion, and can no longer find an audience, or make a living wage.
Solibo’s death represents the fate that seems to be awaiting Creole culture: the event is above all a
metaphor, and so cannot be susceptible to police investigation. (Ormerod-Noakes, 1997: 220)
À première vue, il semble que le conteur ne soit que l’incarnation d’un temps révolu de
l’histoire antillaise et qu’il n’ait donc aucun lien avec la figure de l’écrivain. Cette constatation
nous pousse donc à nous demander si, en fin de compte, cette figure mythique, support de la
mémoire et de l’identité serait uniquement une figure des temps passés, ou si elle aurait pu se
transformer et évoluer avec le temps pour prendre une forme autre.
Si l’on veut étudier la figure du conteur dans les romans et comparer ses manifestations
anciennes et modernes, on peut noter que le roman Solibo magnifique de Patrick Chamoiseau
propose un exemple de « transfert » – ou du moins de tentative de transfert – d’une figure
originelle de l’histoire caribéenne dans le monde antillais à la suite de la départementalisation.
Dans le roman, qui met en pratique les théories de la créolité, on note en effet que, comme dans
la tradition, la parole se conte toujours la nuit. De plus, si la ville de Fort-de-France a remplacé
l’habitation du maître et si la place de la Savane, cette « grand-place de liberté végétale »
(Chamoiseau, 2005b : 28) a remplacé la campagne antillaise, le conteur a, quant à lui, toujours
un public populaire. De même, si les maîtres ne sont plus présents, ils ont été remplacés par un
nouveau maître : l’État français, symbolisé par la présence de la Police aux abords de la Savane.

206
Reconstituant les conditions d’origine dans un milieu moderne, il semble donc que, dans son
roman, Chamoiseau propose un transfert presque littéral de la situation traditionnelle de
l’énonciation des contes. Le lieu et la situation de la manifestation de cette oralité ont beau être
différents de la tradition, ils n’en gardent pas moins certaines caractéristiques de base. Le
personnage de Solibo partage également, comme le conteur traditionnel, les deux visages
contradictoires que nous avons vus plus haut. Ainsi, si le cadavre retrouvé par la police est celui
d’un « nègre gonfle, un nègre de rien comme on en rencontre derrière les marches, pas même
assez grand pour jouer au basket, avec des pattes trop fines pour semer du football ou fumer
dans les cent mètres » (Chamoiseau, 2005b : 96) celui-ci avait cependant, de son vivant, une
puissance acquise par la force de sa parole. Cependant, si le conteur d’antan est une figure
puissante, respectée et, comme avec Longoué ou Wademba, quasiment immortelle, ce n’est pas
le cas de Solibo. En effet, les romans décrivent les conteurs du temps de l’esclavage et insistent
sur leur rôle essentiel et leur puissance, mais Solibo Magnifique parle de sa déchéance et de sa
mort, ce qui pourrait indiquer que le conteur ne peut pas survivre dans le monde contemporain.
En effet, si le visage discret, effacé des premiers conteurs tenait de la nécessité de vivre caché et
de passer inaperçu sur la plantation par non-respect du Code Noir, le monde dans lequel évolue
Solibo n’a plus toutes ces restrictions et ne connaît plus les oppressions de l’esclavage. Jouissant
d’une certaine liberté dans laquelle, contrairement aux règles du Code Noir, il n’est pas interdit
de se réunir, Solibo est connu de tous et ne se cache pas. Malgré les nombreux points communs
entre Solibo et ses ancêtres conteurs, il apparaît que le monde a changé et que l’image du
conteur ne peut se reproduire exactement dans le monde antillais de départementalisation et de
sa (relative) liberté d’expression comme il le faisait du temps de l’esclavage. C’est ainsi que
dans un monde moderne, plus ouvert que le monde des plantations, les conteurs se voient
souvent, comme nous le verrons avec le quimboiseur, contestés. On le voit dans Hadriana dans
tous mes rêves, quand Patrick conteste le récit de Scylla (dont la version, bien que, différent du

207
témoignage de Patrick allait « être retenue pour officielle et vraie » [Depestre, 1988 : 22]) et son
autorité de conteur, « quel flagrant délit d’arrangement du réel ! » (Ibid. 32), tout comme le fait
Mathieu avec Papa Longoué dans Le Quatrième Siècle. De ce fait, le désir d’une liberté
d’expression a été la cause directe de l’apparition de l’oralité, des conteurs et de leur existence
sur les plantations. Cependant, une fois cette liberté « obtenue » (à en croire les auteurs, c’est là
un terne relatif), le conteur antillais peut-il encore avoir une raison d’exister ? Si cette première
figure littéraire du monde créole, cette « symbolic figure as well as a realistic one, representing
the oral folk culture that Chamoiseau venerates» (Ormerod-Noakes, 1997: 220) a originellement
donné aux populations opprimées et réduites en esclavage leur parole, devrait-elle apparaître,
dans les romans contemporains, sous des formes différentes, plus appropriées?
2.3 Fonctions du conteur dans le contexte antillais : hypothèses
Puissant symbole de l’émergence de la parole et de la résistance culturelle contre la
colonisation, mais aussi symbole d’un changement socioculturel important, correspondant à la
fin du monde de la plantation, l’image du conteur traditionnel serait donc trop symboliquement
ancrée dans l’oralité originelle et dans les temps de l’esclavage pour survivre dans des romans
se déroulant à la période contemporaine. Pourtant, quand on observe la société antillaise
contemporaine, il apparaît que le conteur est une figure qui, contrairement à sa contrepartie
littéraire, continue d’exister par l’action d’associations comme « Konté Sanblé » et qui est
même de plus en plus médiatisée:
En Guadeloupe, il devient cependant de plus en plus difficile aujourd’hui d’occulter les conteurs. Très
présents sur la scène médiatique, les conteurs sont généralement sponsorisés par les medias et les instances
politiques, qui utilisent de manière subversive le patrimoine culturel « populaire », à leur avantage,
conscients du rôle et de l’impact des conteurs sur la communauté. (Ramassamy, 2006 : 295)

208
Il apparaît donc que les discours des auteurs, et leur insistance sur la mort du conteur, ne
concernent que le conteur originel, le rebelle, celui né sur les plantations qui serait donc
différent de sa version contemporaine, médiatisée et rémunérée1. En effet, si les premiers
conteurs devaient lutter contre l’acculturation esclavagiste, les conteurs contemporains doivent
« adapter leurs contes à un univers désormais dominé par un nouveau type d’oralité, celui de la
télévision, néo-réalité qui diffère de l’oralité traditionnelle […] » (Confiant, 1995 : 15). Les
romans de notre corpus ne se penchent pas vraiment sur ce sujet, mais nous pouvons également
noter un autre fait intéressant que Chamoiseau et Confiant mentionnent dans leurs écrits: le fait
que le conteur ait été, de son temps, influencé par l’écriture et qu’ « il éprouvait son emprise
impérieuse » (Chamoiseau, 2002 : 196) au point que certains nègres-sorciers « s’affublaient
d’un livre (d’une Bible souvent, de ce ‘papier qui parle’) » (Idem.). En effet, comme le note
Lewis C. Seifert, « although working with the techniques of oral storytelling, the slave
storyteller is nonetheless conscious of the writing that surrounds him (e.g., plantation account
books, Bibles, hymnals, newspapers and official documents from France), even if it is
inaccessible to him » (Seifert, 2002: 218). Or, ce type de comportement n’est pas fréquemment
décrit dans les romans, si bien qu’il y aurait une certaine différence entre la représentation
littéraire mythique du conteur, qui le décrit le plus souvent comme un personnage pur, intouché
par l’écriture, et celle, historique, des historiens et ethnographes. Ainsi, quoique les premiers
conteurs n’étaient pas des incarnations d’une oralité pure et que les auteurs ont par la suite été
influencés par eux puisque « the oral craft of the slave storyteller becomes a model for the
Creole storyteller/writer » (Seifert, 2002 : 218), on peut ici supposer que l’écriture et l’oralité
n’ont jamais été aussi opposées que ce que les auteurs laissent entendre. Ce fait pourrait
1 Ce fait s’appliquant exclusivement à la société antillaise et non aux romans de notre corpus, nous ne nous pencherons pas sur la question.

209
également expliquer l’apparente fusion oralité/écriture dans les romans contemporains et les
marques de l’oraliture comme les néologismes, les répétitions, les exclamations, les
onomatopées, les constatations personnelles : « à ce point que je ne saurais décrire »
(Chamoiseau, 2005a : 87) et les adresses directes aux lecteurs/public : « cette récolte du destin
que je vais vous conter eut lieu à une date sans importance puisque ici le temps ne signe aucun
calendrier » (Chamoiseau, 2005b : 25) et les nombreuses autres figures de style orales
omniprésentes dans les romans. Il y aurait donc dans les romans, et en particulier dans les
romans de la Créolité, une différence entre la pratique de l’oraliture, qui représente un aspect
essentiel de la culture antillaise, et les théories des auteurs, qui semblent toujours mettre en
valeur la position de lutte du conteur et la mort de sa parole. Devant cette constatation, notre
hypothèse sera donc la suivante : si les auteurs antillais mettent en place dans leurs romans une
représentation sublimée du conteur originel, il y aurait cependant un reflet de l’écrivain en
devenir dans le conteur « historique » et sa pratique de l’oralité puisque le premier s’inspirerait
largement des techniques du second pour écrire ses romans. Cependant, cet écrivain ne serait
pas un conteur à proprement parler puisque le monde oppressif qui avait contribué à la création
du conteur originel n’existe plus et puisque son expression était écrite et non orale. L’écrivain
n’est pas un conteur mais il s’en inspire dans ses œuvres : il y a des traces d’idéalisation de ce
dernier dans son œuvre et nous pourrions donc dire que le conteur, cet axe essentiel de l’identité
du peuple antillais, cette figure de la première parole et du premier cri est une « histoire vraie »,
un mythe. Issu des commencements de l’esclavage et du monde Antillais, le conteur serait ainsi
un personnage exemplaire puisque les auteurs le reproduisent et s’inspirent de ses actions
comme d’un « modèle[s] de conduite[s] humaine[s] et conférant par la même signification et
valeur à l’existence » (Eliade, 1988 : 12). En tant que mythe il permettrait aux auteurs qui s’en
inspirent de faire ce que beaucoup considéraient comme un impossible paradoxe: faire passer,
par l’oraliture, la parole contée dans la parole écrite. Cependant, si la liberté d’expression

210
acquise a fait disparaître le conteur et en a fait une figure mythique, quel sera le rôle de ces
écrivains antillais qui rejettent toute possibilité de transfert entre ce mythe et eux ?
3 Le « guerrier de l’imaginaire » et la création des mythes
3.1 Chamoiseau et le « marqueur de paroles »
Dans une étude récente intitulée L’Auteur en souffrance, Dominique Chancé s’intéresse
à un phénomène que l’on peut directement lier à l’image du conteur et à sa disparition : la mort
de l’écrivain, remplacé par la naissance du marqueur de paroles. Il s’agit d’un thème
relativement important de la littérature antillaise mais qui semble surtout préoccuper les auteurs
de la Créolité, comme par exemple dans le roman Solibo Magnifique sur lequel nous allons ici,
une fois encore, nous attarder.
Comme le note Chancé, le marqueur de parole est une figure emblématique d’une
nouvelle littérature antillaise, née principalement des romans de Patrick Chamoiseau. Il s’agit
d’un type de personnage relativement proche de l’ethnographe dont le rôle est, nous l’avons vu
dans notre première partie et avec les travaux d’Ina Césaire, de produire un texte retranscrivant
directement des paroles locales, natives et traditionnelles. Cependant, si la fonction de
l’ethnographe a toujours été, principalement, de sauvegarder et de reprendre la parole locale
sans favoriser une origine particulière, la fonction du marqueur de paroles semble, au contraire,
plus engagée, comme lorsqu’il s’efforce de protéger la figure du conteur antillais et de lutter
contre sa disparition: « in the case of the marqueur de paroles, this informant is his own direct
ancestor, the Antillean conteur, ‘le Papa de la tracée littéraire créole’ whose words are in danger
of disappearing if they are not transformed into written texts » (Haigh, 2001: 75).
Théoriquement, la fonction du marqueur de parole est donc non pas de donner sa propre parole

211
ou d’utiliser son imagination, mais de faire ce que le conteur devait lui aussi, théoriquement,
faire : reproduire, répéter une parole, qui « apparaît généralement comme l’expression de la
collectivité et fait du conteur un porte-voix, auquel n’est concédée qu’une créativité d’acteur »
(Condé, 1987 : 13). D’une certaine manière, il ne serait donc pas un créateur mais un écrivain
dont le but serait de préserver ce qui risque de disparaître. Cette approche du marqueur de parole
pose cependant deux problèmes. Premièrement, bien que réaliste historiquement et
ethnographiquement, les romans sont cependant des fictions (Solibo est un personnage
imaginaire). Deuxièmement, si Chamoiseau cherche à faire passer la parole de Solibo avant la
sienne, cela indiquerait que la parole d’un conteur imaginaire aurait plus de valeur que celle
d’un écrivain réel. L’auteur Chamoiseau est pourtant, au-delà de sa capacité d’ethnographe,
créateur d’un roman qui n’est pas un document ethnographique, ce qui fait de lui plus qu’un
simple marqueur de la parole : un créateur.
Que Solibo soit réel ou non, qu’il soit inspiré de personnages ayant existé, il n’en reste
pas moins, symboliquement, le descendant des mythiques conteurs d’antan et de la figure
emblématique, mystico-mythique, du premier conteur qui, dans la nuit esclavagiste, entreprit le
premier mouvement de résistance artistique, culturelle et identitaire. Ainsi, si le conteur est une
répétition de la tradition, la fonction du marqueur ne serait-elle que de reproduire la parole des
autres ? Il semble en effet que l’écrivain caribéen contemporain ne se considère pas toujours
comme une figure importante dans la culture et la littérature antillaises. Même si les conteurs
qu’il reproduit dans ses romans sont imaginaires, même si tout roman est fruit de son
imagination, Chamoiseau n’hésite pas à rabaisser sa fonction et son importance par rapport au
conteur traditionnel en revenant souvent sur l’aspect dérisoire, inutile de cette entreprise. On
voit ainsi comment, dans Solibo Magnifique, il entreprend de descendre l’écrivain antillais de
son piédestal, le réduisant à n’être que le copieur d’une parole autre, une parole qu’il ne parvient

212
même pas à reproduire : « mais je me disais "marqueur de paroles", dérisoire cueilleur de choses
fuyantes, insaisissables comme le coulis des cathédrales du vent » (Chamoiseau, 2005b : 225).
Contrairement aux mythisations de l’image du conteur qui devient une force de parole presque
surnaturelle, c’est donc à une véritable démythisation de la figure de l’écrivain que l’on a affaire
lorsque le narrateur/écrivain Patrick Chamoiseau se décrit comme un « prétendu ethnographe »
(Chamoiseau, 2005b : 44) doutant de ses capacités, faisant ses recherches sur la vie des djobeurs
muni de son « petit magnétophone à piles qui ne fonctionnait jamais » (Ibid. 43) et d’une
incapacité générale à vraiment saisir la nature de ses sujets d’étude:
J'avais beau, durant les elliptiques lucides, m'imaginer en observation directe participante, comme le
douteux Malinovski, Morgan, Radcliffe-Brown, ou bien Favret-Saada chez ses sorciers normands, je
savais que nul ne s'était vu dissoudre ainsi dans ce qu'il voulait décrire. Je n'étais plus dans ce marché
qu'une sorte de parasite, en béatitude stérile, dont les notes s'apparentaient (et s'apparentent puisque
aujourd'hui encore je n'y comprends hac) aux armes miraculeuses des chantres surréalistes. (Chamoiseau,
2005b : 44)
Incapable d’intégrer son sujet, la vie communautaire des djobeurs, il critique sa propre méthode
qui n’aurait pour résultat qu’une forme d’étude incompréhensible, bien trop loin de la vie. Pire
encore, le narrateur avoue être complètement impuissant quand, à la fin du roman, il réalise
l’inadéquation de son désir d’écrire l’oral pour le préserver, « taraudé d'une obscure exigence, je
consacrais mes jours à charrier une eau en panier, à esquisser des silhouettes de choses
dissoutes, à élucider au travers de la trame du marché une fresque en perdition aux remous de
l'abîme et du renouvellement. Je m'étais fait scribouille d'un impossible, et je m'enivrais à
chevaucher des ombres […] » (Chamoiseau, 2005b : 225), tout en étant critiqué par Solibo lui-
même, qui le pense un peu « couillon » (Chamoiseau, 2005b : 76) de se réduire à l’écriture.
L’auteur rejetterait-il donc la validité de son travail et les fonctions « réalistes »,
ethnographiques et historiques des romans dont nous avons parlé dans notre première partie ?

213
S’inclinerait-il devant le mythe ou, au contraire, jouerait-il avec ses propres convictions d’un
impossible transfert de l’oral vers l’écrit ?
Pour véritablement observer le fonctionnement du transfert (supposé) de la parole du
conteur vers l’écrit, penchons-nous un instant sur le post-scriptum que l’on trouve à la fin du
roman Solibo Magnifique et qui se propose de reproduire « par écrit » la parole de Solibo lui-
même. Il n’est pas question ici d’oraliture et il est immédiatement clair que la position du
narrateur/auteur par rapport à cette entreprise reprend, comme nous l’avons vu plus haut, l’idée
d’une impossibilité de transfert de l’oral vers l’écrit. Impuissant, le narrateur ne semble capable
que de retranscrire une pâle version des discours oraux originaux :
Ô amis, la parole n’est pas docile !... Certains manquaient de souffle, d’autres de rythme, pas un ne
réussissait à marier le ton et la gestuelle : au travail de la voix, le corps se faisait lourd ; quand le geste
s’amorçait, la voix disparaissait. […] Il fut enregistré et je passais la saison des quénettes à traduire
l’ensemble sur tout un lot de pages tourbillonnantes et illisibles. Si bien, amis, que je me résous à en
extraire une version réduite, organisée, écrite, sorte d’ersatz de ce qu’avait été le maître cette nuit-là : il
était clair désormais que sa parole, sa vraie parole, toute sa parole, était perdue pour tous –––––– et à
jamais. (Chamoiseau, 2005b : 226)
Qu’en est-il de ce fameux discours de Solibo ? Bien évidemment, quand on étudie cette
retranscription, les premiers éléments manquants sont toutes les marques originelles de l’oral
comme le ton et la gestuelle, bien que le texte soit lui-même écrit sans ponctuation et que l’on y
retrouve les réactions de l’auditoire qui répond aux appels du conteur « é kraa ! » (Chamoiseau,
2005b : 233), « nous pas save ! » (Ibid. 240). Cependant, à part les jeux sur les homophonies et
quelques jeux de mots qui se transfèrent bien vers l’écrit, ce sont là les seules marques de
l’oralité originelle ayant survécu à la version écrite. Ainsi, cette tentative brutale de
retranscription ethnographique, pure et sans fard, de l’oralité révèle cette impuissance de l’écrit

214
pour simplement retranscrire l’oral. Ainsi, comme l’exprime Alexie Tcheuyap, Chamoiseau et
les autres auteurs de la Créolité seraient donc impuissants par rapport à l’oralité, incapables de la
retranscrire puisque, en toute logique, la phrase écrite n’est plus la parole contée mais une copie
éloignée, dénaturée, figée à laquelle il manque la nature même de la parole : le souffle vital, le
contact physique avec le conteur, qui disparaît par l’écriture et l’éloignement que provoque le
roman : « Passage from one semiotic system to another irremediably alters – even effaces – a
basic aspect or oral performance : corporeality, gesturality » (Tcheuyap, 2001: 51). Tout en
révélant les questionnements intimes de certains auteurs comme Patrick Chamoiseau sur la
légitimité de leurs œuvres, ces remarques nous poussent à nous demander si la quête identitaire
antillaise que l’on retrouve dans ce roman et dans d’autres ne devrait pas être, en fin de compte,
« assimilated to that of the word » (Tcheuyap, 2001 : 520). Rappelons cependant que les
remarques du personnage Chamoiseau ne s’appliquent pas forcément à l’auteur puisque ce
dernier ne fait pas, dans le roman, un texte à but ethnographique. De plus, par l’utilisation que
l’auteur fait de l’oraliture, il pourrait être perçu comme un double évolué de son personnage, un
dépassement de son moi fictif qui reste, quant à lui, pris dans le complexe problème de la
préservation de l’oralité. Ainsi si le personnage Chamoiseau est, dans Solibo Magnifique, un
marqueur de paroles, Chamoiseau semble indiquer qu’il ne devrait pas être un simple
reproducteur, sous peine d’échec : dépassant l’action passive de la reproduction, il doit lutter
avec son imagination.
3.2 Le « guerrier de l’imaginaire »
Si le conteur en tant que personnage ou référence mythique n’est pas présent dans tous
les romans antillais de notre corpus, cela ne veut pas dire que l’oralité en est absente, bien au
contraire. Que l’on prenne des romans comme La Grande Drive des esprits de Gisèle Pineau,

215
Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre ou encore Moi, Tituba… de Maryse Condé et
L’Esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau, on retrouve toujours dans ces
romans une « voix » qui guide le roman, un narrateur qui raconte une histoire par l’intermédiaire
de l’écrivain qui transforme ainsi, comme nous l’avons vu, son texte en « récit ». On retrouve en
effet dans de nombreux romans, cette figure nouvelle, clairement dissociée du conteur et qui
abandonne la retranscription d’une parole autre pour présenter un type de narrateur/scripteur
fictif, un personnage souvent directement témoin des événements, et qui décide d’en faire le
récit pour partager son expérience avec son lecteur. Il peut aussi, comme dans La Grande Drive
des esprits, Hadriana dans tous mes rêves ou encore Texaco, être transmetteur des paroles ou
des témoignages d’autres personnages, qui lui ont été soit racontés directement ou rapportés par
d’autres, relayant par exemple des rumeurs. Le problème du passage du conteur au marqueur de
parole semble donc être le suivant : avec la fin des conteurs, la parole se perd définitivement et
devient inaccessible à l’écriture et, surtout, intransmissible. L’écrivain ne peut donc en aucun
cas imiter le conteur en écrivant ses romans puisqu’il n’est lui-même pas conteur et que ses
récits sont des textes écrits et non des histoires orales. Il ne peut pas non plus imiter les premiers
écrivains antillais qui souffraient d’un regard sur le monde antillais fortement influencé par le
regard colonial et d’un trop grand conformisme. Il devra donc s’adapter au changement et ne pas
se faire uniquement conteur, écrivain ou ethnographe, mais utiliser l’oraliture pour devenir
autre.
En toute logique, si l’oralité pure n’a pas sa place dans l’écrit, les valeurs et les fonctions
du « marqueur de parole » seront différentes de celles du conteur et de l’écrivain. Lorna Milne
propose ainsi, dans son article « The marron and the marqueur, Physical Space and Imaginary
Displacements in Patrick Chamoiseau’s L’Esclave vieil homme et le molosse», une vision
particulière du marqueur de paroles qui serait en fait une figure marginale:

216
On the contrary, the marqueur, openly identified as Chamoiseau, so far identifies with the marron as to
comment that, at times, his own thoughts and dreams commit marronnage […]. Both as thus presented as
marginal figures establishing themselves in relation to a conformist social and cultural order from which
they must distance themselves (Milne, 2003: 73).
Le marqueur de paroles n’est donc plus, comme certains le laissent penser dans leurs romans,
une figure vaine et dérisoire. À partir du moment où le marqueur cesse de vouloir reprendre la
place du conteur ou de reproduire sa parole, sa fonction change et il devient, comme le
proposent les « vieux-nègres » de L’Esclave vieil homme et le Molosse, un gardien des souvenirs
du passé : « le Marqueur de Paroles est pour eux un gardien du passé. Gouverneur-souvenirs.
Bailleur de nostalgie des âges et des époques, des certitudes et des identités » (Chamoiseau,
2005a : 141) et non pas un reproducteur de parole. On le voit d’ailleurs, dans ce roman dans
lequel la voix matérielle et le dialogue sont quasiment absents, remplacé par la voix de ce
« marqueur » qui, tout au long du roman, raconte au lieu de retranscrire: « je vais, sans craindre
mensonges et vérités, vous raconter tout ce que j’en sais. Mais ce n’est pas grand-chose »
(Chamoiseau, 2005a : 45-46). Celui-ci finit même par confondre sa voix à celle de son
personnage quand, lors d’un soudain changement de focalisation, la narration à la troisième
personne du singulier devient une narration à la première personne. Ce marqueur, qui ne se
limite pas à Patrick Chamoiseau, a donc un rôle important à jouer, celui de préserver tout un
monde antillais, de la manière la plus authentique possible, mais sans se contenter de froidement
reproduire ou retranscrire la parole à la manière de l’ethnographe. Il utilise donc l’oraliture pour
« raconter » par écrit une fiction pourtant ancrée dans le réalisme ethnographique qu’il convient
de préserver tout en lui donnant une portée symbolique et mythique en la transmettant vers ses
lecteurs. Racontant ce que d’autres lui ont rapporté, il remplace la froideur scientifique de
l’ethnographe par le ton de la conversation et l’expression de ses propres doutes ou ceux,
anticipés, du lecteur, comme l’exprime par exemple la narratrice de La Grande Drive des esprits

217
qui, malgré ses propres opinions quant au phénomène qu’elle rapporte – la transformation de
Ninette en sainte Manman Ninette – cherche à reproduire fidèlement ce qu’elle a entendu :
« Peut-être croyez-vous qu’il s’agit là d’affabulation et que cette scène hâtivement brossée ne
reflète point la vérité vraie. C’est ainsi qu’on me l’a narrée. Soyez certain que pas une virgule,
point une parole, pas même une marinade n’a été retranchée ou apportée » (Pineau, 1999 : 112).
Ainsi, s’il ne raconte pas forcément ses propres histoires comme le fait le conteur, s’il ne raconte
pas non plus des vérités officielles et historiques comme l’ethnographe ni une pure fiction
comme l’écrivain, s’il n’a pas de spectateurs mais un lectorat, le « marqueur de parole » antillais
s’efforce pourtant, à sa manière, de faire vivre dans les romans l’oralité et l’identité antillaises.
Il semblerait donc que dans le parcours du « marqueur de paroles », depuis les difficultés
exprimées dans Solibo Magnifique jusqu’aux récits antillais de notre corpus dans lesquels il
devient un narrateur et un gardien de la mémoire et de la tradition, se produise un cheminement
naturel de l’auteur. Celui-ci, acceptant son incapacité à reproduire une figure mythique n’ayant
plus cours (le conteur), procède à ce que Laroche appelle une triple transformation : de sa
situation, de son action et de lui-même, ce qui, note Laroche, renvoie à la figure du trickster et
rappelle la notion de « marronnage littéraire » proposée par Lorna Milne :
Quand Glissant recommande la pratique du détour, il propose à l’écrivain de se faire trickster, de
marronner l’écriture traditionnelle et par là de faire entendre la parole créole dans l’écriture de langue
française. Il propose de combiner deux traditions pour une modernité. […] L’écrivain qui pratique le
détour est un trickster, un Ti-Jean, un Bouki. Il ne faut donc pas simplement faire une sociocritique des
œuvres […] mais une narratocritique du réel, voir nos personnages historiques comme des tricksters qui
usent dans le domaine du réel des mêmes armes que les héros des contes (Laroche, 1991 : 45).
En effet, le guerrier doit lutter et se montrer résistant et questionner le réel. L’imaginaire des
« marqueurs de paroles » serait donc, nous dit encore Chamoiseau, l’espace privilégié de

218
nombreux conflits culturels, le champ de bataille identitaire où se déchirent les nombreuses
influences originelles, coloniales, traditionnelles et modernes contre lesquelles ce guerrier de
l’imaginaire doit devenir un « travailleur sur lui-même, affecteur, infecteur, gratteur des failles,
effriteur de muraille, refuseur de conforme, dérouteur de facile, jeteur des germes qui font les
oasis […] » (Chamoiseau, 2002: 305). De ce fait, si l’écrivain/marqueur de parole se détache de
l’oralité traditionnelle, il se détache également de l’écriture de langue française afin d’atteindre
sa modernité en marronnant ces pratiques traditionnelles. Ce n’est que par ce détour de
l’écriture, nous dit ensuite Maximilien Laroche, que le personnage du conteur traditionnel finit
par « survivre » dans l’auteur en transformant sa forme et sa fonction. Cette notion de
transformation en rappelle une autre que l’on trouve à la fin de Écrire en pays dominé, essai
dans lequel Patrick Chamoiseau, en prenant pour exemple le marronnage et la lutte contre la
domination de ses ancêtres, finit par se décrire lui-même non plus comme un marqueur de
parole, mais comme un guerrier de l’imaginaire : « je n’étais plus seulement un ‘‘Marqueur de
paroles’’, ni même un combattant : je devenais Guerrier, avec ce que ce mot charge de concorde
pacifique entre les impossibles… » (Chamoiseau, 2002 : 302). Il n’est donc plus celui qui
reproduit et préserve ou celui qui retranscrit. Il devient actif, celui qui va utiliser les armes
culturelles dont il dispose : l’oraliture, la culture et l’imagination afin de remodeler l’imaginaire
antillais et de l’aider dans sa lutte contre les acculturations et « les dominations nouvelles [qui]
plongent les imaginaires dans une nasse invisible. Agression dans attaque » (Ibid. 303). Il utilise
ainsi un imaginaire qui, en conditionnant l’être et en déterminant l’inconscient, organise le
monde par l’écriture et en offre une représentation nouvelle, spécifiquement antillaise à travers
un filtre culturel et identitaire qui « nous peint une autre réalité, de nouveaux charmes, d’autres
séductions, une autre beauté, poinçonne des éclairages dans les ombres initiales, et couvre
d’ombres des évidences… notamment celles de la domination » (Ibid. 304). Ainsi, comme le
conteur avant lui, mais sur un ton et par un media différent, acceptant l’écriture comme outil du

219
vrai malgré son incapacité à reproduire la parole, l’écrivain antillais serait donc à la fois gardien
des traditions et de la mémoire, mais aussi le peintre d’une réalité autre, non coloniale,
débarrassée des clichés de l’exotisme contre lesquels il lutte. Dépassant ses prédécesseurs
(conteur, ethnographe, écrivain), le guerrier de l’imaginaire propose ainsi, techniquement, une
vision nouvelle et peut-être plus authentique de l’identité antillaise. Une fonction que nous
allons tenter d’étudier dans les romans de corpus qui, selon nous, se placent dans la tradition de
ces « romans marrons » qui subvertissent de nombreux aspects de la littérature et de la culture
antillaise traditionnelle tout en proposant un nouveau regard sur elle-même, notamment par
l’intermédiaire de la (re)création de mythes originels antillais. Ainsi, par ses fonctions
spécifiques de (re)construction d’un patrimoine mythique et culturel, l’écrivain contemporain,
ce guerrier de l’imaginaire, pourrait bien devenir, dans un étrange retour aux origines, une figure
aux fonctions semblables à celles des conteurs du temps de l’esclavage : « by equating his
imagination with a form of cross-cultural knowledge and transcendental understanding, the
marqueur presents himself as a visionary for the collectivity, having the authority to speak for
it» (Garraway, 2006: 163). Ce n’est donc pas un hasard si ces objectifs rappelent ceux mis en
place par Bernabé, Chamoiseau et Confiant dans leur Éloge de la Créolité, ouvrage qui propose
aux Antillais de développer une vision différente d’eux-mêmes, une vision intérieure rejetant
absolument les influences et regards négatifs causés par l’acculturation coloniale, afin de
redécouvrir leurs identités véritables et de donner, comme avec le conteur mythique, une image
d’eux-mêmes appelant que l’on s’en inspire.

220
3.3 Le Marqueur de paroles et l’écriture des mythes dans les romans : hypothèses
Pourquoi les écrivains antillais contemporains utilisent-ils les mythes ? Quel serait, pour
eux, l’intérêt de les intégrer à leurs romans ? Rappelons que, comme nous l’avons proposé dans
notre introduction, la spiritualité et les contes ayant été des moyens essentiels à la survie
identitaire et culturelle des esclaves et de leurs descendants, il peut sembler naturel que les
auteurs attachent également une certaine importance aux mythes surtout que ceux-ci ont une
« valeur d’exemplarité » (Wunenburger, 2005 : 70) et que, de manière générale tout récit porte,
pour celui qui le transmet, valeur et vérité. C’est là un fait d’autant plus important dans une
culture qui, comme la culture antillaise, a connu et continue de connaître une acculturation et
des troubles identitaires. De plus, comme le note encore Jean-Jacques Wunenburger, les mythes
sont également, pour les auteurs, des lieux privilégiés de l’imagination : « un climat créatif, une
dynamique opérative, parce qu[‘ils] ouvrent par eux-mêmes un espace de création »
(Wunenburger, 2005 : 70) qui, comme nous allons le voir dans nos prochains chapitres, permet
aux auteurs de mettre en valeur l’aspect « mythique » de certains faits de l’histoire antillaise
mais aussi, et surtout, de créer de nouveaux mythes là où il n’y avait qu’un manque, un vide. Si
la fascination de l’artiste pour le mythe « peut se comprendre comme une attirance vers
l’originel » (Chamoiseau, 2002 : 71), on peut déjà apercevoir pourquoi ils sont si présents dans
les romans de culture caribéenne française dans lesquels cette notion « d’originel » est, entre une
mémoire effacée et une réalité historique troublée, difficile à cerner. Hypothétiquement, le
mythe serait donc pour l’écrivain antillais, ce « guerrier de l’imaginaire », une matrice créatrice,
culturelle et identitaire qui, tout en lui permettant d’utiliser l’oraliture, lui permettrait également
de combler les vides créés par l’acculturation esclavagiste, d’« explorer les béances d’une autre
géométrie, relier le connu aux inconnus dont on recueille les marques comme autant de légendes
avortées » (Chamoiseau, 2002 : 69) selon ses propres besoins théoriques et sa propre voix.

221
Au-delà de l’idée de culture, du réalisme historique et culturel et de la préservation du
patrimoine, les auteurs antillais, se trouvant face aux vides culturels et aux absences, se devrait
donc aussi d’avoir recours à son imaginaire pour construire, ou encore reconstruire, l’identité
antillaise par divers mythes écrits. Essayant par l’écriture littéraire de (ré)inventer une tradition
s’inspirant de l’art du conteur antillais d’antan afin d’explorer leur patrimoine, de le protéger et
de le consolider, ils lui donneraient des bases esthétiques solides, au croisement de l’écrit et de
l’oral et du réel et du mystique tout en recréant et en redéfinissant la nature même de cet
héritage identitaire et culturel. Ce guerrier de l’imaginaire, que Chamoiseau théorise et dont on
retrouve la marque chez de nombreux auteurs, a beau ne pas avoir la valeur sociale du conteur
d’antan (devenu, lui, une figure mythique de la culture antillaise), on ne rejettera cependant pas
cette idée répandue par les auteurs antillais que tout écrit est inférieur à toute production orale.
L’écriture de romans, de récits antillais et le remplacement de vides historico-culturels par des
éléments de l’imaginaire ne devraient pas non plus être rejetés comme les ersatz dérisoires d’une
oralité perdue, mais devraient au contraire être perçus comme un processus de remise en
question et de (re)création (par l’écriture, l’imaginaire et les mythes nouveaux), de tout un
visage de la culture et de l’identité antillaises. Cependant, la question de la valeur des mythes
écrits par rapport aux mythes oraux retient notre attention dans le cadre de l’étude de la
littérature et de la culture antillaise. Ces mythes nouveaux, créés par l’écriture et non l’oralité,
ont-il une valeur spécifique dans le contexte antillais ?
Comme nous l’avons déjà vu, le passage de l’oral à l’écrit est un véritable
bouleversement narratif dans lequel le narrateur se substitue au conteur et dans lequel
l’énonciation s’inscrit dans un texte romanesque. Cette transition a des conséquences sur la
symbolique du conte ou du mythe, qui est alors transmise en même temps que le récit lui-même,
contrairement au récit oral dans lequel le sens peut être transmis selon le bon vouloir du conteur

222
avant, pendant ou après l’énonciation (lors de l’explication de la « morale » du récit, par
exemple). Ainsi, comme le note Xavier Garnier, le roman est, par son caractère écrit, un récit
fictif qui contient son propre sens : « le roman acquiert une autonomie, matérialisée par le livre,
qui est fait pour voyager. Le roman porte avec lui un monde, que l’on qualifiera de fictionnel »
(Garnier, 1999 : 4). Il fonctionne selon un circuit fermé sur lequel l’auteur ne peut quasiment
plus agir après la publication. En étant publié, et en dépassant ainsi les limites géographiques et
culturelles de sa société d’origine, le roman s’ouvre théoriquement au monde et se donne ainsi
un sens peut-être plus universel contrairement à un conte oral qui, limité par sa situation
d’énonciation, restera plus directement lié à la société qui l’a vu naître. Le passage d’un mythe
oral à un mythe écrit aura également d’autres conséquences et le premier détail important que
l’on pourrait noter concernant l’écriture du mythe est d’abord l’ambivalence de cette tâche : en
passant d’une oralité ancestrale à l’écriture, ou en passant directement de l’imaginaire de
l’auteur à l’écriture, le mythe perd en effet de sa valeur temporelle cyclique pour se fixer dans le
texte littéraire. Plus encore, il devrait perdre également sa valeur originelle (dans le cas d’un
mythe ancien) pour subir une forme de déformation thématique et temporelle. En plus de faire
référence à un aspect culturel spécifique, il servira aussi et surtout à illustrer un aspect littéraire
de l’œuvre dans laquelle il se trouve et, le révélant, perdra en partie son aspect sacré. Ainsi, si le
mythe raconte un fait originel, comme quelque chose qui est venu à l’existence, l’auteur
l’utilisera également de manière littéraire pour soutenir un argument identitaire ou culturel. Les
mythes reproduits dans les romans n’auront ainsi ni la valeur originelle donnée par l’oralité, ni
la valeur complètement figée généralement transmise par l’écriture. De ce fait, comme le
propose Jean-Jacques Wunenburger dans son approche mythocritique, la forme romanesque
marque le triomphe de la civilisation occidentale, de la subjectivité, du désenchantement et de
l’imagination fictionnelle : « l’expression littéraire, loin de se réduire à un processus de
démythisation du monde, permettrait [cependant] d’assurer une transfiguration positive de

223
certains contenus mythiques et, par conséquent, leur pérennisation » (Wunenburger, 2005 : 76).
Il y aurait ainsi dans la littérature, et plus précisément dans la littérature antillaise qui nous
intéresse ici, un retour au mythe. Ce retour aurait une certaine intention évidente vis-à-vis de
l’identité mais aussi vis-à-vis de la fiction elle-même puisque «l’écrivain, en adaptant une
matrice mythique de référence, remythise ainsi la littérature, au sens où il reconnaît que le
mythe offre une charge symbolique inégalée et inégalable par l’imagination individuelle »
(Wunenburger, 2005 : 79). Contrairement à ce que pourraient laisser penser les auteurs dans
leurs écrits théoriques et leur désir de sauver le conteur et l’oralité, il n’y aurait pas dans
l’écriture du mythe un désir de retour à une tradition orale et mythique perdue mais, bien au
contraire, un dépassement de celle-ci et une tentative de libération. C’est ce qu’illustre par
exemple Maximilien Laroche dans son approche du thème du zombi dans les romans haïtiens
dans lesquels
Le romancier qui nous peint des zombis en est un lui-même puisqu’il s’efforce de trouver, au sein même
de sa condition, les moyens de sa libération. Traditionnel, il essaie de trouver les moyens de se moderniser
à l’aide de sa propre tradition. Oralitaire, il écrit pour trouver l’écriture qui s’ajusterait à son oralité […]. Il
joue, crée, fait advenir sa condition sur une double scène : passée et présente (Laroche, 1991 : 25-26).
Du conteur à l’écrivain, il y aurait donc un mouvement de retour sur soi et une forme
d’évolution naturelle qui n’en serait qu’à ses débuts théoriques. Ainsi, de par son utilisation des
mythes écrits et de l’oraliture, la littérature antillaise serait bien plus qu’une simple entreprise de
sauvetage ethnographique d’un patrimoine culturel menacé. L’écrivain ne se fait plus seulement
« le simple héraut posthume d’un mythe mort, [puisqu’il] renoue avec l’ensemble des
procédures de variation et de différenciation de la narrativité mythique afin de faire apparaître
en filigrane une nouvelle histoire, inédite» (Wunenburger, 2005 : 79). Les auteurs antillais ne
sont donc pas seulement des ethnographes collectionneurs d’antiquités culturelles et

224
folkloriques. Ils reprennent ces éléments dans leurs romans, se les approprient afin de créer des
histoires, des personnages et, comme nous allons le voir, des mythes qui, créés ou recréés, leur
appartiendront et leur permettront de mettre en place leurs propres discours et de donner aux
mythes et aux contes de nouvelles valeurs, peut-être plus appropriées au monde contemporain.
Conclusion de la deuxième partie
Si du temps de l’esclavage la parole devait être voilée, cachée du Béké et si celle-ci ne se
déroulait que la nuit dans les Plantations, les temps ont bien changé et le principe même de la
publication des œuvres ouvre le discours/conte/mythe à un plus large public. Si l’écrivain
antillais qui les produit admet souvent son incapacité et son impuissance à reconstituer le mot
exact du conteur et à rendre compte parfaitement de l’oralité, son imprégnation par le conte et le
mythe n’en symbolise pas moins la nécessité culturelle et identitaire d’un retour à l’histoire
racontée et aux mythes eux-mêmes. Originellement nocturne ou sacrée, magique et mythique,
l’oraliture prendrait, par son transfert vers l’écrit, une valeur lui permettant d’éviter le destin de
Solibo et la mort du langage et de l’identité antillaise traditionnelle. Le conte, le mythe et la
figure du conteur dans les romans antillais du réalisme mystique/merveilleux représentent donc
un double paradoxe : incarnations d’un contre-discours culturel originel luttant contre les formes
imposées par l’histoire, ils se révèlent incapables de survivre dans la société contemporaine dans
laquelle contes et mythes oraux sont remplacés par les romans. Ces romans, dans lesquels les
écrivains se disent incapables de prendre le relais des conteurs, les élèvent pourtant au rang de
mythe. Cependant, cette reconnaissance de l’impuissance à maintenir un modèle traditionnel ne
coïncide aucunement avec une perte du pouvoir de la parole, remplacée par les mots. Bien au
contraire, en jouant avec les principes de l’oralité, les auteurs antillais comme Patrick

225
Chamoiseau ou Édouard Glissant défient en effet les visions doudouistes des Antilles de même
que les forces acculturatrices françaises. Incorporant des termes créoles, mêlant les principes de
l’oralité à ceux de l’écriture, les auteurs remettent ainsi en question les canons du roman
traditionnel tout en réaffirmant une certaine continuité (dont ils n’ont pas toujours conscience)
entre l’oralité et l’écriture : « between orality and writing, between an “authentic” and
historically defined Creole identity and the emerging literary, cultural, and political traditions of
Creoleness » (Seifert, 220). Comme le conteur du temps de l’esclavage et les premiers écrivains
qui ont suivi, l’écrivain contemporain serait ainsi une figure adaptée à son temps dont la
fonction de remise en question de l’identité antillaise et ses apports à la culture antillaise
d’aujourd’hui sont essentiels à la question identitaire. Ainsi, son moyen d’expression, l’écriture,
lui permettrait d’atteindre non pas une perte des mythes et contes originels mais plutôt leur
transfiguration par l’écriture. Il devient aussi créateur et initiateur de nouvelles entreprises
littéraires et culturelles qui lui permettent de trouver une liberté nouvelle et de résister aux
influences acculturatrices de l’extérieur : « Ta liberté n’est qu’apparente, me disait-il souvent [le
vieux guerrier]. Tente, au plus loin de toi-même, de déceler ce qui agite ta voix. Tu ne sauras
rien du mystère de l’Écrire mais tu auras pensé ce qui chez toi le mobilise. Et ton art, qui doit
résister à toute domination, trouvera une liberté réelle dans cette pensée marronne »
(Chamoiseau, 2002 : 23). Comme nous allons maintenant le voir, cette liberté et cette résistance
s’illustrent dans une remise en question et une mythisation de certains aspects de l’Histoire
coloniale et de la terre antillaise, bref, par une utilisation de l’imaginaire qui permettra aux
auteurs de dépasser le réalisme ethnographique pour réécrire leur origine et réinventer leur
identité.

226
Troisième partie
La reconstruction mythique et identitaire de la terre natale
dans les romans antillais
De la dualité du regard exprimé par le réalisme mystique au jeu de l’oralité et de
l’écriture dans les procédés littéraires de l’oraliture, la littérature antillaise apparaît comme une
constante oscillation théorique et une fusion de fait entre deux réalités majeures héritées à la fois
des populations déportées et des colons occidentaux. Celles-ci, bien que distinctes et
apparemment opposées, n’en ont pas moins participé à la création du « réalisme mystique » : un
mode d’expression spécifiquement antillais en pleine construction de lui-même et en pleine
création de mythes. Abordant les aspects externes de cette littérature, son mode d’expression et
ses inspirations narratives, nous ne nous sommes cependant pas encore aventurés à explorer son
contenu, ses thématiques et ses créations mythiques. Si la figure du Conteur, que nous avons vue
dans notre précédente partie, est principalement un mythe produit par la lutte des auteurs pour la
préservation de l’oralité suite à la rupture originelle, nous n’avons pas encore étudié la nature
des créations de leurs descendants, les écrivains. Or, la notion d’origine est, aux Antilles, bel et
bien problématique car le monde antillais et sa littérature orale d’origine auraient perdu leur
dimension sacrée et mythique : «the important mythic stories, legends and epic stories
disappeared completely with deportation […] removing from the individuals their sense of the
past, of lineage, and of History, as well as the mythic and legendary origins of their people or
their race » (Corzani, 1994 : 132). Ainsi, à part quelques manifestations du surnaturel (zombis,

227
dorliss…) qui ne semblent avoir qu’une fonction folklorique, nous avons dit qu’il n’y aurait pas,
aux Antilles et dans la littérature antillaise, de mythes originels. Or, comme nous l’avons dit, les
mythes renforcent l’identité collective et l’appartenance à un lieu par la présence d’une base
mythique et narrative. Ils constituent une somme essentielle de savoir, dont la perte
équivaudrait, selon Eliade, à un désastre identitaire et culturel. Ainsi comment, en l’absence de
ces narrations fondatrices et originelles, les auteurs (et par conséquent le peuple antillais)
peuvent-ils se réclamer d’une identité collective ? Comment peuvent-ils accepter cette terre
comme la leur quand leurs ancêtres viennent d’ailleurs et qu’ils en ont, pendant des siècles
d’acculturation et d’esclavage, été aliénés ?
Au début de son Introduction à une poétique du divers, Édouard Glissant constate que
malgré les silences et les absences, malgré les ruptures, le paysage caribéen est littéralement
saturé de mémoire(s) et qu’il « a conscience des drames humains et collectifs ou privés qui s’y
[sont] accumulés » (Glissant, 1996 : 11). Ce paysage aurait-il un rapport à l’histoire antillaise et
à son identité ? Comme nous allons à présent le voir, les auteurs antillais, ces guerriers de
l’imaginaire, ont utilisé la rupture originelle et la déportation sur une terre qui ne leur
appartenait pas comme moteur de création. Il se sont inspirés de leurs rapports à l’Histoire
coloniale et à l’espace antillais pour tenter de se reconstruire et de se réapproprier par le mythe
ce qui leur a été enlevé : une origine. C’est ainsi que les trois chapitres de cette dernière partie
auront pour but d’analyser comment les auteurs antillais, après s’être approprié le mode réaliste
mystique et le style de l’oraliture, utilisent ces outils littéraires antillais pour créer des mythes
antillais leur permettant une réappropriation mythique et identitaire de la terre antillaise.
Travaillant sur des éléments historiques et géographiques ayant, dans les romans, des enjeux
identitaires et culturels essentiels, nous verrons comment des motifs « obsessionnels de
l’écriture romanesque » (Simasotchi-Bronès, 2004 : 7-8) comme la déportation initiale, le

228
rapport avec la France et avec l’île natale, ou encore la représentation d’une figure littéraire
comme le marron, révèlent un véritable manque tout en fondant des mythes nouveaux et en
permettant la (re)construction de l’identité créole. Ainsi, étudiant les (re)mythisations de
certains personnages et événements symboliques et de l’espace antillais, nous allons tenter de
voir dans cette partie comment certains romans antillais parviennent à récupérer le réel antillais
par l’imaginaire réalisme mystique pour le recomposer à travers une substance mythique
travaillée par l’écriture. Étudiant d’abord le rapport culturel et identitaire que les romans
établissent avec l’Afrique et la France, nous verrons dans notre septième chapitre comment
certains de ces récits tentent, par une forme de double rejet, de recréer une origine mythique
pour les peuples antillais. Cette approche nous conduira à étudier, dans un huitième chapitre, le
rapport problématique et violent que les auteurs antillais entretiennent avec leurs îles, ces seules
terres qu’ils peuvent appeler « terres natales » mais qui demeurent pourtant marquées dans les
consciences par une symbolique de l’enfermement, de la souffrance et de l’aliénation.
Cependant, comme nous le verrons dans notre dernier chapitre, c’est sur cette terre que se
dessinent, pourtant, des moyens de fuite et de préservation identitaire, incarnés par des lieux qui,
isolés, mystérieux, riches en magie et en esprits anciens, s’inscriront dans l’inconscient comme
les derniers refuges de l’identité antillaise.

229
Chapitre 7 Ni Africain ni Français: la réécriture d’une genèse antillaise
Prise entre l’Afrique des origines historiques et un statut officiellement français,
l’identité antillaise se définirait entre une origine éloignée dans le temps et l’espace et, depuis la
départementalisation, par un présent symbolisé par l’éloignement de la Métropole. Les grèves
générales qui ont secoué la Guadeloupe et la Martinique lors du premier semestre 2009 ont
rappelé à la France certaines stratifications économiques et sociales en faisant, par exemple,
ressortir l’image du béké, cette ancienne classe de maîtres dont l’influence économique et la
domination du temps de l’esclavage sont encore d’actualité: « l'esclavage a disparu mais ils sont
restés les maîtres, de père en fils » (Gurrey, Hopquin, 2009: n/a). Comme l’a montré cet
événement, les Antilles ont beau faire partie de la France, elles n’en sont pas moins liées à un
ancien modèle colonial né de la séparation maîtres/esclaves décrite dans la plupart des romans
antillais de notre corpus : un rapport de force économique qui se perpétue depuis le temps de
l’esclavage et qui se base entièrement sur une dualité identitaire et culturelle. Cependant,
comme nous l’avons vu dans nos précédentes parties, cette dualité thématique1 a permis à la
littérature antillaise de se développer à travers le réalisme mystique et l’oraliture et donc
d’utiliser cette opposition pour l’élaboration d’une identité littéraire antillaise. Ainsi, suivant ce
raisonnement pour l’appliquer au contenu thématique des romans, nous pouvons nous demander
1 Rappelons ici que, au-delà de la complexité et de la richesse culturelle antillaise décrite par les auteurs de la Créolité, l’opposition entre les deux populations majoritaires, descendants des esclaves et des colons occidentaux, est un thème récurrent de la littérature antillaise contemporaine.

230
si la notion d’identité, telle qu’elle est représentée dans les romans, va se contenter d’une dualité
originelle France/Afrique, esclaves/békés ou si elle va, au contraire, proposer la mise en place
d’une nouvelle identité, plus antillaise. Comme tentera de le démontrer ce chapitre, les rapports
mis en place par les auteurs entre leurs personnages et les pays du triangle Afrique, France,
Antilles, la notion d’identité est, dans les romans antillais, loin d’être facile à déterminer.
Analysant dans nos deux premières parties comment, dans leurs romans, les auteurs Antillais
repoussent l’Afrique et la France vers les domaines du fantasme et de l’imagination, nous
verrons comment ils entreprennent également un recentrement mythique de leur identité sur les
Antilles par une réécriture mythique des images traditionnelles et historiques de la traversee de
l’océan à bord des navires négriers qui, dans les romans, semblent devenir des éléments
fondateurs de l’identité antillaise contemporaine.
1 Redéfinition de l’origine historique dans les romans antillais
1.1 Représentations de l’Afrique de la Négritude à la Créolité
L’Afrique est omniprésente dans toute la littérature antillaise. Nombreux sont les romans
dans lesquels les personnages pensent à cette terre originelle, rêvent d’elle, ou encore se
l’imaginent. Poétique, fantasmée, mémoire directe ou vague souvenir ancestral, elle est « le
premier fondement d’une culture » (Toureh, 1986 : 165), l’origine de la majeure partie de la
population antillaise et donc un des fondements de l’identité antillaise contemporaine. Ce
continent originel a également une importance cruciale dans l’histoire des littératures antillaises.
Il est en effet au cœur des théories de la Négritude qui, depuis Césaire et son Cahier d’un retour
au pays natal (1939), se sont recentrées sur ses liens identitaires et ancestraux avec les Antilles à
une époque où l’Antillais d’origine africaine avait du mal à se définir par rapport à l’Antillais
occidental: « À force de penser au Congo /Je suis devenu un Congo bruissant de forêts et de

231
fleuves » (Césaire, 2000: 12). Ce lien entre l’Afrique et les Antilles est d’autant plus important
que, comme l’explique Franz Fanon, « jusqu’en 1940 aucun Antillais n’était capable de se
penser nègre. C’est seulement avec l’apparition d’Aimé Césaire qu’on a pu voire naître une
revendication, une assomption de la négritude » (Fanon, 1971 : 125). De ce fait, depuis Césaire
et son retour poétique, identitaire et spirituel aux origines historiques ancestrales, on retrouve
souvent, dans les romans, un sentiment fort d’appartenance à l’Afrique. Si ce sentiment est plus
évident dans un roman haïtien comme Le Mât de cocagne de René Depestre qui utilise le
vaudou pour évoquer le rapport à l’Afrique, « la miséricorde des loas d’Afrique est avec
nous ! » (Depestre, 1998 : 134), on en retrouve cependant des traces dans les œuvres de la
Créolité comme Le Meurtre du Samedi-Gloria de Raphaël Confiant, dans lequel Romule
Beausoleil a besoin de retrouver un contact physique avec l’Afrique pour devenir champion de
damier: « la force d’Afrique-Guinée montait en volutes au-dessus de sa tête et se déployait en
vagues brûlantes sur son corps, le mettant dans une transe irrépressible » (Confiant, 1997 : 96-
97). Ce type de rapport à l’Afrique, originellement proposé par le mouvement de la Négritude,
définit donc les Antillais comme des êtres essentiellement africains arrachés à ce continent
originel. Il s’agit donc d’une identité se fiant essentiellement à l’origine historique et ne prenant
pas réellement en compte la possibilité d’une identité liée à la terre natale. L’Antillais n’aurait
donc de valeur et de substance qu’en rapport avec son origine historique africaine et ce n’est
qu’en se tournant vers celle-ci qu’il peut retrouver les forces identitaires perdues par
l’acculturation esclavagiste et remplir le vide de son présent antillais:
It is the original historical displacement from Africa that determines, shadows and haunts Césaire’s present
idea of Caribbean place as indeterminate and empty. […] Africa, to Césaire, represents profundity and
substance, and it is largely through evoking the mythical mother continent that he seeks to fill the void of
the Caribbean present. (Munro, 2003: 146)

232
Ce rapport privilégié à l’Afrique originelle illustre le manque essentiel de l’histoire caribéenne
en révélant le vide, l’incertitude culturelle et identitaire nées de la « coupure béante,
irréversible» (Glissant, 2002 : 26) à cause de laquelle tout lien et tout espoir de retour ont été
annihilés au moment de la déportation. Ce désir de recréer un contact avec l’origine, théorisé par
les auteurs de la Négritude, est d’autant plus important si l’on considère la valeur mythique que
possède généralement la terre natale d’un point de vue culturel et identitaire. En effet, puisque
« l’enfantement des humains par la Terre est une croyance universellement répandue » (Eliade,
2004 : 121), la séparation d’avec la terre natale a été, pour les déportés africains (comme pour
les engagés indiens), traditionnellement perçue comme un sacrilège:
What matters most to the people is what is geographically near […] the land provides them with the roots
of existence, as well as binding them mystically to their departed. […] To remove Africans by force from
their land is an act of such great injustice that no foreigner can fathom it. (Mbiti, 1969: 27)
L’esclave a donc, par son arrachement à l’Afrique, été coupé de cette mère symbolique. C’est là
un sentiment que confirme Édouard Glissant dans ses écrits : « nous rêvons tous de Gorée,
comme on rêve de la matrice d’où on a été exclu : sans le savoir vraiment » (Glissant, 2002 :
827). Cette perte de l’origine et l’imposition d’une nouvelle terre, les Antilles, et d’une nouvelle
condition, l’esclavage, a ainsi entraîné la perte du sentiment d’autochtonie et d’un «sentiment de
structure cosmique qui dépasse de beaucoup la solidarité familiale et ancestrale » (Eliade, 2004 :
122). Tragiques à bien des égards, les notions de rupture et le désir de retour au continent
originel, exprimés par les auteurs de la Négritude et leurs successeurs, auraient comme l’origine
d’une souffrance à la fois physique, culturelle, identitaire et spirituelle née de la perte du
sentiment d’appartenance à une origine et à une identité. Il apparaît donc que la richesse du lien
à l’Afrique dans les écrits de la Négritude a eu comme but essentiel un désir de renouer avec

233
cette origine, cette terre matricielle qui, dans un monde d’acculturations et de domination békée
semblait le seul espoir identitaire.
Si l’on suit le développement de l’histoire littéraire antillaise après Césaire, on peut
cependant s’apercevoir que plus on s’éloigne du mouvement de la Négritude, plus le
rattachement au continent africain perd de son importance. En effet, pour un certain nombre
d’auteurs et de chercheurs relevant du mouvement de l’Antillanité ou de la Créolité, le
rattachement complet à l’Afrique, monolithique, serait symptomatique d’un refus d’avancer vers
une identité nouvelle, caribéenne, plus hétérogène et ouverte sur le monde et l’avenir.
Contrairement aux ouvertures vers la multiplicité des relations que proposent l’Antillanité (vers
le monde méso-américain) et la Créolité (vers le monde créole en général), la Négritude est donc
essentiellement centrée sur une source identitaire originelle unique qui nuirait à un véritable
retour sur soi: « the fascination of Antilleans or black North Americans with Africa leads to a
dispossession of one’s self and one’s history and to a refusal to ‘‘conquer’’ one’s own America»
(Praeger, 2003: 54). On retrouve une illustration littéraire de cette mise à distance de la terre
originelle dans le roman Les Derniers Rois mages de Maryse Condé, dans lequel l’Antillais
Spéro – personnage supposément de sang royal, fils illégitime de Béhanzin, un roi africain en
exil – ressent moins d’attachement à ce passé africain qu’à sa terre natale, la Guadeloupe. Il est
ainsi aliéné et dénigré par les personnages qui, comme sa femme Debbie et de nombreux
personnages américains, sont nostalgiques de cette Afrique ancestrale et vivent dans un passé
africain glorieux : « the workings of the myth of Africa manifest themselves […] within a
contradictory and competitive form of alienation among members of the black community»
(Praeger, 2003: 54-55). Ainsi, si l’Antillanité et la Créolité s’opposent sur l’étendue du monde
créole, ces deux mouvements prennent avec beaucoup de précautions le rapport à l’origine
ancestrale africaine qui pousserait les Antillais à rechercher leur identité dans un pays lointain et

234
étranger. Ce rapport à une origine illusoire explique ainsi que les romans de notre corpus ne
proposent pas tous une image positive et forte de l’Afrique, mais remettent en question son rôle
vis-à-vis de l’identité.
1.2 L’Afrique entre le vague et l’oubli
Si l’Afrique physique n’est quasiment jamais décrite dans les romans de notre corpus2, il
apparaît que les réflexions et descriptions que l’on en trouve sont souvent de seconde main et
qu’elles se basent essentiellement sur des clichés et sur une certaine ignorance de la part des
personnages. On peut observer ce phénomène à travers les références à la polygamie « en
Afrique, d’où nous venons tous, chacun a droit à son comptant de femmes, à autant d’entre elles
que ses bras peuvent étreindre » (Condé, 2004 : 57) ou aux villages de cases de bois : « s’aidant
de ses souvenirs de cartes postales, Spéro essaya de l’imaginer dans un décor rouge de cases
rondes en banco, sans froidure, ni pluie ni grand vent» (Condé, 1995 : 164). Parfois, par un
ironique mouvement de renversement, la représentation de l’Afrique perçue est tellement proche
des stéréotypes et des idéalisations qu’elle ne paraît plus réelle. C’est ce qu’on voit par exemple
dans Ti Jean l’Horizon dans lequel le héros, lors de son retour en Afrique après son avalement
par la Bête, est si troublé par cette conformité aux représentations stéréotypées qu’il se demande
s’il ne rêve pas3:
Tout cela était si conforme qu’il se demanda si cette Afrique ne naissait pas de ses songes, au fur et à
mesure qu’il foulait de son pas tranquille les hautes herbes dégoûtantes de rosée […] Tout à coup, comme
2 Seul les romans Nègre marron de Raphaël Confiant et Ti Jean l’Horizon décrivent et détaillent certains aspects de l’Afrique, même si l’Afrique visitée par Ti Jean est, littéralement, dans le ventre d’une Bête magique. 3 Notons ici que cette Afrique visitée par Ti Jean n’est pas réelle à proprement parler. Située dans un vague passé colonial, Ti Jean n’y accède qu’après avoir été avalé par une Bête, ce qui pourrait expliquer le caractère onirique de cette scène.

235
il contournait un bosquet étincelant, aux feuilles pareilles à des flammes vertes, dans la lumière de l’aube,
il revit une des scènes les plus attrayantes de son livre en couleurs sur l’Afrique. (Schwarz-Bart, 1998 :
142)
Si l’on en croit l’étude de Fanta Toureh, L’Imaginaire dans l’œuvre de Simone Schwarz-Bart,
Approche d’une mythologie antillaise, cette vision pourrait bien signifier le sens profond de la
quête de Ti Jean dont le cheminement serait une descente dans son propre psychisme, mais aussi
une critique de ce retour vers l’Afrique qui, entre pures inventions, fantasmes et clichés
reproduit « un archétype idéal : [qui] ouvre sur le passé, non sur l’avenir » (Toureh, 1986 : 151).
Ainsi l’Afrique perçue par Ti Jean et, par extension, par les autres personnages de notre corpus,
serait non pas une représentation réaliste mais, au contraire, imaginaire qui n’aurait que peu de
rapports avec le réel. Il y aurait donc, dans ce type de représentations, une illusion, un fantasme
rappelant, par son apparence idéale, un locus amoenus, un lieu paradisiaque, comme on le voit
également avec l’Inde visitée en rêve par Ferdine dans Le Meurtre du Samedi-Gloria :
Elle rêva qu’elle voyageait dans l’Inde heureuse dans un nuage de pétales de roses et de bougainvillées,
accompagnée de chants de gloire et qu’elle faisait ses ablutions dans un fleuve si immense qu’il semblait,
à l’horizon, avaler le ciel. Des tambours-matalon résonnaient dans la voûte des manguiers gigantesques et
une musique céleste enveloppait les êtres et les choses. Que la terre indienne était douce ! (Confiant,
1997 : 158).
Comme l’indique Chamoiseau dans son ouvrage Écrire en pays dominé, il se créerait ainsi, dans
ces souvenirs et ces rêves de l’origine, non pas une Afrique (ou une Chine ou une Inde) réelle,
mais une forme de mythe, de symbole puisqu’ « elles ne reconstruisirent nulle Afrique au pays,
mais tissèrent le pays d’un scintillement d’afriques mouvantes, en dérive dans leurs diversités
propres, et en dérive dans toutes les autres » (Chamoiseau, 1997 : 139-140). Cette constatation a
de ce fait des conséquences importantes vis-à-vis des représentations littéraires de l’Afrique : si
tout rapport privilégié à l’Afrique nie le lien aux Antilles, tout rapport à une Afrique rêvée et

236
idéale niera nécessairement tout lien au continent réel. Il y aura donc une déformation du regard
qui entraînera par exemple la déception de la fille de Spéro dans Les Derniers Rois Mages de
Maryse Condé: « car, passé l’enthousiasme des premiers temps, elle déchantait. L’Afrique
n’était plus dans l’Afrique. […] Seules, dans le temple de Dan, les prêtresses aux seins flasques
honoraient la mémoire du passé. […] Pouvoir noir, pouvoir blanc, cela ne signifiait plus rien »
(Condé, 2000 : 257-258). Loin d’être un phénomène littérairement isolé, cette mise à distance
d’une Afrique vague et stéréotypée est un phénomène répandu dans la littérature antillaise
contemporaine.
À ce type de représentations stéréotypées s’ajoutent également, dans les romans, toute
une série de représentations vagues et incertaines qui nous rappelle l’analyse de l’amuseur
public proposée par Confiant dans Les Maîtres de la parole. Plutôt que d’être l’héritier du griot,
qui se voulait historien et hagiographe, le conteur créole est, nous l’avons vu, l’héritier de
l’amuseur public, ce qui expliquerait l’absence de précisions sur l’Afrique perdue. Les
romanciers antillais pourraient bien avoir eux aussi hérité de ce trait puisque, dans leurs romans,
l’Afrique n’est pas toujours mentionnée ou demeure vague. Ils y font parfois référence comme
le « Grand Pays » (Chamoiseau, 2004 : 151) ou « le pays d’avant » (Glissant, 2002 : 36), ce qui
exprime bien l’incertitude dans laquelle il baigne. En effet, si les personnages d’origine africaine
viennent d’un même continent, ils n’ont presque jamais d’indications sur la région, le village ou
l’ethnie d’origine : « lequel de mes ancêtres avait connu ces fers ? D’où venait-il exactement ?
Son nom ? Sa langue ? Tout était effacé…» (Pineau, 2000 : 114-115). Malgré quelques rares
précisions historiques ou géographiques, comme avec les parents de Tituba qui sont ashanti ou
Man Yaya qui est nago, les détails demeurent généralement vagues. À cette incertitude
géographique s’ajoute ensuite l’incertitude historique de cette notion « d’avant » qui insiste sur
l’idée que, si le transbord des esclaves a bel et bien tracé une démarcation entre le temps présent

237
de l’esclavage et le temps passé de l’Afrique, ce temps ne se divise pas en dates précises mais
entre un « avant » et un « après » cet événement crucial. Ainsi, entre ces absences, ces
indéterminations et ces images stéréotypées, nous voyons que, contrairement à l’Afrique forte,
noble, décrite comme pivot identitaire par Césaire, les auteurs plus récents, et en particulier les
auteurs de la Créolité, évitent tout ancrage africain, si bien que ce continent tend à devenir un
symbole d’absence et de l’oubli : « et aucun de nous ne connaît ce qui s’est passé dans le pays
là-bas au-delà des eaux, la mer a roulé sur nous tous, même toi qui vois l’histoire et les tenants.
Voilà. Nous appelons cela le passé. Cette suite sans fond d’oublis avec de loin en loin l’éclair
d’un rien dans notre néant » (Glissant, 2002 : 68). L’Afrique devient ainsi un vide de la
mémoire, une absence référentielle qui continue cependant de hanter l’inconscient collectif
antillais. On le voit par exemple dans la description de l’origine de la querelle entre Longoué et
Béluse dans Le Quatrième Siècle. Dans ce passage, pourtant crucial, Glissant parvient à décrire
une série d’événements se déroulant en Afrique sans jamais proposer de détails géographiques :
Ils s’étaient disputés devant la population rassemblée, chacun d’eux avait parlé, mais à la nuit-descendant,
le choix était confirmé. Alors il s’était enfui dans les bois, poursuivi par un grand nombre car il avait
injurié les anciens, invoqué les morts en sa faveur. Puis la vie en solitaire, jusqu’au moment où il avait
tourné autour de la colonne d’esclaves ; et comme les démarcheurs le capturaient prisonnier, il avait
proposé un troc. (Glissant, 1997a : 283)
Oubliant les descriptions du pays originel dans lequel est né ce conflit qui se perpétue dans tout
le roman, Glissant ne se concentre que sur les actions des personnages. Ce n’est que vers la fin
du roman, après son « initiation » auprès de Papa Longoué, que Mathieu sera capable de « voir »
l’origine de manière plus précise. Ce type de représentation, loin d’une idée de réalisme que les
auteurs n’auraient aucun mal à produire, prendrait alors valeur de mythe, comme dans le roman
Ti Jean l’Horizon :

238
Qualifions cette Afrique de mythique, car elle est une représentation sublimée fonctionnant efficacement
dans le réel, jusqu’à un temps donné, puisqu’elle pousse le marron à se battre. […] Le mythe est si limité
qu’il ne fonctionne pas en dehors de la communauté qui l’a engendré : il ne signifie rien pour les gens de
la vallée qui n’ont rien conservé de l’Afrique originelle, et qui se croient sans passé. (Toureh, 1986 :
150)
Ce phénomène d’imprécision descriptive pourrait bien être, dans les romans, directement lié au
réalisme ethnographique et à la nature même du souvenir dans un milieu acculturateur. Tant que
les esclaves directement venus d’Afrique étaient encore en vie, ils gardaient en eux le souvenir
d’une Afrique simplement distante, sous forme de souvenirs, d’images et de sensations.
Cependant, après plusieurs générations d’esclaves nés aux Antilles, le souvenir de la terre
originelle s’est lentement éteint à mesure que ceux qui en avaient une expérience directe sont
morts. En plus de l’impossibilité du retour, ce phénomène s’est encore accentué quand les
esclaves n’ont plus été transbordés et que les seuls souvenirs de l’Afrique se sont transmis à
travers des contes ou des souvenirs indirects et lointains. Jusqu’à la démocratisation des
voyages, les véritables souvenirs ont ainsi été remplacés par des histoires racontées et l’Afrique
originelle s’est perdue dans le temps et dans les mémoires. Cet état de fait explique la présence
dans les romans de personnages ayant connu l’Afrique qui, par ce simple fait, sont décrits
comme des personnages exceptionnels. On le voit par exemple dans Ti Jean l’Horizon avec
Wademba, le « dernier nègre d’Afrique » (Schwarz-Bart, 1998 : 61), dont la mort annonce une
perte culturelle et identitaire: « n’étais-tu pas toi-même le chemin, le seul chemin qui nous
reste ? » (Schwarz-Bart, 1998 : 61). S’ajoutant à l’effacement graduel de l’origine, la mort d’un
tel personnage est particulièrement tragique pour ceux qui, nés aux Antilles, n’ont aucun lien
direct avec l’origine. Sans des personnages comme le premier Longoué ou Wademba, il n’y a
plus de souvenirs directs et l’Afrique sombre dans l’oubli, « perdue derrière les voilures du
temps. Enterrée dans les fosses des mémoires » (Pineau, 2000 : 112) pour devenir ce « vaste

239
pays dont on ne savait hak » (Chamoiseau, 2006: 154). Parfois l’oubli est tel qu’il pousse
certains personnages à « douter que leurs ancêtres fussent venus d’Afrique, bien qu’une petite
voix leur susurrât à l’oreille qu’ils n’avaient pas toujours habité le pays, n’en étaient pas
originaires […] » (Schwarz-Bart, 1998 : 13). Ainsi, pour les personnages nés aux Antilles,
l’Afrique ne semble donc pouvoir être imaginée qu’à travers des contes, des légendes ou les
restes d’une spiritualité transmis par d’autres. Par conséquent, toutes ces représentations de la
terre originelle n’ont plus aucun lien au passé ou au réel et pourraient au contraire être perçues
comme un espace fantasmatique qui, tout en démontrant cette perte de l’origine, mettrait en
valeur une perception du présent et de la situation antillaise : « Il sera le référent-comparant
inconscient dans le regard que porte les personnages sur le pays d’ici […] » (Simasotchi-Bronès,
2004 : 23-24). Ces représentations d’une Afrique fantasmée et lointaine pourraient ainsi être
perçues comme la substance, le point d’ancrage, d’un discours plus vaste sur l’identité antillaise
dans le monde contemporain.
Nous voyons donc ici que les auteurs contemporains et les créolistes ne peuvent
complètement rejeter la Négritude et son rapport à l’Afrique puisqu’ils ont été un moyen
d’échapper à l’influence occidentale (esthétique, morale, culturelle, etc.) qui a continué de
s’imposer après la fin de l’esclavage en 1848. Comme le passage par l’oralité du conteur et par
l’écriture empruntée des premiers écrivains antillais, la Négritude a donc été une étape cruciale
dans la lutte identitaire et culturelle antillaise. C’est pour cette raison que le rapport à l’Afrique
hérité de Césaire n’est jamais dénigré dans les romans réalistes mystiques car il s’agit non
seulement de l’origine historique d’une majeure partie de la population antillaise, mais aussi des
premiers pas d’une affirmation de la différence et de la légitimité grâce à laquelle l’Antillanité et
la Créolité ont pu développer leurs diversités. C’est pour cette raison que tout rejet total ou tout
oubli de l’Afrique serait, comme pour Mathieu dans Le Quatrième Siècle, scandaleux :

240
« insinuaient […] qu’ils étaient descendants des Caraïbes, Descendants des Caraïbes, tu
entends ! Parce qu’ils désiraient tout bonnement effacer à jamais le sillon dans la mer »
(Glissant, 1997a : 309). L’Afrique a beau etre lointaine, elle demeure cependant une origine
historique, un « avant ». En effet, comme nous l’avons vu dans le passage décrivant les origines
du conflit Longoué/Béluse, le rapport à l’Afrique a beau être imprécis et vague, il a cependant
une fonction d’historicisation de la rivalité : si les deux personnages se battent sur le pont du
navire, et si leur rivalité se poursuit aux Antilles, ce conflit remonte au temps – imprécis certes,
mais bien réel – de « l’avant ». Ainsi, si les auteurs antillais reconnaissent l’Afrique comme
origine historique et ils reviennent souvent sur sa nature vague et lointaine, ils ne peuvent
cependant la négliger car elle participe d’un principe d’historicisation mais aussi, comme nous
allons le voir, de la mise en place d’une nouvelle origine.
1.3 La mise à distance de l’origine historique dans les romans
Vaguement décrite, parfois stéréotypée, l’Afrique ne suit donc pas, dans les romans de
notre corpus, les représentations d’un continent originel et mythique. Tout en reconnaissant le
rôle identitaire unique de l’Afrique, ces romans se détachent du mouvement de la Négritude et
de son regard qui, tourné vers le passé, ne peut clairement envisager l’avenir ni le temps présent.
Cette nouvelle approche, qui constitue une évolution dans la perception de la notion d’identité,
est par exemple illustrée par Maryse Condé dans Les Derniers Rois Mages. Deux personnages
s’opposent dans ce roman, symbolisant deux regards sur l’Afrique. Nous avons, d’un côté,
Djéré, personnage symbolisant une dépendance identitaire à l’Afrique puisqu’il « s’était
accroché à des lambeaux du temps d’hier. Dès qu’il avait été en âge de comprendre quelque
chose à ce qu’il lisait, il avait fait main basse sur tout ce qui concernait l’histoire de l’Afrique et
surtout du Dahomey, que l’on appelle aujourd’hui Bénin » (Condé, 1995 : 21) et, de l’autre,

241
Spéro, pour qui « le passé doit être mis à mort. Sinon, c’est lui qui tue » (Condé, 1995: 127), et
qui préfère oublier son ancêtre africain et « en finir avec toutes ces rêveries qui avaient fait tant
de mal à sa famille » (Condé, 1995: 151). Parmi les auteurs de notre corpus, Maryse Condé est
probablement l’auteure qui revient le plus, dans ses romans, sur cette notion de rejet de
l’Afrique4. On le voit par exemple avec Tituba qui, conçue sur le pont d’un navire et née à la
Barbade, rejette cette Afrique avec laquelle elle n’a jamais eu de liens directs, sauf par ses
parents : « mais nous ne savons plus rien de l’Afrique et elle ne nous importe plus » (Condé,
2004: 151). Ce thème est également traité par d’autres auteurs comme Édouard Glissant « car le
pays là-bas était mort pour toujours […] » (Glissant, 1997a : 244), Patrick Chamoiseau:
« Quoi ? Quelle Afrique ? s’exclamait le zombi. Y’a plus d’Afrique fout ! » (Chamoiseau,
2004 : 213) ou Raphaël Confiant : « Alors c’est quoi cette histoire d’Afrique dont tu me parles
là, hein ? J’ai rien à voir avec ce pays de sauvages, moi ! » (Confiant, 2007 : 62). Si l’on analyse
les romans, on remarque que cette notion de rejet, si elle ne s’applique pas à tous les
personnages, vient systématiquement de personnages nés aux Antilles ou de lointains
descendants d’esclaves. Ainsi, si l’Afrique sera toujours l’origine historique du peuplement des
Antilles, nous retrouvons au cœur de ce discours identitaire une distinction entre l’origine
historique et la notion de terre natale. En effet, sauf quelques rares exceptions (le premier
Longoué et Wademba, par exemple), qu’ils soient nés ou non aux Antilles, les souvenirs des
principaux personnages des romans ne semblent en effet jamais remonter au-delà du navire
négrier. On le voit avec l’esclave vieil homme qui « ne savait plus s’il était né sur l’Habitation
ou s’il avait connu cette traversée en cale […] » (Chamoiseau, 2005a : 37) et avec le personnage
de l’Africaine dans Texaco qui « n’avait évoqué que la cale du bateau, comme si elle était née
4 Ce rapport, qui s’inspire de sa propre expérience, est au cœur de plusieurs de ses romans dont son premier, Heremakhonon. Condé a également publié plusieurs romans se déroulant essentiellement en Afrique comme Ségou : les murailles de terre, Ségou : la terre en miettes ou Célanire cou-coupé.

242
là-dedans, comme si sa mémoire, juste là, avait fini de battre » (Chamoiseau, 2006 : 154). On
retrouve même ce blocage de l’origine chez des personnages de l’époque moderne qui, comme
Man Ya dans L’Exil selon Julia, ne parviennent pas à remonter à leurs origines africaines:
« même quand les Blancs lui criaient de retourner dans son pays d’Afrique, elle ne remontait pas
au-delà de cette traversée-là » (Pineau, 2000 : 114-115). Il y a donc dans les romans antillais
post-Négritude une nette mise à distance de l’origine historique africaine qui s’ajoute aux
descriptions vagues et aux stéréotypes de l’Afrique.
Historiquement, le rejet de l’Afrique pourrait venir de la notion plus que problématique
de ce qu’être « Africain » signifiait du temps de l’esclavage. Si l’on en croit l’étude d’Olivier
Pétré-Grenouilleau, plus des trois quarts des captifs vendus aux Européens étaient fournis par les
pouvoirs en place sur le continent africain. À cette participation de l’Afrique noire dans la traite
s’ajouterait ensuite la difficulté d’établir la notion d’identité du fait de « l’absence d’un
sentiment d’appartenance à une même communauté ‘‘africaine’’, au sein d’un monde où les
barrières ethniques étaient puissantes » (Pétré-Grenouilleau, 2004 : 75). En effet, comme l’a
noté David Eltis dans son ouvrage The Rise of African Slavery in the Americas, les termes
d’Afrique et d’Africains n’avaient, du temps de la Traite, de sens que pour les Occidentaux. Ces
remarques sur l’absence d’une origine précise sur un continent riche en ethnies et cultures
différentes pourraient bien expliquer que si les auteurs et les personnages de romans de notre
corpus se réfèrent à l’Afrique comme continent, ils ne font que très rarement référence à des
régions ou des ethnies précises. Ainsi, l’aspect vague et lointain des descriptions de l’Afrique
serait l’illustration d’un fait historique. Une autre raison, nous dit Pétré-Grenouilleau, serait que
l’esclavage marchand ou domestique était une institution très enracinée en Afrique et qui
fonctionnait selon un processus qui cherchait à transformer les esclaves en « étrangers » par une
forme de « mort sociale » apparaissant « comme un préalable nécessaire à l’asservissement et à

243
son maintien » (Pétré-Grenouilleau, 2004 : 77). Or, nous l’avons vu, la plupart des histoires, des
romans ou des récits du passé commencent sur le navire négrier et la capture est elle-même
rarement décrite, sauf dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant ou Nègre Marron de
Raphaël Confiant. De même, très peu de personnages ont un souvenir ou une trace précise de
leurs origines ethniques et culturelles. Il est donc intéressant de noter ici que, bien que les
romans ne contiennent que peu de traces de l’Afrique originaire, ce manque reflète un état de
fait, dans lequel les esclaves étaient eux-mêmes déshumanisés, coupés de leurs origines et de
leur identité avant même de quitter leur terre natale. Si l’idée que les auteurs contemporains
s’inspirent de ce fait historique et culturel – ou d’un sentiment inconscient de rejet vis-à-vis de
l’Afrique qui se serait formé à l’époque de la rupture – pour appuyer leurs propres thématiques
littéraires et culturelles est une idée intéressante, elle reste cependant difficile à prouver : les
auteurs en question n’en font directement mention ni dans leurs romans, ni dans leurs essais. De
même, si certains personnages rejettent l’Afrique, les romans ne font jamais clairement mention
d’un ressentiment envers une éventuelle responsabilité africaine. Cela nous laisse donc penser
que le rejet de l’Afrique originelle serait plus directement lié à un travail de redéfinition
identitaire entre un « avant » africain, dans lequel l’homme était libre et un « après » qui, de
l’esclavage à l’acculturation, serait à l’origine de l’identité antillaise. Il est alors intéressant de
noter que cette thématique littéraire d’une origine ne remontant pas plus loin que le navire
négrier a un équivalent historique et ethnographique dans l’histoire des Antilles. Sans existence
propre, morts socialement au moment de leur capture, les esclaves africains ne rentrent dans
l’Histoire et n’ont fini par acquérir une « existence » qu’au moment de leur passage sous
l’influence occidentale, que ce soit sur le navire négrier ou à l’arrivée sur la plantation :
« l’esclave entre-t-il ans le monde ‘‘juridique’’ du Code Noir à l’instant où il est pris ou celui où
il est livré à un maître sur la colonie ? » (Sala-Molins, 2006 : 104). Ainsi, si les romans se basent
(presque) toujours sur la traversée de l’océan ou l’arrivée en terre antillaise pour donner une

244
origine à leurs personnages, nous observons que ce fait correspond à la première apparition
historique des esclaves dans les registres du système occidental. Les personnages et leurs
origines apparaissent dans les romans comme ils apparaissent dans l’Histoire : en tant
qu’esclaves, entre le transbord et la plantation. De ce fait les romans de notre corpus semblent
majoritairement proposer que les personnages qui ont pour ancêtres des Africains transbordés
(ou ces Africains eux-mêmes) n’ont commencé à « exister » qu’à partir du moment où,
historiquement et juridiquement, ils sont devenus esclaves, donc entre le moment de leur
capture, de leur transbord et de leur arrivée dans les plantations. Cette suite d’événements qui
explique comment, au-delà des origines historiques, les ancêtres des Antillais d’aujourd’hui sont
apparus, exprime donc une origine qui pourrait bien prendre, dans les romans, valeur d’acte
fondateur.
1.4 Le rejet par l’origine
Si les personnages n’ayant pas connu l’Afrique s’en éloignent, il arrive cependant que,
par le biais de la magie ou d’un déplacement physique, d’autres parviennent à y voyager. C’est
alors l’occasion pour les auteurs de proposer un autre rapport, qui exclut une fois encore les
personnages de tout rapport avec leur origine historique : celui du rejet par l’Afrique ou par les
personnages qui y sont associés. Cette relation peut se manifester de diverses manières dans les
romans. On la trouve par exemple incarnée par des personnages africains n’ayant pas connu
l’esclavage et qui utilisent cette différence pour valoriser l’authenticité de leur origine par
rapport aux Antillais : « Père Mérinés, son concubin, se prétendait descendant d’un authentique
congo débarqué bien après l’esclavage. Il méprisait les nègres d’ici-là, vantant ses ancêtres
africains, à lui, qui n’avaient connu ni chaînes, ni verges, ni pals» (Pineau, 2001 : 23). Cette
différence est encore plus nette dans le roman Zonzon tête carrée lors de la difficile rencontre

245
entre des Antillais avec des Africains fraîchement naufragés qui « ne parlaient aucune langue
connue des habitants » (Césaire, 1994 : 186) : il faudra aux Martiniquais l’explication d’un
prêtre de passage pour comprendre que le mot prononcé par une femme « ‘Ibo’ n’était pas le
nom d’une personne mais d’un peuple du pays noir » (Césaire, 1994 : 187).
Le rejet symbolique par l’Afrique est cependant plus fort quand les personnages antillais
s’y rendent directement et prennent conscience de l’impossibilité d’une véritable continuité. On
peut le voir avec le retour d’une ‘dormeuse ‘ en Afrique dans l’étude sociologique Dieux en exil
de Simonne Henry Valmore, ou dans le roman Ti Jean l’Horizon : si le monde antillais et le
monde africain partagent certains rites et certaines spiritualités, un grand nombre de gestes et de
paroles restent cependant hermétiques à ceux qui tentent de les comprendre. Avec le temps,
l’Afrique des origines et les Antilles ont en effet évolué, l’une sous le joug de la colonisation et
l’autre sous celui du monde des plantations si bien qu’après plusieurs siècles d’histoire, la
dormeuse décrite par Valmore n’a plus vraiment de liens avec l’Afrique et ne peut que ressentir
une certaine aliénation quand elle essaie de comprendre les rituels des marabouts: « et les
Africains ne dilapident pas au premier venu leur savoir […] toutefois, faute de pouvoir
communiquer ici en langue native-natal, il faudra se passer de toute explication » (Henry
Valmore, 1988 : 178). C’est là un sentiment que certains personnages ressentent également dans
les romans : « Manman disait que l’Afrique nous avait pourtant toujours tenus à distance,
comme si la couleur de la peau seule ne faisait pas la famille… » (Pineau, 2000 : 20).
Vivre dans une image rêvée et idéale d’une Afrique éternelle serait donc une erreur et un
facteur d’aliénation puisque, à cause de son éloignement dans l’espace et le temps, les Antillais
sont, dans les romans, incapables de percevoir et de comprendre les changements de ce
continent originel qui a continué à se développer (historiquement, socialement,
ethnographiquement, etc.) sans eux. Cette différence essentielle permet ainsi aux auteurs de

246
mettre en place dans leurs romans un véritable rejet physique ou mental. On le voit par exemple
avec Cyrille, le conteur, dans La Traversée de la mangrove de Maryse Condé : « Je serais bien
resté là, moi, en Afrique. Mais les Africains m’ont donné un grand coup de pied au cul en
hurlant : ‘‘Retourne chez toi !’’» (Condé, 2005 : 154). Ce cheminement identitaire est encore
plus évident dans Ti Jean l’Horizon, dans lequel le héros, transporté dans une Afrique ancestrale
après avoir été avalé par la Bête, cherche à se définir auprès de ses ancêtres5. Incapable de
comprendre des concepts africains qui sont étrangers à son éducation antillaise comme la
polygamie ou la réincarnation, il erre alors dans une société « structurée par des règles qui lui
échappent, et qu’il juge d’après des critères erronés, appartenant à son monde d’origine »
(Toureh, 1986 : 168). Ainsi, même s’il ressent une harmonie profonde avec la nature africaine,
« […] il ressentait jusqu’au bout de ses doigts le sentiment troublant de faire partie du paysage,
de s’y trouver au même titre que le brin d’herbe ou la pierre» (Schwarz-Bart, 1998 : 141), et
même si Wademba lui promet accueil et acceptation grâce aux liens du sang, « il vous suffira de
dire que votre ancêtre se nommait Wademba pour être accueillis comme des frères… car
j’appartiens à un sang très lourd et pesant, un sang de très longue mémoire et qui n’oublie rien
[…] » (Schwarz-Bart, 1998 : 72), il est rejeté par les Africains qu’il rencontre. Pour Ti Jean,
dont le cheminement est particulièrement symbolique, le voyage vers l’Afrique n’est donc pas
un retour parmi les siens, « parmi les tiens ? Non, tu es pour nous comme ces animaux que l’on
voit parfois dans la brousse, et pour lesquels on ne dispose pas de nom, voilà tout ; et ton
langage est pour nous comme la nuit » (Schwarz-Bart, 1998 : 165). Il s’agit au contraire d’un
rejet qui se base sur cet aspect essentiel de l’identité antillaise qu’est l’esclavage des origines,
qui entraînera même l’assassinat de Ti Jean et de Wademba : « l’esclavage est une lèpre du sang
5 Dans notre corpus, Ti Jean l’Horizon est le seul roman dans lequel le personnage principal effectue un voyage en Afrique, plus particulièrement dans l’Afrique des origines.

247
et celui d’entre eux qui est saisi par l’ennemi, fût-ce pour une heure il n’a plus le droit à revenir
dans la tribu…» (Schwarz-Bart, 1998 : 160). Ainsi, comme nous pouvons le constater, le voyage
en Afrique par le ventre d’une Bête n’est pour Ti Jean qu’un passage et non l’aboutissement de
la quête. Malgré ses pouvoirs et son lien historique et originel à l’Afrique, ce n’est pas depuis ce
lieu que Ti Jean libérera le soleil pour devenir un héros. Ce voyage en Afrique, qui se continue
vers la France, semble ainsi être un passage obligé avant un retour en Guadeloupe. De ce fait,
l’Afrique a beau être une référence fondamentale, nous voyons qu’une grande partie des auteurs
post-Négritude remettent en cause son rôle de terre des origines pour se recentrer sur les
Antilles.
1.5 Raphaël Confiant et le regard sur l’Inde et de la Chine
Si les théories de la Créolité s’appliquent à la société antillaise, elles s’illustrent aussi
dans les romans qui cherchent, surtout avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, à rendre
une image authentiquement créole, multiculturelle et multiraciale du monde antillais. L’Afrique
n’étant pas le seul pays originel des populations antillaises et nous ne pouvons parler des
Antilles et du rapport aux pays originel sans mentionner au moins deux communautés6 illustrant
une fois encore la notion que la diversité du monde antillais ne se limite pas à la dualité
Blancs/Noirs: la communauté d’ascendance Chinoise et celle, plus évidente dans les romans, des
engagés Indiens et de leur descendance. En effet, si les personnages chinois ou indiens sont plus
fréquents dans les romans contemporains qu’ils l’étaient aux origines de la littérature antillaise,
ils n’ont que rarement un rôle central par une forme de « négation de la multi-ethnicité
caractéristique de la Caraïbe » (Hurbon, 2000 : 313). Ce n’est que depuis l’apparition de romans
6 La communauté du Moyen-Orient est bien présente dans certains romans, mais son rapport à la terre originelle n’est pas évident. Mentionnons aussi la communauté occidentale et celle des Amérindiens (Caraïbes, Arawaks…), dont le rapport à la terre natale n’entre pas dans la problématique que nous traitons ici.

248
comme Aurore d’Ernest Moutoussamy et depuis l’intérêt d’auteurs de la Créolité pour l’aspect
multiculturel de la communauté antillaise que ces personnages ont des rôles centraux ou
importants (La Panse du chacal et Case à Chine de Raphaël Confiant, Célanire cou-coupé de
Maryse Condé). Comment expliquer cette relative absence ? En dehors du fait que ces
communautés n’ont pas autant d’auteurs pour les représenter, nous pouvons trouver une
différence essentielle dans leurs origines historiques et leur rapport à la notion de rupture.
Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, la thématique d’une grande partie des romans antillais
prend pour axe central la notion traumatique de rupture historique, identitaire et culturelle par
rapport à la terre originelle. Or, si les engagés indiens et la communauté Chinoise ont eux aussi
connu souffrances et acculturations, leur expérience fondamentale, celle de la traversée qui les a
conduits de la Chine ou de l’Inde jusqu’aux Antilles est, même si Confiant et Moutoussamy
décrivent leur traversée vers les Antilles comme une véritable épreuve, essentiellement
différente. Cette différence vient essentiellement de la présence de la violence physique et,
surtout, de la condition d’esclave puisque « le travail forcé n’impliqu[ait] pas la capture
violente, la déportation lointaine, la ‘‘dépersonnalisation’’, la ‘‘désocialisation’’ ou encore la
‘‘désexualisation’’ imputables à l’esclavage » (Pétré-Grenouilleau, 2004 : 285). De même si,
comme les Noirs amenés en esclavage, ils ont dû subir la religion des colonisateurs, ces engagés
ont cependant « conservé les traits essentiels de leurs propres croyances et pratiques » (Hurbon,
2000 : 314).
Cette différence d’expérience est telle qu’il serait donc difficile de dire qu’il y a eu une
identité de statut et de condition entre ces communautés et celles issues de l’esclavage, et ce
même si l’on peut parler, comme pour les esclaves africains, d’une forme d’exploitation. Ces
transbords (volontaires ou non) ayant été plus récents, moins violents et l’acculturation n’ayant
pas été la même (le Code Noir n’était plus en usage) les personnages indiens ou chinois ont

249
donc un rapport différent avec leur origine : l’Inde et la Chine sont souvent, pour eux, de
véritables souvenirs. Ainsi, si ces deux pays, leur histoire, leur géographie, leurs mythes et leurs
traditions sont largement présents dans les romans de Confiant et dans Aurore d’Ernest
Moutoussamy (un tiers du livre se déroule en Inde), ils y sont également décrits en détail. On le
voit par exemple dans Case à Chine, « plus il s’éloignait de son Yunnan natal, plus il était
frappé par l’aisance dans laquelle vivaient les gens, les rues bien tracées et relativement propres
des bourgs, la formidable frénésie des villes envahies de palanquins chamarrés et de carrioles. Et
moins il comprenait leur parler ! » (Confiant, 2007 : 118), ou dans Aurore: « un défilé officiel
avec des éléphants royaux parés de velours et décorés de bagues aux défenses et aux pattes
descendit l’avenue Georges V, brisa la laideur de la ville et tira Sarah de sa torpeur »
(Moutoussamy, 1995 : 63). Cependant, malgré l’absence de souffrances extrêmes et le choix
(relatif, puisque certains ne sont pas partis de leur plein gré) du départ, nous pouvons quand
même parler, dans cette expérience, de rupture et d’acculturation. Il y a plusieurs raisons
culturelles, spirituelles et identitaires qui soutiennent cette affirmation, notamment la tradition
selon laquelle quitter l’Inde est, pour les engagés, considéré comme une faute spirituelle grave :
« en traversant la Grande Bleue peuplée de Houglis (monstres), l’Hindou se coupait de l’eau
sacrée du Gange et se condamnait par conséquent à une vie d’errance perpétuelle, sans
possibilité de réincarnation » (Gamess, 2003 : 134). Ainsi, tout comme l’homme Africain qui,
décrit par John Mbiti, souffre de son éloignement de la terre natale, c’est le Kala Pâni une
«malédiction qui pèse sur la tête de tout hindou qui quitte la terre sacrée de l’Inde » (Confiant,
2004 : 123) qui, dans La Panse du chacal, condamne les engagés indiens à une damnation
éternelle sans jamais « pouvoir atteindre un jour la moksha, la délivrance » (Confiant, 2004 :
171).

250
Cet éloignement, bien que moins violent, remet cependant en question le fonctionnement
de la spiritualité hindoue, comme dans cette scène qui se déroule en plein océan
Atlantique : «comment pouvait-on invoquer Mariémen et surtout lui faire les offrandes
rituelles ? Accepterait-elle ces bols de riz au goût saumâtre qui constituaient le repas quotidien
de ces intrépides qui avaient quitté l’Inde dans le fol espoir d’une vie meilleure ? » (Confiant,
2005 : 184). Ainsi, il y a aussi eu, pour les engagés indiens et les travailleurs chinois, une forme
de rupture : en quittant leur terre natale, ils ont eux aussi quitté tout un monde de mythes, de
croyances et de rituels avec laquelle ils ont, génération après génération, fini par perdre contact.
Leur rupture n’a cependant pas eu lieu, comme les esclaves africains, au moment du transbord,
par le déchirement des familles, les mélanges acculturateurs et les règlements du Code Noir. En
effet, pour tous les engagés, c’est au moment de l’arrêt des migrations qui avaient jusqu’alors
permis le maintien d’un rapport avec le pays d’origine et donc d’une continuité culturelle qu’il y
a eu rupture. Ainsi, sans nouveaux apports, sans nouveaux immigrants, les populations
indiennes et chinoises se sont lentement créolisées et ont fini, elles aussi, par se détacher de
leurs origines: « Vint le temps où seul Z’Oiseau et lui furent capables de converser librement
sans passer par le créole. L’arrêt des convois nous avait privés, nous les travailleurs indiens,
d’une source revivifiante, avait définitivement coupé le cordon ombilical qui nous reliait à
Madras » (Confiant, 2004 : 364). Le roman La Panse du chacal de Raphaël Confiant revient
longuement sur ce phénomène culturel qui, s’il peut être considéré comme une créolisation, est
cependant perçu comme un lent et douloureux détachement et un irrémédiable oubli pour les
populations concernées : «Devi triturait les pans de son sari, en proie à une nervosité croissante.
Sa mémoire défaillait » (Confiant, 2004 : 253). Ainsi, petit à petit, l’Inde et la Chine deviennent
des pays lointains et mal connus, comme l’exprime Rosa dans La Traversée de la mangrove : «
Une nuit, j’ai eu un rêve. J’étais en Inde, notre pays d’origine dont hélas, nous ne savons plus
grand-chose» (Condé, 2005 : 164). C’est pour cette raison que l’engagé indien ou chinois,

251
comme l’esclave africain qui se tourne vers le Conteur, se tourne vers des personnages qui,
comme Radjiv, permettent aux traditions et à l’identité originelle de se maintenir: « Il est le seul
d’entre nous à savoir lire toutes nos langues, avait argué le vieillard, et sans son aide, nous
risquerions d’oublier les rites que décrivent nos livres » (Confiant, 2004 : 141). Face à ces
problèmes identitaires on retrouve donc, dans les descriptions des populations indiennes, des
problèmes identiques à ceux des populations d’origine africaine. Ce conflit se manifeste, dans
les romans de Confiant, par quatre mouvements d’appartenance que l’on retrouve également
dans les romans centrés sur les communautés d’origine africaine. Il y a d’abord les personnages
qui, comme Devi, se réclament d’une identité lentement oubliée, se souviennent de l’origine et
cherchent à maintenir leur lien avec elle : « fort pieuse, elle entretenait dans un recoin de notre
case un minuscule autel en l’honneur de la déesse Mariémen » (Confiant, 2004 : 217). Il y a
ceux qui, conscient comme Adhiyamân de l’impossibilité d’un retour, finissent par rejeter l’Inde
pour mettre en valeur l’île antillaise : « il ne me parlait jamais du pays perdu et cherchait – ô
paradoxe ! – à me faire aimer celui-ci en m’incitant à partager les jeux des négrillons dont le
caractère chamailleur, voir belliqueux, m’intimidait » (Confiant, 2004 : 217). Il y a aussi ceux
qui, nés dans l’entre deux comme Vinesh le fils adoptif d’Adhiyamân et Devi (symboliquement
nés sur le navire) se considèrent de nulle part car ils ne peuvent accepter totalement aucune de
leurs origines: « je préférais croire que j’étais né au mitan de l’Atlantique et de ses tempêtes
soudaines » (Confiant, 2005 : 218). Enfin viennent les créoles qui, nés aux Antilles de parents
d’origines différentes, sont si éloignés de leurs origines historiques qu’ils ne peuvent s’identifier
qu’à leur île natale, comme le fils d’Anthénor et Devi, « ce fils de l’Inde et de l’Afrique qui ne
pourrait se réclamer que d’un seul pays : la Martinique » (Confiant, 2004 : 356). Ainsi, nous
voyons encore ici que si l’Afrique a été mise en valeur par Césaire et les auteurs de la
Négritude, les auteurs plus récents tendent à remettre en question la place de l’origine historique
dans la question identitaire de toutes les communautés : « je t’en prie, abandonne cette idée

252
absurde de rapatriement ! Notre pays est désormais celui-ci » (Confiant, 2004 : 356). Oubliées,
mal perçues après un processus d’acculturation naturelle ou forcée, ces origines historiques
semblent toutes aboutir à une même terre natale, les Antilles, alors que l’origine historique
n’apparait plus, dans les romans de notre corpus, comme la finalité ou l’aboutissement d’une
quête identitaire.
2 Spiritualité et identité antillaises en Métropole
2.1 L’exil vers la France et la découverte de l’altérité
Si les Antillais de Guadeloupe et de Martinique sont d’origines historiques diverses, ils
sont cependant officiellement français puisque que ces îles, devenues Départements d’Outre
Mer le 19 mars 1946, font partie de la République Française. Ce fait rend encore plus
problématique la notion d’identité puisque si les Antillais doivent négocier leurs origines
historiques lointaines, ils doivent également y incorporer ce rapport à un autre pays lointain dont
ils subissent l’influence culturelle et qui semble proposer une alternative aux complexes
questions sur l’origine. Puisque « naître aux Antilles ce n’est pas naître sans identité et sans
dieu. Ce serait plutôt naître avec une surabondance d’identités et de magico-religieux » (Henry-
Valmore, 1988 : 30), la France serait donc devenue, idéalement, un point d’ancrage : « pour ne
pas tomber le mieux était de ne plus penser à l’Afrique perdue, d’oublier les Indiens caraïbes
ancestraux, exterminés, décimés, de laisser les Hindous à leurs affaires et de nous en tenir au
statut de 1946 qui confirmait la nationalité française » (Henry-Valmore, 1988 : 14). Par certains
aspects identitaires, il semble même que la France ait tendance à remplacer l’Afrique dans les
consciences. En effet, comme l’explique Simonne Henry Valmore, si le terme l’òt bò
symbolisait jadis l’Afrique, les temps ont changé et cette expression a maintenant été remplacée

253
par une autre, janbé dlo, qui fait référence à la traversée de l’océan des Caraïbes vers la France :
« En Martinique, en Guadeloupe, aussi loin que remonte le souvenir, l’expression janbé dlo a
désigné la Métropole » (Valmore, 1988 : 15). Après un désir de retour vers l’Afrique des
origines, il y a donc eu déplacement et désir de mouvement migratoire vers la France, ou plutôt
une représentation de la France qui, relativement idéalisée, n’est pas sans rappeler les images
idylliques de l’Afrique : « Et puisque nous étions français, nous avions, somme toute, un rêve
bien légitime : rendre visite à l’Autre Mère, marcher dans ce pays de France qui, disait-on,
n’avait jamais porté d’esclaves » (Henry-Valmore, 1988 : 14). De même, si la rupture avec
l’Afrique a été violente et involontaire, une forme de relation plus positive a vu le jour entre la
France et les Antilles. Si les Antillais n’ont plus de rapports avec l’Afrique et si la Guadeloupe
et la Martinique n’ont pas appartenu à leurs ancêtres esclaves, il semble que les Antillais aient
trouvé un des liens spirituels dans l’enterrement de leurs morts en France, un acte qui symbolise
l’enracinement de la communauté antillaise dans l’identité française : « à présent, nous enterrons
nos morts en France. Nous prenons racine dans l’Autre Bord » (Henry Valmore, 1988: 203). Ce
lien est si fort que Simonne Henry Valmore va jusqu’à parler de l’existence d’une troisième
Antilles : « il existe maintenant trois Antilles : la Martinique, la Guadeloupe et l’Autre Bord – la
Métropole » (Valmore, 1988: 23). Cette situation, bien que décrite idéalement par Simonne
Henry Valmore peut cependant être problématique d’un point de vue identitaire. En effet, si
l’Antillais se sent français, quelle sera son expérience réelle de la France ? Un Antillais est-il
plus proche de la France que de l’Afrique de ses origines ? Le phénomène de l’immigration, tel
qu’il est décrit dans les romans, ne suit pas forcément la représentation idéale décrite par
Simonne Henry-Valmore. On y retrouve au contraire un type de cheminement identitaire
relativement proche de ce que vivent les personnages antillais voyageant en Afrique : un voyage
vers un pays qui, culturellement et spirituellement ne correspond pas toujours aux images et aux
espoirs qui lui sont attribués.

254
Un premier problème qui se présente aux personnages de romans réalistes mystiques
émigrant vers la France est, bien évidemment, l’absence de mythes vivants caractérisant la
pensée occidentale. C’est ainsi que, dans les romans nous voyons comment les créatures du
folklore antillais n’ont pour équivalents français que des malfaiteurs bien moins
impressionnants:
Elle a rencontré pires engeances en Guadeloupe. Elle connaît la figure de l’homme qui tourne en chien.
Elle a vu les dessous des sabots des trois diablesses en cavale. Des esprits malveillants sont venus souffler
une bougie votive dans sa case fermée aux vents. Elle ne craint pas les malfaisants d’ici. Ils ont petites
figures et dents molles. (Pineau, 2000 : 88)
Ce problème qui illustre les difficultés d’adaptation spirituelles rencontrées par ceux qui
émigrent en France trouve une illustration particulièrement intéressante dans l’analyse des
fonctions et du rôle du quimboiseur, personnage antillais par excellence, en terre française.
Comme on le voit dans les études de Simonne Henry Valmore et d’Édouard Glissant, ces
personnages (qu’ils soient réels ou fictifs) sont si profondément liés à la culture et aux croyances
populaires antillaises qu’ils ne pourront pas s’intégrer à un environnement spirituel français.
Selon Glissant, en effet, le quimboiseur perd, après son émigration, sa raison d’être culturelle
(qui ne peut s’appliquer en France) et devient ainsi une sorte d’imposteur:
Au long de l’établissement sur la terre nouvelle, le quimboiseur dégénère, jusqu’à verser dans le
charlatanisme le plus délirant […]. Dépossédé de sa fonction culturelle, le quimboiseur n’a pas sa raison
d’être. On a fait de lui (l’évolution sociale a fait de lui) ce qu’on avait dès le départ, pour combattre le
danger qu’il représentait, voulu qu’il fût annoncé qu’il était: un charlatan (Glissant, 2002 : 180-181).
Tout comme dans la tradition antillaise qui veut que les esprits ne puissent traverser aucune
étendue aquatique, il semble ainsi que l’identité et la mémoire culturelle doivent, elles aussi,

255
rester au pays car elles ne peuvent pas s’adapter en France7. Cependant, comme on peut le voir
dans le roman Chair Piment, la question de savoir si les esprits existent ou non, ou si le
quimboiseur est un charlatan ou un véritable sorcier, ne se pose pas. Ce qui change, d’un bord
de l’océan à l’autre, c’est la façon dont ils sont perçus. En effet, si Mina est, en France, la seule
à voir l’esprit enflammé de sa sœur, ce qui indiquerait qu’elle souffre d’hallucinations, son
retour en Guadeloupe coïncide cependant avec de multiples manifestations de Rosalia, aperçue
par de nombreux autres personnages. D’une manière un peu différente, Victor découvre par le
biais de Bénédicte, une pensionnaire de l’hôpital psychiatrique où il est soigné pour dépression,
qu’il est suivi par trois démons : « Je les vois comme je te vois. Trois démons qui te laissent pas
en paix depuis ta naissance » (Pineau, 2004 : 107). Ce traumatisme est lié au souvenir et aux
blocages mentaux liés au suicide de son père (trois hommes le dépendant sous ses yeux, « trois
hommes en noir laids comme les démons de Bénédicte » [Idem. : 332]) prend ici la forme d’une
possession réelle quand Victor prend conscience de l’origine de son mal. Dans ce roman, le
réalisme mystique entraîne ainsi une série de questions : s’il n’y a là qu’un simple traumatisme
d’enfant, comment Bénédicte a-t-elle pu deviner l’importance de ces trois hommes dans la vie
de Victor ? Y a-t-il une véritable possession ou une contamination du réel par le réalisme
mystique antillais ? De la France aux Antilles, d’un type de perception à l’autre, il y a donc
dans Chair piment un écartèlement de la croyance des personnages qui prend la forme d’une
sorte de schizophrénie culturelle qui ne se résoudra pour les personnages que par un voyage en
Guadeloupe qui permettra un retour sur soi et une libération littéralement magique8. Nous
pouvons ainsi remarquer que les manifestations de la spiritualité antillaise en France décrites
7 Ce fait peut avoir, dans certains romans, des effets curieusement positifs comme pour Marguerite qui, dans L’Homme-au-Bâton affirme avoir été violée par un dorliss et qui est envoyée en France pour être placée hors d’atteinte des esprits. 8 Mina découvre également que sa nymphomanie est d’origine magique.

256
dans les romans de Gisèle Pineau9 n’ont plus uniquement pour but de décrire de manière réaliste
certains rituels mais de permettre aux personnages de prendre conscience d’une réalité
identitaire et culturelle. C’est ainsi que, dans Chair Piment, Mina ne pourra se libérer de l’esprit
de sa sœur qu’en retournant en Guadeloupe, son lieu de naissance avec lequel elle ne voulait
plus aucun rapport. De même, les rêves prémonitoires de Félicie dans Un Papillon dans la cité
lui permettront de prendre conscience de son identité et, indirectement, de retourner en
Guadeloupe pendant un voyage scolaire. Si les oppositions culturelles décrites par Pineau sont
un moyen pour elle d’opposer deux regards, nous voyons qu’elles mettent aussi en valeur le
cheminement identitaire de certains personnages qui, par une forme de détour par la France,
prennent (comme d’autres au contact de l’Afrique) conscience de leur identité antillaise. Vivant
dans une situation qui les pousse à assimiler la culture française et à rejeter leur culture
d’origine, l’existence de ces personnages en Métropole pourrait rappeler celle de leurs ancêtres
qui, après leur transbord, ont connu l’acculturation par l’autorité coloniale.
2.2 Fantasme, acculturation et aliénation dans les romans de Gisèle Pineau
Gisèle Pineau s’intéresse souvent, dans ses romans, aux notions d’acculturation et d’exil.
Elle met souvent en scène des personnages qui, ayant émigré vers la France, cherchent une vie
nouvelle qu’ils se représentent comme exotique, « [ils amenaient de France] des pommes et des
raisons exotiques à nous chavirer le cœur […] » (Chamoiseau, 2004 : 133), ou idéale : « peut-
être à cause de sa lettre où elle m’avait fait miroiter sa ‘‘vie meilleure’’, j’avais imaginé […] une
vraie maison avec cheminée, toit de tuile, fleurs au balcon, petite allée tapissée de gravillons »
9 Les seuls de notre corpus à se dérouler entièrement ou en partie en France. Les passages similaires de romans comme Les Derniers Rois mages de Maryse Condé ou Ti Jean l’Horizon de Simone Schwarz-Bart n’ont pas de rapport au folklore et à la spiritualité.

257
(Pineau, 1992 : 32). Certains des personnages de Pineau, bien que libres, finissent cependant par
subir une forme d’acculturation qui les pousse à rejeter leur île, une attitude qui nous rappelle
celle des Antillais vis-à-vis de l’Afrique. On le voit par exemple avec Marie-Claire pour qui il
n’y a de « retour » qu’en arrivant en France: « Marie-Claire paraissait contente d’être de retour.
Elle promenait son regard dans la foule, avec l’air dégagé et confiant de quelqu’un qui, au terme
d’un long voyage, se retrouve dans la rue de son enfance […] » (Pineau, 1992 : 27). Ce type de
réaction, décrite par Simonne Henry Valmore dans le cheminement d’une dormeuse est, selon
Franz Fanon, une des alternatives classiques de tout Antillais français : « l’Antillais doit alors
choisir entre sa famille et la société européenne ; autrement dit, l’individu qui ‘monte’ vers la
société – la Blanche, la civilisée – tend à rejeter la famille – la Noire, la sauvage – sur le plan de
l’imaginaire […] » (Fanon, 1971 : 121). Ainsi, tout comme nous l’avons vu avec les
descriptions vagues et stéréotypées de l’Afrique dans les romans de notre corpus, c’est au tour
des Caraïbes de s’effacer de la mémoire et du discours des Antillais ayant volontairement migré
vers la France. Cette acculturation est cependant, contrairement à celle imposée par l’esclavage,
volontaire, comme on le voit avec la mère de Félicie dans Un Papillon dans la cité: « Maman a
acheté des huîtres et une grosse dinde pour la nuit de Noël. Elle m’a dit que c’était la tradition
ici et qu’il fallait s’adapter aux coutumes de la France » (Pineau, 1992 : 46). Ainsi, le rejet des
traditions antillaises est pour la mère de Félicie un signe qu’elle est non plus antillaise mais
française. C’est là un phénomène social confirmé par Alain Anselin dans son étude de
l’immigration antillaise en France selon laquelle « les rites festifs de la naissance, de la vie, de la
mort deviennent les signes qu’on est bien antillais » (Anselin, 1990 : 272). Ce passage d’un
système de traditions à un autre ne se fait cependant pas naturellement et les personnages
fraîchement émigrés comme Félicie ou Ti Jean ne peuvent s’empêcher d’avoir un regard
critique, caricatural, illustré par un ensemble d’images sombres et tristes de la France. Un
ensemble de descriptions qui forment un genre d’anti-exotisme révélant un monde « entre ruine

258
et loques » (Pineau, 2004 : 21), celui des banlieues, un monde vide et morne dans lequel se
retrouve une grande partie de la population antillaise de France. On le voit par exemple dans
Chair Piment, « la plupart des gens attendaient la fin du cauchemar et cherchaient à tout instant
une porte de sortie. […] ils avaient le sentiment d’être engeôlés là, piétinés par la vie » (Pineau,
2004 : 22), ou encore, dans les descriptions de Les Derniers Rois Mages: « Paris surprend. Est-
ce là en vérité la cité tant vantée ? Pierres tristes des façades, pavés gras luisants de pluie, métros
malodorants…» (Condé, 1995 : 129). Il est donc intéressant de noter que, si la France n’est pas
conforme aux rêves et aux attentes, elle est aussi, tout comme nous l’avons vu avec l’Afrique,
un monde de rejets dans lequel les personnages font souvent l’expérience de l’altérité.
Les romans de Gisèle Pineau décrivant des personnages voyageant ou émigrant en
France présentent un point important qui n’est pas sans nous rappeler le rejet des personnages
antillais par l’Afrique : si l’Antillais se sent français, « il est pourtant, au regard de la population
française de la Métropole, visiblement étranger » (Glissant, 2002 : 129). La
départementalisation et l’association des Antilles à la France ne signifient en effet pas une
acceptation automatique par la culture française. Comme l’indique Glissant, les Antillais ont
beau faire partie de la France depuis la départementalisation, leur expérience en France n’en est
pas moins une réalisation de l’altérité : « c’est en France le plus souvent que les Antillais
émigrés se découvrent différents, prennent conscience de leur antillanité » (Glissant, 2002, 52).
C’est là une conséquence de la colonisation et de l’acculturation sur laquelle Franz Fanon s’est
d’ailleurs penché, « subjectivement, intellectuellement, l’Antillais se comporte comme un
Blanc. Or, c’est un nègre. Cela il s’en apercevra une fois en Europe, et quand on parlera de
nègres il saura qu’il s’agit de lui aussi bien que du Sénégalais » (Fanon, 1971 : 120-121), et que
l’on retrouve dans un certain nombre de romans. On le voit par exemple avec Ti Jean qui, sous
sa forme symbolique d’oiseau, se fait tirer dessus par des soldats, avec Félicie qui, dans Un

259
Papillon dans la cité, est décrite par sa mère comme une étrangère: « Ben, ma fille, c’est une
étrangère aussi. L’an passé, elle était à l’école communale, dans une campagne de Guadeloupe
qu’on marque même pas sur toutes les cartes » (Pineau, 1992 : 41) ou encore avec Spéro qui,
dans Les Derniers Rois Mages, a du mal à s’intégrer : s’il se fait traiter de « sale Arabe »
(Condé, 1995 : 193), il est trop timide pour aborder les Africains et préfère les observer de loin.
L’Antillais a donc beau être de nationalité française, son identité ne semble pas pour autant
suivre le même cheminement logique : souvent mis à l’écart (les banlieues françaises sont alors
symboliques de cette mise à distance), il est considéré comme étranger par le monde français10.
Ainsi, dans les romans qui la mentionnent ou la représentent, la France pose également un
problème vis-à-vis de la notion d’identité: elle n’est pas une terre ancestrale comme l’Afrique,
ni un espace identitaire et historique comme les Antilles. Tout en étant françaises, les îles
antillaises ne sont pas la Métropole qui, elle, semble mal s’accommoder de ces identités riches,
des rituels, de la spiritualité et des mythes vivants de ces Antillais qui ne sont « ni Africain[s], ni
Indien[s], ni Européen[s], ni Asiatique[s], mais tout cela à la fois » (Henry Valmore, 1988 :
198). Cependant, avant d’aller plus loin, il est intéressant de noter que, dans les romans tous les
personnages ne souffrent pas de la même manière et que tous les Antillais de France n’ont pas
adopté les traditions françaises.
On trouve en effet dans un certain nombre de romans, des personnages forts qui
maintiennent leur identité et qui, comme les Conteurs, les Anciens et leur rapport à l’Afrique,
incarnent symboliquement le « monde d’avant » et les Antilles traditionnelles. En France ce sont
essentiellement des personnages âgés, des grands-mères qui, parce qu’elles ont passé toute leur
10 Il doit même parfois se heurter à un nouveau sentiment d’altérité à son retour aux Antilles car ils ne sont plus purement Antillais mais ont subi une acculturation telle « que l’individu ainsi envahi par le sentiment de son identité ne pourra quand même pas réussir la réinsertion dans son milieu d’origine » (Glissant, 2002, 52).

260
vie dans les îles, ont fini par complètement intégrer cette origine à leur identité. Nous le voyons
par exemple avec la narratrice du roman d’André et Simone Schwarz-Bart, Un Plat de porc aux
bananes vertes ou encore avec Man Ya dans L’Exil selon Julia de Gisèle Pineau. Comme le
note Beverley Noakes dans son étude de L’Exil selon Julia, on peut voir que Julia n’est pas
affectée par la France si bien que, quand elle finit par retourner en Guadeloupe, elle reprend sa
place comme si elle ne l’avait jamais quittée. Forte de son éducation et de son identité,
insensible aux acculturations, elle représente, comme le premier Longoué, Wademba et Man
Yaya, un modèle, une forme d’incarnation de l’identité et de l’esprit de son pays d’origine. À la
fois modèle et inspiration, elle ne voyage pas en France pour se chercher:
Her own attitudes are profoundly unaffected by France, and her sense of Caribbean place and culture never
falters. […] She is sustained by a number of strong beliefs: in traditional herb medicine, Roman
Catholicism, and the dangerous powers of the supernatural. […] Thus there is no element of self-discovery
in Julia’s Parisian experience: but there is self-disclosure, a constant, unselfconscious revealing of self,
which is to become the culturally determining factor in the life of her grand-daughter Gisèle. (Ormerod-
Noakes, 2003: 214-215)
Comme leurs ancêtres littéraires venus d’Afrique (Man Yaya dans Moi, Tituba sorcière noire de
Salem, le premier Longoué dans Le Quatrième Siècle et Wademba dans Ti Jean l’Horizon), ces
personnages ne changent pas et portent en eux le « monde d’avant », sa culture et sa spiritualité
si bien que leur simple présence, rappellent la terre d’origine.
2.3 Le retour magique vers la terre natale
Si tous les personnages antillais des romans réalistes mystiques n’ont pas une force
identitaire identique à celle de leurs aînés, nous retrouvons souvent, chez certains d’entre ceux

261
qui se retrouvent éloignés de leur terre natale11, une forme de retour sur soi identitaire, parfois
doublé d’un retour magique. La plupart des personnages migrants ou voyageurs des romans de
notre corpus ont en effet un point commun : un certain sentiment de rupture qui se manifeste à
un moment ou à un autre de leurs déplacements et qui les pousse à regretter leurs îles natales ou
l’Afrique. Ce sentiment d’appartenance, né de la séparation, fait partie de ce que Glissant
nomme la notion de « détour » et qui permet aux personnages de prendre conscience, par
l’éloignement de leur terre natale, de leur lien identitaire avec elle: « on the other hand
departure, exile, ‘‘detour’’ are seen as important thresholds of self-discovery, a kind of salutary
disorientation » (Dash, 1994: 453). Volontaire ou non, ce déplacement révèle aux personnages
un manque identitaire qui, dans les romans, se manifeste parfois par diverses tentatives
magiques de le combler par le biais de la tradition et de la spiritualité. Ce mode de retour à
l’origine rappelle ceux du temps de l’esclavage, quand esclaves transbordés espéraient, par leur
mort, rentrer dans leur Afrique originelle : « – Un jour, nous serons libres et nous volerons de
toutes nos ailes vers notre propre pays d’origine » (Condé, 2004 : 18). Ainsi, nombreux sont les
personnages qui, éloignés de leur terre natale, tentent par divers moyens oniriques ou magiques
de reprendre contact avec leur île. Certains utilisent une bassine, comme Man Ya qui « songe à
ceux de Guadeloupe qui ont le pouvoir d’enjamber la mer en passant le pied par-dessus une
bassine d’eau » (Pineau, 2000 : 122), ou Tituba qui, depuis Salem, cherche à retrouver la
Barbade dans les reflets d’une bassine d’eau alors que d’autres utilisent une forme de
déplacement onirique (dans Un Papillon dans la cité Félicie voyage dans ses rêves sur le dos
d’un papillon) ou, carrément, un vol magique:
11 C’est le cas de Tituba qui, dans le roman de Maryse Condé, se retrouve à Salem ou de Ti Jean qui après son avalement par la Bête se retrouve en Afrique, au royaume des morts et en France. De manière plus réaliste, c’est aussi le cas de Man Ya ou de Félicie qui, dans les romans de Gisèle Pineau (L’Exil selon Julia, Un Papillon dans la cité) migrent vers la France.

262
Un bougre de Routhiers, pratiquant magies noire et blanche mélangées, disait avoir touché la Guinée, par
un jour de grand alizé. Il faisait grand ramage du masque de coquillages qu’il avait rapporté – soi-disant –
de cet autre rivage accosté. Une autre, capresse, sorcière de Cacoville, avait atterri, et même cassé un os de
son gros orteil, sur une contrée de Nègres-café qui coquaient les oiseaux comme des femmes, une terre à
conquérir, à mettre en cage. (Pineau, 2000 : 122)
Notons que le retour ne se fait pas uniquement vers les Antilles ou l’Afrique puisque les engagés
Indiens font eux aussi l’expérience d’un retour aux sources comme Z’Oiseau, un personnage
qui, bien qu’il n’ait jamais foulé le sol Indien, le décrit cependant en détails, « avec une
simplicité qui forçait le respect et dissipait l’incrédulité : « ‘‘Chaque nuit, je retourne au Pays
Z’Indiens’’ » (Confiant, 2005 : 231). D’autres, par contre, ne voyagent pas physiquement, mais
laissent leur origine venir à eux. Ce sont des expériences plus discrètes, basées sur des traces
physiques bien réelles, que ce soit par le son des tambours joués par Pa Victor dans Le Meurtre
du Samedi-Gloria par lesquels Romule sent « la force d’Afrique-Guinée mont[er] en volutes au-
dessus de sa tête et se déploy[er] en vagues brûlantes sur son corps, le mettant dans une transe
irrépressible» (Confiant, 2001 : 97), par le biais d’objets physiques comme « le petit sachet
contenant un peu de terre de l’Inde » (Confiant, 2004 : 63) ou encore par un thé qui renvoie à
l’Inde des origines : « Le thé de l’Ancêtre possédait des vertus magiques. Je quittais
instantanément la touffeur de l’Habitation Courbaril pour les rives du fleuve Kaveri dont
m’avait souvent parlé mon père » (Confiant, 2004 : 144).
Au-delà de la magie et du surnaturel, l’importance de la notion de retour est donc
spécifiquement dans le mouvement même de retour, par n’importe quel moyen, à la terre natale
pour échapper à certaines conditions de vie. Qu’il s’agisse de la jeune Félicie qui ne peut
voyager seule, de la narratrice d’Un Plat de porc aux bananes vertes et de Julia qui ne peuvent
plus rentrer chez elles, les personnages migrants n’ont bien souvent que leurs rêves et leur
imagination comme moyens d’action: « son esprit voyage sans fatiguer entre la France et son

263
pays Guadeloupe où chaque jour elle espère retourner » (Pineau, 2000 : 16). Ce type de
représentations est tellement répandu dans les romans que nous pourrions l’analyser comme
l’expression plus vaste d’une recherche collective de l’identité antillaise à partir de la terre
étrangère. Peu importe la durée de leur « détour » ou leurs origines, il apparaît que la majeure
partie des personnages principaux des romans antillais sont toujours décrits comme doubles, à la
fois d’ici et d’ ailleurs. Cette dualité fonde leur existence : ils viennent d’Afrique et vivent aux
Antilles (Man Yaya, Wademba, le premier Longoué), viennent des Antilles et vivent en France
(Ti Jean, Félicie, Mina, Man Ya, Spéro qui, lui, a vécu en France et aux États-unis). Même s’ils
ne viennent pas directement d’un ailleurs, ce sont leurs ancêtres ou leurs parents qui les y
rattachent. Dans tous les cas, cependant, les voyages et les retours (oniriques ou non) ont tous
comme motivation la notion de retour à la terre natale. Nous le voyons avec Tituba qui veut
retourner à sa Barbade natale malgré la violence de l’esclavage, ou avec des personnages qui,
comme Ti Jean ou Félicie, partent vers l’Afrique ou la France pour finalement retrouver
l’importance de leur lieu de naissance. Cependant si Glissant rejette, dans Le Discours antillais,
l’idée de retour, « revenir, c’est consacrer la permanence, la non-relation » (Glissant, 2002 : 44),
il ne le fait que parce qu’il considère que les individus concernés n’ont pas encore pu se
constituer en peuples ce qui les condamnerait aux « amers ressouvenirs d’un possible […] à
jamais perdu » (Glissant, 2002 : 45). Or si notre hypothèse de départ est correcte et si les romans
de notre corpus, par leur utilisation du réalisme mystique, permettent aux auteurs de
(re)construire un passé et un sentiment communautaire, alors nous pourrons dire que les rejets
répétés que subissent les personnages lors de leurs voyages vers l’Afrique ou la France leur
permettrait effectivement de vivre ce « détour » dont parle Glissant. En faisant l’expérience d’un
pays autre et d’une culture différente de la leur (dans lequel, par exemple, le réalisme mystique
antillais ne s’applique pas), ces personnages réalisent ainsi que leur véritable identité se trouve

264
dans les rapports qu’ils entretiennent avec la terre natale et que, malgré les doutes, malgré
l’Histoire, la Guadeloupe et la Martinique sont les origines véritables.
Pris entre une Afrique lointaine qui n’a plus vraiment rapport avec eux et une France à
laquelle ils ne se sentent pas appartenir, la question de l’identité semble donc, pour les auteurs
antillais, essentiellement dépendre de leur rapport à la terre natale. Or, si le souvenir de l’origine
«a été perdu» (Henry Valmore, 1988 : 220) et si, comme le propose Patrick Chamoiseau,
«lorsqu'on voit la constitution des Antilles, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de genèse, puisque tout le
monde est arrivé avec sa genèse; il n'y a pas de mythe fondateur, puisque tout le monde est
arrivé avec ses mythes fondateurs » (McCusker, 2000 : 725), on pourrait se demander si cette
notion de genèse, apparemment absente de la culture et de la société antillaise, est pour autant
absente de la littérature. Les romans – par leur travail constant sur la notion d’origine et leurs
créations de mythes comme celui du conteur – laissent-ils ce vide tel quel ou, au contraire,
pourrait-on y voir une tentative de la part des auteurs de (ré)écrire d’un mythe de création du
monde antillais, une cosmogonie ?
3 Le transbord, le navire négrier et l’océan de la traversée : mise en place d’un mythe des origines.
3.1 Histoire et archétype
La cosmognie (du grec cosmo- « monde » et gon- « engendre » a été originellement
défini par le Dictionnaire de l’Académie française comme « Science ou système de la formation
de l’Univers ». Traditionnellement, il s’agit de récits oraux fondateurs (mais aussi de traités
philosophiques ou scientifiques) de la majeure partie des religions et sociétés traditionnelles, des
mythes relatant les origines du monde, des dieux des peuples, etc. Selon Jean-Pierre Giraud, la
cosmogonie a trait à l’origine physique, énergétique de l’univers ou du monde. Elle est donc, en

265
premier lieu « un acte fondamental et énergétique qui permet de dissocier la Terre du Ciel »
(Giraud, 2005 : 362) dans lequel vont ensuite se dérouler une autre catégorie de mythes « qui
concernent l’ensemble des créations nécessaires à la mise en mouvement d’un ordre social
augmenté souvent d’une justification cosmique ou divine quant à la tutelle du groupe » (Giraud,
2005 : 361). Si l’on en croit les études de Mircea Eliade, cette période de création correspond
également à l’idée de Paradis, « la notion de l’‘‘origine’’ est surtout liée à l’idée de perfection et
de béatitude » (Eliade, 1988 :72-73), ce que John Mbiti confirme pour le continent africain dans
lequel, « according to many stories of creation, man was originally put in a state of happiness,
childlike ignorance, immortality or ability to rise again after dying. […] man lived more or less
in a state or paradise » (Mbiti, 1969: 95). À ces origines idéales a succédé une rupture qui a eu,
pour l’humanité, des conséquences tragiques puisqu’elle a pris la forme d’une chute de ce
paradis initial et d’une condition humaine pénible. À la lecture des romans de notre corpus et à
la lumière de nos constatations sur le rapport à la question de l’origine historique aux Antilles,
nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que ce schéma initial – celui de la perte d’un
paradis, d’une chute vers un monde douloureux– rappelle le schéma de la rupture de l’esclavage
qui se traduit par la perte d’un état de liberté dans un pays originel (représenté et fantasmé
comme idéal) et le passage à un état inférieur de l’être, celui de l’esclavage. En effet, comme le
note Beverley Ormerod-Noakes dans An Introduction to the French Caribbean Novel, les
conditions de vie infernales sous le joug de l’esclavage étaient en effet « idéales » pour le
développement d’une thématique du Paradis incarnée par l’Afrique originelle, ancestrale, à
laquelle les populations réduites en esclavage pouvaient rêver. Poussant plus loin cette
interprétation, nous pourrions également dire que la notion de rejet de l’Afrique dans les romans
pourrait s’appuyer sur cette notion cosmogonique qui explique que « pour que quelque chose
puisse commencer, il faut que les restes et les ruines du vieux cycle soient complètement
anéantis. Autrement dit, si l’on désire obtenir un commencement absolu, la fin d’un Monde doit

266
être radicale » (Eliade, 1988 : 71 italiques de l’auteur). Ainsi, comme pour tout monde nouveau,
pour toute cosmogonie, il ne s’agirait plus de « régénérer ce qui a dégénéré » (Idem.), donc de
faire survivre l’Afrique comme origine et comme pivot identitaire, mais au contraire
« d’anéantir le vieux monde » (Idem.) afin de pouvoir en créer un nouveau. Dépassant la théorie
purement ethnographique, nous pourrions voir l’absence de l’Afrique dans les romans antillais
comme la mise en place de la fin d’un monde (l’Afrique) permettant la création d’une nouvelle
existence qui pourrait constituer une nouvelle cosmogonie du peuple antillais, centrée sur les
représentations de la traversée de l’océan et sur l’arrivée en terre antillaise.
Cette notion de mythe des origines est également liée à la notion d’archétype. En effet,
dans les romans, le passage de l’Afrique aux Antilles est tout d’abord un fait historique vérifié,
amplement étudié et qui propose, d’un pays à l’autre, de grandes similitudes. Comme l’explique
Herbert S. Klein dans son ouvrage The Middle Passage, la manière dont ont été transportés les
esclaves semble avoir été identique un peu partout aussi bien pour le nombre d’esclaves
embarqués, pour le type de navires utilisés, pour le temps de la traversée que pour les conditions
de vie et le traitement des esclaves dans les soutes. Ainsi, nous pouvons voir que les descriptions
des conditions de vie des esclaves dans des romans comme Le Quatrième Siècle d’Édouard
Glissant,
Il avait fallu toute la science du Maître de bord pour que parviennent à bon port les deux tiers des esclaves
embarqués. La maladie, la vermine, le suicide, les révoltes et les exécutions, avaient ponctué la traversée
de cadavres. […] On voyait les striures de bois noirci, gonflées par l’eau, là où la tôle chauffée avait été
dressée, près du brasero. Et on voyait encore les traces épaisses de sang, autour de la tôle, car la tôle
servait à faire danser, au rythme du feu, les insoumis qui avaient refusé de marcher, pendant la demi-heure
hygiénique, sur le pont. Et la tôle elle-même était là, tordue, bossue, noircie, sanglante […] (Glissant,
1997a : 24)

267
correspondent aux faits historiques:
En cas de mauvais temps, la vie devenait atroce. Pour empêcher la mer de pénétrer à l’intérieur, aux
écoutilles, des panneaux pleins remplaçaient les caillebotis […]. Les esclaves restaient en permanence
dans l’entrepont clos. La quasi-obscurité, les bailles à déjections qui se renversaient rendaient l’air
irrespirable, affaiblissant et terrorisant encore plus des Africains qui, ne connaissant rien de la haute mer et
des motifs de leur déportation, croyaient parfois qu’ils étaient destinés à être dévorés par les Blancs.
(Pétré-Grenouilleau, 2004 : 136-137)
Cette ressemblance histoire/fiction et cette généralisation historique du déroulement d’un même
événement propose donc, dans les romans, un phénomène de répétition d’un même schéma,
celui de la traversée de l’océan qui, décrit presque à l’identique dans chaque roman, pourrait être
qualifiée de mythique. Suivant cette observation, on pourrait alors parler d’un archétype, ce qui
nous conduit à l’hypothèse suivante : cet archétype du transbord, répété par les auteurs et dont
leurs romans s’inspirent, pourrait prendre la valeur d’un mythe en révélant, par l’écriture, un
« modèle exemplaire ». Lorsque l’on considère, comme Eliade, que le souvenir d’un événement
ou d’un personnage historique authentique ne peut survivre que deux ou trois siècles dans la
mémoire collective et orale, cet élément de mythisation fonctionne ainsi dans le sens de la
préservation de la mémoire associée aux guerriers de l’imaginaire :
Cela est dû au fait que la mémoire populaire retient difficilement des événements « individuels » et des
figures « authentiques ». Elle fonctionne au moyen de structures différentes ; catégories au lieu
d’événements, archétypes au lieu de personnages historiques. Le personnage historique est assimilé à son
modèle mythique (héros, etc.) tandis que l’événement est intégré dans la catégorie des actions mythiques
(lutte contre le monstre, frères ennemis, etc.). (Eliade, 2001b : 59)
Cette utilisation des mythes et leur rapport à l’identité et la mémoire culturelle – qui semble
indiquer qu’une mythisation serait nécessaire pour éviter l’oubli de la rupture de l’esclavage –
reprend également les propos de Maximilien Laroche pour qui ces mythes sont une substance

268
culturelle provisoire, présente dans la culture et qui ne demande qu’à s’exprimer: « le mythe
attend d’être narré. Étant toujours à reprendre, il demeure provisoire […] Les mythes se
déplacent mais reprennent partout la même course. Ils nous obligent donc à reprendre la même
Histoire sans cesse mais différemment chaque fois » (Laroche, 2002 : 26). Cette remarque peut
expliquer pourquoi on retrouve, dans les romans contemporains, un récit des origines semblable
d’un roman à l’autre. Bien que ne faisant pas appel aux dieux ou aux êtres surnaturels, la
traversée semble reproduire, dans les romans, un schema mythique expliquant l’origine du
monde antillais, une histoire vraie racontant un événement primordial à la suite duquel l’homme
africain, l’ancêtre, est devenu esclave dans un monde nouveau. Mettant ainsi par ecrit ce récit
originel, les auteurs antillais font dans leurs romans ce que faisait l’homme des sociétés
traditionnelle, qui était « obligé de se remémorer l’histoire mythique de la tribu » (Eliade, 1988 :
26), dont il « réactualis[ait] périodiquement une assez grande partie » (Idem.). De ce fait, si
connaître le mythe correspond à la connaissance de l’origine des choses, écrire des romans est
donc, pour les auteurs et les lecteurs, un moyen de vivre le mythe et de remonter aux origines du
peuplement antillais afin de proposer une piste au questionnement identitaire.
3.2 Caractéristiques thématiques du mythe antillais des origines
Si quelques romans antillais mentionnent les origines arawaks et caraïbes des îles, ils ne
mentionnent cependant jamais de mythes amérindiens des origines et se focalisent au contraire
sur l’origine des peuplements de l’époque coloniale, en particulier sur le sort des esclaves
africains et leur expérience traumatisante. Cette origine, telle qu’elle est représentée dans les
romans de notre corpus, a cependant une caractéristique absolument essentielle à notre étude : la
quasi totalité des romans que nous étudions ici se déroulent soit directement dans les Antilles de
l’esclavage soit sur le navire négrier. Il semble donc que dans les romans antillais la notion

269
d’origine ne remonte jamais au-delà de l’expérience dans la cale du navire négrier. Si, comme
nous l’avons vu, beaucoup de personnages ont oublié leur origine, pour d’autres la cale ou la
plantation finissent par prendre valeur d’unique origine, comme dans Texaco de Patrick
Chamoiseau: « L’Africaine elle-même n’avait évoqué que la cale du bateau, comme si elle était
née là-dedans, comme si sa mémoire, juste là, avait fini de battre » (Chamoiseau, 1992 : 134).
Chamoiseau a repris cette confusion de l’origine dans d’autres romans comme L’Esclave vieil
homme et le molosse, dans lequel le personnage du vieil homme, sans même considérer
l’Afrique, se demande s’il était né dans la cale du navire ou sur la plantation : « il ne savait plus
s’il était né sur l’Habitation ou s’il avait connu cette traversée en cale, mais chaque balancement
d’un navire négrier dans les eaux calmes d’une rade, débusquait en lui un roulis primordial »
(Chamoiseau, 2005a : 37). L’origine du peuple antillais, aussi bien Africain et Indien que
Chinois, remonterait donc à cet instant initial de la rupture avec une origine historique, lointaine,
souvent perçue comme idéale. C’est là une image récurrente dans les romans, qui hante de
nombreux personnages, même ceux qui, ne se souvenant pas forcément de leurs origines sont
cependant imprégnés par cette expérience originelle. Tout comme l’odeur des cales du négrier
transmise de génération en génération par Papa Longoué est ses ancêtres, cette expérience
semble transcender la mémoire pour acquérir une richesse de détails qui diffère des images
vagues de l’Afrique:
Le vieil homme esclave ne se souvient pas du bateau, mais il est pour ainsi dire resté dans la cale du
bateau. Sa tête s’est peuplée de cette haute misère. Il a le goût de la mer sur les lèvres. Il entend même en
plein jour le museau dramatique des requins contre la coque. Il a aussi le souvenir des voiles, des barres,
des cordages, comme s’il avait été de l’équipage, et cela se mêle à des visions du pays d’Avant, et même
plus que des visions : des femmes, des êtres, des choses, des beautés, des laideurs, qui frétillent en lui, qui
sont lui, et qui se mêlent aux chaos déclarés. (Chamoiseau, 2005a : 51)

270
Il y aurait donc, dans tout transbord des esclaves, une transformation essentielle, une expérience
originelle qui, dans les romans, se ferait par un passage symbolique, de tonalité mythique, par
l’enfermement dans les cales des navires qui font figure de matrice ou de « Ventre Immonde »
(Confiant, 2006 : 160).
Premier lieu de contact avec l’oppresseur, espace intermédiaire entre deux continents,
flottant entre un monde originel libre et un monde futur d’esclavagisme, le bateau négrier est
une forme d’espace tampon. Temporaire, il est cependant le lieu de gestation à la fin de laquelle
le transbordé, celui qui ne sera pas mort ou qui ne se sera pas échappé (comme Longoué dans Le
Quatrième Siècle), atteindra une nouvelle condition et une nouvelle vie. Lieu clos, symbolisant
le passage d’un lieu ouvert et libre, l’Afrique, à un lieu fermé et oppressif, l’île, le navire est un
curieux oxymore. Cloaque de souffrance physique, de putréfaction et de mort, sa cale a toutes
les caractéristiques du tombeau tout en étant un lieu de création : c’est d’un viol sur un navire
que Tituba a été conçue et c’est pendant la traversée infernale de deux océans décrite dans La
Panse du chacal qu’un enfant naît et que, pendant une tempête, deux personnages font l’amour.
Créatrice de nouvelles générations, génératrice de morts, effacement de l’origine et annonciateur
d’une nouvelle vie de souffrances, le navire est pourtant aussi associé à l’image de la
renaissance, par le passage dans une matrice :
Cette barque est une matrice, le gouffre-matrice. Génératrice de ta clameur. Productrice aussi de toute
unanimité à venir. Car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l’inconnu avec quelques-uns, que tu
ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule, qui t’expulse pourtant. Enceinte d’autant de
morts que de vivants en sursis. (Glissant, 1990 : 18)
On retrouve également une ébauche de cette image chez Césaire, qui se représente le navire à la
fois comme un ventre et un nourrisson rongé par des vers: « le négrier craque de toute part…
Son ventre se convulse et résonne…/L’affreux ténia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de

271
l’étrange nourrisson des mers ! » (Césaire, 2000 : 30). Cette constatation pousse certains
chercheurs comme Françoise Simasotchi-Bronès à expliquer que le monde antillais serait en fait
construit sur une « digénèse » (Idem.), construite sur deux espaces originels : la cale du bateau
négrier et la plantation. Si nous reviendrons sur l’image de la plantation dans notre prochain
chapitre, ce passage par la cale du navire, mélange paradoxal entre un tombeau et une matrice
dans lesquels certains personnages meurent alors que d’autres naissent ou sont conçus, n’est
donc pas un monde fermé puisqu’il se termine par une ouverture sur le monde de la plantation.
En effet, l’homme transbordé débarque ainsi du navire en passant à nouvel état d’existence, une
nouvelle vie, négative, à laquelle il ne peut échapper. Ainsi, comme dans toute cosmogonie,
l’ancien monde que représentait l’Afrique disparaît et le navire devient le point de départ d’un
monde nouveau, les Antilles, pour un homme nouveau, l’esclave:
Imagine cela : tu descends du bateau, non dans un monde nouveau mais dans UNE AUTRE VIE. Ce que
tu croyais essentiel se disperse, balance inutile. Une longue ravine creuse sa trace en toi. Tu n’es plus
qu’abîme. Il fallait vraiment renaître pour survivre. Quelle impure gestation, quel enfer utérin, roye, roye,
roye ! (Chamoiseau, 2004: 153)
Plus qu’un simple événement historique, plus qu’une source pour les registres, le navire
esclavagiste et la traversée prennent donc, dans les romans antillais, une valeur symbolique
essentielle : celle de la mise en place, par une double représentation d’un tombeau et d’une
matrice, de la naissance d’une nouvelle identité. Notons également que s’il est intéressant de
remarquer que la traversée en bateau des esclaves rejoint un schéma de création du monde que
l’on retrouve dans certains mythes africains dans lesquels « in a few cases it is said that God
brought men out of a vessel » (Mbiti, 1969: 94), on ne peut véritablement juger de leur influence
sur les romans antillais sans indices probants. Ce qui est cependant frappant, dans les romans de
notre corpus, est que toutes les références au navire comme ventre ou matrice, « the hold of the

272
ship where the Africans were transported has allegorically become the belly of a giant fish »
(Praeger, 2003: 48), se rapprochent d’un schéma très spécifique, celui d’avalement par un
monstre, de passage par un lieu de ténèbres ou d’enfermement dans une caverne, que l’on
retrouve dans de nombreux mythes comme celui, biblique, de Jonas et la baleine et qui
proposent tous une renaissance vers un ordre nouveau :
Pénétrer dans le ventre du monstre – ou être symboliquement « enseveli », ou être enfermé dans la cabane
initiatique – équivaut à une régression dans l’indistinct primordial, dans la Nuit cosmique. Sortir du ventre,
ou de la cabane ténébreuse, ou de la « tombe » initiatique réitère le retour exemplaire au Chaos, de
manière à rendre possible la répétition de la cosmogonie, à préparer la nouvelle naissance (Eliade, 2004 :
166).
Ainsi par la reprise littéraire, symbolique mais aussi mythique d’un fait historique, le transbord
des esclaves, nous pouvons avancer l’hypothèse que, en jouant avec la répétition d’un archétype
historique expliquant l’origine d’un peuple, les auteurs antillais mettent en place dans leurs
romans non seulement une image symbolique mais aussi un mythe cosmogonique purement
antillais. Cet événement historique dramatique, répété d’un roman à l’autre, dont le déroulement
est parfaitement applicable à certains schémas mythiques constituerait ainsi la première étape
d’une réécriture littéraire et mythique de l’Histoire antillaise, passant par une renaissance
associée à une traversée initiatique de l’océan.
Ce mythe antillais des origines n’est cependant pas limité à la répétition d’un schéma
archétypal perte d’une condition idéale/une renaissance après un passage par un gouffre. La
notion même de descente rejoint en effet la notion de mort symbolique à laquelle s’ajoute une
dimension initiatique. En effet, il n’a pas suffi aux transbordés d’entrer dans la cale pour en
ressortir esclaves. Il leur a fallu passer par les différentes épreuves d’un scénario initiatique qui
comporte habituellement « luttes contre le monstre, obstacles en apparence insurmontables,

273
énigmes à résoudre, travaux impossibles à accomplir, etc. » (Eliade, 1988 : 246) que l’on peut
associer aux marins des négriers, à la violence des capitaines ou de l’océan qui, omniprésent et
imprévisible, est parfois perçu comme un monstre : « pour tout dire, elle se révélait un monstre,
un dragon, sur le dos duquel tournevirait le navire qui semblait chercher désespérément à s’y
agripper » (Confiant, 2005 : 103), « l’océan de plus en plus montagneux, secoué comme par un
dragon géant, brisa ses vagues avec rage contre la coque » (Moutoussamy, 1995 : 89). A ces
schémas initiatiques s’ajoutent des mouvements de descente et d’ascension, ou de mort et de
résurrection comme dans le roman Ti Jean l’Horizon qui, jouant avec divers aspects initiatiques,
multiplient également les traversées symboliques si bien que « le périple du héros tout entier se
donne comme une navigation périlleuse » (Toureh, 1986 : 208). Si tout n’est pas aussi évident
dans les romans qui se veulent plus réalistes, et si l’Histoire empêche certains aspects de
l’initiation comme la victoire contre l’opposant (gardien, monstre), on pourra cependant
remarquer une tendance à considérer cette traversée comme l’origine de la transformation de
l’homme africain en homme antillais. On le voit par exemple avec Le Quatrième Siècle
d’Édouard Glissant, roman dans lequel la mer permet la transformation de Longoué : « il n’avait
pas oublié le pays de là-bas, non ; mais toute cette mer à traverser, et la cravache sur son dos, et
l’autre même qui partagea la prison sur les eaux avec lui, avaient déjà fait de lui un Longoué »
(Glissant, 1997a : 53). En plus du passage par une matrice et un tombeau, permettant une mort
symbolique et une renaissance, la traversée de l’océan, chargée de douleurs, de morts et
d’épreuves prend donc également valeur d’épreuve initiatique par laquelle certains personnages
pourront atteindre, par la souffrance et l’épreuve de la traversée, la renaissance – négative –
dans l’esclavage.
Quand on lit les romans antillais, on ne peut en effet s’empêcher de repérer, en plus des
images du navire tombeau/matrice, la répétition de scènes douloureuses et sinistres, comme avec

274
le viol d’Abena sur le bateau Christ the King (Moi, Tituba…) ou encore la difficile traversée des
deux océans dans La Panse du chacal, qui animalise les engagés indiens qui « étaient devenus
des bêtes sauvages, des fauves désemparés devant l’imminence d’un cataclysme » (Confiant,
2005 : 108). Le manque d’hygiène, la mort, la maladie, la pourriture, la violence des
esclavagistes et celle de l’océan, l’engloutissement par les flots et les requins sont ainsi des
images récurrentes d’une souffrance subie et inévitable qui, dans les romans, créent un lien de
souffrance entre les esclaves qui seraient « nés » d’un lien spécifique, historique et symbolique,
illustré par les horreurs d’une destinée commune liée à l’expérience du ventre symbolique du
négrier : « the Transported are linked by the smell of ‘‘vomit, blood and death,’’ the tortures that
the history books do not talk about» (Praeger, 2003: 38).
3.3 L’océan, la renaissance et l’unité identitaire
À l’origine de la culture antillaise représentee dans les romans, il n’y a plus seulement
une terre d’origine historique mais il y a aussi l’océan de la traversée. Or, si l’on se penche sur
le symbolisme « général » de la mer, on peut remarquer que ce lieu primordial est le plus
souvent un « symbole de la dynamique de la vie. Tout sort de la mer et tout y retourne : lieu des
naissances, des transformations, des renaissances » (Chevalier, Gheebrant, 1982 : 623), ce qui se
prête parfaitement au schéma d’engloutissement/mort et renaissance qui s’applique à la genèse
du peuple antillais et à la symbolique de la cale du négrier. Lieu de mort et de gouffres
correspondant à une « descente aux enfers » (Moutoussamy, 1995 : 76), la traversee de l’océan
est souvent illustrée par l’engloutissement par les requins qui suivent les navires. Passant ainsi
de la cale du navire à la mort dans les profondeurs océanes, certains esclaves « ne sont jamais
sortis du gouffre : passés directement du ventre du négrier au ventre violet du fond des mers »
(Glissant, 1990 : 19). Avant la promesse d’une renaissance négative dans les îles caraïbes,

275
l’avalement par la mer est d’abord, pour certains, la disparition des cadavres jetés à la mer ou
l’engloutissement des vivants devenus, après l’abolition de l’esclavage, des preuves
compromettantes que seules les profondeurs peuvent effacer :
Aussi le deuxième gouffre est-il celui de l’abîme marin. Quand les régates donnent la chasse au négrier, le
plus simple est d’alléger la barque en jetant par-dessus bord la cargaison, lestée de boulets […] le gouffre
est de vrai une tautologie, tout l’océan, toute la mer à la fin doucement affalée aux plaisirs du sable, sont
un énorme commencement, seulement rythmé de ces boulets verdis. (Glissant, 1990 : 18)
Si l’océan est historiquement ce qui efface les preuves, il est aussi, symboliquement, ce qui
efface, dissout personnages et identité :
L’émersion répète le geste cosmogonique de la manifestation formelle ; l’immersion équivaut à une
dissolution des formes. C’est pour cela que le symbolisme des Eaux implique aussi bien la mort que la
renaissance. Le contact avec l’eau comporte toujours une régénération : et parce que la dissolution est
suivie d’une « nouvelle naissance », et parce que l’immersion fertilise et multiplie le potentiel de vie.
(Eliade, 2004 : 112-113)
Comme nous l’avons entrevu plus haut, l’océan propose aussi, au-delà de sa destruction,
l’apparition d’une existence nouvelle, quoique négative : « La mer qui pénétrait les chairs pour
en contrarier l’âme, ou la décomposer, et qui installait à la place le petit rythme des survies
nauséeuses, des petites morts, des amères habitudes, du martyre des carcasses qui doivent
s’accommoder de dispersantes cadences » (Chamoiseau, 2005a : 33-34). Un roulis primordial,
une souffrance qui sera commune à tous les esclaves et qui, comme nous l’avons vu, leur
donnera, une forme de « submarine unity » dont parle le poète jamaïcain Edward Brathwaite et
sur lequel revient Michèle Praeger dans son étude sur Édouard Glissant :

276
The future slaves, however diverse they may be, do have a common bond, albeit a negative one. They
have in common ‘‘collective and submarine unconscious,’’ as Glissant notes under the guise of allegory in
Mahogany: the boat is a womb, a tomb, an open wound that splits out its children. (Praeger, 2003: 38)
Ce lien original à l’océan serait donc, dès les premiers instants de l’esclavage, une forme
d’expérience spirituelle des eaux qui, dans la tradition mythique, « conservent invariablement
leur fonction : elles désintègrent, abolissent les formes, ‘‘lavent les péchés’’, à la fois
purificatrices et régénératrices » (Eliade, 2004 : 113). Source de vie et source de mort, l’océan
est, comme la cale du navire, le lieu de l’entre-deux, de l’incertain et de la virtualité. Il est
également un lieu de transition dans lequel l’esclavage et la rupture identitaire et culturelle ne se
sont pas encore entièrement concrétisées puisque les esclaves sont encore ensemble et ne sont
pas encore effectivement sous l’autorité d’un maître : « le bateau regretté, malgré l’enfer de
l’entrepont, parce qu’il n’était certes pas apparu comme un lieu irrémédiable jusqu’à ce moment
où il avait fallu le quitter » (Glissant, 1997a : 40). Il y a donc, entre la cale du navire et l’océan,
non seulement souffrance et mort, mais aussi, dans l’incertitude du destin, une forme
d’ouverture vers d’autres mondes : puisque les eaux sont « le réservoir de toutes les possibilités
d’existence ; elles précèdent toute forme et supportent toute création » (Eliade, 2004 : 112). Le
sillage des négriers a beau avoir été effacé depuis longtemps, la mer possède une permanence
qui actualise ce passé douloureux. En effet, si les plantations traditionnelles, de même que les
chaînes et les habitations d’esclaves ont disparu, l’océan, lui, est toujours présent, rappelant aux
auteurs cette permanence du souvenir, ces histoires englouties :
Et puis, petit à petit la mer m’a appris la nécessité, elle qui mûrit les os des noyés, elle qui voit passer tant
de lunes. Moi qui la regarde se perdre au loin tout en étant toujours présente, je me dis qu’elle témoigne de
l’authentique permanence de la vie et des hommes à travers les accidents du temps et de l’espace […]. Je
crois à cette présence permanente de la mer : c’est elle qui fait surgir le mythe en lieu et place de la carte
postale. (Orville, 2001 : 127)

277
Il y a donc un lien très fort entre cet océan primordial, qui témoigne du passé sans en laisser de
traces, et la mémoire. Il est le lieu de l’engloutissement des morts, du continent Africain disparu
à l’horizon, et de la traversée qui a changé l’identité de millions de transbordés. Les hommes qui
l’ont traversé ne sont plus ceux qu’ils étaient au départ puisque le passage dans le ventre du
navire a changé leur nature profonde et que, de l’engloutissement à la renaissance, ils ont suivi
un schéma mythique qui leur a permis d’acquérir une nouvelle origine.
L’entre-deux n’est cependant pas infini et la rupture qui inaugure le départ sur l’océan et
la souffrance physique se conclut presque toujours par la « renaissance » au sortir de la cale et
par le baptême chrétien qui achève de briser les individus transbordés. On le voit par exemple
avec Tituba qui, en route vers Boston, se fait ensuite baptiser, un viol spirituel, sur le pont d’un
autre navire par un « filet d’eau glacée » (Condé, 2004 : 63) qui symbolise pour elle un nouvel
état et un nouveau commencement. Cette scène fait écho au viol physique de sa mère, Abena, et
symbolise la naissance des personnages à leur condition nouvelle : « c’est en effet le marin sur
le négrier qui le premier inflige à ce corps féminin sa première blessure d’esclave. Il établit le
premier modèle de souveraineté absolue du maître sur la femme esclave, modèle qui sera suivi
par les planteurs dans les plantations » (Curtius, 2006 : 232). Le rituel du bapteme, lié à l’eau,
est ainsi parfois décrit comme violent, puisqu’il donne au baptisé un nom nouveau qui achève
d’effacer les traces de l’avant: « Puis, sans crier gare, l’homme blanc projeta quelques
gouttelettes d’eau dans les yeux de la fille sauvage : et c’est ainsi qu’elle devint Eloïse… »
(Schwarz-Bart, 1998 : 26). Le baptême, dans ce contexte romanesque, peut ainsi prendre
plusieurs valeurs : 1) il vient de clôturer la période de la traite de la « marchandise » esclave et
marque donc un passage, 2) il inscrit et légitime, par la marque de l’eau, l’appartenance de
l’esclave à de nouveaux maîtres et à un nouveau système. La violence spirituelle de la

278
cérémonie baptismale conclut ainsi l’effacement identitaire et culturel des esclaves en
prolongeant les effets de la traversée :
Puisque les esclaves ont déjà en quelque sorte effectué leur plongée dans les eaux baptismales (l’océan),
les gestes expéditifs de Lestigne […] viendrait confirmer cette hypothèse que le baptême est administré à
la fin du voyage comme simple formalité, comme marque de « purification » des esclaves commencée sur
le négrier et comme acte de légitimation de l’esclavage par l’Église. (Curtius, 2006 : 235)
Dans les romans, le baptême ne serait donc plus seulement une marque du maître et de
l’acculturation, mais une étape finale de la renaissance négative de l’esclave dans l’esclavage.
Physiquement et spirituellement, l’esclave est donc un être en souffrance qui, par ses diverses
expériences de l’arrachement, de la traversee et du baptême, a vu les traces de son passé et de
son identité s’effacer graduellement. Comme dans les représentations traditionnelles de la
réincarnation, l’homme réduit à l’esclavage arrive dans une vie nouvelle, complètement
différente de l’ancienne dont le souvenir s’efface graduellement. De ce fait, entre les
descriptions de la cale du navire comme matrice et l’assimilation de la traversée à une épreuve,
nous pourrions ainsi voir dans les descriptions romanesques du transbord un mythe initiatique
qui, combiné à la mort symbolique/renaissance, donnerait à ce fait historique une valeur de
mythe originel.
Les Antillais ont beau avoir des passeports français, leur identité culturelle est bien plus
complexe puisque, pour résumer, « l’Antillais quitte malgré lui un pays où ses ancêtres sont
arrivés contre leur gré, pour faire souche dans une patrie qu’il ne connaît pas, mais qui est la
sienne, et d’où il repart pour rentrer chez lui, où il n’est pas né » (Anselin, 1990 : 190-192).
L’Afrique et, d’après quelques romans, l’Inde et la Chine sont donc des figures contradictoires,
à la fois proches et lointaines, essentielles mais curieusement idéalisées. Ces lieux originels, vers
lesquels les personnages tentent de voyager aussi bien physiquement que par les rêves et

279
l’imagination, apparaissent ainsi comme des lieux historiques (car ils sont bien réels) mais aussi
mythiques si bien que de nombreux personnages sont condamnés à errer entre « un Ici habité par
la pensée d’un Ailleurs reconstruit à partir d’un creux fantasmatique » (Simasotchi-Bronès,
2004 : 22). Cependant, si l’on suit attentivement les déplacements des multiples personnages de
notre corpus, on ne peut s’empêcher de remarquer que, au-delà des reproductions
fantasmatiques et des rêves de l’origine, les auteurs contemporains proposent, prenant à contre-
pied les théories de la Négritude, une véritable remise en question de l’importance de cette
origine historique. C’est pour cette raison qu’en général, si les héros des romans voyagent vers
l’Afrique, ils vivront une expérience négative et pourquoi, certains d’entre eux semblent
carrément la rejeter, faute de souvenirs et de liens tangibles. Finalement, d’un déplacement à
l’autre, d’un transbord forcé à une émigration souhaitée, ces personnages semblent ne retrouver
une harmonie que dans l’acceptation du pays natal comme origine. Tout en se réclamant des
origines Africaines (Indiennes, Chinoises) et Occidentales qui influencent les modes d’écriture
et de représentation du réel antillais, il sera donc essentiel pour les Antillais de ne pas chercher à
se réapproprier un espace perdu qui, comme l’Afrique ou l’Inde, n’a plus de liens directs avec
eux (tous les romans antillais contemporains semblent être d’accord là-dessus), mais plutôt de
s’approprier un espace nouveau, libre, vierge (ou presque), laissant ainsi aux mythes antillais
assez d’espace pour se développer. Cette quête des origines se déploie dans les romans selon un
axe précis, attaché au passé et se développant autour du thème du transbord, divisé entre le
gouffre matrice du navire, le gouffre mortuaire de l’océan, et la notion de renaissance, en cette
terre d’esclavage, « d’une nouvelle création, d’une nouvelle vie ou d’un ‘‘homme nouveau’’»
(Eliade, 2004 : 113) sur une terre nouvelle. Entre une Afrique mise à distance, une traversée
douloureuse mais temporaire et une France aliénante, cette terre – pourtant hantée par la mort et
l’exploitation et sur laquelle flotte l’ombre de l’esclavage et des plantations de canne à sucre –
semble ainsi se présenter comme le seul lieu de l’identité antillaise.

280
Chapitre 8 Une île de souffrance: le mythe et la terre natale
Les deux événements historiques essentiels dans l’Histoire des communautés antillaises
que sont la rupture initiale de l’esclavage et la perte de l’origine, ont pris, par le biais de la
littérature, une valeur mythique et symbolique visant à établir la présence identitaire de ces
communautés en terre antillaise. Le déplacement historique originel de ces populations se
change ainsi en une cosmogonie nouvelle, s’ouvrant sur un nouvel état d’existence, dominé par
l’esclavage et le système des plantations. Cependant cette terre antillaise, telle qu’elle est décrite
par les études historiques, est un lieu qui ne semble avoir existé qu’à partir du moment où elle a
été « découverte », décrite et nommée par les explorateurs et les colons occidentaux. De même
les esclaves et leur société, qui ont peuplé en plus grand nombre que leurs maîtres ces terres
devenues natales, ne sont, même encore aujourd’hui, que des généralités dans les textes
historiques français. Ainsi, si l’on considère ces faits historiques et les acculturations
successives imposées par la société coloniale, il apparaît clairement que, dans les premiers
temps, l’Histoire de la région Caraïbe et le rapport à la terre antillaise ont été produites par les
colons occidentaux, pour les colons occidentaux. Karukera et Madinina sont devenues la
Guadeloupe et la Martinique et les histoires personnelles et culturelles des esclaves et des
communautés amérindiennes préexistantes ont été oubliées. Un problème identitaire se pose
alors : si dans leurs romans les auteurs antillais proposent, par rejet de l’Afrique et de la France,
un recentrement sur la terre natale, celle-ci semblent cependant être imprégnée de
l’omniprésence des Occidentaux et hantée par les souffrances de l’esclavage. On le voit par

281
exemple avec Patrick Chamoiseau qui, dans Écrire en pays dominé, s’intéresse à
l’occidentalisation de l’Histoire antillaise. Chamoiseau illustre ce phénomène avec la Piste
d’Esnambuc qui, avec ses églises, ses forts et ses maisons de maître fonde « patrimoine
architectural et façade culturelle [alors que] (le reste, indéfini, se voit laisser à l’abandon) »
(Chamoiseau, 2002 : 114). Devenue symbole de l’Histoire du pays, elle a été montrée, honorée
et visitée comme telle en dépit des autres traces historiques. C’est là un fait qui a été
traumatisant pour Chamoiseau qui l’avait « reçue comme telle depuis le plus jeune âge,
abandonnant ainsi l’ensemble des autres présences » (Chamoiseau, 2002 : 114). Les iles n’ont
jamais appartenu aux esclaves et l’Histoire officielle, favorisant l’époque coloniale, la culture
des plantations et les statues de colons, semble oublier les esclaves sans paroles et les traces
amérindiennes qui, parfois, se laissent découvrir sur une plage ou au coeur d’une forêt. La
notion d’identité en cette terre natale des Antilles semble donc mise à mal. En effet, comment
les auteurs antillais, qui dans leurs romans font une réécriture mythique de leurs origines,
peuvent-ils s’approprier une terre qui leur a été niée pendant plusieurs siècles ? Comment
peuvent-ils décrire leur attachement identitaire à des îles qui, bien que natales, ne sont
généralement associées qu’à l’histoire coloniale et aux souffrances de l’esclavage?
Comme nous l’avons vu dans le chapitre sept, nous pouvons voir dans les romans
réalistes mystiques antillais une forme de cosmogonie délimitant le temps entre un avant
originel et paradisiaque et un après infernal succédant au passage matriciel de la traversée.
Ayant établi que les auteurs ont effectivement proposé, consciemment ou non, une réécriture
mythique de leur origine, nous pourrions voir de quelle manière il y a dans leurs romans une
forme de (re)possession, de (ré)appropriation mythique de ces lieux essentiellement marqués par
l’histoire coloniale. Nous penchant d’abord sur les difficultés inhérentes à la réappropriation de
la terre natale antillaise dans les représentations romanesques, nous verrons ensuite comment les

282
auteurs de notre corpus mettent en place, dans leurs œuvres, une image négative mais également
mythique de la Guadeloupe et de la Martinique. Cela nous permettra de voir, dans une dernière
partie, comment ces auteurs parviennent, par une représentation du monde des morts et un
découpage des îles entre un « en haut » et un « en bas », à créer une échappatoire permettant au
réalisme mystique et à l’identité antillaise de s’exprimer en terre coloniale.
1 Les difficultés de l’identification à la terre natale
1.1 Les difficultés de l’appartenance à une terre non originelle
Reconnaître les Antilles comme terre natale et se définir par rapport à cette relation peut
paraître problématique quand celle-ci n’est pas vierge mais héritée de peuples disparus dont les
origines historiques et mythiques sont antérieures à leur « découverte » par les Occidentaux. Ce
monde amérindien de mythes et de dieux, s’il n’a pas été véritablement vécu par les premiers
esclaves et par tous les colons, a cependant été décrit dans les récits de voyage des premiers
missionnaires:
On apprend qu’au temps où la Martinique s’appelait Madinina, et la Guadeloupe Karukera, vivaient les
Indiens Caraïbes. Les récits des voyageurs du XVIe et du XVIIe siècle concordent: les dieux aussi étaient
là. Une vision religieuse du monde ; des croyances et des pratiques magiques. Les indigènes n’étaient pas
des bêtes. Ils cultivaient le manioc et priaient les esprits de la nature qui avaient nom Acamboués. Des
prêtres-guérisseurs, appelés Boiyacou ou Boyés, invoquaient ces esprits et maîtrisaient ces entités par leurs
rituels chamaniques. (Henry-Valmore, 1988 : 29).
S’il ne reste que peu de traces archéologiques physiques du passé amérindien, son héritage en
est plutôt inconscient, illustré par exemple au niveau du vocabulaire créole (certains termes
courants comme « anoli » ou « canari » sont d’origine caraïbe alors que « ouassou » est un
terme tupi) ou de la vie quotidienne (manioc, piments, certaines techniques de pêche

283
traditionnelles). Ainsi, comme le dit Édouard Glissant dans Poétique de la relation, la culture
caraïbe n’a pas disparu mais a plutôt « désapparu » puisqu’elle continue d’exister, de se
perpétuer de manière inconsciente dans le quotidien. Ainsi si ces Amérindiens des Antilles
Légueront aux Nègres déjà présents l’art d’extraire des canots de l’arbre appelé Gommier, celui de
fabriquer des poteries et des fours à charbon. Ils leur légueront aussi une médecine naturelle que la langue
créole appelle « Rimèd razyé ». De leur mythologie survivra de manière ouverte la divinité aquatique,
Manman Dlo, mère de l’eau au chanté diabolique, qui enivre en abysse ceux qui voient sa silhouette aux
abords des rivières. (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 26)
Or, nous dit Confiant, il s’agit là d’un héritage presque uniquement inconscient puisque le
conteur créole, par exemple, « ignore que la Maman d’eau est une sirène amérindienne »
(Confiant, 1995 : 11). Cependant, malgré ces quelques éléments, il ne reste aujourd’hui que peu
de traces de ces populations puisque colons et conquistadores, dont les actions principales
étaient « the appropriation and exploitation of territory » (McCusker, 2003: 41), ont été jusqu’à
renommer les îles elles-mêmes1. Ce manque de lien conscient avec le passé n’est cependant pas
présent dans les romans de notre corpus qui sont nombreux à mentionner les origines
amérindiennes des îles caribéennes, reconnaissant ainsi, par l’écriture, que ces îles natales ne
leur appartiennent pas tout à fait, mais qu’ils en sont les héritiers, un peu comme l’ont fait les
haïtiens à l’indépendance d’Haïti, en choisissant de lui redonner son nom amérindien d’origine.
C’est ce que font par exemple Chamoiseau et Confiant dans l’ouvrage Lettres créoles, dans
lequel ils tentent de reconstituer, par l’imaginaire, un récit des origines en s’inspirant d’une
pierre amérindienne qui leur sert de témoignage d’une histoire qui, en plus de son martyre,
souffre « de ses nombreux silences » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 22). Si Chamoiseau reprend
1 Il n’y qu’à la Dominique que, grâce au relief, le peuple Caraïbe put se cacher des forces européennes. De nos
jours, au nord-est de l'île, ils disposent d'un petit territoire de 15 km², donné par la Couronne britannique en 1903.

284
cette thématique dans Écrire en pays dominé, il met en place une image quasiment nostalgique
de cette période : tout en rappelant sa brutalité, il met également en relief de quelle manière le
système culturel et identitaire de cet avant diffère de la période coloniale. S’identifiant à tout le
peuple amérindien antillais, il oppose un système dans lequel « les familles, les alliances, les
haines et les amours enserraient d’un lacis l’ensemble des terres » (Chamoiseau, 2002 : 122) au
système esclavagiste et ses principes de possession de l’espace et de domination de l’autre. Il
rapproche également Amérindiens et esclaves marrons autour d’une « perdition commune [qui]
les rapproche, et souvent les unit » (Chamoiseau, 2002 : 156). Contrairement aux colons et à
leur rapport de domination de la terre, Chamoiseau décrit ainsi les « hommes d’Amérique »
comme des individus proches de la terre, de l’eau et du ciel, et donc de leur terre natale. On le
voit par exemple avec Ti Jean l’Horizon, dans lequel Simone Schwarz-Bart décrit les premiers
habitants de Fond-Zombi comme des hommes à la peau rouge qui, gravant des roches, « avaient
une façon particulière de poser leur œil sur le paysage, d’où le nom chatoyant qu’ils donnèrent à
leur petit univers : Karukéra, l’Ile-aux-belles-eaux » (Schwarz-Bart, 1998 : 12). Mentionnant les
origines amérindiennes des Antilles, les auteurs font donc, comme lors de leurs descriptions de
l’Afrique originelle, référence à un « avant » précolonial en introduisant l’idée que ces îles ont
eu une histoire et une identité avant l’esclavage. Cette appartenance ancienne permet à certains
personnages de rétablir un certain équilibre entre dominateurs et dominés puisque, dans les
romans, ni les esclaves ni leurs maîtres n’ont de racines sur cette terre qui, historiquement, ne
leur appartient pas. Ces peuples, dont il ne reste que des traces discrètes mais bien réelles
(souvent dans les forêts, les ravines ou des lieux isolés, laissés intacts par l’urbanisation),
marquent ainsi de manière puissante l’espace antillais : « Ce pays n’appartient en fait à personne
[…]. Ou plutôt il appartenait au peuple qui a fabriqué ces objets. Les Caraïbes ! » (Confiant,
2004 : 359). Marques de la mémoire antillaise, chaque objet amérindien est ainsi une lutte
contre l’oubli. Dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau insiste sur le lien originel qui lie les

285
amérindiens à la terre en décrivant ces objets comme « peuplant le sol » (Chamoiseau, 2002 :
128) alors que, dans son roman L’Esclave vieil homme et le molosse, la pierre caraïbe devient la
« trace » de toute une culture : « la Pierre est des peuples. Des peuples dont il ne reste qu’elle.
Leur seule mémoire, enveloppe de mille mémoires » (Chamoiseau, 2005a : 129). Dans ce
roman, Chamoiseau permet en effet à cette civilisation originelle des Antilles de revivre à
travers un vieil esclave marron qui, suivant son propre chemin initiatique et identitaire, accepte
ce passé en se laissant complètement posséder par lui : « boule d’ivresse. Ces disparus vivent en
moi par le biais de la Pierre. Un chaos de millions d’âmes » (Chamoiseau, 2005a : 130).
Contrairement aux origines africaines, vagues et imprécises, il s’agit là d’un passé dont il reste
des traces physiques. Par ce simple fait cette pierre amérindienne qui, minérale, se joint aux os
du vieil homme, attire le narrateur qui y revient et s’y accroche lors de son propre cheminement
identitaire et de son acceptation de la terre natale : « je revins souvent auprès de cette pierre. En
rêve. Au-dessus de ces os. En rêve. Après les jours de désarroi mes songes sont marronneurs »
(Chamoiseau, 2005a : 143-144). Accepter cette origine historique des îles caraïbes, qui n’ont
jamais été vierges de toute population, est donc, surtout chez Chamoiseau, une étape essentielle
entre les rejets de l’Afrique et de la France. Ainsi, celui qui naît en Guadeloupe ou en
Martinique n’est pas seulement guadeloupéen ou martiniquais : il est né sur des îles où
naissaient jadis des peuplades amérindiennes comme les Arawaks et les Caraïbes, qui lui ont
donné son nom et qu’il faut reconnaître. C’est encore plus vrai dans le cas des auteurs antillais
puisque, étant écrivains, ils font partie de cette tracée littéraire qui, depuis leurs romans les plus
récents, remonte jusqu’aux pierres amérindiennes et aux fragments de poterie qui (pour
Chamoiseau et Confiant) constituent une forme de littérature silencieuse et mettent en valeur
l’absence de mythe originel : « Nos pays ont inscrit dans leur terre ces paroles brisées, éparses,
partielles, qui remontent la tracée infinie d’une absence de Genèse : cette silencieuse
littérature » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 23). C’est ainsi que, dans La Panse du chacal par

286
exemple, un enfant qui naît aux Antilles d’un métissage et qui n’a jamais connu les pays
originels de ses parents, n’est pas un enfant de l’ailleurs, mais de la terre qui l’a vu naître : « une
nouvelle espèce de Caraïbe, un être né de l’humus même des îles et qui ne devrait plus rien aux
anciens mondes d’où provenaient ses géniteurs » (Confiant, 2004 : 359). Contrairement aux
rapports conflictuels avec l’Afrique des origines ou la France, il n’y a chez les auteurs antillais
aucun rejet de l’origine amérindienne : Simone Schwarz-Bart rétablit l’origine en rappelant le
nom originel donné à la Guadeloupe par ses «premiers occupants » (Schwarz-Bart, 1998 : 12)
alors que John Indien est, dans Moi, Tituba…, fier de son origine, « il paraît que mon père était
un des rares Arawaks que les Anglais n’ont pas fait fuir. Un colosse de huit pieds de haut »
(Condé, 2004 : 28). Cependant, une fois encore, si beaucoup d’auteurs y font allusion, ce sont
les créolistes Confiant et Chamoiseau qui théorisent cette présence originelle et son importance
de reconnaître ce passé dans leurs essais ou leurs romans. Si Raphaël Confiant met en scène,
dans Nègre marron, la rencontre entre un marron et un de ces « Hommes rouges » qui, comme
une vision apparaît soudainement avec « sa peau qui étincelait la lumière » (Confiant, 2006 :
47), l’ouvrage Lettres créoles rappelle que cette origine amérindienne est celle de tous les
Antillais : « ce récit des origines est gravé pour l’éternité dans les roches de la forêt de
Montravail, à Sainte-Luce (Martinique) […]. La main du premier écrivain de nos pays a tracé
des cercles, des zigzags, des pointillés, des hachures. Cela témoigne d’un martyr : celui du
peuple Caraïbe décimé […] » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 21). Reconnaissant cette origine,
ils pourront ainsi faire comme l’esclave vieil homme et se reconnaître comme antillais
véritables, entiers, conscients de leurs origines et de celles de leur terre natale.

287
1.2 L’Infériorisation littéraire des Antilles
Outre la mise à distance identitaire de l’Afrique et de la France par certains auteurs,
l’identité antillaise semble donc essentiellement trouver son identité au cœur de ces quelques
îles ayant souffert, pendant plusieurs siècles de l’esclavage et de l’acculturation qui y est
associée. Ces lieux de mort et de souffrance physique ont dû faire face à cette influence du
« maître » jusqu’à nos jours puisque, par la départementalisation, ces îles sont devenues des
Départements d’Outre Mer et n’ont jamais pu acquérir une véritable indépendance de
l’influence métropolitaine. Il est donc intéressant de voir que, au-delà de la notion d’acceptation
d’une terre non originelle, le regard que portent certains auteurs sur leurs îles est parfois
problématique. En effet, on retrouve bien souvent dans les romans antillais une forme
d’infériorisation des îles antillaises et des descriptions qui se focalisent plutôt sur la petitesse, le
manque d’importance de ce « lambeau de France sous les tropiques » (Pépin, 2005 : 150). On le
voit dans Ti Jean l’Horizon dans lequel la narratrice insiste sur le manque d’importance de la
Guadeloupe, qui ne serait que l’apanage d’études trop sérieuses et ennuyeuses. Par un effet de
rétrécissement de la perspective, le point de focalisation de la narration de Ti Jean l’Horizon
passe ainsi de la planète, au Golfe du Mexique puis à la Guadeloupe pour finir par Fond-Zombi,
que la narratrice semble considérer comme un des lieux les plus reculés et les plus insignifiants
de la planète:
L’île où se déroule cette histoire n’est pas très connue. Elle flotte dans le golfe du Mexique, à la dérive, en
quelque sorte, et seules quelques mappemondes particulièrement sévères la signalent. […] A vrai dire c’est
une lèche de terre sans importance et son histoire a été jugée une fois pour toutes insignifiante par les
spécialistes. (Schwarz-Bart, 1998 : 11)
Le personnage de Ti Jean lui-même a conscience de cette insignifiance puisqu’il explique lui-
même que sa nation est presque inexistante : « Reine, reine, ne t’excuse pas, fit Ti jean en un

288
rire bref, mon pays est si petit que nul ne le connaît, et ma nation est si faible que c’est à peine si
elle croit à sa propre existence… » (Schwarz-Bart, 1998 : 230). Ce fait est également exprimé
par la mère de Félicie qui, dans Un Papillon dans la cité, insiste sur le fait que sa fille est une
étrangère en France parce qu’elle était dans l’école communale d’un village qui, bien que
français, est tellement éloigné de la Métropole (géographiquement et culturellement) qu’il ne
peut qu’être qualifié d’étranger : « dans une campagne de Guadeloupe qu’on marque même pas
sur toutes les cartes » (Pineau, 1992 : 41). Ce type de descriptions de la terre natale, bien que
basée sur la petitesse réelle de ces îles caribéennes, communique pourtant un sentiment
d’infériorisation que rien, dans les descriptions, ne vient directement contrebalancer. Ce
sentiment pourrait être attribué aux influences d’une Métropole toute puissante sur ses lointaines
représentantes (comme nous l’avons vu avec les premiers romans antillais qui tentaient de
recopier les écrivains français) et d’un phénomène d’oppression culturelle qui « inséparable du
colonialisme va déterminer dans chaque pays colonisé un refoulement de l’âme nationale propre
(histoire, religion, coutumes) pour introduire dans cette collectivité ce que nous appellerons
« l’âme-de-l’autre-métropolitaine » (Ménil, 1981 : 19).
Ce type de représentation n’est cependant pas statique dans les romans et on peut
remarquer que, paradoxalement, les auteurs utilisant ces infériorisations identitaires sont
également ceux qui, dans les mêmes romans, les dépassent pour donner à leurs îles natales une
importance plus grande. Ainsi, si la Guadeloupe, « un pays évanoui qui vivra seulement dans les
songes des Blancs, dans le souvenir des Créoles échappés en France ou en Amérique» (Pineau,
2000 : 48) et le village de Fond-Zombie est décrit comme la quintessence de l’insignifiance, la
narratrice le compare cependant aux grandes cités de l’Histoire humaine:
Si la Guadeloupe est à peine un point sur la carte, évoquer cette broutille de Fond-Zombi peut sembler une
entreprise vaine, un pur gaspillage de salive. Pourtant ce lieu existe et il a même une longue histoire, toute

289
chargée de merveilles, de sang et de peines perdues, de désirs aussi vastes que ceux qui hantaient le ciel de
Ninive, Babylone ou Jérusalem… » (Schwarz-Bart, 1998 : 12)
Le roman Ti Jean l’Horizon va même jusqu’à placer l’île et le village guadeloupéen au cœur de
la scène internationale puisque c’est de ce point précis de l’espace que disparaîtra le soleil, avalé
par une Bête apparue dans la forêt proche de Fond-Zombi. Ainsi, le monde entier sera affecté
par un événement cataclysmique originaire de ce lieu pourtant décrit comme insignifiant.
Malgré les apparences, la Guadeloupe et le village ont bel et bien leur place dans le monde et il
aura fallu un cataclysme planétaire pour que ceux qui y vivent réalisent qu’ils font eux aussi
partie du monde: « de tels faits dépassaient l’imagination, et il fallut un long moment aux
bonnes gens de Fond-Zombi pour admettre que le soleil s’y était éteint pour tout le monde, sans
exception aucune, y compris les cites glorieuses de Métropole qui avaient assisté à sa disparition
soudaine […] » (Schwarz-Bart, 1998 : 93). Ti Jean l’Horizon n’est pas le seul roman à proposer
ce type de réalisation et l’on retrouve en effet, dans plusieurs romans, des sentiments identiques
révélant l’importance de la terre natale antillaise, malgré sa relative insignifiance à l’échelle
planétaire. On le voit par exemple avec la Martinique décrite dans La Lézarde comme une
présence essentielle et rassurante: « tu connais ta terre, tu ne l’oublies pas. Elle n’est qu’une
poussière du monde, mais elle est là… » (Glissant, 2003 : 136). Malgré les morts, les tortures et
les souffrances qui y sont associées, cette terre reste natale, la seule à laquelle les personnages
qui y sont nés peuvent se rattacher: « j’aborde à la terre que j’ai perdue. Je reviens vers la hideur
désertée de ses plaies. Je la reconnais à cœur. Odeur de sueur, de souffrance et de labeur. Mais
paradoxalement odeur forte et chaude qui me réconforte » (Condé, 2004 : 107).
Bien que reconnaissant la petite taille de leurs îles et leur peu d’importance sur la scène
internationale, les auteurs ne peuvent rejeter ces lieux qui les ont vus naître et avec lesquels ils
ont un contact physique. En effet, mettant symboliquement à distance l’Afrique et la France et

290
parfois rejetés par elles, les auteurs et leurs personnages ne peuvent rejeter leur terre natale, sous
peine de devenir apatrides. L’infériorisation de la terre natale n’est cependant pas le seul danger
des représentations du rapport identitaire aux Antilles. En effet, si l’influence de la Métropole a
engendré un sentiment d’infériorité qui se manifeste encore parfois dans les romans, elle a aussi
largement associé les Antilles à une forme d’exotisme déformant.
1.3 L’exotisme et les effets de la colonisation
Décrit par Jean-Marc Moura dans Lire l’exotisme (1992) comme une rêverie et
l’approche d’un espace lointain se réalisant dans l’écriture, l’exotisme est en effet un ensemble
de « références à un ailleurs » (Hamon, 1982 : 137) généralement perçues comme le produit
d’un regard superficiel porté sur l’ensemble des manifestations culturelles et identitaires de
cultures étrangères. Ce type de représentation de l’étranger repose en effet sur une dialectique
du même et de l’autre qui devrait être considéré comme « un stade inévitable mais provisoire de
l’apprentissage d’une autre culture » (Schon, 2003 : 13) qu’il faut dépasser. On trouve ce type
de représentation depuis le mythe du « Nouvel Adam » décrit par Maximilien Laroche, qui
« évoque l’image d’un homme à l’orée du Paradis, qui bâtit celui-ci de ses propres mains, le
défriche comme une forêt et le façonne à son image » (Laroche, 1987 : 93), jusqu’aux multiples
représentations qui, des Doudouistes à nos jours, décrivent les îles antillaises comme des lieux
paradisiaques. Ce sont là des représentations qui ont véhiculé toutes sortes de stéréotypes issus
de l’imaginaire occidental : « from the first available writings by Spanish conquerors, which
describe America and especially the West Indies as a rediscovered paradise, to the 1988 edition
of the Guide bleu, the laudatory expressions concerning the archipelago have barely changed »
(Praeger, 2003: 73). Si, comme l’écrit Chamoiseau, « le regard dominant ne distingue que
l’évidence paradisiaque » (Chamoiseau, 2002 : 258), on le voit aujourd’hui encore sur le site

291
officiel des îles de la Guadeloupe2 qui, par ordre de représentations, propose sur sa page
principale la photo d’une plage et celle d’une forêt auxquelles succèdent celles d’un bâtiment
colonial et d’un marché. Même si ce site cherche à mettre en valeur une certaine identité, « plus
qu’une culture… une âme », les images qui, sur les pages suivantes, y sont associées ne vont pas
au-delà de représentations stéréotypées: un bâtiment colonial, un costume traditionnel, des
photographies mettant en valeur la nature (cascades, de forêts tropicales, de colibris et de sports
extrêmes), la mer (plages, de surfeurs et d’hôtels) et les « saveurs » (fruits, de cocktails et de
plats créoles). Bref, malgré des efforts de mise en valeur de la culture, les représentations
principales ne se basent que sur ce qui, pour des touristes occidentaux, représente la
Guadeloupe. Même chose pour la Martinique : si la page d’entrée au site décrit la Martinique
comme « "Papier froissé", petit point en plein cœur de l’arc antillais, la Martinique aime la
diversité et brille de toutes les facettes du monde... »3, les images qui apparaissent sur la page
suivante sont, là aussi, des photographies de montagnes, d’îlots et de plages, bref, tout ce que
l’on peut attendre d’un site touristique4. Nous nous retrouvons donc devant un paradoxe : les
auteurs ont constitué un mythe antillais des origines basé sur les notions de souffrance et de
mort initiatique associés à l’esclavage, mais leurs histoires se déroulent en des lieux
généralement associés à une série de stéréotypes tropicaux de relaxation, de plages blanches et
de cocotiers… et à un passé de souffrance et d’humiliations. Comme le suggére Chamoiseau, il
en est de même pour la vie quotidienne et les multiples formes d’acculturation quotidiennes
2 http://www.lesilesdeguadeloupe.com/ (Janvier 2010)
3 http://www.martiniquetourisme.com/ (Janvier 2010)
4 Notons ici que la section « populations et traditions » de la nouvelle version du site de la Martinique (Juillet 2010)
propose une liste des métissages culturels martinicais, en utilisant des adjectifs uniquement féminins (‘‘chabine’’, ‘‘câpresse’’, ‘‘mulâtresse’’, etc.), en ne précisant leurs origines que par un vague « les nombreuses ethnies qui se sont un jour ou l’autre arrêtées chez nous ». L’esclavage n’est lui aussi que superfiiellement mentionné.

292
dont souffrent ces îles n’ayant pas pu s’émanciper de l’influence directe de la Métropole. C’est
ainsi que les « bars-à-rhum » deviennent des « cafés » et que la période des pluies et des
cyclones est appelée été « simplement parce que cette saison coïncide avec la phase estivale de
l’Europe » (Chamosieau, 2002 : 118). Nous pourrions donc nous demander si ces auteurs qui,
comme nous l’avons vu, rejettent le doudouisme et son regard colonial, rejettent entièrement ces
représentations ou si, au contraire, ils jouent le jeu de cette vision coloniale.
Cette problématique est soulevée par Mohamadou Kane qui, dans son étude du roman
africain « L’écrivain africain et son public », distingue l’Afrique comme public de cœur de
l’Occident perçu comme un public de raison et s’intéresse aux divergences entre leurs attentes et
leurs perceptions. En effet, pour une grande partie du public occidental (qui constitue le
principal lectorat de nombreuses littératures postcoloniales), la Guadeloupe et la Martinique sont
considérées comme un lieu de vacances, des îles lointaines, ce qui n’est pas le cas pour ceux qui
y vivent ou y travaillent. Or, comment évoquer un lieu dit « exotique » sans pour autant faire de
références à cette notion ? La notion de paradis exotique est importante dans les romans car la
Martinique et la Guadeloupe, comme le reste de la Caraïbe, ont toujours fait figure de paradis
dans l’imaginaire occidental (des premiers récits de voyage aux plus récentes représentations
publicitaires). Cette représentation est très différente de celles que peuvent en avoir les Antillais
eux-mêmes puisque, comme l’avons vu, c’est dans ce même paysage que leurs ancêtres ont été
transbordés. Ainsi, comme le réalisme mystique s’intéresse à ce qui se cache derrière le réel, les
romans antillais s’intéressent le plus souvent à ce qui se trouve derrière la façade de l’exotisme
afin de le contrebalancer : « les touristes qui sillonnent les routes de Guadeloupe ne prennent pas
conscience de ce qui se trame dans le pays, continua Victor. Ils sont éblouis par le soleil, le
blanc du sable et le bleu de la mer. Ils disent que la nature est exubérante et foisonnante. Ils sont
au paradis et ne semblent pas croire que les gens existent en vrai dans ce décor… » (Pineau,

293
2004 : 365). Ainsi, nous remarquons que peu de romans se déroulent au bord de la mer, ou dans
un lieu touristique : la plupart d’entre eux choisissent en effet comme décor la campagne
antillaise (L’Esclave vieil homme et le molosse, Moi, Tituba…, Le Quatrième Siècle, La Grande
Drive des esprits) de petites villes ou des villages (Hadriana dans tous mes rêves, Ti Jean
l’Horizon) ou les quartiers pauvres, populaires des grandes villes (Solibo Magnifique, Le
Meurtre du Samedi-Gloria), ce qui entraîne une remise en question de la notion de
représentation qui, dans les romans antillais, ne devrait pas être le reflet du regard occidental.
Tout serait donc une affaire de regard. En effet, comme le note Maximilien Laroche, si l’on peut
comprendre « que les Français aient parlé de St-Domingue comme de la perle des Antilles [il
est] moins compréhensible que les Haïtiens continuent de parler de perle des Antilles à propos
d’Haïti » (Laroche, 1987 : 81). Par une image paradoxale que l’on peut lier à la dualité du regard
(celui de l’esclave/de l’Antillais et celui du colon/de l’Occidental) il apparaît donc qu’un lieu
perçu comme lieu de souffrance pour les uns, puisse être considéré comme un véritable Jardin
d’Eden pour les autres : « toute colonie est un Paradis pour les colonisateurs et un enfer pour les
colonisés, surtout s’ils sont esclaves, comme c’était le cas pour les Haïtiens avant 1804 »
(Laroche, 1987 : 81). C’est ainsi que des écrivains comme Confiant, se retrouvent face à la
difficulté de se représenter eux-mêmes et leur monde en se détachant de l’omniprésence de ces
regards étrangers, exotiques qui les définissent malgré eux : « Et le drame, pour moi, écrivain
antillais, c’est que ni le cocotier ni la plage de sable blanc ne sont exotiques dans mon vécu
quotidien mais, dès l’instant où, usant de la langue française, je m’attelle à les évoquer, je me
retrouve littéralement pris en otage, terrorisé au sens étymologique du terme par le regard
réifiant de l’Occident » (Confiant, 1994b : 173). De ce fait, faire preuve d’exotisme serait
d’utiliser un point de vue étranger pour décrire la terre natale. Or, comme l’indique Confiant,
certains éléments seront, comme la notion de l’île tropicale, immanquablement pris en otage par
le regard occidental et « exoticisé ».

294
1.4 L’île prison et l’anti-exotisme
Il semble donc évident ici que les auteurs antillais contemporains doivent absolument se
défaire de ces représentations stéréotypées qui ne sont que des simplifications du regard colonial
ainsi que « an arrested, fixated form of representation that, in denying the play of difference
(which the negation through the Other permits), constitutes a problem for the representation of
the subject in significations of psychic and social relations » (Bhabha, 2004: 107). Cependant,
comme nous l’avons vu avec les premiers auteurs antillais qui, copiant les modèles littéraires
français, ont représenté une étape nécessaire à l’avènement d’une littérature purement antillaise,
nous pourrions ici supposer qu’il en serait de même pour la notion d’exotisme qui, dans les
premiers romans antillais, ne serait « un stade inévitable mais provisoire dans l’apprentissage
d’une autre culture » (Schon, 2003 : 13). En effet, simplement par leur nature lointaine, leur
végétation et leur spiritualité différente, les îles antillaises seront automatiquement perçues
comme exotiques pour les lecteurs non antillais. Cependant, nous remarquons que les références
aux stéréotypes sont moins fréquentes qu’elles l’étaient chez les doudouistes même si certains
auteurs comme Pépin, Chamoiseau ou Confiant ont parfois tendance à également utiliser
certains stéréotypes spécifiques5. Cependant, malgré ce type de détails, on remarque dans les
romans un véritable affaiblissement des clichés, qui ont bien du mal à survivre dans les milieux
pauvres dans lesquels une majorité des romans se déroulent. Ce fait didactique donnerait ainsi
aux premiers romans antillais et leur exotisme le rôle d’une « entremetteuse analphabète, dont le
lecteur se débarrasse une fois qu’il a fait connaissance avec la culture élue » (Idem.). Ainsi, si
5 En effet, si Confiant et Chamoiseau essaient de rendre compte de la diversité raciale de la Martinique, on retrouve
souvent chez eux une association de la femme métisse, au physique presque toujours charmant, à une certaine sensualité.

295
ignorer ou suivre les stéréotypes serait nier toute une partie de l’évolution de la littérature
antillaise, il semble évident que les auteurs devraient, dans leurs romans, dépasser ce type de
représentations idéales afin d’atteindre une vérité plus profonde, jaillie de l’histoire et de la
conscience collective et individuelle antillaise. C’est ainsi que, décrivant leurs îles natales, ils
prendront ce symbole de l’exotisme qu’est l’île pour l’étudier d’un point de vue antillais.
Ce qui caractérise d’abord l’île, nous dit Roger Toumson dans son étude L’Utopie
perdue des îles d’Amérique, c’est son apparition au milieu des eaux et son détachement du
continent et de l’océan : « point d’émergence, l’île est un organe qui se dégage du milieu liquide
qu’il traverse verticalement pour s’en détacher et apparaître à la surface. Ce qui caractérise ce
phénomène, c’est la soudaineté de l’apparition » (Toumson, 2004 : 49). Cette image génésique
n’est pas sans rappeler la naissance de la Guadeloupe décrite par Simone Schwarz-Bart dans Ti
Jean l’Horizon qui est, elle aussi, apparue : « elle a surgi tout récemment de la mer, à peine un
ou deux petits millions d’années » (Schwarz-Bart, 1998 : 11). Par rapport au continent, duquel
elle se détache, l’île est toujours associée à un certain nombre de stéréotypes dans l’esprit
occidental. Par son isolation, elle est ainsi « une des fonctions constantes du discours utopique »
ainsi qu’ «une représentation onirique, l’objet d’un rêve humain […]. L’essence de l’île déserte
est imaginaire et non réelle, mythologique et non géographique » (Toumson, 2004 : 47).
Cependant, si l’île est souvent décrite ou perçue comme paradisiaque, un locus amoenus, cette
image se heurte, dans la littérature antillaise, au développement d’un autre type de
représentation nettement plus négative. Comme nous le voyons dans les romans antillais,
l’isolation créée par l’océan, et « encerclement d’une mer indéchiffrable » (Chamoiseau, 2002 :
160) est plutôt associée à l’emprisonnement, donc à un lieu de souffrance, plutôt qu’à une utopie
ou un lieu d’ouverture: « The sea imprisons the island, threatens it inescapably » (Praeger, 2003:
88). Ainsi, si l’océan a d’abord coupé tout lien entre l’Afrique de l’avant et les Antilles du

296
présent, devenant une entrave au savoir généalogique, culturel et identitaire, il est ensuite
essentiellement devenu une barrière infranchissable : « il s’aperçut qu’il était arrivé au bout de
la jetée et eut l’impression de se trouver devant une porte verrouillée qui donnait sur l’autre
monde. Toute cette immensité à perte de vue l’oppressait » (Condé, 2000 : 308). L’isolation
offerte par la mer n’est donc, dans les romans antillais, jamais positive et relève de l’absence
d’alternative : « puisqu’il n’y avait plus que la terre minuscule entourée de la mer sans fin et
qu’il fallait bien y rester » (Glissant, 1997a : 86). On le voit par exemple lors des explorations de
Longoué qui, après son marronnage, se retrouve bloqué par la mer : « il marcha sur les hauteurs
au long de la côte et remarqua que toujours la pointe s’offrait à lui, de quelque côté qu’il allât :
voici donc qu’il était cerné, cernant lui-même à mesure de sa marche le secret domaine du
sable » (Glissant, 1997a : 63).
La géographie insulaire apparaît donc, dans les romans, non pas comme un locus
amoenus mais comme une limitation de l’espace et une impossibilité de fuite : « La petitesse des
îles, cercles renfermés, semble limiter l’occasion de fuite par voie de terre, loin des plantations
des maîtres » (Leung, 1999 : 199-200) et donc, par là même, elles deviennent des espaces
fermés, des « espaces prisons » diminuant pour les esclaves et les marrons toute chance de fuite.
Cette absence de mouvement et de liberté symbolise l’impossibilité pour les populations
d’esclaves de vivre dans une véritable alternative coloniale : ils ne peuvent qu’être esclaves ou
vivre dans l’instabilité marronne. En effet, avec la situation insulaire, il n’y a plus de
découvertes ni de nouveautés possibles pour les esclaves qui, dans les romans, se retrouvent
dans un espace marqué par les « stigmates de répétition, d’obsession et d’itération [par lesquels]
L’île est vécue comme camp de condamnation à revivre sempiternellement la même chose »
(Affergan, 1983 : 15). Elle n’est donc pas ouverture de l’esprit et de l’imagination mais
enfermement mental et spirituel comme pour Sylvestre qui, dans La Traversée de la Mangrove,

297
vit une existence limitée par la géographie parce qu’il « ne connaissait rien du passé de son
peuple et dont l’imagination de ce fait ne s’évadait jamais au-delà des limites étincelantes de
l’île […]» (Condé, 2005 : 133). Théâtres du drame de l’esclavage et de l’acculturation, les îles
antillaises ne sont donc pas ces lieux paradisiaques imaginés par les littératures occidentales ou
ces paradis bibliques des premiers récits de voyage. Elles demeurent, dans les romans,
particulièrement représentatives des conditions de vie qu’elles ont pendant longtemps hébergées
et qui, comme dans un palimpseste, s’inscrivent dans chaque replis du paysage antillais « les
paysages, rappelle Glissant, sont les seuls à inscrire, à leur façon non anthropomorphe, un peu
de notre tragédie, de notre vouloir exister » (Bernabé, 1993 : 37). Comme nous allons le voir,
cette tragédie s’illustre en particulier dans la représentation des plantations de canne à sucre et
leur rapport à l’origine de la société antillaise.
2 L’ « en haut » et l’ « en bas » : retrouver sa place dans le monde antillais
2.1 Du système des plantations à la canne à sucre : un mythe monstrueux des origines ?
Comme la traversée de l’océan et le transbord, la plantation de canne à sucre est elle
aussi une constante dans les romans antillais: associée aux règlements du Code Noir elle
marque, dans les romans, le lieu suprême de la rupture, de l’acculturation et celui d’un nouvel
engloutissement identitaire et culturel de l’individu. Succédant au ventre du navire comme
espace de servitude, la plantation représente, comme lui, la continuation « d’une image de la
chute car les personnages passent du souvenir d’un paradis perdu à l’univers infernal de la
canne» (Simasotchi-Bronès, 2004 : 38). Destination finale de tous les négriers, associée à la
souffrance et la mort, la plantation est l’espace principal de la déshumanisation de l’esclave et

298
de la perte de la mémoire qui « lentement se dissout dans la fureur des champs de canne à
sucre» (Confiant, 2004 : 127) à laquelle s’ajoute l’annihilation identitaire voulue par le Code
Noir :
Oui, nous avons été des hommes autrefois, des hommes au complet, comme tous ceux qui vont sous les
nuages : et nous avons construit leurs usines à sucre, nous avons cultivé leurs terres et bâti leurs maisons et
ils nous ont frappés, assommés… Jusqu’à ce que nous ne sachions plus si nous appartenons au monde des
hommes ou à celui des vents, du vide et du néant… (Schwarz-Bart, 1998 : 56)
Suivant la déchirure d’avec l’origine, les diverses ruptures qui font des plantations « un des
espaces dans lesquels les hommes perdent leur humanité, leur véritable ‘‘hauteur’’, pour être
ravalés au rang de bêtes de somme » (Simasotchi-Bronès, 2004 : 40). Bref, après le passage par
le navire et leur perte de l’origine, l’expérience des esclaves s’ouvre ensuite sur cet espace de la
plantation qui achève la déconstruction de l’individu qui se voit réduit à l’état de meuble.
Succédant à la cale du négrier comme lieu de création de cet homme « nouveau » qu’est
l’esclave, la plantation pourrait ainsi, elle aussi, prendre valeur d’origine et de matrice. On le
voit chez Glissant, pour qui « La Plantation est un des ventres du monde» (Glissant, 1990 : 89)
et selon qui « c’est bien à cette deuxième matrice de la Plantation, après celle du bateau négrier,
qu’il faut rapporter la trace de nos sources, difficiles et opaques » (Glissant, 1990 : 87). Tout
comme la cale du négrier, la plantation, ce lieu d’engloutissement réel et symbolique de millions
d’individus, n’a pas d’origine divine ou surnaturelle. Elle n’est donc pas un mythe « classique ».
De même, si elle ne met pas directement en scène les divinités ou les forces créatrices de
l’univers, cette cosmogonie propose cependant, dans les romans, des maîtres qui, bien
qu’humains, ont une « toute-puissance » (Chamoiseau, 2005a : 19) ou une « omniprésence qui
fit qu’on l’appela l’Habitant » (Chamoiseau, Confiant, 1999 : 44) qui, appuyée par l’abondance
des scènes de tortures, de viols et de morts orchestrées par ces maîtres qui ont droit de vie ou de

299
mort sur leurs esclaves, leur donne une image divine. Cette puissance se manifeste également
dans la capacité des colons à créer les plantations à partir du chaos de la nature. Une puissance
créatrice que l’on retrouve par exemple dans la description du maître de plantation dans
L’Esclave vieil homme et le molosse:
Il avait dressé les plus hauts murs de pierre, les officines de marbre et les voûtes gothiques où sommeillent
des grandeurs. Et fondé les villes blanches dans le miroir des rades. Et déployé les ports sur des cheveux
de mulâtresses. Il avait défriché les terres fumantes, dompté les rivières vomies par le volcan, repoussé les
serpents qui contrariaient le songe des angelots de fontaines. (Chamoiseau, 2005a : 104-105)
Pourrait-on, ici aussi, parler de cosmogonie ? Si elle n’a rien de sacré et si elle est plutôt une
marque de la technologie et de l’urbanisation, la plantation n’en définit donc pas moins l’espace
antillais dans ses origines esclavagistes, en jouant le rôle d’ancrage spatial, un point fixe,
permettant « de s’orienter dans l’homogénéité chaotique, de ‘‘fonder le monde’’» (Eliade,
2004 : 27). On le remarque par exemple dans Ti Jean l’Horizon dans lequel la disparition du
soleil et la nuit engendrent un chaos duquel renaît le système plantationnaire, le premier système
social antillais, le premier « ordre » né du monde colonial vers lequel, dans la panique et le
désespoir, se tournent les Antillais :
On en était arrivé là, la bouche débordant de nuit grise, lorsque le bruit courut que les blancs embauchaient
à nouveau, mais sous condition que les gens vivent à l’intérieur des clôtures, comme dans les temps
anciens […]. Quelques augures murmurèrent que l’abomination était entrain de renaître, ils en reniflaient
la vilaine odeur dans l’air… (Schwarz-Bart, 1998 : 105)
Le système des plantations apparaît donc, ici, par la technologie, comme une forme de création à
partir du chaos, en particulier du chaos de la nature antillaise, ce qui nous ramène, comme avec
la cale du négrier, vers une forme de thématique génésique. En effet, bien que cruel et inhumain,
c’est par ce système socio-économique que les Antilles sont aujourd’hui ce qu’elles sont. Que

300
les esclaves aient vécu avant ou après l’abolition définitive de l’esclavage, la plantation reste,
aussi bien historiquement que dans les romans, le lieu originel et unique du contact social entre
les esclaves et leurs maîtres, la première « société » antillaise après la disparition des
amérindiens et le point d’origine de l’ordre social et identitaire antillais : « c’est dans son aire
que s’est mis en place une bonne partie de ce qui fait la complexité des rapports sociaux aux
Antilles » (Simasotchi-Bronès, 2004 : 47).
Seul et unique monde connu par les esclaves transbordés, les plantations ont ainsi été un
monde à part, la matrice génératrice de nouveaux peuples, de nouvelles langues et de nouvelles
identités qui ont fondé les Caraïbes contemporaines. Selon Confiant et Glissant (qui écrit
toujours plantation avec une « P » majuscule), elles sont, par leur création de mœurs, de
coutumes et de personnages comme le marron ou le conteur, à l’origine d’un monde et d’une
civilisation véritablement nouveaux,
La seule où a régné sans partage, pendant quasiment trois siècles, cette institution concentrationnaire
qu’est la Plantation. C’est la seule où sont apparues des langues et des cultures totalement neuves : créoles
à base lexicale française, papiamento, sranan-tongo, religions vaudou, santeria, pocomania, etc… et où un
homme neuf, ni Amérindien, ni Européen, ni Africain, ni Asiatique, est apparu : l’Homme Créole.
(Confiant, 1998 : 10)
Édouard Glissant suggère ainsi que l’importance de ce système a été cruciale dans l’existence et
la survie de la culture caribéenne et ce jusqu’à aujourd’hui : « c’est la floraison de cette culture
populaire du temps du système des Plantations qui fonde aujourd’hui notre « profondeur », le ça
qui nous est à découvrir. C’est à partir d’elle que nous persistons » (Pineau, 2002 : 310). Même
si elle est bouleversée par les fuites des marrons, les drames personnels et les mouvements de
l’Histoire, la présence des plantations (présence physique, onirique ou mémorielle) reste donc
un passage obligé dans les romans antillais. Ce système, presque omniprésent dans les romans,

301
fait partie de ce que André Siganos appelle le « mythe socio-historique », c'est-à-dire un mythe
qui se définit « par une sociologie et une philosophie de l’Histoire visant à envisager, dans une
société donnée, quelle idée la gouverne massivement, et quelles en sont les implications et les
expressions à tous les niveaux de fonctionnement ou de création » (Siganos, 2005a : 89). C’est
ainsi que le système des plantations a, en tant que mythe historique, engendré la création d’un
système de vie et de société spécifiquement antillais comme la généralisation des petits métiers,
les djobs illustrés par exemple dans Chronique de sept misères de Patrick Chamoiseau et
« l’habitude d’une économie parcellaire de subsistance […]» (Glissant, 1990 : 79). Ainsi, si la
traversée dans la cale du négrier a fait de l’homme africain un esclave, la plantation est donc le
véritable berceau de la société antillaise d’aujourd’hui, un mythe originel né non pas de la
douceur et de l’idéal, mais de la chute, de l’épreuve et de son association à un élément essentiel,
autour duquel il s’est organisé et qui est la motivation de sa création : la canne à sucre.
Omniprésents dans les romans, les champs de canne sont l’éternel symbole d’un passé et
d’une histoire qui semble ne jamais s’effacer et que l’on retrouve dans les romans les plus
récents, comme Chair Piment, dans lequel Gisèle Pineau décrit ces: « immuables champs de
cannes bercés par les immuables alizés » (Pineau, 2004 : 236). Symbole maléfique de
l’exploitation et « de misère existentielle » (Leung, 1999 : 105), elle est la Némésis de l’esclave :
la raison de sa présence dans les îles, la raison de son transbord, l’origine de sa souffrance, bref,
l’origine de sa vie et de sa mort. De nos jours encore, elle continue de hanter l’esprit des
Antillais, comme on peut le voir dans leurs réticences annuelles à s’engager dans sa récolte que
l’on retrouve d’ailleurs dans Pluie et vent sur Telumée miracle de Simone Schwarz-Bart à
travers le cri d’Élie, qui jure qu’« il ne ramasserait pas la malédiction » (Schwarz-Bart, 2003:
86). Simple plante à la sève sucrée, les auteurs associent à la canne un champ lexical de
souffrance et de mort comme « le bâton de mort » (Glissant, 2003 : 55), le « bourreau »

302
(Confiant, 2004 : 189) ou « antichambre[s] de l’enfer » (Confiant, 2005 : 227-228) qui, entre
son goût et son prix sur la vie des esclaves, fait naître une oxymore douceur/souffrance: « sous
son doux nom de roseau sucré, il cache une terreur sans nom » (Idem.). Son rapport à l’esclave
est une forme de vampirisation symbolique puisque nombreux auteurs insistent sur l’idée qu’elle
nécessite le sang, la mort et la sueur de millions d’esclaves pour subsister: « nul n’ignore aux
îles que c’est la sueur du nègre qui fit trop longtemps pousser cette graminée » (Césaire, 1994 :
40). Ces lieux de sauvagerie illustrent l’idée que la chute de l’homme africain, la perte de sa
liberté, de son origine, et sa « renaissance » dans les chaînes de l’esclavage est une véritable
malédiction qui semble s’incarner dans ces plantations de canne à sucre, « ces lieux avaient
connu la damnation » (Chamoiseau, 2005a : 103), et qui rappellent ainsi le mythe biblique de
Cham6 qui, selon certains colons, justifiait l’esclavage des hommes noirs en les considérant
comme les descendants de Cham et de son fils, tous les deux maudits : « l’amalgame des deux
punitions [celle de Cham et d’un de ses fils] aboutit à l’histoire véhiculée par l’Église : la
noirceur du péché de Cham se refléta sur l’épiderme de sa descendance comme la trace
indélébile de son opprobre et elle fut contrainte à l’exil dans des contrées lointaines » (Maignan-
Claverie, 2005 : 36). C’est là une discrimination fondatrice qui se retrouverait à la base de
l’inégalité hiérarchique antillaise à laquelle s’identifie le personnage de Chamoiseau dans Solibo
Magnifique : « ‘‘Chamoiseau ? Parce que pour eux, tu étais descendant (donc oiseau de…) du
Cham de la Bible, celui qui avait la peau noire’’, me disait Solibo…» (Ibid. : 57).
Paradoxalement, nous pouvons ici noter qu’un des seuls mythes nommé dans les romans
antillais de notre corpus est donc un mythe biblique, symbole de l’oppression spirituelle et
6 Ce mythe est le seul mythe biblique nommé dans la littérature antillaise. Bien qu’étant un mythe issu de la Bible,
symbole de l’oppression spirituelle et religieuse, il est essentiellement associé à une idée de malédiction imposée par les maîtres et par leur Dieu.

303
religieuse du Livre et des maîtres et qui justifie, par l’idée de malédiction, la condition des
esclaves.
Si la canne est symbole de souffrance et de damnation, elle est cependant un élément
identitaire essentiel. En effet, si les plantations sont à l’origine de la création et de l’existence
des sociétés antillaises, elles ne pourraient pas exister sans la canne, qui en est son symbole, son
incarnation: « qu’est-ce que c’est, hein, la Guadeloupe à présent ? S’il n’y a plus de canne, il n’y
a plus de Guadeloupe ! » (Condé, 2005 : 21). La relation entre le monde antillais et la canne à
sucre a une telle importance qu’elle entretient une relation véritablement fusionnelle entre
l’esclave, l’engagé et leur descendance : « La canne ne lâche jamais le Nègre d’une semelle.
Elle fait corps avec sa douleur séculaire. La canne ne lâche jamais l’Indien. Elle s’insinue au
plus profond de ses songes, territoire de la nostalgie » (Confiant, 2004 : 94). L’importance et
l’omniprésence de ces cannes à sucre sont telles que les romans vont parfois jusqu’à leur donner
vie à travers un système récurrent de personnifications qui font des champs une sorte de créature
vivante hybride symbolisant la souffrance de ceux qui y travaillent : « car la canne vit, chaque
pied de canne vit, chaque pied de canne crie la souffrance du Nègre et de l’Indien » (Confiant,
2004 : 34). Cependant, si certains auteurs insistent comme Chamoiseau sur la laideur des
champs de canne, « en bas, ils s’achèvent sans grâce contre la muraille de bois, dans un grouillis
de paille boueuse » (Chamoiseau, 2005a : 19), ou sur son aspect invasif, « [les cultures de
cannes] montaient d’année en année, colline après colline » (Schwarz-Bart, 1998 : 14), elle
prend cependant chez Confiant l’apparence d’une entité féminine qui, tout en étant à l’origine
du monde antillais, possède un certain nombre d’attributs et de traits de personnalité humains :
« c’est que la canne est rancunière, oui ! Elle se souvient des chapardeurs, des incendiaires, de
tous ceux qui ont versé le sang et se sont livrés à elle, croyant y trouver un sûr refuge »
(Confiant, 2004 : 95). Cet aspect est très présent chez Raphaël Confiant qui, plus que les auteurs

304
qui se contentent de la décrire de manière réaliste, revient dans ses descriptions sur les aspects
divins de la canne qui, telle une déesse créatrice, possède un visage double. À la fois créatrice et
destructrice, il lui a fallu la mort de nombreux esclaves pour créer le monde : « ou plutôt, ici,
dans ce pays, l’Être immense était la canne à sucre. C’était elle qui avait créé cette île de toutes
pièces, qui l’avait façonnée à sa seule volonté, sans que pourtant nul ne lui vouât aucun culte »
(Confiant, 2004 : 203). Elle incarne également le monstre de tout cheminement initiatique,
l’ennemi à vaincre et qui hante presque tous les romans antillais dans lesquels les esclaves et les
engagés, ces « bêtes à cannes » (Glissant, 1997a : 247) luttent dans ces champs pour leur survie:
« Nègres et Indiens se gourment avec elle sans regarder ni devant ni derrière. La couper est un
grand combat. Un combat à la mort – à la vie ! » (Confiant, 2004 : 34). Elle est aussi le point de
départ de ceux qui, choisissant la lutte par la fuite, quitteront ce lieu technologique pour les
hauteurs, celles des mornes et des forêts primordiales.
2.2 Mythes et folklore dans la ville antillaise
L’En haut et les mornes semblent donc avoir un rôle important de réservoir folklorique,
particulièrement à la chute du système plantationnaire. En effet, on pourrait y voit cet « arrière
pays culturel » (Glissant, 2002 : 285) dont parle Glissant puisque les personnages qui y résident
semblent préserver coutumes, légendes et mythes qui leur permet de lutter contre les
acculturations. Suivant cette opposition Nature/Culture, l’en haut semble ainsi s’opposer à ces
milieux urbains qui, prenant le relais des navires négriers et des plantations de canne à sucre et
de toutes les technologies associées au système esclavagiste, semblent souffrir d’un manque
identitaire et culturel. En effet, « la ville se moque des croyances ancestrales» (Beti, 2000) nous
dit Mongo Beti. Cette remarque est valable aux Antilles dans lesquelles le passage du système
plantationnaire au système urbain a « bousculé le mode de vie traditionnel [et] a entraîné

305
l’écroulement des mythologies agraires surgies au sein des campagnes et au bord de la mer pour
permettre aux travailleurs de s’insérer dans leur univers matériel et humain […]» (Ménil, 1981 :
51), ce qui expliquerait que la séparation plantations/mornes et leur lien au passé se manifeste
jusque dans les romans se déroulant dans la période contemporaine : « elle sursautait sur sa
chaise, bégayant que je ne connaissais rien aux mystères de la vie à cause de ma naissance en
ville » (Pineau, 2001 : 162). La ville, concentrant et intensifiant cette opposition, est ainsi
souvent représentée comme un espace négatif par opposition au milieu rural. Comme on le voit
avec Ti Jean, Man Ya ou encore Tituba, un certain nombre de personnages souffrent de leur
séjour en France ou en zone urbanisée qui, pour eux, correspond à un enfermement dans un
monde sans histoires surnaturelles, un « vase clos où s’engluent et se perdent l’histoire de la
terre et la connaissance du passé » (Glissant, 1997a : 255). Comme la France en général, la ville
et le milieu urbain illustrent l’inadéquation des mythes et du folklore en milieu non rural en les
plaçant souvent dans une perspective occidentale, comme on le voit par exemple avec le zombi
dans Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre, ou aves le dorliis dans L’Homme-au-
Bâton d’Ernest Pépin décrits comme absurdes : « ‘Un conte à dormir debout ! Tout juste bon
pour effrayer les enfants ! Il est vrai que les Antillais se comportent souvent comme de grands
enfants, mais tout de même !’ » (Pépin, 2005 : 151). Ce roman de Pépin illustre d’ailleurs bien
ce phénomène puisque la réalité du phénomène dorliis y oscille constamment entre l’hypothèse
occidentale d’un « dangereux malfaiteur qui bénéficiait de la complicité objective et subjective
d’une psychose collective » (Pépin, 2005 : 156) et celle de « l’existence d’un être surnaturel »
(Pépin, 2005 : 156).
Le roman de Pépin, qui se termine comme un conte, ne donne pas de solution quant à la
réalité du phénomène et demeure dans l’indécision. Contrairement à certains romans réalistes
mystiques de notre corpus, dans lesquels le surnaturel explique en partie le réel (Mina et sa

306
nymphomanie dans le roman Chair Piment, par exemple) tout en s’opposant à la pensée
occidentale, l’explication n’est, dans L’Homme-au-Bâton, qu’une option, une alternative. Il n’y
a pas, chez Pépin, de magie inhérente à la ville mais un choix à faire par les personnages et les
lecteurs qui ont, comme Mathieu dans Le Quatrième Siècle, Patrick dans Hadriana dans tous
mes rêves, ou la narratrice de La Grande Drive des esprits, bien du mal à croire à ce folklore et à
cette spiritualité puisqu’ils viennent d’un lieu essentiellement occidentalisé, dominé par la
raison. Ainsi si mythes, spiritualité et folklore s’adaptent difficilement en ville, on remarque que
la plupart des romans de notre corpus se déroulent dans les campagnes antillaises. Ceux qui se
déroulent entièrement ou en partie dans les villes (et qui sont minoritaires dans notre corpus), ne
décrivent que très rarement des manifestations du surnaturel et du folklore, sauf L’Homme au
bâton, qui prend précisément pour sujet les manifestations urbaines du dorliis. Dépassant le
réalisme mystique des premières pages dans lesquelles on met en question la réalité du
phénomène, le roman change d’ailleurs pour devenir une dénonciation des excès et des dangers
du folklore en milieu urbain, dans lequel la moindre histoire peut prendre des proportions
dramatiques : « il suffit parfois d’une toute petite étincelle pour donner naissance à un bel
incendie ! » (Pépin, 2005 : 103). Ainsi, plutôt que d’avoir disparu au contact de la ville, le
dorliss violeur hante chaque page du roman. Contrairement au quimboiseur qui, comme nous le
verrons dans le prochain chapitre, souffre de sa transition dans les villes françaises. La
multiplicité de la population antillaise, constituée d’individus occidentalisés ainsi que
d’individus venus des campagnes, engendre, pour le dorliis, une multiplication d’apparitions,
d’accusations et de réactions carnavalesques, voire absurdes. Ainsi, si des femmes meurent au
même moment à différents endroits de l’île, plutôt que de croire à l’intervention de plusieurs
personnes, la rumeur donne au dorliis le don d’ubiquité, « assurément l’Homme-au-Bâton était
passé par là ! Il pouvait donc intervenir en trois lieux différents au même moment ? Nous avions
affaire à forte partie » (Pépin, 2005 : 31), si bien que dans toute la Guadeloupe, n’importe quel

307
incident finit par se voir attribué à ce personnage folklorique : « partout on voyait la main de
l’Homme-au-Bâton » (Pépin, 2005 : 66).
La multiplication des événements et des histoires permet ainsi aux rumeurs et à la ville
de devenir une véritable matrice de peurs et de cauchemars: « toujours, elle avait engrossé des
peurs paniques vécues avec une délectation morbide. Peur des zombies, peur des nègres
marrons, peur du quimbois, peur des curés, peur de sa propre peur, peur de l’Homme-au-
Bâton ! » (Pépin, 2005 : 95). Ainsi, si la population de l’ « en bas » rejette apparemment le
passé, l’identité et la pensée mythique traditionnelle, il lui arrive également, paradoxalement,
d’en démultiplier les effets. On l’observe spécifiquement dans L’Homme au Bâton, dans lequel
journalistes et personnages occidentalisés critiquent le déchaînement de la rumeur dans les
quartiers pauvres (qui sont également au cœur des romans de Confiant et Chamoiseau) dont la
population, souvent originaire des campagnes, est plus enclin à croire à ces rumeurs. Ainsi, si le
mythe, le folklore et la spiritualité se manifestent en ville, ils ne peuvent s’y développer
correctement. De ce fait, le monde antillais apparaît donc, malgré des nuances, divisé entre un
monde urbain dans lequel les mythes sont majoritairement rejetés et un monde rural dans lequel
ils semblent survivre. Contrairement au monde des mornes et de l’en haut vers lequel, nous le
verrons dans notre dernier chapitre, un grand nombre de personnages effectuent un passage très
significatif du point de vue identitaire, la ville ne semble pas être un refuge de la souffrance et
de l’acculturation. Cependant, il serait également faux de vouloir simplement diviser le monde
antillais entre un « en haut » mythique et folklorique et un « en bas » urbain et occidentalisé
puisque cette division oublierait l’omniprésence de la mort et des Invisibles qui, se manifestant
partout donnent aux îles antillaises leur profondeur mystique.

308
2.3 De la fuite du marron à la séparation du monde antillais
Nouvel ordre social et lieu d’avilissement succédant à la perte de l’origine et à la perte
de statut humain par le biais du Code Noir, le système des plantations de canne à sucre est donc
l’étape suivante de la déshumanisation du système esclavagiste, un système de négation de
l’espace personnel dans lequel il est impossible pour la majorité soumise7 d’avoir accès à la
terre, possédée par une minorité dominante. Cependant, bien que les îles antillaises et leurs
plantations soient souvent décrites comme des prisons infernales perdues au milieu d’un océan,
elles ne sont pourtant pas des lieux complètement fermés. Comme on le voit dans de nombreux
romans, la plantation, lieu de pouvoir et d’esclavage, est toujours bordée de forêts profondes,
ancestrales, préservées des influences coloniales: « ces Grands-bois qui connaissaient l’Avant,
qui recelaient l’hostie d’une innocence passée, qui vibraient encore des forces initiales,
l’émouvaient à présent» (Chamoiseau, 2005a : 105). Contrôlée par la technologie et
l’urbanisation, cette nature est toujours prête à reprendre sa place pour un retour au chaos
végétal primordial, « au bout d’une heure les bois surgissaient de toutes part, livrant des
combats d’arrière-garde aux cultures de cannes […] » (Schwarz-Bart, 1998 : 14), comme on le
voit avec la plantation de bananes décrite dans Chair Piment et qui, après la mort de Melchior,
se fait envahir par la nature sauvage:
Les bananiers se reproduisaient dans l’anarchie et accouchaient de leurs régimes sous les fenêtres de la
case. D’énormes portées mûrissaient sur pied et se démembraient sans pleur. Les fruits tombés à terre
pourrissaient en un jour, lestaient l’air d’un parfum doucereux, écœurant, bonheur des mouches bleues,
vers, rats et autres scolopendres. (Pineau, 2004 : 61)
7 En effet : « la proportion des esclaves par rapport aux libres aura été à Rome de, bon an mal an, d’un sur dix. Aux
Antilles elle atteindra vingt esclaves sur un libre » (Sala-Molins, 2006 : 151).

309
Par son aspect de régénération, cette représentation de la nature tranche avec la stérilité de ces
plantations si fortement associées à la souffrance de l’esclave par ses « courts espaces de terre
battue, lisse et reluisante comme du marbre… » (Schwarz-Bart, 1998 : 14). Cependant, comme
nous avons pu le voir dans notre chapitre sur l’oraliture, les plantations ont beau avoir eu pour
objectif principal l’avilissement des esclaves, elles leur ont également offert les conditions
idéales à l’apparition de diverses formes de contestations et de cultures alternatives8 comme
celle du conteur ou celle, née de contestation physique majeur dans les romans : « la fuite
combattante du marronnage» (Glissant, 2002 : 793). Cette fuite de l’esclave marron est
particulièrement intéressante vis-à-vis des notions d’espace et d’identité car, malgré la petite
taille des îles-prisons encerclées par la mer, celle-ci ne peut plus se faire vers le lointain ou la
distance que permettrait un continent, mais vers les hauteurs, les mornes isolés et les
profondeurs de la nature primordiale qui, selon la thématique universelle Nature/Culture divise
l’espace antillais entre le monde plantationnaire, technologique et oppressif d’une société
essentiellement née dans la clandestinité et dont l’isolation a participé au développement d’une
contre-culture.
En effet, contrairement au Conteur qui cherchait la liberté au cœur de la plantation, il n’y
a pour l’esclave en fuite, nulle réorganisation intérieure du système des plantations, nulle
subversion intellectuelle, nulle échappée spirituelle dans les temples. Sa fuite se fait
essentiellement depuis le monde fermé de la plantation, dont les limites territoriales font office
de seuil entre les deux mondes (le monde colonial de l’esclavage et le monde naturel de la
8 Auxquelles s’ajoutent par exemple le « jardin créole », cette rare possession de l’esclave représentant la présence
de la nature au milieu de la plantation décrite par Françoise Simasotchi-Bronès dans Le Roman antillais, personnage, espace et histoire, Fils du Chaos et les temples hindous qui ont permis aux engagés Indiens de préserver une partie de leurs croyances et de «lutter dans la société post-esclavagiste de l’époque » (Gamess, 2003 : 140).

310
liberté) vers le cœur de l’île. Comme dans la tradition des mythes, ce lieu a un seuil, la limite de
la plantation, et ses « ‘‘gardiens’’ […] qui [en] défendent l’entrée » (Eliade, 2004 : 29) et qui,
dans les romans, prennent l’apparence des maîtres ou leurs représentants. L’Esclave vieil homme
et le molosse, donne ainsi en partie son titre à l’un de ces gardiens :
Sur l’Habitation, on le vit noir, luisant jusqu’au bleu lunaire, avec quelques taches blanches qui évoluaient
peut-être. Mais (tandis qu’il leur rachait les tendons de la jambe) les esclaves qu’il avait rattrapés l’avaient
vu parfois rouge, ou bleu-vert, ou encore habité des vigueurs orangées d’un cœur de flamme vivant. Quant
à ses yeux, vaut mieux n’en pas parler. (Chamoiseau, 2005a : 35)
La fuite du marron ne se fait donc jamais facilement si bien qu’elle semble être un passage
obligatoire pour toute atteinte de la liberté. Si l’on observe l’histoire contemporaine de la
Caraïbe, telle qu’elle est décrite par Glissant, on constate ainsi que le paysage, plus qu’un simple
décor, continue à être le lieu immédiat du destin des Caribéens, un passage essentiel, tout
comme le passage dans la cale du négrier et dans la plantation:
Prenez, par exemple, l’histoire de Cuba : que font Fidel Castro et ses compagnons quand ils débarquent du
‘‘Gramma’’ ? Ils marronnent ! Ils descendent du ‘‘Gramma’’ sur la côte et ils sont obligés de monter dans
la Sierra Maestra et dans la forêt, exactement comme le faisaient les Nègres marrons. […] Il y a là un
phénomène culturel extrêmement important : de voir ces révolutionnaires répéter le trajet du nègre marron
de notre histoire mais aussi de notre manière de dire. […] Le paysage devient non pas quelque chose que
nous commençons par oublier petit à petit, mais l’élément moteur, l’élément central d’une poétique. (cité
par Bader, 1984 : 92-93)
Cette poétique du paysage qui s’illustre, dans les romans, dans la fuite et dans exploration des
forêts primordiales qui bordent les plantations, semble ainsi se manifester dans une forme de
découpage symbolique et apparemment antithétique exprimé dans Ti Jean l’Horizon entre « les
gens d’En-haut » (Schwarz-Bart, 1998 : 16) qui vivent dans les mornes et ceux qui vivent « en
bas » dans les plantations, les villes et les villages. Ainsi divisée, l’île antillaise proposerait, à

311
travers la plupart des romans, une restructuration thématique et identitaire dans laquelle le bas
correspond aux plantations, à la technologie, à une forme de lutte par la ruse (le Conteur) et à la
résistance culturelle et spirituelle (le jardin créole, les temples) alors que le haut correspond aux
mornes, aux marrons, à une quête de liberté et à la tentative de création d’une société nouvelle.
2.4 Une division symbolique du monde
Cette division géographique et thématique est importante dans des romans qui, comme
Ti Jean ou Le Quatrième Siècle, utilisent cette dichotomie pour faire un commentaire social et
identitaire illustrant deux aspects de la culture antillaise. Dans Le Quatrième Siècle, par
exemple, l’opposition entre le haut et le bas détermine le rapport entre les Béluse, qui
descendent des esclaves et qui, comme les Conteurs, ont développé leur identité par la ruse et les
Longoué, gens qui descendent des marrons rebelles. On retrouve ce un schéma dans Ti Jean
l’Horizon, roman dans lequel Wademba et ses semblables, unis et fiers de leur passé, ont fait des
mornes un nouvel environnement identitaire : « [ils] savaient, savaient que des événements
extraordinaires et d’un faste inouï, sans pareil, s’étaient déroulés dans les misérables bosquets
qu’ils hantaient, et c’était les hautes faits qu’avaient accomplis leurs ancêtres… » (Schwarz-
Bart, 1998 : 16-17). Ils s’opposent alors à ceux de la vallée qui « avaient ri […] et ils avaient dit
que ces événements n’en étaient pas, qu’il ne pouvait s’agir de vrais événements car, enfin, en
quels livres étaient-ils écrits ? » (Ibid. : 17). Ils se rapprochent en cela de personnages comme
Mathieu qui, dans Le Quatrième Siècle, cherche lui aussi le passé et la vérité de ses origines
dans les livres : « plus vite, papa, plus vite, ça c’est connu, j’ai lu les livres ! » (Glissant, 1997a :
24). On remarque ainsi dans ces romans que tous les personnages forts, tous ceux qui ont un lien

312
aux origines et à l’identité antillaise et tous ceux qui possèdent la connaissance ou qui pratique
la magie vivent dans l’ « en haut », dans les profondeurs de la nature9, comme Man Yaya et
Tituba dans Moi, Tituba…, Wademba dans Ti Jean l’Horizon et Papa Longoué dans Le
Quatrième Siècle. Ils s’opposent ainsi à ceux qui, vivant dans les villes ou les villages, ont perdu
ce lien avec le passé et l’origine : « ils sont sots, par là-bas en bas. Ils disent : ‘‘ Ce qui est passé
est bien passé.’’ Mais tout ce qui passe dans les bois est gardé au fond du bois ! C’est pour
autant que je marche dans les bois, sans descendre » (Glissant, 1997a : 18) ou ceux qui, comme
dans Ti Jean l’Horizon, ont oublié leur passé et l’esclavage. La valeur identitaire de cette
séparation « en haut »/« en bas» est ainsi particulièrement symbolique, plus particulièrement
dans le roman de Simone Schwarz-Bart dans lequel ceux d’ « en haut », relativement méprisés
pour leur lien au passé, ont le souvenir de mythes et d’histoires que ceux de Fond-Zombi ont
oublié :
Ceux d’En-haut parlaient des gens de la vallée comme de caméléons, de serpents en mue éternelle et
d’experts en macaqueries, et, pour le dire tout net, comme de singes consommés des blancs et qui se
délecteraient à faire juste ce pourquoi ils ne sont pas nés. De leur côté, les bonnes gens du village se
gaussaient volontiers des barbares du plateau, ces empesés d’ignorance, ces enragés de ténèbres qui se
torchaient encore le derrière au caillou. (Schwarz-Bart, 1998 : 19)
Quand les auteurs antillais délimitent le monde antillais de leurs romans entre l’en haut et l’en
bas, ils semblent ainsi faire de l’île, un lieu d’opposition entre deux espaces antithétiques, un
espace « bipolaire » (Burton, 1997 : 70) reprenant de manière symbolique toutes les oppositions
9 A un niveau moindre, on peut même s’apercevoir que, dans d’autres romans, des personnages forts comme
Léonce dans La Grande Drive des esprits ou Man Ya dans un Papillon dans la cité ou L’Exil selon Julia vivent à la campagne plutôt qu’à la ville. Notons également que ces personnages, une fois transportés en France ou à l’étranger (Man Julia, Tituba…) gardent cet aspect identitaire.

313
culturelles apparentes que nous avons vues dans les romans (entre le réalisme et le mystique et
entre l’oralité et l’écriture).
Cette approche thématique, malgré son intérêt symbolique, est cependant modérée dans
le roman : si l’espace antillais est divisé entre l’en haut des mornes et l’en bas des plantations, il
n’en n’est pourtant pas pour autant fermé. Nous le voyons en effet dans les romans quand les
esclaves et leurs descendances se rendent bien souvent dans les hauteurs tout comme les
marrons et leurs descendants (les quimboiseurs, par exemple) descendent vers les Plantations ou
les villes. De même, si les habitants de la vallée se moquent de ceux des mornes et de leurs
croyances, ils craignent cependant leur science qui « venait en droite ligne d’Afrique » (Idem.),
tout comme certains habitants de l’en haut sont curieux et attirés par l’en bas, comme Awa la
mère de Ti Jean qui, éprise d’un jeune homme de la vallée, décide de quitter les hauteurs et son
nom africain pour devenir Éloïse. Bref, malgré une opposition supposée entre les deux mondes
antillais, il y a des mouvements, des déplacements de l’un à l’autre. On le voit également avec la
narratrice de La Grande Drive des esprits qui, originaire de la ville, explore la campagne
antillaise, ou avec Tituba qui, élevée dans l’isolation, descendra dans les villes par amour pour
John Indien. Il est d’autant plus frappant de noter que, plus qu’un simple mouvement dans
l’espace, ces déplacements prennent souvent une valeur symbolique ou mythique : si les
personnages « forts » vivent dans l’ « en haut », il arrive que des personnages de l’ « en bas »
s’y rendent non plus pour marronner, mais afin d’y passer une forme d’initiation spirituelle qui
leur permettra d’atteindre des niveaux supérieurs de conscience et d’identité. On le voit par
exemple dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant, dans lequel Matthieu grimpe dans les
mornes pour écouter les histoires de Papa Longoué et approfondir sa connaissance des origines
Longoué/Béluse. On le voit aussi dans Ti Jean l’Horizon, dans lequel le héros éponyme rend
visite à Wademba pour recevoir son apprentissage, prendre contact avec son destin et initier sa

314
quête. On le voit également dans Texaco de Patrick Chamoiseau, dans lequel Esternome
entraîne Ninon vers les mornes où, après l’abolition de l’esclavage, il pense trouver un monde
différent, plus idéal, « là-haut la terre sera à nous, deux innocents au paradis, et la vie va monter
des ignames tigées dans notre jardin » (Chamoiseau, 2006: 159), car contrairement à l’en bas,
les hauteurs sont, selon son système de pensée, plus saines, vierges de toute trace des plantations
et de l’esclavage alors que sa terre est « plus riche qu’en bas, plus neuve, plus nerveuse pas
encore tétée d’et-caetera récoltes » (Chamoiseau, 2006 : 167).
Ce mouvement vers le haut est également présent dans des romans plus réalistes comme
Le Meurtre du Samedi Gloria de Raphaël Confiant, dans lequel Beausoleil doit également, lors
de son initiation, se rendre dans les hauteurs de Fort-de-France pour apprendre à maîtriser son
esprit et son corps et devenir un champion de damier. Forme d’axis mundi, lien entre le ciel et la
terre, la montagne et les mornes auraient, comme tout lieu en hauteur, traditionnellement, valeur
de « Centre du Monde » (Eliade, 2004 : 39), ce que nous pourrions appliquer à l’identité
antillaise qui, sans prendre en compte l’ailleurs de la migration, n’aurait pas un centre unique
mais se diviserait entre les villes et les mornes. Ainsi, si pour Glissant le départ vers la France
ou l’Afrique permettait un retour sur soi, sur l’identité par le « détour », on remarque chez lui un
cheminement semblable de l’identité qui, en terre antillaise, prend la forme d’un détour par la
fuite identitaire: « Glissant does not deal with the ‘‘truth’’ of marronage [sic] but rather with its
ontological mergence. Glissant’s marronage, like Victor Segalen’s notion of exoticism,
demands not just a departure from the plantation but a ‘‘departure from oneself,’’ a rapture »
(Praeger, 2003: 49). Si la prise de conscience identitaire et culturelle de l’esclave marron prend
place dans les hauteurs dominant les plantations, cela pourrait en partie expliquer pourquoi de
nombreux personnages de nos romans atteignent la transcendance au cœur de la nature
antillaise. Pour eux, atteindre ces hauteurs serait se distancier de la souffrance des plantations,

315
de l’acculturation du monde des maîtres pour habiter un lieu primordial intouché à partir duquel
un nouveau départ, une nouvelle identité serait possible sans aucune marque de l’avant:
« occuper les dos cabossés, les têtes de pics. C’était bâtir le pays (pas le pays mulâtre, pas le
pays béké, pas le pays kouli, pas le pays kongo : le pays des nèg-terre » (Chamoiseau, 2006 :
166-167).
3 La mort, le réalisme mystique et l’identité antillaise
3.1 La mort et le retour aux origines
Pris dans son île-prison, dans l’acculturation et la souffrance du système plantationnaire
dans lequel toute fuite est une condamnation à mort, l’esclave ou l’engagé Indien ne semble
pouvoir reprendre un contact avec sa terre natale que par l’intermédiaire du Conteur, du temple
hindou, du quimboiseur ou encore, comme nous l’avons vu, du rêve. Le retour physique et réel
vers la terre natale reste, pour beaucoup de personnages, une impossibilité du fait des conditions
de vie extrêmes de l’esclavage et du poids de l’endettement des engagés. Il arrive donc que si la
fuite physique du marronnage n’est pas toujours possible et que si les fuites spirituelles et
identitaires sont insuffisantes, les esclaves ou les engagés indiens cherchent une fuite ultime
dans la mort. Historiquement, leurs corps ont beau ne pas avoir eu les mêmes privilèges que
ceux des maîtres, « les maîtres seront tenus de faire mettre en terre dans les endroits destinés à
cet effet leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême,
ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés » (Sala-
Molins, 2006 : 118), la mort se présente cependant, dans quelques romans, comme une
alternative, une autre forme de marronnage libératoire et définitif. Elle peut être un principe
général de libération et d’apaisement des souffrances terrestres, « en vérité, la mort est le plus

316
grand des bienfaits » (Condé, 2004 : 209) et se double même, parfois, d’une idée de retour à
l’origine pour les premières générations d’esclaves ou d’engagés indiens: « rappelons-nous que
les premières générations d’esclaves traités cherchaient parfois la mort, ‘‘pour revenir en
Afrique’’. L’au-delà se confondait avec le pays perdu » (Glissant, 2002 : 217-218). La mort
d’un esclave est donc, dans certains romans, une tristesse mais aussi une joie, car il est souvent
dit que celui-ci retourne à son origine. C’est le cas avec l’Afrique dans Moi, Tituba sorcière
noire de Salem, « Puis l’on se réjouit, car celui-là au moins était délivré et allait reprendre le
chemin du retour » (Condé, 2004 : 19), ou de l’Inde dans La Panse du chacal avec la mort de
l’Ancêtre: « Il est rentré en Inde… Appa a chevauché Barassadi, le cheval céleste, et a regagné
la terre natale » (Confiant, 2004 : 260). Ce retour n’est cependant valable que pour des
personnages qui, comme Wademba dans Ti Jean l’Horizon ou l’Ancêtre dans La Panse du
chacal, sont originaires d’Inde ou d’Afrique et pour qui les Antilles ne sont pas natales.
Ce rapport identitaire à la mort et à l’origine est donc relativement problématique. En
effet, si les ancêtres retournent à la terre d’origine, quelle expérience de la mort auront ceux qui
sont nés aux Antilles ? Théoriquement, si l’on prend en compte la dichotomie apparente du
monde antillais, il se pourrait que les personnages de nos romans soient pris entre une croyance
africaine en l’après vie ou, au contraire, une croyance occidentale au Paradis:
Les morts qu’on envoie ailleurs, il est peut-être plus « normal » de s’en séparer quand cet « ailleurs » vous
est évoqué par une force de tradition, faisant le lien entre toute naissance et toute mort […]. L’adoption du
paradis chrétien satisfait-elle un pareil manque ? (Pineau, 2002 : 217-218)
Si quelques-uns des romans de notre corpus font allusion à une Afrique ou une Inde
paradisiaques visitée en rêve, la notion d’un paradis chrétien est rare. Dans notre corpus, seul le
roman La Grande Drive des esprits propose une vision de l’après-vie influencée par le folklore
catholique. Ce personnage, Man Octavie, se manifeste en effet sous une forme rappelant

317
l’iconographie angélique : « elle portait la robe blanche qui couvrait sa nudité au jour de sa
mort. Mais surtout, elle arborait le visage rajeuni qui, onze ans plus tôt, avait fait s’interroger les
chrétiens de toutes catégories, les maquerelles au cœur fiel et les jocrisses sans malice. Sa masse
de cheveux blancs aveuglaient comme soleil de midi » (Pineau, 2001 : 86). S’il est clairement
fait référence au « Seigneur » (Pineau, 2001 : 88), le roman de Gisèle Pineau propose également
l’existence d’un ailleurs « paradisiaque », comme on le voit avec la brusque apparition de Man
Octavie qui permet à Léonce d’entrevoir un monde antillais parallèle qui ressemble au
Paradis : « un chant d’allégresse lui monta aux lèvres car un prodige s’était produit. Autour de
lui, le jardin qu’il avait laissé sans le moindre fruit regorgeait d’abondance » (Pineau, 2001 :
84). Cependant, ce type de représentation n’est pas là la norme puisque, comme nous pouvons le
voir dans Chair Piment et dans la plupart des romans que nous étudions, les morts peuvent se
manifester auprès des vivants sous forme d’esprits qui, vus par certains, restent invisibles pour
une grande majorité. De même, la majorité des romans décrivent rarement le monde des morts
comme un lieu spécifique. En effet, si de tous les romans de notre corpus se focalisent sur la
présence des morts aux Antilles, seul Ti Jean l’Horizon se focalise en partie sur un retour
symbolique vers l’Afrique originelle et une exploration du continent des morts.
3.2 Ti Jean l’Horizon et le monde des morts en Afrique et aux Antilles
Si les personnages rêvent d’une Afrique ou d’une Inde originelle et paradisiaque qu’ils
n’ont que peu ou pas connue, si certains évoquent la possibilité d’un retour, les romans ne
suivent jamais le cheminement d’une âme jusqu’à cette origine. Comme avec l’Afrique des
origines, ils ne décrivent pas non plus le monde des morts, à l’exception de Ti Jean l’Horizon de
Simone Schwarz-Bart dans lequel le héros suit un cheminement initiatique qui le conduit à y
entrer et à en sortir. Ce lieu est particulièrement intéressant car il s’agit d’un monde

318
« physique » effectivement décrit et qui diffère ainsi des autres romans de notre corpus qui ne
décrivent que les manifestations des invisibles auprès des vivants. En effet, il semble que les
romans antillais gardent le secret de cet ailleurs : on ne sait pas où se trouve Rosalia (Chair
Piment) quand elle ne se manifeste pas, tout comme on ne sait pas d’où vient exactement Man
Octavie ou s’il existe un autre monde dans lequel évoluent les invisibles de Moi, Tituba… En
fait, aucun roman de notre corpus ne définit ce monde des morts, comme si celui-ci devait rester
inconnu et indescriptible : « moi, je suis sur un autre bord que tu ne peux pas connaître »
(Pineau, 2001 : 87). Ainsi, peu de romans décrivent cet autre monde comme le fait par exemple
le Haïtien Dany Laferrière dans Pays sans chapeau. Dans ce roman, l’au-delà est présenté
comme identique au monde des vivants, comme une superposition qui rappelle le principe
réalisme/surnaturel du réalisme mystique : « on franchit la barrière, et la rue n’avait pas changé
à mes yeux » (Laferrière, 2001 : 249). Pour prendre un autre exemple, le monde des morts
exploré par Ti Jean, s’il est bien un monde physique, se différencie cependant de celui de
Laferrière par trois caractéristiques importantes: il se trouve en Afrique, dans le passé et dans le
corps de la Bête dans laquelle Ti Jean s’est engouffré. De ce fait, si les morts antillais se
manifestent dans le quotidien, le monde des morts décrit dans Ti Jean l’Horizon n’est atteint par
le héros qu’au prix d’un déplacement dans l’espace et dans le temps. Situé sous le sol africain,
lui-même atteint au prix d’une chute interminable dans le ventre de la Bête, le monde des morts
est un monde de profondeurs : « au fond de la caverne, usées par les flots des générations, des
marches descendaient en spirale vers les entrailles de la terre, dans une obscurité de plus en plus
sensible, palpable, une bouillie noire qui vous entrait dans la bouche comme de la vase »
(Schwarz-Bart, 1998 : 212). Bien qu’apparemment identique au monde des vivants et plein
d’une « grisaille très douce » (Schwarz-Bart, 1998 : 212), il est cependant placé sous un plafond
de pierre qui semble enfermer les morts dans une sorte de tombeau. Les morts eux-mêmes sont
très différents des Invisibles qui se manifestent en terre antillaise. Contrairement aux Invisibles

319
qui, dans Moi, Tituba… ou dans La Grande Drive des esprits conseillent, soutiennent et apaisent
les vivants, les morts africains que rencontre Ti Jean ils vivent dans une « rêverie perpétuelle
[…] croupissant dans le même silence […] dans une même absence de désir » (Schwarz-Bart,
1998 : 216). Ils ne sont que de pâles copies de ce qu’ils étaient, ce qui étonne Ti Jean qui se
demande « si c’étaient bien là les morts prestigieux qui commandaient aux vivants » (Schwarz-
Bart, 1998 : 216). Ils sont de véritables caricatures de la vie dont le seul pouvoir est de
communiquer avec les vivants pendant leur sommeil et de les guider dans une moindre mesure
pour les pousser à ne pas changer et à garder les coutumes du passé : « Et la nuit venue, ils se
glissaient dans les têtes endormies des rêveurs pour donner un conseil, un remède. Et surtout les
rappeler à l’observance des coutumes anciennes, dont ils étaient les défenseurs enragés,
intraitables » (Schwarz-Bart, 1998 : 219). Pire encore, par leur désir de se réincarner, ils
indiquent clairement leur désir de quitter leur monde si bien que la narratrice s’étonne de leur
incapacité au souvenir et au maintien de la mémoire : « quels que fussent leurs souvenirs de vie,
et même s’ils avaient connu les pires disgrâces, le monde d’en haut leur paraissait revêtu des
plus belles couleurs et ils n’aspiraient qu’à y remonter dare-dare, pour faire une nouvelle saison
au soleil » (Idem.). Bref, les morts rencontrés par Ti Jean semblent figés, pris dans un monde
qu’ils veulent quitter. Ils s’éloignent ainsi en tout point des invisibles antillais représentés dans
les romans. Plus libre, ceux-ci n’envient pas les vivants et évoluent parmi eux, évoluent parmi
les vivants, y compris dans la Guadeloupe natale de Ti Jean quand celui-ci se retrouve nez à nez
avec l’esprit de Filbert, un personnage « mort et enterré depuis belle lurette » (Schwarz-Bart,
1998 : 76). Ainsi, comme avec le rapport avec la terre originelle, il ne semble pas y avoir, chez
les morts africains, d’évolution spirituelle, une transcendance de ce qu’ils étaient de leur vivant
comme on le voit avec Man Octavie qui connaît l’ordre de naissance des futurs enfants de
Léonce ou Tituba qui connaît la transcendance : « oui, à présent je suis heureuse. Je comprends
le passé. Je lis le présent. Je connais l’avenir » (Condé, 2004 : 271). Si Ti Jean est rejeté par

320
l’Afrique, il ne parvient pas non plus à s’intégrer à ce monde des morts qui lui est étranger.
Cette thématique, que l’on ne retrouve pas dans les autres romans, pourrait cependant rejoindre
l’éloignement de l’origine historique que nous avons vu. Ti Jean ne parvient à s’identifier ni à
l’Afrique originelle ni à son monde des morts. Ils ne font plus partie de lui mais il doit les
prendre en compte dans son cheminement identitaire.
Ainsi, Ti Jean ne se retrouve pas en Afrique pour y mourir mais, au contraire, pour
prendre conscience de son identité. En effet, son déplacement dans l’espace et le temps est en
effet bien plus profond et plus symbolique qu’un simple voyage puisqu’il se fait par
l’intermédiaire de l’avalement littéral par une créature surnaturelle. Cet aspect est important
pour notre étude puisque, même à la fin du roman, nous n’avons aucune indication que Ti jean
est bel et bien sorti du corps de la Bête : il est avalé, se retrouve en Afrique, meurt, quitte le
monde des morts, voyage en France, retourne en Guadeloupe, tue la Bête et libère tous ceux
qu’elle avait avalés sans aucune indication que Ti Jean en sort. Nous pouvons donc dire que
toute son expérience de traversées (d’un fleuve et d’une mer), de morts (en Afrique, en France)
et de chutes (la chute après l’avalement, la descente au fond de la caverne vers le monde des
morts, la nouvelle chute en arrivant en Guadeloupe) se fait intégralement dans le ventre de la
Bête, ce qui insiste sur le caractère mythique et initiatique de l’aventure. Si Ti Jean avait certains
jours « l’impression déchirante d’être en exil sur sa propre terre » (Schwarz-Bart, 1998 : 141),
ce n’est que par sa mort symbolique, l’ultime exil, et son éloignement de la terre natale en
Afrique et en France qu’il prend conscience de sa véritable importance pour lui: « Oui, là-bas
était sa place, décida-t-il tout à coup, sous quelque motte de terre rouge exposée aux vents, avec
des morts qui le reconnaîtraient et ne lui diraient pas : étranger, d’où viens-tu ? » (Ibid. : 217).
Or il s’agit bien d’un cheminement initiatique puisque l’on a une forme de renaissance du
personnage « avalé » : à la fin du roman, Ti Jean réalise son attachement profond à la

321
Guadeloupe, sa terre natale, et libère le soleil. Cependant, comme si son initiation n’était pas
terminée, on ne le voit pas sortir du corps de la Bête. Selon Bernadette Cailler, cette créature
fonctionnerait comme une forme de labyrinthe dans lequel Ti Jean doit pénétrer afin de vaincre :
« À l’encontre du mythe grec où le labyrinthe contient la Bête, ici le labyrinthe est contenu dans
la Bête : il faut pouvoir affronter le monstre de l’intérieur, se faire nécessairement victime avec
les victimes » (Cailler, 1983 : 291-292). Au-delà de l’Afrique qu’elle contient, la Bête serait
donc elle-même un type de monde des morts qui, bien qu’apparemment identique au monde
naturel, comme le pays sans chapeau décrit par Dany Laferrière, n’en serait qu’une des
nombreuses dimensions du monde des morts contenu par la Bête : « tu n’as fait que l’effleurer
en surface : il existe bien d’autres étages en dessous, sans compter les salles réservées aux dieux
et dont nous n’avons qu’une connaissance très vague… » (Schwarz-Bart, 1998 : 273) et
permettrait, en suivant un schéma initiatique, un renouvellement identitaire.
Il est également intéressant de noter que, dans le roman de Schwarz-Bart, la « grisaille »
du monde des morts africain ressemble au monde antillais sans soleil : « une nuit plus grise que
noire, une sorte de fumée épaisse qui s’insinuait entre les choses comme un brouillard […] »
(Schwarz-Bart, 1998 : 91). Ce parallélisme peut nous conduire à penser qu’à la disparition du
soleil, la Guadeloupe serait devenue, symboliquement, semblable à un monde des morts. Cette
supposition est soutenue par la description des habitants de Fond-Zombi eux-mêmes qui, une
fois le soleil avalé, acceptent largement et sans volonté le retour du passé, incarné par un
système esclavagiste qui réactualise les tensions primordiales antillaises : « ces présages ne
rencontrèrent aucun écho et la plupart les accueillirent d’un haussement d’épaules narquois :
quelle abomination ? ah, l’esclavage… vous êtes des radoteurs… » (Schwarz-Bart, 1998 : 105).
Sans volonté, ces personnages de l’en bas, symboliquement morts, seraient donc proches des
morts africains. La représentation de l’ombre annonçant la mort dans les romans, nous pourrions

322
peut-être voir, dans la disparition du soleil, à la fois un exemple de mythe tel qu’on en trouve
dans de nombreuses mythologies, mais aussi comme la représentation symbolique d’une mort
identitaire du peuple antillais qui, sans liens directs à l’origine (Wademba vient de mourir),
oublie son passé, ce qui le rend incapable de faire son devoir de mémoire et de lutter contre le
retour de l’esclavage. Même de retour en Afrique, Wademba et Ti Jean sont considérés comme
impurs et rejetés par leurs origines parce qu’ils sont marqués par cette expérience à l’origine de
la rupture identitaire. De ce fait, le cheminement initiatique et mythique de Ti Jean, qui fait
l’expérience de l’Afrique historique et originelle, de la France et, enfin, d’un retour à la terre
natale, pourrait bien être symbolique du cheminement identitaire que devrait faire tout
Antillais afin d’atteindre son identité propre. Nous pourrions même voir dans cet avalement du
soleil un schéma mythique et initiatique applicable non plus à un personnage unique, mais à
l’échelle de toute la Guadeloupe. En effet si, par l’avalement du soleil, la Guadeloupe est
métaphoriquement devenue un pays des morts, nous pouvons rapprocher cette obscurité au
thème mythique de la « nuit cosmique »:
C’est le monde entier qui, symboliquement, retourne avec le néophyte, dans la Nuit cosmique, pour
pouvoir être créé de nouveau, c’est-à-dire pour pouvoir être régénéré […]. Pénétrer dans le ventre du
monstre – ou être symboliquement « enseveli », ou être enfermé dans la cabane initiatique – équivaut à
une régression dans l’indistinct primordial, dans la Nuit cosmique. Sortir du ventre, ou de la cabane
ténébreuse, ou de la « tombe » initiatique réitère le retour exemplaire au Chaos, de manière à rendre
possible la répétition de la cosmogonie, à préparer la nouvelle naissance. (Eliade, 2004 : 166)
On peut ainsi penser que, en avalant le soleil et Ti Jean, la créature avale non seulement le
héros, mais également le monde entier et la Guadeloupe pour les placer dans une Nuit
primordiale « à des fins thérapeutiques » (Idem.) qui permettra donc au héros, mais aussi à toute
la communauté guadeloupéenne, de répondre à leurs dilemmes identitaires. Pourrait-on dire,
comme avec Ti Jean et son rapport à la terre natale, que la disparition du soleil et la plongée de

323
la planète dans les ténèbres permet, de la même façon, au monde antillais d’évoluer et d’entrer
dans une ère nouvelle ? Comme nous l’avons vu plus haut, la Guadeloupe souffre, dans le
roman, d’un sentiment d’infériorité et d’une perte de la mémoire, si bien que la nuit engendrée
par la Bête et le retour du cauchemar des plantations permet de revivre ce passé souvent oublié
et à certains comme Ananzé qui « n’avait pas renoncé […] » (Schwarz-Bart, 1998: 106) de
lutter comme leurs ancêtres, conteurs ou marrons. Plongeant le monde entier dans des « temps
nouveaux », la disparition du soleil permet ainsi à la Guadeloupe de suivre un cheminement
mythique, celui d’une plongée dans la nuit primordiale des mythes, de prendre conscience que,
bien qu’étant une île minuscule et apparemment sans importance, elle a sa place dans le monde :
« au moins, se dirent-ils, apprenant tout cela par la TSF, au moins cette fois nous ne serons pas
seuls dans le malheur » (Ibid : 94). Mieux encore, le temps d’un roman elle devient même le
centre du monde puisque c’est de la Guadeloupe que la Bête s’envole pour avaler le soleil et que
c’est un guadeloupéen qui libère le soleil et sauve, littéralement, la planète. D’une certaine
manière, il semble donc que, tout en suivant un cheminement mythique identique à celui de Ti
Jean, les romans antillais proposent par l’expérience initiatique de certains personnages,
l’apparition d’un sentiment d’appartenance et d’intégration au monde propice à la réémergence
d’un passé oublié, auquel il faut faire face.
3.3 Réalisme mystique, mort et identité aux Antilles
Dans les romans antillais de notre corpus, les morts font partie du quotidien et
n’évoluent pas exactement dans un monde séparé du monde des vivants mais dans un monde qui
semble lui être superposé. On le voit dans Ti Jean l’Horizon dans lequel, malgré l’existence
d’un monde des morts africains, les esprits (et pas nécessairement ceux des morts) semblent
errer parmi les vivants « et lui-même supportait à grand mal les apparitions nocturnes, zombis,

324
chevaux à diables, boules de feu qui venaient rouler à ses pieds. […] et puis un jour, s’enfilant
au cœur d’un hallier, il reçoit un coup de bois dans le dos et se retourne, manque de s’évanouir
devant le visage phosphorescent du nègre Filbert…» (Schwarz-Bart, 1998 : 76). Cette absence
de paradis ou d’un territoire des morts nous rappelle les romans réalistes magiques comme dans
le roman The Famished Road de Ben Okri ou The Palm-Wine Drinkard & My Life in the Bush
of Ghosts d’Amos Tutuola dans lesquels les personnages se heurtent à la proximité des deux
mondes qui facilite le passage d’un bord à l’autre et qui rejoint certaines croyances africaines :
« for the majority of peoples, however, the next world is in fact geographically ‘here’, being
separated from this only by virtue of being invisible to human beings » (Mbiti, 1969: 159).
Cette notion de superposition est particulièrement présente dans le roman Pays sans chapeau de
Dany Laferrière que nous avons vu plus haut mais aussi, et surtout, dans Moi, Tituba…, raconté
du point de vue d’un invisible, Tituba elle-même, qui continue de vivre sur son île tout en étant
intimement liée à elle « et puis il y a mon île. Je me confonds avec elle » (Condé, 2004 : 270).
Sans pénétrer dans un « autre monde » et malgré sa quasi omniprésence et sa connaissance du
passé, du présent et du futur, Tituba continue de vivre tel qu’elle l’avait fait de son vivant « car,
vivante comme morte, visible comme invisible, je continue à panser, à guérir » (Ibid. : 268).
Cet aspect de la mort et de la présence des invisibles au creux du réel que l’on retrouve
(directement décrit ou raconté sous forme de rumeur) dans les romans de notre corpus est un
aspect essentiel de l’étude de la spiritualité et du folklore et une des illustrations principales du
fonctionnement du réalisme mystique. Comme le remarque en effet Maximilien Laroche dans
ses études, la mort est un des aspects essentiels de romans que, comme Le Royaume de ce
monde d’Alejo Carpentier, il nomme « réalistes merveilleux » : « d’un point de vue spatial il
superpose deux lieux : l’un merveilleux qui est situé outre-tombe et l’autre, réel, qui est logé ici-
bas, dans le monde que nous connaissons. Ce décor comporte une dimension temporelle par le

325
fait même d’avoir la mort pour séparation » (Laroche, 1989 : 163). Ainsi, s’il y a, devant nous,
le « royaume de ce monde », celui du quotidien qui fonctionne selon les règles empiriques
occidentales du réalisme et de la vraisemblance et le monde « mystique » (que d’autres
appellent le magique ou le merveilleux), un autre monde qui n’en est pas séparé mais qui fait
partie de lui, qui lui est superposé qui, appliqué au roman de Carpentier, peu tout aussi bien
s’appliquer à ceux de notre corpus:
À l’arrière-scène, on devrait plus exactement dire au niveau supérieur, car il surplombe cet avant-scène
même s’il est placé en retrait par rapport à lui, à l’arrière-scène donc se trouve ce lieu merveilleux d’où le
sujet peut continuer à parler même mort, s’il s’agit du narrateur. Il s’agit d’un lieu où l’on aboutit tout
autant que d’un lieu de départ puisque nous voyons Mackandal en revenir pour continuer son action dans
la réalité quotidienne. (Laroche, 1989 : 164)
Selon les principes du réalisme mystique du monde antillais, il y a donc, dans des romans
comme Moi, Tituba…, La Grande Drive des esprits, L’Homme-au-Bâton, Ti Jean l’Horizon et
Chair Piment deux mondes, deux scènes superposées que tout le monde ne distingue pas, si bien
que si : « en plein jour, un homme ou une femme soliloque ou délire. N’allez pas croire qu’il est
seul, il est en bonne compagnie de nos invisibles » (Pépin, 2005 : 141). D’une certaine manière,
s’il n’y a pas, dans les romans antillais, un monde appartenant spécifiquement aux morts,
devrait-on en déduire que ceux-ci n’ont, comme les esclaves, aucun lieu qui leur soit propre ?
Cet aspect de la représentation de la mort aux Antilles peut se montrer problématique,
surtout si l’on considère, comme le propose Christiane Bougerol que ce qui pose problème aux
morts antillais n’est pas le manque de références généalogiques ou l’oubli, mais l’absence de
territoire : « Au principe de l’ancestralité il y a un territoire. La fixation sur une terre est
attribuée après coup à un ancêtre dénommé fondateur » (Bougerol, 1997 : 129). Si les premiers
esclaves africains sont arrivés en même temps que les premiers colons, ils n’ont cependant

326
jamais été considérés comme des fondateurs. De même, leur condition d’esclave ne leur a que
très rarement donné la possibilité de posséder la terre. Cependant, selon la croyance populaire
illustrée dans certains romans, les esprits des morts ne peuvent traverser les océans et semblent
donc fixés, enracinés en terre antillaise : « car si l’eau des sources et des rivières attire les
esprits, celle de la mer, en perpétuel mouvement, les effraie. Ils se tiennent de part et d’autre de
son immensité, envoyant parois des messages à ceux qui leur sont chers, mais ne l’enjambent
pas, n’osant surtout pas s’arrêter au-dessus des vagues » (Condé, 2004 : 214). Si en France
Rosalia (Chair Piment) n’apparaît qu’à sa sœur et semble prisonnière de ce seul lien, son retour
au pays lui permet de rompre ce lien et d’errer à son aise dans les mornes où, pour la première
fois, elle est vue par plusieurs personnes. De même, les premiers esclaves et engagés voulaient
retourner en Afrique ou en Inde au moment de leur mort, les morts des générations nées aux
Antilles, semblent ne plus vouloir retourner dans leur pays d’origine historique. Comme Tituba,
Rosalia et Man Octavie, ils préfèrent évoluer parmi les membres de leurs familles : « ils se
mêlent aux allées et venues des vivants, partagent leurs gesticulations, leurs amours, leurs
frayeurs, leurs chagrins et leurs joies» (Pépin, 2005 : 140) et sur la terre natale, si bien que l’on
pourrait se demander si cette absence du retour des morts aux origines, ou de transfert vers un
système d’après vie, aurait une valeur spécifiquement liée à la notion d’identité aux Antilles.
Si les influences de la religion catholique se font parfois sentir, les représentations des
invisibles dans les romans de notre corpus semblent cependant liées aux notions africaines de la
mort et de son rapport à la mémoire. En effet, comme l’explique John Mbiti, la mort est, en
Afrique, définitive. Il n’y a pas d’espoir de résurrection ou de passage vers une autre vie. Quand
un individu meurt, il passe dans le Sasa et ne « survit » que tant qu’une personne l’ayant connu
personnellement et se souvenant de son nom est encore en vie. La mort de cette dernière
correspondra à la fin du dernier souvenir et l’individu disparaîtra pour de bon:

327
At the moment of physical death the person becomes a living-dead: he is neither alive physically, nor dead
relative to the corporate group. His own Sasa period is over, he enters fully into the Zamani period; but, as
far as the living who knew him are concerned, he is kept ‘back’ in the Sasa period […]. Those who have
nobody to keep them in the Sasa period in reality ‘die’ immediately, which is a great tragedy that must be
avoided at all costs. (Mbiti, 1969: 159)
Cette notion de mémoire, essentielle à la survie de l’individu, ne propose cependant aucune
résurrection, ni même la vie éternelle puisque l’oubli entraîne sa disparition pure et simple:
«there lie the tantalizing and unattained gift of the resurrection, the loss of human immortality
and the monster of death. Here African religions and philosophy must admit a defeat: they have
supplied no solution » (Mbiti, 1969: 99). Or, si les romans ne considèrent jamais les
conséquences directes de l’oubli sur l’existence des Invisibles, ces derniers apparaissent souvent
liés à la notion de mémoire. On le voit avec Tituba qui, après sa mort, entend sa chanson à
travers toute la Barbade, « mon histoire véritable commence où celle-là finit et n’aura pas de fin.
[…] elle existe la chanson de Tituba ! » (Condé, 2004 : 267), ou encore avec l’esprit enflammé
de Rosalia qui, dans Chair Piment, rappelle à Mina son passé et ses origines. Or, comme nous
l’avons vu, la notion de mémoire est un des aspects essentiels de la culture antillaise qui a
souffert des acculturations et séparations familiales engendrées par les règlements du Code Noir,
mais aussi de l’omniprésence de l’Histoire et de la relative absence de témoignages. Ainsi, si
dans les croyances africaines, « it is the sacred duty of the family […] to keep the living-dead
within temporal sight of the Sasa period » (Mbiti, 1969: 162), ce devoir de souvenir a été en
grande partie impossible aux Antilles où les ruptures et les acculturations ont rendu presque
impossible tout travail de mémoire et de préservation des liens familiaux. Ainsi, puisque l’oubli
est, dans la tradition africaine égal à la mort et puisque « everyone wants to ‘be remembered’ to
be won over to the side of human Sasa, to be kept alive even if the body and spirit have
separated» (Idem.), on peut comprendre que la transmission du passé soit essentielle entre

328
Mathieu et Papa Longoué (Le Quatrième Siècle), entre Ti Jean et Wademba (Ti Jean l’Horizon),
ou avec Tituba qui se cherche une descendante : « comme je suis morte sans qu’il m’ait été
possible d’enfanter, les invisibles m’ont autorisé à choisir une descendante » (Condé, 2004 :
269).
Au-delà de sa simple existence culturelle et traditionnelle, la présence des morts semble
être, dans les romans, essentiellement un système de lutte contre les conséquences de
l’esclavage et ses ruptures sociales. Sans eux, il y aurait une rupture véritable et définitive, une
perte du savoir. C’est pour cette raison que, au-delà des croyances, nous pouvons observer que,
dans une grande majorité des cas, les invisibles permettent aux vivants de recevoir des
enseignements qui, sans leur présence, se seraient perdus à cause des violences et des morts
prématurées provoquées par l’esclavage. Ces morts permettent ainsi, par delà la mort et l’oubli,
de garder une trace de l’origine, de la structure familiale et des histoires personnelles, elles aussi
gravement touchées par le système oppressif. C’est ce que l’on retrouve dans le roman Moi,
Titba, dans lequel Tituba continue de maintenir un rapport avec ses parents décédés, Yao et
Abena, tout en continuant son enseignement avec Man Yaya. Cette relation est également
illustrée dans La Grande Drive des esprits, dans lequel Léonce écoute les conseils de Man
Octavie. Ainsi, pour ces populations antillaises qui ont connu ruptures et acculturations, la mort
n’est plus, dans les romans, une séparation ou une rupture, mais un aspect omniprésent et
essentiel de la vie. Malgré la souffrance, malgré la mort, l’imaginaire permet de reconstituer ce
qui a été perdu et de le rendre omnipresent : « ils sont là, partout autour de nous, avides
d’attention, avides d’affection. Quelques mots suffisent à les rameuter, pressant leurs corps
invisibles contre les nôtres, impatients de se rendre utiles » (Condé, 2004 : 23). Les ancêtres
africains ayant disparu, tout comme la plupart des traces de l’origine historique, les esclaves et
leurs descendants dépendent donc, historiquement, des récits des conteurs mais aussi de la

329
spiritualité et de l’imaginaire qui, par les invisibles, « matérialisent » les origines sociales,
familiales et donc identitaires qui restent aux personnages. Aux Antilles, la mort n’est donc pas
envisagée comme une fin : les Invisibles décrits dans les romans antillais constituent donc, pour
les vivants, une structure familiale, historique et spirituelle survivante. Ainsi, d’un monde
plantationnaire d’acculturations successives, à un monde rejetant l’Afrique originelle et la
France, les Invisibles seraient plus que de simples personnages folkloriques. Ils seraient les
traces identitaires d’une culture et d’une identité dans un monde où, en-dehors des contes, de la
mémoire pure, esclaves et marrons ne laissait que peu de traces de leurs passages. Marques
surnaturelles et indélébiles de l’origine biologique et familiale de personnages comme Tituba,
Léonce et Mina, ces esprits seraient l’illustration d’une lutte contre l’oubli et d’un ancrage dans
cette terre caribéenne.
Malgré les souffrances de l’esclavage et de l’acculturation, la situation antillaise a donc
eu des conséquences bénéfiques puisqu’elle a « développé un élément qu’aucun de ses
protagonistes n’avait pressenti ni n’avait désiré : une culture […] », (Chamoiseau, Confiant,
1999 : 49). Si les auteurs mettent en place dans leurs romans une arrivée qui pourrait constituer
un mythe des origines, une traversée initiatique et l’accession à une existence nouvelle et
négative. Ils échappent ainsi à tout attachement à une origine trop lointaine ou à une France
acculturatrice. Le monde antillais, qui ne semblait être qu’une prison, est donc décrit par les
écrivains comme un monde de limites et de frontières, divisé entre un ici et un ailleurs, entre les
vivants et les morts et entre un « en haut » et un « en bas » dans lesquels les mythes et le
folklore n’ont pas la même valeur. Curieusement, c’est par multiplication des lieux de
l’imaginaire qu’ils semblent capables de se recentrer sur eux-mêmes, sur leur île, dans le refuge
d’un « en haut » agent de transformations et dans le rapport avec ces invisibles qui permettent
de maintenir des liens spirituels familiaux tout en luttant contre l’oubli et l’acculturation

330
provoqués par l’esclavage et la domination de l’Histoire. Quittant le monde de l’« en bas », ses
plantations et ses villes, c’est donc sur ce « en haut » empreint de folklore et de mythes que nous
allons à présent nous pencher. Un lieu qui, libéré de toute frontière et s’ouvrant par l’imaginaire
littéraire vers un l’ailleurs de la spiritualité, pourrait bien être une des clefs de l’identité
antillaise dans les romans réalistes mystiques contemporains.

331
Chapitre 9 L’homme et la nature: de la re-mythisation de la terre antillaise
à la notion d’identité
Selon Édouard Glissant, le lieu est un élément incontournable de tout roman,
particulièrement dans le contexte antillais dans lequel « le rapport à la terre, rapport d’autant
plus menacé que la terre de la communauté est aliénée, devient tellement fondamental du
discours que le paysage dans l’œuvre cesse d’être décor ou confident pour s’inscrire comme
constituant de l’être » (Glissant, 2002 : 343). Comme nous l’avons vu avec l’océan de la
traversée et l’île antillaise, il y aurait donc, dans les romans de notre corpus, un lien essentiel
entre les représentations du milieu et l’identité antillaise, d’autant plus que « refuser à un
homme son droit à l’espace, c’est porter atteinte à son humanité même » (Simasotchi-Bronès,
2004 : 30). Suivant la théorie de Glissant et supposant que la géographie de l’« en haut » joue
elle aussi un rôle essentiel dans l’élaboration d’une identité, nous allons maintenant tenter
d’étudier comment la nature primordiale antillaise joue, dans les romans de notre corpus, un rôle
dans la recréation mythico-symbolique de l’être antillais en jouant sur la substance réaliste
mystique de la terre antillaise. Nous verrons comment, dans les représentations de la nature
primordiale, les romans réalistes mystiques font de ces lieux isolés un des refuges du mythe, de
la culture et de l’identité antillaise. Nous concentrant d’abord sur deux figures littéraires
récurrentes, les marrons et quimboiseurs, nous allons d’abord voir comment leur rapport aux
autres personnages et leur isolation dans cette nature leur permet de devenir, comme le Conteur,
des figures mythiques spécifiquement antillaises. Nous verrons ensuite comment ce territoire

332
isolé et primordial fonctionne, dans les romans, comme un refuge efficace pour le mythe et la
spiritualité antillaise. Ces notions nous conduiront enfin à envisager comment les auteurs, et en
particulier Patrick Chamoiseau, mettent en place par l’écriture une représentation de la nature
comme moyen de transcendance et de (re)définition de l’identité antillaise.
1 Marron, quimboiseurs et l’isolement magique de la Nature
1.1 Le quimboiseur : de l’héritage africain à l’identité antillaise
Si l’on en croit l’étude d’Anny Dominique Curtius, le mot quimbois aurait plusieurs
origines possibles. Il pourrait venir du mot guinéen xikuembo (faisant référence à ce qui est
indescriptible et source de divers malheurs) ou venir d’un geste du père Labat qui, entre
anecdote historique et légende, aurait guéri un esclave mourant en lui faisant boire une potion en
lui disant « tiens, bois » :
Le contexte de la créolisation sur la plantation, de même que le rapport traumatique entre esclaves et
missionnaires ou colons auraient alors eu l’effet suivant : les esclaves sont persuadés que la démarche du
père Labat relève d’une pratique magique qu’ils ont appellent [sic] le tiens bois. Un détour du langage a
donc donné, au fil du temps, le mot Quimbois. (Curtius, 2006 : 110-111)
Phénomène spirituel plutôt que religieux (à la différence, par exemple, du Vaudou haïtien qui
propose un panthéon d’esprits et de divinités, les lwas, des lieux de cultes et une hiérarchie
religieuse), le quimbois et ceux qui le pratiquent, les quimboiseurs, sont des figures
paradoxalement absentes des livres d’histoire. Ce sont cependant des figures récurrentes – voire
omniprésentes – dans la littérature antillaise. En effet, si ces quimboiseurs sont des personnages
essentiels de certains romans de notre corpus (Papa Longoué dans Le Quatrième Siècle, Man
Yaya dans Moi, Tituba…, Wademba dans Ti Jean l’Horizon et Man Octavie dans La Grande

333
Drive des esprits) ils sont également régulièrement mentionnés dans les autres, « Il repensait à
Grands-Ongles le quimboiseur, terreur de son enfance… » (Pépin, 2005 : 42). Né aux Antilles,
le quimboiseur est, si l’on en croit Chamoiseau, comme le Conteur : à la fois l’héritier de
l’Afrique et produit de l’esclavage et de l’annihilation de tout ordre social et religieux qui, au
sortir des navires négriers, a mélangé prêtres, sorciers et simples individus : « De génération en
génération, le fragile savoir africain se diffusera dans une mosaïque plus incertaine, et mille fois
plus complexe. Aucune cosmogonie ne soutiendra vraiment ces pratiques magiques »
(Chamoiseau, 2002 : 179). Ainsi, si le quimboiseur semble, nous l’avons vu, parfois se
confondre avec le conteur, il semble également être la combinatoire de figures aussi variées que
les medicine-men, les mediums et les diviners africains. En plus des quelques traits qui les
rapprochent des conteurs1, on remarque en effet que, comme pour les medicine-men, le travail
des quimboiseurs est souvent de soigner les maladies et la malchance : Papa Longoué est lui-
même décrit comme « le vieux guérisseur, le vieux marron » (Glissant, 2003 : 231), tout comme
Melchior qui « guérissait les plaies, [et] apaisait les enfiévrés » (Glissant, 1997a : 157).
Medicine-Men et quimboiseurs partagent également la révélation et la transmission qui sont à
l’origine de leurs pouvoirs et qui peuvent se faire par un membre de la famille ou par les esprits:
« there are medicine-men who believe that spirits or the living-dead have ‘called’ them, in
dreams, visions or in the waking, to become medicine-men» (Mbiti, 1969 : 167). C’est ce que
l’on voit avec Wademba qui transmet son savoir à sa fille puis à Ti Jean, « [il] l’entraînait dans
les bois, lui enseignait les plantes et leurs vertus cachées, les liens subtils qui les amarrent aux
1 Tout comme les medicine-men sont influents et ont certaines qualités requises par les sociétés dans lesquelles ils
évoluent: on remarque que des personnages comme Man Octavie, Tituba et Man Yaya inspirent crainte et respect : « on la craignait. Mais on venait de loin à cause de son pouvoir » (Condé, 2004 : 21). De même, les medicine men sont également de véritables piliers de leurs communautés, comme on le voit pour Papa Longoué après sa mort : « on pouvait penser qu’il n’avait jamais été plus vivant qu’à cette minute, où une foule vibrante encore de cris et d’ardeurs s’immobilisait, dans la clarté déclinante des flambeaux […] » (Glissant, 2003 : 231).

334
diverses parties du corps humain » (Schwarz-Bart, 1998 : 21-22), et avec Tituba et Léonce qui,
dans Moi, Tituba… et La Grande Drive des esprits reçoivent un enseignement de mentors
décédés. De par ce contact avec le monde des Invisibles, les pouvoirs des quimboiseurs antillais
rejoignent ainsi ceux des mediums qui, dans la culture africaine, lient les humains aux esprits
des morts : «through them messages are received from the other world, or men are given
knowledge of things that would otherwise be difficult or impossible to known» (Mbiti, 1969:
172). La Grande Drive des esprits illustre ce phénomène quand Man Octavie prédit à Léonce les
noms et le destin de ses futurs enfants : « Célestina sera ton aînée […] Un ti-mâle viendra
ensuite, mais il n’est pas pour cette terre » (Pineau, 2001 :87-88). Tout en devenant, comme le
medium africain, un pont entre le monde des vivants et celui des morts, les quimboiseurs
enrichissent donc d’une certaine perception religieuse le monde antillais, « They enrich and
dramatize the religious perception and activities of their communities » (Mbiti, 1969: 176) » qui
s’associe même, chez Pineau, à un syncrétisme avec la religion chrétienne2 comme avec Man
Ninette qui, dans le roman « entra dans la peau de sainte Manman Ninette, patronne des grands
malades, providence des mélancoliques, la main de Dieu sur les chairs meurtries » (Pineau,
2001 : 112).
Si le quimboiseur peut-être à la fois « l’expression d’une dialectique ou mieux, d’une
intersémiotique, entre la magie et le catholicisme » (Curtius, 2006 : 111) et l’héritage de
différentes croyances africaines, il est cependant considéré par Philippe Delisle et Anny
Dominique Curtius comme un phénomène créole puisqu’il « se construit à partir de la mise en
contact brutale de peuples d’origines et de mentalités différentes » (Curtius, 2006 : 110).
« Dépositaire d’une grande idée, celle du maintien de l’Afrique » (Pineau, 2002 : 181) dont la
2 Ce syncrétisme est assez fréquent dans les romans antillais, mais il nous semble qu’il est le plus souvent utilisé
comme matériel ethnographique que comme réelle thématique littéraire.

335
« médecine est culturelle » (Idem.), le quimboiseur est donc une figure antillaise aux origines
apparemment multiples et qui a une grande importance dans la vie des antillais pour qui « les
étapes majeures de la vie sont ponctuées par une séance chez le quimboiseur et sanctionnées par
un rite de protection » (Curtius, 2006 : 112). Si l’ouvrage de Simonne Henry-Valmore insiste
sur la rupture entre la veilleuse antillaise et l’Afrique, on remarque que celle-ci, comme le
quimboiseur, n’a pratiquement aucun rapport avec la France et la ville antillaise dans lesquelles
ils perdent tous deux de leur prestige. C’est ce que l’on voit par exemple avec Sarah Pitagor
dans le roman Chair piment, « une Martiniquaise medium et devineresse dont le fils au chômage
distribuait les cartes de visite à la sortie du métro Château-Rouge à Paris. [Et qui] logeait dans
une chambre de bonne, rue des Poissonniers » (Pineau, 2004 : 15), ou dans Le Quatrième
Siècle : «et je sais que pour toi, un quimboiseur c’est la folie et la bêtise. Mais ce n’est pas vrai.
On ne connaît pas tout mais on connaît quelque chose » (Glissant, 1997a : 159). Illustrant les
théories d’Édouard Glissant et celles de Simonne Henry Valmore dans Dieux en exil, les romans
reprendraient à leur compte la notion que les quimboiseurs ne peuvent réellement se projeter
dans un monde et un type de société qui les considère comme des « charlatans » (Glissant,
2002 : 181). Dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau explique également cette perte de valeur
du quimboiseur par la perte du savoir africain qui ne leur permet pas « d’appréhender ce monde
effervescent » (Chamoiseau, 2002 : 179). Selon lui, c’est par cet aspect spécifique que le
quimboiseur se distingue du conteur qui, bien qu’il lui soit lié, a plus de force car il dépend non
pas de l’Afrique originelle mais, comme nous l’avons vu plus haut, des hommes : « [Le
conteur] ne relève pas des seules mémoires africaines mais de toutes les mémoires qui se sont
échouées là en mille traces mobiles » (Chamoiseau, 2002 : 183). En effet, Sarah Pitagore et ses
cartes de visite n’ont pas le prestige d’une Man Yaya que l’on vient voir de loin et dont la seule
réputation attire les foules. De même, la nature des rituels de protection et leur efficacité
semblent changer entre la France et les Antilles. Si Mina Monterio doit se rendre en Guadeloupe

336
parce que les « sept prières merveilleuses à réciter quarante fois chaque dimanche à six heures,
[et les] deux fioles anti-zombies […] » (Pineau, 2004 : 17) qui lui ont été conseillées en France
ne l’aident pas à stopper les apparitions de Rosalia, certains personnages de romans ont, comme
Wademba dans Ti Jean l’Horizon, des pouvoirs magiques faisant d’eux des figures
surnaturelles :
Jour de malheur, les protections les plus hautes et les plus subtiles ne lui serviraient de rien, car nul ne
pouvait s’opposer aux entreprises de l’Immortel : s’enfuir ?... enjamber la mer ?... hélas, les distances
n’existaient pas pour le vieux magnétiseur des ténèbres et c’était peut-être lui cette mouche sur la table,
semblant lisser innocemment ses pattes […]. (Schwarz-Bart, 1998 : 26)
De ce fait, la dévalorisation du quimbois que l’on trouve parfois dans les romans, et qui semble
inévitable en zone « occidentalisée », ferait partie d’un mouvement symbolique dans lequel la
modernité, l’européanité et le réalisme de la raison « à l’occidentale » sont représentés comme
des marqueurs de culture contre lesquels le folklore antillais lutte difficilement. De manière
générale, le quimboiseur semble tout simplement ne pas pouvoir exister en-dehors du milieu
naturel et des forêts, au milieu desquelles se développe son savoir. En effet, dans les romans,
chaque quimboiseur (les Longoué, Wademba, Man Octavie, Tituba et Mn Yaya) vit dans
l’isolement de la nature. S’il leur arrive de se déplacer (ce qui arrive rarement), ces personnages
semblent pourtant acquérir leur pouvoir spécifiquement de leur situation d’isolation dans le
cœur de l’île (généralement dans l’en haut) et de leur contact à la nature antillaise. Figure
traditionnelle ne pouvant survivre qu’aux Antilles, souffrant des acculturations occidentales qui
cherchent à n’en faire qu’un charlatan, le quimboiseur est ainsi, par son lien au monde visible et
au monde invisible et par son ancrage dans la croyance populaire et ses origines lointaines, une
véritable marque culturelle, un lien identitaire au monde antillais. Plus qu’une simple survivance
des traditions africaines, il est une figure omniprésente, un symbole de l’identité antillaise,

337
comme l’exprime la mort de Papa Longoué dans La Lézarde : « avec lui, la terre des Ancêtres
pénétrait enfin dans l’âme commune. Sans les mystères, sans les légendes ; sans la science de la
nuit ; la terre dénudée mais vivante » (Glissant, 2003 : 231). Connaissant la magie (dans le cas
de Wademba et de Man Yaya), le passé (Papa Longoué) ou l’avenir (Man Octavie), tissant un
lien entre l’ici et l’ailleurs, entre le passé et le présent, le quimboiseur est le lien de la
connaissance entre l’origine ancestrale et les Antilles, et le symbole des souvenirs et des mythes
perdus. Révélateur des multiples dimensions du monde antillais, il est symbole de l’île et de la
nature antillaise primordiale dans laquelle il trouve sa force : « c’est le silence des bois et
l’osmose de l’énergie irradiant entre lui et la nature qui lui procure sa puissance psychique, celle
de voyant » (Leung, 1999 : 49).
Le quimboiseur a donc beau être une figure héritée de l’Afrique, son pouvoir et son
influence semblent cependant venir non pas de son origine lointaine mais de cette isolation et de
ce contact avec la nature antillaise primordiale. S’opposant ainsi aux personnages restés dans les
villes ou les plantations, il est différent du conteur qui a besoin de celles-ci pour exister. C’est ce
que l’on voit par exemple dans Ti Jean l’Horizon avec le village de Fond-Zombi qui illustre
bien son nom quand ses habitants choisissent de ne pas lutter contre le retour à l’esclavage causé
par la disparition du soleil. Comme le propose Francis Affergan, le quimboiseur serait donc de
ces figures spirituelles représentant « un univers mythique qui a pour charge de décongestionner
une réalité anxiogène » (Affergan, 1983 : 87) et qui, comme la figure du Conteur, aurait une
fonction de compensation face à un vide historique et face aux acculturations successives et
continues de la société antillaise. De par ses pouvoirs et sa position sociale, le quimboiseur
créerait ainsi, dans les romans, un lien entre plusieurs mondes : l’Afrique originelle et les
Antilles natales, le monde des vivants et celui des Invisibles, mais aussi, dans les romans, entre
le réalisme et le mystique. Cependant, plus encore que ce lien entre les mondes, le quimboiseur

338
est une incarnation du lien de l’homme antillais à sa terre natale, incarnée par une nature
primordiale porteuse de secrets. En effet, c’est le contact avec cette nature primordiale qui
confère aux nombreux quimboiseurs leurs pouvoirs et qui leur permet de comprendre lors de
leurs initiations le « chant des troncs silencieux » (Glissant, 1997a : 159), « tout ce qui passe
dans les bois est gardé au fond du bois ! » (Glissant, 1997a : 18). Ainsi, dans la majorité des
romans, l’existence du quimboiseur est le point de contact, voire même de passage, entre les
diverses couches du monde réel et du monde spirituel qui se regroupent autour d’un rapport
identitaire profond avec la terre natale, comme on peut le voir dans Le Quatrième Siècle avec
Melchior qui « avait longtemps suivi les bois dans leur profondeur » (Glissant, 1997a : 158),
obtenant tout au long de son expérience un certain pouvoir et une certaine autorité auprès des
hommes. Cependant, malgré sa présence dans les romans, le quimboiseur demeure une figure
discrète qui, si elle guide les personnages, n’agit pas directement et se confond même, parfois,
au conteur sans vraiment inspirer narrateurs ou personnages, comme le fait le marron.
1.2 Le marron : une figure historique et littéraire
S’il y a une autre figure, omniprésente dans la littérature antillaise, intimement liée la
nature antillaise et à ses profondeurs secrètes, c’est bien le marron. Contrairement à d’autres
figures qui, comme le Conteur ou le Quimboiseur, sont relativement absentes des livres
d’Histoire, le marron a su s’imposer comme une figure historique. Cependant, il semblerait que,
par le caractère dispersé du marronnage et la petite taille des îles, le phénomène ne soit pas aussi
vaste et important que les romans le laissent paraître. Venant originellement du terme espagnol
cimarrón, qui s’est d’abord référé au bétail domestique échappé puis aux esclaves amérindiens
en fuite dans les collines d’Hispaniola, ce n’est que vers la fin des années 1530 que le terme
aurait commencé à se voir attribué aux esclaves enfuis et vivant sur les hauteurs. Dans son

339
expression idéalisée, étudiée par Richard D.E. Burton dans Le Roman marron : études sur la
littérature martiniquaise contemporaine, le marronnage serait « un phénomène massif, continu
et durable [concernant] surtout des esclaves d’origine africaine […] en rupture quasi-totale avec
le monde habitationnaire » (Burton, 1997 : 59) ainsi que le symbole du « refus inconditionnel de
l’esclavage, et une négation à part entière des mentalités et des valeurs qu’il implique » (Idem.).
Cependant, la réalité historique ne s’accorde pas avec cette image puisque, selon Burton, le
phénomène aurait été important sans être massif, déclinant avec le temps pour ne plus vraiment
exister dans sa forme classique après 1800. De plus, s’il a concerné « des esclaves d’origine
africaine et créole » (Ibid. : 61) et s’il a été un refus de l’esclavage, le marronnage aurait surtout
existé « en symbiose avec le monde plantationnaire » (Idem.) puisque, sauf peut-être au
Surinam, « aucune communauté marronne n’a atteint à une véritable autonomie par rapport à
l’ordre esclavagiste » (Idem.). De même, les gestes de fuite des esclaves n’auraient pas toujours
été, comme ils le sont décrits dans les romans de notre corpus, des gestes héroïques de révolte.
Selon Burton, s’il y a en effet bien un lien direct entre la prise de conscience des esclaves et le
système esclavagiste, le marronnage pourrait cependant être perçu de différentes manières, à la
fois comme un geste de rébellion, d’opportunité ou de désespoir dont les origines sont souvent
vagues et contradictoires. John K. Thornton, quant à lui, cherche à revaloriser le poids des
influences africaines en suggérant dans son article « I am the Subject of the King of Congo »
que la révolte de Saint-Domingue pourrait s’expliquer par l’héritage de la guerre civile au
Congo. Paul Lovejoy, de son côté, envisage l’idée d’un mouvement interne et spontané et que
«[the] deracination accompanying the ocean voyage and the humiliation of racial stereotyping
that followed in the Americas fundamentally altered the perception of slavery as an institution
for many slaves » (Lovejoy, 1997: 14) et seraient ainsi à l’origine de l’abolitionnisme des
esclaves qui aurait été « a BLACK response to slavery as a European phenomenon » (Ibid,
1997 : 15). Les origines et les motivations du marronnage sont donc historiquement peu claires

340
et beaucoup plus diverses que ses représentations littéraires. À ce marronnage symbolique
s’ajoute également une différenciation de nature, notamment à travers toutes sortes de
résistances dites « passives » et qui, du travail mal exécuté à l’empoisonnement du bétail, n’ont
pas toujours le prestige de la fuite emblématique qui fait de l’esclave fugitif une figure
historique incontournable que l’on retrouve dans des romans français comme Candide de
Voltaire (Le Nègre de Surinam, chapitre XIX), Georges d’Alexandre Dumas, ou Bug-Jargal de
Victor Hugo, et de façon quasiment omniprésente dans la littérature antillaise contemporaine et
les romans de notre corpus. Y aurait-il donc une différence entre le marronnage historique et ses
représentations littéraires ?
Selon Marie-Christine Rochmann, le marronnage aurait, en littérature, deux origines
successives. Tout en faisant entrer le marron dans l’Histoire, l’abolition de 1848 aurait
également entraîné une « historicisation du marronnage dans la littérature celui-ci [devenant] un
épisode au sein d’un parcours narratif plus large, avec l’introduction du motif clé de l’entrée en
marronnage, qui comprend motivations, départ, poursuite, issue » (Rochmann, 2002 : 174).
Après cette apparition, ce n’est cependant que dans le roman Cruautés et tendresses (1925) de
Drasta Houël qu’apparaît le premier « véritable » rebelle esclave de la littérature antillaise. Bien
qu’il n’intervienne pas directement dans l’action, ce personnage réunit cependant « deux des
formes les plus nettes de la résistance à l’esclavage, le marronnage, inscrit dans son corps
mutilé, et le complot en vue d’un affrontement ouvert » (Rochmann, 2000 : 119). Si ce
personnage a, dans des romans comme Outre-Mer de Louis Maynard de Queilhe (1835) ou Le
Dernier Caraïbe de René Brard (1849), joué le jeu d’un certain « projet ethnographico-exotique
conforme aux attentes de la métropole » (Rochmann, 2000 : 46), ce n’est que pendant la période
1920-1950 que cette figure littéraire a pris l’apparence d’un véritable héro noir. Selon
Rochmann, c’est ce que l’on retrouve dans des romans comme D’Jhébo, le Léviathan Noir

341
(1957) de César Pulvar, et Dominique, Nègre esclave (1951) de Léonard Sainville qui racontent
la vie de ces héros au lieu d’en faire des figures « exoticisées » par un point de vue occidental.
Figure omniprésente de la littérature antillaise, le marron est d’autant plus intéressant
que, comme l’exprime encore Marie-Christine Rochmann, il y a une absence de sources
historiques véritables et vérifiables quant à la présence des marrons aux Antilles françaises : « à
l’exception peut-être du camp des Kélers en Guadeloupe, les historiens semblent disposer de
peu d’informations sur les camps de marrons. C’est aussi qu’à la différence de la Jamaïque ou
de la Guyane, aucune communauté marronne ne s’est maintenue jusqu’à nos jours dans les
petites Antilles françaises » (Rochmann, 2000 : 25). Comme pour le conteur que nous avons vu
dans notre précédente partie, l’approche du marron ne peut donc entièrement se faire, aux
Antilles, à partir d’études historiques. Si ce phénomène a poussé les historiens à « emprunt[er]
leurs exemples à la Guyane ou à Saint-Domingue lorsqu’il s’agit de dépeindre une communauté
marronne » (Rochmann, 2000 : 34), on peut donc s’interroger sur la nature et la valeur du
marronnage dans nos romans, qui ne s’inspireraient donc pas directement de l’histoire antillaise.
Comme on a pu le noter avec les figures littéraires du conteur ou du quimboiseur, il y a une
différence entre la réalité historique du phénomène marron aux Antilles, dont on sait peu de
choses, et la valeur symbolique et folklorique que lui attribut certains auteurs antillais qui font
d’eux des héros, comme on peut par exemple le voir dans Nègre-marron de Raphaël Confiant,
qui suit l’évolution de la figure du marron à diverses époques historiques, de l’Afrique des
origines à la Guadeloupe de 1978 et qui se termine sur ces mots, qui signent ici, après la mort du
conteur, la fin d’un autre personnage : « Je suis, je serai le dernier Nègre marron d’ici-là… »
(Confiant, 2006 : 211). Paradoxalement, si le marron n’est mentionné que par les études
historiques, il serait en fait « le seul vrai héros populaire des Antilles, dont les effroyables
supplices qui marquaient sa capture donnent la mesure du courage et de la détermination »

342
(Glissant, 2002 : 180). Figure héroïque, symbole de la lutte, de la révolte et du refus total, il est
donc une représentation spécifique du marron historique qui, partie d’aspects spécifiques d’un
phénomène historique discret, est devenue emblématique de la littérature et de la culture
caribéennes.
1.3 La mise en place du mythe du marron
Du marronnage du quotidien sur les plantations – sabotages, empoisonnements ou,
comme dans le cas de certaines femmes, le choix de l’avortement plutôt que la condamnation de
leur enfant à l’esclavage – au grand marronnage, ce type de révolte a donc plusieurs visages.
Dans sa version quotidienne, sur les plantations, il n’est que discrètement mentionné dans les
romans dans lesquels il prend plus l’apparence de gestes de résistance. On le voit par exemple
avec l’avortement de Tituba qui, dans le roman de Maryse Condé, symbolise ces femmes qui
par « l’utilisation de leur matrice comme lieu et arme de combat, [ont résisté] en silence à
l’esclavage […]. La matrice synonyme de vie [devenant] alors symbole de mort d’êtres humains
mais aussi d’un système avilissant » (Curtius, 2006 : 233). Qu’il s’agisse du personnage
principal (L’Esclave vieil homme et le molosse, Le Quatrième Siècle, Nègre marron), d’une
mention symbolique (Un Papillon dans la cité) ou des personnages secondaires (Moi, Tituba…,
Ti Jean l’Horizon), les romans antillais de notre corpus sont donc thématiquement plus
nettement orientés vers le « grand marronnage », celui de la fuite vers l’ « en haut ». Ce choix
thématique basé sur un phénomène historiquement peu étudié indique ainsi de la part des
auteurs un certain désir esthétique et thématique favorisant l’aspect héroïque de ces
personnages. On peut alors supposer que c’est peut-être justement grâce à ce manque de détails
historiques que les auteurs ont pu transformer cette figure populaire. Leurs écrits réalistes
mystiques mêlant réalisme historique et surnaturel, ils auraient alors une plus grande marge de
manœuvre dans leurs créations de personnages marrons, sans pour autant aller contre les textes

343
historiques. Comme d’autres auteurs, Glissant aurait ainsi, par la création d’un personnage
comme l’ancêtre Longoué, donné un visage et un nom à un phénomène historique mentionné
par les études historiques (et quasiment anonyme aux Antilles, qui n’ont connu ni Boukman ni
Mackandal) et lui aurait donné une forme de légitimité et d’historiographie. Manipulant le fait
historique, il l’aurait même rapproché du mythe. Ainsi, comme le note Marie-Christine
Rochmann, quand Glissant reprend l’histoire de Mackandal dans Monsieur Toussaint, il place
son amputation d’un bras non pas avant son marronnage, comme ça a été le cas historiquement,
mais situe la mutilation lors de la fuite et la chute du héros sur la pierre du moulin, un soir de
calenda, alors qu’il est déjà marron, afin d’appuyer l’héroïsation du personnage. On retrouve un
même type de mise en valeur dans Le Quatrième Siècle, roman dans lequel Glissant décrit une
forme de marron « idéal », pur, n’ayant jamais souffert de l’enchaînement et qui a refusé sa
condition d’esclave dès son arrivée sur la plantation. Par cette notion de pureté et d’isolation de
l’esclavage, nous remarquons que, comme le quimboiseur, le marron doit être lié à la nature
primordiale et à son isolement. Or le marron a, historiquement, comme sa contrepartie littéraire,
toujours eu un rapport spécifique avec la nature : il ne devient en effet marron qu’au moment où
il quitte la plantation pour atteindre les mornes. Comme le conteur entrait en fonction la nuit et
comme le quimboiseur ne survit que dans un isolement primordial, l’acte même du marron est
un rapport avec la nature. En effet, si l’article 16 du Code Noir interdisait aux esclaves de se
regrouper, il insistait encore plus sur le regroupement en lieux isolés, interdisant toute réunion
sous « prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore
moins dans les grands chemins ou lieux écartés […] » (Sala-Molins, 2006 : 122). Ces lieux
reculés, ces refuges, finirent cependant par devenir des éléments essentiels aux révoltes puisque
« c’était aux croisées des grands chemins et dans des lieux écartés que, trompant la vigilance des
maîtres et des commandeurs, [les esclaves] se réunissaient et mettaient au point des tentatives de
sédition et de révolte » (Idem.). C’est d’ailleurs ce qui s’est passé lors de la fameuse cérémonie

344
de Bois Caïman qui aurait été le point de départ de la révolution haïtienne et qui, en dépit de
certains doutes historiques, n’en demeure pas moins un événement essentiel, politiquement et
spirituellement, dans la culture haïtienne. Cependant, que les révoltes se fomentent dans les
plantations ou dans la nature elle-même, le résultat est toujours semblable : une fuite vers les
hauteurs, l’accession à une forme d’autonomie et la reconstitution d’une communauté, « for
everywhere in the New World were slave revolts were successful, the Negroes had the jungle or
the mountains, or both, as a refuge, wherein they might establish and consolidate their
autonomous communities » (Herskovits, 1959: 113). Le marronnage et la révolte sont donc
essentiellement liés à une fuite dans la nature et à la (re)construction d’une identité nouvelle.
Libres de toute acculturation esclavagiste par la prise de possession de ces lieux vierges, les
marrons peuvent ainsi se reconstituer identitairement et culturellement : « le nouveau terroir
devient Source Seconde en tant que re-création de la première. Là se recrée la Weltanschauung
de l’être transbordé. Dans ces communautés, le nouvel espace, le passé est recréé par le rite, la
culture et le savoir […] qui sont ainsi transmis aux futures générations » (Leung, 1999 : 158).
On en revient ainsi à cette bipartition spatiale, vue par exemple dans Ti Jean l’Horizon, entre
ceux de l’ « en haut » qui vivent dans les profondeurs de la forêt marronne, espace qui est
symbole de leur liberté et de la préservation de l’identité, et ceux qui, acculturés dans l’ « en
bas », vivent dans les plantations ou les villes. Plus qu’un marron révolté, qui a fui pour affirmer
sa liberté par réaction contre l’esclavage, Longoué est le marron pur, celui qui, par sa fuite
immédiate et son isolement, n’a jamais connu les chaînes.
Personnage symbolique et historiquement réaliste, le marron garde donc un certain lien
avec son origine et sera affecté non pas par l’acculturation imposée par les colons, mais par un
procédé naturel d’adaptation à la nouvelle terre qui lui permettra de se créer un monde hybride,
né des origines africaines et de la terre antillaise. On le voit par exemple quand, en répétant et en

345
déformant le qualificatif que lui attribue Louise, Longoué se nomme pour la première fois: « une
fois, dans leurs débuts, elle lui avait dit : ‘‘Tu es raide comme un dongré’’. Lui, doucement avait
répété : ‘‘Longoué, Longoué’’. Elle avait ri, les désignant tour à tour : ‘‘Louise, Louise,
Longoué, Longoué’’ » (Glissant, 1997a : 109). Par cet acte, le marron devient ainsi le premier
Longoué en s’offrant une nouvelle origine et un nouveau nom qui, contrairement à Béluse, son
rival devenu esclave, ne sera pas donné par les maîtres et ne s’influencera d’aucune culture, ni
africaine ni française : « en se nommant plus tard lui-même lorsqu’il répète, en le déformant, le
qualificatif attribué par sa compagne Louise, Longoué effectivement s’autocrée, devient son
propre père, c’est-à-dire absolument le premier » (Rochmann, 2002 : 176). C’est ce que l’on
retrouve également dans Moi, Tituba…, quand Yao donne à son enfant un nom ni africain, ni
européen, mais purement nouveau, produit de son imagination et de sa liberté : « ce n’est pas un
prénom ashanti. Sans doute, Yao en l’inventant, voulait-il prouver que j’étais fille de sa volonté
et de son imagination » (Condé, 2004 : 17). Il semble donc que, pour les auteurs, le marron
idéal, héroïsé, soit détenteur d’une certaine pureté vis-à-vis de l’esclavage afin d’obtenir une
certaine identité : on le voit avec Tituba élevée par Man Yaya loin des plantations ou avec
Longoué, qui ne rejoindra les marrons qu’après son propre cheminement identitaire, ou encore
avec le vieil esclave de L’Esclave vieil homme et le molosse qui, comme nous le verrons, suit un
chemin initiatique de purification dans la nature primordiale avant de retrouver sa propre
identité. Héros ancestraux, derniers représentants d’une lignée d’individus vivant dans les forêts
afin d’y préserver un mode de vie originel, Papa Longoué et ses descendants littéraires
introduisent souvent, dans les romans, une dimension légendaire, souvent aux limites du
surnaturel, qui donne à ces personnages historiques et littéraires un aspect mythique.

346
1.4 Le marron comme mythe antillais
Si l’on en revient à la fonction génésique de la traversée dans la cale du navire négrier, le
marronnage pourrait donc, par représentation archétypale dans les romans, prendre une fonction
de mythe originel, celui de la fondation des sociétés marronnes, des premières sociétés
antillaises libres. Le marronnage est donc une fondation, l’origine d’une société révoltée
(comme la plantation est l’origine d’une société soumise dans laquelle apparait le conteur) dans
lequel on peut voir un principe de répétition, un archétype : celui de la fuite vers les mornes qui,
d’un roman à l’autre, suit toujours un cheminement identique. Cependant, la figure du marron
possède une autre caractéristique mythique : son aspect exemplaire. En effet, le marron a bien
souvent une influence déterminante sur plusieurs personnages de nos romans, spécifiquement
pour les personnages de l’ « en bas » qui y font souvent référence. On le voit par exemple dans
Un Papillon dans la cité de Gisèle Pineau, quand Félicie voit un vieil homme de 90 ans qui,
ayant connu la sauvagerie de la guerre, préfère vivre seul dans les bois: « Des fois, le regardant
passer, si vieux, si ridé, un peu voûté, la peau près des os, tenant son coutelas rouillé sur
l’épaule, je pensais qu’il devait sûrement voir, là-haut dans les mornes, les fantômes des
derniers nèg-mawon… » (Pineau, 1992 : 108). On le voit aussi dans La Lézarde d’Édouard
Glissant dans lequel un grand-père fait réaliser à son petit fils ce lien avec les forêts de
Martinique :
Maintenant il voyait distinctement son grand-père, un vieil esclave marqué de fers (c’était cela, c’était
donc cela), et toute la tradition de la famille, la fuite dans les grands bois, le commerce des esprits, l’appel
chaque jour vers là-bas, vers la forêt famélique et somptueuse […] ils ne savaient pas qu’au fond d’eux
c’était la forêt qui appelait. (Glissant, 2003 : 198)
Cette distance temporelle et spatiale, nourrie de rumeurs et de mystères, finit souvent par
produire dans les romans une image parfois surnaturelle ou légendaire du marron, comme le

347
personnage de Ti-Noël qui, dans Moi, Tituba… se développe essentiellement à partir de la
rumeur qui le rend différent du véritable Ti-Noël rencontré par Tituba et qui ne possède aucun
pouvoir : « Personne ne l’avait jamais vu. Depuis le temps qu’il vivait dans les imaginations, ce
devait être un vieillard. Pourtant on lui prêtait jeunesse et audace et on se répétait ses hauts
faits» (Condé, 2004 : 221-222). Ainsi, si les marrons ne sont pas toujours physiquement présents
dans les romans, on remarque cependant qu’un certain nombre de personnages réitèrent leurs
actes ou s’en inspirent dans leur quotidien. Pour Félicie par exemple, personnage du roman Un
Papillon dans la cité, le Marron est un moyen d’affirmer son identité par rapport à son ami
Mohamed et sa fascination pour les Touaregs : « Chez moi aussi il y avait des ancêtres qui ne
craignaient personne. C’était pendant l’esclavage. Ils se révoltaient. Ils brisaient leurs chaînes.
Ils fuyaient dans les bois » (Pineau, 1992 : 61). Mieux, Félicie va même jusqu’à s’inspirer de
leurs actions pour se donner du courage dans sa propre vie:
Pour me donner du courage, j’ai pensé très fort aux nèg-mawon, les braves qu’on n’avait pu asservir. Je
me suis dit qu’en ce temps-là, on ne rigolait pas tous les jours, on ne dansait pas le zouk, on ne mangeait
pas de gâteau de mariage. Quand je me suis retrouvée devant la porte de Mo, j’étais toute regonflée.
(Pineau, 1992 : 88).
De la même manière Siméon, dans Nègre marron de Raphaël Confiant, devient « un Nègre
marron, presque cent ans après l’abolition de l’esclavage » (Confiant, 2006 : 151) après une
expérience qui, durant sa fuite, lui permet de revivre « […] une à une les épreuves majeures
qu’avaient traversées ses ancêtres […] » (Ibid. : 160). C’est là un phénomène que l’on remarque
également dans des romans comme Le Meurtre du Samedi-Gloria ou Ti Jean l’Horizon dans
lesquels, les personnages doivent souvent quitter la ville pour les hauteurs afin d’y suivre une
initiation et d’atteindre une certaine étape de leur évolution personnelle : Ti Jean y rencontre
Wademba et y obtient certains pouvoirs, Romule Beausoleil le fier-à-bras de la communauté de

348
Morne Pichevin (dans Le Meurtre du Samedi-Gloria) part lui aussi pour les hauteurs afin de
parfaire son entraînement au damier, tout comme Pierre Philomène Soleil qui, dans Chronique
des sept misères de Patrick Chamoiseau, s’éloigne de la ville pour développer son jardin. Ce
cheminement vers le haut reproduit donc, comme un pèlerinage initiatique, le cheminement du
marron3. Ainsi, de la figure originelle du marron aux personnages qui, comme lui, s’isolent dans
les mornes, nous pouvons voir dans les romans la répétition presque systématique d’un même
mouvement vers l’ « en haut », positif et nécessaire au développement de ces personnages.
Qu’ils servent de modèle de courage ou de rébellion, ou que leur fuite permette une isolation et
un retour sur soi au cœur d’une nature primordiale et préservée, nous pouvons donc dire que les
figures de marrons présentes dans les romans proposent bel et bien « des modèles de conduites
humaines » (Eliade, 1988 : 12) et confèrent à certains personnages « signification et valeur à
l’existence » (Idem.). Bref, tout comme le Conteur, le Marron est une figure littéraire et
culturelle essentielle, un modèle de conduite et donc un mythe antillais.
2 Nature sauvage et primordiale : du refuge du marron au refuge de l’imaginaire
2.1 La nature: refuge des esprits et du surnaturel
Dans les romans antillais, la spiritualité antillaise se trouve véritablement prise au piège
puisque les villes occidentales et les milieux antillais occidentalisés ne permettent pas aux
mythes de se fixer ou d’avoir une existence normale. Si les manifestations de ces phénomènes
folkloriques comme le zombi ou le dorliis ne produisent pas toujours, en ville, les mêmes
3 Tituba, au contraire, suit un mouvement inverse puisque ses malheurs et ses souffrances auront pour origine un
désir de quitter l’isolation des mornes vers lesquels elle retournera peu avant sa mort et sa renaissance spirituelle.

349
délires4 que dans L’Homme-au-Bâton, il apparaît cependant que l’ « en haut » et la nature
primordiale qui lui est associée sont le refuge de nombreux personnages, marrons et
quimboiseurs, tout en étant la source de nombreux phénomènes surnaturels : Pipi y rêve de
l’esclave-zombi Afoukal, Ti Jean y voit des esprits dévaler la montagne, « un roulement sourd
dévalait la montagne, suivi d’une traînée lumineuse qui contourna un piton rocheux, tomba du
côté de la mer, s’évanouit » (Schwarz-Bart, 1998 : 61), et y rencontre la Bête avaleuse de soleil.
Comme on le voit avec Man Yaya, Abena et Yao dans Moi, Tituba… ou avec Man Octavie dans
La Grande Drive des esprits l’ « en haut » semble être, plus que tout autre lieu de l’imaginaire
antillais, un point d’ancrage du surnaturel et c’est là, dans l’isolation de la nature, que les esprits
des morts ont le plus tendance à se manifester. Si certains romans réalistes mystiques comme Ti
Jean l’Horizon, rendent compte de la richesse folklorique de la Guadeloupe qui « nourrit toutes
qualités d’êtres étranges, hommes et bêtes, démons, zombis […]» (Schwarz-Bart, 1998 : 11), on
remarque que cette richesse ne se manifeste pas partout de la même manière. Nous l’avons vu
dans le cas des villes qui, entre disparition des phénomènes folkloriques et leur absurde
déchainement, remettent en question leur nature. De même, nous avons vu que les habitations et
la nature domestiquée du système plantationnaire échappent également aux esprits qui ne s’y
aventurent que rarement. Ainsi, selon l’imaginaire des romans, le folklore antillais n’a, dans les
œuvres de notre corpus, aucune prise sur les milieux urbains et urbanisés. Ce phénomène
expliquerait alors pourquoi, dans les romans réalistes mystiques, les événements surnaturels se
déroulent essentiellement 1) dans les campagnes et 2) dans le passé. Ce sont en effet les seuls
lieux qui, par leur système de croyances traditionnelles et leur éloignement des lieux
d’acculturation associés à la technologie que sont les villes et les plantations, permettent aux
4 En effet, dans certains romans, les rumeurs « urbaines » associées aux phénomènes folkloriques passent parfois
inaperçues ou sont juste mentionnées par les personnages ou les narrateurs.

350
phénomènes folkloriques de se manifester naturellement : « beliefs involving the spirit world are
more prevalent in the country than in town, and were more prevalent in the past than they are
now » (Ormerod-Noakes, 1997 : 223). Cela explique également que si ces croyances sont fortes,
elles n’en sont pas moins cachées, mises à l’écart, ignorées par le monde des villes
occidentalisées pour lesquelles elles ne sont que « la face cachée des choses, cette tranche du
monde qui ne figurait pas dans les livres de l’école, car les blancs avaient décidé de jeter un
voile par-dessus… » (Schwarz-Bart, 1998 : 47). Comme avec le conteur du temps des
plantations, il apparaît que les créatures du folklore se manifestent en majorité loin des villes, en
particulier la nuit, comme pour le déroulement des pratiques magiques, des veillées funéraires et
de la fuite des marrons : « Il est vrai que l’on retrouve partout chez les Antillais ce goût très
nocturne pour le mystère, l’occultation, la fomentation, le secret, la réclusion et parfois le
silence. Tout se passe comme si l’Antillais semblait résigné à se savoir condamné à l’autre côté
de la lumière : la nuit » (Affergan, 1983 : 22). On le voit par exemple quand Tituba qui, devant
l’impatience de Cohen d’Azevedo de voir les esprits de ses enfants, doit attendre la tombée du
jour pour son rituel : « Étant donné l’impatience du malheureux père, nous n’attendîmes pas la
nuit. À peine le soleil s’était-il couché derrière les toits bleutés de Salem que nous nous
réunîmes dans le jardin aux pommiers » (Condé, 2004 : 209).
L’organisation des romans réalistes mystiques autour d’un lieu précis, les campagnes, et
d’une époque précise, le passé et le temps de l’esclavage, pourrait donc tenir de la stratégie
narrative des auteurs qui opteraient pour un monde sur lequel le folklore a un impact spécifique.
Il y aurait là un type de localisation qui, tout en préparant le terrain du réalisme mystique serait
propice à l’illustration de la notion ethnographique du folklore vivant ainsi que de
l’omniprésence des esprits dans l’imaginaire des milieux ruraux: « on entendait aussi des abois
de chiens libres se déchirant les restes d’un zombie égaré, des envols frénétiques de

351
soucougnans et de chauves-souris dans les arbres à pain, les pruniers de Cythère […] Procession
de chaînes, vacarme de cloches, hurlements des âmes en déveine… » (Pineau, 2004 : 62) ou
dans les forêts: « à un moment donné, l’homme par-devant fit signe d’arrêter et chuchota :
n’ayez pas peur, il y a des Puissances qui passent. Quelques instants plus tard, un roulement
sourd dévalait la montagne, suivi d’une traînée lumineuse qui contourna un piton rocheux,
tomba du côté de la mer, s’évanouit » (Schwarz-Bart, 1998 : 61). Si le réalisme mystique
implique, dans les romans, un contact étroit entre le monde réel et le monde « mystique » et
rappelle les principes de diverses croyances africaines dans lesquelles « the invisible world
presses hard upon the visible: one speaks of the other, and African peoples ‘see’ that invisible
universe when they look at, hear or feel the visible and tangible world » (Mbiti, 1969: 57). De ce
fait si, comme dans la pensée mythique traditionnelle, les manifestations du folklore ont lieu
essentiellement dans une nature isolée, nous pouvons donc en déduire que les profondeurs
naturelles des îles antillaises ont, dans les romans, une fonction essentielle. S’opposant aux
villes, ces lieux marqués par la colonisation et l’occidentalisation, les profondeurs de la nature –
dans lesquels se manifestent les esprits et le folklore et dans lequel s’aventurent un grand
nombre de personnages romanesques – ont un caractère primordial et originel et incarnent un
système traditionnel de pensée et de perception du monde. A la fois lieu de fuite, refuge
historique des marrons et lieu d’initiation symbolique pour de nombreux personnages, la nature
primordiale, intouchée par la technologie est également, et surtout chez Chamoiseau, un lieu de
souvenir, de survie des traces du passé. C’est un monde qui contient encore les seules traces des
populations amérindiennes comme, par exemple, sous la forme d’une pierre volcanique sculptée
sous laquelle le marron de L’Esclave vieil homme et le molosse devine: « des paroles
fondatrices, des gestes sacrés et des conjurations » (Chamoiseau, 2005a : 128). Point de
focalisation des manifestations du réalisme mystique, lieu où le surnaturel se manifeste encore

352
de façon « naturelle » en accord avec la pensée mythique traditionnelle, la nature antillaise
apparaît donc également comme un refuge de l’imaginaire.
2.2 Une Nature vivante et personnifiée
Aspect essentiel du développement d’une mythologie antillaise et du cheminement
identitaire des personnages, le paysage est, pour Glissant, un constituant de l’être et le décrire
comme simple décor ne suffira pas puisque qu’il fait partie d’un tout et qu’il peut être perçu
comme un personnage : « l’individu, la communauté, le pays sont indissociables dans l’épisode
constitutif de leur histoire. Le paysage est un personnage de cette histoire » (Glissant, 2002 :
343). Souvent personnifiée par les auteurs antillais, on remarque qu’en effet la nature est, dans
les romans réalismes mystiques, bien plus qu’un simple décor et se voit souvent attribué des
intentions et des sentiments. Constituée de « lianes mélancoliques » et « d’impudiques racines»
(Chamoiseau, 2005a : 98-99), les descriptions de la nature se présentent également sous forme
de personnifications localisées, généralement appliquées à certains éléments géographiques qui
semblent eux aussi avoir une vie propre. On le voit avec une racine qui, dans L’Esclave vieil
homme et le molosse, semble appartenir à un monstre de contes : « Je crois me trouver devant
une racine, mais la masse est régulière, mousseuse, sans la rugosité des séculaires écorces. Je ne
la sens pas inerte. J’ai peur. Croyant avoir affaire à un monstre des contes, Bête-à-sept-têtes ou
Dragon des peurs initiatiques » (Chamoiseau, 2005a : 125). On le voit également avec une
rivière, « j’ai entendu la Lézarde : elle criait […] une chanson chaotique et sauvage » (Glissant,
2003 : 29) et le vent, souvent décrit comme un animal agressif : « brusquement il s’est secoué. Il
s’est levé debout. Il s’est arc-bouté sur les gommiers, puis d’une seule enjambée il est descendu
dans la savane, renversant tout sur son passage. Il s’est précipité comme un enragé dans notre
maison en ouvrant brutalement portes et fenêtres » (Condé, 2005 : 191). Cette image est encore

353
plus forte avec les descriptions des cyclones qui, dans les romans dans lesquels ils se
manifestent, sont presque toujours personnifiés et prennent un caractère impitoyable et parfois
même démoniaque : « là-bas, sur l’Atlantique, venu des côtes d’Afrique, un cyclone piaffait
d’impatience, prêt à ravager le pays » (Confiant, 2004 : 167), « en 1928, le démon parla dans les
cieux, cracha, jura, frappa. Il avala un vent-fiel et par scélératesse, souffla son haleine délétère à
la face du peuple qui courbait l’échine ou bien gobait les mouches au mitan de l’arc Caraïbe »
(Pineau, 2001 : 123). Devant cette généralisation des personnifications associées aux îles
antillaises, on pourrait se demander s’il s’agit là d’un simple système stylistique de description
de l’environnement antillais ou si on pourrait y voir une véritable thématique antillaise.
Au-delà de ces personnifications, on observe que la nature possède également, d’un
roman à l’autre, une personnalité propre. Bien que parfois violente, la nature ne se confond
cependant pas avec les images violentes, dévorantes associées aux plantations et aux villes et
qui témoignent, comme toute action coloniale, d’un désir de possession, de domination et
d’appropriation. Si la nature est violente, cette violence sera plutôt associée à une forme de
chaos imprévisible s’opposant à l’ordre de la plantation : « Ruisseau devient torrent éperonné
par Maman Dlo, pluies de cendres deviennent trombes, après c’est furie, chiquetaille et
déchoukage » (Pépin, 2005 : 125). On retrouve ainsi, chez quelques auteurs, une lutte végétale
thématique et physique dans laquelle la nature et le monde moderne, l’en haut et l’en bas,
essaient de se conquérir mutuellement : « la maison du mort s’élevait un peu en dehors du
village, serrée par la forêt qui avait dû s’écarter de mauvaise grâce pendant quelques kilomètres
et qui se hâtait, vorace, de reconquérir le terrain perdu » (Condé, 2005 : 15). Plus que de simples
personnifications, certains auteurs vont jusqu’à faire de la nature un véritable lieu vivant, habité
par les esprits, qui vit, bouge, respire et semble posséder, une conscience et qui comme on peut
le voir dans Chair Piment, « Vous vous croyez seuls, mais la terre, l’eau et le vent ont des yeux

354
et des oreilles. Ils entendent et voient tout » (Pineau, 2004 : 358) ou dans Ti Jean l’Horizon :
« Après une longue course en forêt, où tous les arbres avaient des yeux pour le voir, des bras
pour le saisir […] » (Schwarz-Bart, 1998 : 161), nous ramène une fois encore à un système de
pensée traditionnelle.
2.3 De l’animisme traditionnel à l’universalité
Associant ce type de descriptions d’une Nature (englobant toutes les personnifications
locales) à une perspective réaliste mystique dans laquelle les mythes sont toujours vivants, nous
pourrions voir, dans la littérature antillaise, l’élaboration par certains auteurs d’une forme de
croyance traditionnelle de type animiste pour laquelle toutes les choses animées ou inanimées
ont une âme et que l’on retrouve dans la tradition africaine: « nature in the broadest sense of the
word is not an empty impersonal object or phenomenon: it is filled with religious significance.
Man gives life even where natural objects and phenomena have no biological life » (Mbiti,
1969: 56). En effet, dans certains romans de notre corpus, comme dans l’animisme traditionnel,
c’est tout un monde qui semble vivant, plein de présences et d’esprits cachés au creux du réel.
C’est un monde dans lequel « the forces of the universe, whether they work good or evil, are
ever at hand to be consulted in time of doubt, to be informed when crucial steps are to be taken,
and to be asked for help when protection or aid is needed » (Herskovits, 1959: 214) et dans
lequel un « objet tend à devenir signe, c’est-à-dire tentative de communication ou
d’avertissement, de l’invisible » (Suvélor, 1971 : 24). Plus qu’un effet réaliste mystique ou un
jeu de l’imaginaire, cette personnification de la nature, si elle n’est pas présente chez tous les
auteurs, propose cependant un lien important à la notion d’identité. En effet, donner à la nature
une âme et en faire un être vivant permettrait, hypothétiquement, de communiquer avec elle et
d’avoir, du point de vue de l’identité, une forme d’intimité avec elle. Par cette personnification

355
la terre antillaise vidée de ces mythes originels pourrait bien acquérir une âme propre avec
laquelle l’homme pourrait entretenir, lors de ses déplacements vers l’en haut, un rapport
spécifique, à la fois physique, spirituel et identitaire : « je m’efforçais d’entretenir un nouveau
dialogue avec l’eau des rivières ou le souffle du vent, afin de découvrir leurs secrets » (Condé,
2004 : 228). Ce rapport, mis en place par Maryse Condé et que l’on retrouve chez Chamoiseau,
aura ainsi pour but de permettre à l’homme antillais d’accepter cette terre natale comme sienne
et d’effectuer, en s’y plongeant, une renaissance identitaire aboutissant à l’acceptation de soi.
Dans Moi, Tituba…, Maryse Condé met également en place une représentation du
rapport magique à la nature que l’on ne retrouve dans aucun autre roman. Dépassant un rapport
d’intimité au lieu, son roman semble ainsi proposer la notion d’une force magique non plus
spécifiquement antillaise, mais universelle puisque Tituba retrouve toujours, même à Boston et à
Salem où elle se croit perdue, des éléments de la magie. Ne reposant plus son pouvoir sur sa
terre natale, elle parvient ainsi à adapter sa magie à sa terre d’exil : « dans ce pays inconnu et
inclément, qu’allais-je faire ? Je décidai d’user de subterfuges. Un érable dont le feuillage virait
au rouge fit office de fromager. Des feuilles de houx acérées et luisantes remplacèrent les herbes
de Guinée. […] Mes prières firent le reste » (Condé, 2004 : 76). Loin de sa Barbade natale, de sa
nature et donc de ses enclaves magiques, elle parvient à dépasser ses enseignements premiers et,
avec l’enseignement de Judah White, une sorcière locale, se met à voir certains aspects de la
nature américaine d’une manière différente et à transférer ses rituels à Boston et à Salem: « Je
rentrai à Boston réconfortée, ayant appris à voir des amis dans des bêtes auxquelles auparavant
je n’aurais jamais prêté attention : le chat au pelage noir, la chouette, la coccinelle et le merle
moqueur » (Condé, 2004 : 85). Elle réalise donc, lors de son expérience américaine, qu’il existe
un autre pouvoir, une vision plus universelle qui laisse deviner chez Condé un désir d’ouverture

356
de l’individu vers l’universel au lieu d’un recentrement sur soi, ce qui reste unique parmi les
romans de notre corpus.
2.4 La croisée des mondes et le refuge de l’homme antillais
Partagé entre un « en haut » et un « en bas », entre un ici réaliste et un ailleurs des
mythes et du folklore, l’espace caribéen n’est donc pas, nous l’avons vu, entièrement homogène
mais alterne entre un aspect sacré et mystique (se déroulant essentiellement dans le passé et dans
les profondeurs de la nature primordiale), et un aspect réaliste, profane et quotidien (celui des
villes, des plantations et de la France). Il semble y avoir ici un déséquilibre puisque, sous les
effets de la francisation, de la mondialisation et de la modernité, ce monde des mythes et du
folklore semble, d’après les romans, se réduire à un espace particulier et, plus encore, à une
temporalité spécifique (mais non unique). Si les cheminements souvent initiatiques révèlent des
personnages leur révèlent l’imbrication de plusieurs mondes, « Un autre monde. Un autre réel »
(Chamoiseau, 2005a : 59), dont ils n’avaient pas toujours conscience, ces lieux ne sont pas
toujours décrits comme paradisiaques. « Ni des lieux de promenade, ni des lieux de rêverie
comme pour le voyageur occidental au milieu d’espaces européens » (Curtius, 2006 : 236), les
lieux naturels sont donc, dans les romans, des lieux de souffrances et de nouvelles épreuves
initiatiques desquelles le marron doit, comme dans la course de l’esclave vieil
homme, triompher pour atteindre sa liberté: « les Grands-Bois étaient là […]. L’enveloppe
végétale se plaqua contre lui, élastique et suceuse. Il dut assurer avec ses coudes sanglants
l’espace de chaque pas » (Chamoiseau, 2005a : 60). Ce sont donc plutôt des lieux d’histoire, des
lieux de souffrance peuplés d’esprits : « toutes sortes d’histoires couraient sur le plateau en
ruine, et les gens se gardaient bien d’en approcher, le lieu demeurait comme protégé par un
cercle d’ombre, d’horreur secrète » (Schwarz-Bart, 1998 : 48). Cependant, malgré cet aspect

357
parfois négatif, ils permettent aux personnages de prendre compte des multiples dimensions du
monde antillais. On le voit, par exemple, avec l’expérience d’Hadriana qui, dans le roman
haïtien de René Depestre, lui permet de prendre connaissance, avec Patrick, de la réalité du
monde magique du vaudou et à Ti Jean de découvrir lui aussi la diversité du réel :
Laisse-moi te dire ceci : on t’a appris qu’il y a des bois derrière les bois, et c’est la vérité. Mais je
t’apprends qu’il y a aussi des bois à l’intérieur des bois. Ainsi, il y a plusieurs mondes dans cette pièce qui
nous entoure, et dans chacun de ces mondes attendent des forces prêtes à bondir, il suffit d’une simple
déchirure : c’est ce qui est arrivé avec la Bête, et c’est ce qui se produira tout à l’heure, quand tu gigoteras
comme un lapin éventré dans les ténèbres… (Schwarz-Bart, 1998 : 263)
Par cet aspect le monde antillais, tel qu’il est décrit dans les romans réalistes mystiques, n’est
donc pas un monde fermé, à l’image de l’île-prison que nous avons vue plus haut. Par les forces
qui s’y trouvent, en partie cachées dans les profondeurs de la nature, ce réel est décrit, dans les
romans, comme complexe et plein de profondeur. Tout n’est donc pas cloisonné et le monde
antillais, réaliste mystique, n’est pas limitée par la dualité des termes qui le définissent. Il a un
caractère indéfini plongé entre deux réalités qui se superposent et se complètent. Ainsi, si Man
Yaya parle aux esprits des morts, et si tout le monde la croit folle, il se trouve qu’ « en réalité,
elle avait à peine les pieds sur notre terre et vivait constamment dans leur compagnie, ayant
cultivé à l’extrême le don de communiquer avec les Invisibles » (Condé, 2004 : 21). Rien n’est
donc certain et tout peut arriver puisque le réalisme mystique ouvre le réel vers un autre monde
derrière sa façade réaliste :
Dans ce pays, où le soleil fond le bitume, où la pluie arrive à grand galop sans crier gare et s’arrête
brusquement comme par enchantement, où les arbres allaitent les esprits, où les hommes revêtent des
peaux de chien, où les chiens ont peur de la nuit, où les frères et les sœurs ont des couleurs d’arc-en-ciel,
où les quatre-chemins donnent à manger au diable, où Dieu oublie les nègres, où le rhum saoule les mares,
tout peut arriver. Et il arrive que les gendarmes du Lamentin emprisonnèrent un arbre. (Pépin, 2005 : 180)

358
Cette représentation coïncide aux descriptions que Carpentier donne de la Caraïbe et, en
particulier, d’Haïti, où le merveilleux est omniprésent, « I found the marvelous real at every
turn » (Carpentier, 1995a : 87) et inhérent aux réalités humaines et naturelles de l’espace et du
temps. Dans les romans antillais de notre corpus, ces lieux primordiaux sont donc comme des
alcôves dans lesquelles se faufile un autre monde qui, bien que réduit, est néanmoins « un
espace sacré, et par conséquent ‘fort’, significatif » (Eliade, 2004 : 25). En effet, l’image
récurrente de la fuite vers la nature antillaise pour y trouver refuge, par opposition au contrôle
de la nature associé aux colons, est un type d’opposition que l’on retrouve dans les écrits de
Fanon. Pour lui, le nègre et le blanc on un rapport différent au monde. Comme l’illustre par le
monde des plantations, des registres et de la possession par l’acte de renommer les lieux, «Le
Blanc veut le monde ; il le veut pour lui tout seul. [Il] l’asservit. Il s’établit entre le monde et lui
un rapport appropriatif » (Fanon, 1952, 103). Au contraire, comme nous l’avons aperçu et
comme nous allons le voir, le rapport de l’homme antillais cherche, dans de nombreux romans,
un rapport fusionnel, intime avec cette terre : « l’essence du monde était mon bien. Entre le
monde et moi s’établissait un rapport de co-existence. J’avais retrouvé l’Un primordial »
(Idem.). Outre les romans, Chamoiseau met en évidence dans ses essais ce rapport comme une
manière détournée d’échapper à l’organisation coloniale du monde, faite de routes, de chemins,
de villes et de villages. Il propose ainsi de suivre le chemin qui s’enfonce dans cet ailleurs au
cœur de l’île et d’ « Aller hors l’évidence » (Chamoiseau, 2002 : 138). Chez Chamoiseau
comme chez Fanon, c’est en effet dans la solitude des bois que l’on « accède aux suretés de soi-
même, densifié dans son Être, replié sur ses chairs et ses os, quêtant là une vérité stable »
(Chamoiseau, 2002 : 162). Le retour à cette nature, le contact intime avec la terre natale
seraient-ils donc un des moyens possibles pour les auteurs de produire un questionnement et
une redéfinition de la notion identitaire qui, entre une Afrique et une France mises à distance, se
retrouve d’un roman antillais à l’autre ?

359
3 L’Homme antillais, la Nature et la transcendance : un ultime espoir identitaire ?
3.1 Le lien physique à la nature et le cheminement initiatique
Il y a donc, dans certains romans réalistes mystiques, un lien spirituel à la nature qui
entraine un questionnement identitaire. On retrouve une autre forme lien identitaire, cette fois
entre les auteurs et la nature, par l’intermédiaire du style et d’écriture et de l’influence des
éléments de la nature antillaise dans le vocabulaire qu’ils utilisent. Au-delà de la
personnification que l’on vient de noter, on trouve en effet souvent, dans les romans un effet
inverse de naturification décrivant les personnages en rapport avec la nature qui les entoure. On
observe ce phénomène chez des auteurs plus réalistes comme Ina Césaire qui, dans Zonzon Tête
Carrée, décrit l’intelligence d’un enfant comme « engluée dans une mangrove de tabous »
(Césaire, 1994 : 26) et dans lequel la vie des femmes, « dénuée d’aspérités, s’élève aussi lisse
que le tronc d’un cocotier royal » (Césaire, 1994 : 61). Utilisant les spécificités de la nature
antillaise pour définir des cheveux « qui ne connaissaient plus la caresse du peigne, se dressaient
pareils à une mangrove » (Pineau, 2001 : 83) ou les habitants de la Bellem qui, dans La Lézarde
« avaient un air mystérieux et renfermé comme l’ombre de leurs bois » (Glissant, 2003 : 200),
les auteurs mettent en rapport et harmonisent le rapport entre les hommes, la nature antillaise et
le langage. Plutôt que de dépendre d’un vocabulaire et de métaphores occidentalisées, nous
voyons donc souvent dans les romans une appropriation de la nature antillaise et son utilisation
à des fins stylistiques ou politiques. Bref, il y a là une reconnaissance de cette terre qui nourrit,
cette fois sur le plan stylistique, l’imaginaire antillais.
Cependant, il arrive que les romans proposent, au-delà de l’effet du langage, un véritable
rapport physique de ses personnages avec la nature. On le voit par exemple dans le roman

360
d’André et Simone Schwarz-Bart, Un Plat de porc aux bananes vertes, dans lequel une feuille
de siguine tirée de sa valise permet à l’héroïne de retourner mentalement à son enfance en
Martinique qu’elle semble revivre physiquement: « Et les yeux fermés de plaisir, et de douleur,
je caressais aveuglement la feuille de siguine qui reposait, toujours vivante, sur la table ; et qui
me répondait, par instants, en émettant un léger crépitement électrique, comme venu d’une
substance magnétisante… » (Schwarz-Bart, 1967 : 60-61). D’autres, comme Ti Jean ou Tituba
se changent parfois – littéralement – en animaux afin de se mêler au monde naturel avec lequel
ils s’harmonisent : « elle m’apprit à me changer en oiseau sur la branche, en insecte dans l’herbe
sèche, en grenouille coassant dans la boue de la rivière Ormonde quand je voulais me délasser
de la forme que j’avais reçue à la naissance » (Condé. 2004 : 23). Cette harmonisation des
individus et de leur environnement est particulièrement intéressante car elle illustre, en quelque
sorte, le rapport physique que ceux-ci entretiennent avec cette nature dans laquelle ils semblent
parfois se fondre. Les représentations littéraires du rapport de l’homme Antillais à sa terre natale
sont donc, nous le voyons, relativement éloignées du rapport avec l’Afrique originelle qui est,
quant à elle, essentiellement fondée sur le fantasme et la mise à distance. Loin de tout sentiment
de rejet, la terre natale antillaise attire ainsi, parfois, les personnages comme une amante ou une
mère, « et puis une force étrange l’avait obligé à pénétrer plus avant, dans le mitan de cette
forêt. Les grands arbres l’attiraient » (Schwarz-Bart, 1998 : 74), et semble irrémédiablement lier
l’Antillais à sa terre natale et le pousser à une reconnaissance qui le rapproche de son éveil
identitaire.
Cette constatation expliquerait alors le thème, récurrent dans les romans, d’un
cheminement initiatique se déroulant non plus lors de la traversée de l’océan, mais dans la
traversée des mornes. Ainsi, dans Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant, on remarque que,
pourchassé par les chiens lors de l’ascension, Longoué est torturé par le vent soufflant dans ses

361
plaies. Cependant, tout en augmentant sa souffrance ce souffle sert également de nourriture
spirituelle à son corps meurtri pour en stimuler la résistance marronne :
Et il sentit le vent : non pas autour de lui ni sur tout le corps indistinctement, mais qui suivait comme une
rivière les sillons des coups de fouet. Comme si ce vent remontait un chemin à travers son dos, empruntant
toutes les goulées à la fois, chaque travée sanglante, chaque route ouverte dans sa peau. […] Ainsi le vent
s’établit comme l’invisible floraison de cette souche humaine ; et toute la nuit, la première, il allait monter,
flamber à partir de ce corps déchiré, avant de retomber brusquement dans la plaine pour recommencer son
ascension et sa victoire et à nouveau s’étaler jusqu’au bas de la pente. (Glissant, 1997a : 44-45)
Nature et personnages semblent donc fonctionner ensemble et dépendre l’un de l’autre pour
parfois atteindre une harmonie parfaite, un rapport direct. On retrouve en partie ce type de
description dans La Case du commandeur d’Édouard Glissant quand Cinna Chimène semble se
dissoudre dans la forêt dans laquelle elle s’enfuit, « le corps devenu peu à peu indivisible de
l’entrelacs de verdure où elle baignait » (Glissant, 1981 : 73), tout comme les Amérindiens
disparus qui, chez Chamoiseau, fusionnent par l’écriture avec cette nature qui contient les
dernières traces de leur civilisation : « Les Amérindiens des premiers temps se sont
transformés en lianes de douleurs qui étranglent les arbres et ruissellent sur les falaises, tel le
sang inapaisé de leur propre génocide » (Chamoiseau, 2005a : 21). Ce rapport avec la nature
peut parfois devenir intime, plus physique que métaphorique, comme Mira qui, dans La
Traversée de la mangrove, a un rapport presque sexuel aux éléments : « Je me glissais dans
l’eau qui pénétrait, brûlante de la chaleur du soleil de la journée, jusque dans les profondeurs de
mon corps. Je tressaillais sous cet attouchement brutal. Puis je m’asseyais sur la rive et je me
séchais avec le vent » (Condé, 2005 : 49). Cet aspect d’une symbiose avec la nature devient
ainsi une transcendance dans Moi, Tituba sorcière noire de Salem, quand après son exécution,
Tituba se confond littéralement avec son île : « Je me confonds avec elle. Pas un de ses sentiers
que je n’aie parcouru. Pas un de ses ruisseaux dans lequel je ne me sois baignée. Pas un de ses

362
mapoux sur les branches duquel je ne me sois balancée. Cette constante et extraordinaire
symbiose me venge de ma longue solitude dans les déserts d’Amérique » (Condé, 2004 : 271).
On le voit aussi avec Romule Beausoleil qui, dans Le Meurtre du Samedi-Gloria doit passer à
travers une initiation dans la campagne martiniquaise lors de son entraînement au damier. Cette
initiation lui fera vivre un rapport intime avec la terre et fera atteindre à Romule Beausoleil une
profonde harmonie avec lui-même, ses origines et sa terre natale:
Les fromagers et courbarils tutélaires qui l’entouraient semblèrent s’incliner très légèrement. Le vent se
mit à courir en tous sens dans leur feuillage. Puis, de manière distincte, il perçut le sourd martèlement venu
des entrailles de la terre qui lui avait tant de fois annoncé son initiateur. Romule ne bougea plus, cherchant
à mettre la chamade de son cœur à l’unisson de celle de l’univers. Cela se fit presque naturellement et il
en ressentit un profond bien-être. (Confiant, 2001 : 93)
C’est là une initiation qui fait de lui un véritable antillais, né de cette terre nouvelle : « il était
devenu homme-terre. Homme-tambour. Homme-langue » (Confiant, 1997 : 98). Pour prendre
un autre exemple, c’est aussi après son errance en forêt que le premier Longoué devient cette
« indéracinable présence » (Glissant, 1997a : 83) dans le roman de Glissant. Le lien de l’homme
à l’île natale semble donc s’illustrer dans un certain nombre de romans par un lien essentiel avec
la forêt, qui serait, dans le monde antillais, au cœur de tout cycle, de tout début et de toute fin si
bien que, comme l’écrit Maryse Condé dans Les Derniers Rois mages : « La forêt ! Tout
commence par là ! Tout finit par là ! » (Condé, 2000 : 251). Le cheminement des personnages
au cours de leur vie se terminant généralement par un enterrement, il y a donc toujours un retour
physique à la terre antillaise. Si cette notion d’initiation et souffrance est importante, elle est
cependant complétée par le stade matriciel qui, comme dans l’avalement de Ti Jean dans le
ventre de la Bête avaleuse de soleil, permet également de renforcer ce lien à la terre natale.

363
3.2 L’eau et le retour matriciel à la Nature
Nous avons vu dans notre septième chapitre que l’élément aquatique et en particulier
l’océan de la traversée sont, dans les romans antillais, liés à l’idée de matrice et de renaissance
négative dans les chaînes de l’esclavage. Au-delà de ce premier mythe d’origine, on peut
remarquer que certains romans antillais de notre corpus proposent l’ébauche d’une autre
représentation matricielle associée à une forme de renaissance bien plus positive. On le voit par
exemple avec le bain où « flottaient des racines fétides» (Condé, 2004 : 21) dans lequel Tituba
est plongée par Man Yaya ou encore le bain démarré dans lequel, une fois à Boston, Tituba
plonge la jeune Betsey pour la guérir. Contrairement au navire négrier et à la notion initiatique
du gouffre, ce rituel représente une plongée amniotique issue d’un type de pensée traditionnelle
associant le milieu matriciel et amniotique à un retour aux origines du monde. Ainsi, dans le
roman de Maryse Condé, ce rituel s’associe à une expérience particulière qui projette celui qui
la vit en ces temps primordiaux :
Je lui fis jurer le secret et, à la tombée de la nuit, je la plongeai jusqu’au cou dans un liquide auquel j’avais
donné toutes les propriétés du liquide amniotique. […] Plongeant Betsey dans ce bain brûlant, il me
semblait que les mêmes mains qui avaient donné la mort peu de temps auparavant, donnaient la vie et que
je me lavais du meurtre de mon enfant. (Condé, 2004 : 102)
Cette expérience de guérison prend, dans le roman, une tonalité mythique puisque, comme
l’indique Mircea Eliade, ce type d’immersion rituelle est un procédé répandu:
Pour lui redonner la santé, on refait en présence du malade le processus du monde, on réactualise
l’émersion des premiers humains au sein de la Terre. C’est parce qu’on rend présente et active cette
anthropogonie […] que le malade retrouve la santé : il éprouve dans son être intime le processus
primordial de l’émersion. En d’autres termes, il redevient contemporain de la cosmogonie et de
l’anthropogonie. (Eliade, 2001a : 200).

364
Si l’on en croit Eliade, tout rituel d’immersion produit le sentiment d’avoir été enfanté par la
Terre. Cette notion renforce un sentiment d’autochtonie qui s’interprète comme la sensation
d’être « des gens du lieu » (Eliade, 2001a : 203). Si tous les romans de notre corpus n’illustrent
pas une immersion de ce type, ceux qui le font la situeront au cœur même de la nature qui,
perçue comme un refuge, prend également la valeur matricielle d’un « ventre-manman »
(Chamoiseau, 2005a : 105). On trouve une expérience de ce type dans La Traversée de la
Mangrove de Maryse Condé, dans lequel Mira se retrouve dans une ravine au cœur de laquelle
se trouve une source aux propriétés quasi amniotiques : « Je n’ai jamais oublié cette première
rencontre avec l’eau, ce chant délié, à peine audible, et l’odeur de l’humus en décomposition.
[…] J’avais retrouvé le lit maternel » (Condé, 2005 : 52). Cette image de ventre et de matrice est
également présente dans La Case du commandeur d’Édouard Glissant : «Cinna Chimène
disparut […]. Elle plongea (comme par appel des fonds et des tressaillements de la mer […]) au
ventre inviolé de la forêt […] » (Glissant, 1981 : 72). Ainsi, nous pourrions voir dans ces
expériences décrites dans les romans un autre type de schéma mythique qui, par un retour aux
origines matricielles de la terre antillaise, apparaît comme essentielles par rapport à la notion
d’identité. En effet, par cette plongée et ce retour, ce type d’expérience vécue par les
personnages apparaît comme une forme de solidarité mystique et familiale avec la terre natale :
« or, ce souvenir obscur d’une pré-existence dans le sein de la Terre a eu des conséquences
considérables : il a créé, chez l’homme, un sentiment de parenté cosmique avec son milieu
environnant […] » (Eliade, 2001a : 204). Cette parenté trouvée au cœur de la nature primordiale
qui, comme une matrice antique, est directement reliée au passé sera nécessaire aux personnages
en quête d’eux-mêmes. On pourrait ainsi rapprocher cette plongée symbolique vers une « pré-
existence » de l’expérience de Ti Jean qui, symboliquement avalé par la Bête, finit par prendre
conscience de sa propre identité liée à sa terre natale, la Guadeloupe. Le vieux marron de
L’Esclave vieil homme et le Molosse vit également une expérience de ce type lors de sa chute et

365
de son immersion accidentelle dans une source d’eau primordiale à demi ensevelie : « il eut un
sourire : mourir dans l’entraille vive d’une source plus vieille que lui » (Chamoiseau, 2005a :
86). Si l’eau lui rappelle d’abord l’inévitable bateau négrier et l’image primordiale de l’océan de
douleur, l’homme finit cependant par ressentir un rapport cosmique, profondément identitaire
avec la terre antillaise:
Il était tombé dans une de ces vieilles sources qui nourrissaient les bois profonds. Noyade. Une eau glacée-
glacée. Il retrouva les cauchemars des cales négrières. Les abysses. La mer sans vent. Le sel. Les vagues.
Grand-gueule des squales. L’eau. L’eau. Il allait se noyer au profond d’une source. Il en percevait l’intense
vitalité. Elle provenait de loin […] Elle se souvenait des fossiles marins, d’alluvions stellaires. Elle
partageait les connivences des volcans et des plages, les mélopées du ciel murmurées par les pluies, la
poésie des îles dans l’événement d’un temps grandiose. (Chamoiseau, 2005a : 85)
Ce lien, presque charnel, de parenté à la terre maternelle et nourricière est si important qu’il est
d’ailleurs matérialisé par certains rituels antillais spécifiques, hérités des traditions africaines,
souvent décrits dans les romans. Il s’agit, par exemple, du rite du cordon ombilical ou du
placenta qui, enterré sous un arbre à la naissance, lie personnages à la terre qui les a vus naître.
Ce lien intime, initié dès la naissance – comme avec Tituba dont le placenta est enterré sous un
fromager – se perpétue dans la mort, comme on le voit dans Chair Piment, dans lequel l’esprit
de Rosalia, de retour en Guadeloupe, retourne à ce point de contact identitaire: « à la mi-
décembre, Rosalia grimpa sur le morne calvaire et, lasse de driver sur les routes, coucha son
corps au pied de l’arbre du voyageur, là même où Melchior avait enterré les morceaux de son
cordon ombilical » (Pineau, 2004 : 221). Ainsi, si la plupart des personnages des romans de
notre corpus ne se souviennent pas de l’Afrique, de leurs origines historiques, si certains
rejettent ou ne matérialisent celle-ci que par le fantasme et le rêve, beaucoup d’entre eux ont un
lien essentiel, spirituel avec la terre natale. Des quimboiseurs qui perdent leur pouvoir en France
et de Ti jean qui se sent perdu en Afrique, en passant par Spéro qui, dans Les Derniers Rois

366
mages, n’est plus capable de peindre depuis son départ, avec Félicie dans Un Papillon dans la
Cité ou encore Tituba dans Moi, Tituba… nécessaire » (Condé, 2004 : 61), il y a dans certains
romans un lien essentiel, presque physique, qui relie l’individu antillais à sa terre natale, au
monde naturel et aux enclaves réalistes mystiques des forêts primordiales. Ces lieux, devenant
des lieux de régression utérine (regressus ad uterum) positifs, rejoignent, comme l’image la cale
des navires négriers, une tradition universelle, tout à la fois littéraire, mythique et culturelle. De
ce fait, si la traversée de l’océan préfigurait une nouvelle origine mythique, négative et la
naissance à l’état d’esclave, la plongée dans la nature primordiale aura pour résultat une
renaissance plus positive et une acceptation de l’origine. Cependant, si certains auteurs ont
mentionné ce rapport matriciel et cette plongée dans une nature primordiale vers une
renaissance, nul auteur n’a aussi bien travaillé ce principe de transcendance et de métamorphose
que Patrick Chamoiseau, dans son roman L’Esclave vieil homme et le molosse, dans lequel le
cheminement initiatique d’un vieil homme sans histoires devenu marron prend l’apparence
d’une quête initiatique faisant du roman un récit exemplaire, fondateur, explorant les possibilités
d’un renouveau spirituel et identitaire au sein de la nature primitive.
3.3 Patrick Chamoiseau et l’écriture de la quête identitaire
Le roman L’Esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau – composé non
pas de chapitres mais de « cadences », « Matière », « Vivant », « La pierre », « Les os »,
« Eaux », « Lunaire » et « Solaire ») illustrant le cheminement traditionnel et mythique
mort/renaissance de son personnage – débute par un personnage qui porte un nom « octroyé par
le Maître » et le vrai nom est « devenu inutile » (Chamoiseau, 2005a : 22). Par bien des aspects
il est un archétype de l’esclave sans volonté, dépersonnalisé et soumis qui, comme dans l’idéal
du Code Noir, a fini par devenir un objet se confondant avec les machines avec lesquelles il

367
travaille : « le regard attentif du Maître ne le distingue pas du bloc des machines » (Ibid. : 23).
Contre toute attente, poussé par un instinct qui le dépasse, il décide un jour non pas de
marronner mais de quitter la plantation alors que son existence toute entière semble morte, prise
au piège du système esclavagiste : « Il décide donc de s’en aller, non pas de marronner, mais
d’aller. […] Il n’a aucune rumination, aucun œil torve en direction des bois. […] Il se sait prêt.
Il ne sait pas à quoi » (Ibid. : 54). Ce n’est pas une fuite donc, chez ce personnage, mais le
départ d’un cheminement qui se fera par étapes depuis les « bas-bois » (Ibid. : 59) jusqu’aux
« Grand-bois » (Ibid. : 63) riches en histoires et en rumeurs, décrits comme un lieu mythique et
sacré : « le vieil homme se sent pénétrer dans la caverne des âges. Personne ne semble avoir
jamais foulé ces lieux. Cette impression d’investir un sanctuaire se fait enivrante » (Ibid. : 72).
L’esclave vieil homme suit ainsi lui aussi un schéma initiatique fait de montées et de descentes,
passant d’abord vers ce qui semble être les profondeurs de la terre, « […] il eut l’impression de
descendre sans fin, d’atteindre même le fondoc de la terre » (Ibid. : 60), jusqu’à un lieu lié à
l’élément aquatique et matriciel, « l’eau, invisible, dégoulina en douche de certaines grandes
feuilles » (Ibid. : 61) où il subit une perte des repères rappelant la cale du navire négrier, « ce
n’était plus l’absence de repères du début, mais une désorientation profonde » (Idem.), ainsi
qu’un engloutissement dans les profondeurs de la nature jusqu’à une « noirceur primordiale »
(Ibid. : 71), matricielle, dans laquelle le vieil homme va d’abord subir un changement physique
symbolique avant de se confronter aux images de son passé et des ses origines ancestrales par
une série d’hallucinations.
Le vieil homme étant lui-même, au début, comparé à un « minéral indestructible »
(Ibid. : 18) (qui nous rappelle les « miettes humaines devenues minérales » [Chamoiseau, 2002 :
129] associées aux Amérindiens dans Écrire en pays dominé), tout le roman suivra son
cheminement qui, de minéral, soumis et apathique, lui permettra de devenir un individu, une

368
conscience unique. S’il est un minéral avant sa mort, le vieil homme n’a donc pas suivi une
évolution normale puisque la minéralisation, associée chez Chamoiseau aux ossements, devrait
être le dernier stade de l’existence. Ce n’est donc pas un hasard si, au début de cette initiation, le
vieux marron perd cette particularité et se sent disparaître, devenir cendre :
Sa peau devint sensible aux souffles âcres des vents abîmés sous les feuilles, au moelleux des rosées qui
s’accrochèrent à lui, bienheureuses d’être visitées après siècles-temps de solitude. Sa peau devint poreuse,
puis elle devint poudreuse, puis elle dut s’en aller car il crut se défaire en une effervescence au mitan de
laquelle ses os seulement le soutenaient. (Chamoiseau, 2005a : 62).
Ce passage nous rappelle également le memento mori « tu es poussière et tu retourneras à la
poussière » de la Genèse (13 :19) qui est au cœur de nombreuses croyances traditionnelles et qui
nous ramène, comme dans la Bible, à la création de l’Homme. Ainsi, si la poussière est le degré
premier de la matière avant que celle-ci ne prenne corps dans le souffle de vie, les cendres en
figurent l’étape ultime. C’est ainsi que le vieil homme passe par ce stade d’anté-existence, en
devenant poudre jusqu’à ce qu’il se fasse imprégner par une eau matricielle avec laquelle il se
confond: « lui eut le sentiment d’être devenu une eau dans l’eau des feuilles patientes » (Ibid. :
63). Si l’expérience de la noirceur et de la perte de repères rappelle la mort, il y a cependant
également, en ce lieu, un « appel de vie » (Ibid. : 73), une force primale qui se manifeste à
travers une voix antique qui, selon le vieil homme, pourrait être celle des « conteurs connus
durant son esclavage » (Ibid. : 74). Multiple, cette voix est plus qu’humaine : « elle est humaine
humaine humaine. Virile et maternelle » (Idem.). Elle a un aspect universel, presque divin, qui
provoque chez lui des hallucinations et le début de son initiation : « les hallucinations refluent
sous cette force, souveraine telle une voix primale en quelque terre biblique» (Idem.).
À la manière de Ti Jean, qui s’est physiquement déplacé jusqu’à une Afrique ancestrale
par l’intermédiaire de la Bête, l’esclave vieil homme semble spirituellement remonter le temps à

369
travers une série d’hallucinations, depuis sa terre natale et son folklore jusqu’aux origines
mythiques du monde. Il voit ainsi, par exemple, des esprits antillais, « des zombis à tête
d’arbre », « de bons-anges égarés » et « la Bête à Man Ibé » (Ibid. : 75) avant que ses visions ne
le conduisent jusqu’à la « rive oubliée, familière, chargée d’un remugle de savane » (Idem.)
d’une Afrique originelle où il perçoit les rites et les traditions d’« un antan de l’enfance dans des
chants très anciens » (Idem.). Descendant plus profondément encore dans ses origines, il a des
visions de mythes originels expliquant, par l’intervention d’animaux, les origines du fuseau et
du tissage. C’est ainsi qu’il « voit l’oiseau qui offrit le coton, le poisson qui donna le fuseau, et
l’araignée qui confia le tissage » (Ibid. : 76), avant de rejoindre le temps sacré des origines
mêmes du monde : « Il voit le couple androgyne sur le berceau du monde. Il voit des formes
plénières, sculptées dans le grand-noir des mythes, prises dans un temps total, patinées de
matières tombées des sacrifices » (Idem.). Cependant, le cheminement initiatique du vieil
homme vers les origines ne se termine pas, comme il le devrait, par un dépassement de l’être et
sa transformation. En effet, par un jeu temporel surprenant, ses visions le conduisent jusqu’à une
période historique plus récente, celle de l’esclavage, qui dissipe les autres hallucinations.
Comme une marque inconsciente, ancrée plus profondément encore dans l’âme du vieil homme
que ses origines ancestrales, l’image des os et des chaînes englouties dans les profondeurs de
l’océan, semblent la dernière limite de sa régression symbolique, l’obstacle à sa véritable
libération/transformation : « il se voit […] alourdi par des chaînes, et traînant aux en-bas de la
plus sombre des mers. Il se voit dans une poussière d’os se transformant en algues et en rouillure
d’anneaux » (Idem.). Incapable de faire face à cette image du passé, incapable de la dépasser, il
se réveille, « terrassé » (Ibid. : 77). Mais pourquoi une telle image ? Pourquoi revenir à
l’esclavage après un retour à l’Afrique et aux origines mythiques du monde ? Si l’on pourrait ici
voir une forme de blocage psychique auquel l’esclave vieil homme doit faire face, nous
pourrions aussi y voir, comme nous l’avons vu dans le chapitre 7 de cette étude, une redéfinition

370
de l’origine par Patrick Chamoiseau. Illustrant le rejet de l’Afrique comme origine, le vieil
homme aurait alors découvert, lors de ses hallucinations, que sa véritable origine identitaire ne
se trouve non plus dans l’Afrique de son passé et dans ses mythes de créations mais dans
l’acceptation d’un temps historique plus récent, celui de la traversée de l’océan et sa condition
d’esclave. Ce n’est donc pas un hasard si à cette instant précis, le vieil homme tombe finalement
dans l’eau ancestrale d’un « manman-trou » (Ibid. : 85), un utérus symbolique, qui l’engloutit et
qui, comme nous l’avons vu dans d’autres romans, prend une importance spirituelle et
identitaire essentielle. En effet, il n’y a ici aucun engloutissement dans la mort, ni naissance
dans l’esclavage puisque la plongée du vieil homme dans l’élément liquide, tout en étant
intensément spirituelle, n’en demeure pas moins profondément animiste. Cette eau matricielle
dans laquelle il se retrouve est un élément crucial de son développement et de son contact avec
la terre natale. Retrouvant d’abord « les cauchemars des cales négrières » (Ibid. : 85), il dépasse
cependant cette impression première pour percevoir la vitalité de cette source naturelle qui,
personnifiée, a une connaissance intime de la terre qu’elle traverse :
Elle partageait les connivences des volcans et des plages, les mélopées du ciel murmurées par les pluies, la
poésie des îles dans l’événement d’un temps grandiose. Des affaissements l’avaient déviée, et des failles
erratiques l’avaient projetée (pour vingt-deux mille ans) dans des évasions sombres (Idem.)
Touché par cette eau, l’esclave vieil homme se sent « envahi de pureté » (Ibid. : 86) et dans un
transfert de noirceur entre sa peau et une eau devenue noire, il se voit renaître enfin,
symboliquement, douloureusement, dans un hurlement de nouveau né : « il bondit, corps en arc,
lancé. Hurlant au déchiré » (Chamoiseau, 2005a : 87). Cependant, nous le voyons, cette
renaissance ne se fait pas, comme dans la traversée dans le navire négrier, par l’action des
hommes, il n’y a pas ici d’Afrique, de navire ou de terre imposée mais une renaissance qui se
fait au contact de la terre antillaise, d’une source-matrice de laquelle l’homme s’extirpe tout

371
seul. Une fois sorti, on note que son regard est le premier aspect de son être à subir une
métamorphose. En effet, pour la première fois dans le roman, la troisième personne du singulier
qui était associée au vieil homme, devient un « je » alors qu’il peut enfin regarder cette nature
qui l’a fait naître non pas comme un lieu de fuite hostile, mais un lieu serein et accueillant : « Je.
Les lianes allaient chercher le sol pour s’emmêler encore, tenter souche, bourgeonner. Je pus
lever les yeux et voir ces arbres qui m’avaient paru si effrayants dans leurs grands-robes
nocturnes. Je pus les contempler enfin » (Ibid. : 89). De cette focalisation nouvelle l’homme se
met à observer les plantes et les arbres et à les faire symboliquement siens en les reconnaissant
par leurs noms avant de créer un lien fusionnel, charnel avec cette terre en se nourrissant d’elle
comme du lait d’une mère :
Mes mains exhaussaient des poignées de terre noire avec lesquelles je me frottais le corps […] je mangeai
de la terre. Elle se dissipait chaude contre ma langue avec un bouquet de caverne et de sel. La terre me
conféra un sentiment de puissance bien au-delà de la vie et de la mort. Et la terre m’initia aux invariances
dont je percevais l’auguste pérennité. (Ibid. : 91)
Il n’est donc pas surprenant qu’à partir de ce moment il décide de ne plus fuir devant le molosse,
mais de se battre contre cette « Innommable » (Ibid. : 96) incarnation de la violence de
l’esclavage. C’est aussi à partir de ce moment qu’un désir de se fondre à la terre pour des
raisons pratiques (la fuite) devient un désir de fusion : « j’avais envie d’y disparaître. De
m’enterrer aussi. J’enviais ces racines qui pénétraient dans le sol, loin » (Ibid. : 121). Cependant,
pour Chamoiseau, le lien à la terre antillaise ne peut s’arrêter là.
Si l’esclave vieil homme a contemplé son propre passé et s’il est mort symboliquement
pour renaître au cœur de cette terre qui lui est désormais natale, il ne peut la faire entièrement
sienne sans avoir contemplé son passé à elle, ses origines ancestrales qui, quasiment effacées par
la colonisation, subsistent sous forme de traces comme la pierre amérindienne, cette « Pierre qui

372
rêve » (Ibid. : 126) que le vieil homme retrouve au bout de sa course et qui « Froide. Tiède.
Vibrante au lointain de son cœur […] une pierre vivante » (Chamoiseau, 2005a : 126) témoigne
en effet du passé de l’île et des civilisations qui s’y sont succédées. Imprégnée de souvenirs
africains, coloniaux et amérindiens qui prennent vie au contact du vieil homme auquel, la pierre
lui fait ainsi revivre – alors qu’il la tient dans ses bras – une série d’expériences vécues par l’île
et les peuples qui s’y sont succédé. Cette pierre devient ainsi un vecteur du savoir et d’une
forme de connaissance instinctive diffusée par la terre natale et le point de focalisation d’une
expérience essentielle. Si l’on retrouve des pierres amérindiennes dans d’autres romans, elles
illustrent cependant, chez Chamoiseau, deux aspects essentiels de sa pensée: la trace, qui est une
marque concrète, et les mémoires, qui émanent d’elle. L’expérience du vieil homme est ainsi
une manifestation forte de cette association :
Leurs associations, Traces-mémoires, ne font pas monument, ni ne cristallisent une mémoire unique :elles
sont jeu des mémoires qui se sont emmêlées. Elles ne relèvent pas de la geste coloniale mais des
déflagrations qui en ont résulté. Leurs significations demeurent évolutives, non-figées-univoques comme
celles des monuments. Elles me font entendre-voir-toucher-imaginer l’emmêlé des histoires qui ont tissé
ma terre. (Chamoiseau, 2002 : 130-131)
Pour Chamoiseau, il y a donc des histoires au-delà de l’Histoire, et des expériences dépassant
les monuments de la période coloniale. En illustrant cette notion par la rencontre du vieil esclave
et de la pierre, Chamoiseau met donc en place une forme d’expérience du sacré puisque, comme
nous le dit Eliade, « En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans
cesser d’être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant »
(Eliade, 2004 : 18). L’expérience du vieil homme relèverait donc du sacré puisque la pierre perd
son statut d’objet sculpté pour devenir une trace permettant de revivre l’histoire de l’île :

373
La Pierre rêve. Elle m’engoue de ses rêves. Je me serre contre elle, la main avide. Mon esprit abandonne
ses marques. Il est possible que je lui parle, que moi je parle à une pierre. Ou rêve avec elle. Oui, nos rêves
s’entremêlent, une nouée de mers, de savanes, de Grandes-terres et d’îles, d’attentats et de guerres, de
cales sombres et d’errances migrantes sur cent mille fois mille ans. Une jonction d’exils et de dieux,
d’échecs et de conquêtes, de sujétions et de morts. Tout cela. Grandiose hélée, tourbillonne dans un
mouvement de vie – vie en vie sur cette terre. La Terre. Nous sommes toute la terre. (Chamoiseau, 2005a :
127-128)
Dépassant le temps présent de l’expérience, le vieil homme est donc projeté dans un temps
indéterminé et qui, par son caractère cyclique de retour, rappelle les temps et les lieux
mythiques des origines africaines qui se manifestent par l’intermédiaire de « la savane » et les
« attentats et guerres », qui nous rappelle également l’expérience transatlantique avec les
« mers » et les « cales sombres » et la souffrance antillaise avec les « îles » et les « errances
migrantes » qui sont ici présentées sans ordre chronologique. Ainsi, au cœur de cette nature
primordiale, loin de toute marque de civilisation autre que cette pierre d’un peuple disparu,
l’homme semble littéralement prendre contact avec une somme de savoirs et d’histoires et avec
l’origine des îles antillaises. De façon symbolique, il se rend compte que tout ce qui naît, tout ce
qui vit sur la terre antillaise fait partie d’elle. Dépassant le stade du temps profane pour entrer
dans un temps mythique et sacré (hors de l’Histoire coloniale symbolisée, dans le roman, par les
plantations et le domaine de l’habitation), il y aurait donc, dans cette représentation de la pierre,
la mise en place par Chamoiseau d’une hiérophanie par laquelle la pierre devient une
manifestation du sacré et par laquelle l’homme transcende sa propre nature pour se voir lui
même investi, transcendé, par cette histoire qui le pénètre qui et se manifeste à travers lui : « le
monstre n’en crut pas ses yeux. Sa proie était mêlée à une pierre où grouillait une myriade de
peuples, de voix, de souffrances, de clameurs. Des peuples inconnus célébrant un éveil. L’être
semblait une foudre qui traversait la pierre. Une énergie qui ne rayonnait pas » (Chamoiseau,

374
2005a : 136). Au bout de sa course, aux portes de la mort, l’esclave vieil homme ayant
reconstruit des liens avec lui-même, ses origines et la terre, il peut donc entrer dans un temps et
un espace qui ne sont pas ceux de l’esclavage et du colonisateur mais dans un espace mythique
et naturel, tout simplement antillais qui, avant son initiation, ne lui appartenait pas et auquel il
n’appartenait pas. Par sa mort et sa minéralisation en os, le vieil homme rejoint ainsi les
ossements des esclaves qui, au creux de l’océan, se confondent à la rouille des chaînes et finit
lui aussi par intégrer, comme la pierre amérindienne, la mémoire identitaire de l’île :
Mes os. Que diront-ils de moi ? Comme ces peuples réfugiés dans une pierre, je vais aboutir à quelques os
perdus au fond de ces Grands-bois. Je les vois déjà, ces os, architecture de mon esprit, matière de mes
naissances et de mes morts. Certains feront poussière, d’autres roches. (Chamoiseau, 2005a : 135-136)
En activant la mémoire de l’île au contact de la pierre et en activant la mémoire d’un peuple par
l’écriture, on peut imaginer que le roman de Chamoiseau fait de ce vieil homme le symbole de
tout un peuple. Vivant ainsi dans la mémoire, se perpétuant par la lecture, il continue, comme
les esprits africains dans le sasa, de vivre dans un temps éternel dans une terre qui est sienne.
La dimension spatiale est donc, dans les romans antillais, primordiale car elle permet de
rendre compte à la fois de l’histoire et de la société mais aussi, par le mythe, de prendre
possession de son territoire, donc, de sa terre natale : « L’identité se gagnera quand les
communautés auront tenté par le mythe ou la parole révélée, de légitimer leur droit à cette
possession d’un territoire » (Glissant, 1990 : 25). Partis, nous l’avons vu dans notre
introduction, d’une terre sans mythes et vide de toute spiritualité originelle, les auteurs antillais
ont donc contribué, par l’écriture de leurs romans, à un renouveau identitaire de leur terre natale.
Cette terre, dans laquelle certains personnages en quête d’eux-mêmes doivent se plonger afin
d’évoluer, propose ainsi, comme une des solutions à l’acculturation, de faire face au passé
ancestral amérindien et d’accepter une fois pour toute cette terre comme terre natale. Elle

375
permet également à des auteurs comme Patrick Chamoiseau de mettre en place dans leurs
romans de véritables mythes initiatiques de renaissance identitaire permettant à des personnages
de symboliquement atteindre ce qui, pour les Créolistes, serait un véritable sentiment
d’autochtonie : une acceptation de l’île antillaise comme terre natale et identitaire.
Conclusion de la troisième partie
Occuper son espace, physiquement, spirituellement et mythiquement est donc essentiel
dans la culture et la littérature antillaises, puisque ceci signifie un changement de statut vis-à-vis
de la terre. Ainsi, si l’Afrique a été mise à distance, si la France n’est pas idéale et si l’île
Antillaise elle-même résonne encore des souffrances du passé et d’une reconnaissance difficile,
les écrivains tentent cependant, dans leurs romans, d’ancrer leur identité dans la géographie
antillaise natale. Dépassant le simple jeu des personnifications, la nature n’est plus seulement un
décor ou un instrument poétique. Refuge des esprits, des marrons en révolte devant l’esclavage,
des quimboiseurs se tenant à l’écart des acculturations d’un monde envahi par les plantations et
les villes, elle est un continent spirituel dans lequel la pratique magique peut encore se produire
et dans lequel l’homme peut, s’il le désire, plonger aux sources de son identité par l’acceptation
du lien à la terre natale : « La Terre. Nous sommes la Terre » (Chamoiseau, 2005a : 128).
Reprenant possession et recréant, par l’imaginaire de leurs romans, un milieu que possédaient la
France et ses représentants, les auteurs antillais contemporains, en particulier du mouvement de
la créolité, tentent ainsi de proposer une solution contemporaine à la question de l’identité. Le
fait d’ « être antillais » serait ainsi, en partie, un sentiment né du contact avec la terre natale, ses
mythes et sa spiritualité qui, dans le monde contemporain, ont du mal à lutter et semblent
principalement survivre à l’état originel dans la nature primordiale.

376
Conclusion
Le réalisme mystique et la notion de communauté
Le réalisme mystique antillais : de la spécificité antillaise au renouveau identitaire
Spécificité de la littérature des îles antillaises, le réalisme mystique introduit, dans le
domaine du magical realism, une distinction qui permet aux auteurs antillais non seulement
d’affirmer leur présence dans la critique contemporaine mais aussi de devenir une sorte
d’«exception culturelle» (Scheel, 2005 : 12). Ethnographiques et historiques, dépassant les écrits
originels d’Alejo Carpentier et de Jacques Stephen Alexis, leurs romans s’abreuvent de
mouvements littéraires contemporains comme l’Antillanité ou la Créolité. Imprégnés par la
pensée mythique traditionnelle et sa « rationalité » particulière, ils rendent également caduc le
terme merveilleux, qui ne serait plus qu’un terme occidental appliqué à une perception
caribéenne du monde. Opposant une forme de contre-discours littéraire face à un
postmodernisme clamant la mort du roman, ces auteurs « guerriers de l’imaginaire » prennent
ainsi le relais des conteurs d’antan et de leur rébellion par l’oralité. Malgré l’affirmation d’une
impuissance à maintenir l’expression orale traditionnelle, les auteurs antillais comme Patrick
Chamoiseau ou Raphaël Confiant défient cependant les visions doudouistes des Antilles de
même que les forces acculturatrices françaises, en mêlant oralité et écrit dans leurs romans.
Réaffirmant ainsi une certaine continuité de l’oralité traditionnelle par une forme de marronnage
artistique, ils s’affranchissent en partie des règles du roman. Plus qu’une simple dualité entre
« langue des mythes » et « langue du roman », le réalisme mystique est donc un passage vers un

377
système original et singulièrement antillais dans lequel l’auteur devient protecteur de traditions
et initiateur de nouvelles entreprises littéraires qui lui permettront de se trouver une liberté
identitaire et artistique par la résistance aux influences acculturatrices. Plus que la simple
retranscriptions d’une parole, l’écriture des auteurs antillais semble permettre une forme de
transcendance qui, par la (re)création de mythes des origines, restructure l’imaginaire et
conditionne l’être.
Contrairement à nos constatations initiales, les romans réalistes mystiques antillais ne
sont pas, malgré la rupture originelle et les acculturations, vides de mythes originels. Au
contraire, il apparaît que les auteurs caribéens contemporains proposent, dans leurs œuvres, une
reconstruction mythique de la notion d’origine par une remise en question du rapport à la France
et à l’Afrique et une acceptation graduelle du rapport à la terre natale, pourtant associée à la
souffrance de l’esclavage. Restructurant l’imaginaire de leur littérature par une mythisation de
plusieurs espaces antillais – l’océan de la traversée, l’espace de la plantation, le monde des
morts et les forêts primordiales –les auteurs ont ainsi mis en place dans leurs romans un nouveau
mythe originel mettant en scène, comme origine de leur monde l’arrivée des esclaves dans un
navire matrice et l’acquisition du statut d’esclave. Pris entre une Afrique avec laquelle ils n’ont
plus de rapport et une France en laquelle ils ont du mal à se reconnaître, sur une île où le
souvenir de la rupture initiale affleure, les auteurs ont ainsi utilisé dans leurs romans certains
schémas initiatiques, la richesse des spiritualités traditionnelles ainsi que les profondeurs de la
nature pour mettre en place les fondations d’une identité nouvelle, basée sur des principes
traditionnels. Vivante et ontologiquement magique, la nature antillaise est ainsi non seulement le
refuge des esprits et de figures mythiques mais aussi une matrice positive, bénéfique, par
laquelle quelques auteurs ont pu proposer une reconnaissance du rapport intime de l’homme à la
terre natale. Malgré un sentiment d’infériorité latent et le danger constant de tomber dans

378
l’exotisme, certains romans antillais mettent ainsi en place, outre une nouvelle cosmogonie, une
transcendance de l’être par une (re)création identitaire au contact de la terre natale.
Cependant, le monde tel qu’il est représenté par ces auteurs a beau être mystique et
surnaturel, il n’en est pas moins limité dans son utilisation de manifestations magiques. En effet,
comme le dit Man Yaya, il existe des limites, des lois qui ne peuvent être bouleversées:
« l’univers a ses règles que je ne peux bouleverser entièrement. Sinon, je détruirais ce monde et
en rebâtirais un autre où les nôtres seraient libres » (Condé, 2004 : 37). Si les auteurs créent des
espaces de fuite dans les dimensions mystiques du monde réel, il y a des choses que, malgré leur
liberté d’écriture, il ne font pas, comme détruire la réalité de l’esclavage, de l’acculturation et la
réalité des souffrances subies. Le but des auteurs antillais n’est donc pas de lutter contre le passé
puisqu’ils pourraient très bien écrire une uchronie dans laquelle l’esclavage n’aurait jamais
existé. Écrivant des histoires sans pour autant véritablement réécrire l’Histoire, les auteurs ne
réécrivent donc pas ce passé qui, malgré ses souffrances, constitue leur identité mais ce qui leur
reste : un territoire qui, aussi petit soit-il, se voit élargi dans sa nature ontologiquement magique
et transcendé par les mythes qu’il abrite. Ces romans suivent ainsi, presque à la lettre, les propos
d’Édouard Glissant, selon qui « le territoire se définit par ses limites, qu’il faut étendre. Une
terre est sans limites, désormais. C’est pour cela qu’il faut qu’on la défende contre toute
aliénation » (Glissant, 1990 : 166). Or, de nos jours, la diversité culturelle et la globalisation
sont deux phénomènes qui, touchés par cette notion d’aliénation, affectent cette identité
antillaise: « The Antilleans do not know their country; they have forgotten their plants and even
the creole names for these plants, being so used to celebrating a white Christmas and
congratulating one another on the first day of spring when they live in a country with only one
season » (Praeger, 2003: 86-87). Ces romans exprimeraient alors des sentiments profonds de
leurs auteurs face à l’évolution de l’imaginaire antillais. Luttant contre cet oubli du passé et des

379
traditions qui constituent un aspect important de la société antillaise, les romans pourraient donc
être perçus comme la tentative de lui créer un socle mythique. Luttant contre cette acculturation
continue, ces romans pourraient être perçus – quand on considère leurs points communs, et en
particulier l’esprit communautaire qui relie les auteurs autour de mouvements comme la Créolité
– comme la mise en place, roman après roman, d’un sentiment communautaire qui nous rappelle
la fonction du vaudou en Haïti.
Réalisme mystique et vaudou : même combat ?
Le réalisme mystique pourrait bien – par sa nature et ses auteurs guerriers de
l’imaginaire – favoriser le développement d’un sentiment communautaire par la spiritualité et
les mythes qui, plus encore avec le mouvement de la Créolité, inclut les diverses communautés
jadis absentes de la littérature antillaise. C’est ce que propose Chamoiseau dans Écrire en pays
dominé, dans lequel il énonce, malgré les acculturations, l’existence d’un « organisme caribéen»
se développant par l’imaginaire : « dessous l’émiettement des langues et des dominations, il
existe un nouvel ‘organisme’ caribéen que nous ne soupçonnons pas – mais que je sais rêver »
(Chamoiseau, 2002 : 125). Il y a donc bel et bien, dans le réalisme mystique, cette image de
« l’homme américain » décrite par Maximilien Laroche et sur laquelle, en des termes différents,
se penche Raphaël Confiant : « si le monde créole ne possède pas, au départ, de discours de
création du monde, tous les efforts des peuples qu’il comporte ont toujours convergé, de
manière à la fois passionnée et pathétique, vers un seule et unique but : celui de fonder
justement une origine, une généalogie et une légitimité » (Confiant, 1998 : 11). Si l’on suit les
théories de Confiant, le conte est, pour la communauté créole, un tout permettant la création
d’un « nouvel imaginaire fait d’apports africains, européens et amérindiens mêlés,
inextricablement mêlés » (Confiant, 1995 : 10), ce qui pourrait expliquer l’absence d’influences
spécifiques de mythes d’origine précises. De même, par son recentrement sur cette idée de

380
regroupement identitaire de tout ce qui est, par définition, créole (incluant les origines
amérindiennes, les colons européens, les esclaves africains et tous les peuples émigrés d’origine
indienne, chinoise ou arabes), le mouvement de la Créolité renforce encore ce sentiment
communautaire en l’élargissant. Les créolistes s’opposent ainsi à l’Antillanité de Glissant et à sa
tentative de relier les Antilles au reste de la Caraïbe. Or, nous l’avons vu, les romans réalistes
magiques ne font que rarement référence aux Caraïbes ou aux autres îles créoles et se montrent
essentiellement antillais. Ainsi, si les créolistes perçoivent la langue créole comme force
unificatrice née de la diversité et ayant résisté à des siècles de politiques d’assimilation, peut-
être pourrions nous également voir dans le réalisme mystique une force similairement, mais
spécifiquement antillaise. En effet, à quelques exceptions près (comme avec les pratiques
magiques de Tituba qui se déroulent entre la Barbade et Boston), nous avons vu que la
spiritualité présente dans les romans ne s’applique qu’aux Antilles. Il y a donc essentiellement
dans le réalisme mystique un recentrement antillais, un enrichissement par la combinatoire de
tout un ensemble d’identités qui serait peut-être à étudier dans les autres littératures mondiales
de type postcolonial.
Par cet aspect, les romans réalistes mystiques pourraient ainsi avoir une fonction
similaire au « Noutéka » (Chamoiseau, 2006 : 160) qui, dans le roman Texaco, prend la forme
d’une philosophie acquise dans les mornes qui, par ses principes d’unité et de communauté,
donne force et courage: « c’était une sorte de nous magique » (Chamoiseau, 2006 : 160). Ce
sentiment communautaire, lié aux mythes et à la spiritualité, rappelle les études du phénomène
religieux de Laënnec Hurbon et son rapport à l’identité caribéenne : « l’étude du phénomène
religieux compris dans son articulation à la culture ouvrirait bien vers une toute autre Caraïbe,
peut-être plus tournée vers la construction de sa propre identité » (Hurbon, 2000 : 309). En
approfondissant ce rapport aux études de Hurbon, on ne peut s’empêcher de noter une

381
ressemblance entre les spécificités du réalisme mystique et le sentiment communautaire associé
au vaudou haïtien. Tout comme le réalisme mystique pratique un anti-exotisme du quotidien
antillais, le vaudou est lui aussi mêlé aux souffrances quotidiennes et au désir de survie de ceux
qui le pratiquent, partageant « une volonté de se remettre aux sources de lui-même, c’est-à-dire
de se remettre là où le sens n’est exilé ni des choses ni des événements : dans l’univers
symbolique de lui-même » (Hurbon, 2002: 97). On remarque ainsi que, si pour le vodouisant, la
religion vaudou est « la prise de conscience de son Être-au-monde avec l’ensemble du cosmos et
des hommes […] un tout où l’Haïtien majoritaire essaie de s’intégrer pour vivre, pour exister et
pour comprendre le drame de son devenir » (Clérismé, 2000 : 222), ce sentiment correspond,
dans les romans antillais réalistes mystiques que nous avons étudiés, au sentiment éprouvé par
les personnages en contact avec la Nature. C’est là un type de prise de conscience que les
romans tentent de reconstituer en proposant peut-être aux lecteurs antillais de renouer avec leur
terre natale, par la (re)constitution de mythes et une (ré)intégration commune à la terre natale
(par une mythisation du drame originel commun).
Par bien des aspects, nous remarquons donc que les interprétations modernes que fait
Laënnec Hurbon du vaudou haïtien semblent se rapprocher de nos propres conclusions
concernant la littérature réaliste mystique aux Antilles, en particulier quand, dans Dieu dans le
vaudou haïtien, Hurbon décrit cette religion à la fois comme une vision particulière du monde et
comme la tentative de tout un peuple de s’affirmer face à son histoire dramatique. Il pourrait
donc y avoir dans les romans réalistes mystiques une forme de lutte contre l’oubli et
l’acculturation qui, comme dans le vaudou haïtien, se ferait par la restructuration d’un système
cohérent qui, par-delà ruptures et conflits, donnerait les moyens d’une réintégration au monde et
d’une acceptation de soi. Ces deux systèmes, l’un religieux (le Vaudou) et l’autre artistique (le
réalisme mystique) auraient une signification profonde devant l’adversité, celle d’un « ‘langage

382
propre’ d’un peuple placé dans des conditions historiques, économiques et sociales telles qu’il
ne pouvait survivre qu’en trouvant lui-même sa propre réponse, qu’en s’affirmant dans ses
propres ‘modes originaux d’exister’ » (Calame-Griaule, 2002 : 9). C’est donc dans cette
affirmation de soi par le « langage propre » du réalisme mystique, que les peuples antillais
expriment leur mode d’existence. Ainsi nous semble-t-il distinguer, dans cette expression de
l’identité et ce nouvel imaginaire, l’ébauche de la « Méta-Nation » prophétisée par Chamoiseau
et qui, mêlée et emmêlée à toutes les terres du monde, verrait aux Antilles l’avènement d’un lieu
identitaire se développant non plus uniquement dans les limitations d’un lieu fixe, mais dans la
dynamique de l’échange et du partage.

383
Bibliographie
I- Sources littéraires principales
Chamoiseau, Patrick, L’Esclave vieil homme et le molosse (1997), Paris : Gallimard, 2005.
---, Solibo Magnifique (1988), Paris : Gallimard, 2005b.
Condé, Maryse, Moi, Tituba sorcière… noire de Salem (1986), Paris : Mercure de France, 2004.
---, Les Derniers Rois Mages (1992), Paris : Mercure de France, 2000.
Confiant, Raphaël, La Panse du chacal (2004), Paris : Mercure de France, 2005.
---, Le Meurtre du Samedi-Gloria, Paris : Mercure de France, 1997.
Depestre, René, Hadriana dans tous mes rêves (1988), Paris : Gallimard, 1988.
Glissant, Édouard, Le Quatrième Siècle (1964), Paris : Gallimard, 1997.
Pépin, Ernest, L’Homme au Bâton (1992), Paris : Gallimard, 2005.
Pineau, Gisèle, La Grande Drive des esprits (1993), Paris : Le Serpent à Plumes, 2001.
---, Un Papillon dans la cité, Paris : Éditions Sépia, 1992.
Schwarz-Bart, Simone, Ti Jean l’Horizon (1979), Paris : Éditions du Seuil, 1998.

384
II- Sources littéraires secondaires Césaire, Aimé, Cahier d’un retour au pays natal (1956), Colombus : Ohio University Press,
2000.
Césaire, Ina, Zonzon Tête Carrée, Paris : Éditions du Rocher, 1994.
---, Mémoires d’Isles, Manman N. et Manman F., Paris : Editions Caribéennes, 1985.
Chamoiseau, Patrick, Texaco (1992), Paris : Gallimard, 2006.
---, Chronique des sept misères (1986), Paris, Gallimard, 2004.
---, Au Temps de l'antan : contes du pays Martinique (1988), Paris: Hatier, 1988.
Condé, Maryse, Célanire cou-coupé, Paris : Éditions Robert Laffont, 2000.
---, La Traversée de la Mangrove (1989), Paris : Mercure de France, 2005.
Confiant, Raphael, Case à Chine (2007), Paris : Mercure de France, 2007.
---, Nègre marron (2006), Paris : Éditions Écriture, 2006.
---, Les Maîtres de la parole (photographies de David Damoison, textes recueillis par Marcel Lebielle), Paris : Gallimard, 1995.
Depestre, René, Le Mât de cocagne (1979), Paris : Gallimard, 1979.
Glissant, Édouard, La Case du commandeur (1981), Paris : Éditions du Seuil, 1981.
---, La Lézarde (1958), Paris : Éditions du Seuil, 2003.
Laferrière, Dany, Pays sans chapeau (1997), Paris : Le Serpent À Plumes, 2001.
Moutoussamy, Ernest, Aurore, Paris : L’Harmattan, 1995.

385
Pineau, Gisèle, Chair Piment (2002), Paris : Gallimard, 2004.
---, L’Exil selon Julia (1996), Paris : LGF, 2000.
Schwarz-Bart, Simone, Pluie et vent sur Télumée miracle (1972), Paris : Éditions du Seuil, 2003.
---, Un Plat de porc aux bananes vertes (en coll. Avec André Schwarz-Bart) (1967), Paris :
Éditions du Seuil, 1967.
Zobel, Joseph, La Rue Cases-Nègres (1974), Paris : Editions Présence Africaine, 2002.
III- Autres sources littéraires Achebe, Chinua, Things Fall Apart (1958), Oxford; Portsmouth, N.H: Heinemann Educational,
1996.
Asturias, Miguel Ángel, Hommes de maïs (1949), (trad. Miomandre, Francis), Paris : Albin Michel, 1987.
Carpentier, Alejo, Le Royaume de ce monde (1949), (trad. Durand, L.-F.), Paris : Gallimard,
1980.
Márquez, Gabriel García, Cent ans de solitude (1967), (trad. Durand, Carmen ; Durand, Claude), Paris: Seuil, 1995.
-------, Of Love and Other Demons (1994), (trad. Grossman, Edith), Londres: Penguin Books,
1995.
Okri, Ben, The Famished Road (1991), Londres: Vintage, 2003.
Tutuola, Amos, The Palm-Wine Drinkard & My Life in the Bush of Ghosts (1952 & 1954), New York: Grove Press, 1994.

386
IV- Références générales Affergan, Francis, Anthropologie à la Martinique, Paris : Presses de la fondation nationale des
sciences politiques, 1983.
Alexis, Jacques-Stephen, « Prolégomènes à un manifeste du Réalisme merveilleux des Haïtiens», Numéro spécial 1er Congrès International des Écrivains et Artistes Noirs, Paris, in Présence Africaine 8-10, 1956, pp. 245-271.
---, « Of the Marvellous Realism of the Haitians» in Ashcroft, Bill; Griffiths Gareth and Tiffis Helen (Ed.) The Post-colonial Studies Reader, Londres & New York: Routledge, 1995.
Anselin, Alain, L’Émigration antillaise en France, la troisième île, Paris: Karthala, 1990.
Ashcroft, Bill, Griffith, Gareth, Tiffin, Helen (Eds.), The Empire Writes Back, Theory and
Practice in Post-colonial Literatures, Londres: Routledge, 2002.
---, (Eds.), The Post-Colonial Studies Reader, Londres & New York: Routledge, 1995.
Audet, Jean-Paul, « Essai d’approche anthropologique», in Dumont, Fernand et al., Le Merveilleux, Deuxième colloque sur les religions populaires, 1971, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1973, pp.21-25.
Bader, Wolfgang, « Poétique antillaise, poétique de la relation – Entrevue avec Édouard Glissant », in Komparatistische Hefte, no 9-10, 1984, pp. 83-100.
Barjon, Béatrice, « Le Temps sacré dans L’esclave vieil homme et le molosse de Patrick
Chamoiseau », in Durand, Jean-François (Ed.), L’Écriture et le sacré, Senghor, Césaire, Glissant, Chamoiseau, Montpellier, Centre d’Étude du XXe Siècle, 2002, pp.183-202.
Baudry, Robert, « Magie noire, magie blanche et merveilleux », in Chandes, Gérard (éd.), Le
Merveilleux et la magie dans la littérature : actes du colloque de Caen, 31 août-2 septembre 1989, Amsterdam/Atlanta : Rodopi, 1992, pp.3-37.

387
Bebel-Gisler, Dany, Le Défi culturel guadeloupéen : Devenir ce que nous sommes, Paris : Éditions Caribéennes, 1989.
Becker, Colette, Lire le Réalisme et le Naturalisme, Paris : Dunod, 1992 (Collection Lettres Supérieures).
Belmont, Nicole, « Folklore », in Encyclopaedia Universalis, Vol. 9, Paris : Encyclopaedia
Universalis, 1989, pp. 601-608.
Benjamin, Walter, « Le Conteur », in Œuvres, Tome III, Paris : Gallimard, 2000.
Bergson, Henri, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris : Quadrige/PUF, 1990.
Bernabé, Jean, Éloge de la créolité (en coll. Avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant), Paris : Gallimard, 1993.
Berthoud, Gérald, Vers une anthropologie générale : modernité et altérité, Genève : Droz, 1992.
Beti, Mongo, Branle-bas en blanc et noir, Paris : Juillard, 2000.
Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Londres & New York : Routledge, 2004.
---, «Introduction », in Nation and Narration, Londres: Routledge, 1995 : pp.1-7.
Bougerol, Christiane, Une Ethnographie des conflits aux Antilles. Jalousie, commérages,
sorcellerie, Paris : PUF, 1997.
Bowers, Maggie Ann, Magic(al) Realism, Londres : Routledge, 2004.
Brisson, Luc, Le Mythe de Tirésias. Essai d’analyse structurale, Leiden : E.J. Brill, 1976.
Broussillon, Odile, Desbordes, Michèle, « Un Entretien avec Patrick Chamoiseau », Notes Bibliographiques Caraïbes, 48, 1988, pp. 10-22.
Brunel, Pierre, Mythocritique, théorie et parcours, Paris : PUF, 1992.

388
Brunvand, Jan Harold, The Vanishing Hitchhiker : American urban legends and their meanings, New York : Norton, 1981.
Buchet Rogers, Nathalie, « Oralité et écriture dans Pluie et vent sur Télumée Miracle », The French Review, Vol. 65, No. 3, (Fev., 1992), pp. 435-448.
Burton, Richard, D. E., Le Roman marron : études sur la littérature martiniquaise
contemporaine, Paris : L’Harmattan, 1997.
Cailler, Bernadette, «Ti Jean L’Horizon de Simone Schwarz-Bart, ou la leçon du royaume des morts», in Stanford French Review, vol. 6, no 2-3, Octobre 1982, pp. 283-297.
Calame-Griaule, Geneviève, « Préface », in Hurbon, Laënnec, Dieu dans le Vaudou haïtien,
Paris : Maisonneuve & Larose, 2002, pp.9-12.
Carpentier, Alejo, « On the Marvelous Real in America » (1949) in Zamora, Lois Parkinson et Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & Londres: Duke University Press, 1995a, pp.75-88.
---, «The Baroque and the Marvelous Real» (1975) in Zamora, Lois Parkinson et Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & Londres: Duke University Press, 1995b, pp. 89-108.
Casas, Olga Janeth, « L’‘Oraliture’ dans Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau », Lettres Romanes, Vol.55, no 3-4, Automne 2001, pp. 319-329.
Césaire, Aimé, «Sur la poésie nationale», Optique, No. 25, 1956, pp. 6-8.
Césaire, Ina, « Un avatar du conte guadeloupéen : le récit de type nouveau », Cahiers de
littérature orale, « Aux sources des paroles de Guadeloupe », no21, 1987, pp.97-114.
Chamoiseau, Patrick, Écrire en pays dominé (1997), Paris : Gallimard, 2002.
Chamoiseau, Patrick et Confiant, Raphaël, Lettres créoles, Tracées antillaises et continentales de la littérature, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, 1635-1975, Paris : Gallimard, 1999.

389
Chanady, Amaryll Beatrice, Magical Realism and the Fantastic, Resolved Versus Unresolved Antinomy, New York & Londres: Garland Publishing, Inc., 1985.
Chancé, Dominique, L’Auteur en souffrance, Paris : PUF, 2000.
Chase, Richard, « Myth as Literature », in Miller, Jr., James E. (ed), Myth and Method, Modern Theories of Fiction, University of Nebraska Press, 1960, pp. 127-143.
Chauvin, Danièle et Walter, Philippe, «Préface», in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de
mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp.7-9.
---, « Hypertextualité et mythocritique » in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp.175-181.
Chevalier, Jean, Gheebrant, Alain, Dictionnaire des symboles, Paris : Éditions Robert Laffont,
1982.
Chevrel, Yves, « Réception et mythocritique », in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp. 283-294.
Clark, Vèvè A., Daheny Cécile (trad.) «‘Je me suis réconciliée avec mon île’: Une Interview de
Maryse Condé»/«‘I have made peace with my island’: An Interview with Maryse Condé», Callaloo: A Journal of African American and African Arts and Letters, Vol. 12, No. 138, pp. 86-133, Winter 1989.
Clifford, James, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988.
Condé, Maryse, « Préface», in Rutil, Alain, Les Belles Paroles d’Albert Gaspard, Paris :
Éditions Caribéennes, 1987.
Confiant, Raphaël, Confiant, Raphaël, « Appel aux chefs d’État d’Afrique Noire au sujet de l’empoisonnement des populations antillaises », paru sur le site Montray Kréyol, le mardi 8 mai 2007, http://www.montraykreyol.org/spip.php?article285&lang=fr
---, « Construire une anthropologie créole », in Relouzat, Raymond, Tradition orale et imaginaire créole, Martinique : Ibid Rouge Éditions (Presses Universitaires Créoles/GEREC) 1998.

390
---, « Questions pratiques d’écriture créole », Écrire la « parole de nuit ». La nouvelle littérature antillaise, Paris : Gallimard, 1994b.
Corzani, Jack, «West Indian Mythology and Its Literary Illustrations», Research in African Literatures, Vol. 25, No 2, 1994, pp. 131–39.
Cugoano, Ottobah, Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres, traduites de l’anglais
d’Ottobah Cugoano, Africain, esclave à la Grenade et libre en Angleterre (trad. Antoine Diannyère), Londres et Paris: Royer, 1788, XII.
Curtius, Anny Dominique, Symbiose d’une mémoire, manifestations religieuses et littératures
de la Caraïbe, Paris : L’Harmattan, 2006.
Danroc, Gilles, « Métissages d’écriture et de sacré dans la Caraïbe francophone, Glissant, Chamoiseau», in Durand, Jean-François (Ed.), L’Écriture et le sacré, Senghor, Césaire, Glissant, Chamoiseau, Montpellier, Centre d’Étude du XXe Siècle, 2002, pp.235-245.
Dash, J. Michael, « Exile and Recent Literature », in Arnold, James A. (éd.) A History of Literature in the Caribbean, Volume 1, Hispanic and Francophone Regions, Amsterdam/Philadelphie: John Benjamins Publishing Company, 1994, pp. 451-461.
---, «Marvellous Realism – The Way Out of Negritude», Caribbean Studies, vol. 13, no. 4, 1973, pp.57-70.
De Castro, Viveiros, « Exchanging Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in
Amerindian Ontologies», Common Knowledge, vol.10, no.3 (2004), pp. 463-484.
Dehon, Claire L., Le Réalisme Africain, Le Roman francophone en Afrique subsaharienne, Paris : L’Harmattan, 2002.
De Souza, Pascale, « Traversée de la mangrove: éloge de la créolite, écriture de l'opacité », The
French Review, Vol. 73, No. 5 (Avril, 2000), pp. 822-833.
Doody, Margaret Anne, The True Story of the Novel, New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 1996.
Durix, Jean-Pierre, Mimesis, Genres and Post-Colonial Discourse, Deconstructing Magic
Realism, Houndmills: Macmillan, 1998.

391
Echevarría, Roberto González, Myth and Archive. A Theory of Latin American Narrative, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Eliade, Mircea, Le Sacré et le profane (1965), Paris : Gallimard, 2004.
--- Mythes, rêves et mystères (1957), Paris : Gallimard, 2001a.
---, Le Mythe de l’éternel retour (1969), Paris: Gallimard, 2001b.
---, Aspects du mythe (1963), Paris: Gallimard, 2000.
---, Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase (1968), Paris : Éditions Payot, 1983.
Eltis, David, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.
Fanon, Franz, Peau noire, masques blancs (1952), Paris : Éditions du Seuil, 1971.
Faris, Wendy B., Ordinary Enchantments, Magical Realism and the Remystification of Narrative, Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.
---, “Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction” in Zamora, Lois
Parkinson and Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & London: Duke University Press, 1995, pp. 163-190.
Favret-Saada, Jeanne, Les Mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage, Paris :
Gallimard, 1977.
Finnegan, Ruth, Oral Poetry, Bloomington : Indiana University Press, 1992.
Flores, Angel, «Magical Realism in Spanish American Fiction» in Zamora, Lois Parkinson et Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & Londres: Duke University Press, 1995, pp. 108-117.
Gamess, Roselyn et Yves, De l’Inde à la Martinique, le droit d’exister, Fort-de-France : Éditions Desormeaux, 2003.

392
Garnier, Xavier, La Magie dans le roman africain, Paris : PUF, 1999.
Garraway, Doris L., «Toward a Creole Myth of Origin: Narrative, Foundations and Eschatology in Patrick Chamoiseau’s L’Esclave vieil home et le molosse», Callaloo : A Journal of African Diaspora Arts and Letters, Vol. 29, No.1, Hiver 2006, pp. 151-167.
Giraud, Jean-Pierre, « Typologie des mythes», in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp. 359-370.
Glissant, Édouard, « Un marqueur de paroles », in Chamoiseau, Patrick, Chronique des sept
misères, Paris : Gallimard, 2004, pp. 3-6.
---, Le Discours antillais, Paris: Gallimard, 2002.
---, Traité du Tout-Monde, Paris : Gallimard, 1997b.
---, Introduction à une Poétique du Divers, Paris : Gallimard, 1996.
---, Poétique de la Relation, Poétique III, Paris : Gallimard, 1990.
Goimard, Jacques, Univers sans Limites: critique du merveilleux et de la fantasy, Paris : Pocket, 2003.
Gracchus, Fritz, Les Lieux de la mère, Paris : Éditions Caribéennes, 1986.
Grivel, Charles, Fantastique Fiction, Paris : PUF, 1992.
Gurrey, Béatrice et Hopquin, Benoît, « Békés : une affaire d’héritage », Le Monde, 1er mars
2009.
Haigh, Samantha, «Ethnographical Fiction/Fictional Ethnographies : Ina Césaire’s Zonzon Tête Carrée », in Nottingham French Studies, Vol. 40, No. 1, Printemps 2001, pp.75-85.
Hamon, Philippe, « Un discours contraint » in Barthes, R. Bersani, L., Hamon, PH, Riffaterre,
M. et Watt, I., Littérature et réalité, Paris : Éditions du Seuil, 1982, pp. 119-181.

393
Hart, Stephen M., « Magical Realism : Style and Substance », in Hart, Stephen M. & Ouyang, Wen-chin (éds.), A Companion to Magical Realism, Rochester: Tamesis, 2005, pp.1-12.
Heady, Margaret L., From Marvelous to Magic Realism : Modernist and Postmodernist
discourses of Identity in the Caribbean Novel University of Massachusetts Amherst, 1997, 137 pages; AAT 9737535
Henry Valmore, Simonne, Dieux en exil, Paris : Gallimard, 1988.
Herskovits, Melville J., The Myth of the Negro Past, New York : Harper & Brothers Publishers,
1959.
Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (éds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Honorien-Rostal, Rolande, «Frontières du Kont en Guadeloupe », Études Créoles, vol. XXV, no
2, 2002, pp. 15-61.
Horton, Robin, « La Pensée traditionnelle africaine et la science occidentale », in Horton Robin, et al. (dir.) La Pensée métisse, croyances africaines et rationalité occidentale en question, Genève : Cahiers de L’I.U.E.D., 1990, pp. 47-67.
Hurbon, Laënnec, Dieu dans le Vaudou haïtien, Paris : Maisonneuve & Larose, 2002.
---, « Les Nouveaux Mouvements Religieux dans la Caraïbe », in Hurbon, Laënnec (dir.), Le phénomène religieux dans la Caraïbe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, Paris : Editions Karthala, 2000, pp.309-354.
Jolles, André, Formes simples [Einfache Formen, 1930], traduit par A.-M. Buguet, Paris : Le Seuil, Paris, 1972.
Kane, Mohamadou, « L’Écrivain africain et son public », Présence Africaine, Paris, vol. 58, no
5, pp. 8-31.
Klein, Herbet, S., The Middle Passage, Princeton : Princeton University Press, 1978.
Koné, Amadou, Du récit oral au roman, Abidjian : CEDA, 1985.

394
Lacourcière, Luc, « Le Merveilleux folklorique» in Dumont, Fernand et al., Le Merveilleux, Deuxième colloque sur les religions populaires, 1971, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1973, pp.81-85.
Lancelin, Charles, La Sorcellerie des Campagnes, Paris : S.d. Durville, 1965.
Leung, Joyce, L’Esthétique de la canneraie dans le roman des Antilles et des Mascareignes, Paris : L’Harmattan, 1999.
López, Alfred J., Posts and Pasts: A Theory of Postcolonialism, Albany: SUNY Press, 2001.
Laroche, Maximilien, Mythologie Haïtienne, Sainte-Foy, Québec : GRELCA, 2002.
---. « Literature and Folklore in the Francophone Caribbean » (trad. Par J. Michael Dash) in
Arnold, James A. (éd.) A History of Literature in the Caribbean, Volume 1, Hispanic and Francophone Regions, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1994, pp. 341-348.
---, La Double scène de la représentation, Québec: GRELCA, 1991.
---, La Découverte de l’Amérique par les Américains, Essais de littérature comparée, Sainte-Foy, Québec: GRELCA, 1989
---, Contribution à l’étude du réalisme merveilleux, Sainte-Foy, Québec: GRELCA, 1987.
---, L’Image comme écho, essais sur la littérature et la culture haïtiennes, Montréal : Éditions
Nouvelle Optique, 1978.
---, Le Miracle et la métamorphose. Essai sur les littératures du Québec d’Haïti, Montréal : Éditions du Jour, 1970.
Lovejoy, Paul « The African Diaspora : Revisionist Interpretations of Ethnicity, Culture and
Religion under Slavery», in Studies in the World History of Slavery, Abolition and Emancipation, II, 1, 1997. Source en ligne :
(http://www.yorku.ca/nhp/publications/Lovejoy_Studies%20in%20the%20World%20History%20of%20Slavery.pdf)

395
Larroux, Guy, Le Réalisme. Éléments de critique, d’histoire et de poétique, Paris : Nathan, 1995.
Leal, Louis, « Magical Realism in Spanish American Literature» in Zamora, Lois Parkinson et Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & Londres: Duke University Press, 1995, pp. 119-124.
Maignan-Claverie, Chantal, Le Métissage dans la littérature des Antilles françaises, le complexe d’Ariel, Paris: Karthala, 2005.
Maingueneau, Dominique, Le Contexte de l’œuvre : énonciation, écrivain, société, Paris :
Dunod, 1993.
Makward, Christiane, « De bouche à oreille à bouche : ethno-dramaturgie d’Ina Césaire», in Condé Maryse (ed.), L’Héritage de Caliban, Paris : Éditions Jasor, 1992, pp. 133-146.
Maupassant, Guy, « Préface », in Maupassant, Guy, Pierre et Jean, Paris : Pocket, 1998.
Mbiti, John, African Religions & Philosophy, Nairobi: Heinemann, 1969.
McCusker, Maeve, « No Place Like Home? Constructing and Identity in patrick Chamoiseau’s
Texaco», in Gallagher, Mary (Ed.), Ici-Là, Place and Displacement in caribbean Writing in French, Amsterdam & New York: Rodopi, 2003, pp.41-60.
---, « De la problématique du territoire à la problématique du lieu : un entretien avec Patrick
Chamoiseau », The French Review, Vol. 73, No.4, Mars 2000, pp.724-733.
Mélétinski, Evgéni, « L’Étude structurale et typologique du conte », (trad. Kahn, Claude), in Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris : Editions du Seuil, 1976.
Mellier, Denis, L’Écriture de l’Excès, fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris :
Honoré Champion, 1999.
Ménil, René, Tracées, Identité, négritude, esthétique aux Antilles, Paris : Éditions Robert Laffont, 1981.
Milne, Lorna, « The marron and the marqueur, Physical Space and Imaginary Displacements in
Patrick Chamoiseau’s L’Esclave viel homme et le molosse», in Gallagher, Mary (Ed.),

396
Ici-Là, Place and Displacement in caribbean Writing in French, Amsterdam & New York: Rodopi, 2003, pp. 61- 82.
Morin, Edgar, La Méthode, 3. La Connaissance de la connaissance, Paris : Seuil, 1986.
---, La Rumeur d’Orléans, Paris : Seuil, 1969.
Moura, Jean-Marc, Lire l’exotisme, Paris : Dunod, 1992.
Munro, Martin, « Something and Nothing, Place and Displacement in Aimé Césaire and René Depestre», in Gallagher, Mary (Ed.), Ici-Là, Place and Displacement in Caribbean Writing in French, Amsterdam & New York: Rodopi, 2003, pp. 143-155.
Okpewho, Isidore, Myth in Africa, A study of its aesthetic and cultural relevance, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Ong, Walter J., Orality and Literacy: the Technologizing of the Word, Londrres: Routledge,
2002.
Ormerod-Noakes, Beverley, «Displacement and Self-Disclosure in Some Works by Gisèle Pineau», in Gallagher, Mary (Ed.), Ici-Là, Place and Displacement in caribbean Writing in French, Amsterdam & New York: Rodopi, 2003, pp. 211-226.
---, «Magical Realism in Contemporary French Caribbean Literature: Ideology or Literary Diversion ? », in Australian Journal of French Studies, Vol. 34, No.2, mai-août 1997, pp. 216-226.
---, An Introduction to the French Caribbean novel, Londres, Heineman, 1985.
Orville, Xavier, « C’est la mer que j’écris », Notre Librairie, vol. 143, Janvier-Mars 2001, pp. 126-127.
Ouyang, Wen-chin, «Magical Realism and Beyond: Ideology of Fantasy» in Hart, Stephen M. &
Ouyang, Wen-chin (éds.), A Companion to Magical Realism, Rochester: Tamesis, 2005.
Pausch, Marion, «Interview avec Patrick Chamoiseau», in M. Glaser et M. Pausch (Eds.), Caribbean Writers: Between Orality and Writing, Amsterdam: Rodopi, 1994, pp. 151-158.

397
Perret, Delphine, « La Parole du conteur créole: Solibo magnifique de Patrick Chamoiseau », The French Review, Vol. 67, No. 5, (Avril 1994), pp. 824-839.
---, « L’Écriture mosaïque de Traversée de la mangrove », in Condé Maryse (Ed.), L’Héritage
de Caliban, Pointe-à-Pitre, Jasor, 1992.
Pestre de Almeida, Lilian, « Oralité et création dans la production caribéenne : Guillén, Césaire et quelques autres ou Devinette et comptine, son et ponto : formes populaires et orales, puériles et initiatiques » in Laroche Maximilien (Prés.), Tradition et modernité dans les littératures francophones d’Afrique et d’Amérique, Sainte-Foy, Québec : GRELCA, 1988, pp. 211-253.
Pétré-Grenouilleau, Olivier, Les Traites négrières, essai d’histoire globale, Paris : Éditions Gallimard, 2004 (« nrf »).
Pfaff, Françoise, Entretiens avec Maryse Condé, Paris : Karthala, 1993.
Ponneau, Gwenhaël, La Folie dans la Littérature Fantastique, Paris : Édition du CNRS, 1990.
Ponte, Cécilia, «Au Carrefour du réalisme merveilleux» in Laroche Maximilien (Pres.),
Tradition et modernité dans les littératures francophones d’Afrique et d’Amérique, Sainte-Foy, Québec : GRELCA, 1988.
Pradel, Lucie, African Beliefs in the New World, Popular Literary Traditions of the Caribbean
(trad. Catherine Bernard), Trenton/Asmara: Africa World Press, Inc., 2000.
Praeger, Michèle, The Imaginary Caribbean and Caribbean Imaginary, Lincoln/Londres: University of Nebraska Press, 2003.
Price-Mars, Jean, Ainsi parla l’oncle, Ottawa: Leméac, 1973.
Ramassamy, Diana, « Conter: une tradition aveugle ? », in Confiant Raphaël et Damoiseau,
Robert (Dir.), À l’arpenteur inspiré, Mélanges offerts à Jean Bernabé, Matoury, Guyane : Ibis Rouge éditions, 2006.
Ricœur, Paul, Histoire et vérité, Paris : Seuil, 1964.

398
Rochmann, Marie-Christine, «Marronnage et sacré dans l’oeuvre d’Édouard Glissant», in Durand, Jean-François (Ed.), L’Écriture et le sacré, Senghor, Césaire, Glissant, Chamoiseau, Montpellier, Centre d’Étude du XXe Siècle, 2002, pp.173-182.
---, L’Esclave fugitif dans la littérature antillaise, Sur la déclive du morne, Paris : Karthala,
2000.
Roh, Franz, « Magic realism : Post-Expressionism» in Zamora, Lois Parkinson et Faris, Wendy B., Magical Realism. Theory, History, Community, Durham & Londres: Duke University Press, 1995, pp.15-31.
Rony, Jérôme Antoine, La Magie, Paris : PUF, 1966.
Rosello, Mireille, Littérature et identité créole aux Antilles, Paris: Karthala, 1992.
Sala-Molins, Louis, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris: Quadrige/PUF, 2006.
Scheel, Charles W., Réalisme magique et réalisme merveilleux : des théories aux poétiques, Paris : L’Harmattan, 2005.
Schon, Nathalie, L’auto-exotisme dans les littératures des Antilles françaises, Paris : Karthala,
2003.
Seifert, Lewis, C., « Orality, History and “Creoleness” in Patrick Chamoiseau’s Creole Folktales », in Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, Vol. 16, No. 2 (2002), pp.214–230.
Senghor, Léopold Sédar, Liberté I, Négritude et humanisme, Paris: Éditions du Seuil, 1964. Shaw, Donald, L., « The Presence of Myth in Borges, Carpentier, Asturias, Rulfo and García
Márquez» in Hart, Stephen M. & Ouyang, Wen-chin (éds.), A Companion to Magical Realism, Rochester: Tamesis, 2005, pp. 46-54.
Sigal, Pete, “Religion and Family” in From Moon Goddesses to Virgins. The Colonization of Yucatecan Maya Sexual Desire, Austin: University of Texas Press, 2000.
Siganos, André, « Définitions du mythe », in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005a, pp.85-100.

399
---, « Écriture et mythe : la nostalgie de l’archaïque » in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005b, pp.111-118.
Simasotchi-Bronès, Françoise, Le Roman antillais, personnages, espace et histoire fils du
chaos, Paris : L’Harmattan, 2004.
Stern, Joseph Peter, On Realism, Londres: Routledge and K. Paul, 1973.
Suárez, Lucía M., « Gisèle Pineau, Writing the Dimensions of Migration », World Literature Today: A Literary Quaterly of the University of Oklahoma, Vo.75, No.3-4, été/automne 2001, pp. 9-21.
Suvélor, Roland, « Folklore, exotisme, connaissance », Acoma, revue de littérature, de sciences humaines et politique, No2, avril-juin 1971, pp.21-40.
Thornton, John K., « “I Am the Subject of the King of Congo”: African Political Ideology and
the Haitian Revolution », Journal of World History, Vol.4, No.2, Fall 1993, pp. 181-214.
Todorov, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris : Seuil, 1970.
Toumson, Roger, L’Utopie perdue des îles d’Amérique, Essai, Paris : Honoré Champion Éditeur, 2004.
Toureh, Fanta, L’Imaginaire dans l’œuvre de Simone Schwarz-Bart, Approche d’une mythologie
antillaise, Paris : L’Harmattan, 1986 « Monde Antillais/Recherche et documents ».
Tcheuyap, Alexie, « Creolist Mystification : Oral Writing in the Works of Patrick Chamoiseau and Simone Schwarz-Bart», Research in African Literature, Vol. 32, No.4, Hiver 2001, pp. 44-60.
Vincensini, Jean-Jacques, « Merveilleux et mythe », in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp. 237-246.
Walter, Philippe, « Conte, légende et mythe », in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de
mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005a, pp. 59-68.

400
---, « Mythologies comparées », in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005b, pp. 261-270.
Williams, Eric. Capitalism and Slavery, Chapel Hill: University of Carolina Press, 1994.
Wunenburger, Jean-Jacques, « Création artistique et mythique » in Chauvin Danièle et al. (dir.), Questions de mythocritique, Paris : Éditions Imago, 2005, pp. 69-84.
---, « Mytho-phorie : formes et transformations du mythe », Religiologiques, no 10, automne
1994, pp. 49-70.
V- Sites Internet consultés
http://www.cr-guadeloupe.fr/ (Janvier 2010)
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/ (Janvier 2010)
http://www.martiniquetourisme.com/ (Janvier 2010)

401
Document Annexe I

402
Document Annexe II













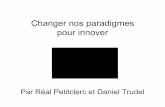


![[EYROLLES] La Révolution Antillaise](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf9a8a550346d033a23fe4/eyrolles-la-revolution-antillaise.jpg)


