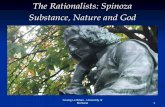Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement
description
Transcript of Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement
-
SPINOZA
Trait de la rforme de lentendement (traduction de Ch. Appuhn)
AVERTISSEMENT AU LECTEUR Ce trait de la Rforme de lEntendement que nous te donnons ici, lecteur bienveillant, dans son tat dinachvement, a t compos il y a bien des annes, par lauteur. Il eut toujours dans lesprit de le terminer ; dautres soins len ont empch, et la mort finit par lenlever avant quil et pu, comme il let dsir, mener son uvre jusquau bout. Comme elle contient toutefois un grand nombre de choses remarquables et utiles, qui seront, nous nen saurions douter, dun grand prix pour le poursuivant sincre de la vrit, nous navons pas voulu que tu en fusses priv ; dautre part, pour te faire paratre plus aisment pardonnables les obscurits, la rudesse et les imperfections qui sy rencontrent et l, nous avons tenu te prvenir et avons rdig cet effet le prsent avertissement. Adieu. DE LA RFORME DE LENTENDEMENT (1) Lexprience mavait appris que toutes les occurrences les plus frquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles ; je voyais quaucune des choses, qui taient pour moi cause ou objet de crainte, ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce nest proportion du mouvement quelle excite dans lme : je rsolus enfin de chercher sil existait quelque objet qui ft un bien vritable, capable de se communiquer, et par quoi lme, renonant tout autre, pt tre affecte uniquement, un bien dont la dcouverte et la possession eussent pour fruit une ternit de joie continue et souveraine. (2) Je rsolus, dis-je, enfin : au premier regard, en effet, il semblait inconsidr, pour une chose encore incertaine, den vouloir perdre une certaine ; je voyais bien quels avantages se tirent de lhonneur et de la richesse, et quil me faudrait en abandonner la poursuite, si je voulais mappliquer srieusement quelque entreprise nouvelle : en cas que la flicit suprme y ft contenue, je devais donc renoncer la possder ; en cas au contraire quelle ny ft pas contenue, un attachement exclusif ces avantages me la faisait perdre galement. (3) Mon me sinquitait donc de savoir sil tait possible par rencontre dinstituer une vie nouvelle, ou du moins dacqurir une certitude touchant cette institution, sans changer lordre ancien ni la conduite ordinaire de ma vie. Je le tentai souvent en vain. Les occurrences les plus frquentes dans la vie, celles que les hommes, ainsi quil ressort de toutes leurs uvres, prisent comme tant le souverain bien, se ramnent en effet trois objets : richesse, honneur, plaisir des sens. Or chacun deux distrait lesprit de toute pense relative un autre bien : (4) dans le plaisir lme est suspendue comme si elle et trouv un bien o se reposer ; elle est donc au plus haut point empche de penser un autre bien ; aprs la jouissance dautre part vient une extrme tristesse qui, si elle ne suspend pas la pense, la trouble et lmousse. La poursuite de lhonneur et de la richesse nabsorbe pas moins lesprit ; celle de la richesse, surtout quand on la recherche pour elle-mme, parce qualors on lui donne rang de souverain bien ; (5) quant lhonneur, il absorbe lesprit dune faon bien plus exclusive encore, parce quon ne manque jamais de le considrer comme une chose bonne par elle-mme, et comme une fin dernire laquelle se rapportent toutes les actions. En outre lhonneur et la richesse ne sont point suivis de repentir comme le plaisir ; au contraire, plus on possde soit de lun soit de lautre, plus
-
la joie quon prouve est accrue, do cette consquence quon est de plus en plus excit les augmenter ; mais si en quelque occasion nous sommes tromps dans notre espoir, alors prend naissance une tristesse extrme. Lhonneur enfin est encore un grand empchement en ce que, pour y parvenir, il faut ncessairement diriger sa vie daprs la manire de voir des hommes, cest--dire fuir ce quils fuient communment et chercher ce quils cherchent. (6) Voyant donc que ces objets sont un obstacle lentreprise dinstituer une vie nouvelle, que mme il y entre eux et elle une opposition telle quil faille ncessairement renoncer soit aux uns, soit lautre, jtais contraint de chercher quel parti tait le plus utile ; il semblait en effet, je lai dit, que je voulusse pour un bien incertain en perdre un certain. Avec un peu dattention toutefois je reconnus dabord que si, renonant ces objets, je mattachais linstitution dune vie nouvelle, jabandonnais un bien incertain de sa nature, comme il ressort clairement des observations ci-dessus, pour un bien incertain, non du tout de sa nature (puisque jen cherchais un inbranlable) mais seulement quant son atteinte. (7) Une mditation plus prolonge me convainquit ensuite que, ds lors, si seulement je pouvais rflchir fond, jabandonnais un mal certain pour un bien certain. Je me voyais en effet dans un extrme pril et contraint de chercher de toutes mes forces un remde, ft-il incertain ; de mme un malade atteint dune affection mortelle, qui voit la mort imminente, sil napplique un remde, est contraint de le chercher, ft-il incertain, de toutes ses forces, puisque tout son espoir est dans ce remde. Or les objets que poursuit le vulgaire non seulement ne fournissent aucun remde propre la conservation de notre tre, mais ils lempchent et, frquemment cause de perte pour ceux qui les possdent, ils sont toujours cause de perte pour ceux quils possdent. (8) Trs nombreux en effet sont les exemples dhommes qui ont souffert la perscution et la mort cause de leur richesse, et aussi dhommes qui, pour senrichir, se sont exposs tant de prils quils ont fini par payer leur draison de leur vie. Il ny a pas moins dexemples dhommes qui, pour conqurir ou conserver lhonneur, ont pti trs misrablement. Innombrables enfin sont ceux dont lamour excessif du plaisir a ht la mort. (9) Ces maux dailleurs semblaient provenir de ce que toute notre flicit et notre misre ne rsident quen un seul point : quelle sorte dobjet sommes-nous attachs par lamour ? Pour un objet qui nest pas aim, il ne natra point de querelle ; nous serons sans tristesse sil vient prir, sans envie sil tombe en la possession dun autre ; sans crainte, sans haine et, pour le dire dun mot, sans trouble de lme ; toutes ces passions sont, au contraire, notre partage quand nous aimons des choses prissables, comme toutes celles dont nous venons de parler. (10) Mais lamour allant une chose ternelle et infinie repat lme dune joie pure, dune joie exempte de toute tristesse ; bien grandement dsirable et mritant quon le cherche de toutes ses forces. Ce nest pas sans raison toutefois que jai crit ces mots : si seulement je pouvais rflchir srieusement. Si clairement en effet que mon esprit pert ce qui prcde, je ne pouvais encore me dtacher entirement des biens matriels, des plaisirs et de la gloire. (11) Un seul point tait clair pendant le temps du moins que mon esprit tait occup de ces penses, il se dtournait des choses prissables et srieusement pensait linstitution dune vie nouvelle ; cela me fut une grande consolation : le mal, je le voyais, ntait pas dune nature telle quil ne dt cder aucun remde. Au dbut, la vrit, ces relches furent rares et de trs courte dure, mais, mesure que le vrai bien me fut connu de mieux en mieux, ils devinrent plus frquents et durrent davantage ; surtout quand jeus observ que le gain dargent, le plaisir et la gloire ne sont nuisibles quautant quon les recherche pour eux-mmes et non comme des moyens en vue dune autre fin. Au contraire, si on les recherche comme des moyens, ils ne dpasseront pas une certaine mesure, et, loin de nuire, contribueront beaucoup latteinte de la fin quon se propose ainsi que nous le montrerons en son temps. (12) Je me bornerai dire ici brivement ce que jentends par un bien vritable et aussi ce quest le souverain bien. Pour lentendre droitement il faut noter que bon et mauvais se disent en un sens purement relatif, une seule et mme chose pouvant tre appele bonne et mauvaise suivant laspect sous lequel on la considre ; ainsi en est-il de parfait et dimparfait. Nulle chose, en effet,
-
considre dans sa propre nature ne sera dite parfaite ou imparfaite, surtout quand on aura connu que tout ce qui arrive se produit selon un ordre ternel et des lois de nature dtermines. (13) Tandis cependant que lhomme, dans sa faiblesse, ne saisit pas cet ordre par la pense, comme il conoit une nature humaine de beaucoup suprieure en force la sienne et ne voit point dempchement ce quil en acquire une pareille, il est pouss chercher des intermdiaires le conduisant cette perfection ; tout ce qui ds lors peut servir de moyen pour y parvenir est appel bien vritable ; le souverain bien tant darriver jouir, avec dautres individus sil se peut, de cette nature suprieure. Quelle est donc cette nature ? Nous lexposerons en son temps et montrerons quelle est la connaissance de lunion qua lme pensante avec la nature entire. (14) Telle est donc la fin laquelle je tends : acqurir cette nature suprieure et faire de mon mieux pour que beaucoup lacquirent avec moi ; car cest encore une partie de ma flicit de travailler ce que beaucoup connaissent clairement ce qui est clair pour moi, de faon que leur entendement et leur dsir saccordent pleinement avec mon propre entendement et mon propre dsir. Pour parvenir cette fin il est ncessaire davoir de la Nature une connaissance telle quelle suffise lacquisition de cette nature suprieure ; en second lieu, de former une socit telle quil est dsirer pour que le plus dhommes possible arrivent au but aussi facilement et srement quil se pourra. (15) On devra sappliquer ensuite la Philosophie Morale de mme qu la Science de lducation ; comme la sant nest pas un moyen de peu dimportance pour notre objet, un ajustement complet de la Mdecine sera ncessaire ; comme enfin lart rend faciles quantit de travaux qui, sans lui, seraient difficiles, fait gagner beaucoup de temps et accrot lagrment de la vie, la Mcanique ne devra tre en aucune faon nglige. (16) Avant tout cependant il faut penser au moyen de gurir lentendement et de le purifier, autant quil se pourra au dbut, de faon quil connaisse les choses avec succs, sans erreur et le mieux possible. Il est par l, ds prsent, visible pour chacun, que je veux diriger toutes les sciences vers une seule fin et un seul but, qui est de parvenir cette suprme perfection humaine dont nous avons parl ; tout ce qui dans les sciences ne nous rapproche pas de notre but devra tre rejet comme inutile ; tous nos travaux, en un mot, comme toutes nos penses devront tendre cette fin. (17) Pendant toutefois que nous sommes occups de cette poursuite et travaillons maintenir notre entendement dans la voie droite, il est ncessaire que nous vivions ; nous sommes donc obligs avant tout de poser certaines rgles que nous tiendrons pour bonnes et qui sont les suivantes. I. Mettre nos paroles la porte du vulgaire et faire daprs sa manire de voir tout ce qui ne nous empchera pas datteindre notre but : nous avons beaucoup gagner avec lui pourvu, quautant quil se pourra, nous dfrions sa manire de voir et nous trouverons ainsi des oreilles bien disposes entendre la vrit. II. Des jouissances de la vie prendre tout juste ce quil faut pour le maintien de la sant. III. Rechercher enfin largent, ou tout autre bien matriel, autant seulement quil est besoin pour la conservation de la vie et de la sant et pour nous conformer aux usages de la cit, en tout ce qui nest pas oppos notre but. (18) Ces rgles poses, je me mets en route et mattache dabord ce qui doit venir le premier, cest--dire rformer lentendement et le rendre apte connatre les choses comme il est ncessaire pour atteindre notre but. Pour cela, lordre tir de la nature exige que je passe en revue tous les modes de perception dont jai us jusquici pour affirmer ou nier avec assurance, afin de choisir le meilleur et de commencer du mme coup connatre mes forces et ma nature que je dsire porter sa perfection. (19) En y regardant attentivement, le mieux que je puisse faire est de ramener quatre tous ces modes. I. Il y a une perception acquise par ou-dire ou par le moyen dun signe conventionnel arbitraire.
-
II. Il y a une perception acquise par exprience vague, cest--dire par une exprience qui nest pas dtermine par lentendement ; ainsi nomme seulement parce que, stant fortuitement offerte et nayant t contredite par aucune autre, elle est demeure comme inbranle en nous. III. Il y a une perception o lessence dune chose se conclut dune autre chose, mais non adquatement, comme il arrive ou bien quand, dun effet, nous faisons ressortir la cause ou bien quune conclusion se tire de quelque caractre gnral toujours accompagn dune certaine proprit. IV. Il y a enfin une perception dans laquelle une chose est perue par sa seule essence ou par la connaissance de sa cause prochaine. (20) Voici des exemples pour illustrer ces distinctions. Je sais par ou-dire seulement quel a t mon jour de naissance ; que jai eu tels parents et autres choses semblables, dont je nai jamais dout. Je sais par exprience vague que je mourrai ; si je laffirme, en effet, cest que jai vu dautres tres semblables moi rencontrer la mort, bien que tous naient pas vcu le mme espace de temps et ne soient pas morts de la mme maladie. Cest par exprience vague encore que je sais que lhuile est pour la flamme un aliment propre lentretenir, et que leau est propre lteindre, que le chien est un animal aboyant et lhomme un animal raisonnable ; et ainsi ai-je appris presque tout ce qui se fait pour lusage de la vie. (21) Voici maintenant comment nous concluons une chose dune autre chose. Quand nous percevons clairement que nous sentons tel corps et nen sentons aucun autre, nous concluons clairement de l que lme est unie au corps et que cette union est la cause de cette sensation ; mais en quoi cette sensation, ou cette union, consiste, cest ce que nous ne pouvons connatre absolument par l ; de mme quand je connais la nature de la vision et aussi cette proprit elle appartenant, quun mme objet vu grande distance parat plus petit que si nous le regardons de prs, jen conclus que le soleil est plus grand quil ne mapparat et autres propositions semblables. (22) Une chose enfin est perue par sa seule essence quand, par cela mme que je sais quelque chose, je sais ce que cest que de savoir quelque chose ou quand, par la connaissance que jai de lessence de lme, je sais quelle est unie au corps. Cest de cette sorte de connaissance que nous savons que deux et trois font cinq et que deux lignes parallles une troisime sont parallles entre elles, etc. Trs peu nombreuses toutefois sont les choses que jai pu jusquici connatre dune connaissance de cette sorte. (23) Pour faire mieux entendre tout ce qui prcde je me servirai enfin dun exemple unique : Soient donns trois nombres ; on en cherche un quatrime qui soit au troisime comme le second est au premier. Des marchands diront ici mainte fois quils savent ce quil faut faire pour trouver ce quatrime nombre parce quils nont pas encore oubli le procd que sans dmonstration ils ont appris de leurs matres. Dautres de lexprience des cas simples tirent un principe universel : il arrive que le quatrime nombre soit connu comme dans la proportion 2, 4, 3, 6, et lexprience montre quen divisant par le premier le produit du second et du troisime, on a comme quotient le nombre 6 ; obtenant par cette opration le mme nombre quils savaient dj tre le quatrime proportionnel demand, ils en concluent que cette opration permet toujours de trouver un quatrime proportionnel. (24) Les Mathmaticiens, sappuyant sur la dmonstration dEuclide (proposition 19, livre VII), savent quels nombres sont proportionnels entre eux : ils le concluent de la nature de la proportion et de cette proprit lui appartenant que le produit du premier terme et du quatrime gale le produit du second et du troisime ; ils ne voient pas toutefois adquatement la proportionnalit des nombres donns et, sils la voient, ce nest point par la vertu de la proposition dEuclide, mais intuitivement, sans faire aucune opration. (25) Pour faire choix maintenant du meilleur parmi ces modes de perception, il est requis dnumrer brivement les moyens qui nous sont ncessaires pour atteindre notre fin, savoir : I. Connatre exactement notre nature, que nous dsirons porter sa perfection, et avoir aussi de la nature des choses une connaissance suffisante,
-
II. Pour en faire droitement ressortir les diffrences, les conformits et les oppositions des choses, III. De faon concevoir droitement quoi elles se prtent et quoi elles ne se prtent pas, IV. Afin de comparer ce rsultat avec la nature et la puissance de lhomme. Par o se verra aisment la plus haute perfection o lhomme puisse parvenir. (26) Aprs ces considrations voyons quel mode de perception doit tre choisi : Pour le premier, il est de soi manifeste que par le simple ou-dire, outre que ce mode est fort incertain, nous ne percevons nulle essence de chose ainsi quil apparat dans notre exemple ; or nous ne pouvons connatre lexistence singulire dune chose que si lessence nous en est connue, comme on le verra par la suite ; do nous concluons que toute certitude acquise par ou-dire doit tre exclue des sciences. Par la simple audition en effet, sans un acte pralable de lentendement propre, nul ne peut tre affect. (27) Quant au deuxime mode on ne peut dire non plus quil ait lide de la proportion quil cherche. Outre que cette connaissance est fort incertaine et nest jamais dfinitive, on ne percevra jamais par exprience vague autre chose que des accidents dans les choses de la Nature, et de ces derniers nous navons dide claire que si les essences nous sont dabord connues. Il faut donc galement rejeter lexprience vague. (28) Au sujet du troisime mode par contre, on doit dire en quelque manire quil nous donne lide dune chose et aussi nous permet de conclure sans danger derreur ; il nest cependant pas par lui-mme un moyen datteindre notre perfection. (29) Seul le quatrime mode saisit lessence adquate dune chose et cela sans risque derreur ; cest pourquoi nous devons nous en servir principalement. De quelle faon il faut lemployer pour acqurir des choses inconnues une connaissance claire de cette sorte, et comment nous y parviendrons le plus directement, cest ce que nous allons faire en sorte dexpliquer. (30) Sachant maintenant quelle sorte de connaissance nous est ncessaire, il nous faut indiquer la Voie et la Mthode par o nous arriverons connatre ainsi vritablement les choses que nous avons connatre. Pour cela il faut observer dabord quil ny aura pas ici denqute se poursuivant linfini : pour trouver la meilleure mthode de recherche de la vrit, nous naurons pas besoin dune mthode par laquelle nous rechercherions cette mthode de recherche, et pour rechercher cette seconde mthode nous naurons pas besoin dune troisime et ainsi de suite linfini ; car de cette faon nous ne parviendrions jamais la connaissance de la vrit ni mme aucune connaissance. Il en est de cela tout de mme que des instruments matriels, lesquels donneraient lieu pareil raisonnement. Pour forger le fer en effet, on a besoin dun marteau et pour avoir un marteau il faut le faire ; pour cela un autre marteau, dautres instruments sont ncessaires et, pour avoir ces instruments, dautres encore et ainsi de suite linfini ; par o lon pourrait sefforcer vainement de prouver que les hommes nont aucun pouvoir de forger le fer. (31) En ralit les hommes ont pu, avec les instruments naturels, venir bout, bien quavec peine et imparfaitement, de certaines besognes trs faciles. Les ayant acheves, ils en ont excut de plus difficiles avec une peine moindre et plus parfaitement et, allant ainsi par degrs des travaux les plus simples aux instruments, de ces instruments dautres travaux et dautres instruments, par un progrs constant, ils sont parvenus enfin excuter tant douvrages et de si difficiles avec trs peu de peine. De mme lentendement avec sa puissance native, se faonne des instruments intellectuels par lesquels il accrot ses forces pour accomplir dautres uvres intellectuelles ; de ces dernires il tire dautres instruments, cest--dire le pouvoir de pousser plus loin sa recherche, et il continue ainsi progresser jusqu ce quil soit parvenu au fate de la sagesse. (32) Quil en soit ainsi pour lentendement, on le verra aisment, pourvu que lon comprenne en quoi consiste la mthode de recherche de la vrit, et quels sont ces instruments naturels par la seule aide desquels il en faonne dautres lui permettant daller de lavant. Pour le montrer je procderai comme il suit : (33) Lide vraie (car nous avons une ide vraie) est quelque chose de distinct de ce dont elle est lide : autre est le cercle, autre lide du cercle. Lide du cercle nest pas un objet ayant un centre
-
et une priphrie comme le cercle, et pareillement lide dun corps nest pas ce corps mme. tant quelque chose de distinct de ce dont elle est lide, elle sera donc aussi en elle-mme quelque chose de connaissable ; cest--dire que lide, en tant quelle a une essence formelle, peut tre lobjet dune autre essence objective et, son tour, cette autre essence objective, considre en elle-mme, sera quelque chose de rel et de connaissable et ainsi indfiniment. (34) Pierre par exemple est un objet rel ; lide vraie de Pierre est lessence objective de Pierre, et en elle-mme elle est aussi quelque chose de rel qui est entirement distinct de Pierre lui-mme. Puis donc que lide de Pierre est quelque chose de rel, elle sera aussi lobjet dune autre ide qui contiendra objectivement en elle tout ce que lide de Pierre contient formellement, et son tour cette ide, qui aura pour objet lide de Pierre, aura aussi son essence qui pourra de mme tre lobjet dune nouvelle ide, et ainsi indfiniment. Chacun peut lprouver en voyant que, sachant ce quest Pierre il sait aussi quil sait, et encore sait quil sait quil sait, etc. Il est constant par l, que pour connatre lessence de Pierre, il nest pas ncessaire que lentendement connaisse lide mme de Pierre et, encore moins, lide de lide de Pierre ; ce qui revient dire que je nai pas besoin pour savoir, de savoir que je sais, et encore bien moins de savoir que je sais que je sais ; pas plus que pour connatre lessence du triangle il nest besoin de connatre celle du cercle. Cest le contraire qui a lieu dans ces ides : pour savoir que je sais, il est ncessaire que je sache dabord. (35) Il suit de l videmment que la certitude nest rien en dehors de lessence objective elle-mme ; cest--dire que la manire dont nous sentons lessence objective est la certitude elle-mme. Mais de l suit videmment que, pour avoir la certitude de la vrit, nulle marque nest ncessaire en dehors de la possession de lide vraie, car, ainsi que nous lavons montr, je nai pas besoin pour savoir de savoir que je sais. Et de l suit de nouveau manifestement que seul peut savoir ce quest la plus haute certitude, celui qui a lide adquate ou lessence objective dune chose : il le faut puisque certitude et essence objective ne font quun. (36) Puis donc que la vrit na besoin daucune marque et quil suffit de possder les essences objectives ou, ce qui revient au mme, les ides des choses pour lever tout doute, il suit de l que la vraie mthode ne consiste pas chercher la marque laquelle se reconnat la vrit aprs lacquisition des ides ; la vraie mthode est la voie par laquelle la vrit elle-mme, ou les essences objectives des choses, ou leurs ides (tous ces termes ont mme signification) sont cherches dans lordre d. (37) La mthode, pour y revenir, doit ncessairement parler du raisonnement ou de laction de connatre ; cest--dire quelle nest pas le raisonnement mme par lequel nous connaissons les causes des choses, encore bien moins la connaissance de ces causes ; elle consiste bien entendre ce quest une ide vraie, en la distinguant des autres perceptions et en en tudiant la nature, de faon prendre connaissance de notre pouvoir de connatre et astreindre notre esprit connatre, selon cette norme, tout ce qui doit tre connu, lui traant de plus titre dauxiliaires des rgles assures et lui pargnant dinutiles fatigues. (38) De l ressort que la Mthode nest pas autre chose que la connaissance rflexive ou lide de lide ; et, ny ayant pas dide dune ide, si lide nest donne dabord, il ny aura donc point de mthode si une ide nest donne dabord. La bonne mthode est donc celle qui montre comment lesprit doit tre dirig selon la norme de lide vraie donne. Deux ides, poursuivrons-nous, soutenant le mme rapport que les essences formelles qui en sont les objets, il sensuit que la connaissance rflexive sappliquant lide de ltre le plus parfait lemporte sur la connaissance rflexive des autres ides ; la mthode la plus parfaite sera donc celle qui montre selon la norme de lide donne de ltre le plus parfait, comment lesprit doit tre dirig. (39) Par o se connat aisment comment lesprit, mesure que sa connaissance stend plus de choses, acquiert de nouveaux instruments lui permettant de continuer avec plus de facilit ltendre. Avant tout en effet, comme il ressort de ce qui a t dit, doit exister en nous, comme un instrument donn de naissance, lide vraie dont la connaissance fasse connatre la diffrence existant entre une perception de cette sorte et toutes les autres. En cela consiste une partie de la mthode. Comme il va de soi, dautre part, que lesprit se connat dautant mieux que sa
-
connaissance de la nature est plus tendue, il est constant que cette premire partie de la mthode sera dautant plus parfaite que lesprit connatra plus de choses et quelle sera parfaite au plus haut point quand lesprit sapplique attentivement ou rflchit la connaissance de ltre le plus parfait. (40) En second lieu, plus lesprit sait de choses, mieux aussi il connat ses propres forces et lordre de la Nature ; mais, mieux il connat ses propres forces et plus aisment il peut se diriger et se donner des rgles ; et mieux il connat lordre de la Nature, plus aisment il peut se prserver des dmarches inutiles ; et cest en quoi consiste toute la mthode comme nous lavons dit. (41) Il faut ajouter quil en est objectivement de lide tout de mme quil en est de son objet. Si donc il existait dans la. Nature quelque chose qui net aucun commerce avec dautres choses, supposer quil y ait de cette chose une essence objective, saccordant en tout avec son essence formelle, elle aussi naurait aucun commerce avec dautres ides, cest--dire que nous nen pourrions rien conclure. Au contraire les choses ayant commerce avec dautres, comme toutes celles qui existent dans la Nature, seront connues et leurs essences objectives auront entre elles, le mme commerce, cest--dire que dautres ides sen dduiront, lesquelles auront leur tour commerce avec dautres et ainsi crotront de nouveaux instruments pour aller plus avant. Ce que je cherchais dmontrer. (42) Pour poursuivre enfin, de ce que nous avons dit en dernier, savoir que lide doit saccorder entirement avec lessence formelle correspondante, il suit clairement que, dune manire gnrale, pour prsenter un tableau de la Nature, notre esprit doit faire sortir toutes ses ides de celle qui reprsente la source et lorigine de la Nature entire, de faon que cette ide soit aussi la source des autres ides. (43) Peut-tre ici stonnera-t-on quaprs avoir dit que la bonne mthode est celle qui montre comment lesprit doit tre dirig selon la norme de lide vraie donne, nous le prouvions par le raisonnement : ce qui semble indiquer que cela nest pas connu de soi. On pourra aussi demander si notre raisonnement est bon. Si notre raisonnement est bon nous devons partir de lide donne, et comme ce point de dpart a lui-mme besoin dune dmonstration, il nous faudrait un second raisonnement pour justifier le premier, puis un troisime pour justifier le second, et ainsi linfini. (44) A quoi je rponds : si quelquun, par un destin qui lui serait advenu, avait march de lavant dans son investigation de la Nature, comme nous lavons expliqu, cest--dire en acqurant des ides nouvelles dans lordre d, selon la norme de lide vraie donne, jamais il net dout de la vrit quil et ainsi possde, parce que la vrit, comme nous lavons dit, se fait connatre elle-mme, et que tout aussi se ft offert lui dun cours spontan. Mais cela nadvient jamais ou advient rarement ; jai donc t oblig de poser ces principes afin que nous puissions acqurir par un dessein prmdit ce qui ne nous est pas chu par destin ; je voulais aussi faire voir que, pour tablir la vrit, et faire de bons raisonnements, nous navons besoin dautres instruments que la vrit elle-mme et le bon raisonnement : jai confirm un bon raisonnement et je mefforce encore de le justifier en raisonnant bien. (45) Ajoutez que de cette faon les hommes saccoutument aux mditations intrieures. La raison dailleurs pour laquelle il advient rarement que, dans ltude de la Nature, on conduise son investigation dans lordre d, ce sont dabord les prjugs dont nous expliquerons plus tard les causes dans notre Philosophie. En second lieu, pour suivre cet ordre, il faut une attention trs exacte et une vue trs distincte, ce qui exige beaucoup dapplication. Enfin cela tient aussi ltat des affaires humaines qui est, comme nous lavons dj montr, trs sujet au changement. Il y a encore dautres raisons que nous ne recherchons pas. (46) Si quelquun demande, comme il se peut, pourquoi moi-mme je nai pas expos dabord, et avant tout, les vrits de la Nature dans lordre d, puisque la vrit se fait connatre elle-mme ? Je rponds en avertissant le lecteur quil se garde quand il rencontrera et l des propositions contraires lopinion commune de les rejeter comme fausses ; que dabord il prenne en considration lordre suivi par nous pour les prouver, et il acquerra la certitude que nous sommes
-
parvenus la connaissance de la vrit ; telle est la raison pour laquelle jai commenc par ces considrations sur la mthode. (47) Si, par la suite, quelque sceptique se trouvait dans le doute lgard de la premire vrit elle-mme et de toutes celles que nous dduirons, selon la norme, de cette premire vrit, cest, ou bien quil parlera contre sa conscience, ou bien nous avouerons quil y a des hommes dont lesprit est compltement aveugle, quil le soit de naissance ou que les prjugs, cest--dire quelque accident extrieur, laient rendu tel. En effet ils nont mme pas conscience deux-mmes : sils affirment quelque chose ou doutent de quelque chose, ils ne savent pas quils affirment ou quils doutent ; ils disent quils ne savent rien, et cela mme quils ne savent rien, ils dclarent lignorer ; encore ne le disent-ils pas sans restriction, car ils craignent de savouer existants, alors quils ne savent rien, si bien quil leur faut enfin garder le silence pour tre srs de ne rien admettre qui ait senteur de vrit. (48) Il faut, en dfinitive, sabstenir de parler de sciences avec eux (car pour ce qui concerne lusage de la vie et de la socit, la ncessit les oblige admettre leur propre existence, chercher ce qui leur est utile, affirmer et nier sous serment bien des choses). Leur prouve-t-on quelque chose, en effet, ils ne savent si largumentation est probante ou dfectueuse. Sils nient, concdent, ou opposent une objection, ils ne savent quils nient, concdent, ou opposent une objection ; il faut donc les considrer comme des automates entirement privs de pense. (49) Revenons maintenant notre dessein : nous avons primo dtermin la Fin vers laquelle nous nous appliquons diriger toutes nos penses. Nous avons reconnu secundo quelle est la Perception la meilleure laide de laquelle nous puissions parvenir notre perfection ; tertio, quelle est la premire Voie o doive sattacher lesprit pour bien commencer : elle consiste, tant donne une ide vraie quelconque, la prendre comme norme pour continuer ses recherches suivant des lois assures. Pour le faire droitement, il faut demander la Mthode : Primo, de distinguer lide vraie de toutes les autres perceptions et de prserver lesprit de ces dernires ; secundo, de tracer des rgles pour percevoir selon cette norme les choses inconnues ; tertio, dinstituer un ordre pour nous pargner dinutiles fatigues. Aprs avoir fait connaissance avec cette mthode nous avons vu quarto, que pour quelle ft la plus parfaite, il fallait que nous eussions lide de ltre le plus parfait. Nous aurons donc au dbut prendre garde avant tout que nous parvenions le plus vite possible la connaissance dun tel tre. (50) Commenons donc par la premire partie de la Mthode qui est, comme nous lavons dit, de distinguer et de sparer lIde vraie des autres perceptions, et dempcher lesprit de confondre les ides fausses, forges et douteuses avec les vraies ; mon intention est dexpliquer cela amplement en cet endroit, afin darrter la pense du lecteur sur une connaissance aussi ncessaire, et aussi parce que beaucoup en sont venus douter mme des choses vraies pour navoir pas pris garde ce qui distingue la perception vraie de toutes les autres. Ils ressemblent ainsi des hommes qui, pendant la veille, ne mettaient dabord pas en doute quils ne fussent veills, mais, stant une fois crus assurs en rve, comme il arrive, quils taient veills, et ayant reconnu par la suite leur erreur, se sont mis douter mme de leurs veilles ; accident dont la raison est quils nont jamais distingu le sommeil davec la veille. (51) Javertis toutefois que je ne traiterai pas ici de lessence de chaque perception et ne lexpliquerai point par sa cause prochaine ; car cela appartient la Philosophie. Jexposerai seulement ce que demande la mthode, cest--dire quel sujet se forme une perception fausse, forge et douteuse, et comment nous arriverons nous en librer. Notre premire enqute aura pour objet lIde Forge. (52) Toute perception a pour objet une chose considre comme existante ou bien seulement une essence et la plupart des fictions ont trait des choses considres comme existantes ; je parlerai donc dabord de cette dernire sorte, savoir celle o seule lexistence est controuve, tandis que la chose que lon se reprsente fictivement dans telle condition est connue ou suppose telle. Par exemple, je forge cette ide que Pierre, que je connais, va la maison, vient me voir et autres choses semblables. Je demande ici quoi se rapporte une pareille ide ? Je vois quelle a trait uniquement aux choses possibles. (53) Jappelle impossible une chose dont la
-
nature implique quil y a contradiction en poser lexistence ; ncessaire une chose dont la nature implique quil y a contradiction nen pas poser lexistence ; possible une chose dont lexistence, par sa nature mme, nimplique pas quil y ait contradiction en poser lexistence ou la non-existence, la ncessit ou limpossibilit de lexistence de cette chose dpendant de causes qui nous sont inconnues tout le temps que nous forgeons lide quelle existe ; par suite, si cette ncessit ou cette impossibilit, qui dpend de causes extrieures, nous tait connue, nous ne pourrions forger aucune fiction au sujet de cette chose. (54) Il sensuit, que sil existe un Dieu ou quelque tre omniscient, cet tre ne peut forger absolument aucune fiction. Pour ce qui nous concerne en effet, sitt que je sais que jexiste je ne puis forger de fiction touchant mon existence ou ma non-existence ; je ne puis non plus me reprsenter un lphant passant parle trou dune aiguille ; ni, quand je connais la nature de Dieu, me le reprsenter fictivement comme existant ou nexistant pas ; on doit reconnatre quil en est de mme touchant la Chimre dont la nature soppose lexistence. Do appert clairement ce que jai dit, savoir que la fiction, dont nous parlons ici, na point lieu au sujet des vrits ternelles. (55) Avant de poursuivre toutefois il faut noter ici en passant que la mme diffrence quil y a entre lessence dune chose et celle dune autre existe aussi entre lactualit ou lexistence de la premire et lactualit ou lexistence de la seconde. Par suite, si nous voulions concevoir lexistence dAdam, par exemple par le moyen de lexistence en gnral, ce serait comme si, pour concevoir lessence dAdam, nous dirigions notre pense sur la nature de ltre et dfinissions Adam comme tant un tre. Cest pourquoi, plus gnralement lexistence est conue, plus aussi elle est conue confusment et plus aisment elle peut tre attribue par fiction toute chose ; au contraire sitt quelle est conue comme lexistence plus particulire dune chose, nous en avons une ide plus claire et lattribuons plus difficilement par fiction (alors que nous ne prenons pas garde lordre de la nature) une autre chose ; ce qui mrite dtre not. (56) Nous avons maintenant considrer les cas o lon dit communment quil y a fiction, bien que nous sachions clairement que la chose nest pas comme nous la forgeons. Par exemple, bien que sachant que la terre est ronde, rien ne mempche de dire quelquun quelle est un hmisphre, telle une demi-orange sur un plat, ou que le soleil se meut autour de la terre et, autres choses semblables. Si nous considrons ces cas avec attention, nous ny verrons rien qui ne saccorde avec nos paroles de tout lheure ; il faut observer seulement dabord quil y a eu un certain moment possibilit de nous tromper et que maintenant nous avons conscience de nos erreurs ; ensuite que nous pouvons forger ou au moins admettre lide que dautres hommes sont dans la mme erreur ou sont capables dy tomber, comme nous lavons t prcdemment. Nous pouvons, dis-je, forger cette ide aussi longtemps que nous ne voyons pas dimpossibilit ni de ncessit. Quand donc je dis quelquun que la terre nest pas ronde, etc., je ne fais pas autre chose que de rappeler mon souvenir lerreur que jai commise peut-tre, ou dans laquelle je pouvais tomber, et ensuite je forge ou jadmets lide que celui qui je parle est encore dans lerreur ou peut y tomber. Je forge cette ide comme je lai dit, aussi longtemps que je ne vois pas dimpossibilit ni de ncessit ; si, en revanche. mon entendement avait peru lune ou lautre, je naurais plus rien pu forger, et il aurait fallu dire seulement que javais fait une certaine tentative. (57) Il nous reste nous occuper des suppositions faites dans les discussions ; suppositions qui ont trait, parfois, mme des impossibilits. Par exemple quand nous disons : supposons que cette chandelle qui brle ne brle pas, ou supposons quelle brle dans quelque lieu imaginaire, cest--dire o nexiste de corps daucune sorte. On fait parfois des suppositions semblables bien que voyant clairement que la dernire est impossible ; mais quand cela arrive on ne forge rien en ralit. Dans le premier exemple en effet je nai rien fait que rappeler mon souvenir un autre exemple de chandelle ne brlant pas (ou que concevoir la mme chandelle sans flamme) et ce que je pense au sujet de cette autre chandelle, je lentends aussi de celle-ci, aussi longtemps que je nai pas gard la flamme. Dans le second exemple on na fait autre chose quabstraire ses penses des corps environnants de faon que lesprit se portt uniquement la contemplation de la chandelle, considre en et pour elle-mme, et en conclt ensuite quelle na en elle aucune cause
-
de destruction : si donc il ny avait point du tout de corps environnants, cette chandelle et aussi cette flamme demeureraient immuables, ou autres choses semblables. Il ny a donc l aucune fiction, mais des assertions pures et simples. (58) Passons maintenant aux fictions ayant trait aux essences seules ou jointes quelque actualit ou existence. Il faut ce sujet considrer surtout que, moins lesprit connat et plus il peroit, plus il est capable de fiction ; et plus il a de connaissances claires, plus ce pouvoir diminue. De mme que, par exemple, comme nous lavons vu plus haut, nous ne pouvons, aussi longtemps que nous pensons, forger lide que nous pensons et que nous ne pensons pas, de mme, quand nous connaissons la nature du corps, nous ne pouvons forger lide dune mouche infinie ou encore, quand nous connaissons la nature de lme, nous ne pouvons forger lide dune me carre, bien que nous puissions exprimer en paroles nimporte quoi. Mais, comme nous lavons dit, moins les hommes connaissent la Nature, plus facilement ils peuvent forger de nombreuses fictions ; telles que des arbres qui parlent, des hommes changs subitement en pierres, en sources, des fantmes apparaissant dans des miroirs, rien devenant quelque chose, mme des Dieux changs en btes et en hommes et une infinit dautres semblables. (59) Quelquun croira peut-tre que la fiction est dlimite par la fiction et non par la connaissance ; cest--dire, quaprs que jai forg lide dune chose et, quusant dune certaine libert, jai voulu donner mon assentiment ce que cette chose existt, telle que je lai forge, dans la nature relle, cela fait quil mest impossible ensuite de la penser diffremment. Par exemple, aprs que jai forg (pour parler leur langage) telle ide sur la nature du corps, et que jai voulu, usant de ma libert, me persuader que cette nature est telle dans la ralit, il ne mest plus possible de forger lide dune mouche infinie et, aprs que jai forg lessence de lme, je ne peux plus la faire carre. (60) 0r, examinons. En premier lieu : ou bien lon nie ou bien lon accorde que nous pouvons connatre quelque chose. Si on laccorde, on devra dire ncessairement de la connaissance ce quon dit de la fiction. Si on le nie, voyons, nous qui savons que nous savons quelque chose, ce que lon dit. On dit ceci : lme peut sentir et percevoir de beaucoup de manires, mais non se percevoir elle-mme, non plus que les choses qui existent ; elle ne peroit que les choses qui ne sont ni en soi ni quelque part que ce soit ; autrement dit, lme pourrait, par sa seule force, crer des sensations et des ides ne correspondant point des choses ; de telle sorte quon la considre en partie comme un Dieu. On dit ensuite : nous avons la libert de nous contraindre, ou, notre me a la libert de se contraindre, bien mieux, de contraindre sa propre libert ; car, aprs quelle a forg lide dune chose et y a donn son assentiment, elle ne peut plus penser autrement cette chose ou en forger une autre ide, et cette fiction la contraint mme avoir des ides telles quil ne soit point contredit la fiction ; comme ici mme on est contraint, pour nabandonner point sa fiction, dadmettre les absurdits que jindique et auxquelles nous ne nous fatiguerons pas opposer des dmonstrations. (61) Laissant de tels adversaires leur dlire, nous prendrons soin plutt de tirer de cet change de paroles quelque vrit utile notre objet, savoir : lesprit qui sapplique attentivement une chose forge et de sa nature fausse pour lexaminer et la connatre, et qui en dduit dans lordre juste ce quil faut en dduire, en rendra aisment la fausset manifeste ; si la chose forge est vraie de sa nature, quand lesprit sapplique attentivement elle pour la connatre, et commencer dduire dans lordre juste ce qui sensuit, il continuera avec succs sans aucune interruption, comme nous avons vu que dans le cas de lide forge fausse, ci-dessus mentionne, lentendement soffre aussitt montrer labsurdit quelle contient et les consquences absurdes qui sen dduisent. (62) Nous navons donc nullement redouter de forger une fiction pourvu que nous percevions la chose clairement et distinctement : sil nous arrive de dire que des hommes sont subitement changs en btes, cela est dit dune faon tout fait gnrale, si bien quil ny a dans lesprit aucune conception de la chose, aucune ide, cest--dire aucune liaison entre un sujet et un prdicat ; si cette liaison existait, on verrait en mme temps le moyen et les causes par o et pourquoi cette mtamorphose a lieu. On ne prend pas garde non plus la nature du sujet et du prdicat. (63) En outre, pourvu seulement quune premire ide ne soit pas forge et que toutes
-
les autres en soient dduites, lempressement forger disparatra peu peu. De plus, une ide forge ne peut tre claire et distincte, mais seulement confuse et toute confusion provient de ce que lesprit connat un entier, ou une chose compose de beaucoup dautres, seulement en partie et ne distingue pas le connu de linconnu ; de ce que, en outre, il sattache la fois aux nombreux lments contenus dans chaque objet sans les distinguer le moins du monde, do il suit : Primo, que si une ide se rapporte une chose trs simple, elle ne pourra tre que claire et distincte. Cette chose en effet ne devra pas tre connue en partie mais ou bien elle le sera tout entire ou il nen sera rien connu. (64) Secundo, que si une chose compose de beaucoup de parties est divise par la pense en toutes ses parties les plus simples et quon soit attentif chacune delles prise part, toute confusion disparatra. Tertio, quune fiction ne peut pas tre simple ; elle nat de la combinaison des diverses ides confuses qui se rapportent des choses et des actions diverses existant dans la Nature, plutt encore de ce que nous sommes attentifs en mme temps, sans leur donner notre assentiment, ces diverses ides ; si la fiction tait simple, en effet, elle serait claire et distincte et par consquent vraie. Si elle naissait dune combinaison dides distinctes, cette combinaison mme serait claire et distincte et par suite vraie. Quand, par exemple, nous connaissons la nature du cercle et aussi celle du carr, il devient impossible de les combiner et de forger un cercle carr ou une me carre ou dantres combinaisons semblables. (65) Concluons donc brivement une fois encore : il nest, nous le voyons, nullement craindre quune fiction soit confondue avec des ides vraies. Pour ce qui concerne dabord la premire sorte de fiction dont nous avons parl, sitt quune chose est conue clairement, nous voyons que si cette chose, qui est conue clairement, est en soi une vrit ternelle, et que son existence en soit une galement, nous ne pouvons forger aucune fiction son sujet ; par contre, si lexistence de la chose conue nest pas une vrit ternelle, il faut seulement prendre soin de confronter lexistence de la chose avec son essence et tre attentif en mme temps lordre de la Nature. Quant la dernire sorte de fiction, nous avons dit quelle consistait dans une attention non accompagne dassentiment porte la fois sur plusieurs ides confuses se rapportant des choses et des actions diverses qui existent dans la nature, et nous avons vu aussi quune chose parfaitement simple ne pouvait tre forge, mais tait un objet de connaissance ; et aussi une chose compose, pourvu que nous fussions attentifs aux parties les plus simples dont elle est compose. Bien plus, nous ne pouvons mme pas, en combinant ces parties, forger des actions qui ne soient pas vraies : car nous sommes obligs de considrer en mme temps comment et pourquoi telle action a lieu. (66) Ayant pris connaissance de ce qui prcde, passons maintenant linvestigation de lIde fausse pour voir quoi elle a trait et comment nous pouvons nous garder de tomber dans des perceptions fausses. Ni lune ni lautre tche ne nous sera difficile aprs notre tude de la fiction. Il ny a en effet aucune diffrence entre elles, sinon que lide fausse implique lassentiment, cest--dire (comme nous lavons dj not) que dans lerreur, au moment de lapparition de certaines images, il ne soffre point de causes do puisse ressortir, comme dans la fiction, que ces images ne proviennent pas de choses extrieures ; lerreur consiste ainsi peu prs rver les yeux ouverts ou pendant ltat de veille. De mme que la fiction, lide fausse se produit au sujet de, ou (pour mieux dire) se rapporte , lexistence dune chose dont lessence est connue ou bien elle a trait une essence. (67) Lerreur relative lexistence se corrige de mme que la fiction ; si en effet la nature de la chose connue implique lexistence ncessaire, il est impossible que nous nous trompions au sujet de lexistence de cette chose ; par contre, si lexistence de la chose nest pas une vrit ternelle, comme lest son essence, mais que la ncessit ou limpossibilit dpende de causes extrieures, alors que lon reprenne et applique tout ce que nous avons dit quand nous parlions de la fiction ; la correction de lerreur se fait de mme. (68) Quant lautre sorte derreur, qui est relative aux essences ou encore aux actions, de telles perceptions sont ncessairement toujours confuses, composes de diverses perceptions confuses de choses existant dans la Nature ; par exemple quand les hommes se persuadent quil y a des divinits dans les forts, les idoles, les btes, etc. ; quil y a des corps de la seule combinaison desquels
-
lentendement puisse natre ; que des cadavres raisonnent, se promnent, parlent ; que Dieu se trompe et autres erreurs semblables. Par contre, les ides qui sont claires et distinctes ne peuvent jamais tre fausses ; car les ides des choses qui sont conues clairement et distinctement sont ou bien parfaitement simples, ou bien composes des ides les plus simples, cest--dire dduites des ides les plus simples. Que dailleurs une ide parfaitement simple ne peut pas tre fausse, cest ce que chacun pourra voir, pourvu quil sache ce quest le vrai, ou lentendement et, en mme temps, ce quest le faux. (69) A lgard, en effet, de ce qui constitue la forme du vrai, il est certain quune pense vraie ne se distingue pas seulement dune fausse par un caractre extrinsque, mais principalement par un caractre intrinsque. Si quelque ouvrier, par exemple, a conu un ouvrage bien ordonn, encore que cet ouvrage nait jamais exist et ne doive jamais exister, la pense ne laisse pas den tre vraie, et cette pense reste la mme que cet ouvrage existe ou non. Au contraire si quelquun dit que Pierre, par exemple, existe, sans quil sache que Pierre existe, cette pense est fausse en ce qui concerne celui qui la forme ou, si lon prfre, nest pas vraie, encore que Pierre existe rellement. Et cette nonciation : Pierre existe, nest vraie quen ce qui concerne celui qui sait avec certitude que Pierre existe. (70) Do suit quil y a dans les ides quelque chose de rel par quoi les vraies se distinguent des fausses ; et nous devons maintenant diriger notre enqute sur ce point afin davoir la meilleure norme de vrit (nous avons dit en effet quil nous fallait dterminer nos penses selon la norme donne de lide vraie et que la mthode est la connaissance rflexive) et de connatre les proprits de lentendement. Il ne faut pas dire dailleurs que la diffrence provient de ce que la pense vraie consiste connatre les choses par leurs premires causes (en quoi elle diffrerait beaucoup la vrit dune fausse, la nature de la pense fausse tant telle que je lai explique ci-dessus) ; car on appelle aussi pense vraie celle qui enveloppe objectivement lessence dun principe qui na pas de cause et est connu en soi et par soi. (71) La forme de la pense vraie doit donc tre contenue dans cette pense mme sans relation dautres, et elle ne reconnat pas comme cause un objet, mais doit dpendre de la puissance mme et de la nature de lentendement. Si nous supposions en effet que lentendement et peru quelque tre nouveau nayant jamais exist, comme le faisait, selon certains, lentendement de Dieu avant quil et cr les choses (et cette perception ne peut assurment provenir daucun objet) et que de cette perception il en et dduit lgitimement dautres, toutes ces penses seraient vraies et ne seraient dtermines par aucun objet extrieur ; mais dpendraient seulement de la puissance et de la nature de lentendement. (72) Pour diriger donc notre enqute, posons-nous devant les yeux quelque ide vraie dont nous sachions avec la plus haute certitude que lobjet dpend de notre pouvoir de penser et na pas dobjet dans la Nature ; cest dans une ide de cette sorte que nous pourrons plus facilement, comme il suit clairement de ce qui prcde, faire notre enqute. Par exemple, pour former le concept dune sphre, je forge une cause volont, savoir quun demi-cercle tourne autour dun centre et quune sphre est comme engendre par cette rotation. Certes cette ide est vraie et, bien que nous sachions que nulle sphre na jamais t engendre de la sorte dans la Nature, cest l cependant une perception vraie et le moyen le plus ais de former le concept dune sphre. Il faut noter dailleurs que cette perception affirme la rotation du demi-cercle ; affirmation qui serait fausse si elle ntait pas jointe au concept de la sphre ou celui de la cause dterminant le mouvement, cest--dire, parlant absolument, si elle tait isole, car lesprit en pareil cas se bornerait affirmer le mouvement du demi-cercle, ce mouvement ntant ni contenu dans le concept du demi-cercle ni issu de celui de la cause dterminant le mouvement. La fausset consiste donc en cela seul quil est affirm dune chose quelque chose qui nest pas contenu dans le concept que nous avons form de cette chose, tel le mouvement ou le repos dans le cas du demi-cercle. Do il suit que les penses simples ne peuvent pas ne pas tre vraies, telle lide simple dun demi-cercle, du mouvement, de la quantit, etc. Ce que ces penses contiennent daffirmation atteint, sans les dpasser, les limites du concept ; nous pouvons donc notre gr, sans avoir derreur craindre, former des ides simples. (73) Il ne nous reste donc qu chercher par quelle puissance notre esprit peut former ces ides et jusquo stend cette
-
puissance ; cela trouv en effet, nous aurons facilement la connaissance la plus haute laquelle nous puissions parvenir. Car il est certain que cette puissance de lesprit ne stend pas linfini quand nous affirmons de quelque chose ce qui nest pas contenu dans le concept que nous en formons, cela indique en effet quil y a en nous un manque de perception, cest--dire que nos penses ou nos ides sont mutiles en quelque sorte et tronques. Nous avons vu que le mouvement dun demi-cercle est faux sitt quil est isol dans lesprit et quil est vrai sil est joint au concept de la sphre ou celui de quelque cause dterminant un tel mouvement. Que si, comme on le voit dabord, il est de la nature dun tre pensant, de former des penses vraies cest--dire adquates, il est certain que nos ides inadquates ont pour unique origine que nous sommes une partie dun tre pensant dont certaines penses dans leur intgrit, certaines seulement par partie, constituent notre esprit. (74) Il importe encore ici davoir gard une rencontre quil ne valait pas la peine de noter en traitant de la fiction et qui est loccasion de lerreur la plus grande, savoir quand certaines choses prsentes limagination sont aussi dans lentendement, cest--dire sont conues clairement et distinctement : en pareil cas, tant que le distinct nest pas distingu du confus, la certitude, cest--dire lide vraie, se mle aux ides non distinctes. Quelques-uns, par exemple, dentre les Stociens ont, par rencontre, entendu parler de lme et aussi de son immortalit, choses quils ne faisaient quimaginer confusment ; ils imaginaient aussi et en mme temps percevaient par lentendement que les corps les plus subtils pntrent tous les autres et ne sont pntrs par aucuns. Imaginant toutes ces choses ensemble et y joignant la certitude de cet axiome, ils taient certains tout aussitt que ces plus subtils dentre les corps sont lesprit, quils ne peuvent tre diviss, etc. (75) Nous nous affranchissons toutefois galement de cette erreur en nous efforant dexaminer toutes nos perceptions selon la norme de lide vraie donne, nous gardant, comme nous lavons dit au commencement, des ides qui nous viennent par ou-dire ou par exprience vague. Il faut ajouter que cette sorte derreur provient de ce que lon conoit les choses dune faon trop abstraite ; car il est de soi assez clair que, ce que je conois dans son vritable objet, je ne puis lappliquer un autre. Lerreur provient aussi de ce quon ne connat pas les premiers lments de toute la Nature, par suite procdant sans ordre et confondant la Nature avec des axiomes abstraits, encore quils soient vrais, on porte en soi-mme la confusion et on renverse lordre de la Nature. Pour nous, si nous procdons de la faon la moins abstraite quil se puisse et partons des premiers lments, cest--dire de la source et de lorigine de la Nature, le plus tt quil se pourra, nous navons pas craindre de nous tromper ainsi. (76) Pour ce qui touche, dailleurs la connaissance de lorigine de la Nature, il nest pas du tout redouter que nous la confondions avec des choses abstraites ; quand en effet on conoit quelque chose abstraitement, comme on fait pour tous les universaux, ces concepts stendent toujours dans lentendement au del des limites o peuvent exister rellement dans la Nature leurs objets particuliers. De plus, comme il y a dans la Nature beaucoup de choses dont la diffrence est si petite quelle chappe presque lentendement, il peut arriver facilement ( les concevoir abstraitement) quon les confonde ; mais, comme nous le verrons plus loin, il ne peut y avoir de lorigine de la Nature de concept abstrait, ni de concept gnral, et cette origine ne peut tre conue par lentendement comme plus tendue quelle nest rellement ; elle na dailleurs aucune ressemblance avec des choses soumises au changement ; aucune confusion nest donc craindre au sujet de son ide, pourvu que nous possdions la norme de la vrit (que nous avons dj indique) ; ltre dont il sagit est unique en effet, infini, cest--dire quil est ltre total hors duquel il ny a pas dtre. (77) Voil pour lide fausse ; il nous reste tudier lIde Douteuse, cest--dire chercher en quoi consiste ce qui peut nous conduire au doute et, en mme temps, comment le doute est lev. Je parle du doute vritable dans lesprit et non de ce doute qui se rencontre maintes fois : savoir quand, par le langage, on prtend douter, bien que lesprit ne doute pas ; ce nest pas la Mthode quil appartient de corriger ce doute, cela rentre plutt dans ltude de lobstination et de son traitement.
-
(78) Il ny a pas dans lme, disons-nous donc, de doute d la chose mme dont on doute, cest--dire sil ny avait dans lme quune seule ide, quelle ft vraie ou fausse, il ny aurait place pour aucun doute et pour aucune certitude ; il ny aurait quune sensation de telle ou telle sorte. Car cette ide nest en soi rien de plus quune sensation de telle ou telle sorte, mais le doute se forme par le moyen dune autre ide qui nest pas si claire et distincte quon en puisse rien conclure de certain lgard de la chose dont on doute, cest--dire que lide qui nous incline au doute nest pas claire et distincte. Par exemple quelquun qui na jamais eu la pense occupe de lillusion des sens - si elle vient de lexprience ou a une autre origine - ne doutera jamais si le soleil est plus grand ou plus petit quil ne parat. Cest ainsi que les paysans stonnent maintes fois, quand ils entendent dire que le soleil est beaucoup plus grand que le globe terrestre ; mais le doute prend naissance en pensant lillusion des sens, et si, aprs avoir dout, on parvient la connaissance vraie des sens et de la faon dont, par leurs organes, les choses sont reprsentes distance, alors le doute sera de nouveau lev. (79) Il suit de l que nous ne pouvons mettre en doute des ides vraies sous prtexte quil existe peut-tre un Dieu trompeur qui nous tromperait dans les choses les plus certaines, sinon quand nous navons encore de Dieu aucune ide claire et distincte, cest--dire quand, par la considration attentive de la connaissance que nous avons de lorigine de toutes choses, nous ne trouvons rien qui nous fasse savoir que Dieu nest pas trompeur aussi clairement que, par la considration attentive de la nature du triangle, nous trouvons que ses trois angles sont gaux deux droits ; mais, si nous avons de Dieu une connaissance telle que du triangle, alors tout doute est lev. Et, de mme que nous pouvons parvenir cette connaissance claire du triangle, bien que ne sachant pas avec certitude si quelque souverain trompeur ne nous gare pas, de mme aussi nous pouvons parvenir une telle connaissance de Dieu, bien que ne sachant pas avec certitude sil nexiste pas quelque souverain trompeur ; et, sitt que nous avons cette connaissance, cela suffit, comme je lai dit, pour lever tout doute que nous pouvons avoir au sujet des ides claires et distinctes. (80) De plus, si lon procde droitement, sappliquant dabord la recherche de ce quil faut chercher premirement, suivant sans aucune interruption lenchanement des choses, et si lon sait comment on doit dterminer les problmes avant dentreprendre de les rsoudre, on naura jamais que les ides les plus certaines, cest--dire claires et distinctes : car le doute nest rien dautre que lindcision de lesprit lgard dune affirmation ou dune ngation quil prononcerait sil ne se trouvait devant lui quelque objet dont lignorance doit rendre imparfaite la connaissance de la chose affirme ou nie. Il ressort de l que le doute nat toujours de ce que les choses sont tudies sans ordre. (81) Telles sont les questions que jai promis de traiter dans cette premire partie de la mthode. Pour ne rien omettre cependant de ce qui peut conduire la connaissance de lentendement et de ses forces, je traiterai encore brivement de la mmoire et de loubli ; y ayant considrer principalement ici que la mmoire acquiert de la force avec le secours de lentendement et aussi sans ce secours. Touchant le premier point, plus une chose est connaissable et plus facilement elle se retient, et au contraire moins elle est connaissable, plus facilement nous loublions. Par exemple, si je donne quelquun un grand nombre de mots sans lien, il les retiendra beaucoup plus difficilement que si je les lui communique sous forme de rcit. (82) La mmoire acquiert aussi de la force sans le secours de lentendement, en raison de la vigueur avec laquelle une chose matrielle singulire affecte limagination ou le sens appel commun. Je dis une chose singulire ; car seules les choses singulires affectent limagination. Si quelquun, par exemple, a lu une seule pice contenant une histoire damour, il la retiendra trs bien tant quil nen aura pas lu plusieurs du mme genre, parce quelle se maintient seule dans son imagination ; mais, sil y a plusieurs objets du mme genre, on les imagine tous la fois et on les confond aisment. Je dis de plus une chose matrielle, car seuls les corps affectent limagination. Puis donc que la mmoire acquiert de la force par lentendement et sans lui, il sensuit quelle doit
-
tre quelque chose de distinct de lentendement et qu lgard de lentendement considr en lui-mme, il ny a ni mmoire ni oubli. (83) Que sera donc la mmoire ? Rien dautre que la sensation des empreintes qui sont dans le cerveau, jointe une pense relative une dure dtermine de cette sensation, comme le montre la rminiscence. Dans la rminiscence, en effet, lme a la pense de cette sensation, mais non sous la forme dune dure continue ; et ainsi lide de la sensation nest pas la dure mme de la sensation, cest--dire quelle nen est pas proprement la mmoire. Quant savoir si les ides elles-mmes sont sujettes quelque corruption, nous le verrons dans la Philosophie. Et, si quelquun trouvait cela trs absurde, il suffit pour notre dessein de considrer que plus une chose est singulire, plus aisment on la retient, comme il appert de lexemple ci-dessus donn de la comdie. En outre, plus une chose est connaissable, plus aisment on la retient. Do suit que nous ne pourrons ne pas retenir une chose singulire au plus haut point, pour peu quelle soit connaissable. (84) Nous avons donc distingu entre lIde Vraie et les autres perceptions et nous avons montr que les ides forges, fausses et autres, ont leur origine dans limagination, cest--dire dans certaines sensations fortuites (pour ainsi parler) et sans lien qui ne naissent pas du pouvoir qua lesprit, mais de causes extrieures selon que le corps, soit dans le rve, soit ltat de veille, reoit tels ou tels mouvements. Que si on le prfre, on entende ici par imagination tout ce quon voudra, pourvu que ce soit quelque chose de distinct de lentendement et par quoi lme puisse prendre la condition de patient ; car la faon de lentendre ne fait pas de diffrence, sitt que nous savons que limagination est quelque chose dindtermin par o lme ptit, et en mme temps comment nous nous en librons laide de lentendement. On ne stonnera donc pas que je ne prouve pas encore ici lexistence du corps et dautres choses ncessaires connatre, et que je parle cependant de limagination, du corps et de sa constitution. Comme je lai dit en effet, ce que jentends par l ne fait pas de diffrence, sitt que je sais que cest quelque chose dindtermin, etc. (85) Nous avons montr cependant que lide vraie est simple, ou compose dides simples, telle lide faisant connatre comment et pourquoi une chose existe ou a eu lieu ; nous avons montr aussi quil en dcoule dans lme des effets objectifs proportionns lessence formelle de son objet ; cela revient ce quont dit les anciens : que la vraie science procde de la cause aux effets ; cela prs cependant que, jamais que je sache, on na conu, comme nous ici, lme agissant selon des lois dtermines et telle quun automate spirituel. (86) Par l nous avons, autant quil se pouvait au dbut, acquis la connaissance de notre entendement, et une norme de lide vraie telle que nous nayons plus craindre de confondre la vrit avec lerreur et la fiction ; nous verrons maintenant sans tonnement que nous puissions connatre certaines choses qui ne tombent en aucune faon sous limagination, quil y en ait dans limagination qui contredisent lentendement et quil y en ait aussi qui saccordent avec lui. Nous savons en effet que ces oprations, do naissent les images, se produisent selon dautres lois, entirement diffrentes des lois de lentendement, et que lme, en ce qui concerne limagination, est dans la condition dun patient. (87) Par l se voit aussi avec quelle facilit peuvent tomber dans de grandes erreurs ceux qui nont pas distingu trs exactement entre limagination et la connaissance. Dans cette classe rentrent, par exemple, les erreurs suivantes : que ltendue, dont les parties se distinguent rellement les unes des autres, doit tre en un lieu, quelle doit tre finie, quelle est le premier et unique fondement de toutes choses, et occupe un moment un espace plus grand qu un autre et beaucoup dautres opinions de mme sorte qui sont toutes entirement contraires la vrit comme nous le montrerons en son lieu. (88) Ensuite, comme les mots sont une partie de limagination, cest--dire comme nous forgeons beaucoup de concepts suivant que, par une disposition quelconque du corps, les mots sassemblent sans ordre dtermin dans la mmoire, il ne faut pas douter quils ne puissent,
-
autant que limagination, tre cause de nombreuses et grandes erreurs, si nous ne nous mettons pas fortement en garde contre eux. (89) Ajoutez quils sont forms au gr du vulgaire et selon sa manire de voir ; de sorte quils sont des signes des choses, telles quelles sont dans limagination et non telles quelles sont dans lentendement, comme il se voit clairement de ce que lon a souvent appliqu toutes les choses qui sont seulement dans lentendement et ne sont pas dans limagination des noms ngatifs, par exemple : incorporel, infini, etc., et aussi de ce que lon exprime ngativement beaucoup de choses qui sont en ralit affirmatives et inversement comme : incr, indpendant, infini, immortel, parce queffectivement nous imaginons avec beaucoup plus de facilit leurs contraires et que ces dernires se sont ainsi offertes les premires aux premiers hommes et ont accapar les termes affirmatifs. Beaucoup daffirmations et de ngations prennent naissance parce que la nature des mots sy prte, et non la nature des choses ; cest pourquoi si nous ignorions cela nous prendrions facilement le faux pour le vrai. (90) Nous vitons, en outre, une autre grande cause de confusion qui empche que lentendement ne rflchisse sur lui-mme : en effet, quand nous ne distinguons pas entre limagination et lentendement, nous croyons que ce qui est plus facilement imagin est aussi plus clair pour nous, et ce que nous imaginons nous croyons le connatre. Par suite nous mettons devant ce qui doit venir aprs, lordre vrai suivant lequel il nous faut avancer est renvers et aucune conclusion lgitime nest possible. (91) Pour arriver maintenant la Deuxime Partie de cette Mthode, jindiquerai dabord le but que nous nous proposons dans cette Mthode, puis les moyens de latteindre. Le but est davoir des ides claires et distinctes, cest--dire des ides telles quelles proviennent de la pense pure et non des mouvements fortuits du corps. Ensuite, pour ramener toutes ces ides lunit, nous nous efforcerons de les enchaner et de les ordonner de telle faon que notre esprit, autant quil se peut faire, reproduise objectivement ce qui est formellement dans la nature, prise dans sa totalit aussi bien que dans ses parties. (92) Touchant le premier point, il est comme nous lavons dj dit, requis pour notre fin quune chose soit conue ou bien par sa seule essence ou par sa cause prochaine : savoir, si une chose existe en soi ou, comme on dit communment, est cause de soi, elle devra alors tre connue par sa seule essence ; si, au contraire, une chose nexiste pas en soi mais requiert une cause pour exister, alors elle doit tre connue par sa cause prochaine ; car en ralit connatre leffet nest pas autre chose quacqurir une connaissance plus parfaite de la cause. (93) Nous ne devrons donc jamais, tant quil sagira dtudier les choses relles, tirer des conclusions de concepts abstraits et nous prendrons grand garde ne pas mler ce qui est seulement dans lentendement avec ce qui est dans la ralit. Mais la conclusion la meilleure est celle qui se tirera dune essence particulire affirmative, ou, dune dfinition vraie et lgitime. Car des seuls axiomes universels lentendement ne peut descendre aux choses singulires, puisque les axiomes stendent linfini et ne peuvent dterminer lentendement considrer une chose singulire plutt quune autre. (94) La voie droite pour inventer est donc de former des penses en partant dune dfinition donne, ce que nous ferons avec dautant plus de succs et de facilit que nous aurons mieux dfini une chose. Ainsi le point capital en toute cette deuxime partie de la mthode consiste en ceci seulement : connatre les conditions dune bonne dfinition, et ensuite donner le moyen den trouver. Je traiterai donc en premier lieu des conditions de la Dfinition. (95) Pour quune dfinition soit dite parfaite elle devra exprimer lessence intime de la chose et nous prendrons garde qu la place de cette essence, nous ne mettions certaines proprits de la chose. Pour claircir cela, dfaut dautres exemples que jcarte pour navoir pas lair de vouloir mettre en lumire les erreurs des autres, je prendrai seulement lexemple dune chose trs abstraite que lon peut, sans que cela fasse de diffrence, dfinir dune manire quelconque, savoir le cercle : si on le dfinit une figure ou les lignes menes du centre la circonfrence sont gales, il nest personne qui ne voie que cette dfinition nexprime pas du tout lessence du cercle,
-
mais seulement une de ses proprits. Et bien que, comme je lai dit, cela importe peu quand il sagit de figures et dautres tres de raison, cela importe beaucoup ds quil sagit dtres physiques et rels : effectivement les proprits des choses ne sont pas clairement connues aussi longtemps quon nen connat pas les essences ; si nous passons outre sans nous arrter aux essences, nous renverserons ncessairement lenchanement des ides qui doit reproduire dans lentendement lenchanement de la Nature, et nous nous loignerons tout fait de notre but. (96) Pour nous librer de cette faute, il faudra observer dans la dfinition les rgles suivantes : I. Sil sagit dune chose cre, la dfinition devra, comme nous lavons dit, comprendre en elle la cause prochaine. Par exemple, le cercle selon cette rgle devrait tre dfini ainsi : une figure qui est dcrite par une ligne quelconque dont une extrmit est fixe et lautre mobile ; cette dfinition comprend clairement en elle la cause prochaine. II. Le concept dune chose, ou sa dfinition, doit tre tel que toutes les proprits de la chose puissent en tre conclues, alors quon le considre seul, sans y joindre dautres concepts, ainsi quon peut le voir dans cette dfinition du cercle ; car on en conclut clairement que toutes les lignes menes du centre la circonfrence sont gales ; et, que ce soit l une condition ncessaire de la dfinition, cela est de soi si vident pour celui qui y prend garde, quil ne parat pas quil vaille la peine de sarrter le dmontrer, non plus que de tirer de cette deuxime condition cette consquence que toute dfinition doit tre affirmative. Je parle dune affirmation de lentendement, minquitant peu de la verbale, laquelle, cause du manque de mots pourra bien loccasion sexprimer sous une forme ngative, bien quelle soit entendue affirmativement. (97) Quant aux conditions dune dfinition sappliquant une chose incre, ce sont les suivantes : I. Elle doit exclure toute cause, cest--dire que lobjet ne doit avoir besoin pour sexpliquer daucune chose en dehors de son tre propre. II. Une fois donne la dfinition de la chose, il ne doit plus y avoir place pour cette question : existe-t-elle ? III. Elle ne doit pas, eu gard lesprit, contenir de substantifs dont on puisse faire des adjectifs, cest--dire quelle ne doit pas sexprimer par des termes abstraits. IV. Enfin (bien que ce ne soit pas trs ncessaire noter), il faut que de cette dfinition se puissent conclure toutes les proprits de la chose. Tout cela est vident pour quiconque est attentif. (98) Jai dit aussi que la meilleure conclusion se tirera dune essence particulire affirmative : car plus une ide est spciale, plus elle est distincte, et claire par consquent. Do suit que nous devons chercher par-dessus tout la connaissance des choses particulires. (99) Relativement lordre maintenant et pour ordonner et unir toutes nos perceptions, il est requis et la raison demande, que nous cherchions, aussitt quil se peut faire, sil existe un tre, et en mme temps quel il est, qui soit cause de toutes choses, de manire que son essence objective soit aussi cause de toutes nos ides, et alors notre esprit, comme je lai dit, reproduira la Nature aussi parfaitement que possible. Car il en possdera objectivement et lessence et lordre et lunit. Par l nous pouvons voir quavant tout il nous est ncessaire de tirer toujours toutes nos ides de choses physiques, cest--dire dtres rels, allant, autant quil se pourra, suivant la suite des causes, dun tre rel un autre tre rel, et cela sans passer aux choses abstraites et gnrales, vitant galement de conclure de ces choses quelque chose de rel, on de conclure ces choses dun tre rel, car lun et lautre interrompent la vritable marche en avant de lentendement. (100) Il est noter toutefois que, par la suite des causes et des choses relles, je nentends pas ici la succession des choses singulires soumises au changement, mais seulement la suite des choses fixes et ternelles. Pour ce qui touche en effet la suite des choses singulires soumises au changement, il serait impossible la faiblesse humaine de la saisir, tant cause de leur multitude suprieure tout nombre, qu cause des circonstances infinies runies dans une seule et mme chose, circonstances dont chacune peut faire que la chose existe ou nexiste pas ; puisque lexistence de ces choses na aucune connexion avec leur essence cest--dire, comme nous
-
lavons dj dit, nest pas une vrit ternelle. (101) Mais il nest pas du tout ncessaire non plus que nous en connaissions la succession, puisque les essences des choses singulires soumises au changement ne doivent pas tre tires de cette succession, cest--dire de leur ordre dexistence, lequel ne nous offre rien dautre que des dnominations extrinsques, des relations ou, au plus, des circonstances, toutes choses bien loignes de lessence intime des choses. Cette essence, au contraire, doit tre acquise des choses fixes et ternelles et aussi des lois qui y sont, on peut dire, vritablement codifies et suivant lesquelles arrivent et sordonnent toutes les choses singulires ; en vrit, ces choses singulires soumises au changement dpendent si intimement et si essentiellement (pour ainsi dire) des choses fixes, quelles ne pourraient sans ces dernires ni tre ni tre conues. Ces choses fixes et ternelles, bien quelles soient singulires, seront donc pour nous, cause de leur prsence partout et de leur puissance qui stend au plus loin, comme des universaux ou des genres lgard des dfinitions des choses singulires et comme les causes prochaines de toutes choses. (102) Puisquil en est ainsi toutefois, une difficult, non petite, semble inhrente lentreprise de parvenir la connaissance de ces choses singulires ; car de tout concevoir la fois, cela dpasse de beaucoup les forces de lentendement humain. Or lordre suivant lequel il faut quune chose soit connue avant une autre ne doit pas, nous lavons dit, se tirer de la succession des existences, ni non plus des choses ternelles ; car en elles toutes les choses singulires sont donnes par nature la fois. Il nous faudra donc ncessairement chercher dautres secours que ceux dont nous usons pour connatre les choses ternelles et leurs lois ; ce nest cependant pas le lieu ici den traiter, et ce nest pas ncessaire tant que nous naurons pas acquis une connaissance suffisante des choses ternelles et de leurs lois infaillibles et que la nature de nos sens ne nous sera pas connue. (103) Il sera temps, avant dentreprendre de connatre les choses singulires, de traiter de ces secours qui se rapportent tous cette fin : savoir nous servir de nos sens et faire, daprs des rgles et dans un ordre arrt, des expriences suffisantes pour dterminer la chose que lon tudie, de faon en conclure enfin selon quelles lois des choses ternelles elle est faite et prendre connaissance de sa nature intime, comme je le montrerai en son lieu. Ici, pour revenir notre dessein, je mefforcerai seulement dindiquer ce qui parat ncessaire pour que nous puissions parvenir la connaissance des choses ternelles, et en formions des dfinitions conformes aux conditions ci-dessus nonces. (104) Pour cela il nous faut rappeler notre souvenir ce qui a t dit plus haut, savoir que, si lesprit sattache une pense quelconque afin de lexaminer soigneusement et den dduire en bon ordre ce qui sen dduit lgitimement, en cas quelle soit fausse il en dcouvrira la fausset ; si au contraire elle est vraie, alors il continuera avec succs en dduire sans aucune interruption des choses vraies ; cela, dis-je, est requis pour notre objet. Car sans un principe nos penses ne peuvent tre dtermines. (105) Si donc nous voulons prendre comme objet dtude la chose qui est la premire de toutes il est ncessaire quil y ait quelque principe qui dirige nos penses de ce ct. En outre, puisque la mthode est la connaissance rflexive elle-mme, ce principe, qui doit diriger nos penses, ne peut tre autre chose que la connaissance de ce qui constitue la forme de la vrit, et la connaissance de lentendement, de ses proprits et de ses forces ; quand nous laurons acquise en effet nous possderons un principe do nous pourrons dduire nos penses, et une voie par laquelle lentendement pourra, dans la mesure de sa comprhension, parvenir la connaissance des choses ternelles, ayant gard ses propres forces. (106) Sil appartient cependant la nature de la pense de former des ides vraies, comme on la montr dans la premire partie, il faut chercher ici ce que nous entendons par les Forces et la Puissance de lentendement. Or, si cest la partie principale de notre Mthode de connatre parfaitement les forces de lentendement et sa nature, nous nous voyons ncessairement obligs (par ce qui a t dit dans cette deuxime partie de la mthode) de dduire cette connaissance de la dfinition mme de la pense et de lEntendement. (107) Mais nous navons jusquici pas eu de rgles pour trouver des dfinitions et, comme nous ne pouvons poser ces rgles sans une
-
dfinition de lEntendement et de sa puissance, il suit de l que, ou bien la dfinition de lEntendement doit tre claire par elle-mme ou que nous ne pouvons rien connatre clairement. Or cette dfinition nest pas par, ou en elle-mme, parfaitement claire. Puisque cependant, pour que nous puissions percevoir clairement et distinctement les proprts de lEntendent, il faut que la nature nous en soit connue (comme de tout ce dont nous avons une Vritable connaissance), la dfinition de lentendement sclaircira delle-mme si nous considrons avec attention les proprits lui appartenant dont nous avons une ide claire et distincte. Nous numrerons donc les Proprits de lEntendement et nous les examinerons soigneusement et nous commencerons traiter de nos instruments natifs. (108) Les proprits de lentendement que jai principalement remarques et que je connais sont les suivantes : I. Il enveloppe en lui la certitude, cest--dire il sait que les choses sont formellement comme elles sont contenues en lui objectivement. II. Il peroit certaines choses, autrement dit, il forme certaines ides absolument, en forme dautres ides. Ainsi il forme lide de quantit absolument, sans avoir gard dautres, mais il ne forme pas les ides de mouvement sans avoir gard lide de quantit. III. Les ides quil forme absolument expriment une infinit ; quant aux ides dtermines, il les forme dautres ides. Ainsi pour lide de quantit : quand il la peroit par sa cause, alors il dtermine une quantit, comme, par exemple, quand il conoit que du mouvement dune surface nat un corps, du mouvement dune ligne une surface, de celui dun point une ligne ; toutes ces perceptions ne servent pas rendre plus claire lide de quantit mais seulement dterminer une quantit. Cela se reconnat ce que nous concevons ces choses comme si elles naissaient du mouvement, alors que cependant nous ne percevons pas le mouvement avant davoir peru la quantit et que nous pouvons aussi prolonger linfini le mouvement qui engendre la ligne, ce qui nous serait impossible si nous navions pas lide de la quantit infinie. IV. Il forme des ides positives avant den former de ngatives. V. Il peroit les choses non tant dans la dure que sous une certaine forme dternit et dinfinit numrique, ou plutt il na gard, pour percevoir les choses, ni au nombre ni la dure. Cest quand il se reprsente les choses par limagination quil les peroit sous la forme dun nombre dtermin, dune dure et dune quantit dtermines. VI. Les ides que nous formons claires et distinctes semblent dcouler de la seule ncessit de notre nature, de telle faon quelles paraissent dpendre absolument de notre puissance seule ; cest le contraire pour les ides confuses ; car celles-l se forment souvent en dpit de nous. VII. Lesprit peut dterminer de beaucoup de manires les ides des choses que lentendement form dautres ides ; cest ainsi que, pour dterminer, par exemple, une surface elliptique, il se reprsente une pointe applique contre une corde et se mouvant autour de deux points fixes, ou conoit des points infinis en nombre qui soutiennent un certain rapport constant avec une ligne droite, ou encore un cne coup par un plan oblique dont langle dinclinaison soit plus grand que langle au sommet du cne, ou procde encore dune infinit dautres manires. VIII. Les ides sont dautant plus parfaites quil y a plus de perfection dans lobjet quelles expriment : nous nadmirons pas autant lartiste qui a conu lide dune pagode que celui qui a conu lide dun temple magnifique. (109) Je ne marrte pas ici aux autres modes qui appartiennent encore la pense, comme lamour, la joie, etc., car ils ne font rien notre prsent dessein et ne peuvent tre conus quon nait dabord peru lentendement. Quon supprime en effet compltement la perception ils sont tous supprims. (110) Les ides fausses et forges nont rien de positif (comme je lai suffisamment montr) par quoi elles mritent la dnomination de fausses et de forges ; mais cest seulement un manque de connaissance qui les rend telles quon les considre. Donc les ides fausses et forges ne peuvent, comme telles, rien nous apprendre de lessence de la pense ; cette connaissance doit tre acquise des proprits positives ci-dessus passes en revue ; cest--dire quon doit maintenant tablir
-
quelque chose de commun do ces proprits dcoulent ncessairement, cest--dire tel que, lexistence en tant pose, elles suivent ncessairement, et, lexistence en tant leve, elles soient toutes leves.

![Karl Marx, Quaderno Spinoza - iliesi.cnr.it · In Spinoza (ed. Gebhardt): 5 [Spinoza aggiunge subito et ad necem dgcanfflr (e mandate a morte)]. Qaademo Spinoza [45] bonae …](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5ba0256f09d3f2c2598c3c6d/karl-marx-quaderno-spinoza-in-spinoza-ed-gebhardt-5-spinoza-aggiunge.jpg)