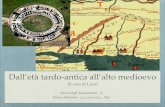REVUE D’HISTOIRE DES TEXTES - unina.it · 2017-05-02 · Fedro e la favola latina tra Antichità...
Transcript of REVUE D’HISTOIRE DES TEXTES - unina.it · 2017-05-02 · Fedro e la favola latina tra Antichità...

REVUEDrsquoHISTOIRE DES TEXTES
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
REVUEDrsquoHISTOIREDES TEXTES
nouvelle seacuterie
TOME XI
2016
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
All rights reserved No part of this publication may be reproduced
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise
without prior permission of the publisher
copy 2016 Turnhout (Belgium)
Printed in Belgium D2016009579
ISBN 978-2-503-56597-2 ISSN 0373-6075
SOMMAIRE
ARTICLES
Maria Chiara Scappaticcio Aesopi fabellas narrare condiscantthinsp les papyrus les Hermeneumata et lrsquoapprentissage du latin danslrsquoOrient grec 1
Raffaella cantore Correzioni nel testo dellrsquoAnabasi del Pari-gino gr 1640 37
Pantelis GolitSiS The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisiasrsquo commentary on Aristotlersquos Metaphysicsthinsp towards anew critical edition 55
Patrick Morantin Un teacutemoin de la lecture du Venetus A agrave la Renaissancethinsp lrsquoeacutedition princeps drsquoHomegravere annoteacutee par VettorFausto (Marcianus gr IX35) 95
Aude cohen-Skalli Les Vitae Siculorum et Calabrorum deConstantin Lascaristhinsp le texte et ses sources 135
David paniaGua Sul ms Roma Bibl Vallicelliana E 26 e sulla trasmissione manoscritta di Polemio Silviothinsp un nuovo testi-mone (poziore) per due sezioni del Laterculus 163
Courtney M Booker Addenda to the Transmission Historyof Dhuodarsquos Liber Manualis 181
Irene Villarroel Fernaacutendez De opusculis Prosperi excerpta huic operi inserere uolui Proacutespero de Aquitania en el Speculum maiusde Vicente de Beauvais 215
Silvia nocentini Il problema testuale del Libro di divina dot-trina di Caterina da Sienathinsp questioni aperte 255
NOTES
David Murphy Βασίλειαν for laquothinspkingdomthinspraquothinsp Self-replicatingerrors in editions of Sosicrates Strabo and Isocrates 295
Salvador iranzo aBellaacuten Jose Carlos Martiacuten-iGleSiaS Un nuevo manuscrito de la Epistula ad Eugenium episcopum (CPL 1210) atribuida a Isidoro de Sevilla 301
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
REVUEDrsquoHISTOIREDES TEXTES
nouvelle seacuterie
TOME XI
2016
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
All rights reserved No part of this publication may be reproduced
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise
without prior permission of the publisher
copy 2016 Turnhout (Belgium)
Printed in Belgium D2016009579
ISBN 978-2-503-56597-2 ISSN 0373-6075
SOMMAIRE
ARTICLES
Maria Chiara Scappaticcio Aesopi fabellas narrare condiscantthinsp les papyrus les Hermeneumata et lrsquoapprentissage du latin danslrsquoOrient grec 1
Raffaella cantore Correzioni nel testo dellrsquoAnabasi del Pari-gino gr 1640 37
Pantelis GolitSiS The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisiasrsquo commentary on Aristotlersquos Metaphysicsthinsp towards anew critical edition 55
Patrick Morantin Un teacutemoin de la lecture du Venetus A agrave la Renaissancethinsp lrsquoeacutedition princeps drsquoHomegravere annoteacutee par VettorFausto (Marcianus gr IX35) 95
Aude cohen-Skalli Les Vitae Siculorum et Calabrorum deConstantin Lascaristhinsp le texte et ses sources 135
David paniaGua Sul ms Roma Bibl Vallicelliana E 26 e sulla trasmissione manoscritta di Polemio Silviothinsp un nuovo testi-mone (poziore) per due sezioni del Laterculus 163
Courtney M Booker Addenda to the Transmission Historyof Dhuodarsquos Liber Manualis 181
Irene Villarroel Fernaacutendez De opusculis Prosperi excerpta huic operi inserere uolui Proacutespero de Aquitania en el Speculum maiusde Vicente de Beauvais 215
Silvia nocentini Il problema testuale del Libro di divina dot-trina di Caterina da Sienathinsp questioni aperte 255
NOTES
David Murphy Βασίλειαν for laquothinspkingdomthinspraquothinsp Self-replicatingerrors in editions of Sosicrates Strabo and Isocrates 295
Salvador iranzo aBellaacuten Jose Carlos Martiacuten-iGleSiaS Un nuevo manuscrito de la Epistula ad Eugenium episcopum (CPL 1210) atribuida a Isidoro de Sevilla 301
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

REVUEDrsquoHISTOIREDES TEXTES
nouvelle seacuterie
TOME XI
2016
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
All rights reserved No part of this publication may be reproduced
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise
without prior permission of the publisher
copy 2016 Turnhout (Belgium)
Printed in Belgium D2016009579
ISBN 978-2-503-56597-2 ISSN 0373-6075
SOMMAIRE
ARTICLES
Maria Chiara Scappaticcio Aesopi fabellas narrare condiscantthinsp les papyrus les Hermeneumata et lrsquoapprentissage du latin danslrsquoOrient grec 1
Raffaella cantore Correzioni nel testo dellrsquoAnabasi del Pari-gino gr 1640 37
Pantelis GolitSiS The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisiasrsquo commentary on Aristotlersquos Metaphysicsthinsp towards anew critical edition 55
Patrick Morantin Un teacutemoin de la lecture du Venetus A agrave la Renaissancethinsp lrsquoeacutedition princeps drsquoHomegravere annoteacutee par VettorFausto (Marcianus gr IX35) 95
Aude cohen-Skalli Les Vitae Siculorum et Calabrorum deConstantin Lascaristhinsp le texte et ses sources 135
David paniaGua Sul ms Roma Bibl Vallicelliana E 26 e sulla trasmissione manoscritta di Polemio Silviothinsp un nuovo testi-mone (poziore) per due sezioni del Laterculus 163
Courtney M Booker Addenda to the Transmission Historyof Dhuodarsquos Liber Manualis 181
Irene Villarroel Fernaacutendez De opusculis Prosperi excerpta huic operi inserere uolui Proacutespero de Aquitania en el Speculum maiusde Vicente de Beauvais 215
Silvia nocentini Il problema testuale del Libro di divina dot-trina di Caterina da Sienathinsp questioni aperte 255
NOTES
David Murphy Βασίλειαν for laquothinspkingdomthinspraquothinsp Self-replicatingerrors in editions of Sosicrates Strabo and Isocrates 295
Salvador iranzo aBellaacuten Jose Carlos Martiacuten-iGleSiaS Un nuevo manuscrito de la Epistula ad Eugenium episcopum (CPL 1210) atribuida a Isidoro de Sevilla 301
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
All rights reserved No part of this publication may be reproduced
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise
without prior permission of the publisher
copy 2016 Turnhout (Belgium)
Printed in Belgium D2016009579
ISBN 978-2-503-56597-2 ISSN 0373-6075
SOMMAIRE
ARTICLES
Maria Chiara Scappaticcio Aesopi fabellas narrare condiscantthinsp les papyrus les Hermeneumata et lrsquoapprentissage du latin danslrsquoOrient grec 1
Raffaella cantore Correzioni nel testo dellrsquoAnabasi del Pari-gino gr 1640 37
Pantelis GolitSiS The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisiasrsquo commentary on Aristotlersquos Metaphysicsthinsp towards anew critical edition 55
Patrick Morantin Un teacutemoin de la lecture du Venetus A agrave la Renaissancethinsp lrsquoeacutedition princeps drsquoHomegravere annoteacutee par VettorFausto (Marcianus gr IX35) 95
Aude cohen-Skalli Les Vitae Siculorum et Calabrorum deConstantin Lascaristhinsp le texte et ses sources 135
David paniaGua Sul ms Roma Bibl Vallicelliana E 26 e sulla trasmissione manoscritta di Polemio Silviothinsp un nuovo testi-mone (poziore) per due sezioni del Laterculus 163
Courtney M Booker Addenda to the Transmission Historyof Dhuodarsquos Liber Manualis 181
Irene Villarroel Fernaacutendez De opusculis Prosperi excerpta huic operi inserere uolui Proacutespero de Aquitania en el Speculum maiusde Vicente de Beauvais 215
Silvia nocentini Il problema testuale del Libro di divina dot-trina di Caterina da Sienathinsp questioni aperte 255
NOTES
David Murphy Βασίλειαν for laquothinspkingdomthinspraquothinsp Self-replicatingerrors in editions of Sosicrates Strabo and Isocrates 295
Salvador iranzo aBellaacuten Jose Carlos Martiacuten-iGleSiaS Un nuevo manuscrito de la Epistula ad Eugenium episcopum (CPL 1210) atribuida a Isidoro de Sevilla 301
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

SOMMAIRE
ARTICLES
Maria Chiara Scappaticcio Aesopi fabellas narrare condiscantthinsp les papyrus les Hermeneumata et lrsquoapprentissage du latin danslrsquoOrient grec 1
Raffaella cantore Correzioni nel testo dellrsquoAnabasi del Pari-gino gr 1640 37
Pantelis GolitSiS The manuscript tradition of Alexander of Aphrodisiasrsquo commentary on Aristotlersquos Metaphysicsthinsp towards anew critical edition 55
Patrick Morantin Un teacutemoin de la lecture du Venetus A agrave la Renaissancethinsp lrsquoeacutedition princeps drsquoHomegravere annoteacutee par VettorFausto (Marcianus gr IX35) 95
Aude cohen-Skalli Les Vitae Siculorum et Calabrorum deConstantin Lascaristhinsp le texte et ses sources 135
David paniaGua Sul ms Roma Bibl Vallicelliana E 26 e sulla trasmissione manoscritta di Polemio Silviothinsp un nuovo testi-mone (poziore) per due sezioni del Laterculus 163
Courtney M Booker Addenda to the Transmission Historyof Dhuodarsquos Liber Manualis 181
Irene Villarroel Fernaacutendez De opusculis Prosperi excerpta huic operi inserere uolui Proacutespero de Aquitania en el Speculum maiusde Vicente de Beauvais 215
Silvia nocentini Il problema testuale del Libro di divina dot-trina di Caterina da Sienathinsp questioni aperte 255
NOTES
David Murphy Βασίλειαν for laquothinspkingdomthinspraquothinsp Self-replicatingerrors in editions of Sosicrates Strabo and Isocrates 295
Salvador iranzo aBellaacuten Jose Carlos Martiacuten-iGleSiaS Un nuevo manuscrito de la Epistula ad Eugenium episcopum (CPL 1210) atribuida a Isidoro de Sevilla 301
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
VI SoMMaire
Antonio arBea Javier Beltraacuten Notas criacuteticas para unanueva edicioacuten de Emporia de Tito Livio Frulovisi 319
Elena SpanGenBerG yaneS Giuseppe Giusto Scaligero e Pri-scianothinsp una collazione cinquecentesca dellrsquoArs Grammatica 333
Fabienne henryot Les manuscrits theacuteologiques drsquoAncienReacutegimethinsp vestiges production typologie 367
DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

DOI 101484JRHT5110484
Revue drsquohistoire des textes ns t XI 2016 1-36 copy
AESOPI FABELLAS NARRARE CONDISCANTthinsp LES PAPYRUS LES HERMENEUMATA
ET LrsquoAPPRENTISSAGE DU LATIN DANS LrsquoORIENT GREC
1 Aesopi fAbell Ae
La ratio loquendi et lrsquoenarratio auctorum ndash qui eacutetaient respectivement la partie meacutethodique et technique de la grammaire lrsquoune propeacutedeu-tique par rapport agrave lrsquoautre ndash eacutetaient les deux laquothinspnoyauxthinspraquo qui compo-saient le domaine du grammairien et qui preacuteparaient le chemin afin que ses eacutelegraveves peacuteneacutetrassent dans les mailles de lrsquoapprentissage de la rheacutetorique Avant qursquoils fussent assez mucircrs pour srsquoinitier au cours des rhetores les grammatici familiarisaient leurs eacutelegraveves avec des exercices preacuteparatoires ndash quaedam dicendi primordia dans la bouche de Quinti-lien προγυμνάσματα dans celle des rheacuteteurs grecsthinsp1 Le premier de ces exercices de lrsquoInstitutio oratoria a pour centre la fablethinsp les jeunes eacutelegraveves devaient apprendre agrave raconter les fables en un style correct et simple et agrave les reacuteeacutecrire avec la mecircme simpliciteacute En premier lieu ils devaient transposer les vers en prose les eacuteclairer avec des mots dif-feacuterents et puis reacutediger une paraphrasethinsp2 Un exercice de ce genre est
thinsp La preacutesente contribution a eacuteteacute preacutesenteacutee sous forme abreacutegeacutee au mois de mars 2015 agrave lrsquoAtelier Meacutediolatin agrave lrsquoinvitation de lrsquoEacutequipe drsquoaccueil SAPRAT (Savoirs et Pratiques du Moyen Acircge au xixe siegravecle) de lrsquoEacutecole pratique des Hautes Eacutetudes de Paris et gracircce agrave Madame Anne-Marie Turcanthinsp elle srsquoinscrit dans la recherche de PLATINUM (Papyri and Latin Textsthinsp Insights and Updated Methodologies Towards a philological literary and historical approach to Latin papiri ndash ERC-StG 2014 no 636983) projet de recherche pour lrsquoeacutetude et la valo-risation des textes latins sur papyrus Une nouvelle eacutedition critique annoteacutee des papyrus latins et bilingues des fables preacutesenteacutees ici est en cours
thinsp(1) Quint inst 1 9 1thinsp sur ce passage de Quintilien voir T ViljaMa a From grammar to rhetoric First exercises in composition according to Quintilian Inst 1 9 in Arctos 22 1988 p 179-201thinsp J H henderSon Quintilian and the Prog ymnasmata in Antike und Abenland 37 1991 p 82-99thinsp et plus reacutecemment M PuGliarello fedro nella scuola del grammaticus in C MordeGlia Lupus in fabula Fedro e la favola latina tra Antichitagrave e Medioevo Studi offerti a Ferruccio Bertini Bologna 2014 p 76-77 Il ne serait pas superf lu de souligner que dans les manuscrits Ambrosianus E 153 sup (ixe siegravecle) et Bernensis 351 (ixe siegravecle) le titre donneacute agrave cette section est De officio grammatici
thinsp(2) Quint inst 1 9 2thinsp igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime suc-cedunt narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente deinde eandem gracilitatem
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio2
difficile aussi pour des maicirctres expertsthinsp une fois que le jeune eacutetudiant se sera entraicircneacute sur cet exercice il sera precirct pour avancer dans le domaine du rheacuteteurthinsp3
Quintilien parle des Aesopi fabellae des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquothinsp un court-circuit est immeacutediatement perccedilu par le lecteur au moment ougrave il lit que les eacutelegraveves doivent drsquoabord laquothinsptraduirethinspraquo en prose les vers de ces fables parce que les fables connues sous le nom drsquoEacutesope sont deacutejagrave en prose Lrsquohypothegravese de John P Postgate selon laquelle Quintilien fait allusion agrave la mise en prose des fables en vers de Phegravedre (fondeacutees sur le modegravele drsquoEacutesope) nrsquoa pas eu grand succegraves Francis H Colson lrsquoa immeacutediatement reacutefuteacutee en soutenant que ni Phegravedre ni les autres auteurs de fables ne pouvaient constituer matiegravere agrave lrsquoenseignement scolairethinsp4 Cependant ce point de vue doit ecirctre contesteacutethinsp la fable est lrsquoun des genres pratiqueacutes dans les eacutecoles de lrsquoAntiquiteacute et on a des teacutemoignages litteacuteraires (les chapitres laquothinspgrammaticauxthinspraquo de lrsquoInstitutio de Quintilien les traiteacutes rheacutetoriques drsquoAelius Theacuteon et Aphthonios les Praeexercitamina de Priscien) et aussi des teacutemoignages laquothinspdirectsthinspraquo qui viennent des eacutecoles crsquoest-agrave-dire les papyrus avec des fables plus ou moins partielles en grec etou en latin lieacutes aux milieux scolaires drsquoOrient mais aussi les manuels des Hermeneumata Pseudodositheana
Cette laquothinspimpreacutecisionthinspraquo demeure dans le texte de Quintilien mais elle se reacutevegravele fictive si on compare ce contexte avec des lignes du cinquiegraveme livre de lrsquoInstitutio En donnant une galerie drsquoexemples neacutecessaires aux orateurs pour structurer un discours bien fondeacute pour lrsquoanalyse des eacutepreuves Quintilien mentionne le cas des exemples pris des contextes poeacutetiques et souligne la force des fablesthinsp avec leur goucirct agreacuteable les fables attirent surtout les paysans et les naiumlfsthinsp5 Une
stilo exigere condiscantthinsp versus primo solvere mox mutatis verbis interpretari tum paraphrasi audacius vertere qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur Sur lrsquoimportance de ce contexte pour la deacutefinition ancienne de paraphrase voir J-F Cottier La paraphrase latine de Quintilien agrave Eacuterasme in Revue des Eacutetudes Latines 80 2002 p 237-252
thinsp(3) Quint inst 1 9 3thinsp quod opus etiam consummatis professoribus difficile qui com-mode tractaverit cuicumque discendo sufficiet Il est opportun de souligner qursquoon ne trouve aucune reacutefeacuterence agrave la fable en tant que genre laquothinspgrammaticalthinspraquo dans le De grammaticis de Sueacutetone ougrave la seule mention (Suet gramm 25 4) est plutocirct lieacutee aux mythes lus dans les ouvrages poeacutetiques (R A KaSter C Suetonius Tranquillus De Grammaticis et Rhetoribus Oxford 1995 p 282-283)
thinsp(4) Qursquoil suffise de renvoyer agrave J P PoStGate Phaedrus and Seneca in Classical Review 33 1919 p 19-24 et F H ColSon Phaedrus and Quintilian I92 A Reply to Professor Postgate in Classical Review 33 1919 p 59-61 et au commentaire de A Pennacini (eacuted) Quintiliano Instituto Oratoria I-II Torino 2001 p 834-835
thinsp(5) Quint inst 5 11 19thinsp voir aussi Priscien M PaSSalacqua Prisciani Cae-sarensis Opuscula I De figuris numerorum De metris Terentii Praeexercitamina Roma 1987 34 13-14thinsp sciendum vero quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti
aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 3
petite parenthegravese drsquolaquothinsphistoire de la traditionthinspraquo est ouverte par Quin-tilien qui preacutecise que mecircme si les fables nrsquoont pas eacuteteacute creacuteeacutees par Eacutesope (mais par Heacutesiode) elles sont connues comme laquothinspeacutesopiquesthinspraquothinsp6 La reacutefeacuterence aux laquothinspfables drsquoEacutesopethinspraquo est donc geacuteneacuterique et il faudrait plutocirct parler de laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo sans neacutecessairement identifier les fables mentionneacutees par Quintilien avec les fables de Phegravedre en seacutenaires iambiques
Le fabuliste thrace affranchi drsquoAuguste Phegravedre devait avoir pour modegravele un mateacuteriel mixte dans lequel ne manquaient pas des fables meacutetriques drsquoauteurs plus ou moins connus venues enrichir le corpus drsquoEacutesopethinsp7thinsp Phegravedre parle de ses fables comme fabulae Aesopiae plutocirct que Aesopithinsp8 et il a eacuteteacute deacutemontreacute que lrsquoEacutesope mentionneacute par Phegravedre nrsquoest qursquoun preacutedeacutecesseur de lrsquoEacutesope connu par la Collectio Augustanathinsp9 Le fabuliste (romainthinsp) Babrius pouvait lui aussi connaicirctre des modegraveles en vers helleacutenistiques lors de son opeacuteration program-matique qui remonte au iie siegravecle apregraves J-C de laquothinspmise en megravetrethinspraquo des fables laquothinspdrsquoEacutesopethinspraquo peut-ecirctre connues par le recueil de Deacutemeacutetrios de Phalegravere eacutelegraveve du philosophe Theacuteophraste agrave la fin du iVe siegravecle
thinsp(6) Quint inst 5 11 19thinsp etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (scil fabellae) (nam videtur earum primus auctor Hesiodus) nomine tamen Aesopi maxime celebrantur
thinsp(7) Sur la tradition et sur les sources de Phegravedre voir F rodriacuteGuez adr a-doS History of the Graeco-Latin Fable vol 1 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 1999 p 120-128 et vol 2 Leiden-Boston-Koumlln 2000 p 121-173 (en particulierthinsp p 129-131thinsp 167-173)thinsp N holzBerG The Ancient Fable An Introduction Bloomington 2002 p 39-52 et plus reacutecemment E ChaMplin Phaedrus the Fabulous in Journal of Roman Studies 95 2005 p 97-123thinsp sur la tradition manuscrite et la complexiteacute drsquoidentif ication drsquoun corpus original des fables de Phegravedre il serait ici suffisant de renvoyer agrave P K MarShall sv Phaedrus in L D Reynolds (eacuted) Texts and Transmission A Survey of the Latin Classics Oxford 1983 p 300-302thinsp S Boldrini Note sulla tradizione manoscritta di Fedro Roma 1990thinsp J HenderSon Phaedrusrsquo lsquoFablesrsquo The Original Corpus in Mnemosyne 52 1999 p 308-329 et P Gatti Ancora su Fedro Ademaro Perotti in MordeGlia cit n 1 p 125-130 Lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition critique des fables de Babrius et Phegravedre par B E Perry Babrius and Phaedrus London-Cambridge 1965 (p xi-cii) reste fondamentale De faccedilon programma-tique Phegravedre soutient avoir laquothinsppolithinspraquo en seacutenaires iambiques la matiegravere drsquoEacutesope (1 prol 1-2thinsp Aesopus auctor quam materiam repperit | hanc ego polivi versibus senariis)
thinsp(8) Phaedr 4 prol 10-14thinsp quare Particulo quoniam caperis fabulis | (quas Aeso-pias non Aesopi nomino | quia paucas ille ostendit ego pluris fero | usus vetusto genere sed rebus novis) | quartum libellum qum vacarit perlegesthinsp voir rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 20-21
thinsp(9) rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 71-72 Sur la Collectio Augustana voir le cadre traceacute par rodriacuteGuez adr adoS vol 1 cit n 7 p 60-90 et vol 2 cit n 7 p 275-357 mais aussi la recherche de C A ZaFiropouloS Ethics in Aesoprsquos fablesthinsp The Augustana Collection Leiden-Boston-Koumlln 2001 et holzBerG cit n 7 p 84-95
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio4
avant J-Cthinsp10 Il a eacuteteacute soutenu en effet que le processus de versifica-tion de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere a deacutebuteacute au iiie siegravecle avant J-C au sein du mouvement Cyniquethinsp11
Seacutenegraveque fait aussi reacutefeacuterence aux Aesopei logoi au moment ougrave il suggegravere agrave Polybius un remegravede contre sa douleur crsquoest-agrave-dire de reprendre son travail dans le domaine des lettres et se deacutedier agrave la lecture Seacutenegraveque est bien conscient qursquoune acircme aussi rudement frappeacutee que celle de Polybius ne saurait srsquoadonner tout de suite agrave la litteacuterature frivole et leacutegegravere et consacrer la gracircce de son style agrave la composition de fables et drsquoapologues eacutesopiques Bien qursquoil ne fasse aucune allusion agrave lrsquoouvrage de Phegravedre puisqursquoil soutient que la fable constitue un genre auquel le geacutenie romain ne srsquoest pas encore essayeacute Seacutenegraveque nous suggegravere qursquoagrave son eacutepoque il circule des fables preacutetendument laquothinspeacutesopiquesthinspraquo (vraisem-blablement en grec)thinsp12
Il est aussi question de Aesopia trimetria dans une lettre envoyeacutee par le grammairien Ausone au preacutefet du preacutetoire Sextus Petronius Pro-bus dans les anneacutees soixante-dix du iVe siegravecle La lettre devait accom-pagner deux livres le deuxiegraveme eacutetant neacutecessaire pour lrsquoeacuteducation des fils de Sextus Petronius Probusthinsp la Chronica de Cornelius Nepos et les Apologues de Iulius Titianus une version latine des fables eacutesopiques en trimegravetres mise au point par ce maicirctre de rheacutetorique du iie-iiie siegraveclethinsp13
thinsp(10) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 214 (mais en geacuteneacuteral p 175-220) mais voir aussi holzBerG cit n 7 p 22-25 Sur les restes des vers anciens dans la tradition de Babrius voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 594-600 Sur Babrius ses bornes chronologiques et ses sources voir M J Luz-zatto A La penna Babrius Mythiambi Aesopei Leipzig 1986 p Vi-xxii mais aussi p 100-119 et holzBerG cit n 7 p 52-63 Sur les caracteacuteristiques et la reconstruction possible de la collection des fables de Deacutemeacutetrios de Phalegravere voir rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 410-497
thinsp(11) Une analyse deacutetailleacutee en est donneacutee par rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 538-585 Il ne serait pas superf lu drsquoajouter agrave ces argumentations le cas du O Claud II 413 (LDAB 146 = MP3 5293) un ostrakon scolaire du iie siegravecle ougrave une fable eacutesopique est suivie par drsquoautres petits textes parmi lesquels on trouve un apophtegme de Diogenes Cynicus
thinsp(12) Sen cons Pol 8 3thinsp non audeo te eo usque producere ut fabellas quoque et Aesopeos logos intentatum Romanis ingeniis opus solita tibi venustate conectasthinsp difficile est quidem ut ad haec hilariora studia tam vehementer perculsus animus tam cito possit accedere Sur ce contexte voir M noslashjGa ard La fable antique II Koslashbenhavn 1967 p 155 et aussi puGliarello cit n 1 p 75
thinsp(13) Auson epist 11 74-81 (R P H Green The works of Ausonius Oxford 1991 p 204 = ep 11 74-85 L Mondin Decimo Magno Ausonio Epistole Venezia 1995 p 29)thinsp apologos en misit tibi | ab usque Rheni limite | Ausonius nomen Italum | praeceptor Augusti tui | Aesopiam trimetriam | quam vertit exili stilo | pedestre concinnans opus | fandi Titianus artifex Sur ce contexte le commentaire de Green cit p 619 et 622 est syntheacutetiquethinsp voir aussi le commentaire de Mondin cit p 164-165
aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 5
Agrave propos de lrsquoopeacuteration faite par Iulius Titianus dans son ouvrage Ausone utilise vertere le verbe usuel pour syntheacutetiser lrsquoopeacuteration com-plexe de laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautrethinsp14 La ressemblance avec le contexte de Quintilien sur les Aesopi fabellae a plutocirct conduit agrave sup-poser que dans ce cas vertere ne deacutesigne pas une laquothinsptraductionthinspraquo drsquoune langue agrave lrsquoautre ndash donc du grec eacutesopique (ou de Babrius) au latin ndash mais une paraphrase en prose des fables latines meacutetriques de Phegravedre drsquoautant plus que le parallegravele entre lrsquoAesopia trimetria drsquoAusone et la fabula Aesopia du prologue du quatriegraveme livre des fables de Phegravedre est eacutevident et que lrsquoon peut supposer une inf luence du fabuliste sur le maicirctre de Bordeauxthinsp15 En effet lrsquoAesopĭa trimetria ne repreacutesentent pas quelque chose drsquoidentique aux fabulae Aesopīaethinsp dans le contexte drsquoAusone lrsquoadjectif Aesopĭus deacuterive du correspondant grec en -ιος alors que le Aesopīus de Phegravedre deacuterive de la forme en -ειος Mais Ausone savait aussi ce que signifie vertere en latin des fables grecquesthinsp lrsquoeacutepigramme avec la fable sur le meacutedecin Eunomus est clairement fondeacutee sur le modegravele drsquoune fable grecque que lrsquoon retrouve dans la tradition eacutesopique et dans la collection de Babriusthinsp16 Dans la Gaule du iie siegravecle lrsquoexercice de traduction en latin des fables grecques eacutetait donc connu et vraisemblablement pratiqueacute dans les eacutecoles puisque le maicirctre Ausone nous en laisse un eacutechantillon On ne peut non plus eacutecarter la possibiliteacute que le maicirctre Titianus en ait fait autant en laquothinsptra-duisantthinspraquo en latin de lrsquoAesopia trimetria en grec Il srsquoagit drsquoun exercice qui a eu du succegraves et qui a beaucoup circuleacute Les papyrus et les Her-meneumata Pseudodositheana nous en donnent un teacutemoignage eacutevident
thinsp(14) Sur la valeur de ce verbe voir M Bettini Vertere Unrsquoantropologia della traduzione nella cultura antica Torino 2012
thinsp(15) Dans cette perspective voir la recherche de S Mattiacci Favola ed epi-grammathinsp interazioni tra generi lsquominorirsquo (a proposito di Phaedr 5 8thinsp Auson epigr 12 e 79 Green) in Studi Italiani di Filologia Classica 104 2011 p 197-232 en particulier p 210-212 et aussi le commentaire de Mondin cit n 13 p 164-165 et aussi plus reacutecemment puGliarello cit n 1 p 80-81 k thr aede Zu Ausonius ep 12 2 Sch in Hermes 96 1968 p 608-628 avait identif ieacute plutocirct un recueil de fables qui eacutetait la paraphrase latine drsquoiambes grecs agrave la diffeacuterence de L HerMann Les fables Pheacutedriennes de Iulius Titianus in Latomus 30 1971 p 678-686 qui a bien insisteacute sur la nature pheacutedrienne de lrsquoAesopia trimetria paraphraseacutee par Titianus Sur ce sujet voir aussi F Bertini Interpreti medievali di Fedro Napoli 1998 p 7 (qui pense agrave Babrius) et holzBerG cit n 7 p 64
thinsp(16) Auson epigr 79 (Green cit n 13 p 86-87) voir le commentaire de Green cit n 13 p 410 et de P dr aumlGer Decimus Magnus Ausonius Saumlmtliche Werke Band 2thinsp Trierer Werke Trier 2011 p 771-775 mais aussi la contribution speacutecifique de D GaGliardi Sui modi del vertere di Ausonio (a proposito dellrsquoepigr 4 P) in Studi Italiani di Filologia Classica 7 1989 p 207-212
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio6
Manuel bilingue heacuteriteacute par lrsquoAntiquiteacute qui a transiteacute entre lrsquoOrient et lrsquoOccident les Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute assez connus et diffuseacutes dans lrsquoEurope carolingiennethinsp17 Une liste de mots latins concernant la sphegravere seacutemantique du corps humain avec ses eacutequiva-lents grecs est connue gracircce agrave un manuscrit ayant appartenu agrave Mar-tin de Laon et il est fort possible que Reacutemi drsquoAuxerre ait consulteacute des dictionnaires bilingues greacuteco-latin au moment ougrave il travaillait sur son commentaire des Partitiones de Priscien Le fait que les Hermeneu-mata aient eacuteteacute connus agrave Laon et Auxerre aux Viiie-ixe siegravecles ne signi-fie pas neacutecessairement qursquoils eacutetaient aussi connus dans la forme fixeacutee par la tradition manuscrite carolingienne dans la Gaule du iVe siegravecle Mais en tant que typologie de manuel scolaire ou mieux typologie drsquoinstrument fonctionnel pour lrsquoapprentissage du latin par les helleacute-nophones et du grec par les latinophones on ne peut pas exclure que la formule des textes avec le latin en face du grec (ou vice versa) et donc la pratique de vertere drsquoune langue agrave lrsquoautre ait eacuteteacute connue dans lrsquoAntiquiteacute tardive aussi en Gaulethinsp il srsquoagissait drsquoune pratique eacutedu-cative preacuteconiseacutee par certains grammairiens et rheacuteteurs agrave partir de lrsquoAntiquiteacute
Les laquothinspfables eacutesopiquesthinspraquo impliquent donc la reacutefeacuterence agrave un ensemble complexethinsp les Aesopiae fabellae repreacutesentent plutocirct une laquothinspeacutetiquettethinspraquo partageacutee par des teacutemoins drsquoune tradition compliqueacutee et (presque) anonyme Au deacutebut il srsquoagissait drsquoune tradition populaire Le leacutegen-daire Eacutesope aurait veacutecu au Vie siegravecle avant J-Cthinsp agrave partir de ce moment parler de laquothinspfable eacutesopiquethinspraquo signifiait parler de la tradition fabulistique grecquethinsp18 Mecircme sa Vie (la Vita Aesopi) ndash une reacuteeacutelabora-tion byzantine drsquoun Roman drsquoEacutesope perdu peut-ecirctre deacutejagrave mise au point au iie siegravecle apregraves J-C ndash ne repreacutesente qursquoun folkbook ouvrage eacutecrit des mains de plusieurs auteurs anonymes qui ont remanieacute au cours du temps un texte dont le noyau originaire est perdu On ne connaicirct pas non plus sa provenancethinsp on a suggeacutereacute lrsquoOrientthinsp19 En
thinsp(17) Dans cette perspective voir A C dioniSotti Greek Grammars and Dictio-naries in Carolingian Europe in M W Herren (eacuted) The sacred Nectar of the Greeksthinsp The Study of Greek in the West in the Early Middle Ages London 1988 p 1-56 en particulier sur la circulation de ce mateacuteriel en France p 9 et 26-31
thinsp(18) rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 14thinsp laquothinspHis name (scil drsquoEacutesope) was used from then onwards to define most of the Greek fable terminologi-callythinspraquothinsp en geacuteneacuteral sur lrsquousage de lrsquoeacutetiquette de laquothinspfable drsquoEacutesopethinspraquo voir p 13-17 mais aussi zaFiropouloS cit n 9 p 10-12
thinsp(19) Qursquoil suffise de mentionner G A Karla Vita Aesopi Uumlberlieferung Sprache und Edition einer fruumlhbyzantinischen Fassung des Aumlsopromans Wiesbaden 2001 (en par-ticulier agrave lrsquointroduction agrave lrsquoeacutedition p 1-17) aussi pour des renvois agrave des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires
aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 7
effet outre la tradition manuscrite meacutedieacutevale on conserve plusieurs fragments de papyrus dateacutes entre le iie et le Viie siegravecle apregraves J-C qui transmettent des sections textuelles des recensions speacutecifiques de la Vita et ils proviennent tous drsquoEacutegyptethinsp20
Les fables Aesopiae repreacutesentaient eacutegalement pour les auteurs de lrsquoAntiquiteacute tardive un noyau complexe ougrave conf luait un mateacuteriel drsquoorigines tregraves diverses On srsquoen aperccediloit dans un petit opuscule de Priscien qui est une traduction des Προγυμνάσματα drsquoun auteur inconnu deacutejagrave au temps de lrsquoarcheacutetype de notre tradition ndash peut-ecirctre le Pseudo-Hermogegravene ou Libaniosthinsp21 On peut trouver dans ce texte un effort pour ramener agrave la culture romaine les exemples qui eacutetaient pertinents dans la culture grecque et aussi une sympathie pour cer- tains auteurs contemporains comme Nikolaos de Myrathinsp22thinsp ces Praeexer- citamina avaient eacuteteacute conccedilus par le grammairien Priscien avec le De figuris numerorum et le De metris Terentii agrave lrsquoinvitation de Symmaque consul en 485 et exeacutecuteacute en 525 agrave qui est adresseacutee lrsquoeacutepicirctre qui ouvre le triptyque
2 la tradition de la FaBle danS leS eacutecoleS (deS rheacuteteurS)
La polyseacutemie du mot μύθος constitue une difficulteacute lieacutee agrave la langue grecque et moins agrave la langue latine dans laquelle la distinction entre le mythe ( fabula) et la fable ( fabella) est plutocirct marqueacuteethinsp23 mecircme si Phegravedre parle de ses fables comme de fabulae Au niveau de lrsquoenseigne-ment rheacutetorique le μύθος est la matiegravere des Προγυμνάσματα mais aussi des Τέχναι Ῥητορικαί avec la diffeacuterence que les deuxiegravemes ne font que montrer le prestige et la seacuteduction du mythe pour ajouter de la force agrave son propre discours Ils sont adresseacutes agrave un public plutocirct acircgeacute ayant une bonne expeacuterience de la pratique oratoire qursquoils souhaitent en revanche perfectionner Dans les Τέχναι Ῥητορικαί le μύθος est utiliseacute en tant que mythethinsp aucune place nrsquoest laisseacutee agrave la fable
thinsp(20) Pour une synthegravese voir karla cit n 19 p 10-11thinsp(21) paSSalacqua cit n 5 33 8-11thinsp nominantur autem ab inventoribus fabularum
aliae Cypriae aliae Libycae aliae Sybariticae omnes autem communiter Aesopiae quoniam in conventibus frequenter solebat Aesopus fabulis uti Sur ce contexte voir aussi puGlia-rello cit n 1 p 83-84
thinsp(22) Sur les Praeexercitamina de Priscien voir lrsquoeacutedition reacutecente de paSSalacqua cit n 5 (en particulier p xxii-xxiV)
thinsp(23) Sur les noms de la fable latine voir D SLuşAnSCHi Phegravedre et les noms de la fable in Voces 6 1995 p 107-113
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio8
qui reacutepond quant agrave elle aux exigences plus strictement didactiques et formatrices des Προγυμνάσματαthinsp24
Comme genre populaire la fable ne cachait pas son caractegravere naiumlf et ludique laquothinspDiscours mensonger fait agrave lrsquoimage de la veacuteriteacutethinspraquothinsp25 qursquoil srsquoagisse ou non du miroir drsquoune eacutecole philosophique la fable est lisible dans de multiples perspectives ndash et souvent ambigueumls ndash susceptibles de plusieurs interpreacutetations connues des maicirctres (et aussi des lec-teurs)thinsp26 La morale est un de ses eacuteleacutements constituants qui explicite lrsquoexemplariteacute du reacutecit la preacuteceacutedant ou la suivant La fable repreacutesente un veacutehicule pour lrsquoapprentissage des eacutethiques surtout pour les enfants et les ignorantsthinsp27thinsp au niveau des eacutecoles elle avait une double fonction formative dans la perspective grammaticale (et rheacutetorique) et dans la perspective morale Les grammairiens et les rheacuteteurs se servaient des fables pour leur esprit eacutethique leacuteger et agreacuteablethinsp28
La simpliciteacute de lrsquoexpression et la clarteacute de lrsquoornement eacutetaient deux eacuteleacutements fondamentaux que les eacutelegraveves devaient reproduire et qui en mecircme temps assuraient une plus grande faciliteacute pour laquothinspapprendre par cœur toutes les fables offrant cette qualiteacute de preacutesentation qursquoon peut trouver chez les anciens mecircmesthinspraquothinsp29 Les eacutelegraveves devaient avoir une grande quantiteacute de fables soit parce qursquoils rassemblaient celles des auteurs anciens soit parce qursquoils eacutecoutaient les fables raconteacutees par leurs maicirctresthinsp30
thinsp(24) Le rocircle des mythes et des fables dans la rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale est bien analyseacute dans la contribution de A GanGloFF Mythes fables et rheacutetorique agrave lrsquoeacutepoque impeacuteriale in Rhetorica 20 2002 p 25-56thinsp sur la fable rheacutetorique voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 1 p 128-132 et la synthegravese claire de holzBerG cit n 7 p 29-31
thinsp(25) Ael Theon 72 28 (M Patillon Aelius Theacuteon Prog ymnasmata Paris 1997 p 30)thinsp μῦθός ἐστι λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειανthinsp cette deacutefinition remonte probablement aux origines de la theacuteorie des προγυμνάσματα qursquoon retrouve chez Apthonios dont la doctrine ne paraicirct pas deacutependre de celle de Theacuteon
thinsp(26) T MorGan Fables and the Teaching of Ethics in J A Feacuternandez del-Gado F pordoMinGo A StraMaGlia (eacuted) Escuela y Literatura en Grecia Antigua Cassino 2007 p 401-403 Sur le but moral de la fable dans le systegraveme eacuteducatif voir aussi B LeGraS Morale et socieacuteteacute dans la fable scolaire grecque et latine drsquoEacuteg ypte in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7 1996 p 51-80
thinsp(27) Quint inst 5 11 19-20 sur lequel voir supra n 6thinsp(28) MorGan cit n 26 p 403thinsp laquothinspWhatever their precise education value
however diff icult they were to use they were used and the ideas were staples of popular ethical thinkingthinspraquo Il suffirait de renvoyer agrave Priscien paSSalacqua cit n 5 33 4-6thinsp hanc (scil fabulam) primam tradere pueris solent oratores quia animas eorum adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitae
thinsp(29) Ael Theon 74 13-15 (patillon cit n 25 p 33)thinsp(30) Ael Theon 76 1-6 (patillon cit n 25 p 35)
aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 9
On lisait deacutejagrave ces fables qursquolaquothinspon (hellip) appelle eacutesopiques libyennes ou sybaritiques phrygiennes ciliciennes cariennes eacutegyptiennes et chy-priennesthinspraquothinsp31 chez Aelius Theacuteon (1egravere moitieacute du iie siegravecle apregraves J-C) Comme exercice scolaire la fable laquothinspprend diverses formesthinsp preacutesenta-tion f lexion mise en contexte avec un reacutecit allongement et abreacutege-mentthinsp on peut aussi y ajouter une morale et inversement agrave partir drsquoune morale donneacutee imaginer une fable qui lui convienne Agrave quoi srsquoajouteront la contestation et la confirmationthinspraquothinsp32thinsp la description de lrsquoexercice par Aelius Theacuteon est tregraves attentivethinsp33 Ses Προγυμνάσματα eacutetaient agrave lrsquousage des maicirctres de rheacutetorique pour preacuteparer les ado-lescents agrave lrsquoeacutetude de la rheacutetorique proprement dite avec une seacuterie de quinze exercices propeacutedeutiques Une partie de ces exercices prenait le relais de lrsquoenseignement du grammairien et la fable est lrsquoun drsquoentre eux
Plus de deux siegravecles plus tard le sophiste et rheacuteteur Aphthonios nrsquoest pas de la mecircme opinion non plus que le compilateur des Προγυμνάσματα connus comme le Pseudo-Hermogegravenethinsp34 En tant que genre litteacuteraire lrsquoexercice de la fable est neacutecessairement lieacute aux conditions linguistiques de sa production Agrave travers des discours conformes aux regravegles du genre fondeacutee sur la paraphrase et lrsquoimi-tation la finaliteacute de la fable est la creacuteation drsquoun reacutecit qui illustre la morale et en deacutemontre le bien-fondeacute Crsquoest cela qui permet agrave la fable de se rattacher agrave la rheacutetorique La structure de la fable scolaire nrsquoest pas tregraves diffeacuterente de lrsquoexercice de Quintilien mais la pratique grecque supposait un effort suppleacutementaire de la part de lrsquoeacutelegraveve crsquoest-agrave-dire la creacuteation de ses propres fablesthinsp35 Le Pseudo-Hermogegravene
thinsp(31) Ael Theon 73 1-3 (patillon cit n 25 p 31) Sur la tradition de la fable orientale et son inf luence dans la tradition grecque voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 287-333 (sur la fable eacutegyptienne en particulier p 328-333) Les prog ymnasmata drsquoAelius Theacuteon du Pseudo-Hermogegravene drsquoAphthonios de Nikolaos de Myra et du commentaire agrave Aphthonios de Jean de Sarde sont publieacutes en seule traduction anglaise par G A Kennedy Prog ymnasmata Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric Leiden-Boston 2003
thinsp(32) Ael Theon 74 3-9 (patillon cit n 25 p 32 avec traduction)thinsp(33) patillon cit n 25 p Viii-xVi et sur le rapport avec la deacutefinition de
Quintilien p xii-xiii En geacuteneacuteral sur la fable dans le traiteacute drsquoAelius Theacuteon voir p xliV-lV
thinsp(34) Pour un essai de datation des deux rheacuteteurs voir M Patillon Corpus rhetoricum Anonyme Preacuteambule agrave la rheacutetorique Aphthonios Prog ymnasmata Pseudo- Hermogegravene Prog ymnasmata Paris 2008 p 49-52 et 165-170thinsp voir aussi p 52-61 pour une comparaison de ses theacuteories avec lrsquoouvrage posteacuterieur de Nikolaos de Myra
thinsp(35) Apht prog ym 1 1-5 (patillon cit n 34 p 112-113 avec commentaire aux p 218-219)thinsp cf aussi Ps-Herm 1 1-10 (patillon cit n 34 p 180-183 avec
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio10
deacutecrit une autre pratique courante qui consiste agrave deacutevelopper ou agrave abreacuteger les fablesthinsp36
Le biographe et patriarche Photius (ixe siegravecle) nous a transmis un recueil de quarante fables eacutesopiques sous le nom drsquoAphtho-nios et lrsquoidentiteacute de lrsquoauteur de cette compilation et de lrsquoauteur des Προγυμνάσματα est justifieacutee agrave la fois par une lettre de Libanios dans laquelle il se reacutejouit que son goucirct pour les tacircches eacuteducatives ait conduit Aphthonios agrave produire tant de bons eacutecritsthinsp37 et par la constatation que la premiegravere fable du recueil illustre exactement la theacuteorie du premier chapitre de lrsquoopuscule rheacutetorique Les fables et les Προγυμνάσματα sont lrsquoexpression compleacutementaire drsquoun mecircme goucirct et de mecircmes besoins eacuteducatifsthinsp il srsquoagit de deux ouvrages qui sont clairement agrave but peacutedagogiquethinsp38
Les quarante fables drsquoAphthonios sont bregraveves et sont construites selon des scheacutemas fixes et symeacutetriquesthinsp39 Agrave la diffeacuterence des fables latines en distiques eacuteleacutegiaques du contemporain Avianusthinsp40 elles eacutetaient laquothinspdessineacuteesthinspraquo par Aphthonios pour la pratique scolaire et les fables de sa collection ref legravetent sa preacuteface theacuteoriquethinsp41 Diverses hypo-thegraveses ont eacuteteacute suggeacutereacutees sur son lien avec Babriusthinsp42 mais il a eacuteteacute aussi supposeacute qursquoAphthonios aurait suivi des modegraveles en vers et proceacutedeacute agrave une mise en prose des vers de son modegravele tout comme le compila-teur anonyme des Hermeneumata Pseudodositheana On ne peut pas non
commentaire aux p 252-253) Sur la preacutesence de la fable dans le traiteacute drsquoAphtho-nios par rapport aux autres traiteacutes rheacutetoriques voir patillon cit n 34 p 62-65
thinsp(36) Ps-Herm 1 5-7 (patillon cit n 34 p 181-182)thinsp(37) Lib epist 11 1065 (eacuted Foerster)thinsp χαίρω δὲ καὶ τοῖς πόνοις σου χαίροντος
τοῖς ἐν τῷ παιδεύειν οὖσιν ὅτι πολλά τε γράφεις Sur cette lettre par rapport agrave Aphthonios voir patillon cit n 34 p 50-52
thinsp(38) Voir patillon cit n 34 p 52 Sur la theacuteorie et la pratique des fables chez Aphthonios et sur la tradition agrave laquelle il se rattache il est utile de ren-voyer agrave lrsquoanalyse de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253
thinsp(39) Sur la collection des fables drsquoAphthonios voir lrsquoeacutetude panoramique de rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 236-253 Elles ont eacuteteacute publieacutees par F SBordone Recensioni retoriche delle favole esopiche in Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia 16 1932 p 141-174 et A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I2 Lipsiae 1959 p 133-151
thinsp(40) Sur Avianus il suffira ici de renvoyer agrave holzBerG cit n 7 p 62-71thinsp(41) Agrave ce propos voir lrsquoanalyse lrsquoattentive de G J Van dijk The rhetorical fable
collection of Aphthonius and the relation between theory and practice in Reinardus 23 2011 p 186-204
thinsp(42) SBordone cit n 39 a supposeacute que les fables drsquoAphthonios deacuterivaient de Babrius alors que rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 237 y a plutocirct vu un produit qui avait un modegravele plus ancien que la preacutetendue collection Augustana Lrsquohypothegravese de deacuterivation de Babrius a eacuteteacute reprise plus reacutecemment par Van dijk cit n 41
aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 11
plus exclure qursquoAphthonios et le compilateur des Hermeneumata aient puiseacute dans les mecircmes modegravelesthinsp43
3 enSeiGner le latin par leS FaBleS thinsp leS Her meneumAtA pseudodositHeAnA
Le caractegravere intrinsegravequement moral de la fable est lrsquoune des rai-sons pour lesquelles elle fut employeacutee au niveau scolaire Les Herme-neumata Pseudodositheana sont un manuel laquothinsporiginalthinspraquo pour lrsquoenseigne-ment-apprentissage de la langue latine dans les milieux grecs et du grec pour des latinophones qui en un premier temps fut faussement attribueacute au maicirctre Dositheacutee auteur de la seule grammaire latino-grecque qui nous soit parvenuethinsp44
Une sorte de prologue introduit la seacutequence des fablesthinsp lrsquoapprentis-sage du latin et du grec est compareacute agrave lrsquoapprentissage drsquoune conduite correcte et drsquoun laquothinspbien vivrethinspraquo (καλῶς ζῆν ndash bene vivere) qui consis-taient agrave honorer ses parents ecirctre doux avec ses fils aimer ses amis faire toutes les choses ἀνυπόπτως ndash sine suspicione et μὴ πονηρῶς ndash non maligne de sorte qursquoon puisse ecirctre toujours utile et recevoir du bien en faisant le bienthinsp45 Crsquoest ce que lrsquoon retrouve dans la preacuteface du maicirctre-compilateur des fables bilingues des Hermeneumatathinsp lrsquoeacutecri-ture des fables eacutesopiques est mise en parallegravele avec la preacutesentation de
thinsp(43) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 251 On a une seacuterie de fables qursquoon trouve dans la collection drsquoAphtho-nios mais aussi dans celles des Hermeneumatathinsp voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 239-242
thinsp(44) Sur les Hermeneumata Pseudodositheana il suffira ici de renvoyer aux plus reacutecentes contributions par dioniSotti cit n 17 (en particulier p 26-31)thinsp K Korhonen On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals in Arctos 30 1996 p 101-119thinsp E taGliaFerro Gli Hermeneumatathinsp testi scola-stici di etagrave imperiale tra innovazione e conservazione in M S celentano (eacuted) ArsTechnethinsp il manuale tecnico nelle civiltagrave greca e romana Alessandria 2003 p 51-77thinsp et B Rochette Lrsquoenseignement du latin comme L2 dans la Pars Orientis de lrsquoEmpire romainthinsp les Hermeneumata Pseudodositheana in F Bellandi R Ferri (eacuted) Aspetti della scuola nel mondo romano Atti del Convegno (Pisa 5-6 dicembre 2006) Amsterdam 2008 p 81-109 ougrave on trouve plus de reacutefeacuterences bibliographiques Sur la gram-maire de Dositheacutee voir G Bonnet Dositheacutee Grammaire latine Paris 2005
thinsp(45) G FlaMMini Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia Monachii-Lipsiae 2004 77 1961-1972thinsp 78 1973-1980 (grec)thinsp 78 1986-1997thinsp 79 1998-2004 (latin = CGL III 38 30-57thinsp 39 1-49) Pour la version du Fragmentum Parisinum voir CGL III 94 57thinsp 95 1-25 Sur la preacuteface aux fables des Hermeneumata voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 117-118thinsp noslashjGa ard cit n 12 p 398 nrsquoeacutetait pas du mecircme avis quand il affirmait que celle des Hermeneumata laquothinspest la seule collection prosaiumlque ougrave la moraliteacute ne soit pas obligatoirethinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio12
son exemplariteacute parce qursquoelles consistent en ζωγραφίδες ndash picturae (portraits) qui sont particuliegraverement neacutecessaires en tant que modegraveles de viethinsp46
Dans un autre ordre les dix-huit fables des Hermeneumata sont transmises tout entiegraveres dans la recensio Leidensis connu par le manus-crit de Leyde UB Voss gr 4o 7 et dans le Fragmentum Parisinum (Paris BNF lat 6503) les versions grecque et latine eacutetant copieacutees en paral-legravele sur deux colonnes Elles nrsquoont pas de titre mais elles sont claire-ment attribueacutee agrave Eacutesope dans la preacutefacethinsp les fables des Hermeneumata ne constituent que des exercices scolaires fonctionnels pour lrsquoappren-tissage drsquoune deuxiegraveme languethinsp47 Parmi elles il y en a deux (la sei-ziegraveme et la dix-septiegraveme fables de la recensio Leidensis) qui sont en trimegravetres iambiques en grec et en prose en latin et qui ont eacuteteacute iden-tifieacutees comme deux fables attribueacutes agrave Babrius (fables 84 et 140) alors que toutes les autres sont en prose dans les deux colonnes grecque et latine Pour le grec les liens avec la tradition de Babrius sont eacutevi-dents tandis que les fables latines des Hermeneumata sont clairement lieacutees agrave la tradition du Romulus
a Les Hermeneumata Babrius et le Romulus
Morten Noslashjgaard avait parleacute de la tradition des fables en prose des Hermeneumata Pseudodositheana comme un laquothinspcarrefour drsquoinf luences diversesthinspraquothinsp48thinsp elles ne deacuterivaient pas directement de Babrius ni drsquoEacutesope mais plutocirct de la source mecircme de Babrius source dont deacuterive aussi
thinsp(46) FlaMMini cit n 45 78 1980-1983thinsp 79 2004-2007 (= CGL III 39 49-57thinsp 40 1-2)thinsp Νῦν οὔν ἄρξομαι μύθους γράφειν Αἰσωπίους καὶ ὑποτάξω ὑπόδειγμα διὰ τοῦτον γὰρ αἱ ζωγραφίδες συνέστηκαν εἰσὶν γὰρ λίαν ἀναγκαῖαι πρὸς ὠφέλειαν τοῦ βίου ἡμῶν ndash Nunc ergo incipiam fabulas scribere Aesopias et subiciam exemplumthinsp per eum enim picturae constant sunt enim valde necessariae ad utilitatem vitae nostrae La version du Fragmentum Parisinum est leacutegegraverement diffeacuterentethinsp CGL III 95 25-36 Il faut ici souligner le choix eacuteditorial de Flammini qui nrsquoa pas publieacute le texte des Hermeneumata Leidensia du manuscrit Voss gr 4o 7 en suivant la dispo-sition originale du texte en double colonne avec le latin en face du grecthinsp il a donneacute le grec et ensuite le latin selon une partition arbitraire en paragraphes Au contraire lrsquoeacutedition du Corpus Glossariorum Latinorum respecte la disposition du texte sur deux colonnes pour les Hermeneumata Leidensia et aussi pour le Fragmentum Parisinum
thinsp(47) Dans cette perspective voir aussi Bertini cit n 15 p 6thinsp(48) noslashjGa ard cit n 12 p 398 (et sur la fable des Hermeneumata p 398-403)
agrave partir de E GetzlaFF Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae Marpurgi Cat-torum 1907 (Diss) Son ideacutee selon laquelle les Hermeneumata seraient un glossaire de traductions latines de textes grecs datant de la f in du iie siegravecle apregraves J-C est maintenant deacutepasseacutee
aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 13
le Romulusthinsp49 Donc les fables des Hermeneumata celles de Babrius et celles du Romulus repreacutesenteraient trois reacutealisations indeacutependantes agrave partir drsquoune source commune ce qui expliquerait aussi les points de contact entre les trois collections Parmi elles la collection des fables bilingues des Hermeneumata laquothinspa vu le jour dans un but peacuteda-gogiquethinspraquothinsp50 Cela nrsquoest pas simplement suggeacutereacute par la briegraveveteacute mais aussi par lrsquoattention pour les deacutetails et les indications temporelles et par la preacutesence des eacutepithegravetes pittoresques
La contribution plus reacutecente sur la fable ancienne de Francisco Rodriacuteguez Adrados se situe dans une perspective diffeacuterentethinsp pour lui la tradition des Hermeneumata nrsquoest pas lieacutee de faccedilon deacutecisive agrave celle de Babrius et ce que lrsquoon connaicirct par la tradition manuscrite est le reacutesultat drsquoun processus drsquoexpansion agrave partir drsquoun noyau originairethinsp51 Dans leur eacutetat actuel (et final) les fables des Hermeneumata montre-raient des formes alteacutereacutees par rapport aux fables en prose ancienne et qui se situent entre les vers et la prose que lrsquoon connaicirctthinsp52 On aurait donc de nombreuses raisons de supposer qursquoune collection helleacutenis-tique originaire de fables abreacutegeacutees fut mise en prose par un compi-lateur anonyme au niveau du iie siegraveclethinsp53 Le compilateur des fables des Hermeneumata aurait recueilli ou creacuteeacute de courtes fables mais aussi abreacutegeacute lui-mecircme des fables appartenant agrave des traditions diffeacuterentesthinsp le compilateur aurait traduit les textes en latin agrave partir de la version grecque originale et le latin de cette compilation aurait aussi eacuteteacute agrave la base de la version du Romulusthinsp54 Si lrsquoon peut identifier lrsquoauteur de la version latine des fables des Hermeneumata avec le Pseudo-Dositheacutee on reste dans le vague pour le modegravele grecthinsp55
Cependant la tradition du Romulus est aussi tregraves complexe et il est plus correct de parler de Romuli plutocirct que drsquoun seul Romulus Georg Thiele a essentiellement identifieacute deux eacuteleacutements dans la composition du Romulusthinsp drsquoune part des paraphrases pheacutedriennes drsquoautre part des fables qui ne partagent rien avec Phegravedre et qui repreacutesentent le noyau drsquoun recueil latin nommeacute Aesopus Latinus qui proviendrait drsquoune col-
thinsp(49) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 399thinsp(50) noslashjGa ard 1967 cit n 12 p 402thinsp(51) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 221-222 (mais sur les fables des
Hermeneumata p 221-235) thinsp(52) Ibid p 222-224thinsp(53) Ibid p 233thinsp(54) Ibid p 233-234thinsp(55) Ibid p 234thinsp laquothinspThe Greek collection in prose thus remains more anony-
mous than ever Not to mention its Hellenistic modelthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio14
lection populaire anonyme en latin indeacutependante de Phegravedre neacutee entre 350 et 500 apregraves J-Cthinsp56
Plusieurs manuscrits eacuteparpilleacutes dans diffeacuterentes bibliothegraveques euro-peacuteennes transmettent des collections de fables latines en prose qui ont toutes le mecircme prologue programmatique dans lequel un certain Romulus dit agrave son fils Tiberinus que ce qui suit sont ses traductions en latin de fables grecquesthinsp il srsquoagit drsquoun laquothinsptrianglethinspraquo (pegravere-fables-fils) eacutevo-queacute deacutejagrave par la lettre drsquoAusone agrave Sextus Petronius Probus Ces manus-crits sont dateacutes entre les xe et xVie siegraveclesthinsp57 Leacuteopold Hervieux a distin-gueacute cinq recensionsthinsp58 auxquelles il faut ajouter les collections de fables latines du Codex Ademari (Leyde Voss lat 8o 15 xie siegravecle)thinsp59 et du Codex Wissemburgensis (Wolfenbuumlttel Gud lat 148 ixe siegravecle) qui contiennent des fables que lrsquoon trouve aussi dans les collections du Romulus
Les codices Ademari et Wissemburgensis nrsquoont pas ce prologue de Romulus agrave son fils Tiberinus mais celui drsquoEacutesope qui deacutedie ses fables agrave son maicirctre Rufusthinsp les mecircmes mots drsquoEacutesope constituent lrsquoeacutepilogue des Romuli Le recueil original Aesopus ad Rufum contenait au moins soixante fables et un prologue (la lettre drsquoEacutesope agrave Rufus) et avait pour source Phegravedre ou des paraphrases en prose de Phegravedre ou une col-lection helleacutenistique latiniseacutee avant Phegravedre La collection de lrsquoAesopus ad Rufum fut la base pour le Romulus qui ajouta de nouvelles fables et lrsquoeacutepicirctre-prologue avec la deacutedicace agrave son fils Tiberinusthinsp peut-ecirctre certaines des nouvelles fables ont elles eacuteteacute puiseacutees dans la collection des Hermeneumata ou dans sa source LrsquoAntiquiteacute tardive a vu circuler plusieurs collections en prose latine qui avaient Phegravedre pour lrsquoun de leurs modegravelesthinsp lrsquoAesopus ad Rufum fut simplement le premier noyau qui grandit avec de nouvelles fables drsquoun Phaedrus solutus du mateacuteriel agrave la base des preacutetendus Hermeneumata des collections helleacutenistiquesthinsp60
b Mateacuteriaux scolaires bilingues qui se rencontrent et se joignent
Lrsquoopinion courante de la critique est que les Hermeneumata sont structureacutes en trois livresthinsp le premier contient les glossaires alphabeacute-
thinsp(56) G Thiele Fabeln de Lateinischen Aumlsop Heidelberg 1910 p iii-Viithinsp(57) Sur la tradition manuscrite du Romulus voir A CaScoacuten dorado Fedro
Faacutebulas Aviano Faacutebulas Faacutebulas de Roacutemulo Madrid 2005 p 306-309thinsp(58) L HerVieux Les Fabulistes latins I-III Paris 1884 vol 1 p 286-296thinsp(59) Sur les fables du moine et grammairien Adeacutemar de Chabannes qursquoil suf-
f ise ici de renvoyer agrave Bertini cit n 15 p 17-64thinsp(60) Sur le Romulus et sa tradition voir noslashjGa ard cit n 12 p 404-431 et
plus reacutecemment caScoacuten dorado cit n 57 p 291-306 ougrave lrsquoon trouve aussi drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Sur la tradition de lrsquoAesopus Latinus voir aussi la synthegravese probleacutematique de holzBerG cit n 7 p 95-104
aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 15
tiques le deuxiegraveme les glossaires theacutematiques reacutepartis en paragraphes avec des titres (les capitula de la tradition meacutedieacutevale) le troisiegraveme un meacutelange de textes narratifs et un colloquium entre maicirctre et eacutelegraveve Parmi ces textes narratifs du preacutetendu troisiegraveme livre des Hermeneu-mata Pseudodositheana on trouve aussi les fables eacutesopiques Ce nrsquoest que reacutecemment qursquoEleanor Dickey a deacutemontreacute que la section transmet-tant le colloquium et les textes narratifs (le preacutetendu troisiegraveme livre) eacutetait le reacutesultat drsquoune addition posteacuterieure par rapport agrave une struc-ture laquothinspprimitivethinspraquo en deux livresthinsp61 La preacuteface de certaines reacutedactions des Hermeneumata et le deacutebut du premier livre montrent qursquoune sec-tion speacutecifique du premier livre a eacuteteacute consacreacutee agrave la conjugaison des verbesthinsp62thinsp les Hermeneumata eacutetaient composeacutes drsquoun premier livre sur les verbes (et ses conjugaisons plus ou moins partielles) et de glossaires alphabeacutetiques puis drsquoun deuxiegraveme livre de glossaires theacutematiques
Les fables eacutesopiques sont lrsquoun des mateacuteriaux les plus anciens agrave ecirctre entreacute dans le troisiegraveme livre des Hermeneumata et comme dans la plu-part des mateacuteriaux ajouteacutes lrsquousage dans les milieux scolaires a ducirc favoriser lrsquoinclusion dans cet ensemble de mateacuteriau scolaire bilinguethinsp63 Il est difficile de deviner la date de composition de ces fables bilin-guesthinsp la preacutesence de deux fables comme celles de Babrius signifie qursquoelles datent au moins du iie siegravecle apregraves J-C mais on ne peut pas exclure que les autres fassent partie drsquoun noyau plus ancienthinsp64 Puisqursquoil srsquoagit drsquoune tradition drsquoorigine grecque la langue origi-nale des fables bilingues doit ecirctre le grec mais agrave lrsquoeacutepoque le latin est deacutejagrave bien stabiliseacute Drsquoautre part si les fables des Hermeneumata Leidensia sont structureacutees de telle faccedilon que le latin soit disposeacute en face du grec (donc le grec est agrave gauche et le latin agrave droite) dans le Fragmentum Parisinum crsquoest le contraire avec le grec en face du latin (donc le latin agrave gauche et le grec agrave droite) Dans les deux cas le grec
thinsp(61) Voir E Dickey The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana I Cam-bridge 2012 p 16-44 (sur la division en trois livres voir en particulier p 32-37) ougrave lrsquoon peut trouver drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques aussi agrave propos de la tra-dition manuscrite des Hermeneumata
thinsp(62) FlaMMini cit n 45 13 356 ndash 14thinsp Ἐμῇ ἐπιμελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ μετέγραψα τοῦτο τὸ βιβλίον πᾶσιν ltἀgtξιολογώτατον ἐν τῷ πρώτῳ γάρ βιβλίῳ τῶν ἑρμηνευμάτων ὡς πρῶτα συνηνέγκαμεν ῥήματα καὶ τούτων ἐκ μέρους ἀναγκαῖα εἰς κλltίgtσιν ῥημάτων ὅπως εὐκόλως τῆς ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων εὐχρησltτgtία ἔσται Mea diligentia et studio transscripsi hunc librum omni-bus dignissimum In primo enim libro interpretamentorum quomodo priora contulimus verba et eorum ex parte necessaria in declinatione verborum uti facilius sermoni hominum proderit
thinsp(63) Voir dickey cit n 61 p 24-25thinsp(64) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 1 p 118-119thinsp laquothinspWe find ourselves
with a mixture of archaic pre-Babrian elements together with the true Babrian traditionthinspraquo
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio16
est eacutecrit en lettres grecques et le latin en lettres latines (contrairement agrave des cas ougrave le grec est copieacute en caractegraveres latins) ce qui montre que les destinataires du manuel devaient avoir (ou eacutetaient preacutepareacutes pour avoir) une bonne connaissance des deux systegravemes linguistiques et des deux eacutecritures Ils avaient cependant pour laquothinsppremiegravere languethinspraquo le latin parce que le latin est la langue de laquothinspreacutefeacuterencethinspraquo sur la gauche des colonnes du Fragmentum Parisinum et la langue des petits titres qui preacutecegravedent les fables greacuteco-latines de la recensio Leidensis des Hermeneu-mata Quant aux deux autres manuscrits qui enrichissent la recensio leidensis et qui nous ont transmis les seules preacutefaces aux fables des Hermeneumata le codex de Saint-Gall 902 et le Harley 5642 de la Bri-tish Library le latin est en face du grec et aucun eacuteleacutement ne contre-dit lrsquoideacutee que dans ces cas la laquothinsppremiegraverethinspraquo langue des destinataires de la compilation devait ecirctre le grec
Les manuscrits Saint-Gall SB 902 et Harley 5642 sont dateacutes entre le ixe et le xe siegraveclethinsp le manuscrit de Leyde est du xe siegravecle alors que le Fragmentum Parisinum est dateacute du ixe siegraveclethinsp65 Mais la tradition des fables bilingues qui circulaient dans les milieux scolaires pour lrsquoapprentissage drsquoune langue eacutetrangegravere doit commencer bien plus tocirct puisqursquoil existe des manuscrits avec des fables greacuteco-latines qui remontent aux iiie-iVe siegravecles
4 FaBleS et papyruS (latinS)
Une eacutetude de Bernard Legras publieacutee dans les Cahiers du Centre Gustave Glotz en 1996 preacutesente un panorama de la contribution de la papyrologie agrave la connaissance de la tradition fabulistique et de son but scolaire et moralthinsp66 Les neuf papyrus de ce corpus contiennent onze fables diffeacuterentes plus un extrait du Prologue des fables de Babrius qui peuvent ecirctre reparties en deux groupesthinsp celles qui eacutetaient deacutejagrave connues par la tradition meacutedieacutevale des grandes collections et celles qui ne sont connues que par les papyrus Lrsquoanalyse de Legras nrsquoest pas simplement attentive aux donneacutees papyrologiques mais aussi agrave la valeur des fables pour la socieacuteteacute dans laquelle elles circulaientthinsp les
thinsp(65) Sur les manuscrits de Leyde UB Voss gr 4o 7 de Saint-Gall SB 902 et de Londres BL Harley 5642 voir FlaMMini cit n 45 p x-xxii mais aussi dickey cit n 61 p 24 n 71 agrave propos des manuscrits de la tradition des Hermeneumata qui contiennent la section avec les fables
thinsp(66) Lrsquoeacutetude en question est celle de leGraS cit n 26 La mecircme anneacutee un volume important sur la tradition des papyrus scolaires a eacuteteacute publieacute par R Cri-Biore Writing Teachers and Students in Graeco-Roman Eg ypt Atlanta 1996thinsp sur la fable voir en particulier p 46-47
aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 17
milieux scolaires assuraient un controcircle sur les jeunes grecs drsquoEacutegypte en les confrontant agrave des contenus moraux agrave travers les histoires des animauxthinsp67
Une dizaine drsquoanneacutees plus tard une mise agrave jour des reacutesultats de la recherche de Legras a eacuteteacute entreprise par Joseacute-Antonio Fernaacutendez Delgado qui srsquoest plutocirct concentreacute sur les textes veacutehiculeacutes par les papyrus puisqursquoil ne srsquoagit pas dans la plupart des cas exactement des textes drsquoEacutesope Phegravedre et Babrius mais de paraphrases de ces textes Les papyrus ont un texte plus bref et plus simple par rap-port aux fables des auctores et ils correspondent agrave ce qui eacutetait connu comme προγυμνάσματαthinsp68
Les documents sont dateacutes entre le iie et le ier siegravecle avant J-C et le iVe siegravecle apregraves J-C et le succegraves de la tradition de Babrius est eacutevidentthinsp69 La preacutesence de Babrius dans les eacutecoles nrsquoa pas simple-ment eacuteteacute justifieacutee par son style clair et simple et par son adaptation meacutetrique mais aussi parce qursquoil srsquoest efforceacute de tenir compte des dis-positions psychologiques des personnages dans des situations speacuteci-fiques ce qui lui assurait une preacutedisposition agrave un usage scolairethinsp70 Il suffit de mentionner sept tablettes de cire syriaques connues depuis 1893 les Tablettes Assendelft de la Bibliothegraveque nationale de Leyde qui transmettent le cahier drsquoun eacutecolier de Palmyre dateacute du iiie siegravecle apregraves J-C dans lequel lrsquoeacutelegraveve avait copieacute ndash peut-ecirctre sous la dicteacutee du maicirctre ndash un choix de quatorze fables de Babriusthinsp71
thinsp(67) Il srsquoagit drsquoune ligne drsquointerpreacutetation suivie tout au long de lrsquoeacutetude et bien reacutesumeacutee p 80
thinsp(68) J A Fernaacutendez delGado The Fable in School Papyri in j FroumlSeacuten T purola E SalMenkiVi (eacuted) Proceedings of the 24th International Congress of Papyrolog y (Helsinki 1-7 August 2004) Helsinki 2007 p 321-330 est une version reacuteduite par rapport agrave J A Fernaacutendez delGado Ensentildear fabulando en Grecia y Romathinsp los testimonies papiraacuteceos in Minerva 19 2006 p 29-52 mais les deux contri-butions se proposent les mecircmes buts et sont structureacutees selon les mecircmes critegraveres
thinsp(69) Sur les raisons possibles du succegraves de la tradition de Babrius voir leGr aS cit n 26 p 56-57
thinsp(70) La recherche de J A Fernaacutendez delGado Babrio en la escuela grecorro-mana in F MeStre P GoacuteMez (eacuted) Three Centuries of Greek Culture under the Roman Empire Homo Romanus Graeca Oratione Barcelona 2014 p 83-100 est un examen analytique des teacutemoignages du texte de Babrius par rapport aux eacutecoles greacuteco-romainesthinsp il srsquoagit aussi drsquoune mise agrave jour des papyrus des fables qui soutient la tradition de Babrius Sur les collections des fables connues par les papyrus voir aussi la synthegravese par rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 357-358
thinsp(71) Lrsquoeditio princeps est de D C heSSelinG On Waxen Tablets with Fables of Babrius (tabulae ceratae Assendelftianae) in Journal of Hellenistic Studies 13 1893 p 293-314 Sur ces tablettes ndash connues aussi comme Tabulae ceratae Assendelftia-nae ndash voir leGr aS cit n 26 p 54 rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 358-
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio18
Sept des papyrus du corpus de Legras sont grecs un latin et un bilingue latino-grec Le latin POxy xi 1404 et le bilingue PAmh ii 26 sont analyseacutes comme des teacutemoins drsquoun niveau speacutecifique de lrsquoenseignement crsquoest-agrave-dire lrsquoexercice drsquoeacutecriture que lrsquoon proposait aux eacutelegraveves agrave la fin du cycle secondaire ou dans lrsquoenseignement supeacute-rieurthinsp72 Mais ils sont aussi lrsquoexpression de lrsquoapprentissage du latin par des jeunes grecs laquothinspsoit achevant leur cycle secondaire soit eacutetudiant deacutejagrave dans le cycle supeacuterieurthinspraquothinsp73
Fernaacutendez Delgado ajoute agrave ces deux textes en latin un troisiegraveme teacutemoin scolaire de la fable latine le PKoumlln ii 64thinsp74 En effet le PKoumlln ii 64 (iie siegravecle apregraves J-C) contient une version lacunaire en prose grecque drsquoune fable connue par la version latine de Phegravedre (1 9) mais aussi par la tradition eacutesopique en langue grecquethinsp on ne peut pas exclure que la fable de ce papyrus ait suivi un modegravele grec inconnu similaire au modegravele (ou au modegravele du modegravele) de Phegravedrethinsp75
Mais en 1965 au cours du onziegraveme Congregraves International de Papyrologiethinsp76 Francesco Della Corte a preacutesenteacute une contribution sur trois papyrus latins transmettant des fablesthinsp le latiniste Francesco Della Corte avait fondeacute sa recherche sur le recueil des papyrus latins de Robert Cavenaile et sur les trois papyrus des fables qursquoil y avait trouveacutes (POxy xi 1404thinsp PSI Vii 848thinsp PAmh ii 26)thinsp77
360 et plus reacutecemment et pour drsquoautres reacutefeacuterences bibliographiques Fernaacutendez delGado cit n 70 p 89-93
thinsp(72) leGraS cit n 26 p 58thinsp(73) leGraS cit n 26 p 61thinsp(74) LDAB 4708 = MP3 19951thinsp(75) Sur le PKoumlln ii 64 voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 36-38 ougrave
on lit que la fable de Phegravedre fut laquothinspderivada a su vez de otra de Esopothinspraquo (p 36) Les rapports entre les deux fabulistes et lrsquohistoire textuelle des fables sont trop complexes pour lier au nom de Phegravedre le texte de la fable grecque du papyrus de Cologne ou pour eacutetablir des liens entre les diffeacuterentes versions de la fablethinsp sur ces fables voir F rodriacuteGuez adradoS History of the Graeco-Latin Fable vol 3 (revised and updated edition by the author and Gert-Jan Van dijk) Leiden-Boston-Koumlln 2003 p 482-483
thinsp(76) La contribution en question est F Della corte Tre papiri favolistici latini in Atti dellrsquoXI Congresso Internazionale di Papirologia Milano 2-8 settembre 1965 Milano 1966 p 542-550
thinsp(77) R CaVenaile Corpus papyrorum Latinarum Wiesbaden 1958 p 117-120 (no 38-40) La numeacuterotation des lignes des papyrus analyseacutes ici suitthinsp pour les POxy xi 1404 le PAmh ii 26 et le PSI Vii 848 les editiones principesthinsp pour le PYale ii 104 + PMich Vii 457 lrsquoeacutedition de S StephenS Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library II Chico 1985 p 50-52
aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 19
a Le POxy xi 1404 (iiie siegravecle)thinsp78
La fable du POxy xi 1404 (planche 1) est copieacutee au verso drsquoun rou-leau qui avait eacuteteacute utiliseacute au recto pour des comptes en grec (iie siegravecle apregraves J-C) La main est expertethinsp sa cursive ancienne est datable du iiie siegravecle et elle ne cache pas une tendance marqueacutee agrave lrsquoeacutecriture de chancellerie qui conduit agrave identifier une main bureaucratiquethinsp79 Ce petit fragment (59 times 169 cm) ne contient qursquoune version latine en prose et lacunaire de la fablethinsp80 et il a eacuteteacute identifieacute comme une para-phrase de la version pheacutedrienne drsquoune fable deacutejagrave connuethinsp81
Un chien traverse un f leuve avec un morceau de viande voleacute dans la gueulethinsp en voyant son ref let dans lrsquoeau il a lrsquoimpression que le morceau de viande reacutef leacutechi est plus grand que le morceau qursquoil transportait et il le lacircche pour tenter de prendre le morceau qursquoil voit dans lrsquoeau La fable deacutenonce la cupiditeacutethinsp amittit merito proprium qui alienum adpetit (laquothinspOn perd justement son bien quand on convoite celui drsquoautruithinspraquo)thinsp82thinsp on lit la mecircme fable au premier vers du recueil de Phegravedre (1 4) En effet dans lrsquohistoire du chien la fierteacute devance une chutethinsp se contenter de ce qursquoon a est un thegraveme qui revient souvent aussi dans les fables de Babriusthinsp83
On peut remarquer trois points communs entre le texte du papyrus et la version connue par Phegravedrethinsp le chien ne longe pas le f leuve mais il le traverse (l 1-2thinsp f lumen tlsaquorrsaquoansiebat)thinsp le vol de la viande nrsquoest pas clairement repreacutesenteacutethinsp on ne trouve pas la scegravene du chien qui lacircche son morceau de viande pour le ref let du sien dans le f leuve parce qursquoil apparaissait plus grosthinsp84 peut-ecirctre parce que le texte du papyrus nrsquoest pas complet
Il a eacuteteacute observeacute que le POxy xi 1404 repreacutesenterait lrsquoun des deux teacutemoins manuscrits les plus anciens de lrsquoouvrage de Phegravedre (avec le preacutetendu pheacutedrien PKoumlln ii 64) et qursquoil teacutemoignerait de la circula-tion de lrsquoouvrage de Phegravedre dans les milieux scolaires drsquoEacutegyptethinsp le fabuliste latin avait une auctoritas litteacuteraire qui lui assurait de faire
thinsp(78) LDAB 136 = MP3 3010 Le papyrus figure dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 38
thinsp(79) G CaVallo La scrittura greca e latina dei papiri Unrsquointroduzione Pisa-Roma 2008 p 161
thinsp(80) Apregraves la l 4 on a un espace vide drsquoenviron 25 cm et il est vraisemblable que lrsquohistoire a eacuteteacute laisseacutee incomplegravete (cf editio princeps POxy xi 1404 p 247)
thinsp(81) leGr aS cit n 26 p 75thinsp(82) Traduction par A Brenot Phegravedre Fables Paris 1924 (= 2009 sixiegraveme
tirage) p 4thinsp(83) Agrave ce propos voir MorGan cit n 26 p 378-379thinsp(84) leGr aS cit n 26 p 75 n 135
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio20
partie des exempla des eacutecoles des grammairiens et des rheacuteteursthinsp85 Mais Phegravedre nrsquoest pas le seul auteur de la fable du chien qui lacircche sa proie pour lrsquoombrethinsp la fable se trouve aussi dans le corpus des fables eacuteso-piques Comme Phegravedre Eacutesope avait parleacute drsquoun chien qui traversait le f leuvethinsp86thinsp par rapport agrave Babriusthinsp87 Eacutesope et Phegravedre repreacutesentent naturellement la version primitive car pour voir un ref let dans lrsquoeau il faut bien que le chien passe au-dessus du f leuvethinsp88 Le chien qui traverse le f leuve est aussi preacutesent dans la version bilingue de la fable des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp le latin des Hermeneumata nrsquoest pas loin du latin du papyrus mais on nrsquoa pas suffisamment drsquoeacuteleacutements pour postuler un lien entre les deux traditions
Il a eacuteteacute illustreacute comment dans le POxy xi 1404 les deux cas oppo-seacutes mais compleacutementaires du in aquam pour in aqua (l 3-4) et altera pour alteram (l 4) convergent dans la perception tregraves faible du -m agrave la fin drsquoun motthinsp dans le premier cas in + accusatif (et non + ablatif ) traduit le compleacutement de lieu lieacute agrave la permanence dans un endroit tandis que dans le deuxiegraveme lrsquoablatif (ou le nominatif ) nrsquoest pas jus-tifiable Si lrsquoon considegravere que lrsquoerreur provient du modegravele et non du copiste et qursquoon lrsquointerpregravete comme une leccedilon authentique les deux cas ne sont que la mise par eacutecrit de la perception du -m comme reacutesonance nasale de la vocale qui preacutecegravedethinsp in aquam pour in aqua repreacutesente un laquothinspidiotisme syntactiquethinspraquo et altera pour alteram la fai-blesse du son Mais il ne srsquoagit pas de la seule possibiliteacute drsquoexpliquer les imperfectionsthinsp89
Lrsquoimportance du POxy xi 1404 ne reacuteside pas dans le fait qursquoil soit le manuscrit le plus ancien de Phegravedre mais plutocirct qursquoil soit le plus
thinsp(85) Fernaacutendez delGado cit n 68 p 35-36thinsp il srsquoagit de la mecircme position que puGliarello cit n 1 p 82-83 ougrave on lit que le papyrus est une laquothinsptesti-monianza importante sullrsquouso scolastico delle favole fedriane nel iii secolo dC note anche in Egitto a Ossirincothinspraquo Sur ce papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 542-544
thinsp(86) Eacutesope 136 A HauSrath Corpus fabularum Aesopicarum I1 Lipsiae 1957 (= 185 E ChaMBry Eacutesope Fables Paris 19602 = 2012 septiegraveme tirage)thinsp κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε
thinsp(87) Dans la fable de Babrius (79) et dans la reacuteeacutelaboration rheacutetorique de Theacuteon (75) le chien passait le long du f leuve
thinsp(88) Sur la fable et les rapports avec les collections dans lesquelles elle est conserveacutee voir noslashjGa ard cit n 12 p 371-372thinsp voir aussi plus reacutecemment rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 174-178
thinsp(89) Crsquoest la perspective de M Lenchantin de GuBernatiS Il valore fonetico di m finale e un papiro di Ossirinco in Bollettino di Filologia Classica 22 1915-1916 p 199-203 qui a eacuteteacute raisonnablement contesteacutee par della corte cit n 76 p 543-544 Sur la perception du -m agrave la fin drsquoun mot voir J n AdaMS Social Variations and the Latin Language Cambridge 2013 p 128-132
aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 21
ancien teacutemoin de paraphrase scolaire en latin drsquoune fablethinsp avant la deacutecouverte du fragment drsquoOxyrhynque on ne connaissait de para-phrases latines que par la tradition meacutedieacutevalethinsp90 Il est aussi vraisem-blable que ce manuscrit eacutetait la paraphrase drsquoune fable parce qursquoil srsquoagit drsquoune typologie textuelle qursquoon ne connaicirct que par la tradition des fables des Hermeneumata Pseudodositheana qui eacutetaient eacutegalement produites dans (et pour) les milieux scolaires De plus la qualiteacute litteacute-raire de la paraphrase du POxy xi 1404 est meilleure que celle des Hermeneumatathinsp91 Le petit fragment drsquoOxyrhynque permet eacutegalement de srsquointerroger sur un autre point importantthinsp eacutetait-il un texte exclusi-vement en latin ou srsquoagissait-il drsquoune version latine drsquoun texte grecthinsp On ne peut pas exclure que le texte latin (le seul que le hasard ait bien voulu nous laisser) de notre papyrus ait eacuteteacute suivi drsquoune version grecque de la fable
En effet on possegravede deux papyrus dans lesquels la version latine drsquoune fable preacutecegravede lrsquooriginal en grecthinsp le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PAmh ii 26 qui sont plus ou moins contemporains du POxy xi 1404
b Le PYale ii 104 + PMich Vii 457 (iiie siegravecle)thinsp92
En 1974 George M Parassoglou a reacuteuni deux fragments drsquoun mecircme rouleau de tregraves bonne qualiteacute reacutepartis dans deux collections diffeacute-rentes celles de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Yale University (New Haven Eacutetats-Unis) et de lrsquoUniversiteacute du Michigan Ils ont tous deux eacuteteacute acheteacutes par le British Museum agrave lrsquoantiquaire du Caire Maurice Nahman le 17 juillet 1930 et revendus agrave lrsquoUniver-siteacute du Michigan en 1931thinsp93 La provenance archeacuteologique du rouleau nrsquoest pas certaine mais on a supposeacute qursquoil venait de Tebtynisthinsp94
Avant la reacuteunification des deux fragments par Parassoglou le PMich Vii 457 (inv 5604b verso) eacutetait simplement connu comme un
thinsp(90) F RodriacuteGuez adr adoS Nuevos testimonios papiraacuteceos de faacutebulas esoacutepicas in Emerita 67 1999 p 9-10 Pour la valeur de la paraphrase du POxy xi 1404 voir aussi T MorGan Literate Education in the Hellenistic and Roman World Cambridge 1998 p 222-223
thinsp(91) Voir della corte cit n 76 p 544thinsp(92) LDAB 134 = MP32917thinsp ce document nrsquoest pas dans le corpus de caVe-
naile cit n 77 Les deux fragments mesurent respectivement 85 times 13 cm et 125 times 5 cm
thinsp(93) G M par aSSoGlou A Latin Text and a New Aesop Fable in Studia Papyro lo-gica 13 1974 p 31-37thinsp une nouvelle eacutedition du texte a eacuteteacute publieacutee par StephenS cit n 77 p 50-52
thinsp(94) Lrsquoinformation est donneacutee dans le Leuven Database of Ancient Books
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio22
document bilingue Il a ensuite eacuteteacute identifieacute comme une fable eacuteso-pique par Colin H Roberts Ce texte est eacutecrit au verso drsquoun texte de nature juridique qui permet de fixer le terminus post quem de la copie de la fablethinsp95 Le texte juridique du recto est en eacutecriture cursive latine dateacute du ier siegravecle apregraves J-C et dont lrsquoorigine est peut-ecirctre les milieux romains en Eacutegyptethinsp96thinsp il srsquoagit vraisemblablement drsquoun commentaire agrave lrsquoeacutedit drsquoun juge de premiegravere instance qui compte parmi les plus anciens des textes latins de droitthinsp97
Au verso les textes en latin et en grec du papyrus ont eacuteteacute eacutecrits avec la mecircme encre noire et par la mecircme main et agrave partir de lrsquoeacutecri-ture cursive latine on a supposeacute qursquoils dataient du iiie siegravecle apregraves J-Cthinsp98 Ni le style ni lrsquoeacutecriture ne sont eacuteleacutegantsthinsp la main est f luide et entraicircneacutee Elle nrsquoest pas la main drsquoun eacutelegravevethinsp on se trouve devant la double possibiliteacute drsquoune copie drsquoun romain qui apprend le grec ou drsquoune copie utiliseacutee par un maicirctre dans sa classe peut-ecirctre pour faire des dicteacutees
De Deacutemeacutetrios de Phalegravere jusqursquoau Moyen Acircge on possegravede quatorze versions diffeacuterentes de la fable connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457thinsp99 Une hirondelle est la protagoniste de la fable eacutesopique Elle tente de convaincre drsquoautres oiseaux soit de deacutetruire des baies de gui avant qursquoelles ne deviennent mortelles soit drsquoeacutetablir un rap-port drsquoamitieacute avec les hommes afin qursquoils ne les empoisonnent pasthinsp100
thinsp(95) Il serait suffisant de renvoyer agrave H A SanderS Latin Papyri in the Univer-sity of Michigan Collection Ann Arbor 1947 p 100-101 La fable a eacuteteacute identifieacutee par C H roBertS A Fable Recovered in Journal of Roman Studies 47 1957 p 124-125
thinsp(96) LDAB 4481 = MP3 2987 On trouve une analyse paleacuteographique du recto du papyrus dans S AMMirati Per una storia del libro latino anticothinsp i papiri latini di contenuto letterario dal i sec aC al i ex-ii in dC in Scripta 1 2010 p 37 et Per una storia del libro latino antico Osservazioni paleografiche bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla Tarda Antichitagrave in Journal of Juristic Papyrolog y 40 2010 p 56-58
thinsp(97) Il srsquoagit drsquoune hypothegravese formuleacutee par paraSSoGlou cit n 93thinsp cf aussi D noumlrr Bemerkungen zu einem fruumlhen Juristen-Fragment (PMich 456r + PYale inv 1158r) in Zeitschrift fuumlr Rechtsgeschichte 107 1990 p 354-362
thinsp(98) SanderS cit n 95 p 101 parle du fragment comme drsquoun laquothinspunique speci-men which calls for publication with facsimiles even though we know little about the contentthinspraquo
thinsp(99) Une analyse attentive de cette fable et de son eacutevolution est faite dans F rodriacuteGuez adradoS La fabula de la golondrina de Grecia a la India y la Edad Media in Emerita 48 1980 p 185-208 (en particulier p 194-196 sur le PYale ii 104 + PMich Vii 457) et Mas sobre la fabula de la golondrina in Emerita 50 1982 p 75-80thinsp la fable du papyrus est le descendant en prose drsquoun modegravele agrave son tour fondeacute sur le modegravele en prose de la fable de Deacutemeacutetrios de Phalegravere Voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 7 vol 2 p 112-113 et cit n 75 vol 2 p 54-56
thinsp(100) Eacutesope 39a-b A hauSrath cit n 86 (= 349 E chaMBry cit n 86)
aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 23
Dans la version du papyrus la plante mortelle est le lin ce qui nrsquoest pas le cas de la version connue par un autre papyrus exclusivement grec laquothinspde bibliothegravequethinspraquo dateacute du ier siegravecle apregraves J-C le PRyl iii 493 (l 103-31) peut-ecirctre lieacute au nom de Deacutemeacutetrios de Phalegraverethinsp101 Dans le PRyl iii 493 lrsquooiseau protagoniste est une chouette et la plante mortelle est le gui La tradition connue par le PYale ii 104 + PMich Vii 457 meacutelange le motif ancien de la trappe pour les oiseaux (connu par le PRyl iii 493) avec le motif plus reacutecent du lin comme plante mortelle En effet le lin est la matiegravere qui permettait de confection-ner des filets pour chasser les oiseaux Ce motif est peut-ecirctre preacutesent dans le modegravele des PYale ii 104 + PMich Vii 457 tout comme dans la source drsquoune fable perdue de Phegravedre et de la Collection Augus-tanathinsp102 La fable de lrsquohirondelle (tout comme les fables babriennes du PAmh ii 26) ne fait pas partie du corpus scolaire des fables des Hermeneumata
La seule analogie entre le latin et le grec est agrave la l 14 du papyrus et la traduction partielle que lrsquoon possegravede (vraisemblablement du grec au latin) est faite mot agrave motthinsp il srsquoagit de lrsquoepimythium ou morale avec laquelle termine la fable Dans le PYale ii 104 + PMich Vii 457 la version (ou mieux traductionthinsp) latine de la fable preacutecegravede le grec comme dans le PAmh ii 26thinsp dans les deux cas la mise en page est diffeacuterente de celle des autres papyrus bilingues parce que le texte nrsquoest pas reacuteparti en deux colonnes lrsquoune en face de lrsquoautre lrsquoune latine et lrsquoautre grecquethinsp mais la justification est toute entiegravere occu-peacutee par des lignes drsquoeacutecriture latine suivies par la mecircme fable en grec
c Le PAmh ii 26 (iiie-iVe siegravecle)thinsp103
Dateacute entre le iiie et le iVe siegravecle le PAmh ii 26 est le papyrus qui agrave un certain niveau reacutef legravete mieux que tous les autres des formes de lrsquoapprentissage du latin en tant que laquothinspdeuxiegraveme languethinspraquo par un helleacutenophone Depuis son editio princeps par Bernard P Grenfell et Arthur S Hunt en 1901 le papyrus nrsquoa pas simplement attireacute lrsquoatten-
thinsp(101) LDAB 133 = MP3 0050 Sur la tradition des fables de ce papyrus voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 82-91
thinsp(102) rodriacuteGuez adr adoS cit n 7 vol 2 p 88-89thinsp 112-114thinsp(103) LDAB 434 = MP3 0172thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit
n 77 no 40 Preacuteserveacute agrave la Pierpont Morgan Library de New York le PAmh ii 26 est reacuteparti en deux fragments mal restaureacutes avec du ruban adheacutesif de 26 times 19 et 258 times 21 cm
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio24
tion des papyrologues mais aussi des philologues et linguistes pour ses laquothinspmonstruositeacutesthinspraquo inteacuteressantes et eacuteloquentesthinsp104
Dans le papyrus on trouve la dix-septiegraveme la seiziegraveme et la onziegraveme fable du recueil de Babriusthinsp lrsquoordre des fables de Babrius du PAmh ii 26 est diffeacuterent de celui qui eacutetait connu par la tradition manuscrite meacutedieacutevale Le texte latin preacutecegravede le grecthinsp on nrsquoa que la traduction latine des vers 2-10 de la fable 16 et la fable 11 en entier alors que la fable 17 en latin est perdue (puisqursquoelle preacuteceacutedait la ver-sion grecque)thinsp105 et les deux fables ndash la 16e et la 17e ndash eacutetaient placeacutees lrsquoune apregraves lrsquoautre en couplethinsp106 Les fables du PAmh ii 26 propo-saient trois thegravemes aux eacutelegravevesthinsp la valeur de la sagesse et lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique (dans la fable Le chat et le coq fable 17 de Babrius)thinsp107 la misogynie (dans la fable Le loup et la paysanne la 16e) et la valeur de la douceur et en mecircme temps le principe de la circula-riteacute des actionsthinsp108 (dans la fable Le renard incendiaire la 11e)thinsp109
Le PAmh ii 26 est un teacutemoin tregraves important sur la circulation (et lrsquousage) scolaire de lrsquoouvrage de Babrius Les fables de Babrius sont dateacutees au plus tard du iie siegravecle parce que le POxy x 1249 dateacute du iie siegravecle contient certaines drsquoentre ellesthinsp110 et donc les fables de Babrius des Hermeneumata Pseudodositheana ont eacuteteacute ajouteacutees apregraves cette date Des raisons aussi bien chronologiques que typologiques nous permettent de situer le PAmh ii 26 entre les traditions monolingue du POxy x 1249 et bilingue meacutedieacutevale des Hermeneumata Crsquoest en effet un document scolaire qui nrsquoa pas la valeur laquothinspstandardiseacuteethinspraquo des Hermeneumata (ni leur mise en page) mais il repreacutesente in nuce un
thinsp(104) Voir par exemple M ihM Eine lateinische Babriosuumlbersetzung in Hermes 37 1902 p 147-151 et L RaderMacher Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri in Rheinisches Museum 57 1902 p 142-145 Sur le papyrus voir aussi della corte cit n 76 p 546-549
thinsp(105) La perte du latin de la fable 17 de Babrius est tregraves significative parce qursquoon possegravede aussi la version latine de Phegravedre de cette fable (4 2)
thinsp(106) Sur la tradition de ces trois fables voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 108-108thinsp 220-221thinsp 418-419 Sur la tradition textuelle de ces fables de Babrius voir lrsquoanalyse de J Vaio The Mythiambi of Babrius Notes on the Constitu-tion of the Text Hildesheim 2001 p 41-42thinsp 39-41thinsp 27-29 ougrave la contribution du PAmh ii 26 est examineacutee par rapport au reste de la tradition manuscrite La fable du paysan et du renard incendiaire est aussi dans le corpus des fables sco-laires drsquoAphthonios (38)
thinsp(107) Le thegraveme de lrsquoimportance de lrsquointelligence pratique est freacutequent chez Babriusthinsp voir MorGan cit n 26 p 379-380
thinsp(108) Voir MorGan cit n 26 p 382-383thinsp(109) Une analyse qui se situe dans cette perspective se trouve dans leGraS
cit n 26 p 76-78thinsp(110) LDAB 432 = MP3 0173
aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 25
niveau deacutetermineacute de lrsquoapprentissage du latin par un helleacutenophone teacutemoignant de lrsquoimportance de la fable pour cet apprentissage Il est aussi un teacutemoin important qui apporte de nouveaux eacuteleacutements agrave notre connaissance de lrsquousage des fables de Babrius pour lrsquoexercice des προγυμνάσματα et en mecircme temps agrave la connaissance de la tradition textuelle de Babriusthinsp111
La traduction latine nrsquoa pas de preacutetentions poeacutetiquesthinsp il srsquoagit drsquoune traduction verbum de verbo mot agrave mot Elle est presque meacutecanique et srsquoappuie sur le grec en respectant lrsquoordre des mots jusqursquoagrave deve-nir souvent incompreacutehensible et eacutenigmatique comme en teacutemoigne lrsquoexemple de la l 8 et ille [dix]it quomodo enim quis mulieri cr[edo] modeleacute sur le grec de la l 24thinsp κἀκεῖνοϲ ˋὁδ᾿ˊ εἶπεν πῶϲ γὰρ ὃϲ γυναικὶ πιϲτε[ύ]ωthinsp112
Le grec est geacuteneacuteralement correct mais le latin est plein de fautesthinsp113 Il srsquoagit de fautes tregraves preacutecieuses permettant drsquoimaginer la perception que les helleacutenophone drsquoOrient avaient du latin Bien qursquoil soit impor-tant de prendre en compte deux niveaux drsquoerreurs ndash les erreurs du traducteur du grec en latin et les erreurs du copiste ndash il est possible de remonter aux imperfections drsquoun eacutelegraveve qui eacutetait en train drsquoap-prendre une deuxiegraveme langue agrave travers lrsquoexercice de la traduction du grec au latinthinsp114
Au niveau de la morphologie les verbes sont lrsquoeacuteleacutement le plus par-lantthinsp lrsquoeacutelegraveve-traducteur nrsquoutilise pas toujours les verbes drsquoune faccedilon correcte Si les formes du preacutesent de lrsquoimparfait et du passeacute simple sont correctes agrave lrsquoindicatif mais aussi au subjonctif lrsquoune des erreurs les plus reacutecurrentes est lrsquoutilisation du participe parfait passif pour rendre le participe aoriste actif du grec (par exemple l 1thinsp auditus ndash l 17thinsp ἀκούσαςthinsp l 2 putatus ndash l 18thinsp νομίσαςthinsp l 27thinsp succensus ndash l 38thinsp ἅψας)thinsp115thinsp le traducteur avait clairement des difficulteacutes avec le systegraveme
thinsp(111) Voir Fernaacutendez delGado cit n 68 p 34-35 et 2014 p 94-96 ougrave le papyrus est replaceacute dans lrsquoensemble des documents scolaires de Babrius
thinsp(112) Voir J n AdaMS Bilingualism and the Latin Language Cambridge 2003 p 736
thinsp(113) On trouve dans adaMS cit n 112 p 725-741 une analyse attentive du PAmh ii 26 surtout dans une perspective linguistique
thinsp(114) della corte cit n 76 p 547 ne distingue pas la f igure du traducteur de celle du copiste et propose que les fables 16 et 11 ont eacuteteacute traduites par deux eacutelegraveves diffeacuterentsthinsp il conclutthinsp laquothinsp(scil le PAmh ii 26) rivela lrsquoinscitia dei giovani che traducono dal greco in latino incappando in madornali errori come festigiatur babbandam sorsusthinspraquo
thinsp(115) B Rochette Papyrologica bilinguia Graeco-Latina in Aeg yptus 76 1996 p 62thinsp pour une analyse des formes correctes et incorrectes des verbes latins du papyrus voir adaMS cit n 112 p 728-732
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio26
des participes latins Il ne connaissait pas non plus parfaitement les paradigmes verbaux Par exemple agrave la l 7 on trouve un monstrum comme tulitus qui srsquoexplique certainement par la connaissance du parfait irreacutegulier de fero Lrsquoeacutelegraveve ignorant le thegraveme du supin a ajouteacute meacutecaniquement le suffixe -tus agrave la racine du parfait tuli et obtenu une laquothinspforme analogique et simplifieacuteethinspraquothinsp116
Le PAmh ii 26 comporte une stratification drsquoimperfections diffi-ciles agrave deacutemecircler Agrave la l 1 la forme anucella (l 1 agrave lrsquoaccusatif ) comme diminutif du latin anus nrsquoest pas lrsquoeacutequivalent exact du grec qui est le niveau laquothinspzeacuterothinspraquo du lemme (l 17thinsp γραῦν) Srsquoil est vrai que les thegravemes de la vieillesse et de lrsquoenfance pouvaient inspirer des diminutifs en latin il faut aussi souligner que la forme la plus courante eacutetait ani-cula et la forme anicilla mentionneacutee par Varron devait circuler au niveau sous-litteacuterairethinsp117 Donc le choix de anucella pour anus (ou anicula) peut trouver ses racines dans les sources laquothinspnot entirely boo-kishthinspraquothinsp118 La forme anucella est-elle le reacutesultat drsquoune laquothinsppollutionthinspraquo (par le copiste) drsquoune forme laquothinspplus correctethinspraquo peut-ecirctre anicilla ou anicella (du traducteur)thinsp Le traducteur a-t-il meacutelangeacute le lemme laquothinspzeacuterothinspraquo anus et le diminutif anicilla (-ella) creacuteant un laquothinsphybridethinspraquo qui a retenu le -u- aussi dans la deuxiegraveme formethinsp Le diminutif bulpelcula pour vulpelcula (l 25 agrave lrsquoaccusatifthinsp119) nrsquoest pas non plus motiveacute par le grec (l 36thinsp ἀλώπεκ᾿) et le becirctacisme est peut-ecirctre le fruit de lrsquoopeacuteration deacutefec-tueuse du copiste plutocirct que celle du traducteur (donc agrave lrsquoantigraphe de la copie du PAmh ii 26)
Lrsquoeacutequivalent grec de frestigiatur agrave la l 5 est παρεδρεύσας (une cor-rection de ενεδρευϲαϲ dans le papyrusthinsp120) Le verbe παρεδρεύω est traduit de plusieurs faccedilons dans les glossaires bilingues Si les Frag-menta Helmstadiensia et le Folium Wallraffianum preacutesentent diffeacuterentes traductions latines pour le mecircme verbethinsp121 la forme praestolor traduit
thinsp(116) rochette cit n 44 p 106thinsp(117) Varro ling 9 74thinsp(118) adaMS cit n 112 p 734thinsp sur la forme anucella du papyrus voir p 733-
734thinsp(119) Bulpelcula inionf ortunam est la lecture de lrsquoeditio princeps alors que bulpelculam
imfortunam celle proposeacutee par J KraMer PAmh II 26 25thinsp bulpelculam imfortunam in Archiv fuumlr Papyrusforschung 53 2007 p 45-52 a eacuteteacute accepteacutee dans lrsquoeacutedition dans Vulgaumlrlateinische Alltagsdokumente auf Papyri Ostraka Taumlfelchen und Inschriften Berlin-New York 2007 n 10 (p 137-144 ougrave le texte du papyrus nrsquoest pas donneacute en entier) en particulier p 141
thinsp(120) B P GrenFell A S Hunt 1901 The Amherst Papyri II London 1901 p 27 (no 26)
thinsp(121) Fr W l 10-12thinsp παρεδρ[ε]υει fraequenlsaquotrsaquoia praesto est | παρεδ[ρε]υετω supersit | παρεδ[ρε]υ[ει]ν σχολαζειν convacare (eacuted J KraMer Glossaria bilin-guia in papyris et membranis reperta Bonn 1983 p 51 no 4)
aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 27
παρεδρεύω dans les gloses greacuteco-latines du Pseudo-Cyrillusthinsp122 Max Ihm fut le premier agrave avoir vu dans le latin du PAmh ii 26 le ref let des choix et de la pratique des glossaires bilingues Il reconnut eacutegalement dans le frestigiatur du papyrus une deacuteformation drsquoun possible praesto-latus neacutee comme une corruption textuelle ajouteacutee agrave une erreur de traductionthinsp123 Eacutetant donneacute que le verbe est preacuteceacutedeacute par une frigitilsaquosrsaquo il est tout agrave fait possible de justifier ce meacutelange par lrsquoerreur drsquoun copiste helleacutenophone non savant inf luenceacute par les mots (et les sons des mots) qursquoil copiait Une traduction latine malheureuse des fables grecques rencontra un copiste qui lrsquoempirathinsp aux imperfections du traducteur (vraisemblablement un helleacutenophone apprenant le latin) srsquoajoutegraverent les imperfections du copiste (vraisemblablement un helleacutenophone qui connaissait peu ou rien du latin)thinsp124 Le reacutesultat eacutetant des corruptions textuelles laquothinspau carreacutethinspraquo souvent impossibles agrave deacutecrypterthinsp125
Quant au codam pour caudam (l 27) est-elle une erreur de monoph-tongaison qursquoil faut attribuer agrave lrsquoeacutelegraveve qui traduisit la fable ou plutocirct au copiste dans ce deacutelicat passage de la meacutemorisation drsquoune peacutericope agrave sa mise par eacutecritthinsp126thinsp
Le ignem babbandam de la l 41 traduit τὸ πῦρ φέρουσαν de la l 30thinsp puisque le latin classique ne connait pas la forme verbale babbare Grenfell et Hunt avaient supposeacute correcte la forme volventemthinsp127 tan-dis que Ihm avait plutocirct proposeacute baiulantemthinsp128 et plus reacutecemment Adams portantemthinsp129 Johannes Kramer a au contraire envisageacute la racine romane de la forme reconstitueacutee baba qui est agrave la base du
thinsp(122) CGL II 397 31thinsp(123) Voir ihM cit n 104 p 150 et della corte cit n 76 p 548thinsp voir
aussi adaMS cit n 112 p 735thinsp laquothinspSince even a translator labouring under the disadvantage of poor command of Latin is unlikely to have written such gibbe-rish we see that a second layer of error must be assumed in the text inf licted by an incompetent copyist of the original translationthinspraquo Sur cette forme voir aussi rochette cit n 44 p 104-105
thinsp(124) Voir adaMS cit n 112 p 739-741thinsp(125) ihM cit n 104 eacutecrit cecithinsp laquothinspAutor und Copist beide sind verantwortlich
fuumlr diesen abicircme drsquoignorancethinspraquo (p 147)thinsp(126) Pour la premiegravere possibiliteacute voir adaMS cit n 112 p 737thinsp(127) GrenFell hunt cit n 120 p 28thinsp(128) ihM cit n 104 p 150thinsp laquothinspDas dritte und kurioseste Raumlthsel stehet XI
6 ignem babbandam fuumlr πῦρ φέρουσαν Warum nicht das nahe liegende portantem ferentem)thinsp Sollte da ein vulgaumlres Verbum babbare vorliegen das Niemand kenntthinsp Die uumlbrigen Schreibfehler machen ein grobes Versehen wahrscheinlicher Gren-fell und Hunt vermutheten volventem ohne sich weiteren Illusionen hinzugebenthinsp baiulantem woran ich dachte scheint fuumlr den aumlgyptischen Scribifax fast zu kuumlhnthinspraquothinsp voir aussi della corte cit n 76 p 549
thinsp(129) adaMS cit n 112 p 730thinsp laquothinspThe expression underlined is translated by ignem babbandam It might seem that a gerundive form (on an incomprehensible
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio28
verbe franccedilaise laquothinspbaverthinspraquo et de lrsquoitalien laquothinspsbavarethinspraquothinsp on parle donc drsquoun laquothinsprenard bavant feuthinspraquo (laquothinspder feuerverspruumlhende Fuchsthinspraquo)thinsp130 Il est vraisemblable que le suffixe du geacuterondif soit neacute soit drsquoune erreur de morphologie du traducteur (donc le geacuterondif agrave la place du parti-cipethinsp -and- pour -ant-) soit drsquoune confusion phoneacutetique de la dentale sourde et sonore qui a aussi causeacute une erreur au niveau de la mor-phologie La deacutesinence -am est quant agrave elle une erreur qui deacuterive de ce qui preacutecegravede ou simplement une confusion de deacuteclinaison (par le traducteurthinsp) Le verbe corrompu devait ecirctre de premiegravere conju-gaison sauf srsquoil y a une autre erreur au niveau de la vocale theacutema-tique (donc -and- pour -ent-)thinsp la possible stratification des erreurs (au moins laquothinspau carreacutethinspraquo) complique la tentative de deacutemecircler le problegraveme Si la racine de la forme reconstitueacutee babbare peut ecirctre appuyeacutee sur des aboutissements romans et qursquoil faut donc remonter directement agrave la mise par eacutecrit drsquoune erreur du traducteur on ne peut pas exclure qursquoon trouve ici une laquothinspdoublethinspraquo erreur et que le copiste ait ajouteacute la sienne agrave une forme qui nrsquoeacutetait pas deacutejagrave parfaitement traduite On peut avoir ici la mise par eacutecrit des confusions par becirctacisme par le copiste agrave partir drsquoune forme traduite (correctement ou pas)thinsp les confusions phoneacutetiques peuvent ecirctre multiples et celles du copiste peuvent srsquoecirctre superposeacutees agrave celles du traducteur helleacutenophone Avec une stratification multiple des erreurs on ne peut pas exclure que la forme-base ait eacuteteacute ferentem (sauf si le traducteur avait mal puiseacute dans son glossaire bilingue de reacutefeacuterence) devenu ndash par exemple ndash perentem etou pepentem et bebentem et encore avec un redoublement phonosyntactique bebbentem jusqursquoagrave devenir babbantem Le becirctacisme la confusion entre -f- et ph- (et en derniegravere analyse p-) le redouble-ment phonosyntactique lrsquoeacutechange entre p et r et vice-versa pour des raisons soit phoneacutetiques soit graphiques (dans certaines eacutecritures et surtout pour des grecs) la confusion entre -a- et -e- ne serait pas une nouveauteacute dans le latin des papyrus drsquoOrientthinsp131 En plus fero qui rend φέρω est la traduction la plus freacutequente qui nous soit parvenue par les glossairesthinsp132 et le traducteur du PAmh ii 26 ne fait normale-ment qursquoune traduction mot agrave mot Mais la datation du papyrus et la preacutesence de plusieurs eacuteleacutements de langue orale nous conduisent agrave
root) has been brought into play to render a participle but it is more likely that textual corruption is behind this bizarre form (portantemthinsp)thinspraquo
thinsp(130) kraMer cit n 119 p 143thinsp(131) Pour des reacutefeacuterences suppleacutementaires voir M C Scappaticcio Papyri
Vergilianae Lrsquoapporto della Papirologia alla Storia della Tradizione virgiliana (i-vi dC) Cedopal ndash Liegravege (series Papyrologica Leodiensia) Liegravege 2012 p 24
thinsp(132) Il est suffisant de renvoyer agrave CGL II 203 13thinsp 325 16thinsp 381 20thinsp 470 35-37
aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 29
une plus prudente suspension de jugement au moins jusqursquoagrave ce que nous ayons plus de possibiliteacutes de comparaison (documentaires et sur papyrus de preacutefeacuterence)thinsp babbandam reste un des laquothinspcoups de geacuteniethinspraquo du traducteur etou du copiste du PAmh ii 26
Drsquoapregraves James Noel Adams le traducteur de la fable grecque en latin devait avoir plusieurs sourcesthinsp la preacutesence de formes du parleacute substandard laisse supposer qursquoil avait appris le latin au niveau sous-litteacuteraire (mecircme si des imperfections au niveau de lrsquoorthographe peuvent ecirctre partageacutees entre le traducteur et le copiste tous deux helleacutenophones)thinsp mais il avait aussi reccedilu lrsquoeacuteducation laquothinspcanoniquethinspraquo dans le domaine de la morphologie latine (bien qursquoavec des lacunes) et il devait avoir agrave sa disposition des glossaires bilingues comme basethinsp133 Cette derniegravere possibiliteacute se justifie si lrsquoon pense aux typologies des textes bilingues connus par la tradition meacutedieacutevale mais aussi aux papyrusthinsp il srsquoagit de glossaires bilingues greacuteco-latins ou latino-grecs qui ont eacuteteacute groupeacutes par la tradition meacutedieacutevale des Hermeneumata Pseu-dodositheana et qui repreacutesentent une tradition dans laquelle conf luent aussi les glossaires bilingues sur papyrus (ier-Vie siegravecles) En mecircme temps il faut reconnaicirctre que le grec inf luence la faccedilon dont le tra-ducteur conccediloit le participe latinthinsp il deacuteduit de lrsquoexistence drsquoun parti-cipe aoriste actif en grec que le latin doit eacutegalement en avoirthinsp134
La meacutethode utiliseacutee pour la construction du texte des fables du PAmh ii 26 est une laquothinspmise en pratiquethinspraquo de la tradition connue par les glossaires bilingues sur papyrus et ensuite par les preacutetendus Herme-neumata Pseudodositheana de tradition meacutedieacutevalethinsp135 Le traducteur maicirc-trisait correctement lrsquoalphabet latinthinsp il connaissait les deacuteclinaisons mais moins bien les conjugaisons Il maicirctrisait les formes actives et il savait former les participes latins mecircme srsquoil montre clairement ne pas en connaicirctre le sensthinsp136
thinsp(133) adaMS cit n 112 p 732thinsp comparer aussi rochette cit n 44 p 106-107
thinsp(134) rochette cit n 44 p 106 ajoute que laquothinspune telle meacuteprise montre que la meacutemorisation de la forme ne srsquoaccompagne pas neacutecessairement de lrsquoeacutetude du sens ou de la fonctionthinspraquo Comparer aussi M Mancini Romanizzazione linguistica e apprendimento del latino come L2 in S Giannini (eacuted) Acquisizione e mutamento di categorie linguistiche Atti del Convegno della Societagrave italiana di Glottologia (Perugia 23-25 ottobre 2003) Roma 2004 p 151-188 (en particulier p 177-178)
thinsp(135) Ce qursquoon donne ici est simplement un eacutechantillonthinsp lrsquoanalyse complegravete du texte et des parallegraveles entre les formes traduites dans les fables du PAmh ii 26 et celles que lrsquoon trouve dans les glossaires bilingues sur papyrus et de tradition meacutedieacutevale sera conduite dans lrsquoeacutedition annoteacutee du papyrus Il srsquoagit drsquoun travail en cours qui rassemble tous les papyrus des fables latines et bilingues latino-grecques en une nouvelle eacutedition
thinsp(136) Pour une analyse plus deacutetailleacutee voir rochette cit n 44 p 106-107
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio30
Dans le parcours graduel qui conduisait les helleacutenophones drsquoEacutegypte vers lrsquoapprentissage et la pratique de la langue latine la traduction des fables repreacutesentait un niveau plus laquothinspeacuteleveacutethinspraquo par rapport agrave la forma-tion grammaticale stricto sensu Lrsquoeacutetudiant devait apprendre agrave la fois la morphologie et le lexiquethinsp donc la familiarisation avec les regravegles de la grammaire latine et avec les f lexions nominales et verbales mais aussi la pratique des laquothinspdictionnairesthinspraquo bilingues greacuteco-latins et latino-grecs eacutetaient les deux passages obligeacutes qui se compleacutetaient lrsquoun lrsquoautre Dans cette perspective les tables bilingues de deacuteclinaisons et conjugaisons sont des exemples de la compleacutementariteacute des deux processusthinsp137
Une fois que lrsquoeacutelegraveve srsquoeacutetait suffisamment familiariseacute avec la gram-maire et le vocabulaire latin il pouvait commencer agrave lire les auc-tores mecircme en laquothinsptraductionthinspraquothinsp138 Et tout cela repreacutesentait la base pour des creacuteations originales telles que la traduction latine drsquoune fable grecque et ensuite la paraphrase dans sa L(angue)2
d Le PSI Vii 848 (iVe siegravecle)thinsp139
Acheteacute en feacutevrier 1924 agrave Medinecirct-el-Fayoum (lrsquoancienne Krokodi-lopolis) par Giovanni Capovilla donneacute aux collections f lorentines et publieacute en 1925 par Girolamo Vitelli le PSI Vii 848 (planche 2) est un fragment drsquoun codex de papyrus en semi-onciale du iVe siegravecle drsquoune
thinsp(137) Pour un panorama sur les papyrus grammaticaux latins voir M C Scap-paticcio Tra canonizzazioni della lsquonormarsquo ed infrazione Sondaggi dai frammenti gram-maticali latini su papiro (i-vi dC) in P Molinelli P cuzzolin C Fedriani (eacuted) Latin vulgaire ndash Latin tardif X Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bergamo 5-9 septembre 2012) Bergamo 2014 p 1031-1045 qui constitue un travail introductif agrave leur eacutedition complegravete annoteacuteethinsp Artes in frammenti I testi grammaticali latini e bilingui su papirothinsp edizione commentata (Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 17) Berlin-New York 2015
thinsp(138) Il est fait ici reacutefeacuterence aux textes des auteurs latins preacuteserveacutes sur papyrus selon la forme du glossaire latino-grecthinsp il srsquoagit de rouleaux ou codices (surtout du iVe siegravecle) ougrave les passages extraits des auteurs comme Virgile ou Ciceacuteron sont disposeacutes de faccedilon agrave preacutesenter le texte latin (un seul mot ou petits groupes de mots) agrave gauche et la traduction agrave droite selon le systegraveme agrave double colonne des glossaires bilingues sur papyrus (et ensuite des preacutetendus Hermeneumata) Pour des reacutefeacuterences bibliographiques suppleacutementaires voir rochette cit n 44 p 101-103 et sur les seuls glossaires bilingues de Virgile M FreSSura tipologie del glossario virgiliano in M-H MarGanne B rochette (eacuted) Bilinguisme et digra-phisme dans le monde greacuteco-romainthinsp lrsquoapport des papyrus latins (Liegravege 12-13 mai 2011) Liegravege 2013 p 71-116
thinsp(139) LDAB 138 = MP3 0052thinsp le papyrus est dans le corpus de caVenaile cit n 77 no 39
aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 31
importance singuliegravere dans le domaine de lrsquoapprentissage du latin (et du grec) dans des contextes allophones crsquoest-agrave-dire dans la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp140
Le petit fragment de la Biblioteca Laurenziana de Florence (103 times 107 cm) est en latin sur la face perfibrale (rarr) et en grec sur la face transfibrale (darr) mais la preacutesence de traces drsquoune deuxiegraveme colonne avec des lettres grecques agrave cocircteacute de la colonne latine nous suggegravere la possibiliteacute qursquoil srsquoagissait agrave lrsquoorigine drsquoun codex dans lequel les colonnes latine et grecque avaient eacuteteacute disposeacutees lrsquoune en face de lrsquoautre En outre les textes latins et grecs lisibles sur les deux cocircteacutes ne correspondent pas et il faut bien croire que les traductions correspon-dantes (pour le latin en grec et pour le grec en latin) ont eacuteteacute eacutecrites sur les colonnes en face maintenant tregraves lacunaires ou perdues La mise en page du codex dont est issu notre fragment ne devait pas ecirctre diffeacuterente de celle des glossaires bilingues et digraphiques qui conte-naient soit des textes des auctores soit des listes de mots agrave la diffeacuterence pregraves que lrsquoespace intercolonnaire est exigu (moins drsquoun centimegravetre) Le texte est bien mis en colonne et lrsquointerligne est bien espaceacute Crsquoest la mecircme main qui a copieacute le texte grec et le texte latin et la ressem-blance de certaines lettres (a et α c et ϲ m et μ p et ρ t et τ) est lrsquoun des indices les plus parlants de lrsquoeacuteducation graphique grecque de la main qui a aussi copieacute le latin
Le PSI Vii 848 contient la fin de la quatorziegraveme fable de la collec-tion des Hermeneumata et la quinziegraveme presque tout entiegravere Les deux fables remontent agrave une tradition deacutejagrave connue parce qursquoelles sont aussi conserveacutees dans le corpus des fables eacutesopiques
La quatorziegraveme fable des Hermeneumata est le reacutecit drsquoun taureau qui pour eacuteviter un lion srsquoeacutechappa dans une caverne ougrave trois chegravevres sauvages se moquegraverent de luithinsp141 Dans le papyrus il nrsquoy a plus que le tout dernier mot de la morale agrave la fin de la fablethinsp il ne reste que la colonne grecque ougrave on lit ὑβρίζο[νται] (l 1)thinsp la colonne latine est lacunaire et il est difficile drsquoeacutetablir srsquoil faut compleacuteter la lacune avec
thinsp(140) Dans lrsquoeditio princeps par Girolamo Vitelli (PSI Vii 848 p 153-154) on lit qursquoil est possible qursquoil srsquoagisse drsquoun rouleau ou drsquoun codexthinsp lrsquohypothegravese drsquoun codex est revitaliseacutee par J Kr aMer Glossaria bilinguia altera Leipzig 2001 p 100-101 Sur ce papyrus voir aussi les observations litteacuteraires de della corte cit n 76 p 544-546
thinsp(141) Eacutesope 242 A hauSr ath cit n 86 (= 332 E chaMBry cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adr adoS cit n 75 vol 3 p 305-306 Les diffeacuterences entre la version des Hermeneumata et la version eacutesopique sont bien visibles mecircme au niveau des eacuteleacutements narratifsthinsp par exemple dans les Herme-neumata les chegravevres sauvages se moquaient du taureau alors que dans le corpus eacutesopique le taureau est frappeacute et encorneacute par elles
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio32
iniurantur (de la recensio Leidensis) ou plutocirct avec iniuria adfliguntur (du Fragmentum Parisinum)thinsp142
La quinziegraveme fable a pour protagonistes un lion et un homme qui se deacutefient pour savoir lequel drsquoentre eux est le plus fort Ils ren-contrent lrsquoimage drsquoun homme eacutetranglant un lion ce qui donne agrave lrsquohomme une raison suppleacutementaire pour montrer sa supeacuterioriteacutethinsp le lion reacutepond en souriant que si les lions savaient faire des images plusieurs hommes auraient eacuteteacute sous la patte du lionthinsp143 Par rapport agrave la version eacutesopique la quinziegraveme fable des Hermeneumata (et donc la fable du papyrus) est introduite par Eacutesope srsquointerrogeant sur la raison pour laquelle ce sont les femmes qui donnent la dot aux hommes et pas lrsquoinversethinsp de mecircme que les lions srsquoils le pouvaient auraient repreacute-senteacute les hommes eacutetrangleacutes par les lions et non lrsquoinverse de mecircme les femmes si elles lrsquoavaient pu auraient deacutecideacute que ce sont les hommes qui doivent apporter la dot Mentionner Eacutesope permet de souligner lrsquoautoriteacute de la fablethinsp144 et lrsquoEacutesope reacutepondant agrave des questions est un eacuteleacutement qui revient souvent dans les papyrus scolaires comme lrsquoOWilken ii 1226 en grec (iiie-iVe siegravecle)thinsp145
La fable de lrsquohomme et du lion preacuteserveacutee dans PSI Vii 848 partage avec la version des Hermeneumata toutes les diffeacuterences par rapport agrave la version eacutesopiquethinsp par exemple dans la version du corpus eacutesopique le lion et lrsquohomme trouvent une stegravele en pierre et se reacutefegraverent donc agrave lrsquoart de la sculpture tandis que dans les Hermeneumata ils trouvent un monument avec une peinture et se reacutefegraverent donc lrsquoart du peintre Les dimensions reacuteduites du fragment ne permettent pas de savoir si le texte du papyrus se prolongeait comme les Hermeneumata avec un laquothinspdeuxiegraveme actethinspraquo de la fable ougrave lrsquohomme et le lion se retrouvent dans un amphitheacuteacirctre ougrave un homme est battu par un lionthinsp146
thinsp(142) Agrave propos voir kraMer cit n 140 p 104 De cette fable voir la version des Hermeneumata Leidensia (FlaMMini cit n 45 87 2215-2221thinsp 88 2222-2227) et le Fragmentum Parisinum (CGL III 100 9-22)
thinsp(143) Eacutesope 264 A hauSrath cit n 86 (= 59 E chaMBry 19602 cit n 86)thinsp sur la tradition de la fable voir rodriacuteGuez adradoS cit n 75 vol 3 p 330-332 Il faut aussi souligner que la fable est dans le recueil de fable drsquoAphthonios (34) mais la reacutedaction drsquoAphthonios nrsquoa pas drsquoeacuteleacutements significatifs en commun avec la tradition des Hermeneumata et contre la tradition eacutesopique
thinsp(144) Voir MorGan cit n 26 p 394-403thinsp(145) LDAB 137 = MP3 2076thinsp voir aussi rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 9thinsp(146) Sur cette version amplifieacutee de la fable des Hermeneumata voir rodriacuteGuez
adradoS cit n 7 vol 2 p 231-232 Contre la tradition eacutesopique mais comme Aphthonius et Avianus les Hermeneumata suppriment la reacutefeacuterence au fait que le lion et lrsquohomme se promenaient ensemble
aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 33
Par rapport agrave la tradition textuelle des Hermeneumata le texte du PSI Vii 848 preacutesente de petites diffeacuterences mais ne change pas de sensthinsp147thinsp la preacutesence des articles grecs au tout deacutebut de la fable (l 3-4thinsp αἱγυν[αῖκεϲ]thinsp τοῖϲἀνδράϲιν) absents de la recensio Leidensis tout comme du Fragmentum Parisinumthinsp148thinsp le texte parle des laquothinspdotsthinspraquo plutocirct que de laquothinspdotthinspraquo (l 5thinsp προῖκα ϲprime avec une addition dans lrsquointerligne par le copiste)thinsp il ajoute un verbum dicendi en introduisant la reacuteponse du lion parce que le papyrus a re]spondit (l 10 comme les deux teacutemoins des Hermeneumata) mais aussi un peu lisible ai t (l 11) qui a un eacutecho dans le (superf lu) inquit du Fragmentum Parisinumthinsp149 Quant au suffu-cabat de la l 15 il srsquoagit drsquoune lectio singularis du papyrus contre le suffocaret des recensiones Leidensis et parisiennethinsp150 Agrave la l 13 on trouve des diffeacuterences par rapport aux Hermeneumata de tradition meacutedieacutevalethinsp le papyrus a sed si et leo pingeret alors que la version de Leyde a si autem leo pingeretthinsp151 et celle du fragment de Paris quod si et leo pingeretthinsp152thinsp malheureusement le cocircteacute grec du papyrus nrsquoest plus preacuteserveacute Dans ce contexte le texte du papyrus semble ecirctre plus proche de celui du Fragmentum Parisinum avec lequel il partage aussi lrsquoabsence drsquoun qui-dem agrave la ligne suivante (l 14thinsp vidisses quomodo = CGL III 100 45)thinsp153
Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus rend difficile la tacircche de le situer dans une tradition deacutetermineacutee drsquoautant que les deux colonnes grecque et latine ne sont pas conserveacutees en entier De plus il nrsquoest possible de combler les lacunes qursquoavec le texte connu par les fables bilingues de tradition meacutedieacutevale De toute faccedilon le texte qursquoon lit dans le papyrus est plus proche de la version de la quinziegraveme fable du Fragmentum Parisinum aussi parce que tous deux ont choisi de pla-cer le grec en face du latin et non le latin en face du grec (comme dans la version du manuscrit de Leyde)thinsp154
Fonder des reconstructions stemmatiques agrave partir drsquoun fragment petit comme le PSI Vii 848 preacutesenterait des limites de meacutethode trop importantes (fig 1) Cependant raccorder les eacuteleacutements structuraux
thinsp(147) La recensio Leidensis est dans FlaMMini cit n 45 88 2229-2246thinsp 89 2247-2263 et le texte du Fragmentum Parisinum dans le CGL III 100 23-54thinsp 101 1-23thinsp les deux versions des Hermeneumata sont fort diffeacuterentes surtout au niveau de la morale finale
thinsp(148) Agrave ce propos voir aussi le commentaire de kr aMer cit n 140 p 104thinsp(149) CGL III 100 42thinsp(150) FlaMMini cit n 45 89 2255 = CGL III 100 46thinsp(151) FlaMMini cit n 45 89 2254-2255thinsp(152) CGL III 100 44thinsp(153) Voir au contraire FlaMMini cit n 45 89 2255thinsp vidisses quidem quomodothinsp(154) Voir aussi la perspective traceacutee dans la premiegravere eacutedition du papyrus PSI
Vii 848 p 154
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio34
drsquoun papyrus avec une branche de la tradition plutocirct qursquoavec une autre nrsquoest pas secondaire et il est encore plus difficile de dessiner un arbre geacuteneacutealogique de la tradition des Hermeneumata Pseudodositheanathinsp155 Dans le stemma des macrostructures de contenu les similariteacutes entre le papyrus et le Fragmentum Parisinum nous conduisent agrave supposer un lien entre les deux traditions soit par contact entre une tradition qui avait le grec en face au latin (le papyrus) et une avec le latin en face au grec (qui agrave son tour serait agrave la base des deux versions des Herme-neumata) (f ig 12) soit parce qursquoil srsquoagirait de deacuterivations drsquoune mecircme tradition latino-grecque parallegravele agrave une greacuteco-latine qui aurait des versions connues par la recensio Leidensis (f ig 13)thinsp156
leS FaBleS danS leS eacutecoleS deS GraMMairienS drsquoorient thinsp entre papyruS et Her meneumAtA
Lrsquoapprentissage drsquoune seconde langue dans un empire plurilingue comme lrsquoEmpire romain eacutetait quelque chose de courant surtout au moment ougrave des personnes de langues diffeacuterentes entraient en contact Pourtant il existe une seacuterie de variantes dans lrsquoapprentissage du latin et du grec comme lrsquoacircge des eacutetudiants le but et surtout la chro-nologie des diffeacuterentes eacutepoques ougrave il est devenu une pratique plus ou moins reacutepandue Drsquoun cocircteacute les latinophones apprenaient le grec pour se rapprocher de la litteacuterature et de la culture grecquesthinsp de lrsquoautre cocircteacute les helleacutenophones apprenaient le latin pour des raisons pratiques surtout quand ils srsquoengageaient dans une carriegravere qui exi-geait lrsquoapprentissage de la langue
Depuis la creacuteation de la province romaine drsquoEacutegypte les structures ptoleacutemaiumlques avaient eacuteteacute preacuteserveacutees ainsi que la politique linguistique
thinsp(155) Je me reacutefegravere ici agrave la reconstruction par rodriacuteGuez adradoS cit n 90 p 10-11 qui met agrave la base un archeacutetype (X) qui serait agrave lrsquoorigine de la tradition du papyrus et drsquoune autre tradition (Y) agrave la base des deux versions de Leyde et de Paris des Hermeneumata (f ig 11)
thinsp(156) La paraphrase latine du Romulus est proche de la version du manuscrit de Leyde des Hermeneumatathinsp voir thiele cit n 56 p 66-68
Fig 13Fig 11
X
Y
L P
Pap
Fig 12
X
YPSI vii 848
FrParis RecLeid
RecLeidFrParis
PSI vii 848
X
Y Z
Fig 1
aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

aesopi fabell as narr are condiscant 35
en vigueur qui faisait du grec la langue officielle de lrsquoadministration et de la culture Agrave ce moment le latin nrsquoeacutetait que la langue des diri-geants et de la communication officielle dans lrsquoarmeacutee et il nrsquoexistait que peu de personnes qui avaient le latin comme langue maternelle parmi les fonctionnaires de Rome Quant agrave lrsquoEacutegyptien il repreacutesentait la langue de la sphegravere priveacutee des Eacutegyptiens mecircmes et de leurs insti-tutions traditionnelles Crsquoest pour cela qursquoeacutevoquer le plurilinguisme dans lrsquoEacutegypte greacuteco-romaine renvoie en premier lieu agrave une coha-bitation de systegravemes linguistiques diffeacuterents lrsquoun agrave cocircteacute de lrsquoautre Le terrain pour la promotion de la langue latine dans lrsquoOrient grec a eacuteteacute preacutepareacute par la Constitutio Antoniniana de 212 mais jusqursquoagrave la fin du iiie ndash deacutebut du iVe siegravecle le latin eacutetait surtout reacuteserveacute aux milieux militairesthinsp Diocleacutetien est le premier agrave avoir tenteacute drsquouniformiser lrsquoad- ministration et de consolider lrsquouniteacute de lrsquoEmpire aussi agrave partir drsquoune latinisation de lrsquoOrient grec Les helleacutenophones qui voulaient ecirctre employeacutes dans lrsquoadministration commencegraverent donc agrave se rapprocher du latinthinsp le latin eacutetait la langue du droit et de lrsquoadministrationthinsp157
En eacutequilibre instable entre le domaine du grammaticus et celui du rhetorthinsp158 la fable a eacuteteacute pendant un moment utiliseacutee non pas sim-plement comme lrsquoun des προγυμνάσματα et comme un exercice qui travaillait sur la laquothinspformethinspraquo du texte mais aussi pour lrsquoenseigne-ment et lrsquoapprentissage drsquoune deuxiegraveme langue Elle eacutetait donc plu-tocirct le terrain du maicirctre de grammaire ndash ou mieux du maicirctre de laquothinsplangue eacutetrangegraverethinspraquo ndash mais pas du rheacuteteurthinsp les personnes srsquoinitiant agrave une deuxiegraveme langue devaient avoir une bonne connaissance de la premiegravere langue et de ses regravegles grammaticales Leur acircge devait ecirctre
thinsp(157) Agrave ce propos se reporter agrave R CriBiore Latin Literacy in Eg ypt in KODAI Journal of Ancient History 13-14 2003-2004 p 111-118 et aux reacutefeacuterences bibliogra-phiques de Scappaticcio cit n 137
thinsp(158) La question de lrsquoappartenance des προγυμνάσματα au terrain du gram-mairien ou du rheacuteteur est probleacutematique et deacutepend de lrsquoanalyse comme on le voit dans la contribution drsquoA WouterS Between the grammarian and the rhetoricianthinsp the κλίσις χρείας in V coroleu oBerparleiter I hoHEnWALLnER R krit-zer (eacuted) Bezugsfelder Festschrift fuumlr Gerhard Petersmann zum 65 Geburstag Salzburg 2007 p 137-154 qui se focalise plutocirct sur le prog ymnasma de la κλίσις χρείας et sur lrsquousage de ce stratagegraveme didactique au niveau de lrsquoenseignement du gram-mairien La nouveauteacute de la contribution de Wouters est dans la comparaison de ce qursquoon lit dans les traiteacutes grammaticaux et rheacutetoriques avec les teacutemoignages directs des papyrus grecsthinsp il srsquoagit drsquoune perspective de recherche et meacutethodo-logique qursquoon a aussi reproduite ici dans lrsquoanalyse de la fable Sur la fonction de la fable en contexte grammatical voir la perspective de puGliarello cit n 1thinsp la contribution de Pugliarello a plutocirct comme objectif de regrouper les pos-sibles teacutemoignages de la circulation du texte des fables de Phegravedre dans les milieux scolaires
copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

copy BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
maria chiara scappaticcio36
plutocirct celui des eacutelegraveves des classes du rheacuteteur Dans le mecircme temps le besoin drsquoapprendre une deuxiegraveme langue les eacuteloignait des pra-tiques oratoires (dans leur premiegravere langue) consideacutereacutees comme plus nobles et la composition des fables dans deux langues diffeacuterentes devait repreacutesenter quelque chose qui se trouvait entre les deacuteclinaisons verbales et nominales les glossaires bilingues et la libre composition dans la nouvelle langue
Le POxy xi 1404 le PYale ii 104 + PMich Vii 457 et le PSI Vii 848 ndash rassembleacutes tous ici pour la premiegravere fois en tant que corpus de fables latines et bilingues sur papyrus ndash ne transmettent pas exactement le texte des fables de lrsquoun ou de lrsquoautre auctor (soit grec soit latin) mais qursquoil srsquoagisse ou non de paraphrase ils sont les teacutemoins de ce mateacute-riel laquothinsphybridethinspraquo reacute-eacutelaboreacute dans lrsquoun ou lrsquoautre des corpus de fables qui nous sont parvenus (le babrien PAmh ii 26 fait donc exception) Leurs textes rentrent bien sous lrsquoeacutetiquette des Aesopi fabellae et juste-ment leurs fables repreacutesentent le terrain sur lequel le grammairien avait le difficile devoir de familiariser les helleacutenophones drsquoOrient avec une nouvelle langue le latin
Puisque les fables ont une origine grecque il est vraisemblable que le langage original fut le grec et qursquoelles furent ensuite traduites en latin Lrsquoeacutetat fragmentaire du papyrus latin POxy xi 1404 nous impose une suspension de jugement sur la nature du texte du rouleau agrave lrsquoorigine (seulement latinthinsp ou bilinguethinsp) mais les PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26 nous preacutesentent une version bilingue qui laissait de lrsquoespace au grec apregraves le latin Le grec nrsquoeacutetait donc pas agrave cocircteacute du latin comme dans le PSI Vii 848 et dans les reacutedactions des fables des Hermeneumata Pseudodositheana Le PSI Vii 848 et ensuite les Hermeneumata pourraient nrsquoecirctre qursquoune version laquothinspcanoniseacuteethinspraquo (et cela mecircme au niveau de la mise en page des textes latin et grec) et proposeacutee comme manuel pour lrsquoapprentissage linguistique de lrsquoexer-cice de traduction (donc du vertere) des fables grecques en latin des PYale ii 104 + PMich Vii 457 et PAmh ii 26
La seule donneacutee incontestable est que les quatre papyrus qui nous sont parvenus gracircce au hasard teacutemoignent de lrsquoeacutevidence de la circu-lation vers le iiie et le iVe siegravecles des versions latines des fables laquothinspeacuteso-piquesthinspraquo ndash une tradition populaire et puis scolaire ndash dans lrsquoOrient helleacutenophone et en mecircme temps du rocircle des fables dans lrsquoapprentis-sage drsquoune L(angue)2
Maria Chiara Scappaticcio
Universiteacute de Naples laquothinspFederico IIthinspraquoPrincipal Investigator ndash PLATINUM (ERC-StG 2014 no 636983)
mariachiarascappaticciouninait
Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)

Pl I-IIMaria chiara Scappaticcio
Planche 1thinsp POxy xi 1404 (iiie siegravecle)With the courtesy of the Wellesley College Margaret Clapp Library
Special Collections
Planche 2thinsp PSI Vii 848 (iVe siegravecle)