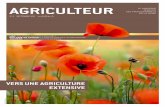REUNION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU … · - Mme Sylvie MAURESMO, bureau d’étude SICAA...
Transcript of REUNION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU … · - Mme Sylvie MAURESMO, bureau d’étude SICAA...
REUNION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS POITEVIN
11 MARS 2009
Compte-rendu
_______
11 mars 2009 - 14 H 00 Ancienne salle des délibérations du Conseil général 79 – Niort
CONTACT : Cellule animation SAGE – M. François JOSS E Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
Hôtel du département – 79021 NIORT Cedex Tel : 05 49 06 79 79 Fax : 05 49 06 77 71
Email : [email protected]
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 2
REUNION DE LA CLE DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS PO ITEVIN DU 11 mars 2009
____
Etaient présents, avec voix délibérative, les membres de la CLE suivants :
Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
- M. Serge AUDEBRAND, adjoint au Maire du Vanneau
- M. Patrick BLANCHARD, vice-président de la CLE, président du SYNHA (mandat de M. ROUSTIT)
- M. Marie-Josèphe CHATEVAIRE, Conseil général de la Vendée (mandat de M. SOUCHET)
- M. Daniel DAVID, maire de Benet
- M. Bernard FAUCHER, maire de Saint Georges de Noisne
- M. Claude GARAULT, SMC du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
- Mme Nicole GRAVAT, Ville de Niort
- M. Jean-Jacques GUILLET, Maire d’Amuré (mandat de M. DUGLEUX)
- M. Jean-Pierre JOLY, S.I.A.E.P de la Plaine de Luçon
- M. Joël MISBERT, Conseil général des Deux-Sèvres
- M. Serge MORIN, Conseiller Régional de Poitou-Charentes, Président de la CLE (mandat de M. FOURRAGE)
Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées
- M. jean BOUCARD, Union des Marais de la Charente maritime,
- M. François DURAND, Association de concertation pour l’irrigation et la maîtrise de l’eau en Charente-Maritime
- M. Jacques HERAUD, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. Bruno LEPOIVRE, association des irrigants des Deux-Sèvres
- M. Yves MIGNONNEAU, Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime,
- M. MOINARD, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. Philippe MOUNIER, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. François-Marie PELLERIN, Association de Protection, d’Information, d’Etude de l’Eau et de son Environnement
- M. Patrick PICAUD, Association Nature-Environnement 17
- M. Antoine PRIOUZEAU, Chambre d’Agriculture de Vendée,
- M. Pierre TROUVAT, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres,
Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
- M. Claude DALLET, Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- M. Pierre BARBIER, DDEA de Vendée (mandat de la DIREN des Pays de la Loire)
- M. C. BARBARIN, ONEMA
- M. Alain DUCLOUX, DDEA Deux-Sèvres
- M. Yann FONTAINE, DISE Charente-Maritime,
- M. D. PERRIN, DISE des Deux-Sèvres
- Mme Bénédicte GENIN, DIREN Poitou-Charentes (mandat du Préfet de région Poitou-Charentes)
- M. Bruno LE ROUX, DISE des Deux-Sèvres,
- M. Cyril CAFFIAUX, Préfecture des Deux-Sèvres.
Assistaient en outre les personnes suivantes :
- M. Jean-François LEBOURG, DIREN Poitou-Charentes
- M. Cédric BELLUC, syndicat hydraulique du Nord Aunis et SIEAGH du Curé
- M. Fabrice ENON, Syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autises,
- Mme Nadine PELON, Chambre d’agriculture de Vendée
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 3
- M. François MARTIN, Conseil général des Deux-Sèvres
- Mme Maggy GRILA, Conseil Général de Vendée,
- M. Olivier CAILLE, Syndicat des eaux de la Courance
- Melle Sabine ALBOUY, stagiaire Agro Paris Tech
- Melle Nathalie COUPIN, stagiaire Agro Paris Tech
- M. Damien MASINSKI, Conseil régional des Pays de la Loire
- M. François JOSSE, IIBSN, animateur du SAGE
- Mme Marion PASQUIER, Parc Interrégional du Marais Poitevin
- Melle Laure THEUNISSEN, IIBSN
- Mme Sylvie MAURESMO, bureau d’étude SICAA Etudes
- M. Christophe BIRET, agriculteur représentant l’ASLI “la Goutte d’eau”
- M. Aymeric MOLIN, DRAAF Poitou-Charentes
- M. Marie TROCME, Directrice de l’I.I.B.S.N.
Etaient excusés :
- M. Dominique SOUCHET, Député, Président de l’IIBSN
- M. Jean-Marie ROUSTIT, Conseil général de Charente-Maritime
- M. JOUBERT, Conseil régional Poitou-Charentes
- M. Hugues FOURAGE, Syndicat mixte du Parc Interrégional du Marais poitevin
- M. DUGLEUX, Conseil général des Deux-Sèvres
- M. BOURON, mairie d’Arçais
- M. BARANGER, maire de Bessines
- M. LACROIX, Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique
- M. Michel BOSSARD, maire de Nieul sur l’Autise,
- Mme Claudette BOUTET, Conseil régional des Pays de la Loire
- M. Claude ROULLEAU, Syndicat intercommunal des eaux de la vallée du Lambon
- M. Jacques SALARDAINE, section régionale de la Conchyliculture RE Centre-Ouest
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 4
I – VALIDATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CLE DU 11 février 2009 Le Président ouvre la séance en présentant les trois points de l’ordre du jour.
Au sujet du procès verbal de la réunion de CLE du 11 février 2009, M. MORIN fait part des réserves de M. PRIOUZEAU concernant la retranscription de certains de ses propos. L’animateur précise qu’une nouvelle version a été proposée à M. PRIOUZEAU qui en a validé les termes. M. MORIN propose d’insérer ces éléments dans le compte-rendu définitif.
En l’absence d’autre remarque, le compte-rendu est adopté à l’unanimité (cf. procès verbal définitif en annexe n°1).
II – PRESENTATION DE L’ETUDE PORTANT SUR L’EVALUATION ECONOMIQUE DU PROJET DE SDAGE SUR LE MARAIS POITEVIN Le Président cède ensuite la parole à M. Aymeric MOLIN (DRAAF Poitou-Charentes) pour une présentation de l’étude portant sur l’évaluation de l’impact économique du projet de SDAGE sur le Marais poitevin et l’analyse comparée des mesures d’accompagnement.
M. MOLIN rappelle tout d’abord que l’étude n’est pas encore totalement finalisée puisque les conclusions définitives ne sont pas attendues avant ce vendredi 13 mars. Il présente et commente ensuite l’étude à partir du power-point dont une copie a été jointe en annexe n°2. En complément des éléments apportés par le power-point présenté en séance, M. MOLIN rappelle notamment le choix des volumes qui ont servi de référence initiale (base 100%) pour essayer de rendre homogène le calcul des conséquences du projet de SDAGE sur les différents départements :
- pour le département de la Vendée, il s’agit des volumes consommés en 2003 ;
- pour le département des Deux-Sèvres et de Charente Maritime, il s’agit des autorisations de prélèvements pour l’année 2005 (autorisations 2005 calculées sur une consommation moyenne réelle sur les années antérieures, corrigée à la hausse par un coefficient de 1,15 .
M. MOLIN rappelle que ce choix a été fait en accord avec les DDEA des différents départements pour tenir compte des politiques de gestion de l’eau qui ont pu être différentes d’un département à l’autre.
M. MOLIN rappelle aussi, qu’à partir des hypothèses de réduction des volumes prélevables retenus dans le projet actuel de SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin (pourcentage global de réduction des volumes prélevables en été de l’ordre de 58 %), le modèle utilisé dans l’étude estime la perte de marge brute annuelle pour les exploitations irriguées à :
- 1,43 M€ pour l’unité de gestion « Mignon Courance »,
- 1,41 M€ pour l’unité de gestion « Sèvre amont »,
- 0,23 M€ pour l’unité de gestion « Lambon »,
- 2,11 M€ pour l’unité de gestion «Mignon et Curé en Charente Maritime»,
- 1,55 M€ pour l’unité « Vendée »
- 0,63 M€ pour l’unité « Autize »
Le total de perte de marge brute pour l’ensemble du territoire du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin peut donc être évalué à 7,36 M€ par an.
M. MOLIN présente aussi des résultats partiels pour les différentes filières agricole.
Ainsi, pour les organismes stockeurs, les modifications d’assolement associées à la réduction des volumes prélevables conduisent à des changements de stratégie d’entreprise qui exigent des investissements complémentaires en matière de stockage. (absorption de l’augmentation des volumes de céréales récoltés en été au dépend des volumes de maïs récoltés à l’automne). Ces investissements sont estimés à 9 M€. Dans le même temps, la perte de marge brute de ces organismes est estimée à 1,8 M€ par an et devrait aussi se traduire par une perte de l’ordre de 75 emplois.
En ce qui concerne les aliments du bétail, les conséquences de la substitution du maïs par d’autres céréales (blé notamment) dans les rations alimentaires sont étudiées. En effet, la valeur énergétique du blé est plus faible que celle du maïs alors que son prix est supérieur à celui de ce dernier. On peut donc s’attendre à une augmentation du coût de production des aliments avec des conséquences sur les filières laitière et bovin viande.
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 5
Pour les éleveurs laitiers, cette augmentation du prix des aliments du bétail devrait se traduite par un augmentation du coût de production du litre de lait. D’autre part, pour certaines exploitations qui n’auraient pas de sécurisation de l’affouragement en ayant des terres dans le marais, cette réduction forte de volumes d’irrigation pourrait se traduire par l’insuffisance de la production de fourrage sur l’exploitation et par un abandon de l’atelier laitier.
Pour les ateliers de bovins viande, l’augmentation des prix des aliments et la diminution de l’autosuffisance en fourrage pourraient conduire à une diminution des capacités d’engraissement et donc à une augmentation de la vente d’animaux maigres.
Dans le cadre de la phase 4 (mise en perspective de ces résultats et impact sur les autres usages), les résultats ne sont pas encore finalisés. Cependant, parmi les conséquences envisagées d’une réduction des volumes prélevables en été, les points suivants ont d’ores et déjà mis en avant :
- un moindre risque de paiement d’une amende européenne dont le coût avait été estimé en première approche en 2003 à 150.000 € par jour,
- une augmentation des disponibilités en eau douce dans le Marais nécessaire à l’activité conchylicole,
- des conséquences assez contrastées suivant les secteurs pour l’agriculture non irriguée du Marais,
- une augmentation des capacités d’épuration et de dilution des rejets des stations d’épuration,
- des conséquences contrastées en terme d’alimentation en eau potable avec une distinction entre les bassins versants où des adaptations ont déjà été réalisées et des territoires où il y a encore des problèmes avérés (zoom sur l’AEP de la ville de Niort),
- des impacts favorables sur les infrastructures en raison du tassement des sols et des tourbes,
- des impacts favorables sur les activités de tourisme et notamment de la batellerie,
- et surtout, des impacts favorables en matière de maintien et de préservation de la biodiversité.
M. MORIN remercie l’intervenant pour avoir tenu son exposé dans les délais impartis. Il poursuit en faisant remarquer que, si pour les personnes ayant suivi régulièrement le dossier les éléments exposés sont facilement compréhensibles, cela doit être un peu plus dur à assimiler pour les membres de la CLE qui le découvre pour la première fois…
Il fait remarquer que même si la validation définitive par l’Etat (commanditaire de cette étude) ne doit pas intervenir avant le 13 mars, c’est déjà une gageure de tenir ce délai au vue du contenu de la commande initiale et des questionnements supplémentaires qui sont venus s’ajouter au fur et à mesure des différents comités de pilotage. Il considère pour sa part que cette étude constitue une base intéressante et une approche du grand bassin versant du Marais poitevin dans son contexte socio-économique global. Il croit savoir qu’il est prévu que chacune des trois CLE concernée par cette étude (aussi bien Vendée que Lay) vont avoir une présentation de ce dossier. Il souhaite que cette présentation soit aussi effectuée devant la CC3S afin que ces membres puissent s’approprier ce dossier. Il conclut en précisant que cette base de réflexion arrive à point nommé pour apporter des éléments d’expertise au débat sur le projet de SDAGE Loire Bretagne dont la rédaction n’est pas encore finalisée et dont la formulation risque encore d’évoluer notablement d’ici octobre 2009. Il ouvre enfin le débat à la CLE.
M. PRIOUZEAU pose trois questions. Il demande tout d’abord sur quelle base tarifaire a été estimée la prévision de perte de 7 millions d’euros par an. Il fait ensuite part de son inquiétude concernant la juste prise en compte de l’augmentation des coûts de production induits par ces mesures pour l’ensemble des filières agricoles. Ces données ne lui semblent en effet pas suffisamment précises, ni suffisamment actualisées, pour tenir compte des dernières évolutions des cours des denrées céréalières, laitières ou encore des produits carnés. Enfin, il estime que cette étude n’apporte pas de réponse précise quant à l’incidence des mesures de réduction des volumes d’irrigation en terme d’emploi sur le secteur de l’agro-alimentaire, notamment en lien avec la perte prévisible d’ateliers d’engraissement sur la totalité, ou tout au moins, sur une grande partie du territoire. M. PELLERIN précise tout d’abord que s’il siège à la CLE en tant que représentant de l’APIIE son intervention se fera, sur ce point, au titre de la Coordination pour la défense du Marais poitevin qui a été invitée à participer à la phase 4 de l’étude. En préambule, il précise que ses interrogations ne constituent aucunement une remise en cause du bien fondé de cette étude (travail colossal de le réaliser dans des délais aussi courts). Il demande tout d’abord s’il est possible de connaître la date de disponibilité de ces documents. En effet, il est pour l’instant impossible à chacun d’effectuer une analyse et une expertise de cette étude et de se déterminer par rapport à son contenu. Il souhaite ensuite savoir quand sera réalisée une étude de l’impact du projet de SDAGE sur l’économie globale du territoire et pas seulement sur la seule économie agricole irriguée. C’est en effet ce que les associations vont demander dans le SDAGE.
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 6
Il argumente sur le fait que, si le travail sur l’économie agricole irriguée est absolument nécessaire, on ne peut se limiter à l’étude d’une petite catégorie d’une population qui est elle même une petite catégorie d’une population générale. Les irrigants sont en effet une catégorie importante mais ce ne sont pas les seuls agriculteurs et ce ne sont pas les seules personnes qui vivent de l’économie de ce territoire. Malgré l’importance du travail effectué, il estime pour sa part que cette étude n’est qu’une étape parmi d’autres. D’autre part, il précise que quelque chose l’a gêné dans l’introduction de la présentation de l’étude qui a été effectuée. En effet, il considère qu’il n’est pas possible d’affirmer que la finalité du SDAGE est d’avoir des niveaux hauts dans le Marais comme cela a été énoncé. L’objectif est bien de faire en sorte que ce dernier, en tant qu unité hydraulique et de biodiversité fonctionne correctement. A ce titre, les niveaux ne constituent qu’un des éléments de la problématique. De plus, il tient à souligner que contrairement à ce qu’il a pu percevoir des premiers éléments et première version de cette phase 4, personne ne demande des niveaux très hauts en été (ou en fin d’été) et que cet élément fait partie des légendes que l’on colporte. Il note que si la Coordination pour la défense du marais poitevin a été invitée à participer à la phase 4 de l’étude, elle en ressort excessivement frustrée pour deux raisons. Tout d’abord, les débats n’ont duré qu’une heure et demi. D’autre part, les premiers éléments du rendu sont particulièrement décevants, avec la présence d’un certain nombre d’erreurs manifestes (non seulement dans le domaine de la biodiversité, mais aussi sur l’élevage ou encore sur l’eau potable où il été a noté des éléments particulièrement choquants). Il considère que cette phase 4 ne pourra être validée que si le travail est poursuivi, ce qui est inquiétant vu la proximité de la date du 13 mars. En conclusion, ses interrogations portent, d’une part sur la date de mise à disposition des documents exhaustifs et, d’autre part, sur la validation de la phase 4 qui ne pourra être signée et cautionnée par l’association que si le débat se poursuit et les documents provisoires, actuellement pétris d’erreurs par omission ou même de contre-vérités, amendés. Avant de céder la parole à l’intervenant pour répondre à ces questions, M. MORIN intervient pour préciser qu’un document produit par le Syndicat des eaux du Vivier (ville de Niort) lui a été transmis (ainsi qu’aux services de l’Etat) juste avant le début de la séance. Ce document apporte un certain nombre d’éléments (y compris chiffrés) se rapportant à l’expérience et au territoire de compétence du syndicat, formule des remarques et fait des propositions de rédaction par rapport au chapitre concernant l’alimentation en eau potable dans la phase 4 de cette étude. Il précise qu’une copie de ce document sera transmis pour information dans le compte-rendu de séance. Il demande ensuite à Mme GRAVAT si elle souhaite intervenir pour apporter des précisions par rapport à ce document (cf. annexe n°3). Mme GRAVAT reconnaît qu’il lui a été difficile de répondre dans les délais impartis. Elle constate cependant l’aspect inquiétant de certains éléments du rendu actuel de la phase 4 de l’étude. En effet, s’il est indéniable que l’agriculture est impliquée dans la problématique économique liée à l’aspect quantitatif du SDAGE, elle n’est pas la seule. Il ne faudrait donc pas oublier que l’alimentation en eau potable peut l’être tout autant, à la fois en raison des conséquences sur les paramètres quantitatifs mais aussi qualitatifs des ressources en eau potable. M. MOLIN aborde alors successivement les différentes questions posées. Tout d’abord, il précise que les éléments chiffrés présentés sont bâtis sur des hypothèses de prix moyens (170 €/tonne pour le blé et 150 €/tonne pour le maïs). Toutefois, dans le cas où plus de détails concernant les scénarii « pris bas » et « prix élevés » seraient demandés, il est tout à fait envisageable de les développer dans d’autres occasions. En ce qui concerne l’emploi sur les filières agro-alimentaire, il confirme que le bureau d’étude a rencontré un grand nombre d’acteurs de la filière aval et que, si par la suite il a été opéré un recentrage sur quelques filières plus précises, c’est que le bureau d’étude a préféré ciblé son travail sur les points de la filière aval qui sont réellement touchés et pour lesquels il est possible de quantifier l’impact. En effet, il a été mis en évidence que certains groupes agroalimentaires présents sur le territoire du marais poitevin (mais pas uniquement sur ce territoire) ont une capacité d’adaptation et de collecte sur des secteurs beaucoup plus larges. Pour eux, la réaction aux conséquences des mesures préconisées dans le SDAGE consiste à compenser ces pertes locales par une augmentation de leur capacité sur d’autres territoires. Par conséquent, ils ont des logiques qui dépassent l’échelle du simple territoire du Marais poitevin. En ce qui concerne la mise à disposition et la transmission des documents à d’autres acteurs que ceux présents dans le comité de pilotage, M. MOLIN précise qu’il faut d’abord qu’ils aient été définitivement validés. Il fait ensuite remarquer que la situation et les critiques portées sur la phase 4 de l’étude lui semblent tout à fait normales, et qu’elles ont aussi été ressenties et vécues lors de l’élaboration des autres phases. Le premier jet d’un bureau d’étude peut en effet comporter un certain nombre d’erreurs. Le rôle du groupe de travail « agriculteurs » mais aussi du comité de pilotage a été de déceler tous ces problèmes et de les faire corriger. Par conséquent, les contributions de chacun sont les bienvenues et le maître d’ouvrage de l’étude prendra soin de s’assurer qu’elles sont prises en compte par le bureau d’étude. Cependant, il tient à préciser que cette prise en compte ne signifie pas forcément une écriture identique à la rédaction de propositions apportées par les contributeurs. Dans un groupe de travail, il peut y avoir des apports contradictoires. Dans ce cas, le travail du bureau d’étude est alors de nuancer des éléments qui ont pu avoir été
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 7
présentés comme des vérités absolues dans un premier temps. C’est ce qui est fait actuellement par le bureau d’étude pour la phase 4. Il note que, dans le cahier des charges initial de l’étude, il n’était d’ailleurs pas du tout prévu d’avoir ce groupe de travail « usagers » lors de la réalisation de la phase 4. C’est le maître d’ouvrage qui a pris la décision d’employer pour cette dernière phase, la même méthodologie que celle employée pour les trois premières : l’utilisation de groupes de travail. Il lui semblait en effet utile de recueillir les témoignages des acteurs de terrain sur ces différents usages. Cette décision a ensuite été validée par la comité de pilotage en décembre 2008. En ce qui concerne plus précisément le domaine de l’alimentation en eau potable, et pour le département des Deux-Sèvres, c’est le syndicat des eaux du Vivier (SEV) qui a été contacté. Ce choix répondait à deux attentes : limiter le nombre de participants pour des questions pratiques, prendre en compte l’importance de ce syndicat qui alimente la ville de Niort (ce qui n’est pas anodin en terme de population sur le bassin versant). Si le syndicat n’a malheureusement pu être présent lors de la réunion du groupe de travail, le bureau d’étude a eu ensuite plusieurs contacts avec ce syndicat afin d’intégrer les remarques qui ont pu lui être proposées. M. MORIN fait remarquer qu’il lui semble important que l’Etat (et plus précisément le ministère de l’agriculture), en tant que financeur, soit à l’avenir propriétaire de l’étude et de la méthode employée. Cela permettrait de rentrer ultérieurement de nouveaux critères ou de nouvelles données pour faire fonctionner le modèle sans que l’on soit obligé de repartir de zéro comme cela a pu être le cas pour d’autres études. M. MOLIN confirme que cette appropriation du modèle ainsi qu’une formation à son utilisation ont été prévues dans le cahier des charges. Il sera donc possible de modifier un certain nombre de paramètres pour avoir des résultats actualisés en fonction de l’évolution de la situation. Le souhait du maître d’ouvrage est notamment de pouvoir intégrer les réformes de la politique agricole commune qui sont actuellement en cours de formalisation. M. BLANCHARD interroge alors M. MOLIN sur la liste des organismes qui ont été contactés pour réfléchir à la problématique de l’eau potable. Celui-ci confirme que des interlocuteurs étaient aussi présents pour représenter les deux autres départements. Il s’agissait en l’occurrence du syndicat des eaux de Charente-Maritime pour ce département et du Conseil général pour le département de la Vendée. M. MORIN remercie les services de l’Etat d’avoir accepter de présenter le dossier devant la CLE, alors même qu’il n’est pas totalement finalisé. Il lui semble en effet important de partager sans attendre les conclusions de cette étude dans la perspective des débats en cours sur le projet de SDAGE. Il promet d’autre part que ces documents seront transmis aux membres de la CLE dès qu’ils auront été finalisés et il interroge les services de l’Etat pour savoir si cette étude va être portée à la connaissance de la commission de coordination inter-SAGE qui est prévue pour le mois d’avril. M. GENIN confirme que l’Etat va bien suggérer que la présentation de cette étude soit bien à l’ordre du jour de la prochaine commission des 3 SAGE. M. MORIN poursuit en souhaitant que, si des propositions ou des remarques en provenance des syndicats d’eau de Vendée ou de Charente Maritime venaient à émerger aujourd’hui (bien que ces structures aient été représentées à la réunion de concertation), elles puissent être intégrées au débat et à l’étude, que cela soit sur l’aspect économique (investissements, coûts) ou sur l’aspect de l’évolution de l’organisation de la production et de la distribution de l’eau potable. M. GUILLET acquiesce et considère que, quitte à mettre les choses à plat, il faut alors qu’elles le soient toutes. Les syndicats d’eau ont dû faire, depuis des années, un certain nombre d’investissements. C’est le cas en particulier des interconnexions, mais aussi , et cela n’est pas anodin, de la création de nouveaux forages. Pour lui enfin, il ne faudrait pas oublier l’économie de la pêche et du tourisme ainsi que les conséquences du tassement des sols liés à des niveaux d’eau trop faibles: maisons fissurées, assurances en augmentation ou encore voiries et ouvrages détériorés. Il conclut en affirmant que tous ces éléments doivent apparaître dans l’étude car ce sont des éléments déterminants, et que cela a touché beaucoup de monde. Pour faire écho et reprendre les inquiétudes et questions exprimées précédemment par M. PRIOUZEAU, M. JOLY annonce qu’il s’est permis d’envoyer au président de la CLE une expertise vendéenne, d’un élu vendéen, portant sur les incidences économiques d’une réduction des volumes d’irrigation, notamment sur l’emploi dans le département (cf. copie du courrier adressé au président de la CLE en annexe n°4). Il espère que ces éléments pourront être intégrés dans l’étude. Il tient aussi à signaler, à l’adresse de ceux ou celles qui n’en auraient pas eu connaissance, que dans un rapport dressé par la préfecture de Vendée en date du 2 février 2009, il est mis en évidence que les 750 établissements qui emploient près de 29 % des salariés de l’industrie vendéenne (soit près du 1/3 des salariés) dépendent entièrement du domaine agricole et para-agricole. Parmi ces fleurons de l’industrie, il peut être cité Fleury Michon, Sodébo ou encore Arrivé. M. JOLY cite ensuite l’exemple de la production de foie gras. Le département de la Vendée est en effet le second département français en terme de production. Or, cette production nécessite une spécialisation, une spécificité
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 8
agronomique autour de certaines cultures. D’autre part, la qualité finale du foie gras dépend d’une certaine typologie et de certaines variétés de maïs. M. JOLY conclue enfin que si on y ajoute l’emploi agricole direct aux emplois salariés de l’industrie agroalimentaire, c’est presque 37 à 38 % des emplois du département qui sont directement induits par l’agriculture et que cette donnée mérite d’être prise en compte. M. MORIN clôt enfin le débat en invitant les membres de la CLE, ainsi que les organismes qu’ils représentent, à produire leurs remarques par écrit et à les transmettre aux services de l’Etat dans les semaines à venir. Un autre intervenant relance la discussion en faisant part de ses interrogations concernant l’évolution de la situation du marais dans l’hypothèse où l’on s’acheminerait vers un arrêt de l’irrigation. En effet, cela fait plus de soixante ans qu’il vit dans le marais et il pense pour sa part que la situation s’est améliorée. Autrefois il n’y avait pas d’irrigation et il n’y avait pourtant pas d’eau en été. Il fallait mettre des batardeaux, batardeaux qui ne servaient pas forcément à grand chose. Aujourd’hui, des outils comme le contrat restauration entretien sont mis à disposition du marais et ces outils apportent un mieux dans sa gestion. Il constate tout de même que les volumes destinés à l’irrigation ont déjà fortement diminué. M. MORIN fait remarquer qu’il lui semble qu’il n’est pas prévu d’aller vers l’arrêt de l’irrigation. A ce sujet, M. MORIN rapporte qu’il a assisté dernièrement à une réunion du comité de pilotage de l’étude de modélisation hydraulique des nappes du bassin versant réalisée actuellement par le BRGM. Il précise qu’il en attend avec impatience les conclusions et qu’il fonde aussi beaucoup d’espoir dans les possibilités offertes par ce modèle en matière d’analyse comparée de scénarios d’évolution des niveaux d’eau, de volumes prélevés et de fonctionnement des milieux. Mme GENIN précise que cette étude est une extension du modèle maillé qui a été développé à l’origine sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes et du Marais poitevin. L’objectif est d’obtenir une estimation un peu plus précise qu’actuellement des volumes prélevables en modélisant au mieux les relations « nappes/marais ». Cette modélisation doit aussi permettre dans un second temps un certain nombre de simulations (un peu plus tard dans l’année). M. DAVID demande ensuite si, en l’état actuel de l’étude économique, il serait faux de la synthétiser très brièvement :
- en rapprochant la marge brute globale des exploitations concernées par les mesures de restriction de l’irrigation (soit 61 millions d’euros) de la perte attendue sur ces mêmes exploitations (7 millions d’euros), soit un ratio de 11 à 12 % ;
- et en constatant qu’un certain nombre de mesures sont étudiées dans le même temps pour compenser au mieux ces pertes prévisibles.
M. MOLIN rappelle que cette étude constitue un outil d’aide à la décision et que bien évidemment la DRAAF n’est pas le décideur. Il confirme que ce qui est souhaité avec cette étude, c’est de pouvoir présenter, en face de pertes économiques, un certain nombre de mesures qu’il est possible de déployer pour les compenser. Il met en garde toutefois sur le fait que cela suppose que les financements de ces mesures soient trouvés. Il précise que, si la décision politique d’accorder ou non le financement de ces mesures échappe totalement à la DRAAF, l’objectif de cette structure est bien de mettre dans la main des décideurs, à la fois une évaluation des pertes économiques engendrées par leurs décisions en matière de limitation de l’irrigation, et des outils qui peuvent être proposés aux agriculteurs lors de cette phase de perte économique. Il confirme que la synthèse que peut faire un décideur politique est bien celle proposée par M. David. Toutefois, il souligne que ce qui est encore plus important que la perte de marge brute pour les exploitants agricoles, c’est la traduction de cette perte en terme de baisse de revenu. C’est pourquoi, ce calcul a été réalisé pour un scénario de réduction des volumes d’irrigation en période estivale de 60 %, pour des prix moyens des produits agricoles, et toute chose restant égale par ailleurs (d’éventuelles évolutions de la réforme de la PAC ne sont en effet pas intégrées à ce calcul). Pour les céréaliers, cela se traduit par une perte de revenu de 20 %, pour les éleveurs par une perte de 14 % et pour les éleveurs en polyculture élevage par une perte de 26 %. Ce chiffrage a été effectué sur une base de -60% des prélèvements car cela correspond, en moyenne sur l’ensemble des unités de gestion, aux hypothèses retenues dans le cadre du projet de SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin. M. MOLIN confirme cependant que le modèle permettrait tout aussi bien d’effectuer les mêmes calculs sur d’autres hypothèses. M. PRIOUZEAU apporte enfin au débat un élément qui lui semble particulièrement important. En ce qui concerne la production laitière, la modélisation se base sur des prix du lait aux alentours de 200 à 220 €/tonne alors que le prévisionnel pour la fin 2009 porte plutôt sur un prix de 150 €/tonne. Pour cette raison, il souhaite que cette situation soit prise en compte dans le modèle, de manière à calculer une incidence réelle sur la perte du revenu net des exploitations agricoles. La crainte de la profession agricole est qu’avec des chutes de prix au niveau des produits agricoles et des modalités d’application de la réforme de la PAC encore inconnues ou mal connues à ce jour, on se retrouve à terme avec des incidences beaucoup plus fortes que celles annoncées aujourd’hui. En l’absence de nouvelles remarques, M. MORIN propose de passer au point suivant de l’ordre du jour.
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 9
III – PRESENTATION DU PROJET DE RESERVE DE SUBSTITUTION DE l’ASLI « LA GOUTTE D’EAU » SUR LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET Tout d’abord, M. MORIN introduit le sujet en indiquant que le projet se situe sur le territoire du bassin de la Sèvre niortaise, dans le département de Vendée. Il rappelle ensuite que ce dossier a déjà franchi les différentes étapes de la procédure administrative (enquête publique, CODERST, arrêté préfectoral). L’objectif de la présente présentation, effectuée à la demande de l’agence de l’eau Loire Bretagne, est de situer le dossier au niveau technique et de solliciter les remarques et l’avis de la CLE sur le projet. M. DALLET précise que l’agence de l’eau a reçu une demande d’aide de la part de l’ASLI « la goutte d’eau ». Or, pour instruire ce dossier qui peut prétendre à ses aides, l’agence de l’eau demande un avis de la CLE avant de le soumettre à ses propres instances. Ce dossier, qui devrait être soumis à ces instances en avril prochain, nécessite donc au préalable un avis de la CLE. C’est ce qui est demandé aujourd’hui. Le Président cède ensuite la parole à Mme Sylvie MAURESMO du bureau d’étude SICAA Etudes pour une présentation du dossier de réserve de substitution de la société ASLI « la Goutte d’Eau » sur la commune de Saint Etienne de Brillouet.
Mme MAURESMO présente et commente le projet à partir du power-point dont une copie a été jointe en annexe n°5. M. MORIN remercie l’intervenante pour la précision et la concision de son exposé qui permet de laisser une large place aux questions. M. DAVID ouvre le débat en demandant s’il serait possible de disposer d’éléments concernant le plan de financement du projet de réserve et de son articulation (ou non) avec un projet plus global sur le bassin versant. M. BIRET prend la parole en tant que président de l’ASLI pour répondre à ces interrogations. En ce qui concerne le coût du projet, il précise que l’ASLI compte arriver à contenir le coût au niveau de 3 €/m3 pour la création du projet, c’est à dire les opérations de terrassement et la pose de la bâche d’étanchéification. En ce qui concerne le financement, le Conseil général de Vendée est partant pour apporter 30 % du montant; en accord avec l’agence de l’eau, il pourrait y avoir ensuite une subvention de celle-ci à hauteur de 40 %. Le reste est apporté par le porteur de projet. M. MORIN demande si des fonds européens sont aussi envisagés. M. BIRET répond que cela n’est pas prévu. M. MORIN souhaite se faire confirmer que le montant de 3 €/m3 pour l’investissement ne tient pas compte du coût éventuel du transport de l’eau. M. BIRET confirme que ce coût ne prend en compte que l’investissement « retenue ». M. Bernard FAUCHER demande ensuite qui sera le propriétaire de la réserve. M. BIRET précise que c’est l’ASLI qui en sera le propriétaire, sachant que ce sont les propriétaires exploitants qui l’achètent. Pour replacer cette question dans son contexte, M. MORIN rappelle les différents cas de figure rencontrés dans les dossiers de réserve présentés à la CLE : le dossier des Autizes qui était porté par un syndicat mixte (en l’occurrence, le syndicat mixte du Marais poitevin et des bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes) ou le dossier situé sur la commune de Pamproux qui était un dossier purement privé (en l’occurrence, une société d’exploitation agricole). Dans le cas du présent dossier, le dossier est porté par une association syndicale libre (ou ASLI). M. PELLERIN prend la parole pour rappeler les remarques faites par la Coordination pour la défense du marais poitevin lors de l’enquête publique. Il précise que ce sont des remarques et des principes d’ordre général que l’on va retrouver pratiquement systématiquement dans tous les projets de réserve et dont le contenu peuvent intéresser les membres de la CLE. Il souligne toutefois que le présent dossier est déjà « ficelé » (tout au moins en terme d’acceptation techique par les services de l’Etat) puisqu’il est déjà passé devant le CODERST. La première remarque (et il tient à souligner que cette remarque n’est pas adressée uniquement au porteur de ce projet puisque ce système existe aujourd’hui ailleurs, notamment en Charente-Maritime) porte sur le fait qu’il suffit de présenter un projet porté par deux personnes pour en faire un projet collectif susceptible de recueillir les différentes sources de subvention. Il considère que c’est effectivement la règle du jeu mais qu’elle est de ce fait un peu dévoyée. Il poursuit en reconnaissant que ce projet présente des aspects très intéressants que l’on ne retrouvait pas dans les dossiers précédents, notamment la substitution totale d’un forage qui devrait vraiment être obturé dans les règles de l’art. Il considère toutefois que plusieurs aspects fondamentaux et principes généraux du projet l’empêchent d’accepter ce dossier tel qu’il est présenté :
- en premier lieu, il constate l’absence d’une étude globale d’incidence qui permettrait d’anticiper les conséquences des différents projets qui, comme chacun le sait, vont se succéder les uns derrière les autres sur ce secteur. Ce point constitue un des principaux défauts du projet et M. PELLRIN rappelle
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 10
que différents dossiers présentés par ailleurs sur la région sont aujourd’hui en difficulté, car ce point y a été mal apprécié.
- en second lieu, la question du choix de l’année 2003 comme base de calcul pour le dimensionnement des réserves lui semble discutable car les consommations de l’année 2003 revêtent des niveaux exceptionnels ;
- il s’interroge ensuite sur la pertinence, et le caractère raisonnable pour les décideurs, de s’engager vers l’autorisation de ce type d’ouvrages alors même qu’on est en pleine discussion sur la définition de volumes prélevables. Il ressent dans cette volonté une stratégie du fait accompli où chacun se précipite pour construire sa réserve avant que le couperet tombe ;
- enfin, il trouve contestable de discuter de l’impact hydraulique d’un ouvrage, puis ensuite de baser les règles de gestion de celui-ci, sur des critères de fonctionnement des nappes en période d’étiage alors même que les prélèvements opérés se font en période hivernale et que l’on sait pertinemment qu’il y a des besoins biologiques et des besoins de fonctionnement des milieux spécifiques à cette période. Pour M. PELLERIN, il ne s’agit pas de s’affranchir de critères et de niveaux de gestion pour les réserves de substitution, mais bien d’utiliser des références hivernales. Or, ce n’est pas le cas pour la réserve de l’ASLI « la Goutte d’Eau » puisque c’est le niveau piézométrique de début d’étiage (POEd) fixé dans le projet de SAGE Sèvre niortaise qui est proposé pour la gestion de cet ouvrage.
M. TROUVAT souhaite réagir par rapport aux propos de M. PELLERIN. Tout d’abord, il lui paraît difficile de réaliser une étude globale qui prenne en compte toutes les retenues qui sont sur un bassin versant lorsqu’on est dans le cadre d’un projet individuel et que l’on est le premier dossier de réserve présenté sur le bassin. Techniquement, il ne voit pas comment cela peut se faire. Ensuite, il rappelle que, même sur des dossiers où la profession agricole a essayé de mettre en place des réflexions collectives (comme cela a été le cas en Deux-Sèvre sur des dossiers comme la Boutonne ou il a été tenté de prendre en compte l’incidence d’un projet global de réserves de substitution sur la totalité d’un bassin versant), où la profession agricole a essayé de répondre à certaines des interrogations des associations de défense de l’environnement avec la plus grande transparence, où la profession agricole a essayé de les solliciter pour qu’elles participent à la réflexion sur le dossier, il n’y a pas eu de réponse très positive de la part de ces associations, au contraire ces associations continuent à attaquer ces projets au tribunal. Pour cette raison, M. TROUVAT se montre perplexe quant à la manière de faire évoluer positivement ce type de dossier. Par contre, il partage le constat de M. PELLERIN quant à l’existence d’une fuite en avant des agriculteurs pour monter rapidement des dossiers et créer des réserves de substitution afin d’éviter de se retrouver confronté à une baisse des volumes prélevables trop importante. Devant ce constat, M. TROUVAT est prêt à négocier les volumes prélevables, à condition cependant que l’on ne réduise pas les volumes prélevables actuels tant que les réserves de substitution n’auront pas été créées. M. PRIOUZEAU souligne qu’avec la gestion prévue pour la réserve de Saint Etienne de Brillouet on supprime les prélèvements en été, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que souhaite la CLE. On prélève dans le milieu en période excédentaire et on arrête en période estivale. M. GUILLET constate toutefois que d’une année à l’autre la pluviométrie peut varier, et que parfois, même en hiver, la nappe ne retrouve pas des niveaux acceptables. On admet donc, devant tout le monde, que ces années là on ne pourra pas avoir recours à des prélèvements hivernaux pour remplir les réserves. M. MORIN se fait ensuite préciser par les services de l’Etat la différence entre ce que l’on appelle les volumes autorisés, les volumes prélevés et les volumes stockés. M. BARBIER explique que jusqu’en 2008, les volumes autorisés en Vendée ne prenaient pas en compte les volumes de printemps. Ce qui fait que le volume autorisé qui a été indiqué dans le dossier (cf. diapositive n°2 de l’exposé) était un volume d’été. Dans les critères du 80 % de l’agence de l’eau, c’est l’ensemble du prélèvement annuel qui doit être considéré. Dans le cadre du projet de réserve, il a donc été repris comme base de calcul les volumes d’été auxquels ont été ajoutés les volumes de printemps. Ce qui fait que l’on arrive à 80 % des volumes sur l’année et non pas seulement sur l’été. Les volumes donnés sont les volumes relevés au compteur transmis à l’agence de l’eau. M. DALLET complète en précisant que l’agence de l’eau attribue une aide sur un volume éligible aux aides de l’agence. Ce volume éligible est calculé sur la base de 80% du maximum prélevé annuellement au cours des 5 dernières années. Dans le cas du présent dossier, les prélèvements ont été maximums en 2003 où ils ont atteint 336 800 m3. Le volume éligible au titre des subventions de l’agence de l’eau est donc de 80 % de ce volume, soit 269 440 m3, ce qui correspond au volume de la retenue. M. BARBIER explique que ce dossier a fait plusieurs aller-retour entre les services de l’Etat avant d’être considéré comme recevable. Une attention toute particulière a donc été apportée afin que ce point sur les volumes soit
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 11
parfaitement cadré. Il ajoute d’ailleurs que ce dossier a obtenu l’aval du préfet coordonnateur de bassin puisque, pour un dossier de réserve de substitution, il est nécessaire de le solliciter au niveau des services de l’Etat. M. MORIN demande ensuite si, dans ce dossier, on est dans le cadre d’application de la circulaire « Ollin » qui demande à ce que l’apport de fond public à la construction de réserve de substitution ne soit possible que si une réduction de 20% des volumes est appliquée. M. DALLET confirme ce propos. M. MORIN souhaite ensuite savoir s’il existe dans l’arrêté préfectoral d’exploitation des dispositions ou des règles de gestion contraignantes en fonction des niveaux piézomètriques ou des débits de cours d’eau. M. BARBIER confirme que des conditions d’exploitation ont été fixées dans l’arrêté préfectoral. Il cite notamment :
- le fait que la retenue ne puisse se remplir que du 1er novembre au 31 mars, - que ce remplissage ne peut s’effectuer que si le niveau piézométrique de la nappe à Saint Aubin est
supérieur à 2,3 m NGF, - qu’il existe aussi une clause de sauvegarde (comme cela avait été le cas sur les réserves des Autizes) qui
précise que la cote de 2,3 m pourra faire l’objet d’un réajustement par un arrêté de prescription complémentaire en fonction de l’évolution de la nappe mesurée à Saint Aubin de la Plaine.
Par conséquent, M. BARBIER confirme qu’on peut revenir sur le niveau de la cote fixée si cela se révélait nécessaire ultérieurement (mais c’est d’ailleurs le cas pour toute autorisation préfectorale). M. MORIN précise que l’arrêté préfectoral sera joint au compte-rendu (annexe n°6). M. TROUVAT souhaite enfin lever un doute sur le fait que l’on soit encore à 80% du maximum prélevé annuellement au cours des 5 dernières années dans le cadre du 9ième programme. M. DALLET confirme les propos qu’il a tenu précédemment : ce sont bien les modalités actuelles du 9ième programme. M. PICAUD fait remarqué que le dossier présenté n’évoque pas d’éventuelles alternatives au projet et souhaite savoir si des études ont été menées sur ce sujet. M. BIRET confirme que des cultures alternatives ont été tentées mais qu’elles ne se sont pas révélées concluantes. Ainsi, il précise que des cultures de protéagineux ont été testées sur l’exploitation mais que les rendements obtenus étaient, malheureusement, trop aléatoires. Ces cultures sont toutefois conservées sur l’exploitation, mais concerne des surfaces relativement restreintes. La culture du tournesol présente quant à elle deux difficultés : une exploitation avec des terres très superficielles et la présence d’oiseaux qui mangent les graines et obligent très régulièrement à effectuer deux voire trois semis. Les résultats sont donc toujours négatifs pour cette culture. La meilleure alternative culturale reste donc le maïs irrigué, car en l’absence d’irrigation les rendements sont dérisoires sur des sols aussi superficiels que ceux observés sur l’exploitation. En l’absence de nouvelle question, M. MORIN propose de passer au vote. Il demande au préalable si la CLE souhaite procéder par un vote à main levée ou à bulletin secret et invite chacun à s’exprimer s’il le souhaite pour expliquer son choix. M. MORIN prend tout d’abord la parole pour exposer le fait qu’il a toujours défendu une gestion collective des réserves de substitution par les collectivités. A titre personnel, il précise qu’il s’abstiendra sur ce dossier car il estime que ce projet n’est pas un projet collectif, même si certains peuvent considérer que c’est le cas puisque le dossier est porté par une ASLI. Il trouve d’autre part surprenant que les services de l’Etat n’en ait pas réalisés une approche globale de bassin versant car cela signifie concrètement qu’on laisse partir des dossiers au fil de l’eau, que les premiers dossiers passés seront les premiers servis et qu’il n’y aura donc pas de gestion collective ni de gestion équitable, y compris pour les prélèvements d’hiver. M. TROUVAT répond qu’il pense qu’il y a d’autres éléments à prendre en compte et il rappelle avoir déjà exprimé cette position lors de la présentation à la CLE du projet de réserve sur la commune de Pamproux. Il admet que l’on peut refuser une réserve parce qu’elle n’est pas collective, mais qu’il faut alors en accepter le surcoût (5 € du m3 pour du collectif au lieu de 3 € pour de l’individuel). Une gestion collective lui paraît intéressante mais il faudrait que la profession agricole sache si les élus veulent voir augmenter ou diminuer le coût de ces réserves. Pour sa part, il considère qu’il serait plutôt opportun pour tout le monde de retenir la seconde solution. Aujourd’hui, on partirait donc sur une réflexion collective de gestion par sous-bassin versant, mais avec ensuite construction de retenues individuelles, parce qu’elles sont moins chères. Il souhaite savoir si les élus valident ce schéma ou non. Il semble à M. TROUVAT qu’il faut quand même aller vers les solutions les moins coûteuses. M. LEROUX répond en se positionnant par rapport à l’instruction des dossiers par les services de l’Etat. Il précise que ces services instruisent les dossiers en fonction de la réglementation existante. Or, d’après les réglementations sur les autorisations « loi sur l’eau », il appartient tout d’abord au bureau d’étude de produire son document d’incidence. Ensuite les services de l’Etat sont tenus de l’analyser. Ce n’est en aucun cas à l’Etat de produire le dossier d’incidence et M. BARBIER a donc instruit le dossier comme le prévoit les textes.
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 12
Par rapport à l’impact global du projet, M. BARBIER ajoute qu’en mettant une cote minimale pour remplir la réserve l’Etat s’est doté d’un garde fou par rapport à une éventuelle surexploitation de la nappe pendant l’hiver. M. PICAUD prend ensuite la parole pour dire que le projet présenté est comparable aux documents d’incidence habituellement rencontrés pour ce type de projet dans le département de la Charente Maritime. Il n’a donc pas de raison de modifier sa position. Il votera par conséquent contre le projet. M. PELLERIN précise qu’en cohérence avec les positions énoncées précédemment il votera contre ce type d’investissement tel qu’il est présenté et conduit en ce moment. Il tient toutefois à souligner, parce que ses propos sont souvent instrumentalisés, qu’il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette position. Il ne s’agit pas d’une position contre le principe de l’irrigation : baisse des prélèvements estivaux ne veut pas dire arrêt de l’irrigation et baisse des volumes jusqu’à zéro. Avant de procéder au vote, M. PERRIN (DISE Deux-Sèvre) demande à ce que soit précisé clairement sur quelle question la CLE doit se prononcer. En effet, si la question est de savoir si l’Etat est pour ou contre la retenue, il lui semble pour sa part que les services de l’Etat n’ont pas à se prononcer. La retenue a déjà été autorisée par l’autorité préfectorale et il n’y a donc pas à revenir sur ce point. D’autre part, en ce qui concerne le financement, M. PERRIN ne voit pas bien en quoi les services de l’Etat auraient à se positionner, surtout pour un dossier qui ne concerne pas le département des Deux-Sèvres. M. MORIN rappelle que, comme tout dans tout scrutin démocratique, tout membre de la CLE peut, soit ne pas participer au vote, soit s’abstenir, soit voter pour, soit voter contre, soit voter blanc. Mais la non participation au vote peut aussi éventuellement être prise en ligne de compte en modifiant le corps électoral. Il souligne que la démarche de l’agence de l’eau est aujourd’hui de toujours demander l’avis de la CLE sur ce type de projet avant de prendre une décision dans ses propres instances (lorsqu’une CLE existe, et que le SAGE soit validé ou non). C’est la raison pour laquelle la CLE doit se positionner aujourd’hui, étant entendu que ce choix ne remet pas en cause l’arrêté préfectoral d’exploitation qui a déjà été pris. Les observations et remarques de chacun seront consignées par écrit et envoyées aux porteurs de projet et aux services de l’Etat une fois le compte-rendu validé. M. TROUVAT rappelle que, sauf erreur de sa part, les services de l’Etat avaient précisé que le Préfet coordonnateur de bassin avait validé le dossier. Par conséquent, il ne comprendrait pas comment ces mêmes services ne pourraient être pas unanimes au moment du vote. M. MORIN propose une suspension de séance de 5 minutes pour permettre au service de l’Etat de se concerter. De retour de la suspension de séance, la CLE décide de se prononcer à main levée sur le projet de réserve de substitution de Saint Etienne de Brillouet. Le collège des représentants de l’Etat participe au vote. Les résultats sont les suivants : La CLE émet donc un avis favorable sur le projet présenté. IV – DELIBERATION DE LA CLE SUR LE PROJET DE SDAGE LOIRE BRETAGNE En introduction, M. MORIN souligne que, suite à la présentation du SDAGE lors de la dernière CLE, la cellule d’animation du SAGE n’a reçu aucune remarque, question ou commentaire sur ce projet de la part des membres de la CLE ou des instances qu’ils représentent. Il annonce d’autre part qu’aucun des trois conseils généraux présents sur le territoire n’a encore pris de délibération sur ce projet. Il rappelle que le Conseil régional Poitou-Charentes a pour sa part délibéré, mais que cette délibération n’est pas encore revenue de la Préfecture et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme valide. L’animateur du SAGE a donc préparé un certain nombre de cartes (paramètres qualitatifs et quantitatifs notamment) pour décliner concrètement au niveau local les mesures générales du SDAGE présentées lors de la dernière CLE. En plus de ces éléments, il a été réalisé un dossier qui sera joint au compte-rendu de séance (cf. annexe n°7) où les orientations fondamentales du projet de SDAGE et les dispositions du projet de SAGE Sèvre niortaise- Marais poitevin sont mises en parallèle. A titre d’exemples, deux ou trois tableaux comparatifs seront ainsi présentés.
TOTAL(nbre de votants)
24 6 7 37
RESULTAT DU VOTE DE LA CLE SUR LE PROJET DE RESERVE DE L'ASLI " LA GOUTTE D'EAU"
FAVORABLE DEFAVORABLE ABSTENTION
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 13
M. MORIN précise qu’il y a toutefois deux points sur lesquels il serait souhaitable que la CLE se penche plus particulièrement : d’une part, le nombre de captages d’eau potable figurant dans la liste des captages prioritaires mise à jour pour prendre en compte le projet de loi dit du Grenelle de l’environnement et d’autre part le projet de programme de mesures de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour le secteur du Marais poitevin. L’animateur présente et commente ensuite le projet de SDAGE Loire Bretagne à partir du power-point dont une copie est jointe en annexe n°8. Derrière des orientations qui diffèrent dans leur formulation, il met en évidence la forte cohérence entre les projets de SDAGE et de SAGE Sèvre niortaise validé par la CLE en janvier 2008. M. MORIN souhaite ensuite rappeler aux nouveaux membres de la CLE qui n’auraient pas suivi les débats et les différentes phases d’élaboration du SDAGE et du SAGE :
- qu’il est clair que le projet de SDAGE n’est pas définitivement calé et ne le sera vraisemblablement pas avant l’automne 2009,
- qu’il y a un certain nombre d’éléments qui ont évolué depuis la rédaction du projet de SAGE et son vote par la CLE en janvier 2008,
- qu’un certain nombre de points évolueront encore vraisemblablement d’ici son approbation définitive par arrêté préfectoral.
Par conséquent, M. MORIN affirme qu’il y aura automatiquement une révision du SAGE une fois celui-ci approuvé, ne serait-ce que pour se mettre en conformité et intégrer le contenu de nouveaux textes réglementaires et de nouvelles études (notamment ceux liés au Grenelle de l’environnement ou les études portant sur les volumes prélevables,..) ou pour mettre le périmètre du SAGE en cohérence avec les connaissances hydrologiques sur l’amont de la Sèvre niortaise et avec le périmètre du SAGE Clain. L’animateur souligne que le listing des captages prioritaires est un point du SDAGE sur lequel il serait peut être souhaitable que la CLE émette une remarque. En effet, sur le bassin versant de la Sèvre niortaise, seuls les captages de la ville de la Rochelle et le captage de la Corbelière (SERSAEP) situé sur l’amont de la Sèvre niortaise, sont aujourd’hui retenus dans cette liste. Il semblerait opportun que l’ensemble des périmètres de captages figurant dans le cadre du programme « Re-Sources » de reconquête de la qualité des eaux intègre cette liste. Tout au moins, il paraît essentiel que le périmètre du captage du Vivier qui alimente la ville de Niort, soit plus de 70.000 habitants, y figure. M. LE ROUX abonde dans le sens de cette proposition et informe l’assemblée qu’un courrier a déjà été envoyé par la DISE du département des Deux-Sèvres pour demander que la liste soit complétée. M. DALLET rappelle que ce listing est issu de la disposition 6C-1 du projet de SDAGE. Cette disposition prévoit que, sur les aires d’alimentation d’un certain nombre de captages jugés stratégiques pour l’alimentation en eau potable et sur lesquels existe un objectif de réduction des traitements de potabilisation, soient mises en place des mesures correctrices ou préventives pour limiter les teneurs en nitrates et pesticides. M. DALLET note que la première version du SDAGE (novembre 2007) présentait une liste incomplète de captages concernés par cette mesure et que l’additif 2009 l’a complétée. M. DALLET confirme toutefois que cette liste peut encore être amendée dans le cadre de la consultation. M. MORIN se demande par ailleurs si, en ces périodes de restrictions budgétaires, il y aura encore bientôt des possibilités de financements pour des mesures de gestion sur des captages qui n’auraient pas fait l’objet d’un fléchage à travers le document du SDAGE. L’animateur reprend la parole pour relever aussi un certain nombre d’éléments du programme de mesures de l’agence de l’eau pour le secteur du Marais poitevin et de la carte qui lui est associé qu’il serait vraisemblablement judicieux de modifier pour tenir compte des données du SAGE Sèvre niortaise-Marais poitevin. En effet, le SAGE Sèvre niortaise a identifié un fort enjeu « réduction des prélèvements estivaux » sur l’amont de la Sèvre niortaise (-40 à –100% de réduction des volumes prélevables en été). Or, ce territoire n’est pas intégré au niveau cartographique dans les mesures intitulées « Réduire les prélèvements estivaux pour l’irrigation ». D’autre part, la cartographie présentée se limite aux bassins hydrographiques et ne tient pas compte du périmètre du SAGE Sèvre niortaise sur sa partie amont. Il serait donc souhaitable de modifier ce périmètre ou tout au moins, dans l’hypothèse où cette rectification ne serait pas envisageable, de bien identifier les enjeux de l’amont du bassin du SAGE Sèvre niortaise sur le périmètre hydrographique mitoyen, celui du secteur du Clain. Enfin, l’animateur note quelques fautes de frappe au niveau de la toponymie du bassin et des infrastructures (SAGE Sèvre niortaise-Marais poitevin au lieu de SAGE Sèvre niortaise-Marais Breton , ou encore retenue de la Touche Poupard au lieu de retenue de la Roche Poupard). M. TROUVAT réagit à la présentation sur deux points. Tout d’abord, il lui semble que la délimitation du bassin versant sur la cartographie du programme de mesure n’est pas forcément un problème puisque ce territoire se retrouve sur le bassin versant du Clain. Ensuite, il considère que, s'il y a bien cohérence aujourd’hui entre les documents du SDAGE et du SAGE, il n’en est pas de même pour ce qui est de leurs objectifs. En effet, il lui semble que les objectifs du SAGE
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 14
sont beaucoup plus ambitieux que ceux du SDAGE. D’autre part, s’il y a effectivement cohérence entre ces deux documents aujourd’hui, cela ne sera plus forcément le cas avec la future version définitive du SDAGE. M. PRIOUZEAU fait ensuite part du courrier adressé au Préfet de Région au sujet du projet de SDAGE par un collectif de partenaires institutionnels vendéens (Conseil général, Association des maires, Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie). Il souhaite qu’une copie de ce courrier soit jointe au compte-rendu de cette réunion (cf. annexe n°9). M. TROUVAT reprend enfin la parole au sujet du projet de programme de mesures de l’agence de l’eau en s’interrogeant sur la pertinence des montants alloués dans le cadre des mesures visant à réduire les prélèvements estivaux pour l’irrigation. Il considère en effet que les montants indiqués( 50 M€) sont insuffisants, et que ce chiffre trop faible ne permettra pas le maintien de l’irrigation sur le bassin versant. En l’absence d’autres remarques, le Président confirme d’une part qu’une copie de la délibération de la CLE sur le projet de réserve de substitution de l’ASLI « la goutte d’eau » sera envoyé à l’agence de l’eau avant la fin du mois de mars, et d’autre part qu’il est nécessaire de prévoir une nouvelle réunion de la CLE pour présenter le projet de programme « Re-Sources » des captages de la ville de la Rochelle afin que ce dossier puisse s’intégrer rapidement dans les programmes financiers des différentes partenaires. La date du 15 avril 2009, à confirmer, est ainsi proposée et retenue par l’assemblée. Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le Président lève la séance à 17 h 30.
le Président de la CLE,
Serge MORIN
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 15
ANNEXE 1
Copie du procès-verbal définitif de la CLE du 11 février 2009
REUNION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS POITEVIN
11 FEVRIER 2009
Procès-verbal
_______
11 février 2009 - 14 H 00 Ancienne salle des délibérations du Conseil général 79 – Niort
CONTACT : Cellule animation SAGE – M. François JOSS E Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
Hôtel du département – rue de l’Abreuvoir – 79021 NIORT Cedex Tel : 05 49 06 79 79 Fax : 05 49 06 77 71
Email : [email protected]
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 2
REUNION DE LA CLE DU SAGE SEVRE NIORTAISE MARAIS PO ITEVIN DU 11 février 2009
____
Etaient présents, avec voix délibérative, les membres de la CLE suivants :
Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
- M. Serge AUDEBRAND, adjoint au Maire du Vanneau
- M. Jacques BOURON, conseiller municipal à Arçais,
- M. Marie-Josèphe CHATEVAIRE, Conseil général de la Vendée (mandat de M. SOUCHET)
- M. Daniel DAVID, maire de Benet
- M. Sébastien DUGLEUX, conseil général des Deux-Sèvres (mandat de M. MISBERT)
- M. Claude GARAULT, SMC du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine
- Mme Nicole GRAVAT, Ville de Niort
- M. Christian GRIMPRET, Maire de Sainte-Soulle
- M. Christian GUERINET, Syndicat d’adduction, de distribution d’eau potable et d’assainissement de la Charente-Maritime
- M. Jean-Jacques GUILLET, Maire d’Amuré
- M. Jean-Pierre JOLY, S.I.A.E.P de la Plaine de Luçon
- M. Joël MISBERT, Conseil général des Deux-Sèvres
- M. Serge MORIN, Conseiller Régional de Poitou-Charentes, Président de la CLE (mandat de M. FOURRAGE)
Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées
- M. jean BOUCARD, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. François DURAND, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. Jean GUILLOUX, Union des Marais Mouillés de la Venise Verte,
- M. Yves MIGNONNEAU, Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime,
- M. Philippe MOUNIER, syndicat des Marais mouillés de Vendée,
- M. François-Marie PELLERIN, Association de Protection, d’Information, d’Etude de l’Eau et de son Environnement
- M. Antoine PRIOUZEAU, Chambre d’Agriculture de Vendée,
- M. Pierre TROUVAT, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres,
Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
- M. RAYNARD, Agence de l’eau Loire-Bretagne,
- M. Pierre BARBIER, DDAF de Vendée
- M. Eric BACHELIER, ONEMA
- M. Alain DUCLOUX, DDE Deux-Sèvres
- M. ALLIMANT, DISE Charente-Maritime,
- M. D. PERRIN, DISE des Deux-Sèvres
- Mme Bénédicte GENIN, DIREN Poitou-Charente,
- M. PAILLHAS, DISE des Deux-Sèvres,
- M. Bruno LE ROUX, DISE des Deux-Sèvres,
- M. Michel GUILLOU, Préfecture de la Région Poitou-Charentes.
Assistaient en outre les personnes suivantes :
- M. Claude DALLET, Agence de l’Eau Loire Bretagne,
- M. Stephan COUROUX, Conseil général Charente-maritime,
- M. Cédric BELLUC, syndicat hydraulique du Nord Aunis et SIEAGH du Curé
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 3
- M. Nicolas MOREAU, syndicat des eaux du Centre-Ouest,
- M. Patrick SOL, CCI des Deux-Sèvres,
- M. Fabrice ENON, Syndicat mixte Vendée, Sèvre, Autises,
- Mme Maggy GRILA, Conseil Général de Vendée,
- M. Claude ROY, Conseil Général de Vendée,
- M. François JOSSE, IIBSN, animateur du SAGE
- Mme Marion PASQUIER et Mme Marie PERRIN, Parc Interrégional du Marais Poitevin
- Melle Laure THEUNISSEN, IIBSN
- M. BARBARIN, ONEMA
- Mme PERTHUISOT, DISE Charente-Maritime,
- M. Pierre POUGET, DIREN Poitou-Charente,
- Mme Florence GABORIAU, Coneil général des Deux-Sèvres,
- M. Marc LAMBERT, directeur du Syndicat des Eaux du Vivier.
Etaient excusés :
- M. Patrick BLANCHARD, vice-président de la CLE, président du SYNHA
- M. Michel BOSSARD, mairie de Nieul sur l’Aitise,
- Mme Claudette BOUTET, Conseil régional des Pays de la Loire
- M. Joseph MARQUIS, Union amicale des maires de Vendée
- M. Claude ROULLEAU, Syndicat intercommunal des eaux de la vallée du Lambon
- Jean-Marie ROUSTIT, Conseil général de Charente-Maritime
- M. Daniel SACRE, mairie de Nalliers,
- M. Dominique SOUCHET, Député, Président de l’IIBSN
- Mme Jacqueline LAMONGIE, UFC Que Choisir
- M. Jacques SALARDAINE, section régionale de la Conchyliculture RE Centre-Ouest
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 4
Le Président ouvre la séance en priant de bien vouloir excuser M. Blanchard, M. le Député Souchet, M. Roustit, M. Bossard, M. Roulleau, M. Marquis, M. Sacre, M. Salardaine, Mme Lamongie, Mme Boutet et Mme Coirier, retenus par d’autres obligations. Il fait ensuite part de l’information communiquée par M. Salardaine concernant l’interdiction temporaire de ramassage, de transport, de distribution, de commercialisation et de mise à la consommation humaine des huîtres et moules en provenance des Filières du Pertuis breton et de la Cote de la Tranche – la Faute sur Mer (parution de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2009) en raison d’une contamination bactérienne des eaux par Escherichia Coli. M. Morin rappelle que la CLE a adopté un certain nombre de dispositions allant dans le sens d’une réduction de ces risques de contamination et souligne les efforts qui restent à fournir pour y répondre. M. MORIN poursuit en évoquant le fait que, suite à l’envoi des courriers d’invitation, deux nouvelles copies de délibérations de communes sur le projet de SAGE sont parvenues à la cellule d’animation du SAGE (Longèves et Saint Ouen d’Aunis – Charente Maritime). Il demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir informer l’animateur si d’autres communes se révélaient être dans le même cas de figure et précise que le prochain compte-rendu de réunion de CLE comprendra une nouvelle carte intégrant ces communes. M. Morin fait ensuite part de trois dossiers qui ont été portés à la connaisance de la CLE :
- un projet de réserve de substitution sur la commune de Saint Etienne de Brillouet (85),
- plusieurs projets de drainage agricoles (85),
- les récentes difficultés rencontrées par le Syndicat mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre pour poursuivre ses missions en tant que structure porteuse du CRE Sèvre amont (désengagement d’une des communautés de communes adhérent au projet).
Concernant le premier point, le projet de réserve de substitution porte sur un volume de 270.000 m3 pour une superficie irriguée prévisionnelle de 160 hectares. Une copie du dossier d’incidences au titre des articles L214.1 et suivants du Code de l’environnement a été communiquée pour avis technique à l’animateur du SAGE par la DDEA 85. Un courrier réponse au nom du Président du SAGE a alors été transmis à l’attention de cette administration. Une copie de ce courrier ainsi que de la réponse apportée par le pétitionnaire sont jointes au présent compte-rendu (annexe n°1). D’ores et déjà, ce projet a été validé par le CODERST de Vendée le 22 janvier et le pétitionnaire a pris contact avec la cellule d’animation pour le présenter devant la CLE lors de sa prochaine séance à la demande de l’Agence de l’eau.
Concernant le second point, M. MORIN précise qu’il a été questionné par des élus et des associations sur de l’existence et la consistance de plusieurs projets de drainage de parcelles agricoles dans le Marais poitevin. Ces projets font actuellement (ou ont récemment fait) l’objet d’une enquête publique :
o 32,5 ha sur la commune de Chaillé les Marais (enquête publique du 6/01 au 21/01), o 60,1 ha sur la commune de Vix (enquête publique du 20/02 au 9/03), o plusieurs hectares dans le cadre d’un autre projet situé sur la commune de Vix (enquête publique du
17/02 au 5/03).
En ce qui concerne le dernier point (CRE Sèvre amont), M. MORIN rappelle le fort intérêt porté par le SAGE aux démarches de Contrat Restauration Entretien de cours d’eau ou de zones humides. Il fait part de sa préoccupation pour ce projet et demande à ce qu’un point soit fait sur l’évolution et les difficultés rencontrées dans le portage du dossier CRE Sèvre amont lors d’une prochaine CLE.
I – VALIDATION DU RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA REUNION DE CLE DU 10 DECEMBRE 2008 Concernant le projet de compte-rendu envoyé aux membres de la CLE parmi les documents joints à l’invitation , M. MORIN précise qu’aucune remarque n’a été adressée à la cellule d’animation du SAGE. Il demande toutefois si un membre de l’assemblée à des questions sur ce document ou souhaite y voir apporter d’ultimes modifications. M. TROUVAT souhaite savoir s’il est possible d’expliciter le terme d’« objectivité / neutralité de l’information délivrée » employé en page 7 du compte-rendu. M. PELLERIN reprend alors les termes des propos qu’il a tenus lors de cette réunion en précisant qu’il s’agissait pour lui d’éviter la confusion entre les documents et les éléments contenus respectivement dans le SDAGE et dans le SAGE et que par « information objective » il entendait la nécessité de bien séparer les deux démarches et les deux documents. En l’absence d’autre remarque, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 5
II – DEFINITION DES VOLUMES PRELEVABLES PAR UNITE HYDROGRAPHIQUE ET REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIE D’USAGERS M. MORIN rappelle tout d’abord qu’il s’agit de réfléchir à la réponse que souhaite apporter la CLE à la question posée par le préfet coordonnateur de bassin dans son courrier en date du 5 décembre 2008 (courrier joint dans le rapport n°2 du dossier de séance). Un SAGE a en effet la possibilité de définir dans son règlement les priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usages. Elle peut donc désigner les membres d’un comité de pilotage qui sera chargé de la détermination de ce volume disponible par masse d’eau et répartir ensuite entre les usages ce volume déterminé comme prélevable. Si la CLE ne souhaite pas réaliser cette étude des volumes prélevables, les agences de l’eau et les DIREN la réaliseront avec l’aide d’un Comité de pilotage qui associera les différentes catégories du bassin. M. MORIN expose les principaux motifs qui le conduisent à penser que la CLE du SAGE SNMP n’est pas la meilleure structure pour porter cette étude :
- des délais très courts (les volumes doivent être déterminés pour la fin du premier semestre 2009), - une priorité du SAGE donnée à l’achèvement de sa procédure d’approbation (passage en comité de bassin ,
préparation et passage de l’enquête publique,..), - le besoin d’une forte cohérence méthodologique et temporelle dans l’évaluation des volumes prélevables pour
les différents bassins du Marais poitevin (Sèvre niortaise, Vendée et Lay), - l’existence de plusieurs dossiers d’études communs à ces différents bassins actuellement en cours sur le
territoire (notamment le modèle maillé du BRGM, l’expertise du conseil général de Vendée, la modélisation hydraulique de la nappe du Nord Aunis).
Il poursuit en disant qu’il a en effet connaissance de SAGE qui se sont saisis de cette étude, mais précise que ces SAGE étaient approuvés et que leur positionnement pouvait donc s’envisager différemment. M. MORIN propose donc que cela soit plutôt la CC3S qui porte cette étude mais interroge les membres de la CLE pour connaître leur position sur ce sujet. Mme GENIN intervient pour apporter des précisions sur deux points. Tout d’abord, étant donné le contexte rencontré sur le Marais poitevin, on peut considérer qu’il n’y aura pas nécessairement un strict respect des délais impartis pour déterminer les volumes prélevables sur ce secteur . D’autre part, étant donné la somme de connaissances apportées par les nombreuses études déjà effectuées sur le territoire, la question de l’utilité d’une nouvelle étude pour déterminer des volumes prélevables peut se poser. M. TROUVAT prend alors la parole pour dire qu’un report de délai pour déterminer ces volumes prélevables lui paraissait impératif et que son interrogation portait plutôt sur l’approche choisit pour cette démarche : démarche scientifique ou démarche politique ? Il conclue en précisant qu’il lui semble pour sa part que cette étude devrait être portée par les services de l’Etat. M. JOLY propose que l’ordre de passage des différents rapports placés à l’ordre du jour soit modifié pour présenter en premier lieu les exposés sur le projet de SDAGE et l’expertise du Conseil Général de Vendée. Il lui semble que les éléments apportés par ces présentations contribueront de manière constructive à la discussion. Il lui paraît en effet comme une nécessité impérieuse de tout entendre avant de débattre de la détermination des volumes prélevables. M. le Sous-Préfet de Fontenay le Comte intervient pour mettre en avant le fait que, très clairement, les volumes prélevables sont directement à mettre en relation avec les cotes (débitmétrique, piézométrique et de niveau) qui seront retenues dans le SDAGE Loire Bretagne. Ces volumes seront donc notamment dépendants des options retenues pour ces indicateurs : option du type « Conseil général de Vendée » ou option du type « SDAGE Loire Bretagne ». Il poursuit en annonçant que la réunion de la commission Inter-Sage, initialement prévue au mois de mars, a été reportée en avril pour permettre, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin Loire Bretagne, d’engager le dialogue et de développer des discussions entre les membres du groupe de travail sur les SAGE du Marais poitevin et l’équipe ayant porté l’expertise du Conseil général de Vendée. L’objectif de ce délai est de mettre à plat les points d’accord et de désaccord entre ces deux options, de progresser dans la compréhension mutuelle, et d’envisager la possibilité d’une synthèse commune. Dans le cas où aucun compromis ne pouvait être trouvé, il faudrait attendre le positionnement et la rédaction définitive du SDAGE pour pouvoir se lancer dans la détermination des volumes prélevables. M. le Sous-Préfet reconnaît que si c’est le SAGE qui porte l’étude dans l’urgence, on risque de se retrouver confronté à une situation de blocage. Il soutient donc une position qui laisse toute sa chance à la négociation et souhaite donc éviter toute polémique inutile.
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 6
M. PELLERIN demande à ce que, à défaut de pouvoir tenir la date butoir de la fin du premier semestre 2009, un délai soit fixé pour la définition de ces volumes. Il ne serait pas souhaitable que le calendrier « glisse » de manière incontrôlée. Il exprime ensuite son désaccord par rapport aux propos tenus par M. le Sous-Préfet de Fontenay le Comte qui semble mettre sur un pied d’égalité les propositions du conseil général de Vendée et l’expertise issue du groupe de travail sur les SAGE. Devant une telle prise de position, il regrette de n’avoir pas engagé sa propre expertise et fait remonter ses propres propositions de gestion. Mme PERTHUISOT fait ensuite remarquer que la date du 30 juin 2009 comme date butoir pour déterminer les volumes prélevables n’a rien de réglementaire (elle a pour origine une circulaire). En effet, seule l’échéance du 31 décembre 2014 (échéance de la DCE pour établir une adéquation entre autorisations et prélèvements) est réglementaire. Il faut se laisser le temps de réaliser ces évaluations, même si le compte à rebours a commencé. M. NADAL tempère toutefois ces marges de manœuvre en indiquant que le 31 décembre 2014 n’est pas la seule date réglementaire. En effet, le recours à des autorisations temporaires de prélèvement pour les irrigants ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2011. C’est d’ailleurs en effectuant un rétro-planning à partir de cette dernière échéance que la date du 30 janvier 2009 a été retenue. M. MORIN demande alors :
- que, lors d’une prochaine CLE, les services de l’Etat présente un calendrier de ces différentes échéances réglementaires ainsi qu’un rétro-planning des différentes étapes permettant de tenir ces délais ;
- que les animateurs des SAGE du Marais Poitevin soient conviés aux réunions portant sur la définition des volumes prélevables.
M. le Sous-Préfet conclue en précisant que l’année 2009 sera le théâtre de choix déterminants puisque en tout état de cause le SDAGE Loire Bretagne devra avoir été validé d’ici la fin de l’année. Pour cette même raison, la base de détermination des volumes prélevables (cotes et niveaux) aura donc été retenue à cette date. Il rappelle aussi que l’intérêt même d’une CLE est d’être le siège de discussions et d’une concertation qui permettent de dégager des positions communes conciliant à la fois les intérêts économiques et la préservation des milieux. Pour synthétiser ce débat, M. MORIN souhaite retenir de ces discussions que la commission de coordination des trois SAGE du Marais poitevin établira un calendrier et un cahier des charges pour déterminer les volumes prélevables. M. TROUVAT prend ensuite la parole pour affirmer qu’il considère que trouver un accord sur les volumes prélevables est un préalable obligatoire et l’étape n°1 en vue de créer un organisme unique (O.U.). Mme PERTHUISOT conclue en précisant, qu’en tout état de cause, et même si la CLE ne se saisit pas du dossier des volumes prélevables, l’Etat et l’Agence de l’eau créeront un comité de pilotage auquel seront associés tous les usagers. III – PRESENTATION DU PROJET DE SDAGE LOIRE-BRETAGNE M. Eric MULLER (Agence de l’eau Loire Bretagne, siège d’Orléans) présente le projet de SDAGE Loire Bretagne(cf. copie du power-point joint en annexe n°2). Il rappelle notamment que le SDAGE constitue en France l’outil principal de la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et que ce document doit être approuvé impérativement avant la fin de l’année 2009. Ce document est structuré autour de 15 questions importantes (diapositive n°4) qui se traduisent ensuite par la rédaction d’orientations fondamentales, puis de dispositions dont l’application doit permettre de répondre aux objectifs d’atteinte du bon état écologique en 2015, à la non détérioration des milieux et à la suppression ou la réduction de la présence d’un certain nombre de substances prioritaires. Sur le bassin Loire-Bretagne, les deux freins principaux à l’atteinte du bon état écologique qui ont été mis en évidence restent :
- la morphologie des cours d’eau, - les pollutions diffuses.
Le projet de SDAGE Loire Bretagne est un projet ambitieux qui garde une certaine souplesse (possibilité de dérogations), mais cette souplesse reste très encadrée. En effet, toute dérogation ou report de délai doivent être argumentés et ne peuvent se justifier que sur la base de trois critères précis :
- la non faisabilité technique dans les délais impartis (calendrier de travaux), - les coûts disproportionnés par rapport aux gains attendus,
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 7
- les caractéristiques physiques des milieux (réponse avec retard des milieux étant donné les temps de transfert de substances par exemple).
Les documents soumis à la consultation comprennent d’une part le projet de SDAGE qui a une portée juridique et des dossiers complémentaires sans portée juridique (programme de mesures 2010-215 de l’agence de l’eau, évaluation environnementale, document d’accompagnement). Il note ainsi que les PLU, les POS et les documents d’urbanisme doivent notamment être compatibles avec ce document. Le Grenelle de l’environnement , dont la tenue a été postérieure à « l’adoption » du projet de SDAGE en 2007, a abordé de nouvelles thématiques et apporté des exigences supplémentaires par rapport aux objectifs que s’étaient initialement fixés le SDAGE. Ces thématiques sont : les captages prioritaires, les réservoirs biologiques, la trame bleue ou encore l’évolution à la hausse des objectifs en terme du nombre de bassins devant atteindre le bon état écologique en 2015. Pour y répondre, il a donc été adjoint un additif au projet de SDAGE 2007 lors du dernier comité de bassin du 04/12/2008. Aux éléments apportés par le Grenelle de l’environnement ont été joints quelques points supplémentaires dont le plan anguille et la révision des bassins situés en zones de répartition des eaux. M. MULLER poursuit ensuite en présentant la fiche du programme de mesures de l’agence de l’eau prévue pour les bassins versants du secteur du Marais poitevin (Sèvre niortaise, Vendée et Lay). Les montants alloués à ce territoire pour la durée de ce programme 2010-2015 se montent à 175 millions d’euros, sachant que l’ensemble des montants prévus sur le territoire du bassin se chiffre à 3,3 milliards d’euros sur la même période. Logiquement, les montants alloués aux deux principaux freins à l’atteinte du bon état écologique (pollutions diffuses et morphologie des cours d’eau) sont aussi les plus importants (respectivement 44 % et 27 % des montants). M. MULLER présente enfin 8 orientations fondamentales du projet de SDAGE ayant un impact particulier sur le territoire du SAGE (cf. diapositives 19 à 26). M. MORIN remercie M. MULLER pour son intervention et ouvre le débat. M. PELLERIN demande des précisions concernant le calendrier de rédaction du SDAGE pour les mois à venir. Un premier additif a déjà été joint au projet initial du SDAGE et vient de nous être présenté. Un second additif est semble t-il prévu pour juin. Les conclusions des discussions en cours portant sur les dispositions concernant le Marais poitevin figureront-elles dans l’additif n°2 ? Que se passera t-il si ces discussions débordent sur le mois de juillet ? M. MULLER répond qu’il est prévu de faire figurer dans l’additif n°2 les éléments suivants :
- la synthèse des avis des assemblées (consultation en cours), - les données sur les réservoirs biologiques, - les points de discussions et de débats.
Dans ce cadre, si un accord est trouvé d’ici juin, il figurera dans l’additif n°2 au SDAGE. M. PELLERIN demande si un additif n°3 est envisagé avant le comité de bassin prévu à l’automne. M. MULLER répond qu’aucun additif n°3 n’est prévu mais qu’il y aura bien une réécriture totale du document pour le passage et la validation devant le comité de bassin de l’automne. M. PELLERIN pose alors la question de savoir si on risque de se diriger vers un vote bloqué avec une disposition concernant le Marais poitevin arrivant lors de la dernière session. M. MULLER répond que le calendrier actuel n’est pas définitif et qu’une réflexion sur le phasage est en cours. Mme GENIN conclue en affirmant qu’il est aujourd’hui trop tôt pour dire si un consensus sur la mesure 7C-4 pourra être trouver d’ici le mois de juin. M. MORIN prévient qu’il ne souhaite vraiment pas que la dernière version du SDAGE soit apportée en séance lors de la session du Comité de Bassin au cours de laquelle est prévu le vote de ce projet. Il demande à ce que le projet puisse être communiqué auparavant. M. TROUVAT demande une confirmation par rapport à l’existence de nouveaux additifs prévus, car ce n’est pas ce qui avait été convenu en comité de bassin. M. MULLER répond qu’il n’y aura pas d’additif n°3. M. LAMBERT rappelle en préalable le contentieux européen portant sur les teneurs en nitrate dans les eaux distribuées destinées à l’alimentation en eau potable qui est actuellement en cours sur la tête de bassin versant de la Sèvre. Il se demande ensuite s’il n’y a pas un risque de basculement de ce contentieux vers un nouveau contentieux, portant cette fois-ci sur les teneurs en nitrates observées dans les eaux « brutes » (comme cela a été le cas en Bretagne). Il s’interroge enfin pour savoir si la formulation actuelle du SDAGE a bien pris la mesure de ce risque et l’a bien anticipé en prenant les dispositions suffisantes pour résoudre le problème posé. M. MULLER n’écarte pas cette hypothèse de basculement du contentieux mais précise que ce risque a déjà été pris en compte dans la rédaction actuelle du SDAGE, notamment avec l’introduction de zonage de captages prioritaires.
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 8
M. MORIN pose enfin une question sur la cohérence entre les démarches de SDAGE et les projets de création d’aires marines protégées, en particulier lorsque ces projets sont concernés par la rédaction de deux SDAGE (Loire Bretagne et Adour Garonne). M. MULLER précise que cette cohérence existe, notamment puisque :
- d’ores et déjà les eaux côtières sont identifiées et des objectifs fixés pour celles-ci, - des dispositions portant sur l’activité conchylicole figurent dans le chapitre Santé-Environnement du projet de
SDAGE, - l’aspect NATURA 2000 est amplement abordé dans ce même document.
En l’absence d’autres questions, M. MORIN cède la parole à M. ROY (responsable du Service « eau » au Conseil général de Vendée) pour la présentation du rapport d’expertise portant sur l’exploitation des eaux souterraines de la plaine de bordure nord du Marais poitevin. IV – PRESENTATION DE l’EXPERTISE DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE M. ROY introduit tout d’abord son propos en précisant :
- que la présente présentation constitue bien un simple porté à connaissance : - puisque le projet de SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin a d’ores et déjà été approuvé ; - que ce document constitue une réponse pragmatique permettant d’intégrer dans le SDAGE des éléments qui ne
soient pas susceptibles de recours contentieux. En effet, le Conseil général de Vendée estime que le projet actuel est trop ambitieux et les objectifs inatteignables ;
- que l’objectif est de trouver une position qui ne compromette pas d’un revers de main une activité économique importante pour le sud Vendée.
M. ROY présente alors le power-point dont une copie a été jointe en annexe n°2. En conclusion, M. ROY souligne que les modalités de gestion proposées en conclusion de cette étude apparaissent, pour le Conseil général de Vendée, comme un compromis équilibré . En effet, ces modalités de gestion :
- demandent une poursuite des efforts de la part des irrigants (alors même que ceux-ci ont déjà réalisés des efforts importants),
- restent cependant réalistes et soutenables du point de vue économique. M. MORIN remercie M. ROY pour son intervention et ouvre le débat. M. DAVID prend alors la parole pour se demander si l’on souhaite réellement un marais vivant. En effet, à ces yeux, la gestion envisagée par le bureau d’étude pour la gestion du Marais revient à proposer une amputation à un malade. Il rappelle qu’en 1995 les usagers en sont venus à se disputer, victimes contre victimes. Les bateliers avaient posés des batardeaux sans autorisation au port de Saint Sigismond pour sauvegarder leur activité car les eaux du Marais remontaient vers l’amont ! Les éleveurs situés en amont de ces ouvrages n’avaient alors plus d’eau ! Il rappelle qu’en tant que maire, il a fait casser ces ouvrages et s’interroge sur la pertinence de continuer à investir dans les ports, dans l’image du Marais, si c’est pour avoir deux mois d’assecs et de sécheresse. Une telle situation est insupportable. M. PRIOUZEAU se montre surpris que M. DAVID ne connaisse pas mieux le marais et met en avant le fait que les batardeaux ont toujours existé. Il fait remarquer que sur un même casier hydraulique il y a de telles différences de niveaux (parfois plus de 50 cm) qu’elles ne peuvent de toute façon se gérer sans avoir recours au système des batardeaux. En ce qui concerne la responsabilité de l’irrigation, il poursuit en précisant que les volumes attribués dans les années 1990 étaient bien plus importants qu’aujourd’hui. Il faut donc reconnaître les efforts qui ont déjà été réalisés par les agriculteurs (gestion volumétrique, diminution des doses à l’hectare,…). Les propositions actuelles se basent sur une diminution des volumes de –50% par rapport à la situation initiale (-30 % déjà acté auquel s’ajoute le –20% annoncé). Pour lui, si des marges de progrès restent possibles dans le domaine technique, notamment en matière d’économie d’eau ou de gestion des volumes, cette proposition de réduction des volumes n’est pas constructive car elle remet en cause la survie économique des exploitations et toute une dynamique économique de territoire. Enfin, il termine en rappelant le contexte de pénurie alimentaire observé actuellement au niveau mondial auquel il faudra pouvoir répondre. M. DUGLEUX demande si les chroniques piézométriques ont été communiquées au groupe d’expert. M. ROY répond par l’affirmative en précisant que ces chroniques sont à la disposition de tous. M. DUGLEUX remarque que ce qui différencie l’expertise du groupe d’expert de l’étude du Conseil général, c’est l’approche qui a été utilisée. Ce choix conduit à des conclusions profondément divergentes.
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 9
M. MOUNIER revient sur les questions de niveaux d’eau en rappelant qu’en 2007 et 2008, les difficultés des éleveurs ne sont pas venus d’un manque d’eau mais plutôt d’un excès avec des niveaux particulièrement hauts ! Pour sa part, Mme CHATEVAIRE tient à prendre la parole pour :
- dire aussi que les batardeaux ont toujours existé, - affirmer qu’on ne peut pas passer sous silence les efforts déjà réalisés par les agriculteurs, - préciser qu’il faut faire attention au paramètre économique.
La proposition du Conseil général de Vendée de se baser sur une réduction des volumes de 20 % est une mesure viable et il vaut mieux partir sur un bon accord que sur des propositions qui seront ensuite fortement contestées. M. DAVID reconnaît l’existence de ces batardeaux mais considère qu’ils étaient à l’origine utilisés dans la gestion des inondations alors qu’aujourd’hui ils servent à la gestion de la pénurie d’eau. Le phénomène de tassement des sols du marais fait qu’aujourd’hui il y a effectivement des niveaux trop hauts, mais seulement dans des baisses localisées. Il acquiesce sur le fait que des éleveurs ont effectivement eu des problèmes qu’il faut étudier, mais que ces problèmes sont très locaux et qu’il ne faut en aucun cas généralisé. Il rappelle qu’il a soutenu en son temps la création des réserves de substitution mais que c’était dans l’esprit d’éviter qu’on aille au delà du raisonnable en matière de prélèvements d’eau. M. MORIN demande si les nivellements du marais qui ont été demandés dans le projet de SAGE ont été effectués et espère que ces travaux ont d’ores et déjà été réalisés. Il poursuit en rappelant qu’en ce qui concerne les réserves de substitution du bassin des Autizes, la CLE avait fait deux demandes lors de leurs créations : la communication des chiffres et volumes servant de point 0 pour ce projet et la participation de la CLE au comité de suivi. A ce jour, il fait remarquer qu’aucune de ces deux demandes n’a été prise en compte. M. JOLY remarque que la passion l’emporte dès que l’on parle d’eau mais il considère pour sa part qu’elle est trop précieuse pour se cantonner à des positions partisanes et des considérations politiques extrêmes. Il rappelle que, sur le territoire où il vit, 300 mm de pluies post-estivales suffisent à faire déborder la nappe. Il faut donc trouver un compromis et l’expertise apportée par le Conseil général est, dans ce domaine, parfaitement plausible. Il fait d’ailleurs remarquer que le bureau d’étude Calligée réalise de nombreuses expertises pour le compte de Vendée Eau, ce qui ne serait pas le cas s’il n’avait pas fait la preuve de ses compétences. En conclusion, il invite la CLE à venir sur son territoire pour partager sa connaissance du terrain. M. PELLERIN prend ensuite la parole pour constater que, dans l’expertise du Conseil général, il y a des points intéressants et positifs et que ce dossier présente des qualités certaines. Mais il se refuse à mettre en parallèle les deux démarches (groupe expert/ Calligée-Conseil général Vendée). En effet, d’un côté on a affaire à un travail collectif ; de l’autre au travail d’un seul bureau d’étude. En conséquence, les résultats du groupe Inter-SAGE sont déjà le fruit d’un compromis ! Il se dit ouvert à la discussion, mais à condition que le compromis ne soit pas toujours dans le même sens. M. PELLERIN reconnaît la transparence du Conseil général de Vendée pour tout ce qui concerne les données piézométriques mais affirme que ce n’est pas (et n’a pas été) toujours le cas pour les données de niveaux. La divergence entre les deux expertises tient au postulat de base : d’un côté on affirme que les assecs du marais sont une chose normale, de l’autre non. A ce sujet, il poursuit en affirmant qu’il peut fournir autant de témoignages allant dans le sens de l’absence d’assecs avant l’irrigation qu’on lui communiquera de témoignages contradictoires… Pour sa part, il pense que la difficulté de compréhension réside aussi du niveau de raisonnement. Tout le monde est d’accord pour constater qu’il y a le feu, mais les scientifiques proposent d’attendre qu’on soit absolument sûr pour établir une stratégie alors que les associations souhaitent anticiper et prévenir sans attendre qu’il soit trop tard. Enfin, il conclue en demandant une nouvelle fois que l’on arrête d’assimiler les notions de volumes attribués et de volumes consommés. M. le Sous-Préfet reconnait qu’il est bien nécessaire de distinguer la réalité avérée et chiffrée de ce qui tient au simple effet d’annonce. M. GUILLET souhaite réaffirmer que l’eau est un bien publique et qu’il ne faut pas oublier les priorités : le milieu, l’eau potable, l’économique. Il attend pour sa part toujours qu’on lui démontre l’intérêt de cultiver du maïs sur le coteaux calcaires. M. TROUVAT revient sur les interactions SDAGE – SAGE Sèvre niortaise. Il souhaite savoir à quel point d’avancement est rendu l’étude menée par la DRAF Poitou Charente sur l’impact économique du projet de SDAGE. Il demande d’autre part s’il est prévu que les conclusions de cette étude soient présentées à la CLE. Il note que si les bateliers luttent pour leur survie, alors oui, les agriculteurs luttent aussi pour leur survie et que c’est la raison de leur présence aujourd’hui. Il conclue en précisant que prôner la décroissance est une possibilité mais qu’il faut bien prendre conscience que cela se traduira par 1000 emplois en moins.
Relevé de conclusions de la réunion de la CLE du 11 février 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 10
M. GUILLOU répond que l’étude précitée n’est pas totalement terminée. Très récemment, il y a encore eu des rencontres avec les bateliers, les éleveurs, les acteurs du tourisme… mais que dès que cette étude sera terminée, elle pourra faire l’objet d’une présentation devant la CLE. M. DAVID répond pour sa part qu’il n’est pas pour une croissance 0, même s’il faut voir la qualité. De plus, les agriculteurs ne sont pas tous irrigants. Il ne faudrait pas trop jouer sur ce paramètre, car si les agriculteurs irrigants jouent leur survie comment doivent réagir les non-irrigants ? M. ROY confirme que si des remarques précises sont formulées sur l’expertise, il est prêt à les recevoir et à essayer d’y répondre. Il poursuit en précisant que la CLE a été destinataire de tous les éléments du dossier. Il conclue sur le caractère artificiel du Marais, caractère avec lequel on est condamné à vivre. Il considère enfin que les avantages attendus des ouvrages (batardeaux) sont supérieurs aux effets négatifs. M. JOLY demande à ce qu’on oublie pas l’action bénéfique pour les milieux du contrat restauration zones humides porté par le Syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin de la Vendée, de la Sèvre et des Autises. L’entretien des canaux fait notamment qu’il y en aura aussi moins à sec en été. M. GRIMPRET précise enfin que ce qui le choque dans les discussions, c’est le nombre de fois où le mot « scientifique » a été utilisé (plus de 25 fois avant qu’il ne s’arrête de les compter). Il rappelle que pour lui le terme « scientifique » est indissociable de deux autres qui sont ceux de « doute » et de « modestie ». Par conséquent, il estime que certaines certitudes devraient être revues. Il poursuit en disant qu’il considère qu’à partir de mêmes données de base, il est possible de faire dire n’importe quoi à des statistiques : c’est ce qu’on appelle de la manipulation. Il tient à en avertir les nouveaux membres de la CLE. Le débat actuel est très politique avec d’un côté des gens « très environnementalistes » et de l’autre des irrigants « qui défendent leur bout de gras ». C’est normal, mais il faut savoir partager les intérêts de chacun. Mme GENIN confirme que l’idée générale est de proposer une nouvelle rédaction de la disposition 7-C4 du SDAGE et de la proposer à la commission de coordination des 3 SAGE prévue au mois d’avril. M. PELLERIN soulève la question de l’état d’avancement du projet de site internet de l’IIBSN, site qui permettrait aux membres de la CLE de communiquer plus aisément. M. DUGLEUX répond que cet outil est toujours d’actualité mais que son achèvement est plutôt attendu sur le moyen terme. M. MORIN rappelle que les remarques éventuelles des membres de la CLE sur le projet de SDAGE sont attendues rapidement (sous quinze jours) pour qu’elles puissent être traitées par la cellule d’animation du SAGE et présentées lors de la prochaine CLE. Il propose enfin de fixer au 11 mars (même heure, même salle) la date de la prochaine réunion de CLE. Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, le Président lève la séance à 17 h 30.
le Président de la CLE,
Serge MORIN
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 16
ANNEXE 2
Power-point de présentation de l’étude portant sur l’évaluation économique du projet de SDAGE sur le Marais poitevin
Évaluation de l’im
pact économique
du projet de SD
AG
E sur le M
arais P
oitevin et analyse comparée des
mesures d’accom
pagnement
DR
AA
F P
oitou-Charentes
AC
Teon-
CA
CG
Contexte de l'
Contexte de l'
é étudetude
Objectif : bon état des
milieux
(respect des directives,contentieux européen)�
Objectif :
maintien de
l'économie agricole
Mandat du groupe d'experts, rapport et conclusions
Étude éco
nomique :
évaluation des p
ertes, mesures d
'accompagnement
Projet de SDAGE :
Objectifs de m
aintien des niveaux d'eau
Réduction des vo
lumes
prélevés dans les nappes de bordure
Zone d'
Zone d'é étude et population concern
tude et population concerné ée e
PA
RT
HE
NA
Y
LA-R
OC
HE
-SU
R-Y
ON
PO
ITIE
RS
RO
CH
EF
OR
T
LUC
ON
TALM
ON
T-SA
INT-H
ILAIR
EC
OU
LON
GE
S-S
UR
-L'AU
TIZ
E
CO
UR
CO
N
MO
UT
IER
S-LE
S-M
AU
XFA
ITS
LEZ
AY
SU
RG
ER
ES
HE
RM
EN
AU
LT (L')
CH
AILLE
-LES
-MA
RA
IS
MA
ZIE
RE
S-E
N-G
AT
INE
SE
CO
ND
IGN
Y
MA
ILLEZ
AIS
SA
INT-H
ILAIR
E-D
ES
-LOG
ES
SA
INT
E-H
ER
MIN
EM
AR
EU
IL-SU
R-LAY
-DIS
SA
IS
MA
RA
NS
SA
UZ
E-VA
US
SA
IS
AIG
RE
FE
UILLE
-D'A
UN
ISLO
ULAY
CE
LLES
-SU
R-B
ELLE
FO
NT
EN
AY-LE
-CO
MT
E
MO
TH
E-S
AIN
T-HE
RAY
(LA)
BE
AU
VO
IR-S
UR
-NIO
RT
JAR
RIE
(LA)
PR
AH
EC
QF
RO
NT
EN
AY-R
OH
AN
-RO
HA
N
SA
INT-M
AIX
EN
T-L'EC
OLE
MA
UZ
E-S
UR
-LE-M
IGN
ON
CH
AM
PD
EN
IER
S-S
AIN
T-DE
NIS
NIO
RT-N
OR
D
NIO
RT
NIO
RT-O
UE
ST
LA R
OC
HE
LLE
AYTR
E
SAU : 319 411 ha
666 irrigants(21 716 ha)�
É Étude tude é économ
ique : conom
ique : é état dtat d
’ ’avancement
avancement
Phase 3 :Impacts sur la filière aval
Phase 4 :Mise en perspective par les im
pacts sur les autres usages
Présentation au Comité
de Pilotage du 25/02/09
Phase 1 :Impacts économ
iques des principes de gestion quantitative
Phase 2 :Identification des m
esures d'accompagnem
ent et évaluation des coûts/bénéfices
Présentation au Comité
de Pilotage du 18/12/08
É Étude tude é économ
ique : prconom
ique : pré ésentation des rsentation des r
é ésultatssultats
666 irrigantsétudiés
CéréaliculturePolyculture/élevage
Élevage
Cultures spécialisées
Pas de cultures spécialisées
Fourrage irrigué
Fourrage non irrigué
Fourrage irrigué
Fourrage non irrigué
4 types «céréaliers
»3 types «
polyculture -élevage
»
superficie irriguéeSAU
dans le marais
SAU dans le m
arais
3 types «élevage
»
10 types / 8 UG : regroupem
ent en 40 groupes
MB issue de l’élevage
Construction du M
odC
onstruction du Mod
è èle le
Mod
Modè èle
le é économique
conomique
Hypothèses fortes :
Limites agronom
iquesSorgho / débouchés
Types
UG
Assolement
Marge brute
Contraintes:volum
e max, SAU
,main d'œ
uvre,...
Volume consom
mé
Actu
elSans irrig
ation
Diminutio
n lin
éaire
du m
aïs irrig
ué
Augmentatio
nde l’o
rge
É Évolution de lvolution de l
’ ’assolement
assolement
en fonction des ren fonction des r
é éductions de volume
ductions de volume
Blé
Prairie
Autres
Maïs
Volume co
nsommé
Résu
ltat économique
Marge brute en fonction du volum
e prM
arge brute en fonction du volume pr
é élevlev
é éU
G du S
AG
E S
NM
PU
G du S
AG
E S
NM
P
80 %
100 %
60 %
40 %
20 %
0 %
Niveau
de
consommatio
n actu
el
61.28 M€59.33 M€
54.98 M€
57.2 M€
52.4 M€
48.59 M€
Quelle perte de revenu?
Quelle perte de revenu?
Perte de MB
Coefficient intégrantles charges de structure
Perte de revenuPerte de revenu
X=
Définition des coefficients :
Céréaliers 1,68 –Polyculture 2,06 –
Éleveurs 2,37
�Hypothèses de départ / scénario de prix : exem
ple du BléHaut : 220 €/T –
Moyen : 170 €/T –
Bas : 120 €/T
Objectif
:acco
mpagner les a
gricu
lteurs
Combinaiso
nde m
esures
Program
mes A
gences
de l’E
au
Document R
égional
de D
éveloppem
ent R
ural
Étude A
SCA
Propositio
ns D
RAF
Sélectio
ncomité
de
Pilotag
e+
Groupe
agricu
lteurs
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Sorgho
Assolement
Bail
Irri-mieux
Retenue
MAE25%
MAE10%
€/m3
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Mm3
Com
binaison des mesures
Com
binaison des mesures
d d’ ’accom
pagnement
accompagnem
ent
-20 %
-40 %
-60 %
-80 %
Coût/efficacité
Réduction de volum
e
Phase 3 : Im
pact sur les filières
Production agricole
Approvisionne
ment
Meuniers
Organism
es stockeurs
Alim
ents bétailM
atériel d’irrigation
LaitV
iande bovine
Phase 4 : M
ise en perspective -im
pacts sur les autres usages
2 2- -Impacts sur les autres usages :
Impacts sur les autres usages :AELB :
Adaptation de l’évaluation des bénéfices environnementaux du PD
M
Groupe de travail usagers
autres usages
Biodiversité
Tourisme
Conchyliculture
Agriculture non irriguéeÉpuration
Eau potable Infrastructures
1 1- -É Évaluation du covaluation du coû ût d
t d’ ’un contentieux europun contentieux europé éen en
Ordres de grandeur
Ordres de grandeur
Limites de la m
odLim
ites de la mod
é élisationlisation
Calendrier de l’étude :
Incom
patibilité entre la réalisation et la consultation des
assem
blées
Les hypothèses fortes :
Les scénarios de prix agricoles
Les contraintes agronom
iques : ex Sorgho
Les capacités du mo
dèle :
Pas de change
ment de systè
me
Quelles perspectives quant
Quelles perspectives quant
à àson utilisation?son utilisation?
Objectifs à court term
e :
-éclairer les décideurs sur les im
pacts de leurs choix
-perm
ettre de calibrer les mesures d’acco
mpagnem
ent
Po
ssibilités à moyen
terme :
-aider les agriculteurs dans leurs choix stratégiqu
es
-créer de nouvelles clés de répartition des volu
mes
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 17
ANNEXE 3
Proposition de rédaction du paragraphe portant sur l’alimentation en eau potable de la ville de Niort dans le cadre de la phase 4 de l’étude portant
sur l’évaluation économique du projet de SDAGE
PROPOSITION DE REDACTION FAITE POUR LE CHAPITRE CONCERNANT LA PRODUCTION D’EAU POTABLE DANS LE CADRE DE LA PHASE 4 DE L’ETUDE
PORTANT SUR L’EVALUATION ECONOMIQUE DU PROJET DE SDAGE (SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - VILLE DE NIORT- MARS 2009)
_________________________________________
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 18
ANNEXE 4
Copie du courrier de M. JOLY adressé au président de la CLE
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 19
ANNEXE 5
Power-point de présentation du projet de réserve de substitution de l’ASLI « La Goutte d’eau » sur la commune de Saint Etienne de Brillouet
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
Réserve d
e substitu
tion de B
el Air
Réserve d
e substitu
tion de B
el Air
St Etien
ne d
e St E
tienne d
e Brillo
uet
Brillo
uet
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Contexte
Contexte
� �2 exp
loitatio
ns regro
upées au
sein de
2 exploitatio
ns regro
upées au
sein de l’A
SLI
l’ASLI L
a Goutte d
’Eau
La G
outte d
’Eau
� �L’EARL Les P
eupliers : 300 h
a (210 ha en
agricultu
re L’EARL Les P
eupliers : 300 h
a (210 ha en
agricultu
re conven
tionnelle et 90 h
a en agricu
lture b
iologiq
ue d
epuis
conven
tionnelle et 90 h
a en agricu
lture b
iologiq
ue d
epuis
1999)1999)
- -3,5 U
TH
3,5 UTH
250 743 m250 743 m
3 3attrib
ués au
1attrib
ués au
1er erjuin au
15 sept. 2007 (+
volume d
u
juin au
15 sept. 2007 (+
volume d
u
1 1er eravril au
1avril au
1er erjuin)
juin)
� �BIR
ET Stép
hane : 90 h
a (75 ha en
agricultu
re biologiq
ue le
BIR
ET Stép
hane : 90 h
a (75 ha en
agricultu
re biologiq
ue le
reste en agricu
lture co
nven
tionnelle)
reste en agricu
lture co
nven
tionnelle)
- -1,5 U
TH
1,5 UTH
76 113 m76 113 m
3 3attrib
ués d
u 1
attribués d
u 1
er erjuin au
15 sept. 2007 (+
volume d
u
juin au
15 sept. 2007 (+
volume d
u
1 1er eravril au
1avril au
1er erjuin)
juin)
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Projet n
é début 2007, en
concertatio
n D
DAF,
Projet n
é début 2007, en
concertatio
n D
DAF,
Agen
ce de l’E
au et C
onseil G
énéral
Agen
ce de l’E
au et C
onseil G
énéral
� �Dépôt D
DAF en
avril 2008Dépôt D
DAF en
avril 2008
� �Arrêté d
’autorisatio
n 12 février 2009
Arrêté d
’autorisatio
n 12 février 2009
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Dim
ensio
nnem
ent d
e la réserveDim
ensio
nnem
ent d
e la réserve
� �Volume créé =
80% des p
rélèvements les p
lus
Volume créé =
80% des p
rélèvements les p
lus
importan
ts (prin
temps+
été) effectués su
r les 5 im
portan
ts (prin
temps+
été) effectués su
r les 5 dern
ières années (2003 à 2007)
dern
ières années (2003 à 2007)
� �Année d
e référence : 2003 (p
rélèvements=
336 800m3)
Année d
e référence : 2003 (p
rélèvements=
336 800m3)
� �Volume =
269 440 m3
Volume =
269 440 m3
� �Rem
plissage à p
artir de 3 fo
rages existants (2 statio
ns
Rem
plissage à p
artir de 3 fo
rages existants (2 statio
ns
de p
ompage) et 4
de p
ompage) et 4
ème
èmeforage (1 statio
n de p
ompage)
forage (1 statio
n de p
ompage)
sera condam
né
sera condam
né
� �Substitu
tion to
tale du 1
Substitu
tion to
tale du 1
er eravril au
31 octo
bre
avril au 31 o
ctobre
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Caractéristiq
ues d
e la réserveCaractéristiq
ues d
e la réserve
� �Surface d
’emprise : 44 630 m
2Surface d
’emprise : 44 630 m
2
� �Volume : 269 440 m
3Volume : 269 440 m
3
� �Hauteu
r digu
e : 8,62 mHauteu
r digu
e : 8,62 m
� �Revan
che : 0,62 m
Revan
che : 0,62 m
� �Etan
chéité p
ar Etan
chéité p
ar géomem
bran
egéo
mem
bran
e
� �Pente talu
s int. et ext. : 1 V
/2H
zPente talu
s int. et ext. : 1 V
/2H
z
� �Trop plein
et vidange d
e sécurité
Trop plein
et vidange d
e sécurité
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau271 659 m271 659 m
3 3Total
Total
19 030 m19 030 m
3 3Perte p
ar évaporatio
n (0,5 l/
s/ha)
Perte p
ar évaporatio
n (0,5 l/
s/ha)
252 629 m252 629 m
3 3Volume irrigatio
nVolume irrigatio
n
72 ha
72 ha
Surfaces m
oyen
nes en
ma
Surfaces m
oyen
nes en
maï ïs s
grain (d
ont 58 h
grain (d
ont 58 h
a en agricu
lture
a en agricu
lture
biologiq
ue)
biologiq
ue)
81 900 m81 900 m
3 3Volume n
écessaire (1820 mVolume n
écessaire (1820 m3 3/ha)
/ha)
13 ha
13 ha
Surfaces m
oyen
nes en
ma
Surfaces m
oyen
nes en
maï ïs s
ensilage
ensilage
22 100 m22 100 m
3 3Volume n
écessaire (1700 mVolume n
écessaire (1700 m3 3/ha)
/ha)
17 100 m17 100 m
3 3Volume n
écessaire (300 mVolume n
écessaire (300 m3 3/ha)
/ha)
125 496 m125 496 m
3 3Volume n
écessaire (1743 mVolume n
écessaire (1743 m3 3/ha)
/ha)
45 ha
45 ha
Surfaces m
oyen
nes en
ma
Surfaces m
oyen
nes en
maï ïs s
semence
semence
6 000 m6 000 m
3 3Volume n
écessaire (200 mVolume n
écessaire (200 m3 3/ha)
/ha)
30 ha
30 ha
Surfaces m
oyen
nes en
colza sem
ence
Surfaces m
oyen
nes en
colza sem
ence
57 ha
57 ha
Surfaces m
oyen
nes en
blé d
ur, p
ois
Surfaces m
oyen
nes en
blé d
ur, p
ois- -févero
lle févero
lle (bio)
(bio)
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Etat in
itial Etat in
itial
� �Projet situ
é sur d
es calcaires blan
cs crayeux d
e Projet situ
é sur d
es calcaires blan
cs crayeux d
e
Fonten
ay et des calcaires b
lancs à silex b
londs d
e St
Fonten
ay et des calcaires b
lancs à silex b
londs d
e St
Aubin
Aubin
� �Terrain
argiloTerrain
argilo- -calcaires su
perficiels (20 cm
)calcaires su
perficiels (20 cm
)
� �La n
appe exp
loitée d
ans le secteu
r est celle du Lias
La n
appe exp
loitée d
ans le secteu
r est celle du Lias
� �Pas d
’écoulem
ent su
perficiel à p
roxim
itéPas d
’écoulem
ent su
perficiel à p
roxim
ité
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Etat in
itialEtat in
itial
� �Parcelle en
projet en
tièrement cu
ltivéeParcelle en
projet en
tièrement cu
ltivée
� �Projet h
ors Z
NIE
FF et N
ATURA 2000, m
ais dans la Z
ICO
Projet h
ors Z
NIE
FF et N
ATURA 2000, m
ais dans la Z
ICO
Plain
e Calcaire S
ud Vendée
Plain
e Calcaire S
ud Vendée
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Im
pact su
r le milieu
natu
relIm
pact su
r le milieu
natu
rel� �Paysage : au
cune su
ppressio
n de h
aie ni d
’arbre
Paysage : au
cune su
ppressio
n de h
aie ni d
’arbre
� �Milieu
terrestre : impact lim
ité (parcelle cu
ltivée, pas d
e Milieu
terrestre : impact lim
ité (parcelle cu
ltivée, pas d
e suppressio
n de jach
ère, pas d
’augm
entatio
n de su
rface suppressio
n de jach
ère, pas d
’augm
entatio
n de su
rface irrigab
le : parcelles irrigu
ées seront les m
êmes
irrigable : p
arcelles irriguées sero
nt les m
êmes
qu’actu
ellement)
qu’actu
ellement)
� �Im
pact su
r les eaux so
uterrain
esIm
pact su
r les eaux so
uterrain
es� �Positif en
pério
de d
’étiage : suppressio
n to
tale des
Positif en
pério
de d
’étiage : suppressio
n to
tale des
prélèvem
ents estivau
x et prin
taniers
prélèvem
ents estivau
x et prin
taniers
� �Qualitatif : p
as d’im
pact, réserve étan
chée
Qualitatif : p
as d’im
pact, réserve étan
chée
artificiellement
artificiellement
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �Mesu
res compensato
iresMesu
res compensato
ires� �
Intégratio
n paysagère : p
lantatio
n de h
aie bocagère (esp
èces Intégratio
n paysagère : p
lantatio
n de h
aie bocagère (esp
èces locale : ch
arme, frên
e, noisetier…
), enherb
ement d
es digu
eslocale : ch
arme, frên
e, noisetier…
), enherb
ement d
es digu
es
� �Alim
entatio
n de la réserve :
Alim
entatio
n de la réserve :
� �Prélèvem
ent
Prélèvem
ent uniquement
uniquemententre le 1
entre le 1
er ernov. et le 31 m
arsnov. et le 31 m
ars
� �Cote d
e début et d
’arrêt de p
rélèvement : 2,3 m
sur le p
iézomètr
Cote d
e début et d
’arrêt de p
rélèvement : 2,3 m
sur le p
iézomètre d
e e d
e St A
ubin la P
laine «
St Aubin la P
laine «
Tous V
ents
Tous V
ents» »
� �Durée d
e pompage estim
ée à 62 jours
Durée d
e pompage estim
ée à 62 jours
� �Plus au
cun prélèvem
ent en
tre 1Plus au
cun prélèvem
ent en
tre 1er eravril et le 31 avril et le 31 o
ctoct, p
our les 3 fo
rages , p
our les 3 fo
rages substitu
és (4substitu
és (4èm
eèm
eforage co
ndam
né)
forage co
ndam
né)
� �Vidange d
e sécurité
Vidange d
e sécurité
ASLI La Goutte d’Eau
ASLI La Goutte d’Eau
� �SDAGE Loire B
retagne et S
AGE Sèvre N
iortaise
SDAGE Loire B
retagne et S
AGE Sèvre N
iortaise - -
Marais P
oitevin
Marais P
oitevin
� �Disp
ositio
n 5C
: Disp
ositio
n 5C
: piézo
métrie
piézo
métrie o
bjectif d
’étiageobjectif d
’étiage� �Piézo
mètre d
e référence : T
ous V
ents à St A
ubin la P
laine
Piézo
mètre d
e référence : T
ous V
ents à St A
ubin la P
laine
� �Cote d
e début et d
’arrCote d
e début et d
’arrê êt tde p
rde p
ré él lè èvem
ent
vement
� �Disp
ositio
n 8A
: Créer d
es réserves de su
bstitu
tion
Disp
ositio
n 8A
: Créer d
es réserves de su
bstitu
tion
� �Pas d
e rejet vers le milieu
aquatiq
ue (sau
f vidange d
e sécurité)
Pas d
e rejet vers le milieu
aquatiq
ue (sau
f vidange d
e sécurité)
� �Forages u
tilisés uniquem
ent p
our le rem
plissage d
e la réserve, dForages u
tilisés uniquem
ent p
our le rem
plissage d
e la réserve, du 1
u 1
er er
novem
bre au
31 mars
novem
bre au
31 mars
� �Volume créé =
80Volume créé =
80% des p
rélèvements
% des p
rélèvementseffectu
és en 2003
effectués en
2003
� �Pas d
’augm
entatio
n de su
rface irriguée
Pas d
’augm
entatio
n de su
rface irriguée
� �Economie d
’eau : irrigatio
n préféren
tiellement d
e nuit, m
ise en
Economie d
’eau : irrigatio
n préféren
tiellement d
e nuit, m
ise en place
place
d’un pivo
t (depuis 2006), m
ise en place d
e tensio
mètres
d’un pivo
t (depuis 2006), m
ise en place d
e tensio
mètres
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 20
ANNEXE 6
Arrêté préfectoral d’exploitation de la réserve de substitution d’ASLI « La Goutte d’Eau
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 21
ANNEXE 7
Dossier comparatif entre les orientations du projet de SDAGE et les dispositions du SAGE Sèvre niortaise
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 22
ANNEXE 8
Eléments sur le projet de SDAGE présenté en séance
Rapport IV
Rapport IV
– –Projet d
e SDAGE
Projet de S
DAGE
1
CLE
–11/0
3/2
009
SD
AG
E Loire B
retagne : rappels
Un docu
ment de planification :
�pour 6 ans
�qui définit les grandes orientations pour une gesti
on équilibrée de la ressource en eau
�Q
ui défint des objectifs de qualitéet de quantités
des eaux à
atteindre par bassin versant
L’outil principal de mise en œ
uvre de la DC
E
2
OBJECTIFS D
'ETAT PA
R M
ASSE
D'E
AU S
UPE
RFICIELLES
(Projet de S
DAGE 2008)
Calcaires du D
ogger du bassin-versant du C
lain
Calcaires et m
arnes libres du Jurassique supérieur de l'A
unis
Calcaires et m
arnes du Lias et du D
ogger libres du Sud-V
endée
Calcaires et m
arnes du Lias et du Dogger
du bassin amont de la S
èvre-Niortaise
Calcaires et m
arnes captifs sous Flandrien
du Lias et du Dogger du sud de la V
endée
Calcaires et m
arnes captifs sous F
landrien du Jurassique supérieur de l'Aunis
Socle du bassin-versant
du marais poitevin
NIO
RT
LA R
OC
HE
LLE
FO
NT
EN
AY-LE
-CO
MT
E
CHARENTE M
ARITIME
OBJECTIFS D
'ETAT PA
R M
ASSE
D'E
AU S
OUTERRAIN
ES
(Projet de S
DAGE 2008)
±
Ba
rra
ge
de
la
Ba
rra
ge
de
la
To
uc
he
Po
up
ard
To
uc
he
Po
up
ard
VENDEE
VIE
NNE
DEUX-SEVRES
Lége
nde :
Principaux cours d'eau
Objectifs fix
és pour le
s masse
s d'eau
souterra
ines :
Bon état, 2015
Bon état, 2021
Périm
ètre du SA
GE
Bon état, 2027
Source : D
IRE
N région C
entre, AE
LB
- Projet de S
DA
GE
nov. 2007
3
CHARENTE M
ARIT
IME
VIE
NNE
VENDEE
DEUX-SEVRES
Sèvre N
iortaise
Sèvre NiortaiseE
stu
aire
de
la
Es
tua
ire d
e la
S
èv
re
Nio
rtais
eS
èv
re
Nio
rtais
eN
IOR
T
LA R
OC
HE
LLE
FO
NT
EN
AY-LE
-CO
MT
E
±
Ba
rra
ge
de
la
Ba
rra
ge
de
la
To
uc
he
Po
up
ard
To
uc
he
Po
up
ard
OBJECTIFS D
'ETAT PA
R M
ASSE
D'E
AU S
UPE
RFIC
IELLES
(Projet de S
DAGE 2008)
Vendée
AutiseC
uré
Courance
Mignon
Lam
bo
n
Gu
irand
e
Légende :
Objectifs fixés pour les m
asses d'eau :
Bon potentiel, 2015
Bon potentiel, 2021
Bon état, 2015
Bon état, 2021
Bon état, 2027
Limite départem
entale
Marais poitevin
Périm
ètre du SA
GE
Source : D
IRE
N R
égion C
entre, AE
LB - P
rojet de S
DA
GE
, nov. 2007)
PR
OJE
T A
CT
UE
L TE
NA
NT
CO
MP
TE
DU
GR
EN
ELLE
DE
L’EN
VIR
ON
NE
ME
NT
(A
UG
ME
NT
AT
ION
DE
LA P
AR
T D
E M
AS
SE
D’E
AU
EN
BO
N E
TA
T E
N 2015)
Version 2009)
4
CHARENTE M
ARIT
IME
VIE
NNE
VENDEE
DEUX-SEVRES
Sèvre N
iortaise
Sèvre NiortaiseE
stu
aire
de
la
Es
tua
ire d
e la
S
èv
re N
iorta
ise
Sè
vre
Nio
rtais
eN
IOR
T
LA R
OC
HE
LLE
FO
NT
EN
AY-LE-C
OM
TE
±
Ba
rrag
e d
e la
B
arra
ge
de
la
To
uc
he
Po
up
ard
To
uc
he
Po
up
ard
OBJECTIF
S D
'ETAT PA
R M
ASSE
D'E
AU S
UPE
RFIC
IELLE
S(Projet de S
DAGE 2008)
Vendée
Autise
Curé
Courance
Mignon
Lam
bo
n
Gu
irand
e
G:\IIB
SN
\DO
SS
IER
S T
EC
HN
ICIE
NS
\PH
OT
O interne equipe
Légende :
Objectifs fixés pour les m
asses d'eau :
Bon potentiel, 2015
Bon potentiel, 2021
Bon état, 2015
Bon état, 2021
Bon état, 2027
Limite départem
entale
Marais poitevin
Périm
ètre du SA
GE
Source : D
IRE
N R
égion Centre, A
ELB
- Projet de S
DA
GE
, nov. 2007)
RA
PP
EL D
ES
OB
JEC
TIF
S D
AN
S LE
PR
EC
ED
EN
T P
RO
JET
DE
SDA
GE
(30/11/2007)R
AP
PE
L DE
S O
BJE
CT
IFS
DA
NS
LE P
RE
CE
DE
NT
PR
OJE
T D
E S
DAG
E (30/11/2007) 5
1.R
epenser les aménagem
ents de cours d’eau2.
Réduire la pollution par les nitrates
3.R
éduire la pollution organique4.
Maîtriser la pollution par les pesticides
5.M
aîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
prioritaires6.
Protéger la santé
en protégeant l’environnement
7.M
aîtriser les prélèvements d’eau
8.P
réserver les zones humides et la biodiversité
9.R
ouvrir les rivières aux poissons migrateurs
10.Préserver le littoral
11.Préserver les têtes de bassin
12.Réduire les conséquences directes des inondations
13.Renforcer la cohérence des territoires et des polit
iques publiques
14.Mettre en place des outils réglem
entaires et financiers
15.Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
SD
AG
E Loire B
retagne : les orientations fondamental
es6
Mais u
ne forte cohérence entre les objectifs d
e ces
deu
x projets
SD
AG
E Loire B
retagne / SA
GE
Sèvre niortaise
Marais poitevin
Des orien
tation
s qu
i diffèren
t dan
s leur fo
rmu
lation
Exem
ples :
7
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions du PA
GD
ou article du règlement
1R
EP
EN
SE
R LE
S A
ME
NA
GE
ME
NT
S D
E C
OU
RS
D
'EA
U4E
- Am
éliorer la géomorphologie des cours d’eau
Art.6
- Interdiction d'altérer les frayères sauf DIG
ou DU
PA
rt.7 - Tout installation, ouvrage, travaux ou am
énagement inclus dans le
fuseau de mobilité d’un cours d’eau en respecter l’intégrité physique.
4A - A
méliorer la circulation piscicole dans le M
arais poitevin et ses bassins d'alim
entation4B
- Concevoir et m
ettre en œuvre un plan de gestion des ouvrages
hydrauliques (hors zone humide du M
arais poitevin)A
rt.5 - Tout propriétaire de barrage ou autre ouvrage im
planté en travers d’un cours d’eau est tenu de transm
ettre au préfet de département une note
d’information
4H - R
éaliser l’inventaire et améliorer la gestion des plans d’eau
Art.8
- Aucun plan d’eau ne peut être am
énagé sur les bassins classés en zone de répartition des eaux, sur les têtes de bassins et dans les aires d’alim
entation des cours d’eau de 1ère catégorie piscicole.
1DLim
iter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit m
ajeur /
1EC
ontrôler les espèces envahissantes4F
- Lutter contre les espèces allochtones ou envahissantes1F
Favoriser la prise de conscience
1GA
méliorer la connaissance
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
Ensem
ble des dispositions de l'objectif 4
"Préserver et m
ettre en valeur les m
ilieux naturels aquatiques"
Em
pêcher toute nouvelle dégradation des milieux
Restaurer la qualité physique et fonctionelle des
cours d'eau
Limiter et encadrer la création de nouveau plans
d'eau
1A1B1C
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions PA
GD
ou règlement
2R
ED
UIR
E LA
PO
LLUT
ION
PA
R LE
S N
ITR
AT
ES
2AR
endre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du S
dageN
C
2A - M
aîtriser la fertilisation azotée organique et minérale des cultures
2B - A
méliorer la gestion et la valorisation agronom
ique des effluents d’élevage
2C - A
méliorer la gestion de l’interculture et le recyclage de l’azote
2D - C
réer une base de données sur les rendements culturaux
2DA
méliorer la connaissance
Ensem
ble des dispositions de l'objectif 2 "Am
éliorer la qualité de l'eau en am
éliorant les pratiques agricoles et non agricoles"
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
Inclure systématiquem
ent certaines dispositions dans les program
mes d'actions en zone vulnérable
En dehors des zones vulnérables, développer
l'incitation sur les territoires prioritaires
2B2C
8
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions PA
GD
ou règlement
4M
AIT
RIS
ER
LA P
OLLU
TIO
N P
AR
LES
P
ES
TIC
IDE
S
4AR
éduire l'utilisation des pesticides à usage agricole
2H - R
éduire le recours aux pesticides par la modification des pratiques
agricoles2E
- Renforcer les dispositifs de bandes enherbées
2F - P
réserver, gérer et reconstituer le maillage de haies de bandes boisées et
des ripisylves2G
- Assurer une gestion durable des sols
Art.1
- Tout nouveau drainage enterré sur les parcelles bordant les cours d’eau est interdit afin de garantir l’efficacité des bandes enherbées et d’éviter tout transfert direct d’eaux résiduaires de drainage dans les cours d’eau.
4CP
romouvoir les m
éthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques
4DD
évelopper la formation des professionnels
4EF
avoriser la prise de conscience4F
Am
éliorer la connaissance
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
2I - Réduire et rationaliser l'utilisation non agricole des pesticides
Ensem
ble des dispositions de l'objectif 2
"Am
éliorer la qualité de l'eau en am
éliorant les pratiques agricoles et non agricoles"
4BLim
iter les transferts vers les cours d'eau
Exem
ples SD
AG
Evs
SA
GE
9
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions PA
GD
ou règlement
8P
RE
SE
RV
ER
LES
ZON
ES
HU
MID
ES
ET
LA
BIO
DIV
ER
SIT
E4C
- Am
éliorer la gestion des niveaux d’hiver et de début de printemps dans le
Marais poitevin
4G - A
ssurer l’inventaire, la préservation et la reconquête des zones humides
(hors Marais poitevin)
4H - R
éaliser l’inventaire et améliorer la gestion des plans d’eau
9B - Instituer ou rénover des règlem
ents d’eau en zone de marais
8B
Recréer des zones hum
ides disparues, restaurer les zones hum
ides dégradées pour contribuer à l'atteinte dun B
CE
des masses d'eau de cours
d'eau associées
4G - A
ssurer l’inventaire, la préservation et la reconquête des zones humides
(hors Marais poitevin)
8CF
avoriser la prise de conscience8D
Am
éliorer la connaissance
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
8AP
réserver les zones humides
Ensem
ble des dispositions de l'objectif 4
"Préserver et m
ettre en valeur les m
ilieux naturels aquatiques"
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions PA
GD
ou règlement
9R
OU
VR
IR LE
S R
IVIE
RE
S A
UX
PO
ISS
ON
S
MIG
RA
TE
UR
S9A
Assurer la continuité écologique des cours d'eau
NC
4A - A
méliorer la circulation piscicole dans le M
arais poitevin et ses bassins d'alim
entation4B
- Concevoir et m
ettre en œuvre un plan de gestion des ouvrages
hydrauliques (hors zone humide du M
arais poitevin)A
rt.5 - Tout propriétaire de barrage ou autre ouvrage im
planté en travers d’un cours d’eau est tenu de transm
ettre au préfet de département une note
d’information
9CA
ssurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole
/
9DM
ettre en valeur le patrimoine halieutique
4D - R
éhabiliter les habitats piscicoles et les frayères
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
9BR
estaurer le fonctionnement des circuits de
migration
10
Pré
conisations du proje
t de S
AG
E S
NM
P
N°
Orie
ntations fonda
me
ntale
s / D
ispositionsD
ispositions PA
GD
ou règlement
12C
RU
ES
ET
INO
ND
AT
ION
S10A
- Généraliser les atlas des zones inondables
10E - A
ssurer la pose de repères de crue
10F - M
ettre à jour et compléter les D
ossier Départem
entaux sur les Risques
Majeurs (D
DR
M), les portés à connaissance, les D
ocuments d’Inform
ation C
omm
unaux sur les Risques M
ajeurs (DIC
RIM
) en matière d’inondation
10G - A
ppuyer l’établissement des P
lans Com
munaux de S
auvegarde (PC
S)
11A - R
enforcer la prévision de crue
10B - M
ettre en place les plans de prévention des risques d’inondation (PP
RI)
10C - A
ssurer la prise en compte du risque inondation dans les docum
ents d’urbanism
e 10D
- Assurer la prise en com
pte du phénomène « ruissellem
ent » dans les docum
ents d’urbanisme et les P
PR
I 4E
- Am
éliorer la géomorphologie des cours d’eau
12A - M
ettre en place des infrastructures ou des zones de surstockage et de ralentissem
ent dynamique des eaux
12B - A
ssurer l’entretien et la réfection des digues12C
- Assurer l’entretien des exutoires
12DR
éduire la vulnérabilité dans les zones inondables /
12AA
méliorer la conscience et la culture du risque et
la gestion de la période de crise
12BA
rrêter l'extension de l'urbanisation des zones inondables
12CA
méliorer la protection dans les zones déjà
urbanisées
Orie
ntations du proje
t de S
DA
GE
2009
11
Compte-rendu de la CLE du 11 mars 2009 _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin 23
ANNEXE 9
Copie du courrier adressé au Préfet de Région par différents partenaires institutionnels vendéens au sujet du projet de SDAGE


























































































![[XLS]shyamlal.du.ac.inshyamlal.du.ac.in/pdf/facultyStaff/Monthly Attendance 1... · Web viewHEMA KIROULA NAVED AHMAD KHAN RAGHAV AGRAWAL MEENU BIRET AADARSH NAGAR SUMRIT GULATI ARUSHI](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5b2ac09a7f8b9ab83a8b59c3/xls-attendance-1-web-viewhema-kiroula-naved-ahmad-khan-raghav-agrawal-meenu.jpg)