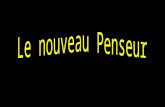Rapport Projet de Cindynique : Gestion des déchets en milieu ...
-
Upload
phamnguyet -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
Transcript of Rapport Projet de Cindynique : Gestion des déchets en milieu ...

Rapport Projet de Cindynique :
Gestion des déchets en milieu hospitalier
BRAUCHLI Ugo
KAUFMAN Arnaud
1

Sommaire
Remerciements : ......................................................................................3 Introduction :.............................................................................................4 I. Caractérisation des déchets...............................................................5
1) Quelques généralités sur les déchets .............................................................. 5
2) Les déchets propres aux activités de soin et les risques engendrés ............... 7
3) La réglementation et les obligations légales. ................................................. 12
a. Les obligations ..................................................................................................................... 12 b. La réglementation ................................................................................................................ 13
II. Politique et gestion...........................................................................19
1) Politique nationale de gestion sans risques des déchets............................... 19
2) Tri, Entreposage, Conditionnement. .............................................................. 22
a. le Tri des déchets d’activités de soins à risques.................................................................. 23 b. le conditionnement. .............................................................................................................. 25 c. L’entreposage et la collecte interne ..................................................................................... 27
3) L’élimination................................................................................................... 31
a. Les différentes filières d’élimination ..................................................................................... 32 b. Traitement par désinfection.................................................................................................. 35 c. Traitement par incinération dans des fours spécifiques. ..................................................... 39 d. Traitement par incinération dans des fours d'incinération des résidus urbains.(Fours mixtes O.M./D.H.)..................................................................................................................................... 40 e. Traitement par incinération In Situ. ...................................................................................... 41
Conclusion..............................................................................................43
2

Remerciements :
Au cours de nos différentes recherches, nous avons été amené à rencontrer différentes
personnes qui nous ont aidé et aiguillé au fil de notre travail. Parmi ces personnes, nous souhaitions
remercier tout particulièrement :
M. Eric Piatyszek, notre tuteur de projet, chercheur à l’Ecole des Mines (centre SITE) qui
nous a guidé et orienté tout au long de nos recherches.
M. Philippe Becaud, médecin ORL au sein de la clinque La Pergola à Vichy, qui nous a ouvert
les portes de la clinique où il exerce sa profession et qui nous a fourni des documents très
intéressants.
La société RDM (Ramassage Déchets Médicaux), entreprise parisienne, pour la précieuse
documentation qu’elle nous a faite parvenir et pour les conseils et orientations d’études
fournis.
3

Introduction :
A l'occasion de la publication du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques sur les déchets hospitaliers et médicaux, présenté le 19 février 1993 à Grenoble, Mme
Ségolène Royal avait lancé un ultimatum aux professionnels de la santé et aux élus locaux pour qu'ils
prennent mieux en compte la collecte et l'élimination des déchets qui peuvent être dangereux.
L'élimination des déchets produits par les hôpitaux, les laboratoires et les cabinets médicaux
commençait alors à mobiliser l'opinion et les pouvoirs publics. En effet, les hôpitaux sont des lieux
très fréquentés et l'activité y est intense. Les déchets ménagers qui en résultent sont variés, tout comme
les déchets spécifiques au domaine de la santé qui comportent divers types de déchets spéciaux. Ces
derniers sont régis par un important cadre législatif et font l'objet d'un suivi qui nécessite une
organisation exemplaire. Particulièrement exigeants au niveau sanitaire, les hôpitaux se doivent de
gérer leurs déchets de façon optimale. Néanmoins, diverses publications et enquêtes ont montré que
les conditions actuelles d'élimination des déchets hospitaliers ne sont pas toujours satisfaisantes. Si
cette situation peut se comprendre, cela n'implique pas que l'on ne tente pas d'y remédier.
Afin de mieux comprendre le concept de gestion des déchets hospitaliers, nous allons
commencer (après avoir énoncé quelques généralités concernant les déchets de tous types) par
identifier les différents types de déchets générés par les activités de soins ainsi que les risques
engendrés par ceux-ci. Ensuite, nous nous pencherons en détail sur la législation en vigueur en ce qui
concerne les déchets hospitaliers. Puis enfin nous étudierons la politique de gestion de ces déchets au
niveau national, comment les déchets sont triés et entreposés et bien sûr nous verrons également les
différentes filières d’élimination de ces déchets.
Notons enfin que dans cette étude nous ne traiterons que la gestion des déchets dans l’enceinte
des établissements de soins, leur responsabilité concernant ces déchets s’arrêtant à l’intérieur de leurs
locaux. Ainsi, nous ne intéresserons pas à tout ce qui concerne le transport des déchets.
4

I. Caractérisation des déchets
1) Quelques généralités sur les déchets Définition économique :
Un déchet est une matière ou un objet dont la valeur économique est nulle ou négative, pour
son détenteur, à un moment et dans un lieu donnés. Donc pour s'en débarrasser, le détenteur devra
payer quelqu'un ou faire lui même le travail.
Selon cette définition, la valeur nulle d'un bien peut redevenir positive : un objet débarrassé
d'un vieux grenier peut devenir objet de brocante, puis une antiquité.
Outre le temps et le lieu, la quantité est aussi un critère : quelque vieux papiers dans une
poubelle sont un déchet ; le ballot de vieux papiers imprimés dans un conteneur est une matière
première secondaire.
Définition juridique :
On distingue une conception subjective et une conception objective de la définition du déchet.
Selon la conception subjective, un bien ne peut devenir un déchet que si son propriétaire a la
volonté de s'en débarrasser. Mais tant que ce bien n'a pas quitté la propriété de cette personne ou
l'espace qu'elle loue, cette personne peut à tout moment changer d'avis. Si le bien a été déposé sur la
voie publique ou dans une poubellerie, son propriétaire peut avoir clairement signifié sa volonté
d'abandonner tout droit de propriété sur ce bien. En fait, ce qui est déposé sur la voie publique
appartient au propriétaire de la voie publique, c'est à dire la municipalité. Mais le propriétaire pourrait
aussi avoir manifesté sa volonté de donner ce bien à un tiers : c'est le cas du ramassage des habits
usagés, d'où l'ambiguïté de la conception subjective.
Selon la conception objective, un déchet est un bien dont la gestion doit être contrôlée au
profit de la protection de la santé publique et de l'environnement, indépendamment de la volonté du
propriétaire et de la valeur économique du bien : les biens recyclables qui sont des matières premières
secondaires entrent dans cette définition objective. Cette conception exige que les déchets soient
nommés dans une liste. Cela nécessite l'élaboration d'une classification en fonction de leur nature et de
leurs caractéristiques. La législation a retenu les deux conceptions du déchet, car la volonté de se
débarrasser ne suffit pas ; la définition objective empêche le détenteur d'un bien de se soustraire à la
réglementation relative aux déchets sous prétexte de sa valeur économique.
5

Lorsque l'on parle de producteur de déchets, on définit deux classes :
- les producteurs du secteur primaire de production : agriculture, élevage, pêche et foresterie.
- les producteurs du secteur industriel : grandes industries de production et de transformation des
matières, industrie nucléaire, industrie minière.
En ce qui concerne les déchets de ces deux secteurs, on entend des déchets tout à fait typés,
propre à l'activité en question, et non pas les déchets communs (par exemple déchets ménagers de la
ferme, déchets d'atelier, déchets de restaurant d'entreprise).
Toutes les autres catégories de déchets qui n'appartiennent pas de manière claire à cet ensemble
sont appelées déchets urbains. Ils comprennent :
- les ordures ménagères;
- des déchets volumineux et produits de façon moins quotidienne;
- des déchets qui exigent des mesures particulières, à cause des dangers immédiats qu'ils représentent
pour la sécurité des populations et pour l'environnement : les déchets du secteur de la santé font partie
de cette catégorie.
6

2) Les déchets propres aux activités de soin et les risques engendrés
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des acticités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Les activités de soins génèrent plusieurs types de déchets nécessitant un tri :
- les déchets à risques infectieux
- les déchets à risques chimiques
- les déchets radioactifs
- les déchets assimilables aux déchets ménagers
Ces déchets doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers et suivre une filière
d'élimination spécifique.
Avant de présenter ces différents types de déchets et les risques qui leur sont inhérents,
commençons par présenter quelques chiffres concernant les déchets hospitaliers dans la région Ile de
France.
Ces chiffres ont pour référence :
Une étude ORDIF de 1992 : interrogation des 700 établissements hospitaliers recensés en Ile
de France afin d’établir des indicateurs concernant les déchets hospitaliers.
étude nationale de 1990 sur l’élimination des déchets hospitaliers, qui a enquêté sur 408
établissements en Ile de France.
Chiffres concernant la production de déchets hospitaliers en Ile de France :
7

En 1992, les 700 établissements hospitaliers d’Ile de France recensés dans l’étude ORDIF
produisent environ :
35 600 tonnes/an de déchets contaminés et assimilés ;
50 000 tonnes/an si on ajoute ceux des laboratoires et de la médecine libérale assimilables aux
déchets des hôpitaux ;
130 000 t/an de déchets domestiques assimilables aux ordures ménagères.
Chiffres concernant le transport des déchets hospitaliers :
L’enquête nationale de 1990 fait apparaître en Ile de France que pour les 57%
d’établissements qui éliminent tout ou partie de leurs déchets à l’extérieur :
75% les font transporter par une entreprise spécialisée,
12% par les services communaux,
13% les transportent eux mêmes.
Chiffres concernant le traitement des déchets hospitaliers :
L’enquête nationale de 1990 fait apparaître en Ile de France que 85% des établissements qui
ont répondu :
séparent les déchets contaminés des non contaminés,
marquent dans 92% des cas les déchets contaminés de façon apparente,
utilisent des conditionnements appropriés pour les aiguilles, les seringues dans 98% des cas et
pour les objets tranchants dans 76% des cas,
respectent pour 60% d’entre eux le délai de 48 heures entre production et traitement, 17%
dépassant un délai de 72 heures,
récupèrent dans 55% des cas les papiers, cartons, eaux grasses, placentas, sels d’argent,
mercure.
Elle met en évidence qu’en Ile de France :
49% des établissements qui ont répondu disposent d’un incinérateur
75% les font acheminer vers une usine spécifique contre 17% vers une usine d’incinération
non adaptée.
Les déchets à risques infectieux :
Les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) peuvent être produits
dans de nombreux secteurs d'activité. Ils incluent par exemple les pansements et les aiguilles des
milieux médicaux ou vétérinaires, ou encore le matériel contaminé en laboratoire de recherche ou
d'analyses biologiques. Les déchets potentiellement contaminés par des agents biologiques pathogènes
8

représentent des risques infectieux pour les salariés qui les produisent, mais également pour les
personnels des sociétés de nettoyage, de collecte, de transport ou de traitement de tels déchets. La
transmission des agents biologiques à l'homme peut se faire par simple contact cutanéo-muqueux, par
piqûre, coupure, par inhalation de particules contaminées (bio aérosol), ou encore par ingestion. Pour
prévenir de tels risques, il est important d'établir des procédures de travail limitant l'exposition des
salariés et de respecter les circuits d'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et
assimilés. Ces déchets doivent être soit incinérés en tant que DASRI, soit prétraités par des appareils de
désinfection, de telle manière qu'ils puissent être incinérés comme des déchets ménagers. Les pièces
anatomiques animales sont évacuées vers l'équarrissage, alors que les pièces anatomiques d'origine
humaine sont éliminées par crémation. Tous ces circuits d'élimination sont encadrés par des règles
précises d'emballage, d'entreposage, de traitement et de traçabilité.
On parle de risque infectieux lorsque des personnes peuvent être exposées à des agents
biologiques susceptibles de provoquer une infection. Les agents biologiques sont les micro-organismes
(bactéries, virus, agents transmissibles non conventionnels ou prions , champignons), y compris les
micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains,
susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Ces agents biologiques ont
été classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu'ils présentent (voir
tableau 1).
L'exposition varie en fonction des activités de travail, qui vont ou non favoriser la
transmission des agents biologiques par les voies cutanéo-muqueuses, respiratoires ou digestives.
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Susceptible de provoquer une maladie chez l'homme
non oui grave grave
Constitue un danger pour les travailleurs
- oui sérieux sérieux
Propagation dans la collectivité
- peu probable possible élevé
Existence d'une prophilaxie ou d'un traitement efficace
- oui oui non
Tableau 1
Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) comportent :
Les matériels ou matériaux piquants ou coupant destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non
en contact avec un produit biologique.
Les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption.
Les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément
identifiables.
9

Ces déchets contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sais ou dont
on a de bonnes raisons de croire, qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme,
il causent une maladie chez l’homme ou chez d’autres êtres vivants.
Font également partie des DASRI, même en l’absence de risques infectieux les déchets assimilés
aux DASRI ; ils présentent les caractéristiques des DASRI et sont issus des activités d'enseignement, de
recherche, ou de production industrielle, dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire.
Sont également assimilées aux DASRI, les activités dans le domaine de la thanatopraxie. Les
équipements de protection individuelle non réutilisables, portés par des salariés exposés à des agents
biologiques, sont considérés comme des déchets contaminés.
Enfin, on considère comme pièces anatomiques les organes, les membres, les fragments
d'organes ou de membres aisément identifiables par un non spécialiste. Il faut faire attention à ne pas
confondre pièces anatomiques et déchets anatomiques, ces derniers n’étant pas reconnaissables par un
non spécialiste.
Les déchets à risques chimiques : Certaines activités de soins et notamment l'activité dentaire et la radiologie génèrent des
déchets nocifs pour l'homme et l'environnement. Ils doivent faire l'objet d'une collecte et d'un
traitement spécifique et sont régis par l'arrêté du 30 mars 1998.
Parmi les principaux déchets chimiques on trouve le mercure, les médicaments anticancéreux
et les médicaments non utilisés car périmés.
Le mercure, métal lourd toxique pour l’homme et très polluant pour l’environnement et
présent dans les établissement de santé sous quatre formes : dans les piles, les tensiomètres, les
thermomètres à mercure et les amalgames dentaires.
Les déchets de médicaments anticancéreux (antimitotiques, caryolytiques, cytostatiques ou
oncothérapeutiques) peuvent présenter pour les personnes qui les manipulent un risque toxique et
avoir des effets cancérigènes, mutagènes ou tératogènes. On peut répertorier deux types de déchets
concernant les médicaments anticancéreux : les tenues de protection du personnel (gants,…) et les
restes de produits comme les restes de perfusions, les fonds de flacons, les ampoules, aiguilles et les
déchets mous très souillés du fait d’incidents de préparation ou d’administration.
Les risques liés à des déchets chimiques sont identifiés par les différents symboles ci-dessous :
E : explosif
O : comburant
F+ : extrêmement inflammable
F- : facilement inflammable
T : toxique
Xn : nocif
10

C : corrosif
Xi : irritant
N : dangereux pour l’environnement
Les déchets à risques radioactifs
L’élimination des déchets radioactifs fait partie intégrante de la gestion des sources
radioactives dont est responsable chaque titulaire d’autorisation de détention et d’utilisation de telles
substances. Une personne compétente en radioprotection doit être nommée et suivre les différentes
étapes de l’élimination.
Pour une meilleure gestion, les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur période
radioactive. En 1986, le groupe d’action concertée en médecine nucléaire (ACOMEN) a défini une
classification en trois types, utilisée dans la pratique :
Type I : période radioactive très courte (inférieurs à 6 jours)
Type II : période radioactive ente 6 et 71 jours
Type III : période supérieure à 71 jours
De plus, seuls certains déchets radioactifs répondant à des critères bien précis doivent subir
une élimination spécifique, les autres suivant la voie des déchets ménagers et assimilés. Les critères
pour faire l’objet d’une élimination spécifique sont les suivants :
Activité massique > 74 kBq/kg
Activité totale > 3.7 kBq pour les radionucléides de radiotoxicité très élevée (groupe I)
> 37 kBq pour les radionucléides de radiotoxicité élevée (groupe II.A)
> 370 kBq pour les radionucléides de radiotoxicité modérée (groupe II.B)
> 3700 kBq pour les radionucléides de radiotoxicité faible (groupe III)
De plus, il faut noter que, la reprise de sources scellées étant obligatoire, seule la gestion de
sources non scellées incombe à l’établissement producteur.
Les déchets assimilables aux déchets ménagers
Tous les déchets générés par l’activité des centres de soins qui n’ont pas été cités
préalablement (déchets produits par l’activité structurelle de ces centres) sont assimilés à des déchets
ménagers et suivent donc un traitement plus classique que les déchets spécifiques aux activités de
soins. Parmi ceux-ci, on retrouve tous les déchets de la vie quotidienne comme les objets servants pour
les repas (assiettes, tasses, verres,…), les restes d’aliments, les cartons, emballages divers, les livres et
magazines, mais aussi tout ce qui concerne la literie (matelas, draps,…).
11

3) La réglementation et les obligations légales.
a. Les obligations
Responsabilité (décret 97-1048 du 6 novembre 1997 et arrêtés du 7 septembre 1999)
Vous êtes professionnel de santé : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets de
soins à risques infectieux.
L'élimination doit se faire conformément à la réglementation en vigueur
Déchets concernés
"Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif, curatif et palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire" qui
présentent un risque infectieux ou un danger pour l'homme :
- matériaux piquants ou coupants en contact ou non avec un produit biologique
- produits sanguins
- déchets anatomiques non identifiables
Tri : Ces déchets doivent être séparés des autres déchets dès leur production.
Fréquence de collecte (Arrêté du 7 septembre 1999)
Emballages et transport (Art R 44-3)
Ces déchets doivent être :
- collectés dans des emballages homologués UN à usage unique
- conditionnés, marqués, étiquetés et transportés conformément à la réglementation sur le transport des
matières dangereuses ( ADR*).
Traitement (Art R 44-9) :Ces déchets doivent être pré-traités ou incinérés à 850° dans des
installations spécifiques et agréées.
Documents obligatoires (Arrêté du 7 septembre 1999)
12

Documents à produire en cas de contrôle des autorités sanitaires et à conserver pendant 3 ans :
a. une convention d’élimination ou contrat avec le prestataire de service
b. les bordereaux de suivi (< 5 kg/mois) ou les bons de prise en charge et
récapitulatifs annuels ( < 5kg /mois) attestant de chaque collecte
et de la bonne élimination des déchets.
Sanctions applicables aux infractions
Un emprisonnement de 2 ans ou plus et une amende de 500 000 Francs, ou l’une ou l’autre de ces
peines sont applicables aux contrevenants.
b. La réglementation
Pour tout secteur d’activité à risque, une réglementation particulière est mise en place. En ce
qui concerne les activités de soins à risques, il existe de nombreux textes applicables aux déchets de
celles-ci. Ces textes peuvent être (est-il bon de la rappeler ?) des lois, des décrets, des arrêtés
ministériaux ou des circulaires. Enfin, ils sont de portées générales ou spécifiques aux déchets, à
l’incinération ou à la désinfection.
Afin d’illustrer au mieux la réglementation, nous donnerons, dans la suite, divers exemples
relatifs à chacun des différents types de textes de lois, et ayant attrait à différents aspects de la gestion
des déchets en milieu hospitalier.
Les textes de portée générale :
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux.
Cette loi définit le terme de déchet et instaure le principe du « pollueur - payeur » : tout
producteur est responsable de l’élimination des déchets qu’il produit. Le décret n°97-1048 du 6
novembre 1997 rappelle que ce principe s’applique aussi aux déchets d’activités de soins.
Elle introduit les 4quatre idées suivantes :
Prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets.
Organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume.
Valorisation des déchets.
Information au public.
Pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux, la seule valorisation possible est la
récupération d’énergie en cas d’incinération.
Cette loi prévoit également une planification de l’élimination des déchets. Pour les déchets
d’activités de soins à risques infectieux, le plan est élaboré à l’échelon régional.
Enfin, cette loi interdisant, à partir de 2002 la mise en décharge de déchets non ultimes.
13

La réglementation spécifique aux déchets d’activité de soin :
Le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activité de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique
(cf. copie du texte de loi en annexe)
Définit :
Les déchets d’activité de soins.
Les déchets d’activité de soins à risques infectieux.
Les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (recherche,
enseignement, thanatopraxie)…
Décrit les obligations des producteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés : tri, conditionnement, entreposage, suivi de l’élimination.
Impose l’incinération ou le pré traitement par des appareils de désinfection validés par le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France (C.S.H.P.F).
Précise l’unique filière d’élimination possible pour les pièces anatomiques d’origine humaines.
L’incinération :
La plupart des textes font plus état des installations d’incinérations ou des plans
départementaux d’élimination des déchets, que d’une réglementation concernant plus spécifiquement
les déchets de soins à risques infectieux.
On peut cependant y trouver des textes, comme l’arrêté ministériel du 23 août 1989 relatif à
l’incinération des déchets contaminés dans une usine d’incinération d’ordures ménagères.
Ce dernier, en effet, fixe les prescriptions pour le conditionnement, l’entreposage et la manutention des
déchets ainsi que pour les conditions de combustion. Il limite la quantité de déchets d’activités de
soins à 10% et définit les conditions du suivi de l’élimination.
La désinfection :
Cette partie concerne bien plus les établissements hospitaliers que la précédente. On y trouve,
par exemple :
La circulaire des ministres chargées de l’environnement et de la santé du 26 juillet 1991
relative à la mise en œuvre de procédés de désinfection des déchets contaminés des
établissements hospitaliers et assimilés. Elle définit la procédure de validation des appareils
de désinfection par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
14

La circulaire n° 96-59 du 1er février 1996 relative aux procédures de désinfection des
déchets d’activité de soins. Elle précise les procédures administratives applicables à
l’installation d’appareils de désinfection des déchets d’activité de soins.
On peut compléter, la liste proposée, par de nombreux autres textes, tels que :
Le décret 94/352 du 4 mai 1994
Oblige à prévenir les risques relatifs à la protection des travailleurs exposés à des agents biologiques
(confinement des agents biologiques, procédure de tri des déchets, affichage).
L'arrêté du 5 décembre 1996, dit arrêté ADR*
Précise les modalités de transport des matières dangereuses par route (classe 6.2 matière infectieuse).
L'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets de soins
Regroupement : immobilisation provisoire de déchets provenant de producteurs multiples.
Une installation de regroupement doit être déclarée en préfecture.
CHAMP D'APPLICATION
L'entreposage sur les sites de production et le regroupement de déchets provenant de producteurs
multiples.
DURÉE D'ENTREPOSAGE ENTRE LA PRODUCTION EFFECTIVE ET LE TRAITEMENT :
Quantité > 100 kg/semaine Quantité < 100 kg/semaine et > 5 kg/mois Quantité < 5 kg/mois
72 h 7 jours 3 mois
CARACTÉRISTIQUES DES LOCAUX (PRODUCTION > 5 KG) :
Ils sont réservés à l'entreposage des déchets et produits souillés,
Les déchets entreposés sont emballés selon l'ADR *,
Les locaux sont signalisés, fermés, ventilés, éclairés, dotés d'une arrivée d'eau
et d'une évacuation,
Le sol et les parois sont lavables...
15

Le compactage, le tassage et la congélation des déchets à risques infectieux sont interdits.
Les pièces anatomiques sont entreposées dans une enceinte frigorifique dédiée et conservées entre 0°
et 8° pendant 8 jours.
*ADR : Accord européen pour le transport des matières Dangereuses par la Route
L'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination
Les documents obligatoires de suivi d'élimination des déchets et leurs modalités d'utilisation
sont définis :
CONVENTION écrite entre le producteur et le prestataire chargé de l'élimination
BORDEREAU DE SUIVI OBLIGATOIRE ET BON DE PRISE EN CHARGE :
Quantité de déchets > 5 kg par mois :
- sans regroupement : Bordereau de suivi CERFA n° 11352*01
- avec regroupement :
Bon de reprise en charge
Retour du bordereau de regroupement CERFA n° 11352*01
avec la liste des producteurs
Quantités de déchets < 5 kg par mois :
Bon de prise en charge
Envoi d'un récapitulatif annuel
Deux arrêtés préciseront les dispositions techniques sur :
- Les modalités d'emballage et de transport
- L'agrément et la mise en oeuvre des appareils de désinfection
Norme NF X 30-500 : Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants
Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'élimination des déchets d'amalgames issus des cabinets
dentaires
16

Par ailleurs, les textes de lois énoncés précédemment sont relatifs à la réglementation
française. On trouve aussi des textes, au niveau européen, de nature plus généralise (liste des
déchets dangereux,…) :
Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets.
Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets
dangereux.
Décision 94/904/CEE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets
dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE
relative aux déchets dangereux.
Décision 2000/532/CEE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE
établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil
établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4,
de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (NDLR voir la §
18).
Quelques commentaires :
Tout d’abord, on peut remarquer qu’après quelques lois dans les années 70, il ne semble pas y
avoir eu de textes édités avant les années 90. Nous n’avons pas trouvé de textes antérieurs. N’y avait-il
pas, alors, de réglementation ?
Nous pouvons aussi se demander si ce n’est pas dans un souci d’harmonisation européenne
que ces décrets se sont mis en place ? En effet, les premiers textes français arrivent en même temps
que la première directive européenne. Puis, hormis l’arrêté du 23/08/89, il faut attendre décembre
1991 et une nouvelle directive européenne, avant de voir apparaître de nouveaux textes à l’échelon
national. A titre d’exemple, dans la gestion des déchets à risques infectieux et des pièces anatomiques,
seuls deux textes en vigueur datent d’avant 1990 (la circulaire du 9/08/78 relative aux emballages et
transport des déchets et l’arrêté du 23/09/89 concernant l’incinération des déchets).
D’un point de vue plus général, on peut penser que la réglementation actuelle, en vigueur,
couvre tous les différents aspects relatifs à chacun des déchets : de la définition des déchets (que l’on
retrouve dans les textes généraux) à la désinfection de ceux-ci, en passant par les modalités
d’entreposage, le contrôle des filières d’élimination, l’emballage, le transport et l’incinération, il est
clair que les textes de lois ne s’arrêtent pas uniquement aux frontières de l’hôpital. On y trouve même
des normes sir la qualité des emballages ! (NF pour normes françaises).
17

Enfin, pour contrôler le bon respect de ces règles, il existe un corps de contrôle, constitué
d’inspecteurs des installations classés (DRIRE notamment) d’ingénieurs et de techniciens sanitaires.
La fréquence des interventions varie beaucoup et est non définie.
A titre de remarques, les contrôles sont effectués de la manière suivante :
DDASS : inspection des établissement, suivi RSD
DRASS + suivi du plan régional des déchets de soin
DRIRE + inspection hors établissements : inspection des véhicules de
transport (intervention du ministère des transports), des incinérateurs.
Enfin, l’avis de l’infirmière générale, conseillère technique régionale en soins infirmiers
(DRASS) est à solliciter.
18

II. Politique et gestion
La gestion des déchets s’inscrit dans une démarche d’optimisation de l’hygiène hospitalière et
de lutte contre les infections nosocomiales. Celle-ci se décompose en diverses étapes :
Conformité à la politique nationale de gestion
Tri des déchets
Entreposage et Conditionnement de ceux-ci
Choix des filières d’élimination et élimination des déchets.
Nous nous concentrerons donc sur chacune des parties, afin de mieux comprendre le système
global de gestion et de pouvoir l’analyser.
1) Politique nationale de gestion sans risques des déchets.
C’est aux gouvernements que revient la charge d’établir un cadre pour la gestion sans risque
des déchets produits par les soins de santé et de veiller à ce que les directeurs d’établissements
assument leur part de responsabilité dans ce domaine. Par ailleurs, les politiques et les plans pour la
gestion sans risque de ces déchets doivent couvrir les trois points suivants :
1. La création progressive d’un système global de gestion des déchets, de leur
production à leur élimination.
2. La formation de toutes les personnes impliquées et leur sensibilisation.
3. Le choix d’options sûres et écologiques pour le traitement de ces déchets.
Pour cela, il faut disposer d’un mécanisme national de coordination, impliquant le Ministère
de la Santé et d’autres parties intéressées. Il est important que l’autorité désignée coordonne ces efforts
et reçoive un appui politique suffisant, de même que le financement et le personnel nécessaires.
Pour atteindre son but, la stratégie nationale dans ce domaine doit prévoir les activités suivantes :
Identifier les principaux partenaires, entre autres : le Ministère de la Santé,
l’organisme travaillant pour l’environnement, des organisations non
gouvernementales, les producteurs de déchets, les entreprises et les services
d’élimination des déchets.
Désigner l’autorité responsable de l’élaboration, de l’application et de l’évaluation de
la politique.
19

Procéder à une évaluation initiale et à l’analyse des problèmes conduisant à une
manutention ou une élimination dangereuse.
Elaborer un cadre politique national établissant que la gestion des déchets fait partie
du système de santé et que les services de santé ont la responsabilité juridique et
financière de s’occuper de ce problème dans de bonnes conditions de sécurité et avec
un devoir de diligence.
Elaborer un cadre réglementaire et des directives nationales faisant appel à une
approche globale incluant la formation, les questions de sécurité et de santé au travail,
ainsi que le choix avisé des options en matière de gestions des déchets, compte tenu
des circonstances.
Elaborer un dispositif de contrôle.
Fixer des buts ou des objectifs pratiques à atteindre dans des délais précis.
Créer une infrastructure nationale et régionale pour l’élimination des déchets produits
par les soins de santé.
Appuyer les autorités régionales et municipales au niveau de l’exécution.
Intégrer la diminution des quantités de déchets dans la politique nationale d’achats.
Evaluer l'impact à l’aide d’indicateurs de procédés (nombre d’établissements de soins
ayant des systèmes de gestion sans risque des déchets) et d’indicateurs de résultats
(par ex. Nombre d’accidents ou des déchets sanitaires ont été impliqués).
En ce qui, concerne les établissements de santé, on dénote d’autres activités plus spécifiques.
Celles-ci ont attrait à différents aspects de la politique : du système global (contrôle et décisions au
niveau le plus haut) aux choix des options de traitement, en passant par un sensibilisation et une
formation du personnel.
Système global :
Les services ou établissements de santé doivent mettre en place un système global de gestion
des déchets reposant sur les moyens sûrs et écologiques. Le système doit partir de mesures
fondamentales puis être amélioré progressivement. Les premiers pas comprennent le tri à la source, la
manutention, le traitement et l’élimination des objets pointus et tranchants.
Activités importantes :
Attribuer les responsabilités pour la gestion des déchets
Attribuer des ressources humaines et financières suffisantes
Diminuer les quantités de déchets en agissant sur la politique des achats et la gestion des
stocks
20

Trier les déchets en deux catégories : dangereux et inoffensifs
Mettre en place des options sûres pour la manutention, la conservation, le transport, le
traitement et l’élimination
Contrôler la production et la destination des déchets.
Sensibilisation et formation :
La sensibilisation aux dangers inhérents aux déchets produits par les soins de santé et la
formation à des pratiques sans risque est un point fondamental pour obtenir à la fois un engagement et
des modifications du comportement par tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ces déchets.
Le personnel doit donc être formé sur les règles de tri mises en œuvre, les conditionnements et les
filières d’élimination retenues (dont nous parlerons par la suite).
Activités importantes :
Sensibiliser les décideurs et les responsables d’établissements de santé aux risques et
responsabilités s’associant à ces déchets.
Intégrer la gestion de ces déchets dans les programmes de cours des infirmières, des médecins
et des responsables de services de santé.
Elaborer un programme national adapté aux diverses catégories professionnelles.
Apprendre aux agents de santé, aux agents chargés de l’élimination des déchets et à la
communauté les risques inhérents à ces déchets (risques infectieux, ressenti ou psycho-
émotionnel, mécanique, chimique et toxique, radioactif) et les bonnes pratiques (lavage des
mains, port de gants, ne pas porter ses mains pendant le travail (tabagisme, onychophagie),
suivi médical et vaccinations à jour).
Apprendre aux agents de santé les procédures en cas d’accident du travail (consignes écrites
spécifiques, déclaration d’accident au médecin du travail).
Choix des options de traitement :
Les options de traitement retenues doivent être efficaces, sûres, écologiques afin de protéger
les personnes des expositions volontaires ou accidentelles aux déchets au moment de la collecte, de la
manutention, de l’entreposage, du transport, du traitement ou de l’élimination.
Activités importantes :
Identifier les ressources disponibles pour la gestion centralisée des déchets et leur élimination
Choisir des options durables pour la gestion et l’élimination en fonction :
- de leur coût
- de leur caractère écologique
21

- de leur efficacité
- de la sécurité des travailleurs
- de la prévention des réutilisations de matériel médical jetable, seringues par exemple
- de l’acceptabilité sociale
Identifier les options convenant à chaque établissement de santé de chaque niveau
Contrôler et évaluer la sécurité et l’efficacité
Il est fondamental que toutes les personnes concernées par ce problème comprennent que la
gestion des déchets produits par les soins de santé fait partie intégrante de ceux-ci. Les effets
indésirables secondaires à la mauvaise gestion des déchets produits par les soins de santé altère la
qualité des soins de santé.
Enfin, l’intérêt d’une telle politique soulève la question inhérente des enjeux de la bonne
gestion. Divers et variés, on dénote principalement :
La responsabilité du producteur
L’hygiène hospitalière
La sécurité et les conditions de travail tout au long de la filière d’élimination
L’accréditation
L’image de marque de l’établissement producteur
L’impact économique
2) Tri, Entreposage, Conditionnement.
Ces trois aspects sont tous trois d’une importance majeure dans la gestion des déchets.
En effet, faut aussi se préoccuper du tri dès l’étape qui génère le déchet c'est-à-dire dès la
réalisation d’un soin ou d’un acte médico-technique.
L'entreposage et le conditionnement des déchets d'activités de soins sont soumis au respect
de certaines prescriptions. En particulier, le stockage doit être isolé d'autres déchets; la collecte doit
être effectuée dans des emballages à usage unique et des conditions très restrictives, notamment en ce
qui concerne les délais, doivent être respectées quant à l'entreposage de ces déchets. L'éventualité de la
création, dans la nomenclature des installations classées, d'une rubrique spécifique aux installations de
regroupement, d'entreposage et de pré traitement (désinfection) de déchets d'activités de soins à
risques infectieux a été abandonnée (circulaire n° 911-2000 du 25 mai 2000, non publiée au Journal
Officiel).
22

a. le Tri des déchets d’activités de soins à risques.
Pourquoi trier ?
Dans la vie courante, le tri des déchets et ordures ménagères permet un meilleur recyclage,…
Cependant, le tri n’est pas, ici, une obligation légale. Aussi est on en droit de se demander pourquoi le
tri des activités de soins à risques est-il si important. Tout d’abord, parce que certaines activités de
soins et notamment l'activité dentaire et la radiologie génèrent des déchets nocifs pour l'homme et
l'environnement. Ils doivent faire l'objet d'une collecte et d'un traitement spécifique et sont régis par
l'arrêté du 30 mars 1998. Ainsi, le tri permet de:
Assurer la sécurité des personnes
Respecter les règles d’hygiène
Eliminer chaque type de déchet par la filière appropriée, dans le
respect de la réglementation. En particulier, les déchets d’activité de
soins à risques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers et
assimilés
Contrôler l’incidence économique de l’élimination des déchets
d’activité de soins à risques
Comment trier ?
On distingue les déchets d’activité de soins assimilables aux déchets ménagers et les déchets
d’activité de soins à risques. Ces derniers comportent plusieurs catégories qui correspondent à des
filières d’élimination distinctes :
Déchets d’activités de soins à risques infectieux
Déchets d’activités de soins à risques chimiques et toxiques
Déchets d’activités de soins à risques radioactifs
On distingue enfin les pièces anatomiques.
La récupération et la valorisation de certains déchets.
La mise en place de filières de récupération et de valorisation des déchets assimilés aux
déchets ménagers s’inscrit dans une politique globale de gestion des déchets. La valorisation va
devenir un outil prépondérant dans la gestion des déchets des établissements de soins parce qu'elle
permettra de diminuer les quantités à traiter, donc le prix à payer pour cela.
Pourtant, s’agissant des unités de soins, la mise en place de telles filières est extrêmement
délicate car les critères de tri s’en trouvent multipliées et complexifiées :
23

manque de place de stockage ou problème de sécurité (risque d'incendie pour les cartons par
exemple); manque de sensibilisation de l'ensemble du personnel de l'établissement;
manque d'incitation, notamment lorsque l'hôpital ne paie pas l'élimination de ses ordures
ménagères.
Viennent s'y ajouter des difficultés d'organisation: recherche de débouchés difficile, fluctuation des
cours importante, partenaires locaux pas toujours motivés.
Cependant, il existe des débouchés déjà bien établis suivant les matériaux :
déchets de cuisine: ils sont de plus en plus rares et ils doivent être pasteurisés
avant leur utilisation en alimentation animale;
papiers, cartons: il existe toujours une filière locale, mais une rémunération
n'est pas à espérer;
verres: il existe de nombreux accords entre les établissements et les
collecteurs, à condition que le tri soit bien fait;
films radiologiques: ils sont la plupart du temps repris par les fournisseurs;
médicaments: ils sont repris par des organisations comme "Pharmaciens sans
frontières", ou "l'Ordre de Malte";
thermomètres: il existe des sociétés spécialisées dans la récupération du
mercure (liste disponible à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie);
ferrailles: elles sont récupérables par un ferrailleur local;
déchets d'espaces verts : ils peuvent être compostés sur place ou sur une plate-
forme de la commune, si elle existe.
Concernant les autres déchets à éliminer, ils devront aboutir à des déchets "ultimes" (selon la
loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 15 juillet 1975) ; c'est à dire des déchets, résultant ou non de
traitement et qui ne sont plus valorisables, dans les conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux.
Il faut noter toute fois, le caractère ambigu, voir incohérent de cette définition, soulevée
d'ailleurs par un article paru dans le journal "La Tribune Desfossés" du 24 octobre 1996. En effet,
selon les conditions techniques et économiques d'élimination, donc de valorisation dans une région, un
déchet sera considéré comme valorisable (donc non ultime parce qu'elle a les moyens de le valoriser)
alors qu'il sera considéré comme non valorisable donc ultime dans une autre région !...
Les conditions économiques et techniques ne sont pas uniformes sur l'ensemble de la France
ce qui pose un problème majeur pour les régions les plus pauvres. La région déficitaire en installations
peut alors, pour valoriser ses déchets, les faire traiter par une autre région (qui a les moyens de les
24

valoriser); ce qui est en totale contradiction avec la loi, qui précise dans ces objectifs, vouloir " limiter
en distance et en volume le transport des déchets".
b. le conditionnement.
Le conditionnement est une technique consistant à emballer. Dans une société industrielle, les
emballages étant normalisés, le conditionnement devient la mise en conformité d'unités avec un
cahier des charges déterminé.
Dans les établissements de santé, les conditionnements constituent une barrière physique
contre les déchets blessants et les micro-organismes pathogènes doivent être à disposition sans rupture
d’approvisionnement dans l’unité productrice de déchets.
Les déchets doivent être séparés des autres déchets dès
leur production et placés dans des emballages spécifiques. Si
les déchets d’activités de soins à risques sont mélangés dans
un même contenant à des déchets non dangereux, l’ensemble
est considéré comme infectieux et éliminé en tant que déchets
d’activités de soins à risques.
Les conditionnements doivent donc être adaptés au type de déchets produits (perforant, solide,
mou, liquide), aux conditions de leur production, aux spécificités internes et externes de la filière
d’élimination. Il est également important de savoir si les déchets sont susceptibles de contenir des
Agents transmissibles non conventionnels (ATNC). En effet, ces déchets suivent un circuit
d’élimination spécifique différent de celui des autres déchets d’activités de soins à risques. En
conséquence, les établissements doivent mettre à la disposition des agents plusieurs types de
conditionnements :
conditionnement pour déchets d’activités de soins à risques infectieux (sacs, cartons,
fûts, boîtes pour déchets piquants coupants,…)
conditionnements pour les autres déchets à risques.
De plus, le conditionnement dépend des conditions de collecte et des caractéristiques des
véhicules de transport. On peut utiliser :
des poubelles ordinaires ou hermétiques
des sacs
25

des bacs roulants
des conteneurs de grande capacité
Le sac est le plus fréquemment utilisé mais il existe d’autres types de conditionnement rigides
(caisses carton doublé plastique, fût,…). Le support du sac peut être mobile ou fixe. Le dispositif de
fermeture temporaire est de préférence actionné par une pédale. Il convient d’éviter, pour des raisons
d’hygiène, les systèmes à couvercle.
A titre d’exemple, on donne le tableau suivant :
Types de déchets
Perforants
Solides (DASRI et assimilés)
Solides (DASRI) Mous Liquides
Pièces anatomiques
humaines
Sac en plastique Sac en plastique doublé intérieurement de plastique Caisse en carton avec sac plastique intérieur Boîte et minicollecteur Fût et jerricane en plastique Emballage étanche pour liquides Emballage rigide compatible avec la crémation
Tableau : Choix des emballages pour DASRI et assimilés et pièces anatomiques humaines
Les emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux sont à usage unique. Ces
emballages doivent pouvoir être fermés temporairement en cours d’utilisation et doivent être fermés
définitivement avant leur enlèvement. Un arrêté du 24 novembre 2003 (entré en application depuis le
26 décembre 2004) et différentes normes précisent les caractéristiques de chaque emballage (cf.
annexe). Il existe également une marque NF (marque NF 302) concernant les emballages pour déchets
d’activités de soins perforants.
De façon générale, ces emballages doivent :
Etre résistants et imperméables
Avoir une couleur dominante jaune
Avoir un repère horizontal indiquant la limite de remplissage
Porter le symbole « danger biologique »
Porter le nom du producteur
26

Un code couleur permet la différenciation obligatoire entre les emballages contenant des
déchets d’activités de soins à risques infectieux et ceux contenant des déchets assimilables aux déchets
ménagers. Le jaune est la couleur la plus fréquente rencontrée pour identifier les déchets d’activités de
soins à risques infectieux.
Enfin, le choix de l’emballage est également guidé par la filière d’élimination des déchets. En
effet, si les déchets d’activités de soins à risques et les pièces anatomiques sortent de l’établissement,
les emballages doivent répondre également aux exigences de la réglementation : les emballages pour
déchets d’activité de soins à risques infectieux mous répondent aux critères
précisés par la circulaire D.G.S n°296 du 30 avril 1996 relative au
conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ; et à l’application du Règlement pour le Transport des Matières
Dangereuses par la Route (le sigle R.T.M.D.R est remplacé par celui
d’ADR). Si un emballage n’est pas agréé ADR, il sera placé dans un
suremballage agrée (grand emballage, grand récipient pour vrac)
c. L’entreposage et la collecte interne
Pour améliorer l'hygiène et préserver l'environnement, il est recommander d'éviter la
prolifération des conteneurs ou des aires de stockage en adaptant la fréquence de collecte aux quantités
produites. C’est pourquoi les déchets d’activités de soins à risques et assimilés doivent être entreposés
dans des conditions particulières. Ainsi, à l'exception des pièces anatomiques, il est interdit de
congeler les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés en vue de leur entreposage. Il
est également interdit de compacter les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les
récipients et débris de verre.
1. La collecte interne :
Le circuit de collecte interne est le trajet suivi par les déchets d’activités de soins à risques
infectieux avant leur évacuation.
Lorsqu'un établissement comporte plusieurs unités productrices de déchets d’activités de soins
à risques, il est possible de créer des entreposages intermédiaires, où les emballages pleins sont
déposés temporairement avant leur déplacement vers le lieu d'entreposage centralisé, d'où les déchets
seront enlevés en vue de leur élimination. Dans un souci de traçabilité, il est recommandé à chaque
27

unité productrice de déchet d’activtés de soins à risques de noter sur les emballages pleins, ses
coordonnées et la date d'entreposage des déchets.
Les principes de base :
On dénombre de nombreux principes, dont les principaux sont :
Le circuit des déchets d’activités de soins à risques infectieux doit s’intégrer dans les
autres circuits hospitaliers
L’utilisation d’emballages étanches, voire de sur-emballages fermés efficacement
permet une bonne gestion des flux propres et sales au regard des règles d’hygiène
hospitalière
Aucun déchet n’est entreposé dans les zones dites « propres »
Les déchets conditionnés dans des emballages primaires sont placés dans des
conteneurs adaptés à la collecte interne. Dans la mesure du possible, on évitera le
transvasement des déchets d’activités de soins à risques infectieux. Notamment, en
cas de transport sur la voie publique, les sacs seront placés le plus tôt possible dans des
grands récipients pour vrac agréés au titre de l’ADR. Si le transvasement ne peut être
évité, il se fera, dans la mesure du possible, grâce à un dispositif automatique
Les conditionnements remplis sont évacués le plus rapidement possible du service
producteur vers le local d’entreposage intermédiaire
Afin d’éviter les manipulations multiples d’emballages primaires au cours de la
collecte interne, les sacs sont placés dans des conteneurs mobiles, étanches et rigides,
réservés à cet usage et dans lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac.
Les caractéristiques des conteneurs :
Les conteneurs doivent être :
Equipés d’un système de préhension adapté au reste de la filière
Equipés d’un système de timonerie adapté au système de convoyage interne, le cas
échéant
Clairement identifiés par une mention explicite (ex : déchets d’activités de soins à
risques infectieux), le pictogramme du danger biologique et/ou un
code couleur afin de pouvoir aisément distinguer les conteneurs
contenant des déchets d’activités de soins à risques infectieux de
ceux contenant des déchets assimilés aux déchets ménagers
Nettoyés et désinfectés régulièrement et obligatoirement avant le
retour dans les services, d’où la nécessité de prévoir une aire aménagée à cet effet.
28

L’organisation de la filière d’évacuation
Tout d’abord, aucun déchet ne doit demeurer dans la chambre du patient, sauf cas
particuliers (protocole d’isolement, …).
Ensuite, les conditionnements doivent être en nombre suffisant, de taille adaptée et, leur
emplacement doit être défini en fonction des besoins et en respectant les règles d’hygiène.
Enfin, il convient de procéder à des regroupements successifs en fonction de l’organisation et
des configurations architecturales (entreposage au sein de l’unité, par étage, par bâtiment, par site,…).
Le compactage et le tassage :
Le compactage des déchets d’activités de soins à risques infectieux est interdit pour des
raisons d’hygiène et de sécurité. Toute pratique comparable au compactage est également interdite
(ex : tassage).
Par contre, le compactage des déchets d’activités de soins assimilables aux déchets ménagers
reste possible. Dans ce cas, les compacteurs sont placés dans les locaux réservés à l’entreposage des
déchets et des produits souillés ou contaminés. Un protocole précisant les conditions d’utilisation et de
maintenance doit être affiché de manière visible à proximité du compacteur.
2. Les lieux d’entreposage :
Afin de limiter au maximum le contact avec les DASRI, il est préférable de situer les lieux
d'entreposage en retrait des zones d'activité et à distance de prises d'air neuf de ventilation. De plus,
pour une plus grande fonctionnalité, ces lieux d'entreposage doivent être faciles d'accès, notamment
pour les véhicules de collecte.
Le local d’entreposage intermédiaire :
Ce local, dont l’emplacement n’a pas toujours été prévu dans les bâtiments existants est très
souvent indispensable. Il permet, en effet, d’effectuer un entreposage temporaire pour une ou
plusieurs unités de soins, dans des conditions conformes à la réglementation et aux protocoles internes.
Il sert, aussi, de point de collecte à l’intérieur de l’établissement qui peut également être utilisé pour
l’entreposage des produits souillés, du linge sale, des déchets ménagers et assimilés.
Par ailleurs, il est généralement situé, dans la mesure du possible, à l’extérieur de l’unité de
soins, souvent à proximité du circuit d’évacuation (monte charge, ascenseur,…).
Le protocole d’entretien du local d’entreposage intermédiaire et des conteneurs est le suivant :
Identification de la personne responsable
Liste du matériel et des produits nécessaires pour accomplir cette tâche
29

Description des différentes tâches à réaliser (fréquence et horaires) et des
mesures exceptionnelles à prendre en cas d’incident.
Enfin, les conditions générales et les équipements sont les suivants :
Superficie adaptée au volume de déchets produits et au rythme de collecte
Absence de communication directe avec d’autres locaux
Local non chauffé et éventuellement réfrigéré dans le cas des conditions
climatiques particulières (départements ou territoires d’outre-mer et assimilés)
Ventilation suffisante, naturelle ou mécanique
Porte suffisamment large pour laisser passer les conteneurs et, à fermeture
impérative
Eclairage efficace
Interdiction d’entreposer des déchets conditionnés dans des sacs à même le sol
Identification du local du point de vue de la réglementation incendie
Sols et parois lavables, résistants aux chocs et aux produits détergents et
désinfectants
Poste de lavage des mains à proximité
Conteneurs mobiles distincts et clairement identifiés pour les déchets
d’activités de soins à risques infectieux et les déchets assimilables aux déchets
ménagers
Affichage des consignes et des protocoles internes
Le local d’entreposage centralisé :
Il s’agit du local où sont entreposés les conteneurs pleins avant enlèvement. Il est situé en
retrait des zones d’activités et à distance des fenêtres et des prises d’air ; et doit être facilement
accessible pour les véhicules de transport. Lorsque la configuration des bâtiments ne permet pas la
construction d’un tel local, l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux peut être
envisagé sur des aires grillagées extérieures respectant les prescriptions de l’arrêté relatif aux
modalités d’entreposage (cf. partie sur le réglementation).
Le protocole d’entretien du local d’entreposage centralisé et des conteneurs, ainsi que les
conditions générales et les équipements, sont les mêmes que ceux du local d’entreposage
intermédiaire.
3. durée d’entreposage et conditions particulières
Production de déchets d’activités de soins à risques inférieure ou égale à 5 kg par mois :
30

Lorsque la production de DASRI et assimilés ne dépasse pas 5 kg/mois, leur entreposage se
fait dans des emballages spécifiques (chap. 3), à l'écart des sources de chaleur.
Durée d'entreposage :
Les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés peuvent être entreposés
pendant une durée maximale déterminée en fonction de la production du site. Celui-ci est défini
comme un lieu, relevant d'une même personne juridique, non traversé par une voie publique, où sont
installées les activités génératrices des déchets.
L’élimination
3)
Comme nous l’avons vu précédemment, l'obligation d'élimination incombe au producteur des
satisfaire à cette obligation, le producteur peut confier l'élimination de ses déchets à
ouvert d'une convention écrite qui doit comporter un certain nombre de
entions obligatoires listées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 1999 (cf. partie réglementation). Si
production mensuelle des déchets est dépasse 5 kg, le producteur doit émettre un bordereau de suivi
de se des déchets au prestataire. Si la production est inférieur à 5 kg, le
déchets. Afin de
un prestataire de service, sous c
m
la
déchets lors de la remi
producteur émet un bon de prise en charge, précisant notamment la date d'enlèvement des déchets et
les coordonnées du collecteur. Dans ce cas, c'est au prestataire qui assure le regroupement des déchets
d'émettre le bordereau de suivi des déchets. Tous ces documents de suivi doivent accompagner les
31

déchets jusqu'à l'installation chargée de leur élimination finale. Les installations de regroupement
doivent être déclarées en préfecture.
Deux filières d'élimination peuvent être utilisées :
Le traitement par incinération. Il peut être pratiqué dans des incinérateurs internes aux
établissements hospitaliers ou dans les installations d'incinération des déchets ménagers et
assimilés qui doivent à ce titre respecter les prescriptions de l'arrêté du 23 août 1989 (JO du 8
novembre 1989).
Le traitement par désinfection préalable, permettant la remise des déchets traités au service
énagers et assimilés. Les appareils de désinfection
ites du service rendu et de se prononcer sur la possibilité d'accepter ou non
de collecte et d'élimination des déchets m
doivent être agréés. Les modalités d'acceptation en déchetterie des déchets d'activités de soins
à risques infectieux produits par les ménages et par les professionnels exerçant en libéral, sont
précisées dans une circulaire du 29 juin 2000. Il appartient notamment à la collectivité de
déterminer les lim
ces déchets et dans quelles conditions financières.
a. Les différentes filières d’élimination
Une filière comporte deux parties bien distinctes : la partie interne (de la production à
ment du service producteur) et la partie externe (au
l’enlève niveau des services techniques chargés de
la collecte des déchets à l’extérieur du site producteur).
Même s’il existe de nombreuses interactions entre les deux, il est important que la partie
externe soit le contraire.
a bon
organisée en fonction de la partie interne et non
L ne solution à la croisée des chemins : Chaque producteur de déchets de soins est conduit à
considérer le contexte spécifique auquel il est confronté (politique globale de l’établissement). Ainsi,
la réflexion stratégique qui conduira au choix de la filière d’élimination la plus appropriée repose sur
Les données quantitatives et qualitatives de production
ts économiques des différents scénarii possibles
Dans tous le rmettre de respecter les délais entre la
production des déchet ou désinfection :
une analyse multicritère fondée sur :
La réglementation et les normes
Les filières d’élimination existantes localement
Les contraintes structurelles et organisationnelles
Le contexte socio-politique local
Les résulta
s cas, la solution retenue devra pe
s d’activités de soins à risques infectieux et leur incinération
32

72 heures pour des pr
7 jours pour des prod
Une concentration en
oductions supérieures à 100 kgs/semaine
uctions comprises entre 5 kgs/mois et 100kgs/semaine
tre les différents acteurs :
Les professionnels de santé producteurs de déchets d’activités de soins à risques
infectieux (médecin, infirmière,…)
Le personnel des services logistiques et économiques
Les intervenants extérieurs à l’établissement
La cohérence e
Les gestionnaires et les services administratifs
Les prestataires de service
st recherchée et vérifiée entre :
Les critères de tri et les protocoles de soins pour en vérifier la compatibilité, le
r la qualité et la pérennité du tri.
pour éviter tout refus de prise en charge
exploitant de l’installation destinataire
Les conditionnements et le matériel de collecte de manière à réduire tout risque
tion inutile se répercutant sur l’ergonomie.
La qualité de l r :
pragmatisme, l’acceptabilité et par delà, garanti
Les critères de tri et les filières d’élimination
par le transporteur ou par l’
sanitaire et à éviter tout manipula
a gestion interne des déchets d’activités de soins à risques infectieux repose su
de lutte contre les
La réalisation d’une étude préalable de la production et des flux
e
a apportée au retour de
L’identification d’un référant « déchets » qui, interlocuteur de tous les intervenants
de la filière, travaille en étroite collaboration avec le Comité
infections nosocomiales (C.L.I.N), l’équipe d’hygiène hospitalière, le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.CT)
La formulation des protocoles et procédures retenus (tri, conditionnement, entreposag
intermédiaire, fréquence des enlèvements,…), intégrant la spécificité de certains
services le cas échéant
L’information et la formation systématique et itérative de tous les agents (formation
initiale, continue, d’accueil,…). Une attention particulière ser
l’information auprès des acteurs consernés.
33

34

b. Traitement par désinfection
L'incinération des déchets contaminés était obligatoire, conformément à l'article 88 du
Règlement Sanitaire Départemental Type du 9 août 1978. Toutefois à compter de la circulaire
ministérielle du 26 juillet 1991, d'autres procédés peuvent être utilisés.
Ces nouvelles technologies expérimentées sous l'égide du Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France, visent à assurer une désinfection des déchets hospitaliers, les amenant à un niveau
de contamination assimilable à celui des ordures ménagères (élimination par la filière classique des
ordures ménagères à l'exception du compostage).
Six appareils font aujourd'hui l'objet de circulaires de dérogation. Il s'agit de :
L'appareil STHEMOS : Proposé par la Société des Techniques d'Hygiène (STH), il a été validé par
circulaire du 26 juillet 1991. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une
décontamination grâce à la vapeur et à des micro-ondes. Après introduction automatique, les déchets
sont broyés (entraînés par une vis sans fin), humidifiés et chauffés par injection de vapeur à 150 C,
puis passent au travers de faisceaux de champs électromagnétiques alternatifs (2450 MHz) produits
par 6 générateurs de micro-ondes qui maintiennent la température à 100 C pendant 30 à 45 minutes.
Après quelques minutes de stockage dans une trémie tampon, les déchets sont évacués par une vis
d'extraction dans un conteneur (réduction de 80 % du volume initial). En fin de traitement, les déchets
se présentent sous la forme d'un granulat homogène normalement assimilable à des déchets ménagers
et pouvant être évacués comme tels.
La durée totale du cycle est de 45 à 60 minutes. La capacité nominale de l'appareil est de 250
kg par heure (varie avec la densité des déchets) et ses dimensions sont les suivantes : longueur 6 m -
largeur 2,5 m - hauteur 3,25 m . L'installation nécessite des branchements en eau et électricité.
Prix de l'appareil : de 2,1 à 2,5 MF H.T.
Commentaires :
les déchets admis dans cet appareil ne devront pas contenir de toxiques volatiles ;
l'industriel devra mettre en oeuvre, en complément des contrôles existants, un dispositif
visualisant et contrôlant les caractéristiques de la vapeur injectée,
Et formulant les souhaits suivants :
la mise au point d'indicateurs par exemple physico-chimiques intégrant les paramètres temps,
température et humidité, garantissant la fiabilité du procédé ;
35

étant donné l' du dispositif de traitement dans son état
actuel, le choix du mode d'élimination final devra tenir compte de la granulométrie des déchets
aspect visuel des déchets, tels qu'issus
traités.
L'appareil VIRHOPLAN : Proposé par la société Elipson's, il a été validé par circulaire du 15 juin
1992. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une décontamination par voie chimique
(liquide) et d'un compactage (à 50 tonnes). Les déchets broyés sont immergés dans un produit
désinfectant à large activité antimicrobienne (glutara
: produit Dialdanios) conforme aux nor
ldéhyde, formaldéhyde et isothiazolone en milieu
mes AFNOR (bactéricide, virucide, fongicide). A
e et une
alcoolique
l'issue de cette phase, les déchets sont compactés avec pour effet une réduction de volum
pénétration à coeur du produit désinfectant.
Le stockage des déchets désinfectés est obligatoire pendant au minimum 48 heures afin que le
produit désinfectant poursuive son action. La capacité de l'appareil est de 250 kg par heure et ses
dimensions sont les suivantes : longueur 3 m - largeur 1,2 m - hauteur 2,2 m. L'installation nécessite
des branchements en eau, en électricité et un raccordement au réseau d'assainissement.
Prix de l'appareil : de 1,6 à 2,1 MF H.T.
Commentaires :
Le VIRHOPLAN est la synthèse de 3 techniques en une seule :
c'est un broyeur efficace (granulométrie très fine) ;
et plus à la demande, au lieu des 4 tonnes habituellement retenues).
dans une enceinte étanche et en dépression par rapport au
plantée la machine. Il traite les liquides résiduels éventuels avant leur rejet au réseau
L'appareil GABLER GDA 103
un appareil de désinfection de qualité (assure une désinfection des déchets hospitaliers les
amenant à un niveau de contamination inférieur à celui des déchets domestiques) ;
un compacteur de haute gamme (pression de compactage de 25 à 50 tonnes suivant le modèle
De plus, il désinfecte les déchets solides
local où est im
d'assainissement.
S : Proposé par la société Etude Conception Réalisation (ECR), il a
été validé par circulaire du 18 août 1992. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une
désinfection therm
enveloppe de chauffage). air au niveau de la trémie,
les déchets sont broyés puis sont transportés vers une chambre de désinfection par une vis sans fin qui
passe par un compartiment de chauffage à parois remplies d'huile calo porteuse dans lequel les déchets
ique (température obtenue par circulation d'huile calo porteuse à 160 C dans une
Introduits automatiquement avec aspiration de l'
36

son
transfor
la vis. érature reste de l'ordre de 100 °C durant les 35 à 40 minutes que dure le cycle. Les
échets sont ensuite évacués vers un conteneur par une autre vis sans fin également dotée d'une
nveloppe de chauffage par circulation d'huile.
t humidifiés par de l'eau préchauffée. Dans ce compartiment à parois très chaudes, l'eau est
mée en vapeur et la température des déchets atteint 100 °C au plus tard à la fin du parcours de
La temp
d
e
La durée totale du cycle est de 35 à 40 minutes. La capacité de l'appareil est de 250 kg par
heure et ses dimensions sont les suivantes : longueur 5,5 m - largeur 1,7 m - hauteur 3,4 m.
L'installation nécessite des branchements en eau et en électricité.
L'appareil STERIL'MAX 100 : Proposé par la Société Nouvelle des Etablissements Joseph Lagarde,
il a été validé par circulaire du 15 juillet 1994. Le principe repose sur une phase de broyage suivie
'une d
ars. Après retour à la pression atmosphérique, il y a refroidissement de l'enceinte, évacuation des
t et ouverture des portes. Une vis évacue les déchets et les
mène dans la trémie d'un second broyeur qui améliore la granulométrie et réduit le volume.
du cycle est de 45 minutes. La capacité de l'installation est de 100 kg par heure et ses
m - largeur 3,7 m -
hau un
rac
L'appa
d ésinfection thermique. Après introduction automatique des déchets et fermeture des portes
d'entrée et de sortie, les déchets sont broyés et le cycle de désinfection commence par une mise sous
vide de toute l'enceinte. Puis les déchets subissent une alternance d'injection de vapeur et de mise sous
vide permettant l'obtention d'une température de 135 C pendant 10 minutes, la pression étant de 3.128
b
condensas et des eaux de refroidissemen
a
La durée
dimensions sont les suivantes : longueur 5,5
teur 3,75 m. L'installation nécessite des branchements en eau, vapeur et électricité et
cordement au réseau d'assainissement.
reil LAJTOS TDS 1000 : Proposé par les Etablissements Lajtos, il a été validé par circulaire
e désinfection de toute l'enceinte commence par une élévation de température qui est
poursuivie jusqu'à l'obtention de 138 C. Ce palier est maintenu pendant 10 minutes ; la pression
ugmente avec la température jusqu'à 3.8 bars, seuil auquel elle est régulée. Après refroidissement de
du 15 juillet 1994. Le principe repose sur une phase de broyage, suivie d'une désinfection thermique.
Après introduction manuelle des déchets, fermeture des portes d'entrée et de sortie, les déchets sont
broyés. Le cycle d
a
l'enceinte, évacuation des condensas et des eaux de refroidissement, un bac de réception est présenté
manuellement. L'ouverture des portes permet l'évacuation des déchets.
La durée du cycle est de 45 à 60 minutes. La capacité de l'installation est de 100 kg par heure
et ses dimensions sont les suivantes : longueur 1,8 m - largeur 1,5 m - hauteur 5 m. L'appareil est mis
en place sur deux niveaux, le premier où a lieu l'introduction manuelle des déchets, le second leur
37

sortie. L'installation nécessite des branchements en eau, vapeur et électricité et un raccordement au
réseau d'assainissement.
L'appareil ECOSTERYL 250 : Proposé par les établissements Perin Frères, il a été validé par
ée ; les déchets sont broyés. Une vis
ssure leur transfert vers le système de chauffage par micro-ondes (12 générateurs) puis vers la trémie
e maintien en température entre 98 et 106 C où les déchets restent pendant environ une heure.
circulaire du 15 juillet 1994. Le principe repose sur une phase de broyage suivie d'une désinfection
thermique. Après introduction automatique des déchets avec mise en dépression de la trémie,
aspersion d'un produit désinfectant et fermeture de la porte d'entr
a
d
Les déchets sont ensuite repris en bas de la trémie par une autre vis, refroidis et évacués vers
un sac se trouvant dans un conteneur.
La capacité de l'installation est de 250 kg par heure et ses dimensions sont les suivantes :
longueur 7 m - largeur 4,5 m - hauteur 4,2 m. L'installation nécessite des branchements en eau,
électricité et un raccordement au réseau d'assainissement.
Bilan :
Il ressort qu'en général, les procédés de désinfection sont attractifs, tout particulièrement pour
les installations sur les sites des hôpitaux, donc dans des tonnages plus faibles. Deux raisons
principales à cela :
les hôpitaux ne sont plus alors producteurs de déchets à risques car ces derniers sont
désinfectés et assimilables à des déchets ménagers ;
les coûts globaux ne sont pas alourdis par des coûts de transport de déchets contaminés, ces
derniers étant traités sur leur lieu d
e production.
ar contre, ces procédés sont en général moins intéressants pour des schémas territoriaux car les coûts
e traitement (qui évoluent entre 1100 et 1400 francs par tonne pour 3500 tonnes par an), sont à
és par la filière classique des
P
d
affecter également d'un coût de transport pour tout ou pour une partie des déchets spécifiques.
En conclusion, on peut dire que le prétraitement des déchets d'activité de soins à risques réalisé par ces
appareils avant leur élimination finale (U.I.O.M. ou mise en décharge) pose 2 types de problèmes,
économique et organisationnel :
le coût d'investissement et de fonctionnement des appareils de désinfection validés est
actuellement relativement élevé pour un établissement de soins. Toutefois, les déchets
résultants seront transportés à moindre frais parce qu'élimin
ordures ménagères, à l'exception du compostage. Ce prétraitement devra être économiquement
comparé à une collecte sélective par des entreprises spécialisées puis à l'incinération dans une
usine d'incinération d'ordures ménagères ou dans une unité spécifique.
38

Par ailleurs, l'insertion d'un appareil de désinfection dans une filière d'élimination des déchets
d'activités de soins a un impact très net en amont et nécessite une réorganisation du travail. De
plus, ces appareils nécessitent un contrôle soigneux, en terme de sécurité et de protection de
l'environnement.
c. Traitement par incinération dans des fours spécifiques.
C'est le premier procédé qui a été autorisé à partir du 8 août 1978 (Circulaire ministérielle
relative au Règlement Sanitaire Départemental Type). Aujourd'hui, ces fours doivent être conformes
aux spécifications de l'Arrêté ministériel du 25 janvier 1991 relatif aux usines d'incinération des
chets
vier 1991.
Princip
dé hospitaliers contaminés dans des usines d'incinération de résidus urbains. Il s'agit alors d'une
installation classée qui doit être soumise à autorisation, conformément à la nomenclature 322B4 des
installations classées.
Quant aux installations existantes ayant déjà fait l'objet d'une autorisation administrative, elles
devront être également mises en conformité dans le cadre d'un échéancier décrit dans l'Arrêté
ministériel du 25 jan
e :
exister. as d'unité de petite taille, dérivent des petits
L'incinérateur idéal considéré sous les aspects performances et prix ne semble pas encore
Les techniques proposées, notamment dans le c
incinérateurs brûlant des déchets industriels banals (cartons, bois, plastiques, ...). La plupart des
constructeurs proposent des systèmes à combustion pyrolytique, ce qui correspond en réalité à une
combustion étagée.
ETAPE 1 réalisée dans une chambre primaire ou chambre de combustion. L'incinération du déchet est
conduite en phase réductrice (ou défaut d'air), la température moyenne des fumées est maintenue aux
environs de 700-750 °C.
pour pe
nerte (cendres) par une
combustion en léger excès d'air.
Dans la chambre primaire il est nécessaire de distribuer progressivement l'air de combustion
rmettre :
de ne pas obtenir une température de flamme élevée dans la première moitié de la chambre
(sinon scories adhérentes ou réfractaires, problème de fusion du verre) car le P.C.I. initial du
déchet peut être très élevé (4000-7000 kcal/kg).
épuiser, dans la deuxième moitié, le carbone résiduel dans la fraction i
39

ETAPE 2 réalisée dans la chambre secondaire ou chambre de post combustion. Les fumées issues de la
e sont brûlées en phase oxydante avec notamment :
transformation du
chambr
CO en CO2
cracking des molécules à radicaux du type C-M ou équivalent avec production de CO2.
ette deuxième phase est généralement réalisée en présence d'une flamme (brûleur) ; en excès d'air et
sous forte turbulence ; à densité énergétique volum
Dans ce type de conduite, moyennant un temps de séjour voisin de 90 minutes accompagné
un bra
C
ique élevée.
d' ssage suffisant, le taux d'imbrûlés carbone (mesuré à 500 C) réalisable, est voisin de 2 %. Ce
type d'installation traite uniquement des déchets d'activités de soins à risques. Le four spécifique est
soit installé à côté d'une usine d'incinération d'ordures ménagères, auquel cas le dispositif de traitement
des fumées est commun, soit installé de manière indépendante avec son propre traitement des fumées.
Commentaires :
raison des coûts de traitements alourdis en valeur relative par les réglementations récentes. D'où la
nécessité d'opérer en ce cas dans le cadre de schémas territoriaux (et non avec de petites installation
sur site) comme le préc
Ce type de procédé n'est pas adapté pour les quantités inférieures à 3500 tonnes par an en
onise la Circulaire ministérielle du 21 septembre 1990.
our d'éventuels schémas territoriaux, les coûts de traitement évoluent entre 850 francs H.T. par tonne
et 1900 francs H.T. par tonne (3500t/an).
P
(14700t/an)
d. Traitement par incinération dans des fours d'incinération des résidus urbains.(Fours mixtes O.M./D.H.).
Depuis le 23 août 1989, les usines d'incinération de résidus urbains peuvent recevoir des
déchets hospitaliers contaminés, moyennant certaines dispositions : en particulier, un quota maximum
de 10 % de déchets contaminés et une mise en conformité à l'Arrêté ministériel du 25 janvier 1991.
ent.
Princip
Cette solution présente l'avantage d'une élimination de bonne qualité liée à une maîtrise plus grande
des conditions d'exploitation dans des usines centrales de traitem
e :
Les déchets hospitaliers conditionnés sur les lie ux de production en emballages spécialement
ada
et ferm heures en ce
ptés, sont acheminés jusqu'à l'usine d'incinération. Ils sont alors réceptionnés sur une aire couverte
ée, indépendante et rigoureusement propre. Ils ne doivent pas rester plus de 24
40

li
monte-charge spécifique, puis par un basculeur de type benne à ordure.
Dans le four, les déchets hospitaliers sont alors incinérés av
eu. Ils sont ensuite, depuis le hall de réception, amenés jusqu'à la trémie d'alimentation du four par un
ec les déchets ménagers, dans les mêmes
con tions réglementaires, entre autre à 850 C pendant au moins 2
sec
premier, dans lequel ils sont lavés et
t d'être pris par le collecteur et remis en circulation dans les établissements
ditions, conformément aux disposi
ondes.
Une fois vidés, les récipients (containers plastique, voire chariots de transport de cartons, etc)
regagnent par le monte-charge un deuxième hall, distinct du
désinfectés avan
hospitaliers.
Commentaires :
On constate que cette solution est d'autant moins onéreuse que l'on se rapproche du quota de
10 % autorisé par la réglementation. En particulier, on peut noter que le coût de traitement est de
ordre de 800 francs H.T. par tonne, pour un schéma de 3500 tonnes par an, sur un four d'incinération
res de 5 tonnes par heure.
ment faible (pour une installation bien adaptée),
mais aussi parce qu'elle peut permettre de solutionner rapidement un problème de déchets hospitaliers
sur une installation existante classée.
(Remarque : il faut ajouter les coûts relatifs au transport des déchets à risques).
l'
d'ordures ménagè
Par contre, l'investissement d'adaptation de l'U.I.O.M. à l'incinération des déchets hospitaliers
devient lourd pour les tonnages sensiblement inférieurs au quota de 10 % ; en effet, dans le même
schéma que ci-dessus, une quantité de 20 tonnes par an seulement remonterait le surcoût de traitement
de 800 à 6800 francs H.T. par tonne de déchets hospitaliers.
Mais dans le cadre des schémas territoriaux, cette solution est cependant très intéressante, non
seulement en raison de son coût de traitement relative
e. Traitement par incinération In Situ.
Cette solution d'élimination est plutôt tolérée actuellement car la majorité des incinérateurs in
situ encore en activité n'est pas autorisée.
L'utilisation de ces dispositifs installés sur l
l'avantage d'une grande autonomie de fonctionnement, sans transport à l'extérieur. Cependant, ces
dispositifs qui, lors de leur installation, ont constitué un progrès dans l'élimination des déchets
contaminés sont aujourd'hui, pour la plupart, très anciens et ne fonctionnent plus de façon satisfaisante
es sites des établissements de soins présente
41

(technologie limitée, absence de traitement des fumées, fonctionnement discontinu, entretien
irrégulier).
C'est pourquoi, depuis 1991, les incinérateurs in situ sont progressivement arrêtés. Quelques
uns seront
pour répondre à des spécificités locales.
maintenus et leur situation régularisée alors que certains seront éventuellement mis en place
42

Conclusion
43

ANNEXE :
Décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activité de soins à riques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MESP9722279D
Le premier ministre :
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de léquipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les artibles L.1 et L.48 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-40, L.2223-41 et L.2224-14 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre IV du livre II ; Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux notamment des déchets dangereux ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedes 5 avril et 6 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre Ier du livre Ier du code la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre V-III ainsi rédigé :
Chapitre V-III Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilé et aux pièces anatomiques
Section 1 Elimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés
Art. R. 44-1. - Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des acticités de diagnostic, de suici et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente cession ceux qui : 1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes : a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec
un produit biologique ; b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aiséments identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les décehts issus des activités d'enseignements, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les
caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Art. R. 44-2. - I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R.44-1 est tenu de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement
44

industriel, lorsque ces déc ns un tel établissement ; b) A la personne morale pour le com rofessionnel de santé exerce son activité
productrice de déchets ; c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
ces opérations. Un arrêté conjoint des min l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
III. - Les personnes mentionnées au I ci-de 'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint
des ministres chargé de la santé et de l'envi u conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-3. tre, dès leur production, séparés des autres déchets.
emballages doivent ivement avant leur enlèvemen ans les cas
Le conditionnement, le marqu ivités de soins et assimilés sont soum e au transport des matières dangereu uillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint d chargés de la santé, de l'environnement et de
l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-5. - Les modalités d'entrepo s de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres char t de l'environnement, pris après avis Conseil
Art. R. 44-6. - L ar des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les
groupement de communes dans les conditions définies à l'article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraite nt ne peuvent cependant être compostés.
oeuvre é,
Ar u de
activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1
hets sont produits dapte de laquelle un p
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être crite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en medure d'effectuer
istres chargés de la santé et de
ssus doivent, à chaque étape de l
ronnement après avis d
- Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.44-1 doivent ê
Art. R. 44-4. - Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballagesà usage unique. Ces pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définit
t. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf ddéfinis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
age, l'étiquetage et le transport des déchets d'actis aux dispositions réglementaire prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relativ
ses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 j
es ministres
sage des déchets d'activités d'activité
gés de la santé esupérieur d'hygiène publique de France.
es déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soir pré-traités p
me Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agrées par arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en
des appareils de définfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santde l'environnement et de l'industrie, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section 2 Elimination des pièces anatomiques
t. R. 44-7. - Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes o
membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, receuillis à l'occasion des activités de soins ou des
Art. R. 44-8. - Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
Art. R. 44-9. - L
Loi
45

Sanctions
OI 75-633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LAL RECUPERATION DES MATERIAUX, COMPLETEE PAR LA LOI 88-1261 DU 30 DECEMBRE 1988
l'une ou l i aura :
dest les modalités d'élimination des déchets caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination
qu'elle produit, remet ou p e 8, ou fournit des informations inexactes.
8. Mis obstacle à l' article
E
En r la r
véhic dant pas cinq ans.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamn ion intégrale ou par extraits de sa décision et écentuellement la diffusion d'un mess le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous peines
prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité
Le n de la nature peuvent exercer e les infractions prévues au
présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles cont pour objet de
Article 24
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000.00 F à 120 000.00 F ou de 'autre de ces deux peines seulement toute personne qu
1. Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni ds informations inexactes.
2. Méconnu les prescriptions de l'article 6. 3. Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la
ination et
des déchets rend en charge, en application de l'artibl
4. Remis ou fait remettre des déchets à toute autre que l'exploitant d'une installation agrée, en conséquence des artibles
9 et 10. 5. Elimine des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10. 6. Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prestations concernant les
caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financiéres de prise en charge des déchets ou matériaux et les
procédés de traitement mise en oeuvre, fixées en application des articles 9. 10. 20. et 21.
7. Méconnu les prescriptions des articles 15. 16. et 17. accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'
26. 9. Exporte ou fait exporter, importe ou fait importer, fait transiter des déchets sans en avoir informé, dans les
conditions prévues en application de l'article 23-1, les Etas d'expédition, de transit ou de destination ou malgré
l'opposition d'un de ces Etats.
n cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes
à la loi. cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonne
fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité l'éliminateuou de récupérateur.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un ule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excé
é, la publicatage, dont il fixe les termes, informant
puissent excéder le montant maximun de l'amende encourue. s associations agréées en application de l'article 40 de la loi 76-926 du 10 juillet 1976 relative à la protectio
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concern
défendre.
46

ANNEXE :
47

48

49