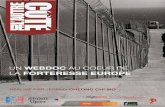Rapport de Stage de fin d’´etudes E.N.S.T.A France T´el...
Transcript of Rapport de Stage de fin d’´etudes E.N.S.T.A France T´el...
Rapport deStage de fin d’´etudes
E.N.S.T.AFrance T´el´ecomSara Jane LUDOVICY(sara [email protected])28 aoˆut 2006
Table des mati`eres
1 Intro duction3
2 Pr´esentationde France T´el´ecom 42.1 FranceT´el´ecom . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.2 RO&SI . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.3 DDSI .. .. .. .. . .. .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.4 SIFAC .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.5 DO IPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 62.6 DPPROF . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Pr´esentation du pro jet et de l’´equipe MACSIM83.1 Lesapplications deMACSIM .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . 93.2 Les rˆolesde la MOEMACSIM .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 113.3 Les autresacteurs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 12
3.3.1 La maˆıtrised’ouvrageSCR .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . 123.3.2 L’exploitant DOSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 123.3.3 L’Assistance Client`ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12
4 ContributionauprojetMACSIM 134.1 Le projet IHM d’exploitation et d’assistance client`ele . . . . . . . . . . . . 13
4.1.1 Les fonctionnalit´es de l’IHM pour CBPUB et PARM . .. .. .. . 134.1.2 Le projet et son d´eroulement .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 164.2 La gestion documentaire et la gestion de configuration logicielle pour leprojet MACSIM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 224.2.1 La gestion documentaire . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 224.2.2 La gestion de configuration logicielle .. .. .. .. .. .. .. .. . 23 5 Tˆaches r´ealis´ees 265.1 l’IHM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 265.2 La gestion documentaire et logicielle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 265.2.1 La gestion documentaire . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 265.2.2 La gestion de configuration logicielle .. .. .. .. .. .. .. .. . 275.3 Le transfert des comp´etences .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27I
Entreprise d’accueilFrance Telecom/SIFAC ArcueilLieu du stage SIFAC,67 avenueLenine, 94112 Arceuil CedexTuteur entreprise chef de projet Christophe LOIR
[email protected] :01 55 88 19 81
Ecole Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees(E.N.S.T.A.)32 Boulevard Victor,75739 Paris cedex 15tel :01 45 52 54 01
TuteurENSTA Bruno [email protected]
Dur´ee 6 mois,du 27 f´ evrier jusqu’au 28 ao ˆut 2006Sujet Gestion du projet « IHM d’exploitation et d’assistance clien-
t`ele » et mise en oeuvre dans le cadre d’un pro jet mon´etiqueau sein de la division du syst`eme d’information de FranceT´el´ecom III
Resume
Monstage de fin d’´etudesa d´ebutefin fevrier pour une p´eriode de six mois jusque fin ao ˆut 2006.J’ai int´egr´e l’´equip e de maˆıtrise d’o euvre MACSIM au sein du SIFAC (Syst`eme d’Information etde FACturation) `a Arcueil.Deux missions m’ont´et´e confi´ees au sein de l’´
equip e MACSIM. La premi`ere est l’instruction etla r´ealisation du projet IHM pour deux applications ma jeures de MACSIM. L’autre mission estla mise en oeuvre de la gestion do cumentaire (GED) et de la gestion de configuration logicielle(GCL) pour les applications de la plate-forme MACSIM.Pendant ces 6 mois, j’ai effectu´e les tˆaches suivantes pour le pro jet IHM:
– la mont´eeen comp´etencesfonctionnelles surles applications de la plate-forme MACSIM,– l’´etude de la demande de refonte des IHMs,– l’analyse de l’existant,– la r´edaction de la « Proposition de Solution » puis sa soumission `a la MOA,
– la conception et le d´evelopp ement d’une fonctionnalit´e de b out en bout en utilisant desframeworks,– le transfert des comp´etences sur le projet IHM.Pour la gestion documentaire, j’ai fait le travail suivant :– analyse l’existant,– d´efinition d’un plan de classement pour les documents,– identification des utilisateurs et d´efinir les droits d’acc`es aux diff´erents types de document,
– utilisation de l’outil WebDOC,– cr´eation des groupes d’utilsateurs WebDOC,– mise en place du plan de classement sous WebDOC en ajoutant les droits d’acc`
es auxdiff´erents utilsateurs.Pour la gestion de configuration logicielle :– analyse de l’existant,– identification tous les objets manipul´es : sources, scripts, binaires, etc,– identification de toutes les versions de chaque application du projet MACSIM,– ´etude des diff´erents ´el´ements utilis´es avec PVCS Dimensions : demande de modification,fiche d’anomalie, baseline, design part,– ´etude des correspondances entre les ´el´ements de PVCS Dimensions et ceux du projetMACSIM,– d´efinition de la strat´egie de migration,– d´efinition des processus d’int´egration des livrables d´evelopp´es en externe,– personnalisation de l’outil PVCS Dimensions au projet MACSIM et aux processus d´efinis,– migration les sources vers l’outil,– r´edaction du « Mode Op´eratoire de PVCS Dimensions ».
Remerciements
Jevoudrais toutparticuli`erement remercier Christophe Loir,chefde pro jet MOEMACSIM, p our m’avoir prop os´e ce stage au sein de son´equip e chez France T´elecom.Il a su me consacrer une partie de son temps pour me guider et me former malgr´esonemploi du temps charg´e.Je voudrais ´egalement remercier Kader Benab deslem p our son expertise fonctionnelle
sur les applications MACSIM, Est´eban Fernandez p our son exp ertise sur l’architecturetechnique, Jean-Claude Bana pour avoir partag´e ses connaissances sur les IHM et lefonctionnement g´en´eral au sein de France T´el´ecom, Patrice Folie pour ses pr´ecieusesconnaissances dans les bases de donn´ees ORACLE, Elise Gibirila pour ses conseils sur laconduite de pro jet. Et encore un grand merci `a tous pour la bonne humeur et la bonneentente qui a r´egn´e pendant ces 6 mois.Merci aussi `a l’´equipe de pro duction `a Lyon et `a l’Assistance Client`
ele de Nancy, R´egisD´eldicque de la cellule Clara `a Orl´eans S´ebastien Meslin, ing´enieurqualit´e et pour finirJean-Marie Leconte,DBA Oracle`a Grenoble.1
Chapitre1
Intro duction
Mon stage de fin d’´etudes a d´ebut´e fin f´evrier pour une p´erio de de six mois jusqu’`afin ao ˆut 2006. J’ai int´egr´e l’´equipe de maˆıtrise d’oeuvre MACSIM au sein du SIFAC(Syst`eme d’Information et de FACturation) `a Arcueil.
Lors de mon entretien de stage, j’ai exprim´e le souhait de participer `a un pro jetinformatique en cˆotoyant chaque co eur de m´etier impliqu´e dans sa mise en oeuvre.Jesouhaitais `a la fois faire de la gestion de pro jet et un travail plus technique de conceptionet de d´evelopp ement.Deux missions m’ont ´et´e confi´ees au sein de l’´equip e MACSIM. La premi`
ere est l’ins-truction et la r´ealisation du projet IHM pour deux applications ma jeures de MACSIM.L’autre mission est la mise en o euvre de la gestion do cumentaire (GED) et de la gestionde configuration logicielle (GCL) pour les applications de la plate-forme MACSIM.
Ce stage chez France T´el´ecom est une grande opp ortunit´e pour d´ecouvrir le mondedu travail au sein d’une grande entreprise fran¸caise des T´el´ecommunications. Les pro jetsy sont ambitieux et respectent les normes et qualit´es de services requises par FranceT´el´ecom.CesnormesetexigencesFranceT´el´ecom semblentparfoisˆetrelourdes`amettreen place, mais contribuent sur le moyen et long terme `a optimiser les performances dechaque ´equipe et ainsi `a satisfaire ´egalement les clients du Sifac.3
Chapitre2
Pr´esentation de France T´elecom
J’ai int´egr´e l’´equipe de la maˆıtrise d’oeuvre pour le pro jet MACSIM (Moyen d’Acc`esetde Contrˆole au Syst`eme Informatique de la Mon´etique).Ce pro jet se situe dans lahierarchie FT,au niveauRO&SI/ DDSI / SIFAC / DOIPS / DP PROF.
Dans les paragraphes suivants, les diff´erentes structures hi´erarchiques dont je d´ep ends
sont pr´esent´ees.2.1 France T´el´ecomFrance T´el´ecom, l’op´erateur de t´el´ecommunications historique fran¸cais, a pour ambi-tiondedevenirlefournisseurdeservicesdet´el´ecomsder´ef´erencedanstouslespayso`uilestpr´esent.Au31 d´ecembre2005,FranceT´el´ecomservaitplusde145 millionsdeclientsr´epartis sur les cinq continents dans 220 pays ou territoires.En juin 2005, le programme NExt (Nouvelle Exp´erience des T´el´ecommunications) estlanc´e par le pr´esident de France T´el´ecom, Didier Lombard. NExT est un programmede transformation sur trois ans qui confirme les orientations de France T´el´ecom vers lesnouveaux services de t´el´ecom. Ce plan comporte plusieurs volets : commercial, financieret organisationnel. En effet, depuis peu une refonte de l’organisation intragroupe a eulieu afin de mieux servir sa vocation d’op´erateur int´egr´e.4
Depuis le 1er Juin 2006, Orange est devenue la marque unique des pro duits et servicesde France T´elecom,mis `a part le fixe en France, en Pologne, en Jordanie et dans les paysafricains. Wanado o,MaLigne TV ou encore Equant ont donc disparu pour adopter lanouvelle marque « Orange ». Ce rebranding est tout `a fait dans la politique actuelle de
convergence.2.2 RO&SIFrance T´el´ecom comprend aujourd’hui huitgrandes divisions dont la RO&SI (R´
e-seaux, Op´erateurs et Syst`emes d’Information).Cette division d´efinit les politiques ded´evelopp ement et assure le pilotage des r´eseaux de France T´el´ecom, toutes technologiesconfondues. Elle pilote le d´evelopp ement et la maintenance du Syst`eme d’Informationdu Groupe. Cette division est ´egalement en charge de la commercialisation des offres et
des services aux op´erateurs tiers.2.3 DDSISous la division RO&SI se positionne la DDSI (Direction du D´eveloppement du Sys-
t`eme d’Information). Cette direction r´eunit les activit´esdu SIFAC,SI Client,SIRES etSI Support. La DDSI a un rˆole f´ed´erateur dans la construction d’une organisation unifi´eedu d´evelopppement SI du groupe.Les ambitions de la DDSI pour 2006 sont bas´ees sur trois axes majeurs :1. d´elivrer dans les d´elais, avec la qualit´e service requise et dans le respect des coˆutspr´evus2. accroitre les performances (budget, productivit´e, capacit´e d’adaptation avec desprojets cycle court)3. acc´el´erer la transformation au service des objectifs du Groupe (internationalisation,renouvellement des comp´etences, etc ...)5
2.4 SIFAC
Le SIFAC (Systeme d’Information et Facturation) a pour mission d’assister les maˆı-trises d’ouvrage, de pr´eparer les briques g´eneriques contribuant `a la convergence des SIpour la totalit´e du Group e et d’assurer la maˆıtrise d’o euvre du SI. L’activit´edu SIFACconcerne les 145 millions de clients du group e FT,en liaisonetroite avec les servicesde communication des diff´erentes divisions.Les clients directs du SIFAC sontinternesau groupe FT. Le SIFAC est comp os´ed’un ensemble de directionsop´erationnelles (DO)dont faitpartie la DO IPS.Sur la figure 2.1,vous trouverez l’ensemble des directionsop´erationnelles actives au Sifac.
Fig. 2.1 – Le Sifac et ses diff´erentes DO.2.5 DO IPSLa direction op´erationnelle Infranet & Paiement Solutions a pour mission d’assurerla maˆıtrise d’oeuvre des packages mettant en oeuvre le progiciel Infranet, ainsi que lamaˆıtrise d’oeuvre des applications de paiement, encaissement et recouvrement. Cettedirection op´erationnelle (DO) est compos´ee d’un ensemble de directions de projet dontfait partie la DP PROF.6
2.6 DP PROF
La direction de pro jet PROF est sous la responsabilit´ede Maguy Tyssandier.Cettedirection de pro jet a sous sa supervision les pro jets dans les domaines suivants:
– Paiement mon´etique (inclus le pro jet MACSIM),– Recouvrement Contentieux,– Facturation comptabilite.
Les principales resp onsabilit´es de la direction de pro jet sont:– R´eussir les pro jets qui lui sont confi´eset tenir les engagements pris lors des jalons,– Participer `a la relation client MOA en co ordination avec le DO et les autres acteursSIFAC,– Maintenir les applications, am´eliorer et atteindre les objectifs de qualit´
ede service,– Assurer le m ˆurissement des applications de sa resp onsabilit´e,– Assurerla gestiondes comp´etences surun domainefonctionnelet technique,– G´erer le plan de charge de la DP, assurer le resp ect des exigences de Sarbanes
Oxley1 (SOX) et d´ecliner les objectifs de la DO sur ses applications et ses pro jets– D´ecliner les ob jectifs de la DO sur chacune de ses applications et chacun de sespro jets,– Fournir aux clients les ´el´ements permettant le calcul du ROI sur ses applications
et s’assurer du calcul du ROI2 avant le lancement du pro jet,– Contribuer`al’accroissementdescomp´etences dansle domaine del’interconnexion.
1La loi Sarbanes-Oxley implique que les Pr´esidents des entreprises cot´ees aux Etats-Unis certifientleurs comptes aupr`es de la Securities and Exchanges Commission (SEC) l’organisme de r´egulation desmarch´es financiers US. France T´el´ecom est cot´e au New York Stock Exchange. 2Return on Investment7
Chapitre3
Pr´esentation du pro jet et del’´equip e MACSIM
MACSIM(Moyen d’Acc`es et de Contrˆole au Syst`emeInformatique de la Mon´etique)est une plate-forme quirecouvre essentiellementdeux domaines : celui des Publiservicesetceluide la Vente`a Distance. Ces services sontfournis par le biais d’un ensemble deplusieurs applications.Dans le contexte MACSIM, la mon´etique correspond aux paiements avec une carte
bancaire soit dans un automate, soit chez un commer¸cant via un terminal de paiement;ou encore sur internet.8
3.1 Lesapplications de MACSIM
La plate-forme MACSIM regroup e un ensemble de sept applications:
ARTE Le syst` eme ARTE realise l’interface entre le r´eseau FT de pu-bliphonie et diff´erents serveurs MACSIM.Ilest routeurentre lapubliphonie et les applications MACSIM
CBPUB Service depaiementdest´ elecommunications par carte bancairedans les publiphones(cabines t´elephoniques).Ce service permet`a la client`ele d’obtenir des communications t´elephoniques `a partirdes publiphones.
PARM Gestionnairede T´ elepaiement de MACSIM. C’est l’interface entrele monde bancaire et les diff´erentes filli`eres de paiement (lesautresapplications de MACSIM).C’est le gestionnaire des transactionsmon´etiques (interface entre la plupart des applications MACSIM
etlemondebancaire).OPERA OPERA est aussi appel´e syst`eme de reconciliation SSPP:sys-
t`eme s´ecuris´e de paiement dans les publiphones. OPERA permetle paiement via un publiphone de biens tels que le rechargementdecompte mobilepr´e-pay´e,ce rechargement se r´ealisant via un
serveurvocalcommer¸cant.SERMON Service de paiement des t´el´ecommunications par Porte Monnaie
Electronique (PME) MONEO dans les publiphones (cabines t´ele-phoniques). Ce service permet `a la client`ele d’obtenir des commu-
nicationst´el´ephoniques`apartirdespubliphones.MORE Service de rechargement du Porte Monnaie Electronique (PME)
MONEO dans les publi- phones (cabines t´el´ephoniques). Ce servicepermet `a la client`ele `a partir des publiphones de cr´editer d’une
mani`ere s´ecuris´ee sur le PME une somme d´etermin´ee.FORMAT FORMAT est une plate-forme e-paiement qui permet aux com-mer¸cants abonn´es de faire du paiement en Vente `a Distance. Lecommer¸cant peut acc´eder `a ces services `a partir d’une interfaceHTML s’il dispose d’un ordinateur ou `a partir d’une interfaceWAP s’il dispose d’un GSM compatible WAP. Ces services sontaussi accessibles en mode automatique si le commer¸cant disposed’un serveur WEB, sur la base d’un protocole HTTP propri´etairede FORMAT. Passerelle pour le paiement CB d’achat en VAD viainternet/intranet.Les figures 3.1 et 3.2 pr´esentent la plate-forme MACSIM dans le domaine des Publi-services et dans le domaine de la Vente `a distance.9
Fig.3.1 – Sch´ema de la plate-forme MACSIM dans le domaine des Publiservices
Fig.3.2 – Sch´ema de la plate-forme MACSIM dans le domaine des Ventes `a distance10
3.2 Lesrˆoles de la MOE MACSIM
L’´equip e MACSIM (la maˆıtrise d’o euvre MACSIM) est constitu´ee de huit personnesayant des profils divers:un chefde pro jet,une assistante `a la gestion de pro jet,desexp erts fonctionnels, un architecte technique, des concepteurs/d´evelopp eurs et une p er-sonne charg´ee du supp ort et de la maintenance.
Les rˆoles de la MOE MACSIM sont les suivants:– R´ealiser les applications nouvelles ou les´evolutions des applications existantes
selon les princip es en vigueur `a la DDSI, conform´ement aux demandes´emises parla MOA et aux engagements de co ˆuts et de d´elais,
– R´ealiser les recettes etlesint´egrations applicatives p our les parties sous sa resp on-sabilit´e et participer aux tests transverses avec les interlo cuteurs techniques desentit´es tierces, apr`es accord de la MOA,
– Particip er `a la mise en place pilote des nouveaux services,– Assurer,surdemandedela MOA,la d´efinition et la fourniture aux exploitants
des ´evolutions du param´etrage, destin´ees `a faire´evoluer le fonctionnement desapplications,– Assurer lagestion des incidents avec lesexploitants,
les industriels,ainsique lesinterlo cuteurs techniques des entit´es tierces (commer¸cants, banques, ...),
– G´erer les configurationslogicielles,lesparam´etrages ainsique les r´eferentiels et lesdocuments asso ci´es,– Fournir aux exploitants les ´el´ements n´ec´essaires (do cuments d’installation,
d’ex-ploitation,de soutien,...),– Assurer la mise en place d’un soutien technique et fonctionnel pour la MOA et
l’exploitant,– Assurer`ala MOAquelesmoyens,lescomp´etencesetlesressourcessontmis`a
disp osition. 11
3.3 Lesautres acteurs
3.3.1 La maıtrise d’ouvrage SCR
Le SCR(Services de Communication R´esidentiels) assure la maˆıtrise d’ouvrage des´evolutions de la plate-forme MACSIM. Il est en charge:
– De la co ordination des intervenants,– Duplanning consolid´e du pro jet (coˆut, charges, d´elais),– Des relations commerciales etcontractuelles avecles banques,– De la contractualisationavec le SIFAC et la DOSI (les exploitants),– De validerlessp´ecifications,– De validerle PV de recette final,– De la mise en place d’une organisation projet en accord avec la MOE et l’exploitant.
3.3.2 L’exploitant DOSIL’exploitationMACSIMestconfi´ee`alaDOSI(DirectiondesOp´
erations du Syst`emed’Information) sur la base d’un contratde services.Les activites principales couvertesparla DOSI sont:– De r´ealiser l’exploitation quotidienne (batch, sauvegarde,
parametrage,sup ervi-sion, traitement des incidents, founiture des r´eseaux,fourniture et maintenance
desserveurs)desapplicatifs,– D’assurer la tra¸cabilit´e de la configuration des serveurs et des interventions et de
r´ealiser les tableaux de bord d’exploitation et commerciaux,– De garantir la qualit´e de service n´egoci´ee avec la MOA,– De r´ealiser la mise en place de nouvelles versions applicatives ou de nouveaux
param´etrages livr´es par la MOE,– De mettre en place les moyens (personnels, plates-formes, ...) pour r´ealiser les
phasesdetestsoud’int´egration,– Der´ealiserlesoutiendeniveau1:incidentsd’exploitation.3.3.3 L’Assistance Client`eleL’AssistanceClient`eleestcharg´ee:– De r´ealiser l’exploitation commerciale (accueil client num´ero AZUR, gestion mo-n´etique et contentieux, introduction `a la demande de la MOA des donn´ees der´ef´erentielrelativesauxclients). 12
Chapitre4
Contribution au pro jet MACSIM
4.1 Le projet IHM d’exploitation et d’assistance client`ele
Le pro jet IHM r´epond `a un besoin de refonte et de mise en conformit´edes applicationsaux normes requises par France T´el´ecom. Ce pro jet a donc pour but de mettre en placeune nouvelle IHM pour les applications CBPUB et PARM.
4.1.1 Lesfonctionnalit´esde l’IHM pourCBPUBet PARM
CBPUB (CarteBancairesdans la PUBliphonie) est une applicationde servicede paie-ment des t´el´ecommunications par carte bancaire dans les publiphones(t´elephone public).Ce service permet `a la client`ele d’obtenir des communications t´el´ephoniques `a partir despubliphones.L’IHM doit pouvoir lire et mettre `a jour les donn´ees sur les transactions et toutes
les informations relatives `a ces transactions. Ces informations sto ck´ees en Front Office,sont r´eguli`erementcopi´ees vers le Back Office (BO). Des traitements batch sont ensuiteeffectu´esen BO afin de validerles transactionsbancaires. Cette validation se traduit enfait par la cr´eation de remises qui sont envoy´ees aux CTC1Certainesdonn´eesdanslesbasesenBOpeuventˆetremodifi´eesparlebiaisdel’interfacegraphique. Ces changements sont n´ecessaires pour assurer des ´evolutions d’ordre mat´e-riel (ajout de nouveaux publiphones) ou financier (tarification des communications); etaussi pour r´epondre aux contraintes changeantes des banques (liste noire). Les modi-fications effectu´ees par l’IHM sur les donn´ees en Back Office doivent ˆetre valid´ees parl’administrateur, avant que les nouvelles donn´ees puissent ˆetre transfer´ees vers les basesen Front Office.1CentredeTraitementCommer¸cantouCentredeT´el´ecollecteCommer¸cantsdesbanques.Partier´ea-lisantpourlecompted’Acqu´ereurlesfonctionsd’acquisitiondesremisescommer¸cant,lesquellespeuventemprunter des supports diff´erents. 13
Une contrainte qui d´ecoule des fonctionnalit´es precedentes est de v´erifier que les mo-difications app ort´ees aux tables maintiennent une coh´erence parfaite entre elles.Cesv´erifications se feront dansla couche de pr´esentation (v´erifier le bon format des don-n´ees), etdans la coucheapplicative(mettre `a jour plusieurs tables si n´ecessaire).
France T´el´ecom a l’obligationd’archiver et de conserver `a titrede justificatifde paie-ment, pendant un an `a compter de la date de vente,l’historique des transactions decarte bancaire. Les applications CBPUB et PARM devrontˆetre en mesure de fournirlapreuvede la transaction`a la demandede la banqueou du titulaire dela carte.L’IHMdoit donc pouvoir lancer des traitements d’archivage et de d´esarchivage de donn´ees, desimpressions de tickets clients et bancaires.
Lorsqu’il s’agitde transactions qui onteu lieu dans les 6 pr´ecedents mois, les donn´eessont toujours en base. L’impression de ticketse faitalors directementpar l’AssistanceClient`ele `a Nancy. Si la demande de ticket client ou bancaire se fait pour des transactionsqui ont eu lieu avant cette p´erio de de 6 mois,elle est alors trait´ee par les exploitantsde Lyon car ils’agit d’effectuerde traitements plus d´elicats. Ces derniersdoiventalorsretrouver l’archive, puis la d´ecompresser et imprimer le ticketet l’envoyer `a l’AssistanceClient`ele.L’IHM existante pour CBPUB, r´ealis´ee en SQL*Forms, r´
ep ondait en partie aux exi-gences des utilisateurs et de la MOA mais n’´etait cep endant pas conforme aux normesde France T´el´ecom.L’applicationPARM(Plate-formed’Autorisationetde ReconciliationMon´
etique) estun gestionnaire de T´el´epaiementde MACSIM.C’est l’interface entre le monde bancaireet les diff´erentes fili`eres de paiementc’est-`a-direlesautresapplicationsde MACSIM.PARM n’a actuellementpas d’interface graphique.Les consultations etlesmises `a jourde la base en Back Office se font actuellementpar le biais de scripts et de requˆetes« impromptus »2.Vous trouverez dans la figure 4.1 sur la page 14, toutes les fonctionnalit´es repr´esent´eesdans un useCase.2 Impromptus est un logiciel utilis´e par la DOSI pour consulter les bases.15
4.1.2 Le projet et son d´eroulement
La mise en oeuvre de ce pro jet s’est d´eroulee selon les normes Agathone3 en cotoyanttoutes les phases suivantes:
– Phase d’etude,– Phase de mˆurissement,– Phasede conception,– Phase de fabrication du pro duit,– Phasede g´en´eralisation,
– Phase d’utilisation.La d´emarche adopt´ee pour ce pro jet est la suivante:
– Premi`ere estimation descharges– Analyser l’existant,– Recenser les besoins des utilisateurs,– Pr´eparer la maquette,– Soumettre la proposition et pr´esenter la maquette `a la MOA,
avec la DOSI etl’assistanceclient`ele,– ( Apr`es la Validation par la MOA ) Concevoir les architectures fonctionnelles et
techniques,– R´ealiser l’IHM,– Effectuer les tests,– Pr´eparer la mise en place pilote,– Pr´eparer la mise en production,– Assumer le soutien et la maintenance.Je n’ai malheureusement pas eu le temps de finir la phase de d´eveloppement lors de
ce stage, ainsi que les autres phases qui en d´ecoulent.Estimation initiale des chargesDans un premier temps, j’ai du pr´eparer le planning pour ´etablir une premi`ere esti-mation des charges. Il a ´et´e n´ecessaire d’identiffer toutes les tˆaches pour ensuite faireune premi`ere estimation en jour-homme de chaque tˆache identifi´ee. Vous trouverez dansl’annexe ma toute premi`ere estimation des charges pour le projet IHM, c’est-`a-dire uneestimation de 6 mois en commen¸cant par la phase d’´etude jusqu’`a la phase de mise enproduction. Notre chef de projet m’a ensuite confi´e qu’il avait lui-mˆeme estim´e le travailsur 16 mois.3Agathone est un programme France T´el´ecom qui a pour objectif de permettre la r´ealisation d’un SIde qualit´e r´epondant aux attentes des clients. Ce programme comprend des engagements qui concourent`a l’am´elioration de la qualit´e de service offerte aux utilisateurs.16
Analyse de l’existant et Recensement des besoins
Lors de la phase d’´etude, j’ai fait une analyse pouss´ee des applications existantes pourcomprendre leur fonctionnement.Cela m’a aide pour preparer la rep onse (Do cument« Prop osition de Solution ») `a la demande d’´evolutionde l’IHM, formul´ee par la MOA.Cette analyse de l’existant a´ete assez lourde et difficile.
Pour des raisons tde s´ecurite, l’IHM existante ne peutˆetre manipul´ee depuis les lo cauxdeFranceT´el´ecom Arcueil. Cette IHM, install´ee sur des serveurs AIX en r´eseau s´ecurise`a Lyon, a acc`es `a des donn´ees bancaires`a caract`ere confidentiel. J’ai donc dˆu faire cetteanalyse en me basant sur les ´el´ements suivants:
– les do cuments existants (dossier de sp´ecifications,manuels utilisateurs,slides depr´esentation, descriptions des tables, etc),
– les nombreux´echanges mails et t´el´ephoniques avec les utilisateurs (les exploitantset l’assistance client`ele),– les connaissances de l’exp ert fonctionnel de l’´
equip e MACSIM.
J’ai pu constater que l’IHM CBPUB existante n’´etait pas le seuloutil utilise pouracc´eder aux bases. Pour r´ep ondre aux nouveaux besoins de la MOA,les exploitantsont r´ealis´e de nombreux scripts lo calement `a Lyon. Ces scripts et requˆetes impromptusn’´etaient ni document´es ni accessibles depuis Arcueil. Ceci a bien´evidemment alourdi laphase d’´etude mais a ´et´e tout de mˆeme b´en´efique sur un point. Les nombreux´echangesque j’ai pu avoir avec les utilisateurs ont r´ev´el´e les nouveaux besoins de ceux-ci.Enanalysant l’existant, j’ai fait en parall`ele un recensement des besoins des utilisateurs.
La prop osition de SolutionDans le document « Proposition de solution », je propose de mutualiser les IHM pour
les deux applications en mettant en place une IHM de typ e client l´eger. Etant donn´equeles deux applications sontli´ees fonctionnellement dans le cadre MACSIM, il m’a parulogique de pouvoir naviguer facilement entre les deux ensembles de fonctionnalit´es. Cetteorientation s’est r´ev´el´ee d’autant plus judicieuse, qu’actuellement une ´etude est en courspour mutualiser les applications CBPUB et PARM.Le « Dossier d’Analyse Fonctionnelle » est un document qui compl`ete la propositionde Solution en d´ecrivant de mani`ere plus exhaustive et de mani`ere plus d´etaill´e lesfonctionnalit´es d’une application. Ce document se fait normalement apr`es la validationde la « Proposition de Solution » par la MOA. En accord avec le chef de projet, il a ´et´ed´ecid´e de poursuivre le projet sans attendre la confirmation de la MOA. J’ai donc r´edig´ece document pour ensuite enchainer sur la phase de conception.17
La conception et lesframeworks choisis
La technologie pour la couche pr´esentation de l’IHM m’a´eteconseillee par la celluled’accompagnement Clar@4. Il s’agit du Framework JSF (Java Server Faces) pour lesapplications Web Java.
JSF ( Java Server Faces) est un framework permettant la cr´eation d’interfaces WEBavec la mise en place du Design Pattern MVC.Java Studio Creator2 utilise cette techno-logie et p ermet de d´evelopp er assez rapidement des pages web en utilsant tout simplementle « click, drag and drop». Je l’ai utilis´e pour developp er la maquette. L’inconv´enientde cet outil est qu’il requiert ´enorm´ement deressources.A partir d’une dizaine d’´ecrans,l’outil a tendance `a ralentir le PC. Cette maquette contientaujourd’hui plusd’unesoixan-taine d’´ecrans et cette couche de pr´esentationn’est pas encore compl`etement termin´ee.En JSF, chaque ´ecran est associ´e `a un fichier jsp (en XML) et un fichier java.
La maquette que j’ai donc d´evelopp´ee sous Java Studio Creator 2 m’a permis depr´esenter assez rapidement lesfonctionnalit´es aux futurs utilisateurs de l’IHM.Cettepr´esentation s’est faite par le biais de Co opNet5. J’ai pu ainsiprendre en compte lesnouvelles remarques et faire les adaptations avantd’attaquer la conception d´etaillee dupro jet. Vous trouverez un aper¸cu de la maquette sur l’image 4.2.
Pourla conception, on m’avait recommand´e d’utiliserle framework Spring.Spring estun framework op en-source J2EE pour les applications 3-tiers. Une de ses caract´eristiquesma jeures est le « inversion of control » (IoC) ou « dependency injection ».C’est undesign pattern qui permet de casser la d´ependence entre des modules, des ob jets ou desclasses.Si on a par exemple une « classe A » qui d´ep end d’une « classe B »,
le IoC vapar le biais d’un troisi`eme ob jet « Interface C » mettre en relation les classes A et B.Les d´ep endances sont pr´ecis´ees dans le fichier de configuration et c’est donc Spring quis’o ccupe d’instancier les diff´erentes classes n´ecessaires pour le bon fonctionnement del’application.De ma propre initiative, j’ai voulu essayer de combiner le framework Spring avec leframework Hibernate. Ce dernier permet de g´erer la persistance des objets en base dedonn´ees relationnelle en Java. L’accompagnateur de la cellule Clara m’avait d´econseill´ed’utiliser ce framework car il ne l’avait lui mˆeme jamais essay´e auparavant avec le frame-work Spring car il avait eu peu de retour d’exp´erience. Lors de la phase de conception,j’ai quand mˆeme finalement fait le choix d’int´egrer le framework Hibernate. Les figures4.3, 4.4 et 4.5 pr´esentent respectivement l’architecture logicielle , un diagramme de classepour une transaction et l’architecture de d´eploiement de l’IHM CBPUB/PARM. 4Clar@ est une structure inter-SN, mise en place depuis le 01/12/2000, pour accompagner les´equipescharg´ees de d´evelopper des projets faisant appel aux technologies pr´econis´ees par FT5CoopNet d´esigne une conf´erence qui combine l’utilisation de Netmeeting et le t´el´ephone18
Le framework Hib ernate a p our grand avantage de r´eduire le temps de d´evelopp ementde la couche DAO en´evitant aux d´evelopp eurs d’´ecrire du co de source java redondant.Je tiens `a pr´eciser que dans les deux bases CBPUB et PARM, il y a plusde quatre-vingt-dix tables dont certaines contiennent´enormement de champs.Sur internet,j’ai trouveun outil de synchronisation « Hib ernateSync ». En scannant les bases, cet outil m’a faitgagner ´enorm´ement de temps en cr´eant les fichiers demapping et lesfichiers Java (lemo d`ele et les fichiers DAO) asso ci´es `a chaque table.
Fig. 4.3 – L’architecture logicielle de l’ihm cbpub/parmJ’ai fait le choixd’utiliser tous ces frameworks en me basant surles avantages de chacun
d’eux. Ensuite, j’ai dˆu faire fonctionner les trois frameworks en parall`ele. Sur internetde nombreux articles confirment le bon fonctionnement de la combinaison Spring etHibernate moyennant un juste param´etrage des fichiers de configuration. Pour en ˆetreabsolument sˆure, j’ai tenue `a tester moi-mˆeme la combinaison de ces trois frameworks.Une de mes tˆaches a donc´et´e de programmer une fonctionnalit´e (recherche et consulta-tion de donn´ees en base) de bout en bout en utilisant JSF pour la couche de pr´esentation,Hibernate pour la couche d’Acc`es aux Donn´ees et Spring pour instancier les couches m´e-tier et DAO. Cela a finalement confirm´e mon choix de l’architecture logicielle et m’a aussipermis de montrer un exemple concret d’une fonctionnalit´e en code source. Cette tˆachem’a pris du temps car il n’a pas ´et´e facile de trouver le bon param´etrage des nombreuxfichiers de configuration.Toute cette phase de conception est formalis´e dans le document « Dossier de Concep-tion » qui d´ecrit l’architecture logicielle, les diff´erentes couches et les frameworks `a20
Fig. 4.4 – Exemple de diagramme de classe pour la fonctionnalite mentionn´ee
utiliser.La pr´eparation `a la phase de d´evelopp ementFrance T´el´ecom a mis `a ma disposition une plate-forme de d´eveloppement de 30 Go
avec le serveur d’application WebLogic et le SGBD ORACLE. Il m’a fallu exp orter toutesles tables et index des deux bases TCBPUB etTPARM de la plate-formede test versla plate-forme de d´eveloppement; transf´erer les archives compress´ees puis les importerdanslesbasesinstanci´eessurlaplate-formeded´eveloppement.L’espace disque mis `a ma disposition sur la plate-forme de d´eveloppement est lar-gement inf´erieur `a celui en test ou en production. J’ai dˆu prendre en compte cettecontrainte de volum´etrie (de 100 Go `a 20Go) et exporter partiellement le contenu detoutes les tables. Il a ´et´e d´ecid´e d’exporter int´egralement les tables de petites tailleset environ 5% des donn´ees des grosses tables. Ces bases m’ont d’ailleurs servi pourlaprogrammationdelafonctionnalit´edeboutenboutmentionn´eelorsdelaphasedeconception. 21
Fig.4.5 – L’architecture de d´eploiement
4.2 La gestion documentaire et la gestion de configurationlogicielle pour le projet MACSIM4.2.1 La gestion documentaireL’acc`es `a l’information en interne est devenu pour beaucoup d’entreprises un facteur
cl´e de r´eussite. Il est imp ortant de p ouvoir acc´eder de mani`ere rapide aux informationssouhait´ees, de les trier, de les partager, de les stocker,...Il existe de nombreux outils qui permettent d’am´eliorer l’accessibilit´e des documents.Au Sifac un nouvel outil de gestion documentaire WebDOC a ´et´e mis en place.Les processus actuels de gestion documentaires ont dˆu ˆetre revus pour ˆetre conformesaux exigences requises par France T´el´ecom. En tant que gestionnaire de la GED, j’aid’abord identifi´e les utilisateurs/contributeurs des documents li´es aux diff´erentes ap-plications de MACSIM. Il a ´egalement ´et´e n´ecessaire de revoir le plan de classement.Ma proposition a ´et´e valid´ee par les ing´enieurs qualit´es et la migration des documentsexistants vers ce nouvel outil est en cours.22
4.2.2 Lagestion de configurationlogicielle
Qu’est-ce que la Gestion de Configuration Logicielle?
La gestion de configuration logicielle est une discipline du g´enie Logiciel.C’est unensemble d’activit´es con¸cu p our sup erviser les changements:
– identifier les pro duits qui sont susceptible d’ˆetre mo difi´es,– identifierles liensentreeux,– d´efinir les m´ecanisme de gestion des versions de chaque pro duit,– contrˆoler les changements imp os´es.La GCL r´ep ond `a une question essentielle qui est la suivante:
Quelqu’un a obtenuun r´esultat. Comment le reproduire?
Les normes qualit´es de France T´el´ecom imp osent l’utilisation de l’outil PVCS Dimen-sions qui est un outil qui permet les fonctionnalit´es suivantes:
– G´erer des d´evelopp ements multiples (branches, fusion, report),– G´erer des versions,– Faciliter la gestion de d´eveloppements externalis´
es,– G´erer des proc´edures de fabrication,– G´erer des livraisons,– G´erer les demandes de changement (DM, fiches d’anomalies, demandes de report),
– G´erer des cycles de vie par workflow (comp osants, versions, demandes de change-ment, do cuments de r´ealisation).Cet outil est donc bien plus qu’un outil de gestion de version comme CVS ou SVN.
L’outil PVCS Dimensions avec le r´ef´erentiel de d´evelopp ement 26C p ermet une gestiondeconfigurationlogicielle avecun pilotagepar lesdemandes de changement.Une de-mande de changement ou change do c (CD) correspond concr`etement soit `a une demanded’´evolutionde la part de la MOA, soit `a une signalisation d’une anomalie de la partdela MOE ou des exploitants. Dans PVCS Dimensions un « change do c » permet d’asso-cier un ensemble de fichiers sources, de modules logiciels `a une demande d’´evolution ousignalisation d’une anomalie. La figure 4.6 est une capture d’´ecran qui pr´esente l’outil.Le r´ef´erentiel de livraison 26D permet de r´ef´erencer tous les ex´ecutables livr´es enproduction. Ceci a comme grand avantage de faire travailler tous les acteurs du projet,ie. MOE et Exploitants sur exactement les mˆemes versions de chaque application. Ceciavait d´ej`a pos´e probl`eme auparavant quand des modifcations avaient ´et´e apport´ees parles Exploitants sans un accord pr´ealable de la MOE. Je n’ai par contre pas travaill´e surce r´ef´erentiel.Au d´ebut du stage, l’outil de r´ef´erence pour la gestion de configuration logicielle,PVCS Dimensions, n’avait pas encore ´et´e int´egr´e sur le projet MACSIM. On m’avaitdonc demand´e, en partenariat avec l’assistante de suivi de projet, de prendre en chargela mise en oeuvre de la gestion de configuration logicielle de la plate-forme MACSIM.23
Nous avons, dans ce cadre, fait une analyse pr´ealable de l’existantet effectu´eles activit´essuivantes:
– identifier le typ e des informations (formats des fichiers),et les versions `a migrersur l’outil,
– d´efinir uneorganisationdes informations(commentclasserlesfichiers),– d´efinir le cycle de vie de chaque type d’information, type de comp osants,– trouverles relationsentre lesdiff´erents comp osants
Ensuite, nous avons approfondi les notions du mo d`ele26C de PVCS Dimensions c’est-`a-dire les notions li´ees au contrˆole des changements.
– d´efinir un changement (demande d’´evolution,demande de changement suite `a lasignalisation d’un bug en pro duction ou en test)
– comprendre lecycle devied’unchangement– identifier les liens entre un changement et les comp osants,fichiers ou mo dules
logiciels.Finalement, il nous a´et´e demand´e d’initialiser l’environnement PVCS Dimensions
pour le pro jet MACSIM.– Personnaliser les demandes de changements pour MACSIM,
– Migrer les versions sur PVCS Dimensions,– R´ediger le mo de op´eratoire de l’outil,– Pr´eparer une pr´esentation de l’outil PVCS Dimensions pour l’´
equip e MACSIM.
24
Chapitre5
Tˆaches r´ealis´ees
5.1 l’IHMLe document « Proposition de Solution de l’IHM CBPUB/PARM »a´
eteenvoye`a laMOA et on est actuellement en attente d’un retour de leur part.En accord avec le chefde pro jet MOE, je n’ai pas attendu leur r´eponse pour attaquer la phase de conceptionqui se fait normalement apr`es la validation de la MOA du pro jet.
En revanche, j’ai eu l’opp ortunit´e de pr´esenter ma maquette aux diff´erents utilisateursc’est-`a-direles exploitants de Lyon et l’Assistance Client`ele de NAncys.Je voulais avoirun retour assez rapide de leur partafin de minimiser les risques d’´ecart. Il apparaˆıt qu’ils´etaient plutˆot satisfaits des fonctionnalit´es prop os´ees, ainsi que de la nouvelle ergonomiede l’IHM. J’ai pu ainsi prendre en compteles quelquesremarques faites lorsde cettepr´esentation.Il ne me reste actuellement que quelques semaines avant la fin de mon stage pour finir
le transfert des comp´etences sur le pro jet IHM et finir la r´edaction de mon dossier de
conceptiond´etaill´ee.5.2 La gestion documentaire et logicielle5.2.1 La gestion documentaireA ce jour, le plan de classement est termin´e et appliqu´e. Les diff´erents utilisateursont´et´eidentifi´esetleplandeclassementa´et´emisenapplicationdansl’outilWebDOC.Je pr´epare actuellement le transfert de comp´etences sur la gestion documentaire etsonoutilWebDoc. 26
5.2.2 Lagestion de configurationlogicielle
L’analyse de l’existant est termin´ee. J’aiegalement suivi une formation « utilisateur»et « administrateur » pour l’outilPVCS Dimensions.La pro cedure de migration del’existant vers l’outil a´ete etudiee et nous allons effectuer la migration assez rapidement.
Je pr´epare ´egalement le transfert de comp´etences sur la gestionde configuration logi-cielle avec son outil PVCS Dimensions.
5.3 Letransfertdes competences
Le transfert de comp´etences se fait tout d’ab ord en r´ealisant un planning assez d´e-taill´e. Dans notre cas, les charges comprennent le temps queje vaisdevoir consacrer `atransmettre les informations et le temps que la personne va passer seule sur cette tˆachepour atteindre un certain niveau de connaissance, niveau pr´ecisedans le planning.Il y aura un transfert des connaissances sur :– les aspects fonctionnels du projet IHM,– les aspect techniques du projet IHM,– les comp´etences de gestionnaire de configuration logicielle sur l’outil PVCS Dimen-
sions,– les comp´etences de gestionnaire do cumentaire sur l’outil WebDOC.
27
Chapitre6
ConclusionCe stage de fin d’´etudesau sein de France T´
elecom m’a faitd´ecouvrir le domaine dela Publiphonie (cabines t´el´ephoniques) et de la Mon´etique par les asp ects fonctionnelset techniques et par son SI. Le pro jet MACSIM m’a´egalement permis de d´ecouvrirplusieurs phases du cycle de vie d’un pro jet informatique dans une grande entreprise.
Ce pro jet fait intervenir plusieurs profils de personnes quine sont pas toutesimpli-qu´es de mani`ere directe dans le pro jet MACSIM. On y trouve la MOA, le directeur depro jet, le chef de pro jet, les experts fonctionnels et techniques, les exploitants, les concep-teurs/d´evelopp eurs, les ing´enieurs qualit´es, les prestataires, le service support mat´eriel deFT et autres. Tous n’ont pas forc´ement le mˆeme ob jectif. Cette grande collaboration estdonc `a la fois un atout et une contrainte : elle peutˆetre une ´enorme source d’informationet de service mais am`ene parfois une forte d´ep endance entre les diff´erents acteurs.
Pendant ce stage de fin d’´etudes j’ai travaill´e sur un pro jet qui r´epond `a une demandede refonte des IHM existantes des applications CBPUBetPARM.Cette demandeavait´et´e formul´ee par la maˆıtrised’ouvrage avantle d´ebutde mon stage.Le travail surceprojet IHM a exig´e des efforts d’analyse et de compr´ehension. Cela m’a finalement permisde trouver une solution optimale tout en restant en ad´equation avec les demandes etexigences de la MOA et des utilisateurs. La mont´ee en comp´etence s’est faite par :– la lecture de documents fonctionnels et techniques,– les formations FT auxquelles j’ai assist´ees,– les nombreux ´echanges que j’ai pu avoir avec l’expert fonctionnel, les exploitantset l’assistance client`ele.J’ai ´egalement abord´e les aspects techniques du projet IHM. En effet, j’ai du r´edigerle dossier d’architecture logicielle, plus sp´ecifiquement la partie de conception d´etaill´ee.Mes choix des frameworks se sont bas´es sur les pr´econisations de France T´el´ecom et lesinformations que j’ai trouv´ees sur internet. J’ai voulu minimiser au plus mes estimationsde temps de d´eveloppement et rendre l’application le plus maintenable possible.28
La nouvelle IHM CBPUB/PARMr´ep ondra mieux aux b esoins des utilisateurs,ellesera plus ergonomique.Par ailleurs,les exploitants n’auront plus besoin de cr´eer denouveaux scripts car tout sera dor´enavant param´etrable depuis cette nouvelle interfacegraphique.Parall`element au pro jet IHM, j’ai travaill´
e sur la gestion do cumentaire et la gestion deconfiguration logicielle. Ce travail ma fait comprendre l’imp ortance d’une b onne gestiondans ces domaines. Il ne suffitpas seulement de cr´eer la solution, il faut aussi pouvoir lasto cker, la retrouver facilement, la faire´evoluer dans un r´eferentiel commun bien d´efini.
L’outil WebDo c est aujourd’huiutilise par l’equip e MOE MACSIM maisegalementpaslesexploitantsde Lyon. PVCS Dimensions avecson r´eferentiel de d´evelopp ementa´et´e mis en place. Les nouvelles fiches d’anomalies sont d´esormais enregistr´ees dans l’outilet puis li´ees aux fichiers concern´es par l’anomalie.
La combinaison des asp ects analytiques et techniques a´ete pour moi un d´efi motivant.J’aipu ainsiconcilierles visions de conception et de pratique techniquetout au long dece stage.Ce stage m’a permis de d´ecouvrir France T´el´ecom, une grande entreprise des T´
ele-communications. Souhaitant ´evoluer `a l’international, j’ai ´et´e accept´eeen CDI au Sifacdans la Direction Op´erationnelle Internationale sur une mission en collab oration avecORANGE Suisse. 29
Bibliographie
[1] interneFT,Etat des lieux des services ”plate-formes mon´etiques » du groupe FranceT´el´ecom,France T´el´ecom - Branche des Services du Fixeet del’Internet,2003
[2] interneFT,Manuel Utilisateur : Archivage des Tickets, 2002
[3] interneFT,Manuel Utilisateur : IHM, 1994-2002
[4] interneFT,Conception Archirecture : Archivage des Tickets, 2002
[5] interneFT,Description base de donn´ees, 2002
[6] interneFT,Conception Architecture : CBPUB, 1994-2002
[7] interneFT,Sp´ecifications de besoins PARM G05R01C00 : Gestionnaire de t´elepaie-ment multi-crit`ere,2005[8] Sun Microsystems Press - A Prentice Hall Title, , Creator Field Guide-
secondedition,GailAnderson - PaulAnderson,2006[9] Spring, Spring java/j2ee Application Framework - R´ef´erence Documentation,
RodJohnson, uergen Hoel ler, Alef Arendsen, Colin Samaleanu, Rob Harrop,ThomasRisberg, Darren Davison, Dimitry Kopylenko, Mark Pl lack, Thierry Templier, Erwin
Vervaet,2004-2005[10] Oracle - The Rational Database Management System,Oracle SQL*Forms - Desi-
gner’s Guide version 5.0, 1994-2002[11] interneFT,Description du cycle de vie d’un page web JSF, 2006[12] Oracle - The Rational Database Management System, Oracle SQL*Forms - Desi-gner’s Guide version 5.0, 2006[13] interneFT,Dossier de Conception Hibernatoo, 2006[14] interneFT,Dossier de Conception Springoo, 2006[15] interneFT,Dossier de Conception NetAssistant, 2006[16] interne FT, Guide de Mise en oeuvre de la persistance avec Hibernate et Spring,2006 encore en Draft[17] interne FT, Archirtecture Logicielles Types pour Application N-Tiers en contexte@rchimede - Couche pr´esentation Servlet/JSP, 2003[18] interne FT, Archirtecture Logicielles Types pour Application N-Tiers en contexte@rchimede - Persistance & acc`es aux donn´ees, 2003Etencorebeaucoupplus... 30