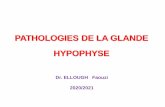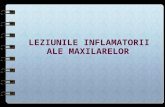r- nriii j~ - bmsenlis.combmsenlis.com/data/pdf/js/1864-1869/bms_js_1869_06_26_MRC.pdf · Toutes...
Transcript of r- nriii j~ - bmsenlis.combmsenlis.com/data/pdf/js/1864-1869/bms_js_1869_06_26_MRC.pdf · Toutes...

a « J - u i « « » ,Samedi * « Ju in INC».SB' A
ON SW- i t w i t a h ' -
r - nriii j~■ U S TOOS L *
du o irA i
A Pam .c^ezUM .Hai
is in te rro m p u c l rèt-considéré com m e orjnc p as d 'av is c on tra ire .Rtlmift» t U ligne,
5 lignes, 1 fr 50 c .
L abonnem ent e s t payable d ’«Vrenouvelé s i k j ’ijxplratlo:vers,
lesquelles1 clic
L’Eqijpereui' es t parU lu n d i p o u r le cam p d e Châlons.Le P rince Im péria l, en" costum e de sous-liçutenant, accom pa
g n a it S a Majesté. ’ r . r : : " 1. ^ tra in im p é ria l, (» r ti récem m ent des
? M !^ J ;W » liP W J } d ff l feu»; P c s fo iic n e ib 9U6ion, des employés i |j | l p l« f» ;oçeaux f ur. Je» roues.:
f t EÆ I¥ ^ rî!P î^ w i|i iD c f^ i) it( r .;D a )a s .a u c u n e g a rc , lc sau to riiés ^ j^ n J îK ^ P ^ ^ P 'd f i^ B ld u I r a f n .K ic e p lé i i .C l i à k i^ o ù Sa:Maj>s|é
^ • legéfiéndcou iroandan l la dhrlsionct le p réfet, tousJ i} t« iu f l . ; ,. r<„. , ,d ii PeÜt-M ourm elon, ju sq u ’au q u a rtie r im péria l, la
•é OUiquapticr im péria l avec to u s lés générau: usent*. . •
i r p a r une g rande petrailo aux flàmljeaux.^ » ju ille t,: a r in iy é m iré a è la b a ta ille do;BblréVino, tous
le» Anciens so ldats « I ia lW èiïifciere ëii . ^ , :^ ^ e m W devant luLe jeu d i 24
le» anciens so ldats d'Italie,- Officiels éii (èw. q u a rtie r im périal e t o n t e tc prtsentâ>S f f f i t | « e s t a i f r i a t a o t t o d r t f q s l q ù * uàro liS .'B
- Sbiitn1-’ ■ ’ ’
—r -r . — ,éclial•r * r, ? r - : - i - - ^ “ /-v.-* n “, r e réj>Ondu.:
«’.âbWqi»^'*: d e yqit; q pç v o ^ a 'gyc^pag oublié la grandeW«!T;“ W w e..PPW >V .ow ç o m b a ü û JI ÿ a d ix années. Con-
'JWMr Iq sQUvénhç des com bat» d e vos . I ^ ; c b a « .c q i « ^ t t q j j f ( » r o ù s àycxàssiste : c a r i ’e s l l 'h is to ire de
"^5?i p rogrès«go laç iv ilisà tio n . Vous
“S S f t F Ï T e ^ ^ W ^ w i 1? 8? c é ^ l^ f id é lH e a u , d raiieau , le dév q u em én ta . la p ù tn o .. (W tlrin ez com m o p a r d e passé, e t vous
d jgpes fils d e la gijandè Rafipn »
L t o p e r e u r s’cst en tre tenu ensu ite avec p lusieurs vieux soldats, d o p M a.aocuetlb les dem an d es avec sa b o n té o rd inaire .
■ R y, a dans Ire paroles prononcées p a r W Em pèrétir u n aperçu liMtoRiqUe d o n t la v é r i té 'a -été cen t fois rcOorlnue e t m êm e dém on trée , ëouveht avec u n graod ta len t, p a r loë-adversaires de lannllt.m ilA m tru in a ln T n u lo o Ino « U U A u l t-_.* . ■ . . , *7 jw r ira auversaircs u e la po litique im périale. T outes Jes glande» guerrré en trep rises ou
p a r la F ian cé , depuis Richelieu ju sq u 'à TYapolcon III,l i r ibllf. rm h p o m ro c ' Ail A n 1.»> •' m .-I J l lllIINtljWIII 111,
.tarer ou do défendre un progrès. Toutes léfaites, o n t été les Victoires e t les défaites
soutenueso n t eu: p o u r b u t de r .. se® victoires, tou tes ses d e la c ivilisation.
11 n ’est j*as une idée libérale q u i n ’a it eu besoin, p ou r se répand re en E urope, d ’y ê tre p rom enée triom phalem en t dans les pli»; d e n o s dfapeaux . E t ntfe soldat» o n t été, dans tou tes les grandes phases d è n o tre h is to ire m ilita ire , les infatigables ouvriers d e Ja g ran d e ceüvre q u ’d a été donné à la Frarice m oderne d 'accom plir. Ils o n t laisso leu rs os su r toutes les grandes rou tes de I E u ro p e , ils o n t a rro sé d e leur sang les cham ps d fAllem agne, et derriè re eux se so n t levées les riche» moissons d o ü t ils avaient ete le» héro ïques sem eurs.
décrets insérés au Journa l o fficial nom m en t M. Schneider r r 'î 'r* * r$ ii®t A lfred Lé Roux, 'Jérôm e David e t Du M irai, vice-presidents du Corps législatif.. iP q r u n au tre d écre t, lo baron Jé rô m e D avid est n o m m é erand-
. 'Omçiçr d e la .Légion .d 'honneur. ^ ° ,H .
, O u a v a it d i t q uoM . d e Poraigny avait désavoué la publication d e la le ttre q u il avait a d r e s ^ à Jil. E iq ile .Qllivior. Voici ce que M. de P érsigny écrit à c e t égard *J» Constitutionnel :
. , Cham arande, ce 19 ju in 1809.M onsieur le R édacteur,
Perjnd tlez m o i d e m ’adresser à vous p o u r faire cesser d es com m en taires o iseux, .ridicule» e t bien d ignes de ceux q u i les font. S’il es t v ra i, e a :effut, com m e vous l’ave* d i t vous-nu5me, en in séran t m a. le ttré d u 3 d an s vos colonnes, q ue ce tte IfeUre n ’a p o in t é té p u b liée p a l n td i, je n c to u s e n rem éreiepas m oin» d ’avoir pensé q ue j étais tou jou rs p rê t à répondre, cliver» ' e t c o n tre tous d e nres 'actes e t d e m es paroles. J e v o ü ssu lsd o n c trésob ligéd 'avo ir pu b lié m a le ttre . ^
Agréfe*, etc'. P eehichï.
La Gazette, de M adrid publie le d iscours d ’o uvertu re q u e le qiarçch^l Serrqno a p rononcé, com m e régent, dans la séance du 18 ju in , ap rès avoir p rêté serm ent à la Constitution :
« Messieurs les députés,« Avec la c ré ftio iv d u pouvoir constitu tionnel q u e vous avez
daigne d ie confier, é t q ue j'accen tcavcc reconnaissance, com lncnce u ne nouvelle ère p o u r la révolu tion do sep tem bre. L’époqite des gyaveà périls est passée : il s’ouvro u ne àü trc époque de réoreani- sa tion datiè laqudué n o u s n ’avons rien fi c ra ind re , A m oins q ue ce n e ' so it '' nh tr» ; n iv in » ‘ (litriituUi<ù>. n n o in d lilA .» lions:s in r-lî . . ^form e m onarch ique, Traditionnelle a n s « , miifc’én fôü réé d ’iiistî- tu tio n s d ém ocratiques. A jÿourd ’h a i es t venu le m om en t de: développer e t consolider las conqnêtes réalisées e t de fortifier l ’au to rité , qu '.o sl: l’égide d e to u s Je» d ro its c l.le rem p art d e tous les iillérôts sociaux, rossçyrqnl en m êm e tem ps n os relations dip lom atiques avec Iqs au tre» puissances.
« JL’entrenrM e e s t a rd u e p o u r m a faiblesse personnelle ; mais «« q u i rtto donnq conOanoe dans u n » h eu reu se :issu e , c’èsl votre h au te sagesse, l’adhésion form elle de» anm ies de te rre c l d e m er le patrio tism e éprouvé.do la m ilice citoyenne e t lesagee t trè» noble Vsj>ritd e ,P P trq j p a |r iie.
« I )a p03tc d h o nneur auquel vous m ’ave* élevé, j e ne vois pas)ǧpartl3.P9lil,iques, jo .v o is |o .c o d o ro n d a m c n l^ :jiy '^ |j |ig c lo U lle.Iç sp a rtisp ç jitiq u es , jo ,v o is )o co d o fondam eulal
; • r* r* ® ; çi'ti^ .lojiituEd. «éxeculc ; je ' Vols no tre ëh crc pa trje si ilé^Vi>iisf»
ojuoude rmpi^te et• ^ . . . .J ü w d q s l!^ iv * é c td o
repos, si ayiqç. gç pxogre^ é t de, liberté, ,ct enfin, .'comme sunrêi asp iration .ihU ftegnç lemeqtl? t e ü v t e w . , ,
; j p « à u ' 4 a u ra M âaéîqo iiîU N ihé sur ferttté do Abrdfp mprel .ol m atérie l, a ü u n u e le
ri-gne• W#%6kfin WMÇw'RfSft-W Wtrîe, k Jafyielfq j 'ÿ conkacré toute'jn'À' l i iè j iu d c ^ ^ n ! v iq ïéüteV nt^re.
i, l’iio rore d ’5, en é thjus vfiyjqns poindj
_deivmü le lioulovlird do fàvUlftrCé d’e 'r î W M î . !
m m k d e M. d ^B éü p t éo’n jra rto les r r t ^ d o 'c â b l H é l l d Sain t- l*tH crsbbûi^V ^m 8, lTAu<riclic n a rioii’a r ^ è iùteif, d e , c<s jnécon- teu tem ents. O n cherche à Tcffrayer cn p l a M t dèvh’n t sés yeux le spéèlW ûo la tb fo b h ë n c ^ V W » 1 ce q u ’elloAUrAît k ijdlî^U ll'6 y i vbfuéon^io celled tin1 éôVaük)ié;pbMifaîa\étv HVPkTèmt rè t ïlo & A o e t do Pôlç^he; (frOitfOb h b ’il né gâgtferéit ‘ p à i'd n 'iiitf f r if f i V h ie p a r la ëohfiSnté‘,'fa ndéliM ; j é déVéhedicnl des jifoviuces poYonalses, ce q q 'ii1 pétHriiU hom iila lë ihciit? ; 1?,: " " 1
O ij éssàyéd 'f'frràyèr'TA iilriche n.-jr la niéftpcctivo. d ’u ne guerre avec ta 'R ussie: M àis c 'é ^ lS ünb m jnà 'nv 'fc doht^’M:' do Béust ne **** *i*&'d(ipe.
ello succom berait sons lps èlférts do tous lé i'jje S ’il p la ît î iT A ùtriche d e ré tabfir ^chè* élle Vodctèn Voya’urnc d e
Pologne, le cab ine t dé Saint-Pétèrsbourg devra sc résfgnér} il au ra mémo m ieux à faire, c’est do l 'im ite r .
En Angleterre, la C ham bre des lo rds, p a r 179 voix con tre 146, a adopté le principo d 'u n e réform o an s iq e t de l'E glise d 'Irlande . t«ette réform e, on le s a it, é ta it depuis longues années aussi
m a w îf fixèrqne^les S S n aR iô iu e tle s ' lim ite» d ev ra s 'accom plir.
S ans doit te , o n n o sau ra it tro p féliciter les lo rds e t les m om bres d u clergé anglican , q u i en s’associant au vœu popu la ire , o n t une fois d e p lu s do n n é u n grand exem ple d e sagesse e t d e patrio tism e. M ais leu r condu ite s i bien inspirée ne do it pas nous l’airo perdre d e vue la p a r t légitim e d ’éloges q u i rev ien t au peuple v anglais lo i-m êm e. A pri* avoir m on tré sa volonté, il a su a tten d re , e t par là i l e s l parvenu à ob ten ir. C’est cc q ue le pcuplo français a ra rem en t sii faire.
Certains jo u rn a u x a ttrib u en t la ru p tu re d u m in is tre am érica in avec le gouvernem ent d e Rio-de-Janoiro à d e s causes d ’une fausseté m anifeste e t q u ’il im porte d e rectifier. Voici les la its tels q u ’ils sc so n t p rodu its .
Le général W ebb , rappelé, par son gouvernem ent, e t ;V la veillo de rem e ttre à l 'E m p ereu r ses lot 1res de rappèi, adressa au m inistre des affaires é trangères une note dem andan t le paiem ent d ’une
. '•jdW Poité ,re la tive a u navire am éricain le Canada, naufragé en , . : S u r là réponse d u m in is tre q ue l ’on a ttenda it, p o u r régler
l’a lla irc , q ue la légation du Ilrésjl aux E tat-IJnLseùt fuit connaître le» in ten tio n s, su r ce po in t, d u cab inet d e W ashington , le général adressa u ne seconde nolcconrüC dans les term es tels q u e lo g ouvernem ent brésilien se v it c o n tra in t de la lui renvoyer, en y jo ig n an t les passe-po rts q u ’il avait dem andés.
Il ressort d e ces fa its, q ue la conduite du m in is tre am éricain n ’im plique en rieii u n e ru p tu re en tre les gouvernem ents du Brésil e t des Etats-U nis. — On p eu t c ro ire que le général, froissé d ’un rappel auquel, sans d ou te , il n 'é ta it pas p réparé, n ’au ra pas voulu q u itte r , sans fa ire u n peu de b ru it , u n pays o ù il résidait depuis 1861’cl q u i lu i avait tou jours fait le m eilleur accueil.
Q uant aux rap p o rts existant en tre les Etat-Unis e t le Brésil, ils so n t excellents, e t tous les b ru its répandus en sens con tra ire uo sony q u e le ré su lta t du désir de certa ins correspondants, in té ressés à cacher, le p lu s longtem ps qu ’il leu r sera possible, la s i tu a tio n c r itique d e la cause paraguyenne et de ses défenseurs.
Les jou rn au x d u Brésil nous apporten t le tex te du d iscours prononcé par l ’em pereu r Don P edro 11, à l’o uvertu re d e la session parlem entaire . N ous on ex trayons les passages su ivan ts q u i o n t t r a i t aux relations d u Brésil avec les puissances é trangères, ainsi q u ’aux dern ie rs inc iden ts d e la guerre con tre le Paraguay :
y Les relations do l’em pire avec tous les gouvernem ents des n a tions étrangères o n t é té am icales, excepté avec le Paraguay, et la guerre provoquée p a r lo président Lopez se p o u rsu it, avec h o n n eu r vil g lo ire , p o u r le Brésil e t ses alliés.
« A près l'occupation de la cap ita le d e no tre e nnem i, les o p é ra tio n s nécessitaient ré tab lissem en t d ’une mission spéciale destinée a s ’en tend re avec les gouvernem ents alliés, c l cc soin a été confié au m in is tre des affaires étrangères.
« lia constance e t l’héroïsm e des volontaires d e la garde n a tio nale , de l’arm ée e t de la m arine, o n t tr iom phé de tou tes les difficultés-de terrain e t do fortification de l'ennem i.
t « La m arche à travers le Chaco c l les engagem ents d ’Ito ro ro , d ’Avâhy e t de Lam as Valentinas a ttes ten t la d iscipline e t la v a leu r d e nos troupes e t do nos a lliés. Ce so n t des faits q u i fon t h o n n e u r , , ...... Ia ,.„Iir Ia n .
(m m m and'cnt1*8’ & *liabileU5 Cl à des généraux q u i lcsf ^ l e plu*!qqe U m oins œ
« Je suis profondém ent afiligé d e la m ort de tous les B résiliens, i î d^o m n o se 'n t ains? •*d o n t quelques-uns é taient des officiers de la p lu s grande d istinc tion , « n i «—*..* .i~ i . _i—I^our dévouem ent e t leu r fidélité à tous les devoirs de l'h o n n eu r m ilita ire recom m andent leu r souvenir à la g ra titu d e de la n a tio n .
« La province d e M atto Grosso est délivrée de l ’invasion p a ra guayenne; l ’ennem i ne foule plus le sol brésilien, e t no tre escadre e s t m aîtresse dans les eaux d u P arana e t d u Paraguay. »
t P a r o rd re d ’Ism aîl-Pacha, lo m inistère des affaires étrangères d ’Egypte v ien t d é tro transféré du Caire à A lexandrie.
I-c Caire, ville d ’intérieure, n’est q ue la cap ita le nom inale d u royaum e et la résidence du khéd ive ; toute la puissance c l tou te l ’activ ité d u pays se trouven t concentrées à A lexandrie, où le vice- roi possède d ’ailleurs un palais q u ’i! vien t h ab ite r pen d an t les g randes chaleu rs d e l ’année.
L ’inauguration officielle d u passage en tre les deux m ers p a r le canal de Suez aura lieu le 17 novem bre.
Lès navires de com m erce o u d ’E ta l q u i po rte ro n t d e s visiteurs se ron t affranchis d e tous d ro its de passage. Il dev ro n t ê tre rendus au plus ta rd le 16 novem bre à P ort-Saïd . Il passeront lo canal d e Port-Saïd au lac de Tism an lo 17, séjourneront le 18 devant Ism aïla , où le khédive d onnera u ne fêle, e t le 19, ils t raverseron t les lacs Amers p o u r e n tre r le m êm e jo u r en m er Rouge.
P lusieurs jo u rn au x d e Vienne, en tre au tres la Nouvelle Presse lib re , a ssu ren t q u e l'E m p ereu r F ranço isJoseph a u ra it p rom is a u vico-roi d ’Egypte do se rend re ,'s i les circonstances le p e rm e tten t, à l'inaugura tion d u canal de Suez.
E n ce cas, Sa Majesté ferait d 'ab o rd une visite au su ltan , e t partira it p o u r Alexandrie.
Lo gouvernem ent grec a reçu do M. le baron Baitde, m in is tre de,F ranco près la c o u r hellénique, notification officielle d e la p ro cha ine arrivée de M. do (.esseps à A thènes.
L e d irec teu r du canal de Suez sera acconqiagné d ’un ingénieur français, avec lequel il se p ropose d ’explorer l’is th in ed u C o rin lh e .
O n parle égalem ent d ’un canal q u i re lierait la B altique à la m e r d u Nord p a r le percem ent du Ju llan d .
I») gouvernem ent danois serait, assure-t-on , s u r le po in t de “— les travaux .
La grève de» m ineu rs du bassin de la Loire tire heu reusem en t n sa fin, c l les travaux seront, selon toute probabilité , rep ris p a r to u t sous peu d e jou rs .
----------------------------------------- r . — em pêchés derep rend re leu r besogne. Nous croyons savoir q u cccsd cu x person nages o n t é té a rrê tés dans la journéo.
L ob iid cm a in u n a u tre gronpo, m ais cette fois p lu s nom breux ,, ( a r^ l.a ’é lev a itd c 6 0 à 8 0 , s 'est de nouveau présen té à la m ém o m iné , déridé èi s ’y occuper. Grâce aux mesure» prises, les ouv riers <jui le complotaient n ’on t pas éljy in tim idés; ils son t descendus
' , En ésberait ù Saint-Elienho q ue lés m ineurs d u M ontccl r e p r e n - . ’d w ^ T ^ n t Ô t l e u r s lèâvaux.
Ifc tèpfivçrhent test donné. N ous avons to u t lieu do cro ire q q ’il sc ^êderafibéfa 'p rom ptem en t.
11 e s t très-naturel q u e les ouvriers s’efforcent d 'o b ten ir p ou r leur travail lo prix lo p lu s élevé possible. Mais les grèves e t les coalitio n s son t-elles le m oyen le plus sû r d ’élover le taux des salaires? L’exnériepce p rouve lo contraire . E t, en effet, ces grèves, coa- lïffonk, lié m odifient nu llem ent la s itua tion d u m a rch é ; elle» b is se n t la m êm e offre en préscnco d e la m êm e dem ando, e t trop feouvont m êm oellesd im inuenl la dem andeon forçant les industriels q u i fo rm en t la p rincipalo clientèle du* charbonnages, so it à ad resser a illeurs leu rs com m andes, so it à chôm er. O r, que résulte-t-il do là? C 'est q ue la situ ta lio n d u m arché e st modifiéedans u n sens défavorable aux ouvriers q u i, v ivan t su r leu rs économ ies, sc trouven t b ien tô t sans ressources, à la m erci des en trepreneurs.
Cela est év ident. Mais il existe des agita teurs q u i o n t mission d 'ab u se r, d ’cn lra ln ér les m alheureux ouvriers, lesquels, o u b lian t q u e c ’est p a r la bienveillant» initialivo des com pagnies charbonnières q u 'o n t é té organisées les caisse» de prévoyance, sc m o n ten t la tôle e t en tre n t en grève. Il faut p laind re ces pauvres pens do n t la condition , après to u t, es t loin d ’ê tre heureuse. Mais il faut pu n ir sévèrem ent les fauteur» de troub les q u i les poussent & do crim inelles violences.
tendan t à m od ifie r les artic les 6 18 e t 619 d u Codœ d c .....v..», relatifs a la com position des tribunaux d» com m erce é lla iis tedes notables. Depuis plusieurs annéçs déjà le nom brèdescom m erçan ts adm is à la no tab ilité ava it é té confeiifcrablemènt ' augm enté ; i mais10 d ro it conféré adx préfets p a r l’a rtic le 619 de pérte 'r a rb itra ire m en t su r la liste des électeurs des juges consulaires tel ou tcPcom - m c iran ts n ’est plus cqncfiiable avec le suffrage universel. On p eut donc, espérer que, sans faire u n re tou r au rég im e 'des catégories, fo u s les paten tés jou iro n t enfin du d ro it de partic iper à l'élection des m agistrats spéciaux d o n t ils son t les justiciables. L’institution des conseils de p ru d ’hom m es fonctionne depuis longtem ps su r ce llo b ase , e t l ’on com prend m al pourquoi le m êm e p rincipe n ’est pas appliqué aux tr ibunaux e t au x cham bres de com m erce.
Le m ouvem ent religieux n u e cause en Allemagne le prochain concile s e propageant dans d au tre s contrées, il devient intéressant d e connaître le nom bre de représen tan ts q u e ces contrées enverro n t à Rom e. Voici les chiffres q u e fournissent à ce sujet les jou rn au x italiens :
Les sièges épiscopaux e t abbatiaux qui peuvent ê tre représentés au concile son t au nom bre d é 850 . Le d ro it des évêques in p arlibus in fulelium n ’est pas encore établi d ’une m anière certaine.11 fau t a jo u te r com m e m em bres de l’assem blée 57 cardinaux (15 resten t à nom m er).
Ces 922 m em bres probables du concile sc d iv isen t en 4 0 cardinaux italiens, 293 évêques de m êm e na tion , 66 espagnols, 2 2 po rtugais c l 90 français, en to u t 512 dignitaires d e race latine. •
V iennent ensu ite 77 évêques brésiliens, mexicains ou am éricains du S ud , ce q u i porto à 600 envirou lo nom bre des. sièges épiscopaux attribué» à la race latine.
P rès de 6 0 do ces sièges so n t vacants on Ita lie : les titu la ires do 160 a u tres n e sc re n d ro n t p robablem ent pas à Rome.
Il ne restera donc q u e 4 0 0 la tins environ à l'assemblée.D ’un a u tre cô té , on a tten d d’A nglctcrreeldT rlandc 48 évêques,
d 'A m érique 5 2 , de Grèce e t d e T u rq u ie 20 . La P russe a 12 de ces dign ita ires, la Bavière 8 , l'A utriche 45 , la Belgique 6 , la Hollande 15, le Canada 16.
Les évêques de Pologne, d e Russie e t d'O céanie ne viendront sans dou te pas. Les A rm éniens, les Grecs un is qui se trouven t eu A utriche, en R ussie e t en Bulgarie, les Syriens, les C haldéensel les M aronistes se ron t fo rt peu représentés.
Chemin Je fer du lord.D é p a r t s *b S e îiu s : 7 h.*56 m atin . — 42 lu 44, i*- 4 liv2 6 ; 8 H . ! * soir.
D b^ a b ts d e Paris : 7 h: 55, — midi, — 5 Iu !0 , ~ 1 0 I i; 4 0 floiri.: t
im m èrid
P o u r e x tra it e t rédaction : E rnest Payon.
NOUVELLES DÉPARTEMENTALES.M. le g aule des sceauxvient d ’envoyer aux parquets d e l'E m pire
le com pte général de l'adm in istra tion d e là justice pendant l'année 1807. N ous en extrayons ce q u i p eu t intéresser l e départem ent :
COl'R p ’aIIIEXS.L a c our d ’Am iens, dans le ressort de laquelluest situé le dépar
tem ent de l’Oise, a ren d u , en 1867, 681 a rrê ts , soit 601 a rrê ts de m oins q ue la co u r la p lus occupée (I ) (la cour d ’Aix)ct 395 arrêts
1 occupée (la cour do Chàm béry). E lle occupep a r scs travaux en m atière civile. Ses a rrê ts : en m atière civile 192, dont 19 p a r défau t,
201 arrê ts d e la ch am b re d ’accusation, 251 a rrê ts de la cham bre co rrectionnelle, 37 a rrê ts de la cour d ’assises de la S om m e.
DE L OISE.t Ello occupe, p a r sas im p o rtan ts travaux , le c inquièm e rang et
n ’est précédée su r la liste do 1867 n ue p a r q u a tre cours d ’assises, celles des Bouches-du-R hône, de la Seine-Inférieure, de l'Aisne c l d e là G ironde. E lle a ju g é 70 affaires, so it 41 de m oins q ue la co u r d ’assises la p lus occupée (celle de» Bouches-du-Rhône) e t 62 do plus q u e la m oins occupée (celle des Hautes-Alpes). Elle a jugé 53 accusés d e crim es co n tre les proprié tés, 31 accusés de crim es con tre les personnes. S u r ces 8 4 accusés, 17 o n t été acquittés.
JUSTICE CIVILE ET COMMSI’.CIAI E.Parm i les tribunaux de d eux cham bres, q u i son t au nom bre de
8 1 , le tribunal civil de Beauvais occupe le vingt-septièm e rang : il a term iné eu 1867, 517 affaires civiles, so it 7 d e plus q u ’en 1866, 78 de plus q u ’en 1865.
Parm i les tribunaux de tro is juges, le tr ibuna l civil deCom piègne occupe le dixièm e rang, celui de C lcrm ont le ving t-un ièm e, celui do Senlis le vingl-qualrièm o : ils o n t te rm iné le prem ier 395 , le second 353 , le troisièm e 332 affaires civiles.
Le tribuna l civil le p lus occupé du ressort, en 1867, a été celui de Laon q u i a te rm iné 6 29 affaires civiles, le m oins occupé celui d e D oullcns q u i en a te rm iné 123.. Le trib u n a l do Beauvais a , en o u tre , rendu 102 jugem ents
d 'avant-fairo d ro it, celui d e Compiègue 64 , celui deG lerinont 48, celui de S enlis 45.
Le tribunal de com m erce d e Beauvais a term iné en 1867 contrad icto irem ent 92 affaires, celui de (’om piègne 2 26 affaires. lies tribunaux civils d e S enlis e t de C lcrm ont jugean t com m ercialem ent o n t te rm iné contrad icto irem ent le p rem ier 145, le second 167 affaires. Ces m êm es tr ibunaux o n t rendu p a r défaut le prem ier 5 74 , lo second 173, lo troisièm e 2 1 1 , lo q ua trièm e 173 jugem ents. I ls o n t te rm in é en 1867 : le p rem ie r 17 faillites, lo second 2 9 , le tro isièm e 15, le q ua trièm e 12.
Voici com m cn tsc classontles Ira vaux des juges de pa ix . Affaires term inées p a r jugem ents contrad icto ires : 1096 d ans l ’arrondissc- inen t d e Beauvais, 6 7 2 d ans celui de Clerinont, 443 dans celui do Compiègue, 4 75 d ans celui d e Senlis. Affaires term inées par jugem ents de défau t définitifs .* 1 ,116 dans le prem icrarrondissem ent, 771 dans le second, 323 dans le troisièm e, 545 dans lo quatrièm e. Affaires term inées par arrangem en t à l’audiçnco : 6 82 affaires dans le p rem ier arrondissem ent, 199 dans le second , 112 dans le tro isièm e, 155 d ans le quatrièm e. MM. les juges de paix do l’arrond issem ent de Beauvais o n t seuls, de to u t le ressort d 'A m iens, délivré en 1867 p lus do 25 ,000 bille ts d 'avertissem ent (25,513). ceux do l’arrondissem ent do C lcrm ont en o n t délivré 15,876, ceux de l’ar- rondissem cnl d e Compiègue 9 ,2 8 9 , ceux de l’arrondissem ent de Senlis 9 ,227 .
JUIUDICTIO.X CORRECTIONNELLE RE SIMPLE POLICE.
I-o tribuna l correctionnel d e Beauvais a ju g é 551 affaires, soit 437 de m oins que le p lus occujié du ressort (celui de Laon) e t 801 de p lus q u e le m oins occupé (celui de Doullens) : il a jugé 642 prévenus.
Lesaiulres tribunaux correctionnels o n t ju g é : celui do C lcrm ont 488 Al r.O-f . . . i J . n m n « •
498
ur Idc li- ! ro
affaires e t 587 prévenus, celui d e C o m p i l e 406 affaires e t prévenus, celui uo Senlis 493 affaires e t 5 72 prévenus,
tribunaux do sim plo police o n t ju g é dans l'arrond issem en t uvais 1751 inculpés d o n t 04 o n t é té acqu ittés , ceux de l 'a r -doB eauvais ..........
rondisscinent do C lcrm ont 1079 d o n t IQ5 o n t é téacqu ittés , ceux de l’arrondissem ent deC om piègne 1144d o n t 4 2 o n t été acqu ittés , ceux d e l’arrondissem ent d e S c til is i435 d o n t9 4 ô n l été a cquittés._______ D- BEhfc.
O n annonce quo l’a rm em en t de la gondarm erio recevra prochainem ent des m odifications im portan tes. Voici en quoi elles consistent :
Lo pistolet de cavalcrio serait reuqilacé, pour cette trou po d ’élite , p a r u n révolver ; — Le ftisil do gendarm erie serait abandonné p o u r le fusil nouveau m odèle. O n sait q ue les gendarm es doivent tou jou rs avoir des arm es chargées; avec les arm çs se chargeant par la culasse, cette p roscription n ’est p lu s nécessaire par su ite de la rap id ité du chargem ent ; il y au ra it par conséquent économ ie do m unitions. Trois m odèles des nouveaux revolvers sont à l ’essai dans différentes brigades.
( I) ÎNou» faisons abstrac tion , «tans ce rétlim é sta tistique, de la i d e Paris « t d u tr ib u n a l de la Seine,
-
K m p p u n t d e .1» v i l l ç d e M e n l j» .
REMBOURSEMENT ANNUEL.
Conform ém ent à l ’artic)e 8 des conditions d e l’em pru ilt de la ville de Senlis au torisé par décret im périal d u 27 ju in 1855, e conseil m unicipal, d ans sa séance d ù l 2 ju in ; 1&69,'a déterm iné le nom bre d ’olnigaiions à rem bourser celte année.
Ce nom bre a é té fixé à 6 , e t im m édiatem ent un tirage Ait sort a eu lien , d ’ap rès lequel lés obligations rem boursables en 1869 son t celles p o r ta n t les n°‘ 158, 101, 213 , 7, 2 1 2 ,2 0 8 ,4 2 4 , 28 .
Les po rteu rs d e ces h u it obligations en rccévroni lé n io n lan t à la caisse m unicipale à p a r tir du 1" ju ille t p rochain, ensem ble li s in térêts échus. • .
Senlis, le 2 4 ju in 1869 . Le Maire,■ II. ÜOENT.
Nous avons assisté d im anche d ern ie r au 3* concert de la saison cl é té donne par la Société m usicale d e Senlis, e t nous avons pri« no tre p a r t d u plaisir éprouvé par la fouie réu n ie sous les allées om breuses de la ravissante prom enade d u g rand cours.
Nous y avons jo u i d u spectacle, to u jo u is p ou r nous si plein « a ttra its , qu o ffrent tous ces charm an ts enfants, parés avec tan t (le sont p a r. l ’a inou r-p rop ro m aternel, dansan t en rond su r ilie rb o fleurie et fo rm ant, avec l'abandon d é to u r êge, des m o u nos d u n e an im ation e t d ’u itg rac ieu x infini». ' ' . .
Le ciel lui-m êm iî, si’ inelémeid. depuis louubunns, sc ia it ras- am eré e t les cbaüd» rayons du soleil tamlsj?» p a r le reufflrtge épais d onna ien t à la réunion u ne physionom ie des plus joyeuses.
N ous devons adresser d e b ien sincères c om plim ents à noa artistes am ateu rs p ou r les p rogrès sensibles q u ’ils o n t réalisés. N u is nous réjouissons d e v o ir leu rs cadres se com pléter e t no tre t es chère bociole m usicale secouer la to rpeu r d ans laquelle elle sem blait plongée il y a quelques m ois, ce q u i, à n o tre g rand reg re t; laissait déchéancea ^ *lrac teu rs sysI,îmatiques p ou r p roclam er sa
Sans p arle r d u ta len t de la d irec tion , M, Chauvin prendra sa p a r tî te s éloges décernés à ses élèves |>oiir la façon réoUeinent rem arquable do n t o n t é té exécutes l ’ouverture d e B é a lr tx 'e l la lantaisie su r M artha . On ne sau ra it nous accuser d 'exagération dans n o tre appréciation lorsque iious au rons d it q u e le public si réserve d 'o rd ina ire , n sub i un en traînem ent inaccoutum é e t a récom pensé par ses bravos ceux q u i s'efforcent d e lui donner c ra - lu itom ciit u n e intelligente c l agréable d istraction.
S o c i é t é « r i u s I i M s c t i o n g é n é r a l e ,
d e l ’arrondissem ent d e s e n l is .
Conférence p ublique su r la D ig estio n , fa ite le dim anche 43 ju in , p a r M. le docteur A rm a n d M oreau, de P aris. *
Lw ê tres v ivants se développent e t s’en tretiennent dans l ’é ta t de san té en p renan t aux ê tres q u i les en touren t une substance o u i devien t leu r p ropre substance. 1
O n donne le nom du fond ions de nu trition à l'ensem ble des actes e t des phénom ènes q u i am ènent cette transform ation d e a m atière e t, com m e o n d it , cette assim ilation. .
Le sang q u i c ircu le par to u t le co rp s po rte à chacune des parties les élém ents de n o u rritu re e t d e réparation , c t la nu trition se fait p a r i échangé des m atériaux du sâng e t des organes - ceux ci tro u v an t ce qui' leu r es t nécessaire; Le phénom ène essentiel e u lté rieu r des fond ions de n u trition se produit au contact d u sane e t d i's o igancs, e t nous appara ît non pas sim plem ent com m e un phénom ène ch im ique sc passant en tre substances hétérogènes au contact, m ais en o u tre com m e un phénoinnio v ita l dans lequel 1 organe ou la cellule q u i se n ou rrit couservu e t développe la form e e t les p ropriétés physiologiques q u ’il possède.
L’é tude de la d igestion com prend u ne série d 'a c t e physiques ch im iques, physiologiques qui transform ent l'a lim en t V i e font pénétrer dans les vaisseaux où il se m êle au sang.
On donné le nom d ’alim ent à tou t ce qu i nou rrit.L 'alim ent se présente sous des form es très variées :Los herbes, les g raines, la chair, etc.Il s’agit d e com prendre com m ent ces substances si variées sont
m odifiées par l’anim al q u i s'en no u rrit e t peuvent se m êler à son
La bouche ou l'o rifice supérieur d u canal digestif reço it les a lim ents, q u i passent d e la dans l'estom ac, puis dans l’in testin (Test dans l'in testin q u ’a lien lo dern ie r phcnoinèino d e la digestion Les a lim ents devenus liquides filtren t à travers Ire parois m ôm e de I intestin e t pénétren t ainsi d ans u n e foule de vaisseaux pleins de sang ou de lym phe, e t son t em portés dans la circulation ' La digestion ( s i a lo rs term inée; Ire parties q u i n 'o n t pu êlre dissoules séjournent encore quelque tem ps dans l'in testin e tso n t re jetées au dehors par l'ex trém ité inférieure du canal digestif
Telles son t d ’une m an ière générale les opérations q u i constituent com m e chacun sait, le travail de la digestion, e t qu i s o n ta u jo u r- il Imi connues dans beaucoup de leurs détails.
Si lions considérons l’e ilrë in o variété do Birmc e t d 'o n ran r, que présenté h liouctic des an im aux, nous no la rderons nas à rem arquer q ue celle v arié té répond à la variété des aliihonls «ni'ils p rennen t dans la na tu re . La conform ation extérieure des an im aux est en rap p o rt avec 1 espèce d 'a lim en t q u 'ils dévorent. On com prend que 1 anim al no p o u rra it vivro s'il ne savait s ’em parer de sa n o u rritu re . Un ch ien à côté d ’nh tas do b lé sc laisse!» m o n ir i r ' Sa s tru c tu re es t en ra p p o rt avec une aù lre espéra d 'a lim en t' Un lapin se lauscra sans dnuto m o u rr ir aussi a u p rts do chairs I n s nourrissantes. E l cependant le pain fait avec le blé' iion rn 't 1res bien le ch ien . E l l a viande cu ite n ou rrit lrts-l>ien aussi le lap in , com m o 1 expérience l’a prouvé.
Ile n 'es t donc pas seulem ent avec la natu ro in iim o do l'alim ent c est avec ses caractères physiques e t la form e sous laquelle il sc présen te , q ue la conform ation de l'an im al es t dans ce rap p o rt nécessaire. Parm iléso iscaU x, nous voyons correspondre je lire du flanu iian t, le bec de l'avoccllc, celui de la tuo ln le , celui d u p erroque t, celui de la cigogne, de l'aigle, .celui d u bœ-croiso correspondre aux qualités physiques de IJilinienl e t a i i j c ircons: tances dans lesquelles 1 a lim en t eo présen te à eux iSüxnlIemenl les den ts larges sem blables à dos m eules des é léphants, dès bœ ufs ' conviennent p o u r b royer les herbes. L is den ts niguêstles chais conviennent p ou r d éch ire r les chairs vivantes. E t o u tre les différences q ue présen ten t les den ts ou les becs, d 'an tres différenccs sc voient encore dans la conform ation dé tou t le co rps, qu i per m e tten t M 'anim ai do se n o u rrir d é l 'a lim en t siafeial q ir i ls trou vent dans la na tu re . Ainsi les ongles conviennent à eaux q u i o n t leu d en ts aigiifs, les sabo ts à ceux q u i s i ’ nourrissan t, d lic rljcs do p lantes, ccsl-ii-d iid d 'u n a lim e n t 'q u i Pc fu it pas b l o n i ne so défend 1V1S, n 'o n t licsoin do Icuib piods q ue pour so sou ten ir Considérons le m om en t où l 'a lim en t saisi est déiii d a n s la bouche” S 'il est sec, il passera.difficilem ent p lu s avant. Hais d is e trouvé S “ J * î v“ p H H t e !» Salive,,qui lo ' ram ollit, lo pénèlro e t ravorisc lo IraVail des donts e t de la langno. Les herbes sèches broyées p a r l is d en ts, maniées par la langue, hiiniccléos p a r lé sahve, lassées Cl adhérentes n 1,1 faveur ilostirs visqueux s'am assent en u ne boule q ue l'habivoro avale. Toutes, ccs^ opérations so n t m iïa n iq u e s e t physiques : la division, le llroicioiiiiL.lo ram o llissem ent c l la d issolution ; ca r il peu t sc ren c o n lr tt d iissnhstanccs qu i se d issolvent d ans la salive. ”
E lles sont faciles h com prendre, nous les connaissons, nous les exécutons dans u np foule de circonstances.
(/In d u strie nous présente m ille bpéralions sem blables A cellro q u i so passent dans la bouche do 1 an im al q u i m arge L’art du cu isinier es réalise e t m e t s o n service t l p ; I m to m M s variés q m s n n l les analogues des organes q ue les 'anim aux 'possèdent si»|*aremonl 011 ra|i|»ort avec une alim entation spéciale.
Mais dijjti com m ence dans la bouche mie oi»cralion p lus in tim e (juo (ou tre celles que j e viens d enum iîrcr, une opération q u i n 'e s t

JO U R N A L D E SF.N I.tS .
pus-sim plem ent, physique et, q u i nous donne une idée des plié ùom ènes d ig e s tif proprem ent dits.
i m âchoire fri appelées à l 'a id e do
La salive les an im aux supérieurs es t fourn ie p a r Irois glandes principales, u n e supérioure appelée paro tide située prés île l’orcillo, d o a l le p rodu it passe dans la bouche à la faveur d ’un long çanal situé d ans l'épaisseur do la joue.
D eux g lan d es placées, au-dessous uo la soue-m axillaire e t sublinguale fournissent aussi, condu its spéciaux, do la salive à la bouche. L i salive n u i vient d e la paro tide est askez sem blable à l’eau , elle froide bien , liés deux au tre s so n t visqueuses. La. prem ière hum ecte donc les au tres , e n ro b e les fragm ents d 'herbes ou d ’a lim ents, e t p erm et -à la langue do les rassêïïinhr en une boule qui est avaleo d ’un seul coup.
Ces deux actions q u i consistent h h um ecter, à iuv isquer, à dissoudre son t encore purem ent physiques. Il en est une au tre p rodu ite par la salive qui consiste dans u ne modification in tim e , dans u n e transform ation des substances successivem ent abondantes d ans la n a tu re e t dans les a lim ents p ris aux végétaux. Les fécules, les am idons ne se dissolvent pas dans l ’e a u ; m ais en présence d e c erta ins acides elles se transform ent ensucrcs, c'pst-à- diro en subetance^Uolubles. >
Les ch im istes savent opérer ces transform ations à l ’aido de liq u id es q u i o n t d es propriétés énergiques.
Là salive q u i cependant n ’est pas a r id e p ro d u it les même- transform ations, d ie change l ’am idon e t la fécule en sucre . Nous observons donc ici u ne m odification très-im pO rtante e t q u i nous (hit p ressen tir le résu lta t de tou tes ces opérations q u i com m encent dans la bouche d e l'an im al e t se co n tinuen t dans l’in testin . Ce ré su lta t c’est la d issolution des a lim ents. Ils ne p o u rro n t e n tre r, en effet, dans le sang q u e s 'ils so n t dissous. I ls do ivent pour
fécules cl contribue aussi «Via. digestion des m atières (ibrincuses et album ineuses. À
D ans l’épaisseur do l 'in tes tin on trouve u ne foule do petites g landes qu i donnent u n suc h om m e suc intestinal, d o n t l'action a clé m oins étudiée q ue celle Hcw sucs déjà çitdS; les sucs versés en abondance à chaque digostion s u r les a lim ents ren tren t avec eux au m oins Une grande partio dans le sang, (le no son t quo les parties réfrnetaires à leü r action q u i so n t rejetées au dehors.
E n résum é, c’est dans l'in testin q ue les a lim e n ts subissent l ’action dos d erniers sucs q u ’ils rencontren t. Us c hem inent à la (hveur des contractions do l'iu testiq do n t la sm'faco in te rne , sèche,dans l'é ta t d ’abslinenco, est tou jours hum ectée quand /ils pansent, leur présen te suffisant y>oiir am ener la form ation des différents Sucs q u i se versent su r leur passage. v
p én é tre r d ans.le sang traverser des m em branes, passer à travers l e s ................................les parois des vaisseaux q u i contiennent le sang. I ls ne le peuvent faire q u e s’ils .sont dissous. Voici la fécule q u i est insoluble, elle se tran fo rm e p a r l 'action do la salive en u n sucre soluble.
V oici.com m onl on peu t prouver l 'action de la salive s u r l'am i don . F a ites chauffer un peu d 'am idon dans l'eau ; quand il s’esl ram o lli, gonflé, e t q u ’il constitue l’em pois, laissez-le refro id ir et m ellez-en dans vo tre bouche une petite q u an tité que vous garderez p lusieurs m inu tes. La présence de l'em pois am ènera la form ation de salive. S i vous recueillez ensuite ce mélange d ’em pois et do salive, vons constaterez qu’il y a du sucre de form é, tandis q u e la salive e t l ’em pois n ’en contenaient pas. Le ta rlra tc double de cu ivre e t d e potasse est un réactif com m ode; chauffé avec laliqueu r sucrée, cette liq u eu r bleue dev ien t rouge ; elle reste bleue s’il n’yl’v a pas d e sucre.
A 1 aide de l'eau iodée, on peut vo ir si to u t l'am idon est transform é. L’eau iodée preud une coloration b leue tan t q u 'il reste de l'am idon non transform é.
Ce quo nous d isons de l'am idon est vrai aussi do la fécule.L e rô le de la sa’ive est surtou t Un rô le physique.La q u an tité de salive m êlée aux alim ents se s est considérable.
O u.a pesé le bol alim entaire chez le cheval, c 'est-à-d ire la boule form ée par le mélange d 'u n foin sec, im bibé de salive e t avalé; ce b o l, re tiré de l’œsophage par une plaie faite au cou , a fourni un poids d e salive q u a tre fois plus fort q u e le poids de l'h erb e sèche.
Les différentes salives aqueuses ou visqueuses agissent surtou t p ar le u rs qualités physiques.
Si o u fait m anger une- purée de pom m es d e Ic n v à un ch ien e tn u e l 'o n p ren n e dans son c tom ac ce lte fécule avalée, on voit à 1 a ide de réactifs te ls q ue l ’e iu iodée, q u e cette fécule n'a pas subila transfo rm ation en sucre , «au m oins p ou r la p ins g rande partie e t c om m e les an tre s liquides versés dans l'estom ac e t l'in leslii possèdent la m êm e p ropriété que la salive et à u n degré beaucoup plus in tim e , le rô le physique de la salive do it ê tre considéréco m m e b ien m oins im p o itan t q ue son «action physique, d ire d e sou iuiluence ut de pour la déglutition.
A vant de su ivre les alim ents dans l’estom ac e t de considérer les influences nouvelles q u 'ils vont su b ir, d isons un m o t d 'au tres o péra tions m écaniques, q u ’ils subissent chez d iv e r s e espèces d an im aux.
La bouche des m am m ifères e t le bec des oiseaux ne sont pas 1rs seu ls organes dans lesquels l'alim ent est modifié d 'u n e m anière physique. Beaucoup d'oiseaux o n t u n estom ac m usculcux très- robuste ; le gésier, dans lequel les co rp s les p lu s d u rs son t com -
’ !S 1)0p rim es c l brisés. Spallauzani a vu des boules do verres introduites d an s legéz ie r ê tre l>risées et réduites en poudre-im palpable; avantde parvenir dans le gézicr, les a lim ents séjournent d an s u n e poche ou ja b o t où ils subissent une incarcération p lus ou m oins prolongée.
Certains poissons, en tre au tres les carpes, o n t l'estom ac à son en trée d e pièces osseuses très-fortes d ont l’action est évidem m en t la m êm e q ue celle des dents meulières des m am m ifères rum inan ts . Enfin 1a m astication qui se p ro d u it dans la bouche et qui se fait chez les m am m ifères rum inan ts à l'a ide de dents très- larges se répè te encore après q ue l’an im al a dégluti. L’estomac fait à certa ins m om en ts e t- p ar des contractions tou t à fait norm ales e t physiologiques rem onter des alim ents im parfaitem ent broyés dans la bouche où ils subissent de nouveau I action de la salive e t celle de la tritu ra tio n .
Dans l'estom ac, les a lim ents déterm inent p a r leu r présence la sécrétion d ’u n suc particu lier appelé suc gastrique. Le suc est acide e t porte particu lièrem ent son action su r les a lim en ts nlhu- m ineux ou f ib rineux, p a r exemple su r la chair. La cha ir est dissociée et réduite en u n e charp ie hum ide, com m e elle le serait par l’action prolongée de l'eau bouillante.
Autrefois, en 1752, le célèbre R éaum ur usa it du procédé su ivan t p o u r se p rocu rer du suc gastrique : il f.iisail avaler à debuses ou à d 'au tre s oiseaux de proie des éponges bien propres et re tenues p a r des ficelles; au bout d e quelque tem ps il les retiraitto u t im bibés d u suc gastrique q u ’il recueillait d ans un verre.
Spallauzani a aussi em ployé ce m oyen.E n 1828, Ileaum ont, médecin, eu t l’occasion de vo ir un Canadien
q u i ava it reçu un coup de fusil dans les côjes gauches ; la plaie é ta it péné tran te et ne s’éta it pas ferm ée, mais les b on is cicatrisés .laissaient u ne ouvertu re assez large p our q ue l'on p û t voir l 'in té rieu r de l ’cstornac.
Beaum ont p r it à son service cet hom m e, et pa rd es observation: nom breuses q u ’il a consignées dans un volum e il p û t constater l’action d u suc gastrique dans l'estom ac e t vérifier la com plète sinologie q u i ex iste en tre ce suc p ris chez l 'hom m e ou étud ié sur les an im aux.
Q uelques années p lu s ta rd , le doc teu r B londol, de Nancy, imagina ce procédé q u i est journe llem en t em ployé dans les laboratoires do physiologie e t perm et d ’o b ten ir des quan tités notables d e ce suc précieux.
Ce procédé consiste à in troduire dans l'e stom acun tube d’argent c o u rt e t d ’environ 1 Centimètre de d iam ètre in té rieu r ; ce tube offre à scs deux ex trém ités un reiiord arro n d i, bien saillant, qui le fixe d 'u n e pa rt su r la paroi in te rne d e l'estom ac e t d 'a u tre pa ît su r les tég u m en ts; on do it le m ain ten ir Imuché e t ne l ’o uv rir q u ’au m om ent où l ’on veut recueillir d u suc gastrique.
C’est s u r le ch ien q ue l’on pratique cette o|»cr.ilion ; l'anim al ne souffre pas e t v il parfaitem ent bien avec la fistule gastrique ainsi constituée.
La dissociation de la ch a ir s'effectue très-bien dans le suc gastriq u e ex tra it de l'anim al e t recueilli dans un verre. On peu'fa ire ainsi sous scs-yeux une digestion artificielle,
l i l l i e ..................................
On peut
La pftte ou bouillie alim entaire de l'cstomaC passe dans l'in testin e t rem o n te presque aussitôt deux canaux ou conduits q ui versent su r e lled eu x liquides abondants. L 'un s’appelle lesuc pancréatique; il so rt d ’u n e g’ànde appelée pancréas. Cette glande qui a longtem ps été considérée cam m e sem blable aux glandes salivaircs, fourn it un su c -q u i possède la propriété rem arquable de form er avec les graisses e t les hu iles u n e ém ulsion. Los graisses subissent en ou tre u n e décom position ch im ique; g râce à celte action , les corps gras avalés peuven t ê tre absorbes par l ’in testin .
C’est M. Claude B ernard q u i a trouvé celte proprié té rcm ar quable du eue pancréatique, e t voici com m ent e lle s ’est révé lée . lu i : il exam inait 1rs inslcslins d ’un lap in c l il rem arqua que les vaisséaux ch jlifè res q u i son t à la surface do l ’in testin et, q ue leur transparence ren d invisibles éta ien t rem plis d 'u n liquide laiteux et devenaient a insi visibles environ à KO centim ètres au-delà de Vèslojiùÿ. I l chercha la raison c l v it q u e le canal pancréatique sVravrâiWtaBa l ’in testin précisém ent à ce niveau. Les expériences nombreuses qtffl fil ensuite confirm èrent l ’idée q u i lu i v in t à - - » d’a iin im e r a u suc pancréatique l ’action dissolvanto desl'e sp rit i graisses.
L’autre .conduit glandulaire q u i s'ouvre près d e l’estom ac, en m êm e tëtpps que Ur Ornai.pancréatique chez l'h o m m e , le chien la plupart des animaux, f t t l e canal cholédoque q u i conduit bU« liquide venant du foie et do n t les usages d ans les phénom ènes
' de là digestion ' sont peu connus e t paraissent se bo rn e r à une actlbo physique permettant aux alim ents d e chem iner p lus ftd k m cn t.
Leone; pancréatique n’agit pas seulem ent com m e dissolvant les il a u n e au tre action manifeste c l très-énergique su r les
Deux m ots, autrefois consacrés p ou r exprim er l’é ta t desalim enls, son t encore employés au jou rd 'hu i : le chym e désigne la bouilliea lim entaire so rtan t de l'estom ac; lo chylo désigne le liquideyésul- lan l de l'action de tous les sucs a lim entaires e t q u i passe dans des vaisseaux transparen ts appelés chylifères e t d evenant b ien visibles
s’ils é ta ien t rem plis de la it, quand la digestion se I mCes vaisseaux laités ou chylifères, découverts il v a (jeux il é té considérés a lors com m e destinés à recueillir ‘o n t é té considérés a lors com hio destinés à . recueillir .tout h „
d u it des digestions, q u ’ils po rten t, à l'aide d e canaux très lonj^ . ju sq u e dans une veine placée profondém ent à la naissance du col, sous la clavicule. <
A ujourd 'hu i, on sait q u ’une partie des liquides résu ltan t de jla digestion des alim ents est em portée p a r le s veines nom breuses qui ram pent avec les vaisseaux chylitères su r l’in testin . Toutes ces veines se réunissent p ou r traverser le foie. Lo sang reço it donc de deux m anières le p rodu it do Ind igestion des a lim ents. 11 le reçoit par les veines nom breuses qui couvrent l 'in tes tin e t par les vaisseaux blancs q u i vont po rte r lo chyle près d u cœ ur, d ans la veine sous-clavièrc.
L’absorp tion ou la i*énélration se fait à travers les parois des vaisseaux, e t on considère ce phénom ène com m e analogue au pas-
je de liqueurs à Ira vois un (jltre.L’intestin offre une longueur en rapport avec le m ode d ’a li
m entation . A insi, l'in testin du chien m esure tro is fois la longueur de son c o rp s; celui de l’hom m e, six fois; celui d u m outon, viugl- h u it fois.
Le chien est carnivore, l’hom m e est om nivore, le m outon est herbivore.
E t a t c i v i l « le S e u i l s .N aissant: t
Q uiot (Georges-Victor).M inait (M aric-Lénnliiie).G rausar (Eliso-Louise-Gcrmaine).
D ccès.P oirée (M nrigcnnc-Rcsliludo), veuve Cochet, 7 r. a n s ,4 mois. Dubois (M argiicritc-E inm a), 1 mois.Barré (Ilcnriclte-M arceline), fem m e Tassin, 45 alite 4 0 !frièis. B arb ier (Eugènc-Louis), 13 mois.
P ub lica tions d e m ariages.E ntre M. Vallée (Lonis-Félix), m aître -se rru rie r à Sentis, et
mademoiselle M orin-(ltosc-Ernoslinc), cuisinière à Senlis.E n tre M. Lange (Jean-B nptisle-Paulj, scieur d e pierres à Senlis,
e t m adem oiselle Fréchou (Jeanne-M arie), dom estique à Senlis. M ariages.
M. Decrept (llonoré-A lberl), e t m adem oiselle D eerepl (Maric- Thérèsc-Antoincllè).
prières e t do messes j o u r appeler les grâces (je Dieu su r la jeunesse.. Mgr lévêquo do lleàu vais a érigéT œ uvro en une association q u i
a é té aussi approuvée e t bénie p a r N otre Saint-l*èro le Papo Pio La jeunesse chrétienne, app o rte sa petite piérro à l’édilice placé
sous son patronage.
ÉTA T C IV II. IIK O.REIL. N aissances.
7 ju in . D cquivre (Aimablo-Olympe).— Kocli (Maileleiiie-Barbe).-
A f f a i r e C a d o r e t . — A tten ta is à la pudeùr. Sphir-Déstré Cadoret,-jouhiaiiefr àBldeourt,- eèt'acdùéé d ’atten- f i la p u d eu r, avec violence, s u r deux de ses enfan ts âgés do > do treizo ans.
MF*. Da Costa, s u b s ti tu t , PoutienM ’accusatien;; ................ * nto la (’
.0 - 10 - 14 - 10 - 18 - 2 1 -
Paul (Angustin-Louis). Lcclérèq (Jules-Frédérie). B inel (hmile-M arcel). - Clauwncrl (Eugène),
willo (C ln rhs-Q '\
T rassoit le (Charles-Oct a vo-N icolas).Bochcl (Jeanne-Augustine).
Publica tions d e m ariages.E ntre M. Amc.iu (Edm e-D ésiré), m enuisier, dem euran t «à Mon-
tere.au (Soinc-et-Marno), e t madem oiselle Masquelier (Mario- Désirée-Josénho), cuisinière, d em euran t à Creil.
v E ntre M. Devanneaux (Louis*Ambroiso-Ernosl), n u d lcu r à Creil, e t mademoiselle A nsart (Joachiine-Célmo-Josèplio), dom estique à Creil.
E n tre M. Ilelaplace (Louis-Léon), ouv rier au chem in de fer à Creil, e t m ademoiselle Desachy (Blanche-Anna), dom ostiquo à Civil.
E ntre M. Gcffroy (François-X avier), m anouvrier à Creil, e t madcinnisellc Aubin (M arie-Philomèno), ouvrière en boutons à Apreinotfl.
Enlro M. D upuis (Em ilo-Lucienl, charre tie r à Creil, e t m ademoiselle D upuis (Sévcrine-Virginie), couturière à Creil.
E ntre M. Clairet (Marie-Dieudo'nné-Auguslc), ta illeu r d e pierres à Beau vais, e t m ademoiselle Hoffmann (Catlicrinc-Thérèsc-Flo- rentine), demoiselle de magasin à Creil.
M ariage.1 i ju in . M. Kagne (A rm and), e t m adem oiselle Poulain (Julienne-
Augusline).Décès.
4 ju in . H allol (Adolphe-Narcisse), 57 ans.
. . . . . . travaux forcé* ............. .il 01 ,(1A Tt)m Audience du 19 ju in .
A f f u l r e B o l t c l . ~ i'A 1 ten lk t* 'à '\a p u d e u r .
Cliarles-Frençois-JosepljjBoih'l, p ffgo r, i j q m ip i l ^ Jçberm ont, est accusé d ’a tten ta ts à la p udeu r su r deux do ses filles âgées de m oins do treize ans. • ,
M. Cotclle, p rocu reu r im péria l, sou tien t l’accusation.M* Blancliet, avocat,* présente |a défense.Boitel, déclaré coupable par le jù ry , es t condam né à vingt année»
d e travaux forcés. •
7 - 11 -
17 - 20 -
G la la g /n y . — Le 18 avril I8G7, un cultivateur d u village de Balaguy (Dise), vieillard de soixante-dix ans, revenait (laps sa charre tte du m arché voisin. Arrivé au haut do la crête q u i descend à Balagny, il voyait un enfan t, couché près d ’une m eule de blé, t i re r de sa poche une a llum ette , la f ro tte r con tre son sab o t; r iu s la iil d ’après il apercevait d e la fumée au pied de la m eule cl l'eu lan t se sauvait à toutes jam b es ; deux m inutes ne s’étaient p is écoulées «pie la m eule é ta it to u te en flam m es ; des d ouze cents gerbes do n t elle se com posait, il ne resta it b ien tô t plus que la cendre.
Cet enfant, reconnu plus tard p ou r le fils d ’une veuve Lcgrand, c vivanl.que d 'aum ônes e t h ab itan t dans mm carriè re abandonnée
aux environs de lLilagnv, é tait tradu it p ou r incendie devant le tribunal d e Senlis, q u i le condam nait à tro is ans do correfciioh. E n exécution (le ce jugem en t, i l é ta it envoyé dans la-colonie «agricole du val d 'Y èvre, p rès Bourges (Cher). ’ - f f. 7 '
Pendant deux ans il est resté d ans cet établissem ent, m ais n'y voulant rien faire, ni à l'école, ni aux ateliers, ni au x cham ps. A ux.exhortations q u i lui é ta ien t faites, il répondait constam m ent qu ’il ne voulait rien faire tan t qu 'il serait enfcrm é,-m nis q ue si .on voulait le laisser p a r tir , il ira it chez sa sœ u r, m aîtresse d ’école «à C hantilly, et qu ’il s’y condu irait bien . Fatigué d e son inconduite e t désespérant de jam ais le. ram ener d ans la bonne voie, le d irecteur d e la colonie se d îc ida à ten te r ce d ern ie r m oyeu, et p ou r lui faciliter son re tou r chez sa sœ ur, il lui rem it une som m eue 15 IV.
Le m isérable en fan t n 'a pas tenu s i porolc ; au lieu d 'a lle r chezsa sœ ur à C hantilly, il s 'est a rrê té à Paris, ou ses 45 fr. n 'o n t |ias tardé à ê tre épuisés, et il y a (rois jo u rs il é ta it arrê té au m ilieujo u rs il a rrê té au m ilieud e la nu it en éta l de vagabond; ^
Edouard L egrand, (pii a m ain tenant douze ans, a com paru a u jou rd 'hu i devan t le tribunal correctionnel, où son histoire a été révélée. E ncore une lois il a essayé de tro m p er la justice p a r des feintes larm es c l un sem blant de repen tir , n u is le tribunal n e s'y e s t pas laissé prend re , et l’a renvoyé d ans une m aison d e co rrectio n , où il sera enferm é ju sq u 'à l'accom plissem ent de sa dix- hu itièm e année. (G azette des T r ibunaux .)
( 'B c r m o n t . — P lusieurs com m erçants de C lm n o n t o n t eu l 'heureuse idée .de proposer la ferm eture générale des magasins, études, e tc ., le d im an ch e; il para it q ue la proposition avait été fort bien accueillie p a r la m ajo rité des intéressés, m ais, à ce que p rétend le Sem eur , la p lu p art au ra ien t reculé dcvqnl u n engagem en t écrit e t signé, Los choses restent donc dans le sta tu quo , n u is nous espérons bien q u 'on a rrivera p rom ptem ent à s 'en tend re, e t à réaliser le projet do ceux q u i o n t pense q u 'u n jo u r d e repos par sem aine, é ta it non seulem ent u tile , m ais nécessaire.
C o y r . — Sous le litre : l 'n e Fêta religieuse (i la cam pagne, nous lisons dans 1 e. Peuple :
D im anche dern ie r, une cérém onie des p lus intéressantes réunissait, dans un d is jo lis villages de la forêt de C hantilly , une foule sym path ique, anim ée d e sen tim ents où la curiosité avait peut-être sa pa rt, m ais où la religion avait certainem ent la sienne : on posait'
.1., l’Zniicn .U l- «».. ..«la prem ière p iètre de l'église de Coye. On ne sait peu t-être pas jn’il faut de d évouem en t,d ’activité, de persévérance à unassez ce qu il tan t de rtc vouem ent, d activité, de p
cu ré de cam pagne, non pas seulem ent pour m ener à bonne fin la reconstruction de son église, m ais m êm e p o u r so m ettre en m esure de la com m encer. _
Celle prem ière p ierre , qundratn i l angularis, é ta it le résu lta t et le p rix d ’une im m ense effort.
La population l’avait com pris ; elle avait associé son zèle intelligent à l'a rd eu r de son tiaslcur. T outes les maisons étaienttapissées, toutes les rues jonchées d e feuillages; on eû t d it (pie la forêt elle-m êm e voulait payer son trib u t à cette fêle pieuse. D esancôté l'au to rité m unicipale n’av a it rien négligé p o u r tém oigner l'm térêl'm térè t qu 'e lle p renait à l'en treprise e t jiour en solenniser l'inauguration . A uprès de M. le m aire d e Coye éta ien t venus seranger plusieurs personnages ém inents, en tre a u tres M. Leroy de S aint-A rnaud, sénateur, e t M. lo vicomte d e P h u c y , d é p tilj do
r m anquait à la jo ie de cotte belle jou rnée , pas m ém o les ’un soleil auquel nous n ’étions p lu s liabiluéq, e t q u i ivec une sorto de com plaisance une brillan te procession
l’Oise.Rien ne
rayons d ’iéclairait avec une sorto de com plaisàncc une brd lanfè procession à laquelle tous les habitan ts avaient p ris p a r t; Ilte jeunes filles vêtues de b lanc, la fanfare de la com m une, sous la direction d ’un vrai m usicien, la com pagnie des pom piers, tam bour on tête, avaient égalem ent tenu à l’ho nneur d e grossir les rangs d u cortège et d ’en augm enter l’éclat.
On avait regretté que la san té d e Mgr de Beauvais ne lui eû t pas
présence u ne œ uvre a laquelle le souverain p ontife lui-m êm e avait envoyé hes bénédictions. Mais ce prélat é ta it rem placé par M, la b h é («affineur, chanoine do Beauvais, d irec teu r uu collégi S aint-V incent do Senlis, e t, com m e on a pu s 'en convaincre, éloq u en t préd icateur.
P lusieurs discours o n t é té prononcés : M. le cu ré , M. le m aire d e Coye, M. de Plancy e t M. Leroy do Sain l-A rnaud o n t to u r à to u r exprim é chaleureusem ent le désir d e v o ir s 'achever b ien tô t cette église, ob jet d e ta n t do vœux e t d o ta n t d'espérances, q u ’une pensée toute apostolique, a m ise sous l'invocation de Notre-Dame d e la Icuncsse. " A. Claveau.
Nota. — Celte église est destinée à perpétuer une fondation de
Rcangeois (inorl-né).P ru iithn iill (Adélaïdc-Zoé), veuve Delaye, 3 2 ans. T isseranl (m ort-né).W allct (Louis-A uguste), 1 an 2 mois.Guillaume (Marie-Nicoie), v* 'Parm enlier, (5! ans 1/2.
X â o iiy . t- M. Laffineur, ancien vicaire do la cathé«lrale de Noyon, ancien sujœ rieur d u sém inaire d o cette ville, e t en dern ie r lieu, supérieur de l'Institu tion Snint-Y iiicenl, do Senlis, q u i vient d ’ê tre cédée par Mgr l'Evcque. de Beauvais aux P ères M ariâtes, ’ient d’être nom m é cu ré doyen de Mouy.
K i t î i t i i n c s . — Il a rriv e presque chaque année quo la cérém onie du feu de la Sain t-Jean , q u i se célèbre dans la com m une de Sainlinos, est une occasion d e désordre. Nous apprenons q ue la soirée de jeu d i dern ier a é té m arquée p ar des scènes beaucoup plus regrettables encore q ue d e coutum e. Iles rixes violentes se seraient engagées en tre les hab itan ts de d iverses com m unes d is environs sq disputant la possession d e la fam euse perche q u i su rm o n te le bûch e r; des accidents fo rt g raves e n seraien t résultés e t on assu re m êm e q u 'un gendarm e a é té blessé.
Une instruction est, d it-o n , com m encée con tre les au teu rs do ce scandale, e t nous form ons des vœux p our q u ’à l'av en ir des m esures soient prises p ou r em pêcher le re to u r de pareils faits. Nous verrions sans peine disparaître une cou tum e issue d 'u n p r in cipe superstitieux e t q u i n a rien de com m un avec la saine e t véritable dévotion.
S * o S 3 c e c o c i ’c f r l i o m i c i l c < le S t c n l i g .
P r é sid e n c e dk M . B a u c iia r t .
Audience, d u m ercred i l à ju in 1809.D enis-M ichel C a r lry , âg é d e 2 2 a n s , né à F rc m e c o u r l
(S e in e -e lO ise ), c h a i r e l i e r , d e m e u ra n t h C re il. p ré v e n u d ’ou triig o p u b lic h la p u d e u r , a é té c o n d a m n é e n un m o is d e p r iso n , 1G f ra n c s e t a u x Trais.
— P ie r re A lexis S a v a ry , ôgé d e «54 a n s , n é à F o n ta in e S à lp t- l.u e le n , m aço n , d e m e u ra n t é g a le m e n t à G re it, pom pare il d é lit d 'o u lr .tg e p u b lic à la p u d e u r ré i té ré , a é té c o n d a m n é e n q u a t r e m o is d 'e m p r is o n n e m e n t , 25 f r . d ’a m e n d e e t a u x f ra is .
• Adolp! c-R em y P o isso n n ie r , ô gé d e 18 a n s , n é à C or neillcs (O ise), n ia io u v rie r , d e m e u ra n t avec sa fam ille D icudoitue, csl p rév eu u d 'a v o ir s o u s t r a i t f r a u d u le u s e m e n t d u n u m é ra ire ; ce je u n e , h o m m e «voue ce vol, m a is d é jà a n té r ie u re m e n t il a su b i u n em p riso n n e m e n t d e h u it m o is p o u r v(d d e h m êm e n a tu r e . Le t r ib u n a l c o u d a n i ne P o is so n n ie r e u tro is m o is du p r iso n e t aux f ra is . Le p è re du p iévcu il a é té d ih-h iré c iv ilem en t re sp o n sa b le d es f r a i s p o u r sou fils en co re tu m e u r .
— E m ile Doré,, âg é d e 38 a n s , o u v r ie r de c a r r iè r e , n é ( d e m e u ra n t à «Sèitlis, n ’a p a s d 'a n té c é d e n t ju d ic ia i r e , tirais peu d e jo u rs d 'in te rv a lle s , il a volé m ie p ioche d a n s m ie c a r r iè re d ’une p a r t e t u n sac. d e g ra in e s d e se m e n c e q u 'u n c liiir re lic r de fe rm e a v a it d é p o sé il in s u n c h a m p , d 'a u t r e p a r t . D oré se c o n te n te d u lieu c o m m u n : j 'a i tro u v é ! m ais cela n ’ex cu se p as so n ac te e t ne. fa it p a s d i s p a ra î t r e ce d o u b le d é lit . L e t r ib u n a l c o n d a m n e D oré e n q u in ze j n u s de p riso n e t a u x fra is .
— T h é o d o re C l.ihaiit, â g é d e 21 a n s , né à l lu lly , c h a r re l ie r , d e m e u ra n t a l.év ig iien , a d é jà é té c o n d a m n é p lu s ie u rs fois p o u r co u p s t-l b le s su re s , m ais rie n ne. p e u t r e te n i r son n u tu iv l v io len t, e m p o rté e t m é c h a n t. Le 15 d e ce m o is , é ta n t iv re selon son h a b i tu d e , il a b a l l t t un c a b .i re l ie r , sa fem m e e t se s i n f i n i s , p a rc e q u ’ils lu i re fu sa ie n t d e s b o isso n s d o n t il n 'av a it pas b eso in , et il a b r is é les c lô tu re s d e la m a iso n d u d it a u b e rg is te . Le t r ib u n a l c o n d a m n e F.lnhuttl e n tro is m ois d e p r iso n , 50 f ra n c s d ’an tc iid e e t aux fra is .
— L ouis-A uguste R ag iic t, âg é de CI an s , m a n m iv ric r , n é d e m e u ra n t à S a in t-L e u d ’E sse iv iit. a in ju r ié ib-s a g e n ts - ch em in de fe r à la g a ie d e S ah tl-I.e il c l sV st m is en é ta l de réb e llio n lo rsq u 'i l a é té q u e s tio n d e l 'e x p u lse r d e l’en cc in tc où il é ta it e n tr é sa n s beso in n i p e rm iss io n . Le t r ib u n a l c o n d a m n e le d it R aguc t e n 8 jo u r s d e p r is o n , 10 fr . d 'a m e n d e c l a u x fra is .
— Z ép liir in -Ju les-E rn csl D o larg ille , âg é d e 21 a n s , lté à F iq u iè rc s (S om m e), sc d is a n t m a ré c h a l- fe r ra n t, d e m e u ra n t où il tra v a ille , ce q u i se I n d u i t p a r : s a n s d o m ic ile , p u is ' q u ’il ne tra v a ille ja m a is , a su b i d iv u s e s c o n d a m n a tio n s nom vol, e t p a ra it d é c id é à ne p lu s rie n f r i r e q u ’e r r e r d e cô té cl d ’a u tre ; il ne n ie p a s q u e la vie im m o le fait m ieu x son a ffa ire q u e ce q u e l'o n p eu t lu i o ffr ir do p lu s a v a n ta g e u x . Le tr ib u n a l c o n d a m n e ce t h o m m e e n d e u x m o is d 'e m p riso n - iicm cn t c l aux fra is .
COUIl BVASSISSES D E L’OISE.Présidence doM . D a v o s t , Conseiller à la C our im périale d ’Amiens,
Audience du vendredi i H ju in .
A f f a i r e l â c h a » . — A tten ta t d la p udeur.Dehnn (Atigusle-Théodore), charretier, né lo 13 octobre 1844 à
Russy-Bémonl, prévenu d ’a tten ta t à la p udeu r avec violence su r...... ....... . ou ., f...A* .1.. « o ...... .,« ______l . i „ ■_____une jeune tille âgée de 12 ans, e t déclaré coupable avec circonstances a tténuantes, a été condam né à six ans do réclusion.
IiC siégo du m inistère public é ta it occupé par M. Da Costa, substitu t.
M* Félix Leroux a présenté la défense.
A f f a i r e f i l l e T h i e r r y . — A tten ta ts à la pudeur.Li nom m é Léonie-Angélina T hierry , ouvrière épiuceusc,
dem eurant à Beauvais, csl accusé» d ’avo ir com m is d re a tten ta is i tro is en fan ts âgésla pudeur tentés ou consom m és sans violence su r Irois ei
de m oins de 13 ans. c l un ou trage oublie à la pudeur.M. Da Costa, subU itu t, sou tien t l'accusation.M* Rose, avocat, présente la défense, loi ju ry rapporte d e là cham bre de ses délibérations un verdict
négatif su r 1» chef d’outrage public à la p udeu r, e t affirm atif sur Ire au tres chefs.
En conséquence, la fille T hierry c s ta ru u illé o c n ce (pii concerne l’outrage public à la p udeu r, c l condam née, pour les a tten ta ts à lupudeur, en cinq années do réclusion.
P .B lauchel, avocat, présen te la défense.%2ccw > reconnu coiqiolfle, fuàls favec 'adrùiteion-’ d o circons-
' ‘ • • • - w cos d e f ‘Muantes, csl condam né h vingt annci
L E S A L 0I L DE 1869.M . P ie rre Billet.
Monsieur le D irecteur,
S achant o u ’u tilisan l les loisirs b ien ra re s , hélas! que me donne La politique, je m ’occupe u n peu do c ritiq u e d ’a r t , vous voulez b ien m e dem an d er m on avis s u r d eux tab leaux exposés au Salon sous les num éros 234 e t 235 e t signés B illet . Votre lettre m ’est arrivéo l ’avanl-veille de la ferm etu re , e t si certaines circons-ta n i- ra n n m ’av.-iiimt rtna Tar/tricA il m ’m'il n n .1 ,« l . l . ^ ^ « ...tances no m ’avaient pas favorisé, il m ’eû t probablem ent été
idrc à vo tre d ésir, ce q ue j ’aurais vivementim possible de m e rem regretté.
H eureusem ent, j e connaissais les deux toiles d o n t vous me p arliez; elles m ’ava ien t Irappé, m oi com m e bien d ’au tres , et sans re to u rn e r au Salon j ’au ra is pu vous d o n n e r m on h u m b le Avis sur elles. J ’ai pu cependan t refaire le voyage des Champs-Elysées, et m e voilà avec m on pe tit Iragage d 'im pressions nouvelles. ’
Les deux toiles de M. B illet so n t ti caractère b ien différent.
t so n t très rem arquables e t d ’un
Le' n* 234 représen te u n pêcheur s u r la place d ’Ambleteuse(Pas-de-Calais). C’est u ne toile d é chevalet d ’une b onne dimensionpour nos ap p artem en ts exigus. La scène, b ien sim ple , se passe à ■aube; elle a p ou r cadre le cie l, la m e r c i la te rre . La, te rre : ’est u n te rra in q ue vient visiter la vague à. la m arée h au te . Le citi
est légèrem ent b rum eux , m ais profond ; on sen t q ue derrière ces nuages gris c la ir est l ’im m ensité . La n ie r n ’àp p ara lt q u ’à l’horizon;sa nappe verte e t m ince que frange l’écum e argentée d e la vague relie le ciel à la terre .
S u r le p rem ier p lan , u n pêcheur, d ebou t e t incliné, pose ses m ets q u ’une fem m e accroupie fixe su r le sol à l ’aide d ’u n piquet
Com m e on le v o it, la scène, répétons-le , csl fo rt sim ple et né vise p as.à l ’effet d ram atique . Mais il y a ta n t do calm e e t tant de vio à la fois dans cet le com position, q u ’oo s ’a rrê te p ou rla iw arder. Com m e faire, e t c 'est là le vrai m érite , ce tableau révèlo une habileté peu com m une, une g rande ferm eté de touche;l’app rêté , pas do procédés vulgaires, pas do ficelles : c’e s t là xcellcnte page d 'u n ta le n t q u i s 'affirm e.
Le second tableau a p o u r légende : L a P artie de M . le M ain .Ici nous som m es en plein tableau de genre . loi peintre e t l'observa teu r o n t chacun sa tâche , e t j ’ai hâ te de d ire q u ’elle est bien rem plie par l ’un e t par l 'au tre .
V oici la com position :D errière un rideau de verdu re d ’u n cô té e t le m u r d ’u n cabaret
do l’au tre , se d resse u n e tab le a u to u r de Laquelle so n t assis quatre: mr - A
im p o rtan t, com m e aussi «à l ’a tten tion tlèfé- ronto d e la galerie, est en tra in d a llu m er sa p ipe au chaudron decuivre, to u t en m éd itan t s u r le coup de cartes. Son partenaire se fait verse r à bo ire . Les d eux adversaires d e M. le Maire attendentsa décision, l'un avec anxiété , l 'au tre avec insouciance. Derrière so l ien n eu t les iuges çhi cam p , graves com m e il convient à des tom oins do com bat. Au fond u'no servan te em plît à la tonne un
U ne p e tite scène p rise s u r le v if e l très-finem ent rendue. Chaque personnage-a b ien la p ose et* la physionom ie q u i lu i convient. T ra ité m oins n p g is lra lcm cn l q ue le p rem ier, m ais dans une excellente g am ine de tons,, ce tableau ne m anque n i de vigueur ni do vie. Nous avons to u s v ii ces paysans, nous connaissons tous ce m aire , e t en signalant le caractère do,vérité de ce tte œ uvre do fine observation, nous faisons son éloge co ipp |e t. E tre vrai est l’a r t do la nein tiire tout entier.
Le liv ret po rte q ue M. B illet est élève de M. B re to n ;___serions assez, disposé à le croire, nous, élève do Ja u ro n ; quoi qu’il en so it, M. B illot a assez de valeur par lu i-m êm e p o u r ne suivre personne, |»as m êm e les m aîtres. Nous lu i conseillons d ’être lui, rion q ue lu i; il y a assez d 'o rig inalité d ans son pinceau pour faire un pein tre e t un lion pein tre .
Nous som m es habitué à respecter les décisions d e to u t ju ry , en peinture, com m e en m usjqu»; néanm oins, nous ndus demandons pou rquo i M. Billet n ’a pas ob tenu une médaille. Heureusement, l'avenir est là p o u r fo u rn ir ù M. Billet l’occasion, n o n pas de h m é rite r , c ’est fait, m ais d e l 'ob ten ir.
E .-M . Ée Lydex.
1 Ï 8
— u «.«.i» ncTuitiu «îu v.uiivuuit> uu ut-auvais zuo prix pourl'cs|>ècc bovine, d 'u n e v.delir de 30,G85 f r ; 40 p rix a l ’esiièa ovine, d ’un» valeur de 7 ,9 3 3 fr. ; 2 2 p rix à l ’espèce porcine, d unet'.llillip fin Q IRQ (v . O» tinv . .. .. 1____ 1«.__
L’adm inistra tion de la guerre v ien t d e tran sm e ttre a iik colonels des rég im ents l'au torisation qu 'e lle acÀordc cliaque année’pourque ces m ilitaires so ien t m is à la disposition dés c u ltiva teu rs pour la faucltaison ( de la m oisson. Les dem andes des explo itan ts doivent ê tre adressées à la p réfecture, q u i les transm et aux chètë de corps avec les a ttesta tions nécessaires.
Nous em prun tons «au S a lu t p u b lic le p o rtra it suivant du « m in eu r. »
J 'a i en tendu d ire p a r quelques personnes q u e parm i les mineurs de Sain t-E tienne se trouvaien t beaucoup d é trangers, des Brlgej e t des P iém ontais. C’est u ne erreu r.
La population des m ineu rs es t exclusivem ent indigènes. On est m in eu r do père en fils. Dès q ue l ’enfan t iwmt ê trè employé dans les m ines, il e st enm ené par son père , il débu té p a r le travail que son âge perm et de lui confier, e t arrive peu à p eu , — son amb ition suprêm e, — h être p iqueu r, nom m e l'é ta ien t ses aïeux.
C(esl un rude m étie r que celui de m ineu r : à c inq heures du m a tin , il descend d ans la carrière o ù iiendant douze heurte.éclairé p a r une lam pe d o n t l ’éclat rapjlelie peu celu i des rayon* du soleil, il travaille, tan tô t conché s u r le ven tre , ta n tô t sur ledos, ta n tô t su r le flanc. Nous ne parlons pas des dangors do tout* espèce auxquels il e s t exposé; le p lu s effrayant do tous est h te rrib le feu grisou , q u i tu e les hom m es com m e des m ouches; put* ce so n t les inondations e t lcs ,éb o u lem en ls . H abitué S ,Vivre»u m ilieu de ces dangers, le m in eu r e s t d ’une insouciance quede cruels exem ples ne corrigent pas . Au risque de faire éclater h feu g risou , e t p ou r so d onner un vulgaire plaisir, il a llutoo sa pipe- Les explosions, q u i fon t ta n t de victim es, n ’o n t souvent p** d ’a u tre origine.
Le m in eu r est fo rt igno ran t e t s'occupo peu , jo c ro is, de poli* tiq u e ; le tcm p s lu i m anque p our lire . L orsque, lo so ir , il est sorti do la m ine, il s’assied s u r le pas d e sa po rte , o u , en causant avec scs voisins il m ange sa soupo dans t e pot do te rre , — exclusivem ent sléphauo is, — q u ’on a décoré d u nom do bichon. U souper achevé, e t arrosé quelquefois d ’u r i verre do vin, il * coiicho e t reprend lo lendem ain son existence do la veille.
C elte vio, — m onotone com m e u n çonato, — n ’ept interrompu*n u e n n r lo repos d u d im anche. Ce jour-là,’ le m in eu r, ignora^ (leâ ab lu tions pendan t to u te la sem aine, so débarbouille^ s 'au leverdo l’au ro re , dans d eux ou tro is seaux d ’eau , q u ’il transform e *• encre. U ne partie de boules, uno sta tion au cabaret cQnstil,,e,,les un iques d istractions do la journée.
C’est là , com m e on voit, une d u re existence, e t bien faite |>o‘ir nue ceux q u i la m ènent se sen ten t p ris , ià de certa ines licurtt, désir de la voir s’am éliorer.
s’imposo c Les méi
flam m e p; par les g n cam iiagne place, apè venir avec e t le plant
Les vigi l l a g r ê l
•artou t recoiffées (
-septentri»!tyrolienne
Qu’avor
O n l i t dt iO C r é
qu i à tt ire . paraître .
Ju squ 'à fondée no liesoins de
. h autem ent L echiffi
d ix m itliaiéloquente.
UniU ne lart e t le t l |* ë ( sable des o
L esy s tè L e € r é d l actuelle e t H pe pliera les itiainsc le ttre .de g spéciales, transmissii
. Do nqm faciliteront le i p rê ts e
, sa tio n d es A idé d<
Crédit ru r B’esl traçai
L ad e tU à lO .ou 1S
. ou tro is ce no tranafoi de tte , u n i cen t,), lu i m ontera' d aussi cons do chcrcli' ce tte entre
L acom ] leu rs à ch
. agissemeni succès; o r V r a n e e
. cette instil dans l ’ave
L ’agricicapitalisteavantageu
E n ex tou tes les
Los a j
N » du Ilcgi m airie
t i n t7ü(
135<1431
1491<150!
102!1 0 2173!174
Claei
E tu d e i (Ois

C 'était lund i lo p rem ier jo flr do l’é té .. . .Q u 'avons-uous la it h paint Médurtl ?Ço b ienheureux prend tro p a u série*x son em ploi d e d irec teu r
général d u service d ’arrosage.Paris so noio dans son in acad am ; P aris se lève tristem ent,
regardant lo ciel som bre. Il p leu t de la m élancolie; lo fro id h um ide des m auvais jo u rs do novem bre est e n tré dans la m aison e t s ’y est in s ta llé 'co m m e u n garnisairo. C’est l’hô te désagréable (pii. s'im pose e t f a i t la loi chez les b onnes gens fanatiques d u soleil.
Les m énagères g ro n d en t en ra llu ih an t le feu q u i fum e ut no flam m e pas. Les ouv riers songent aux blés couchés d ans lo sillon p ar les grandes p lu iqs.V ienno 14 S a in t-Jean , e t, dans nos riches eam pagncdu C entre, les m oissonneurs .qu i s'assem blaient su r la place, a p te s la p rem ière messe, m anqueron t à la louée. Pourquoi ven ir avec les faucilles en tourées d e joncs» L’épi ne s’ost pas,doré et lo p lan t s’étiole dans la boue.
Les v ignerüns'on t des tristesses noires., I l a grêlé d im anche, & P a ris , des g réions g ros com m o des oeufs do pigeons. L e so ir, il ag ra it fallu s em m itoufler de fourrures..
P a r to u t de» pluies glaciales; le s m ontagnes d 'A u v e rg n o /o son t recoiffées d e b lan c ; il neigeait, v c id rcd i e t sam edi, dans l'Ita lie
<-Mptenlfionale,isiir j e v e rsa n t des C risoôs e t au p ied des Alpes tyroliennes. ' ‘ ' ‘
Q u’avons-nous (hit h sa in t Médard ?
O n li t d ans le Jo ilrna l officiel :Le Crédit Rural de Piquer, te l e s t lo titre sym path ique
q u i à tt ire l’a tten tion e t inv ite à lire u ne notice q u i vient de . paraître .
Jusqu ’à présen t, aucune in s titu tio n géuéralo d e c réd it n ’a été fondée p o u r satisfaire d 'uno façon s'pécialo e t exclusive aux besoins d e l’agricu lture . Cependant lus in térêts ru rau x réclam ent
. h au tem en t u ne in stitu tion de ce genre*Le chiffre de la de tte hypothécaire ru ra lo , qui s’élève à plus de
d ix m illiard» d ’ap rès les sta tistiques pfliciclles, en e st u ne preuve éloquente.
U ne large place e s t-d o n c vacante. Cette place va ê tre occupée, et le Urédli Rural do France sera l’auxilia ire ind ispensable des com icès e t de to ü to s 'lrs au tre s associations agricoles.
Le systèm e dé la Com pagnie e st d u n e sim plic ité rem arquab le . Le Crédit Rtaral de fraUee va transfo rm er la dette a c tü d le e t s e substituer aux- parties enlrolosq u tiles e lle e s t étab lie . Il (je p liera aux usages des em p ru n teu rs ru rau x , e t rem placera , dans les ib a in sd u p rê te u r ,.to c p n tra t no tarié , d ire c t e t gênan t, p a r une • Icttre'.de gage qui le m obilise ctM ui conservé les m êm es garanties spéciales, jo in te à l ’exactitude du p ayem en t e t à la facilité de transm ission d e i valeurs de bou rse .
Do nom breuses succursales,sociétés indépendantes elles-m êm es, faciliteront les opérations hypothécaires, feron t p o u r leu r com pte le j p rê ts chirographairew .aux ag ricu lteu rs , e t a ideron t à l’orgaui-
, sa tion des en trep rises locales d ’in té rê t agricole.A idé d e ces auxilia ires m u ltip les, pu issants e t g ra tu its , le
Crédit r u r n ld e F rance m archera rap idem ent dans la voie q u ’il b’csI tracée c l réalisera des bénéfices très-im p o rtan ts .
L a 'd e tte s u r Laquelle va opérer lo Crédit ru ra l s’élève, en effet, à lO .ou 12 m illiards. A dm ettan t q u ’avec lo concours d e ses deux
. ou tro is cents bras é tendus s u r tou te la France, 1 a Crédit ru ra l no transform e quo le d ix ièm e, ce q u i es t inadm issible, do cotte d e tte , u n avantag j d e 50 cen t. Q/0 (le Crédit foncier perçoit 60 cent*), lu idonnora un .p ro d u it annuel do 6 m illions, q u i s’augm entera ' do l ’iritérôt d u capital luU nôm c c l du p ro d u it p eu t-ê tre ' aussi considérable de"scs au tre s branchas ; il n ’est donc pas utile do ch e rch e r‘des com paraisons p ou r ch iffrer les bénéfices réservés à ce tte en trep rise .
la» Composition de son conseil, lo soin quo m e tten t les fondateu rs à classer Ips actions daps lo p u b lic c l à év iter ainsi les agissem ents prém aturés d e la spéculation , son t a u ta n t d e gages do succès; o n peu t donc lo d ire hau tem en t : le Crédit ru ral de Fraqee est l’uqo des p lus belles créations do n o tre époque, et
. cette in stitu tion nationale est appelée à jo u e r un rô le im portan t dans l’av en ir d e la France.
L 'ag ricu ltu re no pouvait désirer u n plus puissan t aux ilia ire , les capitalistes no sauraien t tro u v er un p lacem ent p lu s s u r e t p lus avantageux .
SOUSCRIPTION A 35 ,0 0 0 ACTIONS DE 500 F IL DU
C R É D I T R U R A L D E F R A N C ESOCIÉTÉ ANONYME
A utorisée par décision des assem blées générales des 27 jan v ie r e t 31 m ars 18G9, déposées avec les s ta tu ts au rang des m inutes do M* G autier, no taire à Paris, le 2 8 m ai, à élever son capital par l ’émission d ’hetions ju sq u ’à concu rrence do *
l / i s i g t f l i a i l l î o n s « l e I W t n c s .
CONSEIL D’ADM INISTIÜTION.M. lo général b aron do Gond recour, G. k e ; p ro p rié ta ire , m em bre
d u conseil général d u Lot-et-G aronne (P résident).M. le m arqu is de M ontlaur, 0 . * , v ice-président du conseil
général d e l’A ilier, m em bre de la Société des agricu lteurs de France.
M. Moll, O . * , professeur d ’agricu lturo au C onservatoire des ' Arts-ct-M éticra, m em bre do la Société im périale, d ’ag ricu ltu re ,'' ad m in is tra teu r d e la Société dès-agriculteurs de France.
M. lo duc do M arm ier * , p ro p riéh ù rc , dépu té a n C orps législatif (dernière' législature).
M. G nidou, * , avoué honoraire , ancien p résiden t de la Cham bre des avoués de la Seine.
M. le m arqu is d o D auvct, p rop rié ta ire ,'m em b re do la Société d e s .agricu lteurs d e France. \
M. I/Jvassor-Scrval, C. te , p rop riétaire , général de d ivision.M. lo m arqu is de Reyniès, p rop rié taire .M. B aradnt, p rop riétaire , m em bre d e la Société des agricu lteurs de
F rance (D irecteur délégué).CONSEIL SUPERIEUR. (Q uelques-uns d e ses M embres.)
M. L arrab u rc , 0 . te , sénateur, conseiller g énéral, m em bre de la Commission supérieure de l’enquête agricole.
M. le baron M artrin-Donns, p résident d u Comice agricole de N ar- bonne , m em bre d e la Société des agricu lteurs de France.
M. Chesiielong, 0 . t e , député au C orps législatif.M. Salam an, président de la Société d ’ag ricu ltu re de l’A ude,
m em bre de l.q Société des a g ricu lteu rs d e France.M. de R oincur, G. te , ancien m ag istra l, président d u Conseil
général do la Ilàute-Loiro.M. le com te de V itrollcs,' p rop riétaire .M. Ti ssonnière, t e , p rop riétaire , président d u Conseil général de
la Lozère.M. L subet, p rop riétaire , p résident d u Com ice agricole, m em bre
du Conseil général do Vaucluse.M. le com te de Percy, t e , président de la Société d ’ag ricu ltu re d e
d e S em u r, m em bre de la S ociété des ag ricu lteu rs d e France.M. Fouqucl, président d e la Société dès ag ricu lteu rs d e France.51. le m arquis duB ourdeilles, propriétaire .M. le com te de D aüvel, p ropriétaire.
E tc ., e tc ., etc.OPERATIONS. -
Le Crédit R u ra l de France consent des p rê ts hypo thécaires; m obilise e t Iransform o au moyen de ses le ttre s d e gage, la de tte hypothécaire ru ra le évaluée à plus d e d ix m ill ia rd s pa r les d o cu m en ts officiels; facifilo les p rêts ch irographaires quo do n o m breuses succursales, organisées su r tous lis po in ts de l'E m pire , feront à l’ag ricu lture , c i aide à la création d e tou tes en treprises d ’in té rê t agricole; travaux d ’irrigation , petits chem ins de fer, d é frichem ents, dessèchem ents, e tc ., etc.
SOUSCRIPTION.Les actions so n t do 500 fruhes. E lles se ro n t rem boursées à
GOO francs.A u x avantages de l ’action se jo ig n en t, dans ces t itre s , toutes les
bonnes conditions de l’obligation :1° Un in té rê t d e 5 0 ;0 leu r es t alloué a v an t to u t p artage e t payé
d ans la France en jan v ie r e t ju ille t.2 ' Ils p rennen t leu r part à la répartition des bénéfices.3° Leur cap ita l, p lace su r hypothèque, e s t rem boursé à GOO f r .,
e t l 'actionnaire conserve, m êm e ap rès ce rem lm ursem enl, une ac tion bénéficiaire q u i q u i lui m ain tien t s e s d ro ils s u r les bénéfices et dans la p rop rié té d u fonds social.
An . I 5 0 fr . par action on souscrivant.u n v e rso . j 7 5 i , a r<tpi>rti , jo^ . , :
Aucun n u ire appel de fonds ne pouvant ê tre fait q ue s u r délibération du Conseil d ’adm in istra tion , au p lu s tô t dans q u a tre m ois.
Les actionnaires o n t lo d ro it de se libérer p n rn n lic ip a tio n , c l de verser le p rem ier q u a r t en en tie r en souscrivant.
Les actions libérées do m oitié p o u rron t ê tre d é l iv ré e au porteur. ■ La SO U SC R IP TIO N publique ne sera ouverte que le 5 ju il le t , à P aris, au siège social, rue Scribe, «• 5 .
Mais DES AUJOURD’HUI les dem andes des dé|iîirlemenl.s ac- co inpagnéasdu jirem ier versem ent de 5 0 francs, reçues p a r correspondance, séria it classées jo u r par jo u r , e t les dernières seront seules réductibles.' Lo Conseil d ’adm inistra tion aura la faculté de clore la souscription dès q u ’il jugera q u ’cllc a a tte in t une som m e suffisante, conform ém ent aux délibérations ci-dessus relatées.
Envoyer 5 0 francs pour chaque action , en espèces ou m andats su r Paris, ou verser d m fonds dans T une d es succursales do la Banque de France, au com pte do 51. B u i.vdat, directeur du Crédit H kral de France».
■•Donner oxactc’incnl ses nom s, p rénom s, adresse; e t le nom bre •d'jfclionii souscrites.'
SOCIÉTÉ ANONYMEP oin LA SOUMISSION, LA CONSTRUCTION ET I.’HXPI.OITATION
d u chem in de fe r
m i î m a c i h l o x s - s i m a b s eM IS E N A D JU D IC A TIO N
P a r décret im périal du 2 0 m ai I8G0, en exécution de la loi du 18 ju ille t 1868.
S ta tu ts reçus p a r M ' M OÙCIIET, no ta ire <i Paris.
C a p i ta l i i iO n iiE lio n s .ilirtue e t définitive à
120,000 obligations.Souscription publique e t définitive à €0 ,0 0 0 actions e t
Les actions son t de 5G0 francs, payables :ICO francs à la souscrip tion ;100 francs à la répartition q u i suivra l ’ad judication :300 francs par term es égaux de 100 francs, d e six m ois en six
m ois à d a te r uc l’ad judication.IjCs in térê ts e t dividendes se paieront les 1 " ja n v ie r c l 1 " ju il le t
GARANTIES ET AVANTAGES ATTACHÉS AUX ACTIONS.1° Affectation spéciale de la subvention d e l ’E ta l a ssu ran t A 0 /0
d ’in térêt e t l'am ortissem en t;2 “ Revenu du trafic, d o n t le m in im u m , d é te rm in é p a r les s ta
tistiques officielles, assure encore, A 0/0 de d ividende.Total, 8 0 /0 d e revenu an n u e l, sans ten ir com pte de l ’augm en
ta tion norm ale des produ its j .3* D ro it d e souscrire , aux prix exceptionnels de 275 fr . par
privilège, m ais sim u ltaném en t, deux obligations par chaque action, m oyennant le versem ent im m édiat d e 2 5 fr. par obligation.
Les obligations so n t .rem boursables à 500 IV. e t produisen t 15 f r . d ’in té rê t annuel, payables les 1 " avril e t 1 " octobre.
T o u t p o r t e u r (Tu n e a c t io n fa i t p a r t ie d e l’a s se m b lé e g é n é ra le .
Le capital-action sera défin itivem ent fix é su ivan t le ch iffre de la subvention.
ADMINISTRATION ET CONTROLE.Les m em bres d u Com ité soum issionnaire do ivent ê tre agréés
par le m in istère des travaux publics. (A rtic le 3 d 'u n arrê té an térieur.)
I / i répartition des actions, s’il y a lieu , sera faite sous le contrô le de l ’au to rité . (M ême a rtic le .)
Le conseil d 'ad m in is tra tion sera nom m é en assem blée générale. (A r t. 10 des S la tu h .)
COMITÉ PROMOTEUR :Le général do division d e P reu illv , grand-officier d e la Légion
d 'h o n n eu r;
Le com te do M onlesquiou-Fczcnsae;1/5 v icom te d e B oisguilbert; , .Eugène Dupin (fils d e P hilippe), conseiller général de la Nièvre’,
chevalier d e la Légion d ’ho n n eu r;A. Jacquesson, chevalier.do la Légion d 'Jiopnçui, de la .maison
Jacquesson e t F ils, négociants à Chàlons-sur-M arne.
CONSEIL D ’ADMINISTRATION ; ,Les m em bres d u conseil d 'ad m in is tra tio n , sau r leu r acceptation,
seront choisis, en o u tre , c l à côté «fc quelques grandes influences centrales, parm i-les som m ités locales?, c’est-àrdire ; Y
Les Maires d ’O rléans, M ontargis, Sens, Troyes, Arc/f-suV-Aube, Chàlons-sur-M arne; * . ,
Les D éputés, Conseillère généraux, Présiden ts des T ribunaux de com m erce e t g rands Propriétaires ou industrie ls des départem ents du Loiret, do l ’Yonne, d e l’Aube et de la 5!arne.
VERSEMENTS A FAIRE : 'Pou r une action . 100 fr.P o u r deux obligations. ..................... 50 fp.*P a r souscription sim ultanée. . . . . . . 150 fr.
Chaque souscrip teur p eu t verser, chez son b anqu ier ou son agent d e 'c liangc, so it en espèces, so it en valeurs cotées.
L’envoi peu t ê tre la it d irectem ent p a r leltre chargée é l adressée au d irec teu r do l ’Union des A ctionnaires, 18, C haussêc-d’A ntin, à Paris. ____________
LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE DU 20 AU 3 0 JU IN : .-A P a r is , dans les bureaux de l ’Union des A ctionnaires, 18j
Chaussée-d’A n lin ;E l dans l e s d épa r tem en ts , chez left co rrespondants/le l'Union
des A ctionnaires, ind iqués par les feuilles locales e t les a-fiches.
NOTA. — P our tous renseignem ents e t docum ents, S ta tu ts , Carte^, Notices, T ableaux d ’in térêts e t d'am ortissem ent p rogressif. Comparaison de la va leu r des actions e t obligations d u Chemin dn fe r (VOrléans à Chdlons-sur-SIarne, avec les actions e t obligations des au tres chem ins de f e r frança is ,, s'adresser a n directeur île / 'U nion ues A ctionnaires, 18 , Clihussce^d'Anlin, à Tcorrespondants.
i P aris, e t u s e s
I es m isères, dangers e t désappoin tem ents (pie, ju sq u 'ic i,.le s m alades o n t éprouvé* dans les drogues nnuiéiliim ilc-i, se trouvent a p rcscu t rem placés p a r la certitu d e d ’une rad ie a lo e t prom pte guérison m oyennant la délicieuse Rcvaleseièrc D u Barry d e L ondres, qu i rend , la pa rfaite san té n u i organes de digestion, aux n rrfs , poum ons, foie e t memlirarjc m uqueuse, aux p lus épu ises m êm e, guérissan t les mauvtiii.es digestions (dyspepsie), gastrites , gastralgies, cnnsti|ia (iou . habituelles , hém orroïdes, g laires, ven ts, pa lp ita tions, d ia rrhée, gonflem ent, é tourd issem ent, bourd onnem ent dans les o re illes , ac id ité, p itu ite , nau. ces e t vomrsvemeuts, dou leur i. a ig reu rs , c ram pes e t spasmes d 'cslom ac, insom nies, lluxion de p o itr ine , cb ôrose, tlueu r blanche, toux , opj resvinti, asthm e, b ronchite, phlhis ic (consom ption), d a rtre s , é rup tions, inélnn -olié, d é , crissem ent, rhum atism e, gou tte , fièvre, catarrhe* , oppression, cloulTrm eut, hystérie-, név ra lg ie , vice d u sangj hvdropisie, m anque de fraîcheur e t d 'énergie nerveuse. _ 1
I lus nuiirriSYantc que la viande, e lle rend la san té et tV otm m iie 50 foi* son p r ix en nu-dceiuc. Kn boites : l / t l i t . , 2 f r . 3 5 ; I L it., 7 f r ; 12 fcil , Cü f r . — Du Barry e t C*, 26, plarc 'V cndôm c, Paris.
A ppétit, d igestion, som m eil c l énergie rendus p a r la B cralestâèrc Cho- rolsitee aux personnes, e t faux enfan ts les p lu s faibles, e lle n o n rri t trois- foi* p lus que la viande e t rend les chairs ferme*. — loi tab lettes pou r C lasses, 1 f r . 2 5 ; pou r 12 t , 2 f r . 25 ; 24 t , 4 f r .; 40 I , 7 f r . Kn Imites eu poudre d e 12 tasses, 2 fr. 25 ; de 57G lasses, CO fr. ou env iron 10 c . la lasse. — Du Barry e t C ', 2G, place V endôm e, Paris.
Le p lus p u r e t déli- a t Chocolat e s t la « Perfection de Chocolat D u B arry : ■ prépa ré san» mu tin m élange du fceules ou a u tre s substances nuisibles ou pâteuses, pa r des machine* spcc alcs qui en lèven t au cacao le n t p rincipe d ’échauflem eut ; ce C ho-o la t est t ai fadem ent soluble e t c onvien t a ax estomacs les p lu s délirais.ou irritab les, c j justifia pleinem ent to n nom « le . Perfection. ■ Ko ta ldclU s d e 75 e . tu I f r . , so it fi fr. t c k i l . ; qualité vanillée à 1 f r . e t 2 f r ., 's o it 8 fr, le Lil. Un l i l d e ce C hocolat a lim ente mieux que 2 Lil. d e Chocolat « r.lh ia ire , e t p a r re lie raison il’est m oins coû teu x . — D u Barry e t C*, 26, place Vendôme, Pa ris . —■-ü J p o t à Sentis, chez MM. Mercier e t Donon, épiciers, c l chr**Ics pharm. o l cpic.
L e P ropriétaire-G érant : E rnest P a v e s .
Ar t k l g 1 " .
CAISSE D W A R O T DE SEW LIS.En
toutesLos
En exôm tion tlo T arlic lo A de là loi d u 7 m ai 1813 , le Conseil d 'ad m in is tra tio n inform e les intéressés quo les dépô ts ci-dessous énoncés, abandonnés p a r leu rs titulaires depuis l'année 1839, seront, au p rem ier janv ie r p ro c h a in , convertis en rentes su r l'K la t, e t que es les inscriptions ren tes achetées p a r app lica tio n de celte m esure, ou m entionnées dans la présen te pub lication , se ro n t rem ises à la Caisse des dépôts et consignations..os ayanU -droits so n t en conséquence in v ité s à faire avant le 31 d écem bre prochain tou tes les diligences nécessaires a u p rè s de la Caisse d ’épargne p our prévenir la conversion d e leurs dépôts en ren ies e t la consignation dés inscriptions d e rentes.
N“ . du Registre m atricule.
457553564G50700985
13541438
1493 i: 1599
11-22162517391741
NOMS E T PRÉNOMS.DATES
d e la prem ière opération .
DEMONCIIY (P icrrc-F rançois-B cnoist). BOMBART (J/mise-ARNOULT (5ROUSSEAU (ABgc-Félix).........................LEROY (AlexanurinQ*Brigitle) . . . . DESJARDINS (Joan-Louis-Franéois) .DIGNAC'"NERON (Louis-Denis), p o u r la yue-prop .
e t d am e v* NERON, née PUGNANT,p o u r l 'u su fru it .....................................
ERRIER (R ieuletle).............................BQUFFARD (A rthém ise), veuve
TRU PTIT (Lucien). . • .................DUCOTTRET ( l / m i s ) .........................BODOU (F ranço is).................................FLEURY (Jcan -B ap tis to ).....................LËSSBRT (Jules).....................................
1G o c to b re '1836.18 décem bre 1836. 1 " janv ie r 1837.12 février 1837.19 m ars 1837.17 décem bre 1837. 2 6 a o û t 1838.
5 aoû t 1838.9 décem bre 1838.
•G jan v ie r 1839.3 février 1839.3 février 1839.
2 3 ju in 1839.2 3 ju in 1839.
Scnjis, le 31 m ai 1869.L e Caissier,
E . VATIN.
AGE à ce lte épotpin.
NAISS
Dates.
ANGES
Lieux.DOMICILES. PROFESSIONS.
DATES de la
dern ière opération ou
de l'échance prévue par la loi.
NATURE d e la
dern ière opération ou
d e l’échéantH* prévue par lu lui.
MONTANT actuel
du cap ita l.
45 ans. „ Verbcrie. S errurier. 2 2 septem bre 1839. R em boursem ent. 59 0531 ans. » a V crbcric. Cuisinière. 13 octobre 1839. ici. 20 093 2 ans. » » Senlis. Cocher. 17 février 1839. id . 12 833 6 ans. n * V er. Berger. 3 novem bre 1839. id . 2 723 6 ans. a a Brasseuse. D om estique. 18 aoû t 1839. id . . 3 9 8?22 ans. » a Beau lieu. B erger. 21 janvier 1839. Versem ent. 49 303 3 ans. a a Crépy. O uvrier ébéniste. 9 ju in 1839. Rem boursem ent. 14 2530 ans. » a Boulanger.
Crépy. 2 ) jan v ie r 1839. id. * 8160 ans. a a Rentière. ■21 ans. » ■ t / » O rm oy. C outurière, v. i 4 a o û t 1839. id. 6 57
49 ans. „ ' . C ham bly. Journalière . 10 m ars 1839. id. 5 5416 ans. a a Cham bly. M ineur. 2 6 m ai 1839. V ersement. 11 6321 ans. a a Beaulieu. Em ployé d e ferm e. 3 février 1839. id. 79 4322 ans. a a M orlefontaine. C h arretier. 2 3 ju in 1839. , id. 1522 ans. « F on taine. C harretier. 2 3 ju in 1839. id. 3 0 61
RENTES 3 POUR CENT
Nom bre M oulantd ’inscriptions. | des renies.
Certifié conform e aux écritu res de la Caisse :Le Président du Conseil d 'adm inistra tion .
Marquis d’AURAY.
RENTES 4 1/2 POUR CENT
Nom bred ’inscriptions.
Montant des rentes.
Abt. 2 .
A V 8 .C h e m in «le F e r «le N e n lîs
à C ré p y .
Le Sous-Préfet do l'arrond issem en t de Seiilis,; dônno dvis q ti'on exécution de l 'a rticle 10 do la.loi d u 3 m ai 1841, les plans e t é ta fs parcellaires, m odifiés, des te rra in s à acquérir p ou r la construc tion du chem in de fe r dn Sçnlis à C répy, dans les coin- m uues do M onlépilloy, F rcsnoy-lc-L dai, R ully , Auger-Saint-V incent e t O rm oy- V illers, res te ron t déposés pendan t h u it jou i? ,- d u ' ving t neu r ju in an h u it ju ille t 1869, à là Souè-PréfectOro do S cnhs, oô les parties inlércssceo p o u rro n t en p rend re connaissance, e t Ibtirnir leu rs oliservations écrites dans la formo preeorile p a r l’artic le 7 do lad ite loi.
A Sentis, le 2 6 ju in 1869.M“ d’AUIUY.
Akt. 3 .
E tude do M 3 F r é m y , avoué à Senlie (Oise), ru e N euvtH le-Pariî, n* 13.
Vente sua* LicilulîonY ij^ E n lr o M apm rs e t a vec a dm ission
d i: ir a i\g e r s .E u T itud ion ro d e s c iq écs d n t r ib u n id
civ il d e p re m iè re in s ta n c e s é a n t A S cn lis , n u p a la is d e ju s t ic e .
L e M a rd i v in g t J i l î l l r t 1 8 8 9 , à m id i,
I T t * OU
D0MA1HE DE M 0H TIG 8Y
S itu é co m m u n e d e RUSSY, p rè s C répy- c n-V alo is;
Ce D om aine , d 'u n s e u l l e n a u l , se Iro u v c d a n s u n s ite a g r é a h le e l p it lo re sq u e , cl à m i k ilo m è tre d u la gai'o du C répy (ligne d e P a r is à Soissnns);
I l consiste n o tam m en t en :1- — D N BEAU C O R PS DE FER M E
n’o u v en ëm è iit c o n s tru i t , C o u r, J a r d in e t D ép en d an ces;
2 - — 5 2 U gC T A R E S fil A l l -S f c C.d e T e r r e s la b o u ra b le s e t Bois;
3 “ UN P E T IT CHALET d a n s le b u is , S erva n t d e R endez vous do Chasse;
£n un seul lot.
On fait savoir qu 'en exécution d ’un juao- itnen t contrad icto irem ent rendu en tre les parties c i-après nom m ées p a r le tribunal civil do prem ière instance do Senlis, le vingt-deux avril 1869, enregistré,
l f Sera, aux requête , poursu ite e t diligence d e : \
1* M. V ictor G liarlicr, Notaire honoraire , chevalier do la Légion d ’honneur, dem eura n t à Senlis ;
2* M. Pierfo-Loifis C hartio r, p roprié- lalro e t m aire , dem euran t au Plessis-Gassot, can ton d ’Ecouen,
« C oderp io r agissant tan t en son nom■ personnel q u ’a u nom e t com m e adm i- « n is lra teu r provisoire dès biens do m a- « dam o Anne - A délaïde • C h a rlie r , son• épouso, e t sop m andataire général, aux « term es d ’un jugem ent su r rétracté rendu « p a r lo tribunal civil de p rem ière instance• do P ontoise, lo onze avril 1857, cnre-■ g is lré ; »
M. V ictor C harlier e t nw ditc dam o Chartio r, du PJessis-Gassot, héritiers chacun pou r u n tiers de m adam e Marie-Mélanie-
Sonbic C h a rlie r , leu r s œ u r , décédée à Crepy, le deux décem bre 1866, veuve de M. C harles Benoist-Benoist, saisie p o u r m oitié d e la succession de m adam e S opliie- Ilcn rie lte B enoist, décédée à Crépy, lo vingt-cinq novem bre 1 -6 6 , épouse en deuxièm es noces de M. Jean - Baptiste C harlier lils; laquelle succession d.î m a dam e C harlier, née B enoist, a é té acceptée sous bénéfice d 'inventaire seulem ent, su ivant déclaration passée au greffe du t r ib u nal civil de Senlis, le d ix-sopt ju in 1867;
Ayant p o u r avoué constitué M 'F ré n iy ;En présence de m adam e A ngélique-’
Louise. C harlier, veuvo d e M. P ierre-I/m is- X av ier\B ilic t, propriéta ire , dem euran t à’ Versailles ci-devant, pu is à Paris, rue Croix-des-PetiLs-Champs, n ° 2 7 , e t actuel-; lem ent à Sonlis, ru e S ain t-P ierre;
Ladite dam o h éritiè re , p a r représentation de M. François-Sim on C harlier son père, de la feue dam e Bonoist-Bcnoisl ci-dessus nom m ée,
Ayant |>our avoué constitué M 'I/is so rre , dem euran t à Seuils, Vioilld-Ruo-do-Paris;
Procédé à la vente p a r ad judication , au plus ollYant e t d e rn ie r enchérisseur, e t à l’ex tinction des feux, des im m eubles ci- npres désignés : ■
D É S I G N A T I O N .
Lo D om aine de M ontiany, situé com m une de Russy, V anton de Crépy, a rro n dissem ent t,le $en lis (Oise), d un seultenan t, com prenant
1 «.««. u n edrns do ferïne nouvellem ent c onstru it, lieu d it la B utlo do Montigny, ayant deux entrées fe rm an t p ar deux grilles én fer, servant de p o r to charretières, p la
cées a l’o rien t e t à l ’occident d e la co u r, se com posant : 1" (l’un bâtim ent d ’habitation ayant trois pièces par bas, avec grenieç au- dessus; le tou t co n stru it en p ie rrts do taille e t m oellons, e t couvert en ardoises; 2* de Ih’ilim enls ru rau x c l d ’exploitation en tou ran t l.i co u r, e t sc com posant, nu bo u t m id i, d ’un hangar do deux travées couvert en z in c ; su r lo cô té , bergerie de six travées, greffier à fourrages au-dessus, construite en p ierres d e taille e t moollons, e t couverte en ardoises; su r le cô té o rien t, qu a tre petites, travées en appentis p ou r
I ioulaillers e t to its à porcs; pe tit clos à vo- iillo e t ja rd in en tou ré tlo m u rs ; pu its au
m ilieu de la co u r; au nord e t ferm ant la cour de ce cô té , un grand bâtim en t ù diver^ usagos e t à deux rcz-dc-cbausséc, •Pun a ü !nivcau do la co u r, l 'a u tre au niveau ' tlo la pliiine; au n o rd , com posé, su r la ’cotir, a u n e étalée à vaches e t d 'uno écurie de q u a tre travées ;
„ , D errière , u n grand cellier voûté en pierres do ta ille , se rvan t do bergerie, et ayant son en trée ex térieurem ent par le bo u t occident encore d o n n an t su r la cour, u n fournil et une p e tite cham bre de do m estique; une grange do q u a tre travées;
Au-dessus des établcs, écurie e t cellier faisant rez-de-chaussée ex té rieu r, logem ent de d om estique, toits à porcs. Ces dern iers lià tim cnts constru its en p ierres e t m oellons, couvcrtsV n ardoises;' C iterne en dehors de la ferm e.
Tous les bâtim ents, co u r, ja rd in c l d é pendances d 'uno contenance de v ingt-trois a res d ix -n eu f cen tiares;
E l le tout, lient aux te rres ci-après désignées.
2” "". Aii m êm e te rro ir , terres y a tten an t e t se com posant de :
!" An chem in do M ontigny, jo ignan t la rou le d 'A udrival, cinquante-deux ares c inq uan te-sep t centiares de te rre e t bordure de friches ;
2“ E n tre la lla ic de l'A llée d e ki H uile c l la pièce ci-dessus, deux hectares qua- ranic-ueux arcs quaran te-cinq cen tiares do te rre , friche e t chem in particu lie r;
3" En face la pièce précédente, en tre le chem in d e Montigny c l la plaine, deux hectares roixanlc-cl-un ares soixante-sept centiares do te rre labourable , friche plantée et rillon ;
4* A l'A ncieune Sapinière, un hectare soixante-quatre arcs ving t-quatre centiares, de te rre labourable et- bo rdu re défrichée ;
5* S u r le P lateau , nu irovd d u chem in d u M ilieu, onze hectares de te rre , com pris rem placem en t des lignes d o n n e s défrichées et le chem in d e C ulture;
6* S u r le P lateau , au m idi du chem in d u d it lieu , sep t hectares quatre-vingt-six ares soixante-seize centiares d e t i r r e , c o m pris rem placem en t des lignes d ’orm es d é frichées c l bo rdu re réservée ;
7* A u-dessous d e la ferm e d é M ontigny, qualre-v ing l-hu it ares quaran te-et-un centiares d e te rré e t do b o rdu re réservée ;
8° (Vu Grand Rillon c l à la C!ici\aie, te rrain en n a tu re do taillis e t friche, su r lequel so trouve u n bâtim en t appelé lq llu tlo , contenant quatre-v ing ts arcs soixante-cinq centiares ;
9* A l'O rien t e t près, le m u r du ja rd in do la ferm e, u n terra in’en friche, taillis e t planté ou a rb re s , con tenan t q u aran te a rcs;
10° Au T rou de ^ancienne M arnière, su r le P lateau , en bois taillis d ’arbres,
contenant d ix-neuf ares soixante-quatorze centiares;
1 1 ' Au long du chem in d.'Audrival ù Russy, e t faisant bordure de la pièce n* 6, désignée ci-dessus, u n terrp in taillis e t arbres, contenant soixante-trois arcs v ingt-neuf centiares;
12* Chapelle de Montigny, lo terrain su r lequel son t les ru in es d u . lad ite Chapelle, planté .en lailli? .et, jeu açs arbres, con tenant d ix -n eu f ares soixante-dix centiares.
3 " " “ . M arché d it de Montigny.13“ Au P erchoir, u n hectare so ixante ares
v ing t-sep t centiares, com pris douze a r c s douze centiares de bo rdu re , traversés par la rou le e l le chertiinM c for)
14* Sous la Chapelle d e Montigny^ deux hectares soixante quinze, aresqU arante-sep t cen tiares (non com pris là route).
15“ A la. Fpntaine de M ontigny, u pe pièce partie en te rre labourable e t parjio eu friche, plantée d e peupliers, contenant u n hectare t r e n te ares cinquante.-,neuf cen-. tiares', d o n t, soixante-six ares -vingt-cinq- centiares en ' lorro labourable, c l le fiurphur en friche plantée.
A"'*'. Lp bois dp îfontigny :16° l / l bois de M ontigny, d 'u n serti le-.
. u a n l, aux P ondants, m idi ç l,.o rinn l do la ; B utte de. M ontigny, c l traversé n a r le lias vers le m id i par là g ra n d i ro u te de Crépy à ' Villers-Cotterêts c l par le cheiq in de fer do- Paris à Boissons, lim ité au n o rd e t à l’o rien t p a r les terres labourables d u p la -AJ te iu ck lé ssu s désignées, n** 3 , G, 7 e t 11 e t au m idi, p a r les te rres en |I i i n e ajqiarte*

%
I
r
nan l à M. C harticr, les rep résen tan ts De- souche», de Saint-G erm ain c l au tres , le chem in d e 1er e t la Ib rè t de Retz.
Ledit Iwis se com pose de d ix-sqtl hoc tares soixante-seize ares douze cenlines,- non com pris la rou te n i le chem in d e 1er e t d e :
1* U n pav illo n , de form e carrée , co n j osé d une pièce avec chem inée, éclairée de q uatre lenôtres; sous-sol servant de logem ent au b û ch e ro n ; ce pavillon servant d e rendez-vous de chasse est lnMi en p ie rres , b riqùes e t inoëllons, couvert en a rdoises ;
2* Un hangar à la barriè re de T illet, se rvan t de rem ise, ferm ée, ayant deux travées, bfiti ci) m oÿllons, couvert en tuiles.
m i s e : a p r i x .O utre les charges, clauses e t conditions
portées au cèh icr des charges, les enchères seront reçues sq r la m ise à prix fi.yioj>;y\le jugem ent sus-énoncé, de < 1 7 ,5 0 0 f r .
S ’adresser pour avoir m en ls :
des renseigne •
1* A M ' FREMY, avoue, poursu ivant la ven te ;
2* A M* LASSER RÉ, avoué co-licitanl;3° A u Greffe du T ribuna l c iv il de Sentis,
où le cahier des charges est déposé;A• E t à M** BENOIST e t IULEZEAUX,
notaires n Senlis.
Fait e t rédigé p a r l'avoué p oursuivant soussigné,
A S en lis, le q u in ze ju in 1869.
S igné : FREMY.
E nregistré à Seid is, le seize ju in 1869, reçu un franc qu inze centim es, s u b vention com prise.
S ig n é : Bo y s .P o u r insertion ,
S ig n é : F rémy.
A V E N D R E o u A 1 ,0 1 1 C i l
MKUI1I.LL OU NON.
MAISON DE CAMPAGNEAu P lo s s is -C h a m n n t.
Avec h a s sc c o u r , é c u r ie , rem is* . J a r d i n c i D é p e n d a n c e s .
C ontenant 50 arcs.S 'a d re s s e r à M' Bknoist, n o ta ire A S en lis.
E tudodeM ® l 8c n o i » ( . n o ta ir e à S en lis
A V E N D U E OU A LOIJKUA LAMIARLK,
P o u r e n t r e r e n jo u tsn n c c le 1" oc to b re 1809,
LE MOULIND e l a C h a u s s é e d e S i - A i r o l n s ,
S itu é & S a iu l-N ico la s , co m m u n e d e O o u rleu il.
M onté a e d o u x p a ire s d e m eules. S 'a d re s s e r : à P a r is , à M* BRËÜ Î LLAND,
n o ta ir e , ru e S a in t-M a rlin . 5351;E t à S en tis , a u d it M 'B E N O IS T , n o ta ire .
A C É D I ilt a l'am iab leBONNE
EXPLOITATION AGRICOLE« le S I H I l e c l a i •0 8
A U ully , e n tre S en lis e t R ully , L ongue jou issance .
On p o u r ra i t n e c é d e r a u p re n e u r q u e 175 h e c ta re s o u m o in s , e t u ne p a r t ie d u C orps d e F e rm e .
S 'a d re s s e r :A R ully , à m a d a m e FREM O N T;Kl à S en lis , A M' B EN O IST, n o ta ire .
P ar le m in is tè re do M* F ra n c h e , notaire à Ct'cpy,
A ROU V ILLE, p rè s C répy ,E n la dem eure de M . M irland,
C onsista u t en : c h e v a u x , v aches, p o rc s , v o ilu re s , c h a r r u e s , h e rse s , u ne m a c h in e A b a t t r e sy s tèm e D ùvoir, vola ille s , 3 ,000 b o tte s d e s a in fo in cl lu- z e rn o , bo is à b rû le r , e t a u t r e s o b je ts d e c u l tu re e t d é m é n a g é ,
Au co m p ta n t. F ra is o rd in a ire s . S 'a d resse r audit M 'F ra n c h e , notaire.
E lu d e do 11* X la iA r e - B I c v n l l o i i ,n o ta ire à C ham bly (O ise).
MAISONS itu ée A P e rs a n ,
c l IO 1»BKCE8 «le T E R R ES itu é e s t e r r o i r do P e rsa n ,
A V E N D J I EPAR ADJUDICATION VOLONTAIRE,
Pa." le m in is tè re do SI* M aitru -D kva llon , nota ire à Cham blg, e t en son é tu d e .
Le D im an ch e 9 Ju ille t 1809, A n jid i.F a c ilité s p o u r le p a iem en t.
S 'a d resse r a u d it 3P M aitrc-D cvallon.
Art . 5 .E tu d e d e S I ' F r ë i n y , av o u é à S en lis ,
r u e N eu v e -d e -P a ris , n° 13.
_ V E A T ED e B i e n s « le m i n e u r s ,
P ar le m in is tè re de M* V r am ant . nota ire <i B aron, co m m is à cet e ffe t,
1° D ’UNE MAISONS itu é e à PERO Y E L E S GOM BRIES,
can to n d e N a iite n iM e -IIa u tlo u in (Oise),AVEC
P o u r , J a r d i n e t D é p e n d a n c e s ;
2 & DE 4 PIÈCES DE BOIS■Situées m êm e t e r r o i r , c l t e r r o i r
d ’AucER-SAiNT V in c e n t ;
E n c i n q L o i s qui p o u r ro n t ê t r e ré u n is p a r tie lle m e n t
ou eu to ta li té . L ’a d ju d ic a tio n a u r a l ie u e n la M airie
d e P c fo y e tes-G orubries , le D im anche o nze J u ille t 1869, d e u x h e u re s d e re le v é e .
S 'a d resse r p o u r a vo ir d e s rense ignem en ts :
1° .1 M* FRÉMY, avoué. « Sen lis , poursu ivant la vente ;
2* A M* VRAMANT, notaire <i Baron, dépositaire du cah ier des charges.
A C E D E R A L ’AM IABLE P o u r e n t r e r e n jo u is sa n c e d e su ite ,
UNE FEUNE«le îîSO H ectares
» D 'un seu l tenan t.A v e c B a i l d e ( l i x - h u i t a n s .
S’a d re s s e r A M* R iT n’O IS T , n o ta ire ;Sen lis .
A r t . 6 .
F.ludc de M* P a u l D c l g o v c , avoué à Senlis (Oise), rue d u Chàlcl, n° 21 ,
successeur de M* J ci.f.s T iicurv.
V E X T ES u r expropria tion fo rcée .
E n l’au d ic n c o d e s c r ié e s d u t r ib u n a l c iv il d e S en lis , a u P a la is d e J u s tic e d e la d i te v ille , rue .N eu v o -d e P a r is .
D U N E MAISONA v e c J a r d i n e t D é p e n d a n c e s ,S ise à BARON, e n la ru e lle d u T r iè r e ,
can to n d e N an teu il lc - l la u d o u in (O ise), EN UN S E U L LO T.
L’ad ju d ic a tio n a u ra lieu le M ardi ving t- n e u f J u in 1869, h e u re d e m id i.
S 'a d resse r p o u r les rense ignem en ts :1° A M* P aul DELGOVK, avoué, à
S enlis, pou rsu ivan t la vente;2 ' A M* BENOIST, n o ta ire à Senlis;3° E t a u Grcllc du T ribunal de Senlis,
où le cah ie r des charges est déposé.
A n n on ces D iv erses.
Elude de M c B a l l é d e n l , commissaire* p risen r à Senlis.
F aillite Vacguerie, de Nanliuiil-lv- H audouin .
A V E N D R E A U X E N C H È R E SE n v e r tu d 'u n e o rd o n n a n c e ,
E t p a r s u i te d e la f a il l i te d e E d o u n rd - A lfrcd V a c q u c rie , d e N au lcu il-lc - I la u d o t i in ,
A S cn li* , S a lle d es V entes,Les D im an ch e 2 7 c l L u n d i 2 8 Ju in 1869,
à u n e h e u re d e re levée ,
D’U N E GRANDE Q U A N TITÉDE
Marchandises neuvesC o m p re n a n t u n F o n d s d e M arch an d
d e N o u v eau té s , R o u e n n e rie s , B on n e te r ie , M e rc e r ie , C h a p e lle r ie , P a r fu m e r ie , d e C h a u ssu re s e t d e C onfec tions, e t Jo u e ts d 'e n fa n ts .
E tu d e d e M ' B e n a l n l , n o ta ir e i S en lis.
A I . O Ü K K M E l I I L l î i ; .P o u r e n t r e r e n jo u is s a n c e d e s u i te ,
D IE I I I S O I DE C ilPA G N ES itu é e a S i in t-L é o n a rd .
S ’a d r e s s e r a M* Bb n o is t . no ta ire .
A V E I N E A L A f l U A B L EU N E JO L IE
MAISON BOURGEOISEN o u v e llem en t r e s ta u ré e ,
S ise à V illev c rl, fa u b o u rg d e Senlis,AVBG
C o u r , J a r d i n * t D ^ p e n d a n e r w ,C o n te n a n t le to u t 72 o re s CO cen tia re s .
S 'a d re s s e r p o u r a m p le s ren se ig n e m e n ts , à M* B EN O IST, n o ta ir e A S en lis.
a l o u h k i > e s a j i T f i i :
BELLE CHASSES u r e n v iro n 1 5 0 h e c t a r e s de
p la in e , f r ic h e s c l b u is ,Au t e r r o i r d ’iv i l l r r s , co m m u n e de
V illen eu v c-su r-V erb eric (Oise),E n bordure de la fo re t d 'I la la tte .
S’a d re s s e r à M. I .E F È V R E , g a rd e a u ch â te a u d ’O g n o n , p ic s S en lis (Oise).
A C É D E R
UNE FERME1 6 6 I lo c la rç s «le T erres
labou rab lesA la p o r te d e S u issons (A isne).
C orps de F e rm e n eu f.P o sition e x cep tio n n e lle c o m m e in d u s tr ie
S ’adresser à M* C A II.I.E T , notaire à Soissons.
A L O lIEIfi Une Maison seule
Avec JA R D IN , É C U R IE e t REM ISE A VOLONTÉ.
S 'a d re s s e r chez M” * veuve Dupillf., 55 , ru e V icillc*dc-Paris.
V IL L E DE CR E IL .
A D J U D IC A T IO NP o u r la
C o n stru c tio n d 'u n e Ecole«le F illes .
Le D im an ch e I " A oût 1869, à u n e h e u re s , il s e r a p ro c é d é en la m a ir ie d e C re il, à l 'a d ju iiic a tio u a u ra b a is , s u r s o u m iss io n s cac h e té e s , d e s tra v a u x A e x é c u te r p o u r lu c o n s tru c tio n d 'u n e E co le d e filles.
Ces tra va u x seront adjugés en n e u f lots: savoir
1 " lo . T e r ra s s e m e n ts e tm a ç o n n e rie . . . 35 ,410
2* — C h a rp e n te r ie . . 5 ,6 1 55 ' — M enu iserie . . . 5 .791A- - P a rq u e ts s u r b i
tu m e .......................... 3 .2495* — S e r r u r e r ie . . . 14 ,5226 ' — C o u v c r tu rc c t p lo m
berie 4 .6117* — P av ag e . t , . 1 ,5168* — P e in tu re cl v itre r ie 2 .0477* - P ré a u x c o u v e rts . 3 ,0 0 0
T o ta l d e s tra v a u x .7 1 ,7 9 7 27
On p o u r r a p re n d a e co n n a is sa n c e , à la M airie d e O e i l , d e s (d an s e t dev is c l d u c a h ie r d e s ch a rg es .
SO U S -P R É F ECTU R E DE SE N L IS .
Clieinîng v ic in au x .
T ra v au x n eu fs e t d 'e n tre t ie nA D J U D I C A T I O N
I.c M ard i 7 Ju ille t 1869 , A d eu x h e u re s , A l’hôtel de. la Sous-Préfecture.
On peu t p r e n d re c o n n a issa n c e d e la n a tu re l le s tra v a u x c l d e s co n d itio n s de le u r e x é c u tio n , so it A la Sous-P réfec- tu r c , s o it e u b u ra n u d e M. l 'In g é n ie u r d e l 'a r ro n d is s e m e n t d e S en lis.
J u s t ic e d e P a ix d e C re il.
V e n t é M o b i l i è r eA «O G E fiT -L E S -V lÉ IlG E S .
P our cause de départ,E n la d e m e u re d e M. P e l le tie r , ru e de
B èbvillé ,I.c D im anche 4 J u i l le t 186 9 , A m id i,
P a r M. Em ile L o u c h ez , gre ffier de Creil,
C elle v e n te c o n s is te p r in c ip a le m e n t e n : m e u b le s , l i te r ie , t a b le a u x , lam p es , u s te n s ile s d e m é n a g e , v a isse lle , b a t te r ie d o c u is in e , b o u te il le s , o u t i ls d e j a r d in a g e , e t b e a u c o u p d 'a n tre * o b je ts .
C onditions o rd n a ire s .
PS itué
E lu d e d o II* Franche, n otaire A CrépyJO ise).
A djudication vo lon ta ireP a t su ite de cessation de cu lture,
L eD iraan ch e I I Ju i l le t 1 869 , à m id i.
E lu d e d u M ° E l r c i t r , n o ta ir e û Acy.
A V E N D R E P A R AD JUD ICA TIONEu la s a lle d e la M airie d e B elz,
Le D im anche 18 Ju ille t 1869, à I h e u re Par le m in is tè re de M* Br c t t e , no ta ire
ii Acij,
DEUX BAISONS C9HTIGUESU n très beau Clos
C o n ten an t 1 h e c ta re 5 3 a r c s 31 c e n t . , <*l 8 P a r c e lle s «8c T err e
D’u n e co n ten an ce d e I h e c l. 25 a r . 66 c. Le to u t s i tu é co m m u n e e t te r r o i r
d e B elz.F a c ili té s p o u r p ay e r.
On t r a i te r a a v a n t l’ad ju d ic a tio n s ’il est fa it d e s offres su ffisan tes .
S 'a d resser a u d it M* B r g t te , notaire.
E lu d e d e M ° f L c s n i i i i i e , n o ta ire à Cha n til ly. v ,
i i i s o n d e c a m p a g n etu ée à C h an tilly , ru e de P a r is , n» 17, E l JA RD IN 6 la su ite avec d ro it «le
s o r t ie s u r la p e lo u se ,
A V E N D R EP a r ad ju d ic a tio n a m ia b le ,
E n l'é tu d e c l p a r le m in is tè re de M* i.EJioiXB, nota ire à Chantillij,
Le M erc red i 50 Ju in 1869, à u n e h e u re . S 'a d resse r a u d it M* L em o in e , notaire.
E lu d e de .11* T o u r n e u r , n o ta ire à V crhc r ie . \
a >"b-]: î h c 2*:P ar a d judication volonta ire ,
A V crbcric, en l'é lude e t p a r le m in is tè re d e M* T o u rn e u r . nota ire .
L e D im anche A Ju ille t 1869, A 1 h e u re ,
2 Marchés de Terre E T P D É
E n 9 pièces S ises t e r r o i r s d e V c rb e n e , S l-V ansl de-
l.o u g m o n t, V e rrin e s , d é p e n d a n c e de N èry , e t le Bois d ’A gcux, d ép e iitlan ee d e i.o ngucil-S a in l-M arie .
l ’o n (« -n a n « h c r d. 5 8 a r c s 411 c F a c ili té s p o u r p a iem en t.
S ’adresser a u d it M* T o u rn e u r , nota ire
E lu d e d e M c J u l e s i ü o l c v a l l e ,h u is s ie r A S e n lis.
V l i . Y T I î V O L O N T A IR EDE
SEIGLE, AVOINE, POISS u r p ied e t s u r les lieux .
Terro ir de S en lis ,Le D im anche A Ju il le t 1869, à m id i. P ar le m in is tè re de M* J . N o i.eva i.l e ,
On se r é u n ir a a u ch a m p d e m a n œ u v re .
E tu d e d e M e l l c n i c i , h u is s ie r -p r is e u rà C h an tilly .
V E N T EAUX ENCHÈRES rUULIQITS,
S u r la p la c e p u b liq u e d u la co m m u n e d e Gove (Oise),
Le D im anche A J u il le t 1869, A 9 h e u re s , Par le m in is tè re d e M* Il ém et,
r e
RECOLTESDe F o in , A voine, O rge, P om m es de
t e r r e , Se ig le , B e tte rav es e t L égum es, Pendantes p ar B acin is,
S itu ées nu t e r r o i r du Coye. C o n d itions o rd in a ire s .
S’a d re s s e r p o u r vo ir le sd ile s réco lte s au g a rd e c h a m p ê tre d e Coye,
L E ÎM IU N IXCOÏPAGME FRANÇAISE D'ASSMAACES SUR LA VIE
G a r a n t i e t T r r n t c - s i x M il l io n s
A ssurance p our la v ie en tiè re : U n cap ita l es t p ay é a n décès d e l’a ssu ré .
A ssurances m ix te s : U n cap ita l es t payé â l’A ssu ré , s 'il es t v ivan t a p rè s un c e r ta in n o m b re d 'a n n é e s , ou A ses h é r i t ie r s a u ssitô t son décès.
L es a s s u ré s reço ivent a n n u e l l e m e n t , le p ro d u i t d e 50 p 100 d a n s les bénô- ' lices d e la C om pagnie . La p a r tic ip a tio n ca lcu lée ffur le m ontai)! d e to u te s les p r im é s v e rsée s a d o n n é les ré su lta ts su iv a n ts p o u r ch acune d es tro is d e r - n iè re s a n n é e s 1866, 18G7.ÇI 1868 u
A ssu ran ces vie e n tiè re 4 . 2 | • /. — c h a q u e ah née.
A ssu ran ces m ix tes 5 .4 0 7 . — c h a q u e a n n é e .
E x e m pl e : M. G ... a fa it a s s u re r s u r la vie e n t iè r e , eu 1848, u n cap ita l d e 100 ,000 f i . m o y en n an t u ne p r im e an n u e lle d e 5 ,0 0 0 fr ; I l a reçu p o u r sa p a r tic ip a tio n en 1860, — 2 ,594 fi*.; en 1867, — 2 ,5 2 0 f r . , e t e n 1868, — 2 .646 fr.
L ’a s s u ra n ç c p ré se n te d o n c un d o u b le a v a n ta g e : e lle g a ra n t i t l ’a v e n ir do la f am ille ; e lle c o n s titu e p o u r l ’a s su ré u n p lacem en t d e fonds.
E n vo i fra n co de no tes exp lica tives .S ’a d re s s e r A P a r is , a n s iège d e la
C om pagn ie, r u e de L a fay e lle , n * 3 3 .E l A S en lis , à M. AVATELI.1N, ag e n t
g é n é ra l.
E lu d e s d e M* D9 « '« J a r d i n s , n o ta ire A B e lz . e t d e M* I B p c l< e , n o ta ire A Acy.
1 l i c e t a r e 0 7 a r e s 410 c c u t l u r t - s
de TerreAn t e r r o i r d e V illc rs-S a in l-G o n cst,
A V K Πim KP a r a d ju d ic a tio n v o lo n ta ire ,
A V illc rs-S a in t-G cncsl, eu la m aison co m m u n e ,
Le D im an ch e A Ju i l le t 1869, A 2 h e u re s , P ar le m in is tè ro d e M " D esja iu h n s
c l R hk t tk .J o u is sa n c e a u I I n o v em b re 1869. S ’adresser à M " D es ja rd in s e t B re tte .
A C H ftE It D E S U I T EA L’AMIABLE,
UNE FERMES itu ée A R ouv ille , p rè s C fépy ,
C on tenan t l'n v iro u i O l h e c f a r MS 'a d resse r p o u r tous renseignem ents : A M* FRA N CH E, n o ta i ie A C répy .
A V E N D R E
UNE MAISONO i’i s ’e x p l o l t e u n c o m m e r c e
d ’E p i c c r i e ,S ise A F rc sn o y -le -L u a l, c a n to n do
N an lcu il (Oise).S 'a d re s se ra M. D c ro ix , pro p rié ta ire à
F resn o g -le L u a t, g u i e x p lo ite led it fo n d s d e c o m m erce .
A V I S .
PEINTURE. — V ITRERIED a p i e r N p e i n t s .
M . S A U V A G E , p e in tre A S en lis , r u e d e s T r ib u n a u x , p r é v ie n t s a n o m b re u se c lien tè le q u e la v en te d e s e s P a p ie rs p e in ts ay a n t p r i s u n e ex ten s io n c o n s id é ra b le , il a pu fa ire d e n o uve lles acq u is it io n s ch ez les m e ille u rs f a b r i c a n ts , e t q u ’il p e u t s o u m e ttre a u x p e r so n n es q u i v o u d ro n t b ien l’h a iio rc r d ’une v is ite , u n g ra n d c h o ix d e P a p ie rs de to u te s n u a n c e s , d e p u is les p lu s o r d i n a ire s ju s q u ’au x p lu s ric h e s .
P r i x ( r è * m o d é r é s .
LA SDRDITÉ EST CURABLE.D epu is p lu s d e 50 n u s je so u fira is
d ’u ne s u r d i té c ro is s a n te , c o n su lta n t v a in e m e n t les p lu s c é lè b re s m éd ec in s . F in a le m e n t je ré u ss is A re c o u v r ir l ’ou ïe , g râ c e A u n re m è d e q u i m e fu t con fié p a r u n c a p ita in e d e v a isseau , a y an t beau co u p voyagé, e t j e r e ç o is - jo u rn e lle m e n t, A m a g ra n d u s a tis fa c tio n , u ne q u a n t i té d e le ttre s d e r c m e rc im e n ls d e s p e rso n n e s é g a lem en t s e c o u ru e s . J e p u is e x p é d ie r c e re m è d e A c h a q u e m a la d e c o n tre la so m m e d e 10 IV. e n tim b re s- p o s te (a ffra n c h ir) , o u c o n tre re m b o u r se m e n t.
Louis O ELSN ER , à B erlin , N oue S c h o a u h a u se r SI ta s s e , 12.
La C‘! chaiifoiu-iiièi-c«le l ’Oucstf,
L. RENARD e t C *. A PA RIS. G R A l i X , re p ré s e n ta n t A S en tis , T ien t A la d isp o s itio n d es C u ltiv a te u rs
d e s e n g ra is h u m a in s , t r è s r ic h e s e t p ro p re s A la c u l tu r e d e s b e tte ra v e s .
On d o n n e ra to u s le s re n se ig n e m e n ts d e m a n d é s .D é p ô t d o C e n d r e » v é g é t a t i v e s
A IV. 5 0 l ’h e c to litre , A S en lis.
BAGNOLES DE L’ORNEE a u x ch lorurées lo d iq u cs, su lfu re u se s cl
arsenica les. — E a u x ferru g in eu ses M nvganésicn nés.
In s ta lla tio n c o m p lè te — P isc in es d e n a ta t io n ; h y d ro th é ra p ie , m o n tée p a r M. G . C h a rle s , d e P a r is — D yspepsies, vo ies re s p ira to ire s , rh u m a tis m e s , p a r a lysies, m a la d ie s d u la p e a u , c h lo ro se , ly m p h a tism e , p la ie s , b le s su re s , e tc . — Beau p a rc , b é te ls , r e s ta u ra n ts . — P rix m o d é ré s . — M. J ouari», d i r e c te u r , p a r Fe rlé -M a i é .
A V E N D R ERemise mobile
E n c h é n c c i w a p l u .S ’a d re s s e r r u e do B eau v ais ; 55 .
Seul!», vue leiivc-dc-P arls, 6 5F a u b o u rg S a iu t-M a r l in .
T r a n s m is sio n nus onuRus d k n o u R ss . — A ch a ts , v e n te s e t r e p o r ts . N ég ocia tion e n b a n q u e d e v a le u rs n o n ‘co tée s .
C a iu ik d k s t it r e s . — L es t i t r e s so n t re ç u s e n d é p ô t, m o y e n n a n t u n d r o j l d c 20 c e n tim e s p a r a n n é e c l p a r l i t r e . L es c o u p o n s so n t e n c a is sé s d 'o ffice avec re te n u e d e 50 e . p a r 1 00 fr .
Pa y e m e n t im m éd ia t d e s c o u po n s é c h u s , m o y en n an t n u e c o m m iss io n d e 75 c . p a r 100 f r . Les c o u p o n s d e s l i t r e s no m in a tifs , c e u x p a y a b le s a p rè s re c e tte a u x C o m p ag n ie s , n e p ay e n t q u e 50 c o n l. p a r 100 f ra n c s en c a issé s .
Af f a ir e s d iv e r s e s . R ec o u v re m e n t d e c ré a n c e s , d e fe rm a g e s e t d e lo y e rs . E n c a is se m e n ts , v e rse m e n ts , so u s c r ip tio n s , d é p ô ts , r e t r a i t s o u re n o u v e lle m e n ts «le d é p ô ts d e t i t r e s e t d ’e sp è c e s a u x ca isse s p u b liq u e s , e tc .
E s c o m p t e d e s c o u po n s non éc u u s j u s q u 'à six m o is d ’é c h é a n c e
F o u c a e f , fils, r u e N eu v e-d e-P aris , b a , A S e n lis , d e 8 h e u re s A 2 h e u re s .
MAISON: BOURGEOISE IG ra n g e s , h a n g a rs , t W n i l , ÿcS ' l
é la h le , 1011 h |io re s ,ç la p iç m , jionlain * - l plusicMi-s c a v e s , n d l h è i j t a ^ ô n 'd è S | m e r ; g r a n d e c o u r . L assq -cpJ,',VV RraÙT d u s e n to u r e do m u rs , g a r n i , d« S I e n e s p a l ie r s .o ld ’a r l i rc s I ro ilic rs S I c o n le n a n c o do )2 .3Q U in è lrc * . y l U to u t s i t t lé ù S en tis , ru e d esJ a r il in i^ I
n- /«. ‘
n M'|» Oellor,,V O T F > t . .
* velés s . g . S o m m ie rs ;b o u r r e le ts , e r f o i p r a l e n j û i lto n n és . .Un se u l m a te la s su ffit:
U o m .D 'w t,^ p » , , «,WSn b ip meiM
A I ! > a r o (
e t C " ,SU CCESSEUH S DE
ix . m u v o i K *CONSTRUCTEURS-
MÉCANICIENS
» B C V e r r i e r ; n o t a i r e , à ; L o za rch * . I D B lIlA W D B t • 1
Un second €lfcieS e p résen ter .
(A p p o in tem en ts e t logem eu l.)
MtüARICIENSA te lie rs c l s iè g e d e la S o c ié té A L ia n c o ü r l R an lig n v
(O ise). _ ____ _
B u re a u x e t d é p ô ts , A P a r is , r u e d e V ia rm e s , 2 9 (H alle a u x I S ég u in , 5 . A la C hapelle .
M a c h i n e » à b a t t r e « s e s e t p o r t a t i v e s .M n e l i m c s à v a p e u r U s e s c i l o c o n i o b i l c w ,
ft„ . . . . . .. „ „ I n s t r u m e n t s a g r i c o l e » . |M éd a ille s d o r , o . « M a B t e s ^ ^ i M ^ , . , t a C i„ c0111s r i8 fa l)J |ii |
A l 'E sp o s ilin n u n iv e rse lle d e 1807, G ra n d i M édaille d 'o r (c la sse 48) ______________ p l a in t 1 n x p o u r J Io issonncusa Mao C orn ick * .
> c l ;ru e
l ’L I N D E M É D E C IN E ! I
1‘ S'NTE S S S S S S * — I REVALESCIÊRE DU BARRY
n u i i-rnininii... ' r..:. ... - _ . . .
LE SEU L
D EU X FO I;
parM m a(n«
L e Jou •na\ financier
L’UNION DES ACT.OUAIRSS(T ro ls iè m o A n n ô •)
M T /X^ > < . A LES MARDIS
\ ^ { »
m JS! VENDREDIS , 7 ' V
D onne U premier .«•» n u i vc lles O nanelères, , .i s tc ii(i^ ru |iliit! iIoh a-fM-inblèen nèiiérnh-â, le conrai e t to ir lo iit lu coiii|m raV ou r a b o u - iie** (I- h v a ’e u re c o té e s e t n o n c o tée s , a v ec le u r i tn e n u , Io u m K ira iilic » , le u r a v en ir , eu u n m o t, le s îv u so iy iio in e n ts les p lu s compU-ts.
P u t lie te premier l o i L is te s offlciHIen «les T '.rag . » e t le p r ix c o u ra n t «les v a leu rs
loir.D isc u te to u te s le s E m iss i n s , ind iquo
. . s u l)itrsi:.'«-s e s plu-i u v a u lfl^ e iix , e t e x p liquo les iiii-illo ii.es opôraL O us a te rm o o u u u COIlIptUUt. '
A l’.ON \ EU KNTfl :Un on, «o fr. — .Six m o is , 5 fr . (Le même
im iir to u le lu l-'raucc).U n nuu 6ro : 2 0 centim es
B cuf. vlx : 13 , Chaa s é > l 'A n t I n , Pwrls
E n ro t i /r .ilu it,( i (i.'rr tl'r tfu l. p e n d a n t un mots, tlrnri.ui udriüce u u D lncm tr
. . . . . . . DE LORDtttlq u i ccononii.vc 5!) fuis s ... r . . . . . . pu, u re lm t
l /n r e p .s , , . e t , . » o c a
.n rd ilc , n a ii.ee , „ „ ,n m i „ on, c„ „ . . . f a „ ou “ T “ . d .nigrcurs, congestions, iii lb m n ia lio u s ilc i i i . l r s i in . ®, ,l„ u . ‘ • ’ meme eu groM esse, ilnulcan,!insom nies, fluxion «le nu lr in r rtouflcm cui innv « „ • W ïlc> c ran ,pc* -«t s|i»sm es d 'o toaur,!
de f ra le lltllr e t d 'cuerg ic n e r tc n .e . Cet n lim eù l e st d’-ilrm rd1' 1— le m anque d 'e u ltn u p d .l ,!
l ï . I r a i t .le 70,000 C a re , « . l a * , rebelle , à T r a i t e . , , . , .
■jais;
il e.w-es <lc irunescc .— N" nÂ.KGI) • M"< fi-illnr.l il’..,.® . i .1• • P "ra lf , , p , l r l m em bres, pur su le l
t e t r s - "c ”w ’~
■'i « s iar. trrWdK’.rvS'jsr.'ïrc: BrBürafAîî,‘*MAISON DU .BAHUT h C u , 2ti, | .l;,c cA e n Jg .n r , Paris.
S A N T É A T O U S P A R
L A H E V A M S C IE ilE C H O C O LA TÉ E DD BARRY' ï» I-OCDRI El EN TABLETTES, ■
cn l'".u 'lrc c c.n •"b ie lles pou r fa ire 12 lasses, 2 f r . “25 c . ; ,1e 24 lasses 4 f r • eu l.o ,le , d e I » 10 , do 28» m , , . , , 32 ,le 57(i S „ , !o ’t
u 10 v cnli un s la ia»sC clans ces grandes bo îte s . • »
A in s i le p lu s p u r e t d é lirâ t C hocolat e n la
P E R F E C T IO N D E CH O CO LA T DO BABRY
M i i r c l n - s « l u B h * p a i a( e u i c n ( .
R r n i i i n N , 10 ju in .F rom ent ITiccl. IH 78. — M uison 17 37___
Mclcit 10 20 . — Seigle 13 •* . — O rge 13 02.I— Avoine 10 70.
Pain ( lasc oflieicllp) le Lit. t " q u a lité 52 c . . i2* q u a lité 27 c .
« l c r s s in n t , 19 ju inlllé l'Iicel. |*« qua i. 2 0 » » , 2* q u a i. 18 89,
i’ qua i. 17 7 8 .— Méteil 10 I t . — Seigle 13 33.: - O rg e 13 01.— Avoine l*« q . I l 0 0 ,2*q . 10 »».
Pain lu Lit. I " q u a lité 33 c . j 2- q té 28 c . « o n i p l ê g n c . 19 ju in .From ent l’hcc t. tiuntilé 19 25 , 2* qua lité
18 25, 3 ' qua lité 17 23. — M éteil 15 Ko. __Seigle 12 50. — O rge 12 »». — Avoine 10 »»
Pain te Lit. 1 " qua lité 32 c . , 2* qualité 27 c. C ré g iy , 19 ju in .Rlé les 100 L it. I " qualité 27 25, 2‘ qualité
20 50, 3* q u a lité 25 »». — Méteil *• »». __Seigle 1750. — O rge 18 • » .— A voine t " qualité 20 50, 2* qu a i. 19 50.^ Pain flakc officieuse) te k it. I - qua lité 31 c . ,
n r , ., , r ! Cr, , ? U‘, o n , n - 18 j" in .o r Z 100 k ,l- 1” qua lité 25 85, 2* qualité « - V ’ i r r*1.""1" 6 24 — U c te if 20 »». - 1Seigle 10 u ). —, Orge 18 50. — Avoine 20 50. ^ la m blanc (lafcoflieieusc} le k it. I " q. . . « 31 c" 2* 2 ^ ’ ( ,a *e ^ c‘ boulanger») 1- qusl
P M M t a l a l e . l h * t B M , 18Die I liect. I " • " -- , — i ' i - ï r 1" Tu.a ' 20 3!)- * quai. I 9 » . l
j q u a i. I i 7 5 . — Méteil 10 05. — Seigle 12 60,1 1. — A voine qualité 9 W . |
bis 30 c.
— O rge 11 80,2 ' qualité 8 60.
Pain blanc le kit; 35
22 -iu ,n - — Marché ordinaire; [ * • ! <1 affaires se son t tra ité s au jouM ’hui, l o i acheteurs n 'ayan t pas voulu accepter la hsaswB «tue dem andait la c u ltu re . O n a co té les Mes i l 1 f r . 50 de p lu s q „ ’il y a h u it jo u rs e t de SO c.l su r les avoines. ■
From en t les 100 k it. l»qualiM » 27 . . . 2*qs* l î f ? V l 3 ' 25 ” > -r- Seigle 16 50. —■Avoine l ' t qua lité 20 t»0, 2* q u a lité f9 50. I
n i l b. ? t ' 1:* S “» » ‘é 21 05, 2*q»»l«6| .19 75, 3* q u a lité 18 5o. — â c i8 |e 11 90. -
«I*sàlit^ 9 45, 2* qua lité 8 20.Pain le k it. !•* q u a i. 33 c .; » qua i. 28 c.
f r .4 tO p a r ail
BUREAUX7 , p la c e de
B o u rse , P a r is
«iss
L e P lus co iup lid d e s jo u rn a u x O aan c te iv . le g u id e in d isp e n sa b le d e s a c l ie n n a l r e , e i d e s n h l ie i l u re s I n i l i T ’.!, Imal ç h e , m ie R evue do h. In m s e , le c o u rs d e lo u le s les v a le u rs f ra n ç a ise s el S £ *, | ; ' l aR clc lle d e e u s les l i ra g c s . les r e c c lle s d e s c h e m in s d e Ter, les d iv id e n d e s c a i c c c v .d r W . n n ï ’. i . r.s co n v n ca llo u s aux assem b lées s i 'n f-ra lc s c l les e o m p le s-rc iid u s d u c e s a s se m b le ra , le b ila n licbd’u n i id 'X a c i n i : ’ '" W d g n i c s n ........ :1ères e l i i id u s lr i r l lc s , d e s a r l le lc s ra iso n n e s c l d e s r e , e « c i c l „ , ï " " S ï 4
. RBr anBUREAUX
7 , P lace do I* B o u rse , Paris*
chaque a liste fomls.l e s e e u v e c a l io u s a u x » « ™ 'b b i « « W r “ é .” .!
co n se ils s u r les. m e ille u rs p lacem en t* A o p é re r , d e s c o r re s p o n d a n c e s do toiileK lo i p la c e s d e I T i i p î n ? ,0 aVT ' % 2
c n e n v o y a n t i i r . 4 0 e n lim b ro s-n o s te o u e n u n m a m la l A l 'o rd re d e M. d e F o n t b o n II h ni n e tir , D '-g eran t d u jo u r n a l , 7 , p lace d e la B o u rse , P a r is . o m n o u iiia ii l , il’do la L égion d'hoii*
Tu p x r m u s , M a ire de la v ille de S tn lis , pour légalisa tion de la signature de M . E Pjly n , ap p osée à l’a rtie le . Le 1869 E nregistré n Senlis, le 1869. f I Im p r im er ie cl L ithograph ie E rn est PA Y E N , suce de M -
1 Place de l'IJ iile lile-V ille d Senlis.ItE G N IE B ,