PLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926
-
Upload
andre-decotelli -
Category
Documents
-
view
135 -
download
0
Transcript of PLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926
-
COLLECTION DES UNIVERSITES DE FRANCEpublie sous le patronage de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUD
PLATONOEUVRES COMPLTES
TOME IV i PARTIE
PHDON
TEXTE TABLI ET TRADUIT
Lon ROBINProfesseur la Facult des Lettres
de l'Universit de Paris.
PARISSOCIT D'DITION LES BELLES LETTRES
g5, BOULEVARD RASPAIL
1926Tous droits rserves.
-
NOTICE
I
LE P11DON
S'il est impossible de dater le Phdon, on peut du moinsle situer dans l'uvre de Platon. Sa parent avec le Banquetest en eflet manifeste : celui-ci enseigne comment vit le Sageet celui-l, comment il meurt ; ils se ressemblent en outre parleur contenu doctrinal. Sans doute il est difficile de dire
lequel des deux a prcd l'autre*
. S'il est possible cependantde dterminer d'une faon au moins approche l'poque dela composition du Banquet
2,du coup on obtiendra le mme
rsultat pour le Phdon. Tenons le ds prsent pour un dia-
logue de la maturit de Platon. 11 ne fait certainement pascorps avec les dialogues proprement apologtiques, Apologieet Criton. D'autre part, il parat bien avoir t crit, notam-ment aprs le Gorgias dont il suppose et complte l'eschato-
logie, aprs le Mnon auquel il fait une allusion non douteuse(72 e sqq.). Enn on ne peut gure contester que, par rap-port au Phdon, le Phdre (rserve faite de certains pointslitigieux) et la Rpublique (le livre I tant mis part) repr-sentent un nouvel effort pour prciser les problmes, pourapprofondir les solutions, pour tendre la porte des systmesmythiques.
1. Peut-tre est-ce le Banquet, auquel se rfrerait l'expriencequ'chcrate, dans le Phdon 5o, b, est cens avoir d caractred'Apollodore. Voir plus bas.
2. Voir la notice sur ce dialogue.
-
vin PHEDON
Par consquent, l'poque o semble avoir t composle Phdon, Platon a dj accompli son grand voyage enEgypte, Cyrne, dans la Sicile et la Grande-Grce ; il estdj le chef d'une cole, qu'il vient d'tablir dans le parcd'Acadmus (388). Il est en possession d'une mthode pourapprendre et pour enseigner, dont le Phdon peut dsignerla technique par voie de simple allusion, quitte en prciserensuite l'usage (76 d, 78 d et ioid sqq.). Il a une thoriede la connaissance et de l'tre, laquelle il se rfre dans lePhdon comme une doctrine depuis longtemps rebattue etqui a son vocabulaire spcial, ou qui le cherche
!
;thorie
dj familire ceux pour qui il crit. L'orientation math-matique de sa pense, dj manifeste dans le Mnon et dontle VII e livre de la Rpublique fixera le caractre symboliqueet prliminaire, se rvle aussi dans le Phdon par l'emploiprivilgi des exemples ou des reprsentations mathma-tiques
2. Tout cela, certes, est mis dans la bouche de Socrate.
Mais Socrate est ici personnage d'un dialogue dont l'auteurest Platon. Donc, tant qu'il n'aura pas t prouv par desraisons dcisives 3 que le Phdon est d'un bout l'autre untmoignage historique relativement Socrate, on sera endroit de penser que, s'il constitue un document, ce doit tresurtout en ce qui concerne son auteur.Aucun doute srieux ne peut tre lev sur l'authenticit
du dialogue. On a pu croire, sur la foi d'une pigramme quise lit au bas du premier feuillet du Phdon dans un de nosmanuscrits (le Venetus, Append. class. 4, cod. 1, celui quisera dsign par le sigle T), que cette authenticit avait tconteste par le Stocien Pantius. Ce n'est qu'une mprisesur le sens de l'pigramme : les doutes de Pantius portaient,non sur l'attribution de l'ouvrage Platon, mais sur la valeurdes arguments qui y sont allgus en faveur de l'immortalitdes mes individuelles 4 .
1. 65 d; 72 e-73 b; 74 a; 75 cd; 76 b, d; 78 a; 92 d; 100 b;102 b. 100 d.
2. - f a sqq., 96 e sqq., 101 bc, 102 b sqq., io3 e sqq., no d,ni b.
o. Ce problme sera examin un peu plus loin, p. xv sqq.4. Cf. S. Reinach, Panaitios critique (Rev. de Philologie 1916,
201-209).
-
NOTICE
II
LE PROBLME HISTORIQUE
Le Phdon n'est pas, on le sait, un dialogue direct, comme
par exemple le Gorgias ou le Mnon. C'est, encadr dans untoi dialogue, le rcit du dernier entretien de Socrate avec sesfidles 1
,le jour mme o il but la cigu.
Le rcit est fait par Phdon d'lis, un de ces fidles, chcrate de Phlionte,qui est impatient de connatre, d'aprsun tmoin, les circonstances de la mort de Socrate et surtoutce qu'il a dit avant de mourir. Quelles sont chez chcrateles raisons de cette curiosit ? Il n'appartient pas au groupesocratique ; c'est un Pythagoricien et, avec trois autres Phlia-
siens, un des cinq membres de la Secte que connut Aris-toxnede Tarente, le Musicien 2 . Mais, sans parler de la placequ'y tiennent Simmias et Cbs, plus d'un dtail dans le
dialogue (p. ex. 5g b, 60 a) est fait pour laisser croire qu'entreles Pythagoriciens de Grce et les Socratiques il existe desrelations habituelles. D'autre part, bien que sans douteSocrate soit moi t depuis quelque temps dj (cf. 58a fin),Platon suggre que l'vnement est assez rcent pour s'im-
poser la proccupation d'chcrate comme au souvenir dePhdon.Le nom de Phdon a t popularis par notre dialogue. Mais
ausujet de sa personne et de ses doctrines notre ignorance
n'est gure moins grande que pour chcrate. Sur quoi sef ,nde la tradition d'aprs laquelle, appartenant une noblefamille d'lis, il aurait t amen Athnes comme prison-
1. Les membres d'un groupe philosophique, runis autour d'undirecteur, et que le groupe soit ou non constitu rgulirement en
cole, sont des associs et des confrres. C'est pourquoi le mot Ita:-
00; m'a paru devoir fre rendu par camarade, plutt que par ami.2. Diogne Larce VIII, 46. chcrate est mentionn aussi dans le
catalogue des Pythagoriciens que dresse Jamblique la fin de sa Viede Pythagore (267); parmi les femmes pythagoriciennes est nommeune chcratie de Phlionte, peut-tre sa fille. Voir p. 1, n. 1.
-
x PHDONnier de guerre ? et, remarqu de Socrate pour son intelligence,rachet sa prire par un des amis du Matre, par Cbsmme, prcisait-on parfois ? Il se trouve, il est vrai, qu'en4oi-4oo les faubourgs de sa ville natale furent ravags par lesSpartiates, qui taient alors les allis d'Athnes. Mais quelrapport y a-t-il entre ce fait et la tradition ? Celle-ci semblebien n'tre qu'un petit roman en marge du Phdon. Lafigure du personnage n'est peut-tre pas plus aise dter-miner d'aprs les donnes du dialogue. Sans nul doute, levoir assis prs du lit de Socrate, et le Matre pressant entreses doigts les boucles de sa longue chevelure (89 b), on peutle prendre pour un disciple particulirement aim 1 . Letableau est gracieux sans fadeur ; la
xvivacit rieuse des rpar-
ties tempre l'motion. Mais ce disciple aim est-il un toutjeune homme? On l'admet le plus souvent, pour cette raisonque c'tait Athnes l'usage des jeunes gens de porter lescheveux longs. Pourquoi donc alors Socrate aurait-il cou-tume de railler 2 Phdon sur une pratique habituelle songe ? Tout au contraire il est naturel qu'il le gronde souventde conserver dans Athnes un usage de son pays, qui n'y con-vient pas aux hommes qui ont pass la jeunesse. Au surplus,et quelle que ft la ralit, il semble impossible que Platonait pu vouloir donner une apparence simplement aimable celui dont il faisait le narrateur d'un entretien o s'agitent,autour de Socrate mourant, les problmes derniers de la con-duite et de la destine. Quelle confiance chcrate pourrait-ilavoir dans l'exactitude d'un tmoin que sa grande jeunesseet empch de s'lever de telles hauteurs ou de suivre unediscussion si subtile? D'autre part, aprs avoir, au mpris desindications implicites de Platon, suppos Phdon trs jeuneen 399, on est ensuite conduit supposer en outre que lafondation de son cole lis est de beaucoup postrieure lamort de Socrate. Quelle doctrine y enseignait-il? Sans douteune doctrine voisine de celle des Mgariques et fonde sur un
1. Le fait qu'Eschine avait aussi donn son nom l'un de ses dia-logues socratiques ne prouve rien par lui-mme quant l'autoritdont il jouissait (quoi qu'en pense Archer Hind, d. du Phdon,Introd., p. 4o).
2. L'interprtation la plus rpandue (cf. p. 54, n. 1) donne toute la scne une tournure quivoque et, par rapport aux circon-stances, singulirement dplace.
-
NOTICE xi
usage, pareillement intemprant, del dialectique: Timon leSceptique en effet, dans ses Silles (fr. 28 Diels) le rappro-chait d'Euclide, l'un bavard ls l'autre, dispuleur. On sait enoutre quelle parent unit l'cole d'rtrie, fonde par Mn-dme et Asclpiade de Phlionte, d'une part l'cole d'lis,de l'autre, celle de Mgare *: Des cinq Compositions socrati-ques (/oyoi fftixpxucoQ qui lui taient attribues, deux seule-ment taient tenues pour authentiques : son Zopyre, dont lethme physiognomique est pass dans la lgende de Socrate,et son Simon, duquel sort sans doute ce prtendu disciple deSocrate, Simon le cordonnier, dont les propos (vxtmxot oyot)taient, la vrit, galement rapports Eschine. Aulu-Gelleparle de l'lgance manire du style de Phdon : le pauvrefragment conserv par Snque (Ep. 94, 4i) semble bien luidonner raison. En somme, autour de la personnalit de Ph-don il n'y a pour nous qu'incertitudes et tnbres.
Passons au dialogue racont. Le thtre en est la prisono, sur l'ordre des Magistrats, le condamn doit avoir, aucoucher du soleil 3
,
mis fin lui-mme son existence enbuvant la cigu. Parmi les personnages nomms comme pr-sents, cinq seulement prennent part l'entretien : Griton,Phdon, Simmias, Gbs, enfin celui que Phdon ne peutdsigner nommment avec certitude (io3a). D'autres inter-ventions sont antrieures l'entretien, ou seulement pisodi-ques : celles du Portier, de Xanthippe ou du Serviteur desOnze et de son
acolyte. Platon y a joint une liste d'ab-
1. Phldon, disait-il, en faisant un calembour sur le nom.2. Avant de connatre Slilpon de Mgare, Mndme (mort -\
ans, peu aprs 278) avait t l'lve lis de Moschus et d'Anchi-pylus, successeurs de Phdon aprs Plistanus. Raison de plus pourne pas loigner beaucoup de la mort de Socrate la fondation del'cole d'Elis, supposer mme qu'elle ne ft pas antrieure. Enfin,si c'est vraiment une rgle pour Platon (comme l'a indiqu M. L.Parmentier dans ses confrences de 192 5 ia Sorbonne) de ne pasmettre en scne des hommes encore vivants, il est possible que Phdonft dj mort au moment de la composition du dialogue.
3. Voir p. 8, n. 1 et p. 100, n. 3. Il est assez difficile de pr-ciser quelle poque de l'anne eut lieu la mort de Socrate : dansle Phdon il est question la fois de la fte d'Apollon (61 a) et duplerinage Dlos (58 a-c). Or celui-ci avait lieu en fvrier ou mars,tandis que la fte du Dieu se plaait au dbut de mai; en parlantde la fle, Platon a sans doute en vue les ftes de Dlos.
-
xn PHDOXsents : ce sont les fidles dont la prsence en un tel jour, auxcts du Matre, est suppose attendue par chcrate d'aprsce qu'il sait de la composition du cercle socratique. Avec Pla-ton, on doit en outre dans ce double catalogue distinguer lesAttiques et les trangers 1 , ceux qni frquentent habituelle-ment
Sorateet ceux qui ne l'approchent qu'accidentellement
l'occasion de leurs sjours Athnes, mais qui chez eux serclament de lui et veulent tre, par quelque ct, des Socratiques . Enfin, tandis que, en ce qui concerne cesderniers, Platon parat suggrer (5g c) qu'il a nomm tousceux qui taient nommer, au contraire, pour les Attiques,il indique (ibid. b fin) que son numration des assistantsn'est pas complte ; de fait, bien d'autres noms figurent dansl'Apologie (3g e sq.) 2 .
Quels sont, maintenant, ceux dont l'absence a besoin d'treexplique ? C'est, parmi les Attiques, Platon et, parmi lesEtrangers, Aristippe avec Clombrote. Le premier, dit Ph-don (59 b fin), tait malade. Qu'il ajoute je crois , rienn'est dans sa bouche plus naturel : bien loin de suggrerl'ide d'une fiction destine a
reporter sur un autre la res-ponsabilit d'un rcit infidle, c'est au contraire l'affirmationimplicite du fait. Malade de chagrin? Toute conjecture sur lacause de la maladie est inutile
;mais l'absurdit de celle-
ci est vidente, si l'on songe l'analyse, la fois subtile etforte, que Platon s'est attach faire du mlange de douleure
: de srnit qui anime la plupart des assistants 3 . Quant Aristippe de Cyrne et Clombrote d'Ambracie, ilstaient, disait-on, gine. Or gine tait un endroit de plai-sir et Aristippe est l'apologiste du plaisir ; il n'en a pas falludavantage pour supposer* que ceux-l n'ont pas voulu sacri-fier leurs jouissances, ni compromettre leur tranquillit parun
spectacle qui leur et t trop pnible ! Le blme serait
1. Sur ces personnages, voir p. 3, n. 1.
^
2. 11 est naturel que ni Chrphon (cf. Apol. 2c e sq.), ni Xno-phon ne soient nomms : le premier, parce qu'il tait mort avant !eprocs; le second, parce qu' ce moment il avait, depuis un an dj,quitt Athnes pour prendre part l'expdition de Cyrus ; sur laplace de Xnophon dans le cercle socratique, voir mon article dei Anne philosophique, XXI, 19 10.
3. Comparer 58 e sq. avec 117 c sqq.4- Diogne Larce II, 65 et III, 36.
a
-
NOTICE xiii
par trop dissimul et, en outre, singulirement maladroit :leur absence n'est sans doute pas plus coupable aux yeux dePlaton que ne l'est la sienne propre. Ce qui seul est intres-
sant, c'est qu'il ait tenu nommer Aristippe parmi les fidles
authentiques du Socratisme. Du reste le Socrate du Banquetest-il si loign de l'attitude du Sage cyrnaque ? L'idal decelui-ci n'est-il pas, d'autre part, qu'il faut se rendre ind-
pendant des choses et les matriser par la pense, savoir tou-
jours cueillir en elles, quelles qu'elles soient, la fleur du plaisiret chercher celle-ci gale distance de l'apathie complte et des
passions violentes, qui sont toujours douloureuses * ? La sr-nit de Socrate en face de la mort et l'allgresse de la lib-ration prochaine s'accordent aisment avec un tel idal.
Ainsi, pour des raisons de fait, deux disciples notoires setrouvent tre exclus de l'entretien. Il en reste en revanchedeux autres parmi les prsents: c'est Antisthne, qui doitfonder l'cole dite Cynique, et c'est Euclide, qui est dj ouqui va devenir scolarque Mgare. Or c'est assez pourPlaton d'avoir cit leurs noms : il ne leur fait aucune placedans un entretien aussi riche de philosophie, au cours duquelleur silence ne laisse pas d'tonner. Pourquoi ce parti pris ?Vraisemblablement parce que ce sont des contemporains, et
que les convenances littraires du temps interdisaient Pla-ton de prter des contemporains un langage qu'au moment
suppos de l'entretien ils n'avaient pas en effet tenu, ou quin'est plus le leur au moment o il crit. Ds Hors n'est-onpas dj tent de penser qu'il n'y a pas lieu de chercherdans le Phdon un rcit historique et qu'il est une fiction?
Cette prsomption se conlirme, si inversement on s'inter-
roge au sujet de ceux qui sont, avec Socrate, les principauxprotagonistes de l'entretien dans ce qu'il a de proprementphilosophique: Simmias
2,
Cbs et enfin cet inconnu mys-trieux, hracliten ou protagoren en qui il y a comme unreflet de la pense d'Aristippe, et dont l'objection topique(io3 a) commande la partie dcisive du dialogue. Quant auxdeux autres, dont le rle, surtout celui du second, n'est pas
i. Sans doute ces ides sont plutt celles du second Aristippe, le
petit-fils du ntre. Mais vraisemblablement elles taient dj cellesde l'anctre qui combinait au Socratisme des influences hracli-tennes, transposes par l'enseignement de Protagoras.
2. Diog. La. II, 12^, crit Simias.
-
xiv PHEDON
moins important, ils sont pour nous presque aussi nigma-tiques. Il ne peut tre question dmettre en doute leur exis-tence, mais il est bien certain que les anciens n'taient pasmieux informs que nous sur leur compte ; ils ne savaientque ce qui nous en est dit dans le Phdon ou dans le Criton(45 b) : qu'au temps de la mort de Socrate ce sont de jeuneshommes (Phdon 89 a); qu'ils appartiennent des famillesriches et sont prts, pour seconder le plan d'vasion conupar Criton, donner Leaucoup d'argent; qu'ils ont t desauditeurs du Pythagoricien PhiJolas pendant le temps quecelui-ci a sjourn Thbes (Phdon 61 d); que Simmias estde Thbes et Gbs au moins botien, comme semblent leprouver la forme dialectale que Platon met dans sa boucheet le chez nous dont il se sert propos du sjour de Phi-lolas Thbes avant son retour en Italie (ibid. 62 a, 61 e).Une autre fois encore Platon a parl de Simmias : de tous lesGrecs de son temps, lit-on dans le Phdre (242 ab), Socraten'a connu personne de plus habile que Phdre faire natreles discours, l'exception toutefois de Simmias le Thbain.Mais l'allusion au Phdon saute aux yeux ; car c'est Simmiasqui, en provoquant les explications de Socrate (63 a-d), a tl'instigateur de toute la discussion ; il n'y a donc l aucunedonne nouvelle. Aucune autre ne nous vient d'ailleurs.Xnophon (Memor. III 1 1, 17 ; I 2, 48) ne fait manifeste-ment que rpter Platon, si ce n'est qu'il spcifie que Cbs,comme Simmias, est de Thbes mme *. La VIP lettre platoni-cienne (345 a), bien mieux, se contente, en s'appropriantson exclamation de 62 a, de l'appeler le Thbain ; maisl'authenticit de cette lettre n'implique pas celle de tousles mots de son texte, et ceux-ci peuvent fort bien n'trequ'une glose. De mme Diogne Larce, quand il prcise queGbs est de Thbes (II, 126), ne fait sans doute qu'interprterle Phdon 2 . C'est justement parce qu'on ne savait rien d'eux,
1. De plus, chez lui, on trouve la forme vraisemblablement cor-recte du nom de leur compagnon du Phdon : Phdoncfos (au lieu de-des), comme Epaminondas, Plopidas, etc. Quelques manuscritscrivent Phdnids.
2. Simmias et Cbs sont nomms encore, avec rfrence expli-cite au Phdon, dans la XIIIe lettre platonicienne 363 a, falsificationantrieure au ier sicle de notre re (puisque le catalogue de Thra-
-
NOTICE xv
que d'ingnieux faussaires ont t tents d'crire sous leurnom. Diogne met au compte du personnage de Platon lefameux Tableau de Cbs, petit crit de tendances stoco-cyni-ques,dontla composition se plaee aux environs de l're chr-tienne. Comment, aprs cela, ne pas tre sceptique l'garddes vingt-trois dialogues dont il gratifie Simmias (II, 124)?11 n'est pas jusqu' la ralit pythagorique de leurs thoriesdans le Phdon qui ne soit matire soupons. Sans doutela doctrine de lame-harmonie, expose par Simmias, se rat-tache aux thories musicales et mdicales de Philolais
;sans
doute, ngligerait-on mme le fait qu'chcrate se souvientde lui avoir jadis accord son adhsion (88 d), elle se retrouve, peu de chose prs chez Aristoxne et Dicarque, Pripat-ticiens de la premire gnration qui sont d'origine pvthago-rique. D'o vient cependant qu'Aristote l'expose et la discute(De an. 1 4, jusqu' 4o8 a, 28) sans nommer les Pythagori-ciens, et qu'il leur rapporte au contraire des thories tout fait diffrentes (ibid. 2, 4o4 a, 16-20)? D'o vient, surtout,que Gbs, auditeur lui aussi de Philolais, ait sur l'me unedoctrine autre que celle de Simmias?
Par rapport Socrate lui-mme, le problme de l'histori-cit du Phdon devient particulirement dlicat. Pour ce quile concerne, en effet, les lments de comparaison ne man-
quent pas, soit qu'on les cherche en dehors de Platon ou bien l'intrieur de son uvre, Mais de quel critre dispose-t-onpour dcider quel est le plus historique, du Socrate quifigure dans VApologie ou de celui qui figure dans le Parm-nide ou le Philbe, de celui que bafoue Aristophane commele plus pernicieux des Sophistes ou de celui que glori-fient Xnophon et Platon ? De l'emploi de cette mthodecomparative il ne peut rien sortir que de problmatiqueet d'arbitraire. C'est notre dialogue lui-mme qu'il fautinterroger.Une chose frappe tout d'abord et qu'il semble difficile de
nier : le Socrate du Phdon est en possession d'un art bien
sylle, dans Diog. La. III, 61, la mentionne). Il est question de Sim-mias, appel le Socratique, dans la Vie de Platon (eh. 6) et dans les
Prolgomnes la pliilosophie de Platon (ch. 1) qui sont connus sousle nom d'Olympiodore ; mais les ides qui y sont attribues Simmiasne sont qu'un commentaire de Phdon 76 b.
-
xvi PHEDOxN
dfini de penser et de parler, dont il existe une mthode 1 ;tout l'entretien semble tre une mise en uvre de la rhto-
rique philosophique, considre comme un acheminement la dmonstration. De r7roXoyi'a, en effet, du plaidoyer quidveloppe des motifs et s'efforce de les rendre persuasifs, ons'lve ensuite la 7rapau.u6c'a, l'exhortation qui comportedj des justifications logiques et constitue, comme on disaitalors, une protreptique, un exercice de conversion ; on par-vient enfin des raisonnements, dont la rigueur prtendvisiblement s'galer celle des dmonstrations mathma-tiques, pour les surpasser en porte ; seuls ils sont capablesde lgitimer en dernire analyse, s'il y a lieu, les modesantrieurs de l'argumentation : les rgles mmes de cettemthode suprieure sont nonces avec une prcision tech-nique qu'il faut souligner. Dans cet nonc et surtout dansle morceau sur la misologie (8g c-91 b), l'ensemble decette technique est oppos avec une belliqueuse ardeur aux
prtentions injustifies d'adversaires qui ne savent ni ce
qu'est rigueur ni ce qu'est vrit2
. Dira-t-on que c'est pr-cisment une telle technique que visaient Aristophane en fai-sant, pour une part, du Socrate des Nues un matre de chi-cane ? ou le faiseur de comdies en le traitant d'odieuxbavard (70 b)? ou encore Xnophon quand il raconte (Mem.I 2, 3i-38 ; cf. ibid. i5, 39 et 47) comment les Trente avaientinterdit Socrate d'enseigner l'art de la parole ? Soit ; accep-tons que Socrate ait en effet donn un tel enseignement.Mais ou bien c'est avant ce qu'on peut nommer la priode
critique de sa carrire, avant de se vouer tout entier cette mission d'examen dont parle l'Apologie et que lui a
impose la rponse de l'Oracle delphique ; ou bien cet ensei-
gnement de l'art de penser et de parler n'a pas t inter-
rompu par l'exercice de la mission. Dans le premier cas, oncomprend mal pourquoi, son dernier jour, Socrate met en
1. Voir en particulier 61 b, 6 j c fin, 75 d, 78 d, 84 d, 89 c, 91ab, 101 de, n5 c.
a. D'une faon gnrale ils sont appels conlroversistes, k+xtXo-
yuoiy gens qui enseignent parler pour ou contre, sans nul souci dela ralit et de l'essence des choses. C'est ainsi que l'lve des
Sophistes qui a crit les Doubles raisons (oii'jol Xvoi) rejette expres-sment toute recherche de ce genre, c'est--dire portant sur le taxt (Vorsokratiker de Diels, ch. 83, 1 17).
-
NOTICE xvn
un tel relief des pratiques auxquelles il a renonc pour les
plus graves raisons ; et plus mal encore, dans l'autre hypo-thse, qu'il soit oblig de s'expliquer ainsi sur ce qui seraitla procdure accoutume de son enseignement et de sesrecherches. C'est donc peine si Platon dissimule que, sur ce
point, son langage n'est point dans le Phdon celui que tenaitson matre.De mme le Socrate du Phdon est trs loign de celui
qui professe savoir une seule chose, c'est qu'il ne sait rien.C'est un philosophe qui spcule sur l'tre et sur le Devenir,qui a l-dessus des doctrines bien dfinies, l'enseignementdesquelles il se rfre souvent et qui sont connues et
acceptes de Simmias comme de Cbs. A vrai dire, tandisque le second connat bien la thorie de la rminiscence, le
premier l'ignore ou l'a oublie
;mais peut-tre n'y a-t-il
pas l qu'un artifice destin effacer cette impression de
dogmatisme et rendre l'entretien sa libert d'allure.D'autre part, non seulement les recherches des Physiciensne sont pas ignores de ce Socrate, non seulement il les alui-mme pratiques (en quoi l'on voit le Phdon s'accorderavec les Nues, d'un quart de sicle antrieures au procs)
;
mais bien plus il ne s'en est pas actuellement dsintress.Car c'est une nouvelle physique qu'il se propose de substi-tuer l'ancienne. Au surplus, li comme il l'est l'explica-tion de la vie et de la mort, le problme de l'me ne con-cerne-t-il pas la physique ? Mais comment croire, cette foisencore, qu'un philosophe qui n'a pas renonc savoir pour-quoi les choses naissent, existent et enfin prissent, ait
gard par devers lui jusqu'aux dernires heures de sa vie unensemble de preuves si savamment labor, si troitementnou aux doctrines qui sont dj familires aux membresdu groupe dont il est le chef?
D'un autre ct cependant il se caractrise fortement parson attitude profondment religieuse et par l'enthousiasmede son asctisme. Bien que, ce qui peut tonner, le Phdonne contienne pas d'allusion explicite la mission dont So-crate a t investi par le Dieu de Delphes, l'image d'Apollonn'en domine pas moins le dialogue : c'est lui qui visite
i. Pour ceci et ce qui prcde voir les rfrences, p. vm, n. i.2. Voir le morceau de 96 a-101 a et p. 87, n. 1 fin.
IV. 2
-
xvni PHDONSocrate en songe, c'est lui qui a retard sa mort et lui adonn ainsi le temps de se mettre en rgle ; comme lescygnes Socrate est son service, et c'est de lui qu'il tient sesdons prophtiques
1. Dvotion particulire qui, d'ailleurs, se
rattache l'ide gnrale que nous sommes la chose des dieuxet que nous ne devons pas, par le suicide, dserter arbitrai-rement la tutelle de ces matres excellents, avec lesquels leJuste aprs sa mort est assur de vivre en socit. Et c'estencore cette pense religieuse que se rapportent ses der-nires paroles, sur le vu fait Escuiape
2. Le rle capital
qu'il donne aux notions de purification et d'initiationtmoigne de l'influence de l'Orphisme : soit qu'il s'agisse desusciter des rflexions rationnelles ou de les dpasser par des
reprsentations figures et mythiques, c'est sur des rvla-tions mystiques qu'il s'appuie et sur des traditions reli-
gieuses3
. Homme inspir et prophte, le Socrate du Phdonest en outre l'aptre passionn de la mortification. La foi et
l'esprance dont il travaille, parfois avec les accents d'unebrlante loquence, communiquer l'ardeur ses amis, ontpour objet la libration complte, qui doit purifier entire-ment l'me de la misre des passions et de la dpendance
l'gard du corps *. La vertu consiste rduire autant qu'onle peut cette dpendance et vivre par la pense pure, renoncer tous les plaisirs corporels, aux richesses, aux soinset la recherche de la toilette 5 . Ce Socrate a donc dj lestraits d'un Cynique, et on ne peut oublier que la Comdie lesa vigoureusement souligns. Mais par ailleurs il en possded'autres grce auxquels, vitant la forfanterie et le charla-
tinisme, bornant l'asctisme la matrise spirituelle, il luiconserve sa noblesse. Dans son zle, son apostolat n'a riende hargneux ni de brutal ; il est fervent, mais plein d'indul-
gence, et il s'efforce surtout de se faire aimer ; il ne proscrit niles liens de famille, ni le respect des coutumes et des obliga-tions sociales. Les actes moralement indiffrents de la con-duite extrieure, ou qui ne sont pas strictement exigs par les
i. 6oe-6i b, 84 e sq.2. Pour tout ceci voir 61 c sqq. ; 63 bc, 69 d 5 111 b; 118 a.3. Voir par ex. p. 17, n. 2 ; p. 21, n. 1 ; p. 22, n. 4 ; P- 4o, n. 1
et n. 3; p. 4i, n. 1.
4- Notamment 66 b-67 b, 68 ab, 83 bc.5. Cf. 64 c-e, 68 b-69 d, 81 a-c, 82 c-84 b.
-
NOTICE xix
ncessits vitales, sont pour les choix de la conscience desoccasions et des instruments, soit du salut de l'me, soit desa ruine *. En somme, ces deux aspects pratiques du person-nage, l'inverse des prcdents, s'accordent aisment lasituation. Ils s'accordent aussi avec le fait mme de l'accusa-tion : dans son groupe social, un Socrate prophte et aptredevait passer pour impie et pour corrupteur de la jeunesse.
La question peut tre encore envisage d'un autre pointde vue, et par rapport l'existence mme du cercle socra-tique ou, si l'on veut, la nature du lien qui unit au Matreses fidles. Ceux-ci en effet viennent, semble-t-il, de tous les
points de l'horizon philosophique dans la seconde moiti duv e sicle. Les uns, comme Simmias et Cbs, sont pythago-risants
; d'autres, comme Euclide, appartiennent la famille
latique ; Aristippe et l'inconnu relvent de Protagoras et serattachent l'Hraclitisme, comme d'ailleurs Platon lui-mme dont Cratyle a t le premier matre 2 ; Antisthne estun lve de Gorgias. Au surplus, une fois Socrate mort, lesdivergences clatent et des polmiques, souvent trs prescomme celle d'Antisthne et de Platon, mettent les disciplesaux prises. Le lien qui les unissait, c'tait donc la personnemme de Socrate. Du vivant de celui-ci ils communiaient,non pas dans l'acceptation d'une doctrine philosophique, maisdans une sorte de culte sentimental l'gard du caractredu Matre, dans la confiance en sa direction spirituelle. Voilce qui rapproche l'attachement fanatique d'un Apollodore derattachement terre terre d'un Criton. Pour tous, sa con-duite est un exemple surhumain ; sa pense, un objet de m-ditation et d'examen. Telle est du moins l'impression qui sedgage du dialogue: par les sentiments, d'ailleurs remarqua-blement divers et nuancs, qu'elle suscite
3,
elle dtourne
i. Par ex. 60 a (cf. p. 5, n. 2), 116 b ; n5 bc, 116 a, c ; 98 e sq. ;1 16 e sq.
2. Aristote, Metaph. A 6, 987 a, 32 sq.3. L'tat d'esprit des assistants se peint surtout dans les passages sui-
vants : 58 e-5 b, de; 61 c; 62 a; 64 ab; 77 e sq.; 95 ab; 101 b; 116 a;117 c-e. C'est pour ne pas attrister Socrate qu'ils hsitent prsenter des
objections, 84 d. Si ces objections affligent ceux qui les entendent,ce n'est pas parce qu'elles contredisent des doctrines auxquelles ilsseraient attachs
;c'est parce qu'elles leur semblent capables d'bran-
ler leur confiance en Socrate et la paix de leur admiration 88 b-89 a.
-
xx PHEDON
des questions qu'un examen critique conduit se poser, elletouffe toute impression contraire, elle donne au rcit dePhdon un cachet d'incontestable vrit.
Est-ce une raison pour le considrer comme un rcit his-
torique de ce qui s'est rellement fait et dit le dernier jourde la vie de Socrate? C'est une opinion que M. John Burneta soutenue avec autant d'ingniosit que de vigueur
1. Contre
cette opinion il existe, on l'a vu, de fortes prsomptions.Bien plus, dans les hypothses auxquelles elle est conduite,elle parat expose d'inextricables difficults. S'agit-il d'ex-
pliquer la composition du cercle socratique et l'adhsion don-ne la thorie des Ides ou la thorie de la rminiscencepar les Pythagoriciens Simmias et Cbs ? Aprs le retour dePhilolas en Italie, les Pythagoriciens de la Grce continen-tale avaient, dira-t-on, pris Socrate pour chef, et il tait lui-mme un des leurs. ce compte ne faudrait-il pas supposeraussi bien, Euclide tant un des fidles de Socrate, quecelui-ci a t aprs la mort de Zenon pris pour chef par lesElates de Mgare ? Du coup on devra baptiser latiques desdoctrines que, pour le premier motif, on nommait djpylhagoriques ! Il y a plus : comme c'est Socrate, entendezcelui de l'histoire, qui dans le Phdon expose la thorie desIdes et la thorie de la rminiscence, on veut retirer Platondes doctrines dont une tradition pour bien dire incontestelui attribuait la paternit, afin de les transfrer Socrate et,par del Socrate, aux Pythagoriciens. Ce qu'implique unsyncrtisme aussi hardi 2 , c'est la dprciation radicale dutmoignage d'Aristote : en distinguant comme il l'a fait laconception des essences chez Socrate et chez Platon, chez cedernier et chez les Pythagoriciens, celui-ci s'est, dit-on, com-
pltement fourvoy. Mais est-il croyable que, comme on le
i. Dans son dition du Phdon (toith Introd. and Notes, Oxford,Glarendon Press, 19 1 1) et dans Greek Philosophy, / (London, igi4),ch. ix et x, fin. La thse de l'historicit a t dfendue aussi, ind-pendamment du premier travail de M. Burnet, par M. A. E. Taylor,Varia Socratica, I (S 1 Andrews Univ. Publications IX, 191 1). Voirmes articles Une hypothse rcente relative Socrate (Revue destudes grecques XXIX, 1916, p. 129-165) et Sur la doctrine de larminiscence (ibid , XXXII, 191 9, p. 5i-46i).
2. C'est dj celui de Proclus (cf. Gr. Philos, p. 91) ou d'Olym-piodore (in Phaedon., ad 65 d, p. 3i, 16 sq. Norvin).
-
NOTICE xxi
prtend, Aristote n'ait pu Athnes, trente-deux ans aprsla mort de Socrate, rien apprendre de certain sur l'enseigne-ment de ce dernier ? Sous un autre rapport enfin l'interpr-tation historique ne semble pas moins aventure. S'agit-il eneffet d'examiner les rapports du Phdon, par exemple avec laRpublique? Le Phdon est, par hypothse, la dernire expres-sion de la pense de Socrate lui-mme ; donc tout ce qu'unentretien, donn pour chronologiquement antrieur, contientde plus quant au contenu doctrinal et quant aux formules,ou bien on s'efforcera (au prix de quelles subtilits!) de l'yretrouver sous-entendu 1
,ou bien, pour sauver une thse
par ailleurs intenable, on niera la ralit de ces enrichisse-ments.
Il semble donc impossible de considrer le Phdon autre-ment que comme l'exposition par Platon de ses propresconceptions sur la mort et sur l'immortalit de nos mes, enrelation avec d'autres doctrines, la thorie des Ides et la
rminiscence, qui faisaient dj notoirement partie de sonenseignement. Si l'on s'obstine cependant le tenir pourune narration historiqne du dernier entretien de Socrate,on doit reconnatre qu' tout le moins il brouille deux vo-lutions de pense, solidaires sans doute, mais successives :bref ce serait un vritable monstre historique. Qu'on y voieau contraire une libre composition de Platon, il est ds lors
naturel, d'abord que celui-ci ait donn pour cadre au sujetqu'il traitait la dernire journe de son matre ; il est naturelaussi que, voulant s'adresser indirectement par del l'en-ceinte de son cole ceux qui avaient t avec lui les fami-liers de Socrate, il rappelle ici leurs noms ; il l'est galementqu'ayant peut-tre rfuter des objections venues du dehorsou du dedans de son cole, il les ait places dans la bouchedes moins connus de ces familiers. Se considrant enfin lui-mme comme le continuateur de l'uvre de Socrate, il pou-vait se croire en droit de lier comme il l'a fait l'histoire desa propre pense ce qu'il savait du pass de celle de sonmatre, en prolongeant l'une par l'autre. Personne autourde lui ne pouvait s'y tromper : la fiction tait vidente pourtous les lecteurs, et Platon n'avait pas besoin de chercher ladissimuler. Au surplus c'tait la rgle mme du genre litt-
i. Voir par ex. p. 63, n. 2.
-
xxii PHEDON
raire auquel appartient le dialogue philosophiquece petit drame dont Socrate tait le protagoniste obligatoire ;il est, avec des personnages rels, une imitation de laralit. Que cette imitation puisse, tout comme nos romansou nos drames historiques, contenir des dtails d'histoirevraie, on le croira sans peine. Il y a au dbut et la fin duPhdon beaucoup de particularits concrtes qui ne sont pro-bablement pas de l'invention de Platon. Est-il utile de cher-cher lesquelles ? Le plus souvent, c'est l'art avec lequel cesdonnes sont utilises qui en fait la signification et l'intrt 2 .Par consquent ce que nous avons tudier dans le Phdon fc'est avant tout la pense de Platon.
III
LA STRUCTURE DU PHDONET SON CONTENU PHILOSOPHIQUE
L'art de Platon dans la composition de ses dialogues estun art qui sait se faire oublier. Bien que l'analyse doive enfaire vanouir le charme, il est cependant indispensable, pourbien saisir l'harmonieuse progression de la pense philoso-phique, de marquer avec soin les articulations et les con-nexions de la pense, de noter chaque moment dcisif lesrsultats obtenus et le progrs qu'ils conditionnent. Cheminfaisant on y joindra, pour quelques notions importantes, derapides remarques sur leur signification historique et surleur dveloppement ultrieur dans la pense de Platon.
L'expos des circonstances qui ont pr-57 a -61 c c^^ ^a dernire journe ou qui en ont
marqu le dbut tant laiss de ct, lercit de l'entretien commence par une notation concrte :Socrate garde la jambe la cuisson douloureuse des fers etil prouve du plaisir se la gratter ; plaisir et douleur sontdonc solidaires (60 bc). Notation pisodique en apparence,
1. C'est ainsi qu'Aristote caractrise le Xdyo; awxpaTt/.o, Poet.
1U7 b, 9-20; Rhet. III 16, i/ji 7 a, 18-21 ; fr. 61, i486 a, 9-12.2. Voir par ex. p. 102, n. 3.
-
NOTICE xxin
mais qui, sans parler de l'application qu'elle reoit plus tard
(83 d), appelle dj l'attention des auditeurs sur la solidaritgnrale des contraires. C'est une premire touche par la-
quelle est indiqu un thme essentiel du dialogue.Puis l'ide qu'sope, s'il y avait song, aurait reprsent
par une fable, c'est--dire par une histoire raconte ou un
mythe, cette solidarit du plaisir et de la peine (60 c) est le
pivot sur lequel se met tourner l'entretien, poussant tou-
jours plus avant le rayon de la recherche, largissant gra-duellement le cercle dcrit. Cette ide provoque en effet une
question incidente de Cbs : pourquoi, depuis qu'il est en
prison, Socrate a-t-il pour la premire fois de sa vie critdes compositions potiques et musicales ? La rponse deSocrate contient en germe les deux thmes sur lesquels s'en-
gagera la discussion. Un songe, dit-il, l'a souvent visit, luiapportant une invitation de la Divinit faire de la musique ;s'il avait bien interprt cette invitation dans le pass % ellene se serait pas renouvele ; il y voit, en ce qui le concerne,une intervention bienveillante d'Apollon. C'est d'autre partun bonheur pour le Sage de quitter la vie le plus tt pos-sible. Or deux ides sont impliques dans cette rponse : le
scrupule religieux et le souci actif de l'obissance aux dieux
supposent en eflet que, par rapport ceux-ci, les hommessont dans une dpendance dont il y aura lieu de dterminerla nature
;en outre, la mort est un bien ; mais pourquoi et
quelles conditions? C'est le problme, problme auquel estlie l'autre croyance.
I. Puisque la mort est un bien, un vrai
remiere^parie,
philosophe ne devra-t-il pas se la don-ner lui-mme ? Socrate ayant pos en
principe que la conscience religieuse l'interdit, Cbs s'entonne. L'enseignement de Philolas ne les ayant pas clai-rs l-dessus, Simmias et lui, l'occasion est bienvenue defaire du problme de la mort l'objet d'une recherche appro-fondie et de rasonter ce qu'on pense
2 du grand voyage. Lebut de l'entretien est ainsi dfini (61 c-e).
1. En considrant la philosophie comme la forme la plus leve dela musique, 61 a. Cette ide, pythagorique d'origine, est bien exposedans les Lois III, 689 cd ; cf. Rep. VIII, 548 b et III, 4n csqq.
2. C'est sur une tradition que Socrate se fondera pour en parler,
-
xxiv PHDONOr ce qui a embarrass Cbs, c'est que continuer ou ces-
ser de vivre ne comportent pour notre choix aucune alterna-tive et que, la mort tant suppose un bien pour l'homme,ce ne soit pas lui-mme qu'il appartient de se confrer cebien, mais un autre tre. La solution de la difficult estcherche d'abord dans l'interprtation d'une formule sacra-mentelle des Mystres
*: nous sommes, nous autres hommes,
dans une sorte d'enclos ou de garderie, et c'est notre devoir
d'y rester. Autrement dit, les humains sont la chose desdieux et leur proprit ; ils sont sous leur tutelle ; pourmourir ils doivent en avoir reu l'ordre de ieurs matres(62 a-c).
II. Dans cette solution Cbs aperoit pourtant une incon-squence : si nous sommes la chose des dieux et que ceux-cisoient les meilleurs des matres, il est absurde pour un phi-losophe de ne pas s'irriter contre la mort et de la souhaitercomme une libration. Aussi bien, observe Simmias, est-ceprcisment le cas de Socrate. Celui-ci est ainsi amen prononcer, et cette fois devant le tribunal de ses amis, un
plaidoyer, une nouvelle apologie, pour justifier son attitudeet celle du philosophe en face de la mort (62 c-63 b).
i Le thme gnrateur de ce plaidoyer 2 , c'est l'affirma-tion d'une double esprance, celle de trouver chez Hads desDieux autres que ceux de ce monde, mais pareillement bonset sages, et cette autre, moins assure quoique probable, d'yrencontrer aussi ces dfunts auxquels les mrites de leur vie
mais sur une tradition qui n'est pas, comme celle des Pythagoriciens(ax 'a), soumise la rgle du Secret, 61 d s. fin.
1. Littralement dans ce qui ne doit pas tre divulgu . Quandbien mme Athnagore, en rapportant ce qui suit Philolas (6,p. 6, i3 Schwartz), ne se fonderait pas sur une simple infrencetire du Phdon, son assertion serait sans importance : en devenant,notamment avec Philolas, une cole philosophique, le Pythago-risme cessait d'tre une secte secrte. Encore moins s'agit-il icides Mystres reconnus par la religion d'tat, pour lesquels l'obliga-tion du silence tait absolue. Plus probablement la formule enquestion appartient l'enseignement, moins ferm, des Mystresorphiques et mme sans doute quelque Discours sacr. Sur lesens de poup, que je traduis par garderie, voir p. 8, n. 2.
2. Thme qu'une intervention de Criton (63 de) amne reprendrepour le souligner fortement (c sq.).
-
NOTICE xxv
promettent, d'aprs une antique tradition, la batitude aprsleur mort 1 . Il s'agit donc de justifier par des motifs plau-sibles cette double esprance (63 b-64 a).Un premier motif se tire de la conduite mme du vrai
philosophe : son unique occupation est en effet de s'ache-miner la mort et, enfin, de mourir ; pourquoi s'irriterait-ild'avoir atteint le but de son activit ? (64 a) La qualitspcifique de la mort dont il travaille ainsi se rendre digne,fournit un second motif. La mort en effet c'est le corpsrendu lui-mme, l'me rendue elle-mme, la sparationdes deux. Or, si le philosophe fait aux yeux du vulgaire fi-
gure de moribond, c'est parce qu'il ddaigne tous les plai-sirs qui intressent le corps. Mais, s'il les ddaigne, c'est que,pour lui, il n'y a que la possession de la pense et l'exercicede la pense dans le raisonnement pour permettre le pluspossible celle-ci, en isolant le plus possible aussi l'me du
corps, le contact avec la vrit et la connaissance de l'tredes choses
;tandis que cette condition est empche ou per-
vertie par l'usage des organes corporels de la sensation et parles motions qui y sont lies. Si donc notre doctrine estvraie, que chaque ralit : juste , beau , bon , ou grandeur , sant , force , peut tre connue exacte-ment et purement dans la vrit de son essence individuelle
2,
ce doit tre sans aucun mlange de ce qui vient du corps et
par le corps, mais au moyen seulement de la rflexion raison-ne (64 a-66 a). La conclusion s'impose : ou bien l'mene. connatra rien vritablement, ce qui est son but, qu'aprsla mort et compltement spare du corps ; ou bien ellen'approchera pendant la vie d'un tel savoir qu' la conditionde rduire autant que possible son commerce avec le corpset de se purifier, pour entrer en contact avec ce qui lui-mme est pur (66 b-67 b).
2 Les motifs de l'esprance du philosophe ayant t ainsidtermins, il faut dire quels sont chez lui les effets et les
1. Cf. 80 d, 81 a ; p. 4o, n. 1 et 3.2. 65 d, a-d signifie qui n'est que cela seul (voir p. 35, n. 1 et
p. 39, n. 2), et en soi en mme temps que pour nous, mais condi-tion que nous usions de la pense sans aucun concours de la sensation.La chose en soi n'est donc pas, comme dans le Kantisme, strictementinconnaissable pour nous; elle est au contraire chez Platon le con-naissable par excellence.
-
xxvi PHDONsignes de la purification. La purification habitue l'me se
sparer du corps pour se recueillir en elle-mme, Si donc lamort est prcisment cela et que le vrai philosophe s'occupeuniquement d'apprendre mourir (cf. 64 a, c-65 a)
1
,
cet
ami de la sagesse se distinguera aisment de l'ami du corpsen ce que, loin de s'irriter de l'approche de la mort, il s'en
rjouit (67 b-68 b). De plus il n'y a que lui pour pos-sder une vertu relle et qui donne l'me la purification,tandis que la vertu ordinaire ne fait que se contredire elle-mme et est tout illusoire (68 c-69 b). Enfin la destinequi menace ceux qui arrivent chez Hads sans avoir t puri-fis et initis est trs diffrente de celle qui est promise auxautres : Socrate a-t-il eu raison de rgler sa vie sur une telle
esprance ? c'est ce qu'il saura tout l'heure. Du moins sonplaidoyer aura-t-il fait comprendre ses amis pourquoi lamort prochaine ne lui inspire point de rvolte (69 c-e).La porte de ce plaidoyer qui constitue la premire partie
du Phdon doit tre exactement mesure. Gomment le phi-losophe sait-il qu'il doit attendre pour quitter la vie un ordredes Dieux ? par une rvlation ; que la batitude sera le lotdes Purs? encore par une rvlation. Si, en attendant la
mort, il emploie la vie se mortifier afin de se rendre pur,c'est parce qu'il a l'espoir de cette batitude. Or, pour justi-fier cet espoir, ce qu'il allgue c'est l'exercice mme de laphilosophie, c'est la connaissance philosophique et la vertu
philosophique, fondes toutes deux sur la pense. Mais unetelle justification ne compte que si rellement, une fois s-
pare du corps, l'me survit la mort physique. Autrement,l'espoir du philosophe tant une duperie, son asctisme estun vain effort, son savoir et sa vertu des illusions, plus labo-rieuses mais non moins dcevantes que celles du vulgaire.Jusqu' prsent la survivance de l'me tait donc suppose titre d'objet de foi religieuse; elle a maintenant besoind'tre tablie, et l'objet de cette foi, d'tre rflchi et trans-
pos par la conscience philosophique.
1. Cf. Gicron, Tusc. I 29, 7i-3i, 75. Mais, quand Snque (Ep.26, 8 sq.) donne Lucilius ce conseil : Meditare mortem.. Egregiares est condiscere mortem, ce n'est pas Platon qu'il l'emprunte,c'est, il ne faut pas l'oublier, Epicure ; on sait assez qu'aux yeuxdes Epicuriens, la mort n'est rien pour nous .
-
NOTICE xxvii
Pour la troisime fois, la clairvoyanceDeU69
84b
rtie'
critique de Gbs discerne la difficultet oblige Socrate approfondir sa pen-
se. L'loquence du langage de Socrate n'empche pas leprincipe d'en rester fort incertain : qui nous assure que l'me,au moment o elle se spare du corps, ne se dissipe pascomme un souffle ? Pour lgitimer l'esprance du philosophe,il est donc ncessaire de sermonner (7iapaij.u6isc) celui qui n'est
pas philosophe et de lui faire croire (rJ.az'.) que, par elle-
mme, notre me possde une activit propre et une pense.Sur la question de savoir si les mes des morts ont ou n'ont
pas une existence aux Enfers, Gbs en effet demande seule-ment tre dfendu contre une crainte qui ne lui permet pasde partager la croyance du philosophe; de son ct, Socratelui offre seulement de constituer sur l'objet de la rechercheun ensemble de reprsentations vraisemblables (69 e-70 c).
I. Une premire raison est, une fois de plus, fournie parla tradition
religieuse : la vieille croyance au cycle des gn-rations i implique que nos mes existent aux Enfers et que,tout comme la vie engendre la mort, rciproquement desmorts doivent natre les vivants. Si cette dernire croyanceest conteste, on devra alors chercher un autre fondement la croyance en la survie de nos mes (70 cd).
Le principe impliqu par la tradition demande donc treprouv par une gnralisation inductive. Or on constate que,partout o existe une opposition de contraires, il y a devenirde l'un l'autre: ainsi ce qui est plus grand nat de ce quitait auparavant plus petit. Et maintenant, comment s'oprece devenir? Entre les deux contraires, et de l'un l'autre, il
y a une double gnration : ainsi dans l'exemple prcdents'accrotre ou diminuer. Un autre exemple facilitera l'analysedu cas qui nous occupe : entre veille et sommeil, le couple deprocessus intermdiaires par lequel se fait le passage de l'un
1. Voir p. 22, n. 4- Ce thme mystique a t exploit par lespotes (cf. la fin du fr. 83g d'Euripide, Chrysippe) et par les philo-sophes, notamment par Empdocle. Mais Heraclite disait dj : C'est une mme chose que ce qui est vivant et ce qui est mort, cequi est veill et ce qui est endormi, ce qui est jeune et ce qui estvieux
;car par le changement ceci est cela, et cela de nouveau par le
changement est ceci. (fr. 78 Diels, 88 Bywater).
-
xxvni PHDON l'autre est appel s'endormir et s'veiller. Semblablement, sitre vivant et tre mort sont deux contraires f
,
il doit y avoir
passage rciproque de l'un l'autre. Or dans un sens ce pas-sage se nomme mourir. Est-il croyable que, dans le sens
oppos, il n'y ait pas de processus compensateur? Dans laNature il y aurait alors dfaut d'quilibre et boiterie. Mais ce
processus existe : on le nomme revivre. C'est donc une con-
squence ncessaire, dont on doit convenir, que les mes deceux qui font morts continuent d'exister en un endroit d'o
part le recommencement de la vie. Au reste une preuve parl'absurde peut en tre donne : tons au devenir, en suppri-mant la mutuelle compensation, sa forme circulaire ; il se faitalors en ligne droite d'un contraire l'autre et sans retourinverse
;si donc, dans le cas dont il s'agit, renatre ne faisait
pas quilibre mourir, il serait fatal que dj tout se ft d-finitivement abm dans le nant. Ainsi donc l'accord desinterlocuteurs (o^oX^Y^txa) tait lgitime sur la ralit du re-vivre, avec la double ncessit et que les morts en soient le
point de dpart et que leurs mes existent ; ce qui impliqueenfin une diffrence entre le sort des mchantes et celui desbonnes (70 d-72 e).
II. Une deuxime raison se prsente alors l'esprit de C-bs. Le lien qui l'unit la prcdente, pour n'tre pas expli-citement indiqu, n'en est pas moins visible : la notion durevivre a veill chez lui la notion de cette reviviscence quiest, avec Voubli} un des deux processus intermdiaires entredeux nouveaux contraires, ignorer et savoir.
Si ce qu'on appelle s'instruire est vraiment se res-souvenir , nos ressouvenirs actuels supposent une instruc-tion antrieure: ce qui implique que nos mes, avant de
prendre figure d'hommes, existaient quelque part et qu'ellessont immortelles. Gomment une interrogation bien conduitesuffirait-elle mettre en tat de dire vrai sur l'objet d'une
question, si dj l'esprit n'en avait en lui une science et la
conception correcte? (72 e-73 b).L'hsitation de Simmias suivre la suggestion, quelque
1. Il est possible que Platon songe ici au clbre passage d'Euri-
pide qu'il cite dans le Gorgias 492 e, et qu'Aristophane a souvent
parodi : Qui sait si vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pasvivre ? (fr. du Polyidos, 63g JN.).
-
NOTICE xxix
peu confuse, de Gbs conduit reprendre la thorie de laRminiscence, autrement que dans le Mnon et en analysantle mcanisme du ressouvenir en gnral. Trois faits sonttout d'abord noter. Une perception quelconque n'est passeulement connaissance de son objet propre, mais encore re-prsentation intrieure, ou image, d'un objet autre 1 : ainsila vue de la lyre fait penser celui qui elle appartient, etet c'est l proprement se ressouvenir. En second lieu, les con-ditions de l'oubli sont l'loignement dans le temps et le d-faut d'attention. Enfin, un portrait de Simmias peut aussibien faire penser Gbs qu' Simmias lui-mme. En rsumle ressouvenir se produit entre les semblables comme entreles dissemblables (73 b-74 a)
2.
Or, considrer tout d'abord le cas o le ressouvenir vadu semblable au semblable, ncessairement il s'y joint unsentiment de ce qui, pour la ressemblance, peut manquer
l'objet vocateur par rapport l'image voque. Quand parexemple nous parlons de l'gal comme tel ou en soi, nous
parlons d'une notion bien dfinie, et de quelque chose quiest distinct et en dehors de tel ou tel objet sensible gal telautre de mme nature. Or ce qui nous fait penser cet gal,purement gal et rien qu'gal, c'est la vue de ces divers
objets3
. Entre eux et lui cependant il y a une grande diff-rence : tandis que, sans changer eux-mmes et par le seulchangement du terme de comparaison, ils sont tour tour nos yeux gaux et ingaux, l'Egal en lui-mme au contrairene peut devenir ingal sans cesser d'tre ce qu'il est. Donc,puisque c'est la vue de choses ingales qui a voqu l'ide del'Egal, on voit que toujours, et mme dans le cas des sem-blables (cf. p. 3o, n. 1), c'est le sentiment d'une diffrenceou d'une dficience qui provoque le ressouvenir (74 a-d). Deux propositions en dcoulent dont il faut convenir.
1. Sous condition qu'ils ne soient pas, comme deux contraires,ainsi blanc et noir, objets immdiats d'un mme savoir ; il y a ici aucontraire deux connaissances distinctes et on passe mdialement del'une l'autre.
2. Cette remarquable analyse de l'association des ides a t
reprise par ristote dans le De memoria (2, /J5i b, 16 sqq.) : c'est delui que vient la division classique entre le cas de la similarit, celuidu contraste et celui de la contigut.
3. Comparer Rpublique VI, 507 bc.
-
xxx PHDOND'abord, si nous avons conscience de ce qui manque auxgalits sensibles pour tre pareilles l'gal comme tel, c'est,ncessairement, que nous avons une connaissance pralablede ce dont, tout en restant toujours en dehors, elles tendentcependant approcher ; connaissance chronologiquementantrieure notre premire exprience des objets qui nousont fait penser cette ralit pure. En second lieu, puisquela connaissance sensible est, bien qu'imparfaite, l'origine pre-mire de notre reprsentation d'une ralit parfaite, il fautbien que la connaissance de cette ralit provienne d'uneautre source (7A d-75 c)
1.
Une double question se pose maintenant : dans quellesconditions avons-nous acquis cette connaissance ? de quellefaon la possdons-nous? Pour le premier point, la per-ception sensible commenant avec la vie, il est ncessaire quenous ayons acquis cette connaissance avant de natre, pour en
disposer aussitt ns : connaissance, non pas seulement de
l'gal, mais d'une faon gnrale de toutes les essences ouchoses en tant que telles, sur lesquelles portent les questionset rponses du dialecticien (75 cd). Pour le second pointon se trouve en face de cette alternative : ou bien ce savoirest pour nous un savoir vie et que nous n'oublions jamais ;ou bien au contraire nous le perdons en naissant
2,
et nous
en rcuprons ensuite la notion comme de quelque chose quiest ntre. Or la premire hypothse est fausse : savoir c'esten effet pouvoir rendre raison
3 de ce qu'on sait ; puisqu'ence qui concerne les ralits absolues dont il s'agit chacunn'en est pas toujours capable, c'est donc qu'il ne s'agit pas d'unsavoir qui soit constamment et universellement en notre pou-voir. Ainsi l'autre hypothse est ncessairement vraie : on nesait pas, on apprend, c'est--dire qu'on se ressouvient d'unsavoir qui ne peut qu'tre antrieur au temps o, devenant
1. Comparer le mcanisme del preuve cartsienne de l'existencede Dieu par l'ide du Parfait.
2. D'aprs le mythe d'Er (Rep. X, 621 a), les mes avant derevenir sur la terre boivent l'eau du fleuve d'Oubli (Amls). Ainsine s'abolissent pas seulement sans doute les souvenirs de leursexistences humaines, mais aussi les souvenirs dj retrouvs de leurexistence antrieure.
3. A soi-mme comme autrui : c'est la caractristique du dia-lecticien, Rep. VII, 534 b. Cf. p. 57, n. 1.
-
NOTICE xxxi
des hommes, nous n'avons plus que des perceptions sensiblesconfuses et changeantes. Nos mes, par consquent, existaient
auparavant et part de nos corps1
, possdant ce qu'il faut
pour acqurir ce savoir : la pense. Aucune autre hypothsen'est possible. Il serait absurde notamment de supposer cette
acquisition simultane notre naissance ; car, puisque nousne naissons pas (cf. 75 d, 76 bc) avec la possession prsenteet effective de cet acquis, il faudrait que nous l'eussions
perdu au moment mme o nous l'acqurons (76 d-76 d).Platon insiste ensuite avec force sur l'importance du
rsultat obtenu, et prpare ainsi la troisime raison. Uneseule et mme ncessit lie en effet indissolublement l'exis-tence de nos mes antrieurement notre naissance et.d'autre part, l'existence d'essences telles que Beau, Bien,etc., auxquelles nous rapportons les donnes sensibles comme des modles et dans lesquelles nous reconnaissons quelquechose qui tait dj ntre avant que nous fussions ns (76 d-
77 a)-Cette liaison est incontestable
;mais que gagne-t-on, objec-
tent Simmas et Cbs, l'avoir accorde? Ce qui dsormaisest croyable, c'est que l'me prexiste; mais il n'y a l parrapport la question qu'une moiti de preuve, car on peutbien concevoir que, ayant pri l'instant de la mort, l'mea commenc ensuite, d'une manire ou d'une autre, unenouvelle existence avant que nous naissions. L'objection deCbs (cf. 70 ab) subsiste donc : la survivance de l'me reste tablir (77 a-c).
Mais ils ont eu tort de disjoindre arbitrairement lesdeux premires raisons ; car elles font corps l'une avecl'autre. On est convenu en effet (cf. 72 a, d) que tout cequi a vie provient de ce qui est mort; par suite il ne peuty avoir d'autre origine cette manifestation d'une me quel'acte de mourir et l'tat d'tre mort; mais ce retour del'me au devenir, cette renaissance, ne se conoivent quesi, aprs la mort, cette me a continu d'exister. La preuveest donc complte (77 cd).
III. Ainsi Cbs et Simmias devraient tre satisfaits; s'ils
1. Rappel de ce qui a t dit plus haut sur l'affranchissement del'me l'gard du corps en tant que condition de la pense ; princi-palement 66 d-67 a, 69 bc.
-
xxxii PHDOISsouhaitent cependant un examen plus approfondi, c'est sansdoute que leurs puriles frayeurs ne se sont pas encore va-nouies. Or pour les chasser, c'est des exorcismes, des en-chantements qu'il faut avoir recours, en se persuadant toute-fois que personne n'est, plus que nous-mmes, apte lespratiquer heureusement. Donc, en reprenant la discussionau point o elle est reste, Platon procde comme si jusqu'prsent rien n'avait t fait pour vaincre les doutes de Gbs ;il ne vise encore qu' substituer l'incroyance inquite, ou une croyance qui fait peur, une autre croyance qui rcon-forte et composer cette croyance, que chacun est matre dese donner, avec des reprsentations vraisemblables (77 d-
78 b). La porte de la troisime raison, que l'on tend sou-vent surestimer, se trouve ainsi limite : elle n'est qu'unnouvel aspect de la 7rapaauGta, instruction et sermon l'usagede ceux qui n'ont pas la foi.Au reste la question prsente est pose en des termes qui
nous reportent aux frayeurs de Cbs : quelle sorte dechose appartient-il de se dissiper? pour quelle sorte de chose
peut-on craindre un tel accident? est-ce pour l'me? Ainsil'on verra, en ce qui concerne celle-ci, comment doit tre
envisag l'instant de la mort, avec crainte ou avec confiance.On rejoint mme ainsi le thme fondamental du plaidoyerde Socrate.
i La troisime raison de croire l'immortalit de nosmes se fonde sur un double postulat de sens commun :d'abord une distinction entre choses incomposes et choses
composes, celles-ci se dcomposant d'autre part en leursparties constitutives; puis cette probabilit que les choses
incomposes gardent toujours leur nature essentielle et leurrapport, tandis que les composes changent sans cesse dansleur nature et dans leurs relations (78 bc) *.
Appliquons cela aux analyses antrieures. D'une part il y aces pures essences dont les demandes et rponses de la dia-
lectique s'efforcent d'expliciter l'existence indpendante : leBeau en tant que beau, l'gal en tant qu'gal, etc. ; chacuned'elles possde l'identit permanente de nature et de relation
qui est le propre des choses incomposes, avec l'unit formelle,puisqu'elles ne sont rien d'autre que ce qu'elles sont. D'autre
1. Voir p. 35, n. 1 et p. 39, n. 2.
-
NOTICE xxxin
part il y a la multiplicit des sujets qui sont appels beaux,
gaux, etc., recevant ainsi, sous forme d'pithte ou d'attribut,la dnomination qui appartient en propre aux essences detout l'heure ; tous les caractres de ces sujets s'opposent ceux des choses de l'autre classe ; ils sont visibles et sen-sibles de toute manire, tandis que les essences ne sontaccessibles qu' la rflexion et au raisonnement (cf. 65 d-66 a), tant en effet invisibles (78 c-79 a).On peut donc admettre deux genres de l'tre : le genre
visible, ou de ce qui change incessamment ; le genre invisible,ou de ce qui est toujours identique. Or, notre corps et notreme tant leur tour deux choses distinctes, c'est videmmentavec le premier genre que le corps a le plus de parent et deressemblance, et l'me, puisque nous au moins nous ne lavovons pas, avec le genre de l'invisible (79 ab). Une pre-mire conclusion, c'est, comme dj l'indiquait le plaidoyer(cf. 65 b-d), que le corps tire du ct de ce qui change tou-
jours une me qui recourt lui et ses sensations pour exa-miner une question qui la concerne, qu'il fait hsiter et
divaguer sa dmarche ; mais qu'au contraire, si elle ne comptepour cela que sur elle-mme, elle se porte alors vers ce quoielle est apparente, vers ce qui est pur, immortel, immuable ; ce contact, elle acquiert elle-mme pour toujours cet tatd'immutabilit dont le nom est pense (79 c-e). Uneseconde conclusion, c'est que la matrise du Divin, la servitude du mortel (cf. 62 bc) se retrouvent, pour un mme tre,dans la relation de son me son corps : c'est au mortelque le corps ressemblera le plus et l'me, inversement, auDivin (796-80 a).
Quel est le rsultat dernier de cette analyse ? Ce qui estdivin, immortel, intelligible, unique en sa nature essentielle,indissoluble, toujours identique en soi et dans ses relations,voil quoi l'me ressemble le plus, et le corps au contraire ce qui a toutes les proprits opposes. En consquence, c'estla partie visible du compos humain, le corps, qui est aprsla mort voue la dissolution. Sans doute elle peut, danscertaines conditions ou grce certains artifices ou dans quel-ques-uns de ses lments, chapper pour un temps plus oumoins long cette dissolution naturelle. Mais c'est une raison
dplus pour se refuser croire que l'me, tant la partie invi-sible et celle qui est appele trouver au pays de l'Invisible.
IV. 3
-
xxxiv PHDONauprs d'un Dieu sage et bon
4,
la rsidence qui lui convient,doive, comme le redoute Gbs, se dissiper et prir (8oa-e).
Cette troisime raison, qui semble en un sens prolongerseulement le plaidoyer de Socrate, marque d'autre part un
progrs sur les deux raisons prcdentes. La premire, pourexpliquer la compensation des trpas par des renaissances,tablissait la subsistance ncessaire d'un principe de vie. Laseconde le dterminait comme une pense : sans quoi on ne
comprendrait pas que des perceptions sensibles, toutes rela-tives, pussent nous rappeler des ralits intelligibles, toutes
absolues, les Ides. La troisime montre enfin qu'entre cesIdes et l'me, principe de vie et de pense, il y a, non passans doute une identit de nature, mais une ressemblance etune parent. Elle commence donc dfinir la cbose qu'estl'me et indiquer, quant ses caractres tout au moins,pourquoi elle a des chances de ne point prir. Mais elle ne
prouve pas encore que l'me ait une existence sans fin.2 II ne s'agit encore en effet que d'un encouragement,
d'un effort pour rendre plausible la magnifique esprance duphilosophe, pendant sa vie et en face de la mort. Ce qui lemontre, c'est l'troite relation de la troisime raison avec un
mythe eschatologique, dont la donne provient de la rvla-tion religieuse et qui dveloppe seulement, comme on le voitds le dbut, des indications antrieures du plaidoyer (cf.63 bc, 69 c). Une destine perptuellement bienheureuseattend les mes des initis, celles qui, s'tant purifies par lamortification, ont russi n'tre rien qu'mes au moment dela mort; une destine misrable au contraire, celles qui,s'tant pendant la vie farcies en quelque sorte de corporit,quittent le corps impures et souilles (cf. p. 4i n. 3). Cesont ces mes qui, lourdes de matire visible et terrestre etayant horreur de l'Invisible, donnent lieu aux fantmes qu'onvoit autour des tombes ; ce sont elles qui, dans leur impa-tience d'une nouvelle incarnation, s'individualisent dans l'es-
pce animale de laquelle les rapprochent leur genre de vie et.leurs passions dominantes ; mritant mme de revenir laforme humaine quand elles ont pratiqu, et sans lui donnerla pense pour fondement, une vertu de routine (cf. 68 d
sqq. ; cf. p. 43, n. 1). Seules ont droit la forme divine et
1. C'est--dire chez Hads;voir p. o, n. 1.
-
NOTICE xxxv
au bonheur qu'elle comporte, les mes compltement puri-fies de ceux qui ont men la vie de l'ami du savoir (80 e-82 c).
Quelles sont d'ailleurs les fins auxquelles tend le vrai phi-losophe ? En les dterminant, ainsi que la mthode propre les atteindre, Platon donne la seconde partie du Phdon saconclusion. Le morceau est une sorte d' lvation sur la
mort, dans laquelle, l'aide des mditations antrieures, il
dgage du mythe le symbole moral qui y est enferm *. Lemorceau s'achve en effet sur ce thme de l'effroi, qui tait l'origine de la deuxime partie, et qui y est deux fois rappelaprs l'argument de la rminiscence et aprs la runion decelui-ci l'argument des contraires
2. Corrlativement, on voit
reparatre aussi l'ide initiale du sermon d'encouragement,de l'incantation apaisante; cette autre encore, qu'il est ennotre pouvoir de chasser des illusions dont nous sommesnous-mmes les artisans 3 . Le retour de ces ides caractriseuniformment toute cette partie du dialogue comme une pr-paration la dmonstration vritable.
Pourquoi l'ami du savoir est-il dtach des apptits corpo-rels et affranchi des craintes qui assaillent l'ami des richesseset celui des honneurs ou du pouvoir
4? Parce que seul il a
souci de son me, mais non de son corps ; parce qu'il sait bieno il va en suivant la philosophie et en s'interdisant de rienfaire qui contrarie la purification et la libration qu'elle lui pro-cure. Emprisonne dans le corps, l'me est en effet incapablede rien examiner qu' travers les barreaux de sa gele, mais
jamais d'elle-mme ni par ses propres moyens: emprisonne-ment d'ailleurs remarquable, car il est l'uvre de l'emprisonnlui-mme. Aussi, en sermonnant celui-ci sans brusquerie,en l'invitant se reprsenter lui-mme sa vritable fin, en
1 . Mais ce n'est pas, proprement parler (comme le dit M. Burnet,Phaedo, sommaire de 80 c-84 b), Vapplication morale d'une thorie.
2. Comparer 84 b avec 70 a et 77 b, e.3. Comparer 83 a, 82 e, 83 c avec 70 b, 77 e, 78 a.4. Ceux-ci, les tXo/prJaaTOt, les 01'Xapyot, les oiko-'.u-ot sont
opposs 82 c aux amis du savoir, aux iXouaOe, comme ils l'ont t68 c, sous le nom gnrique d'amis du corps, p'.Xoaojjxatot, au philo-sophe. Mais, le franais ne possdant que ce seul dcalque des com-
poss analogues qui existent en grec, on est oblig, pour traduire les
autres, d'user de priphrases.
-
xxxvi PHDONlui remontrant le dommage auquel autrement il s'expose * , laphilosophie fait-elle effort pour lui faire comprendre en quoiconsiste le mal suprme, celui dont tous les autres dcoulent.Ce mal, observe Platon avec une pntrante prcision, c'est
que l'intensit de l'motion porte invinciblement l'me
juger de l'objet qui a fait natre cette motion qu'il est toutce qu'il y a de plus vrai : les plaisirs et les peines sont la
pointe qui cloue l'me au corps, en sorte qu'elle juge de lavrit en fonction de son corps. Le calcul du philosophe, c'estau contraire qu'il ne vaudrait pas d'avoir pris tant de peineen vue de s'affranchir, pour mettre ensuite de nouveau sonme la merci des motions corporelles. Il a vcu dansl'exercice et sous la conduite de la pense raisonnante
2, ayant
pour objet de contemplation et pour aliment le vrai et ledivin, ce qui chappe aux fluctuations de l'opinion ; il necraindra donc pas que son me soit dissipe par la mort, car,en la menant vers ce quoi elle est apparente, la mort bienau contraire la dlivrera de tous les maux humains (82 c-84 b).
Aprs cette ardente exhortation la vieT0184 c^lifta
1G'
spiritue^e un lng silence coupe par unesorte d'entr'acte le droulement de l'en-
tretien. Chacun mdite de son ct, Socrate comme ses amis.Au tour de ceux-ci d'exposer leurs propres conceptions ; toutle premier, Socrate voit bien les insuffisances de la sienne etla prise qu'elle offre aux objections ; il est tout prt cher-cher avec eux une solution meilleure et qui mette fin leursdoutes (84 cd).
Quelles sont donc ces insuffisances ? Dans la premire par-tie Platon a donn des motifs de croire une vie future del'me. Il a mme commenc, dans la deuxime partie, d'endfinir la nature, en allguant des raisons, dont chacune dter-mine un caractre de l'me. Mais ce ne peut tre l qu'unprlude : l'me, qui est le principe permanent de la vie, a enoutre la pense ; par ce second caractre elle est corrlativede l'Ide, qui est l'intelligible. Mais on ignore si entre le pre-mier caractre et le second il existe un lien ncessaire : de
1. Rapprocher 83 a-c de 65 bc, 66 b-d, 79 d, 82 e.2. Comparer 84 a s. jln., avec 66 a, 79 a.
-
NOTICE xxxvn
nouvelles dterminations sont donc empruntes aux choses
auxquelles l'me ressemble le plus ; on montre par analogiequ'elle doit avoir quelque chose d'immortel et de divin,d'indissoluble et d'immuable, d'unique en sa nature. Maisl'immortalit appartient aux Dieux (cf. io6d) ; l'indissolubi-lit, l'immutabilit et l'unicit de nature sont des propritsdes Ides; or notre me individuelle n'est ni Dieu, ni Ide;aucun de ces caractres de notre me n'est donc rattach l'Ame en tant qu'me, Ce qui manque encore par cons-
quent, c'est de connatre Yessence de notre me, de rapportercelle-ci l'Ide de l'me, ainsi qu'on doit le faire de toutechose concrte, sensible ou non pour nous (cf. 79 b). Voildonc la relation qu'il faut dmontrer, s'il doit tre dfinitive-ment tabli que l'asctisme du philosophe et sa srnit enface de la mort ne sont pas une duperie.Dans l'introduction del troisime partie rapparat, d'une
faon remarquable, le thme apollinien du Prologue, maislargi et exalt jusqu'au prophtisme. Chez Socrate le dondivinatoire n'est pas infrieur ce qu'il est chez les cygnes : siceux-ci chantent surtout au moment de mourir, ce n'est paspar tristesse
1,comme le croient les hommes toujours obs-
ds par la crainte de la mort ; c'est qu'ils ont la presciencedes biens que rservent les demeures d'Hads. Serviteur dumme matre, consacr au mme Dieu 2 , ayant reu de luiune facult prophtique qui ne le cde pas la leur, Socraten'a pas plus de raisons qu'eux de s'affliger de quitter la vie :c'est donc avec une entire libert d'esprit qu'il est prt
1. Ce n'est jamais la souffrance, dit Platon 85 a, qui, comme onle croit, fait chanter les oiseaux: ni l'hirondelle, ni le rossignol, nila huppe. Allusion une lgende attique : Procn et Philomletaient les deux filles de Pandion, roi d'Athnes ; la premire avait
pous Tre, roi de Thrace ; celui-ci, ayant viol sa belle-sur, luifit couper la langue pour l'empcher de rvler le crime ; elle russit
cependant par un subterfuge en instruire sa sur, puis toutesdeux, pour se venger, firent manger Tre le corps de son fils Itys ;poursuivies par la fureur du pre, elles furent changes, Procn enhirondelle, Philomle en rossignol, et Tre lui-mme devint lahuppe.
2. Le cygne est l'oiseau d'Apollon. Socrate parle ici comme dans
l'Apologie 23 c, du service du Dieu (tt;v -ou eou XoRjpefav) ;mais ici il n'explique pas pourquoi Apollon est son matre.
-
xxxviii PHDONcouter objections ou questions, et l'on croit deviner que ses
rponses seront des rponses inspires (84 d-85 b).
I. Deux hypothses nouvelles sur la nature et la conditionde nos mes vont tre exposes ; c'est de la discussion dechacune d'elles que se dgagera progressivement la thorie dePlaton.
i Simmias, qui parle le premier, commence par exprimer l'gard de la possibilit de rsoudre le problme une dfianceque Socrate ne dsapprouve pas, et qui d'ailleurs ne doit pasdisparatre (cf. 107 ab). On ne peut cependant, dit-il, aban-donner ce problme avant d'avoir soumis l'preuve de lacritique toutes les solutions qui en ont t proposes, ou avantd'avoir essay d'en trouver une personnellement. Mais, sid'aucun ct on n'a obtenu satisfaction, il ne reste qu' s'ac-commoder, pour faire la traverse de l'existence, d'une simpleprobabilit humaine, ou bien se confier au soutien mieuxassur d'une rvlation divine (85 b-e).
Ceci dit, l'objection de Simmias et sa thorie sont les sui-vantes. Appliquons, dit-il, la conception de Socrate la rela-tion de l'accord musical (cf. p. 49 n. 2) avec la lyre et avecles cordes qui donnent cet accord : ce qu'il y a, prtendra-t-on, d'invisible, d'incorporel et d'incomparablement beaudans la lyre accorde, ce qui en elle s'apparente l'immortelet au divin, c'est l'accord musical; quant la lyre avec ses
cordes, voil ce qui est corporel, compos et, en fin decompte, apparent la nature mortelle. Supposons mainte-nant qu'on brise le bois de la lyre et qu'on en sectionne lescordes : il faudra dire alors que ncessairement ce qui est denature mortelle doit avoir pri bien avant que pareil sort
puisse atteindre ce qui au contraire est, de sa nature, immor-tel, et que par consquent l'accord continuera de subsister
quelque part. La mme comparaison, qui a conduit la thsesocratique cette absurdit, va servir Simmias pour expo-ser sa propre thorie. Pour lui, l'me de chacun de nous estune combinaison et un accord rsultant d'une tension et d'unecohsion convenables des opposs, chaud et froid, sec ethumide, etc., qui constituent le corps. Celles-ci viennent-ellesdonc se relcher ou se tendre l'excs, par exemple sousl'action des maladies, alors il est fatal que, comme l'accord
des sons, l'me prisse aussitt dans la mort. Il y a plus :
-
NOTICE xxxix
elle a beau tre ce qu'il y a de plus divin ; c'est elle quiprira la premire, en laissant les restes du corps subsister
longtemps aprs qu'elle aura pri (85e-86d).2 Au lieu de discuter sur le champ l'objection et la thorie
de Simmias, Platon a prfr donner la parole Gbs (86 de).C'est que l'objection et la thorie de celui-ci sont beaucoupplus pntrantes : par suite, discuter conjointement Tuneet l'autre, il devait trouver l'avantage d'tablir une gradationdans la preuve.
Cbs souligne tout d'abord le pitinement de la recherche :sans doute, il l'a dj dit (cf. 77 c), la prexistence de l'melui parat avoir t suffisamment prouve, mais non sa sur-vivance. Ce n'est pas dire qu'il accepte la thorie de Sim-mias : tout au contraire, il pense avec Socrate que l'me a
plus de force que le corps et plus de dure. Pourquoi donc
rejette-t-il cependant la conception de celui-ci, puisqu'aussibien, c'est un fait, la mort n'anantit pas le corps, lequel parhypothse a moins de rsistance? Figurons, dit Cbs, cette
conception par un symbole : un vieux tisserand est mort ; ce
qui prouve, dira-t-on, qu'il continue de subsister quelquepart, c'est que le vtement qu'il s'tait lui-mme tiss et
qu'il portait n'a pas pri ; or un vtement qu'on porte duremoins de temps qu'un homme ; si donc ce qui dure le moinssubsiste, plus forte raison est-ce le cas de l'homme lui-mme (86 e-87 c).
Raisonnement d'une vidente absurdit ! Supposons eneffet que meure notre tisserand aprs avoir us plusieurshabits et s'en tre tiss tout autant pour les remplacer : pos-trieure toute la suite de ses habits passs, sa disparitionn'en est pas moins antrieure celle du dernier qu'il s'estfait. Telle est aussi la relation de l'me au corps : la pre-mire est plus rsistante et plus durable ; mais, s'il est vrai
que la mme me, en une longue suite d'annes, puisseuser, puis reconstituer, un grand nombre de corps successifs(comme elle le fait au cours d'une seule vie en rparantl'usure de l'organisme), en revanche l'anantissement decette me peut fort bien prcder celui du dernier de sescorps, tandis que celui-ci, l'me une fois morte, rvlera parsa propre corruption son intrinsque faiblesse et son incapa-cit se reconstituer de lui-mme. Mais, s'il en est ainsi,quel motif aurait-on encore de se persuader que, lorsqu'on
-
xl PHEDON
sera mort, l'me continuera de subsister quelque part ? Onpeut en effet, sans nul doute, accorder la thse de Socratenon pas seulement la prexistence, mais mme une certainesurvie de nos mes, avec une suite de naissances et de morts,ces naissances renouveles prouvant assez d'ailleurs quelleforce de rsistance possdent ces mes. Une telle concession
n'obligerait pas pourtant concder en outre que l'me nedoive pas se fatiguer dans ces renaissances successives et ainsi
perdre peu peu son nergie essentielle ; de sorte qu'en finde compte une de ses morts signifierait pour elle la destruc-tion radicale. Or cette mort-l, qui anantit l'me en mmetemps qu'elle dissout le corps, nul n'est capable de la recon-natre. Par consquent aucun homme de sens n'a le droit degarder sa srnit en face de la mort ni d'tre sans crainte au
sujet de son me, avant du moins d'en avoir dmontr l'im-mortalit et l'indestructibilit absolues (87 c-88 b).
II. Ainsi, une fois de plus (cf. 70 a), Cbs affirme que le
problme reste entier. Les trois arguments de la deuxime
partie n'ont donc pas, Socrate en convenait lui-mme (cf.84 c), totalement bris les droits de l'incrdulit. L'insistancede Platon est significative
l: on sent que la discussion est
prs d'accomplir une tape dcisive ; les esprits sont troubls,les curs malades
;les doutes endormis se sont rveills et
la confiance en la possibilit d'une solution est branle ;tout semble reprendre du commencement, et ce sont des
intelligences vaincues, en pleine droute, qu'il faut ramener l'examen de la question (88 b-89 a), Autrement dit, pourtriompher de l'incrdulit ou de la croyance fausse, on nedoit compter que sur la dmonstration. D'autres traits con-tribuent poser dramatiquement la crise qui dcidera dusort de la recherche. Elle est bien morte, la thse sur laquellereposait l'esprance de Socrate mourant: que, ds maintenant,en signe de deuil, Phdon sacrifie sa longue chevelure ! Ou,s'il est brave, qu'il engage contre les ngateurs un combat
herculen, et qu'il jure de ne pas la laisser repousser avantd'avoir ramen au jour la thse dfunte ! (89 a-c). Bref toutconcourt montrer qu'un nouveau bond va porter l'entre-
1. Il accentue par une intervention d'Echcrate (88 cd) ce qu'a ditPhdon du dsarroi et de l'inquitude des assistants.
-
NOTICE xli
tien vers des spculations plus difficiles et qui rclament unsurcrot d'attention.
Aprs ces remarques, l'objet propre du morceau qui sertde prlude cette phase du dialogue semble assez clair : ilest destin faire comprendre la fois, et qu'il est vain
d'opposer, comme l'ont fait Simmias et Gbs, croyance
croyance, ce qui est le propre de la controverse sophistique ;et que Socrate ne se proposera pas de rfuter leurs opinions,c'est--dire de nier son tour, mais de conqurir un lment
positif de vrit, qui lui avait sans doute chapp puisqu'iln'avait pas russi les convaincre.
C'est un grand mal,dit-il en effet, de dtester en gnral les raisonnements et dedevenir misologue , comme certains deviennent misan-
thropes , qui hassent l'humanit tout entire. Or de partet d'autre la cause du mal est la mme : c'est un usageaveugle et incomptent de l'objet; tour tour on passe d'uneconfiance irraisonne une dfiance qui ne l'est pas moins.La pratique del controverse antilogique , en apprenant justifier galement deux thses opposes, finit mme parengendrer, en ce qui concerne la valeur de l'argumentationlogique, un universel scepticisme, et l'gard d'une ralitvraie comme d'une pense vraie ; et l'on se figure avoiratteint ainsi le comble de la sagesse ! Mais c'est une vraie
piti que nos dconvenues relativement des raisons capa-bles, avec un mme contenu, de passer tour tour du vraiau faux et inversement, nous puissent porter rejeter la
faute, d'un cur lger, sur le raisonnement en gnral. Carla faute est ntre, s'il existe un raisonnement dont la vrit
puisse tre reconnue et ne se perde point ; cette faute est dene pas possder la technique (celle du dialecticien) capablede nous donner en effet une connaissance vraie de la ralit
(89 c-90 d).Ce qu'il faut donc en pareil cas
l
suspecter et incrimineravant tout, c'est notre propre sant et, pour la rendre bonne,faire un courageux effort. Au lieu de se comporter en gros-sier disputeur qui, sans souci de la vrit, ne vise qu' im-
poser sa propre opinion la conviction d'autrui, le philo-sophe ne voit l qu'une fin accessoire, et sa fin principale est
1. Remarquer la reprise, 90 d fin, de la formule de 89 c fin ; larelation des deux parties du morceau est ainsi mise en vidence.
-
xlii PHEDON
de reconnatre par lui-mme s'il a trouv la vrit. Aussibien y a-t-il prsentement pour Socrate tout bnfice croireainsi en l'existence d'une vrit
; car, mme s'il n'y a rienpour nos mes aprs la mort, au moins n'aura-t-il pas impor-tun ses amis de lamentations jusqu'au moment o finirason ignorance ! Voil donc dans quel esprit il discutera lesthories de Simmias et de Gbs : c'est la Vrit seulement
qu'ils doivent avoir gard, soit pour lui donner, lui, leur
adhsion, soit pour lui tenir tte ; une illusion, que la seuleardeur de sa conviction aurait fait natre en eux et en lui, lais-serait dans leur esprit une blessure qui ne se fermerait pas(god-oc) 1 .
i Le sens de la discussion ayant t ainsi dtermin,Socrate rsume les deux thses afin de dfinir, d'accord avecleurs auteurs, les points qu'il s'agit d'examiner. Puis, tantentendu que de la thse socratique ils ne rejettent pas tout,il obtient de leur part un commun assentiment la doctrinede la rminiscence (91 c-92 a). Voil d'o partira l'examende la thse de Simmias.
Or, si celui-ci tient sa conception de l'me-harmonie,il ne peut d'autre part accepter la rminiscence. Tout accorden effet est une synthse. Que l'me soit l'accord des ten-sions constitutives du corps, ds lors il faudra, pour que larminiscence soit vraie, que l'me prexiste aux facteurs dontelle est cense tre la composition; ou, pour que la thse deSimmias soit vraie, que l'me soit une rsultante de facteurs
qui n'existent pas encore. Contradiction manifeste : il fautdonc choisir. Le choix de Simmias est bientt fait : il s'estlaiss, dans sa thorie, sduire par de fallacieuses analogies ;la rminiscence au contraire et, par consquent, la prexis-tence de notre me dpendent d'un principe dont la certitudes'impose, savoir que c'est l'me qu'appartient cette ralitdont l'pithte propre est essentielle (92 a-e)
2.
Puisqu'il s'agit cependant, non d'un succs obtenir surun adversaire, mais d'une vrit trouver, une retraite aussi
1. Cette conception critique de la recherche, accompagne de laconviction qu'il existe une vrit, ne s'oppose pas seulement aux
Sophistes qui n'ont pas cette conviction, mais en mme temps auxPythagoriciens, qui acceptent sans critique la Parole du Matre.
2. Voir p. 49, n. 3 et p. 60, n. i-3.
-
NOTICE xliii
prompte ne peut contenter ; aussi poursuivra-t-on l'analysede cette notion d'accord. Un compos quelconque, et parconsquent un accord, ne doit tre, ni dans sa nature, nicomme agent ou patient, autrement que ne le comportentles lments dont il est fait (cf. 78 bc). D'o il suit que l'ac-cord ne conditionne pas ses facteurs constituants, mais qu'ilen est la suite ou le rsultat ; il ne peut donc tre en opposi-tion avec ce qu'exigent ses lments. Voil un premier pointacquis et convenu (92 e sq.). En chaque cas, d'autre part,un accord musical est spcifiquement ce qu'il est par rapport telles tensions des cordes et par rapport tels intervalles dessons
;il ne peut pas plus tre suprieur ou infrieur ce que
prcisment il est, que ces intervalles ne peuvent tre, parrapport ce qu'il est, augments ou diminus (cf. p. 61,n. 1). D'o il suit qu'une me, supposer qu'elle soit unaccord, est spcifiquement ce qu'elle est, et ne peut l'tre ni
plus ni moins qu'une autre me. C'est un second point donton doit convenir (o,3 ab).
Celui-ci vient le premier en discussion. Personne ne con-testera qu'il y ait des mes vertueuses et d'autres, vicieuses.
Expliquera-t-on cette diffrence en disant que dans une me,qui est dj accord, la vertu constitue un supplment d'ac-cord et le vice, un dfaut de supplment d'accord ? Mais l'uneserait alors moins compltement accord que l'autre, desorte qu'un accord pourrait tre infrieur ce qu'il est spci-fiquement, au lieu d'tre toujours gal lui-mme. Or cen'est pas ce dont on est convenu : en s'y tenant, on devraitau contraire nier toute supriorit de vice ou de vertu dansles mes
;bien plus, aucune me d'aucun vivant absolument
ne pourrait tre mauvaise, car toute me, tant pareillementme, devrait tre pareillement accord (a3 b-g4 b) *.On envisage ensuite la premire proposition. Dans l'en-
semble du compos humain, il est certain que l'autorit
1. Plusieurs auteurs, et notamment Philopon dans son commen-taire du De anima, attestent qu'Aristote avait utilis cette argumen-tation dans un dialogue de sa jeunesse, Eudeme ou De l'me (tous lestextes sont runis dans le fr. 4i de Rose; voir surtout 1482 b, 42-
44 i483 a, 5-i8). Tandis que accord et dsaccord, disait-il, sont deux
contraires, l'me n'a pas de contraire. D'autre part l'accord fait la
sant, la force ou la beaut ; mais ce sont l des modalits de l'me,non ce qui en constitue la nature.
-
xliv PHDONappartient l'me (cf. 79 e sq.), et surtout quand elle est
sage. Or cette autorit, elle ne l'exerce pas en se prtant com-
plaisamment aux affections du corps, mais bien plutt en lescontrariant, quand elle juge raisonnable de le faire. Or cedont on tait convenu, c'est que, si l'me est l'accord destensions et des relchements du corps, jamais elle ne pourrafaire entendre une musique qui soit avec eux en oppositionet que cette musique, bien loin de les conditionner, en estau contraire une suite naturelle. La dfinition de l'me parl'accord conduit donc une fois de plus une contradiction.Cette dfinition est donc inacceptable (94 b-95 a).
Voil la thse de l'me-harmonie dfinitivement mise horsde cause (96 ab). La mthode employe mrite tout d'abordl'attention : tant donne la base une thse, admise sousrserve ou par mutuelle convention (uttoOegi), on en dduitles consquences pour voir si elles conviennent, soit avec le
principe, soit entre elles, soit enfin avec des faits qui ne sont
pas contests par celui qui a accept le principe1
. C'est un
exemple anticip de la mthode dont la formule sera plusexplicitement donne dans la suite (cf. 100 a, 101 de). Enoutre de cet aspect formel de la discussion, il faut noter quesur la nature essentielle de l'me elle a permis d'acqurirdeux rsultats positifs. L'un est que l'me a son essence
propre, laquelle ne comporte pas de degr (cf. 93 b). L'autreest que les dterminations de cette essence et de ses propritssont relatives au bien et au mal (cf. 93 a) ; ce qui impliqueque son action sur le corps n'est pas purement mcanique,mais relative aux fins propres de l'me, qui sont morales. Orces deux rsultats, obtenus l'encontre de la thse de Sim-mias, s'opposent ce qu'implique celle de Cbs, et en faitils serviront la rfuter (cf. p. l et p. lx sq.).
2 La discussion de cette dernire thse est la pice capi-tale de la troisime partie. C'est ce que Platon marque biends le dbut. Il signale en effet tout d'abord avec quelque
1. Aussi l'emploi de la proposition conditionnelle (avec et, efosc,InstoT]) est-il frquent dans tout le morceau. On remarquera particu-lirement les expressions qui marquent l'assentiment (oii.oX6ff\iici),la position des prmisses (u~6Q-z'.), la dduction des consquences (ixtoutou toj oyou, xaTa tov pv Xoyov) : 93 c 1, 8 ; d 1, 2 ; e 7 sq. ;g/i a 5 ; b 1 ; c 2, 6.
-
NOTICE xlv
solennit les risques' d'une partie o il s'agit de jouer un
jeu serr (q5 b). Puis il s'astreint reprendre une fois deplus (cf, 91 d) le contenu de cette objection redoutable :folle confiance du philosophe fonde sur une croyance sanspreuve ; nergie quasi divine de l'me, qui lui permet de
prexister on ne sait combien de temps la vie corporelle,de faon acqurir les connaissances dont elle se ressouvientensuite, et qui par consquent lui confre une dure sup-rieure celle du corps ; refus de considrer cette plus longuedure comme quivalente l'immortalit
2, puisque l'incar-
nation est au contraire pour elle le commencemen
















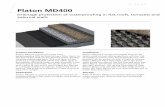
![jazzpotes2.free.frjazzpotes2.free.fr/AEBERSOLD/Aebersold - Vol 99 - [Tadd Dameron].pdf · CD VOLUME 99 Enclosed Tadd Dameron Book and ŒL) Set I n strum entali Sts](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5b3891c87f8b9a5a178d8808/-vol-99-tadd-dameronpdf-cd-volume-99-enclosed-tadd-dameron-book-and-oel.jpg)


