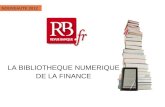Paola Marrati La Nouveaute de La VieRDES_059_0032
-
Upload
guada-lucero -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Paola Marrati La Nouveaute de La VieRDES_059_0032
-
LA NOUVEAUT DE LA VIE
Paola Marrati
Collge international de Philosophie | Rue Descartes
2008/1 - n 59pages 32 41
ISSN 1144-0821
Article disponible en ligne l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2008-1-page-32.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marrati Paola, La nouveaut de la vie , Rue Descartes, 2008/1 n 59, p. 32-41. DOI : 10.3917/rdes.059.0032--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution lectronique Cairn.info pour Collge international de Philosophie. Collge international de Philosophie. Tous droits rservs pour tous pays.
La reproduction ou reprsentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorise que dans les limites desconditions gnrales d'utilisation du site ou, le cas chant, des conditions gnrales de la licence souscrite par votretablissement. Toute autre reproduction ou reprsentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manire quece soit, est interdite sauf accord pralable et crit de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation en vigueur enFrance. Il est prcis que son stockage dans une base de donnes est galement interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
32 |
PAOLA MARRATILa nouveaut de la vieQuelle est au juste la philosophie de la vie de Deleuze ? La plupart des dbats rcents autour deDeleuze font de la question de la vie la question centrale de sa pense. Quil sagisse de clbrerson vitalisme optimiste et de l appliquer joyeusement toutes sortes de domaines et deproblmes ou quil sagisse au contraire de dnoncer la navet dangereuse de se fier quelque chose comme la vie , en particulier quand il sagit dthique et de politique, tout lemonde semble convaincu quil y a chez Deleuze une philosophie de la vie. Mais est-ce vraimentle cas ? Y a-t-il quelque chose dans la pense de Deleuze quon pourrait appeler une philosophiede la vie ? Quest-ce que Deleuze affirme, ou croit, propos de la vie exactement ?
Voil les questions que jaimerais poser pour essayer danalyser de prs le rle que la notion devie joue dans luvre de Deleuze, en laissant de ct, pour le moment du moins, dbats etcontroverses souvent striles. Puisque ce rle est loin dtre clair, il me semble importantdessayer de comprendre la fonction que la notion de vie joue dans la configurationconceptuelle complexe que Deleuze a mise en place, surtout si lon veut engager une discussionsur les enjeux thiques, philosophiques et politiques de son uvre.
Soulignons tout dabord que Deleuze na jamais dvelopp une mtaphysique ou uneontologie de la vie, comme Nietzsche ou Bergson lont fait, pour ne citer parmi les penseursde la vie que ceux qui lont profondment influenc. Pour Deleuze, lempirisme transcendantal,limmanence ou lunivocit de ltre, jouent le rle de catgories critiques ou ontologiques ; pasla vie .Deleuze na pas non plus entam une rflexion sur lhistoire ou lpistmologie des sciencesde la vie, sur la rationalit propre aux sciences du vivant ou la singularit de leur place dans lechamp de la connaissance, la manire de Canguilhem, par exemple. Ses rfrences Darwinou Weismann ne sont ni plus nombreuses ni plus significatives que celles quil consacre un
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 32
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
CORPUS | 33
mathmaticien comme Riemann. Et en ce qui concerne le topos du dveloppement biologiquede luf quon trouve de Diffrence et rptition jusqu Mille plateaux , il faut remarquerquil doit au moins autant au Diderot du Rve de dAlembert qu lhistoire rcente delembryologie 1.Enfin, il faut souligner, nen dplaise certains, quil ny a pas de politique de la vie chezDeleuze. Contrairement Foucault, Deleuze nanalyse pas les formes modernes oucontemporaines de pouvoir qui prennent la vie comme objet. La catgorie de biopouvoir nappartient ni son vocabulaire conceptuel ni ses analyses politiques (pas mme, et cesttrs significatif, aux moments de la plus grande proximit avec Foucault 2). Encore moinsessaye-t-il de faire de la vie un objet de luttes politiques, comme certains le fontaujourdhui sous le titre, mon avis bien ambigu, de biopolitique .Pourtant, en un sens, la notion de vie est en effet trs importante, voire dcisive pourDeleuze. Jaimerais expliquer ici selon quel sens la vie joue un rle essentiel dans laphilosophie de Deleuze, sous quel aspect elle en fait partie ncessairement et lui donne sonaccent motif le plus singulier, ce que William James aurait appel son temprament , dansles belles pages dUn univers pluraliste o il nous demande de reconnatre que les motions etles tempraments sont aussi dcisifs pour une philosophie que ses concepts 3. Pour ce faire, ilme faudra dabord montrer que la ncessit de la vie, quelle quelle soit pour Deleuze, ne peuttre exprime dans une philosophie de la vie en aucun des sens mentionns prcdemment.Je commencerai par deux points de linterprtation deleuzienne de Bergson qui ont la plusgrande importance pour sa propre pense. Le premier concerne le statut du problme. Deleuzeinsiste juste titre sur limportance que Bergson accorde la catgorie de problme danslvolution biologique : cest en fonction des problmes, plutt que des besoins, comme on lecroit dhabitude, que les vivants voluent. Dans Lvolution cratrice, Bergson dcrit en effet lesvivants humains et non-humains comme des exemples de solutions actives et cratrices des problmes. Le problme de soutenir la vie la nutrition par exemple, ou la respiration, lasynthtisation de la lumire etc. reoit des solutions diffrentes selon les diffrentes lignesde lvolution. Les vies vgtale et animale sont ainsi deux solutions divergentes, maisgalement lgantes, dun mme problme 4. Et il en va de mme, selon Bergson, pour les
1. Diffrence et rptition, PUF, Paris, 1969, p.276-285 et Mille plateaux, Minuit, Paris, 1980, p.185-204. |2. Dans son Foucault, Deleuze analyse de manire dtaille Surveiller et punir et La volont desavoir, mais mme dans ce contexte, la catgorie de biopouvoir reste en marge et quand elle est voque,cest toujours avec un accent trs deleuzien pour rappeler que la vie est ce qui rsiste toujours aupouvoir. Cf. Deleuze, Foucault, Minuit, Paris, 1980, p.79-99. |3. William James, Philosophie de lexp-rience: un univers pluraliste, Les empcheurs de penser en rond, 2007, p.20-27. |4. Lvolution cra-trice, [1904], PUF, Paris, 1957, (la plante et lanimal, p.107-121).
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 33
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
PAOLA MARRATI34 |
formes de vie les plus complexes, jusquaux formes de vie humaines o le biologique et lesocial ne se laissent plus sparer.Cela ne revient pas dire que les vivants sont des rponses ajustes, pragmatiques ouautomatiques aux dfis de lenvironnement : selon Bergson, cest la notion de besoin et noncelle de problme qui implique une telle ide. Cela veut dire en revanche que lancienneopposition entre raison et connaissance dune part, et les forces obscures et irrationnelles dela vie dautre part, est totalement dplace. La vie, quelle quelle soit, ouvre le champ illimitdes problmes et des solutions auquel la rationalit humaine elle-mme appartient. Il ny aaucun abme combler entre la vie et la connaissance : elles sappartiennent lune lautre, etcrer des concepts, poser des problmes, trouver des exemples de solutions sont des formesde vie que nous autres humains pratiquons peut-tre plus que dautres vivants, mais qui nenous exilent pas dans un domaine extrieur celui de la vie 5.De cette conception bergsonienne, Deleuze garde lide de la priorit des problmes parrapport aux solutions, lide de linsistance des problmes qui sincarnent (cest son terme),sans sy puiser, dans des cas de solutions toujours nouvelles 6. Dans Diffrence et rptition,Deleuze plaide pour une nouvelle conception de ce que signifie penser et pour une nouvellepdagogie, une nouvelle Bildung, individuelle et collective, qui fasse de la position desproblmes la tche vritable de la pense, tche quil oppose une image de la cultureappauvrie et conservatrice qui conoit la pense et lducation comme lapprentissage desbonnes rponses des questions dj dtermines. Il affirme que la libert que nous avons,en tant qutres thiques et politiques, dpend de notre capacit de poser des problmes : On nous fait croire la fois que les problmes sont donns tout faits, et quils disparaissentdans les rponses ou la solution []. On nous fait croire que lactivit de penser, et aussi levrai et le faux par rapport cette activit, ne commencent quavec la recherche des solutions,ne concernent que les solutions. [] Cest un prjug infantile, daprs lequel le matredonne un problme, notre tche tant de le rsoudre, et le rsultat de la tche tant qualifi devrai ou de faux par une autorit puissante. Et cest un prjug social, dans lintrt visible de
5. Lide que les pratiques cognitives, loin de sopposer la vie, lui appartiennent est aussi centraledans le travail de George Canguilhem qui, de ce point de vue, sinscrit dans lhritage de Bergson.Foucault, dans son essai La Vie: lexprience et la science, dcrit avec profondeur le lien entre vie etconnaissance chez Canguilhem, tout en retraant une gnalogie de ce quil considre comme une vri-table tradition franaise des philosophies du concept et de lhistoire de la rationalit. Nanmoins,dans son effort pour dcrire cette tradition, Foucault la distingue dune autre ligne, certainsgards plus visible, qui met au centre de la rflexion le statut de la subjectivit et dans laquelle ilsitue sans nuance Bergson, en sous-estimant tout ce qui chez ce dernier ne peut pas tre rduit un spi-ritualisme classique. Cf. Michel Foucault, La Vie: lexprience et la science, in Dits et crits IV,Gallimard, Paris, 1994, p.763-828. |6. Diffrence et rptition, P.U.F., 1968, p.236.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 34
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
CORPUS | 35
nous maintenir enfants, qui nous convie toujours rsoudre des problmes venus dailleurs[].Telle est lorigine dune grotesque image de la culture, quon retrouve aussi bien dans lestests, dans les consignes du gouvernement, dans les concours de journaux (o lon conviechacun choisir selon son got, condition que ce got concide avec celui de tous.) []Comme si nous ne restions pas esclaves tant que nous ne disposons pas des problmes eux-mmes, duneparticipation aux problmes, dun droit aux problmes, dune gestion des problmes 7. Et il va encore plus loin, en accordant aux problmes un statut proprement ontologique, danssa reformulation de la conception platonicienne et kantienne de lide qui, dans la logique deDiffrence et rptition, doit rendre compte de limpossibilit de rduire lexprience audomaine du simple constitu sans pour autant faire appel une notion dialectique du pouvoirdu ngatif 8. Ce qui est en jeu pour Deleuze dans une telle quasi-ontologie du problme nestplus une conception de la biologie ou de lvolution ni une ontologie de la Vie : ltre est ltredes Problmes-Ides, non pas une quelconque notion rifie de Vie. Pourtant, le sens que lavie, quelle quelle soit, ait prcisment un tel pouvoir de crer des problmes-solutions nedisparat pas de son uvre ; au contraire, il est dautant plus insistant quil reste implicite.
La deuxime intuition bergsonienne laquelle Deleuze reste fidle concerne le statut mme dela diffrence. La diffrence ne doit pas tre comprise comme une dtermination empirique quisparerait les uns des autres les tres et les choses tels quils apparaissent dans lexprienceconstitue ; la diffrence doit tre comprise plutt comme le processus constitutif qui distinguechaque chose en elle-mme, qui fait de quelque chose ce quelle est, qui dtermine son tresingulier. La diffrence, de ce point de vue, est toujours interne, processus de production et dediffrenciation, de cration du nouveau. Deleuze interprte de cette manire le conceptbergsonien dlan vital : lessence de llan, lessence de la vie si lon veut, nest rien dautrequune tendance cest--dire un mouvement et non pas un ensemble des caractres donns et notamment une tendance au changement et la transformation. trange essence, dfinie parrien de substantiel ou de fixe, mais seulement par une pulsion ou une passion pour lechangement, par un dsir bizarre de poser des problmes et une insatisfaction permanente parrapport toute solution donne. Dfini de cette manire, le concept dlan vital, la vitalit dela vie , nest pas en contradiction avec la notion de diffrence interne, mais au contrairelimplique, tout comme il implique une conception du temps comme dure. La tendance auchangement assume la forme des processus de diffrenciation qui crent des formes de vie
7. Op. cit., p.205-206. Je souligne. |8. Op. cit., p.218-247.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 35
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
PAOLA MARRATI36 |
nouvelles et imprvisibles. La diffrence vitale est cratrice, elle produit du nouveau, et donneainsi un contenu laffirmation clbre et nigmatique de Bergson selon laquelle le temps estinvention du nouveau ou nest rien du tout 9. moins que ce ne soit le contraire et que ce soit la ralit du temps, la ralit du virtuel silon prfre un vocabulaire strictement deleuzien, qui donne son contenu indfinissable la vie , en faisant concider le vital avec la puissance du temps qui est puissance du nouveau,et en vidant ainsi la vie de tout contenu spcifiquement biologique. En ce qui concerneBergson, la question est trs difficile : la nature du rapport entre llan vital et la dure estcomplexe et il nest pas facile dtablir sils concident ou sils se croisent seulement. MaisDeleuze va sans doute dans cette deuxime direction, celle o cest la ralit virtuelle dutemps, sa puissance de diffrence, qui dtermine la vie .Je mexplique. Tout comme Deleuze extrait la catgorie du problme de son contextebiologique pour lui donner un statut presque ontologique, de mme il essaie de d-biologiserle concept dlan vital. Dans son essai sminal La conception de la diffrence chez Bergson ,publi dabord en 1956 et maintenant accessible dans Lle dserte et autres textes, il rassemble laconfiguration des concepts que je viens de rsumer brivement de la manire suivante : Quand la virtualit se ralise, cest--dire se diffrencie, cest par la vie et cest sous uneforme vitale ; en ce sens il est vrai que la diffrence est vitale10. Mais cest pour crire la fin du mme texte : Le bergsonisme est une philosophie de ladiffrence, et de ralisation de la diffrence : il y a la diffrence en personne, et celle-ci seralise comme nouveaut 11.
Bien entendu, Deleuze nefface pas la vie dans son interprtation de Bergson, pas plus quedans sa propre pense. Mais la vie est constamment et systmatiquement vide de toutcontenu empirique ou biologique. La vie vient concider avec la ralit virtuelle dutemps, avec son pouvoir illimit de diffrenciation, cest--dire de cration du nouveau.Quand, plus tard dans sa carrire, Deleuze voquera la puissance de la vie inorganique ,comme il le fait par exemple dans Cinma 2, il reformule la mme ide dans un vocabulairelgrement diffrent, celui de la diffrence. Mais alors que le temps et la diffrence sont pourDeleuze des objets philosophiques quil essaie toujours nouveau de conceptualiser, la vie,comme concept, lui chappe. La vie nest pas, pour Deleuze, un concept. Ce qui nimplique pas,bien entendu, quelle ne puisse pas ltre : Deleuze naurait jamais, explicitement ou
9. Lvolution cratrice, op. cit., p.11. |10. La conception de la diffrence chez Bergson, in Lledserte et autres textes [1953-1974], Minuit, Paris, 2002, p.61. |11. Op. cit., p.72.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 36
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
CORPUS | 37
implicitement, lgifr sur ce qui est ou ce qui nest pas un objet proprement philosophique.Ce que je veux dire est que la vie nest pas et ne peut pas tre un concept dans la philosophie deDeleuze.Il y a plusieurs raisons cela. Certaines sont ngatives , des raisons de prudence et desagesse philosophique : Deleuze est trop au courant de lhistoire et de la science poursengager dans lentreprise risque de donner une dfinition de la vie , de lui donner uncontenu ontologique bien dfini. Pour ne rien dire du fait que si jai jusqu maintenant parlsans prcaution dontologie , ce nest que par commodit : mon sens il nest pas sr quonpuisse dcrire le projet philosophique de Deleuze comme une ontologie. Son rapport latradition kantienne dune philosophie critique, et sa mfiance par rapport la phnomnologie,sont trop forts pour quon puisse lenrler sans scrupule dans le renouvellement contemporainde lontologie12. Mais il y a dautres raisons qui font que la vie nest pas un concept pourDeleuze, et des raisons plus importantes encore.
La puissance du temps comme cration du nouveau nimplique nullement pour Bergson oupour Deleuze une attitude optimiste par rapport la vie telle quelle est, la vie comme nousla connaissons dans sa configuration prsente et passe de pouvoir et doppression. Ellenimplique pas non plus lespoir en un futur meilleur. Au contraire, lide du temps commeinvention du nouveau ouvre toute une srie de disjonctions. Tout dabord, celle entre lenouveau et lavenir : le nouveau ne concide plus avec un futur proche ou lointain. Ce quiviendra demain ou aprs-demain peut trs bien ntre quune version lgrement diffrentede lancien. Cest bien pour cette raison que le nouveau devient un problme philosophique(et politique). Plus prcisment : le nouveau devient le problme qui dfinit la modernit,telle que Deleuze la conoit. Sil est correct de penser la modernit comme habite par larecherche du nouveau, il est en revanche fourvoyant didentifier le nouveau avec la notion deprogrs qui, dans la version des Lumires ou dans une version hglienne de la tlologie delhistoire, porte toujours en soi lespoir dans le futur comme ce qui concide ncessairementavec le nouveau13.Deuximement, le nouveau produit une disjonction dans le prsent lui-mme. La tchecritique de la philosophie, rappelons-le, nest pas pour Deleuze une tche purement
12. Cest ce que remarque, juste titre, Franois Zourabichvili: une lecture ontologique de la pensede Deleuze passe ct du fait essentiel que sa philosophie est une alternative la phnomnologiedans toutes ses versions. Cf. F. Zourabichvili, Introduction Indite: Lontologie et le transcendan-tal in F. Zourabichvili, A. Sauvagnargues, P. Marrati, La Philosophie de Deleuze, PUF, Paris, 2004,p.5-12. |13. Avec Bergson, Nietzsche est lautre rfrence majeure pour Deleuze sur la question de ladistinction essentielle entre le nouveau et le futur.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 37
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
PAOLA MARRATI38 |
acadmique, celle de repenser les critres et limites du savoir, mais aussi, et insparablement,une tche thique et politique, voire thrapeutique. La croyance dans la puissance du tempscomme production du nouveau ne demande aucune soumission au prsent, ses valeurstablies ou ses normes reconnues, mais est au contraire un appel rsister. Et il fautremarquer que la rsistance, selon Deleuze, est dirige tout autant contre la violence etlinjustice du monde que contre les pouvoirs de la btise et de la mchancet qui nousmenacent de lintrieur de la pense. Do limportance pour la philosophie dtre la foiscritique et clinique ou, pour utiliser un vocabulaire diffrent, limportance de garder lespritle fait que la critique sociale ne doit pas tre divorce de lexigence du perfectionnismemoral14.Mais quest-ce qui vient soutenir toutes ces disjonctions quand on refuse, comme le faitDeleuze, toute forme de transcendance ? Chez Deleuze, il ny a aucun messianisme (avec ousans messie), aucun horizon utopique, aucune croyance dans le progrs ou dans des lois delhistoire dans sa forme hglienne ou heideggrienne, peu importe, de ce point de vue. Ilny a mme pas la consolation que pourrait apporter la connaissance prsume dunequelconque essence de la Mtaphysique, ou de lOccident, qui dplierait sa logique demanire ncessaire, pour le meilleur ou pour le pire.Autrement dit : il ny a aucune assurancedans une posture prophtique du philosophe. La philosophie de limmanence, telle que je lacomprends, si je la comprends, ce qui reste pour moi une question ouverte , implique quele monde est devenu un. Et cest une ide qui peut nous faire perdre la raison. Les disjonctionsdu temps, dans le temps, ne peuvent pas, ne peuvent plus tre adoucies ou rdimes par aucunredoublement du monde.Je veux clarifier ce dernier point en introduisant un philosophe qui est rarement lu ct deDeleuze : Stanley Cavell. Dans Une nouvelle Amrique encore inapprochable, Cavell sinterroge,comme il le fait dans de nombreux autres textes, sur le sens philosophique de lAmrique etse demande, dans une interprtation de lessai dEmerson intitul Exprience, ce que veut dire,au juste, nouveau monde . De Platon Kant, la philosophie a toujours connu deux mondes,distincts et spars, mme sils entretiennent les rapports les plus intimes. Un de ces mondes,le ntre, ntait pas ce quil aurait d tre, il tait seulement limage dforme de lautremonde. Chez Emerson, lespoir de Marx de mettre fin la dualit des mondes entransformant le ntre, en le rendant adquat, enfin, lidal, lespoir donc que la philosophiepuisse mettre en pratique ses valeurs, prend une tournure inattendue. LAmrique du
14. Dans sa discussion de la thorie de la justice de Rawls, Cavell fait des remarques importantes sur lacomplmentarit entre critique sociale et perfectionnisme moral, complmentarit qui est son avisessentielle pour le fonctionnement dune vritable dmocratie. Cf. S. Cavell, Les Voix de la raison,Seuil, Paris, 1996, chapitre XI et Cities of Words, Harvard University Press, Cambridge, 2004, p.164-188.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 38
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
CORPUS | 39
XIXe sicle reprsente, ou aurait d reprsenter, une csure dans lhistoire humaine, lemoment o les conditions pour que la philosophie soit mise en pratique sont donnes, ici etmaintenant. LAmrique est la promesse accomplie dun nouveau monde, du seul monde quenous avons : elle fait disparatre tout redoublement. Nanmoins, la promesse nest tenue qumoiti. Le monde est devenu un, la transcendance a disparu, mais ce nouveau mondeimmanent, le seul qui nous soit donn, est encore inapprochable. Jusqu quand ? est unequestion qui na plus de pertinence : le problme nest plus celui du futur mais celui duprsent. Quest-ce qui nous spare du monde dans lequel nous sommes ? La nouvelleAmrique, prsente mais inapprochable risque, selon Cavell, de nous rendre fous, maintenantquil ny a plus de raisons qui nous sparent dun monde que pourtant nous ne savons pascomment approcher : La philosophie de Platon Kant a connu deux mondes ; il y a beaucoup connatre. Ici et maintenant il ny a plus de raisons pour que lun ne soit pas mis en pratique,port sur la terre. LAmrique nous a privs de la raison. Sa promesse mme nous rend fous(comme la mort dun enfant) 15.
LAmrique dEmerson, lue par Cavell, donne un nom historique et gographique auproblme de limmanence, un nom qui naurait probablement pas dplu Deleuze, mais ceserait le sujet dautres analyses. Pour les prsentes, je voudrais souligner que pour Deleuze la vie nest pas la rponse la condition qui nous rend fous , elle nintervient pas comme larponse au problme de limmanence mais comme le nom de ce qui nous soutient danslimmanence. Cest dans la vie et partir de la vie que nous exprimentons les disjonctions dutemps et lcrasement des deux mondes en un.Dans son dernier texte, court et extraordinairement dense, Immanence : une vie, Deleuzecrit : Quest-ce que limmanence ? une vie Nul mieux que Dickens na racont ce questune vie, en tenant compte de larticle indfini comme un indice du transcendantal. Unecanaille, un mauvais sujet mpris de tous est ramen mourant, et voil que ceux qui lesoignent manifestent une sorte dempressement, de respect, damour pour le moindre signede vie du moribond. Tout le monde saffaire le sauver, au point quau plus profond de soncoma le vilain homme sent lui-mme quelque chose de doux le pntrer. Mais mesure quilrevient la vie, ses sauveurs se font plus froids, et il retrouve toute sa grossiret, samchancet. Entre sa vie et sa mort, il y a un moment qui nest plus que celui dune viejouant avec la mort. La vie de lindividu a fait place une vie impersonnelle, et pourtant
15. S. Cavell, Une nouvelle Amrique encore inapprochable, [1989], ditions de lclat, Paris, 1991,p.94. Traduction modifie.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 39
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
PAOLA MARRATI40 |
singulire, qui dgage un pur vnement libr des accidents de la vie intrieure etextrieure, cest--dire de la subjectivit et de lobjectivit de ce qui arrive. Homo tantumauquel tout le monde compatit, et qui atteint une sorte de batitude16. Dans ce passage, Deleuze spare rigoureusement une vie de toutes ses dterminationsbiologiques, morales, personnelles et politiques sans pour autant la charger dun contenuontologique ou mtaphysique particulier. On ne nous dit pas ce que la vie est vraiment .Nous ne sommes pas non plus confronts des situations limites : le roman de Dickens dcritune exprience tout fait ordinaire. Nous avons tous t tmoins dinstances de vie humaineet non-humaine qui portent en elles une telle qualit impersonnelle et mouvante.Cette vie nest pourtant pas sans qualifications : elle est flicit et batitude, capable desusciter le respect, lattention et lamour de tout le monde du moins jusquau moment oles habitudes personnelles et sociales de btise et de mchancet ne reprennent le dessus,emprisonnant et dfigurant le pouvoir dune vie. Et si on se demande maintenant commentDeleuze peut prouver que les instances de vie sont en effet flicit, ou que la tche de laphilosophie, de lart et de la littrature est bien de librer la vie de tout ce qui lopprime etcest pour cela quils sont tous des formes de rsistance et que la rsistance, au bout ducompte, est toujours rsistance la mort , la rponse est simple : il ne le peut pas. Il ny aaucun argument pour soutenir une telle ide : cest une affaire de croyance, ou de perception,et non pas de connaissance ou dargumentation. Il sagit dune intuition pr-philosophique etnon dun concept, mais comme Deleuze nous le rappelle, la philosophie ne pourrait pasexister sans intuitions pr-philosophiques17.Jadmets volontiers que parler dintuitions, dactes de croyance ou de foi, peut paratre, aumieux, dcevant. Mais est-ce vraiment le cas ? Avant den dcider, considrons certainesconsquences de lattitude de Deleuze par rapport tant des dbats contemporains.Tout dabord, la conviction de Deleuze quil ny a que des instances singulires de vie, que lavie se fait au cas par cas, est un appel sans nuances au besoin danalyses spcifiques pour dessituations spcifiques18. Deleuze nous met en garde contre la tentation de faire de la vie unnouvel universel abstrait. Les universaux, Deleuze y a toujours insist, nexpliquent rien, ilsdoivent tre eux-mmes expliqus, et la vie ne fait pas exception.Il y a sans doute des manires modernes et contemporaines de manipuler, dtruire, dfigurer,ou protger et amliorer la vie humaine et non-humaine. Il nest pas seulement utile maisncessaire danalyser ces processus : leurs gnalogies, tats prsents, tendances potentielles.
16. Gilles Deleuze, Limmanence: une vie [1995], dans Deux rgimes de fous, Minuit, 2003, p.361. |17. Deleuze et Guattari, Quest-ce que la philosophie? Minuit, Paris, 1991, p.42-43. |18. Abcdaire deGilles Deleuze, DVD, dition Montparnasse, 1996.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 40
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie
-
CORPUS | 41
On ne contribue pourtant pas cette tche difficile quand on prend une des deux positionsaujourdhui dominantes.Il nest pas trs utile de vouloir doter la vie (surtout humaine pour le moment) des droitsuniversels et inalinables, selon une certaine version du kantisme (le travail rcentdHabermas ou les positions de Ratzinger sont deux exemples importants et emblmatiquesde cette position). Bien entendu, toutes les transformations actuelles ne sont pas sous le signedu nouveau, hors sens deleuzien du terme, et il y a bien des raisons dinquitude devantcertains dveloppements. Nanmoins, croire que la vie devrait tre protge par des droitsuniversels est non seulement inefficace, mais profondment fourvoyant. Il ny a aucune natureternelle de la vie ou des humains qui pourrait tre lobjet dune telle protection.Il nest pas non plus trs utile de faire de la vie lobjet non prcis dun pouvoirinsaisissable. La notion de vie nue telle que Agamben la dveloppe est aussi une version dununiversel abstrait, selon un mode schmittien-heideggrien plutt que kantien, mais ladiffrence cet gard nest vraiment pas dcisive. Aucune de ces deux positions, mon sens,ne peut nous offrir les instruments danalyse dont nous avons besoin au cas par cas, pas plusquelles ne peuvent nous protger des formes doppression prsentes ou contribuer laborerune politique dmocratique.Enfin, Deleuze, je crois, nous met en garde contre tous ceux qui, au nom des valeurs plusnobles , nont que du mpris pour la vie minimale, pour tous ces cas singuliers de solutionsaux problmes que sont les tres vivants.Cest une leon quil ne faudrait pas oublier.
RD 59 intrieur 4/01/08 14:48 Page 41
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
- -
201
.255
.250
.150
- 03
/01/
2013
15h
38.
Col
lge
inte
rnat
iona
l de
Philo
soph
ie
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - - - 201.255.250.150 - 03/01/2013 15h38. Collge international de Philosophie