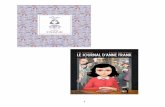As-tu déjà senti le désir… de faire une chose agréable pour quelquun…que tu aimes?
ORS RUN-cancer du col de luterus a la reunion-2002 Ce travail a pu être mené à bien grâce à la...
Transcript of ORS RUN-cancer du col de luterus a la reunion-2002 Ce travail a pu être mené à bien grâce à la...

Le cancer du col de l’utérus à La Réunion
Evaluation de la campagne d’incitation au dépistage menée
par le département en 2000
Juin 2002
Etude réalisée par l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion à la demande du département de La Réunion

Remerciements Ce travail a pu être mené à bien grâce à la participation active, agréable et efficace de Caroline Rodot et David Durolek, tous deux jeunes médecins qui ont réalisé leur thèse de médecine sur les deux études présentées dans ce document. Nous les remercions très chaleureusement. Nous remercions également tous les médecins de l’île de La Réunion qui ont bien voulu participer à la réflexion sur le protocole de l’étude, qui nous ont aidés à recueillir les données et qui nous ont accompagnés dans l’analyse des résultats. Nous avons été touchés par la confiance accordée par toutes les femmes réunionnaises qui ont bien voulu participer à de longs entretiens et nous livrer très simplement leurs expériences. L’appui d’Agnès Brissot et Muriel Roddier pour toute la partie anthropologique de ce travail nous était indispensable et nous les remercions de leur disponibilité et de leur aide. Ce travail a pu être réalisé grâce au soutien financier du département de La Réunion.

Avertissement Nous prions les lecteurs de ce travail de bien vouloir ne pas s’offusquer des erreurs d’orthographe que nous avons commises en rapportant, en créole, les propos des femmes réunionnaises interviewées.

Sommaire Introduction ……………………………………………………………… p.1
Etat des lieux
1. La situation française face au dépistage du cancer du col utérin …………….. p.2 2. La situation réunionnaise face au dépistage du cancer du col ……………….. p.3
2.1. Les données du registre : la pathologie cancéreuse à La Réunion …… p.3 2.2. Les données épidémiologiques du cancer du col de l’utérus à La Réunion p.3 2.3. Le dépistage du cancer du col utérin à La Réunion …………………... p.4 2.4. Description de la campagne 2000 à La Réunion ……………………… p.5
Etude épidémiologique rétrospective sur le cancer du col de l’utérus et l’activité de dépistage à La Réunion sur la période 2000-2001
1. Objectifs, matériel et méthode ………………………………………………... p.9 2. Les résultats
2.1. L’activité de dépistage en 2000-2001 ………………………………… p.12 2.2. Résultats de l’étude épidémiologique sur le cancer du col utérin ……. p.14
a. La population concernée ……………………………………… p.14 b. Epidémiologie ………………………………………………… p.14 c. Caractéristiques concernant les patientes et leurs facteurs de risque p.16 d. Modalités de diagnostic des cancers ………………………….. p.18 e. Données concernant le traitement des carcinomes ……………. p.23
3. Discussion des résultats de l’enquête épidémiologique
3.1. Les limites de la méthode ……………………………………………. p.25 3.2. Discussion des résultats ……………………………………………… p.25
a. Les données épidémiologiques ………………………………. p.25 b. Les caractéristiques des femmes et leurs facteurs de risque …. p.28 c. Les modalités de diagnostic ………………………………….. p.31 d. Traitement des carcinomes invasifs ………………………….. p.33
4. Résumé des principaux résultats de l’enquête épidémiologique …………….. p.34

Approche anthropologique des réticences des femmes face au frottis à l’île de La Réunion
1. Objectifs, matériel et méthode ………………………………………………… p.35
2. Description des entretiens ……………………………………………………
p.37 2.1. Description des informatrices …………………………………………… p.37 2.2. Les soins et les relations avec le médecin traitant ………………………. p.38 2.3. Les comportements de prévention ………………………………………. p.39 2.4. Le suivi gynécologique …………………………………………………… p.39 2.5. Le cancer …………………………………………………………………. p.40 2.6. Les maladies d’en bas ……………………………………………………. p.43 2.7. le cancer du col de l’utérus ………………………………………………. p.43 2.8. l’expérience du frottis ……………………………………………………. p.45 2.9. les réticences face au frottis ……………………………………………… p.45
3. Analyse des résultats ………………………………………………………… p.49 3.1. La relation avec le médecin et les comportements de prévention …… p.49 3.2. Le suivi gynécologique ………………………………………………. p.50 3.3. la représentation du cancer …………………………………………… p.50 3.4. les maladies d’en bas …………………………………………………. p.53 3.5. l’expérience du frottis ………………………………………………… p.54 3.6. les réticences face au frottis ………………………………………….. p.54 3.7. typologie des comportements ………………………………………... p.57
4. Discussion …………………………………………………………………… p.61 4.1. Les limites de la méthode ……………………………………………. p.61 4.2. les facteurs déterminants …………………………………………….. p.61 4.3. Recommandations …………………………………………………… p.62
5. Résumé des principaux résultats de l’approche anthropologique …………… p.65 Conclusion ……………………………………………………………… p.66 Annexes ………………………………………………………………… p.67

Introduction
Le cancer du col de l'utérus vient au second rang des cancers féminins, dans le monde entier et représente une des priorités en matière de santé publique, tout au moins dans les pays industrialisés. L’existence de formes pré-cliniques curables, que l’on peut détecter par un test simple, le frottis, rend ce cancer accessible au dépistage. Si la mortalité due au cancer du col a diminué de façon importante dans certains pays bénéficiant d'un dépistage organisé et, dans une moindre mesure, en France (où le dépistage n'est pas organisé mais laissé à l'initiative du corps médical), elle reste élevée à La Réunion. Une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col, à l’initiative du Département de La Réunion, a débuté en juin 2000. Le département a demandé à l’ORS d’apporter des éléments d’évaluation de l’impact de cette campagne. Ce document présente les résultats de ce travail qui a allié une approche épidémiologique et une approche anthropologique. L’étude épidémiologique est descriptive et rétrospective sur les années 2000 et 2001. Elle a été menée afin de :
- Décrire l’activité de dépistage du cancer du col utérin à la Réunion, - Décrire la situation épidémiologique du cancer du col utérin à la Réunion, - Comparer nos résultats avec ceux d’un travail identique mené à la Réunion pour les
années 1996 et 1997 - Comparer la situation réunionnaise à celle d’autres régions de France ou du monde.
L’étude anthropologique a été menée sous forme d’entretiens avec des femmes réunionnaises afin de décrire leur représentation de cette maladie et de sa prévention et de comprendre les réticences de certaines femmes réunionnaises à effectuer cet examen. Les résultats complémentaires de ces deux études nous permettent de dresser le bilan des actions mises en place par le département depuis juin 2000 et de présenter quelques recommandations en termes de communication pour une meilleure adhésion des femmes à ce dépistage.

Etat des lieux 1. La situation française face au dépistage du cancer du col utérin
En France, le développement d’une politique de dépistage organisé des cancers est aujourd’hui un axe
essentiel de santé publique. Le dépistage systématique et organisé du cancer du col utérin n’est pourtant pas encore mis en place dans toutes les régions françaises.
Selon le rapport du Haut Comité de Santé Publique (La Santé en France 1994-1998) malgré l’importance du nombre de frottis réalisés chaque année (six à sept millions d’examens) aucun bénéfice évident n’a pu être observé. Ce nombre suffirait à couvrir la population exposée au rythme d’un frottis tous les trois ans. Mais on observe une mauvaise répartition de ces examens . D’après le Baromètre Santé du CFES réalisé en décembre 1995, les femmes âgées de plus de 50 ans ne bénéficient pas d’un nombre suffisant de frottis, alors qu’elles présentent un risque de cancer invasif du col plus élevé. Les femmes jeunes font paradoxalement l’objet d’un excès de dépistage. Outre le facteur âge, il a été constaté que les femmes les plus concernées par l’absence de dépistage sont les femmes qui ne travaillent pas, les femmes du milieu rural, ou du secteur artisan-commerçant. Il y a une dizaine d’années, des programmes de dépistage organisés du cancer du col se sont mis en place dans cinq sites pilotes, financés par le Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information en Santé. Le lancement de ces expériences, situé dans la perspective d’une généralisation à l’ensemble des départements français, a constitué une étape indispensable pour valider les procédures et confirmer la faisabilité et le bien fondé d’un tel programme en terme de santé publique. La loi de financement de la sécurité sociale de 1999 a créé un contexte législatif favorable à la généralisation du dépistage du cancer du col : les actes de dépistage organisé et de diagnostic seront identifiés par une nomenclature spécifique. Les professionnels et les structures devront être habilités pour pratiquer un acte de dépistage selon un cahier des charges précis. Seuls les actes de dépistage organisé, pratiqués dans ces conditions seront pris en charge à 100 % sur le budget de la Gestion du Risque.

2. La situation réunionnaise face au dépistage du cancer du col utérin
2.1. Les données du Registre : la pathologie cancéreuse à la Réunion À la Réunion, l’incidence des cancers, toutes localisations confondues et quelque soit le sexe, est plus faible par rapport aux autres pays disposant d’un registre du cancer1 . La figure suivante illustre la position du Registre de la Réunion en comparant les taux d’incidence des cancers féminins, standardisés à la population européenne à partir de la base de données d’EUROCIM.
453,88
443,43
414,97
334,34
291,77
241,42
240,85
182,82
164,11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
SW GENEVA
DENMARK
FR/HAUT-RHIN
IT GENOA
FR/ISERE
FR/TARN
SP GRANADA
FR/MARTINIQUE
FR/REUNION
Cancers féminins tous sites confondusIncidence standardisée à la population européenne.
Position du registre des cancers du Département de la Réunion. Donnés 1993-1994. 2.2. Les données épidémiologiques du cancer du col de l’utérus à la Réunion À l’inverse de la tendance décrite pour les autres localisations, le cancer du col utérin a une incidence très importante sur notre île : au deuxième rang des cancers féminins après le sein, il représente 15 % des cancers féminins selon les données 1993-1994 du Registre Départemental des Cancers. En comparaison, il occupe en métropole le septième rang des cancers féminins2. Sur la période 1996-19973, les taux d’incidence standardisés à la population mondiale étaient de 26,7 pour 100 000 femmes par an pour les carcinomes in situ (contre 15,5 en métropole en 1992) et 21,5 pour 100 000 femmes par an pour les cancers invasifs (contre 8,6 en métropole en 1992).
1 Grizeau P., Vaillant JY., Beggue A., Le cancer à l’île de La Réunion, Données 1993-1994, Conseil Général 2 Weidmann C., L’incidence du cancer du col de l’utérus régresse régulièrement en France, BEH 1998 ; 5 : 17-9 3 Thèse médicale de J.Toudy, Bordeaux 1999.

À la Réunion, il existe une mortalité par cancer de l’utérus deux fois supérieure à la moyenne nationale4 : l’indice comparatif de mortalité (ICM) par cancer de l’utérus est égal à 201 pour la période 1993-1994. Cette différence tend à s’accroître, l’ICM était de 143 pour la période 1988-1992. Un décès par cancer de l’utérus sur deux survient avant 65 ans. Ainsi, le cancer du col utérin est un véritable problème de santé publique à la Réunion. 2.3. Le dépistage du cancer du col utérin à La Réunion Dans la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, l’article 37 confie aux Départements la responsabilité du dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades. En 1987, le Département déjà préoccupé par ce problème, réalise une première campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col. Dix ans après, deux études, faisant l’objet d’une thèse de doctorat de médecine, permettent de faire le point sur la pathologie :
• Le cancer du col de l’utérus à la Réunion : Etude épidémiologique rétrospective sur la période 1996-1997
• Enquête auprès des médecins généralistes sur leur comportement face au frottis. D’après les résultats de ces travaux, la situation est préoccupante :
• Le taux d’incidence du cancer invasif du col utérin reste très élevé et les cancers sont diagnostiqués à des stades tardifs.
• Si la campagne de 1987 a été bénéfique, son impact a été temporaire : le taux d’incidence brut des
cancers invasifs a beaucoup diminué dans les années 1993-1994, ce qui témoigne d’un recrutement massif de cancers peu évolués juste après la campagne , mais il a de nouveau augmenté en 1996-97 (cf figure suivante).
Périodes 1982-1984 1988-1992 1993-1994 1996-1997 25,7 22,3 16,7 20,89
Evolution de l’incidence brut du cancer invasif du col de l’utérus à la réunion.
• Il a été constaté un doublement du nombre de frottis réalisés en 1988 ; ce qui était effectivement l’objectif de la campagne de 1987. Ensuite l’activité de frottis n’a pas progressé alors même que la population féminine concernée augmentait.
Ainsi, d’après les conclusions de ces études, il semble exister une véritable carence de dépistage quantitatif, associée à une mauvaise répartition des frottis dans les tranches d’âges : manque de frottis chez les femmes de plus de 50 ans et excès de dépistage chez les plus jeunes. Début 2000, alors qu’au niveau national, le cancer est devenu une priorité de santé publique, le Département de la Réunion décide de mener une nouvelle campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col utérin.
4 Tableaux de bord : la santé observée à la Réunion. Observatoire Régional de la Santé.

2.4. Description de la campagne 2000 à La Réunion Les objectifs
• Obtenir une meilleure participation de la population féminine, en particulier des femmes âgées de 45 à 65 ans.
• Obtenir une meilleure participation des médecins généralistes. • Obtenir la mise en place d’un contrôle de qualité par les laboratoires de cytologie et
d’anatomopathologie. • Evaluer cette action et ses résultats.
Création d’un comité de pilotage Créé début avril 2000, ce comité regroupe les partenaires institutionnels et les professionnels concernés :
Le Département L’Agence Régionale de l’Hospitalisation La DRASS Le Conseil de l’Ordre des Médecins L’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) La Mutualité de la Réunion Le Comité Départementale de la Ligue contre le cancer. La Société de Gynécologie-Obstétrique Un anatomopathologiste par cabinet Les chefs de services des trois pôles de cancérologie L’AROF5
Création de trois commissions, une pour chaque objectif :
• Commission sensibilisation-formation des médecins, sous la responsabilité de la Société de Gynécologie Obstétrique en relation avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux et le Département.
• Commission des anatomopathologistes, chargée de définir les modalités du contrôle qualité et l’évaluation de la campagne avec la Cellule d’Epidémiologie de Prévention et d’Education à la Santé (CEPES)
• Commission « communication du grand public » responsable de la validation des messages et comprenant le Département, la DRASS, la CGSS, la Mutualité de la Réunion, la Société de Gynécologie-Obstétrique et le Comité Départementale de la Ligue contre le cancer.
Les différentes actions
• Actions de sensibilisation des médecins Un courrier conjoint du Département et de la Société de Gynécologie Obstétrique, a été adressé en mai 2000 à tous les médecins généralistes libéraux ainsi qu’à tous les médecins des services du département. Il s’agissait de rappeler la gravité du problème de santé publique posé par le cancer du col utérin à la Réunion, d’annoncer le début de la campagne et de proposer des séances d’Enseignement Post Universitaires (EPU). Avant le début de la campagne médiatique, quatre EPU sur la technique de réalisation du frottis et la conduite à tenir devant un frottis anormal, se sont tenus dans les quatre pôles hospitaliers de la Réunion ; ces formations assurées par la Société de Gynécologie Obstétrique, ont été suivies par près d’un quart des généralistes de l’île. Les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (A.N.A.E.S.) « conduite à tenir devant un frottis anormal du col de l’utérus » ont été mises à la disposition des médecins
5 Association Réunionnaise d’Orientation Familiale

au cours des EPU puis à la Cellule d’Epidémiologie de Prévention et d’Education pour la Santé du département. Un document concernant la technique de réalisation du frottis et la conduite à tenir devant un frottis anormal, a été réalisé par un groupe du comité de pilotage. Il a été envoyé à tous les médecins généralistes, accompagné d’une affiche destinée à l’information des patientEs dans les cabinets médicaux.
• Actions de la commission des anatomopathologistes Un consensus général des anatomopathologistes de l’île de la Réunion existe sur une indication en clair, dans la conclusion des comptes rendus de cytologie des frottis, de la conduite à tenir en fonction des lésions, selon les recommandations de la Conférence de consensus de Lille et la classification dite de BETHESDA. Les laboratoires d’anatomopathologie et de cytologie, qui réalisent les frottis, ont entrepris une réflexion pour mettre en place un contrôle de qualité dès l’année 2000.
• Actions de sensibilisation du grand public Une campagne médiatique s’est déroulée sur trois périodes d’une dizaine de jours, en juin et septembre 2000 puis en avril 2001. Elle a constitué en la diffusion de plusieurs communications au travers des différents médias réunionnais :
� Trois spots télévisés à base de témoignages de femmes, valorisant la santé et incitant au frottis, ont été réalisés. Ces spots mettaient en scène des femmes d’âge différents (une jeune femme, une femme de 45 ans et une de 65 ans), afin de sensibiliser les femmes de toutes ces tranches d’âge et de rappeler le fait que le dépistage doit être pratiqué dès le début de la vie sexuelle et jusqu’à 65 ans.
� Un magazine télévisé de 12 minutes intitulé « plein la vie » a été réalisé et diffusé en septembre 2000.
� Plusieurs spots d’information radiophoniques, ainsi que des émissions interactives, ont été réalisés et diffusés au cours des différentes vagues médiatiques, sur les radios publiques et les radios de proximité.
� Des articles ont été publiés dans la presse quotidienne locale (Le Quotidien, le Journal de l’île de la Réunion et Témoignages) et dans la presse magazine.
� Des dépliants « Département Santé » sur la prévention du cancer du col ont été tirés à 55000 exemplaires. Tout comme les affiches, ils ont été largement diffusés, dans les cabinets médicaux, points info santé, PMI, AROF, CGSS, Mutualité, CAF, laboratoires, pharmacies, comités d’entreprises et club du troisième âge.
� Une cassette vidéo sur le dépistage du cancer du col utérin, a été réalisée en 2001 par la Ligue Départementale de Lutte contre le Cancer
• Actions d’évaluation Lors des réunions préparatoires de la campagne, le comité de pilotage et en particulier la commission chargée de l’évaluation de la campagne a décidé que celle-ci devrait comporter deux volets : d’une part l’évaluation du programme de communication et d’autre part l’évaluation de la campagne elle-même. Il a été souligné que les objectifs spécifiques des actions de communications vers le public cible étaient de mettre à l’ordre du jour une préoccupation de santé publique, de faire sortir de son tabou le frottis, de légitimer les actions de terrain en favorisant le dialogue, d’informer et de combattre les idées reçues. Évaluation du programme de communication Un post test de la campagne de communication télévisuelle et radiophonique a été réalisé en juillet 2000. Il s’agissait d’effectuer le bilan de reconnaissance, d’attribution et d’influence de la campagne médiatique à l’issue de la première vague. Cette étude a été confiée à l’agence Louis Harris Réunion, qui a réalisé une enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 351 femmes réunionnaises.

Les résultats sont les suivants :
• Concernant la reconnaissance de la campagne, en spontané et en assisté, 87 % des femmes interrogées déclarent avoir vu ou entendu la publicité. On note un déclaratif inférieur pour les 60-65 ans, les inactives et les foyers de catégorie socioprofessionnelle inférieure.
• En ce qui concerne l’attribution de la campagne, seulement une femme sur dix attribue au Département de la Réunion la réalisation de cette campagne. Un peu moins d’une femme sur cinq l’attribue au Ministère de la santé.
• Concernant l’influence de la campagne, 98 % des femmes interrogées déclarent connaître le frottis. 90 % déclarent qu’elles connaissaient déjà cet examen avant d’avoir vu ou entendu la publicité. Parmi elles, neuf sur dix sont d’accord pour dire que : - Toutes les femmes sont concernées par le frottis - Il s’agit d’un examen simple - Il faut le faire au moins jusqu'à 65 ans Par contre une sur trois n’est pas d’accord avec les affirmations suivantes : - Il faut le faire au moins tous les 3 ans. - C’est un examen qui peut se faire chez n’importe quel médecin.
Évaluation de la campagne de prévention 2000
En matière d’évaluation de la campagne, plusieurs objectifs ont été retenus par le comité de pilotage lors des réunions préparatoires :
• Etudier le comportement des femmes réunionnaises vis-à-vis du dépistage. • Mesurer l’efficacité de la campagne en analysant d’une part l’activité de dépistage en terme de
frottis et le public recruté par la campagne, et d’autre part l’impact de la campagne sur l’incidence des cancers in situ et invasif.
Le Département a confié à l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) la conduite de ces travaux. Avec l’aide de deux médecins thésards, nous avons proposé de répondre à la demande du Conseil Général en alliant à la fois : • Une approche quantitative, grâce à une étude épidémiologique rétrospective sur le cancer du col de
l’utérus et l’activité de dépistage à la Réunion, sur la période 2000-2001. • Une approche qualitative, par la réalisation d’une étude anthropologique, visant à mieux décrire et
comprendre les réticences des femmes réunionnaises à faire ce genre de dépistage.

Etude épidémiologique rétrospective sur le cancer du col de l’utérus et l’activité de dépistage à la Réunion, sur la période 2000-2001
1. Objectifs, matériel et méthode Objectifs L’objectif général de notre étude est de mesurer les effets de la campagne d’information et d’incitation au
dépistage du cancer du col, menée en 2000, par le Conseil Général de la Réunion. Les objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés sont les suivants :
• Décrire l’activité de dépistage du cancer du col utérin à la Réunion pour les années 2000 et 2001,
• Décrire la situation épidémiologique du cancer du col utérin à la Réunion, pour les années 2000 et 2001,
• Comparer ces résultats avec ceux d’un travail6 mené à la Réunion pour les années 1996 et 1997.
Matériel et méthode
Le protocole a été présenté avant le démarrage de l’enquête à un comité de pilotage constitué de représentants du conseil général, de représentants des médecins libéraux, des cancérologues, des gynéco-
obstétriciens hospitaliers et libéraux.
Ce comité de pilotage a complété et validé le protocole de notre étude. Celui ci comporte deux volets : Etude de l’activité de dépistage Cette étude est menée à partir de l’activité des laboratoires privés et publics d’anatomo-pathologie. On recueille les informations suivantes auprès des responsables de ces laboratoires :
- nombre de frottis effectués tous les mois par les laboratoires d’anatomo-pathologie de l’île, âge des patientes, qualité du prescripteur, notion de frottis antérieurs,
- nombre de frottis pathologiques et proportion des différents types de lésion.
Etude épidémiologique du cancer du col utérin
6 Thèse soutenue à Bordeaux en 1999 par deux médecins ( Dr Toudy et Dr Sneed) sous la direction du Dr Grizeau du Conseil Général et du Dr Chevalier de l’hôpital de Saint Paul, intitulée « le cancer du col de l’utérus à l’île de la Réunion : Etude épidémiologique rétrospective sur la période 1996-1997 et enquête auprès des médecins généralistes sur leur comportements face au frottis ».

Cette étude est menée à partir des dossiers médicaux des patientes, sur la base d’un questionnaire rempli par un médecin enquêteur. Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive et rétrospective des cas incidents de cancer du col utérin
sur les deux années 2000 et 2001. Les critères d’inclusion sont les suivants : toutes les femmes de nationalité française, résidant à la Réunion, ayant présenté un cancer du col utérin diagnostiqué et confirmé histologiquement entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. Sont exclues de l’étude les femmes ne répondant pas à l’ensemble de ces critères. La confirmation histologique du cancer du col utérin est posée à partir d’une biopsie, ou des résultats histologiques post-conisation ou post-hystérectomie. Les diagnostics de dysplasie sévère du col utérin sont inclus dans les cancers in situ.
Le repérage des cas est fait à partir de quatre sources de données différentes : - Les deux services de cancérologie et radiothérapie, public et privé, - Les neuf services de gynécologie et les quatre services de chirurgie viscérale, publics et
privés, - Les sept départements d’informatique médicale, publics et privés, - Les cinq laboratoires d’anatomopathologie, publics et privés, L’ensemble de ces sources d’informations permet d’avoir un recueil exhaustif des nouveaux cas de cancer du col utérin diagnostiqués à la Réunion. Le recoupage des informations recueillies permet de déceler d’éventuels double-comptes et de les éliminer. Les données sont recueillies par un médecin enquêteur, sur la base d’un questionnaire rempli à partir des dossiers médicaux des patientes, consultés dans les cabinets privés et dans les services de soins des différents établissements de santé de l’île. Le questionnaire finalisé comporte les données suivantes, regroupées en cinq grandes rubriques : Etablissement et service où le dossier a été consulté. Caractéristiques de la patiente : âge, lieu de résidence, catégorie socioprofessionnelle, situation maritale Facteurs de risques : Notion de partenaires multiples, parité et âge lors de la première grossesse, notion de précocité des rapports sexuels (avant 18 ans), habitudes tabagiques, contraception, notion de frottis antérieur, délai écoulé entre le dernier frottis normal et le premier examen à visée diagnostic du cancer du col. Diagnostic du cancer : motivation du premier examen à visée diagnostique, types de signes d’appel s’ils existent, et délai entre leur apparition et la première consultation médicale, qualité du prescripteur du premier examen à visée diagnostique, délai entre la première consultation et l’établissement du diagnostic, type d’examen ayant conduit au diagnostic histologique de néoplasie, date du diagnostic histologique. Caractéristiques du cancer : type histologique, présence de signe d’infection à papillomavirus, stade du cancer selon la classification de la FIGO, type de traitement. Saisie et analyse des données

Chaque patiente a reçu un numéro aléatoire d’identification : le code patient. Seul ce code était saisi permettant ainsi l’anonymisation des données informatisées. Les données ont été saisies sous Epi-Info version 6.04. Le nettoyage de la base de donnée a été fait en collaboration entre les médecins de l’ORS et le médecin enquêteur. L’analyse repose sur les tests statistiques classiques : test du khi 2 pour les variables qualitatives, Anova pour les variables quantitatives, le degré de significativité retenu est de 5%. L’analyse des données s’est faite par un tri à plat de l’ensemble des variables retenues pour décrire les patientes et leur maladie, puis une analyse spécifique a été faite pour les cancers in situ d’une part et les cancers invasifs d’autre part. Enfin des croisements suivant les tranches d’âge, les stades de diagnostic du cancer, la zone géographique d’habitation, etc…ont été faits pour décrire d’éventuelles différences entre ces sous-groupes de la population étudiée.

2. Les résultats 2.1 - L’activité de dépistage en 2000 et 2001
Les données que nous avons recueillies ne concernent que le chiffre global de frottis pratiqués à la Réunion par l’ensemble des laboratoires d’anatomo-pathologie, publics et privés. Elles sont très incomplètes par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés. Malgré la bonne volonté de la plupart des laboratoires que nous avons sollicités, certaines données que nous souhaitions obtenir étaient introuvables, d’autres étaient dispersées (pour les laboratoires qui se sont re-structurées entre 2000 et 2001), d’autres enfin n’étaient disponibles et interprétables que manuellement et faute de temps disponible pour reprendre les milliers de frottis réalisés pendant ces deux années, nous n’avons pas pu les exploiter. Seuls les deux laboratoires hospitaliers nous ont fourni des données mensuelles, leur analyse n’a pas permis de montrer une augmentation significative du nombre d’examens, rythmée par les trois périodes de la campagne médiatique. Néanmoins, ces deux laboratoires réalisent moins de 20 % de l’ensemble des frottis. Nous avons eu connaissance de la répartition des frottis en fonction de l’âge des patientes pour 93 % des examens : ceux pratiqués dans les laboratoires privés et un des laboratoires publics. Il s’agit la plupart du temps d’une estimation, réalisée par les laboratoires eux-mêmes. Les frottis seraient réalisés à 80 % chez des femmes de moins de 50 ans (à noter que les femmes de 20 à 50 ans représente environ 80% des femmes de 20 à 65 ans d’après le dernier recensement de la population). Nous n’avons pas obtenu suffisamment d’informations sur le type des lésions et la qualité du prescripteur pour pouvoir les présenter. 59 042 frottis ont été réalisés en 2000 et 61 560 frottis ont été réalisés en 2001. Les laboratoires privés ont réalisé 81 % des frottis en 2000 et 83 % en 2001.
Le nombre de frottis a suivi une progression ces dernières années, illustrée par le tableau suivant.
Année 1988 1996 1997 2000 2001 Nombre de frottis pratiqués dans l’année
50 000
53 300
54 000
59 042
61 560
Taux de frottis pratiqués pour 1000 femmes âgées de 20 à 65 ans
320,8
283,8
281,7
290,1
296,6
% d’augmentation par rapport aux données antérieures
+ 6,6 % en 8 ans soit une moyenne de
0,8 % par an
+ 1,3 % en 1 an
+ 9,3 % en 3 ans soit une moyenne de 3,1 % par an
+ 4 % en 1 an
% d’augmentation de la population des femmes de 20 à 65 ans selon les estimations de l’INSEE
+ 20,5 % en 8 ans soit une moyenne
annuelle de + 2,6 %
+ 2,1 % + 6,1 % en 3 ans soit une moyenne
annuelle de + 2 %
Non connu

Le nombre de frottis pratiqués a augmenté régulièrement entre 1988 et 2001. Rapporté au nombre de femmes réunionnaises âgées de 20 à 65 ans, on constate que cette progression est légèrement plus importante que la croissance démographique des femmes de ces classes d’âge depuis 1997.
Evolution du nombre de frottis et du taux de frottis pour 1000 femmes âgées de 20 à 65 ans
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1988 1996 1997 2000 2001260
270
280
290
300
310
320
330
nombre de frottis
taux de frottis pour 1000femmes
Le taux de frottis constaté en 1988 est important. En 1987 une première campagne d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du col avait été menée à la Réunion par le conseil général, et le nombre de frottis réalisés avait alors doublé entre 1987 et 1988. Depuis, la progression du dépistage est moins impressionnante. Néanmoins l’analyse de ces données est encourageante quant à la progression du dépistage du cancer du col utérin à la Réunion depuis ces 5 dernières années.

2.2 - Résultats de l’étude épidémiologique sur le cancer du col utérin.
a) La population concernée Nous avons recensé 395 cas de cancers du col de l’utérus diagnostiqués entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. Nous avons retrouvé 264 cancers in situ et 131 cancers invasifs, soit deux cancers in situ pour un cancer invasif.
Répartition des cancers du col utérin (n = 395)
carcinome invasif
33%
carcinome in situ67%
Nous décrivons ci-après les résultats de notre enquête pour ces deux types de cancer du col utérin de manière distincte. b) Epidémiologie
Cancer in situ
Cancer invasif
264 cancers in situ diagnostiqués en deux ans à La Réunion représentent un taux brut annuel
d’incidence du cancer in situ du col de l’utérus à la Réunion de :
36,8 pour 100 000 femmes.
131 cancers invasifs diagnostiqués en deux ans à La Réunion représentent un taux brut annuel d’incidence du cancer invasif du col de l’utérus de :
18,2 pour 100 000 femmes. Les taux d’incidence annuel pour chaque stade sont
les suivants :
STADE I 6,5 cas pour 100 000 femmes
STADE II 6,8 cas pour 100 000 femmes
STADE III 3,5 cas pour 100 000 femmes
STADE IV 1,4 cas pour 100 000 femmes

La population de référence est la population féminine réunionnaise du recensement de 1999. L’incidence des formes in situ est deux fois supérieure à celle du cancer invasif.
Cancer in situ
Cancer invasif
C’est une pathologie qui touche les femmes jeunes : Age moyen : 38,7 ans Age médian : 37,5 ans Age minimum : 19 ans Age maximum : 78 ans
C’est une pathologie qui touche des femmes plus âgées : Age moyen : 53,7 ans Age médian : 51 ans. Age minimum : 26 ans Age maximum : 93 ans
Nous observons un décalage d’une quinzaine d’années entre la découverte du cancer in situ et celle du cancer invasif. Les taux spécifiques d’incidence varient suivant les tranches d’âge comme l’illustre le graphique suivant :
Taux d'incidence spécifiques des cancers du col utérin en 2000-2001 à La Réunion
0
20
40
60
80
100
120
Tranches d'âge
Cancers invasifs 0 0 8,78 16,86 27,87 24,36 35,93 48,87 26,87 61,4 61,95 54,35 63,39
Cancers in situ 4,69 25,36 47,42 92 86,89 97,45 50,31 55,38 26,87 21,93 33,79 6,79 7,92
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-7475 et
+
Pour le cancer in situ : ils sont élevés entre 30 et 44 ans, avec un maximum observé pour la tranche d’âge 40-44 ans. Pour le cancer invasif : les taux spécifiques d’incidence augmentent avec l’âge ; les taux les plus élevés sont observés pour les tranches d’âge supérieures à 60 ans.

c) Caractéristiques concernant les patientes et leurs facteurs de risque
• Lieu de résidence
Cancer in situ
Cancer invasif
- 41,3 % résident dans le Sud, - 31,8 % résident dans le Nord, - 18,6 % résident dans l’Ouest, - 8,3 % résident dans l’Est.
75% des femmes résident en zone urbaine et 25% en zone rurale.
- 36,4 % résident dans le Nord - 34,9 % résident dans le Sud - 17,1 % résident dans l’Est - 11,6 % résident dans l’Ouest
82 % résident en zone urbaine et 18 % résident en zone rurale.
• Etablissement où le dossier a été consulté
Cancer in situ
Cancer invasif
66% ont été pris en charge en clinique privée. 33% à l’hôpital.
100% ont été pris en charge dans les deux services de cancérologie et radiothérapie de l’île
• Catégorie socioprofessionnelle
Cancer in situ
Cancer invasif
Cette information était documentée pour seulement 43 % des femmes (n= 114). Parmi elles :
- 45,6 % de femmes sans profession - 26,3 % d’employées - 12,3 % de femmes appartenant à la
catégorie « profession intermédiaire » - 12,3 % de retraitées - 1,8 % d’étudiantes - 0,9 % de femmes « artisans, commerçants,
chefs d’entreprises » - 0,9 % de femmes « cadre, professions
intellectuelles supérieures »
Pour plus de trois quarts des patientes (n=101), cette information était documentée, nous avons retrouvé parmi ces femmes :
- 53 % de femmes sans profession - 23% d’employées - 20 % de retraitées - 3 % de femmes de « profession
intermédiaire » - 1% de femmes « artisan, commerçant, chef
d’entreprise »
• Situation maritale
Cancer in situ
Cancer invasif
Cette information n’a pas pu être précisée pour 9 dossiers (n = 255) :
- 50,6% sont mariées, - 46,3% sont célibataires, - 2% divorcées, - 0,8% veuves.
Cette information n’a pas pu être précisée pour 8 dossiers.
- 44,7% sont mariées, - 30,1% sont célibataires, - 9,8% séparées ou divorcées, - 15,4% veuves.
• Multiplicité des partenaires

Aucun dossier ne mentionnait d’information à ce sujet.
• Multiparité et âge de la première grossesse
Cancer in situ
Cancer invasif
Cette information n’était pas mentionnée dans 42 dossiers (n = 222). La parité moyenne est de 2,8. Un quart des femmes a eu plus de trois enfants. L’âge de la patiente lors de sa première grossesse était mentionné dans seulement un tiers des dossiers (n = 82) : l’âge moyen est de 22 ans. 28 % d’entre elles (soit 23 femmes) étaient âgées de 18 ans ou moins au moment de leur première grossesse.
La parité est connue pour 127 femmes. - 75% des femmes ont 3 enfants ou plus. - Six femmes n’ont pas d’enfant. - Une femme a 16 enfants.
L’âge de la patiente lors de sa première grossesse était mentionné dans un tiers des dossiers (n = 43) : l’âge moyen est de 21 ans. 33% d’entre elles étaient âgées de 18 ans ou moins au moment de leur première grossesse.
• Précocité des rapports sexuels
Cancer in situ
Cancer invasif
90 % des dossiers ne mentionnait aucune information à ce sujet. Nous avons retrouvé la notion de précocité des rapports sexuels dans 25 cas soit 9,5 % de l’ensemble des cas de cancers in situ du col.
71 % des dossiers ne mentionnait aucune information à ce sujet. Parmi les autres cas (n=38), nous avons retrouvé la notion de précocité des rapports sexuels dans 26 cas, soit au moins 19,8 % de l’ensemble des cas de cancers invasifs.
• Habitudes tabagiques
Cancer in situ
Cancer invasif
Cette information était documentée pour trois quart des femmes (n= 163). Parmi elles :
- 70 % ne fument pas, - 30 % fument.
Cette information était documentée pour 86 % des femmes (n= 113) parmi elles,
- 84 % ne fument pas, - 16 % fument
• Contraception
Cancer in situ
Cancer invasif
Nous avons noté l’utilisation d’une contraception orale pour 50% des femmes.
Nous avons noté l’utilisation d’une contraception orale pour 30 % des femmes.
•

• Notion de frottis antérieur et délais entre le dernier frottis systématique et le frottis ayant conduit au diagnostic
Cancer in situ Cancer invasif
Cette information était documentée pour moins de la moitié des femmes (n = 118). Parmi elles :
- 96,6 % des femmes avaient déjà eu au moins un frottis,
- 3,4 % des femmes n’en avait jamais eu. Le délai écoulé entre le dernier frottis et celui qui a conduit au diagnostic, ou le cas échéant, entre le dernier frottis et l’apparition des signes d’appels n’a pu être précisé que pour un tiers des carcinomes in situ (n = 90). Les résultats sont les suivants :
- Le délai moyen est de 27 mois. - La médiane est de 24 mois : la moitié de ces
femmes avait fait un frottis datant de plus de deux ans.
- Un quart d’entre elles avait fait un frottis datant de plus de trois ans
Cette information était documentée pour un quart des femmes (n=33) ayant présenté un cancer invasif du col utérin. Parmi elles :
- 88 % avaient déjà eu au moins un frottis, - - 12 % n’en avaient jamais eu.
Le délai écoulé entre le dernier frottis et celui qui a conduit au diagnostic, ou le cas échéant, entre le dernier frottis et l’apparition des signes d’appels n’a pu être précisé que pour un quart des dossiers de cancers invasifs (n=32) :
- Le délai moyen est de 41 mois soit 3 ans et 4 mois.
- La médiane est de 43,6 mois : la moitié des femmes avaient un frottis datant de plus de 3 ans et demi.
d) Modalités de diagnostic des cancers
• Date du diagnostic Les cancers in situ et invasifs du col utérin ont été diagnostiqués au cours des deux années étudiées selon le calendrier illustré par les figures suivantes :
Répartition par trimestre des cancers in situ ( année 2000 et 2001)
28
36 33 3034 37
2936
0
10
20
30
40
1er trim.2000
2° trim.2000
3° trim.2000
4° trim.2000
1er trim.2001
2° trim.2001
3° trim.2001
4° trim.2001
050100150200250300
Effectifs trimestrielsEffectifs cumulés

Répartition par trimestre des cancers invasifs ( année 2000 et 2001)
1715
18 18 20 188
14
0
10
20
30
1er trim.2000
2° trim.2000
3° trim.2000
4° trim.2000
1er trim.2001
2° trim.2001
3° trim.2001
4° trim.2001
0
40
80
120
160
effectif trimestrieleffectif cumulé
• Circonstances de découverte et examen anatomo-pathologique de première intention
Cancer in situ
Cancer invasif
94 % des carcinomes in situ ont été découverts à l’occasion d’un examen systématique, chez des patientes asymptomatiques. Quatorze dossiers (5%) mentionnaient la présence de signes fonctionnels. Enfin, pour trois dossiers (1%), nous n’avons pas retrouvé d’information concernant les circonstances de découverte. Les signes fonctionnels, mentionnés dans quatorze dossiers, n’étaient probablement pas liés directement à la néoplasie, mais correspondent aux signes qui ont motivé la consultation gynécologique, et dont le bilan a permis de découvrir le cancer in situ. Les signes évoqués dans les dossiers sont les suivants : métrorragies dans sept cas, un cas de dyspareunie, un cas de cystocèle, divers motifs tels que constipation, anémie, etc… dans cinq cas. Pour les patientes asymptomatiques, nous avons retrouvé la réalisation d’un frottis de dépistage dans 89 % des cas et d’une biopsie en première intention dans 11 % des cas, biopsie réalisée devant la découverte d’anomalies de la colposcopie de dépistage.
Pour 80 % des cas de carcinome invasif, des signes fonctionnels ont motivé la première consultation. Ce furent : - des métrorragies dans 79 % cas, - des douleurs pelviennes dans 10,5 % cas, - des leucorrhées dans 5,7 % des cas, - des signes urinaires dans 1 % des cas, - divers motifs tels que constipation ou asthénie, dans 2,8 % des cas. La proportion de signes d’appel fonctionnels, est d’autant plus importante que le stade évolutif est avancé (cf. graphique) Enfin, 20 % des carcinomes invasifs ont été découverts à l’occasion d’un examen systématique : frottis de dépistage dans trois quarts des cas, biopsie d’emblée lors d’une colposcopie de dépistage dans un quart des cas.

p ré s e n ce d e s ig n es d 'a p p e ls e n p o u rce n tag e
p o u r c h a q u e s ta d e d e s ca n c e rs in va s ifs
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
IA IB IIA IIB IIIA
IIIB
IV A IV B
%
• Qualité du prescripteur de l’examen anatomopathologique de première intention
Cancer in situ
Cancer invasif
Dans le cadre du dépistage systématique du cancer du col, un frottis a été prescrit et réalisé par :
- un gynécologue dans 56 % des cas, - un généraliste dans 38 % des cas, - un médecin de l’AROF dans 4 % des
cas et - un médecin de PMI dans 2 % des cas.
Le gynécologue a été à l’origine du diagnostic dans trois quarts des cas et le médecin généraliste dans
un quart des cas.
Parmi les cas de cancers invasifs découverts par frottis de dépistage, l’examen a été réalisé par :
- un gynécologue dans 52 % des cas, - un généraliste dans 44 % des cas et
- un médecin de PMI dans 4 % des cas.
Répartition des frottis de dépistage des cancers in situ en fonction de la qualité du prescripteur
gynécologue56%
généraliste38%
AROF4%
PMI2%

• Délai entre l’apparition d’éventuels signes fonctionnels et la première
consultation
Cancer in situ
Cancer invasif
Ce délai est nul pour la plupart des cas, en effet les carcinomes in situ ont très majoritairement été découverts à l’occasion d’un examen systématique.
Cette donnée était précisée pour 59 % des dossiers (n = 77) :
- le délai moyen est de 11,57 semaines, - la médiane est de 8 semaines.
Onze patientes ont consulté leur médecin sans aucun délai après l’apparition des signes, soit environ 14 % des cas précisément renseignés. Des données moins précises ont été recueillies pour 27 patientes supplémentaires. Ainsi, parmi les dossiers renseignés (n = 104) nous constatons que :
- 47 % des patientes ont attendus quelques semaines avant de consulter (moins de 12 semaines) et
- 42 % ont attendu plus de 3 mois avant de consulter.
• Examen anatomo-pathologique ayant conduit au diagnostic du cancer
Cancer in situ
Cancer invasif
La majorité des carcinomes in situ (72,7 %) ont été diagnostiqués par biopsie. Parfois c’est la conisation (25,8 % des cas) voire l’hystérectomie (1,5 % des cas) qui ont apporté le diagnostic.
Le diagnostic histologique a été posé par biopsie dans 94 % des cas, puis confirmé à l’examen histologique de la pièce opératoire. 4 % des cancers invasifs ont été diagnostiqués sur une pièce d’hystérectomie. 2 % après conisation.
• Délai entre la première consultation et le diagnostic histologique de certitude
Cancer in situ
Cancer invasif
Nous n’avons pu préciser ce délai que pour 227 dossiers. Dans le cadre du dépistage
systématique du cancer du col utérin, il s’agit du délai entre le frottis de dépistage et
l’examen histologique de certitude. Dans la plupart des cas, ce délai est court, de l’ordre de quatre semaines (cf. graphique). Ce délai est supérieur ou égal à trois mois
Ce délai est connu pour 122 patientes, mais n’est précisé que pour 82 d’entre elles.
49 % des 122 patientes ont consulté d’emblée
un gynécologue, les autres ont d’abord consulté leur médecin traitant, puis ont
bénéficié d’une consultation spécialisée. Pour les délais connus avec précision,
- le délai moyen est de 4 semaines - la médiane est à 2 semaines.

pour 14 % des dossiers renseignés. (cf. graphique) Ces délais sont plus importants s’il s’agissait d’un frottis systématique sans signes d’appel (n = 18, moyenne : 7 semaines et médiane : 4 semaines) et moins importants pour les femmes qui présentaient des signes d’appel (n = 64, moyenne : 3 semaines et médiane : 1 semaine).
Les délais très longs correspondent à la découverte de lésions dysplasiques au cours d’une grossesse et à quelques cas de patientes « perdues de vue » : pour 7 cas, ce délai de confirmation du diagnostic après la première visite au médecin traitant est supérieur ou égal à 12 semaines.
délai entre le frottis de dépistage et le diagnostic du cancer in situ (n=195)
médiane
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 24 28 72
délai en semaines
nom
bre
de c
as
Délai entre le premier frottis et le diagnostic de cancer invasif (n=82)
26
10 95
14
15 5
1 1 2 2 1
05
1015202530
0 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 32 36
délai en semaines
nom
bre
de fe
mm
es
• Type histologique du cancer
Cancer in situ Cancer invasif Il s’agissait :
- d’un carcinome épidermoïde dans 98,5 % des cas et
- d’un adénocarcinome dans 1,5 % des cas.
Il s’agissait : - d’un carcinome épidermoïde dans
83% des cas - d’un adénocarcinome dans 10 % des
cas, d’un carcinome de type mixte dans 2,3% des cas d’un carcinome d’un autre type (tumeurs conjonctives, tumeur neuro-endocrine.) dans 4,7% des cas.

• Association à une papillomavirose
Cancer in situ Cancer invasif Des signes d’infection à Papillomavirus (HPV) ont été mis en évidence pour 61% des cancers in situ.
Des signes d’infection papillomateuse ont été mis en évidence dans seulement 8,4 % des cas de l’ensemble des cancers invasifs.
• Les différents stades des cancers invasifs au moment du diagnostic
10 % des cancers sont découverts au stade IA ; ce sont des microinvasifs. Près d’un tiers des cancers invasifs ont été diagnostiqué au stade IIB.
14
33
11
38
3
22
82
05
10152025303540
IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
Stade évolutif
Nombre de cancers invasifs en fonction du stade de la FIGO
La fréquence des métastases ganglionnaires est d’autant plus importante que le stade évolutif est élevé (cf graphique)
0
20
40
60
80
100
%
IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
présence de métastases ganglionnaires en pourcentage pour chaque stade

e) Données concernant le traitement des carcinomes Pour les cancers in situ Le traitement des cancers in situ est précisé pour 257 patientes. Pour les dossiers dans lesquels l’information a été retrouvée : La plupart des carcinomes in situ ont été traités par conisation seule (84%). Parfois une hystérectomie a été réalisée dans un deuxième temps lorsque les limites de l’exérèse ne passaient pas « in sano », voire d’emblée en fonction de l’âge de la patiente : c’est le cas pour 24 patientes (9%). 18 patientes ont bénéficié d’une hystérectomie d’emblée (7%). Pour les carcinomes invasifs Les différents traitements utilisés pour chaque femme atteinte d’un cancer invasif sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Stade Chirurgie
exclusive Chirurgie et
Radiothérapie Radio et chimiothérapie
concomitante Chimiothérapie Total des
cas IA 7 6 1 14 IB 1 23 9 33 IIA 0 6 5 11 IIB 2 2 34 38 IIIA 0 1 2 3 IIIB 1 7 14 22 IVA 0 4 4 8 IVB 0 0 0 2 2

3. Discussion des résultats de l’enquête épidémiologique 3.1. Les limites de la méthode Nous regrettons les difficultés rencontrées au niveau du recueil des données dans les laboratoires d’anatomo-pathologie. Elles ne nous ont pas permis d’analyser l’activité de dépistage pendant ces deux dernières années comme nous le souhaitions, ni d’identifier les patientes ayant présenté un cancer du col utérin prouvé histologiquement. La variété et la complémentarité des sources de données que nous avons utilisées par la suite (Départements d’information médicales, services de gynécologie, de cancérologie et radiothérapie, registres des blocs opératoires…) nous permettent de penser que nous avons atteint l’exhaustivité des cas de cancer du col utérin diagnostiqués à la Réunion pendant ces deux années. La consultation des dossiers médicaux sur place, dans les structures de soins, a permis d’éviter les double-comptes. La méthode de recueil de données utilisée pour cette étude a cependant quelques limites. Elle est rétrospective ce qui explique le nombre parfois important de données manquantes. Certains indicateurs trop souvent absents des dossiers médicaux n’ont pu être interprétés ou l’ont été avec beaucoup de prudence. C’est le cas pour certains facteurs de risque des femmes atteintes de cancer du col utérin, ou pour les délais dans la prise en charge de leur pathologie. 3.2 Discussion des résultats Notre étude permet de décrire la situation actuelle de l’incidence du cancer du col de l’utérus à la Réunion. Nous allons maintenant la comparer avec les données recueillies à La Réunion en 1996-97 puis avec les données retrouvées dans la littérature.
a) Les données épidémiologiques Afin de pouvoir comparer les données de la Réunion avec celles d’autres régions françaises ou internationales nous avons calculé le taux d’incidence standardisé du cancer du col utérin.
Cancer in situ
Cancer invasif
Taux d’incidence standardisé pour 100 000 femmes : Avec la population métropolitaine : 37,09 Avec la population européenne : 36,77 Avec la population mondiale : 31,88
Avec la population métropolitaine : 26,57 Avec la population européenne : 22,63 Avec la population mondiale : 17,15

Comparaison aux données locales de 1996-1997
La comparaison des donnés de notre étude et de celle menée en 1996-1997, nous permet de faire plusieurs constatations :
� Il existe une augmentation de 25% du taux d’incidence du cancer in situ (de 29,35 à 36,76) et une diminution de 12,7% du taux d’incidence du cancer invasif (de 20,89 à 18,24) en 4 ans.
Cette évolution pourrait s’expliquer par une augmentation et une plus grande précocité de la détection des lésions du col utérin, donc un essor du dépistage. L’augmentation de l’incidence des lésions in situ sur les quatre dernières années, s’observe pour la plupart des tranches d’âge : (cf. graphique) Pour les femmes de 55 à 64 ans, les taux n’ont pas progressé, ils sont superposables à ceux de 96-97 : On notait à l’époque un manque de dépistage dans cette population. Sans doute ce constat peut encore être fait. On observe une augmentation du taux spécifique d’incidence pour la tranche d’âge 65-69 ans. Toutefois, il apparaît difficile d’interpréter ces chiffres étant donné le faible effectif de ces tranches d’âge.
Comparaison des taux spécifiques d'incidence par tranche d'âge, des cancers in situ
0
20
40
60
80
100
120
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Tranches d'âge 2000-2001
1996-1997

Taux d'incidence du cancer invasif du col utérin standardisés à la population
mondiale (1988-92)
10,0110,37
7,7511,92
9,6810,48
7,43
14,09
0 5 10 15
Bas-Rhin
Doubs
Hérault
Somme
La baisse de l’incidence du cancer invasif sur les quatre dernières années s’observe également pour la plupart des tranches d’âge (cf graphique).
L’âge moyen de découverte du cancer du col, d’après notre étude, est de 38,7 pour le cancer in situ et 53,7 pour le cancer invasif. Ceci n’a pas changé de manière significative depuis 96-97. En 1988-92, d’après les données du Registre des cancers à La Réunion, l’âge moyen du diagnostic du cancer invasif du col utérin était de 51 ans. Nous constatons donc une augmentation de 2,7 ans en dix ans. Cette évolution peut être liée au vieillissement de la population réunionnaise d’une part et à l’essor du dépistage précoce d’autre part. Comparaison aux données d’autres registres L’étude comparative des données provenant de 9 registres français, sur la période 1978-1992 publiée en février 1998 dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, a montré une diminution de l’incidence du cancer invasif et une augmentation de l’incidence des lésions in situ, au cours des vingt dernières années. Ces deux tendances correspondent à ce que nous avons pu observer à la Réunion sur les quatre dernières années. Concernant le cancer invasif, l’analyse des données des différents registres dans le monde par Coleman7 fait apparaître une diminution de l’incidence depuis les trente dernières années et plus particulièrement dans les pays où le dépistage est organisé. Les données des différents registres français sont illustrées par le graphique ci-après D’après notre étude, le taux d’incidence annuel du cancer invasif du col de l’utérus, standardisé à la population mondiale, est de 17,15 pour 100 000 femmes pour la période 2000- 2001. Il est 1,7 fois supérieur à la moyenne des taux observés dans
7 Trends in cancer incidence and mortality, IARC Sci publ. 1993 ; 121
Comparaison des taux spécifiques d'incidence par tranche d'âge du cancer invasif du col utérin
020406080
100120140
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
Tranches d'âge 2000-2001
1996-1997

les différents registres français sur la période 1988-92. En 1996-97, il était 2 fois supérieur à cette moyenne.
Ainsi, même si l’incidence du cancer du col à la Réunion a diminué par rapport à 1996-97, elle est toujours fortement supérieure à celle observée en métropole. Cette différence est sans doute liée, comme l’avaient évoqué les Drs Toudy et Sneed, aux différences socio-économiques et à l’insuffisance de dépistage notamment chez les femmes les plus âgées.
En comparant nos données avec celles du registre du Tarn pour la période 1990-95, à propos de l’âge de la femme au moment du diagnostic du cancer du col utérin : Pour le cancer in situ : l’âge médian de diagnostic du cancer in situ est de 36 ans dans le Tarn, ce qui est comparable aux résultats de notre étude (37,5 ans) ; le taux d’incidence spécifique le plus élevé est observé pour la tranche d’âge 30-39 ans dans le Tarn, le maximum est observé pour la tranche d’âge 40-44 ans à La Réunion. Pour le cancer invasif : l’âge médian de diagnostic du cancer invasif est de 61 ans dans le Tarn alors qu’il est de 51 ans à la Réunion selon notre étude. Le taux d’incidence spécifique le plus élevé est observé pour la tranche d’âge 60-69 ans dans le Tarn ; à la Réunion le maximum est observé pour la même tranche d’âge. b) Les caractéristiques des femmes et leurs facteurs de risque Lieu de résidence En ce qui concerne le lieu de résidence des patientes, nous avons comparé nos données avec celles de la répartition de la population réunionnaise établie par l’INSEE lors du recensement de 1999 . Parmi les patientes qui ont présenté un cancer in situ, il existe une sur-représentation des habitantes du Nord (142 %) et du Sud (118 %) associée à une sous-représentation des habitantes de l’Est (50 %) et dans une moindre mesure, de l’Ouest (73 %). Ce résultat permet de poser l’hypothèse d’une carence de dépistage dans l’Est. Cette carence pourrait en partie s’expliquer par le moindre effectif des structures de soins dans cette région de l’île. Parmi les femmes qui ont présenté un cancer invasif du col, il existe une sous-représentation des habitantes de l’Ouest (46 %) associée à une sur-représentation des habitantes du Nord (140 %). Pour les régions Sud et Est les données de notre étude correspondent à la répartition de la population générale. Par ailleurs, la majorité des femmes concernées par notre étude réside en zone urbaine. L’interprétation de cette information est difficile car il n’existe pas de liste clairement établie pour répartir les lieux de résidence en « ville » ou dans les « écarts ».

Les résultats de plusieurs études, menées à la Réunion et en métropole, montrent que l’activité de dépistage par le frottis semble moins importante en milieu rural : Une étude réalisée à la Réunion en 19888, dans le cadre de l’évaluation de la première campagne départementale de dépistage du cancer du col, montrait que les femmes âgées, résidant en zone rurale, de faible niveau d’instruction et socio-économique, étaient les plus nombreuses à n’avoir jamais eu de frottis. Selon une étude réalisée dans la région Rhône-Alpes en 19899, à propos de la réalisation des frottis cervicaux dans une clientèle de médecine générale, « l’absence totale de frottis s’observait plus fréquemment de façon significative en milieu rural qu’en milieu urbain. ». Catégorie socioprofessionnelle Dans notre enquête, les femmes sans profession sont moins représentées que dans la population féminine générale. Ceci se retrouve surtout pour le cancer in situ. Ceci pourrait refléter une carence de dépistage chez ces femmes. Un audit sur le dépistage du cancer du col dans une clientèle de médecine générale, réalisé dans la Sarthe en 199210, retrouvait des données comparables : « les femmes les moins bien suivies sont les femmes au foyer. Les mieux suivies appartiennent aux catégories professionnelles intermédiaires. ». Par contre, les femmes appartenant à la catégorie « profession intermédiaire » sont sur-représentées pour le cancer in situ et sous représentées pour le cancer invasif. Ces deux constats semblent traduire une meilleure adhésion au dépistage pour les femmes de cette catégorie socioprofessionnelle.
� Multiplicité des partenaires Cette information qui concerne le plus important facteur de risque, n’apparaît pas dans les dossiers médicaux que nous avons consultés. Selon les données locales de 1997 concernant les comportements sexuels à la Réunion11, le nombre moyen de partenaires des femmes et des hommes est respectivement de 2 et de 11; La proportion d’hommes multipartenaires à la Réunion (20 %) est supérieure à la proportion métropolitaine (13 %).
8 Skrzypczak, thèse de médecine à Lille en 1992 : l’éducation pour la santé à La Réunion, actions du Conseil Général. 9 Riou F., Les frottis cervicaux en médecine générale, évaluation de la réalisation régulière de frottis cervicaux dans la clientèle de médecins généralistes de la région Rhône-Alpes. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1989 ; 18 : 145-151 10 Pare F., Audit sur le dépistage du cancer du col de l’utérus dans une clientèle de médecine générale. La revue de santé publique 1994 ; 6 (1) : 7-15 11 DRASS – ORS, mai 1997, analyse des comportements sexuels à La Réunion.

Multiparité Selon notre étude, la parité moyenne des femmes ayant présenté un cancer in situ est de 2,8 et celle des femmes ayant présenté un cancer invasif est de 4,7. Ces moyennes sont toutes deux supérieures à l’indice de fécondité moyen des réunionnaises : 2,4. Parité précoce En ce qui concerne l’âge de la patiente au moment de sa première grossesse, l’interprétation de nos résultats est difficile car deux tiers des dossiers ne mentionnaient aucune information à ce sujet, que ce soit pour le cancer in situ ou pour le cancer invasif. Parmi les dossiers renseignés, 28% femmes atteintes d’un cancer in situ, et 33% des femmes atteintes d’un cancer invasif, étaient âgées de 18 ans ou moins lors de leur première grossesse. Précocité des rapports sexuels Cette information est rarement retrouvée dans les dossiers (17% de l’ensemble des dossiers). Ce faible effectif ne permet pas de savoir s’il existe ou non une proportion significative de femmes ayant eu des rapports sexuels précoces. D’après les données locales décrivant les comportements sexuels à la Réunion en 1997, l’âge moyen du premier rapport sexuel est de 17,9 ans pour les femmes réunionnaises contre 18,1 ans en métropole. Pour la population générale, il n’y a donc pas de différence significative entre la Réunion et la métropole sur ce point, qui pourrait rendre compte de l’incidence plus élevé du cancer du col de l’utérus à la Réunion. Habitudes tabagiques Le tabac est considéré comme un facteur de risque du cancer du col utérin. Selon Brinton12, le risque relatif est de 1,5 chez les fumeuses. Dans notre étude, nous avons retrouvé 17 % de femmes qui fument. La proportion de fumeuses est plus élevée parmi les femmes qui ont présenté un cancer in situ que parmi celles qui ont présenté un cancer invasif. Cette différence est probablement liée au fait qu’il y a moins de femmes qui fument dans les tranches d’âge les plus âgées. À la Réunion, d’après les estimations du Baromètre Santé, sur la période 1999-200013, 19 % des femmes âgées de 15 à 75 ans fument. Ainsi les données de notre étude correspondent à celles de la population générale et ne révèlent pas de sur-représentation des fumeuses parmi les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus.
12 Brinton LA, Cigarette smoking and invasive cervical cancer, J.Am. Med. Assoc., 1986, 255, 3265-3369 13 DRASS, baromètre santé 1999-2000

Contraception Aucune étude n’a permis à ce jour d’établir un lien de cause à effet entre la contraception orale et le cancer du col. Selon l’étude de Brémond14 en 1986, c’est l’utilisation d’un moyen médical de contraception (pilule et surtout stérilet) qui représente un facteur de meilleure surveillance de la femme, et influence la pratique du frottis. Selon notre étude, la proportion des femmes qui utilisent une contraception orale est plus élevée chez celles atteintes d’un cancer in situ que chez celles atteintes d’un cancer invasif. Néanmoins l’utilisation de la contraception orale est naturellement le fait de femmes jeunes . c) Les modalités du diagnostic Date du diagnostic Le nombre de cancers in situ et de cancers invasifs, diagnostiqués chaque trimestre est quasiment identique : on n’observe pas d’augmentation du nombre de diagnostics dans les suites des deux premières périodes de la campagne médiatique qui se sont déroulées en juin et en septembre 2000. Par contre, un plus grand nombre de cas a été diagnostiqué au cours du deuxième trimestre 2001, c’est-à-dire juste après le déroulement de la troisième vague médiatique de la campagne à la fin du premier trimestre 2001. Ceci s’observe autant pour les cancers in situ que pour les invasifs. Circonstances de découverte La plupart des cancers in situ a été découvert à l’occasion d’un examen systématique, chez des patientes asymptomatiques. Au contraire, seuls 20 % des cancers invasifs du col ont été diagnostiqués chez des patientes asymptomatiques. Les autres ont été découverts suite à l’apparition de signes fonctionnels, essentiellement des métrorragies. Le dépistage, qui permet de dépister des formes localisées de cancer du col, permet une diminution significative de l’incidence et de la mortalité du cancer invasif du col utérin (conférence de consensus sur le dépistage du cancer du col utérin en 1990). Selon notre étude, le dépistage concerne essentiellement des femmes de moins de 50 ans : seuls 15 % des cancers, in situ et invasifs, découverts à l’occasion d’un examen systématique, ont été diagnostiqués chez des femmes de plus de cinquante ans. En 1996-97 le même constat avait été posé : les résultats de l’étude menée à l’époque, montraient que le frottis était à l’origine du diagnostic de cancer in situ dans 82,2 % des cas chez des femmes âgées de moins de 50 ans. 14 Bremond A., Dépistage du cancer du col utérin, rôle de la contraception et de la catégorie socio-professionnelle. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1986 ; 15, 1021-1025.

Ceci reflète probablement la moindre pratique de dépistage des femmes réunionnaises âgées de plus de 50 ans. Plusieurs auteurs ont montré que les femmes ménopausées sont moins bien suivies sur le plan gynécologique et que le dépistage est plus fréquent chez les femmes plus jeunes : une étude faite dans la région lyonnaise en 198915, menée auprès de plus de 200 généralistes, a montré que plus de la moitié des femmes n’ayant jamais eu de frottis appartenait à la tranche d’âge 60-69 ans. La plupart des cancers invasifs sont découverts à un stade avancé : le diagnostic a été posé le plus souvent au stade II B de la classification FIGO. En 96-97, le cancer invasif du col était également diagnostiqué le plus souvent au stade II B, mais ce stade représentait un quart des diagnostics alors qu’il représente un tiers des cancers invasifs selon notre étude. Parallèlement, nous avons retrouvé une proportion moindre de formes très évoluées. Parmi l’ensemble des cancers invasifs, un quart a été diagnostiqué aux stades III ou IV, contre un tiers il y a quatre ans. Ainsi, le diagnostic du cancer du col semble intervenir plus tôt dans l’évolution de la maladie. Qualité du prescripteur Pour l’ensemble des cancers du col, le gynécologue a été le plus souvent à l’origine du diagnostic (biopsie et frottis confondus). Toutefois, dans le cadre du dépistage systématique par le frottis, la participation du médecin généraliste a été relativement importante (dans 38 % des cas) et en nette augmentation par rapport aux données de 1996-97 comme l’illustre le graphique suivant :
01020304050607080
en 1996-97 en 2000-01
Qualité du prescripteur des frottis de dépistage (en pourcentage)
généralistespécialisteAROFPMIautre-inconnu
L’implication des médecins généralistes est une condition indispensable au succès du dépistage. Ils ont un rôle important dans la sensibilisation, l’information des femmes,
15 Cf. Riou F.

notamment celles qui ne consultent pas pour un motif gynécologique et qui échappent au dépistage. Les résultats de notre étude peuvent êtres considérés comme encourageants car la participation des généralistes est plus importante qu’il y a quatre ans. Elle est également supérieure à celle observée en métropole, dans plusieurs départements : Les résultats de trois ans et demi de campagne de dépistage organisé dans le département du Bas-Rhin, projet pilote « EVE » opérationnel depuis 199416, indiquent que le dépistage reposait essentiellement sur les gynécologues, le pourcentage de frottis prescrit ou réalisé par un médecin généraliste était faible, 7,6 %. De même, le bilan des trois premières années du programme pilote de dépistage mis en place en 1993 dans le département du Doubs17, montre que les frottis ont été réalisés par un gynécologue pour 84 %, un médecin généraliste pour 14%. Ces constats doivent être relativisés car la densité de médecins spécialistes exerçant à la Réunion est bien plus faible que celle retrouvée en métropole. L’importante participation des médecins généralistes au dépistage du cancer du col de l’utérus, n’est sans doute que le fait d’une moindre présence de spécialistes sur le territoire réunionnais. Infection à Papillomavirus Il existait des signes d’infection à Papillomavirus (HPV) dans 61 % des cancers in situ, et dans seulement 8,4 % des cancers invasifs. Ceci correspond aux données actuelles sur le cancer du col utérin et l’infection à HPV. En effet selon l’EMC (Encyclopédie Médico-Chirurgicale), la koïlocytose n’apparaît que s’il persiste une maturation de surface, ainsi la fréquence des signes d’infection à HPV est inversement proportionnelle à la gravité de la lésion. Une étude sur la prévalence des papillomaviroses a été réalisée au Centre Hospitalier de Saint Denis, mais n’est pas terminée faute de moyens. Par ailleurs, aucune étude épidémiologique sur la prévalence des maladies sexuellement transmissibles n’est disponible à la Réunion. Métastases ganglionnaires La fréquence des métastases ganglionnaires est d’autant plus importante que le stade évolutif est élevé. Ce constat correspond aux données actuelles sur le cancer du col. Il était déjà posé dans l’étude de 1996-97, néanmoins le nombre de métastases ganglionnaires mis en évidence pour chaque stade de cancer invasif est plus élevé dans notre étude, et s’approche des données de références retrouvées dans l’EMC.
16 Fender M., peut on et faut il organiser le dépistage du cancer du col de l’utérus en France ? J Gynecol Obstet Biol Reprod 1998, 27 : 683-691. 17 Monnet E., Dépistage du cancer du col de l’utérus : résultats des trois premières années d’un programme organisé dans un département français ; Rev Epidém et Santé Publ 1998 Vol 46 suppl 1

d) Traitement des carcinomes invasifs Le traitement des cancers invasifs du col utérin est mieux codifié, qu’il y a quatre ans il est basé sur les standards, options et recommandations de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNLCC) et la Société Française d’Oncologie Gynécologique (SFOG). Il est important de souligner que l’utilisation des protocoles de radio chimiothérapie concomitante a commencé dès 1996 à la Réunion.

4. Résumé des principaux résultats de l’enquête épidémiologique
� On note une augmentation régulière du nombre de frottis pratiqués à la Réunion depuis 1996. Cette augmentation est légèrement plus forte que l’augmentation de la population féminine réunionnaise ce qui prouve une plus grande adhésion des femmes réunionnaises au dépistage du cancer du col de l’utérus.
� Il existe une augmentation de 25% du taux d’incidence du cancer in situ et une
diminution de 12,7% du cancer invasif depuis ces 4 dernières années. � Le taux d’incidence annuel du cancer invasif du col de l’utérus standardisé à la
population mondiale reste aujourd’hui 1,7 fois supérieur à la moyenne des taux observés dans les différents registres français sur la période 1988-92.
� Parmi les patientes qui ont présenté un cancer in situ, il existe une sur-représentation
des habitantes du Nord (142 %) et du Sud (118 %) associée à une sous-représentation des habitantes de l’Est (50 %) et dans une moindre mesure, de l’Ouest (73 %). Ce résultat permet de poser l’hypothèse d’une carence de dépistage dans l’Est. Cette carence pourrait en partie s’expliquer par le moindre effectif des structures de soins dans cette région de l’île.
� Dans notre enquête, les femmes sans profession sont moins représentées que dans la
population féminine générale. Ceci se retrouve surtout pour le cancer in situ. Ceci pourrait refléter une carence de dépistage chez ces femmes. Un constat similaire a été posé en 1992 dans un autre département français (la Sarthe).
� En comparaison avec les données de 1996-97, le diagnostic du cancer du col semble
être fait plus tôt en 2000-01. Actuellement, dans un tiers des cas, le stade de découverte des cancers invasifs est le stade II B.
� La participation des généralistes dans le dépistage des cancers du col est plus
importante qu’il y a quatre ans : les généralistes étaient à l’origine du frottis de dépistage dans moins de 10% des cas en 1996-97 versus 38% des cas en 2000-01.

Approche anthropologique des réticences des femmes face au frottis à l’île de La Réunion
1. Objectifs, matériel et méthode Objectifs
Par une approche qualitative et anthropologique, nous nous sommes fixés comme objectifs de : - Définir et comparer les différents profils de comportements des femmes réunionnaises face au
frottis, - Cerner les réticences à pratiquer cet examen chez les femmes de plus de 40 ans.
Matériel et méthode
• La pré-enquête
Elle a été réalisée afin d’établir le guide d’entretien et élaborer les hypothèses de travail. Nous avons interrogé plusieurs femmes réunionnaises ainsi que des personnes ressources à La Réunion18.
Les hypothèses
- Les femmes réunionnaises pratiquant peu ou pas ce dépistage ont quelques caractéristiques : plus souvent issues du milieu rural, âgées de plus de 60 ans, peu éduquées, retraitées ou inactives.
- La pratique du dépistage à La Réunion (pas uniquement pour le cancer du col) se heurte à la croyance selon laquelle tant que « je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade … Et donc, je ne fais rien ! »
- Les croyances religieuses donnent à la maladie survenant chez les personnes âgées une certaine image de fatalité : c’est naturel d’être malade quand on devient vieux. Cela n’entraîne pas de comportements préventifs.
- Des croyances fortes (religieuses ou non) peuvent donner à la maladie le sens d’une « punition » ou d’un « sort » jeté sur l’individu à cause d’une « faute » commise par lui-même ou à cause d’une autre personne qui lui veut du mal : maladie volonté divine ou maladie punition…..
• L’enquête
A partir des hypothèses posées, une grille d’entretien (cf. annexe) a été élaborée. Elle permet d’abord le recueil des caractéristiques personnelles et familiales des femmes interviewées (que nous appellerons les informatrices), puis aborde successivement quatre thèmes : Représentation de la maladie, médecin traitant et comportements de prévention, Le cancer, connaissances et représentations Les maladies « d’en bas », le cancer du col de l’utérus : connaissances et représentations Le frottis : connaissances et attitudes
18Dr Barrau, chef de service de gynécologie du Centre Hospitalier de Saint Pierre ; Dr Kauffman, service de gynécologie de Saint Pierre ; Des sages-femmes réunionnaises du Centre Hospitalier de Saint Pierre réunies par la surveillante Mme Desprairies ; Dr Sandra Greget, Cancérologue de la clinique Sainte Clotilde ; Brigitte Lowinsky, Sage-femme, Surveillante-chef du CHD de Saint Denis ; Dr Gabrielle, gynécologue libéral à Saint Louis

Pour mener les entretiens, nous avons fait appel à une femme parlant créole, ayant l’expérience des entretiens anthropologiques. Elle ne s’est pas présentée comme une professionnelle de santé mais comme une enquêtrice travaillant sur le cancer à la Réunion, afin que les femmes interrogées puissent s’exprimer plus facilement sur ce sujet délicat. Les entretiens ont été réalisés au domicile de l’informatrice, en tête-à-tête, sauf dans 3 cas où la fille de l’informatrice a également été interrogée. Ils ont été enregistrés sur bandes afin de mieux retranscrire leur contenu, et d’éviter la prise de notes systématique durant l’entretien. D’une durée prolongée (une heure en général), l’entretien a permis à la personne de s’exprimer de manière approfondie. Certaines informatrices ont été revues plusieurs fois pendant le temps de l’enquête pour compléter les informations. La population enquêtée Vingt femmes réunionnaises ont été interviewées lors de notre étude. Elles ont été choisies parmi des femmes connues de l’enquêtrice pour avoir participé à une étude anthropologique sur le diabète. D’autres femmes ont été contactées par la méthode « boule-de-neige » ou bouche-à-oreille. Enfin, d’autres ont été sollicitées par l’intermédiaire des personnes ressources rencontrées lors de la pré-enquête. Nous avons inclus dans notre étude, après que son médecin ait obtenu son consentement, une femme atteinte du cancer du col, en cours de traitement. Cette femme a été interrogée dans le service où elle était prise en charge. Les informatrices ont été choisies sur la base du volontariat et présentent plusieurs caractéristiques : Elles sont âgées de 41 à 69 ans, représentant ainsi la population ciblée par la campagne. Seule une femme de 32 ans, fille d’une informatrice, a été inclue dans l’étude. Elles résident depuis plus de 10 ans à La Réunion. Leur situation géographique représente à la fois les milieux urbains et ruraux. Leurs origines ethniques (créole, malgache, métropolitaine, chinoise) et religieuse (catholique, tamoule, musulmane, culte des ancêtres) sont variées, reflétant ainsi le caractère pluriethnique de la Réunion. Leur situation professionnelle et leur niveau socioéconomique sont variés. Il faut préciser que l’anonymat de toutes ces personnes a été strictement respecté et qu’aucune coordonnée les concernant n’a été gardée, au-delà du terme de cette enquête. Méthode de l’analyse L’analyse des données recueillies lors des entretiens, s’est déroulée selon le schéma suivant : Retranscription de l’intégralité des entretiens enregistrés, Classement des différents thèmes abordés lors des entretiens, Analyse du contenu de chaque thème,

Vérification des hypothèses par des entretiens supplémentaires, Proposition d’une typologie de comportements, Comparaison avec la littérature, Séances de travail avec l’enquêtrice et une anthropologue réunionnaise aux différents temps de l’analyse. 2. Description des entretiens La grande majorité des femmes interrogées ont participé avec plaisir à cette étude. Elles appréciaient de pouvoir parler librement de questions assez intimes avec une femme extérieure à leur environnement, avec qui les rencontres étaient ponctuelles, ce qui leur garantissait que ces échanges ne « reviendraient pas aux oreilles de leurs proches ». Dans quelques cas, des femmes ont marqué un peu de méfiance en début d’entretien, impressionnées par le magnétophone posé à côté d’elles. Elles ont été très intéressées par le sujet et demandeuses d’informations, elles ont presque toutes posé des questions à l’enquêtrice. – Description des informatrices Les âges : Six femmes ont entre 40 et 49 ans Sept femmes ont entre 50 et 59 ans Six femmes ont entre 60 et 69 ans Une seule femme a moins de 40 ans (32 ans), c’est la fille d’une autre informatrice. À trois occasions, mère et fille étaient présentes. La situation familiale : Presque toutes les femmes interrogées sont mères (17/20), parmi elles, huit femmes vivent en couple (une en concubinage) et neuf vivent seules (six veuves, deux célibataires et une divorcée). Trois femmes sont célibataires sans enfant. Neuf femmes sont grand mères. L’appartenance ethnique : La majorité se définit comme créole (13 /20) parmi elles, quatre se définissent comme « créole cafre » et une comme « créole blanche ». Il y a quatre malbaraises, une malgache, une chinoise et une métropolitaine vivant depuis plus de 10 ans à La Réunion. La religion : La majorité est catholique (14/20), quatre sont hindoues, une est musulmane et une pratique le culte des ancêtres selon la tradition chinoise. L’activité professionnelle : La majorité des informatrices exerce ou a exercé un emploi. Un peu plus de la moitié d’entre elles (9/15) occupe un emploi de service tels que femme de ménage, auxiliaire de vie, serveuse à la cantine, travail dans une pouponnière. Trois sont vendeuses, une est religieuse, et seulement deux femmes ont un emploi qualifié (un agent administratif et une ancienne directrice d’école à la retraite).

Cinq femmes sont sans profession. Le niveau d’éducation : Deux femmes ne sont jamais allées à l’école. La plupart des informatrices ont quitté l’école en primaire (10/20), cinq l’ont quitté au collège. Une des femmes a eu un BEP comptabilité et deux ont eu le baccalauréat. Le lieu de résidence : Les informatrices résident principalement dans le Nord-Est de l’île (St André, St Suzanne), mais aussi à St Denis, et dans une commune du Sud-Ouest (les Avirons). La plupart sont issues du milieu rural correspondant à la population ciblée par la campagne. – Les soins et les relations avec le médecin traitant Parmi la population interviewée, toutes les femmes ont recours à un médecin généraliste et treize sont suivies régulièrement par lui : cinq sont suivies pour la tension, deux pour la tension et le diabète, deux pour le diabète, trois pour la ménopause et une pour le cholestérol. Dans la majorité des cas, le médecin traitant est un homme d’origine métropolitaine d’une cinquantaine d’années. Les informatrices déclarent souvent dans un premier temps qu’elles se sentent à l’aise avec leur médecin ; mais dans un deuxième temps, on constate certaines « craintes » qui s’expriment de la manière suivante : * La peur que le médecin révèle des informations les concernant à l’entourage, du fait qu’il suit en général toute la famille. Par exemple Mme M, malbaraise, ne parle pas de ses problèmes de couple avec son médecin de peur que « ça arrive aux oreilles de la famille » (ent.1). * Dans trois entretiens, en ce qui concerne la pratique du frottis, les informatrices nous disent qu’elles préfèrent le gynécologue ou le médecin de l’AROF, pour plus de professionnalisme ou plus d’anonymat. « Je suis plus à l’aise avec le gynécologue, je sais que c’est son métier … Il faut absolument voir un spécialiste pour ça » (ent.2). « Pourtant je suis bien avec elle, mais je sais qu’un médecin n’a pas beaucoup de temps, je ne veux pas encore l’embêter à perdre son temps » (ent.2). « Nana d’moun y ém pa lo’doktèr, tou sa, a moin non ! si fo alé doktèr, moin télman y’a un ti machin, mi sa va o dokter, moin la pèr d la maladi grav »(ent.12). (Traduction :Il y a des personnes qui n’aiment pas aller chez le docteur, moi au moindre petit signe, je vais chez le docteur, car j’ai peur des maladies graves) – Les comportements de prévention La majorité (16/20) déclare faire des examens biologiques régulièrement (en général tous les 6 mois ou tous les ans), afin de dépister ou de suivre un diabète, de connaître le taux de cholestérol. Parfois elles font un bilan seulement lorsqu’elles ne se sentent pas bien.

La mammographie est largement pratiquée dans l’ensemble de la population étudiée, puisque 14 sur 20 ont fait au moins une mammographie. Beaucoup déclarent avoir eu mal pendant la mammographie, en la comparant au frottis beaucoup moins douloureux. Chez les femmes ménopausées, un tiers seulement bénéficie d’un traitement hormonal substitutif. Les deux tiers des informatrices utilisent des « remèdes pays » comme les tisanes, qui parfois sont utilisées dans un but préventif : « Je bois tout le temps les plantes pour être bien. À base de plantes, c’est bon ; les plantes qu’on sait depuis avant, que maman nous avait indiquées. Voilà pour moi ça, c’est une habitude, il faut que je boive deux ou trois fois par semaine, je prends le romarin. J’ai toujours pris ça, depuis des dizaines d’années, parce que, quand j’étais plus jeune, j’étais toute seule avec les filles, y s’agissait pas de tomber malade, de pas pouvoir travailler. Le médecin, j’y allais jamais. Maintenant je le vois plus régulièrement, parce que je ne travaille plus, j’ai plus de temps … Pour la tension, je bois toujours des z’herbages ». (ent.4) « Dernièrement, j’ai eu la dengue, ben, j’ai soigné mes petits-enfants avec ça, j’ai amené les trois au docteur, mais j’ai donné des z’herbages et mes petits-enfants sont guéris. Ils sont plus guéris avec les z’herbages, que les médicaments docteur » (ent.4). (Traduction : Dernièrement pour la grippe, j’ai amené mes petits-enfants chez le médecin et je les ai soignés aussi avec des tisanes. Les tisanes sont plus efficaces que les médicaments.) Une autre informatrice d’origine malgache utilise la prière comme moyen de prévention : « J’ai une prière que je fais matin et soir, c’est contre toutes les maladies, le cancer etc… Si je prie pas un jour, je suis malade … Pour ne pas sombrer dans l’alcool, dans la drogue, y’a que Dieu et la prière qui nous aident …Sinon on n’arrive pas à surmonter tous les problèmes de la vie » (ent.2). Une femme (ent.19) insiste sur les excès de la médecine moderne : le médecin pour un « petit point » va faire un « tas de bilans » avec des résultats douteux, qui génèrent de l’angoisse. Elle préfère laisser grossir le point pour que le diagnostic soit certain. – Le suivi gynécologique Près d’un quart des informatrices n’ont pas de suivi sur le plan gynécologique. Seules quatre femmes utilisent ou ont utilisé une contraception orale et trois un stérilet. Elles sont suivies, pour la moitié d’entre elles, par un gynécologue. Un quart sont suivies exclusivement par leur médecin généraliste. Une femme est suivie dans un centre de l’AROF. Treize femmes préfèrent êtres suivies sur le plan gynécologique par une femme, quatre informatrices n’ont pas de préférence, et trois préfèrent un homme. « Moin mi préfèr in zinékolog om ké fanm ; avèk in om, on se san ze sé pa koi, in fanm lé parey ke nou » (ent.18). (Traduction : je préfère un gynécologue homme que femme, avec un homme, on se sent je ne sais pas comment, mais une femme, elle est comme nous) « Mi préfèr le tit fanm la, èl iy pran soin, èl démand a ou touzour si ya dé doulèr, si sa fé mal, mé band zom la, lé dur, i atrap a ou kom sa, présé, rantré, fini avèk ». (ent.16) (Traduction : je préfère la petite femme médecin car elle prend soin de vous, elle vous demande si vous avez des douleurs, contrairement aux hommes qui sont plus durs, plus pressés et moins délicats)

« Même si elle est un peu brutale, moi je préfère aller voir la femme docteur au centre, plutôt qu’un bonhomme » (ent.5). Pour une informatrice, c’est l’âge qui détermine son choix pour le médecin : elle se sent plus à l’aise avec un homme de son âge, plutôt qu’avec une femme plus jeune : « Au contraire, j’étais un petit peu plus mal à l’aise avec la femme, elle était plus jeune que moi » (ent.11). 2.5 – Le cancer Les causes : La majorité des informatrices déclare spontanément ne pas connaître les causes exactes des cancers. Après réflexion, elles évoquent différents facteurs : a) Les causes les plus fréquemment citées sont l’alcool et le tabac, plus rarement les épices. Une informatrice dont le mari est décédé du cancer nous dit : « mi pans ke sa vyin in pe de tou, dabor dé problèm, kan moun i boi, i fum , é mi pans ke lé pluto zénétik. Moin mi-pans le kansèr a touzour été la, avan sété in maladi kom tout lé zot, lé moun fésé pa plus avek » (ent.17). (Traduction : je pense que les causes du cancer sont très diverses, je pense surtout à l’alcool et au tabac. Le cancer doit être aussi héréditaire. Il a toujours existé, mais avant il était considéré comme une simple maladie parmi les autres.) b) Quelques femmes évoquent également les soucis personnels, le stress comme facteurs déclenchant le cancer. Ainsi une patiente atteinte du cancer du col nous explique qu’à la suite d’une dispute avec sa fille, elle a eu une hémorragie qui l’a conduite à découvrir son cancer. Bien que sa fille soit impliquée dans ses problèmes, qui selon elle sont à l’origine de sa maladie, elle remercie le bon dieu qu’elles se soient disputées afin qu’on découvre son cancer à temps pour le traiter. c) On retrouve dans plus de la moitié des entretiens, la notion d’origine divine des maladies, et particulièrement du cancer. Cette notion est évoquée, le plus souvent de manière spontanée. « Ça vient de Dieu c’est le destin » (ent.2). « C’est Dieu qui donne la santé, la maladie, la joie et tout » (ent.2). « Avan dèt né, le bon dye li la kré sa pour ou, kont li, vi pe pa batay, fo lès fèr » (ent.17). (Traduction : avant la naissance, Dieu a tracé votre chemin, contre cela vous ne pouvez pas vous battre, il faut vous laisser faire.) Quelques femmes pensent sans l’affirmer, que le cancer pourrait être une punition divine. La moralité chrétienne est souvent présente dans le discours des femmes interrogées. La notion de faute commise et de punition est évoquée surtout pour l’alcool et le tabac, punition qui semble pouvoir frapper également la descendance. « Tout dépend de la vie qu’on mène aussi, j’ai l’impression que si on mène une vie saine, qu’on aime son époux, qu’on va pas voir ailleurs, qu’on passe pas dans des excentricités à tout point de vue, on est moins angoissé que si on mène une vie perturbée…Le stress, ça peut provoquer beaucoup de maladie, aussi » (ent.13). d) Certaines s’interrogent ainsi sur le caractère héréditaire du cancer « Ça suit peut-être les générations ? », et semblent attendre une réponse de l’enquêtrice :

« i di l’kansèr i sui lo famiy ? » (ent.14), (ent.16). (Traduction : certaines personnes disent que le cancer est héréditaire) « J’ai connu des familles à cancer, peut être ça suit les générations, je me pose pas trop de questions là-dessus des fois, mais je dis c’est bizarre, y’a un membre de la famille qui est mort de ça, un deuxième, un troisième, c’est dans le sang peut être, je sais pas, ça doit provenir de quelque chose bien sûr. Une punition ? ça se peut ». (ent.8) e) Trois femmes évoquent, avec un discours passéiste, les excès de la société de consommation à l’origine de nombreuses maladies, comme le cancer. « La cause, c’est les microbes, les aliments, parce qu’avant, on mangeait pas tout ça » (ent.18). « Auparavant, la vie était saine, maintenant nous vivons dans un monde de consommation qui nous abîme, et même si on le sait, et qu’on essaie de faire attention, on se laisse toujours embarquer » (ent.7). « Sè lo mal de la sosyété, sa na l’alkol, zamal, taba, kansèr et sida » (ent.20). (Traduction : ça c’est le mal de la société, il y a l’alcool, le cannabis, le tabac, le cancer et le sida). Les comportements vis-à-vis du cancer : Quatorze femmes connaissent un ou plusieurs cas de cancer dans leur entourage, dont dix concernent le cancer du col de l’utérus. Plusieurs informatrices confirment que le cancer a toujours existé mais auparavant « c’était une maladie comme les autres » (ent.17), dont on ne se préoccupait pas plus que d’une autre : « Avan i ekziste, mè i parl sou d’ot non » (ent.18). (Traduction : avant le cancer existait, mais on lui donnait d’autres noms) Au fil des entretiens, on remarque que le cancer reste un sujet très tabou à La Réunion. Plusieurs informatrices affirment qu’il est souvent dissimulé : on le cache à l’entourage mais même parfois au médecin : « Les créoles, ils ont peur de ça, on préfère pas parler du cancer, si tu connais une personne qui a le cancer, tu vas la voir, mais tu parles pas, par exemple s’il y a plein de monde dans la salle, on évite de parler de ça » (ent.18). « Mè nana d’moun kan lé mor, i di pa sé lo kansèr, y di nan ot soz, i ve pa dir, parfoi sé lo doktèr mèm i ve pa dir pour pa la pèlerine nana langois » (ent.16). (Traduction : Quand on meurt du cancer, on ne dit pas, et l’on ne veut pas dire que c’est le cancer, on dit que c’est autre chose. Parfois, c’est le médecin qui le cache à son patient pour ne pas l’angoisser.) Les croyances fausses à propos du cancer : Nous présenterons les différentes croyances évoquées en commençant par les plus souvent citées : *Plusieurs femmes ayant eu des expériences de cancers dans leur entourage proche, pensent qu’il ne faut pas l’opérer, surtout si le stade est avancé, car cela risque d’accélérer la maladie. « Mi trouv fodrè pa tousé kan i lé la, fo pa opér du moin, mon mari la opéré et li lé parti tro vit » (ent.17). (Traduction : je pense qu’il ne faut pas toucher le cancer quand il est là, du moins ne pas l’opérer, mon mari a été opéré et il est décédé trop vite)

« Si kansèr lé la, fo pa fèr l’opérasyon sansa i agrav i guéri pa, si où lès kom sa mèm, i va trèn in an ou tèt de , si ou rouv : si moi kom sa » (ent.18). (Traduction : il ne faut pas opérer le cancer car ça l’aggrave et ça ne le guérit pas : sans traitement, la personne va vivre encore un ou deux ans, en cas d’opération, elle ne vivra que six mois.) *D’autres femmes évoquent plus globalement le risque de propagation du cancer en cas d’investigations et de traitement : « Mi antand moun i di, lo kansèr fo pa tous, fo lès la, fo pa fér dé réyon, sé la mèm ki komans a propazé » (ent.14). (Traduction : j’entends certaines personnes dire qu’il ne faut pas toucher le cancer, ne pas faire de prélèvements, de radiothérapie car c’est comme cela qu’il se généralise) *Une informatrice pense que traiter le cancer trop tôt, ça peut favoriser sa généralisation : « Mè, na dé foi kan ou pran a tan, sa i propaz plu vit osi, mi pe dir a ou kom sa, ke si nana in rasin, fo anlev a èl avèk , aprè bin ou trouv lo rasin ou ? Zamè ou pe pa trouv a èl » (ent.16). (Traduction : Parfois quand on traite le cancer trop tôt il se généralise plus vite, car on enlève le cancer sans sa racine, alors on ne peut plus la retrouver) *Certaines de ces informatrices nous expliquent que parler du cancer, c’est l’attirer sur soi, et que le cancer, pour certains créoles, est contagieux : «Mi pans pa lo bon dye va punir su in maladi kom sa, pétèt a fors ou pans a la maladi, ou pe gang sa, ou voi, tou d’in cou » (ent.16). (Traduction : Je ne pense pas que Dieu puisse punir quelqu’un par une maladie comme le cancer, par contre si on pense trop à cette maladie, on peut alors l’attraper soudainement) « Nana do moun na pèr : si par epsampl nana in kelkin i na kansèr, i di « moin, mi frékant pu li», pour pa atrap , i fo pa frékant , lo moun va pa dir pour gard sa an secrè ». (ent.18) (Traduction : Certains ont peur : si une personne a le cancer alors ils ne la fréquentent plus pour ne pas l’attraper à leur tour…Ainsi les gens atteints ne le disent pas et le gardent en secret) *Aucune informatrice ne nous parle spontanément de rapport entre le cancer et la sorcellerie. Lorsque nous leur demandons si le cancer est une maladie « arrangée », le résultat d’un mauvais sort, les informatrices nous répondent que « des gens pensent comme ça » mais qu’elles n’y adhèrent pas. « Moin-mèm mi konè pa, mi kroi pa tro gran soz » (ent.17). (Traduction : moi je ne sais pas et je ne crois pas à grand chose) « Y’a des gens, qui, au nom de la religion peuvent faire n’importe quoi, et penser n’importe quoi, que c’est certainement le voisin qui a dû faire tout pour que, etc…À La Réunion, les gens sont crédules, sont croyants, et sont innocents entre parenthèses, naïfs…Là-dessus je suis nette, si quelqu’un est malade, c’est scientifiquement prouvé, c’est pas quelqu’un d’en haut ou d’en bas qui aurait mis quelque chose, quand même ! Malheureusement, y’a beaucoup de gens qui croient encore à la sorcellerie, l’envoûtement » (ent.13). *Une femme est persuadée que le cancer ne peut pas être guéri, que les médicaments ne servent qu’à aider l’organisme à supporter la maladie. 2.6 – Les maladies « d’en bas» Les connaissances des informatrices dans ce domaine semblent limitées. Quand on évoque les maladies d’en bas, on constate que la pudeur et la moralité chrétienne sont fortement présentes : « Y’a pas d’âge pour le frottis, tout dépend de ce que l’on ressent en soi. Moi je connais une fille de 30 ans qui est obligée de faire un frottis parce qu’elle a des problèmes. Elle souffre du

bas-ventre, elle a des partenaires et tout, bon, et donc pas dire qu’elle est obligée, mais elle devrait faire souvent parce qu’elle a des douleurs. C’est pas normal qu’elle puisse saigner quand il faut pas, qu’elle puisse avoir des pertes blanches, en fait des trucs bizarres, quoi, que moi je connais pas » (ent.13). Le sida est cité de façon spontanée dans un peu plus de la moitié des entretiens, il apparaît souvent comme une nouvelle maladie interprétée comme une punition divine des excès de la société moderne. « Le monde est trop libre, c’est comme le sida, c’est le bon Dieu qui a fait ça, c’est une punition » (ent.18), « Le sida, c’est une preuve d’infidélité » (ent.19). Seules 10 femmes dans la population étudiée parlent de leurs problèmes intimes avec leur entourage, plutôt avec la famille, plus rarement avec les amis ou avec des voisins : « Vous savez le Créole c’est chacun pour soi, on s’occupe pas des affaires des autres, on reste chez soi, si on est malade, on rend service l’un et l’autre mais après… » (ent.4). « Mi parl, mè nana moun i parl pa, zot la ont » (ent.16). (Traduction : Moi j’en parle, mais il y a des gens qui n’en parlent pas parce qu’ils ont honte). « Si moin diskut èk in voisin pour ke re sa va dan zoreille sot voisin, sa pa mon zenr…mi kzs pa d’sa èk mon bonom, ni èk mon garson, nu nana poin le soi ! Mi préfèr gard sa pou moin tou sèl » (ent.1). (Traduction : En parler avec un voisin pour qu’il le répète à un autre, ce n'est pas mon genre ; même avec mon mari et mes garçons, je n’en parle pas, je n’ai pas le choix, je préfère garder ça pour moi toute seule) À l’inverse Mme B (ent.7) nous dit qu’elle trouve important de pouvoir parler des problèmes intimes avec son entourage pour avoir des conseils ou « dédramatiser ». Elle connaît une dame morte d’un cancer du col non dépisté parce qu’elle n’avait pas osé parler de ses douleurs, sans doute par honte. 2.7 – Le cancer du col de l’utérus Les causes Les informatrices ont une opinion partagée à propos de la relation qu’il pourrait y avoir entre ce type de cancer et le comportement sexuel de la personne atteinte : *Pour celles qui pensent qu’il y a une relation, l’argument principal est la multiplicité des partenaires, la vie excentrique voire le stress. « Peut-être la bringuerie, quand on a une vie excessive, c’est là qu’on cherche, les prostituées, tout ça » (ent.18). (Traduction : c’est peut-être la débauche, quand on a une vie excessive, c’est là qu’on prend des risques comme les prostituées entre autres) « Ça, c’est la mauvaise fréquentation » (ent.18). « Certains vont dire que cette femme-là, elle avait une mauvaise vie. Surtout si elle a attrapé une maladie à l’utérus, on peut penser à autre chose déjà…» (ent.18). « Si un fanm i kour droit gos, tou sa, mi di pétèt i parvyin dsa, anfin mi pans, moin mi konè pa » (ent.12). (Traduction : si une femme fréquente plusieurs partenaires, je pense cela peut venir de là, je ne sais pas.) *Les autres insistent sur le fait que cette maladie peut arriver à tout le monde et qu’elle peut évoluer en silence d’où l’intérêt du dépistage.

On retrouve, chez un peu plus de la moitié des femmes interrogées, un discours passéiste : « Avant elles respectaient leurs maris, elles couraient pas à droite, à gauche, elles étaient plus fidèles, elles n’avaient pas de sous pour aller chez le gynécologue » (ent.18). Une informatrice qui évoque d’abord une possible relation entre le cancer du col et le comportement sexuel, s’interroge sur le fait qu’une religieuse soit décédée de ce cancer : « Y’a une jeune religieuse qui est morte du cancer du col de l’utérus, ça doit pas choisir les filles » (ent.8). On retrouve également dans plusieurs entretiens, la notion de mauvaise hygiène intime comme facteur favorisant ce cancer : « Peut-être c’est la façon de faire la toilette, non ? Faut bien laver» (ent.16). « Le produit de bain, pas le savon, mais avec le pH, j’sais pas quoi là » (ent.6). « Le manque d’hygiène, ça doit jouer un rôle comme dans les autres maladies» (ent.8). Les autres causes citées sont plus générales :l’alcool et le tabac. Une informatrice évoque l’inflammation et les épices : « c’est peut-être celui qui mange beaucoup des épices, c’est l’inflammation, j’sais pas moi » (ent.11). Une autre évoque un germe : « Mêmes des femmes qui n’ont point d’enfant, elles ont un cancer de l’utérus, donc c’est pas la sexualité alors ! Donc c’est, j’sais pas moi, un germe dedans ? » (ent.18). Quelques informatrices n’ont pas d’idée pour expliquer les causes de ce cancer. Les signes : C’est principalement les femmes qui connaissent un cas de cancer du col de l’utérus dans leur entourage proche qui citent certains signes comme les saignements, les pertes abondantes ou bien une douleur « de plus en plus intense qui gène les rapports » (ent.13). La plupart des informatrices ne se prononce pas. Les comportements vis-à-vis du cancer de l’utérus. Toutes les femmes qui nous disent avoir rencontré un cas de cancer de l’utérus dans leur entourage font le frottis régulièrement. Ce cancer, encore plus que les autres, semble être caché, on n’en parle pas, ou bien on utilise des mots détournés : « Le cancer de l’utérus, on n’ose pas m’en parler, on va me dire qu’on souffre du bas-ventre, qu’on a fait des examens, je ne demande pas lesquels » (ent.13). « Elle avait honte de dire à ses enfants, de dire au médecin qu’elle avait des douleurs toujours dans l’utérus, et pis ça s’est aggravé, et c’était trop tard » (ent.2). – L’expérience du frottis Dans les entretiens, on retrouve cinq femmes qui n’ont jamais été dépistées et deux qui n’ont eu qu’un seul frottis. Une femme nous dit avoir fait trois frottis au total, et les autres déclarent le faire faire régulièrement, au maximum tous les trois ans.

Pour la majorité des femmes à qui on en a déjà fait, le frottis est un examen simple, non douloureux, vite fait. Elles le considèrent comme un examen important, nécessaire, elles en connaissent le rôle et les modalités d’exécution. Elles savent à quelle fréquence et à quel âge il faut le faire pratiquer. Néanmoins il est considéré comme un peu gênant pour la moitié d’entre elles. Pour les femmes qui ont rarement fait faire un frottis, l’expérience est plutôt négative : la honte vient au premier plan (ent.1). « Moin, kan mi sa va, mi pran mon sak pou met sur mon zie, kom sa mi woi pa, moin la ont ». (Traduction : quand je vais faire le frottis, je prends mon sac pour me le mettre devant mes yeux, comme ça je ne vois pas ce qu’il se passe car j’ai honte) La douleur ne semble pas être un obstacle car une seule femme déclare avoir eu mal lors du frottis, on constate plutôt une forte appréhension. « Le frottis, c’est dans la tête que ça fait mal, du moment qu’on touche les parties intimes, on a l’impression que ça va faire mal, c’est une partie très sensible » (ent.13). Pour l’ensemble des femmes, la peur du résultat semble être un point essentiel puisque la moitié des informatrices l’évoque de façon spontanée. « C’est pas l’examen qui m’inquiète, c’est surtout les résultats …Je stresse jusqu’au résultat c’est la même chose pour la mammographie » (ent.2). « Ça n’empêche pas que mes mains tremblent quand je vais chercher les résultats » (ent.8). Environ trois quarts des informatrices déclarent spontanément avoir été informées sur le frottis par les médias. – Les réticences face au frottis La pudeur : Le sentiment de pudeur est évoqué par toutes les femmes, mais il apparaît plus nettement dans dix entretiens. Ces informatrices évoquent également une très forte pudeur chez leurs parents. Elles se plaignent souvent d’une éducation trop stricte dénuée d’éducation sexuelle. Ce sentiment de pudeur perdure chez elles, mais s’est néanmoins atténué : « Ankor a stèr , mi trouv nou ariv a cozé, mè avan lété in sujè tabou, ryin, nou parl mèm pa lé règl. Moin è navé trèz an, kan mé règ té arrive, mi konpran mèm pa koi i lé, aprè ma voisine la esplik a moin été in soz lé normal pi li apel mon manman. koméla, nou ariv a racont a manman in ti bétiz dvan le, pou fèr rir a èl , mè, aèk popo falè pa ryin ou di d’ travèr, in ! » (ent.17). (Traduction : maintenant, je trouve qu’on arrive à en parler, avant c’était un sujet tabou, on ne parlait même pas des règles. Quand mes règles sont arrivées, à l’âge de treize ans, je ne savais pas ce que c’était. C’est ma voisine, deux mois après, qui m’a expliqué que c’était normal et qui l’a dit à maman. Maintenant, on arrive à plaisanter un petit peu avec ça, devant elle pour la faire rire, mais avec papa, il ne fallait rien dire de travers) « On a grandi à notre façon à nous, très stricte, le respect, quoi ! » (ent.4). « C’est vrai pour un accouchement hein, on est un petit peu obligée de voir le médecin, elles savent bien que le médecin est là pour ça, tandis que là, aller d’elles-mêmes voir le gynécologue qui va quand même refaire les mêmes gestes de l’accouchement, faire le toucher et tout ça, alors elles se sentent un peu gênées. C’est pour ça que quand le médecin est une femme, c’est plus facile, beaucoup plus facile » (ent.5).

Ainsi, on retrouve dans deux des trois entretiens où la fille de l’informatrice est présente, un clivage entre les générations : la mère n’a jamais eu de frottis malgré l’incitation constante de sa fille, qui le fait pratiquer régulièrement. Par ailleurs, une informatrice nous explique qu’elle a changé de médecin par pudeur : à la suite d’une visite de la médecine du travail, elle s’est sentie obligée de faire faire son premier frottis par un médecin homme; elle a ensuite choisi une femme. Le sentiment de ne pas être concernée par le frottis Cet argument est constant chez les femmes faisant faire peu ou pas de frottis. Il peut s’exprimer par : *Un certain déni de l’intérêt du dépistage : La fille d’une informatrice nous déclare concernant sa mère : « Elle a toujours pensé que ça ne la concernait pas ; elle ne connaît rien du cancer et ne semble pas intéressée d’en parler. De toutes façons, elle pense que tant qu’on sent rien, que tout va bien, c’est qu’on est en bonne santé » (ent.7). *Des croyances fausses : La phrase : « Je n’ai connu qu’un homme donc je ne suis pas concernée », est la plus retrouvée : six informatrices l’ont citée, : « Je n’ai jamais connu d’homme à part mon mari, j’ai l’impression qu’on était sains tous les deux …J’ai jamais refait le frottis, et pis si je m’étais sentie quelque peu malade, si j’avais un problème ou quoi, certainement j’en aurais fait, mais au contraire ça marchait bien » (ent.13). « Kan zot i ariv dann zot az la, i pans zot na poin dot bonom, zot navé ryin kèn partnèr, zot i voi pa lutilité, si zot’navè ket soz a gangné, zot norè gangné depui avan, pa an dèrnié » (ent.17). (Traduction : Arrivées à leur âge, elles doivent se dire qu’elles n’ont pas eu d’autre homme dans leur vie, elles n’ont eu qu’un seul partenaire et ne voient pas l’utilité du frottis. Si elles avaient dû attraper quelque chose, elles l’auraient attrapé plus tôt). La croyance selon laquelle « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade » est retrouvée chez cinq informatrices. D’autres croyances sont plus anecdotiques : - Les femmes ne seraient plus concernées par le frottis après la ménopause. « Les gens pensent qu’après les règles, c’est fini, y’a plus de problème » (ent.18). « Une fois le docteur chinois m’a dit que je devais faire un frottis, mais comme je suis ménopausée depuis longtemps, je lui ai dit que sûrement c’était pas la peine » (ent.20). - Certaines femmes pensent que le frottis ne sert pas uniquement à dépister le cancer, mais également d’autres maladies. Une informatrice pense qu’il serait nécessaire lors de la grossesse pour la santé de l’enfant : « Si mi fè in zanfan dann nef moi, y fo ke mon’zanfan i soy byin portan » (ent.19). (Traduction : Si je fais un enfant dans 9 mois, il faut qu’il soit en bonne santé.) - Une informatrice répond qu’elle se sent protégée car elle est suivie sur le plan biologique : « Mon docteur m’a fait des prises de sang, il me dit que j’ai rien » (ent.4). La peur de savoir :

La moitié des femmes interrogées déclare avoir peur du résultat du frottis et trouve l’attente très angoissante. Pour une informatrice c’est la peur de savoir qui l’empêche de faire son frottis : « Moin la pèr, mi préfèr pa ryin savoir, si mi konè , mi kroi mi pe mourir pi vitman ankor …Voila, sé sa, moin la pèr du rézulta, aprè mi vivra aèk sa… La, la mi kroi mi s’ra malad ; si zamè mi konè klé anndan, mi gangn kèt soz, bin la lé sur, mi s’ra malad, akoz mi vivra tou lé jour aèk sa, mi s’ra strésé ;sé a koz d’sa mi kroi mi ve pa ryin savoir… » (ent.4). (Traduction : j’ai peur, je préfère ne pas le savoir, car si je le savais, je crois que je mourrais plus vite. J’ai peur du résultat car si je sais que j’ai quelque chose à l’intérieur, c’est là que je serais vraiment malade. Je vivrais tous les jours avec ça, je serais stressée. C’est pour cela que je ne veux pas le savoir) La peur du geste : Les informatrices évoquent une forte appréhension par rapport à la réalisation du frottis, qu’elles considèrent finalement comme injustifiée lorsqu’elles en font l’expérience. Cette appréhension est surtout liée à la crainte de la douleur : « Comme avant une piqûre » (ent.13). La non-prescription par le médecin : Aucune informatrice ne déclare ne pas faire le frottis parce que son médecin ne lui a pas proposé, par contre on retrouve à plusieurs reprises cet argument pour justifier l’absence de pratique de la mammographie. La négligence : Chez quelques informatrices, la négligence semble plutôt liée à des raisons personnelles pour ne pas pratiquer le frottis. Elle est souvent associée à la fatalité : « Oui, plusieurs fois on m’a envoyée faire frottis à la médecine du travail, pis tout le temps remettre à demain, à demain et pis après c’est plus nécessaire quoi ! » (ent.3). « Y’a des gens qui s’en foutent, qui se laissent aller, c’est le destin, c’est le bon dieu qui nous donne ça, alors faut accepter, faut pas chercher ailleurs » (ent.18). Les difficultés matérielles : Ces conditions particulières sont souvent évoquées pour justifier l’attitude des femmes dans le passé, les principales citées sont le manque de temps dû au travail à l’extérieur mais aussi au travail à accomplir à la maison et la charge des enfants à assumer : « Une fois je crois, j’avais pris rendez-vous chez une gynéco pour faire un examen et un frottis, mais j’ai pas pu y aller, il n’y avait personne pour tenir la boutique ce jour-là…. Alors j’ai pas pu y aller et puis ensuite, j’ai pas pris rendez-vous… » (ent.20). En fait cette femme parlait aussi de négligence de sa part, cet exemple n’était qu’un prétexte. Le manque d’argent est évoqué à une reprise : « Avant, elles n’avaient pas de sous pour aller chez le gynécologue » (ent.18). Rôle du conjoint : Dans quelques cas, on constate que le mari peut être un frein au dépistage, soit en interdisant à sa femme d’aller chez le gynécologue, soit en l’accompagnant chez le médecin, ce qui limite les échanges.

«Nana d’moun osi, sé lbonom li défand leur fanmm, aèl i pe pa alé sé zinékolog, dé foi i di kli fé son zalou, ou si le froti lé oblizé, i fo li acompagn aèl » (ent.18). (Traduction : Parfois c’est le mari qui ne veut pas que sa femme aille chez le gynécologue, car il est jaloux, ou bien si le frottis est vraiment nécessaire, il l’accompagne) « Sur la fin, moi-même je voulais prendre la pilule, mais mon mari ne voulait pas » (ent.12). On peut remarquer également la pudeur au sein même du couple, une informatrice nous explique en parlant du comportement de son compagnon vis-à-vis du frottis : «Il comprend, il pose pas trop de question là-dessus, il demande si c’est bon le résultat, si tout va bien » (ent.2). À deux reprises, les informatrices nous ont confié de grandes difficultés relationnelles avec leur mari.

3. Analyse des résultats – La relation avec le médecin et les comportements de prévention L’existence d’un suivi médical et la confiance envers le médecin sont essentielles pour la pratique régulière du dépistage. Les femmes qui font régulièrement le frottis sont presque toutes suivies habituellement par leur médecin traitant. Dans ce groupe, la relation médecin patient est souvent une relation de confiance. Parmi les femmes réticentes à la pratique du frottis, plus de la moitié n’est pas suivie régulièrement. Un manque de confiance envers le médecin traitant est nettement plus présent dans le discours de ces femmes. Certaines ont peur que leur médecin de famille révèle à l’entourage des informations les concernant. L’importance accordée à la peur de la révélation de problèmes personnels, peut être considérée comme une particularité locale. Plusieurs facteurs nous permettent de l’expliquer : *La réticence à se confier aux autres coexiste localement avec le fréquent repli sur soi et l’habitude répandue de ne pas se mêler des affaires des autres, pour éviter d’attirer le malheur ou la malveillance d’autrui19. En ce qui concerne la santé, c’est un moyen de se protéger puisque selon la logique populaire encore prévalente à La Réunion : moins on se dévoile « aux autres », moins on est vulnérable par rapport à d’éventuelles malchances. Cette réticence à se confier se manifeste vis-à-vis de l’entourage mais surtout au sein même de la famille. Ainsi, le médecin de famille, voire du quartier est parfois perçu comme dangereux parce qu’il représenterait un éventuel vecteur d’informations. C’est une des raisons qui conduit l’informatrice à consulter le spécialiste dans une démarche qu’elle estime plus anonyme. *La méfiance envers l’étranger, qui est bien ancrée dans la culture réunionnaise20, se retrouve également dans la relation avec le médecin le plus souvent originaire de la Métropole (appelé en créole « doktèr zoreil »). *Le recours à d’autres interlocuteurs privilégiés qu’ils soient religieux ou guérisseurs. On constate cependant que malgré leur réticence à la pratique du frottis, la moitié de ce groupe de femmes a un suivi biologique, même si celui-ci n’est pas toujours très régulier. On peut ainsi considérer que ces femmes adhèrent en partie au principe de prévention biomédicale de certaines maladies graves. Ce pas vers la bio-médecine n’empêche pas deux tiers des informatrices d’avoir recours à la médecine traditionnelle, en particulier à la phytothérapie qui est la pratique de soins la plus banale et la plus répandue sur l’île. Elles expliquent qu’elles préparent elles-mêmes les tisanes médicinales, utilisées soit en prévention pour conserver un bon équilibre de santé, soit de manière curative. Les autres facettes de la médecine populaire réunionnaise n’ont pas été abordées par les personnes interrogées lors des entretiens.
19 ANDOCHE J. : L’interprétation de la maladie et de la guérison à l’île de la Réunion. Paris : Sciences sociales et santé, 1988, 6 (3 - 4 ) : p145 à 165. 20 BENOIST J. :Anthropologie médicale en société créole. Paris : Les champs de la santé, 1993.

Aucune informatrice n’a par exemple fait référence aux tisaneurs, aux guérisseurs ou aux leveurs de sort (appelés parfois « grat ti bois » en créole). Les pratiques de sorcellerie sont connues des informatrices, mais aucune ne reconnaît y adhérer. Cela n’est pas étonnant car parler de sorcellerie à La Réunion comme ailleurs21 est un comportement risqué pour soi et pour les siens. – Le suivi gynécologique À La Réunion, le médecin traitant assure ce suivi plus souvent qu’en métropole, il dépiste proportionnellement plus de cancers du col que le médecin généraliste métropolitain22, ceci s’explique, comme nous l’avons vu précédemment par la plus faible densité de spécialistes à La Réunion. Dans le choix du praticien qui réalise le frottis, l’importance attachée au sexe du médecin varie d’une catégorie d’informatrices à l’autre : Les plus réticentes préfèrent toutes que leur médecin spécialiste soit une femme, exprimant ici leur grande pudeur vis-à-vis de leur nudité et de leur vie intime. Mais parmi les autres : un tiers préfère un médecin femme, un tiers préfère un médecin homme et un tiers n’a pas de préférence. Ainsi, l’idée reçue que la pratique du dépistage est freinée si le médecin est un homme, n’est qu’en partie vraie. D’ailleurs, la thèse intitulée « Le médecin généraliste et le dépistage du cancer du col à La Réunion » de P.SNEED en 1999, renforce cette hypothèse puisque l’auteur constate qu’il n’y a en réalité pas de différence entre le nombre de frottis faits par les médecins de sexe masculin et ceux réalisés par des femmes médecins. L’âge du médecin ne semble pas non plus être un facteur déterminant dans les réticences face au frottis chez les femmes interrogées ici puisqu’une seule a déclaré être gênée par la jeunesse relative de son médecin qu’elle compare à son « garson ». Il faut préciser que dans beaucoup de familles réunionnaises encore, la promiscuité d’un habitat précaire, les conceptions traditionnelles sur les rapports intergénérationnels et sur la différenciation sexuelle des rôles sociaux ou la morale chrétienne obligent à une certaine vigilance entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les jeunes et leurs aînés. La représentation du cancer La représentation chez la femme réunionnaise : C’est une maladie difficile à se représenter car elle est longtemps asymptomatique, et son étiologie reste mystérieuse pour la population générale. Penser à se prémunir contre une maladie que l’on a du mal à se représenter est encore plus délicat.
21 FAVRET-SAADA J. : Les mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage Paris : Gallimard, 1977. 22 SNEED P. : Enquête auprès des médecins généralistes sur leur comportement face au frottis. Th. : Méd. : Bordeaux 2 : 1999 ; 36.

D’une manière générale, il apparaît que dans le contexte local, la notion de « maladie » n’existe qu’à partir du moment où l’on en ressent des signes considérés comme « anormaux »23 et gênants pour le quotidien. Pour des maladies comme l’HTA ou le diabète24, on constate que souvent le patient réunionnais ne croit pas à la réalité de la maladie « silencieuse » dont on le dit atteint. De même, certains patients stoppent brutalement le traitement prescrit à long terme car ils sont persuadés d’aller mieux et que la maladie a disparu, alors qu’il s’agit d’une pathologie chronique. Ainsi, dans la représentation de la maladie à La Réunion, la prévention interviendrait davantage comme le moyen d’empêcher l’aggravation d’un mal dont on commence à ressentir les premiers effets. L’approche populaire de la prévention est par conséquent différente de la notion biomédicale de prévention. Le cancer est une maladie qui fait peur, car elle apparaît incurable, parfois contagieuse, souvent d’étiologie complexe et obscure. Même en présence de facteurs de risque, la médecine ne peut expliquer l’atteinte individuelle de cette maladie : « Mon voisin fume plus que moi, et il n’a pas attrapé le cancer ! ». Pourtant les malades ont le plus souvent besoin de répondre à des questions fondamentales pour eux, telles que : Qu’est-ce qui m’arrive? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? etc… Devant l’absence de réponses médicales, il est fréquent que les patients se tournent vers la religion. Ils considèrent alors que leur Dieu est le tout puissant maître de la vie et de la destinée humaine et ils sont persuadés que c’est un niveau d’excellence que la médecine des hommes n’est pas prête d’atteindre. Le malade attend de la religion qu’elle lui fournisse la cause du malheur qui le frappe et un secours pour supporter cette épreuve souvent perçue comme « rédemptrice » pour le pêcheur ou « transcendante » pour celui qui veut se rapprocher du (es) Dieu (x). On retrouve dans la moitié des entretiens, la notion d’origine divine des maladies, et particulièrement du cancer. Cette notion est évoquée, le plus souvent de manière spontanée, c’est vraisemblablement dû au fait que la médecine n’en explique pas la cause. Néanmoins, on remarque que cette cause est presque absente du discours des femmes qui n’ont pas eu de frottis. Ce n’est que lors d’un deuxième entretien que ces informatrices en parlent comme s’il s’agissait d’une confidence profonde que seul un climat de confiance peut susciter. Plusieurs informatrices nous ont confirmé que pour certaines personnes, parler du cancer faisait courir le risque de l’attirer sur soi. On constate que les femmes les plus réticentes ne donnent pas d’explication de leurs comportements, qu’elles s’opposent en bloc aux principes de prévention de la médecine moderne. Elles craignent aussi l’engrenage dans lequel la découverte d’un résultat anormal les ferait tomber (ent.4 et 20) : hyper médicalisation, désorganisation de leur vie en cas de diagnostic de cancer. On suppose donc qu’elles se protègent du cancer en évitant d’en parler.
23 G. CANGUILHEM (1966) montre que la définition du « normal » et du « pathologique » est déterminée par des conceptions culturelles variables d’une société à l’autre. Le normal et le pathologique, Paris : PUF, 1966. 24 RODDIER M. : Le diabète, entre culture et santé publique. Approche anthropologique des représentations du diabète de type 2 à La Réunion. Th. D. : Anthro. : La Réunion : 1999 ; 65.

Lors d’un premier entretien, on constate que les femmes les plus réticentes ne connaissent généralement pas de cas de cancer dans leur entourage, en particulier d’atteinte par le cancer du col de l’utérus. L’expérience lorsqu’elle existe pourtant n’est souvent « dévoilée » que dans un deuxième temps, lors d’entretiens complémentaires, confortant l’hypothèse d’une tentative de « mise à distance » du cancer par évitement, en n’y faisant pas allusion. Une autre hypothèse peut être avancée, celle d’un « état caché » par la personne même qui en est atteinte notamment parce qu’elle craindrait d’être suspectée de contagion et rejetée. Si cette hypothèse était vérifiée, ce que ce travail ne nous permet pas d’affirmer, elle pourrait expliquer pourquoi certaines femmes interrogées n’ont pas connaissance de cas de cancer autour d’elles. Ces deux idées sous-tendent que la représentation du cancer à La Réunion pourrait être marquée par l’évitement ou le secret, selon que l’on ait la position du « sujet à risque » ou de la « personne contaminante ». Il faut souligner, qu’une fois encore, ces notions populaires sont assez éloignées de celles de la bio-médecine, sur lesquelles s’appuient pourtant le discours médical tenu dans la relation de soin. Il n’est pas étonnant alors que quelquefois cette relation soit en réalité un « colloque singulier ». En outre, cette représentation traditionnelle se caractériserait aussi par le pouvoir particulier attribué à la parole, rappelons que la société réunionnaise a pour fondement l’oralité au travers du créole. Ce danger de la médisance par la parole transparaît notamment dans l’expression locale « la bous cabri », qui illustre le caractère néfaste d’une parole génératrice de malchance et émise dans le cadre des relations sociales25. Il faut ajouter à ce constat d’un certain « tabou » sur le cancer en général, la place particulière du cancer du col de l’utérus qui, dans la pensée populaire, renvoie à la sexualité, au rapport à la partie du corps féminin la plus symbolique et à la pudeur de l’intime. De plus, I. STOJCIC dans sa thèse en 199426, montre que l’intérieur du corps est mal appréhendé par beaucoup de Réunionnais qui ignorent l’anatomie et la physiologie de leurs organes. Du point de vue de la prévention, on peut donc penser que le non-dit et la conduite d’évitement représentent peut-être le frein le plus important du dépistage du cancer du col à La Réunion. Le discours du médecin traitant sur le cancer : Il est intéressant de noter que la gêne et le non-dit que l’on retrouve chez les patientes vis-à-vis du cancer existent également chez la plupart des médecins27. Ce constat pourrait s’expliquer par différentes raisons, mais probablement d’abord par le fait que la médecine n’étant pas toujours capable de guérir cette maladie, le médecin a un certain sentiment d’échec ou d’insatisfaction par rapport à son rôle professionnel. Une autre raison tiendrait au fait que l’annonce du diagnostic de cancer à un patient est une démarche difficile à laquelle le médecin n’est généralement pas préparé car cette question est peu abordée dans les études médicales. Il s’agit donc le plus souvent d’une approche très
25 Cf Andoche 26 STOJCIC I. : La représentation du corps à l’île de la Réunion. Th. D. : Anthro. : Bordeaux 2 : 1994 ; 56 27 Cf Sneed

variable suivant la personnalité du médecin et l’expérience que celui-ci a pu accumuler au cours de sa pratique professionnelle. Par ailleurs, il faut souligner que le discours médical sur le cancer qui est tenu au patient n’a généralement pas pour objectifs premiers de répondre aux questions que ce dernier se pose face à la révélation de son atteinte. Or nous avons exposé précédemment les caractéristiques de la représentation sociale de la maladie comme le cancer, marquée par plusieurs questions cruciales pour le patient, par son hésitation à croire en la réalité pathologique asymptomatique, par l’effort qu’il doit faire pour comprendre la chronicité. Le trouble ou le silence de certains médecins sont vraisemblablement une cause supplémentaire d’évitement du sujet par leurs patients, parmi lesquels beaucoup attribuent encore largement au médecin « l’aura du savoir ». Le non-dit de part et d’autre crée une situation néfaste pour l’abord de la prévention du cancer. Les fausses croyances populaires sur le cancer Beaucoup d’informatrices pensent que le cancer ne peut pas guérir, ou que la prise en charge et le traitement sont préjudiciables à son pronostic. Lorsque le cancer est diagnostiqué tardivement, une évolution fatale survient au cours de sa prise en charge thérapeutique. Cette dernière est alors interprétée comme la cause de l’aggravation du cancer. De manière paradoxale, le traitement médical est perçu plus dangereux que le mal. Le cancer est parfois assimilé à quelque chose qui pousse dans le corps. On constate l’usage de plusieurs analogies végétales pour désigner les processus pathologiques. Par exemple, une femme nous parle de la « racine » du cancer qui se trouve dans le corps, qu’il faut absolument enlever avec le cancer pour être guéri. Cette représentation « naturaliste » et « extractive » n’est pas très surprenante dans une société au fondement agricole, dominée dans le passé par les plantations et peuplée à l’origine par des cultivateurs malgaches, africains ou indiens et des Chinois venus pour la plupart de la région rurale de Canton. . 3.4 Les maladies « d’en bas» : D’après la thèse sur la représentation du corps à la Réunion écrite par I. STOJCIC en 1994, l’intérieur du corps reste mal connu contrairement à l’extérieur dont les parties sont bien désignées : « Les connexions des organes entre eux sont totalement méconnues ou alors analysées de manière très fantaisiste par rapport aux données classiques de l’anatomie et de la physiologie ». On constate un manque de connaissances plus ou moins important concernant les maladies de l’appareil génital féminin, nommées en créole : les « maladies d’en bas » et notamment au sujet du cancer du col de l’utérus. Beaucoup d’informatrices n’en disent rien ou font état d’affirmations erronées, qu’elles tiennent pour vraies avec conviction.

Cependant, il est à noter que presque toutes les femmes ont posé des questions au cours des entretiens, cela montre une demande importante d’informations et un certain intérêt de la part des femmes à ce sujet. Le cancer du col de l’utérus est un sujet abordé avec réserves par les femmes interrogées probablement pour deux raisons principales : la peur que le cancer suscite d’une part et, d’autre part, la référence à la sexualité qu’elles associent systématiquement à cette affection et qui gêne beaucoup d’informatrices pour parler sans honte de ce type de cancer et le considérer seulement d’un point de vue de santé et de prévention. 3.5 L’expérience du frottis Toutes les femmes qui n’ont eu que quelques frottis, ont une représentation plutôt négative du geste médical. Toutes évoquent la gêne pudique ressentie au moment du prélèvement nécessitant une dénudation et une position inconfortable. De plus une fréquente appréhension d’une douleur quelconque au premier dépistage, puis de la découverte d’une pathologie ensuite, augmente le stress de la plupart des patientes. Au cours des entretiens, on constate l’intérêt et les effets favorables des campagnes de dépistage, puisque près d’un quart des enquêtées déclarent avoir été informées de la possibilité du dépistage du cancer du col de l’utérus par les médias. Il faut souligner que cette déclaration est le plus souvent spontanée. Ce constat est confirmé par les résultats de l’étude menée par la société « Louis Harris » sur l’impact de la dernière campagne locale. Dans l’ensemble les informatrices ont une bonne connaissance des modalités pratiques du frottis : l’âge des femmes concernées par le frottis et sa simplicité sont des notions bien intégrées. Par contre elles surestiment la fréquence à laquelle le frottis doit être pratiqué puisque plus de la moitié des femmes suivies régulièrement, font le dépistage tous les deux ans. Cette surestimation est retrouvée également dans l’étude « Louis Harris ». 3.6 Les réticences face au frottis Nous avons essayé de classer ces réticences en catégories distinctes suivant leur principale cause : La pudeur On constate que la pudeur est très présente dans le discours de toutes les femmes qui n’ont encore jamais eu de frottis et chez celles qui en ont rarement eu un. Cette notion apparaît également chez un peu moins de la moitié de celles qui ont eu régulièrement un frottis. Au total chez près de deux tiers de l’effectif des femmes interrogées, un des freins au dépistage du cancer du col de l’utérus par le frottis est la pudeur qui les retient d’accepter le geste médical. Cette pudeur est également à l’origine du mauvais vécu du frottis que l’on retrouve dans presque la moitié des entretiens.

La volonté de dissimulation de sa nudité et de son intimité est très présente dans la société réunionnaise où la moralité catholique imprègne encore largement les mentalités28. Le refus d’adhérer à la société moderne Chez les plus réticentes, on retrouve une forte opposition vis-à-vis de la société moderne en général et de la bio-médecine en particulier. Cela peut se traduire par : *Un manque de confiance aussi bien dans le médecin traitant, que dans la prise en charge et le traitement des maladies, en particulier lorsqu’il s’agit d’un cancer. Ainsi beaucoup d’informatrices pensent que le cancer ne guérit pas ou que le traitement médical proposé aggrave le pronostic. L’action de l’homme dans ce domaine sacré, réservé au divin, est considérée par ces femmes comme plus délétère que bénéfique. Certaines justifient leurs propos par des exemples de cas de cancers connus dans leur entourage, qu’elles interprètent à leur manière et souvent à partir de croyances fausses. Une femme insiste sur l’absurdité, selon elle, du traitement d’un cancéreux en fin de vie. Elle pense que lorsqu’il n’y a plus d’espoir et que le malade rentre à son domicile avec prescription d’un sérum « pour faire semblant », c’est pour que le médecin ait bonne conscience. *Une impression d’inutilité du frottis ou du dépistage systématique puisqu’on ne peut pas tout prévenir : une femme nous dit en parlant de sa sœur : « même si elle fait le frottis consciencieusement, cela ne l’a pas empêchée de devenir très malade avec son diabète » (ent.19). *L’accusation de la société actuelle tenue pour responsable de nombreuses maladies comme le sida, le cancer, les maladies nutritionnelles, les conséquences de l’alcoolisme et du tabagisme, etc... Les informatrices ont tendance à regrouper toutes ces causes dont le point commun est la notion d’abus, de faute commise par rapport à la morale sociale, aux valeurs normatives d’hygiène de vie. *Un discours passéiste tenu par plus de la moitié des femmes interrogées qui disent que le mode de vie traditionnel était plus sain et qui croient peu aux bienfaits des progrès techniques. La peur du résultat anatomo-pathologique du frottis : Cette crainte du résultat est liée à la peur du cancer. Elle peut être parfois la première motivation à faire le frottis ou au contraire, mais heureusement plus rarement, la première raison de ne pas le faire. La peur de « devoir vivre avec ça » et qu’alors la maladie ne devienne le centre de la vie, que tout tourne autour de ça. Les croyances erronées Ces convictions reflètent le plus souvent des valeurs prônées par la religion de référence de la femme et transmises par son milieu familial. Par exemple la notion de pureté, véhiculée par le christianisme, est à l’origine de l’idée qu’une bonne hygiène intime protège contre le cancer.
28 cf Benoist

Parfois l’origine de ces croyances semble découler de la représentation sur l’ethos féminin à la Réunion. Ainsi, la croyance selon laquelle, il n’y a plus de risque de maladies génitales pour la femme ménopausée, qui serait en quelque sorte « protégée » par son statut, peut s’expliquer par le fait que la ménopause est considérée comme une sorte de « retraite sociale » et que le retour à un état d’irresponsabilité « infantile » est parfois perçu comme « naturel » chez la femme âgée29. Dans le même ordre d’idées, celles qui disent ne plus avoir d’activité sexuelle parce qu’elles n’ont plus de compagnon et vivent seules, ce qui est le cas de nombreuses femmes ménopausées, se sentent également protégées contre le cancer du col de l’utérus. Cette attitude se retrouve aussi chez les femmes nullipares qui ne se sentent pas concernées par le risque de pathologie concernant un organe qui, selon elles, est resté « intact » chez elles. Par ailleurs, la représentation traditionnelle de la maladie dans laquelle la perception de la réalité pathologique est liée à la manifestation de signes douloureux ou gênants, véhicule l’affirmation fausse que : « tant qu’on ne sent rien, c’est qu’on n’est pas malade ». Cette affirmation est retrouvée de manière constante dans le discours des femmes qui n’ont jamais eu de frottis. La peur de la douleur Elle ne semble pas être un facteur déterminant car cette crainte d’une douleur est peu évoquée dans les entretiens. La négligence Elle est parfois reconnue par les informatrices. Mais souvent celles-ci banalisent cette attitude survenant dans le cadre de conditions de vie où les obligations familiales, en particulier maternelles, prennent toute la place au détriment de l’attention de la femme pour sa propre santé. Mais chez les plus réticentes au frottis, le comportement négligent, vis-à-vis de la prévention du cancer du col de l’utérus, est généralement argumenté par le sentiment de n’avoir pas de contrôle sur sa santé. Selon elles, les maladies sont envoyées par Dieu ou par la malchance, quoique l’on fasse. Ce sentiment d’impuissance face à des forces surhumaines est lié à la représentation traditionnelle de la maladie à la Réunion, dans laquelle les facteurs exogènes dominent l’individu qui n’est alors qu’une victime30. Les difficultés matérielles Les difficultés de transport, le paiement de l’examen, les horaires ou le manque de temps n’apparaissent plus comme un motif majeur de non-acceptation du frottis. Elles sont plutôt utilisées pour justifier les comportements d’autrefois appelé en créole « le temps lontan ». 3.7. Typologie des comportements 29 Cf thèse de Stojcic 30 ANDOCHE J.L’interprétation de la maladie et de la guérison à l’île de la Réunion. Paris : Sciences sociales et santé, 1988, 6 (3 - 4 ) : p145 à 165

À partir des différents éléments mis en évidence dans nos entretiens et par comparaison avec une analyse du dépistage du cancer du sein réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé de Rhône-Alpes31, nous avons pu établir une typologie des comportements des femmes réunionnaises vis à vis du frottis. Cette typologie est axée sur les thèmes de « pudeur » et de « lieu de contrôle de la santé » (selon le concept psychosocial de « locus of control » utilisé en particulier en épidémiologie sociale, qui met en avant l’orientation du pouvoir de contrôle sur les déterminants de santé telle qu’elle est perçue par la personne malade ou à risques). Ce lieu de contrôle peut-être interne, dans ce cas la personne est consciente des risques et adhère à un discours de prévention car elle se considère en partie responsable de sa santé. A l’inverse, ce lieu peut apparaître comme externe, notamment lorsque la personne a des convictions religieuses fortes ou se croit sous l’emprise de forces surnaturelles. Dans ce cas, la personne se perçoit comme soumise à un destin décidé par Dieu ou victime de l’infortune ou d’esprits malfaisants. Elle n’adhère pas ou peu à un discours préventif puisque les conditions de sa santé sont extérieures à elle. Ce comportement plutôt passif et attentiste est souvent désigné comme « fataliste » par les professionnels de santé. Dans cette classification, quatre principaux types de femmes apparaissent caractérisés par un ensemble de comportements qui leurs sont particuliers : Les « traditionnelles »
31 Le dépistage du cancer du sein ; lettre de l’ORS ; janvier 2002
LES
OBEISSANTES
LES
EVOLUTIVES
LES
TRADITIONNELLES
LES
RATIONNELLES
PUDIQUES
« FATALISTES »
« NON FATALISTES »
NON PUDIQUES

Dans cette catégorie, les femmes sont plutôt âgées de plus de 60 ans, leurs origines socioculturelles et religieuses sont variées, leur niveau d’études peu élevé. Elles sont en situation de faible médicalisation (moins de suivi médical régulier, pas de suivi gynécologique). Elles ont peu confiance envers leur médecin traitant. Ces femmes ne s’inscrivent pas dans une démarche de prévention : elles ne font pas de mammographie et ne prennent pas de traitement substitutif de la ménopause. Elles ont plutôt recours aux savoirs traditionnels créoles, par exemple elles prennent régulièrement des tisanes médicinales, curatives ou préventives. Autrement dit ces femmes, que nous avons désignées par « les traditionnelles » sont très ancrées dans la culture locale ancienne et adhèrent peu aux valeurs de la bio médecine. Elles se représentent la santé et la maladie selon un modèle traditionnel, qui accorde une large part à la destinée. Elles pensent ne pas exercer de contrôle sur leur santé parce que celle-ci dépendrait de forces extérieures. Il est évident que pour ces femmes, le discours moderne de prévention n’a pas beaucoup de sens. Ces femmes parlent peu des cas de cancer présents dans leur entourage et notamment de ceux de cancer du col de l’utérus. Elles ont d’ailleurs peu de connaissances sur le cancer et semblent peu intéressées par ce sujet. Elles déclarent souvent ne pas en connaître les causes comme si cette absence d’explication sous-entendait en partie leur désintérêt - apparent ou réel ? - en tous cas manifeste. On observe aussi qu’elles ont une faible connaissance du but exact du frottis. Ces femmes « traditionnelles » sont très pudiques et ne parlent pas de leurs problèmes intimes avec leur entourage. Cette pudeur limite d’ailleurs les possibilités de communication sur le sujet. Il se dégage de leur discours un sentiment que le dépistage du cancer par le frottis est de toute façon inutile que c’est pour cela qu’elles n’en ont pas fait faire et ne se sentent pas concernées, car elles s’estiment en bonne santé. Elles sont toutes d’accord avec les affirmations suivantes : « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade » et « si je n’ai plus de partenaire sexuel, je n’ai pas (plus) besoin de faire le frottis ». L’éventualité d’un frottis n’est alors liée qu’à l’apparition de signes cliniques pathologiques. Ces femmes n’évoquent pas spontanément une origine divine pour expliquer la survenue de la maladie comme si elles n’adhéraient pas à cette croyance. En réalité, elles pensent que le fait de s’intéresser à la maladie va attirer le malheur sur elles et elles sont convaincues qu’en parler, c’est se fragiliser. C’est probablement pourquoi, elles dissimulent les raisons de leur comportement face à la maladie et restent dans la croyance que Dieu est tout puissant et qu’elles n’ont aucun pouvoir de contrôle sur leur santé. Les « obéissantes » On les retrouve dans toutes les tranches d’âge de l’étude. Ces femmes vivent plutôt seules parce qu’elles sont veuves ou célibataires. La majorité de ces femmes ont quitté l’école dès le primaire et sont sans profession au moment de l’enquête. Elles ont un suivi médical et font des bilans biologiques régulièrement. Par contre elles sont plus négligentes concernant le frottis, qu’elles font faire de façon irrégulière et il en est de même pour la mammographie. Ces femmes sont rarement suivies par un gynécologue, c’est

souvent le médecin traitant qui réalise le frottis. Elles préfèrent en général avoir affaire à un médecin femme plutôt qu’à un médecin homme, en ce qui concerne le frottis. Elles sont aussi pudiques que les « traditionnelles » et parlent pas ou peu de leurs problèmes intimes avec leur entourage ; elles évitent de parler des cas de cancer qu’elles connaissent et notamment ceux qui concernent le cancer du col. Ces femmes, que nous désignons par les « obéissantes », ont un discours très emprunt de références normatives religieuses ou sociales qu’elles s’interdisent de transgresser. Elles ont été marquées par une éducation familiale plutôt stricte, dominée par la religion et dépourvue d’éducation sexuelle. Tout ce qui concerne l’appareil génital a pour elle une connotation sexuelle qui les gêne et les empêche d’en parler librement. Ce qui domine dans leur représentation des « maladies d’en bas », c’est le rapport au corps, au sexe et pas le rapport à la maladie. Ces femmes donnent plus d’importance au destin qu’aux représentations rationnelles du risque de cancer. Elles justifient leur comportement par le fait qu’elles ne sont pas responsables de leur santé. Mais à la différence de la première catégorie de femmes décrites, les traditionnelles, ces femmes dont le comportement est soumis aux lois morales ont une peur du cancer qui les incite à faire le dépistage. À moins qu’il ne s’agisse pour elles de se soumettre aussi à la contrainte, perçue cette fois dans le discours médical inquiétant sur les risques de cancer et parfois culpabilisant quant au devoir de veiller sur sa propre santé. Le discours de ces femmes « obéissantes » est teinté de moralité chrétienne et la maladie y est souvent interprétée comme une punition divine. On y retrouve beaucoup de croyances fausses sur le cancer. À la différence des « traditionnelles », les « obéissantes » ne sont pas d’accord avec l’affirmation : « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade ». Elles se montrent plus angoissées par la survenue d’une maladie et elles sont généralement plus attentives aux manifestations de leur corps, qu’elles se doivent d’entretenir comme l’écrin « propre » d’une belle âme. Ces femmes se sentent concernées par le cancer « qui peut arriver à tout le monde » mais elles justifient le faible nombre de leurs frottis par le sentiment d’être « saine ou pure », de n’avoir connu qu’un seul homme dans leur vie. Elles imaginent ainsi être préservées de toute contamination par cette maladie puisqu’elles sont en dehors de toute vie de « débauche ». Elles se considèrent également protégées par une cessation d’activité sexuelle et elles sont toutes d’accord avec l’affirmation : « Si je n’ai plus d’homme, je n’ai plus besoin de faire le frottis ». Ces femmes pensent donc que le cancer du col de l’utérus est d’abord en rapport avec le comportement sexuel de la femme et elles l’interprètent souvent comme la conséquence d’une vie « excessive » plus répandue avec l’évolution de la société devenue plus permissive. Ainsi, leur discours sur les risques de cancer du col de l’utérus est souvent passéiste et moralisateur, laissant peu de place à l’idée moderne de prévention qui s’adresse à toutes les femmes. Il semble que ces femmes ne puissent bénéficier d’un examen régulier que lorsque le frottis leur apparaît comme une contrainte à s’imposer. Les « évolutives » Ces femmes ont environ la cinquantaine, elles sont bien suivies sur le plan médical et notamment du point de vue gynécologique. Les notions de destinée et de moralité chrétienne sont présentes dans leur discours, mais restent plus secondaires.

Elles adhèrent au comportement de prévention en général : elles font le frottis et la mammographie régulièrement. Ces femmes n’ont pas de préférence pour le sexe du médecin qui pratique le frottis. Elles n’ont pas d’appréhension liée à la pudeur et parlent de leurs problèmes de santé avec leur entourage. Elles n’hésitent pas à évoquer les cas de cancer du col connus parmi leurs relations. Ces femmes ne pensent pas que le cancer du col soit lié au comportement sexuel. Elles ne sont pas d’accord avec les affirmations suivantes « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade » et « si je n’ai plus d’homme, je n’ai plus besoin de faire le frottis ». Le discours de ces femmes, que nous avons qualifiées d’ «évolutives », est donc effectivement marqué par l’intégration de données modernes qui chez elles prennent le pas sur tout en faisant référence au système traditionnel auquel elles adhèrent de moins en moins. Les « rationnelles » Elles sont plutôt jeunes, ont un niveau d’étude plus élevé que la moyenne des femmes des trois premiers types. Ces femmes, que nous avons appelées « les rationnelles », adhèrent aux représentations scientifiques du cancer et de son traitement. Elles sont suivies régulièrement sur le plan gynécologique, elles ont plutôt confiance envers leurs médecins et sont sensibles au discours sur la prévention en général. Elles utilisent peu la médecine traditionnelle. La notion de destinée et la moralité chrétienne sont absentes de leur discours. Elles font faire un frottis régulièrement et en parlent avec leur entourage. Elles ont d’ailleurs un véritable rôle d’incitation au dépistage autour d’elle. Ceci est notable dans les entretiens où la fille de l’informatrice est présente lors de l’enquête. On remarque donc une influence intergénérationnelle : les filles tentent d’inciter leur mère à se faire dépister. Ces femmes ont une peur raisonnée du résultat du frottis et elles ont un vécu plutôt positif du geste médical. Elles ne sont pas d’accord avec les affirmations « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade » et « si je n’ai plus d’homme, je n’ai plus besoin de faire le frottis ». Elles adhèrent au modèle biomédical et leur pensée semble peu imprégnée par le modèle traditionnel. Ces femmes sont généralement déjà convaincues par l’intérêt préventif du dépistage du col de l’utérus par le frottis et se conforment aux consignes médicales recommandant la régularité de l’examen.

4. Discussion 4.1. Les limites de la méthode Nous avons ciblé la population étudiée en fonction de l’âge (plutôt élevé), du lieu d’habitation (plutôt rural) et du niveau socio-économique (plutôt faible) afin de retrouver le plus de femmes, à priori, réticentes. Ainsi, dans notre typologie, les femmes les mieux « surveillées » apparaissent peu car elles appartiennent préférentiellement à la tranche d’âge 20-39 ans. D’ailleurs ses femmes ont tendance à être trop dépistées. Elles estiment, pour la moitié d’entre elles, que le frottis est un examen qui doit être fait tous les ans32. Il existe à la Réunion comme en métropole un excès de dépistage chez les plus jeunes33. Le petit nombre d’entretiens n’a pas permis de pouvoir étudier les différents types de comportement en fonction de la religion ou de la situation géographique des informatrices. Nous avons constaté parfois une barrière d’expression avec certaines femmes qui avaient du mal à exprimer leurs idées même lors du second entretien. La barrière de la langue joue également un rôle dans ce contexte. Enfin, les femmes les plus réticentes ont été plus difficiles à trouver et à interroger, et le recueil dans cette catégorie d’informatrices semble être plus pauvre. 4.2. Les facteurs déterminants Au travers de tous ces entretiens, on constate que ce qui est le plus déterminant pour le comportement de prévention : c’est d’en parler ou de ne pas en parler. Celles qui en parlent le moins sont celles qui sont le moins sensibles à l’importance du dépistage, alors que celles qui en parlent facilement, avec les femmes de leur entourage (mère, sœur, fille, belle-sœur, cousine) sont au contraire celles qui l’assument le mieux. Les femmes les plus réticentes sont peu suivies sur le plan médical et non suivies sur le plan gynécologique. Ainsi, le médecin de famille est leur seul interlocuteur dans le domaine du biomédical. C’est certainement pour ces femmes, les plus éloignées de la prévention, que le rôle du médecin traitant est primordial : rôle d’information, d’explication pour convaincre la patiente de l’intérêt préventif du frottis, et rôle de réassurance sur le geste médical indolore. La pleine adhésion du médecin traitant à la pratique du dépistage apparaît donc comme essentielle. Dans une moindre mesure, le conjoint peut être un frein au dépistage soit par jalousie ou parce qu’il n’a pas conscience de l’intérêt du dépistage. Cette étude montre globalement, qu’une femme adhère d’autant plus au dépistage du cancer du col de l’utérus qu’elle perçoit un risque pour elle-même et qu’elle a une représentation positive du dépistage et de son intérêt.
32 Etude Louis Harris 33 Thèse Dr Toudy

4.3. Recommandations A partir des résultats de cette étude, nous proposons un certain nombre de recommandations pour une campagne de prévention à La Réunion ; ces recommandations touchent à la fois au contenu des messages, aux outils de communication et aux acteurs de la prévention. Le contenu des messages Nous avons pu mettre en évidence plusieurs types de rapport à la maladie, ceci nécessite donc de disposer de plusieurs discours de prévention. En effet, pour être efficace de manière optimale, il serait préférable d’adapter le discours de prévention à la personne ciblée ou au moins au groupe visé dont on a saisi le système de logique de pensée. Ainsi, si nous reprenons les comportements des différents groupes de femmes que nous avons pu définir dans notre travail : Pour les « traditionnelles », il faudrait favoriser la communication, en général, avec l’entourage mais également avec le médecin traitant. Le discours auprès de ces femmes doit insister sur l’importance de parler de ces maladies et de leur prévention, sortir du non-dit très lourd à porter pour dédramatiser. Dans le discours de prévention auprès de ces femmes, il est important de tenir compte de leurs croyances fausses sur le cancer et tenter de les faire disparaître pour les remplacer par les connaissances que nous avons actuellement sur cette maladie. Pour les « obéissantes », le discours de prévention devrait insister sur le fait que la femme peut elle-même exercer un vrai contrôle sur sa santé, notamment avec l’aide de son médecin, pour lutter contre la destinée dont elle se sent victime. Le discours tenu aux femmes « traditionnelles » et aux femmes « obéissantes » devrait les aider à dépasser les obstacles dues à leur pudeur et à les déculpabiliser, afin de pouvoir parler de problèmes intimes en terme de maladie, sans forcément inclure de lien avec la sexualité. Pour ces deux groupes de femmes, les espaces de communication sont primordiaux à développer, à faciliter, à soutenir. Nous y reviendrons dans les propositions pour les supports à la communication. Pour les « évolutives », le discours de prévention viserait à renforcer leurs convictions. Il faudrait accroître leur adhésion au modèle moderne en leur apportant les informations supplémentaires qu’elles demandent. Pour les « rationnelles », qui sont convaincues de l’intérêt du dépistage et respectent les consignes, on peut penser que le discours doit être plus général et prôner une large communication pour qu’elles continuent à inciter d’autres femmes à la pratique du dépistage du cancer du col de l’utérus par le frottis. Plus globalement, et ceci intéresse tous les groupes de femmes, il serait souhaitable que : la communication en matière de prévention du cancer du col de l’utérus comporte des messages positifs à propos de la prévention,

on évite de mettre en avant la notion de risque et le terme de « cancer », afin de réduire le sentiment de peur qu’ils génèrent, incitant au déni. Ces idées ont d’ailleurs déjà été appliquées dans l’élaboration du programme de communication de la campagne 2000, dans le choix du script des messages télévisés. Il semble que la réussite de l’impact34 de cette campagne confirme la pertinence de ces précautions, l’information insiste sur la possibilité d’avoir recours à la Réunion à un dépistage fiable et disponible dans l’ensemble du département grâce à la présence des médecins généralistes et spécialistes, et sur les bons résultats de ce type de dépistage, l’information lutte contre les croyances fausses sur les cancers, et particulièrement sur le fait que le cancer n’est pas une maladie contagieuse, croyance qui semble être encore très forte à La Réunion, Ainsi, une campagne d’information sur le cancer en général, pourrait favoriser l’adhésion à de nouvelles actions de dépistage, via une meilleure compréhension. Les outils de communication, les acteurs de la prévention Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de favoriser les échanges, le dialogue et la communication sur le thème de la maladie cancéreuse et de sa prévention. Dans sa campagne d’incitation au dépistage du cancer du col utérin, le Conseil Général a utilisé différents supports d’information : l’information grand public en utilisant les outils médiatiques, la sensibilisation et la formation des médecins généralistes, principaux interlocuteurs des femmes sur ces sujets. Il nous paraît important de poursuivre les efforts de communication avec ces deux « supports » mais aussi de développer de nouveaux espaces de parole pour les femmes. Pour ce qui concerne les soignants, nous souhaitons insister sur la nécessité de : prendre davantage conscience du stress et du traumatisme psychologique importants induits fréquemment par le dépistage du cancer et qu’à toutes les étapes (présentation, réalisation et résultat) les femmes soient accompagnées, avec respect, tenir compte des représentations des femmes réunionnaises sur cette maladie et des fausses croyances que certaines d’entre elles peuvent avoir, tenir compte également d’éventuelles réticences de la part des conjoints de ces femmes pour les aider à les dépasser et faire en sorte que ceci ne constitue plus un obstacle au dépistage du cancer du col de l’utérus,
34 Etude Louis Harris

pouvoir s’appuyer sur d’autres acteurs de prévention et de sensibilisation au dépistage lorsqu’ils le jugent utile. Afin d’aider les professionnels de la santé à suivre l’adhésion des femmes au dépistage, il serait intéressant d’organiser le dépistage des cancers selon le modèle de la vaccination, avec dans le carnet de santé de l’adulte, ou la carte vitale, une rubrique destinée au suivi des dépistages. De nouveaux outils de communication et acteurs de prévention pourraient être imaginés. Les actions pour favoriser la communication, les dialogues et les échanges sur la prévention et la santé doivent s’appuyer sur des relais de proximité qui renforcent l’impact des messages grand public. Ces derniers visent à créer une prise de conscience collective d’un problème de santé. Les relais de proximité permettent aux personnes concernées de mieux comprendre ces messages pour se les approprier afin qu’ils constituent pour elles de véritables aides aux changements de comportements. Des relais de proximité pourraient être sollicités à travers les structures existantes dans les quartiers (associations de quartiers, clubs, regroupements religieux…) en s’appuyant sur des outils de communication qu’on mettrait à leur disposition ou sur des acteurs formés dans le domaine de la prévention pour intervenir sur place au sein de ces structures. Il s’agit d’aller vers les femmes, dans leurs lieux de vie habituels pour favoriser l’émergence d’espaces de paroles « naturels ». En terme d’outils de communication, en tenant compte des difficultés pour certaines femmes de plus de 50 ans d’avoir accès à l’information écrite, il serait important d’avoir recours à des supports informatifs variés : spots télévisés, émissions radio, mallette pédagogique pour les acteurs de prévention qui s’adressent à ces femmes…..

Résumé des principaux résultats de l’approche anthropologique
Notre travail décrit comment chaque femme, à sa manière, a un comportement de prévention qui correspond au système de logique du groupe auquel elle appartient : « Les traditionnelles » se prémunissent par le silence, par le non-dit et par le refus d’en parler. « Les obéissantes » se protègent par une conformité à des valeurs de pureté et à des normes moralistes. Ces deux premières catégories utilisent aussi la prière pour se protéger des maladies et plus généralement pour se protéger des aléas de la vie.
Les deux dernières, «les évolutives» et « les rationnelles » sont plus orientées sur le versant préventif de la
médecine moderne. Elles adhérent plus facilement aux représentations scientifiques du dépistage.
L’évolution des mentalités est illustrée dans les rapports mère-fille que nous avons pu décrire et laisse espérer à terme une baisse progressive des réticences des femmes réunionnaises vis à vis du dépistage. Notre travail permet d’avancer des hypothèses quant à la carence de dépistage des femmes de plus de 50 ans, associée à un excès de dépistage chez les moins de 20 ans, mise en évidence par J. TOUDY dans sa thèse du cancer du col de l’utérus à La Réunion en 1999 et confirmée par notre étude épidémiologique :
- Les femmes de moins de 50 ans et surtout celles de moins de 35 ans dialoguent de
façon plus ouverte avec les praticiens, vivant mieux leur féminité et leur sexualité, grâce a deux évènements importants : la libération de la femme et l’émancipation de la sexualité.
- Pour les femmes après 50 ans, le corps, la féminité, la ménopause et ses troubles sont
occultés. Leurs valeurs psychosociologiques sont traditionnelles, elles ont moins de dialogue avec le médecin et oblitèrent tout discours sur la féminité. Elles refusent de plus de s’identifier aux femmes qui peuvent être touchées par le cancer, et se sentent protéger par leur vie qu’elles jugent saine.
Certains points, abordés trop succinctement dans ce travail, mériteraient à eux seuls de faire l’objet d’autres études complémentaires :
- Il pourrait s’agir, par exemple, de s’attacher à mieux comprendre l’influence des différentes religions à La Réunion dans la représentation du cancer.
- Les différentes représentations du cancer en fonction de la localité géographique ont été peu abordées dans notre étude, néanmoins d’après le Docteur S. GREJET, cancérologue à Saint Denis, et d’après des résultats de notre étude épidémiologique, il semble exister des différences de comportement face au cancer en fonction du lieu d’habitation sur l’île.
L’exemple de la représentation du cancer de l’utérus chez la femme réunionnaise montre bien, par sa complexité et les paradoxes qu’elle induit, que les logiques des programmes de santé publique ne correspondent pas toujours aux évidences des individus qu’elles visent.

Conclusion
Les résultats de notre étude mettent en évidence une évolution positive des comportements des femmes réunionnaises et des professionnels de santé de l’île vis à vis du dépistage du cancer du col de l’utérus.
Il est probable que les actions mises en œuvre par le département pour améliorer l’adhésion des femmes réunionnaises à ce dépistage aient eu des effets favorisants ces changements progressifs de comportements. Nous avons pu noter à la fois
- une augmentation du nombre de frottis pratiqués à la Réunion, - une implication croissante des médecins généralistes dans la prescription des frottis de
dépistage,
- une augmentation du taux d’incidence des cancers in situ accompagné d’une diminution du taux d’incidence des cancers invasifs,
- une proportion plus importante de cancers invasifs diagnostiqués à un stade précoce.
Parallèlement, nous avons décrit les représentations des femmes réunionnaises de leur santé, du frottis, du cancer et en particulier du cancer du col. Nous avons identifié les principales réticences des femmes de plus de 40 ans à faire ce dépistage. Nous préconisons quelques recommandations pour les actions d’informations à venir :
- tenir compte des représentations des femmes réunionnaises pour élaborer les contenus des messages d’information,
- lutter contre les fausses croyances encore présentes chez les femmes de plus de 40 ans,
- utiliser des moyens variés de diffusion de cette information en privilégiant le plus
possible les relais de proximité qui peuvent aider à développer le dialogue entre femmes, entre femmes et professionnels, sur ce thème de santé.

Annexes
Annexe 1 : Rappels sur le cancer du col de l’utérus Annexe 2 : Les principes du dépistage organisé Annexe 3 : Les recommandations actuelles à propos du frottis cervico-vaginal et à propos du dépistage organisé du cancer du col utérin Annexe 4 : Guide d’entretien pour l’enquête sur le comportement des femmes à propos du cancer du col de l’utérus et du frottis Annexe 5 : Tableaux résumés des données collectées auprès des informatrices

Annexe 1
Rappels sur le cancer du col de l’utérus

Rappels sur le cancer du col de l’utérus 1. Epidémiologie Le cancer du col de l’utérus vient au deuxième rang des cancers féminins dans le monde. Son incidence est très variable selon les pays ( figure 135). C’est le cancer le plus fréquent dans les pays en développement. Dans les pays industrialisés on observe depuis quelques décennies une baisse notable à la fois de l’incidence et de la mortalité par cancer du col utérin. Cette diminution est attribuée en partie à l’essor du niveau de vie et de l’hygiène, mais elle est surtout liée à la pratique du dépistage des lésions précancéreuses. Ainsi, on observe parallèlement à la baisse de l’incidence des formes invasives, une augmentation de l’incidence des lésions in situ. En France, les données des registres départementaux de cancer montrent une diminution de l’incidence du cancer invasif du col de l’utérus ces dernières années. Entre 1978 et 1992, les taux d’incidence standardisés à la population mondiale sont passés de 15,6 à 8,6 pour 100000. Le cancer du col de l’utérus qui arrivait au 3ième rang des cancers féminins les plus fréquents en France en 1975, est passé actuellement au 7ième ou 8ième rang36. Pour le cancer in situ, en France, le taux standardisé à la population mondiale était de 15,5 pour 100 000 femmes en 1992.
35 Globocan 2000 : cancer incidence, mortality and prevalence worldwide ; IARC Cancer base n°5, Lyon, IARCPress 2001 36 WEIDMAN et al, l’incidence du cancer dol de l’utérus régresse régulièrement en France. BEH 1998 ; 5 : 17-9
93,8561,08
58,1352,0951,8
43,3526,4626,27
22,9922,66
21,0515,66
14,614,1613,58
12,5811,53
10,149,359,34
8,257,84
7,145,765,24
4,23
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
HaitiNicaragua
BolivieZimbabwe
GuinéeJamaïque
MauriceMadagasc
SénégalPhilippine
PologneAlgérie
PortugalArgentine
RussieItalie
AllemagneFranceSuède
AngleterreCanada
USAAustralie
TunisieChine
Finlande
Taux d'incidence du cancer du col de l'utérus standardisé à la population mondiale (1997)

2. Les facteurs de risques Le cancer du col est lié à de multiples facteurs : les facteurs infectieux (papilloma virus), les facteurs sexuels (précocité des rapports sexuels, multiplicité des partenaires de la femme mais aussi de son conjoint, multiparité), le tabac, l’inadéquation de la surveillance gynécologique, les facteurs économiques et sociaux, les facteurs nutritionnels, les facteurs immunitaires. L’absence de dépistage peut relever de nombreux facteurs, liés au médecin ou à la femme. Les facteurs liés à la femme ont été étudiés par BREMOND37, ce sont :
• L’âge : la surveillance cytologique se relâche après la ménopause.
• La contraception : les femmes utilisant une contraception médicale, tels que la pilule mais surtout le stérilet, sont mieux surveillées que celles qui utilisent un moyen non médical de contraception. (Par ailleurs, plusieurs études ont montré que les femmes ayant bénéficié d’une stérilisation tubaire participent moins au dépistage.)
• La catégorie socioprofessionnelle (CSP) : Les femmes qui appartiennent à une CSP
élevée participent plus au dépistage.
• La parité : Les femmes sans enfant et les femmes ayant plus de trois enfants se prêtent moins facilement au dépistage.
3. Histologie et classification 85 % des tumeurs du col sont des carcinomes épidermoïdes développées aux dépens de l’épithélium malpighien exocervical. 10 % sont des adénocarcinomes développés aux dépens de la muqueuse cylindrique endocervicale. 5 % sont des formes plus rares : carcinomes adéno-squameux, tumeurs conjonctives du col utérin.
Différentes classifications sont utilisées pour caractériser les stades des tumeurs du col utérin. Elles sont rappelées succinctement dans le tableau ci-après :
OMS 1970 RICHART
1973 BETHESDA 1988 RICHART
1990 Dysplasie légère CIN 1 Lésions de bas grade CIN1 avec
koïlocytose Dysplasie moyenne CIN 2 CIN2 avec ou sans
koïlocytose Dysplasie sévère Carcinome in situ
CIN 3
Lésions de haut grade CIN 3 avec ou sans
koïlocytose Carcinome invasif Carcinome invasif Carcinome invasif Carcinome invasif
37 J Gynecol Obstet Biol Reprod 1986 ; 15 : 1021-1025 : Dépistage du cancer du col utérin, rôle de la contraception et de la catégorie socio-professionnelle.

L’évolution des dysplasies n’est pas inéluctable, puisqu’une dysplasie peut spontanément régresser, se stabiliser ou s’aggraver. On considère globalement que plus la dysplasie est sévère plus le risque de survenue d’un carcinome invasif est grand. Le cancer in situ est par définition une lésion limitée à l’épithélium ; l’évolution va être marquée par l’effondrement de la membrane basale. Le cancer devient progressivement « micro invasif » puis invasif, jusqu’à l’invasion pelvienne et la diffusion métastatique tardive.
Le carcinome micro-invasif est une lésion infiltrante précoce dont la potentialité métastatique est encore limitée. Dans la classification de la Fédération Internationale des Gynécologues et Obstétriciens, (FIGO), on distingue deux types de carcinomes microinvasifs : Le stade Ia1 correspond à une lésion infiltrante minime, uniquement visible au microscope. Le stade Ia2 correspond à une lésion infiltrante ne dépassant pas 5 mm de profondeur et 7 mm de largeur. Le diagnostic de carcinome microinvasif est difficile, il se fait par l’examen histologique de la pièce opératoire (conisation) qui détermine, la profondeur et l’extension latérale de la lésion, les limites de l’exérèse et l’invasion vasculaire. La profondeur de l’infiltration représente le principal paramètre corrélé avec les métastases ganglionnaires et les récidives locales : 4. Diagnostic et clinique du cancer du col Les lésions précancéreuses et le cancer du col à un stade précoce sont asymptomatiques mais le col est facilement accessible et des examens para-cliniques simples permettent leur détection puis le diagnostic : le frottis cervico-vaginal représente l’examen de choix pour le dépistage du cancer du col, sa spécificité est excellente, sa sensibilité dépend de la sévérité de la lésion : excellente dans les CIN III, elle est moindre dans les CIN I et II où les cellules anormales occupent les couches profondes de l’épithélium. Le frottis ne fait que dépister, il faut ensuite pratiquer une colposcopie qui permet de repérer la lésion et d’orienter la biopsie, qui elle seule apporte la preuve de l’existence et la nature de la lésion. La colposcopie : il s'agit d'un examen du col à la loupe binoculaire sans préparation puis avec l’application d’acide acétique puis de Lugol (test de Shiller). La colposcopie met en évidence, de manière précoce, les modifications tissulaires macroscopiques des processus néoplasiques. Cependant, ces lésions ne sont pas spécifiques, et la colposcopie ne peut être utilisée comme moyen diagnostique ; son intérêt est topographique. Elle permet de visualiser la « zone de transformation » entre les épithéliums malpighiens et cylindriques et de repérer les lésions à biopsier. Le biopsie orientée, guidée par la colposcopie, la biopsie s'effectue à la frontière entre la zone de transformation atypique et l'épithélium cylindrique. La biopsie permet d’établir le diagnostic de certitude en cas de cancer invasif, mais seul l’examen histopathologique d’une pièce opératoire (conisation ou hystérectomie) permet de distinguer un cancer in situ d’un

cancer microinvasif. Cet examen précise la profondeur de l’infiltration en millimètre, l’extension latérale, l’invasion vasculaire et les limites de l’exérèse. Ces caractéristiques sont fondamentales pour le choix du traitement. La conisation diagnostique est réalisée dans les cas où la zone de transformation remonte dans l’endocol et n'est pas bien vue à la colposcopie, la biopsie orientée n'étant alors pas réalisable. Les formes invasives du cancer du col engendrent des signes cliniques. Il existe parfois des signes fonctionnels qui motivent la première consultation, mais le cancer peut être latent, découvert à l’occasion d’un examen gynécologique systématique. Les signes fonctionnels sont les métrorragies essentiellement ; elles sont souvent provoquées (coït, effort d'exonération, toilette) peu abondantes et répétées. D’autres signes fonctionnels peuvent exister : les leucorrhées souvent striées de sang et volontiers purulentes, les signes urinaires (cystite, dysurie, hydronéphrose) ou rectaux (ténesme, épreintes ou faux besoins) qui signent l’envahissement pelvien et qui apparaissent tardivement, les douleurs pelviennes voire des signes généraux (asthénie, fièvre, amaigrissement, anémie). L’apparition d’un de ces signes doit conduire obligatoirement à la réalisation d’un examen gynécologique avec examen au spéculum et touchers pelviens. Tout saignement chez une femme d’âge mûr doit faire l’objet d’un bilan car le cancer du col représente la cause la plus fréquente des métrorragies post ménopausiques. Le bilan d’extension permet de déterminer le stade évolutif du cancer, fondamental pour le choix du traitement. Il existe plusieurs classifications, mais il est recommandé de toujours utiliser celle de la Fédération Internationale des Gynécologues et Obstétriciens (FIGO) seule ou en plus d’une autre classification, afin de pouvoir comparer les résultats des différentes thérapeutiques. Les correspondances entre les différentes classifications sont mentionnées dans la figure ci dessous :
TNM38 Extension FIGO TIS Tumeur in situ Stade 0 T1 Tumeur limitée au col I T1a Carcinome invasif pré clinique IA T1a1 Invasion < 3mm en profondeur
sans dépasser 7 mm latéralement IA1
T1a2 Invasion en profondeur entre 3 et 5 mm sans dépasser 7 mm latéralement
IA2
T1b Lésion cliniquement visible IB T1b1 Taille clinique ne dépassant pas 4 cm IB1 T1b2 Taille clinique > 4 cm IB2 T2 Tumeur dépassant le col utérin mais non étendue
à la paroi pelvienne ou au tiers inférieur du vagin. II
T2a Sans atteinte des paramètres IIA
38 Tumor, Node Metastasis

T2b Avec atteinte des paramètres IIB T3 Tumeur atteignant les limites de la région pelvienne. III T3a Tumeur étendue à la paroi pelvienne IIIA T3b Tumeur étendue au tiers inférieur
du vagin et/ou retentissement sur le haut appareil urinaire.
IIIB
T4 Tumeur envahissant la muqueuse vésicale ou rectale IVA M Métastase à distance IVB
Le pronostic est déterminé par plusieurs facteurs : le stade de la FIGO, l’envahissement lymphatique ; le volume tumoral, l’extension paramètriale. Le taux de survie à 5 ans est de100 % pour les cancers in situ, 80% pour les cancers au stade I et IIA, 55 % pour les cancers au stade IIB, 35 % pour les cancers au stade III, 5 à 10 % pour les cancers au stade IV.

Annexe 2
Les principes du dépistage organisé

1. Principes du dépistage organisé des cancers et application au cancer du col utérin
Le dépistage organisé d’un cancer consiste en l’application systématique dans une population asymptomatique d’un examen capable de détecter soit une lésion précancéreuse, soit un cancer infra clinique à un stade précoce de son développement. Il doit en résulter dans le premier cas, l’absence de survenue du cancer et dans le deuxième, une amélioration du pronostic et des chances de guérison. L’objectif ultime est une réduction de la mortalité par cancer. Pour réaliser un dépistage, deux conditions sont indispensables :
• disposer d’un test capable de détecter tôt le cancer • disposer d’un traitement capable d’améliorer son pronostic.
Le cancer et le test doivent avoir certaines caractéristiques :
• L’histoire naturelle du cancer doit montrer une phase pré-clinique suffisamment longue pour permettre la détection d’un grand nombre de cas pendant cette période. (La connaissance de la durée moyenne de la phase pré-clinique d’un cancer est utile pour définir le délai optimal entre deux tests de dépistage).
• Le pronostic du cancer doit être fortement lié à son extension au moment du diagnostic. La détection précoce du cancer et son traitement vont alors modifier l’histoire naturelle de la maladie et augmenter la probabilité de guérison.
• La mortalité spécifique du cancer doit être considérée comme un problème de santé publique.
Les caractéristiques du cancer du col en font un cancer accessible au dépistage organisé. En effet, il est précédé pendant plusieurs années de lésions précancéreuses, détectables par un examen simple, et dont le traitement évite l’apparition du cancer. D’autre part le pronostic d’un cancer du col découvert à un stade précoce est bien meilleur que si la découverte est plus tardive. Les caractéristiques du test :
• Un test de dépistage doit avoir une sensibilité et une spécificité élevées, mais la sensibilité du test est souvent privilégiée (la priorité étant de limiter le nombre de faux négatifs)
• Un test de dépistage doit être simple, facile à réaliser, acceptable par la population et sans danger car il est proposé à un nombre très important de personnes asymptomatiques, non-demandeuses de soins.
• Un test de dépistage n’a pas vocation à donner d’emblée la preuve de l’affection et tout résultat positif est obligatoirement suivi d’examens complémentaires qui confirment ou non le diagnostic de cancer. Ces examens de confirmation du diagnostic doivent aussi êtres acceptables et facilement réalisables.
• Le test doit être reproductible et d’interprétation simple et standardisée afin de disposer rapidement des résultats et garantir leur fiabilité.
• Enfin, un test de dépistage doit avoir un coût raisonnable (par rapport au coût global de la maladie) et supportable pour les organismes financeurs du dépistage.

Le frottis cervical présente la plupart de ces caractéristiques : c’est un examen simple, qui ne nécessite pas un équipement important et dont l’apprentissage est relativement aisé. Il est peu onéreux et d’une innocuité totale. Bien qu’il ne soit pas toujours « facilement » acceptable par les femmes du fait qu’il concerne leur intimité, le frottis représente l’examen de choix pour le dépistage du cancer du col. Son efficacité a été évaluée, sa spécificité est excellente, sa sensibilité dépend de la sévérité de la lésion : Excellente pour les lésions sévères, elle est moindre pour les dysplasies légères. Les avantages du dépistage organisé: Le dépistage va améliorer le pronostic de la plupart des patients dont la maladie a été détectée grâce au test. Le dépistage permet de traiter à efficacité égale mais de façon moins radicale les cancers de petite taille. Le dépistage est capable de générer des économies de ressources par une réduction du coût total de la prise en charge de la maladie (traitements initiaux moins radicaux et diminution des décès des patients atteints). Les inconvénients du dépistage organisé: Le dépistage allonge inutilement la durée de la maladie de ceux dont la détection précoce du cancer ne va pas modifier le pronostic. Le dépistage rassure à tord ceux qui auront un résultat faussement négatif. Le dépistage génère une inquiétude chez ceux qui auront un test faussement positif et les soumet à des examens complémentaires inutiles. Le dépistage conduit à la détection et au traitement de lésions non cancéreuses mais jugées à risque potentiel de dégénérescence maligne, dont une partie n’aurait jamais évoluée et n’aurait pas été découverte sans dépistage. Cela entraîne une expérience inutile d’angoisse et de traumatisme psychique et corporel chez les individus concernés. Le dépistage a un coût spécifique lié à la réalisation du test, aux examens complémentaires induits par les faux positifs et aux traitements des lésions à risque qui n’auraient pas évoluées en cancer.

Annexe 3
Les recommandations actuelles
à propos du frottis cervico-vaginal et
à propos du dépistage organisé du cancer du col utérin

Recommandations En matière de frottis
Lors de la conférence de consensus sur le dépistage du cancer du col utérin, qui s’est tenu à Lille en 1990, des recommandations à propos du frottis ont été établies. L’essentiel de ces recommandations fait toujours référence en la matière :
• Le frottis doit être réalisé par une personne formée, de préférence le médecin que
consulte la femme, gynécologue ou médecin généraliste. • Il doit être réalisé en dehors des périodes menstruelles, de toute infection vaginale, de
tout traitement local, à distance d’un rapport sexuel (48 heures) et si nécessaire après traitement oestrogénique chez la femme ménopausée.
• Le prélèvement doit intéresser l’exocol et l’endocol et en particulier la zone de jonction.
• Pour l’exocol, on utilise la spatule d’Ayre et pour l’endocol, l’utilisation d’une brosse type Scrinet ou Cytobrush est recommandée.
• Toute lésion cervicale suspecte doit faire l’objet d’examens complémentaires par un spécialiste quels que soient les résultats du frottis.
• Chaque prélèvement doit être étalé sur une lame identifiée, en couche mince et fixée avant d’être transmis au laboratoire avec une fiche de renseignement.
• C’est à un cytopathologiste qualifié que revient la responsabilité de l’interprétation des frottis. La technique classique de PAPANICOLAOU est actuellement la plus utilisée. (Une technique en monocouche est en cours d’évaluation)
• La qualité de l’interprétation du frottis est impératif. Elle passe par : o Le refus des prélèvements de mauvaise qualité. o L’utilisation d’une classification unique. La classification de Béthesda est
recommandée. o La notification de recommandations diagnostiques dans le compte rendu. o L’organisation de procédures d’évaluation interne et externe des
cytopathologistes à l’initiative de la profession. • Le frottis doit être proposé systématiquement à toute femme ayant ou
ayant eu une activité sexuelle, et âgées de 25 à 65 ans. • Le dépistage peut être arrêté au-delà de 65 ans si les femmes ont été
régulièrement surveillées et si leurs deux derniers frottis de dépistage étaient normaux. • Le dépistage n’est pas nécessaire chez les femmes ayant subi une
hystérectomie. • Un frottis tous les trois ans correspond au rythme optimal de dépistage.
Un frottis annuel n’offre pas de bénéfice appréciable supplémentaire. Cependant le premier frottis doit être répété un an plus tard avant de passer au rythme triennal. Il n’est pas recommandé d’adapter le rythme du dépistage selon l’existence de facteurs de risques.
• Tout frottis pathologique doit conduire à une prise en charge spécifique par un spécialiste sur le plan thérapeutique.
En 1994, l’Agence Nationale pour le Développement et l’Evaluation médicale (ANDEM) a repris ces recommandations en laissant la possibilité de commencer le dépistage à partir de 20 ans, en raison de l’évolution de l’épidémiologie des lésions cervicales précancéreuses chez les jeunes femmes.

En matière de dépistage systématique du cancer du col L’analyse des résultats de 11 programmes étrangers par un groupe d’experts du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), en 1986, a montré que le dépistage du cancer du col est efficace s’il réunit certaines conditions d’organisation et de qualité. Les résultats ont montré que pour l’ensemble des femmes bénéficiant d’un frottis tous les trois ans à partir de 20 ans, l’incidence du cancer invasif est réduite de 91 %. (20) Dans certains pays nordiques, on a pu observer une réduction très importante de l’incidence et de la mortalité par cancer du col depuis l’introduction du dépistage systématique. (11) L’organisation par les autorités sanitaires, du dépistage systématique du cancer du col, doit permettre de répondre à certains éléments essentiels qui conditionnent l’efficacité d’une telle campagne :
• Obtenir un taux de participation maximal des femmes de la population ciblée (un taux de couverture supérieur à 60 % est recommandé. (10)
• Obtenir l’adhésion de l’ensemble du corps médical et utiliser les structures médicales existantes.
• Assurer un contrôle de qualité à chaque étape de la procédure (réalisation des frottis, interprétation des lames.)
• Assurer le suivi des femmes dont les résultats sont suspects ou pathologiques. • Evaluer en permanence les résultats du programme : Ceci permet d’apporter les
modifications nécessaires à l’amélioration du programme. L’évaluation du programme porte sur le taux de participation des femmes et du corps médical, les résultats des frottis (pourcentage de frottis techniquement insatisfaisants, pourcentages de faux positifs, de faux négatifs) confrontation cyto-histologique, nombre de cancers d’intervalle, évolution de l’incidence et de la mortalité chez les femmes surveillées et chez les femmes non surveillées, les traitements mis en œuvre et leurs résultats, les coûts.

Annexe 4
Guide d’entretien

ENQUETE SUR LE COMPORTEMENT DES FEMMES A PROPOS DU CANDER DU COL DE L’UTERUS ET DU FROTTIS
Guide d’entretien Présentation de l’enquête
Le Conseil Général a fait une grande campagne d’information et de motivation des femmes pour le dépistage du cancer du col et nous aimerions savoir pour quelles raisons certaines femmes hésitent à se faire dépister ou refusent de le faire. C’est pourquoi j’aimerais discuter avec vous; et savoir un peu quelle est votre attitude vis-à-vis des problèmes de santé, et plus spécialement des problèmes gynécologiques ;
SITUATION PERSONNELLE ET FAMILIALE
- Age. - Situation maritale : mariée célibataire concubinage
divorcée veuve - Nombre d’enfants filles garçons - Nombre de petits-enfants. - Niveau d’éducation - Profession. - Couverture sociale. - Milieu socio-culturel :
o D’origine o Acquis
- Religion. MALADIE
- Pour quelles raisons allez-vous consulter votre médecin ? (Quels sont les signes déclenchant une telle décision ?)
- Beaucoup de gens pensent et disent « tant que je ne sens rien, c’est que je ne suis pas malade ». Qu’en pensez-vous ?
- Selon vous quels sont les éléments qui provoquent une maladie ? Comportement de la personne, punition, volonté divine….
- Pensez-vous que certaines maladies pourraient être évitées ? (comportement de prévention).
- Si oui, de quelle(s) façon(s) ? - Essayez-vous, vous aussi, de prévenir certaines maladies ? - Comment ? - Avec qui dans votre entourage (en dehors de votre médecin traitant éventuellement),
parlez-vous de vos ennuis de santé ? - Vos amies, vos voisines, vos proches dans la famille, vous racontent-elles leurs
propres soucis de santé et leurs inquiétudes dans ce domaine ?

MEDECIN TRAITANT ET COMPORTEMENT DE PREVENTION
Nous avons vu lors de plusieurs discussions que certaines réticences des femmes à pratiquer un frottis sont peut-être dues à leur relation avec leur médecin traitant, et nous essaierons d’éclaircir les choses dans ce domaine aussi.
- Avez-vous un médecin traitant ? - Est-ce un homme ou une femme ? - quel âge a-t-il ou elle ? - Est-il ou elle créole ou zoreille ? - s’il ou elle est métropolitain, parle-t-il ou elle créole ? Lui parlez-vous créole ? Vous
comprend-t-il ? - Pourquoi l’avez-vous choisi ? - Le connaissez-vous depuis longtemps ? - vous donne-t-il des explications? Dans quelle langue ou sous quelle forme (orale,
écrite, dessins) ? Les comprenez-vous ? - Vous sentez-vous assez à l’aise avec lui (ou elle) pour lui parler de tous vos
problèmes, même de problèmes intimes ? - Si l’examen médical le nécessite, en fonction des signes que vous présentez, vous
sentez-vous à l’aise pour vous déshabiller devant votre médecin ? Est-ce différent selon que le médecin est un homme ou une femme ?
- Prenez-vous des médicaments régulièrement ? - Que signifie pour vous la prévention en matière de santé ? - Faites-vous un « bilan de santé » régulièrement ? - Faites-vous d’habitude les examens préventifs que l’on vous propose (médecin
traitant, médecine du travail, etc…), par exemple prise de sang à la recherche d’un diabète, radiographie pulmonaire, mammographie après 40 ans, etc…?
- Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller voir votre médecin ? - Allez-vous parfois voir un spécialiste ? (rhumatologue, cardiologue, gynécologue,
etc…) - Pour quelles raisons particulières ? - Utilisez-vous (maintenant ou dans le passé), une méthode de contraception ? lequel ou
lesquels ? pendant combien de temps ? - Par qui êtes-vous (ou avez-vous été) suivie :
Par votre médecin généraliste ? Par un centre de PMI ou de planification familiale ? Par un gynécologue ?
- Si oui, pourquoi ? - Est-ce un homme ou une femme ? - Vous a-t-il déjà proposé de faire un frottis ? - Si vous n’avez jamais été suivie par un gynécologue, pour quelles raisons ? - Si ce sont des raisons matérielles (disponibilité des spécialistes, difficultés de
transport, etc.), le regrettez-vous ?

LE CANCER
- Connaissez-vous des gens dans votre entourage qui ont ou ont eu un cancer ? - Que pensez-vous de cette maladie :
o De ses causes. o De sa gravité. o Des possibilités de guérison. o Des possibilités de prévention.
- Pensez-vous que le cancer peut se soigner ? Peut guérir ? Peut-être « contrôlé » ? - Pensez-vous que le cancer peut s’aggraver ? - Pensez-vous que l’on peut éviter les complications d’un cancer ? Comment ?
LES MALADIES D’EN BAS LE CANCER DU COL
- Connaissez-vous des signes qui indiquent l’apparition d’une « maladie d’en bas » ? - Quels sont ceux qui vous paraissent inquiétants (douleurs, saignements, etc.) et qui
pour vous doivent faire consulter un médecin ?
- Ces maladies ont-elles une signification spéciale ? - À quoi sont-elle liées ? - À votre avis, quelles sont les causes possibles de ces maladies ? - À votre avis un cancer peut-il évoluer sans donner de signes apparents pendant
quelque temps ? - Où se trouve l’utérus ? quelle est sa fonction ?
- Avez-vous déjà entendu parler du cancer du col de l’utérus ? - Savez-vous comment il se manifeste ? - Quels sont les signes précurseurs de ce cancer ? - Savez-vous comment on en fait le diagnostic ? - Savez-vous si c’est un cancer que l’on peut soigner ? - Selon vous est-ce un cancer grave ? - Est-ce un cancer qui peut toucher toutes les femmes ? - Est-ce une maladie transmissible ? Est-ce une maladie en rapport avec la vie sexuelle ? - Pensez-vous qu’une femme qui n’a plus de relations sexuelles depuis longtemps peut
malgré tout avoir un cancer du col de l’utérus ou non ? - Connaissez-vous des femmes qui ont eu un cancer du col ? Ont-elles été traitées à
temps et guéries ? - Cela a-t-il changé quelque chose dans votre comportement vis-à-vis de cette maladie ? - Savez-vous si c’est un cancer que l’on peut prévenir ? - Dans ce cas, comment ? - Savez-vous s’il existe des facteurs de risque, des éléments qui peuvent favoriser
l’apparition de ce cancer ?

FROTTIS : CONNAISSANCES ET COMPORTEMENT
PARADOXES ENTRE LES DEUX
Les réticences vis-à-vis du frottis peuvent être liées à un manque d’information (méconnaissance des facteurs de risque d’apparition de cancer, méconnaissance du risque lié à ce cancer, méconnaissance des possibilités de guérison en cas de dépistage précoce, méconnaissance des possibilités de réalisation du frottis).
Elles peuvent aussi être liées à la peur, peur de « savoir », peur d’être mise en face d’une réalité inapparente, peur des conséquences du dépistage (l’annonce d’une pathologie nécessitant un traitement, une action).
CONNAISSANCES - Avez-vous déjà entendu parler du « frottis » ? Où ? Par qui ou comment ? - Savez-vous à quoi sert le frottis ? - Pensez-vous que le frottis concerne :
o Les femmes jeunes ? o Les femmes en âge d’avoir des enfants ? o Les femmes avant la ménopause ? o Toutes les femmes ? o Jusqu’à quel âge ?
- Est-ce selon vous un examen utile ? - Savez-vous comment se passe l’examen ? - Savez-vous combien de temps dure l’examen ? - Est-ce selon vous un examen simple ? - Est-ce un examen qui fait mal ou pas ? - Est-ce un examen qu’il faut faire une seule fois ou plus ? - Savez-vous qui peut pratiquer le frottis ? Où ? - Selon vous qui doit demander ou proposer le frottis ? La femme ou son médecin ?
COMPORTEMENT
- Avez-vous déjà fait un frottis ? - Quand ? - Qui vous l’avez proposé ? - Pourquoi ? - Qui l’a fait ? - Vous a-t-on expliqué le résultat ? - Faites-vous un frottis régulièrement ?
o Si oui, pourquoi ? o À quel rythme ? o Est-ce vous ou votre médecin traitant, votre gynécologue, qui y pense et le
propose ? o Recommandez-vous à d’autres personnes proches (filles, sœurs, amies, mère,
voisines, etc.) de se faire faire un frottis ? o À votre avis, pourquoi certaines femmes refusent-elles de faire un frottis ?

- Si vous n’avez jamais fait de frottis, pourquoi ?
o Est-ce un manque de temps ? o Est-ce parce que vous ne croyez pas à son utilité ? o Est-ce par peur du résultat ? o Est-ce parce que vous pensez que vous n’en avez pas besoin ?(Si vous pensez
par exemple que vous n’avez pas de risque d’attraper cette maladie…).

Annexe 5
Tableaux résumés
des principales données collectées
auprès des informatrices

Tableau 1. Caractéristiques socio-démographiques des « informatrices ».
Age Situation matrimoniale
Religion Identité socio-
culturelle
Niveau d’étude
Profession Nbre d’enfants
Nbre de petits
enfants
Lieu de résidence
1 51 mariée Hindouiste Malbaraise Primaire Aide ménagère 4 1 St-André 2 58 mariée Musulmane Malgache Primaire Femme au foyer 2 0 St-Denis 3 62 célibataire Catholique Créole Primaire Pouponnière 0 0 Cambuston 4 62 veuve Catholique Créole Primaire Employée de maison 4 3 Cambuston 5 44 mariée Catholique Créole Primaire Femme au foyer 3 0 Cambuston 6 69 veuve Hindouiste Malbaraise Pas d’école Cuisinière 9 5 St-André 7 42 célibataire Hindouiste Malbaraise Secondaire Employée de Mairie 0 0 St-André 8 48 célibataire Catholique Créole Primaire Aide ménagère 1 0 Avirons 9 60 célibataire Catholique Métropolitaine Secondaire Religieuse 0 0 Avirons 10 57 veuve Catholique Créole Pas d’école Vendeuse 10 15 St-Paul 11 50 divorcée Catholique Créole Primaire Serveuse de cantine 1 1 St-André 12 61 veuve Catholique Créole Primaire Femme au foyer 7 15 St-André 13 64 veuve Catholique Créole Bac Directrice d’école 3 6 St-André 14 51 mariée Hindouiste Malbaraise Primaire Femme au foyer 5 3 Ste-Suzanne 15 32 mariée Catholique Créole BEP Aide ménagère 2 0 St-Denis 16 55 concubine Catholique Créole Secondaire Aide ménagère 6 0 St-Denis 17 49 veuve Catholique Créole Primaire Femme au foyer 3 0 Avirons 18 41 célibataire Catholique Créole Primaire Auxiliaire de vie 1 0 Avirons 19 41 mariée Catholique Créole CAP Aide ménagère 3 0 St-André 20 52 mariée Culte des ancêtres Chinoise Secondaire Vendeuse 4 3 St-André

Tableau 2.Qualité de la relation de soins et comportement de prévention de la femme
Age Suivi
médical régulier
Suivi biologique
régulier
Confiance envers le médecin traitant
Utilisation de la médecine
traditionnelle
Suivi gynécologique
Contraception orale
A déjà pratiqué au moins une
mammographie
Traitement de la
ménopause
Reconnaissance des campagnes
de dépistage
1 51 - + - + +/- + - - + 2 58 + + - + + - + + + 3 62 - - + + - - - - + 4 62 + + - + - - - - + 5 44 + + - + + + + nc + 6 69 + + + + - - - - - 7 42 + + + - - + + nc + 8 48 + + + - + - + nc + 9 60 - + + - + - + - + 10 57 + + + + + - + - + 11 50 + + - + + - + + + 12 61 + + + +/- - - + - + 13 64 - + - + + - + + + 14 51 + + - +/- + + + - + 15 32 - - + +/- + - - nc - 16 55 + + + +/- - - + + - 17 49 + + + + +/- - + - + 18 41 + + + + - - + nc + 19 41 - - + + - - + nc + 20 52 - - - - - - - - - nc = non concerné +/-= irrégulier

Tableau 3. Représentations populaires en rapport avec les comportements des femmes face au cancer du col de l’utérus
Age Donne une origine divine à la maladie
Moralité chrétienne
Discours passéiste
Expérience de cancer
dans l’entourage
Expérience de cancer du
col dans l’entourage
Pense qu’il existe une relation entre
la sexualité et cancer du col
En accord avec : « Tant que je sens
rien, c’est que je ne suis pas malade »
En accord avec : « Pas de mari, pas de frottis »
1 51 +/- - - - - + + + 2 58 ++ - - + + +/- - - 3 62 +/- + + + - + + + 4 62 + + +/- + - +/- + + 5 44 - - +/- + + - - - 6 69 +/- - + - - +/- + + 7 42 - - + + + +/- - - 8 48 + + + + + +/- - - 9 60 + + - + + - - - 10 57 ++ ++ +/- + + +/- - - 11 50 + + - + + +/- - + 12 61 - - - - - + - - 13 64 - ++ ++ + - + - + 14 51 + + - + + - - - 15 32 - + - + + + - - 16 55 - + - + + + - - 17 49 ++ + + + - - - + 18 41 ++ ++ + + - + - - 19 41 + ++ + + - + + + 20 52 + +/- + - - +/- + +

Tableau 4. Expérience profane féminine du frottis et présence de pudeur
Age Pratique
du frottis Vécu du frottis
Peur du résultat
Pudeur Parle de ses problèmes intimes avec son entourage
Préférence concernant le médecin qui pratique le frottis
1 51 +/-(1) - + ++ - Femme 2 58 + + + - + Femme 3 62 - nc + + - Femme 4 62 - nc + + - Femme 5 44 + - + + + Femme 6 69 +/-(1) - + ++ - Femme 7 42 + + - - + Femme 8 48 + + + - + Indifférent 9 60 + + + - + Homme 10 57 - nc + - + Femme 11 50 + + + - + Homme 12 61 + + + + + Femme 13 64 +/-(3) - - ++ - Femme 14 51 + + - - + Indifférent 15 32 + - - - + Indifférent 16 55 + + + ++ - Femme 17 49 + + - + - Indifférent 18 41 + + - + - Homme 19 41 - nc + + - Femme 20 52 - nc + + - Femme
nc = non concerné +/- = irrégulier