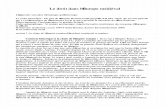Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères - INTRODUCTION … · 2005. 4. 15. · Le...
Transcript of Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères - INTRODUCTION … · 2005. 4. 15. · Le...

INTRODUCTIONMéthodes et objectifs


L’évaluation et le rapport recoupent plusieurs sources d’information
La Direction générale de la Coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère desAffaires étrangères a décidé de procéder à une évaluation externe du dispositif de crédits déconcentrés«Fonds social de développement» (CD/FSD), évaluation qui porte sur la période allant de la créationde ce dispositif en 1996, à 2001.
Cette évaluation fait suite à des travaux analogues menés sur les CDI et le Fonds spécial de dévelop-pement.
Un comité de pilotage a été constitué, présidé par M. Gérard La Cognata, sous-directeur de la rechercheà la DGCID (voir la composition du comité de pilotage en annexe 6).
Cette évaluation a été l’occasion d’une formation-action avec la contribution du cabinet Eureval-C3E,en particulier dans l’élaboration du cahier des charges (voir les termes de référence en annexe 5).
Les critères d’évaluation suivants ont été définis par le comité de pilotage, «les trois premières [ques-tions] étant nettement prioritaires» :
— bénéfice durable pour les populations pauvres,— structuration des acteurs,— capacité opérationnelle des postes,— articulation avec les stratégies sectorielles,— justification du maintien du dispositif,— image de la coopération française,— concertation avec les autres acteurs.
Les trois questions transversales suivantes ont également été posées à l’évaluation:
— types de population touchés: questions du genre et de la jeunesse;
— renforcement des capacités des structures de base en matière d’organisation et de relations;
— comparaison (benchmarking) avec les dispositifs d’autres bailleurs.
Le cabinet Evalua a été retenu pour la réalisation de cette évaluation, qu’il a conduite en coopérationavec six consultants de pays de la ZSP (Haïti, Madagascar, Mozambique, Mauritanie, Tchad, Burundi).
Cinq types d’information distincts ont été mobilisés.
— Les projets financés sur CD/FSD ont été recensés sur une base de données, créée par un stagiaireau MAE à partir des informations disponibles à Paris. Elle a ensuite été diffusée à chacun des SCACconcernés début 2001. Ceux-ci ont complété ou corrigé l’information. Les fiches ainsi collectées (voirannexe 2) ont été saisies, réunies, corrigées d’erreurs diverses, et analysées par Evalua au deuxième tri-mestre 2001. Chaque projet est décrit sous l’angle de son secteur ou domaine, de son budget, des inter-venants, et des conditions administratives de mise en œuvre (les résultats ou impacts ne sont pas trai-tés ; les bénéficiaires sont indiqués «en clair» mais ne sont pas caractérisés par des variables statisti-quement exploitables). La base recense 1269 projets dans 30 pays, totalisant un budget de 340987 kFF,ou l’équivalent de trois ans et demi d’engagement sur CD/FSD; la base peut donc être considéréecomme représentative, au moins pour les projets terminés. Un grand nombre de statistiques tirées decette base sont présentées aux parties 3.1 et 3.3 du présent rapport.
— Les évaluateurs ont mené des analyses sur documents et des entretiens à Paris au cours du troisiè-me trimestre 2001, en interne au MAE (voir en annexe 7 la liste des personnes rencontrées), pour étu-dier en particulier la façon dont est géré le dispositif au niveau central, et dont sont attribuées les enve-loppes de crédits déconcentrés aux SCAC.
— Les évaluateurs ont également réalisé des analyses documentaires et des entretiens d’acteurs dans
31Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001

32Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
six pays, d’octobre 2001 à mars 2002 (7 à 12 jours par pays) : Haïti, Madagascar, Mozambique,Mauritanie, Tchad, Burundi. Chaque mission était réalisée par un trinôme composé d’un consultantd’Evalua, d’un consultant national, et un agent du MAE membre du comité de pilotage (dans le cadrede la formation-action). Les entretiens menés ont également intégré, de façon variable d’un pays àl’autre, les autorités nationales, différentes personnalités de la société civile, l’AFD, et d’autresbailleurs de fonds. L’ambassadeur et le chef de SCAC ont été rencontrés au début et à la fin de chaquemission (voir l’agenda des missions en annexe 7).
— Lors de ces mêmes études nationales, les évaluateurs ont visité et noté, sur une grille développantles critères impartis à l’évaluation, 45 projets tirés au sort dans la base de données initiale. La notationa été faite dans la mesure du possible par consensus des trois membres de l’équipe d’évaluation dansle pays. Les grilles de notation complétées figurent dans les rapports «pays», qui ont le statut d’annexesau rapport d’évaluation, et qui sont résumés, pour le présent document, en partie 6. Ce travail sur pro-jets a notamment nourri la synthèse évaluative, partie 4 du présent rapport.
— Un questionnaire, basé sur les enseignements des études de cas et discutant de perspectives d’ave-nir, a été écrit par Evalua, diffusé aux SCAC par le MAE, saisi et analysé par Evalua au deuxième tri-mestre 2002. Le nombre de SCAC répondants est de 32, soit la grande majorité des 45 SCAC ayantbénéficié d’enveloppes CD/FSD – la plupart des non-répondants sont les SCAC de pays ne bénéficiantdu dispositif que depuis 2000 (pays de la ZSP qui ne relevaient pas du «champ»). Les évaluateurs ontégalement calculé, sur les 6 pays où ils se sont rendus, le décalage moyen entre leur propre réponse auquestionnaire et la réponse des SCAC. Le total des réponses, question par question, et l’information surces différences avec la perception des évaluateurs, figurent en annexe 3.
L’échantillon de six pays défini par le comité de pilotage pour des études sur place
Le comité de pilotage a envisagé, lors de la rédaction des termes de référence, un échantillon de 6 payspour les études de cas: Haïti, Madagascar, Mozambique, Mauritanie, Tchad, Burundi. Il s’agissait, defaçon volontaire, de pays qui ne figurent pas, à l’exception de Madagascar, parmi les terrains d’inves-tigation et d’expérimentation les plus habituels de la coopération française.
Encore fallait-il vérifier que cet échantillon rende compte, aussi bien que possible, de la diversité dessituations nationales en matière de mise en œuvre des CD/FSD.
Le graphique suivant, réalisé sur la base de données des projets (à partir de données provisoires datantd’avril 2001), confirme que ces six pays (soulignés) se répartissent bien sur les deux axes que sont lemontant total des engagements sur CD/FSD, et le montant moyen des projets financés:

33Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Un résultat équivalent apparaît dans le graphique suivant, basé sur les données définitives, avec deuxaxes qui sont le nombre de projets financés et leur montant moyen – les 6 pays retenus sont en italique:
Un autre graphique, synthétisant un grand nombre de variables tirées de la même base de données,figure ci-dessous au § 3.4. Il permet de constater que, sur des variables qui décrivent l’emploi desCD/FSD de façon plus qualitative que par le seul montant moyen, l’échantillon reste représentatif d’unediversité de cas de figure; à l’exception de quelques situations «atypiques», non représentées parmi les6 pays, et où ces crédits sont majoritairement employés pour des projets concernant l’État national. Ils’agit souvent de pays à faible montant d’enveloppe CD/FSD. Le cas d’Haïti, qui fait partie de l’échan-tillon, est également atypique mais avec un volume élevé de CD/FSD.


PREMIÈRE PARTIEObjectifs, réglementation et moyens
mis en place par le MAE


2 Instruction n° 402475/DAG/BAI/BFAC du 4 août 1988.3 Selon l’évaluation-pays de l’aide française au Burkina Faso, 1989-1998, citée par le rapport d’étude de l’IRAM pour leMAE, «Lutte contre la pauvreté et les inégalités», juin 2000, p. 113.4 Circulaires du 27 juillet 1977 (POD) et du 6 décembre 1979 (CID).5 Instruction n° 402093/DAG/BAI/BFAC du 29 juin 1989.
37Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
1. Historique et réglementation: CDI, FSP, CD/FSDLe dispositif de crédits déconcentrés «Fonds social de développement» (CD/FSD) a pris en 1996 lerelais de deux dispositifs antérieurs de coopération: les Crédits déconcentrés d’intervention (CDI) et leFonds spécial de développement (FSD).
Les Crédits déconcentrés d’intervention venaient eux-mêmes à la suite d’instruments analogues definancement de petits investissements ou plus généralement de petites actions par la coopération fran-çaise.
Le Fonds spécial de développement a un historique spécifique, lié à la dévaluation du franc CFA en1994.
1.1. LES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS D’INTERVENTION (CDI)
La mise en place des Crédits déconcentrés d’intervention, en 1988, répondait à deux préoccupationsmajeures 2 :
— Poursuivre le mouvement de déconcentration au profit des chefs de mission (actuels chefs deSCAC).
— Encourager les initiatives de développement initiées au plus près du terrain («développement à labase»).
Les CDI constituent ainsi une «évolution des opérations déconcentrées antérieures, sans rupturemajeure» 3, c’est-à-dire des procédures POD (Petites opérations de développement), CID (Crédits d’in-tervention directe) et CLI (Crédits légers d’intervention) 4.
Les conditions d’application des CDI sont les suivantes, telles que précisées par une instruction de1989 5 :
— Objectifs :• situer la conception et la mise en œuvre des projets du FAC plus près des partenaires et des réa-
lités locales, pour les projets de dimension moyenne;• associer davantage les bénéficiaires à la conception et à la réalisation des projets ;• mobiliser les partenaires plus nombreux (collectivités locales, ONG, œuvres privées…), et sou-
tenir leurs actions de développement économique, social et culturel ;• réduire les délais de mise en œuvre des opérations.
— Conditions d’éligibilité : l’éventail des opérations susceptibles de bénéficier d’un financement estlarge puisqu’il recouvre tous les projets justiciables d’un financement FAC «parce qu’ils contribuentau développement économique, social et culturel».
— Durée des projets : la durée d’exécution des projets ne doit pas, en principe, excéder trois ans.
— Plafond des crédits ouverts : 1 million de FF d’autorisation de programme par projet.

38Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
6 Selon la synthèse qu’en donne une évaluation ultérieure, Hachmanian E. et Verges F. (1994) : «La politique des CréditsDéconcentrés d’Intervention – Évaluation de la politique française (1988-1993)», Collection «Evaluations», 1994, n° 22,pp. 14-15.7 Hachmanian E. et Verges F. (1994) : «La politique des Crédits déconcentrés d’intervention – Évaluation de la politique fran-çaise (1988-1993)», Collection «Evaluations», 1994, n° 22.
— Bénéficiaires : associations de droit local, coopératives, groupements villageois, petites entreprisesde droit local, administrations centrales ou locales de l’État, collectivités territoriales et organismesinter-États.
— Association des bénéficiaires : l’association des bénéficiaires à la conception et à la réalisation desprojets constitue l’un des fondements de la procédure. Elle se traduit notamment par l’obligation d’uneparticipation des bénéficiaires pouvant revêtir diverses modalités : contribution financière, mise à dis-position de moyens en personnel, matériel, logistique, locaux, équipements, aide à la conception et àl’élaboration du projet. Cette participation doit en principe être prévue dans tous les cas et atteindre aumoins 30 % «dans la mesure du possible» du montant total de l’opération.
— Secteurs d’intervention: une large autonomie est laissée aux chefs de mission qui sont appelés àdéfinir « les orientations de leur action en fonction des priorités locales de développement».
— Modalités de gestion: les CDI doivent être utilisés comme des subventions et ne peuvent êtreemployés en tant que prêts, avances remboursables ou prises de participation. Les Missions de coopé-ration et d’action culturelle (MCAC) ont la possibilité de solliciter l’ouverture d’une nouvelle envelop-pe CDI lorsqu’elles ont engagé au moins 75 % des crédits de l’enveloppe attribuée.
La politique de déconcentration des crédits du ministère a donné lieu à plusieurs évaluations suc-cessives:
— En 1984, l’évaluation des POD, CLI et CID pointait les limites suivantes 6 :
• les dotations de crédits déconcentrés apparaissaient comme «des crédits de poche servant à toutet à rien sans que les MCAC aient défini une politique locale d’utilisation» ;
• l’absence d’objectifs, de priorités stratégiques, conduisant les missions à la «dispersion» desactions et au «saupoudrage» ;
• les dotations n’atteignaient pas une «masse critique» suffisante pour avoir un impact significatifsur le développement des États concernés;
• parmi les critères de sélection des projets, les missions privilégiaient plus le sérieux du bénéfi-ciaire ou la fiabilité de l’opérateur que la nature du projet lui-même et son intégration dans unepolitique de développement ;
• la logique «dépensière» des missions les conduisait à rechercher, en priorité, à consommer lesenveloppes et à n’accorder vraiment d’importance qu’au suivi comptable des projets ;
• la participation des bénéficiaires, parfois très formelle, n’était pas toujours ou mal valorisée;
• les insuffisances du suivi et du contrôle interdisaient toute capitalisation d’expérience;
• La passivité des MCAC – qui se bornaient à recevoir des demandes de subventions mais n’avaientpas d’action volontariste en direction des porteurs de projets potentiels (pas de diffusion d’infor-mation sur les POD, CLI et CID) – ne suscitait pas suffisamment les demandes;
• les coûts de gestion et de suivi importants étaient induits par la mise en œuvre des crédits décon-centrés, et la charge de travail était lourde pour les conseillers peu formés à ce genre d’exercice.
— Dix ans plus tard, dans un contexte de stabilité du cadre réglementaire et du quadruplementdes dotations budgétaires, l’évaluation des CDI 7 formulait les conclusions suivantes :
• Sur la mise en œuvre des CDI dans les missions:
- forte implication des chefs de mission dans la sélection des projets,- attitude plutôt attentiste dans la phase d’initialisation des projets («malgré la multiplication des
contacts avec la société civile, les MCAC n’ont pas toujours eu les moyens de repérer ou desusciter de bons projets sur le terrain»),

39Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
8 45,7 millions d’euros et 15,2 millions d’euros.
- suivi insuffisant de la réalisation des projets ; évaluation ex-post pratiquement inexistantelorsque l’opérateur n’est pas une ONG structurée («la plupart des MCAC visitées manquent demoyens en personnel pour effectuer un suivi et un contrôle sérieux des projets au cours de leurphase d’exécution. Seules les grandes missions disposent d’un chargé de mission CDI qui estgénéralement un Volontaire du progrès») ;
- grande «dispersion» des financements (40 % des CDI sont inférieurs à 50000 FF);- insuffisante capitalisation des acquis et transmission des expériences («les chefs de mission et
leurs conseillers ne transmettent généralement ni à leurs successeurs ni à leurs homologuesd’autres pays les doctrines qu’ils se forgent sur les CDI»).
• Sur le suivi et l’évaluation par les Services centraux:
- performance du système d’information et de gestion pour le suivi financier, mais inefficacitépour la mesure des résultats et des impacts (souvent formels, les rapports de présentation nepermettaient pas de se forger un jugement sur ces questions) ;
- faible capacité de «veille réglementaire» (il apparaît quelques détournements de procédures,quelques financements dont le caractère de «projet de développement» est contestable), mais,selon les évaluateurs, ces usages hors normes concernent moins de 10 % des crédits ;
- rareté des sollicitations des MCAC en direction de l’expertise de l’administration centrale(sous-directions sectorielles notamment).
• Sur les résultats et impacts pour la MCAC:
- amélioration de l’image de la MCAC en tant que structure et du chef de MCAC en tant que res-ponsable (existence de crédits dont la décision d’attribution est prise au sein de l’ambassade,rapidité en termes d’instruction, de décision et de mise en œuvre) ;
- valorisation de la coopération française vis-à-vis des autres bailleurs de fonds («les enveloppesde crédits déconcentrés dont disposent les autres bailleurs de fonds sont soit très inférieuresaux enveloppes CDI des missions, soit d’une mise en œuvre beaucoup plus lourde et jugée tropcomplexe par les autorités locales de coopération»).
• Sur les résultats et impacts pour la société civile :
- bonne connaissance de la société civile locale par les MCAC, mais insuffisamment capitalisée(grande variété de projets et de domaines touchés) ;
- caractère «très peu opératoire» de la clause de «30 % de participation des bénéficiaires», dontl’application reste «formelle et floue» ; l’évaluation note même que les CDI ne financent pasfréquemment des projets consommateurs de main d’œuvre («les CDI n’ont pas jusqu’icicontribué significativement à mettre au travail, sur des projets précis, les collectivités debase») ;
- quant à un éventuel «appui à l’émergence d’une société civile», il n’était «que partiellementtransparent» – du moins les CDI ont-ils ouvert, selon les évaluateurs, les portes des missions(SCAC) françaises à des cercles d’interlocuteurs plus larges.
1.2. LE FONDS SPÉCIAL DE DÉVELOPPEMENT (1994-1995)
La dévaluation du franc CFA et du franc comorien, intervenue le 12 janvier 1994, réduisant le pou-voir d’achat des détenteurs de patrimoines ou de salaires libellés en francs CFA, appelait des mesuressociales d’accompagnement.
Cette logique d’accompagnement social de la dévaluation a conduit à la création par la France d’unFonds spécial de développement, pour un montant initial de 300 millions de FF, complété enjuillet 1994 par une mesure complémentaire de 100 millions de FF8.

40Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
9 304898 euros.
Conçu pour neutraliser les effets négatifs de la dévaluation du franc CFA et contribuer à désamorcer leséventuelles tensions sociales, le Fonds spécial de développement devait répondre à des situations d’ur-gence localisées grâce à un décaissement rapide.
Cette procédure exceptionnelle était, en priorité, destinée à favoriser la réalisation de programmes definancement d’initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, d’amélioration des condi-tions de vie dans les zones urbaines (notamment en matière de santé et d’éducation), de créations d’em-plois et de petits investissements sociaux. Elle ne devait initialement avoir dans le temps (dix-huit mois)et dans l’espace qu’une portée limitée, et n’avait pas vocation à être renouvelée. L’enjeu visait à obte-nir l’adhésion des populations à la décision de dévaluation.
Cette démarche correspondait également à une volonté de renouveler l’action de la coopération de laFrance au profit de la société civile des États concernés.
La conception des projets relevant du fonds spécial devait procéder d’une étroite concertation au planlocal, notamment avec les bénéficiaires, en les impliquant soit par le biais du financement, soit par lafourniture de main d’œuvre. Afin d’assurer la pérennité des actions retenues, il était admis que les pro-jets susceptibles d’être agréés au titre du fonds spécial devaient prévoir la gestion participative desacteurs locaux dans la perspective d’une prise en charge définitive au plan technique comme au planfinancier. C’est ainsi que les bénéficiaires et les opérateurs devaient en priorité être choisis hors de l’ap-pareil de l’État.
Les projets devaient être présentés par des associations ou des collectivités locales. Leur coût unitairedevait être égal ou inférieur à 2 MFF9 pour en permettre plus facilement le suivi par des équipes localesproches des populations les plus vulnérables. La création de revenus temporaires, en particulier par l’in-termédiaire de chantiers à haute intensité de main d’œuvre était préconisée, ainsi que toute réponse àdes besoins sociaux de base. Les deux tiers des crédits devaient être affectés à des projets en zonesurbaines.
Le choix des projets relevait d’un comité local de sélection associant les différents partenaires. Le comi-té de sélection, placé sous la responsabilité conjointe du chef de la Mission de coopération et d’actionculturelle (MCAC) et du directeur de la représentation locale de la Caisse française de développement(actuelle AFD), associait les acteurs locaux (représentants du gouvernement, de la société civile) et lesbailleurs de fonds (Union européenne, PNUD, Banque mondiale…). D’une manière générale, lesautres bailleurs de fonds ont participé aux travaux des comités locaux, sans s’engager sur le plan finan-cier. La France a supporté seule le financement de ce dispositif qu’elle avait créé.
L’évaluation du Fonds spécial de développement (1995)
Deux évaluations du Fonds spécial de développement ont été conduites à la demande du ministère dela Coopération et de la Caisse française de développement, par deux cabinets :
• Le cabinet Price Waterhouse a évalué les modalités de mise en œuvre et l’impact du fonds spécialdans quatre pays à revenu intermédiaire : Gabon, Cameroun, Côte d’Ivoire et Congo, pour la Caissefrançaise de développement ;
• Le cabinet «Pegase» a effectué une étude dans les sept Pays les Moins Avancés (PMA): Sénégal,Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, République Centrafricaine, Bénin, pour le ministère de laCoopération.
Les principales conclusions et recommandations ont été les suivantes :
— Le processus de montage, de sélection et de mise en œuvre s’est révélé relativement efficace. Maisun manque général de rigueur en termes de suivi sur le terrain et dans le domaine financier et comp-

41Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
10 Rapport d’étude de l’IRAM pour le MAE, «Lutte contre la pauvreté et les inégalités», juin 2000, p. 114, faisant référenceà l’évaluation du Fonds spécial de développement par Pégase, ministère de la Coopération, décembre 1994.
table est observé. La priorité accordée au principe d’un décaissement rapide, l’inexpérience de certainsintervenants, et un environnement propice à un certain opportunisme de quelques acteurs, figurentparmi les principaux facteurs explicatifs identifiés par les évaluateurs.
La plupart des postes ont affecté au suivi du FSD un coopérant du service national (CSN). Si ces per-sonnes ont démontré une forte motivation, leur prestation a souffert de leur faible expérience sur lesplans technique, administratif et comptable.
Les moyens humains à la disposition des postes étaient insuffisants pour effectuer un suivi et une éva-luation de qualité des projets :
— La mise en œuvre du Fonds spécial a conduit à un certain déplacement des actions de coopérationfrançaise vers les zones urbaines au détriment des zones rurales.
— Les projets relatifs à l’amélioration du cadre de vie ont recueilli une part importante des fonds. Ilsont permis dans la plupart des pays une redistribution des salaires.
Les groupes sociaux bénéficiaires des projets sont essentiellement les populations défavorisées,connaissant des problèmes sanitaires, de nutrition, d’emploi. Il s’agit également de populations le plussouvent jeunes, très localisées.
Mais cette orientation vers les groupes vulnérables n’est suivie d’effets que pour une petite fraction desfonds, de même que les mécanismes de concertation prévus: «Les groupes exposés (jeunes défavori-sés et groupes à santé déficiente) ne seront concernés que par 6,1 % des fonds […]. La société civilen’est pas réellement associée au dispositif […]. Le caractère d’urgence […] du décaissement […] nepermet ni d’identifier de nouveaux partenaires de la société civile […], ni d’être à l’écoute de projetsémanant d’elle […]» 10.
1.3. LE FONDS SOCIAL DE DÉVELOPPEMENT (DEPUIS 1996)
Annoncé par un télégramme en date du 14 décembre 1995, le Fonds social de développement consti-tue une nouvelle «composante de l’aide française». Contrairement au Fonds spécial, le Fonds social dedéveloppement ne procède pas de l’aide conjoncturelle et ne relève pas systématiquement de la procé-dure d’urgence. Il n’est pas réservé aux seuls pays de la zone franc, mais devient l’un des instrumentspermanents de l’aide française destinée à l’ensemble des pays du «champ».
L’objet du Fonds social de développement est de financer en priorité des réalisations physiques depetite dimension dans les secteurs sociaux et les services collectifs. Les dynamiques micro-écono-miques, créatrices de revenus et d’emploi, doivent être favorisées. Ces projets doivent se dérouler «depréférence en milieu urbain, au bénéfice des populations pauvres, sans exclure les opérations enmilieu rural concourant aux mêmes objectifs».
Ne peuvent en aucun cas être financés sur crédits déconcentrés les projets qui seraient uniquementconstitués par :
— des opérations de simple opportunité, sans but social, économique ou culturel bien défini ;
— des opérations de prestige;
— le fonctionnement ou l’équipement de services administratifs, d’associations ou d’œuvres privées ;
— un appui logistique à l’assistance technique;
— des actions ponctuelles relevant du financement du Titre 4, du FAC, ou correspondant à un com-plément financier à un projet FAC.
L’instruction transmise par la lettre no 5037 du 9 mai 1996 du ministère de la Coopération définit les

11 7622 et 304898 euros.12 1,83 millions d’euros.
principales dispositions du Fonds social de développement (cf. annexe 4). Ces dernières s’appuient surle dispositif relatif au Fonds d’aide et de coopération (FAC) et s’inspirent en grande partie des règlesapplicables aux Crédits déconcentrés d’intervention (CDI) d’une part, aux procédures temporaires duFonds spécial de développement d’autre part.
Quatre principes caractérisent le dispositif du Fonds social de développement :
— l’intervention auprès de la «société civile», en complément des interventions plus «tradition-nelles» de la coopération française auprès de l’État partenaire, dans une perspective d’échangesentre ces acteurs ;
— la déconcentration et son corollaire, la responsabilité du chef de la MCAC, puis de l’ambassadeurà compter de la fusion entre les ministères des Affaires étrangères et de la Coopération: poursuitedu mouvement de déconcentration amorcé depuis 1977;
— l’application des règles de gestion du Fonds d’aide et de coopération (statut dérogatoire au droitbudgétaire, les dépenses n’étant pas soumises au contrôle financier de droit commun);
— la programmation des besoins: le poste définit une enveloppe dont il a besoin pour financer desprojets de développement dans les trois années qui suivent.
La mise en œuvre des crédits répond à huit critères principaux:
— Les projets éligibles au Fonds social de développement doivent être d’un montant unitaire définientre des seuils «plancher» et «plafond» respectivement fixés à 50000 FF et 2000000 FF 11 ;
• ces seuils sont plus élevés que ceux des fonds antérieurs. La rédaction de l’instruction est légère-ment ambigüe, on peut comprendre ces seuils comme portant sur le montant du projet (article 2du protocole de financement), sur les « financements externes», donc hors participation des béné-ficiaires (§2.1.1 de l’instruction), ou sur la seule contribution française, pour le seuil inférieur de50000 FF (dernière phrase du § 2.1.1 de l’instruction).
— Les FSD sont financés à hauteur d’environ 15 % des crédits totaux alloués au pays (enveloppeFSP);• les bénéficiaires de l’aide accordée disposent impérativement de la personnalité morale;
• la participation du bénéficiaire doit au moins être égale à 30 % du coût total du projet. Ellepeut prendre la forme d’une contribution financière, d’une fourniture de terrains, de locaux, dematériels ou d’équipements pour la réalisation du projet, de main d’œuvre, ou encore d’une par-ticipation à la conception et à l’élaboration du projet ;
— Chaque projet doit être délimité dans l’espace et dans le temps.
— La durée d’ouverture de l’autorisation de programme est au maximum de trois ans.
— La durée d’exécution du projet doit être d’une durée inférieure à deux ans, délai compris entre ladate de signature du protocole de financement et la date du dernier paiement.
— Les décaissements, versés en une ou plusieurs tranches, sont assurés par la représentation locale dela Caisse française de développement (actuelle AFD).
La procédure effectue une importante distinction entre les pays suivant le montant de l’enveloppeFAC/FSP qui leur est consenti :
— dans les pays de la zone franc et les pays pour lesquels la programmation annuelle des cré-dits du FSP dépasse 12 MFF 12, les crédits déconcentrés sont divisés en deux guichets. Le pre-mier guichet «dit guichet ‘État’» doté d’un tiers des crédits au maximum, est destiné à financerles projets bénéficiant à l’État et à ses services déconcentrés. Le deuxième guichet «dit guichet‘FSD’», doté de deux tiers des crédits au minimum, est affecté aux projets présentés par les acteursde la société civile et les collectivités territoriales.
42Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001

43Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
13 45734 euros.
• «Tous les projets de développement éligibles au FAC sont éligibles au 1er guichet» : c’est à pro-pos du 2e guichet, dit «FSD», qu’il est précisé: «sont éligibles, les opérations visant en prioritédes réalisations physiques dans les secteurs sociaux et les services collectifs. Les dynamiquesmicro-économiques de groupe, créatrices de revenus et d’emplois, seront favorisées. Les projetsinterviendront de préférence en milieu urbain, au bénéfice des populations pauvres, sans exclu-re des opérations en milieu rural concourant aux mêmes objectifs.»
— Dans les autres pays, les crédits déconcentrés sont regroupés en un guichet unique dont bénéficientaussi bien l’État et ses services déconcentrés que la société civile et les collectivités territoriales.
• Dans ces autres pays, «tous les projets de développement éligibles au FAC sont éligibles au gui-chet unique »
— Dans les deux cas, cependant, l’instruction fixe pour objectif de «rapprocher la prise de décisionet la mise en oeuvre des projets, de leurs bénéficiaires. De ce rapprochement sont espérées unemeilleure adéquation aux réalités locales et l’émergence de nouveaux partenaires, issus de lasociété civile». La société civile et les représentants de l’État sont associés à la préparation et à lasélection des projets au sein d’un comité consultatif, consulté a minima pour les projets du 2e gui-chet d’un montant supérieur à 300 kFF 13.
Chaque SCAC est tenu d’établir un arrêté de clôture à l’issue du projet. Il dispose sur chaque envelop-pe de crédits déconcentrés, d’une enveloppe plafonnée à 2 % du montant total des autorisations depaiement, pour financer les dépenses relatives au suivi et au contrôle des projets (contre 5 % surles CDI).
• Le SCAC peut également passer des marchés de suivi de projets avec «un opérateur, de préfé-rence local», en imputant le coût de suivi sur le budget de chaque projet. Prévue par l’instruc-tion, la forme de «marchés à bons de commande» permet d’ailleurs au SCAC de généraliser cesystème au suivi par un opérateur de la totalité des projets.
En tant que de besoin, des assistants techniques peuvent participer au suivi et même à la réalisation deprojets, en tant que «chefs d’opérations», sous réserve d’une autorisation formelle de l’État.
Une enveloppe fixée à 0,5 % du montant de l’enveloppe des crédits déconcentrés ouverte par le comi-té directeur, est réservée au contrôle et à l’évaluation des projets par le ministère, sans préjuger descompétences de l’Inspection générale des Affaires étrangères. Ces crédits sont gérés et mis en œuvrepar le ministère.
La procédure vis-à-vis de Paris est la suivante :
— Le SCAC rédige un rapport de présentation, adressé au comité directeur, rapport qui demandel’ouverture des autorisations de programme. Ce rapport comporte un descriptif et un bilan de chacundes projets réalisés ou engagés dans le cadre de l’enveloppe en cours, et une présentation des actionsenvisagées dans le cadre de la future enveloppe financière (un plan est joint, voir annexe 1 de l’ins-truction figurant au 7.3 de ce rapport).
L’ouverture d’une enveloppe de crédits est soumise à deux conditions principales : d’une part, les cré-dits de l’enveloppe précédente doivent avoir été engagés à hauteur de 75 %, et d’autre part, les comptes-rendus financiers récapitulatifs de l’utilisation des crédits de l’enveloppe précédente doivent avoir étévisés et certifiés par le poste puis envoyé au ministère, en pièce jointe au rapport de présentation del’autorisation de programme demandée.
— Le rapport de présentation est examiné en comité d’examen. Ce comité fonctionne suivant lesmodalités retenues par la circulaire ministérielle du 25 novembre 1986 qui instaurait un comité desélection des projets. Le comité d’examen vérifie l’ensemble des paramètres permettant de reconnaîtreun projet comme viable. Il examine les questions de fond soulevées par chaque projet ainsi que lesaspects techniques. Il s’assure de l’achèvement de la mise en œuvre technique du projet et de son éli-gibilité au financement. Le bureau du FSP assure la préparation et le bon déroulement des travaux du

44Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
comité d’examen. Il enregistre les décisions de cette instance et transmet les dossiers retenus au comi-té directeur pour décision.
Le bureau de l’évaluation fournit un avis écrit sur le rapport de présentation. Dans le cas des CD/FSD,compte tenu du caractère général des orientations qui figurent sur chaque rapport, cet avis porte plussur la façon dont sont présentées les opérations passées que sur la pertinence des projets eux-mêmes.
Concernant la forme du rapport de présentation, le bureau de l’évaluation a proposé en 1999 (le docu-ment dont nous disposons est à l’attention du SCAC Madagascar) un plan-type en trois parties de natu-re à mieux dégager le lien entre situation nationale et orientations du FSD:
• un premier chapitre décrit le cadre du projet (rappel de la situation économique, rappel des enjeux etdes priorités de la coopération française, description des principaux acteurs de la société civile) ;
• un deuxième chapitre dresse le bilan général, mais aussi par secteurs et par régions, des opérationsfinancées jusqu’à ce jour sur les précédentes enveloppes;
• enfin une présentation claire des orientations et des objectifs que l’on fixe à la mise en œuvre de lanouvelle enveloppe ainsi que de ses modalités de mise en œuvre (procédures et critères de sélectiondes projets, modalités de suivi et d’évaluation…).
— Institué par le décret no 59-464 du 27 mars 1959, le comité directeur prend les décisions relativesà l’utilisation des crédits inscrits au Fonds de solidarité prioritaire (donc au Fonds social de dévelop-pement). Cette instance se réunit trois à quatre fois par an, pour examiner aux fins d’adoption, les pro-jets d’opérations présentés par les services du ministère des Affaires étrangères, sur proposition desacteurs locaux.
Compte tenu du nombre de dossiers inscrits à l’ordre du jour de chacune des séances du comité direc-teur (dont les projets FSD ne constituent qu’une partie), cette structure tend généralement à entérinerles propositions du comité d’examen.
La procédure à suivre dans chaque pays est également définie par l’instruction:
— Protocole d’accord à signer avec l’État «dans les pays disposant de deux guichets» (article 1.2 del’instruction) : il fixe les grandes lignes des interventions du FSD de même que la composition et lesattributions du comité consultatif.
— Organisation d’un comité consultatif. Il peut être uniquement interne au SCAC en cas de guichetunique, ou pour les projets relevant du 1er guichet. Il «est composé de représentants de l’État et de lasociété civile», auxquels «peuvent être adjoints» «des représentants d’autres bailleurs», et il est«placé sous la coprésidence du chef de mission [SCAC] et du directeur d’agence locale de [l’AFD]»,pour le 2e guichet. Cependant, «les projets d’un montant inférieur à 300 kF peuvent être instruits parle comité consultatif constitué dans la formation simplifiée du 1er guichet».
— La décision revient dans tous les cas au chef de SCAC (instruction écrite avant la fusion des minis-tères).
— Protocole de financement à signer avec le porteur de projet, pour lequel un modèle est donné(article 2 de l’instruction).
— Protocole de clôture à signer avec le porteur de projet.
L’instruction étant plus précise sur les modalités de la mise en œuvre des financements CD/FSD quesur la nature de ceux-ci, on remarquera que la Cour des Comptes, dans son rapport sur les procéduresde gestion des crédits des Missions de coopération et d’action culturelle, met précisément en causeles Crédits déconcentrés (1996-1999) sur le plan de la nature des opérations financées:
«Certains instruments du FAC, notamment les Crédits déconcentrés d’intervention (CDI),ont parfois été utilisés à des fins différentes de celles pour lesquelles ils avaient initialementété prévus. C’est ainsi qu’ayant pour but d’aider des opérations physiques de petite dimen-sion «favorisant les dynamiques micro-économiques créatrices de revenus et d’emplois», lescrédits déconcentrés d’intervention ont été utilisés à des opérations n’ayant pas de lien avecle développement, tels le financement de colloques et de séminaires, l’achat d’équipements

45Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
14 L’encadré ci-dessous reproduit la présentation du questionnaire tel qu’il a été envoyé aux SCAC. Il en ira de même lorsd’autres citations relatives à ce questionnaire, plus loin dans le présent rapport.Les 4 réponses proposées s’interprètent comme «nettement la première proposition, plutôt la première proposition, plutôt laseconde, nettement la seconde».
de bureau, de matériels, voire de véhicules, au Gabon et au Togo par exemple, pour les admi-nistrations locales».
Mais le rapport d’évaluation antérieur de MP Conseil/ICEA sur les CDI indiquait que ces utilisationshors normes, répondant à des pressions constatées dans tous les pays, ne mobilisaient qu’unfaible pourcentage des crédits.
1.4. LES CD/FSD COMME ÉLÉMENT DU FONDS DE SOLIDARITÉ PRIORITAIRE (FSP)
Faisant suite à la réforme institutionnelle de la coopération française, la création du Fonds de solidari-té prioritaire (FSP), succédant au Fonds d’aide et de coopération (FAC), a été décidée par décretno 2000-880 du 11 septembre 2000, circulaire d’application du 6 décembre 2000.
En conséquence, le champ des CD/FSD est élargi à la ZSP, plus large que l’ancien «champ», et desenveloppes CD/FSD sont accordées au Zimbabwe, au Ghana, à l’Afrique du Sud, au Vietnam, etc.
Les nouvelles orientations du FSP par rapport au FAC posent dans le principe, une question depositionnement aux CD/FSD. Le FSP a en effet pour vocation la coopération institutionnelle, tandisque les infrastructures servant au développement économique et social relèvent désormais uniquementde l’AFD. Un agent du Bureau de l’évaluation indique ainsi au comité d’examen en mars 1999: «Laquestion qui resterait en suspens est la justification de ces micro-financements pour des types d’opé-rations et dans des secteurs où le ministère n’est plus appelé à intervenir directement».
Dans la pratique, les projets à vocation économique, clairement envisagés par l’instruction du 9 mai1996, sont rares car les postes évitent, voire souvent excluent, de financer sur CD/FSD les projets d’en-treprises privées nationales.
Certes, la vocation des CD/FSD comme élément de la relation entre les postes et la société civile n’estpas affectée par la réforme institutionnelle française. Mais, encore faudrait-il que, contrairement à cequ’indiquent les évaluations précédentes, cette dimension de «relations avec la société civile» prennele premier rang par rapport à la dimension «petites opérations d’investissement».
La situation reste pour le moins ambiguë, à en juger par les réponses des SCAC à une enquête par cour-rier électronique, menée pour l’évaluation:
Réponses de 32 SCAC à un questionnaire dans le cadre de l’évaluation:questions sur la gestion des CD/FSD 14
Choisir entre les réponses… Plutôt Plutôt … proposées à gauche et à droite<- <- -> ->
Les SCAC sont une structure 13 14 1 2 Les représentations d’autres particulièrement adaptée pour gérer bailleurs disposent d’organisationsun tel outil (CD-FSD) mieux adaptées
Les CD-FSD relèvent plutôt du 16 12 11 1 … plutôt de la coopération institu-financement du développement… tionnelle

46Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
2. MoyensDe 1996 à 2001, les CD/FSD ont représenté en moyenne 113 MFF (17,2 Mn €) d’engagements. Lesannulations partielles ou reliquats étant très faibles, ce chiffre d’engagements donne une bonne idée dela part de l’APD française consacrée à ce moyen d’intervention:
— 0,3-0,4 % de l’APD française ;
— environ 7 % du seul Fonds de solidarité prioritaire (FSP), qui représente environ 1200 MF(180 Mn €) par an;
— environ 17 % du montant total des FSP «État» dont les CD/FSD font partie, soit environ 650 MF(100 Mn €) par an.
Ce montant correspond à peu près au plancher défini par l’instruction de 1996: «dans tous les pays,l’enveloppe de crédits déconcentrés est fixée à 15 % au moins de l’enveloppe FAC annuelle du pays».
Il représente aussi un montant stable par rapport à l’époque des CDI, pour lesquels l’évaluation obser-vait une stabilisation sur la période 1990-1993 à 110 MFF/an, soit à l’époque 12 % des crédits FAC-État. La fusion des dispositifs CDI et FSD (fonds spécial) n’aura donc pas correspondu à une crois-sance des montants dédiés à cet outil ; on peut même parler d’une baisse en monnaie constante.
Sont pris en compte dans ces totaux, et intégrés dans les tableaux qui suivent, quatre enveloppes impor-tantes de crédits déconcentrés gérés comme des CD/FSD, enveloppes allouées dans des circonstancesparticulières, totalisant 54 MFF, soit 8 % du total :
— Le Programme de développement local aux Comores (PDLC), 1998, 20 MFF.
— Le projet Appui aux initiatives privées en RD du Congo, 1999, 9 MFF.
— Le Programme post-urgence de reconstruction suite aux inondations, Mozambique, 2000, 15 MFF.
— Le Fonds d’appui aux initiatives privées sur crédits déconcentrés, Niger, 1999, 10 MFF.

47Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Engagements d’enveloppes CD/FSD, 1996-2001, en millions de francs français 15
Millions de Francs 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Afrique du Sud 3,94 3,94Angola 3,00 3,00 8,00 6,00 8,00 28,00Bénin 4,50 6,50 5,00 6,00 6,00 6,00 34,00Burkina Faso 7,00 7,00 7,00 7,50 28,50Burundi 3,00 5,00 4,00 12,00Cambodge 8,00 8,00Cameroun 15,00 5,00 10,00 9,00 10,50 49,50Cap Vert 2,00 2,00 2,50 2,00 8,50Centrafrique 4,00 4,00 8,00Comores 4,00 20,00 3,00 27,00
Congo 4,50 9,00 13,00 26,50Côte d’Ivoire 7,50 6,00 15,86 29,36Cuba 1,00 1,00Djibouti 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 5,25 12,25Est Caraïbes (Petites Antilles) 2,00 2,50 3,00 7,50
Ethiopie 3,00 3,00Gabon 2,00 3,00 3,00 8,00Ghana 2,00 2,00Guinée 5,95 6,00 11,95Guinée Bissau 4,00 3,50 7,50
Guinée Equatoriale 2,00 1,50 3,50Haïti 5,40 7,00 6,00 6,00 4,00 18,01 46,41Kenya 4,00 4,00Liban 4,00 4,00Libéria 2,00 2,00
Madagascar 5,00 9,00 4,00 9,00 27,00Mali 10,00 6,00 10,00 10,50 36,50Maurice 2,00 2,00Mauritanie 6,00 6,00 12,00Mozambique 4,00 22,00 26,00
Namibie 3,00 3,00 6,00Niger 5,00 6,30 15,00 10,00 36,30Nigéria 4,00 4,00Palestine 9,84 9,84RD Congo 14,00 9,00 16,00 39,00
République Dominicaine 1,00 1,00Rwanda 2,00 3,00 8,00 13,00Sao Tome 3,20 2,00 5,20Sénégal 11,00 8,00 19,00Seychelles 3,00 3,00
Tchad 6,00 5,00 7,00 6,00 5,00 29,00Togo 7,00 7,00 8,00 22,00Vanuatu 3,50 3,50Vietnam 3,00 3,00Zimbabwé 2,00 2,00
TOTAL 120,55 73,30 113,50 114,50 151,50 102,39 675,74
15 Tous les projets adoptés en comité des projets jusque fin 2001 sont intégrés. Les CD/FSD numérotés «2001» mais adop-tés en 2002 ne sont pas intégrés. N’est pas intégré un éventuel financement (les sources divergent) de 1 MFF aux Seychellesen 1996.

48Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
16 Tous les projets adoptés en comité des projets jusque fin 2001 sont intégrés. Les CD/FSD numérotés «2001» mais adop-tés en 2002 ne sont pas intégrés. N’est pas intégré un éventuel financement (les sources divergent) de 152449 euros auxSeychelles en 1996.
Engagements d’enveloppes CD/FSD, 1996-2001, en milliers d’euros 16
Millions d’euros 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Afrique du Sud 600 600Angola 457 457 1220 915 1220 4269Bénin 686 991 762 915 915 915 5184Burkina Faso 1067 1067 1067 1143 4345Burundi 457 762 610 1829Cambodge 1220 1220Cameroun 2287 762 1524 1372 1600 7546Cap Vert 305 305 381 305 1296Centrafrique 610 610 1220Comores 610 3049 457 4116Congo 686 1372 1982 4040Côte d’Ivoire 1143 915 2418 4477Cuba 152 152Djibouti 152 152 229 229 305 800 1867Est Caraïbes(Petites Antilles) 305 381 457 1143Éthiopie 457 457Gabon 305 457 457 1220Ghana 305 305Guinée 907 915 1822Guinée Bissau 610 534 1143Guinée Équatoriale 305 229 534Haïti 823 1067 915 915 610 2746 7075Kenya 610 610Liban 610 610Libéria 305 305Madagascar 762 1372 610 1372 4116Mali 1524 915 1524 1601 5564Maurice 305 305Mauritanie 915 915 1829Mozambique 610 3354 3964Namibie 457 457 915Niger 762 960 2287 1524 5534Nigéria 610 610Palestine 1500 1500RD Congo 2134 1372 2439 5946République Dominicaine 152 152Rwanda 305 457 1220 1982Sao Tome 488 305 793Sénégal 1677 1220 2897Seychelles 457 457Tchad 915 762 1067 915 762 4421Togo 1067 1067 1220 3354
Vanuatu 534 534
Vietnam 457 457
Zimbabwé 305 305
TOTAL 18378 11175 17303 17455 23096 15610 103017

DEUXIÈME PARTIESociétés civiles des pays
d’intervention et émergence de projets


51Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
17 Une étude commandée par la DGCID va, dans les prochains mois, réaliser un portrait de ces sociétés civiles du Sud.18 Le terme «d’ONG professionnelles» est également souvent utilité (p. ex. dans le rapport IRAM pour le MAE, «Luttecontre la pauvreté et les inégalités», 2000). De fait ces ONG sont aussi en général celles qui ont plus de permanents que deréseaux militants ou sympathisants.
Les CD/FSD sont destinés à la fois à financer des petits projets et à rapprocher la coopération françai-se de la société civile. Il est utile d’examiner dans quelles circonstances des «acteurs de la société civi-le» peuvent contribuer à « l’émergence de projets» (2.3 infra), ce qui demande au préalable d’identi-fier ces acteurs de la société civile (2.1) et d’examiner comment les bailleurs mettent en œuvre despetits projets (2.2).
1. Les sociétés civiles dans les pays du Sud«Par “représentants de la société civile”, on entend des personnes morales de droit privé(associations, coopératives, entreprises, groupements divers…) ou de droit public à caractè-re local (collectivités territoriales et leurs établissements publics).»
Instruction du 9 mai 1996 sur les CD/FSD
Les notes portant sur chacun des 6 pays étudiés sur place intègrent une analyse rapide de la situationsocio-économique propre à chaque pays – la stratégie d’utilisation de crédits déconcentrés est par défi-nition liée à chaque situation nationale.
Il en va de même pour les relations des acteurs de la coopération française avec la «société civile»,mode d’organisation des sociétés nationales face au contexte moderne: chaque société civile est évi-demment spécifique, à l’exception peut-être des formes d’organisation les plus directement suscitéespar la présence des bailleurs.
Définir par défaut la «société civile» comme «l’ensemble des acteurs organisés dans des structuresdéclarées, autres que l’État», laisse ouverts tant les modes d’organisation que les raisons de cette orga-nisation.
Pour spécifier la nature de l’autre partie contractante sur projet FSD, l’instruction sur les CD/FSD uti-lise des termes juridiques à portée internationale. Les «représentants de la société civile» y sont défi-nis comme les «personnes morales de droit privé […] ou de droit public à caractère local». Cette ins-truction laisse ouverte la question des personnes physiques et des réalités sociales qui sont ainsi repré-sentées. Par ailleurs, comment qualifier les organisations qui ne bénéficient pas d’une personnalitémorale juridiquement reconnue?
L’un des deux objectifs des CD/FSD étant la coopération avec les sociétés civiles, il est nécessaire, mal-gré la très forte diversité des pays, de présenter ici les grandes composantes des «sociétés civiles»identifiées par les évaluateurs 17.
— La composante la mieux identifiée par les bailleurs est celle que, de façon générale, leur recherchede relais opérationnels a suscitée: les ONG de projets, équivalents approximatifs des associations àactivité commerciale relevant de la loi 1901 en France 18.
Quand un agent de la coopération française dit que la société civile nationale est «dynamique» ouqu’elle est «embryonnaire», il fait souvent référence à ces relais opérationnels.
— Les collectivités locales sont, de plus en plus souvent dans les pays du Sud, dirigées par des élus,

52Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
19 Cf. par exemple la définition de la société civile que donnent MM. Stéphane Hessel et Khémaïs Chammari, «Missiond’Observation Burundi» de la FIDH, «Soutenir la société civile»:
«Par delà les débats sémantiques et conceptuels qui nourrissent une abondante littérature sur la notion de sociétécivile, nous retenons l’approche qui regroupe sous cette expression les instances, les associations, les personnalitéset les médias qui ont la vocation de garantir ou de protéger, en dehors des institutions de l’État, l’exercice effectifdes libertés publiques et de favoriser l’émergence et l’affirmation autonome d’une identité collective pluraliste fon-dée sur des projets économiques et sociaux de base et sur une culture de la citoyenneté».
et se voient reconnaître par l’État un champ d’intervention croissant (courant de décentralisation, sousla pression des bailleurs), à défaut de moyens financiers importants.
Même un maire nommé par l’État sera souvent considéré comme proche de la «société civile» du faitde sa dépendance, pour la réussite de son action, envers la population locale.
— Entendue au plan des personnes plus que des organisations, la «société civile» désigne la fractionde l’élite socio-politique qui se tient en marge de l’État ; cette «société civile» a des liens importantsavec la vie politique, à divers titres :
• acteurs économiques de premier plan pour qui sont importantes les bonnes relations avec l’Étatquel qu’il soit : leurs organisations sont les Chambres de commerce par exemple;
• animateurs de l’opposition;
• institutions intervenant dans la vie politique en dehors des instances de conquête du pouvoir :organisations de plaidoyer («advocacy») comme au Mozambique, structures de représentationpolitique d’associations aux vocations diverses (collectifs). Certaines de ces institutions se limi-tent à quelques personnes de l’élite socio-culturelle, à l’image de «Reporters Sans Frontières» enFrance, d’autres ont une large implantation jusque dans les villages, comme la ligue Iteka (liguedes droits de l’homme) au Burundi 19.
— Le terme de «société civile» peut également désigner le mode d’organisation ou «de structu-ration» des citoyens au plus petit niveau géographique («à la base», au niveau des «communau-tés»). Absente de l’instruction de 1996, cette dimension apparaît dans des textes ultérieurs sur le FSD:par exemple, le FSD est «destiné au financement de projets d’investissement communautaires» selonun discours du ministre Charles Josselin au Burkina Faso (juin 2001). Ces modes d’organisation varientfortement d’un pays à l’autre :
• structures de relations très anciennes et bénéficiant d’une forte légitimité comme dans de nom-breuses sociétés rurales africaines (chefferies de village, associations masculines ou féminines declasses d’âge, castes professionnelles…);
• ramifications ultra-locales des structures administratives (chefs de quarterão ou groupe de10 maisons, au Mozambique; chefs de sous-colline au Burundi) : ces ramifications peuvent êtredes formes de contrôle du niveau local par le niveau central plus que d’expression de la base;
• le terme de «groupement» ou de «coopérative», dans lequel sont supposés s’associer des per-sonnes de même métier (maraîchères, pasteurs, potiers…) correspond souvent, soit à un nom à lamode pour une structure ancienne (caste, clan…), soit à la présentation, à l’usage des bailleurs,d’un entrepreneur privé servant d’intermédiaire entre l’argent extérieur et les producteurs. Voireaux deux à la fois, comme dans une oasis de Mauritanie où le président d’une des coopérativesest un notable maure, commerçant international, tandis que les coopérateurs (cultivateurs) sontdes «harattines», Noirs dépendants de la famille du président.
• La création de groupements plus égalitaires se fait souvent parmi les jeunes ou plus encore parmiles femmes, là aussi dans le prolongement de fonctionnements associatifs traditionnels se tenantà l’écart des structures politiques formelles dominées par les hommes. Dans ces structures fémi-nines ou de jeunesse, on remarque souvent que les leaders, certes bien identifiés, peuvent assezfacilement être contestés, parfois publiquement, en cas de comportements contraires à l’objet del’association: un contrôle collectif joue.
— Dans plusieurs pays (parmi lesquels certains des pays étudiés par les évaluateurs : Mauritanie,Tchad, Burundi), s’est produit tout au long des années quatre-vingt-dix un mouvement de réinvestis-

53Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
20 Une figure majeure de l’Église catholique au Burundi, Mgr Simon Ntamwana, archevêque de Gitega, mettait ainsi publi-quement en cause, en 2000, la participation aux négociations de paix de certains organismes: «nous voudrions […] peut-être[…] demander à ceux qui ne sont pas dans la société civile ou ceux qui n’ont pas ce profil là de ne pas perdre leur temps àprendre la place de la société civile alors qu’ils sont des émanations de partis ou d’idéologies».21 Nous bouclons ce rapport quelques jours après le soulèvement militaire du 19 septembre 2002.
sement, dans les régions, des personnes «originaires» ou «ressortissantes» de ces régions, maisqui ont fait entre temps carrière dans les grandes villes. Ces personnes, même si elles continuent à pas-ser l’essentiel de leur temps dans ces grandes villes, deviennent alors de puissants acteurs du change-ment économique et social dans leur région. Avec la démocratisation et la décentralisation, cela se tra-duit souvent par l’obtention de mandats électifs locaux qui consacrent leur fonction d’ambassadeursdes sociétés locales auprès des structures urbaines modernes.
— Beaucoup des pays étudiés sont marqués par de profonds clivages ethniques ou régionaux qui,bien qu’ils ne trouvent souvent aucune formalisation juridique (en l’absence d’élections à l’échellerégionale, ou de quotas ethniques dans les assemblées), jouent un très grand rôle dans la vie sociale etéconomique. Des structures juridiques aux vocations apparentes diverses sont parfois les expres-sions de ces clivages: ainsi en est-il au Burundi de certaines associations patronales ou étudiantes, quisoutiennent la «ligne dure», opposée aux accords de paix d’Arusha, au sein de la minorité tutsi au pou-voir 20.
— Les Églises et autres communautés religieuses sont des «acteurs de la société civile» à de mul-tiples niveaux:
- comme organisations sociales (on peut dire qu’elles «structurent les populations à la base»),
- comme ONG opérateurs de projets (avec certains personnages de «bâtisseurs» charismatiques,expatriés ou nationaux, dont la culture professionnelle est proche de celle des SCAC – cf. cas deMadagascar),
- comme organisation de plaidoyer au plus haut niveau socio-politique (Madagascar, Tchad,Burundi…), voire par un rôle politique direct de certains de leurs membres (Haïti, Bénin…),
• ceci concerne particulièrement l’Église catholique du fait de ses structures hiérarchiques,mais s’applique aussi de façon moins ouverte à des organisations musulmanes, confréries(Sénégal) ou associations (Niger).
Enfin, les entreprises privées, formelles ou informelles, répondent bien à la plupart des définitions dela «société civile», notamment celle qui figure dans l’instruction de 1996 sur les CD/FSD.
Dans la réalité, bien entendu, les frontières entre ces catégories ne sont pas étanches et beaucoup depersonnes agissent sur plusieurs plans, notamment dans et en dehors de l’État. C’est particulièrementsensible dans les localités de province, comme le traduit à sa façon une dépêche de presse après la mortdu ministre ivoirien Émile Boga Dougou 21, événement qui semble bousculer sa ville natale aux plansadministratif, traditionnel, commercial, religieux voire ethnique – tandis que le plan «politique» ausens français du terme n’est même pas évoqué (la dépêche est citée intégralement).
Après la mort de Boga Doudou, ministre d’État : Lakota sous le choc
Après l’annonce de la mort de Boga Doudou Emile, ministre d’État, ministre de l’Intérieuret de la Décentralisation, c’est la consternation à Lakota, sa ville natale.A l’entrée de la ville, le corridor jadis grouillant de monde, ressemble à un désert. Seuls lesagents des forces de l’ordre continuent leur patrouille. Ce sont des visages affligés par la mortde leur député que nous avons rencontrés. Pour M. Gnahoua Boga Bertin, planteur, «c’est lepeuple dida qui est mort. C’est le bâtisseur de Lakota que Guéi vient de tuer. C’en est finipour cette région qui commençait à décoller». Nous avons croisé des femmes aux visagesbadigeonnés de kaolin, exécutant des danses funèbres et chantant le nom du défunt. A la garede Néko, village natal du ministre Boga Doudou, tous les véhicules qui assurent cette ligne,ainsi que les autres trajets sont garés. Interrogé, un apprenti nous déclare que le véhicule qui

54Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
s’est rendu hier à Néko à 14 heures n’est pas encore de retour ce matin 20 septembre. Pourlui, la mort de Boga Doudou va freiner les travaux de reprofilage des routes entamés dans ledépartement. Seuls les taxis-ville circulent à Lakota. Nous n’avons pas pu nous rendre àNeko, faute de véhicule.Au bureau du syndicat national des transporteurs, M. Nouho Dosso, le secrétaire de section,témoigne que «le ministre Boga Doudou ne faisait pas de discrimination entre Dida et allo-gènes d’une part et entre musulmans et chrétiens d’autre part». A preuve, ajoute-t-il, il aenvoyé onze personnes à La Mecque l’année dernière. Pour les transporteurs, c’était un ras-sembleur. C’est une grande perte pour la région, conclut-il.À Lakota, tous les services publics (préfecture et sous-préfecture) sont fermés. La ville estencore sous le choc et ressemble à une cité morte.
Soumaïla Bakayoko, Fraternité matin (édition en ligne), no 11364 – 21 septembre 2002.
2. Les bailleurs de fonds
Les différents bailleurs de fonds expriment un intérêt croissant tout au long des années 90 sur ledéveloppement social, les micro-projets, la décentralisation. Ils s’efforcent depuis quelques annéesd’aller encore plus loin dans cette orientation par le biais de contractualisations avec les gouverne-ments : l’allocation de ressources budgétaires nouvelles et l’allégement des dettes n’étant accordésqu’en échange, par exemple, de la mise en œuvre, par le gouvernement ou sous son égide, de pro-grammes de développement social.
Les différents bailleurs apparaissent donc principalement comme des acteurs parallèles et occasionnel-lement concurrents de la coopération française, de par le volume de fonds alloués à leurs programmesde micro-projets (PMR-FED ici, PDL là, etc.), ou en direction des collectivités locales (PAICALMadagascar…).
Comme dans tout système économique, les relations entre acteurs aux rôles similaires (ici lesbailleurs) sont aussi rares que les relations entre acteurs complémentaires (bailleurs et gouver-nements, bailleurs et opérateurs) sont fréquentes.
Des complémentarités apparaissent cependant entre deux bailleurs quand leurs moyens sont dis-semblables et complémentaires ; par exemple:
• le Japon dispose de peu voire pas du tout de personnel dans un grand nombre de pays et peut doncdonner des fonds par l’intermédiaire d’un bailleur présent, comme la France (et en pratique les ges-tionnaires des CD/FSD, par exemple en Haïti et à Madagascar) ;
• inversement, d’autres bailleurs ou organisations étrangères ont, dans le domaine du développement«à la base», plus de personnel dans les régions que la coopération française et peuvent donc servirde relais pour l’instruction et la préparation de projets CD/FSD: ainsi du service allemand de volon-tariat, le DED, au Tchad.
Les ONG de pays du Nord («internationales») ne se considèrent pas comme des bailleurs, mais relè-vent ici de cette catégorie plutôt que de la société civile (nationale). Elles sont bien perçues par lesnationaux comme des bailleurs. Les évaluateurs ont pu constater, en se rendant sur les lieux où plu-sieurs projets avaient été réalisés par des ONG du Nord, que la responsabilité et le financement du pro-jet étaient imputés par les habitants à cette ONG.
L’image d’organisations présentes à titre transitoire, et transférant des savoirs et modes d’orga-nisation aux nationaux, correspond à une réalité, mais doit être relativisée.
Dans certains pays, notamment dans les configurations de «sortie de crise», la présence des ONGinternationales augmente (Burundi) : des «nouveaux expatriés», à profil «humanitaire», payés surfonds étrangers, succèdent ainsi aux entreprises privées étrangères en relation financière avec la clien-

55Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
22 CILONG: Centre d’Information et de Liaison des ONG. FONGT: Fédération des ONG Tchadiennes.23 Op. cit., p. 113.
tèle ou les producteurs nationaux, entreprises qui ont cessé, réduit ou cédé leur activité lors des crisessocio-politiques.
Les ONG internationales souhaitent du fait de leurs principes, et pour des raisons de viabilité financiè-re, transférer leur activité à un personnel national, soit par embauche, soit par contractualisation avecdes structures nationales, soit par essaimage et création de telles structures (par exemple Interaide enHaïti). Elles restent néanmoins directement implantées, et, bénéficiant d’une relation privilégiée avecles bailleurs dont elles savent satisfaire les critères en matière de mode de gestion des projets, elles sontune concurrence parfois difficile pour les ONG nationales de création plus récente. Ce clivage se mani-feste par exemple au Tchad par l’existence de collectifs distincts pour les ONG internationales (leCILONG) et pour les ONG nationales (la FONGT22).
Plusieurs gouvernements tentent, soit de limiter l’extension et l’enracinement des ONG étran-gères, en privilégiant les ONG nationales (Mozambique), soit de maximiser leurs retombées écono-miques et leur transfert d’expérience, en leur imposant un ratio élevé d’employés nationaux (plus de80 % par exemple au Burundi).
Dans l’ensemble, la croissance des projets de développement local ou social promet une croissan-ce soutenue tant aux ONG internationales que nationales.
En effet, la croissance passée, présente et future des fonds alloués par les bailleurs au développementsocial, local, communautaire…, même si cela ne représente encore globalement qu’une petite fractionde l’APD, demande un personnel sur place bien supérieur à ce que mobilisent les projets d’infrastruc-tures lourdes mis en œuvre par des entreprises privées étrangères.
Ce secteur d’activité ne devrait donc pas connaître la crise et ce sont plutôt les bailleurs qui, dans laplupart des pays, sont à la recherche «d’opérateurs fiables» ou «d’ONG sérieuses».
Cela se traduit, du point de vue des parties étrangères, par un besoin de «formation» pour transfor-mer les porteurs de projets ou de revendications, nombreux parmi les personnes instruites mais sansemploi (appelés par exemple «diplômés-chômeurs» en Mauritanie), en opérateurs de projets pour lecompte des bailleurs.
Ce schéma est décrit de façon particulièrement claire, dans le cas du Yémen, par le rapport d’étude del’IRAM pour le MAE, «Lutte contre la pauvreté et les inégalités» 23 :
[…] Les bailleurs de fonds ont besoin de ces «agences de mise en œuvre» pour traduire enactions leurs programmes-cadres, et donc pour justifier leur présence dans le pays.La structure qui se dessine ressemble à celle de la sous-traitance, à divers titres: forte hié-rarchisation entre les divers types d’intervenants, cahiers des charges imposés ou pour lemoins influencés par le donneur d’ordres (ici le bailleur de fonds), dépendance du sous-trai-tant (ici les associations et autres organismes financés) […], opacité des termes de décisionet de choix, faibles transferts technologiques du haut vers le bas.Elle est, à plusieurs égards, juxtaposée plus qu’intégrée aux dynamiques endogènes, et tendà opérer une sélection parmi ces dynamiques, sur la base de critères qui ne sont pas forcé-ment d’efficacité mais […] de ‘capital social’: les ‘capacités’requises des associations quibriguent un soutien des programmes de lutte contre la pauvreté sont en premier lieu celle derédiger une demande de financement et un projet […], de savoir où s’adresser […], etc.Les aspects linguistiques sont au cœur du dispositif (…, il s’agit en particulier de) maîtriserles divers niveaux du langage globalisé introduit dans le pays par ce dispositif : les conceptset la terminologie produits par les organismes internationaux […]. Puis la traduction de cesconcepts dans le langage codé des programmes et projets […]; leur traduction technique endes actions ‘sur le terrain’; enfin le langage parlé avec les dites ‘communautés locales’, dontles champs sémantiques sont le plus souvent infiniment différents. […]

56Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
C’est une construction qui vient de l’extérieur […]. L’endogénéisation est néanmoins encours […], les ‘acteurs locaux’, ou ceux qui souhaitent en faire partie, apprennent à se repé-rer dans son architecture, intègrent progressivement son langage, intériorisent ses termes,règles et valeurs.
Un interlocuteur français dans l’un des pays visités a décrit aux évaluateurs, dans le même sens, une«greffe de société civile» à partir des ONG internationales : autre image pour une exogénéité quicherche à s’enraciner.
Ce fonctionnement collectif des bailleurs et des ONG peut aussi poursuivre un but politique. Dans cer-tains pays, le rejet, par les bailleurs, du pouvoir politique en place les conduit à financer les actions desONG en espérant favoriser ainsi l’émergence d’une contre-élite appelée à gérer ensuite le pays:
«Nous avons une forte réticence à travailler avec les autorités locales. [Avec les CD/FSD],on monte des contre-pouvoirs avec la société civile dans l’espoir de créer une nouvelle élitequi raisonnera selon des critères différents. Ces gens qui auront été capables de gérer desstructures, géreront un jour une [municipalité].» (Un ambassadeur de France, parlant desCD/FSD dans le pays où il est en poste).
3. L’émergence et la conduite de projetsde développement
3.1. QUI MET EN RELATION L’ARGENT ET LES BESOINS ?
Selon l’instruction du 9 mai 1996, «les crédits déconcentrés ont pour vocation de rapprocher la prisede décision et la mise en œuvre des projets FAC de petite taille de leurs bénéficiaires. De ce rappro-chement sont espérées une meilleure adéquation aux réalités locales et l’émergence de nouveaux par-tenaires, issus de la société civile».
Le simple fait de travailler avec un partenaire technique non étatique, comme une ONG, répond-il à ces objectifs? Y a-t-il vraiment rapprochement, adéquation aux réalités locales, émergence departenaires issus de la société civile?
Les différentes fonctions attribuées aux acteurs de la société civile, du statut de «représentants» à celui«d’opérateurs», sont toutes citées par l’instruction de 1996, mais ne sont pas clairement distinguées etil n’apparaît pas qu’elles correspondent en fait à des acteurs différents.
Les ONG nationales qui gèrent des projets, tout comme les ONG étrangères (françaises par exemple),constituent un milieu professionnel qui a d’une part son éthique, d’autre part sa clientèle : les bailleursde fonds. «Producteurs d’actions de développement» répondant à la demande de ces derniers, lesONG ne sont que fort rarement – et sont de moins en moins – représentatives des gens chez quices projets sont implantés (les «bénéficiaires finaux»). Comme le montrent quelques cas extrêmes –réalisations non utilisées, bâtiments à l’abandon… le fait que la mise en œuvre soit le fait de natio-naux ne suffit pas à garantir que le projet réponde à une attente, soit appropriable par les gens quis’en serviront dans la durée, etc.
Cependant, pour une coopération étrangère, entrer en relation avec les populations pauvres nese décrète pas. Il faut des mécanismes de rapprochement entre projets de bailleurs et réalités des«bénéficiaires». Concrètement, des intermédiaires sont nécessaires, pour prendre en charge l’in-génierie sociale et relationnelle qui constituera le vecteur du projet.
Qui joue ce rôle de médiateur entre l’argent et les besoins?
Ces médiateurs se recrutent en grande partie parmi les structures de la «société civile» décrites précé-

57Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
24 Cellule de liaison et d’information des associations féminines.
demment (2.1) – ONG nationales de projets, des associations locales parrainées par des personnes plusou moins haut placées, des élus locaux…
Selon la façon dont ces acteurs jouent ce rôle de médiation, les évaluateurs proposent la typologie sui-vante :
1. Médiateurs «de haut de bas» (top-down), à la recherche de terrains d’application pour des projetspermettant l’obtention de crédits :
— les assistants techniques,— les petites ONG de projets, parfois surnommées ONG «attachés-case».
2. Médiateurs «de bas en haut» (bottom-up), à la recherche de crédits pour satisfaire la demande desgens sur un territoire donné:
— les élus locaux,— les ONG implantées pour longtemps sur un territoire précis, comme TMD à Madagascar,— les associations originaires d’un territoire précis, comme l’AFEA à N’Djamena.
3. Médiateurs «autocentrés», dont les projets sont la principale production, et qui cherchent àmotiver ou à mettre en concurrence, selon les cas, tant les bailleurs que les territoires «bénéficiaires»:
— les ONG de projets à dominante technique comme ASSODLO en Haïti, KULIMA au Mozam-bique;
— les «binômes» que peuvent constituer localement un expatrié (AT…) et un élu (remarqué àMadagascar par exemple).
— À la frontière entre les deux dernières catégories, des acteurs autocentrés mais qui ont besoind’un important soutien populaire:
— les religions organisées, dont les Églises,— les organisations de masse ou de réseau.
3.2. DIMENSION SOCIALE ET DIMENSION ÉCONOMIQUE : COMMENT OBTENIR DES RÉSULTATS« SOCIAUX » AVEC UN SYSTÈME DE FINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS ?
Les projets viseront en priorité des réalisations physiques de petites dimensions dans les sec-teurs sociaux et les services collectifs. Les dynamiques micro-économiques de groupe, créa-trices de revenus et d’emplois, seront favorisées.
Article 2 du protocole type d’accord avec l’État national, annexé à l’instruction de 1996.
Comme la plupart des fonds des bailleurs, les CD/FSD excluent le financement de dépenses récur-rentes, et doivent financer des projets potentiellement autonomes, viables après la phase d’inves-tissement.
Cette description évoque la création ou le développement d’une entreprise, d’une activité rentable ; or,dans la pratique, et à l’image d’autres bailleurs, les SCAC excluent de mettre les fonds au servi-ce de projets d’entreprises privées nationales – ce qui constitue une accentuation de la doctrined’emploi des CDI antérieurs. Le financement du secteur privé est considéré comme revenant à l’AFD,malgré l’interruption du programme de celle-ci destiné aux PME, le programme AIPB (Appui aux nitiatives productives de base). Aucun poste n’inclut les entreprises dans sa perception de la «sociétécivile», en tout cas en tant que bénéficiaires potentielles de CD/FSD, malgré la citation explicite desentreprises parmi les acteurs de la société civile, dans l’instruction de mai 1996.
Ce paradoxe est d’autant plus sensible que la demande sociale elle-même porte sur des activités poten-tiellement rentables, notamment la demande des femmes. Le micro-crédit à vocation productive, dontle financement est exclu sur CD/FSD dans les 6 pays visités, vient en tête des attentes, signale laCELIAF, collectif d’associations féminines au Tchad 24.

58Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Comment ce paradoxe est-il traité? Au moins trois logiques ou critères sont utilisés pour le résoudre,ou à tout le moins le contourner.
— Critère de la distribution des revenus: les SCAC envisagent ouvertement le financement d’acti-vités à vocation économique dès lors qu’elles bénéficient à un grand nombre de personnes, par contras-te avec celles qui enrichiraient un petit nombre.
Par exemple, pour décider du financement d’une coopérative maraîchère, on veillera à ce que le nombrede coopérateurs soit élevé par rapport au chiffre d’affaires.
• Cela conduit-il à des structures économiques réalistes? cela dépend sans doute dechaque secteur d’activité et de chaque région, mais on observe parfois des détournementspatents de cette apparence «coopérative». De fait, dans des pays où le coût du capital estélevé par rapport à celui du travail, on voit mal comment le collectif des travailleurs peutrésister à une appropriation des moyens de production par des «riches», personnes privéesou institutions.
• L’opposition grand nombre/petit nombre fait-elle sens? Plus précisément, dans quellescirconstances peut-on espérer que la distribution des revenus restera relativement large?Dans une région donnée, cela renvoie notamment au choix du secteur d’activité du projet,par exemple au choix d’une activité consommatrice de main d’œuvre (exploitation de lagomme arabique plutôt que travaux routiers). Mais choisir une activité consommatrice demain d’œuvre, plutôt que de capital, reste paradoxal pour un fonds de financement d’in-vestissements : cela conduirait plutôt à de petits investissements unitaires accompagnés delarges composantes accompagnement/formation.
— Critère de la nature du service. Le caractère «social» de certains services est plus facilementreconnu que pour d’autres, même s’il y a «recouvrement des coûts»; en pratique cela concerne les ser-vices dont les acheteurs (non les producteurs) sont les habitants du lieu concerné: santé, scolarisa-tion (y compris l’école privée), marché, eau potable, assainissement, etc.
Les investissements sur ces projets ne devant pas générer de déficits récurrents, on demande aux struc-tures qui délivreront le service «social» de générer des revenus, d’être économiquement viables, brefde fonctionner comme des entreprises commerciales.
Ceci correspond bien à la conception française du service public : les services rendus par les collecti-vités locales, comme la fourniture de l’eau ou l’assainissement, sont réputés sociaux bien qu’ils visentl’obtention de bénéfices d’exploitation qui financent le fonctionnement général de la collectivité ;objectif qui conduit à garantir un monopole à l’offreur de services.
• Ce cas de figure est assez fréquent et les bailleurs, dont les SCAC, assument volontiers unegestion privée de ces services dès lors qu’elle prend la forme d’une délégation de servicepublic par une autorité légitime (État, commune…) ou considérée comme représentativepar le bailleur (comité d’usagers…).
Débat en comité consultatif CD/FSD au Tchad, mai 1999, sur le projet urbain de Mongo,incluant une composante de ramassage des ordures.[Par une note écrite remise au comité, le représentant d’un collectif invite à] impliquer lapopulation aussi bien dans la réalisation des infrastructures, la précollecte que dansl’acheminement des ordures [c’est lui qui souligne].
Extraits du PV de réunion:
La représentante du ministère […] met en exergue les problèmes liés au mode de gestiondes ordures ménagères. Elle a rappelé les mauvaises expériences déjà vécues avec lescomités d’assainissement de N’Djaména. Concernant notamment l’entretien des charretteset des bœufs, elle demande à qui reviendra cette charge, à la Mairie ou aux comités.[L’attaché sectoriel, en réponse,] a confirmé ce problème de gestion des moyens de dépla-cement des ordures ménagères: souvent, ces moyens manquent et la pérennité de l’actionn’est pas assurée. Ici, une nouvelle expérience est tentée: un système de prestation de ser-

59Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
vices. Ce sont des privés qui utiliseront les charrettes et qui seront chargés d’enlever lesordures.
Suite aux discussions, le projet a obtenu l’avis favorable de tous les présents.
• Cette option pour les services financés par la population locale reste paradoxale, car la pre-mière demande («sociale») des populations pauvres est souvent financière : ils préfére-raient avoir des opportunités de gagner de l’argent en produisant sur place des produits ouservices vendus ailleurs, aux plus riches ou à l’exportation.
— Logique de viabilité: dans certains cas, les bailleurs prennent acte du paradoxe, et le résolvent parun déguisement de la rentabilité économique derrière un affichage social. Les bailleurs retrouventalors la logique de viabilité technique, économique et financière qui est chère à nombre d’entre eux, eten particulier à la coopération française au cours des années couvertes par l’évaluation.
Beaucoup de projets qui nous sont présentés, sous un petit déguisement, visent à faire démar-rer une micro-entreprise, ce qui n’est pas mal, au contraire. […] Je veux lancer une PME deconfection, 10-20 machines… je dis qu’il s’agit de formation […] pour les enfants de la rue,les sidéens, les orphelins… Résultat des courses à terme: un atelier qui fonctionne. Ça peut[= aurait pu] faire l’objet d’un micro-crédit plutôt que d’un don… […] Les bailleurs de fondsvont volontiers financer quelque chose qui se pare d’oripeaux convenus. (Agent français auBurundi).
Les porteurs nationaux de projets, et les intermédiaires, ont bien compris le fonctionnement desbailleurs et respectent habituellement ce qui est devenu une «charte de nommage» implicite, avec des«mots magiques» comme «coopérative, groupement, autopromotion, entraide», etc., pour désignerdes entreprises créées à l’initiative d’une seule personne physique.


TROISIÈME PARTIEUtilisation de l’outil par les postes


63Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
1. Place des CD/FSD dans la stratégie nationaledes postes
1.1. CD/FSD ET RELATION AVEC L’ÉTAT
Crédits «déconcentrés» donc à la disposition des ambassades et SCAC, les CD/FSD sont l’un des ins-truments de leur relation avec leurs différents interlocuteurs nationaux, le premier de ceux-ci étantl’État.
Cependant, les CD/FSD ne représentent «que» de l’ordre de 17 % des FSP dédiés au pays (FSP-Étatpar opposition aux FSP mobilisateurs et «d’intérêt général»), et rarement plus de 3 % de l’ensemblede l’aide française aux pays concernés, dont des fractions bien plus importantes concernent la relationavec l’État.
— Il arrive donc fréquemment que les CD/FSD ne jouent pas, au moins en première analyse, unrôle majeur dans la relation des ambassades et SCAC avec les États nationaux.
On observe ainsi que, dans plusieurs pays disposant de «deux guichets», la proportion des fonds consa-crée au guichet «État» est inférieure au maximum d’un tiers autorisé. Dans des pays à guichet unique(pas de limite à la part «État»), on observe souvent une faible proportion, inférieure à un tiers, de fondspassant par l’État.
Plusieurs postes font état de pressions venant de divers acteurs au sein de l’appareil d’État pour béné-ficier de ces fonds. Cette information doit être relativisée. D’une part, ces pressions semblent partouttrès supportables, en tout cas dans les pays d’expression française, où le rapport de forces est en faveurde la France. D’autre part, le souci de bonnes relations avec l’appareil d’État ne conduit pas forcé-ment à des projets sur le «guichet État» mais peuvent aussi se traduire par des projets de collectivi-tés locales ou d’autres organisations de la société civile. Ainsi de la création de quatre carrefours gira-toires à Nouakchott, dont un près de la résidence du Premier ministre et un près de l’ambassade deFrance: c’est un projet traité avec la municipalité de Nouakchott (d’ailleurs non élue à l’époque). Demême, les CD/FSD ont financé simultanément au Burundi une ONG patronnée par la femme duPrésident de la République (tutsi) et une ONG patronnée par la femme du Président de l’Assemblée(hutu).
— Inversement, et au même titre que pour les projets FSP, certains projets «État» peuvent s’interpré-ter selon des logiques différentes d’un soutien aux titulaires du pouvoir d’État : acquisition de mousti-quaires pour les hôpitaux, financement de médiations pour la paix ou de services œuvrant pour l’étatde droit, réalisation de documentaires sur divers sujets par les médias nationaux, etc.
— Dans d’autres cas, en particulier là où le rapport de forces diplomatique est moins favorable à laFrance, par exemple au Mozambique, État lusophone qui a récemment adhéré au Commonwealth, leposte a pu obtenir de consacrer une forte proportion des CD/FSD à des actions avec l’État – deux tiersdans ce cas précis. Mais l’État n’apparaît pas forcément comme l’organisme bénéficiaire, en particu-lier dans l’enquête de recensement des projets CD/FSD, à laquelle ont répondu les SCAC en 2001(tableau ci-après).

64Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— Dans plusieurs pays, le positionnement de la France par rapport au pouvoir politique se traduit plu-tôt dans la répartition géographique des actions sur CD/FSD que dans le pourcentage «État»: faibleproportion de projets dans la région du fleuve en Mauritanie, question de l’équilibre entre hauts pla-teaux et côte à Madagascar, souhait de financer des projets au Nord dès la paix civile revenue au Tchad.
On peut cependant constater dans certains pays – non pas tous – une plus grande aisance des SCACà travailler avec les services de l’État qu’avec le nouveau milieu du développement, moins bienconnu des services français (conseillers sectoriels comme AT). L’orientation «sociale» et «société civile» que sont supposés prendre les CD/FSD est cependant claire pour tous les SCAC, qui sont d’ac-cord pour travailler avec des partenaires non-étatiques. Parmi ceux-ci, il y a la «société civile», maisaussi d’autres partenaires traditionnels de la France comme les ONG françaises et les institutions catho-liques.
1.2. CD/FSD ET RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
La question suivante a été posée aux SCAC par les évaluateurs pour situer les différents objectifs qu’ilsimpartissaient aux CD/FSD, notamment la place de la coopération avec la société civile, sur laquelleportaient la première, la troisième et la cinquième des 5 réponses proposées.
Bénéficiaire = État Nbre projets %Montant
(kFF) %ANGOLA 15 52% 8 459 62%BENIN 7 8% 1 578 7%BURKINA FASO 18 29% 4 807 28%BURUNDI 13 38% 2 187 32%CAMEROUN 9 13% 2 897 10%CAP-VERT 9 45% 2 940 56%CENTRAFRICAINE (R.) 5 26% 1 170 30%COMORES 0 0% 0 0%CONGO 2 11% 1 800 18%CONGO RDC 1 3% 918 4%COTE D'IVOIRE 1 2% 360 3%DJIBOUTI 10 42% 2 360 53%GABON 1 5% 135 3%GUINEE 11 23% 4 436 47%GUINEE EQUAT. 1 11% 90 5%GUINEE-BISSAO 3 30% 621 22%HAITI 33 31% 11 649 48%MADAGASCAR 5 10% 2 978 16%MALI 8 6% 1 080 4%MAURITANIE 1 5% 400 7%MOZAMBIQUE 4 29% 1 449 38%NAMIBIE 7 78% 2 165 74%NIGER 25 22% 4 421 17%PETITES ANTILLES 4 24% 1 115 31%RWANDA 1 11% 840 17%SAO TOME 6 40% 1 195 36%SENEGAL 2 5% 560 6%SEYCHELLES 13 87% 2 634 94%TCHAD 19 15% 6 202 29%TOGO 2 4% 800 5%Total 236 19% 72 246 21%Rappel total projets 1269 100% 340 987 100%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

65Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
25 Les réponses sont présentées dans ce rapport avec les mêmes termes et dans le même ordre que dans le questionnaire d’ori-gine.26 Dans les 6 pays visités, les évaluateurs ont perçu les objectifs des SCAC quant aux CD/FSD, différemment de ce qu’expri-ment les réponses des 6 mêmes SCAC à ce questionnaire. Les évaluateurs ont perçu une moindre importance de l’aide auxplus pauvres, et une plus grande importance de la diffusion de la culture française. Mais les évaluateurs classent aussi «Relierla coopération française à des acteurs non étatiques» parmi les principaux objectifs poursuivis.27 La «diversité autour de la moyenne» est mesurée par l’écart-type entre pays.
Enquête auprès des SCAC (32 réponses) — nombre de citations (2 réponses possibles) 25
Comment définir le mieux possible les objectifs des CD-FSD dans ce pays? Nb de citations
Favoriser des formes d’organisation nouvelles au sein de la société 12
Aider les gens les plus pauvres et atténuer leurs difficultés 24
Renforcer des structures qui mènent des projets de développement 11
Promouvoir l’enseignement, la culture, la langue française 3
Relier la coopération française à des acteurs non étatiques 22
Si l’aide aux plus pauvres apparaît en tête, avec en particulier 19 citations «en premier», le thème dela société civile vient en second sous la forme «Relier la coopération française à des acteurs non éta-tiques» 26.
De quels types d’acteurs non-étatiques s’agit-il, par rapport à la typologie définie précédemment (au2.2)?
Les SCAC classent ainsi les partenaires avec qui ils souhaitent travailler :
Avec qui LesquelsEnquête par mail auprès des SCAC (32 réponses). faudrait-il donnent les Lesquels3 questions différentes regroupées dans ce tableau. travailler de meilleures expriment le4 réponses possibles par question. façon plus garanties mieux lesL’ordre ci-dessous est celui du questionnaire. fréquente de qualité besoins etLes 4 réponses les plus choisies sont mises en gras. qu’avant, sur technique et les attentes
CD-FSD? de gestion? des habitants?Les syndicats et mouvements d’opinion 3 0 5Les ONG nationales et associations 22 9 22Les ONG françaises 9 22 5Les ONG venues d’autres pays 5 14 3Les autorités traditionnelles 2 1 7Les élus locaux 15 2 13Les institutions catholiques 3 15 11Les structures d’autres religions 1 5 3Les services de l’État dans les régions 8 2 4Les services centraux des ministères techniques 3 3 2Les opérateurs économiques nationaux 9 4 5Les autres bailleurs de fonds bilatéraux 13 12 2Les bailleurs de fonds multilatéraux 6 3 0Les habitants en direct (les bénéficiaires) 15 0 18
Aucun type de structure n’est bien classé selon les trois critères. Le seul à être bien classé pour ses qua-lités de gestion et sa représentativité est cependant rejeté comme partenaire avec lequel travailler (ils’agit des institutions catholiques).
Cette approche par critères laisse donc entière la question des choix de partenaires.
Les choix effectivement faits sont révélés par la répartition des projets entre types d’organisations béné-ficiaires (excepté le cas de l’État, cf. tableau au 3.1.1) 27 :

66Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Dans presque tous les pays, la catégorie des associations à but non lucratif est la plus représentée.Viennent ensuite, à peu près au même niveau globalement, les collectivités territoriales, les organisa-tions confessionnelles et les coopératives ou groupements divers. Dans presque tous les pays, les entre-prises privées sont exclues.
Ce tableau statistique ne renseigne pas sur le caractère «national» ou non des structures les plus repré-sentées, que sont les associations à but non lucratif.
Or l’étude dans 6 pays a permis d’identifier un bon nombre d’organismes animés par des expatriés:ONG de projets françaises, missions catholiques, etc. ; on trouve parmi les institutions catholiques desbénéficiaires de longue date, «abonnés» aux crédits déconcentrés, dont quelques-uns considèrentmême les concours sur CD/FSD comme des subventions utilisables, en cas de besoin, à d’autres usagesque ceux prévus par le projet officiellement présenté.
Ces organismes animés par des expatriés sont cependant minoritaires parmi les bénéficiaires desfonds CD/FSD, même dans les pays où leur relation avec l’ambassade et/ou le SCAC a été particuliè-rement étroite (Tchad…). De plus, dans le cas de l’Église catholique, la part décroissante de mission-naires au sein du clergé conduit à long terme à l’étiolement de ces relations privilégiées.
Statut de l'organisationbénéficiaire (% nb de projets)
Collect.terr.
Assoc.but non
luc.Org.
confess.Coop,
gpt div. Entrepr.ANGOLA 0% 31% 17% 0% 0%BENIN 2% 67% 15% 4% 0%BURKINA FASO 13% 39% 6% 8% 0%BURUNDI 3% 53% 6% 0% 0%CAMEROUN 43% 18% 7% 3% 0%CAP-VERT 20% 15% 0% 10% 0%CENTRAFRICAINE (R.) 11% 47% 16% 0% 0%COMORES 0% 50% 0% 0% 0%CONGO 11% 68% 0% 11% 0%CONGO RDC 0% 79% 5% 5% 0%COTE D'IVOIRE 14% 55% 18% 7% 0%DJIBOUTI 8% 38% 4% 8% 0%GABON 16% 53% 26% 0% 0%GUINEE 8% 33% 0% 2% 0%GUINEE EQUAT. 0% 22% 22% 44% 0%GUINEE-BISSAO 30% 10% 10% 20% 0%HAITI 7% 32% 17% 5% 1%MADAGASCAR 4% 65% 10% 8% 2%MALI 2% 58% 5% 12% 9%MAURITANIE 20% 40% 5% 25% 5%MOZAMBIQUE 21% 36% 7% 7% 0%NAMIBIE 0% 11% 0% 0% 11%NIGER 5% 23% 3% 46% 1%PETITES ANTILLES 24% 41% 0% 12% 0%RWANDA 56% 11% 22% 0% 0%SAO TOME 40% 13% 0% 0% 0%SENEGAL 7% 41% 27% 17% 0%SEYCHELLES 0% 0% 0% 0% 0%TCHAD 5% 54% 12% 14% 0%TOGO 13% 58% 8% 15% 0%Total 10% 43% 9% 12% 1%Répartition en % des fonds 15% 40% 8% 10% 1%Montant moyen en kFF 424 250 232 222 155Diversité autour de la moyenne 14% 20% 8% 12% 3%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

67Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Le cas des ONG françaises de projets est différent, et on pourrait supposer une tendance à la hausse deleur présence sur les CD/FSD. En fait, elles bénéficient de financements plus lourds par la France, oùelles ont leurs centres de décision et sont en relation, entre autres, avec le MAE (MCNG): pour lesONG françaises, les CD/FSD apparaissent comme une ressource d’appoint pour des projets ponc-tuels de petite dimension. Globalement, 8 % seulement des projets ont pour opérateur une ONG étran-gère (on reviendra plus loin sur la notion d’opérateur).
Le cas des «groupements» correspond souvent à celui de structures qui n’ont pas la personnalité mo-rale. Elles ne seront donc pas directement bénéficiaires des financements.
Le cas des collectivités territoriales est particulier. Toutes n’ont d’ailleurs pas la personnalité morale,faute de décentralisation: il peut s’agir en fait de services locaux de l’État. On observe une forte varia-bilité entre pays: la proportion de projets CD/FSD au bénéfice de collectivités locales est nulle danscertains pays, supérieure à 40 % dans d’autres (Cameroun, Rwanda, Sao Tome et Principe). Un des fac-teurs de variabilité peut être l’existence ou non de projets FSP spécifiques en faveur des collectivitéslocales, dans le pays concerné.
Le montant unitaire moyen des projets relevant de collectivités locales est pratiquement doublede celui des projets dont bénéficient les autres types de structure, 424 kFF, et nettement plus élevé quele montant unitaire moyen des projets avec l’État.
Globalement, dans la perspective de la décentralisation, réalisée ou non, les élus locaux apparaissentcomme des interlocuteurs privilégiés. Ils concilient souvent plusieurs légitimités (économique, sociale,démocratique) et sont en situation d’entreprendre pour le développement local. Ils font le lien entre lesprovinces et la capitale. Les fonds dont ils ont besoin sont souvent à l’échelle des CD/FSD et non deprojets de plusieurs millions de francs ou d’euros. Le caractère administratif de leur structure crée uneparenté avec le SCAC et facilite souvent l’échange d’informations ainsi que la gestion:
[Ça permettait] une opération bouclée nickel vis-à-vis du bureau des marchés. En face, lasociété civile est plus difficile à identifier, cerner, travailler avec. (Une personne d’un SCAC,à propos d’un gros projet avec la municipalité d’une capitale).
Il arrive, notamment sur plusieurs projets visités par les évaluateurs, que cette relation de la coopéra-tion française avec les collectivités locales reproduise le schéma et les limites de la relation avecl’État: la légitimité de l’interlocuteur et la parenté professionnelle semblent «dispenser» la partie fran-çaise d’aller voir au-delà, de rencontrer sur place d’autres acteurs que le pouvoir politique local.
Cette limite peut être particulièrement problématique quand la dépendance des collectivités locales parrapport à l’État fait des élus des obligés du pouvoir central autant que de leurs électeurs, quelle que soitleur étiquette politique initiale. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les capitales, qui sontsouvent les bénéficiaires des fonds CD/FSD les plus massifs (Yaoundé, Bujumbura, Douala,Nouakchott,…).
Si la relation avec les collectivités territoriales est en règle générale aisée, les conseillers de coopéra-tion ne sont en revanche pas intégrés dans les milieux professionnels du développement (notam-ment les ONG nationales), à l’exception de quelques pays (Mali dès les premières années du FSD…).Leur connaissance de ce milieu se limite parfois aux ONG nées par essaimage d’ONG françaises (ONGprofessionnelles notamment). Cette distance se vérifie aussi avec les organisations de plaidoyer, desdroits de l’homme, etc., et plus encore avec les autorités traditionnelles, de religions non européennes,etc. ; ce qui éloigne la représentation française de puissantes structures de pouvoir dans les pays du Sud.
Dans chacun des 6 pays étudiés, les appréciations que les SCAC portent sur leurs relations avec lasociété civile sont bien éloignées de l’appréciation des évaluateurs, comme des témoignagesrecueillis par ceux-ci auprès d’acteurs de la société civile (journalistes, collectifs, etc.). Les ambassadesapparaissent comme des «bunkers» – a fortiori depuis le 11 septembre – dont le citoyen moyen n’estpas légitimé à franchir la porte ; indépendamment des CD/FSD, les files d’attentes pour les visas dansde nombreux pays francophones, symbolisent pour les nationaux cette difficulté à accéder aux institu-tions françaises. Contrepartie positive, les gestes de la représentation française pour se rapprocher

68Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
des réalités sociales sont d’autant plus appréciés qu’ils sont rares, même s’ils sont maladroits (p. ex.au Tchad, hors CD/FSD, l’ambassade a donné à la presse du papier pour l’impression, mais en quan-tité très modeste, ce qui a permis aux éditorialistes d’en sourire).
En fin de compte, on peut tracer de premières pistes quant aux facteurs d’amélioration de l’image de laFrance auprès de l’élite socio-économique et du grand public dans les pays de la ZSP.
— La régularité, la fidélité de l’engagement d’un bailleur, par la présence humaine et le dialogueautant et plus que par le financement, apparaît comme un facteur d’image positive (p. ex. présenceitalienne, modeste mais remontant à des décennies, dans la lutte contre le paludisme au BurkinaFaso). Or un dispositif voué à financer des investissements ponctuels, comme les CD/FSD, n’estpas de nature à traduire cette fidélité dans la relation.
— Les nationaux assimilent assez volontiers ce que fait l’État français, ce que font les collectivités ter-ritoriales françaises et ce que font les ONG françaises. Cependant, les postes n’ont pas en règlegénérale de stratégie pour une synergie de leur propre action sur CD/FSD avec celle de la sociétécivile française.
L’analyse des CD/FSD dans 6 pays ne permet pas de conclure à leur intégration dans une stra-tégie organisée de mise en relation de la France avec la société civile nationale. Le terme de «socié-té civile» est d’ailleurs aussi peu utilisé, dans plusieurs des SCAC rencontrés, que ceux de «pauvres»ou de «femmes». Quand il est utilisé, il est souvent assorti d’épithètes négatives («introuvable»,«embryonnaire», «hétérogène»…).
La recherche d’acteurs non-étatiques pour conduire des projets de développement procède autant d’unerecherche de relais opérationnels (logique de «sous-traitance» déjà évoquée) que d’une logique rela-tionnelle passive: rester présents dans le pays malgré les problèmes politiques (Haïti…), répondre auxdemandes, ne pas décourager les gens qui s’adressent à la France (Tchad…). Cette passivité se traduit,en tout cas dans la plupart des pays francophones, par une absence de communication sur le dispositif,absence révélatrice du faible souci qu’a la représentation française de son image dans la société civile.
L’exception principale est celle de pays où la relation entre la France et les États a connu(Madagascar), ou connaît actuellement (Haïti) une crise profonde. Dans ce cas de figure, l’orien-tation vers la société civile est réelle, en tant que partenaire de remplacement, ceci essentiellementdans l’optique de la conduite de projets de développement (même constat au Niger après le coup d’É-tat de 1999) plus que pour le partenariat lui-même.
Ces analyses se rapprochent certainement de celles des évaluations antérieures sur les crédits décon-centrés. Les évaluateurs ont cependant pu constater des évolutions entre 1996 et 2001, allant dans lesens d’une plus grande attention aux dynamiques associatives (Tchad…) et surtout d’une implicationcroissante en direction des collectivités locales (Mauritanie…).
1.3. CD/FSD ET COOPÉRATION SECTORIELLE
Outil multi-sectoriel, les CD/FSD concernent potentiellement tous les acteurs sectoriels de lacoopération française: attachés sectoriels du SCAC et assistants techniques en premier lieu. Ils infor-ment aussi, potentiellement, les stratégies sectorielles du SCAC et/ou de l’AFD – même si ce n’est pasleur vocation première.
Il apparaît aux évaluateurs, sur le base des cas des 6 pays étudiés sur place, que cette articulation sec-torielle se fait assez bien au niveau des personnes, mais très peu au niveau des politiques et de lacapitalisation d’expérience.
Du point de vue des attachés sectoriels, ainsi que de certains assistants techniques, les CD/FSD sontconsidérés comme une enveloppe dans laquelle on peut aisément puiser tant qu’il s’agit de sommeslimitées. Ces agents de la coopération française considèrent donc la «souplesse» comme la premièrequalité des CD/FSD.

69Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Ainsi dans une réunion d’attachés sectoriels, organisée pour l’évaluation:
[Question: qu’est-ce que ça change, qu’il y ait des CD/FSD, plutôt que pas de CD/FSD?]
— Il n’y a pas photo: c’est le degré de complexité du FSP nouvelle formule. C’est la sou-plesse [du FSD]. On peut le mobiliser à chaque instant. On puise dans une enveloppe quin’est pas contrainte.
— On n’a pas d’instrument pour intervenir sur des projets de faible envergure, sinon celui-là. Dans le cadre d’un FAC, [on intervient en fonction des] objectifs fixés par le projet, mêmesi on a tenu compte des aspirations nationales.
La souplesse, je crois que c’est l’idée maîtresse qu’il faut avancer. […] Ce sont des petits pro-jets mais qui sont quelquefois très importants pour nos interlocuteurs.
— Mais aussi et surtout la population cible. Les projets FSP ont pour interlocuteur princi-pal les États, pas toujours un objectif de lutte contre la pauvreté, surtout de développementinstitutionnel et de politiques publiques générales.
— [Je retiendrais leur] caractère omni-sectoriel. La liste est ouverte.
Trois arguments sont avancés par ces attachés sectoriels, dans un ordre qui exprime, de l’avis des éva-luateurs, une priorité décroissante: (1) un instrument commode pour les acteurs français (il ne s’agitpas ici des décideurs mais des cadres intermédiaires), (2) qui permet de financer de petits projets impor-tants pour les «interlocuteurs» de la coopération française, (3) et aussi «et surtout» pour la «popula-tion cible» (qui apparaît, ici comme ailleurs, sous forme d’objet et non de sujet).
Sous cet angle, les CD/FSD jouent donc une fonction de guichet complémentaire aux projets FSPactifs dans le pays. Ainsi de projets peu coûteux dans les domaines des média ou de la diffusion de laculture française ou francophone. Les SCAC ne bénéficiant en général que de fonds modestes dans lesecteur culture-média (contrairement au budget des CCF), on observe ainsi de nombreux cas où le FSDest employé sur ce secteur sans considération de sa vocation propre.
Des projets dans des secteurs à investissements lourds bénéficient aussi parfois des CD/FSD, commele permet le montant maximum de 2 MF (plafond doublé par rapport aux CDI antérieurs) : ainsi de laréalisation de 4 carrefours giratoires à Nouakchott. Sur de tels projets à 2 MF, on trouve en général unAT employé à plein temps: c’est aussi le cas à Haïti avec les quatre «FSD à 2 MF» qui constituent desreformulations de projets FSP arrêtés pour raisons politiques (suspension de la coopération franco-haï-tienne). On peut également observer des grappes thématiques de projets FSD, qui constituent l’occu-pation principale d’un AT sectoriel (par exemple sur l’eau potable en Mauritanie).
Le guichet constitué par les CD/FSD est parfois utilisé en lien avec les FSP-État:
— utilisation d’un CD/FSD comme pilote d’un futur FSP – ou plus précisément, dans un cas àMadagascar, pour lancer malgré tout un projet de FSP refusé par Paris (dans cet exemple, au vu desrésultats du projet FSD, le FSP a été de nouveau présenté et a été accepté) ;
— financement d’une rallonge à un FSP existant – un projet CD/FSD à N’Djamena peut être classédans cette catégorie et a été piloté par les AT en place au titre du FSD antérieur.
Ces usages de l’enveloppe CD/FSD se font certes sans grande considération des objectifs impartis à cetoutil (et des dispositions spécifiques de l’instruction de 1996 sur ce point) ; cela étant, ils témoignentde son appropriation par les attachés sectoriels et AT, appropriation qui demande par définition queles attachés sectoriels et AT aient le sentiment d’utiliser les CD/FSD en fonction de leurs propres objec-tifs. Au demeurant, cette utilisation «à d’autres fins» va rarement jusqu’à contredire les objectifspropres des CD/FSD, et se fait en toute hypothèse selon les mêmes procédures que celles appliquéespar le SCAC à l’ensemble des projets CD/FSD.
Or la mobilisation des attachés sectoriels et des AT sur l’utilisation des CD/FSD fait partie des condi-tions pour que ceux-ci mettent en relation la coopération française avec la société civile.
Un cas «limite» est celui des AT qui rencontrent des obstacles, dans l’institution où ils sont en poste,pour mener à bien leur lettre de mission (par exemple quand celle-ci leur enjoint de «conseiller» le

70Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
ministre ou le directeur) : ils peuvent alors être poussés, par leur conscience professionnelle comme parleur supérieur hiérarchique, à se mobiliser sur le montage de projets et la recherche de fonds pour cesprojets, les CD/FSD étant alors une ressource bienvenue (un exemple en Mauritanie). Si cette situationpeut poser problème par rapport à la mission des AT, elle ne conduit pas pour autant à un usage détour-né des CD/FSD, et elle pourrait même conduire à une capitalisation d’expérience fructueuse dans lesecteur concerné.
Les CD/FSD apparaissent donc comme bien connus des personnels «sectoriels» français et utili-sés par bon nombre d’entre eux; inversement, bon nombre d’AT sont mobilisés par les SCACpour participer à l’instruction et au suivi technique de projets CD/FSD (dans la plupart des paysétudiés, mais pas tous: contre-exemple du Mozambique).
Cela ne se traduit cependant pas, en règle générale, par une capitalisation formalisée de leçons etde méthodes au sein de la coopération française.
Les raisons de cette absence mériteraient d’être approfondies. On peut penser que la principale est ladifférence d’échelle entre les CD/FSD et les projets, FSP ou AFD, qui constituent des enjeux impor-tants pour les coopérants. Ils ne mobilisent pas les mêmes fonds, n’ont pas la même répétitivité (dansle temps et l’espace), ne se font pas avec les mêmes partenaires, et souvent pas avec les mêmes moyenstechniques. Les CD/FSD apparaissent donc, pour certains agents français, comme la fraction plus sym-pathique, plus humaine, plus proche du terrain, d’une mission de coopération qui se déroule pour l’es-sentiel sur un autre plan, plus administratif, plus politique, plus encadrée.
L’idée naturelle selon laquelle les CD/FSD pourraient financer des réalisations pilotes avant un projetplus vaste se heurte à deux obstacles :
— la durée limitée des mandats des attachés et coopérants, qui, s’ils ne trouvent pas en arrivant desprojets en cours, sont incités à «justifier» rapidement leur poste par le lancement de projets sub-stantiels ;
— l’absence (dans l’état actuel des choses – 2002) de fonds français dédiés à la réalisation d’études decapitalisation, ou de préparation de projets ultérieurs.
En conclusion, la capitalisation d’expérience et l’utilisation des leçons des FSD sur d’autres réa-lisations, se font de façon informelle par les personnes elles-mêmes, non de façon formalisée etencore moins dans le cadre de stratégies sectorielles.
1.4. CD/FSD ET RELATION AVEC LE MILIEU DES FINANCEURS DU DÉVELOPPEMENT
Un objectif (second) visé par le Ministère avec la création des CD/FSD, était l’amélioration de la rela-tion entre la France et les autres acteurs étrangers du développement dans les pays du Sud.
À en juger par les entretiens menés auprès de représentants des bailleurs pour les dossiers de dévelop-pement local ou social, l’image de la France dans ce milieu dépend d’une part du professionnalisme,d’autre part de l’effectivité de son engagement pour la promotion, l’autonomisation, la prise de pouvoir(empowerment) des groupes sociaux pauvres.
— Le professionnalisme «technique» traditionnel de la coopération française est reconnu par lesautres bailleurs.
— Le professionnalisme «sociétal» de la coopération française, sa capacité d’écoute des gens et dessociétés, fait sans doute l’objet d’appréciations diverses :
• dans les pays de langue officielle française, la France est considérée comme connaissant bien le«terrain» mais on lui reproche sa difficulté à sortir d’un dialogue exclusif avec l’appareil d’État ;
• dans les pays d’autres langues officielles, la France est moins liée à l’État mais s’adresse souventavec trop peu de moyens aux acteurs non-étatiques, pour se constituer une expertise et avoir dupoids sur ce milieu.
Les réponses de 32 SCAC à l’une des questions de l’enquête menée par mail dans le cadre de cette éva-

71Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
28 Ce tableau témoigne de la différence de positionnement entre les pays francophones et les autres. Les chiffres sont lesréponses des SCAC et non les appréciations des évaluateurs sur le même sujet (image de la France dans la société civile) : dansles 6 pays visités, l’image perçue par les évaluateurs est très différente de celle perçue par les SCAC. Pour les évaluateurs, laFrance ne semble pas être perçue par la société civile comme particulièrement attentive aux plus pauvres ou comme favori-sant l’évolution de la société et des rapports de pouvoir. Cf. annexe III.
luation, illustrent cette opposition, bien que la question porte sur l’image de la France auprès de lasociété civile 28. Chaque répondant devait choisir les deux propositions les plus appropriées parmi 5:
Les autres bailleurs de fonds, au-delà de partenariats ponctuels, apparaissent principalementcomme des concurrents, en raison du parallélisme de leurs actions, et de par les projets politiquespropres de chacun. La concertation entre bailleurs joue un certain rôle d’information mutuelle voire decontrôle mutuel, sans aller jusqu’au niveau opérationnel ou professionnel :
«Je ne connais pas en détail les règles de financement des uns et des autres. Nous avons régu-lièrement des rencontres internationales, mais qui ne traitent pas des approches et des outils[…] Le seul moyen d’apprendre ce que fait le Danemark ou autre est d’aller les voir, de bienregarder si ce qu’ils disent est vrai, d’aller voir leur projet : on risque de les contrarier et deleur prendre du temps, donc cela ne se fait pas. Il faut se méfier de l’information qui est sou-vent superficielle et truquée […] Quelle est l’utilité de l’information recueillie?» (personnedu SCAC au Mozambique)
Dans le domaine spécifique du développement local et social, le sentiment général est que lesefforts parallèles des uns et des autres sont par principe complémentaires, l’efficience comman-dant de ne pas passer trop de temps à la coordination:
«La présence au Mozambique de nombreux bailleurs de fonds (ONG, organismes interna-tionaux et représentations diplomatiques) augmente les opportunités de cofinancement. Lesdemandeurs élaborent des projets ambitieux qui nécessitent des apports financiers impor-tants. Toutefois, dans le choix des projets financés, on a cherché à privilégier des projets plusmodestes mais plus facilement et rapidement réalisables, dont le financement était entière-ment couvert par la subvention et l’apport du bénéficiaire».
Rapport de présentation 2000-81, SCAC Maputo, p. 5.
Dans l’enquête précitée auprès des SCAC,
— 24 pensent que «Le pays manque de financements extérieurs pour des micro-projets» contre 8 quichoisissent l’alternative «Le pays est presque saturé de financements pour les micro-projets»;
— 11 indiquent que «Des concertations locales ont été mises en place sur une ville, une région, entrebailleurs» contre 20 selon lesquels «ce dispositif n’existe pas à [leur] connaissance ici».
Sur la base des cas des 6 pays visités, les évaluateurs ont le sentiment que les SCAC sous-estimentun peu (et ignorent en partie) le flux de financements extérieurs pour des micro-projets; et queles concertations entre bailleurs sont encore plus rares que déclaré ci-dessus par les SCAC.
En d’autres termes, l’utilisation des CD/FSD par les SCAC ne s’inscrit pas dans une stratégie derelation avec les autres bailleurs.
Deux éléments d’analyse complémentaires sur ce point :
— Les CD/FSD se rapprochent d’autres fonds bilatéraux, mais se distinguent des fonds sociaux mul-
Aux yeux du public national, et par rapport aux SCAC de 22 pays où SCAC de 10 pays oùautres bailleurs, la France… le français est langue le français n’est pas
officielle langue officielle
Joue un rôle modeste, un rôle d’observateur autant que d’acteur 2 5Est le partenaire central, doté d’une grande influence sur le pays 12 1Fait partie des bailleurs les plus attentifs aux plus pauvres 9 4Apparaît comme le bailleur bilatéral le plus lié à l’État 11 2Favorise l’évolution de la société et des rapports de pouvoir 10 4

72Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
tilatéraux, par leur pratique de projets «uniques», ponctuels, répondant à des demandes de la«société civile»; par opposition aux grappes de projets aussi importants que possibles, que sontconduits à mettre en route les bailleurs multilatéraux pour consommer les crédits alloués.
Il pourrait donc y avoir complémentarité entre les CD/FSD et les fonds multilatéraux (PAM, UE,BM…), or celle-ci n’est que très rarement recherchée. Les cas de coopération entre bailleurs citéscorrespondent plutôt à des bilatéraux (le Japon, le DED allemand…). De fait, pour faire valoir la coopé-ration française auprès des multilatéraux, il faudrait un effort de capitalisation et de communication, àun niveau professionnel (sociologique ou sectoriel), qui n’est pas fait.
— Faire valoir l’implication française dans le milieu des «développeurs» au sens large supposerait unrenoncement au «colbertisme» actuel, par lequel on tend à réserver les fonds français aux acteursfrançais (et aux nationaux) tout en invitant ces mêmes acteurs français (et nationaux) à travailler surles fonds d’autres bailleurs.
2. Organisation des postes pour les CD/FSDLes évaluateurs ont observé dans 6 pays, et l’enquête à laquelle 32 SCAC ont répondu confirme, unegrande variété de solutions quant au mode d’organisation des postes pour gérer les CD/FSD :
Toutes ces formules sont pratiquées dans plusieurs pays. La délégation à l’extérieur est la formule lamoins pratiquée, le recours à des salariés en contrat local est plus fréquent mais concerne presque uni-quement des pays non francophones (le salarié en contrat local a donc sans doute un rôle d’interprèteautant que de gestionnaire).
Dans les cas les plus nombreux, la gestion des CD/FSD revient soit personnellement au chef de SCAC(cas du Burundi, parmi les pays étudiés sur place), soit à un ou des attachés sectoriels ou AT(Madagascar…), soit à un ou des «juniors», VP le plus souvent (Tchad, Mozambique…). Les solu-tions intermédiaires sont fréquentes également : VP sous la responsabilité d’un attaché sectoriel auTchad; répartition de responsabilités par le chef de SCAC entre les attachés sectoriels en Mauritanie…
Cette variété de solutions est une conséquence assez logique de la discrétion de l’instruction du19 mai 1996 à ce sujet. Sa principale disposition est l’autorisation d’allouer jusqu’à 2 % des fondsCD/FSD au suivi-évaluation, avec la précision suivante :
Cette enveloppe est strictement limitée à la couverture des seuls frais effectivement et direc-tement imputables au suivi et contrôle des crédits déconcentrés. Toute rémunération, horsper-diem, de personnel, temporaire ou permanent, est exclue; l’achat d’un véhicule sur cescrédits est également prohibé.
Ces restrictions semblent viser essentiellement l’usage des 2 % à des fins qui ne seraient pas liées auxCD/FSD eux-mêmes: financement de personnel additionnel ou de frais généraux pour le SCAC.
Il faut cependant forcer la lettre de ce texte pour en arriver à une situation où:
— la fonction de gestion courante des CD/FSD serait financée sur cette enveloppe de 2 %, et non pasle «suivi et contrôle»;
— l’enveloppe servirait bel et bien à rémunérer du personnel et leurs véhicules, non pas en direct maispar l’intermédiaire d’un employeur qui les met à disposition (l’AFVP par exemple).
Quelle formule définit le mieux le mode de gestion des CD-FSD dans ce poste? (réponses de 32 SCAC) en 1er en 2e Total
Mise en œuvre par un personnel junior (VP, VI…) 7 4 11Recours à un personnel en contrat local 6 1 7Gestion assurée personnellement par le chef de service 7 6 13Délégation à un organisme externe (national p. ex.) 2 2 4Partage des responsabilités entre plusieurs «sectoriels» 4 6 10Nomination d’un senior (AT…) comme chargé des CD-FSD 7 5 12

73Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
29 D’après plusieurs sources orales convergentes : nous n’avons pas identifié de source écrite à ce sujet, qui dépasse dans unecertaine mesure le cadre de l’évaluation.
En revanche, dans le cas de la mise à disposition de VP par l’AFVP comme dans celle de l’emploi d’ATou VI sur la gestion des CD/FSD, la comptabilisation des coûts respecte la règle posée par l’instructionen ne prenant en compte que les coûts directs.
Ainsi, le coût direct de rémunération d’un VP est d’environ 36 kFF/an, à comparer avec l’enveloppe de«2 %» qui peut représenter de 40 à 120 kFF/an selon les pays; mais le coût complet d’un VP pour laFrance a été estimé aux environs de 300 kFF/an 29, soit en ordre de grandeur la moitié du coût paramé-trique d’un AT. Le coût complet de gestion des CD/FSD, tel qu’il ressortirait d’une comptabilitéanalytique, est actuellement masqué.
En-dehors du SCAC, deux autres instances peuvent jouer un rôle quant aux CD/FSD: l’ambassade elle-même (l’ambassadeur, ordonnateur des crédits déconcentrés depuis la fusion des deux ministères), etl’agence locale de l’AFD qui était directement impliquée dans le dispositif antérieur du Fonds spécialde développement.
— En pratique l’implication de l’ambassadeur se traduit dans certains pays par une orientation géné-rale, notamment sur la répartition géographique des projets ; par une présence possible au comitéconsultatif de sélection; par le relais accordé à certaines demandes de crédits ; et dans quelques cas pardes initiatives «sociales» ou humanitaires recourant aux crédits CD/FSD, initiatives prises dans cer-tains cas par l’épouse de l’ambassadeur.
— L’implication de l’AFD joue à deux niveaux indépendants l’un de l’autre : dans la sélection des pro-jets, par la présence du directeur d’agence au comité consultatif de sélection dans certains pays; dansle règlement financier, l’AFD étant en règle générale le comptable assignataire des paiements ; cecimême dans certains pays où il n’y a pas d’agence de l’AFD, comme au Burundi où les règlements sontfaits par l’agence de l’AFD à Nairobi (Kenya).
3. Cycle de vie du projet CD/FSD
3.1. IDENTIFICATION
Les projets financés sur CD/FSD sont toujours, ou presque toujours, émis par un porteur de projet etnon imaginés et développés par les personnes en charge de la gestion des CD/FSD.La première condition de l’arrivée de projets est donc la notoriété du SCAC, ou plus largement de l’ambassade, comme financeur possible de projets de cette échelle.Le premier facteur de cette notoriété est constitué par les projets antérieurs et par l’existence institu-tionnelle du dispositif CD/FSD et/ou de ses prédécesseurs (CDI).Le dispositif CD/FSD est manifestement très peu connu, pour le reste, les situations des pays semblentcontrastées :
Réponses de 32 SCAC à un questionnaire dans le cadre de l’évaluation:questions sur la communication des CD/FSD:
Choisir entre les réponses… Plutôt Plutôt … proposées à gauche et à droite<- <- -> ->
Les projets financés sur CD-FSD 14 9 8 0 Le dispositif CD-FSD est connusont attribués à «la France» sans comme telautre précision
Une communication est 6 15 6 4 L’appui français sur CD-FSD estsystématiquement prévue et signale accordé de façon discrète, sans enla contribution française faire étalage
Si le poste faisait connaître le CD- 9 10 8 4 Une communication sur les CD-FSD par une communication, il serait FSD a été nécessaire pour générer noyé sous les demandes de fonds l’envoi d’assez de projets de qualité

74Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Les réponses des SCAC à ces questions ne font pas apparaître de différence entre les pays francophoneset les autres, alors même que la notoriété de la coopération française et la facilité à communiquer (dufait de la langue) sont bien différentes dans les deux cas. Ces différences quant à la communicationreflètent principalement des stratégies différentes des postes.
Une communication plus importante semble toutefois être organisée là où la France est en position mar-ginale et cherche à se positionner parmi les bailleurs (certains pays non francophones, ou Haïti avec laposition très dominante de l’USAid), voire là où la popularité de la France est manifestement faible ;dans d’autres cas, une note de présentation ou d’autres documents existent mais font l’objet d’une dif-fusion limitée aux Français travaillant sur place, en premier lieu les AT et les personnels du SCAC(Burkina Faso dans les années quatre-vingt-dix).
Un exemple de communication particulièrement importante en Guinée (Conakry) :
• Financement en Guinée-Conakry, sur l’enveloppe CD/FSD 1996 (46 kFF), d’actions decommunication accompagnant la mise en œuvre des projets du FSD.
Utilisation de cette enveloppe:- publication de reportages écrits dans la presse locale.- prise en charge des frais des agents de la radio-télévision guinéenne pour la réalisation d’unedizaine de reportages.- réalisation d’un film promotionnel de 6 à 10 minutes par l’alliance franco-guinéenne sur lesactions réalisées grâce au FSD pour large diffusion: ce film a été diffusé sous forme de cas-settes vidéo à tous les ministères guinéens, les associations locales, les autres bailleurs defonds. Il a également fait l’objet d’une diffusion télévisée.- édition de plaquettes de présentation du Fonds social de développement pour diffusion largeauprès des administrations, collectivités locales, ONG, coopération décentralisée, coopéra-tion internationale.
Plaquette de communication dénommée «Gaïus» du nom du comité de sélection des projets«Groupement d’Appui aux Initiatives Urbaines et Sociales».
Contenu: les origines du Fonds social de développement, des exemples de secteurs d’inter-vention, la composition du comité de consultation, les critères d’éligibilité au FSD.
Un grand nombre d’idées viennent de «porteurs de projets» français (AT…) ou correspondantsréguliers de la coopération française. Le SCAC entretient ainsi par l’intermédiaire des CD/FSD un«réseau francophile» dans le pays (cas de la Mauritanie…). Cependant, sans avoir pu comptabiliser cecas de façon formelle, les évaluateurs pensent qu’il concerne moins de 50 % des projets CD/FSD: lamajorité des projets émaneraient au départ de nationaux sans intervention d’acteurs français.
La demande arrive sous des formes très diverses : par courrier postal, par téléphone, par l’intermédiai-re de tierces personnes en contact avec la coopération française…
La demande de dossier ne précède naturellement jamais l’expression d’une demande: la constitutiondu dossier fait plutôt partie de la phase d’instruction de la demande. «Demande» signifie donc rare-ment «projet constitué».
«Le premier contact [se fait] par courrier qui nous est envoyé. Ou un coup de fil, une per-sonne a entendu parler par un AT, en milieu rural… [Les personnes] viennent chercher desinformations: quels types de projets sont financés; comment instruire les dossiers. On restegénéral, on dit : ‘quel est votre projet?’. On dit [que les CD/FSD financent des] ‘micro-réa-lisations dans le secteur du développement’, car il n’y a pas de cadre rigide.» (Interview desVP responsables des CD/FSD au Tchad).
Quelques SCAC (Madagascar, Tchad…) ont mis en place un cahier d’enregistrement des demandes etsont donc en mesure de les comptabiliser. La plupart des SCAC rejettent dès leur arrivée une bonnepartie des demandes en tant que «non éligibles» car extérieures au champ couvert par les CD/FSD. ÀMadagascar, le comité consultatif, qui se réunit chaque mois, intervient dès cette étape pour présélec-tionner les projets qui doivent être instruits par le SCAC.

75Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
30 Schéma manuscrit ; cette version par les évaluateurs comporte quelques précisions additionnelles.
3.2. INSTRUCTION
Le processus d’instruction des dossiers CD/FSD est relativement complexe, ceci non en raison decontraintes réglementaires, mais en raison des étapes à franchir entre la demande «brute» et un «bon»projet au regard des critères de la coopération française.
On prend dans les pages suivantes l’exemple du Tchad, où la gestion est particulièrement structurée.Les gestionnaires y ont rédigé un schéma d’instruction30 :
Le schéma indique également une durée globale «3 à 6 mois».
Dans la pratique, les différentes étapes indiquées ci-dessus comme successives peuvent se déroulerdans un ordre différent, et être en partie parallèles, et cependant la durée globale est en moyenne biensupérieure.

76Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Cela s’explique par une logique d’instruction des projets qui procède autant d’un rapprochement depoints de vue entre acteurs de cultures et intérêts différents, que d’une «chaîne administrative» commecelle symbolisée par le schéma.
Ainsi, le rapport de présentation de l’enveloppe 2001 (Tchad) déclare :• Un accompagnement des bénéficiaires dans la conception du projet est systématiquementnécessaire. Ce travail, animé par les Volontaires, mobilise autour des bénéficiaires des per-sonnes ressources (assistants techniques, techniciens nationaux…) pour finaliser la réflexion,effectuer les visites de terrain et fournir un avis argumenté sur les dossiers présentés. Aucunedemande n’est acceptée avant qu’une visite de terrain ait pu être effectuée.
Mais, dans ce pays très vaste, la distance géographique pose souvent problème pour cette visite de ter-rain, et plus largement ralentit l’instruction:
Soit les personnes viennent au SCAC, sur certains projets dans le domaine social, [ou] quandil n’y a rien… [aucune réalisation déjà existante]. La visite de terrain se fera à un momentou à un autre, après le passage en commission par exemple, en raison du problème de dis-tance. […] En moyenne, c’est un an, l’instruction. Tous ceux qui sont sur N’Djamena peuventfacilement venir nous voir. En brousse, on a juste une adresse, ils ne viennent pratiquementjamais sur N’Djamena, ça va traîner (Interview des VP responsables des CD/FSD).
L’instruction avant le passage en commission fait souvent appel à des tiers, de statuts divers, pour l’éva-luation ex ante (faisabilité) et l’accompagnement/formation des demandeurs : direction de la Productionagricole (ministérielle), une association pour les projets de pisciculture, d’autres bailleurs ou orga-nismes étrangers sur des projets déjà traités par eux (DED, AFVP sur le projet urbain de Mongo…). Lebureau d’études de l’École nationale des Travaux publics (ENTP), où travaillent deux AT, est sollicitépour les études préalables de projets comprenant une construction immobilière.
Les fiches «d’avis d’experts» sont remplies par 4 personnes – responsable du FSD, conseiller chargédu FSD, conseiller sectoriel, ainsi qu’une «personne-ressource»: très généralement, toutes sont fran-çaises y compris la personne-ressource (souvent un AT).
Au total, le processus d’instruction parvient à:— fiabiliser le projet au plan technique et financier (ou l’éliminer pour ces motifs) ;— mettre le dossier dans une forme acceptable pour la partie française, entre autres en traitant le
critère des 30 % de participation des bénéficiaires (cf. infra 3.3) ;— en revanche, les gestionnaires du FSD sont peu équipé(e) s pour évaluer le projet au plan
social (qui est demandeur, qui seront les bénéficiaires, quels sont les rapports de pouvoir, etc.).
Bien que conscient(e) s de l’importance de cet aspect, les gestionnaires ne peuvent guère l’appréhen-der qu’à travers le critère, peu explicatif, de «degré de motivation perçu des bénéficiaires», lors desentretiens ou de la visite de terrain.
Cette conclusion peut être étendue aux différents pays étudiés sur place par les évaluateurs ; y comprisaux pays, nombreux, dans lesquels il y a très peu de formalisation du processus d’instruction, surtoutquand celle-ci est coordonnée en direct par le chef de SCAC (Mauritanie, Burundi…).
La volonté du bailleur d’arriver à un «bon projet» selon ses propres critères se heurte fréquemment àune conception du développement, chez les nationaux, qui ne suit pas la «logique de projet» au sensoccidental du terme. La négociation entre les deux parties va donc déboucher, dans le meilleur des cas,sur une reformulation du projet dans un langage acceptable pour le bailleur; celui-ci n’est pas forcé-ment certain de la signification de ce qui a été écrit pour l’organisation bénéficiaire, mais il reste maîtredu paramètre majeur qu’est le montant du financement accordé:
«Il est très difficile d’obtenir de nos interlocuteurs le fait de dire «mettons-nous ensemble,élaborer ensemble le projet». C’est venu sur le mode «on vous amène le truc», en généralbeaucoup surdimensionné. Quand on dit «on ne va pas financer ça», on nous répond «pre-nez ce que vous voulez». C’est pas quelque chose où on se sent à l’aise, mais bien souventon est contraint à ça». (Agent français, Burundi).
Ce dialogue difficile est sans doute lié en partie à la différence culturelle, mais tout autant à la diffé-

77Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
rence de position. Ainsi, le dialogue entre gestionnaires des CD/FSD et institutions catholiques semblesouvent reproduire le même schéma. La partie française est en général très satisfaite quand elle par-vient à introduire une clause vérifiable allant dans son sens (mixité du collège catholique d’Amtoukouiau Tchad), et assez satisfaite quand elle parvient au moins à limiter le montant d’un projet sur lequelelle a des doutes (projet pour la bibliothèque universitaire de Bujumbura, Burundi).
Dans leur majorité, les SCAC reconnaissent une insuffisance sur l’instruction des projets au plan socio-logique, admettent une faible formalisation de l’instruction (donc une personnalisation), et jugent utilela validation par des nationaux:
Réponses de 32 SCAC à un questionnaire dans le cadre de l’évaluation:questions sur l’instruction des projets CD/FSD (à trois endroits différents du questionnaire)
Or, les expertises nationales en matière de micro-projets sont généralement peu employées par lespostes à la phase d’instruction. Elles sont plus souvent positionnées comme celles d’opérateurspotentiels en aval de la décision. Alors que, là où il y a recours à ces expertises, l’apport de celle-cis’avère pertinent, profitable et souvent efficient :
— Dans l’exemple du projet urbain de Mongo (Tchad), c’est la Direction provinciale du génie ruralqui a proposé de réaliser les études techniques pour un coût représentant un faible pourcentage du bud-get du projet, alors que la partie française peinait à trouver un bureau d’études qui serait venu deN’Djaména à des coûts bien supérieurs.
Les obstacles à une plus grande consultation des nationaux semblent donc institutionnels plusque techniques:— en général, aucun salarié national n’est associé à l’instruction des CD/FSD: recourir à une experti-
se nationale demanderait de sortir du cercle de travail quotidien;— il y a un rapport de forces entre partie française et parties nationales : tant que les fonds ne sont pas
accordés, les gestionnaires des CD/FSD ne se sentent pas toujours autorisés à communiquer sur leprojet avec des nationaux (logique de «sous-traitance» évoquée dans le rapport de l’IRAM préci-té, pour le cas du Yémen).
Cette problématique se reproduit à l’étape de la décision de financement.
3.3. DÉCISION DE FINANCEMENT
L’étape de la décision de financement peut être étudiée sous deux angles:— celui du processus: qui prend part à la décision,— celui des critères d’octroi : qu’est-ce qu’un bon projet aux yeux de ceux qui les sélectionnent.
Choisir entre les réponses… Plutôt Plutôt … proposées à gauche et à droite<- <- -> ->
On étudie suffisamment la capacité des 5 17 8 2 On étudie insuffisamment la bénéficiaires à financer l’usage de capacité des bénéficiaires à finan-l’équipement fourni cer l’usage de l’équipement fourni
On étudie suffisamment les rapports de 5 8 10 8 On étudie insuffisamment les rap-pouvoir parmi les gens qui géreront ports de pouvoir parmi les gens l’équipement dans la durée qui géreront l’équipement dans la
durée
Les méthodes de sélection et 8 12 5 5 Des notes ou des grilles ont été d’affinement des projets sont très liées écrites sur l’instruction des pro-aux personnes en place. jets et les critères de sélection.
Les acteurs nationaux se prononcent en 4 6 14 4 Les projets qui sont volontiers fonction d’enjeux qui leur sont propres, validés par les acteurs nationauxla coopération française a les siens qui sont ceux qui ont les meilleurs sont différents résultats

78Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Qui prend part à la décision ?
Les crédits déconcentrés sont engagés sous la seule autorité du SCAC – avant la fusion des ministères– puis, depuis la fusion, sous la seule autorité de l’ambassadeur qui en règle générale la délègue auSCAC.
L’instruction de 1996 requiert un protocole-cadre d’accord avec l’État, au moins dans les pays «à deuxguichets». Ce protocole existe toujours dans ces pays à deux guichets, et parfois ailleurs ; on constatecependant dans certains cas le démarrage de financement de projets alors que le protocole d’accord n’apas été signé avec l’État (dans un contexte de relations difficiles entre les deux États). Quoi qu’il ensoit, ce protocole-cadre en dit peu sur le contenu des projets financés. La clause concrète qui peut fairedébat entre les parties est la composition du comité consultatif, qui figure en annexe du protocole.
De fait, l’instruction de 1996 prévoit la création d’un comité consultatif de sélection, au moins dans lespays où les CD/FSD comprennent «deux guichets».
Ce comité consultatif a effectivement été réuni dans la plupart des pays, fût-ce tardivement par rapportà la réglementation (au Tchad, on n’en trouve trace qu’à partir de mai 1999).
Il est généralement composé des représentants des ministères concernés, du conseiller de coopérationet ses principaux conseillers, du représentant de l’agence locale de l’AFD, de représentants de la socié-té civile et éventuellement d’autres bailleurs de fonds. La configuration de cette structure a pris desformes différentes d’un pays à l’autre, principalement en fonction de la plus ou moins grande partici-pation des autorités locales.
— La représentation de la société civile est très inégale selon les pays, les collectifs d’ONG étant lesstructures les plus fréquemment représentées.
— La présence du représentant de l’AFD au comité consultatif de sélection ne constitue guère uneimplication institutionnelle de l’AFD, mais s’apparente plutôt à une expertise «amicale» à part de sonmétier principal. Il y a un facteur 20 entre le plafond financier des projets CD/FSD (2 MFF) et le plan-cher des projets AFD (de l’ordre de 40 MFF).
— La représentation d’autres bailleurs semble très rare : un seul cas parmi les 6 pays étudiés sur place,celui de Madagascar avec la représentation d’une agence du système des Nations Unies.
Même si l’on observe, sur la durée, une progression de la coopération française vers une consultationaccrue des nationaux, cette évolution reste lente et fragile :
— la fréquence de réunion des comités consultatifs est souvent basse (apparemment semestrielle auMozambique) ;
— les SCAC se saisissent parfois de raisons circonstancielles pour éviter la constitution de ce comitépartenarial ou pour le dissoudre:• en Haïti, il a été supprimé quand la coopération avec l’État avait été suspendue, alors qu’il aurait
été aisé de reconstituer un comité avec des représentants de la société civile. Mais précisément,le comité antérieur ne comprenait que des représentants des deux États,
• en Mauritanie, l’idée d’un comité a été vite abandonnée:
Il y a eu [aux débuts du FSD] une tentative pour essayer d’agréger d’autres bailleurs defonds, on y a renoncé. Et des représentants de l’introuvable société civile. Plutôt que de fairedes réunions folkloriques pour se conformer à une circulaire quelconque, [les responsablessuccessifs du SCAC ont] préféré être efficaces. […] Cette voie […] ne servait à rien. (Agentsdu SCAC).
• au Burundi, la grande tension socio-politique peut servir de justification à la non-constitutiond’un comité consultatif (inexistant quoique annoncé par le rapport de présentation de l’envelop-pe 2000, mais les fonds de celle-ci n’ont pas encore été entamés) : mais des comités partenariauxfranco-burundais, coprésidés par les deux parties, existent sur d’autres fonds (contrepartie de l’ai-de alimentaire) et fonctionnent à la satisfaction de la partie française.

79Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
En l’absence de comité consultatif, la réunion de direction du SCAC s’y substitue dans le meilleur descas ; à moins que «pour des raisons de rapidité», les décisions ne soient prises en direct par le chef deSCAC avec les parties concernées, et ne soient éventuellement pas formalisées par écrit (ainsi, les refusde financement ne sont pas actés en Mauritanie).
— En raison du nombre élevé et de la diversité des projets déposés, soit directement par leurs initia-teurs, soit par l’intermédiaire des assistants techniques, un comité interne à chacun des SCAC a sou-vent été institué, afin de préparer les travaux du comité consultatif. Cette structure, souvent informelle,présélectionne les dossiers et ne retient que les demandes éligibles dans la forme et pertinente quant aufond. Ce travail sur dossier est parfois complété par une visite d’identification sur le terrain.
Dans une telle configuration, le comité consultatif prend la forme d’un débat inégal entre deux partieshomogènes: la partie française, bien informée, vient défendre un projet qu’elle a déjà retenu commevalable ; la partie nationale, qui n’a pas participé au processus de réflexion, est placée dans une posi-tion délicate puisque des questions de sa part deviennent synonymes de rejet d’un financement que labailleur est prêt à accorder.
• Fonctionnement d’un comité au Mozambique (observé par les évaluateurs) :
Chaque projet a donné lieu à une présentation orale par la responsable du FSD sur la base d’undocument synthétique indiquant notamment les objectifs poursuivis par le projet et la cohé-rence entre le projet et les orientations définies par le poste. Le débat qui a suivi a essentielle-ment consisté en une demande de compléments d’informations de la part des représentants del’administration mozambicaine. La faible participation des membres du SCAC à ces échangestrouve son origine dans la position connue à l’avance du conseiller de coopération (si le projetest présenté, c’est que celui-ci est d’accord). Le débat conduit la responsable du FSD à dépas-ser un simple rôle de présentation du projet pour endosser celui de défenseur du projet.
À l’inverse, à Madagascar, le travail de présélection est transparent vis-à-vis du comité consultatif, qui aété invité, très en amont, à se prononcer sur la mise à l’instruction de toutes les demandes reçues. De plus,le comité reçoit, pour chaque projet, à la fois le représentant des bénéficiaires visés, et le représentant del’opérateur technique; la bonne appropriation du projet par le représentant des bénéficiaires fait partiedes critères d’appréciation du comité. Ceci est rendu possible grâce au rythme mensuel des réunions.
Réponses de 32 SCAC à un questionnaire dans le cadre de l’évaluation:questions d’opinion sur la sélection des projets CD/FSD
Choisir entre les réponses… Plutôt Plutôt … proposées à gauche et à droite<- <- -> ->
Ces fonds français doivent être sous 10 9 7 4 L’emploi des fonds devraitl’autorité exclusive des ambassadeurs relever d’une codécision entreet SCAC Français et nationaux
Les experts nationaux devraient être 3 9 11 7 … devraient être consultés sur lesconsultés le plus en amont possible dossiers réellement présentables,dans l’examen des projets donc instruits et présélectionnés
L’instance de sélection des projets 6 4 15 5 L’efficience commande dedevrait recevoir en personne les décider sur dossiers, les gestion-représentants des bénéficiaires naires ayant auparavant reçu les
porteurs de projets
Les acteurs nationaux se prononcent en 4 6 14 4 Les projets qui sont volontiersfonction d’enjeux qui leur sont propres, validés par les acteurs nationauxla coopération française a les siens qui sont ceux qui ont les meilleurssont différents résultats
La forme de consultation la plus 8 13 5 4 … un comité assez large pouradaptée est un petit comité de représenter les institutionsprofessionnels, qui se réunit fréquemment concernées, quitte à être réuni moins
souvent

80Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Les différents SCAC interrogés reconnaissent que des réunions fréquentes seraient préférables et valo-risent (ce chiffre a déjà été présenté plus haut) l’opinion des nationaux; la majorité pense que «cesfonds français doivent être sous l’autorité exclusive des ambassadeurs et SCAC» même si un sur troisenvisage une codécision entre Français et nationaux. Cela étant, la majorité préfère consulter les natio-naux en aval de la présélection des dossiers et ne pas faire auditionner les représentants des bénéfi-ciaires par le comité (tableau ci-dessus).
Sur quels critères sélectionner les projets ?
Les critères des SCAC comme ceux des ONG de projets convergent en général sur une même visiondu «bon projet». Dans le langage de l’évaluation, les critères les plus prisés seraient par ordre d’im-portance décroissante:
— la confiance qu’inspire l’organisation bénéficiaire des fonds quant à ses intentions et à ses compé-tences pour mener à bien le projet ;
— la durabilité du projet, l’existence de mécanismes (financiers, institutionnels, techniques) qui leferont fonctionner une fois l’investissement réalisé;
— l’éligibilité par rapport aux critères des CD/FSD (investissement physique, etc.) ;
— l’efficience par rapport au coût financier, c’est-à-dire rapport entre le budget du projet et les réali-sations: coût par salle de classe, coût par rapport à d’autres projets dans le même secteur…
La place importante, mais relative, des critères d’éligibilité, peut être illustrée par les pourcentages d’in-vestissements physiques:

81Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
De même la personnalité morale du bénéficiaire, ne semble pas toujours attestée (il y a un très fort pourcentage de non-réponses à cette question), mais elle est plus souvent vérifiée pour les plus grosprojets :
La pertinence du projet, son caractère prioritaire pour des personnes dans le besoin, son impact,sont parfois évoqués dans les entretiens, mais sont très peu cités lors des décisions (PV de débats encomités consultatifs par exemple) : il s’agit plus de considérations générales que de critères effecti-vement étudiés.
Par exemple, en Mauritanie, le SCAC cite les critères suivants :— projet dont les bénéficiaires tirent un profit direct ;— projet concret ;— populations a priori défavorisées ;— partenaires motivés ;— projets sociaux éducation/santé/alimentation, y compris eau et hygiène;— essayer de travailler dans chaque wilaya (région) ;— «travailler avec la société civile, dont les élus, les collectivités locales»;— nécessité de décaisser à hauteur de 75 % des crédits pour demander une nouvelle enveloppe.
Malgré la richesse de cette liste, la raison décisive semble être pour les évaluateurs la connaissancepréalable du partenaire, avec un argument-type qui serait :

82Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Je connais bien Untel, il fait du bon boulot. (Cité par un agent du SCAC).
À Madagascar comme dans d’autres pays (Burkina Faso…), ont été menées des démarches d’analy-se multi-critères des projets, au moins sous forme de grilles d’appréciation (sans que soient pourautant réalisées des évaluations ex ante). Ces grilles ont été élaborées sur place et ont fait l’objet dedébats au sein des comités consultatifs. L’exemple du Burkina Faso suggère d’ailleurs que les débatsin abstracto sur les critères sont plus libres et plus profonds que les débats sur chaque projet, pour lesraisons évoquées précédemment (enjeu financier, inégalité d’information entre parties française etnationale). Ces grilles d’analyse ont aussi l’avantage de constituer un repère pour les gestionnaires desCD/FSD dans leur travail d’instruction des projets (et de présélection explicite ou implicite), en amontde la sélection.
Les critères ainsi dégagés convergent avec la priorité à l’implication des «bénéficiaires» et à la «dura-bilité», citée précédemment. Ainsi, à Madagascar, quatre des onze critères de sélection font référenceà cette notion: «participation des bénéficiaires directs», «participation des promoteurs du projet»,«mécanismes de pérennité prévus ou possibles» et « intégration du projet dans le contexte existant etl’environnement institutionnel».
Interrogés sur les éléments concrets qui attestent de cette implication et de cette durabilité, lesSCAC mettent en avant les réalisations passées du même demandeur, plus que certains facteurssociologiques (existence d’un parrainage) ou juridiques (association en règle). Dans la pratique, lesfacteurs juridiques sont les premiers vérifiés et l’historique du demandeur est une notion ambiguë:en fait, il est aisé de vérifier les réalisations antérieures de l’opérateur technique, mais la notion a moinsde sens pour les bénéficiaires (notions que les SCAC ne distinguent pas toujours, comme le remarquaitdéjà l’évaluation sur les CDI).
Les SCAC répondants sont également nombreux à mettre en avant la clause de «30 % de participationdes bénéficiaires», ce qui s’écarte notablement du fonctionnement réel de la sélection, tel que nousl’avons observé.
Réponses de 32 SCAC à un questionnaire dans le cadre de l’évaluation:questions d’opinion sur les critères de sélection des projets CD/FSD
Le critère des « 30 % de participation des bénéficiaires »
Pour s’assurer de la réalité de la demande et de l’appropriation des projets par les personnes, la procé-dure demande actuellement «30 % de participation des bénéficiaires». Le principe de cette clause est
Parmi les critères suivants, lesquels vous semblent attesterle plus sûrement de la motivation des «bénéficiaires» etdes chances de durabilité des réalisations du projet? Citations en 1er ou en 2e
Le fait que le même demandeur ait déjà à son actifdes réalisations durables 20
Une clause selon laquelle les bénéficiaires doivent réunirles matériaux et autres contributions, avant le premier versement 9
Une vérification de la réalité du besoin par un spécialistedu secteur et/ou de la région 12
La qualité de l’analyse de la situation, et du montage du projet,dans le dossier écrit 11
L’ancienneté de l’association ou organisme, et le fait qu’ilsoit en règle avec l’administration 3
Le parrainage du projet par des personnalités influentes dansla région où il doit être réalisé 0
Un budget de projet dans lequel 30 % ou plus des coûts sontpris en charge par les bénéficiaires 12

83Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
31 «Lutte contre la pauvreté et les inégalités», op. cit., p. 163.32 Cela étant, pour l’application de la règle des 30 %, l’instruction de 1996 ne fait pas différence entre société civile (ou 2e
guichet) et État (ou 1er guichet).33 L’exclusion des pauvres peut certes se faire par d’autre biais – par le seuil minimum de 50 kFF (trop élevé pour la plupartdes projets de villages), par leur absence de contact direct avec les bailleurs…
jugé pertinent par beaucoup: la réalité de la participation – qu’elle soit financière, en nature ou entemps – témoigne bien de chances accrues d’appropriation.
Cependant, la règle des 30 % est, de façon très générale, contournée ou appliquée de façon artificielle.Pour atteindre le niveau de 30 % en valeur sur un investissement physique (bâtiment, puits…), il fautattribuer aux temps passés des valeurs monétaires sans rapport avec les valeurs des salaires (de tâche-rons par exemple).
• Au demeurant, l’image d’une participation populaire massive, «à la chinoise», ne corres-pond pas à la réalité des projets CD/FSD que nous avons visités. Il s’agit à de très raresexceptions près, d’investissements réalisés selon des procédés techniques modernes, et nonde travaux à haute intensité de main d’œuvre. L’idée selon laquelle la mobilisation de main-d’œuvre prouverait « l’adhésion des populations au projet» est d’ailleurs passée de mode.
Illustration du caractère artificiel de ce type de comptes, la clause fréquemment rencontrée dans lesconventions, bien que dénuée de sens: «le bénéficiaire met l’ensemble de ses moyens matériels ethumains à la disposition du projet». Une telle clause permet de situer le % de contribution à n’impor-te quel niveau, et c’est ce que font certaines conventions en intégrant dans le périmètre de calcul desréalisations des organisations «bénéficiaires» indépendantes de l’investissement considéré.
Ce contournement s’explique très naturellement. Les populations pauvres ont fort peu d’argent, mais,souvent, du temps et des connaissances (techniques et sociales), de faible valeur monétaire.
L’IRAM remarque dans le cas du Burkina Faso:
• Les conditions d’éligibilité imposées aux promoteurs [des projets] contrarient la fonctionsociale et le choix d’aider les quartiers défavorisés des villes : la contribution de 30 % decofinancement exigée [des] promoteurs devient une clause d’exclusion. Ce qui confère auFSD un caractère relativement élitiste même si sa ligne directrice est loin d’être celle-là.31
Les «acteurs de la société civile» n’ont, eux aussi, aucune raison de financer 30 % d’un budget deprojet :
— les ONG de projets fonctionnent entièrement sur fonds des bailleurs : même ce 30 % viendra biende quelque part ;
— les structures de la société civile aidées en raison de leurs objectifs généraux (média, syndicats,ordre des avocats, etc.) ont bien entendu un budget de fonctionnement à côté de l’aide française,mais intégrer une partie de ce budget général dans le périmètre du projet est un peu artificiel.
À titre de point de comparaison, les bailleurs financent à hauteur de 100 % les programmes d’investis-sement publics de nombreux pays très pauvres, à l’exception jusqu’ici des investissements de souve-raineté (défense et diplomatie). Ils sont donc moins exigeants envers l’État que ne le sont les CD/FSDenvers la société civile 32.
Cette barre de 30 % pourrait donc poser de gros problèmes… si elle était appliquée.
En pratique, dans les 6 pays d’étude, nous n’avons pas rencontré ce problème, le seuil de 30 % étantcontourné autant que de besoin, donc toujours formellement vérifié33. L’habitude de la contourner amême conduit les SCAC à instrumentaliser cette clause: elle est invoquée pour justifier la non-sélec-tion d’un projet sur laquelle, en fait, le SCAC a des doutes concernant l’efficience (montant excessif dela demande), la viabilité ou la motivation durable de ses promoteurs.

84Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
3.4. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
Les conditions de mise en œuvre concrète des projets sont la partie la plus variable, d’un pays àl’autre et d’un secteur d’activité à l’autre, du cycle de projet.
Les statistiques sur la durée moyenne des projets en donnent une première idée: cette durée moyennevarie de 4 à 20 mois selon le pays, avec une moyenne générale de 12 mois. En pondérant selon lebudget, on obtient des chiffres un peu supérieurs, 5 à 21 mois, avec une moyenne générale de 14 mois,ce qui traduit le fait que les plus gros projets tendent, en moyenne, à durer plus longtemps.
Les délais d’exécution ont d’ailleurs dû être modifiés pour 25 % des projets.
Sur la base de données de projets rassemblée par le MAE, 42 % seulement des projets sont déclarés parles SCAC comme clôturés (tableau ci-dessus)
. Le fait que le chiffre se rapproche de 100 % dans quelques pays suggère en outre que, dans ces pays,certains projets récents sont absents de la base de données. Il y a 23 % de non-réponses sur ce point et34 % de projets non encore clôturés.
Ces pourcentages sont importants au regard de l’ancienneté de mise en place du fonds (5 ans à la datede l’enquête) et de la durée moyenne des projets (1 an) : compte tenu de la montée en charge du dis-positif, on attendrait, sinon 80 %, du moins de l’ordre de 70 % de projets clôturés.
L’absence de clôture pour un pourcentage important de projets traduit :
Projets clôturés(NB: 23% de non-réponses)
Nbreprojets %
Montant(kFF) %
ANGOLA 12 41% 4 321 32%BENIN 15 18% 3 395 16%BURKINA FASO 57 92% 16 275 95%BURUNDI 10 29% 1 911 28%CAMEROUN 21 29% 8 126 28%CAP-VERT 20 100% 5 242 100%CENTRAFRICAINE (R.) 1 5% 300 8%COMORES 0 0% 0 0%CONGO 15 79% 8 147 81%CONGO RDC 8 21% 3 730 14%COTE D'IVOIRE 27 61% 6 143 54%DJIBOUTI 20 83% 3 949 88%GABON 18 95% 4 207 91%GUINEE 2 4% 0 0%GUINEE EQUAT. 0 0% 0 0%GUINEE-BISSAO 2 20% 950 34%HAITI 14 13% 2 665 11%MADAGASCAR 33 69% 12 391 68%MALI 73 58% 12 330 48%MAURITANIE 14 70% 5 183 86%MOZAMBIQUE 7 50% 2 230 58%NAMIBIE 0 0% 0 0%NIGER 33 28% 11 781 45%PETITES ANTILLES 14 82% 2 959 81%RWANDA 6 67% 3 350 68%SAO TOME 1 7% 600 18%SENEGAL 1 2% 101 1%SEYCHELLES 3 20% 635 23%TCHAD 59 46% 11 506 53%TOGO 49 94% 15 666 97%Total 535 42% 148 091 43%Rappel total projets 1269 100% 340 987 100%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets
(Projets de durée "0"non pris en compte)
Duréemoyenne des
projetsMoy. pondérée
par le budgetANGOLA 18 20BENIN 17 18BURKINA FASO 7 7BURUNDI 9 10CAMEROUN 18 21CAP-VERT 20 21CENTRAFRICAINE (R.) 9 9COMORES 4 5CONGO 12 13CONGO RDC 13 16COTE D'IVOIRE 11 10DJIBOUTI 17 19GABON 12 13GUINEE 4 7GUINEE EQUAT. 11 14GUINEE-BISSAO 8 10HAITI 9 10MADAGASCAR 15 17MALI 12 11MAURITANIE 16 20MOZAMBIQUE 10 11NAMIBIE 18 20NIGER 11 12PETITES ANTILLES 8 8RWANDA 16 17SAO TOME 11 11SENEGAL 10 12SEYCHELLES 14 18TCHAD 14 15TOGO 13 13Total 12 14
Informations fournies par les postes(enquête du MAE sur 1269 projets)

85Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
• le peu de contraintes sur les SCAC à cet égard: la principale obligation pour obtenir une nouvelleenveloppe est celle d’avoir engagé 75 % des crédits de l’enveloppe précédente;
• et aussi la difficulté à réunir toutes les pièces permettant la clôture (voire à retrouver le signatai-re du protocole initial pour signer avec lui le protocole de clôture), dans les conditions de mise enœuvre qui sont celles de micro-projets, à une échelle financière qui est dominée dans beaucoup depays par le «secteur informel».
Les notions mêmes de «responsable de la mise en œuvre» et «d’opérateur» sont nécessairementfloues: elles n’ont pas le même sens quand il s’agit d’acheter des micro-ordinateurs pour un serviceadministratif, de rénover des bornes-fontaines, ou de construire des bibliothèques dans le cadre d’unprogramme de l’Agence de la Francophonie. Il y a donc une géométrie variable entre maître d’ouvra-ge, opérateur, entrepreneur, bénéficiaire… La distinction française entre les fonctions de maître d’ou-vrage, d’assistant à maître d’ouvrage et de maître d’œuvre ne correspond d’ailleurs pas aux traditionsjuridiques d’autres pays.
On peut cependant distinguer deux tendances divergentes parmi les SCAC :• déléguer la mise en œuvre à des ONG aussi importantes et fiables que possible (Haïti, Mada-
gascar…);• gérer les projets en interne avec le personnel du SCAC et les AT (Burundi, Mauritanie…).
Le tableau suivant montre bien cette diversité. Il intègre aussi une distinction entre «bénéficiaire» et« tiers» (opérateur?), dont le sens est plus flou: la distinction entre «bénéficiaire» et «opérateur» estincertaine dans la gestion actuelle des CD/FSD, car l’opérateur, étant destinataire des fonds, est sou-vent qualifié par abus de langage de «bénéficiaire».
Mise en œuvre des projetsCD/FSD (en % des fonds)
Par le SCACdirectement
Subvention aubénéficiaire
Subvention àun tiers
Plusieursmodes
ANGOLA 25% 34% 23% 5%BENIN 12% 58% 27% 0%BURKINA FASO 54% 41% 2% 0%BURUNDI 85% 2% 1% 11%CAMEROUN 54% 5% 13% 15%CAP-VERT 14% 38% 0% 49%CENTRAFRICAINE (R.) 76% 20% 4% 0%COMORES 26% 0% 0% 0%CONGO 47% 37% 0% 0%CONGO RDC 4% 86% 11% 0%COTE D'IVOIRE 14% 48% 3% 0%DJIBOUTI 64% 14% 12% 2%GABON 72% 15% 12% 0%GUINEE 0% 89% 3% 0%GUINEE EQUAT. 52% 0% 32% 0%GUINEE-BISSAO 63% 37% 0% 0%HAITI 26% 61% 10% 0%MADAGASCAR 7% 51% 34% 0%MALI 0% 49% 10% 0%MAURITANIE 88% 4% 8% 0%MOZAMBIQUE 53% 19% 29% 0%NAMIBIE 0% 80% 0% 15%NIGER 36% 4% 59% 0%PETITES ANTILLES 6% 86% 0% 0%RWANDA 62% 38% 0% 0%SAO TOME 75% 7% 18% 0%SENEGAL 1% 5% 2% 0%SEYCHELLES 100% 0% 0% 0%TCHAD 52% 45% 3% 0%TOGO 0% 46% 52% 0%Global 30% 40% 17% 3%Global (% du nb de projets) 30% 41% 14% 2%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

86Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
La présence au sein du SCAC d’une cellule de gestion des CD/FSD n’est pas nécessairement associéeà une mise en œuvre interne; ce serait plutôt l’opposé dans les 6 pays étudiés sur place. L’existenced’une cellule de gestion, point central de contact avec des opérateurs, est de nature à faciliter la délé-gation de la mise en œuvre à ceux-ci.
L’absence de cette fonction de gestion conduit à l’inverse à une surcharge des attachés sectoriels et ATcompte tenu de la masse de prises de contacts, de papiers, de vérifications, que demande la mise enœuvre de micro-projets : c’est ce qu’on observe au Burundi, où l’utilisation des CD/FSD est presquearrêtée faute de personnel au SCAC, et en Mauritanie malgré la présence d’une personne en contratlocal, car celle-ci n’a aucune autonomie de décision et n’est informée qu’au compte-gouttes par les atta-chés sectoriels.
Les statistiques sur les opérateurs des projets (parmi lesquels les personnels français ne sont pas pré-vus) donnent une image différente (tableau infra).
•
Une place somme toute restreinte semble accordée aux ONG «locales»: 15 %, à peine plus que lesONG étrangères avec 11 %.
— Ces chiffres semblent représenter une augmentation (bien que la nomenclature ne soit pas la
Opérateurs desprojets CD/FSD (en %des fonds)
Servicesadministration
Entrepr.privées AGETIP
Collec.territoriales
ONGlocales
Autrescas
ONGétrangères
Plusieursopérateurs
Aucunde cescas /SR
ANGOLA 70% 3% 14% 5% 9%BENIN 5% 42% 6% 9% 8% 26% 4%BURKINA FASO 4% 33% 4% 15% 5% 23% 18%BURUNDI 88% 1% 3% 8% 1%CAMEROUN 2% 57% 4% 0% 6% 25% 6%CAP-VERT 10% 70% 13% 8%CENTRAFRICAINE (R.) 78% 22%COMORES 100%CONGO 61% 4% 29% 6%CONGO RDC 14% 4% 4% 8% 38% 32%COTE D'IVOIRE 39% 2% 14% 45%DJIBOUTI 33% 15% 45% 6%GABON 34% 4% 62%GUINEE 10% 4% 2% 40% 32% 2% 11%GUINEE EQUAT. 67% 17%GUINEE-BISSAO 1% 56% 20% 4% 11% 9%HAITI 12% 22% 2% 24% 4% 3% 15% 18%MADAGASCAR 18% 33% 6% 8% 25% 9%MALI 2% 52% 1% 0% 1% 0% 1% 6% 37%MAURITANIE 22% 1% 1% 74% 2%MOZAMBIQUE 22% 2% 51% 24%NAMIBIE 40% 10% 15% 31% 3%NIGER 6% 8% 0% 42% 1% 24% 18% 0%PETITES ANTILLES 23% 10% 18% 37% 3% 9%RWANDA 33% 21% 20% 22% 3%SAO TOME 82% 18%SENEGAL 1% 1% 1% 97%SEYCHELLES 7% 46% 3% 44%TCHAD 62% 2% 0% 6% 2% 28%TOGO 0% 36% 20% 42% 2%Total 3% 33% 0% 1% 15% 4% 11% 14% 17%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

87Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
même), par rapport aux CDI, pour lesquels l’évaluation identifiait les «ONG et congrégations» commeopérateurs pour 16 % des engagements.
• Les collectivités territoriales, bénéficiaires de 15 % des fonds, ne sont opératrices que pour 4 %: dansla majorité des projets qui les concerne, un intervenant technique agit pour leur compte ou à leurbénéfice.
• La fraction la plus importante, 30 % des fonds, va aux entreprises privées : il s’agit en majorité (17 %)de projets qui ont été classés précédemment en «mise en œuvre directe par le SCAC». En d’autrestermes, cette mise en œuvre directe consiste souvent à passer des achats auprès d’entreprises, et cor-respond alors à des projets qui demandent moins «d’accompagnement des bénéficiaires» — le cas-type est celui de l’achat de matériel bureautique, pour lequel les compétences et moyens d’actionsdes SCAC sont souvent supérieurs à ceux des «opérateurs nationaux» possibles.
• Les services de l’État n’ont que très rarement le statut d’opérateurs ; par conséquent, les projets du«guichet État» ne conduisent qu’exceptionnellement à des versements d’argent à l’État ou à sesdémembrements.
Le fractionnement des versements est la règle (82 % des projets et 88 % des fonds), en particulieren cas de subvention à un organisme. Chaque SCAC a établi ses propres normes à cet égard: àMadagascar, par exemple, avance de 50 %, versement intermédiaire de 30 % et solde de 20 % sur pré-sentation de justificatifs.
Fractionnement dufinancement Nbre projets %
Montant(kFF) %
ANGOLA 27 93% 13 486 99%BENIN 82 98% 21 016 99%BURKINA FASO 48 77% 14 193 83%BURUNDI 27 79% 5 989 88%CAMEROUN 62 86% 27 857 95%CAP-VERT 17 85% 4 532 86%CENTRAFRICAINE (R.) 19 100% 3 886 100%COMORES 2 9% 415 11%CONGO 17 89% 9 610 96%CONGO RDC 30 79% 21 875 84%COTE D'IVOIRE 43 98% 10 998 96%DJIBOUTI 21 88% 4 174 93%GABON 16 84% 4 192 91%GUINEE 22 46% 8 060 85%GUINEE EQUAT. 7 78% 1 560 83%GUINEE-BISSAO 9 90% 2 756 99%HAITI 97 91% 23 520 96%MADAGASCAR 45 94% 16 815 93%MALI 91 73% 16 506 64%MAURITANIE 14 70% 5 454 91%MOZAMBIQUE 10 71% 3 478 90%NAMIBIE 9 100% 2 915 100%NIGER 111 96% 25 386 98%PETITES ANTILLES 15 88% 3 441 94%RWANDA 9 100% 4 940 100%SAO TOME 11 73% 2 752 82%SENEGAL 3 7% 711 8%SEYCHELLES 8 53% 1 999 72%TCHAD 123 96% 20 762 96%TOGO 51 98% 15 933 98%Total 1046 82% 299 211 88%Rappel total projets 1269 100% 340 987 100%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

88Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
34 Résultat d’une analyse factorielle utilisant comme individus les 32 pays et comme variables les suivantes : durée moyennedes projets ; pourcentages des fonds allant en milieu urbain; pourcentages des fonds par type de bénéficiaire ; pourcentagesdes fonds par secteur ; pourcentages des fonds par mode de mise en œuvre; pourcentages des fonds ayant fait l’objet d’unrèglement fractionné. Seules les variables bien discriminées par l’analyse sont mentionnées sur la carte. Les variables qui nefigurent pas sont donc des variables moins corrélées à la mise en œuvre des projets.35 «Actuellement»: la réforme comptable en cours du FSP confie ce rôle aux Trésoriers-payeurs.
La carte de synthèse suivante positionne les pays selon les caractéristiques des projets qu’ils ont finan-cés (base de données des 1269 projets). Les variables qui créent les différences les plus fortes sont liéesà la mise en œuvre des projets (raison pour laquelle la carte est présentée ici34).
La carte se lit de la façon suivante : plus un pays est éloigné du centre dans la direction de l’une desflèches, plus il a de chances de partager la caractéristique correspondante.
Un groupe de pays en haut à gauche, dont la Mauritanie et le Burundi, se caractérise par la mise enœuvre directe par le SCAC. Un groupe de pays en bas à gauche, dont la plupart des pays sahéliens,Madagascar et le Mozambique, se caractérise par le poids des structures associatives parmi les bénéfi-ciaires. Quelques pays, dispersés sur la droite du graphique, présentent des utilisations plus originales,notamment un fort pourcentage de projets «État» : il s’agit pour la plupart de pays à faible montant deCD/FSD, dont des pays à «guichet unique». Haïti se rapproche de ce troisième groupe.
Le comptable assignataire des paiements est actuellement l’AfD35. La liaison entre le SCAC etl’AFD semble techniquement de bonne qualité, alors même qu’elle se fait parfois à distance (SCAC
ANGOLA
BENIN
BURKINA FASO
BURUNDICAMEROUN
CAP-VERTCENTRAFRICAINE (R.)
COMORES
CONGO
CONGO RDC
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTIGABON
GUINEE
GUINEE EQUAT.
GUINEE-BISSAU
HAITI
MADAGASCAR
MALI
MAURITANIE
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NIGER
PETITES ANTILLES
RWANDA
SAO TOME
SENEGAL
SEYCHELLES
TCHAD
TOGO
Bénéf. : confessionnel
Culture / francophonie
Mise en œuvre SCAC
Subvention bénéf.
Projets longs
Bénéf. = Etat
Bénéf. = association
ONG étrangères
ONG nationale

89Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
36 Les évaluateurs n’ont pas rencontré les agents de l’AFD chargés de cette fonction comptable.
Bujumbura et AFD Nairobi, par exemple). Ainsi, à Madagascar, les opérateurs apprécient le respect desdélais de mandatement. Le décaissement semble jugé assez rapide, au moins par comparaison avecd’autres bailleurs. Ainsi, au Mozambique, le premier versement est en général perçu entre trois et quatresemaines après la demande du SCAC, sachant que l’agence de l’AFD n’hésite pas à solliciter des com-pléments d’information au poste ou une demande d’autorisation formelle à l’AFD Paris.
À ce qu’on peut en ressentir du côté du SCAC 36, le grand nombre d’écritures et de vérifications deman-dé par la gestion des CD/FSD, pour des sommes parfois minimes, constitue une charge peu appréciéepar l’AFD. Certains SCAC ressentent les exigences en retour de l’AFD comme excessivement strictes ;mais les évaluateurs n’ont pas constaté que ces exigences dépassent les besoins normaux de la fonctioncomptable. Le problème est plutôt l’absence, côté SCAC, de personnels maîtrisant cet aspect des dos-siers : les volontaires ou les AT n’ont pas cette formation et peuvent être très peu efficients dans le trai-tement comptable des dossiers, qui occupe une part importante de leur temps de travail aux dépens del’instruction et du suivi.
Le contrôle de la comptabilité des projets est effectuée par le SCAC lui-même dans 73 % des cas.Dans quelques pays comme Madagascar, il a été délégué à un bureau d’études national (Alpha Conseilen l’occurrence).
Le suivi des projets, entendu comme fonction distincte de la mise en œuvre, est globalement faibleet souvent très faible.
Dans le cas de délégation de la mise en œuvre à des opérateurs, comme au Mozambique, la responsa-bilité du suivi est implicitement confiée aux opérateurs dans la mesure où la responsable FSD n’effec-tue que très rarement des déplacements sur site (en dehors de la capitale et de sa proche banlieue) -démarche qui déçoit les bénéficiaires qui ressentent un manque d’intérêt de la part de la coopérationfrançaise.
Ces opérateurs effectuent pour certains un suivi très poussé (cas du GRET sur le projet T’Wizé enMauritanie) mais, faute d’implication du côté du SCAC, les informations provenant du suivi ne remon-tent pas jusqu’à lui ou ne sont pas capitalisées au SCAC.
Quand la mise en œuvre est faite directement par le SCAC, les évaluateurs n’ont pas observé que soitmise en place une fonction distincte de suivi et de remontée d’information. Le seul type de suivi surlequel on constate une implication substantielle est celui des contrôles techniques de chantier, notam-ment par des AT (exemples de chantiers de bâtiment au Burundi, d’hydraulique rurale enMauritanie…).
Le cas de la Guinée (Conakry) illustre une évolution, d’un suivi direct qui ressemble beaucoup à de lamise en œuvre, vers un suivi externalisé confié à une ONG nationale :
• Rapport d’exécution de l’enveloppe 96 du SCAC de Guinée-Conakry
Enveloppe disponible : 120 kFF. Dépense effective de 46 kFF.
«Cette dépense correspond à l’achat de bons d’essence afin de permettre au service de coopé-ration de se déplacer pour rencontrer les ONG sur leur lieu de projet, procéder à des suivis etvisites des projets en cours d’exécution, procéder à des visites finales des projets».
• Rapport d’exécution de l’enveloppe 98 du SCAC de Guinée-Conakry
Convention avec une ONG locale (EUPD) pour assurer le suivi de six projets FSD (coût :88,5 kFF)
«Le but de la convention signée avec EUPD était de permettre les opérations suivantes :— exécution du suivi sur le terrain du projet afin de vérifier la conformité des réalisations phy-
siques et activités par rapport aux projets adoptés par le comité consultatif de sélection desprojets ;
— production de comptes rendus bi-hebdomadaires pour informer le service de coopérationet d’action culturelle sur le déroulement du projet ;

90Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— intervention en tant qu’appui-conseil ;— vérification sur site des mémos financiers (vérification de la véracité des justificatifs four-
nis ainsi que de la concordance avec les devis présentés dans les projets) ;— production d’outils de gestion simplifiés et formation à leur utilisation (cahiers de caisse,
fichiers d’abonnés, fiches de gestion de stocks…);— production de rapport de fin d’exécution du projet.
Le montant versé à l’EUPD doit permettre de couvrir les dépenses de déplacement (carbu-rant, entretien), l’utilisation d’un bureau et de ses moyens informatiques, les fournitures debureau nécessaires, les honoraires de la personne chargée d’assurer les activités décrites ci-dessus et les frais de gestion du siège»
Dans l’ensemble, là où il y a des gestionnaires identifiés des CD/FSD, leur présence «sur le ter-rain» et auprès des «bénéficiaires» pendant le projet est encore plus modeste que leurs capaci-tés d’accompagnement en amont des projets.
En effet, la pression qui s’exerce sur eux de la part de leur hiérarchie concerne le flux desdemandes à prendre en compte, et l’objectif d’engager les crédits; tandis que, une fois les projetsapprouvés, la comptabilité et le suivi apparaissent comme des fardeaux peu gratifiants.
3.5. BILAN STATISTIQUE DES RÉALISATIONS
Les éléments statistiques sont tous tirés de l’analyse de la base de données centralisant les réponsesdes postes, et comprenant 1269 projets dans 30 pays.
Localisation en zoneurbaine Nbre projets %
Montant(kFF) %
ANGOLA 19 66% 7 404 54%BENIN 44 52% 12 539 59%BURKINA FASO 33 53% 10 167 59%BURUNDI 29 85% 6 355 93%CAMEROUN 49 68% 22 060 76%CAP-VERT 12 60% 3 704 71%CENTRAFRICAINE (R.) 15 79% 3 420 88%COMORES 11 50% 2 418 62%CONGO 14 74% 9 009 90%CONGO RDC 35 92% 24 034 92%COTE D'IVOIRE 35 80% 9 607 84%DJIBOUTI 12 50% 2 240 50%GABON 15 79% 3 978 86%GUINEE 27 56% 8 494 90%GUINEE EQUAT. 7 78% 1 680 89%GUINEE-BISSAO 4 40% 1 772 64%HAITI 63 59% 14 141 58%MADAGASCAR 32 67% 13 637 75%MALI 50 40% 10 020 39%MAURITANIE 11 55% 4 696 78%MOZAMBIQUE 13 93% 3 556 92%NAMIBIE 6 67% 2 540 87%NIGER 55 47% 12 741 49%PETITES ANTILLES 11 65% 2 782 76%RWANDA 7 78% 3 940 80%SAO TOME 11 73% 2 678 80%SENEGAL 26 63% 6 073 65%SEYCHELLES 1 7% 480 17%TCHAD 85 66% 15 942 74%TOGO 29 56% 7 029 43%Total 761 60% 229 134 67%Rappel total projets 1269 100% 340 987 100%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

91Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
82 % des projets concernent des réalisations physiques, localisées pour 60 % d’entre elles en milieuurbain et pour 32 % en milieu rural. Les projets en milieu urbain ont un montant moyen plus élevéet recueillent de ce fait 67 % des fonds. Ce pourcentage peut dépasser 90 % dans certains pays commele Mozambique, le Burundi ou le Congo RDC: cela traduit en général des situations d’insécurité danslesquelles le fonctionnement de la coopération se limite pour l’essentiel à la capitale. Il apparaît cepen-dant, comme au Mozambique, une inertie : les dynamiques de réinvestissement de la société civile versles provinces, en cas d’amélioration de la sécurité civile, ne sont suivies qu’avec des années de retardpar la coopération française.
Dans quelques cas, les CD/FSD sont investis par le poste de façon ciblée sur un territoire particulier :un quartier de Bangui en Centrafrique, la région du fleuve Sénégal au Mali. Cela se traduit dans ce der-nier cas par une (courte) majorité de financements allant au milieu rural.
Ces données sont à rapprocher des objectifs des CD/FSD (priorité au milieu urbain) mais aussi de larépartition de la population, qui reste rurale à plus de 80 % dans certains des États où la ville reçoit legros des financements (Mauritanie, Burkina Faso, Burundi et Rwanda…). Les éléments d’informationdisponibles incitent donc à penser qu’en termes géographiques, les CD/FSD n’opèrent pas de redistri-bution de revenus entre régions riches et pauvres, mais plutôt un accroissement des écarts de revenus.Le constat pourrait être différent à l’échelle plus fine du quartier, mais les évaluateurs n’ont pas lesmoyens statistiques de le vérifier.
Ventilation par secteurs
Domaine des projets CD/FSD(en % des fonds)
Dév.économique
Dév.institut.
Educ,format.
Santé,social
Culture,francophonie
Autre (dtdévrural)
ANGOLA 49% 2% 6% 30% 13% 0%BENIN 20% 6% 32% 24% 8% 10%BURKINA FASO 9% 5% 49% 15% 7% 9%BURUNDI 3% 13% 33% 24% 19% 5%CAMEROUN 11% 4% 5% 44% 4% 30%CAP-VERT 36% 12% 10% 20% 21% 0%CENTRAFRICAINE (R.) 7% 10% 18% 35% 22% 7%COMORES 9% 0% 11% 28% 14% 0%CONGO 52% 0% 38% 8% 2% 0%CONGO RDC 39% 4% 33% 10% 11% 3%COTE D'IVOIRE 22% 0% 9% 66% 3% 0%DJIBOUTI 33% 14% 14% 13% 25% 0%GABON 44% 4% 19% 0% 29% 0%GUINEE 2% 10% 39% 44% 2% 3%GUINEE EQUAT. 0% 5% 11% 17% 52% 16%GUINEE-BISSAO 39% 34% 0% 11% 16% 0%HAITI 16% 7% 16% 32% 29% 0%MADAGASCAR 34% 1% 16% 41% 4% 4%MALI 28% 6% 30% 26% 9% 1%MAURITANIE 4% 39% 4% 45% 7% 0%MOZAMBIQUE 0% 9% 0% 72% 7% 12%NAMIBIE 5% 0% 21% 16% 58% 0%NIGER 42% 1% 13% 37% 3% 4%PETITES ANTILLES 49% 0% 9% 19% 5% 10%RWANDA 37% 0% 32% 1% 29% 0%SAO TOME 62% 4% 9% 15% 6% 4%SENEGAL 28% 0% 22% 41% 7% 1%SEYCHELLES 19% 0% 9% 3% 45% 24%TCHAD 1% 28% 24% 9% 19% 19%TOGO 11% 0% 32% 47% 0% 8%Total 24% 6% 22% 29% 11% 7%Total en % du nb de projets 20% 6% 20% 28% 14% 7%Variabilité selon les pays 18% 10% 13% 18% 15% 8%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

92Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— Avec 28 % des projets et 29 % des fonds, le domaine de la santé et du social est le premier bénéfi-ciaire des fonds CD/FSD.
— Le développement économique vient en second avec 24 % des fonds pour 20 % du nombre de pro-jets. Dans quelques pays, les financements sont principalement destinés au développement écono-mique: Sao Tome et Principe (62 %), Petites Antilles (49 %), le Congo-Brazzaville (52 %): la varia-bilité entre pays est assez élevée puisque ce type de financements est pratiquement exclus dansd’autres pays comme le Burundi, la Mauritanie et le Tchad.
— L’éducation et la formation sont le troisième secteur bénéficiaire avec 22 % des fonds (20 % dunombre de projets).
— Les projets dans le secteur culture et francophonie représentent 11 % des fonds et 14 % du nombrede projets.
— Les projets participant au développement institutionnel et à l’état de droit représentent 6 % du total,le pourcentage étant en fait très variable. Ils sont assez nombreux d’autre part dans certains pays oùle fonctionnement démocratique n’est pas assuré au cours de la période sous revue (13 % des fondsau Burundi, 34 % en Guinée-Bissau, 39 % en Mauritanie, 28 % au Tchad). Ils tendent à décroîtredans plusieurs des pays étudiés (Tchad…); cependant, on ne peut vérifier aucune tendance géné-rale d’évolution quant à la répartition sectorielle des fonds.
— Les projets «autres», 7 % des fonds et du nombre de projets, comprennent notamment certainesactions de développement rural.
Répartition sectorielle des fonds selon l’année de début du projet
Le montant moyen par projet est de 269 kFF, avec une assez forte variabilité, de 169 kFF au Tchad, à685 kFF par projet au Congo RDC.
À l’image du plafond qui a doublé depuis les CDI (de 1 à 2 MFF), le montant moyen a ainsi pra-tiquement doublé puisqu’il était de 141 kFF sur la période 1988-1992 – époque où 40 % des opé-rations se faisaient pour un montant inférieur à 50 kFF, somme qui constitue le plancher pour lesCD/FSD.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000
Autre
Culture,franco.
Santé,soc.
Educ,format.
Dév.institut.
Dév. éco

93Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
3.6. SUIVI DES RÉSULTATS ET DE L’IMPACT
(On désigne par «résultats» ce qu’il advient des réalisations du projet une fois celui-ci effectif, doncla façon dont les bénéficiaires visés utilisent, ou non, le service que le projet devait apporter: fréquen-tation d’un nouveau marché… On désigne par «impact» ou «effet» la façon dont le projet a amélio-ré ou non la vie des gens, notamment au regard des objectifs visés au départ : hausse du chiffre d’af-faires, de l’hygiène alimentaire…).
Les résultats et l’impact des projets sont généralement très mal connus par les SCAC en raison de l’ab-sence générale de suivi ex post et a fortiori d’évaluation. Ce que les évaluateurs ont constaté sur placeétait souvent, en termes de résultats et d’impact, bien différent – en pis comme en mieux! — de ce quiapparaissait dans les dossiers ou de ce que pensaient les personnels français les plus au courant des dos-siers.
Le principal retour sur les projets après leur réalisation se fait dans un but de communication à com-mencer par l’éventuelle inauguration. Cet impact sur l’image de la France ne fait pas pour autant l’ob-jet d’une stratégie suivie. L’inauguration ne s’inscrit pas dans un souci durable de visibilité ; il y a aumieux visibilité ou valorisation des coopérants qui ont instruit et suivi le projet, plus que promotion dela France dans son ensemble. Une visibilité de l’aide française est obtenue auprès des quelques notables
Montant moyen desprojets CD/FSD selon lespays
Nbreprojets
Montantmoyen
(kFF)Montant
total (kFF) % du totalANGOLA 29 472 13 674 4%BENIN 84 253 21 212 6%BURKINA FASO 62 276 17 135 5%BURUNDI 34 201 6 836 2%CAMEROUN 72 405 29 188 9%CAP-VERT 20 262 5 242 2%CENTRAFRICAINE (R.) 19 205 3 886 1%COMORES 22 178 3 927 1%CONGO 19 527 10 020 3%CONGO RDC 38 685 26 030 8%COTE D'IVOIRE 44 260 11 428 3%DJIBOUTI 24 187 4 487 1%GABON 19 242 4 602 1%GUINEE 48 197 9 440 3%GUINEE EQUAT. 9 209 1 880 1%GUINEE-BISSAO 10 277 2 771 1%HAITI 107 229 24 512 7%MADAGASCAR 48 378 18 148 5%MALI 125 207 25 915 8%MAURITANIE 20 300 6 007 2%MOZAMBIQUE 14 275 3 856 1%NAMIBIE 9 324 2 915 1%NIGER 116 224 25 986 8%PETITES ANTILLES 17 215 3 647 1%RWANDA 9 549 4 940 1%SAO TOME 15 224 3 365 1%SENEGAL 41 228 9 342 3%SEYCHELLES 15 186 2 789 1%TCHAD 128 169 21 613 6%TOGO 52 311 16 194 5%Total 1269 269 340 987 100%
Informations fournies par les postesen réponse à une enquête du MAE sur 1269 projets

94Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
et opérateurs avec lesquels la coopération a travaillé, tandis que l’objectif de promotion de la Francecomme bailleur «social» dans la «communauté des bailleurs», sur lequel plusieurs SCAC se sontinvestis en 1996, mobilise moins.
Il n’y a pas de dispositif organisé ou systématique de visite de projets ex post, à l’inverse de ce que pra-tiquent quelques autres bailleurs (comme le DED au Tchad avec une procédure de visite à un an). Il ya très peu d’évaluation ex post, mais on repère quelques exceptions:
— Le SCAC Burundi a préparé la présente étude par une évaluation de tous ses projets terminés,confiée à l’AFVP.
— Le SCAC Madagascar a confié l’évaluation de 12 projets terminés au cabinet malgache COEFRessources.
Il semble que dans les deux cas, l’évaluation ait été faite pour l’essentiel par entretiens de l’évaluateuravec l’opérateur technique du projet, sans nécessairement de visite «sur le terrain», ce qui conduit, dansquelques-uns des cas où nous avons pu comparer avec nos propres observations, à des conclusionsétonnantes pour ce qui est des résultats des projets. Ces deux évaluations sont cependant des documentsintéressants qui, au moins dans le cas de Madagascar, ont suscité des décisions quant à la gestion desCD/FSD.
Globalement, l’analyse des rapports de présentation fait ressortir un manque de «leçons de l’expérien-ce», qu’on peut relier à la faiblesse des dispositifs de suivi et d’évaluation pour tout ce qui dépasse lesuivi financier.
Le bureau de l’évaluation de la DGCID, dans ses observations sur les rapports de présentation à desti-nation du comité d’examen des projets, en fait fréquemment état :
— Manque de définition d’objectifs et d’indicateurs de mesure de leur atteinte :
Cap-Vert (2001-?)
«Il existe dans ce dossier (comme dans tous les autres rapports de présentation CD/FSD) undécalage entre les objectifs généraux (lutte contre la pauvreté, amélioration de l’environne-ment, actions à forte intensité de main-d’œuvre…) et les sous-projets: que se passerait-il sion appliquait à chaque sous-projet un ratio «objectif» que l’on pourrait doter d’un coeffi-cient?».
— Faible maîtrise des résultats et des effets :
Maurice (2001-114)
“Les rapports d’exécution sont précis quant aux activités réalisées et aux moyens dépensés.Par contre, on sait peu de choses des résultats et encore moins de leurs impacts»
Seychelles (2001-11)
«Nous ne disposons pas de mesures d’impact sur les bénéficiaires finaux»
Liberia (2001-77)
«Pourquoi n’est-il pas rendu compte, dans les conditions habituelles de l’utilisation de ladotation CD/FSD de 2 MF accordée en 2000? Tout ce que le projet indique est le finance-ment de quatre opérations sans produire les fiches. Pourtant la dotation CD/FSD est géréepar le SCAC d’Abidjan qui connaît les procédures (des protocoles sont-ils établis? le cofi-nancement 70/30 est-il respecté?). Il est vrai que les CD/FSD se prêtent facilement à ce typed’intervention, mais comme on n’est pas dans le contexte prévu, comme on ne respecte pasles instructions, comme on ne suit pas le dispositif, pourquoi ne pas intituler le projet :‘actions humanitaires dans le secteur social et sanitaire?’ ». […] « L’évaluation telle qu’el-le est prévue consiste uniquement de s’assurer que l’argent est effectivement dépensé, et iln’est pas possible d’apprécier l’efficacité ou l’impact».
Niger (2001-83)
«Les fiches font un bon compte rendu, mais il ne s’agit pas vraiment d’une évaluation».

95Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— Faible pratique de l’évaluation, d’où questions sur l’utilisation des crédits de suivi-évaluation:
Territoires Palestiniens (2001-154)
“2 % des crédits sont destinés à des missions de courte durée et au suivi des différents pro-jets. Il sera intéressant d’établir un suivi à partir d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (enplus du suivi financier)».
Angola (2001-105)
«L’évaluation proposée semble plutôt s’apparenter à un suivi financier. Est-il possible dedétailler plus précisément ce à quoi correspondent les 78715 F prévus pour les missions decourte durée, le suivi et l’évaluation?»
Les CD/FSD ne semblent pas faire exception sur ce point par rapport à l’ensemble des projetsFAC/FSP, à en juger par le rapport de la Cour des Comptes sur les procédures de gestion des créditsdes Missions de Coopération et d’Action Culturelle, recoupant les constats des évaluations antérieuresdes crédits déconcentrés:
«La Cour a constaté que les projets ne faisaient pas systématiquement l’objet d’une véritableévaluation de leurs résultats par rapport aux objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre.Il n’existe tout au plus que des «bilans» ou des comptes rendus partiels, peu chiffrés, ne per-mettant de tirer aucune conclusion de l’exécution des projets. Il ne faut pas s’étonner, dansces conditions, si les mêmes erreurs se répètent sans qu’il y soit mis fin. Les missions decoopération privilégient les tâches de gestion au détriment de l’évaluation. Cette situationpeut s’expliquer par la faible ancienneté moyenne des conseillers de mission, qui, n’ayant pasla mémoire des projets, sont peu enclins à les évaluer. Force est de constater que peu de pro-jets ont été remis en cause, la pratique étant de reprendre dans un nouveau projet les finali-tés du précédent malgré son échec avéré».
4. Relations avec ParisLe moment-clé des relations des postes avec Paris est l’écriture des rapports de présentation, et leur exa-men par les comités (le comité d’examen et l’ex-comité directeur du FAC, devenu conseil d’orientationstratégique du FSP).
Le Chargé de mission géographique (CMG) se comporte en avocat du SCAC au comité d’examen.Il lui donne les clefs de langage (concepts porteurs, notions «en vogue») que le SCAC va intégrer danssa rédaction pour habiller son projet. Le CMG participe même généralement à la rédaction des rapportsde présentation, ce qui lui permet de s’approprier le document jusqu’à ce qu’il se sente en mesure dele «défendre».
Les possibilités d’action des comités sont dans la pratique plus limitées que sur les autres projetsFSP. En effet, le taux de déconcentration des crédits est fixé par l’instruction de 1996 à 15 % au moinsdes FSP-État : il ne s’agit pas de refuser ou d’accepter l’octroi de crédits déconcentrés, tout au plusd’exiger que cet octroi se fasse dans un cadre conforme aux objectifs des CD/FSD. Or le rapport deprésentation est par définition très déconnecté du contenu de chacun des projets qui seront ultérieure-ment proposés par des demandeurs. Le seul point sur lequel le rapport de présentation puisse, dans lapratique, contenir des engagements précis, porte sur la procédure, par exemple sur la composition ducomité consultatif. Mais Paris est peu en mesure de vérifier ensuite le respect effectif de ces engage-ments, qui ne laissent pas de traces dans les flux financiers.
On en arrive donc à un octroi quasi-automatique des enveloppes CD/FSD.
Un élément de contestation vient du Bureau de l’évaluation qui fait le constat régulier, de 1996 à1998, du faible niveau de «gestion et de formulation des projets», d’où ses propositions de refonte duplan des rapports de présentation, en 1999, proposition qui tend à voir figurer dans les rapports deslignes directrices plus claires pour l’emploi de la future enveloppe.

96Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
37 Terme créé par le Conseil d’État, à notre connaissance en 1967 dans l’examen de la législation sur les Parcs NaturelsRégionaux.
La commande de la présente évaluation des CD/FSD émane du Bureau de l’évaluation lui-même, dansla logique des remarques et propositions qu’il formule depuis des années:
— Critiques sur certains choix d’affectation des ressources financières.
Seychelles (2001-11)«Est-il bien judicieux de financer la Francophonie (1er poste de dépenses) par le biais desCD-FSD?»
Togo (2001-80)«Peut-on utiliser les crédits du FSD à l’assistance d’un volontaire de l’AFVP?»
Gabon (2001-71)
«Un certain nombre de projets relèvent davantage du financement sur Titre IV que d’unCD/FSD. Un seul exemple sera cité: l’aide de 369000 F octroyée à l’association «Union desécrivains gabonais». On pourrait en citer d’autres. Il conviendrait que le présent projet soitvraiment orienté vers la structuration de la société civile».
• Une personnalité membre du comité directeur du FAC pendant plusieurs années de la pério-de sous revue, le sénateur Michel Charasse, a également mis en cause à de nombreusesreprises la légèreté des justifications figurant dans les projets transmis par le comité d’exa-men, pour certains financements à la limite du champ des CD/FSD. Cette pression a contri-bué à une plus grande vigilance du comité d’examen sur le contenu des rapports de pré-sentation.
— Remarques sur la diversité des pratiques, qui ne semble pas toujours causée par la diversité dessituations des pays:
«Les modalités d’instruction des requêtes, les principes de cofinancement, les procédures demise en œuvre ou les méthodes de contractualisation suivent les instructions du Départementdans leurs grandes lignes, mais on relève souvent des écarts, sans savoir s’il s’agit de dérivesou d’adaptations aux conditions locales. Par exemple, certains postes contribuent à des opé-rations de micro-crédits alors que d’autres postes estiment que de tels projets à caractère plu-riannuel ne peuvent bénéficier d’un tel soutien».
Note de M. Ruleta (Bureau de l’évaluation) au comité d’examen, mars 1999.
— Critiques sur l’absence de suivi-évaluation dans les pays (cf. supra 3.6).
L’évaluation dans les 6 pays a montré dans certains cas une grande continuité par rapport aux CDIantérieurs (Tchad, Mauritanie…); dans l’un des pays (Burundi), on dit et l’on écrit encore «CDI».
Comme le terme double de «CD/FSD» l’exprime très bien, on a affaire à la fois à un instrument avec sapolitique, ses intentions (sociales, de développement), et à une pure et simple délégation de crédits, renou-velée de façon rituelle une fois atteint le seuil de 75 % d’engagements sur l’enveloppe précédente.
La déconcentration qui est le principe même des CD/FSD, en fait un dispositif local subordonné auxobjectifs locaux de l’ambassade (et il est heureux qu’elle dispose effectivement de fonds «souples»pour poursuivre ses objectifs). L’existence d’une instruction réglementant le fonds est d’ailleurs igno-rée, dans plus d’un pays, par les gestionnaires : le texte des rapports de présentation semble en tenir lieu.
Il y a donc une situation paradoxale dans laquelle, en fin de compte, la conformité de l’emploi desfonds aux objectifs du FSD repose sur la communauté culturelle du milieu de la coopération, surles valeurs professionnelles partagées par l’administration centrale et par les SCAC. Elle trouve seslimites dans la différence de position entre l’administration centrale, conceptrice de stratégies dedéveloppement, et un poste qui a ses propres objectifs de développement institutionnel propre dansle pays où il se trouve.
Précise pour ce qui est du mode d’emploi des fonds, l’instruction de 1996 comprend en revanche du«droit à l’état gazeux 37” pour ce qui est du reste, définissant des «objectifs», des «priorités», des

97Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
«notamment». Un tel «droit à l’état gazeux» est adapté aux situations dans lesquelles on est assuré dela communauté d’objectifs entre les acteurs locaux et l’autorité qui réglemente. Il est quasi-inopérantquand les acteurs locaux chargés de l’appliquer, ont des jeux d’objectifs propres différents de ceux duniveau central, et c’est le cas pour les ambassades.
Seuls sont donc opérants, dans la réglementation des CD/FSD,
— les éléments «durs», «procéduriers», les points de passage obligés, sous réserve que l’on puisseeffectivement contrôler leur observance: or la distance géographique et le nombre élevé de projetslimitent les capacités de vérification pour tout ce qui n’est pas financier ;
— les éléments qui, bien que flous et peu vérifiables, ont une valeur «éthique» au sens de l’éthiquepartagée du milieu de la coopération (refus d’opérations de prestige…).
En d’autres termes, les possibilités dont Paris disposent pour faire appliquer certaines orientations parles postes en matière de CD/FSD reposent :
— à court terme sur la définition d’un noyau de procédures fermes et vérifiables, donc peu nom-breuses;
— à court et long terme sur la formation des coopérants appelés à travailler sur CD/FSD (notamment,à court terme, les juniors).


QUATRIÈME PARTIESynthèse évaluative


101Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Les évaluateurs signalent en préambule que, dans certains pays, les CD/FSD tiennent dans la coopéra-tion française une place qui dépasse leur vocation initiale : quand la coopération inter-étatique est sus-pendue, les seuls fonds d’investissement (titre VI) restent les CD/FSD, et il peut même arriver commeà Haïti que le poste obtienne le report sur CD/FSD des sommes qu’il aurait dû gérer sur FSP «État».
Ailleurs, comme au Burundi, l’AFD n’est pas présente et c’est le SCAC qui gère d’importants projetsde développement économique et social, qui de facto marginalisent les CD/FSD.
La synthèse évaluative qui suit se concentre sur le cas «standard» où les CD/FSD coexistent, dans lacoopération du SCAC, avec des projets FSP «État».
1. Bénéfice durable apporté aux publics visés parle dispositif
«Le ciblage sur les populations les plus pauvres a été souligné, même si les évaluations ontconstaté que seule une minorité des très pauvres était touchée par les fonds sociaux, faute decapacités à porter eux-mêmes leurs besoins et par suite du manque d’intermédiaires dans lesrégions isolées».
Bilan des fonds sociaux à la conférence de la BM à Washington en mai 1997, selon le comp-te rendu de mission de Lucien Cousin et Claude Praliaud.
L’analyse des mécanismes d’impact des projets sur les publics visés dépasse les possibilités de l’éva-luation: c’est pourquoi le cahier des charges avait préféré le terme de «bénéfice durable» apporté auxdestinataires.
Pour savoir dans quelle mesure les projets apportaient un bénéfice durable aux publics visés par le dis-positif CD/FSD, les évaluateurs ont étudié d’une part leur ciblage (qui est touché?), d’autre part la via-bilité ou durabilité des réalisations.
— Apporter une aide à des populations pauvres est un objectif, au moins implicite, des per-sonnes qui gèrent et attribuent les fonds CD/FSD.
Cependant ce n’est pas un critère utilisé de façon systématique, ni même un critère souvent évoquéexplicitement (on admet implicitement qu’un projet en milieu rural, par exemple, bénéficiera à despopulations pauvres). Enfin ce critère ne recoupe que rarement les axes stratégiques de la présence française dans les pays visités ; or le dispositif étant entièrement déconcentré (aucun contrôle centrala priori quant à la nature des projets financés, pas ou très peu de procédures vérifiables à suivre), c’estde façon naturelle un outil d’intervention pour l’ambassade en fonction de ses objectifs stratégiques.
Au final, certains projets visent bien des publics particulièrement pauvres (handicapés mentaux, jeunesmamans de quartiers périphériques…) tandis que d’autres touchent au contraire des publics «d’élite»comme les universitaires ou les administrations centrales de l’État.
Le ciblage des populations pauvres relève parfois d’une logique caritative («on a nos pauvres», admetun interlocuteur) pour laquelle l’ambassade est le financeur de réseaux français ou francophiles : ONGfrançaises sur place, Église catholique, relations des assistants techniques…
Les projets bénéficiant plus aux femmes qu’aux hommes sont très minoritaires.
On peut relier ces constats sur le FSD au constat plus général fait par l’IRAM sur la «difficulté» de la

102Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
38 «Lutte contre la pauvreté et les inégalités», op. cit., conclusion de la partie 5 «Actions sociales et catégories ‘marginali-sées’», p. 123.
coopération française «à prendre en compte la société dans ses différenciations (hommes/femmes,jeunes, pauvres, statuts sociaux différents)» et sa «croyance […] dans les capacités intégratrices desÉtats et de leurs institutions à réguler l’ensemble des sociétés.38 »
— La viabilité des projets financés, ou a minima le fait qu’ils produisent leurs effets sur la duréeinitialement prévue, est un souci constant des professionnels français de la coopération danschacun des pays étudiés.
C’est vrai au plan technique (contrôle attentif de la qualité des bâtiments…), c’est de plus en plus vraiau plan économique (attention croissante au «recouvrement des coûts», aux prix de vente…), c’estencore vrai, bien qu’avec une compétence inégale, au plan social : les SCAC se préoccupent de l’ap-propriation des projets par les bénéficiaires.
Les CD/FSD ont un caractère ponctuel – ils ne doivent pas être réitérés au profit d’un même projet, oufinancer des dépenses récurrentes – et, bien que cette règle soit parfois ignorée ou contournée, ellecontribue à éviter une dépendance durable de la structure bénéficiaire envers la coopération française.
La viabilité et de façon générale la «qualité» des projets financés sur CD/FSD contraste, aux yeux denombreux coopérants, avec ce qu’il advient des projets financés par des dispositifs financiers de gran-de ampleur, français ou multilatéraux.
Les «bons projets» financés dans chaque pays sont d’ailleurs parfois mis en avant par les officiels fran-çais pour illustrer la valeur apportée au pays par notre coopération.
Les évaluateurs ont noté de façon très positive la plupart des projets à l’aune de ce critère.
Faire passer ces conclusions de l’échelle des projets financés à celle du pays aidé, pose la question del’impact. Obtenir un impact significatif à l’échelle du pays aidé passerait par une démultiplication del’expérience des projets financés, via la capitalisation d’expérience et la communication, points quiseront évoqués plus loin (5, 6).
2. Structuration de la société civileLes évaluateurs ont étudié les effets potentiels des projets financés, sur la structuration sociale, à deuxniveaux: celui des «bénéficiaires» visés (public) et celui des «opérateurs» de projet (ONG natio-nales, par exemple).
— Les projets financés sur CD/FSD ne contribuent à structurer les gens qui doivent en bénéfi-cier, que dans la mesure où cela relève de la méthodologie d’intervention de l’opérateur.Orienté sur l’investissement physique (bâtiments…), le dispositif ne finance pas explicitement, etne réalise que rarement, d’accompagnement social auprès des groupes de population visés par lesprojets.
Le dispositif se distingue négativement, sur ce point, de certains autres fonds ou stratégies de bailleurs ;cependant la différence reste modérée, car le caractère «coopératif», «de base», «autogéré», «spon-tané», «villageois» revendiqué par de nombreux bailleurs pour les projets qu’ils financent, ne résistepas souvent à l’analyse; il s’agit en grande partie d’une mise en scène destinée au bailleur. En fait, lesprojets d’investissement prennent place dans un contexte et une dynamique sociale qui peut ou non,selon le pays et l’époque, avoir un caractère «communautaire».
• La règle de non-récurrence limite la capacité des CD/FSD à favoriser la structuration de lasociété civile à la base, comme le remarque un agent du Bureau de l’évaluation dans unenote au comité d’examen des projets (mars 1999) :
«Il apparaît indispensable d’examiner attentivement le postulat posé dans les instructions dudépartement relatif aux actions menées dans le temps et non reconductibles, au regard desexigences du développement, de l’appui institutionnel aux communautés de base et de l’émer-gence de collectivités locales autonomes. Le développement, dont l’évaluation s’apprécie en

103Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
termes d’impact et de pérennisation, s’inscrit dans le moyen terme et justifie un appui pro-longé et répété sur plusieurs années».
— La contribution des CD/FSD au renforcement de la société civile organisée, c’est-à-dire des struc-tures qui bénéficient des fonds et mettent en place des actions, est essentiellement limitée à desaspects techniques: le suivi attentif par le SCAC, de petits projets d’investissement, lui permetd’élever le niveau de compétence technique et administratif de certains opérateurs (Mauritanie dansle domaine de l’eau); parfois (Madagascar), de les mettre en réseau.
Sur la dimension plus socio-politique, ou culturelle, que pouvait viser le dispositif, les CD/FSD nejouent qu’un rôle minime. L’isolement, toujours vérifié, du milieu de la coopération française par rap-port aux acteurs du développement dans la plupart des pays, n’est que très partiellement et très lente-ment combattu par le dispositif CD/FSD. Les réseaux de relations qui sous-tendent la grande majoritédes projets, se tissent autour de la coopération avec l’État, ou d’institutions françaises ou francophilesdans les pays, qui font écran par rapport à un contact direct entre la coopération française et les struc-tures nationales.
— Globalement, les enveloppes CD/FSD ne comprennent qu’une fraction minime allouable à destâches de suivi (2 %), et le coût complet du personnel SCAC affecté aux CD/FSD peut souvent êtreévalué à l’équivalent de 10-20 % du montant des enveloppes. Alors que, dans le financement demicro-projets en milieu pauvre, les coûts d’accompagnement peuvent facilement dépasser les coûtsdirects des projets.
Dans ces limites restrictives, les CD/FSD sont une occasion pour de nombreux personnels françaisexpatriés, de s’ouvrir au développement local et «d’aller sur le terrain», étant mobilisés par le SCACcomme conseils techniques ou comme relais.
La présence généralement faible d’acteurs de la société civile dans les comités consultatifs attes-tent de la distance qui reste considérable entre les services français et la société civile. Les diffé-rentes raisons qui viennent à l’esprit pour expliquer ce faible recours,— manque de connaissance de ces acteurs,— difficulté à définir avec les autorités de l’État la liste des représentants de la société civile invités à
participer au comité consultatif (la liste est annexée au protocole d’accord avec l’État),— difficulté à faire travailler un ensemble d’acteurs venant d’horizons différents,
témoigneraient toutes d’un manque d’aisance des personnels français par rapport à ces nouveauxacteurs, largement financés par d’autres bailleurs, qui s’immiscent dans le tête-à-tête historique entreles administrations française et nationale.
Une amélioration dans la concertation avec les nationaux ou le recours à des expertises nationales peutêtre constatée dans quelques pays (Tchad…), mais le retard sur ce plan entre la France et nombred’autres bailleurs bilatéraux ou grandes ONG, semble loin de se combler.
3. Capacité opérationnelle des SCAC dansla gestion de ces fonds
Les capacités manifestées par les SCAC dans la gestion des enveloppes et des projets CD/FSD,apparaissent globalement satisfaisantes pour ce qui est de la gestion stricto sensu ; mais au détri-ment du suivi, de l’évaluation, de l’insertion dans les réseaux de la société civile et des contactsavec les partenaires et les bénéficiaires.
— La délégation de tâches de gestion à un personnel junior est souvent pratiquée (VP, VSN/VI…),notamment là où les enveloppes sont les plus importantes (Haïti, Tchad…). Indépendamment desquestions que cela peut poser quant aux conditions et au financement de ces affectations, une telledélégation apparaît comme un facteur extrêmement positif :
• pour la qualité de gestion, la relation avec les demandeurs ;• pour la capacité d’absorption du poste ;

104Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
• pour le respect des objectifs statutaires du dispositif, qui sont cohérents avec les objectifs per-sonnels des volontaires quant à leur travail de coopération (même si l’instruction de 1996 estsouvent inconnue).
— Le recours à du personnel en contrat local, personnel national notamment, en complémentdu personnel expatrié, est très peu pratiqué (Madagascar…) alors que cette solution sembleraitparfaitement adaptée à la gestion de micro-projets. La plupart des autres bailleurs la pratiquent, ycompris des organisations de volontaires. Le fait que les SCAC n’y recourent pas (par choix oupar souci de stricte conformité à l’instruction de 1996) augmente le coût de gestion du dispositifet réduit la capacité de compréhension des projets et des événements par le personnel ; doncaugmente les temps de gestion et les risques d’erreurs.
— Certains postes arrivent à mettre en œuvre le dispositif sans personnel dédié (Burundi…),donc en mobilisant le personnel au plus haut niveau, notamment le chef de SCAC. Cette pratique,fort intéressante et qui peut améliorer la qualité unitaire de certains projets, implique en toutcas une forte charge de travail et limite fortement la capacité d’absorption ainsi que la vitessede traitement des dossiers. De plus, cette formule conduit à une grande informalité (peu de procé-dures écrites) donc au risque de ruptures en cas de départ du «leader» qui mobilise l’ensemble.
— Le souci d’évaluation ex post est en général inexistant. Cependant deux postes se sont interro-gés sur le sujet et ont mobilisé des expertises externes.
Les coûts de gestion de tout mécanisme de financement de micro-projets sont élevés comparés auxmontants distribués : le montage des dossiers nécessite un appui important de la part du personnel duSCAC en faveur des promoteurs. En effet, les demandes reçues par les cellules FSD doivent souventêtre discutées avec le promoteur afin de s’accorder sur un projet viable et répondant réellement à unbesoin prioritaire des bénéficiaires. La cellule FSD apporte également un appui technique aux promo-teurs pour le montage du dossier avant passage au comité de sélection puis parfois dans le cadre de samise en place (suivi comptable et financier, contrôle de l’avancée des travaux).
La gestion du FSD apparaît très personnalisée, elle manque donc de continuité dans le temps, cequi est dommageable à ses objectifs généraux. Les structures et les procédures de fonctionnementdes FSD, telles qu’elles sont définies dans les textes, laissent un pouvoir quasi-discrétionnaire à l’am-bassadeur et/ou au conseiller de coopération qui en sont les responsables directs. Ce sont eux qui choi-sissent le personnel chargé d’assurer le fonctionnement de la structure, décident de la stratégie d’inter-vention du fonds et donnent leur aval pour le financement des projets. Le personnel exécutif des SCACne restant en poste que pour une durée limitée, la gestion d’un instrument tel que le FSD en souffre, carelle repose en grande partie sur la connaissance des acteurs de la société civile locale et sur la consti-tution d’un réseau d’interlocuteurs. Le problème se pose surtout lors du remplacement du conseiller decoopération ou des personnes chargées de la gestion de la cellule FSD.
4. Concertation avec les acteursSur l’emploi des CD/FSD, la concertation de la coopération française avec les autres acteurs est dequasi-inexistante (Burundi) à importante (Mozambique), mais, de façon générale, insuffisante.
— Les partenaires «État», notamment les ministères techniques, sont dans certains cas consultés, defaçon profitable aux deux parties (Madagascar…), mais cela ne remplace pas la «société civile».
— Les autres bailleurs de fonds sont associés de façon ponctuelle à quelques projets, ou superficielle(présentation de l’existence du dispositif). Il n’y a pratiquement pas de partage d’expériences oud’expertise technique entre bailleurs.
• Il est à noter que les micro-projets ne justifient guère de «gestion collective» par la «com-munauté des bailleurs». Le risque de redondance ou d’incohérence des financements a étéminime ces dernières années. Il devient réel quand des bailleurs concentrent des fonds sub-stantiels sur des villes de province, ce qui demande une coordination sur place plutôt quedans la capitale.

105Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— La société civile est, globalement, bien moins associée à l’examen des projets que ne le prévoitl’instruction de 1996. Dans trois des six pays visités, il n’y a pas de comité mixte de sélection desprojets. L’évolution va dans ce sens (Tchad) mais de façon souvent informelle ou floue, et avec desretours en arrière (Haïti).
5. Image de la France dans la société civile
L’image de la France est, dans la plupart des pays, celle d’un appui au pouvoir en place. Divers facteursy contribuent dont la continuité avec l’époque coloniale (mais c’est le cas aussi au Burundi, anciennecolonie belge), la promotion des entreprises françaises sur des secteurs où l’acheteur estl’État, et surtout, sans doute, la conception française de la vie politique – dans laquelle la régulation desrelations économiques et sociales par l’État joue un rôle central : le rôle politique de la société civile estmal compris par la tradition administrative française.
Pour autant, le dispositif CD/FSD a-t-il permis, comme c’était l’un de ses objectifs majeurs, de nuan-cer cette image de relation privilégiée avec le pouvoir d’État?
L’impact de chaque projet sur l’image de notre pays est difficile à évaluer étant donné la différenced’échelle (petit projet et grand objet !).
Quant à l’impact du dispositif CD/FSD dans son ensemble, on peut craindre qu’il ne soit pro-portionnel à sa notoriété, laquelle est habituellement nulle, l’ambassade et le SCAC ne communi-quant pas en général sur son existence.
Peu d’étalage est fait quant à l’origine française du financement: très peu de plaques sur les bâtiments…;la pratique des inaugurations solennelles, avec convocation des média, est plus fréquente. Cela s’appliquesurtout à des projets «à symbolique politique» sur lesquels les ambassadeurs se sont impliqués. Mais, làoù il y a communication démonstrative, cette pratique génère-t-elle une image positive? On peut plutôtpenser qu’une image positive repose sur l’appropriation des projets par des acteurs nationaux quisouhaiteraient eux-mêmes faire état de leurs bonnes relations avec la France. Elle repose donc sur untissu de relations humaines, autant et plus que financières, avec la société civile.
On relèvera que, dans la majorité des pays francophones (le Tchad fait exception), les ambassades etles SCAC semblent accorder plus d’intérêt aux média écrits en langue française, qu’aux radios émet-tant dans les langues utilisées par les habitants.
6. Articulation sectorielle
L’articulation des projets CD/FSD avec le reste de la coopération française sur les mêmes secteurs, etla capitalisation de l’expérience CD/FSD sur ces mêmes secteurs, prennent deux formes:
— la réalisation sur CD/FSD de projets-tests avant la formulation d’un projet plus ambitieux (surFSP);
— la capitalisation personnelle d’expériences par les spécialistes techniques qui suivent les projets (ATpar exemple).
Ces deux modes ne suffisent pas, de l’avis des évaluateurs, à la capitalisation et à la valorisationdes «bonnes pratiques» sur CD/FSD. Ceci alors même que ces projets, très divers, constitueraientune riche base d’expérience secteur par secteur.


CINQUIÈME PARTIERecommandations et enjeux d’avenir


109Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
39 Terme utilisé à plusieurs reprises dans le document «Lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion: une contribu-tion au débat», MAE/DGCID série Repères, non daté (2001?).40 Avec les «appuis aux initiatives de quartiers» et «certaines opérations menées par des ONG», p. 28.
«Les idées principales entendues lors de la conférence ont été les suivantes: écoute et participationdes populations concernées, évaluation des activités, souplesse et adaptation, concertation entre lesdifférents types d’acteurs, articulation des moyens et surtout renforcement des capacités locales à lafois dans la société civile et chez les agents de l’administration».
Bilan des fonds sociaux à la conférence de la Banque mondiale à Washington en mai 1997, selon lecompte rendu de mission de Lucien Cousin et Claude Praliaud.
1. Champ couvert par ces recommandations• Les évaluateurs se sont attachés à étudier l’avenir possible
- d’un dispositif de financement géré dans les pays de destination,- accordant des financements unitaires modestes comparés à ceux des «projets» classiques
(FSP ou AFD),
et qui serait destiné à poursuivre à la fois les deux finalités suivantes :- faire coopérer la France avec des acteurs non-étatiques;- améliorer la situation sociale et économique des populations pauvres par des actions de
développement (et réduire ainsi les inégalités).
Ces quatre caractéristiques sont partagées par les CD/FSD tels que définis par l’instruction de 1996,cependant le champ précédemment défini est un peu plus large: il ne spécifie par exemple pas de prio-rité «urbaine», n’utilise pas le terme de «projet»…
Inversement, ce champ reste assez étroit. Il n’intègre ni les financements qui peuvent être gérés depuisParis (actuels «cofinancements ONG» et coopération décentralisée), ni l’ensemble de la lutte contre lapauvreté et les inégalités, ni l’ensemble des relations entre le MAE et la société civile des pays duSud,…, mais uniquement l’espace de recoupement, peut-être étroit, entre «actions qui améliorent lasituation sociale et économique des populations pauvres» et «relations de coopération avec les acteursnon-étatiques».
• Il y a une synergie, mise en valeur par le consensus actuel sur le développement, entre cesdeux finalités : améliorer la situation sociale et économique des populations pauvres leurdonne plus de «capacités» pour être acteurs de la société civile ; et le développement decette dernière, de même que sa mise en relation avec l’étranger, peut ouvrir des «opportu-nités» pour les populations pauvres. Les deux finalités pourraient cependant être poursui-vies indépendamment l’une de l’autre.
— Dans le cadre de la stratégie de coopération française qui se veut globale et «inclusive 39», le FSDest explicitement situé comme l’un des rares outils explicitement destinés aux populations pauvres,voire comme «directement ciblé vers des populations considérées comme défavorisées ou dominées»40.
On remarquera qu’une action qui remplirait les deux objectifs généraux ci-dessus, faire coopérer laFrance avec des acteurs non-étatiques et améliorer la situation sociale et économique des populationspauvres, concourt de ce fait à un troisième objectif général : améliorer la connaissance que les acteursfrançais ont des réalités socio-économiques et humaines des pays du Sud.

110Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Le champ défini ci-dessus ne recouvre pas tout l’actuel «guichet État» dans la mesure où celui-ci seraitutilisé, en tout ou partie, comme une commodité pour le financement de projets spécifiquement sou-haités par le SCAC ou l’ambassade. Dans les recommandations pratiques, on prendra cependant encompte cette dimension.
On étudie, grâce aux informations collectées au cours de l’évaluation, comment le dispositif, qu’onappellera par commodité CD/FSD, peut répondre à ces objectifs. Ceci conduit à définir six types d’ac-tions finançables sur CD/FSD, regroupées en trois catégories, de nature similaire aux deux «guichets»actuels (partie 5.1).
Ces trois catégories sont ensuite déclinées sous l’angle de leurs procédures de sélection et de suivi-éva-luation (partie 5.2 à 5.4).
Cette revue des actions permet enfin de formuler des recommandations transversales quant à la gestiond’un dispositif qui financerait ces actions-types (partie 5.5).
2. Objectifs spécifiques des CD/FSD et moyensà mobiliser
Les deux finalités générales des CD/FSD – améliorer la situation sociale et économique des populationspauvres et collaborer avec les acteurs non-étatiques – sont de nature différente, si bien qu’il est préférabledans un premier temps, de préciser les voies et moyens d’atteindre chaque objectif, pour ensuite consta-ter l’espace de recoupement entre les deux, dans lequel se situerait le champ d’intervention des CD/FSD.
2.1. POUR AMÉLIORER LA SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS PAUVRES
Les sociétés des pays de la ZSP peuvent être considérées comme globalement pauvres ; du moins lagrande masse de la population est-elle pauvre et à ce titre destinataire légitime des financementsCD/FSD. Mais la masse n’est pas la totalité, et les bailleurs ne sont pas en contact avec la masse. Il estdonc nécessaire d’examiner de façon plus attentive si les projets bénéficient bien aux populationspauvres ou seulement au milieu où se recrutent les interlocuteurs des bailleurs.
• Rapport d’étude de l’IRAM pour le MAE, «Lutte contre la pauvreté et les inégalités»,pp. 138-139 (texte portant globalement sur la coopération française) :
«La prise en compte [explicite] de la lutte contre la pauvreté aurait permis d’améliorer lesinterventions de la coopération française.
— En s’obligeant à expliciter les choix: […] le choix des régions (pauvres et enclavées ou àbonnes potentialités économiques); […] le choix des catégories sociales prioritaires (lesentrepreneurs, les «élites» ou les petits paysans et les femmes).
— En s’obligeant à relier chaque intervention à une ou plusieurs finalités (dont la luttecontre la pauvreté), ce qui évite de rester à un niveau purement technique […];
— En s’obligeant à mieux analyser les différents «acteurs sociaux» ou «catégoriessociales» et les relations qu’ils entretiennent, seule façon de mieux connaître à qui profi-tent les appuis de la coopération française.
Ceci devrait permettre de ne plus se contenter de jugement sommaire sur les effets d’entraî-nement supposés: ‘on se concentre sur les plus dynamiques, les innovateurs… et les autressuivront’ (alors qu’en général les ‘autres’ n’ont pas les ressources économiques ou socialespour appliquer le «paquet unique» qui est proposé).
On doit distinguer le cas de catégories spécialement défavorisées par rapport à la masse de la popu-lation. Plusieurs projets CD/FSD évalués s’adressent à de telles catégories, comme les diabétiques à

111Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
41 On reviendra plus loin sur ces limites; c’est ici l’ordre de grandeur qui compte: trop élevé pour le financement de projetsindividuels de personnes pauvres ; trop faible pour des projets à grande échelle.
Madagascar, les enfants handicapés mentaux en Mauritanie, etc. : ces personnes, qui ont pu dans lepassé être «bien intégrées» dans les villages, sont souvent parmi les premières victimes des mutationssociales en milieu urbain. À moins que leur malheur ne résulte directement des bouleversements de lamodernité, comme les réfugiés, les sidéens ou les enfants de la rue au Burundi. Les coopérations despays démocratiques, comme celles des communautés religieuses, ont une légitimité particulière à inter-venir auprès de ces catégories défavorisées, en raison des valeurs d’égalité ou de fraternité dont elles seréclament.
Parmi les actions qui visent la masse de la population, on peut distinguer celles qui recherchent uneamélioration «objective» au vu de critères de développement ou de pauvreté dont sont porteurs lesbailleurs ou les organisations internationales – réduction de la mortalité infantile, éducation pour tous,etc. ; et celles qui recherchent une amélioration perçue par les personnes concernées : obtention d’unesource de revenus réguliers, accès d’une partie au moins des enfants à un emploi formel, etc.
Il y a bien entendu un fort recoupement entre ces deux types d’améliorations – chaque «progrès» estde nature à satisfaire à la fois le bailleur et le bénéficiaire – mais l’ordre des priorités peut différer. C’estle rapport de forces entre offreur et demandeur, ainsi que le processus de décision, qui vont hiérarchi-ser les priorités. Par exemple, quand l’offreur est en relation avec un groupe social, la concertation ausein de ce groupe va souvent déboucher sur une demande d’équipement collectif, qui n’aurait pasnécessairement été la première priorité de chacun des membres du groupe.
Un fonds comme les CD/FSD, géré sur place et fournissant des financements unitaires de l’ordre de 50à 2000 kFF 41 semble particulièrement adapté:
— à des actions en faveur de catégories spécialement défavorisées mais relativement peu nom-breuses;
— à des actions visant à améliorer la situation sociale et économique perçue par des groupessociaux locaux – villages, quartiers, clans…
— La recherche d’une amélioration «objective» correspond en général à une entrée sectorielle –hydraulique villageoise, système de soins… – pour laquelle les CD/FSD ne sont jamais à la hauteur desbesoins quantitatifs.
Les orientations ainsi préconisées sont proches du mode d’emploi actuel des CD/FSD. Cependant,environ la moitié des projets ont bénéficié à des catégories plus riches que la moyenne, et les CD/FSDsemblent avoir dans l’ensemble plus bénéficié aux hommes qu’aux femmes, ce qui confirme la néces-sité d’un ciblage explicite des actions.
Mais le ciblage ne suffit pas. Même employés en faveur de populations pauvres, les CD/FSD risquent,leur montant restant modeste par rapport aux fonds multilatéraux et aux budgets des États, de n’avoirqu’un impact symbolique. Et il y a des risques que le symbole soit négatif quand un bailleur veutdémontrer, par quelques actions, son souhait de voir améliorée la situation sociale et économique despopulations pauvres (un objectif de communication et non de lutte contre la pauvreté), tout en étantabsent des grands chantiers dans ce domaine, voire en les perturbant par ses initiatives non coordon-nées avec les plans nationaux.
Ayant pour finalité la solidarité avec les populations pauvres, la lutte contre la pauvreté, les CD/FSDdoivent donc non seulement être cohérents avec les autres efforts au plan national (ce qui a été engénéral le cas depuis 1996), mais aussi rechercher une démultiplication de leur impact (effet delevier) en prenant appui sur des mécanismes de financement plus massifs, sectoriels par exemple, cequi a très peu eu lieu jusqu’ici.

112Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
2.2. POUR COLLABORER AVEC LES ACTEURS NON-ÉTATIQUES
La seconde finalité des CD/FSD, établir des relations de collaboration entre la France et les acteurs non-étatiques des pays de la ZSP, a, elle aussi, des conséquences spécifiques si on la vise réellement et nonpas à un plan symbolique: «établir quelques relations avec quelques acteurs», comme cela a été le casjusqu’ici dans la plupart des pays, peut satisfaire la seule finalité de renseignement, mais ne suffit pasà insérer la France parmi les partenaires reconnus par la société civile organisée; ni à apporter un équi-libre, dans l’ensemble de la coopération française, par rapport à la relation inter-États.
Une étude sur la société civile des pays du Sud, en cours pour la MCNG, devrait permettre de préciserles modalités de coopération à préconiser.
Les évaluateurs proposent de distinguer sommairement deux familles d’acteurs en-dehors de l’Étatcentral :
— Les pouvoirs locaux de toutes sortes: leaders de réseaux sociaux (à légitimité traditionnelle, éco-nomique, politique ou autre), élus locaux, pouvoirs techniques (services techniques locaux de l’É-tat, les bureaux de gestion de projets des Églises…).
— Les réseaux de la société civile à l’échelle «nationale», c’est-à-dire souvent à l’échelle de lacapitale: ONG de projets (ou bureaux privés de gestion de projets), collectifs d’associations oud’ONG, associations et réseaux féminins…
— Bien entendu, les structures animées par des expatriés n’ont pas lieu d’être considérées comme desacteurs non-étatiques au regard des objectifs visés, c’est-à-dire comme des composantes de la socié-té civile des pays du Sud.
Pour établir une relation de confiance et même de coopération entre la France et l’ensemble, ou dumoins une large partie, des acteurs nationaux non-étatiques (au-delà de liens ponctuels ou symbo-liques), les CD/FSD doivent certes s’intégrer dans l’ensemble du dispositif français sur place, qui inclutégalement :— les relations personnelles de nature diplomatique,— les financements sur titre IV (bourses d’études, de stages…),— des projets FSP nationaux (appui aux média, à l’état de droit…),— les programmes nationaux ou «d’intérêt général» d’appui à la décentralisation,— la coopération non-gouvernementale ou des collectivités territoriales, éventuellement soutenue
depuis Paris (MCNG).
Cette bonne intégration pose peu de problème tant que les CD/FSD restent gérés depuis le pays, sousl’autorité directe de l’ambassadeur et du SCAC.
Mais elle ne suffit pas pour que le dispositif français prenne en compte le territoire et les réseaux caté-goriels d’acteurs dans leur ensemble. En effet, les CD/FSD sont dans la plupart des pays le principalinstrument français de financement de projets qui s’adresse directement à la société civile nationale.Les CD/FSD doivent donc d’une façon ou d’une autre prendre en compte l’ensemble du terri-toire et des réseaux catégoriels d’acteurs, même si ce n’est pas partout par le financement effec-tif de projets.
Cela requiert :
— une communication sur le dispositif couvrant exhaustivement certains types d’acteurs clairementrepérés et légitimes: par exemple, toutes les collectivités locales élues; ou les collectifs pour redif-fusion vers les organisations membres;
— des clés de répartition des financements sur le territoire, évitant la concentration sur les capi-tales ou les régions déjà au centre de l’attention des bailleurs ; des réseaux de contact et des dépla-cements systématiques sur le territoire ;
— et surtout la recherche d’actions qui bénéficient directement ou indirectement au plus grandnombre – lieux carrefours, organisations ramifiées sur tout le territoire, etc.

113Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
42 L’évaluation a constaté la quasi-absence de capitalisation formalisée en aval des projets, donc de diffusion d’informationprofessionnelle sur ce qui a été réalisé; et l’absence d’un dispositif d’ingénierie qui permette de travailler sur des projets enamont d’une décision de financement de l’investissement.43 Le renforcement des compétences «générales» pour la gestion de projet (traitement de texte, comptabilité…) n’est pasl’objet de cette action-type. Il trouve des financeurs par ailleurs et, sur CD-FSD, doit pouvoir se faire par la pratique, dans lecadre de projets d’investissements.
2.3. TOUTES LES PHASES DU CYCLE DE PROJET (PAS SEULEMENT L’INVESTISSEMENT) PEUVENTCONTRIBUER AUX DEUX OBJECTIFS DES CD/FSD
Le «cycle de projet» qui environne un investissement comprend aussi des phases d’ingénierie (étudespréparatoires, conseil), de capitalisation (évaluation, études comparatives), de diffusion d’infor-mation (communication, formation…), lesquelles préparent voire suscitent de nouveaux projets.
Appuyer chacune de ces étapes peut tout à fait contribuer à favoriser les deux objectifs impartis auxCD/FSD.
Les évaluateurs recommandent donc d’étendre les types d’intervention sur CD/FSD, qui actuellementne comprennent que l’investissement lui-même et, éventuellement, l’ingénierie en amont du mêmeinvestissement42.
Dans cette optique, les CD/FSD pourraient donc financer:— des activités de capitalisation sur des projets antérieurs,— de la formation professionnelle ou de la communication liée au développement social,— des études préparatoires ou des travaux d’ingénierie (technique ou socio-économique).
Il ne s’agit dans aucun de ces trois de cas de dépenses récurrentes.
La formation, la communication, l’ingénierie, mettent toutes la coopération française en relation avecdes acteurs de la «société civile», mais n’ont pas d’apport immédiat pour les populations pauvres ; ellespermettent en revanche d’espérer un effet de démultiplication (levier) important dans la mesure oùd’autres bailleurs proposeraient des financements «lourds» tout en manquant des moyens humainspour ce type d’actions.
• Elles contribuent ainsi au «renforcement des capacités» des acteurs de la société civile,aidant ceux-ci à se positionner activement sur les politiques de développement social oulocal.
Les ONG nationales et (le plus souvent) internationales sont très actives sur ces trois types d’activitésde capitalisation, formation, ingénierie. C’est donc leur activité dans ce domaine qu’il peut s’agir d’ap-puyer, en tout cas celle des ONG nationales ; et, plus largement, celle des autres acteurs nationaux dudéveloppement (collectivités locales, entreprises privées, organismes confessionnels, etc.).
Les activités de ce type financées sur CD/FSD devraient se positionner de façon différente et complé-mentaire des activités organisées par les agences sectorielles ou intergouvernementales, p. ex. colloquesou ateliers sur les «stratégies nationales» sectorielles. Les activités sur CD/FSD devraient être plusproches du «terrain»:
— activités organisées dans les provinces;
— activités de capitalisation et de formation axées sur les pratiques professionnelles (à un niveau plusopérationnel que stratégique) ;
— en s’inscrivant dans le cadre et les objectifs des stratégies nationales déjà définies.
Ces activités de capitalisation, formation, communication, ingénierie, sont à décliner dans deux direc-tions43 :
— sectorielle d’une part (eau, agronomie, marchés…),
— sociale et économique d’autre part (transversale aux différents types de projets, mais potentielle-ment spécifique à des milieux sociaux, régions, etc.).

114Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
2.4. SEPT TYPES D’ACTIONS, OU ACTIONS-TYPES, FINANÇABLES SUR CD/FSD
Les évaluateurs proposent de définir plus précisément des types d’actions de nature à être décidés surplace, pour des montants modestes, contribuant à améliorer la situation sociale et économique despopulations pauvres, et faisant coopérer la France avec des acteurs nationaux non-étatiques. Cette défi-nition plus précise doit permettre d’une part de communiquer sur le dispositif de façon plus concrète,d’autre part d’établir des critères d’évaluation ex ante et ex post pour les financements CD/FSD.
Quatre de ces actions-types concernent des projets physiques:
— l’investissement local,— le petit projet expérimental,— l’action ciblée en faveur d’un groupe défavorisé,— l’appui aux promoteurs des droits humains et de la démocratie.
— Deux actions-types financent la capitalisation et la diffusion d’information:
— sur les projets CD/FSD,— sur les droits humains et la démocratie.
La valeur opérationnelle de cette notion d’actions-types repose entièrement sur l’utilisation decritères de sélection, de suivi et d’évaluation précis, tels que ceux proposés dans la partie suivante.
• Chaque poste suit en effet sa propre stratégie, et les termes précédents peuvent être utiliséscomme «mots-valises» pour à peu près n’importe quoi, s’ils ne sont pas accompagnés deconditionnalités précises et vérifiables. Or ces conditions de pertinence sont souvent diffi-ciles à renseigner, et même souvent étrangères à la logique des porteurs de projet dansquelque pays du Nord ou du Sud que ce soit (ainsi de l’indicateur «chiffrage de la popula-tion de la zone concernée»). Elles doivent être à la fois obligatoires et très peu nombreuses;sans quoi l’information indispensable sera noyée dans une masse d’informations purementformelles mais abondamment renseignées.
Une dernière catégorie est nécessaire pour permettre au poste d’adapter rapidement ses interventionsaux situations d’urgence, compte tenu de sa stratégie générale :
— Guichet «État et actions d’urgence».
3. Recommandations pour les projets physiques
3.1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LES PROJETS PHYSIQUES
L’analyse de la pertinence des objectifs suppose […] d’identifier clairement les populationsbénéficiaires concernées, et que soient mis en évidence la place ou le rôle des différentsacteurs sociaux ou catégories sociales, les relations de pouvoir qu’ils entretiennent entre euxet avec l’environnement institutionnel, les inégalités qui les traversent. […]
Cela nécessite d’accorder le temps suffisant à la phase de diagnostic et à la formulation desopérations. C’est aussi dans cette phase de préparation que doivent être définis avec soin ledispositif de suivi-évaluation ainsi que les critères utilisés qui devront associer les indicateursquantitatifs et les indicateurs qualitatifs, en accordant autant d’importance aux uns qu’auxautres.
Lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion : une contribution au débat,MAE/DGSID série Repères, non daté (2001?), pp. 28-29.
On désigne par projets physiques des appuis en nature, sous forme en général d’infrastructures ou dematériel d’usage professionnel.

115Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Le type d’apport et le secteur professionnel concerné devraient rester aussi ouvert qu’actuellement.
Aux critères de sélection des projets propres à chaque type d’organisation aidée et à chaque secteurdevraient être ajoutés des critères de pertinence permettant d’assurer que l’apport bénéficie bien enpriorité à des populations pauvres. Beaucoup d’indicateurs ont été suggérés à cet égard comme la redis-tribution des revenus, le nombre d’emplois, différents critères de définition des populations pauvres etvulnérables, etc.
Les évaluateurs suggèrent d’utiliser au moins un indicateur transversal du type «nombre debénéficiaires par FF (ou €) investi». En effet, les services utiles aux «moins pauvres» ont souventun coût unitaire élevé (sans quoi les «moins pauvres» pourraient se les offrir) ; et les services destinésaux populations pauvres mais dont le coût unitaire est élevé sont en général non durables, financière-ment et socialement. Ce ratio prend en pratique des valeurs si dispersées d’un projet à l’autre, qu’il estutile malgré l’imprécision sur certains paramètres. L’utilité durable du projet pour des populationspauvres a semblé aux évaluateurs vraisemblable, dans les 6 pays étudiés, à moins de 50 FF par bénéfi-ciaire et par an, et improbable à plus de 200 FF par bénéficiaire et par an.
Un dossier pour une action physique devrait donc impérativement renseigner les critères suivants :
— le nombre de personnes pouvant utiliser l’équipement chaque année, ou capacité de service ;— le nombre de personnes appelées à en bénéficier directement, de par leur lieu d’habitat et leurs
caractéristiques personnelles, ou bassin de chalandise ;— par déduction, le nombre d’utilisateurs visé (la plus petite des deux valeurs précédentes) ;— le nombre d’années pour «l’amortissement» d’un investissement de ce type (il pourra naturel-
lement s’agir d’une approximation, et le nombre d’années peut être inférieur à un pour certainstypes de dépenses) ;
— le coût sur FSD (montant du projet) ;— le coût complet, réel ou estimé, de l’investissement toutes sources de financement confondues;— les ratios des précédents : coût FSD et coût complet par bénéficiaire et par an.
Ces mêmes critères devraient être renseignés à la réception de l’équipement et par évaluation expost (en considérant bien entendu le nombre d’utilisateurs effectifs).
Concernant le célèbre critère des «30 % de participation des bénéficiaires», les évaluateurs recom-mandent, faute d’avoir trouvé une solution, de poursuivre la réflexion avec les gestionnaires desCD/FSD pour trouver une clause qui ait un peu plus de sens. L’absence de toute clause de ce typemettrait les gestionnaires des CD/FSD en situation inconfortable pour exiger un engagement financierou humain de leurs interlocuteurs. Quelques alternatives possibles :
— la mise en place par la partie nationale, avant le démarrage du projet, de sa contribution (matériauxde construction…) (idée issue du Bénin, mais qui n’est pas applicable à tous les projets) ;
— un dépôt de garantie (de valeur très inférieure aux 30 %), restituable après réception (mais c’est unesource évidente de litiges) ;
— le paiement par la partie nationale (organisation représentative des bénéficiaires) de l’ensemble desrémunérations de personnes sur le projet - paiement monétaire des intervenants externes, ou contri-bution gratuite en temps de travail. Cela demande que ces temps soient chiffrés, ce qui est parfoisdifficile dans les pays où le travail est bon marché – mais c’est précisément le lien entre richesse dupays et coût du travail qui justifie cette formule.
3.2. L’INVESTISSEMENT LOCAL
Cette première action-type est la plus proche de la majorité des financements CD/FSD actuels.
L’instrument CD/FSD permet en effet de travailler avec des acteurs locaux sur la situation de leur ter-ritoire et les besoins de développement, en amont du choix d’un investissement dans un secteur donné.Après la décision quant à la nature et au lieu de l’équipement (mais non avant), le relais pourrait être

116Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
passé à une ONG de projet ou à un bureau d’études privé en tant que maître d’œuvre ou maître d’ou-vrage délégué pour le compte de la collectivité récipiendaire.
Les critères indiqués au 5.2.0 sont bien adaptés à ce type d’action, pour lequel la notion de «bassin dechalandise», donc de choix du lieu d’implantation, est particulièrement importante.
3.3. LE PETIT PROJET EXPÉRIMENTAL
Pour que les CD/FSD aient une contribution plus que symbolique à la résolution de difficultés qui tou-chent la masse d’une population – eau potable en Mauritanie, conditions de vie des réfugiés auBurundi, scolarisation au Tchad, etc. – il faut que les investissements financés sur CD/FSD soientreproductibles par d’autres fonds, donc se fassent dans des conditions d’accompagnement et de contrô-le qui permettent d’en tirer le maximum de leçons.
En d’autres termes, le caractère «pilote», trop souvent invoqué pour justifier des projets hasar-deux, prend son sens s’il donne lieu à un dispositif d’expérimentation probant.
— Un certain nombre de projets financés sur CD/FSD peuvent revendiquer à bon droit un caractèrepilote ou expérimental, comme la construction d’un «collège communautaire agricole» dans la régionde Bongor (Tchad) ou l’intégration sur CD/FSD d’un volet « latrines sèches» dans le projet urbainT’Wizé, quartier de Dar-el-Beïda (Nouakchott, Mauritanie). Mais les évaluateurs n’ont que rarementconstaté de dispositif permettant de tirer les leçons de ces projets pilotes et de les communiquer large-ment. C’est certes le cas de T’Wizé, mais de façon purement interne au GRET, opérateur du projet,encore que le GRET ait communiqué ses rapports au SCAC.
— À Madagascar, le caractère innovant a toujours figuré parmi les critères de sélection des projets pré-sentés au CD/FSD, et figure explicitement dans la grille d’analyse des projets. En revanche, le SCACn’a pas su créer une dynamique de partage d’expériences entre ONG bénéficiaires des fonds, contrai-rement à ses intentions en ce domaine.
En complément des critères listés au 5.2.0, un dossier pour ce type d’investissement devrait impérati-vement renseigner les critères suivants, qui devront ensuite être actualisés lors de la réception duprojet et lors de l’évaluation ex post indépendante, laquelle est indispensable par définition pourun projet pilote :— le plan de financement – recettes et dépenses, année par année – pour le projet, intégrant les diffé-
rentes sources de coût donc l’ingénierie ;— le plan de financement – recettes et dépenses, année par année – pour un projet identique mais en
«régime de croisière» au lieu d’être pilote (en cas de reproduction à «x» exemplaires) ;— le ratio «coût par bénéficiaire et par an» pour le projet en «régime de croisière»;— le nombre de personnes manquant d’un tel équipement ou service au plan national (calcul du poten-
tiel de reproduction du projet).
Sur cette action-type, l’enjeu de la viabilité est au moins aussi central que celui d’utilité sociale. Desinvestissements orientés sur les classes détenant le gros du pouvoir d’achat national peuvent donc rem-plir ces critères, par exemple dans les domaines d’internet et des télécommunications, ou de la pro-duction exportable.
Ce type de projet rejoint l’approche traditionnelle du développement par l’initiation d’activités viablesappelées à essaimer.
3.4. L’ACTION CIBLÉE EN FAVEUR D’UN GROUPE DÉFAVORISÉ
Sur une problématique sociale – situation d’une catégorie défavorisée, épidémie… – les CD/FSD nepeuvent a priori financer de façon récurrente l’aide à la population touchée. Cependant, plusieurs pro-jets visités par les évaluateurs présentent de bons résultats avec des coûts limités: laboratoire

117Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
44 Ce centre ne fait pas partie des structures aidées sur CD-FSD et visitées par les évaluateurs, mais a été évoqué en comiteconsultatif par des interlocuteurs tchadiens, comme exemple de ce que la coopération française a financé à tort dans le passéet devrait éviter à l’avenir.45 Ce critère a une importance bien moindre en situation d’urgence, où par ailleurs la question de la viabilité est secondaire.
d’analyses médicales sur le VIH à Bujumbura, soutien à un centre de lutte contre le sarcome de Kaposi(maladie opportuniste associée au SIDA) à Port-au-Prince, bâtiment principal d’un centre d’accueil deshandicapés mentaux à Nouakchott, maison du diabète à Antananarivo, confection de vêtements par etpour des réfugiés de Bujumbura…
De plus, le bénéfice d’image pour la France peut être très important dans l’ensemble de la popula-tion et particulièrement parmi les structures à vocation sociale. Ceci tant que l’équipement s’intègredans le «paysage social et sanitaire» national, ce qui lui assure un rayonnement sur d’autres struc-tures pouvant accueillir les mêmes groupes défavorisés.
Il est également nécessaire que les personnes qui y sont accueillies ne soient pas «sorties» de leurmilieu – cf. le contre-exemple d’un centre d’accueil pour enfants de la rue au voisinage de N’Djamena,créé par des expatriés, et très critiqué par les nationaux car les enfants y vivaient avec un tel standing –«ils mangeaient à table» — qu’il leur était difficile de se réinsérer ensuite dans leur famille 44.
Les CD/FSD devraient permettre le lancement de telles structures et éventuellement contribuerà leur fonctionnement (fourniture de médicaments, maintenance…). Une efficience supérieurepeut être obtenue en prenant en charge explicitement des fournitures utiles au fonctionnement,plutôt qu’en surdimensionnant l’investissement initial, histoire de faire un «beau projet» (nom-breux exemples parmi ceux évalués).
Cependant, la prise en charge, par l’État ou par des structures nationales non-étatiques, de larémunération du personnel (a minima), apparaît comme une garantie de viabilité et d’intégra-tion sociale de la structure 45 pratiquement indispensable.
Les critères suivants seraient à renseigner en complément de ceux du 5.2.0:— les dépenses récurrentes annuelles pour un nombre d’utilisateurs fixé;— l’effectif permanent qui serait employé par la structure sur financements nationaux;— une estimation de l’effectif équivalent temps plein déjà mobilisé dans le pays par les services sani-
taires ou sociaux rendus à la catégorie sociale concernée;— le ratio : «coût supporté par les bailleurs, par bénéficiaire et par an» (on calcule le coût complet
investissement + dépenses récurrentes sur la durée d’amortissement, et on divise par la durée et lenombre de bénéficiaires directs) ;
— le ratio «effectif employé sur financement national, par bénéficiaire et par an».
3.5. L’APPUI AUX PROMOTEURS DES DROITS HUMAINS ET DE LA DÉMOCRATIE
Approcher la lutte contre la pauvreté par de «petits projets» apportant un bénéfice individuel aux gensqu’ils touchent, c’est nécessaire mais non suffisant, comme le rappelle la doctrine française en matiè-re de coopération:
La prise en compte des inégalités, en plus de la pauvreté, permet d’introduire les dimensionspolitiques au cœur des stratégies de développement. […] [Les] analyses des rapports de pou-voir […] mettent notamment en lumière […] la faible représentation des pauvres dans le pro-cessus de décision, pour ne pas dire, parfois, la captation du pouvoir par une élite […].L’enjeu est […] de renforcer la participation des populations au débat public de façon àconstituer une base de soutien aux réformes pro pauvres.

118Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
L’implication des populations défavorisées doit se traduire par leur participation accrue auxprocessus politiques et aux décisions locales. […] Les mécanismes de décision et de suivi desdécisions doivent être démocratiques et participatifs.
Lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion : une contribution au débat,MAE/DGSID série Repères, non daté (2001?), extraits : pp. 15 et 19.
Une approche par les mécanismes socio-politiques est donc également nécessaire; elle seule prenddirectement en compte les dimensions non économiques de la pauvreté (marginalisation, exclusion desmécanismes de décision, déni de droits…). Par conséquent, dans la mesure où elle passe par la socié-té civile, elle entre bien dans le champ des CD/FSD.
Les évaluateurs proposent donc une action-type «d’appui aux promoteurs des droits humains et de ladémocratie», qui repose obligatoirement sur le soutien à des organisations de la société civile exis-tantes.
Les CD/FSD ont d’ores et déjà financé de telles actions: fourniture de matériel à l’Ordre des avocats(Mauritanie), par exemple. Elles n’ont cependant représenté jusqu’ici qu’une très petite minorité del’ensemble des fonds sur CD/FSD.
Dans la pratique, seul le type de destinataire distingue cette action-type de la précédente. Il s’agira ausside fournir à l’organisation bénéficiaire des infrastructures (bâtiments) ou du matériel et des moyenstechniques, directement utiles à ses actions opérationnelles, sans s’engager sur le financement du tempsde personnes.
Les critères d’appréciation à utiliser sont donc les mêmes que pour l’action-type précédente. Ilsseront cependant plus difficiles à appliquer, en particulier le chiffrage du nombre de bénéficiaires :financer la défense, par une ONG juridique, d’un groupe de paysans sans terre, bénéficie potentielle-ment à tous les paysans sans terre. Un indicateur complémentaire serait le temps total consacré au tra-vail de l’organisation, par des bénévoles ou des personnes rétribuées. Le ratio entre ce temps, et le totaldes financements externes, est un indicateur de «l’assise populaire» dont bénéficie l’organisation; cecritère n’est cependant pas le seul à prendre en compte.
4. Recommandations pour les actionsde capitalisation et la diffusion d’information
4.1. LA CAPITALISATION ET LA DIFFUSION D’INFORMATION SUR LES PROJETS CD/FSD
Cette cinquième action-type sort des critères actuels de financement sur CD/FSD – limité aux inves-tissements physiques – bien que, dans la base de données, on puisse trouver quelques projets financésqui se rapprochent de cette définition.
Ces actions auraient pour objectifs directs:
— De capitaliser sur les expériences de «petits projets» existants.
— De faire se rencontrer et collaborer, non pas en situation de rapports de pouvoir et d’argent dansun projet à gérer, mais sur un «terrain neutre» d’échanges professionnels (et en particulier «sur leterrain» dans les villages et quartiers), les «développeurs» nationaux (ONG de projets, serviceslocaux et centraux de ministères…) et français (AT, ONG françaises, etc.).
— De diffuser les informations ainsi produites, dans le milieu des «développeurs» nationaux enpremier lieu, de façon à améliorer l’utilité des projets financés sur d’autres fonds et à valoriser l’ex-pertise d’origine française.
Si l’utilité de ce type d’actions par rapport aux objectifs précités des CD/FSD semble évidente, il est ànoter qu’elle peut contribuer aussi, bien plus que des investissements physiques ponctuels, à l’image de

119Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
la coopération française. L’image d’une coopération se bâtit en effet à notre sens, non sur le montantdes fonds qu’on a transformés en bâtiments ou en équipements dans le pays, a fortiori sur la dimensiondes plaques d’inauguration, mais sur le temps et l’écoute qu’on aura consacrés aux interlocuteurs natio-naux – attention fidèle et conséquente, c’est-à-dire attentive aux suites concrètes données aux idées etprojets formulés dans le dialogue.
Compte tenu de la difficulté à quantifier des réalisations non physiques, et même à s’intéresser à leurimpact (compte tenu de leur caractère ponctuel), les critères de sélection, de compte rendu et d’éva-luation devraient porter sur l’audience (la plus grande possible) de l’activité financée. Le temps quelui consacrent des personnes par ailleurs actives est en effet un indicateur de l’utilité qu’elle présentepour eux. Cet indicateur n’a évidemment qu’une valeur très relative quand des auditeurs sont payéspour venir écouter, situation qui devrait être évitée.
Les indicateurs sont donc:
— le nombre de personnes directement concernées (d’interlocuteurs ou d’interviews dans une opéra-tion de capitalisation, de participants à une formation ou colloque, de destinataires dans une diffu-sion, de téléchargements pour un document mis en ligne…);
— la durée moyenne de la participation des personnes directement concernées (nombre de jours d’uneformation, temps moyen qui sera passé à lire un document…);
— nombre de jours*hommes mobilisés (payés ou non par le financement), c’est-à-dire le produit desindicateurs précédents ;
— le montant CD/FSD et le coût total de l’opération (CD/FSD + autres sources) ;
— les ratios en coût par personne directement concernée et par jour*homme.
4.2. LA CAPITALISATION ET LA DIFFUSION D’INFORMATIONS SUR LES DROITS HUMAINS ET LADÉMOCRATIE
Cette action-type est techniquement analogue à la précédente (actions de capitalisation, formation,communication, ingénierie) et recourt donc aux mêmes critères de sélection et d’évaluation.
Elle diffère de la précédente:
— par le type d’organismes bénéficiaires, en l’occurrence les structures de la société civile dont l’ac-tivité promeut directement les droits humains et la démocratie ;
— par le fait qu’elle ne s’appuie pas forcément sur des projets d’investissement réalisés ou en courssur CD/FSD, mais peut être menée de façon autonome.
Elle complète l’appui matériel aux promoteurs des droits humains et de la démocratie (action-type 4),étant entendu que les besoins de ces structures ne sont pas toujours d’ordre matériel mais parfois de«renforcement des capacités humaines».
Les CD/FSD ont financé dans le passé un petit nombre d’actions de ce type qui sont souvent classéesen «développement institutionnel»: soutien à une campagne en faveur des droits de l’homme(Burundi), «facilitation d’accès à la justice pour les plus démunis» (Haïti), «Séminaires ElectionsLibres et Démocratie» (Gabon)…
5. Guichet «État et actions d’urgence»La principale qualité des CD/FSD aux yeux des postes est leur «souplesse d’utilisation» et nous avonspu constater dans d’autres cadres la spontanéité avec laquelle revient l’expression «ça peut passer surCD/FSD» dans des secteurs bien éloignés de la lutte contre la pauvreté ou des relations avec la socié-té civile. De fait, les postes doivent faire face, en ligne avec leur stratégie nationale, à des situations(urgence humanitaire…) et à des demandes (partenaires État…) non anticipées ou programmées.

120Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
46 Il ne nous apparaît pas nécessaire de fixer pour les autres types d’actions des planchers ou plafonds qui seraient permanentset applicables à tous les pays.
Les évaluateurs proposent donc de maintenir la possibilité de financements passant par une procédurede décision plus légère que la norme des CD/FSD (comme c’est le cas actuellement pour le «guichetÉtat»). Le comité consultatif serait informé dans les mêmes conditions et avec le même niveau dedétail que pour les autres projets, mais ex post et non pas ex ante. L’ouverture de cette possibili-té suppose:
— un plafonnement de son montant, par exemple à hauteur de 20 % des enveloppes 46 (dans uncontexte d’augmentation du montant global des enveloppes) ;
— un compte rendu et le cas échéant une évaluation selon les mêmes modalités que pour lesautres financements CD/FSD.
Les critères utilisés pour l’information du comité consultatif, et qui devraient systématiquement êtrerenseignés à la réception du projet (donc dans les rapports de présentation d’enveloppes CD/FSD ulté-rieures) et à l’évaluation, sont les mêmes que pour des actions analogues avec la société civile, quiseraient classées dans les actions-types précédentes. Les critères communs suivants devraient être tou-jours renseignés:
— nombre d’utilisateurs directs de l’équipement financé (utilisateurs d’un équipement de bureau,effectif permanent d’une structure aidée, bénéficiaires d’un colis alimentaire…);
— le cas échéant, nombre de bénéficiaires indirects (personnes directement touchées par l’action de lastructure aidée…);• L’expérience montre que l’identification de bénéficiaires indirects est particulièrement utile pour
ces actions dont beaucoup appuient des structures ayant une position centrale dans le pays.
— durée pendant laquelle le financement est supposé porter ses fruits (durée d’amortissement pour uninvestissement…);
— coût pour l’aide française ;
— ratios entre coût pour l’aide, nombre de bénéficiaires et durée.
6. Recommandations transversales sur la gestionde l’instrument sur place
6.1. STRUCTURE DE GESTION
Les évaluateurs recommandent que soit mise en place dans chaque pays une cellule de gestion desCD/FSD, bien identifiée et chargée de la totalité de ce fonds (quel que soit le «guichet»). Cette cellu-le de gestion n’a pas vocation à accumuler une expertise sectorielle (eau, culture…) qui est à mobiliserchez les conseillers, les AT, les ONG spécialisées ou les ministères techniques, mais à constituer uneexpertise socio-économique sur le financement de «petites» actions, et un savoir-faire pratique sur lagestion de ces financements dans l’appareil de coopération français.
Malgré la diversité des pays et des besoins sectoriels, malgré la diversité des solutions actuellementretenues pour la gestion des CD/FSD, les structures et contraintes internes des ambassades sonttrès semblables dans les pays de la ZSP et justifient à notre sens la recommandation d’un uniqueschéma d’organisation de cette cellule, à peu de variantes près :
Elle comprendrait :
— deux coopérants expatriés juniors, typiquement avec un statut de volontaires (VP, VSI…), avec uneformation axée sur la gestion de projets et/ou la communication interculturelle (si possible un dechaque profil) ;

121Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
47 Il semble que les SCAC qui gèrent des fonds plus importants avec une seule personne, n’y parviennent qu’en créant surleur enveloppe quelques «gros projets» à plus de 1 MF confiés à une ONG française, un AT, etc.La présence de deux juniors est fortement souhaitable de part la dynamique que cela leur donne et de par les possibilitésaccrues de tuilage donc de capitalisation d’information.48 Le SCAC Guinée (Conakry) prévoit ainsi pour les CD/FSD un forfait de frais généraux de 6 %.
— un socio-économiste national ;
— un gestionnaire, de formation comptable, en contrat local.
— Ce format doit permettre de gérer dans des conditions correctes des enveloppes annuelles à partirde 4 MFF (600000 euros). Au-dessous de cette somme, il semble raisonnable de prévoir un seul juniorfrançais en complément des deux salariés nationaux 47.
Dans les pays où sont présents des assistants techniques, notamment dans les provinces, cette cellulepourrait recourir à l’expertise de ces derniers, ceci étant spécifié sur leur fiche de poste. Cela peut repré-senter typiquement un «équivalent temps plein» pour un pays (même si ce coût resterait sans doutemasqué donc non décompté).
La cellule de gestion serait chargée de l’instruction des projets, du suivi de leur réalisation et des ver-sements financiers, de la réception du projet, de l’information du comité consultatif, de la clôture comp-table, de l’organisation d’une visite ex post (par exemple une année après la réception, à l’image duPAOIL au Tchad) et de l’organisation des évaluations.
— Elle ne serait pas chargée de la gestion directe des projets qui resteraient gérés par le SCAC (achatsde matériels, etc.).
— Elle devrait obligatoirement recourir ou s’associer, pour la visite ex post, à une personne compé-tente, nationale, n’ayant pas été associée au projet ou à son instruction.
— Elle commanditerait, accompagnerait, mais ne signerait pas, les évaluations de projets ou études decapitalisation.
Elle pourrait jouer également le rôle de relais sur place de la MCNG.
Elle bénéficierait d’un budget de fonctionnement adapté à la dimension du pays, de façon à pouvoireffectuer une moyenne de 4 visites sur site par projet, y compris la visite ex post.
Elle dépendrait directement du chef de SCAC ou serait rattachée à un attaché de coopération chargépar ailleurs des dossiers «sociaux».
Les locaux d’installation de cette cellule devraient favoriser à la fois ses contacts avec l’ensemble de lapopulation, avec sa ligne hiérarchique (chef de SCAC), avec l’ensemble du personnel français (ATnotamment). Ces exigences sont évidemment contradictoires dans une période (durable?) de renforce-ment de la sécurité des ambassades. Quitte à être dans le même bâtiment, la cellule devrait au moins setrouver aussi près que possible de l’accueil voire si possible en amont de celui-ci.
De plus, les structures (ONG nationales…) auxquelles serait confié un rôle d’opérateur en aval de ladécision de financement, bénéficieraient de façon explicite, dans le budget de projet, d’un pourcentagedestiné à couvrir leurs propres frais de gestion. Ce pourcentage peut être de l’ordre de 6 à 15 %, variantselon le secteur et le type de réalisation: plus élevé dans un secteur «social» que pour la réalisationd’infrastructures, plus élevé aussi à distance de la capitale 48.
Le coût complet de ces échelons de gestion (interne SCAC et opérateurs) ne peut être que très supé-rieur aux 2 % actuellement prévus par la réglementation des CD/FSD – auxquels s’ajoutent dans la pra-tique de nombreux coûts cachés, de la rémunération des volontaires à la marge des opérateurs. Nousévaluons ce pourcentage à 30 % des enveloppes CD/FSD en intégrant tous les coûts cachés (dont letemps des AT mobilisés), soit en pratique 20 % en se limitant aux coûts qui seraient décomptables dansune comptabilité analytique.
Ces dispositions s’éloignent de la tendance générale à la déflation des effectifs français expatriés.Cependant elles nous semblent particulièrement appropriées :

122Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— ces personnes sont en contact fréquent avec les «acteurs de la société civile», c’est le temps qu’ilsconsacrent à leur travail, au moins autant que les montants investis, qui contribue à l’objectif de«coopération avec la société civile» des CD/FSD;
— il s’agit d’une assistance technique liée à la «préparation, la négociation et l’évaluation des pro-grammes», pour reprendre les termes de l’avis du 25 juin 2002 du HCCI, par contraste avec lesassistants techniques en « fonctions de chefs de projets», situation que la même instance appelle àabandonner ;
— enfin, le travail sur les CD/FSD, fonds multi-sectoriels, est une excellente formation pour des«coopérants débutants» et contribue ainsi à remettre à niveau l’expertise technique française – cequi se traduit déjà par l’intérêt manifesté par l’AFVP pour les fonctions de gestion du CD/FSD,auxquelles elle affecte assez volontiers ses volontaires.
6.2. PHASE DE CONCERTATION ET DE SÉLECTION
La recommandation centrale des évaluateurs consiste à accroître le pouvoir et l’information departies nationales dans la phase amont du cycle de projet.
Rappelons que l’enquête auprès des postes montre un accord général quant à l’apport des nationauxpour sélectionner les «bons projets», et montre également peu de craintes quant aux éventuelles consé-quences négatives d’une telle consultation.
— La présence de salariés nationaux dans la cellule de gestion des CD/FSD serait d’abord unapport en soi, ensuite un «pont» vers de nombreuses expertises, notamment dans le milieu des «jeunesdéveloppeurs professionnels», nombreux dans certains pays depuis la réduction des recrutements dansla fonction publique.
— L’institution formelle d’un comité consultatif partenarial doit, selon les évaluateurs, êtregénéralisée à tous les pays, incluant ceux où il n’existe pas encore ainsi que ceux où il a été suppri-mé. Les raisons reçues de certains pays n’ont pas convaincu les évaluateurs (et ont parfois amusé lesévaluateurs nationaux), les inconvénients de la décision purement interne restent dans tous les cas supé-rieurs aux risques que peut comporter l’institution de ce comité. Bien entendu, dans les pays où lacoopération interétatique avec la France est suspendue, l’État ne serait pas présent au comité.
— Le comité consultatif doit, selon les évaluateurs, être associé de façon fréquente et assez enamont pour apporter un véritable conseil et non un simple sceau final. Comme à Madagascar, ilpourrait délibérer à partir de la simple idée de projet pour indiquer si le projet doit ou non être instruitpar la cellule de gestion. Ceci suppose des réunions assez fréquentes pour être informé à plusieursreprises du cheminement du même dossier – par exemple une réunion toutes les 6 semaines, voire plusfréquente (elle est mensuelle à Madagascar).
Une telle fréquence sera plus facile à obtenir d’un comité consultatif restreint, comprenant par exemple4 membres permanents nationaux – 2 pour l’État et 2 pour la société civile – en plus de deux repré-sentants statutaires du SCAC et/ou de l’ambassadeur.
Dans beaucoup de pays, compte tenu des diversités institutionnelles, régionales ou ethniques à prendreen compte, cela imposera un comité à deux vitesses: un comité plénier qui se réunirait pour le bilanannuel de l’utilisation du fonds, et un bureau restreint désigné – c’est essentiel – par le comité plénier.
Une fréquence élevée permet aussi que certaines des réunions soient thématiques et associent donc desexpertises spécialisées (expert national du domaine ou ministère technique, conseiller sectoriel duSCAC, AT…).
— Les expertises suivantes sont requises pour un avis sur le portefeuille de projets, et il serait doncutile qu’elles soient réunies dans le comité consultatif ; chacune d’entre elles peut en pratique êtreapportée par un représentant de l’État ou de la société civile :

123Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
49 Contrairement à la situation actuelle : dans beaucoup de pays, il n’est informé que des projets «guichet société civile» quidépassent 300 kFF, ce qui est rare (c’est plus que le montant moyen des projets).
• expertise économique et financière, qui peut être apportée par le ministère des Finances, un col-lectif d’ONG de projets, éventuellement par la partie française (SCAC)…
• expertise socio-anthropologique nationale ;• contact avec les réseaux de leaders d’opinion (journaliste, collectif de la société civile…);• de façon systématique ou occasionnelle, expertise juridique (nombre de projets sont bloqués pour
des motifs juridiques, droit foncier, droit des associations…);• de façon systématique ou occasionnelle, expertise en architecture et/ou construction (au regard
du grand nombre d’investissements en bâtiments).
— Le comité consultatif doit recevoir d’une part les représentants des «bénéficiaires» et d’autrepart leur partenaire technique, tous deux invités à s’exprimer (voir 5.5.3 infra).
— Le comité consultatif doit aussi souvent que possible se déplacer pour voir les projets, et/ou mis-sionner un ou plusieurs de ses membres pour le faire : un pourcentage des crédits de fonctionnementpeut être réservé à ces déplacements du comité de pilotage (de l’ordre de 5 % devraient suffire).
— Le comité consultatif doit pouvoir délibérer sur les projets situés dans des régions périphériques.Cela peut demander que certains membres titulaires du comité se fassent représenter à ces réunionsdans les régions, par les représentants de leur institution (ministère, collectif…).
— Le comité consultatif devrait être doté d’un règlement interne écrit et son «avis», même s’ilreste consultatif, devrait être enregistré de façon claire dans les PV selon des formes fixées par le règle-ment (l’instruction de 1996 prévoit cet enregistrement mais il reste flou, faute de règlement interneet/ou faute de contrôle). Il pourrait, comme cela se fait dans certains pays, noter les projets sur une grilledont les critères auraient été délibérés par avance: l’expérience montre (Burkina Faso) que l’expressiond’opinions est plus aisée sur ces débats de méthode sans portée financière directe, que quand un finan-cement peut être menacé par l’avis exprimé.
— Le comité devrait être consulté formellement sur tous les projets où son avis peut être utile,c’est-à-dire sur tous 49. Cependant il pourrait n’être informé qu’ex post des projets relevant du guichet«État et actions d’urgence». En cas d’impossibilité de réunir physiquement le comité, une consultationécrite devrait avoir lieu (fiche de circulation avec avis et signature des personnes membres du comitéet de l’autorité décisionnaire (ambassadeur ou par délégation chef de SCAC)).
— L’avis du comité pourrait aussi – c’est ici une simple suggestion - avoir valeur délibérative, commec’est déjà le cas sur certains fonds cogérés par la France et la partie nationale (des fonds de contrepar-tie par exemple). Le guichet «État et actions d’urgence» ferait exception. Il faut alors admettre que desprojets rejetés par le comité puissent être néanmoins financés au titre de ce troisième guichet – on peutpenser que le souci de bonnes relations avec les parties nationales conduirait l’ambassade à n’utiliserce moyen de contournement que de façon exceptionnelle.
6.3. PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Présence de deux intervenants du côté du demandeur
La gestion de chaque action, donc le dossier de projet, devrait identifier deux intervenants différents :
— Une organisation demanderesse, en tant que représentative des bénéficiaires (commune, grou-pement, etc.).
• Cette organisation devrait, soit bénéficier d’une légitimité élective ou traditionnelle, soit présen-ter la demande avec les noms et signatures d’un nombre minimum fixé de personnes physiques(7 par exemple, nombre adopté par le DED au Tchad, ou 10, nombre adopté par d’autres inter-venants).

124Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
50 La personnalité morale n’est pas toujours le terme adéquat : il peut s’agir des services techniques d’une municipalité nonélue, par exemple.
- Cette organisation est nécessairement nationale par son statut et par la nationalité de ses ani-mateurs.
- Cette organisation n’est pas nécessairement déclarée juridiquement.
• Cette organisation est tenue pour responsable de la pertinence du projet et de la bonne utilisationde l’équipement une fois réalisé.
— Un partenaire technique présentant les compétences nécessaires à la direction de l’exécutiondu projet.
• Ce partenaire technique peut être national ou non.- Il s’agit nécessairement d’une structure ayant un statut juridique50.
• Il est tenu pour responsable de la qualité technique de la réalisation.
— Le cas d’une structure partenaire unique, remplissant ces deux fonctions, serait limité au cas d’ins-titutions nombreuses aux services diversifiés : organisation religieuse ayant un bureau d’étudesinterne, municipalité ayant des services techniques. Il y aurait alors au sein de l’organisation, deuxpersonnes physiques différentes, responsables de ces deux fonctions, identifiées comme tellesdans le projet.
— Le partenaire technique peut n’être identifié que dans un second temps, en aval de la décision quantà la nature de l’action financée. Le SCAC peut orienter les représentants des bénéficiaires vers unpartenaire technique.
Cette exigence de «pluralisme des points de vue du côté du demandeur» doit contribuer à la pertinen-ce des projets en évitant les idées portées à titre personnel par une personne convaincante ou influente,mais non nécessairement représentative ou fiable. Il est en effet souvent difficile aux gestionnaires desCD/FSD, dans ce cas, de contourner l’écran que fait cette personne avec sa vision subjective du projet,de son avenir, et de la demande sociale.
Une des conclusions de l’évaluation des CD/FSD à Madagascar par le cabinet COEFRessources (2001):
L’implication et la synergie des différentes parties prenantes du projet sont plus importantespour la réussite du projet que le choix du prestataire chargé des travaux, et cela que les tra-vaux aient été confiés à un entrepreneur extérieur ou aux bénéficiaires directs de l’action.
Cette distinction entre représentant des bénéficiaires et partenaire technique figure aussi dans le Guidede la gestion locale.
Mise en œuvre directe et subvention
Comme c’est le cas actuellement, les formules de mise en œuvre directe ou de mise en œuvre déléguée(subvention ou marché) devraient pouvoir être utilisées.
La mise en œuvre directe par le SCAC devrait certes être rare, comme le stipule l’instruction de 1996:elle limite les capacités quantitatives de mise en œuvre de CD/FSD, et limite, pour le moins, la relationde coopération avec les acteurs non étatiques. Toutefois il semble difficile de faire de cette clause unedisposition réglementaire car des exceptions seront toujours justifiables ; les évaluateurs comptent, pourlimiter les cas de mise en œuvre directe, sur l’octroi d’enveloppes accrues saturant les capacités internesdes SCAC, sur l’exigence de partenaires représentatifs de la population bénéficiaire, et sur le fait queles missions de la cellule CD/FSD excluraient explicitement la réalisation directe de projets.
En cas de mise en œuvre directe, le partenaire technique du projet pourrait logiquement être un AT ouune personne interne au SCAC, identifiée comme partenaire technique dans les dossiers du projet.
La subvention directe doit requérir, comme actuellement, une validation détaillée des coûts, un échéan-

125Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
cier fractionné de paiement, la production de mémoires d’exécution successifs et d’un rapport final àréception. L’échéancier de paiement peut prévoir un petit pourcentage à verser à la suite de la visite expost (après un an). Cette «prime à la réussite» doit être très limitée (5 % par exemple) car les opéra-teurs auront, en règle générale, équilibré leur budget sans compter sur ce versement complémentaire.
6.4. PHASE DE CAPITALISATION ET DE DÉMULTIPLICATION
La capitalisation et la démultiplication sont des fonctions essentielles du dispositif CD/FSD, trèsmal remplies actuellement.
Les évaluateurs proposent d’y remédier à trois niveaux:
— capitalisation d’une expertise socio-économique et de gestion, par la création ou le développementde la cellule de gestion composée de Français et de nationaux (cf. supra) ;
— études de capitalisation, diffusion d’information et formation, réunions franco-nationales de «déve-loppeurs», faisant l’objet de l’action-type 4 finançable sur CD/FSD (cf. supra) ;
— échanges d’expertise au-delà des frontières nationales.
Cet échange d’expertise a été très faible pour les CD/FSD sur la période évaluée: il s’est limité à l’ap-port d’expériences par des personnes changeant de poste et de pays d’affectation; or le gros de l’expé-rience est détenu par des juniors (volontaires) et parfois des salariés nationaux, et ne passe donc guèreles frontières.
Il s’agit d’un déficit déjà repéré par le Bureau de l’évaluation (note de Michael Ruleta au comité d’exa-men, mars 1999):
«En l’absence de soutien technique, de suivi par les services centraux, d’échanges entre lespostes, il est à craindre que ce mode d’intervention ne profite d’aucun enseignement, ne fassel’objet d’aucune valorisation, ne tire aucun enrichissement des initiatives réussies et ne s’in-tègre pas dans les nouvelles orientations de la coopération française»
Cet échange d’expertise doit pouvoir se faire en autogestion par les cellules nationales CD/FSD, prin-cipalement par internet. Des «têtes de réseau» peuvent s’autodésigner ou être désignées par Paris dansles différentes régions géographiques. La formation et le tuilage des volontaires et des salariés natio-naux doivent être vérifiés et si nécessaire organisés depuis Paris (cf. infra 5.4).
Des rencontres annuelles des gestionnaires de CD/FSD pourraient être organisées à Paris pendant lesvacances scolaires, une partie d’entre eux rentrant en France. La formation des volontaires sur le départpourrait être jumelée avec ces rencontres.
Quelles procédures de suivi et d’évaluation ?
Si les évaluateurs ne préconisent pas que soit imposée une évaluation ex post et externe de tous lesfinancements CD/FSD, les recommandations précédentes intègrent cependant un renforcement impor-tant du suivi et de l’évaluation:
1. Examen ex ante de tous les projets (facultatif pour le seul guichet État-urgence) par le comitéconsultatif, au lieu des seuls projets «2e guichet» supérieurs à 300 kF actuellement ;
2. Autosaisine possible du comité consultatif pour faire des visites de terrain en groupe ou en déléguantquelqu’un, un budget de fonctionnement lui étant dédié;
3. Compte rendu des quelques indicateurs de base qui remontent à Paris sur tous les projets (cf. infra5.6.3) ;
4. Visite ex post à un an, avec un expert national externe;
5. Auto-évaluation des enveloppes terminées, jointe au rapport de présentation (cf. infra 5.6.3) ;
6. Évaluation ex post externe de tous les projets expérimentaux;

126Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
7. Études de capitalisation ou évaluations à l’initiative du SCAC sur les sujets et projets qu’il jugeutile ;
8. Évaluations à l’initiative de l’administration centrale, à l’aide des crédits réservés à cet effet (cf.actuelle enveloppe de 0,5 % des crédits CD/FSD).
En cas d’évaluation proprement dite – obligatoire en particulier pour tous les projets à caractère «expé-rimental» – des évaluateurs externes et indépendants du projet devront être recrutés à cet effet. Lecomité consultatif tiendra le rôle d’instance d’évaluation: en formation plénière pour la validation destermes de référence et la présentation du rapport, en formation restreinte si elle existe pour la créationdes termes de référence, la sélection du ou des évaluateurs (trices), voire une présentation intermédiai-re permettant d’élaborer de façon collective des recommandations.
Les grilles d’évaluation de projets peuvent utilement faire l’objet d’échanges entre gestionnaires desCD/FSD dans les SCAC. Elles doivent vérifier et fiabiliser, au long du cycle de projet (ex ante, en cours,ex post), les valeurs des quelques indicateurs de référence de chaque type d’action; et traduire les objec-tifs (généraux, nationaux, ou sectoriels) impartis aux CD/FSD, à l’image des grilles utilisées pour laprésente évaluation (cf. version intégrale des notes sur chaque pays).
7. Recommandations sur la gestion du dispositif àl’échelle du MAE
7.1. RECOMMANDATIONS SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Dans la logique d’une déconcentration des crédits et d’une coopération de proximité, les évaluateursrecommandent une augmentation du volume des CD/FSD (par exemple un doublement par rapport àla période 1996-2001), qui serait accompagnée d’un renforcement de leurs lignes directrices, de façonà accroître les chances d’atteindre les objectifs fixés.
— Ce cadrage accru peut permettre au MAE d’accorder dans de bonnes conditions de confiance, desenveloppes elles-mêmes accrues (les 20 % pour le guichet «État et actions d’urgence» représententplus que les actuels 33 % du «guichet État», si l’enveloppe est doublée).
— L’ensemble du cycle de projet, de l’identification à l’évaluation, resterait de la responsabilité despostes, ce qui continuerait à faire des CD/FSD les fonds «les plus déconcentrés» au sein du titre VI.
— Les CD/FSD apparaissent actuellement comme le type des Fonds de développement social ou local«incontrôlés» par contraste avec ceux d’autres bailleurs multilatéraux ou bilatéraux (cf. étude del’ACDE, novembre 2000, sur les fonds de développement participatif). Un cadrage accru apparaît belet bien nécessaire si l’on veut que, contrairement aux intérêts immédiats des postes dans la plupart despays, mais conformément à leurs intérêts de long terme, les fonds aillent aux populations pauvres et ali-mentent une coopération avec la société civile nationale.
Une même nomenclature, qui peut être basée sur celle de l’enquête de 2001 (à préciser et compléter),serait imposée aux SCAC pour classer leurs projets par secteur, zone géographique et type d’opérateur,notamment dans les rapports de présentation. Les SCAC y ajouteront naturellement, dans ces rapports,les nomenclatures qu’ils auront jugées adaptées pour caractériser l’intérêt particulier des CD/FSD dansle pays.
7.2. RECOMMANDATIONS SUR LES ENVELOPPES FINANCIÈRES ALLOUÉES AU DISPOSITIF
Les évaluateurs pensent qu’un doublement de l’enveloppe CD/FSD, par rapport à la période 1996-2001, est praticable et souhaitable, moyennant les recommandations indiquées ci-dessus pour la struc-ture de gestion du dispositif dans chaque pays.

127Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
51 Ce taux pourrait être assez stable. Les pays les plus pauvres sont certes les plus nécessiteux, mais ce sont aussi ceux où ilest possible de faire des projets très peu chers. Dans les pays d’ancienne colonisation française, le flux de demandes est sansdoute plus élevé, mais ce sont aussi ceux où il existe une plus grande diversité d’instruments d’intervention, limitant lesCD/FSD à un champ plus étroit.Le niveau indiqué ne peut constituer un maximum lorsque le FSD «récupère» des fonds prévus initialement pour le reste duFSP (cas de Haïti actuellement).À titre de point de comparaison, 34 pays de la ZSP sont des PMA et totalisent 210 millions d’habitants.52 Les chiffres actuels étant de 0,3-0,4 % de l’APD, et de 7 % du FSP (soit 17 % des FSP «État»).
— Les évaluateurs partagent en effet l’avis des SCAC selon lequel les CD/FSD remplissent mieux leursobjectifs que la moyenne des projets FSP; et prennent note de l’avis des SCAC selon lequel les enve-loppes CD/FSD pourraient rester à leur niveau actuel : ce qui traduit, de l’avis des évaluateurs, lasituation des systèmes de gestion, non l’état des besoins ou des potentiels d’action efficace.
Un chiffre de 1 FF (0,15 €) par an et par habitant pourrait être une référence raisonnable51.
Les CD/FSD resteront de toute façon une part minime de l’APD française (inférieure à 0,7 %) et unefraction du FSP (inférieure à 15 % 52) – alors qu’ils sont à la fois le principal moyen de coopérationdirecte avec les acteurs non-étatiques du Sud, et le principal outil ciblant les populations pauvres.
Dans les pays où les enveloppes CD/FSD sont supérieures à ce chiffre, ou bien quand elles l’atteignentmais en l’absence d’une structure de gestion adaptée, c’est qu’une partie de l’enveloppe est consacréeà des «petits FSP», projets de taille moyenne gérés par la coopération française sur le même mode etavec les mêmes motivations que les FSP classiques (cas de Haïti).
7.3. RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT
Les évaluateurs recommandent la mise en place d’une cellule de suivi des CD/FSD au bureau duFSP. Il s’agirait d’une structure de suivi comptable, réglementaire et de procédures, veillant à l’infor-mation des gestionnaires dans chaque pays, et au respect des critères posés par la réglementation desCD/FSD.
Elle recevrait communication de la base de données des projets dont le financement a été décidé, ainsique des PV des comités consultatifs.
Il ne s’agirait pas d’une cellule d’expertise sectorielle en développement social ou en eau potable…,non plus que d’une fonction d’animation professionnelle (forum internet, dialogue ou conseil sur lecontenu des projets…) qui devrait, elle, être assurée par le réseau des gestionnaires du CD/FSD lui-même. Cette fonction d’animation est en effet incompatible avec celle de suivi-contrôle.
Cette cellule pourrait être composée de deux personnes (de niveaux A et B par exemple), de façon àassurer une permanence. Cette fonction, dont le contrôle de légalité est la composante majeure, devraitselon les évaluateurs être assurée par la DGCID en interne et non déléguée à un opérateur externe; ou,dans ce dernier cas, le même opérateur ne devrait pas être chargé des actions dans les pays du Sud.
La forme actuelle d’examen des rapports de présentation pose des problèmes évidents: les comi-tés ne sont pas en mesure de prendre de vraies décisions, n’étant maîtres ni du contenu des projetsfinancés avec l’enveloppe, ni du rythme d’engagement des crédits. En d’autres termes, le mode dedécision «par oui ou par non» n’est pas adapté aux CD/FSD.
Les évaluateurs recommandent donc d’améliorer l’information et de développer le pouvoir dedécision des comités.
— Améliorer leur information : un rapport final d’exécution sur les enveloppes CD/FSDanciennes, comprenant une auto-évaluation ex post de leurs forces et faiblesses, devrait êtreexigé pour la présentation de nouvelles demandes, en plus du rapport partiel d’exécution de l’en-veloppe précédente, engagée à hauteur de 75 %. En effet, ce dernier rapport est nécessairement très

128Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
descriptif quant aux réalisations et laudateur quant à la stratégie. On peut espérer plus d’analyse cri-tique sur les enveloppes plus anciennes, le personnel ayant en partie changé entre temps.
— Développer son pouvoir de décision: compte tenu des constats faits sur le passé, les comitésdevraient pouvoir poser au SCAC d’un pays donné des conditionnalités plus précises quecelles fixées par la réglementation: date limite pour le respect d’une procédure jusque là ignorée(réunion effective du comité consultatif…); planchers ou plafonds au sein de l’enveloppe (au maxi-mum X % pour tel secteur ou telle action-type…); large communication du SCAC sur l’existencedu dispositif, etc. ; ceci se décidant nécessairement par une négociation avec le poste.
La MCNG pourrait être destinataire des rapports de présentation des CD/FSD et émettre un avis à l’at-tention du comité d’examen: une cohérence accrue de l’intervention française en direction des ONG etcollectivité locales en serait attendue.
La communication sur le dispositif est un axe de travail pour le MAE dans son ensemble autantet plus que pour les postes. Comme toute administration en situation de guichet, le SCAC a tendan-ce à limiter l’information des usagers potentiels pour éviter de devoir gérer des files d’attente, ou pourlimiter celles-ci.
Il appartient donc aussi à Paris d’agir en direct pour faire connaître le dispositif. Les ministres s’yemploient en mettant en avant le FSD, témoignage de l’engagement social de la France, dans leurs dis-cours tenus dans les pays de la ZSP. Cependant les porteurs de projet potentiels n’écoutent guère lesdiscours des ministres. Il est donc nécessaire de les relayer par une communication de masse, de natu-re à toucher les porteurs de projet potentiels : communication publicitaire dans les bulletins profession-nels des différentes professions du développement, achat d’espace sur les radios francophones, encou-ragement à la réalisation de reportages ou films documentaires, etc. – le choix des moyens adaptésdemande une expertise en communication que les évaluateurs ne prétendent pas avoir.
La détermination du service en charge de cette communication peut aussi poser problème; cela ne cor-respond pas à la vocation de la cellule de suivi du FSD telle que définie précédemment. Cette commu-nication pourrait en fait être commandée à un opérateur externe.
La dénomination de l’instrument est un élément important de sa communication.
La création d’un nouveau terme comporte des pièges. L’inertie est importante : l’appellation FSD com-mence à être connue et utilisée, et à chasser «CDI» de l’usage courant… et les nationaux s’amusentvolontiers de la valse des étiquettes dans les dispositifs des bailleurs.
De plus «Fonds social de développement» traduit assez bien l’esprit du système, même si le mot desociété civile n’y figure pas. Tandis que le terme technique de «crédits déconcentrés» n’exprime pasla vocation du dispositif mais son mode de gestion.
Les évaluateurs proposent donc de consacrer l’appellation «Fonds social de développement»(FSD).

SIXIÈME PARTIERésumés des études de cas


131Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
1. Haïti
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
Haïti a une superficie de 27750 km2, dont 60 % présentent des pentes supérieures à 20 %. Les terresappropriées pour l’agriculture ne représentent que 30 % du territoire. La population est de 8 M habi-tants, soit 290 h/km2. Malgré l’urbanisation accélérée de ces dernières années, environ 60 % de la popu-lation vit en zones rurales, d’habitat dispersé, dépourvu d’infrastructures. Le territoire est enclavé, dif-ficile d’accès.
Haïti est le seul PMA des Amériques. Très dépendant commercialement des États-Unis (87 % desexportations, 60 % des importations), déficitaire dans ses échanges commerciaux, donc vulnérable auxchocs extérieurs, Haïti bénéficie des transferts en provenance de la diaspora (plus de 375 M$ en 1999)et de l’APD (220 M$ en 1999)
Après avoir connu en 1996, pour la première fois, une succession présidentielle démocratique et consti-tutionnelle, entre le président Aristide – rétabli dans ses fonctions en octobre 1994 par une force mul-tilatérale sous l’égide de l’ONU – et René Préval, le pays est confronté à une grave crise politiquedepuis juin 1997. Les élections de mai 2000, précédées par une nette détérioration du climat social etpolitique (assassinat du célèbre journaliste Jean Dominique et de candidats de l’opposition), ont étémarquées par des irrégularités relevées par les observateurs de l’Organisation des États Américains(OEA). L’opposition a refusé de participer au second tour, tenu malgré tout le 9 juillet 2000, puis auxprésidentielles et sénatoriales de novembre 2000, qui ont ramené au pouvoir M. Aristide. La plupart desbailleurs de fonds, dont la France et les multilatéraux (BID, Banque mondiale), ont «gelé» leur coopé-ration.
Malgré les initiatives de l’OEA et de certains secteurs de la société civile, le dialogue entre le partiLavalas du président Aristide, et l’opposition, a échoué.
La notion de «société civile» est relativement nouvelle dans les esprits en Haïti, et son émergence dansla vie politique est liée à l’après-mai 2000. Les organisations de défense des droits de l’homme, lesorganisations religieuses, celles des patrons et des commerçants, ont été amenées à investir l’arène poli-tique.
D’autres acteurs de la société civile sont surtout présents sur le champ économique et social : ONG opé-rateurs de projets, coopératives d’épargne et de crédit, surtout urbaines, coopératives de paysans. Lescoopératives, qui mobilisent les fonds propres de leurs membres, sont appuyées par l’État et bénéficientd’avantages légaux. Les ONG, alimentées par des fonds internationaux auxquels l’État n’a plus accès,sont perçues par celui-ci comme des concurrents à encadrer et contrôler.
Les relations bilatérales avec la France ont été traditionnellement amicales, même si aucun chef d’Etatfrançais ne s’est jamais rendu en Haïti. La France est le troisième bailleur bilatéral avec 4,5 % del’APD, après les États-Unis (32 %) et le Canada (7 %).
Une enveloppe CD/FSD a été allouée chaque année, entre 4 et 8 MFF.
La suspension, en 2000, des actions de coopération avec l’État haïtien, a signifié le maintien des pro-jets État en cours, mais sans renouvellement, et la forte diminution de l’assistance technique – 30 ATen 1999, 13 à la fin 2001. La coopération avec la société civile, sur CD/FSD, est alors considéréecomme un moyen de «montrer que la France n’abandonne pas Haïti» (interview), et reste à l’écoutedes attentes des habitants. Cette orientation prend en compte les leçons d’une précédente suspension de

132Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
53 Rapport d’évaluation d’élèves de l’ENA, «Les crédits déconcentrés d’intervention en République d’Haïti — Evaluationdes procédures et perspectives à court et moyen terme», 1993, p. 6.
la coopération, suite au coup d’État du général Cédras (septembre 1991), qui avait été l’occasion pourla coopération française d’entrer en contact avec la société civile haïtienne.
Les premières années, défiant face à « la multiplication» des associations portant des projets de déve-loppement, le SCAC avait fait le «choix {…} d’attribuer des crédits déconcentrés aux ONG reconnues,surtout françaises 53 ». La stratégie d’essaimage de certaines ONG françaises (Prodeva, ONG haïtien-ne, est une émanation d’Interaide), le développement des partenariats entre ONG françaises et haï-tiennes, et le départ de hauts fonctionnaires vers les postes de direction des ONG, ont ensuite permisaux ONG haïtiennes d’accéder aux financements CD/FSD. Les collectivités territoriales ont égalementété identifiées (p. ex. pour l’enveloppe 1996) comme des partenaires essentiels, mais des conflits sontapparus sur les décisions de maîtrise d’ouvrage, entre partie française et collectivités concernées (lesGonaïves, Port-au-Prince).
Depuis 2000, la coopération avec la société civile haïtienne recouvre un choix politique: «on montedes contre-pouvoirs avec la société civile dans l’espoir de créer une nouvelle élite qui raisonnera selondes critères différents. Ces gens qui auront été capables de gérer des structures, géreront un jour unesection communale» (interview).
Sur les 10 MFF de l’enveloppe 2002, le SCAC prévoit d’affecter quatre fois 2 MFF à des projets àdimension institutionnelle qu’on peut qualifier de «mini-FSP», s’adressant soit à des démembrementsde l’État (École Normale Supérieure), soit à des institutions non étatiques (Fédération des Chambres deCommerce et d’Industrie/Fédération des Industries d’Haïti, Fédération des Chambres d’Agriculture).
MODE DE GESTION DES CD/FSD
En 1996, le poste a organisé une rencontre avec les ONG françaises et haïtiennes pour présenter ce nou-vel instrument. De fait, les porteurs de projets sont essentiellement les ONG, et dans de rares cas lesassistants techniques (prolongement ou expérimentation de projets FSP). Satisfaites du cadre très largedes CD/FSD et d’exigences administratives moindres que celles d’autres bailleurs, les ONG déplorentcependant l’absence de financements en amont des projets (ingénierie sociale et politique).
Le poste reçoit une trentaine de projets par semaine. Après un écrémage qui en retient une dizaine,l’instruction est réalisée par un tandem composé d’un attaché de coopération et d’un CSN. Les porteursde projets (donc les opérateurs potentiels, non les bénéficiaires) sont reçus par le CSN. Une phase d’al-lers-retours s’engage alors, à l’issue de laquelle il reste environ 5 projets. Ceux-ci bénéficieront d’unconseil et de visites de l’équipe CD/FSD et/ou d’AT; le recours à une expertise extérieure est rare,contrairement à la pratique d’autres bailleurs.
Une fois le financement accordé – sans comité consultatif depuis la suspension de la coopération, etsans grille de sélection formalisée – la mise en œuvre relève du porteur de projet. Le suivi administra-tif et financier est effectué avec rigueur (paiements par tranches de 50 %, 40 % et 10 % sur justificatifde dépenses, délai de mandatement inférieur à une semaine, délai de paiement de l’ordre de troissemaines), mais le suivi technique est léger et informel (visites d’AT ne donnant lieu qu’à une restitu-tion verbale). Il n’y a pas non plus d’évaluation en fin de projet.
QUELQUES PROJETS
— Réhabilitation et renforcement du réseau d’eau potable à Grand Goave: 146 kFF, cofinancement japo-nais à hauteur de 639 kFF. Long travail de concertation avec les bénéficiaires (300 personnes d’un quar-tier déshérité) par l’ONG Assodlo, leader national sur le secteur. Le partenaire local est une associationpréexistante, KOD, dans l’opposition au pouvoir municipal, ce qui bloque l’achèvement du projet.

133Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— Appui aux centres Gheskio – Groupe haïtien de recherche sur le sarcome de Kaposi, à Port-au-Prince (200 kFF). La qualité de leurs travaux est reconnue au plan international (financements obtenusde l’Agence nationale [française] de Recherche sur le SIDA, et de nombreux bailleurs). Les CD/FSDont financé l’agrandissement des laboratoires, un sas de sécurité, des équipements pour le laboratoire.
— Projet d’adduction d’eau potable, à partir d’une source en montagne, au profit de 200 habitants duvillage de Petit Bois (300 kFF). Projet réalisé par l’ONG haïtienne Gataphy en partenariat avec leGRET, avec une forte implication du SCAC (plusieurs déplacements…). Bonne maîtrise technique etsociale du projet (comité de pilotage démocratiquement élu). Cependant, un raccordement des villagesenvironnants aurait certainement augmenté l’efficience (moindre coût par usager).
— Équipement de l’atelier automobile du collège Saint-Vincent au Cap-Haïtien (50 kFF). Bénéficieraà une cinquantaine de jeunes chaque année. L’ONG partenaire «Fondation Saint-Vincent» (Pères salé-siens) bénéficie de l’aide d’autres bailleurs nord-américains et de l’appui d’écoles agricoles confes-sionnelles de Bretagne.
ENSEIGNEMENTS
Face à l’accroissement des enveloppes financières consacrées par les bailleurs de fonds bi et multilaté-raux aux projets de proximité, le secteur des ONG s’est professionnalisé. Elles interviennent en quali-té d’intermédiaire entre populations locales et bailleurs de fonds, sélectionnant à la fois les groupe-ments villageois les plus dynamiques et les bailleurs de fonds les plus attractifs. Cette position en«écran», associé à un suivi léger de la mise en œuvre technique des projets sur CD/FSD, a pour consé-quence une faible intégration du poste au sein de la société civile haïtienne.
La souplesse et la réactivité du dispositif, l’expérience instructive du SCAC avec les collectivitéslocales dès 1996, la combinaison entre assistance technique et enveloppe déconcentrée, apportent auxCD/FSD une efficience reconnue par les autres bailleurs. Cependant, en l’absence de lignes directricespubliées, et en l’absence de communication sur le dispositif comme sur chaque projet financé, lesCD/FSD n’atteignent certainement pas actuellement leur but d’affichage de la continuité de la présen-ce française aux côtés du peuple haïtien.
2. Madagascar
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
La Grande Île – 587000 km2, 15 M habitants dont 12 M à la campagne – présente une variété d’éco-systèmes, et une complémentarité entre agriculture vivrière, cultures de rente, élevage, exploitationforestière et activités de pêche. Elle a toujours été en contact avec d’autres civilisations. Au cours descrises traversées par Madagascar depuis trois décennies (baisse du revenu par habitant de 40 % en20 ans), ces caractéristiques ont semblé constituer des handicaps: la diversité suscite des cloisonne-ments, l’ancienneté de la scolarisation et de l’administration favorise la lourdeur bureaucratique.
La situation macro-économique s’est améliorée à partir de 1997, grâce à des réformes institutionnelles,mais la crise ouverte par les présidentielles de décembre 2001 a rappelé la fragilité de ces améliora-tions, et la profondeur du clivage entre les hauts plateaux où se trouve la capitale, et les provincescôtières.
La notion de société civile, à Madagascar, est fortement associée aux ONG, confessionnelles (lesÉglises jouent un rôle politique et social très important depuis le XIXe siècle) ou laïques. Sur les sec-teurs du développement rural, de la santé, de l’éducation, les ONG ont répondu à la demande desbailleurs de fonds. Malgaches (un millier) ou étrangères (dont une vingtaine d’ONG françaises recon-nues), elles sont concentrées dans la province-capitale d’Antananarivo, où sont les centres décisionnels,les intellectuels, les représentants de la diaspora.

134Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Premier bailleur bilatéral, la France a défini, à l’occasion de la commission mixte de mai 2000, troisaxes de coopération prioritaires :
— le développement humain et social, avec des programmes dont les objectifs se rapprochent de ceuxdes CD/FSD (Programme d’Appui aux Initiatives de Quartiers – PAIQ, Programme d’Appui àl’Insertion Socio Économique – PAISE,…);
— le développement économique: infrastructures, services publics marchands, dynamisation desfilières productives et des organisations rurales…
— Les institutions: État de droit et décentralisation (Programme d’Appui à la Gestion urbaine –PAGU, Programme d’Appui à l’agglomération d’Antananarivo…).
Les relations difficiles entre les deux États, dans les années 1985-1995, ont favorisé le rapprochementde la coopération française avec les ONG. La France a exigé leur participation à la dernièreCommission mixte.
L’utilisation des CD/FSD – 27 MFF de 1996 à 2001 – a répondu à plusieurs logiques:
— Cohérence avec les FAC/FSP (expérimentation, prolongement…): déjà, en 1995, le poste a affec-té l’intégralité d’une enveloppe CDI au PAIQ.
— Actions innovantes et transposables : «le but recherché […] est de créer un effet de levier, en finan-çant des projets pilotes, qui pourront être répliquables avec l’intervention d’autres bailleurs»(Rapport de présentation de l’enveloppe 1998).
— Connaissance de la culture malgache: «un outil de coopération «chaleureux», un véritable espa-ce de rencontre et d’échange entre la partie malgache et la partie française, entre le Comité dePilotage et les porteurs de projets» (Rapport de présentation de l’enveloppe 1999).
— Adaptation aux besoins de la population, comme en témoigne l’affectation en 2000 de 5 MFF à desactions de post-urgence dans les régions sinistrées par trois cyclones.
MODE DE GESTION DES CD/FSD
La première enveloppe (1996) a essentiellement bénéficié à la province-capitale, mais le poste a cher-ché, dès 1998, à couvrir l’ensemble du territoire, dont le secteur rural, en s’appuyant sur les AT des pro-grammes sociaux (PAIQ, PAISE) dans les provinces.
Le nombre de projets qui remontent est tel que le poste ne finance pas de communication sur lesCD/FSD. L’instruction des projets donne lieu à plusieurs étapes, coordonnées par une AT chargée àtemps partiel des CD/FSD.
— Une fois le projet présenté sous la forme requise (dossier-type), s’engage un dialogue avec le por-teur de projet.
— Lors des réunions mensuelles du comité consultatif, le secrétariat CD/FSD présente la totalité desdemandes reçues au cours du mois et communique aux membres du comité consultatif une courte ana-lyse de chacun des projets assortie d’un avis. Le comité consultatif est appelé à se prononcer (note desynthèse, débat).
Le comité consultatif comprend 9 personnes réparties en trois collèges : pouvoirs publics, société civi-le, et bailleurs de fonds (SCAC, AFD et une agence des NU).
— Si le comité consultatif retient le projet pour étude, le secrétariat poursuit sa mission d’analyse etde conseil en s’appuyant éventuellement sur le réseau des AT. Il note le projet par «oui» ou par «non»sur 11 critères.
— Si le projet présente au moins six «oui», il est présenté au comité consultatif. Le dossier completest adressé aux membres une semaine avant la réunion, et donne lieu à un premier débat, suivi par uneprésentation du projet par le porteur de projet (ONG) et un représentant des bénéficiaires (élu, prési-dent de structure associative…) – le comité donne une grande importance aux propos de ce dernier.

135Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Plutôt qu’un avis négatif, le comité consultatif émet des conditionnalités. Ce fonctionnement est res-pectueux de la culture malgache, en favorisant le consensus, et évite à la partie française d’imposer sonpoint de vue – lorsqu’il est présent, l’ambassadeur ne préside d’ailleurs pas la réunion.
Le suivi administratif et financier des projets financés est attentif. Un manuel de procédures couvranttous les aspects de la présentation des justificatifs de dépenses a été réalisé à l’usage des bénéficiaires.Après s’être adjoint les services ponctuels d’un cabinet d’audit financier, le poste a recruté à temps par-tiel un consultant de cette société pour prendre en charge les tâches de suivi administratif et financier.
Les conditions de financement (avance de 50 %, versement intermédiaire de 30 %, solde de 20 % surjustificatifs) sont bien acceptées par les opérateurs, qui apprécient le respect des délais de mandatement(relation de qualité entre l’ordonnateur et le comptable).
En revanche, l’AT responsable des CD/FSD n’est pas en mesure d’assurer un suivi opérationnel. Lesopérateurs (ONG) sont donc très autonomes – voire peu aidés – dans leur rôle d’opérateur, surtout si leprojet se situe loin de la capitale.
QUELQUES PROJETS
— Extension du Centre Energie à Antananarivo (233 kF), qui accueille une cinquantaine d’enfants desrues et des jeunes en grande difficulté sociale. Il est soutenu par l’ONG catholique française AuteuilInternational. Situé près de l’Alliance française, il est régulièrement suivi par la représentation françai-se. Il est autonome pour son fonctionnement, mais ses bâtiments étaient vétustes et exigus: son exten-sion vise à lui permettre de diversifier ses formations professionnelles au-delà des ateliers menuiserieet poterie, et d’intensifier ses actions d’alphabétisation.
— Construction d’un centre socio-culturel pour les jeunes de la zone d’Ambohimalaza, provinced’Antananarivo (269 kFF). Projet de la paroisse, cherchant à créer un lieu de rencontre pour les jeunesde la zone, et un pôle de formations professionnelles orienté vers la proche zone franche. Le bâtimentest très peu utilisé. L’expert financé sur 14 mois par le SCAC pour concevoir le programme de forma-tions, a en fait délivré, à temps partiel, une formation micro-informatique.
— Adduction d’eau potable dans la commune rurale de Sabotsy Anjiro, province d’Antananarivo(388 kFF). Captage de la source, construction de trois réservoirs et de 38 bornes-fontaines. Projet sou-tenu par l’association française Trans Mad Développement, et l’association malgache Fikrifama (rap-prochement suggéré avec succès par le SCAC). Maîtrise d’ouvrage confiée à la mairie qui, une foisl’ouvrage terminé, a rétrocédé la gestion à un comité composé de 10 usagers élus. Chaque borne fon-taine est gérée par un comité composé d’une femme coordinatrice et d’un homme percepteur, élu parles usagers. Il y a actuellement 1600 bénéficiaires payants (sur un potentiel de 7000 personnes). Le prixde l’eau finance l’entretien courant mais non le renouvellement (amortissement).
— PAISE – Volet «Construction d’un atelier multiservices à Mahajanga. Budget de 2 MFF pour l’en-semble du projet PAISE CD/FSD, dont 750 kFF pour l’atelier multiservices. Structure de perfection-nement technique et de ressources à disposition de diverses corporations de métiers (menuiserie, méca-nique générale, ferronnerie, bâtiment second œuvre et carrosserie peinture). Le projet est porté par laville de Mahajanga. Un AT est mis à disposition. Le projet apparaît guidé par une opportunité (don dematériel du Conseil régional de la Réunion) plus que par une analyse des besoins et potentiels de l’ar-tisanat local.
ENSEIGNEMENTS
Le dispositif CD/FSD à Madagascar est à la fois— un outil complémentaire aux instruments de la coopération d’État à État, permettant l’expérimen-
tation;— un instrument original qui apporte à la coopération française un avantage concurrentiel par rapport
aux autres bailleurs de fonds;

136Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— un moyen de compréhension de la société malgache et de ses mécanismes de prise de décision, unsupport du dialogue avec les autorités politiques au plus haut niveau, et un vecteur d’ouverture à lasociété civile malgache (appréhendée au travers des ONG), et au secteur privé.
3. Mozambique
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
Avec une série impressionnante de réformes politico-économiques et une croissance annuelle de 10 %,le Mozambique (783000 km2, 19 M habitants) connaît un redressement remarquable depuis les accordsde paix de 1992, qui ont mis fin à 16 ans de guerre civile ; même si l’antagonisme subsiste entre leFrelimo, vainqueur des élections au plan national, et la Renamo, majoritaire dans le Nord et le Centre,qui rejette depuis 2000 les résultats électoraux. Depuis le plan d’ajustement structurel de 1987, leMozambique a reçu une aide étrangère d’environ 55 Mds FF. Le pays reste en retard par rapport à lamoyenne de l’Afrique subsaharienne (mortalité infantile, faible taux de scolarisation, pauvreté).
La société civile s’est développée dans la décennie 90 avec la constitution d’un cadre légal garantissantle droit de libre association; la recherche d’autonomie des syndicats ; l’émergence de collectivités ter-ritoriales librement administrées. On distingue:
— Les ONG «prestataires de services sociaux» (développement rural, enfants des rues), émanant pourcertaines d’ONG étrangères : une centaine d’ONG mozambicaines et environ 90 ONG étrangères,dont 8 françaises (1999). Chaque ministère cherche à coordonner les ONG de son secteur, soit enles intégrant dans ses commissions, soit en fixant un cadre d´intervention: par exemple, les projetsd’adduction d’eau en milieu rural sont tenus de faire participer les bénéficiaires à toutes les phasesde l’opération.
— Les collectivités locales : le conseil municipal dispose d’un réseau d’administrateurs allant jusqu’auniveau du quarterão (groupe de dix maisons). Proche de la population, ce réseau manque deconnaissances techniques et de moyens financiers.
— Les associations de paysans, souvent constituées en vue de l’appui de l’État ou d’ONG, parfoisregroupées en forum à l’échelle d’un district ou d’une province, ce qui leur permet notamment d’or-ganiser la commercialisation de leurs produits. La plupart sont affiliées à l’União Nacional dosCamponeses (UNAC).
— Les associations d’intérêts et de mobilisation, lieux de débat autour de thèmes tels que la dette, lefoncier, la justice économique, la femme ou les droits de l’homme. Elles tentent de peser sur le gou-vernement et les bailleurs, et y parviennent parfois.
— Les syndicats.
— Les réseaux, qui se sont tissés ces dernières années. Ils jouent parfois un rôle d’intermédiaire entrebailleurs et ONG. Les principaux sont Link (ONG nationales et internationales) et Teia (« la toile»:ONG et groupes mozambicains réunis en plates-formes provinciales, comprenant également leséglises).
Dans ce pays lusophone et membre du Commonwealth, la place de la coopération française est mo-deste (11e bailleur). Ses priorités sont la promotion de la langue française, la promotion du secteurprivé, le renforcement de l’État de droit, l’organisation des collectivités locales, les services sanitaireset sociaux.
Les partenaires civils de la coopération française sont en premier lieu les ONG françaises, notammentl’AFVP (qui intervient sur le programme JVA et sur le projet de post-urgence dans le district deChokwe) et Essor (projets sociaux en milieu urbain).
Selon plusieurs entretiens, la coopération française entre très lentement en relation avec la société ci-

137Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
54 En 2000, suite aux inondations de février-mars, une autre enveloppe de 20 MFF est accordée, consacrée pour 15 MFF audistrict de Chokwé (réhabilitation des infrastructures sanitaires, scolaires et administratives), avec délégation de maîtrise d’ou-vrage à l’AFVP, et pour 5 MFF à une aide budgétaire. Atypique par rapport aux CD/FSD, elle n’est pas évoquée dans la suite.
vile nationale du fait de l’environnement juridique différent, d’«une maîtrise très inégale de la langueportugaise», d’un fonctionnement trop administratif.
La première enveloppe CD/FSD, de 4 MFF (1997), donnait une priorité aux «opérations culturelles[qui] s’inscrivent dans une logique de présence française auprès d’une élite nationale [et sont favo-rables] aux succès économiques remportés […] par nos entreprises» (Rapport de présentation). Sonengagement a été difficile, le poste faisant face à «l’absence, dans la société civile mozambicaine d’as-sociations organisées, à l’exception des ONG dont la plupart sont des opérateurs associés à des ONGétrangères» (selon la demande de prolongation) : il obtint de Paris la montée à 2/3, au lieu d’1/3, de lapart du «guichet État».
La seconde enveloppe, de 7 MFF (2000) 54, «entend renforcer ce mode de coopération avec une socié-té civile en plein développement et avec des collectivités décentralisées de plus en plus volontaristesquant à leur développement de proximité» (Rapport de présentation). Les champs d’intervention sonttrès larges (culture, pauvreté urbaine, décentralisation…) au regard de la modestie des financementsfrançais au Mozambique.
MODE DE GESTION DES CD/FSD
Les CD/FSD ont financé 15 projets d’un montant moyen de 281 kFF sur le guichet «État» et 9 projetsd’un montant moyen de 253 kFF sur le guichet «FSD».
Trois réunions à l’attention des ONG françaises et francophones, et un document en français et en por-tugais qui semble avoir été fort peu diffusé, n’ont pas suffi à générer une notoriété des CD/FSD. De1997 à 2000, ce sont essentiellement les AT (une vingtaine) et les VP qui ont identifié et présenté desprojets au poste ; à partir de 2000, le dispositif a commencé à être connu parmi les ONG mozambi-caines; fin 2001, les CD/FSD ont été présentés au réseau Link (17 structures représentées).
À la réception d’une demande (une vingtaine par mois), le conseiller de coopération et d’action cultu-relle en examine la conformité aux règles des CD/FSD, en s’appuyant sur les attachés, et transmet lesprojets jugés éligibles à une VI chargée des CD/FSD.
Celle-ci entre en contact avec le porteur de projet pour améliorer la formulation du projet et le rendreapte à passer au comité consultatif. Cette phase donne parfois lieu à des visites sur site de la respon-sable FSD, quasi-exclusivement sur Maputo ou les environs, et à des échanges techniques avec les deuxattachés de coopération du SCAC.
Le document de présentation est ensuite présenté au conseiller de coopération et à l‘ambassadeur pourvalidation.
La présentation au comité consultatif a consisté, jusqu’en juin 2001, à un échange de points de vue lorsde la réunion interne du SCAC (conseiller et attachés de coopération, représentant de l’AFD et direc-teur régional de l’AFVP).
Un comité consultatif partenarial, avec quatre représentants de l’État et un de la société civile, s’estréuni à deux reprises (juin et décembre 2001). Lors de ce dernier comité, le débat a surtout consisté enune demande de compléments d’informations de la part des représentants de l’administration. Lesmembres du SCAC participent peu, sachant que si le projet est présenté, c’est que le conseiller decoopération est d’accord. Le débat conduit la responsable du FSD à endosser le rôle de défenseur duprojet.
Le suivi de la mise en œuvre des projets est implicitement confié aux opérateurs dans la mesure où laresponsable FSD n’effectue que très peu de déplacements en régions – les bénéficiaires ressentent unmanque d’intérêt de la part de la coopération française.

138Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
Si le dynamisme des deux CSN/VI qui ont été en charge des CD/FSD est reconnu, ainsi que la rigueurde la gestion administrative, trois difficultés sont récurrentes : questions juridiques (problème de lasécurisation foncière), questions techniques (analyse architecturale), questions économiques et finan-cières (comptes prévisionnels).
QUELQUES PROJETS
— Réhabilitation du poste de santé du village de pêcheurs de Costa do Sol, près de Maputo (80 kFF),poste destiné à 20800 habitants. Demande formulée par la direction de la santé de la ville de Maputo,qui s’est chargée d’équiper le poste du matériel médical et d’affecter le personnel médical. Ce person-nel ignore, comme les usagers du poste, l’origine du financement.
— Aide au relogement des victimes des inondations de la commune de Matola, près de Maputo(335 kFF). Plus de 500 ménages ont dû être transférés dans un quartier entièrement à construire (bair-ro Khongolote). La commune a désigné des opérateurs, dont la plus grande ONG mozambicaine,Kulima, qui a sollicité un financement français. Celui-ci a payé la construction de 42 maisons. D’autresbailleurs sont intervenus, dont le Conseil général de Seine-Saint-Denis (300 kFF avec HandicapInternational pour 35 maisons), lequel, contrairement à l’ambassade, est identifié comme financeur parle maire de Matola.
— Agrandissement du centre de l’ONG mozambicaine ASEM à Beira (335 kFF). Cette association,partenaire d’une ONG suisse homonyme, scolarise 400 enfants défavorisés et héberge les plus dému-nis. Le projet vise à construire deux nouvelles salles de classe (le coût par classe semble donc élevé).
ENSEIGNEMENTS
Les CD/FSD auraient pu permettre à la coopération française, malgré ses moyens limités, de faire res-sortir sa spécificité si, au lieu d’une large couverture sectorielle et géographique, le choix avait été faitde «segments» peu couverts : un secteur (les enfants des rues par exemple), une zone géographique, oudes projets expérimentaux (p. ex. tests de méthodes d’intervention en milieu ouvert pour les enfants desrues).
La pénétration des réseaux de la société civile demanderait aux représentants de la coopération fran-çaise de s’y investir plus qu’actuellement.
Le dispositif CD/FSD a démontré au Mozambique qu’il pouvait efficacement se substituer aux procé-dures « traditionnelles» (FSP) pour répondre aux situations d’urgence, moyennant dérogations à sespropres contraintes réglementaires.
4. Mauritanie
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
Sur un territoire d’un million de km2, désert pour l’essentiel, les 2,6 millions de Mauritaniens se regrou-pent dans les villes de la côte (Nouakchott, 600000 habitants), les oasis de l’intérieur et la vallée dufleuve Sénégal. Ils se répartissent approximativement par tiers entre Maures «blancs» (Beidanes),Haratines (Noirs affranchis, de civilisation maure, parlant comme les précédents l’arabe hassanyia), etethnies «négro-mauritaniennes», éleveurs (Peuls) ou cultivateurs. Les structures sociales tradition-nelles (dont l’organisation clanique maure) restent pleinement actives à travers l’appareil d’État commeà travers les structures privées (entreprises, ONG).

139Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
55 J.-F. Troin et Anne Marie Frérot, «Espaces du monde arabe: Territoires nomades réinventés? Le cas mauritanien»,Géographies, col. 74, N° 1, 1997-2003, pp. 111-125.56 Rapport de présentation de l’enveloppe 1999. Le mot «retrouver» est entre guillemets dans le texte.57 Les exemples ci-dessous en témoignent mal car la plupart de ces projets, en cours, n’ont pas été visités.
Grâce aux rentes du minerai de fer et des ressources halieutiques, la Mauritanie est, comparée à ses voi-sins sahéliens, un pays à plus haut revenu. Elle bénéficie également, malgré une situation géostraté-gique peu favorable, de la concurrence des bailleurs de fonds dont la France, premier bailleur bilatéral,la Banque mondiale et l’Union Européenne, tous trois présents sur la majorité des secteurs d’activité.
La décentralisation a revalorisé « les anciennes régions socio-tribales […] comme lieux d’investisse-ment» des élites urbaines55. Une mobilisation importante a marqué les dernières élections locales etl’opposition a créé la surprise, tandis qu’un début de «relève des générations» avait lieu parmi lescadres liés au PRDS au pouvoir. Bénéficiant de peu de recettes fiscales directes, leur fortune et/ou leursrelations dans l’appareil d’État et chez les bailleurs, sont des atouts nécessaires pour réussir.
Les classes sociales les moins concernées par les joutes politiques s’organisent le plus librement : grou-pements de femmes (tontines…), de jeunes, de paysans du fleuve. Un parrainage par un notable, asso-cié à la reconnaissance juridique qui, depuis 2 ans, est assez facilement obtenue, peut leur donner accèsaux financements venus de la capitale. La région du fleuve a aussi accès aux financements étrangersvia les émigrés en France, ou via les ONG étrangères présentes dans cette région, comme le GRDR.
La France associe un attachement à la stabilité du pouvoir d’État, qu’elle a fait naître à la fin des annéescinquante, avec un concours au processus démocratique. Cela la conduit à cibler la population harati-ne, pour sa promotion socio-économique dans le cadre des structures existantes, à soutenir les éluslocaux, «meilleurs relais possibles […], plus acceptés par la société civile que les représentants loin-tains de Nouakchott» (interview).
Deux enveloppes CD/FSD de 6 MFF chacune ont été attribuées en 1996 et 1999. La première enve-loppe a été affectée pour 4 MFF à deux gros projets à Nouakchott (piloté par un AT employé en fait auSCAC) et Nouadhibou (finalement non réalisé). Parlant de «“retrouver” l’esprit du FSD» 56, une nou-velle équipe réoriente les CD/FSD vers le financement de micro-projets, les collectivités locales (quisont bénéficiaires de 49 % de la seconde enveloppe 57), et vise la présence dans toutes les wilayas(régions).
MODE DE GESTION DES CD/FSD
Dans la première moitié de la période étudiée, le poste n’avait ni personnel dédié aux CD/FSD, ni comi-té consultatif de sélection des projets. La gestion ne se structure pas avec la nouvelle équipe: pas decomité partenarial, pas de PV des décisions internes (dans la période étudiée), pas de documents de pro-jets ou de grilles écrites de sélection. Les CD/FSD sont directement pilotés par le conseiller de coopé-ration et son adjoint, qui s’appuient fortement, pour l’instruction des dossiers comme pour leur gestionet leur suivi, sur l’important réseau d’AT – environ 90, dont des AT enseignants présents dans leswilayas au titre de la réforme de l’enseignement. Une personne en contrat local est chargée du suivi desCD/FSD, mais, peu informée par les attachés de coopération et les AT, sa tâche se limite en pratique àun secrétariat administratif.
La gestion très directe par le personnel français, en particulier le personnel technique, est appréciée parcertaines parties nationales, le pays ayant une très haute capacité d’évaporation des fonds. Compatibleavec l’instruction de 1996, cette gestion directe limite cependant les capacités quantitatives d’engage-ment sur CD/FSD. L’absence de toute formalisation et de toute consultation de nationaux à l’étape desélection des demandes est, elle, à la fois incompatible avec les textes et peu justifiable.

140Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
QUELQUES PROJETS
— Réalisation de quatre carrefours giratoires à Nouakchott – budget finalement engagé de 2057 kFF,légèrement supérieur au montant prévu de 2 MFF. Le SCAC et un ingénieur-conseil français ontpromu, avec un AT architecte, la création de giratoires, dont un près de la résidence du Premier ministreet un près de l’ambassade de France. Les promoteurs du projet ont prévu des embellissements monu-mentaux au centre des carrefours afin de donner des points de repère à une ville qui, selon eux, en man-quait. Des dispositions malvenues dans la passation des marchés ont engendré d’importants retardsdans la réalisation.
— Appui à l’Ordre National des Avocats (installation du siège) 310 kFF. Fourniture de matériel pouréquiper le siège de l’Ordre, hébergé dans le Palais de justice. Ordinateur, sièges, étagères pour la biblio-thèque. Un financement équivalent a été accordé simultanément au Syndicat de la profession. L’Ordre,plus que le Syndicat, a acquis une réputation d’indépendance par rapport au pouvoir d’État.
— Restructuration de bornes fontaines (Nouakchott – 988 kFF). Installation de 10 bornes-fontaines(sur 15 prévues). C’est la première opération concrète menée, à sa création, par une structure ministé-rielle de lutte contre la pauvreté. La conception des bornes a bénéficié de l’aide technique d’AT fran-çais. La gestion de chaque borne est confiée à un «diplômé-chômeur». Sur place, un fontainier sertl’eau aux revendeurs qui l’apportent aux ménages par fûts de 200 litres en utilisant une remorque tiréepar un âne. Le prix de revente est théoriquement plafonné.
— Association pour la promotion des handicapés mentaux (Nouakchott – 338 kFF). Cette associationmauritanienne, créée en 1993, a tenté de recenser les handicapés mentaux de Nouakchott, puis créé àpartir de 1996 une structure d’accueil, qui atteint maintenant 60 enfants et jeunes sur un terrain fournien 1999 par l’Etat. À côté de petits bâtiments financés auparavant par d’autres bailleurs, les CD/FSDont financé un grand bâtiment qui accueille au rez-de-chaussée des salles de classe et à l’étage lesbureaux administratifs.
ENSEIGNEMENTS
La mise en œuvre directe permet aux CD/FSD des réalisations visibles et de bonne qualité technique,ce qui contraste avec ce que d’autres bailleurs disent de leurs propres opérations (Programme de Micro-Réalisations du FED par exemple).
Cette priorité accordée à la viabilité technique et économique, a cependant des limites, sous l’angle dela compréhension des enjeux humains des projets, et sous l’angle de la relation avec la société civile :aucune communication systématique n’a été menée sur le CD/FSD, même en direction des communes;le SCAC n’apparaît pas comme une tête de réseau qui ferait se rencontrer et s’enrichir mutuellement,les acteurs du développement dans différentes régions ou différents secteurs. Il se situe plutôt à la margede ce monde des «développeurs», d’ailleurs principalement centré sur la vallée du fleuve Sénégal,région de moindre priorité politique pour la Coopération française.
La gestion très personnalisée des CD/FSD par le chef de SCAC a conduit en fin de compte enMauritanie à des orientations prometteuses et adaptées à la situation dans la période récente, mais onpeut craindre que, faute de formalisation, elles ne durent pas au-delà de sa présence en poste.
5. Tchad
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
Dans le territoire immense (1,3 million de km2) du Tchad se distinguent un Nord saharien et un Sud,au climat soudanais, où sont concentrées les richesses marchandes: le coton et l’exploitation pétroliè-re naissante.

141Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
La longue guerre civile des années quatre-vingt entre Nord et Sud, puis entre factions et ethnies duNord, a ruiné l’économie et rendu inopérant l’appareil d’État, y compris l’enseignement public. LePNB par habitant et le budget de l’État par habitant sont parmi les plus faibles du monde.
Les années quatre-vingt-dix sont marquées par la stabilité du pouvoir du président Idriss Déby, par larestauration du fonctionnement administratif, et par une pacification progressive.
Des réseaux sociaux se constituent ou se reconstituent pour l’obtention de revenus (micro-entrepre-neuriat féminin), la défense de l’état de droit, l’enseignement, avec les nombreuses associations deparents d’élèves qui ont créé des écoles «communautaires». Ces «acteurs de la société civile» trouventsouvent dans l’administration d’État une alliée, face à l’arbitraire possible des détenteurs locaux dupouvoir d’État.
La politique française au Tchad est marquée par l’historique colonial, par le rôle stratégique du paysdans une Afrique centrale bouleversée par les conflits entre «seigneurs de la guerre», et par la baissede l’influence française au profit de l’économie américaine (concession à Esso de l’exploitation pétro-lière) et de la Banque mondiale: tout en restant présente militairement et en encourageant le processusde stabilisation, la France réduit le coût de sa coopération, en particulier de l’assistance technique.
Les CD/FSD ne jouent pas dans cette stratégie un rôle central – ils représentent certes environ 6 MFFpar an, mais seulement 2 % de l’aide totale au pays sur la période. Les projets CD/FSD sont souventcaractérisés par leur «souplesse» qui permet d’intervenir sur des projets présentés par des interlocu-teurs habituels de la coopération française. Cependant, à partir de 1999, l’emploi des CD/FSD par leposte manifeste son intérêt pour une nouvelle catégorie d’acteurs, ceux de la «société civile», en par-ticulier les structures associatives et les municipalités – lesquelles restent, sur toute la période évaluée,dirigées par des maires nommés par l’État.
MODE DE GESTION DES CD/FSD
L’instruction et le suivi des projets sont organisés, et pour la plus grande partie réalisés, par une cellu-le de gestion composée de deux Volontaires du progrès (VP) et localisée au SCAC même, sous l’auto-rité de l’attaché de coopération chargé du secteur social.
Les VP ont constitué une documentation assez abondante, incluant des guides détaillés pour l’élabora-tion de documents de projets, et des embryons de guides de procédures ou de grilles de critères de sélec-tion. Les critères majeurs concernent l’efficience des projets et la durabilité des services qu’apporterontles investissements financés.
Conscient(e)s de la nécessité d’accompagner les demandeurs pour arriver à une formulation raison-nable et viable des projets, les VP sont cependant surtout occupés par les tâches de gestion et ont peud’occasions de se déplacer dans le pays. Ils (elles) trouvent un appui technique auprès d’assistants tech-niques français, de services ministériels, d’associations spécialisées, et parfois d’autres bailleurs.
Un comité consultatif a été constitué, il inclut, depuis 1999 au moins, les représentants de trois minis-tères et de trois collectifs d’ONG ou d’associations. Les expertises réunies sont du meilleur niveau etles échanges sont significatifs ; cependant, le comité, ayant un statut flou et étant souvent consulté enaval de projets déjà validés par le SCAC, semble peu en mesure d’orienter l’usage des enveloppesCD/FSD.
QUELQUES PROJETS
— Un financement de 747407 FF sur l’enveloppe 1996 a été accordé à la capitale, en prolongementd’un FSP antérieur, pour divers travaux: réhabilitation de bornes-fontaines, soutènement des berges duChari le long de la Présidence, création de caniveaux dans un quartier inondable près de la grande mos-quée et du marché. Gérés par les AT en poste à la municipalité, ces projets ont accompagné la créationet la professionnalisation des services techniques municipaux.

142Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
58 Selon Charles Ntagwarara dans le quotidien «le Renouveau», cité par la Revue hebdomadaire de la presse burundaise, édi-tion diffusée par internet, N° 147 du 9 au 13 septembre 2002.
— Une association féminine de la capitale, accompagnée au départ par une nutritionniste française, abénéficié de 90400 FF sur l’enveloppe 1997, ce qui lui a permis de créer des accueils par quartier (chezdes femmes membres de l’association), une garderie, la fabrication de farine enrichie pour les bébés.Bien que son action semble très peu coûteuse par personne bénéficiaire, elle a réduit son activité fautede capacité à mobiliser des financements ultérieurs.
— Un «collège communautaire agricole» a été construit, dans un village proche du fleuve Logone,pour 240000 FF sur l’enveloppe 1998. Cette idée originale de l’Église catholique – former des jeunesdu village jusqu’au niveau de la 3e, mais avec une spécialisation agricole et sans possibilité de passerdans l’enseignement classique – ne semble pas, à l’expérience, être viable ou répondre à une demandesociale.
— Un projet urbain a été financé dans le bourg de Mongo pour 991750 FF, comprenant plusieursvolets dont des latrines pour des écoles, le déplacement de l’abattoir, le drainage des eaux pluviales(destructrices dans cette ville), la collecte des ordures par des charretiers, et un petit volet d’appui à lamunicipalité. Basé sur une relation entre la municipalité et l’AFVP, et géré pendant 2 ans par un VP surplace, ce projet est exceptionnel par son efficience et son adaptation progressive aux réalités locales.
ENSEIGNEMENTS
La gestion des CD/FSD au Tchad assure un équilibre entre structuration (procédures) et réflexion auto-critique constructive. La délégation formée d’un binôme de juniors, les VP, qui sont en l’occurrencesouvent de jeunes femmes, a des effets très positifs sur la conformité de l’usage des CD/FSD à leurvocation, et sur la mise en relation de la coopération française avec la société civile au sens large.Malgré cela, la relation avec la société civile reste ténue.
La montée en puissance des autres bailleurs sur les fonds sociaux ou locaux (Union européenne,Banque mondiale, etc.) est observée par la coopération française, mais peu de conséquences en sonttirées sur le rôle spécifique des CD/FSD dans un contexte où les opérateurs de projets issus de la socié-té civile sont déjà, et vont de plus en plus, être mobilisés par les bailleurs sur des projets structurés etpilotés région par région.
6. Burundi
SITUATION NATIONALE ET STRATÉGIE D’UTILISATION
Pays de collines, dont le climat et la pluviométrie permettent deux à trois récoltes annuelles, le Burundicompte 6,5 millions d’habitants soit près de 240 hab./km2, dont environ 90 % en zone rurale. Ses limitesterritoriales préexistaient à la colonisation belge. La longévité du pouvoir du clan des Baganwa sembleavoir reposé sur sa capacité à assurer un équilibre des forces entre «l’aristocratie» Tutsie (descendantsd’éleveurs) et la majorité «paysanne» Hutue (plus de 80 % de la population). En témoigne l’institutionséculaire d’une justice indépendante, assurée par le corps des Bashingantahe, «par excellence la pier-re angulaire de la société civile traditionnelle 58”.
Dès l’indépendance, la transition vers une monarchie constitutionnelle se brise sur les ambitions indi-viduelles et ethniques: le Burundi sera dirigé par des régimes autoritaires puis militaires dominés parles Tutsis ; des massacres interethniques ont lieu en 1965-1966, 1972 (les plus graves), 1988. La tran-sition démocratique menée par le major Pierre Buyoya porte à la présidence en 1993 Melchior

143Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
59 Note d’orientation stratégique, 5 décembre 2000.
N’Dadaye, du parti FRODEBU, hutu, mais il est assassiné par des militaires tutsis. L’instabilité desmois suivants est marquée par des massacres couramment évalués à 250000 morts. De nombreuxTutsis migrent vers la capitale, qui se vide d’une partie de sa population hutu. En 1996, l’armée ramèneau pouvoir Pierre Buyoya, qui doit faire face à un embargo des pays voisins et à la suspension de laplupart des coopérations étrangères. Il relance une transition démocratique. Les négociations accou-chent en 2000, sous la pression du médiateur Nelson Mandela, de l’accord d’Arusha. La mise en appli-cation de cet accord de partage du pouvoir s’avère difficile, alors qu’une rébellion armée hutue persisteet que l’armée répond à ses exactions par d’autres massacres de civils.
L’utilisation des CD/FSD au Burundi est très dépendante de cette situation.
La France, qui s’était fortement impliquée dans les années quatre-vingt au Burundi (environ120 MFF/an FAC et AFD, et 70 AT), a «mis en sommeil» sa coopération de 1996 à 1998. Les CD/FSD,même très réduits par rapport aux CDI antérieurs, ont alors représenté un élément de continuité : 55 %de l’enveloppe 1996 (3 MFF) sont allés à trois projets dans les domaines de l’enseignement secondai-re et supérieur ; 28 % sont allés à des actions dans le domaine culturel, souvent rattachées au thème desdroits de l’homme.
Reprenant la coopération en 1998, avant les autres grands bailleurs, la France a un rôle diplomatiqueimportant à Bujumbura, dans le cadre des négociations sur la détention du pouvoir d’État, mais inves-tit des moyens financiers et humains réduits : environ 25 MFF par an depuis 2000, et un SCAC com-posé de moins de deux cadres équivalent temps plein – l’AFD étant absente suite à un contentieux avecl’État.
Dans «l’objectif d’aider à la stabilisation du Burundi», «trois domaines d’intervention ont été privi-légiés par le SCAC:— État de droit et appui au processus de paix et de réconciliation nationale,— reconstruction économique et satisfaction des besoins de base des populations,— éducation, culture, francophonie dans un contexte de modernité et d’ouverture» 59. (Le lien entre
«éducation, culture, francophonie» et «stabilisation» du pays apparaît pourtant fort indirect).
Ces trois domaines d’intervention correspondent bien à l’emploi de l’enveloppe CD/FSD de 1998(5 MFF): les secteurs de l’éducation et de la culture mobilisent 38 % des crédits ; des aides socialespour des publics très démunis (réfugiés, malades du Sida, prisonniers…) en consomment 46 %; lethème de l’état de droit reste présent.
Le retour éventuel à la paix serait sans doute suivi du retour des centaines de milliers de Burundais réfu-giés en Tanzanie, qui se retrouveraient sans doute en ville, compte tenu de l’absence de foncier libredans les collines. Développer une économie urbaine consommatrice de main-d’œuvre est pour cette rai-son l’un des objectifs des bailleurs. L’enveloppe CD/FSD de 2000 (4 MFF) a été demandée commeréserve pour le lancement rapide de tels projets lors du retour de la paix – encore attendue.
Le poids des CD/FSD est modeste par rapport aux programmes lourds d’intervention de certainsbailleurs sous forme de petits projets dans tout le pays (Union Européenne, Belgique, Banque mondia-le à partir de 2002).
MODE DE GESTION DES CD/FSD
Compte tenu du faible volume de FSP dans le pays, la règle des deux guichets avec «30 % maximumpour le guichet État» et avec comité partenarial obligatoire pour le guichet «société civile», ne s’ap-pliquait pas aux enveloppes 1996 et 1998 (encore en cours d’utilisation en 2002).
L’emploi des CD/FSD par l’ambassade selon la situation socio-politique, visant un impact symboliquedes financements français, s’est traduit par :

144Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
— Un mode de décision particulièrement «souple». Il n’y a ni comité de sélection franco-burundais,ni comité interne formalisé et régulier, mais des dispositifs partenariaux (entre États) existent surd’autres fonds français.
— La gestion directe de la grande majorité des projets (27 sur 34), le SCAC faisant preuve, malgré sonmaigre effectif, d’un professionnalisme, d’une capacité de gestion et d’une finesse d’analyse socio-politique remarquables.
Pourtant, la société civile, telle qu’elle s’auto-organise en réponse à la crise nationale, a semblé aux éva-luateurs mal connue du SCAC et rarement recherchée comme partenaire, au contraire des administra-tions locales de l’État ou de l’AFVP. Celle-ci joue au Burundi, selon les évaluateurs, un rôle intéres-sant, comparable à celui d’une agence de coopération technique.
Parmi les partenaires nationaux qui auraient été imaginables, on compte les associations communalesde développement, créées ensemble par les cadres hutus et tutsis originaires de différentes communes;la principale organisation en réseau, réputée pour sa neutralité, qui est la ligue Iteka des droits de l’hom-me; les organisations de l’Église catholique ou des Églises protestantes ; etc.
QUELQUES PROJETS
— Le financement d’équipements pour le centre Syfed-Refer («campus numérique») de l’Agenceuniversitaire de la Francophonie, et l’informatisation du catalogue de la bibliothèque universitaire(parallèlement au financement de matériel informatique par le PNUD pour l’université), ont été finan-cés à hauteur de 800 kF. Le maître d’œuvre de la première composante est le bureau régional de l’AUF,dirigé par un AT français ; la seconde composante a pour acteur principal une ex-AT enseignante, quia, de France, proposé au SCAC ce projet avec l’appui du recteur de l’université. Le choix de logicielpoussé par cette AT a rendu le projet peu opérationnel.
— L’IGAA (Association pour le progrès de la femme et de l’enfant) a pour présidente d’honneurMadame Pierre Buyoya. Après que l’IGAA a bénéficié d’autres financements français, MadameBuyoya a proposé un projet de magasin de stockage et de vente de produits au profit de groupementsde productrices. Il a été financé à hauteur de 213 kFF, après redéfinition, à la demande du SCAC, en«centre polyvalent de formation et d’animation», qui comprend une grande salle de réunion et lesbureaux de l’association.
— Le quartier Kamenge, au nord de Bujumbura, à dominante hutu, a été rasé par l’armée après avoirété occupé par la rébellion. Par la suite, une grande partie de la population est rentrée et manquaitd’équipements collectifs. La coopération française a financé pour 511 kFF la construction d’une nou-velle école avec 6 classes, un bloc administratif, deux terrains de sport, une vaste salle polyvalente des-tinée à l’ensemble du quartier. La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’AFVP. L’utilité de l’école appa-raît évidente (liste d’attente importante) même si l’efficience est discutable (d’autres classes auraientpu être préférées à la salle polyvalente).
— L’association ASPEDI – Assistance aux personnes en difficulté – réunit, sous la direction d’un colo-nel en retraite, des professionnels du secteur de l’habillement. L’association a obtenu 181 kFF surCD/FSD pour un projet pilote d’aide aux réfugiés des camps pour leur fournir des tenues: 1500 enfantshabillés, 12 tailleurs réfugiés mobilisés et formés. À la demande du bailleur français, le projet a ensui-te évolué, en un centre de formation d’apprentis, proche d’une PME de confection.
ENSEIGNEMENTS
Au Burundi, la coopération française a mené plusieurs projets de développement social et économiqueà la base (objectifs voisins de ceux du FSD), avec des budgets plus importants. Fonds «souple» decomplément, les CD/FSD n’ont donc guère été utilisés selon la ligne initialement prévue pour ce dis-

145Fonds social de développement
Évaluation du dispositif de crédits déconcentrés CD/FSD - 1996-2001
positif. Paradoxalement, cette ligne – appui aux populations pauvres urbaines, collaboration avec lasociété civile burundaise – devrait devenir d’actualité en sortie de crise avec le retour des réfugiés deTanzanie, le possible exode rural, la croissance de la demande économique.
Plus que l’usage des CD/FSD de 1996 à 1998, l’évaluation regrette la non-mobilisation, depuis cettedate, des CD/FSD en faveur des enjeux et acteurs burundais émergents.
Les fonds massifs d’autres bailleurs pour le développement local visent aussi, en principe, les «struc-tures de la société civile», mais la pression à la consommation des crédits peut conduire à une mise enœuvre directe. La «souplesse» des CD/FSD devrait à l’inverse en faire l’instrument d’une coopérationet d’un partenariat.