Etude de l'Ethique à Nicomaque, Livre VI, Aristote (Académie de Nantes)
Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
Transcript of Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
1/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIEA PARTIR DES ACTIVITES CLINIQUES QUOTIDIENNES
DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN EVEIL PROLONGE DE COMA
Projet de mobilité Doc.Mobility
DOCUMENT DE TRAVAIL : version du 22.02.2016
Requérant : Michael Cordey (THEMA – ISS – SSP – UNIL)[email protected]
Durée : 18 moisPériode : Février 2017 – Août 2018Lieu : Université de Montréal (UdeM - Canada)
Institut/Unité : Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM)Unité de recherche en neuroéthique
Responsables : Pr. Eric RacineFonction : Directeur, unité de recherche en neuroéthique
TABLE DES MATIERES
Table des matières ........................................................................................................................................... 1
Plan de recherche ............................................................................................................................................ 2
Description du projet ............................................................................................................................... 2
État actuel de la recherche et problématiques ........................................................................................ 3
La littérature concernant la prise en charge des patients victimes d’états apparentés au coma .................................. ........... 3
Problématiques soulevées à partir de la littérature produite par les professionnels de la santé .................................. ........... 4
L’anthropologie médicale et de la santé : enjeux éthiques, incertitude et prises de décision ................................................ 5
Conclusion : penser les enjeux éthiques en anthropologie .................................................................................................... 8
Objectifs ................................................................................................................................................... 9
Questions de recherche ............................................................................................................................ 9
Méthodes .................................................................................................................................................. 9
État d’avancement de mes travaux de recherche .................................................................................... 9
Importance du projet ............................................................................................................................... 9
Calendrier du projet ......................................................................................................................................... 9
Importance du lieu de travail ........................................................................................................................... 9
Importance pour la formation personnelle ...................................................................................................... 9
Intentions de publications ................................................................................................................................ 9
Bibliographie ................................................................................................................................................... 9
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
2/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
PLAN DE RECHERCHE
Description du projet
Dans le cadre de la réalisation d’une thèse de doctorat en sciences sociales effectuée sous la direction d’IlarioRossi, je mène une recherche sur les enjeux éthiques liés aux évolutions récentes de la prise en charge des patients
victimes d’états apparentés au coma. Les développements scientifiques, technologiques et médicaux dans des
domaines tels que l’imagerie médicale, la neurochirurgie ou la médecine intensive permettent de sauver la vie d’un
nombre grandissant de patients atteints de lésions cérébrales. Parmi ces patients rescapés des soins intensifs, un
nombre important sont victimes de troubles de la conscience et d’état apparenté au coma. Une fois leur état
stabilisé, ces patients sont susceptibles d’engorger les soins intensifs en occupant des lits pendant plusieurs jours
voire plusieurs semaines dans l’attente d’une évolution ou d’une décision. Parallèlement à cette problématique, on
assiste depuis une vingtaine d’années à des changements terminologiques propres à la façon de nommer et
d’évoquer les états dans lesquels se trouvent ces patients. Les notions de coma, d'état végétatif ou d'état pauci-
relationnel se voient en effet peu à peu substitués par les notions d'état minimal de conscience, d'éveil non-
répondant ou d'éveil prolongé de coma. À grands coups d'imagerie médicale, de dispositifs expérimentaux et de
protocoles de recherche innovants, des neurologues ont montré qu’un certain nombre de patients jusqu’ici jugés
en état végétatifs – et donc incapable de communiquer – répondent à des stimuli. Leurs travaux ont ainsi participé
à nourrir les débats scientifiques quant à la façon de définir l’éveil de coma et la conscience, contribuant ainsi à
donner naissance à des dispositifs de prise en charge clinique spécialisés. Si d’un point de vue épidémiologique,
scientifique, médical et médiatique, on assiste à un regain d’intérêt pour la thématique, force est de constater que
très peu d’études en sciences sociales se sont focalisées sur l’évolution des dispositifs cliniques, politiques,
économiques ou juridiques en la matière ou sur les enjeux éthiques que soulève la prise en charge des patients
victimes d’états apparentés au coma.
Malgré les avancées diagnostiques, le recours systématique à l’imagerie médicale et les moyens tant personnels
que technologiques engagés, les cliniciens ne sont pas en mesure de lever l'incertitude sur le potentiel d'éveil ou
de récupération des patients atteints de troubles de la conscience. Si le recours à l'imagerie permet bien de localiser
les lésions et d'en apprécier l'étendue, elle ne permet ni de prédire l'importance des troubles neurologiques, ni le
potentiel de récupération, ni l'évolution de l’état de santé. Dans ce contexte, j’effectue l’ethnographie d’une unité
interdisciplinaire pilote de neuroréhabilitation précoce mise sur pied en 2011. À l’interface entre les soins intensifs,les centres de réhabilitation et les soins palliatifs, la mission de l’unité est d’organiser une filière spécialisée
permettant d’établir des critères de sélection des patients, de délivrer des traitements visant à favoriser l’éveil et
d’établir un plan d’orientation. Dans ce cadre, je m'intéresse plus précisément à la façon dont les activités
quotidiennes des professionnels – menées en interaction avec des humains comme des non-humains – façonnent
les évènements et rythment les prises de décision. Favorisant une approche pragmatique et phénoménologique, je
m'attache à décrire la façon dont le travail clinique constitue la base tangible à partir de laquelle les acteurs
accordent leur posture tout au long de la phase aigüe d’hospitalisation. Par la description des activités et
interactions quotidiennes, mon objectif consiste à explorer les conditions de l'éthique en train de se faire. En ce
sens, je cherche moins à questionner l'espace clinique en tant qu'il constitue un lieu ou se jouent des rapports de
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
3/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
pouvoir, de domination ou d'autorité, qu'en tant qu'il constitue un dispositif plastique – fait d’objets techniques,
d’objets familiers, de protocoles, de savoirs scientifiques, de diagnostic, de pronostic, de lois, de principes, de
discussions ordinaires, de perception, d’émotions, de jugement, d’évaluation et d’épreuve de tangibilité – à partir
duquel les acteurs donnent prise au langage, s’emparent de responsabilités, se déprennent d’engagements – bref,
se saisissent quotidiennement de la question éthique et s’accordent au fil des activités quotidiennes.
État actuel de la recherche et problématiques
La littérature concernant la prise en charge des patients victimes d’états apparentés au coma
Parmi le foisonnement d’études et de littérature à disposition en sciences sociales sur les enjeux éthiques de la
pratique clinique, à ma connaissance, aucune d’entre elles ou presque ne s’est spécifiquement focalisée sur les
dispositifs de prise en charge des patients victimes d’état apparenté au coma. Une grande majorité de la littérature
sur le sujet provient en effet des cliniciens eux-mêmes et plus particulièrement de neurologues, médecins-
réanimateurs, psychiatres, psychologues, mais aussi des sciences infirmières et des neuroéthiciens. Parmi les
thématiques traitées, on trouve notamment des questionnements sur les enjeux éthiques liés aux mauvais
diagnostics (Schnakers et al. 2009; Schnakers et Laureys 2011), aux questions juridiques, de représentation légale,
de directive anticipée ou de volonté présumée (Bernat 2008; Schnakers et Laureys 2011; Wijdicks 2014), à la
façon dont les nouvelles catégories diagnostiques modifient les représentations sociales et les attitudes des
professionnels ou des proches (Eric Racine et Bell 2008; E Racine et al. 2008; Jox et al. 2012), aux enjeux de
l’interdisciplinarité, à l’organisation des soins ou à la mise sur pied de filières spécialisées (Berney et al. 2011;
Tasseau 2015), sur les besoins d’information et de soutien des familles et des proches tout au long de la phase
aigüe d’hospitalisation (Baret et al. 2012; De Goumoëns 2014; Didier 2014), sur la difficulté des soins et les défis
que doivent relever les soignants en matière d’éveil de coma (Balat 1998; Balat 2001; Baret et al. 2012; Minjard
2014b; Puggina et al. 2012), sur le rôle que les familles peuvent jouer en la matière (Minjard, Talpin, et Ferrant
2013), sur le rôle et la place que peuvent occuper les psychologues dans les unités de soins intensifs et d’éveil de
coma (Mimouni et Scelles 2013; Minjard 2015), sur l’enjeu éthique de la reconnaissance et la gestion de la douleur
par les soignants (Schnakers et Laureys 2011; Arbour 2013), sur le vécu de l’éveil de coma et l’identité des patients
(Grosclaude 2009; Potter 2009), sur la controverse concernant la définition de l’alimentation artificielle et de
l’hydratation comme traitement ou comme soins (Aubry 2008; Bernat 2008), sur la définition de la conscience
(Bontridder et Bosman 2006; Schnakers et Laureys 2011), du soi (Minjard 2014a), du statut du patient en état
minimal de conscience (Jox et al. 2012), de la personne (Demaison 2004; Defanti 2011) et de la définition de lavie et de la mort (Laureys 2005; Schumacher 2014).
Parmi cette vaste littérature produite par les professionnels de la santé, une partie importante concerne les enjeux
éthiques relatifs à la décision d’arrêter ou non les traitements en contexte d’incertitude. Cette littérature relève de
nombreux facteurs susceptibles d’influencer le processus de prise de décision tels que les croyances, la culture, les
projections, l’espoir, le diagnostic, le pronostic, leur interprétation, la situation familiale ou les rôles adoptés par
les membres de la famille ou les proches (Eric Racine et al. 2009; Braun et al. 2009; Crozier 2010; Rodrigue et al.
2011; Zier et al. 2012). Pour répondre aux enjeux éthiques liés à l’incertitude qui règne autour de l’évolution des
patients en éveil de coma, certains auteurs mettent principalement l’accent sur les impératifs de communication
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
4/9
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
5/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
Troisièmement, cette littérature a tendance à se focaliser sur les moments décisifs et les choix critiques, laissant
de côté les activités ordinaires et les choix quotidiens qui marquent la trajectoire hospitalière et mènent aux
situations d’urgence.
L’anthropologie médicale et de la santé : enjeux éthiques, incertitude et prises de décision
Si ces trois critiques – dispositif, épistémologie, focale – valent pour la littérature produite par les professionnels
de la santé, elles valent aussi, en partie au moins, pour la littérature en sciences sociales. Comme dit précédemment,
à ma connaissance, aucune recherche en sciences sociales ne s’est intéressée aux dispositifs de prise en charge des
patients en éveil de coma et aux processus de décision en la matière. Du point de vue historique, en effet, ce sont
principalement des neurologues (Sacks 1987), des neurochirurgiens (Cohadon 2000; Pheline 2001; Cohadon 2008;
Bousigue 2015), des journalistes (Dellus 1999) ou des patients (Bauby 1997; Lieby et Chalendar 2013; Blanchin
2015) qui offrent des témoignages, esquissant en creux, l’histoire des enjeux éthiques et des dispositifs cliniques
de prise en charge.
En revanche, les sciences sociales se sont depuis longtemps intéressées à la question du « faire vivre et du laisser
mourir », pour paraphraser Michel Foucault (1975), et à la façon dont les sociétés gouvernent les questions de vie
et de mort dans nos sociétés médicalisées. Depuis les années 50, de nombreuses études se sont attachées à couvrir
– explicitement ou non – les enjeux éthiques des pratiques cliniques et hospitalières. Des études ont relevés des
enjeux liés aux changements économiques, juridiques, épidémiologiques, technologiques et sociaux. D’autres se
sont attachées à montrer le rôle des représentations sociales ou des cultures professionnelles. Certaines ont relevé
les enjeux liés au changement de la figure du patient et de son statut. D’autres encore ont montré le poids de
l’organisation sur le travail clinique mais aussi la marge que les acteurs – prestataires comme bénéficiaires – ontsur la négociation des traitements médicaux, des prises de décision et du partage des responsabilités. En forçant le
trait, on parvient à dégager trois façons d’aborder les questions éthiques en matière de prise en charge de la maladie
et du mourir et de processus de décision en contexte d’incertitudes. La première est constructiviste, social-
historique et relève à la socio-anthropologie de la santé. La deuxième, relative aux ethnographies hospitalières, est
clinique et organisationnelle. La troisième, cognitivo-interprétative, est relative à la sociologie et à l’anthropologie
médicale. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’étude du langage et aux enjeux de l’information et de la
communication dans les relations médecins-patients. À chacune de ses perspectives correspond des façons bien
particulières de conceptualiser et de problématiser les enjeux éthiques relatifs à la prise en charge et aux processus
de décision médical que je discuterai brièvement ci-dessous
1- La socio-anthropologie de la santé, telle que proposée par Raymond Massé (2007), Didier Fassin (2000; 2001),
João Biehl (2013) ou encore Paul Farmer (2004), est soucieuse de dresser une critique des grands mouvements
épidémiologiques, historiques et sociaux. Dans ce cadre, les évolutions dans nos façons de définir et de parler de
la maladie et de la santé – que ce soit au niveau des acteurs politiques ou de la société civile – y sont pensées
comme les révélateurs des changements culturels, normatifs et moraux d’une société. Cette approche, fondée sur
une analyse historique des discours, se donne ainsi comme perspective critique d’identifier et d’articuler les grands
principes selon lesquels les acteurs justifient leurs actes ou demandent aux autres de les justifier. En ce qui
concerne la question vie/mort et les prises de décision médicales, cette posture est relativement proche des travaux
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
6/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
de Catherine Rémy (2010) ou de Florence Burgat (Burgat 2006) qui étudient les frontières d’humanité et les statuts
attribués aux êtres dans le contexte médical des xénogreffes. Elles montrent notamment comment les discours, les
principes et les jugements moraux - permettant de distinguer l’homme et l’animal sur le plan biologique - ont
évolué historiquement, allant aujourd’hui jusqu’à brouiller cette distinction et, parfois, la possibilité même de
sacrifier la vie de l’un pour la vie de l’autre. Dans cette même perspective, les nombreux travaux concernant lessoins palliatifs et la gestion de la fin de vie, tels que ceux de Michel Castra par exemple (2010), identifient dans
les modèles médicaux et les discours des acteurs, des principes normatifs et des valeurs morales. Plus
généralement, cette approche renvoie aux nombreux travaux critiques adressés à l’avènement de la démocratie
sanitaire dans nos sociétés occidentales contemporaines (Bureau et Hermann-Mesfen 2014; Ménoret 2015) et aux
nombreux principes qui la compose tels que l’autonomie, l’information, la communication, le soutien,
l’accompagnement, le consentement éclairé, la volonté présumée ou le consensus. Or, si certaines études menées
en sciences sociales sur ces questions s’attachent à décrire les effets, contradictions, tensions et ambiguïtés de ces
principes à partir de leur mise en œuvre par les acteurs qui y sont confrontés - et c’est notamment le cas des travaux
de Sylvie Fainzang (2010) sur l’automédication ou de Philippe Bataille (2012) et de Yannis Papadaniel (2013) sur
les soins palliatifs - une grande partie laissent de côté la façon dont les principes et les valeurs s’ancrent et
s’articulent concrètement dans le travail clinique quotidien.
2- Concernant les ethnographies hospitalières, un grand nombre d’entre elles se sont focalisées sur le poids que
revêtent les institutions, l’organisation, la division du travail et les technologies dans les rapports sociaux, les
modalités de prise en charge ou les prises de décision (Glaser et Strauss 1965; Sudnow 1967; Glaser et Strauss
1968; Strauss 1992; Zussman 1992; Vassy 2004; Vassy et Couilliot 2011). Une partie importante de cette
littérature met l’accent sur les rapports de classe et de pouvoir intrinsèques à la hiérarchisation hospitalière et aux
professions (Peneff 1992; Olivier de Sardan et Jaffré 2003; van der Geest et Finkler 2004; Pouchelle 2008). En ce
qui concerne les prises de décision d’arrêt de traitement ou de réorientation du plan médical, c’est principalement
du côté des études menées dans des unités de soins intensifs qu’il faut se tourner pour trouver ce type de
questionnement. Sur ce point, certains auteurs relèvent notamment le manque de cadre légal et de protocole ainsi
que la zone grise dans lesquelles s’opèrent les décisions d’arrêt de traitement (Cassell 2005; Kentish-Barnes 2007).
Dans ce contexte, Nancy Kentish-Barnes (2012) met l’accent sur les cultures institutionnelles des différents
hôpitaux dans lesquels elle a mené des ethnographies. De son côté, désireuse d’enrichir les réflexions en matière
de prise de décision, qu’elle juge parfois réduites aux contraintes institutionnelles et matérielles, Joan Cassel
(2005), tout comme Anne Paillet (2007), s’attache à décrire les débats, les principes moraux invoqués et les pointsde vue des différents professionnels engagés dans des situations concrètes. Pour ces auteurs, il s’agit de
cartographier l’espace des points de vue puis de les synthétiser sous forme de cultures professionnelles afin de
rendre compte des raisons et des principes au nom desquels on décide. Les observations participantes sont ici
mises à profit de la description d’une économie morale (Cassell 2005) ou d’une éthique « en acte » (Paillet 2007)
dans lesquelles les actes de langage constituent des révélateurs culturels. Qu’ils soient de langage ou non, les actes
sont ici considérés comme des révélateurs et non de l’activité qu’il s’agit de décrire et de questionner à partir de
leur effet, de leur efficacité ou de leur performativité. Pour paraphraser Sjaak van der Geest et Kaja Finkler (2004),
ces approches ethnographiques de l’hôpital envisagent la maladie, la médecine et la santé comme le reflet des
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
7/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
normes et des valeurs morales d’une société et accordent peu de place à l’études des activités et des vies qui se
jouent dans l’espace clinique.
Dans une certaine mesure, cette critique peut être adressée aux travaux fondateurs de Barney Glaser et d’Anselm
Strauss (1963) en matière d’ethnographie hospitalière, travaux qui ont notamment inspiré le travail d’IsabelleBaszanger (1986) autour du concept d’ordre négocié. Ces travaux, issus de l’École de Chicago, ont notamment
participé à promouvoir l’idée selon laquelle l’ordre social est le résultat du travail des acteurs. Dans cette
perspective, des négociations et des adaptations sont continuellement effectuées par ceux-ci en vue de maintenir
l’équilibre et le fonctionnement des institutions sociales. Ces approches, empruntes de structuro-fonctionnalisme,
mettent ainsi l’accent sur le fonctionnement organisationnel de l’hôpital. Bien que thématisant la question de
l’incertitude, et notamment dans le contexte du mourir à l’hôpital (Glaser et Strauss 1965; Glaser et Strauss 1968),
ces auteurs ne l’interrogent qu’en tant qu’elle constitue une menace pour l’ordre social et le bon fonctionnement
de l’institution. Pour ceux-ci, l’adaptation des conduites et la production de l’ordre, constitue la réponse pratique
à donner à l’incertitude. La critique principale qui peut être adressée à cette approche réside dans le manque
d’attention porté aux processus et aux activités par lesquels les acteurs accordent leurs conduites dans l’incertain.
Si l’on accepte d’opérer ce changement de perspective, alors il ne s’agit plus de décrire le travail des acteurs en
tant qu’il produit de l’ordre et de la certitude ou qu’il leur permet de savoir comment se conduire dans telle ou
telle circonstance. Il s’agit, en revanche, de décrire et d’interroger les activités à partir desquelles ils parviennent
ou non à s’accorder et à conjurer ainsi l’incertain. C’est là tout l’enjeu éthique pointé par le travail d’Annemarie
Mol (2009) d’Anne Lovell, de Stefania Pandolfo et de Veena Das (2013), mais aussi par les travaux philosophiques
de Sandra Laugier (2013) ou de Cora Diamond (2011) autour de l’éthique du care.
3- De la même façon, ces critiques peuvent s’appliquer, en partie au moins, à la sociologie et à l’anthropologie
médicale. Dans ce domaine, on ne compte plus, les études sur les relations médecins-patient et le rôle que
l’information et la communication jouent sur les décisions en situation de risque ou d’incertitude. De nombreux
recherche portent ainsi sur les enjeux en matière d’alliance thérapeutique, d’observance au traitement, d’itinéraire
thérapeutique ou de transformations identitaires. L’anthropologie médicale s’est notamment beaucoup intéressée
à la question de l’annonce de la maladie et du diagnostic en tant qu’événement susceptible d’affecter et de
désorganiser la vie d’un individu dans son ensemble (Augé 1984; Baszanger 1986) et à la façon dont cet événement
donne lieu à une quête de sens (Good 1998) et à des reconfigurations biographiques et identitaires (Herzlich et
Pierret 1984; Rossi 2007). Souvent basées sur des entretiens compréhensifs, ce type d’étude a principalement pourobjectif de faire entendre le point de vue des patients dans le champ médical en restituant la façon dont ceux-ci
donnent sens au vécu de la maladie. En articulant les récits de l’expérience de la maladie aux logiques d’actions
décrites par les acteurs, cette approche a notamment permis de montrer que les comportements de santé ne sont
pas réductibles à une pure logique biomédicale (Baszanger 1986; Fainzang 1997; Mino 2010). Partant du décalage
entre le sens que les professionnels et les patients donnent à la maladie – et notamment du décalage entre
diagnostic, pronostic, étiologie, traitement (Laplantine 1993) – certains auteurs se sont intéressés aux enjeux
éthiques de la circulation de l’information et de la communication médecin-patient. Ils ont notamment montré que
celle-ci dépend de la culture des professionnels (Zolesio 2012) et de l’appartenance sociale des patients (Fainzang
2006). Hormis ces constats sociologiques, certains auteurs se sont plus précisément intéressés aux enjeux éthiques
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
8/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
du mensonge, de la rétention d’information, du secret et des non-dits (Saillant 2006; Fainzang 2006; Mino 2010).
En étudiant les pratiques des professionnels et les principes selon lesquels ils décident de dire ou de ne pas dire,
Sylvie Fainzang (2006) et Jean-Christophe Mino (2010) ont décidé de mettre l’accent sur les rapports de pouvoir.
Pour ces auteurs, le mensonge ou la rétention d’information a ainsi tendance à se réduire à un moyen visant une
fin : influencer le patients en vue de son adhésion à l’étiologie et au traitement proposé par le médecin. Or, ceglissement de l’analyse des pratiques discursives vers une analyse des logiques argumentatives a tendance à mettre
de côté la question éthqiue de l’engagement des médecins vis-à-vis de leurs patients, question qui pourtant
transparaît tout au long de leur écrit respectif. Le point aveugle de ces approches réside dans le fait de réduire la
question éthique de l’information à la question du choix. Bien informer, c’est garantir le libre arbitre et le choix
des patients. En outre, à l’exemple du travail d’Aaron Cicourel (2002), l’analyse de la question de l’information
et de la communication se focalise, ici encore, sur le moment précis du face à face entre le médecin et le patient,
laissant de côté tout ce qui amène un médecin ou un patient à parler de telle ou telle manière dans telle ou telle
situation. Sur cette question, le travail d’Annemarie Mol (2003) est une fois encore exemplaire, dans la mesure où
elle nous invite à envisager les enjeux éthiques du partage de l’information et de la communication comme un
processus incertain, sans cesse travailler par les acteurs, qu’il convient de décrire et de mettre en perspective à
partir de ce qu’ils essaient de dire et de faire plutôt qu’à partir de notre volonté de diagnostiquer ce qu’ils disent et
ce qu’ils font.
À propos d’incertitude, la sociologie médicale a passablement travailler la problématique ouvrant à un
questionnement sur sa transmission et son partage entre les professionnels de la santé, les patients, les familles ou
les proches (Ptacek et Eberhardt 1996; Ménoret 2007). Le travail pionnier de Renée Claire Fox (1959), élève de
Talcott Parons, a décrit plusieurs types d’incertitude et mis l’accent sur son caractère irréductible dans l’exercice
de la pratique médicale. De son côté, Fred Davis (1960; 1963) à montré comment l’incertitude constituait une
ressource avec laquelle jouent les acteurs afin de contrôler la situation. Plus récemment, Nicholas Christakis
(1999), élève de Fred Davis, a axé son travail sur la dimension prophétique du pronostic médical. Pour résumer,
l’ensemble de ces travaux se focalise soit sur des typologies et des essais de définition de l’incertitude, soit sur
l’incertitude en tant qu’une ressource permettant aux acteurs de gérer la situation. Si une partie de ces travaux a
permis de montrer que les acteurs peuvent jouer avec l’incertain, aucun de ces travaux ne s’est intéressé à la façon
dont certitude et incertitude se font et se défont collectivement, au fil des activités cliniques et des interactions. Ce
n’est que très récemment, par le développement d’une sociologie du diagnostic, portée notamment par Sarah
Nettleton (2011; 2014), John Gardnet (2011) mais aussi par le travail d’Annemarie Mol (2003), que les chercheursen sciences sociales s’intéressent – de façon rarement explicite – aux enjeux éthiques du travail clinique, du
diagnostic, du pronostic et de l’incertain des façon processuel, autrement dit, en tant que fruit du travail et des
activités collectives. À ce propos, Simone Bateman (2010) fait le constat d’un manque crucial d’études en la
matière tandis que Julian Reynier (2007) rappelle qu’il serait intéressant de s’intéresser à tout le travail nécessaire
en amont avant de délivrer une information – tel un diagnostic ou un pronostic – ainsi que tout le travail que cela
produit en amont.
Conclusion : penser les enjeux éthiques en anthropologie
Tournant éthique : éthique située et multi-située, éthique en acte, éthique ordinaire
-
8/19/2019 Michael Cordey (2016) PENSER L'ETHIQUE EN ANTHROPOLOGIE
9/9
Michael Cordey | Demande de bourse Doc.Mobility (FNS) Plan de recherche
Objectifs
Questions de recherche
Méthodes
État d’avancement de mes travaux de recherche
Importance du projet
CALENDRIER DU PROJET
IMPORTANCE DU LIEU DE TRAVAIL
IMPORTANCE POUR LA FORMATION PERSONNELLE
INTENTIONS DE PUBLICATIONS
BIBLIOGRAPHIE















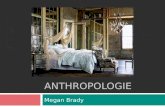
![[Pierre Macherey] Introduction a l'Ethique de Spin(BookZZ.org)](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cf9470550346f57ba20081/pierre-macherey-introduction-a-lethique-de-spinbookzzorg.jpg)



