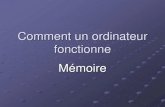mémoire TPFE
-
Upload
maude-caron -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of mémoire TPFE

Maude Caron//TPFE
juillet 2009
ENSAPL
Sous les hauts fourneaux, une rivière


Merci à :
Ali Fall pour sa disponibilité.
Armelle Varcin, Denis Delbaere, Claire Alliod, l’asso le Savoir Fer et l’espace Archive d’Arcelor-Mittal
La smala Delebecque-Caron-Hanriat-Quentin : merci d’être là !, Léa et Svetlin.


5
Note d’introduction
I. Anticiper la reconversion d’une vallée sidérurgique Le choix du sujet
Recherches et références
Exemples de reconversions locales
II. La vallée de la Fensch en Moselle Petite histoire de la vallée : la famille Wendel
Promenons nous ensemble : l’espace physque de la vallée
Les enjeux du territoire : le paysage comme moteur d’une reconversion
Recherches er références
Les travaux de l’OREAM Lorraine
Rudolph Schwartz et la ville paysage
III. Hayange, ville déclencheuse de nouvelles situations Le paysage moteur d’une reconversion
Comment tourner une vallée vers autre chose ?
IV. La cluse de Hayange : une géographie porteuse d’identité Quel devenir du cordon industriel si l’activité sidérurgique disparaît ?
Un paysage de transition qui instaure un nouveau rapport au territoire
Pour conclure
Bibliographie

6
Le choix de la vallée de la Fensch s'est fait tout
d'abord parce que je suis originaire de Lorraine,
mais surtout parce que ce territoire était porteur
d'imaginaire à mes yeux : vallée des anges (c'est
ainsi qu'on appelle toute la partie Nord de la Mo-
selle en raison des nombreuses communes dont
le nom se termine par –ange), bassin natal de
l'entreprise Arcelor, haut-fourneaux qu'on aperçoit
depuis l'autoroute, paysage fort marqué de val-
lonnements et de sites industriels plus ou moins à
l'état d'abandon.
Cette vallée possède une histoire. Non pas seule-
ment une histoire au sens d'une mémoire, d'un
passé lié au lieu, mais aussi une histoire au sens
d'un récit, d'une épopée humaine singulière.
Il s'agit d'un territoire colonisé il y a 4 siècles par
une famille, les Wendel, pour acheter les quelques
forges existantes et exploiter le fer présent dans le
sol. Famille qui s'est approprié la vallée, ses terres
comme ses habitants au point de la modeler dans
un seul but de rentabilité.
Il s'agit par voie de conséquence d'un territoire
exploité dont le sol a été creusé, fouillé, déplacé,
envahi et même annexé à plusieurs reprises par
l'Allemagne.
Il s'agit enfin d'une terre qui a accueilli, pendant
150 ans, de nombreux immigrants formant des
communautés encore très présentes : italiens,
russes, allemands, polonais, portugais. Ces dif-
férentes communautés se rejoignaient pour une
raison commune : la sidérurgie.
La vallée de la Fensch est un lieu à forte empreinte
symbolique, porteur d'images fortes et d'imaginaire.
Le patrimoine sidérurgique, très prégnant, a porté
l'identité de la vallée au fil du temps et a engagé
un rapport particulier au territoire, à la terre en tant
que socle.
Ici, tout devient binaire, exacerbé : un paysage
qu'on a exploité, mais paradoxalement un rapport
très fort entre ville et nature. L'urbanisation est sin-
gulière, avec un cœur de vallée formé du cordon
industriel, tandis qu'en périphérie, sur les coteaux,

7
se sont développées les villes. Les hauteurs sont
occupées par les jardins familiaux puis les forêts
qui ferment un peu plus la vallée. On sent une
forte imprégnation de la cité ouvrière jardinée, de
l'étalement urbain, du Stadtlandschaft (ville-pay-
sage) développé au début du siècle par l'architecte
allemand Rudolf Schwartz qui a dessiné le plan ur-
bain de Thionville et ses environs.
Aujourd'hui, la famille Wendel a quitté la vallée
mais reste propriétaire de nombreux terrains.
L'activité sidérurgique est en déclin : seul le haut-
fourneau de Hayange fonctionne, l'activité minière
s'est éteinte depuis une dizaine d'années. Les ha-
bitants se tournent vers le Luxembourg, à 20 km de
là, pour trouver du travail, tandis que la vallée tente
de perpétuer une activité ouvrière très ancrée.
Ainsi, on a affaire à un territoire en crise, tourné
vers une histoire qui se transforme peu à peu en
Histoire. On a affaire à une société locale qui s'est
construite autour de la vie ouvrière – organisation
économique, sociale, politique et territoriale – et
qui doit trouver une nouvelle identité, un nouvel "en
commun", un nouvel horizon.
Il s’agit, pour cette vallée, d’une reconversion.
Reconversion spatiale, industrielle et mentale.
Aujourd’hui, la vallée n’est plus vectrice d’emplois
et d’activités, mais devient plutôt un lieu emprunt
de nostalgie pour ses habitants.
L’industrie sidérurgique s’est installée au fil des
siècles le long de la rivière de la Fensch, dével-
oppant un cordon industriel linéaire en fond de
vallée et recouvrant une grande partie du cours
d’eau.
La sidérurgie occupe ainsi toute la place : elle est
la colonne vertébrale le long de laquelle s’articule
toute la vallée, et elle constitue le patrimoine com-
mun de tous ses habitants.
Si l’industrie subsistante venait à disparaître, que
deviendrait la vallée ? Quels seraient les moyens
à mettre en place pour y générer une nouvelle
attractivité ? Comment pourrait se maintenir une
cohérence territoriale ? Quels seraient les outils
pour aider une communauté à faire le deuil d’une
histoire passée pour mieux se tourner vers autre
chose ?

88

999

10
Elle est située dans le sillon mosellan, axe majeur
de communication et de développement de la Lor-
raine.
Ce qui réunit ces communes est la présence du
cours d’eau de la Fensch, affluent de la Moselle
et colonne vertébrale du développement industriel,
économique et social de la vallée.
Mon envie de départ était de travailler sur un site
à la portée humaine et symbolique très forte, avec
une sensation de confinement, d’enfermement.
Ma question initiale était en effet de savoir si le pay-
sage pouvait permettre de s’échapper. S’échapper
de la pesanteur sociale et physique d’un territoire.
S’échapper au sens d’aller vers autre chose, de
concentrer son regard et son énergie vers un autre
horizon.
En peinture, une échappée, c’est une perspective
entrevue par un espace libre réservé à cet effet.
Le paysage est-il un moyen de créer une possi-
bilité de s’échapper, de s’extraire?
La vallée sidérurgique de la Fensch, dans le nord
lorrain, qui est le lieu de naissance d’Arcelor-Mittal,
m’a permis de traiter cette question.
Située au Sud-ouest de Thionville en Moselle, la
vallée de la Fensch, au-delà de son existence
géographique, est depuis 10 ans une commu-
nauté d’agglomération dont la ville principale est
Hayange.
La vallée de la Fensch, ce sont 10 communes et 70
000 habitants répartis sur 86 km2.
Le choix du sujet

11
Thionville
LUXEMBOURG
TTTThhhhhioooooooThioooonvvvvvvvvvilleeeeeeeeeeeonville

12
Le c
ours
d’e
au d
e la
Fen
sch
à H
ayan
ge

13
L’identité de la vallée s’est forgée autour de l’activité
sidérurgique qui s’y est développée pendant 3 siè-
cles. On a affaire à un paysage très marqué par
l’industrie, mais qui tout à la fois conserve un rap-
port très étroit à la nature, sur lequel je reviendrai.
Investie dans un seul but de production et
d’exploitation, la vallée est aujourd’hui dans une
position délicate : les usines ferment progressive-
ment, Arcelor-Mittal met son personnel (3000 sala-
riés) au chômage technique pour une période d’au
moins 6 mois,... .
Contrairement au bassin minier du Nord où l’activité
industrielle est actée comme révolue et apparte-
nant à l’histoire passée (classement au patrimoine
de l’Unesco, reconversion des terrils, réhabilitation
de certaines usines), dans la vallée de la Fensch il
existe encore une activité industrielle (notamment
Corus Rail, à Hayange, qui fabrique les rails du
TGV, et Arcelor-Mittal dont l’avenir lorrain est plus
qu’incertain).

14

15 L’usine Arcelor-Mittal à Hayange, et
ses hauts-fourneaux inactifs depuis mars 2009

16
On est dans un processus de déclin et de déprise,
mais qui reste chuchoté. On en parle entre proches,
dans le cercle privé, sans que cette fin de la sidéru-
rgie ne soit officiellement et publiquement recon-
nue.
Pour les habitants de la vallée, le travail de deuil
s’enclenche progressivement, même si la chose
n’est pour l’instant pas acceptée.
D’ailleurs, élus et acteurs locaux, dès qu’ils en ont
l’occasion, ressortent leurs casques et chaussures
de mineurs/ouvriers. Tout ici est tourné vers cette
époque glorieuse de la sidérurgie. Que ce soit à
l’échelle collective, avec les ronds-points et au-
tres lieux stratégiques ornementés de chariots de
mineurs, ou que ce soit à l’échelle individuelle,
avec par exemple les clôtures de jardin faites de
bouts de tuyaux ou de morceaux de rails récu-
pérés à l’usine.
Le wagon de la mine comme identifiant à l’entrée de la Cité Bellevue - Hayange

17
Le sujet ici est bien de travailler sur la façon
d’anticiper la reconversion industrielle de la vallée.
D’utiliser les outils du paysage pour permettre
l’amorce, l’ouverture sur une nouvelle dynamique
de territoire.
“Il s’agit de prendre en charge proprement un tra-
vail de version par lequel le territoire va pouvoir
s’exprimer dans un nouveau style et une nouvelle
grammaire.”
Sabine Ehrmann, Cahier thématique n°9 Paysage,
Territoire, Reconversion, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, Paris
La situation socio-économique de la vallée de la
Fensch est en effet assez problématique : plus d’un
tiers des actifs (7 000 personnes) travaille au Lux-
embourg qui offre un plus large panel d’emplois et
de meilleures rémunérations, tandis que 10 % de
la population de la vallée vit en-dessous du seuil
de pauvreté.
Par ailleurs, depuis la crise sidérurgique de la fin
des années 70, la population est en diminution
constante. La vallée a perdu une moyenne de 2 000
habitants par an sur plusieurs années, taux toujours
en baisse mais qui se stabilise aujourd’hui et qui
bénéficie malgré tout d’un solde démographique
positif - nombre de naissances supérieur à celui
des décès.
Il reste cependant à noter un fort vieillissement de
la population et une désertification des jeunes qui
partent pour leurs études puis pour s’installer dans
des endroits où la qualité de vie est meilleure.
Aujourd’hui, la vallée est surtout un espace inter-
médiaire entre le bassin thionvillois tiré par la dy-
namique luxembourgeoise, et le bassin messin qui
s’appuie sur les fonctions administratives, universi-
taires et commerciales de la capitale régionale.

18
L’importance du dynamisme luxembourgeois se
fait de plus en plus forte, puisque le Luxembourg
compte doubler son effectif de travailleurs français
d’ici 2020 (70 000 aujourd’hui contre 140 000 en
2020).
Un projet de reconversion de site industriel situé
à la frontière concerne directement la vallée de la
Fensch : il s’agit de Belval, à Esch-sur-Alzette, qui
compte crée 25 000 emplois d’ici 2015.
Le projet comprend des logements, bureaux, salle
de spectacles, centre commercial, université, etc..
Le site de Belval - Luxembourg : un site industrei reconvertit en pôle d’activités

19
F
L
Thionville
Belval
Vallée de la Fensch
Moselle
7 000 actifs= 10 % de la population
= 1/3 des actifs de la vallée
25 000 emplois d’ici 2015
2009 : 70 000 transfrontaliers2030 : 140 000
20 000 emplois (dont 8 000 industriels)
Légendecommunes luxembourgeoises
cantons français
EFFECTIFS40 à 100
101 à 500501 à 1000
1001 à 3100
moins de 20km des frontières lux.
de 20 à 45 km des frontières lux.
Le travail des frontaliers français vers le Luxembourg
Metz
Hayange
tztetetetetzeeMee
HaHayHaHayaHayangegegeayanayanan eeeaH ngana enggegHa nga e
etzetetetzeeM
Luxembourg
Source : IGSS, Luxem
bourg, 2004.
Thionville
Belval

20
Ces emplois transfrontaliers, même s’ils bénéfi-
cient à l’économie de la vallée (consommation
courante locale, impôts, etc.) posent de nouvelles
problématiques : sur les 70 000 actifs travaillant au
Luxembourg, 90 % utilisent leur voiture pour se ren-
dre au travail, les 10 % restant utilisant le train. Le
principal axe routier, l’A31, se trouve chaque jour
engorgé par ces allers-retours quotidiens, tandis
que le réseau ferré français propose une offre très
limitée en termes de mobilité (seul un TER par jour
se rend à la frontière).
Pour encourager le transport en commun, la Com-
munauté d’Agglomération du Val de Fensch a initié
la mise en place d’un réseau de bus (une vingtaine
Frontières
Lignes de train
Lignes de bus t
Gare
Arrêt de bus
ThionvilleHayange
Metz
Hagondange
Frisange
Volmérange
Hettange
Audun le Tiche
Esch sur Alzette
Bettembourg
Rodange
Longwy
Longuyon
Conflans-Jarny
Montmédy
Luxembourg
Pétange
par jour) permettant de se rendre à Luxembourg
ville en 35 minutes (liaison Thionville-Hayange-
Luxembourg).
Cependant, cette liaison ne dessert que la capitale
luxembourgeoise et ne permet pas d’accéder aux
zones strictement transfrontalières.
Ainsi, on retrouve une très forte concentration des
infrastructures le long du sillon mosellan, entre
Nancy et Luxembourg, sans alternatives réelles de
réseaux secondaires.
Frontières
Lignes de train
Lignes de bus transfontalières
Gare
Arrêt de bus
Le transport en commun transfontalier

21
METZ
THIONVILLE
NANCY
LUXEMBOURG
MOSELLE
Rail + Route
Route
Rail
Aéroport international
Aéroport national
Port fluvial
Plates-formes logistiques
LUXEMBOURG
FRANCE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
ESCH/ALZETTE
HAYANGE
A31
A30
Infrastructures de transport et de logistique le long du sillon mosellan

22
Recherches et références
La promenade verte le long des berges de l’Orne
La vallée de l’Orne se situe à quelques kilomètres
au Sud de la vallée de la Fensch et porte également
les stigmates de 150 ans d’exploitation minière et
industrielle. Depuis 1996, l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine est chargé de mener les opéra-
tions de traitement des espaces les plus dégradés.
L’organisme a défini le traitement des berges de
la rivière et d’espaces publics y attenant comme
moteur de la revalorisation de la vallée. 23 km de
promenade ont ainsi été dessinés par l’atelier Al-
fred Peter, traversant 2 départements et 10 com-
munes.
En plus du ruban de 2,5 m de large qui accompa-
gne le cours d’eau, deux ponts ont été réhabilités,
tandis que 6 passerelles et 3 gués ont été constru-
its.
La promenade longe les jardins ouvriers, traverse
les centres villes, débouche dans des forêts. Son
succès a généré une multitude d’initiatives pub-
liques parallèles telles que ravalement de façades
ou restauration de places.

23
Amnéville se situe en Moselle, le long du sillon mo-
sellan, dans la vallée de l’Orne. La commune faisait
partie des cités sidérurgiques lorraines en déclin et
la question de la reconversion s’est très vite posée
au sein de la municipalité. C’est l’existence d’une
source chlorurée minérale associée à une équipe
municipale convaincue de l’intérêt médical et so-
cial d’une station thermale qui a permis de mettre
en place une stratégie de reconversion.
La commune, sous l’impulsion du maire, entama
à partir de la fin des années 80 un vaste chantier
d’aménagements touristiques : complexe thermal,
casino, zoo, hôtels, restaurants et centre d’art.
L’aménagement le plus spectaculaire reste cepen-
dant les 160 ha de crassier qui séparaient la ville
d’Amnéville et le pôle thermal. La commune en a
fait une station de ski couverte, accompagnée d’un
golf (18 trous) et d’une salle de concert.
Première piste indoor en France, suite à de ré-
cents travaux d’allongement, le « tunnel nival »
d’Amnéville est devenu en terme de domaine ski-
able la plus longue piste indoor au monde avec
620 m contre 400 m à Dubaï. Elle a accueilli en no-
vembre 2008 pour la seconde année consécutive
le championnat de France de ski indoor alpin (70
concurrents) et le 1er championnat international de
ski indoor alpin (24 nationalités).
La reconversion d’un site industriel en zone touristique et de loisirs : Am-néville
Le crassier en 1988, puis son aménagement : salle de concert et parking, centre thermal et golf.

24

25

26
L’histoire sidérurgique de la vallée de la Fensch
remonte au Moyen Age, même si celle-ci reste
avant tout une vallée rurale pendant plusieurs siè-
cles.
Des textes remontant au XIVe siècle font référence
à une mine et plusieurs forges présentes sur la
commune d’Hayange, mais leur essor reste incer-
tain et l’activité est soumise aux fluctuations des
guerres.
Le tournant a véritablement lieu au début du XVIIIe,
lorsque Charles Martin Wendel rachète les forges
d’Hayange. Ce premier personnage de la longue
lignée Wendel va arriver dans la ville comme un
véritable pionnier, faisant de la vallée son domaine
gardé, et fera immédiatement construire un châ-
teau à proximité des forges.
La vallée compte à l’époque environ 5 000 habi-
tants.
Pendant un siècle, la famille Wendel investit, ouvre
des galeries de mines et agrandit les forges. Les
ouvriers sont souvent des paysans qui travaillent à
la mine en famille durant les périodes creuses.
Une forge au début du XVIIIe siècle
Petite histoire de la vallée : la famille Wendel

27
A la fin du XVIIIe, François Wendel, très proche du
mouvement humaniste et des encyclopédistes,
participe à la création du Creusot auprès de la fa-
mille Schneider.
Au milieu du XIXe, les Wendel découvrent la
présence de houille dans l’extrême Est du départe-
ment, aux environs de Forbach, sur la frontière fran-
co-allemande. Cette houille, transformée en coke,
permet une très nette augmentation de la produc-
tion de l’acier. Les Wendel vont donc développer
un second pôle sidérurgique à Petite-Rosselle et
à Stiring-Wendel, installant sur place de grandes
cités ouvrières équipées et modernes.
Cet essor industriel se répercute dans la vallée de
la Fensch : il faut extraire plus de minerai et con-
struire de nouveaux hauts-fourneaux. Le site Saint-
Jacques ou celui de la Paix, la Platinerie, la Fende-
rie sont créés. Toutes ces installations s’étirent le
long du modeste cours d’eau de la Fensch, sur
plus de 17 km.
Les paysans sont priés de choisir entre activité
agricole ou sidérurgique et une grande majorité
d’entre eux décide de rejoindre l’empire Wendel.
La vallée connaît alors une première déprise ag-
Affiche placée à l’entrée des mines
La présence agricole à la fin du XIXe siècle :
le monde paysan va progressivement disparaître au profit de la sidérurgie.

28
Vue panoramique de Knutange et Nilvange au début du siècle : paysage typique de la vallée de la Fensch. Infrastructures, usines
teaux sont boisés.
L’industrialisation de la vallée au début du siècle : le noyau du village est éclaté avec l’apparition des logements ouvriers.
Les installations sidérurgiques : les hauts-fourneaux de Hayange en 1870, le téléphérique d’une douzaine de km reliant les mines
Jacques vers 1850.

29
et habitations s’installent dans le fond de vallée, tandis que les coteaux sont consacrés à l’agriculture et au jardinage. Les pla-
d’Aumetz aux usines de Knutange (transport du minerai), les hauts-fourneaux de Patural à Hayange en 1910 et l’usine Saint-

30
Edification de cités ouvrières à Algrange (ci dessus) et Knutange (ci dessous) à la fin du XIXe siècle.

31
ricole. Les terrains sont rachetés par les Wendel
qui deviennent progressivement propriétaires
de toute la vallée : ils possèdent les usines, les
mines, de nombreux terrains et les nouvelles ci-
tés ouvrières qu’ils font construire à proximité des
lieux de travail.
Parce que la main
d’œuvre locale n’est pas
suffisante, la famille fait
venir de nombreux mi-
grants via des centres de
recrutement créés en Al-
lemagne, Pologne, Italie,
Russie et Ukraine.
Toute une organisation so-
ciale et spatiale se met en
place : des cantines pour
célibataires sont créées, on délimite les quartiers
russes, italiens ou polonais, les cités construites
s’organisent en fonction du grade hiérarchique de
leurs habitants et différents lieux de cultes sont éri-
gés : mosquée à Florange, temple et synagogue
à Hayange.
Les Wendel offrent également de nombreux équipe-
ments : stades, piscines communales, écoles (ils
subventionnent les familles scolarisant leurs en-
fants jusqu’à leur 14 ans), crèches, etc.
Nationalité des mineurs de fer en Lorraine,
document du Musée de la Mine de Neufchef
L’union sportive de Hayange en 1926

32

33

34
Etat des frontières en 1815 Etat des frontières en 1870
Albert Bettannier, Les annexés en Lorraine, 1910. Metz, Musée de la Cour d’Or.

35
Pendant l’annexion, entre 1870 et 1918, la vallée
de la Fensch deviendra littéralement allemande :
les rues changent de nom, la langue officielle de-
vient l’allemand, les Wendel sont écartés de leurs
usines.
Cette situation recommence durant la 2e guerre
mondiale, sous une Allemagne nazie. La rue prin-
cipale d’Hayange prend d’ailleurs le nom d’Adolf
Hitler Strasse et plusieurs habitants sont déportés.
Au lendemain de la guerre, l’activité sidérurgique
reprend de plus belle. 3 nouvelles usines sont
créées sous l’égide des Wendel (Sollac, Sacilor,
Usinor) et les constructions continuent, notamment
dans les endroits plus dégagés : plateaux autour
d’Hayange (Saint Nicolas en Forêt) ou à proximi-
té de la Moselle, à Fameck, où la géographie est
beaucoup plus plane.
Dans les années 1960, la vallée de la Fensch at-
teint les 80 000 habitants et connait son apogée
sidérurgique. Les conditions de travail à l’usine et
dans les mines se sont considérablement amé-
liorées en raison des progrès techniques : mécani-
sation, électricité, carburants.
Cependant, le minerai local, qu’on appelle cour-
amment “minette de Lorraine”, n’est pas un min-
erai de grande valeur : sa concentration en fer est
de 15 % en moyenne, alors qu’on en trouve ailleurs
dont le taux atteint les 30 %.
A partir des années 70, la concurrence étrangère
devient donc de plus en plus forte, tout d’abord
parce que le minerai est de meilleure qualité, mais
aussi parce que le transport de fret à l’échelle inter-
nationale devient courant et enfin parce que dans
Saint-Nicolas en Forêt, sur les hauteurs de Hayange : une cité
ouvrière de 500 logements construite dans les années 50

36
de l’acier par l’Etat aggrave la situation. Cepen-
dant, en 1975, 72 % de l’acier brut français vient de
la vallée de la Fensch.
La famille Wendel tente des associations et des fu-
sions avec d’autres industriels, ce qui donne nais-
sance au groupe Sacilor, mais la Lorraine voit ses
sites fermer progressivement (bassin de Pompey,
Longwy, Forbach). Grèves et manifestations des
mineurs et ouvriers se multiplient et pour sauver
l’activité sidérurgique de la vallée, l’Etat décide de
nationaliser le groupe. A l’époque, le président est
Giscard d’Estaing ; sa femme Anémone est une
descendante Wendel.
De l’argent public est réinjecté dans l’entreprise,
ce qui n’empêche pas la fermeture définitive de
les pays moins développés économiquement par-
lant bénéficient d’une main d’œuvre à moindre
coût.
Les Wendel subissent de plein fouet cette con-
currence. Ils tentent de s’adapter, commencent à
réduire la main d’œuvre, mais la Lorraine reste de
toute façon peu équipée en terme de transport : un
seul axe autoroutier dessert l’Est français, il s’agit
de l’A31, le réseau ferré reste peu développé à
l’échelle européenne et le transport fluvial a depuis
longtemps était mis de côté par l’Etat. Ainsi, le ré-
seau fluvial en Lorraine ne permet pas le transport
des matières et produits finis (acier, pièces auto-
mobiles, etc.).
L’augmentation du prix du pétrole en 1974, la crise
économique qui en découle et le blocage du prix
Les grèves des employés de la sidérurgie en avril 1976.

37
tout le secteur minier au début des années 90 et
l’enfrichement qui commence à s’insinuer sur les
anciens sites industriels de la vallée.
Sacilor devient Arcelor en 2002, mais l’homme
d’affaire indien Mittal lance une OPA agressive
sur le groupe en 2006, promettant le maintien
de l’activité industriel et des emplois en Lorraine.
Sacilor finit par céder.
Comme il fallait s’y attendre, Mittal n’a pas tenu
ses promesses : seul un haut-fourneau reste al-
lumé aujourd’hui, et l’actualité récente va dans le
sens de la fermeture imminente d’Arcelor-Mittal
: les 3 000 salariés de l’entreprise ont été mis au
chômage technique jusqu’en septembre 2009.
Quant aux Wendel, toujours fortement présents
sur la scène économique et financière française,
leur activité s’est déplacée dans l’investissement,
avec la fondation du groupe Wendel Investisse-
ment en 2002, dirigé par Ernest-Antoine Seillière,
également fondateur du syndicat patronal MEDEF
et, forcément, héritier de la famille Wendel.
Wendel Investissement a successivement était ac-
quéreur du groupe Lagardère Editis, du fabricant
de matériel électrique Legrand, de la société Bu-
reau Véritas et possède une minorité de contrôle
auprès de Saint-Gobain.
La famille reste un important propriétaire foncier
dans la vallée : forêts, terrains, bâtiments, même si
la plupart des logements ont été revendus à leurs
habitants, tandis qu’un organisme lorrain, l’EPFL
– Etablissement Foncier Public de Lorraine – ré-
cupère les friches industrielles appartenant à la fa-
La famille Wendel pose, lors de sa réunion annuelle de 2004, pour le magazine Paris-Match au Musée d’Orsay

38
mille (souvent pour le franc symbolique) pour les
dépolluer et les réhabiliter.
Il existe un énorme ressenti de la part des habi-
tants vis-à-vis des Wendel, accusés d’avoir litté-
ralement “abandonné” la vallée sans préavis. Il est
vrai qu’on a affaire à un territoire tenu, développé,
aménagé et pensé par une famille. Qu’on a affaire
à des habitants pris en charge durant des généra-
tions de leur naissance à leur mort, qui vivait dans
une communauté très marquée et particulièrement
fermée (spatialement et en raison du travail effec-
tué) et qui se retrouvent aujourd’hui démunis de-
vant cette fin sidérurgique qui ne fait place à rien.

39
Promenons nous ensemble : l’espace physique de la vallée
Comme dit précédemment, la vallée de la
Fensch est une entité territoriale reposant à la fois
sur une réalité spatiale – un relief creusé par un
cours d’eau – et sur une réalité administrative –
création de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch en 1998 -.
Cependant, je me suis surtout intéressée dans le
cadre de mon travail à la commune de Hayange.
Ceci pour plusieurs raisons : il s’agit tout d’abord
du berceau historique du développement sidéru-
rgique de la vallée – c’est ici que ce sont installés
les Wendel -, cette commune est aujourd’hui re-
connue comme “capitale” de la vallée – c’est la
plus importante en termes d’habitants – et enfin
elle constitue ce que j’appelle le “cœur de vallée”.
Il m’a en effet semblé opportun de diviser la vallée
de la Fensch en 3 secteurs bien définis (repris
des travaux de claire Alliod dans le Plan de Pay-
sage réalisé pour le compte de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, et qui identifiait
5 secteurs) :

40
Hayange
Algrange
Nilvange
Knutange
NeufchefSérémange
Ranguevaux
HAUTE VALLE

41
e
Fameck
Florange
Uckange
EE
BASSE VALLEE
COEUR DE VALLEE

42
La basse vallée, comprenant les communes de Flo-
range, Uckange et Fameck.
Ce secteur possède peu de relief et se trouve à
la confluence de la Fensch et de la Moselle. Il bé-
néficie donc de la proximité du sillon mosellan en
termes d’infrastructures (fluviales, routières, fer-
rées) et de mobilité, que ce soit pour les entrepris-
es ou les particuliers.
Le passé sidérurgique s’y ressent peu, et il n’est
pas déplacé de parler pour cette partie de la vallée
d’une reconversion presque établie : plusieurs
nouvelles zones d’activité s’y sont implantées, ac-
cueillant de nouvelles entreprises – notamment
Thyssen Krupp – et le seul haut-fourneau restant
à Uckange a été classé patrimoine de l’Unesco. Il
constitue aujourd’hui une attractivité touristique de
la vallée.
La basse vallée est le secteur le plus dense (1009
hab/km2) et le plus peuplé (31500 habitants) de la
vallée de la Fensch. La population y est relative-
ment jeune, avec une forte immigration récente
(Afrique du Nord). Une quarantaine de nationalité
est d’ailleurs présente au sein de la commune de
Fameck. La proximité de l’A31 permet aux habi-
tants d’accéder rapidement aux aires d’emplois
que sont Thionville et le Luxembourg.
Page suivante : les grèves chez Arcelor-Mittal - dont le siège social se trouve à Flo-
range - le 1er mai 2009, l’entreprise Thyssenkrupp qui s’est installée sur l’ancien site
de Daewoo à Fameck, et l’affiche 2009 du Festival du Film Arabe de Fameck qui
existe depuis 20 ans.
Le U4 à Uckange, un ancien haut-fourneau
classé patrimoine de l’Unesco et mis en
lumière réalisée par Claude Lévèque.

43
La vallée basse, vue aérienne depuis Hayange

44
Le musée de la mine de Neufchef, seul
d’anciens mineurs
La haute vallée, comprenant Algrange, Knutange,
Nilvange et Neufchef.
Secteur le plus éloigné à l’Ouest du sillon mo-
sellan, la haute vallée est très enclavée. L’industrie
y a presque disparu, sans pour autant faire place
à d’autres activités. Ici, on trouve de nombreuses
friches industrielles et quelques usines désaf-
fectées et abandonnées. Il est à noter la forte
présence de cités ouvrières assez remarquables,
mais il est difficile de s’installer aujourd’hui dans
cette partie de la vallée, que ce soit pour un par-
ticulier ou une entreprise, en raison de la mauvaise
desserte routière et l’inexistence d’alternatives en
termes de mobilité.
De ce fait, la population de ce secteur est vieillis-
sante et connaît une forte baisse démographique
(selon l’INSEE, Algrange a perdu plus de 40 % de
sa population en 50 ans).
Un fait qui m’a beaucoup marqué est la présence
de foyers ukrainiens, russes et polonais en grand
état de délabrement : après renseignements, il
s’agit de “mouroirs” accueillant les immigrés ve-
nus seuls travailler à l’usine ou à la mine et n’ayant
pas de véritables retraites.
Aujourd’hui, une reconversion de site industriel de
60 ha, le site de la Paix, est en projet afin de revita-
liser cette partie sinistrée de la vallée : logements,
parc, équipements et zone d’activité y ont déjà été
programmés.

La vallée haute, vue aérienne depuis Hayange
site touristique de la vallée, créé par Logements ouvriers à Nilvange

46
Le cœur de vallée, comprenant Hayange, Sérémange-
Erzange et Ranguevaux.
Il s’agit de la partie de la vallée qui nous concerne plus
directement.
Ce secteur est, comme dit plus haut, le berceau de
l’histoire sidérurgique de la vallée, et Hayange en con-
stitue la capitale administrative et symbolique.
Lieu charnière entre basse vallée ouverte et haute vallée
enclavée, on y trouve encore 2 importants sites indus-
triels : Corus Rail (fabrication, notamment, des rails de
TGV) et Arcelor-Mittal.
L’organisation spatiale y est spécifique : fond de vallée
encombré (centre ville, industrie, infrastructures, zone
d’activité), coteaux habités et plateaux boisés. J’y revi-
endrai plus loin.
La commune d’Hayange possède l’Office du tourisme
de la vallée et un centre ville relativement dynamique,
avec de nombreux commerces. C’est également la
seule ville de la communauté d’agglomération, avec
Uckange, équipée d’une gare.
C’est sur cette partie de la vallée que s’oriente mon
analyse de site.

47
Le viaduc de l’A30 qui domine Hayange Les bureaux centraux Wendel

48
D’un point de vue géologique, la vallée de la
Fensch est constitutive du plateau lorrain, lui-
même rattaché au bassin parisien. C’est cette
géologie qui a permis l’enrichissement de la
vallée : les réserves ferrifères, inscrites dans les
couches sédimentaires, affleurent au niveau de
Hayange grâce à la faille qui traverse la ville et
qui date des mouvements tectoniques anciens
du massif vosgien voisin.
Le relief de la vallée est peu marqué à l’Est, à la
confluence de la Fensch avec la Moselle, avec
des altitudes comprises entre 160 et 220 m et des
dénivelés maximums de 3 % à Florange, tandis
qu’à l’Ouest, à partir de Hayange, il est relative-
ment encaissé, sous l’action de la Fensch venue
“inciser” le plateau haut d’origine : les altitudes
vont de 180 m (fond de vallée à Hayange) à 420
m (plateaux d’Algrange) avec des dénivelés al-
lant jusque 30 % à Algrange et Hayange.
Il s’agit d’un relief de cuestas : le plateau calcaire
d’origine a été creusé durant la période glaci-
aire par les cours d’eau puissants qu’étaient la
Fensch, l’Orne voisine ou encore la Moselle.
Carte géologique

49
Faille
d’Hay
ange

50

51
Le relief et l’organisation géo-spatiale sur la commune de Hayange
Le relief au niveau de Hayange : c’est la Fensch qui a creusé le fond de la vallée aujourd’hui urbanisé.

52
Quant au cours d’eau de la Fensch, il prend sa
source à Fontoy, à 237 m d’altitude, et rejoint la
Moselle, à 158 m d’altitude, après un parcours de
13,5 km avec une pente moyenne d’environ 0,5%.
Cependant, le bassin versant de la Fensch est
en grande partie imperméabilisé en raison de
l’urbanisation et de l’industrialisation du fond de
vallée. Le tracé de la rivière a été remanié sur pr-
esque toute sa totalité, avec un lit mineur réaména-
gé, couvert ou canalisé pour répondre aux besoins
de l’urbanisation et des implantations industrielles.
De plus, le cours d’eau a longtemps pâti des rejets
des industries avoisinantes.
Aujourd’hui, environ la moitié seulement du cours
d’eau est à ciel ouvert, et sur cette moitié, les berg-
es sont privatisées.
Cette situation concerne également les 4 affluents
de la Fensch : le ruisseau d’Algrange a complète-
ment disparu tandis qu’un court tronçon de la pe-
tite Fensch qui va de Neufchef à Algrange est en-
core perceptible.
Aujourd’hui, seuls le Kribsbach – Ranguevaux à
Florange – et le ruisseau de Marspich – qui rejoint
la Fensch à Sérémange – ont encore une réalité
physique.

53

54
La Fensch dans le centre de Hayange :
ouvert.
Le tracé de la petite Fensch à l’entrée de Neufchef

55
un tronçon de quelques mètres à ciel Les abords privatisés de la Fensch à Nilvange

56
Cette géomorphologie de cuestas, associée
à la présence de minerai de fer, a déterminé
l’organisation spatiale de la vallée, et plus par-
ticulièrement au niveau de Hayange. La principale
caractéristique de cette organisation repose sur la
progression dans les échelles et sur la hiérarchisa-
tion des activités depuis le fond de vallée jusqu’aux
plateaux :
- le fond de vallée comporte les éléments
imposants et structurants, le long ou sur la Fensch
: usines et bâtiments industriels, réseau ferré in-
dustriel, zone d’activité et route départementale.
Ce “cordon” de la Fensch constitue la colonne ver-
tébrale de la vallée.
- le bas de coteau accueille le centre ville
(commerces, administrations et équipements prin-
cipaux) et les quartiers d’habitation, les circulations
sont dédiées à la desserte locale.
- le coteau haut est utilisé pour les nom-
breux jardins familiaux et quelques cités jardins
installées sur les courbes de niveau.
- le plateau est presque entièrement boi-
sé, avec quelques petites poches agricoles sub-
sistantes.
Cependant, cette organisation est à nuancer
puisqu’au milieu du XXe siècle, quelques poches
urbaines ont été créées sur les plateaux. Cette
nouvelle urbanisation, destinée aux ouvriers, suiv-
ait le plan de développement de “l’aire urbaine de
Thionville - Stadtlandschaft Diedenhofen - dessiné
par l’architecte allemand Rudolf Schwarz pendant
la seconde guerre mondiale. Schwarz prônait en
effet l’étalement urbain et un rapport privilégié à
la nature par la construction de petites unités ur-
baines distantes les unes des autres mais relié à
un centre urbain fort.
Ce plan fut appliqué dès la fin de la guerre et une
unité urbaine fut créée sur les hauteurs de Hayange
: il s’agit de Saint-Nicolas-en-Forêt.
D’autres quartiers sur les hauteurs furent dévelop-
pés, comme Marspich ou le Konacker, aujourd’hui
rattachés à Hayange.
Cette extension urbaine a cessé aujourd’hui, même
si un lotissement vient d’être construit à proximité
de Saint-Nicolas-en-Forêt, notamment en raison
de l’absence de foncier disponible sur la com-
mune de Hayange.
La tendance forte en terme paysager concerne
plutôt les coteaux, dont la fonction “tampon” entre
ville et forêt tend à disparaître : au fur et à mesure,
les constructions ont pris de plus en plus de hau-
teurs tandis que la déprise agricole du XXe siècle
a entrainé la disparition des vergers, vignobles et
maraichers sur les coteaux au profit de la forêt.
Ainsi, à travers des cartes montrant l’évolution de
la vallée, on observe très nettement le “grignotage”
progressif des coteaux au profit à la fois de la forêt
et de l’urbanisation, amenuisant l’espace tradition-
nellement dédié aux jardins ouvriers et aux verg-
ers.

57
PLAT
EAU
BO
ISE
CO
TEA
UH
AU
TJA
RD
INE
cité
s ou
vriè
res
jard
ins
fam
iliau
xch
emin
s pi
éton
s
ville
his
toriq
uequ
artie
s ou
vrie
rsco
mm
erce
svo
ies
de d
esse
rte
site
s in
dust
riels
RD
952
cour
s de
la F
esch
quar
tiers
ouv
riers
rése
au fe
rré
frich
es
BA
S D
E C
OTE
AU
UR
BA
NIS
EFO
ND
DE
VALE
EIN
DU
STR
IEL
CO
TEA
U E
T C
RA
SSIE
R
Le coteau de la vigne qui s’est enfriché depuis la disparition des vignobles, et la cité ouvrière Sainte-Berthe au premier plan.
Le fond de vallée encombré par le cordon industriel
La rue du Maréchal Foch à Hayange, principale rue commerçante.
La cité Bellevue et les jardins familiaux sur le coteau Sud de Hayange
Vue depuis Saint-Nicolas-en-Forêt sur les hauteurs de Hayange

58

59
Evolution des masses bâties et boisées entre 1810 et 2005 : le fond de vallée s’urbanise tandis que les pla-
teaux et les coteaux se boisent au fur et à mesure de la déprise agricole.

60
L’enfrichement du coteau de la Vigne, au Nord de Hayange : les vignes et vergers du début du XXe siècle ont laissé place à de la friche.

61
Le coteau Sud, ou côte des Moutons, consacré au paturage et au verger, a laissé place à une densification de l’espace forestier et à l’extension du tissu urbain - lotissements, cités ouvrières et logements collectifs.

62
Le tissu urbain de la vallée s’est développé le long
du linéaire de la Fensch et par voie de conséquence
du cordon industriel. Même si aujourd’hui ce cor-
don est mité en raison de la fermeture progressive
des usines, la structure originelle de la vallée se
ressent encore aujourd’hui.
Le mitage du cordon industriel prend différ-
entes formes : quelques reconversions en zones
d’activité se sont effectuées dans la vallée – les
haut-fourneaux et usines sidérurgiques limitent les
reconversions à des zones d’activité, plateformes
logistiques ou parcs en raison de l’instabilité du sol
(présences de nombreuses cavités souterraines
de stockage remblayées avec des gravats de
chantier) et des pollutions, ainsi que le classement
d’un haut-fourneau qui a permis la création d’un
site patrimonial et touristique à Uckange.
Cependant, l’activité sidérurgique aujourd’hui vac-
illante laisse supposer une désagrégation progres-
sive du cordon industriel, soulevant directement
le problème de l’organisation spatiale de toute la
vallée.
Sur Hayange, l’épaisseur de l’emprise industrielle
(jusque 200 m de largeur sur les 300 m de fond de
vallée) a repoussé l’habitat et certains équipements
sur les limites du fond de vallée et sur les coteaux.
Seul le centre ville, qui comprend la mairie, la place
centrale, les commerces et l’église principale de
la ville, se situe au milieu du fond de vallée. Il con-
stitue une rupture du cordon industriel et c’est par
cet unique “noyau” que communiquent, en termes
de mobilité, les habitants de Hayange.
Etat actuel de l’activité industrielle

63Répartition du type de construction selon la topographie à Hayange

64
Les infrastructures routières et l’accessibilité aux pôles d’activité depuis Hayange

65
En effet, à plus grande échelle, même si Hayange
est relativement bien desservie au niveau routier –
présence d’un échangeur de l’A 30 qui dessert la
ville et d’une route départementale historique qui
permet de relier les différentes communes de la
vallée de la Fensch entre elles -, il peut s’avérer
compliqué, pour les hayangeois, de relier rapide-
ment les pôles d’emplois et d’activités alentour tels
que Esch-sur-Alzette/Belval, Thionville ou Metz au-
trement que par la voiture.
Il existe une gare, complètement excentrée par
rapport au cœur de la ville et difficile d’accès.
Le cordon industriel constitue justement un mur
pour ce type d’équipement puisque la gare se situe
au Nord de la ville qui, elle, s’est plutôt développée
sur le secteur Sud.
Ainsi, pour se rendre à la gare, on est obligé de
passer par le centre de la ville pour ensuite ac-
céder à la gare au Nord.
Pour conclure, l’espace central de Hayange con-
stitue un “nœud” au niveau de la vallée de la
Fensch. Seul lieu de vie qui rompt le cordon indus-
triel, il est en outre le pôle commerçant de la vallée
et possède des qualités spatiales indéniables :
nombreux espaces publics – système de places
et passages piétonniers -, équipements, vie com-
merçante, marché, etc.

66
Façade commerçante
Placette au niveau de la rue du maréchal Foch
Place de la mairie

67
Depuis la cité Gargan : 40 minutes
Depuis la cité Bellevue :30 minutes
Depuis le centre ville :20 minutes
GARE D’HAYANGE = 1 TER / JOUR
Les trajets pour se rendre à la gare depuis différents quartiers

68
Recherches et références
L’OREAM Lorraine – Organisation d’Etudes d’Aménagement des Aires Métropolitaines : la définition d’une métropole lorraine dès la fin des années 60
L’OREAM officia en Lorraine de 1966 à 1970, et
son travail aboutit à la mise en place d’un “Schéma
d’aménagement de la métropole lorraine”. Penser
il y a 40 ans, ce schéma d’aménagement reste
d’une grande actualité et recense des probléma-
tiques encore actuelles sur le territoire.
Le principe général du schéma repose sur la créa-
tion d’une grande métropole lorraine à l’échelle
européenne. Cette orientation implique la mise en
place d’infrastructures répondant à cette ambition
– réseau ferré, viaire et fluvial – ainsi que la défini-
tion de zones de centralité existantes à densifier et
à orienter vers des domaines innovants. Ces zones
de centralité se trouvent le long de l’axe mosellan,
il s’agit de Nancy, Metz et Thionville. L’objectif n’est
pas de créer une aire urbaine longeant la Moselle,
mais au contraire de bien délimiter zones urbaines
et espaces plus naturels.
Voici quelques extraits du Schéma d’aménagement
de la métropole lorraine :
“Le développement de la métropole après 1985 ne
sera certainement pas tel qu’il remette en question
l’option fondamentale retenue : construire la mé-
tropole à partir des villes existantes et non par la
création d’une ville nouvelle ou d’une urbanisation
continue entre Metz et Nancy.
[…]
Deux objectifs principaux doivent être rappelés en
ce qui concerne Metz-Thionville et le Bassin Si-
dérurgique : créer des activités nouvelles qui per-
mettent, outre la solution des problèmes de con-
version industrielle, un développement important,
et promouvoir des services supérieurs accessibles
de tous les points de cette agglomération.
[…]
ORIENTATIONS POUR 2000 : Ménager aujourd’hui
les possibilités futures de développement
N° 7 – Bassin sidérurgique
L’héritage du XIXe siècle industriel et ses prolonge-
ments actuels laissent un passif difficile à résorber.
L’environnement est à ce point dégradé qu’il con-
stitue vraisemblablement un facteur limitant du
développement et étend son influence à l’ensemble
de la région Lorraine.
Cependant, la richesse du support naturel et par-
ticulièrement la présence de boisements assez re-
marquables autorisent à penser que, quelles que
soient les hypothèses de développement de la mé-
tropole, un réaménagement du cadre de vie est pos-
sible et qu’il peut précisément constituer l’un des
atouts de ce développement.
[…]
La restructuration et la rénovation de l’habitat
devraient être basées sur un desserrement systéma-
tique autour des établissements industriels et viser
une association habitat-espace naturel se substitu-
ant à l’ancienne association habitat-usine.”
Extrait du “Schéma d’aménagement de la métro-
pole lorraine”, OREAM Lorraine, Pont-à-Mousson,
1970.

69

70

71

72
Rudolf Schwarz est un architecte urbaniste al-
lemand de la première moitié du XXe siècle très
inspiré par l’idéologie catholique (il consacra sa
thèse aux églises rhénanes).
Travaillant durant la seconde guerre mondiale pour
le IIIe Reich, il fut missionné en Lorraine annexée
pour réorganiser la région de Thionville. Le but était
alors de réaménager le territoire en grand bassin
industriel par la mise en place d’infrastructures
adéquates et de zones résidentielles, mais aus-
si d’évincer progressivement les travailleurs de
souche étrangère – fremdstämmig – au profit de
travailleurs aryens de Lorraine ou de Sarre alle-
mande.
A partir de 1942, Schwarz élabora le concept
nouveau d’une Aire Urbaine de Thionville - Stadt-
landschaft Diedenhofen . Prenant en considéra-
tion que les mineurs parcouraient généralement
de faibles distances, et que les ouvriers sidérur-
gistes venaient au contraire au travail d’assez loin,
Schwarz projeta, au-dedans de son aire urbaine,
à des distances entre un et quatre kilomètres des
usines, de nouveaux noyaux d’habitation de 2500
habitants chacun, composés à 90% de maisons
individuelles avec jardin et en rapport direct avec
la nature avoisinante.
Le projet était basé sur la création de 4 cités –
Siedlungen – majeures dont une se situe au niveau
de Hayange : il s’agit de la Siedlung Volkringen, au
plan très géométrique.
Schwarz conçoit chaque Siedlung comme
“une étoile dans une galaxie” : indépendante
les unes des autres, elles possèdent des lieux
d’habitation et des lieux collectifs, de la vie pub-
lique. L’organisation de ces Siedlungen entre elles
est comparable à une arborescence et rappelle la
nervation des feuilles.
C’est de ce plan urbain nazi que découle
l’organisation spatiale actuelle de la vallée et le
privilège donné à Hayange, ainsi que la création
de poches urbaines en dehors du tissu urbain his-
torique du fond de vallée.
Rudolf Schwarz et le concept de ville-paysage - Stadtlandschaft - appliqué à l’aire urbaine de Thionville

73
Les quatre Siedlungen
du Stadtlandschaft Diedenhofen
La Siedlung Volkringen : on reconnait, en bas du plan, le cordon
industriel de fond de vallée à Hayange.

74

75

76
L’enjeu principal qui concerne la vallée de la
Fensch est bien l’accompagnement d’une transi-
tion, d’un passage vers une nouvelle page d’histoire,
un nouvel horizon social et économique.
On a affaire à un territoire enclavé qui a tendance
à se replier sur lui-même parce que sans réelles
perspectives ni stratégies d’avenir.
Le manque d’horizon concerne à la fois l’avenir
socio-économique de la vallée comme sa con-
figuration spatiale : fond de vallée encombré par
les infrastructures (chemin de fer, routes) et par le
cordon industriel qui coupe la vallée en deux et qui
empêche tout vis-à-vis entre les versants. Cette
situation d’enclavement découle également de
l’enfrichement et du boisement progressif des co-
teaux qui referment plus encore le fond de vallée.
Il s’agit d’un territoire où la situation spatiale fait
écho à la situation sociale : ce constat de repli
s’applique aussi aux gens qui vivent là. Chômage,
pas de perspectives d’avenir après des siècles de
sidérurgie, déprise, …
On étouffe !
Rencontrer les habitants et acteurs de la vallée
m’a permis de comprendre la très forte prégnance
d’une tradition paternaliste, héritée des Wendel,
qui subsiste. Aujourd’hui encore les habitants ne
sont pas capables de reprendre en main leur ter-
ritoire et restent dans une position passive vis-à-vis
des enjeux et de l’avenir de leur vallée – qui pour-
rait se résumer à l’attente de la fermeture du site
Arcelor-Mittal pour aviser de ce qu’il serait possible
de faire ensuite.
Cependant, la présence et la gouvernance de la
vallée par la famille Wendel durant 300 ans a tout
de même laissé des empreintes positives : les
équipements sont nombreux – stades, piscine,
hôpitaux, écoles, etc. -, les cités ouvrières de qual-
ité et le mélange culturel produit par plusieurs gé-
nérations d’immigrés peut être perçu comme une
richesse – peu de territoires peuvent se glorifier
d’une telle tolérance entre différentes communau-
tés qui vivent ensemble.
Ici, la crise, au-delà de l’aspect économique, est
avant tout identitaire : les habitants, d’origines mul-
tiples, se sont justement retrouvés autour d’un en-
commun qu’était la sidérurgie, et le territoire de la
vallée de la Fensch a toujours été associé au Bas-
sin Sidérurgique de Lorraine.
Bernard Lavilliers la chantait en 1976 :
Viens petite bourgeoise demoiselle
Visiter la plage aux de Wendel
Ici pour trouver l’eldorado
Il faut une shooteuse ou un marteau
La vallée d’la Fensch, ma chérie,
C’est l’Colorado en plus petit
Le paysage moteur d’une reconversion

77
Les infrastructures liées à la sidérurgie : réseaux ferré et hydraulique qui s’enchevêtrent à proximité du centre-ville

78
Aujourd’hui, tandis que la sidérurgie se délocalise
– Arcelor a été racheté il y a 3 ans par l’indien Mit-
tal qui transfert progressivement son savoir-faire
local en Inde, et Corus Rail, qui a fourni à la SNCF
l’intégralité des rails utilisés sur la ligne TGV Est, a
été racheté en 2007 par le groupe indien Tata Steel
et pourrait subir le même sort qu’Arcelor – se pose
la question de l’identité de la vallée.
Le rapport au territoire/sol/terre est très particulier
dans la vallée de la Fensch, comme dans d’autres
territoires industriels. Pas de tradition territoriale,
pas de culture ancestrale commune (culinaire, fes-
tive ou autre), pas d’attachement à une terre. Ce
qui faisait vallée et communauté, c’était le fait que
tout le monde allait au “charbon”.
Aujourd’hui, il s’agit donc de créer un paysage ca-
pable de fédérer autour d’une identité renouvelée,
des bouts d’héritage et de population épars, en
misant sur les atouts de la vallée. Retrouver un « en
commun » et un « quelque part », en somme. Que
cette vallée ne soit pas seulement une ancienne
vallée industrielle mais aussi « … ».
Contrairement au bassin houiller du Nord de la
France, à l’histoire similaire, qui subit une déprise
démographique et économique forte, ici de nom-
breux atouts sont présents pour repartir d’un bon
pied.
La vallée de la Fensch possède en effet des atouts
qu’il s’agit peut-être maintenant de valoriser.
Tout d’abord, une situation frontalière. A 20 km du
Luxembourg, 30 km de l’Allemagne et 40 km de
la Belgique, la vallée fait partie de l’euro-région
Saarlorlux qui tente de mettre en œuvre des coo-
pérations transfrontalières en termes d’emplois, de
transports, de développements économiques et
territoriaux.
Aujourd’hui, la vallée de la Fensch n’entre dans au-
cun projet transfrontalier, alors qu’elle est dans une
situation de grande interdépendance avec le Lux-
embourg en ce qui concerne le volet économique
et de l’emploi. Ce qui pose des problèmes de mo-
bilité, puisqu’il n’existe pas de liaison rapide qui
desserve aujourd’hui le Sud du Luxembourg et la
vallée – par la route ou le rail.
Située le long de l’axe mosellan, la vallée pour-
rait bénéficier du dynamisme régional et des
métropoles européennes proches : Metz, Luxem-
bourg, Saarbrücken, etc.
Ensuite, une qualité paysagère. Déjà soulignée par
l’OREAM à la fin des années 60, l’une des spéci-
ficités du lieu est bien l’imbrication qu’il existe en-
tre site et paysage, avec une forte présence de la
forêt. Etymologiquement, Hayange vient de Heiyin-
gen Villa, Hei signifiant “bois enclos”.
Ce rapport entre habitat et forêt est donc ancestral
et reste très ancré dans l’organisation urbaine de
la vallée, notamment au travers des cités ouvrières
construites sur les coteaux, à la lisière de la forêt.
L’espace transfontalier du Saarlorlux

79
La cité Bellevue et les jardins familiaux au Sud de Hayange

80
Ce rapport à la nature se traduit également par
l’usage notable des jardins familiaux sur les co-
teaux, mais aussi par les sentiers qui jalonnent les
communes pour rejoindre les espaces de nature.
Dans Hayange, cette qualité paysagère se lit aussi
par les nombreux espaces publics qui ponctuent la
ville : places, décrochés, passages, petits délais-
sés où des bancs ont été installés, etc.
De façon plus générale, le paysage de cuestas
qu’offre la vallée est en lui-même singulier.
Les enjeux de la vallée pourraient ainsi se résumer
en deux points :
- gérer le patrimoine sidérurgique à court, à moy-
en et à long terme. La question est, comme dans
nombre d’autres cas, de savoir s’il s’agit de le con-
server pour le dédier à un autre usage ou de le lais-
ser disparaître pour permettre l’apparition d’autre
chose. Dans ce cas, quel accompagnement ? Et
surtout comment valoriser une organisation so-
ciale et spatiale ouvrière spécifique sans pour au-
tant glorifier ce qui l’a vaincu, et qui a traumatisé
cet univers ouvrier – l’usine ? Le risque est en effet
de transformer les usines en objets patrimoniaux
alors que le véritable patrimoine de cette vallée, ce
sont ses habitants et la façon dont cette commu-
nauté (j’entends par là aussi bien les Wendel que
les employés de la sidérurgie) s’est construite.
- désenclaver. Il s’agit avant tout de redonner une
lisibilité au paysage de la vallée et que cette nou-
Le marché sur la place de la mairie

81
velle lecture permette d’installer un autre rapport
au territoire. Ce désenclavement passe à la fois
par le regard – mieux voir l’espace dans lequel on
vit, et par le déplacement – possibilité d’entrer et
sortir de la vallée de façon aisée.
- valoriser le cadre de vie. La qualité paysagère
de la vallée constitue l’un de ses atouts majeurs,
mais elle est de plus en plus altérée par des pro-
jets épars qui “diluent” son harmonie : zones
d’activités systématiques sur d’anciennes friches,
lotissements construits sans prise en compte du
site, etc. Il est peut-être temps de prendre soin
de ce territoire et de miser sur les éléments qui lui
sont liés : des villes à taille humaine, des forêts,
des plateaux, des cités jardinées, un cours d’eau.
Valoriser la qualité de vie qu’offre la vallée, c’est
aussi permettre l’arrivée de nouveaux habitants qui
donnent un souffle neuf et la création de nouvelles
façons de vivre ce territoire.

82
Comment tourner une vallée vers autre chose ?
Plusieurs orientations, hypothèses et recherches
ont nourri ma réflexion.
- laisser décroître la haute vallée pour concentrer les énergies sur Hayange
Le postulat de départ est que la vallée est en train
s’enfermer dans une dynamique de déclin : ce
qui la tenait jusqu’à maintenant (industrie tricente-
naire) se désagrège. Il s’agit maintenant de trouver
un autre moyen de faire vivre cette vallée et exister
ce territoire.
Il s’agit aussi de se re-concentrer sur l’essentiel :
une vallée qui se vide, une industrie qui disparaît, et
un potentiel paysager très fort. Le parti est de dire
qu’avec les pôles d’emploi tout proche (Metz, Thi-
onville et Luxembourg), il faut assumer la résiden-
tialisation de cette vallée (avec petits commerces et
équipements), mais surtout d’accepter l’idée d’une
décroissance urbaine. Abandonner ce qui périclite
(les communes-mouroirs de la haute-vallée) pour
mieux se concentrer en termes d’énergies sur ce
qui continue à vivre (la commune d’Hayange).
L’idée est de mettre en valeur ses atouts, en
valorisant la qualité de vie et l’extraordinaire mé-
lange culturel, paysager et historique de ce lieu, et
d’inciter diverses personnes à venir y vivre.
Cela passe par le fait de :
- accompagner la disparition de la haute vallée en
misant sur l’abandon comme gage de qualité spa-
tiale
= Travail sur la gestion des ruines, l’enfrichement
et l’abandon d’une partie de territoire.
- concentrer le projet sur Hayange en valorisant la
qualité de vie
= travail sur la place principale et sur les chemine-
ments qui en partent et qui vont soit jusque sur les
hauteurs de la ville, soit qui passent à travers les
anciennes galeries souterraines encore viables.
Etat actuel de la haute vallée au niveau de Nilvange

83
L’objectif est de donner une identité nouvelle à
la vallée, un nouveau “en commun” à travers les
espaces de cheminements, d’attirer de nouvelles
populations résidentielles (quoi de mieux que
de vivre dans un endroit où tout est concentré :
se promener, faire son marché, découvrir, être au
calme, etc.) françaises et luxembourgeoises et de
faire accepter l’idée que le développement futur de
cette vallée passe par une phase de décroissance
urbaine (en concentrant les énergies sur une ville
et en faisant le choix de laisser disparaitre ce qui
n’a plus de raison d’être).
Les recherches ont porté sur le concept de décrois-
sance urbaine, très développé en Allemagne de
l’est et aux usa (shrinking cities ou schtrumpferde
stadte), dans d’anciennes villes industrielles telles
que Détroit ou Leipzig.
- la conquête des hauteurs : rendre ac-cessible les plateaux boisés et y créer des points de vue privilégiés sur la vallée
Le repli, l’enclavement et le fait de rester bloqué sur
un passé sidérurgique idéalisé fonctionne de paire
avec l’enclavement spatial de la vallée. Il n’y a pas
d’horizon, pas de perspectives, que ce soit sur le
plan économique comme sur le plan paysager.
A ce stade, la première nécessité en termes de
paysage, c’est peut-être déjà de pouvoir s’extraire
de cette vallée pour prendre du recul et en ressaisir
la globalité, l’essence. De pouvoir la dominer phy-
siquement, la VOIR.
Il s’agit d’aller vers le haut, la lumière.
Comment accéder aux hauteurs, avoir des points
de vue sur la vallée (travail de déboisement des
plateaux à certains endroits, mais aussi sur les
cheminements à moitié abandonnés qui existent
Dans 25 ans : la haute vallée se désurbanise progressivement.

84
dans Hayange) ?
Comment avoir une lisibilité de versant à versant ?
Comment travailler la mobilité pour ne pas rester
étouffé dans le fond de vallée ?
Comment s’échapper, pour quelques instants, de
la pesanteur de ce territoire et offrir un nouveau re-
gard sur la vallée ?
L’accessibilité des plateaux pose la question du
futur développement urbain de la vallée : si je tra-
vaille sur les hauteurs, est ce que je veux en faire
des lieux de constructions privilégiés, ou au con-
traire cantonner l’urbanisme en fond de vallée ?
Ma position serait plutôt de cantonner l’urbanisme
en fond de vallée qui devient vivable parce que
justement il y a possibilité de s’échapper sur les
hauteurs.
Seulement, étant donné la situation économique et
sociale du site, rendre accessibles ces hauteurs ne
suffit pas. Qu’est-ce que je peux y proposer ?
Pour moi, ces hauteurs sont associées à quelque
chose de léger, à la fête. Il faudrait y instaurer des
usages nouveaux : jeu de clairières et promon-
toires? Sentier de randonnée? Grandes pelouses
dégagées?
- mettre en place un paysage qui soit le socle, le support d’une nouvelle page de l’histoire de la vallée.
Redéfinir l’identité de la vallée, c’est peut-être tout
simplement travailler avec ses éléments :
l’en-commun de la vallée de la Fensch, ce n’est
plus la sidérurgie, mais la vallée en elle-même. Un
relief, un cours d’eau, des masses boisées et des
poches urbaines de petites tailles et dispersées
dans ce paysage.
Orfeu Negro, Marcel Camus, 1959.
Dans ce film, qui revisite le mythe d’Orphée pendant le carnaval de Rio, les scènes sont tournées soit en fond de vallée, dans
la ville de Rio où tout abonde - les gens, l’alcool, les paillettes, etc. - , soit sur les hauteurs où vivent les pauvres.
C’est ici que se déroule la véritable histoire, loin de la ville étouffante. Là, on domine Rio, on chante, on danse, on joue de la
musique en regardant le soleil se lever.

85
Il s’agit alors de s’extraire du fond de vallée où les
choses se sont accumulées au point de débor-
der - Fensch, forges, voies ferrées, usines, hauts
fourneaux, habitat, routes, ponts, autoroute, etc.,
et tout cela sur une épaisseur allant de 100 à 300
m - et de se tourner vers les hauteurs.
Travailler non plus sur la longueur de la vallée mais
sur son épaisseur, ses liaisons (visuelles et phy-
siques) de versant à versant.
Redévelopper sur les plateaux et les coteaux une
activité agricole disparue (vignes, vergers, cul-
tures), peut-être en s’inspirant du modèle du kib-
boutz israélien : la ferme appartiendrait à un organ-
isme administratif et elle fonctionnerait sur le mode
de l’usine, avec mécaniciens, éleveurs, bergers,
etc.
La production pourrait bénéficier directement à la
collectivité locale (hôpitaux, écoles, et marchés lo-
caux).
Dans le fond de vallée, il s’agit de travailler sur la
mise en place d’un paysage évolutif qui permette
d’aboutir à la disparition progressive du cordon in-
dustriel sur plusieurs décennies.
Ce paysage à long terme n’est pas définitif, il est
justement le socle pour autre chose. C’est une
sorte de mise en réserve.
Scénario envisagé à l’horizon de 2050
1. Remettre en surface la Fensch enterrée.
2. Créer de nouvelles poches urbaines sur les hauteurs (selon le dével-
oppement urbain prôné par Schwarz).
3. Réduire les masses boisées et ouvrir les plateaux à une activité agri-
coledisparue.
4. Travailler les circualtions alternatives, non plus dans le linéaire de la
vallée mais dans son épaisseur (relier les poches urbaines et quartiers à
pied).
5. Mettre en place un “parc de la Fensch” sur l’ancienne emprise sidéru-
rgique avec dépollution des sols et mise en réserve des terrains pour une
autre fonction.

8686

87878787

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
La singularité de Hayange est le contraste offert entre un fond de vallée industriel, marqué par les fu-
mées, le volume des usines, l’odeur très prégnante de brûlé dégagée par les cheminées, et le paysage
environnant de la Moselle, très rural, vallonné, bucolique.
Ce contraste accentue l’impression de dureté du cordon industriel, mais aussi l’enclavement de la ville,
comme s’il s’agissait d’un microcosme, d’un monde parallèle qui possède sa propre organisation. Toute
la ville semble fonctionner autour du noyau des usines.
Qu’est-ce qui rassemble les gens qui vivent là ? Comment supportent-ils au quotidien leur environnement
direct ? Quand l’activité sidérurgique cessera et que les usines disparaitront, que restera-t-il ? Qu’est-ce
qui permettrait de maintenir la spécificité de la vallée – vallée des anges ?
Quel devenir du cordon industriel si l’activité sidérurgique disparaît ?

89
La caractéristique première de la vallée de la Fensch est justement son statut de vallée : à la manière de
l’eau, tout gravite vers le fond et se concentre au niveau le plus bas, c’est-à-dire le thalweg.
On retrouve donc une organisation où industrie et cours d’eau se superposent au point le plus bas, et où
la densité décroit au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la Fensch pour monter sur les plateaux.

90
CONCENTRATION DESSERREMENT
Cette densité ne dépend pas d’un rapport vides/pleins, mais plutôt de volumes et de concentration
d’activités.
Aujourd’hui, c’est bien le cordon industriel qui structure la vallée et qui en a organisé tout le développe-
ment. Lorsqu’on suit le linéaire de la vallée, il constitue une continuité, comme une colonne vertébrale qui
relie le chapelet de villes les unes aux autres.
Industries
Ville
Le linéaire industriel vu depuis le Sud de Hayange : à gauche, le site de Arcelor-Mittal et à droite, celui de Corus Rail.

91
Cités ouvrièresJardins
Bois
DISPERSION

92
Le linéaire industriel est uniquement rompu par le centre ville de Hayange sur environ 1 km (contre les 17
km de cordon industriel). Ce centre ville se retrouve ainsi cerné d’espaces hermétiques qui constituent des
barrières entre les parties Nord et Sud de la ville.M
osel
le
Fens
ch
Hayange
Nilvange
Sérémange-Erzange
Un paysage de transition qui instaure un nouveau rapport au territoire

93
Se pose alors la question du devenir de cette “colonne vertébrale” industrielle si l’activité sidérurgique
disparait. Qu’en reste-t-il ? Quelle armature pour la vallée ? Quelle cohésion spatiale ? Comment faire sub-
sister la dichotomie entre monstres d’acier et paysage rural environnant ?
Comment surtout permettre le passage d’une activité industrielle historique à une autre forme d’occupation
du territoire ? Comment gérer la période de latence, d’un point de vue spatial et humain ?
Deux options sont envisageables.
Tout d’abord, intégrer l’espace industriel devenu disponible au tissu urbain traditionnel et le fondre aux
villes attenantes.
Cette solution précipiterait cependant la disparition du caractère de la vallée.
Hayange
Hayange
Nilvange
Nilvange
Sérémange
Sérémange
Florange
Florange

94
La seconde solution serait de maintenir le linéaire dense du thalweg, en y installant un paysage de transi-
tion qui conserve une unité à l’échelle intercommunale et qui constitue un espace spécifique structurant
pour la vallée.
L’idée est de créer un espace qui conserve un statut particulier, tout en permettant une mise en réserve
foncière pour la création de futures activités.
Il s’agit d’un paysage provisoire, à la temporalité indéfinie – peut-être à l’échelle d’une génération, qui ac-
compagne la disparition progressive des installations liées à l’industrie.
Cette disparition nécessite du temps. Un temps qui permette une mise en jachère, un repos du sol
longtemps exploité. Un temps surtout qui constitue un délai, un sursis pour la communauté de la Fensch
qui s’est constituée autour de cette industrie.
Le temps de faire le deuil et d’envisager autre chose. Le temps de se réapproprier ce morceau de territoire
et de décider de son devenir.
Le cordon industriel rendu disponible et accessible permet trois actions :
1. profiter de l’ouverture de l’espace pour redonner un statut public à la Fensch. Cela passe par la décou-
verture maximale du cours d’eau et l’aménagement de ses berges afin de permettre d’approcher de la
rivière.
2. rendre praticable et traversable l’espace.
3. recycler les installations liées à l’industrie pour de nouvelles fonctions temporaires.
Nilvange
Hayange Sérémange Florange

95
... avec berges accessibles et pièces d’eau.
NilvangeHayange
Sérémange
Florange
La Fensch de demain mise à ciel ouvert...
Nilvange
Hayange Sérémange Florange
Nilvange HayangeSérémange
Florange
La Fensch à découvert aujourd’hui
1. Redonner un statut public à la Fensch

96
GARENilvange
Hayange
Sérémange
GARE
Les routes principales : le cordon industriel
n’est franchissable qu’au niveau du centre
ville de Hayange, rendant compliqués cer-
tains déplacements - notamment l’accès à
la gare.
La seconde solution, plus intéressante, consiste à
maintenir les routes principales telles quelles en renfor-
çant la mobilité par des circulations transversales sec-
ondaires, dédiées aux piétons et aux cyclistes, qui permettent de se déplacer
de quartier à quartier et d’accéder à la Fensch.
Nilvange
Hayange
GARE
Une fois le cordon ouvert, la première solution est de créer des
franchissement réguliers. Cependant, Hayange perd ainsi son
statut de centre.
Nilvange
Hayange Sérémange
Sérémange
2. Rendre Accessible et traversable l’espace.

97
Nilvange
Hayange
Sérémange
3. Recycler les installations industrielles
Les sites industriels en coupe longitudinale
L’idée n’est pas de conserver uniquement les constructions de l’ordre de l’emblèmatique...
... mais plutôt de conserver une continuité spatiale grâce aux volumes.

98
Comment recycler ?
Promenade végétalisée : le
gazoduc et les voies ferrées
deviennent de grandes jar-
dinières de plantation.
Profiter des réseaux de
transport existants pour les
transformer en voies de cir-
culations piétonnes, avec
le gazoduc comme prom-
enade haute.
Réseaux : voirie, gazoduc et
voies ferrées
Manifestations ponctuelles
comme spectacles, cirque,
évènements annuels, etc.
Réutilisation des matériaux
pour créer des espaces
de jeux : structures pour
enfants, acrobranche, par-
cours, etc.
Espaces de jardinage :
vergers, jardins familiaux,
vignes.

99
Les vides industriels : zones de stockage, etc. Les usines
Ferme et étable
Logements collectifs, hôtellerie
Equipements : salle de
spectacle, halle de sport
Activités commerciales et de logistique :
centre commercial, galerie marchande,
artisanat.


101
Le sujet ici est bien d’anticiper la future reconversion du cordon industriel en permettant un réinvestisse-
ment de l’espace par la communauté.
Il ne s’agit pas de prendre en charge tout l’espace, mais de faire se télescoper un passé industriel avec un
futur encore indéfini. De conserver des traces tout en faisant place à de nouveaux rapports au territoire de
la vallée. Il s’agit d’un travail d’acupuncture à partir de ce qui existe.
Pour cela, il est nécessaire de donner un statut public au cordon industriel et de permettre aux gens de
l’arpenter par un réseau de circulations douces. Ces circulations sont un moyen de réappropriation de
l’emprise industrielle par les habitants. S’y promener librement, cela signifie que le statut de cet espace
change et qu’il devient bien public.
Il est également nécessaire de réhabiliter - en le découvrant - le cours d’eau de la Fensch. Ceci parce
que le ruisseau constitue le fil conducteur de la vallée, mais aussi parce cela signifie qu’on passe à autre
chose, qu’aujourd’hui il s’agit de prendre soin du territoire. La Fensch n’est plus utilitaire, elle est la garante
d’un écosystème spécifique et d’une qualité paysagère pour la vallée.
La réhabilitation de la Fensch constitue l’aménagement pérenne du projet. Elle consiste à découvrir le
cours d’eau le long du cordon industriel et à révéler sa présence dans le centre ville d’Hayange. Une zone
de baignade attenante à la Fensch et accessible à tous est également créée en récupérant les cuves de
stockage d’eau d’Arcelor, sur un principe de piscine naturelle.
Une voie ferrée industrielle longeant la Fensch est recyclée en promenade douce, tandis que des circula-
tions piétonnes transversales permettent de traverser le cordon et facilitent la mobilité entre les quartiers
de Hayange et l’accès à la gare. Ces circulations peuvent préfigurer la future trame viaire lors de la phase
de reconversion du site. Il s’agit donc d’un aménagement temporaire pouvant se pérenniser.
Enfin, les installations industrielles – bâtis, réseaux de voies ferrées et zones de stockages – sont réin-
vesties temporairement avant leur destruction et proposent des fonctionnalités multiples : jardins, centre
équestre, résidences d’artistes (théâtres, cirques, studios de cinéma) et toute autre activité nécessitant de
l’espace.

102
Bibliographie
Ouvrages
CLUZET Alain, Ville libérale, ville durable?, Luxembourg, Ed. L’Aube, Coll. “Monde en cours”, 2007, 190 p.
BESSE Jean-Marc, Voir la Terre, Arles, Ed. Actes Sud, Coll. Paysage, 2000, 165 p.
BOURGASSER Alphonse, Hayange ou les métamorphoses d’une ville, Hayange, Editeur Hayange 1993,
182 p.
CERTU, Aménager des rivières en ville, Lyon, Ed. Certu, 2002, 161 p.
CLAUDE Henri, La lorraine vue par les peintres, Metz, Ed. Serge Domini, 2003, 167 p.
Collectif, Atelier Territoire et Industrie n°3 : France(Givors)-Allemagne (Forbach, Saarbrücken), Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-
Etienne, 2008.
DA COSTA GONCALES Michel, GALAND Geoffrey, Se distraire en ville, Paris, coll. Autrement Junior, Ed.
Autrement, 2004, 61 p.
LOHRER Axel, Aménagement et eau, Bâle, coll. Basics, Ed. Birkhauser, 2008, 79 p.
MANTZIARAS Panos, La ville-paysage, Rudolf Schwarz et la dissolution des villes, Paris, Ed. Métis
Presses, Coll. “Vues d’ensemble”, 2008, 296 p.
OREAM Lorraine, Schéma d’aménagement de la métropole lorraine, Pont-à-Mousson, Ed. OREAM, 1970,
211 p.
ROBINSON Alexander, MARGOLIS Liat, Systèmes vivants et paysage, Bâle, Ed. Birkhauser, 2008, 191 p.
STEENBERGEN Clemens, Composing landscape, Bâle, Ed; Birkhauser, 2008, 429 p.
ZIMMERMANN Astrid, Constructing landscape, Bâle, Ed. Birkhauser, 2009, 533 p.

103
Articles, colloques, fiches
BRAUN Pascal, “Une promenade verte requalifie une ancienne vallée industrielle”, Le Moniteur, n°5502,
08 mai 2009, p. 40-42.
FAGNONI Edith, “Amnéville, de la cité industrielle à la cité touristique : quel devenir pour les territoires
urbains en déprise ?”, Mondes en développement, n° 1, vol 32, 2004, p. 51-66.
LELEVRIER Christine, “La mixité sociale et les politiques urbaines”, Dossier pourquoi les villes sont-elles
en crise ?, Passages, n°109-110, Mai-Juin 2001, p. 29-32.
TORNATORE Jean-Louis, “L’invention de la Lorraine industrielle”, Ethnologie française, Tome XXXVII,
février 2005, p. 679-689.
TORNATORE Jean-Louis, “Trou de mémoire, une perspective post-industrielle de la Lorraine sidéru-
rgique”, in DAUMAS Jean-Claude, La mémoire de l’industrie : de l’usine au patrimoine, Cahiers de la MSH
Ledoux, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 49-80.
Documents divers
Les paysages et la trame verte dans les bassins miniers nord lorrains, Metz, Direction Régionale de
l’Environnement de Lorraine, dans les bassins miniers nord lorrains, 2003.
Etude préalable à l’élaboration du Plan de Paysage, Marc Verdier, Nancy, 2005.
Plan de Paysage du Val de Fensch, Agence Claire Alliod, Nancy, 2005-2006.
Dossier de presse du Parc du haut-fourneau U4 à Uckange, saison 2008, Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch, Hayange, 2008.
Consultations Internet
http://www.belval.lu/fr/News/SMOT. SMOT - un nouveau schéma stratégique de mobilité transfrontalière

104
qui facilite la mobilité des frontaliers entre la Lorraine et le Luxembourg, auteurs multiples, licence de
documentation libre, consultable sur le site http://www.belval.lu, 14 janvier 2009, consulté le 28 janvier
2009.
http://transit-city.blogspot.com/search/label/Canyon%20city, Vers de nouvelles formes de ville-jardin, au-
teurs multiples, licence de documentation libre, consultable sur le site http://transit-city.blogspot.com, 14
novembre 2008, consulté le 3 février 2009.
http://transit-city.blogspot.com/search/label/jardin, The farm, the futur of suburbs?, auteurs multiples,
licence de documentation libre, consultable sur le site http://transit-city.blogspot.com, 14 mars 2009,
consulté le 20 mars 2009.
http://www.adrets.net/lieuxtouristiques2.htm, Amnéville : la bifurcation de l’industrie vers le thermalisme,
les loisirs et le tourisme, Edith Fagnoni, licence de documentation libre, consultable sur le site http://www.
adrets.net, consulté le 20 mars 2009.
Filmographie
Camus Marcel, Orfeu Negro, Production : Dispat Films (Paris) Gemma Cinematografica (Rome) Turpan
Filmes (São Paulo), distribution Lux Films, 1959, 105 min.
Merci pour leurs informations et/ou la mise à disposition de leur documentation à :
CAVF
Musée des Mines de Fer de Neuchef
Agence Claire Alliod
Mairie d’Hayange
Association Le Savoir Fer
Espace Archives Arcelor, Florange
AGAPE
EPFL


10610100010000066666666