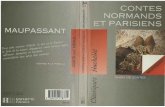m4ker.free.frm4ker.free.fr/74%20eBooks%20Fran%E7ais/Le%20Cl%e9zio,%20...Created Date 20050727122040Z
Transcript of m4ker.free.frm4ker.free.fr/74%20eBooks%20Fran%E7ais/Le%20Cl%e9zio,%20...Created Date 20050727122040Z
-
J.M.G. Le ClézioPoisson d'or
«Quem vel ximimati in ti teucucuitla michin.»
Ce proverbe nahuatl pourrait se traduire ainsi:
«Oh poisson, petit poisson d'or, prends bien garde à toi!
Car il y a tant de lassos et de filets tendus pour toi dans
ce monde.»
Le conte qu'on va lire suit les aventures d'un poisson
d'or d'Afrique du Nord, la jeune Laïla, volée, battue et
rendue à moitié sourde à l'âge de six ans, et vendue à
Lalla Asma qui est pour elle à la fois sa grand-mère et sa
maîtresse. A la mort de la vieille dame, huit ans plus
tard, la grande porte de la maison du Mellah s'ouvre
enfin, et Laïla doit affronter la vie, avec bonne humeur
et détermination, pour réussir à aller jusqu'au bout du
monde.
-
Ce livre vous est proposé par Tàri & Lenwë
A propos de nos e-books : ! Nos e-books sont imprimables en double-page A4, en conservant donc la mise en page du livre original.
L’impression d’extraits est bien évidemment tout aussi possible.
! Nos e-books sont en mode texte, c’est-à-dire que vous pouvez lancer des recherches de mots à partir de l’outil intégré d’Acrobat Reader, ou même de logiciels spécifiques comme Copernic Desktop Search et Google Desktop Search par exemple. Après quelques réglages, vous pourrez même lancer des recherches dans tous les e-books simultanément !
! Nos e-books sont vierges de toutes limitations, ils sont donc reportables sur d’autres plateformes compatibles Adobe Acrobat sans aucune contrainte.
Comment trouver plus d’e-books ? ! Pour consulter nos dernières releases, il suffit de taper « tarilenwe » dans l’onglet de recherche de votre client
eMule.
! Les mots clé «ebook», «ebook fr» et «ebook français» par exemple vous donneront de nombreux résultats.
! Vous pouvez aussi vous rendre sur les sites http://mozambook.free.fr/ (Gratuits) et http://www.ebookslib.com/ (Gratuits et payants)
Ayez la Mule attitude ! ! Gardez en partage les livres rares un moment, pour que d’autres aient la même chance que vous et puissent
trouver ce qu’ils cherchent !
! De la même façon, évitez au maximum de renommer les fichiers ! Laisser le nom du releaser permet aux autres de retrouver le livre plus rapidement
! Pensez à mettre en partage les dossiers spécifiques ou vous rangez vos livres.
! Les écrivains sont comme vous et nous, ils vivent de leur travail. Si au hasard d’un téléchargement vous trouvez un livre qui vous a fait vivre quelque chose, récompensez son auteur ! Offrez le vous, ou offrez le tout court !
! Une question, brimade ou idée ? Il vous suffit de nous écrire à [email protected] . Nous ferons du mieux pour vous répondre rapidement !
En vous souhaitant une très bonne lecture, Tàri & Lenwë
http://mozambook.free.fr/http://www.ebookslib.com/mailto:[email protected]
-
Quand j'avais six ou sept ans, j 'ai été volée. Jene m'en souviens pas vraiment, car j'étais tropjeune, et tout ce que j'ai vécu ensuite a effacé cesouvenir. C'est plutôt comme un rêve, un cau-chemar lointain, terrible, qui revient certainesnuits, qui me trouble même dans le jour. Il y acette rue blanche de soleil, poussiéreuse et vide,le ciel bleu, le cri déchirant d'un oiseau noir, ettout à coup des mains d'homme qui me jettentau fond d'un grand sac, et j'étouffe. C'est LallaAsma qui m'a achetée.
C'est pourquoi je ne connais pas mon vrainom, celui que ma mère m'a donné à ma nais-sance, ni le nom de mon père, ni le lieu où jesuis née. Tout ce que je sais, c'est ce que m'a ditLalla Asma, que je suis arrivée chez elle unenuit, et pour cela elle m'a appelée Laïla, la Nuit.Je viens du Sud, de très loin, peut-être d'un paysqui n'existe plus. Pour moi, il n'y a rien eu
11
1
-
avant, juste cette rue poussiéreuse, l'oiseau noir,et le sac.
Ensuite je suis devenue sourde d'une oreille.Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue,devant la porte de la maison. Une camionnettem'a cognée, et m'a brisé un os dans l'oreillegauche.
J'avais peur du noir, peur de la nuit. Je mesouviens, je me réveillais quelquefois, je sentaisla peur entrer en moi comme un serpent froid.Je n'osais plus respirer. Alors je me glissais dansle lit de ma maîtresse et je me collais contre sondos épais, pour ne plus voir, ne plus sentir. Jesuis sûre que Lalla Asma se réveillait, mais pasune fois elle ne m'a chassée, et pour cela elleétait vraiment ma grand-mère.
Longtemps j'ai eu peur de la rue. Je n'osaispas sortir de la cour. Je ne voulais même pasfranchir la grande porte bleue qui ouvre sur larue, et si on essayait de m'emmener dehors, jecriais et je pleurais en m'accrochant aux murs,ou bien je courais me cacher sous un meuble.J'avais de terribles migraines, et la lumière duciel m'écorchait les yeux, me transperçait jus-qu'au fond du corps.
Même les bruits du dehors me faisaient peur.Les bruits de pas dans la ruelle, à travers le Mel-lah, ou bien une voix d'homme qui parlait fort,de l'autre côté du mur. Mais j'aimais bien lescris des oiseaux, à l'aube, les grincements desmartinets au printemps, au ras des toits. Dans
12
cette partie de la ville, il n'y a pas de corbeaux,seulement des pigeons et des colombes. Quel-quefois, au printemps, des cigognes de passagequi se perchent en haut d'un mur et font cla-quer leur bec.
Pendant des années, je n'ai rien connud'autre que la petite cour de la maison, et lavoix de Lalla Asma qui criait mon nom : « Laï-la ! » Comme je l'ai déjà dit, j'ignore mon vrainom, et je me suis habituée à ce nom que m'adonné ma maîtresse, comme s'il était celui quema mère avait choisi pour moi. Pourtant, jepense qu'un jour quelqu'un dira mon vrai nom,et que je tressaillirai, et que je le reconnaîtrai.
Lalla Asma, ce n'était pas non plus son vrainom. Elle s'appelait Azzema, elle était juiveespagnole. Lorsque la guerre avait éclaté entreles Juifs et les Arabes, de l'autre côté du monde,elle était la seule à ne pas avoir quitté le Mellah.Elle s'était barricadée derrière la grande portebleue et elle avait renoncé à sortir. Jusqu'à cettenuit où j'étais arrivée, et tout avait changé danssa vie.
Je l'appelais « maîtresse » ou bien « grand-mère ». Elle voulait bien que je l'appelle « maî-tresse » parce que c'était elle qui m'avait apprisà lire et à écrire en français et en espagnol, quim'avait enseigné le calcul mental et la géomé-trie, et qui m'avait donné les rudiments de lareligion — la sienne, où Dieu n'a pas de nom, etla mienne, où il s'appelle Allah. Elle me lisait
13
-
des passages de ses livres saints, et elle m'ensei-gnait tout ce qu'il ne fallait pas faire, commesouffler sur ce qu'on va manger, mettre le painà l'envers, ou se torcher avec la main droite.Qu'il fallait toujours dire la vérité, et se laverchaque jour des pieds à la tête.
En échange, je travaillais pour elle du matinau soir dans la cour, à balayer, couper le petitbois pour le brasero, ou faire la lessive. J'aimaisbien monter sur le toit pour étendre le linge. Delà, je voyais la rue, les toits des maisons voisines,les gens qui marchaient, les autos, et même,entre deux pans de mur, un bout de la granderivière bleue. De là-haut, les bruits me parais-saient moins terribles. Il me semblait que j'étaishors d'atteinte.
Quand je restais trop longtemps sur le toit,Lalla Asma criait mon nom. Elle restait toute lajournée dans la grande pièce garnie de coussinsde cuir. Elle me donnait un livre pour que je luifasse la lecture. Ou bien elle me faisait faire desdictées, elle m'interrogeait sur les leçons précé-dentes. Elle me faisait passer des examens.Comme récompense, elle m'autorisait à m'as-seoir dans la salle à côté d'elle, et elle mettaitsur son pick-up les disques des chanteurs qu'elleaimait : Oum Kalsoum, Said Darwich, HbibaMsika, et surtout Fayrouz à la voix grave etrauque, la belle Fayrouz Al Halabiyya, quichante Ya Koudsou, et Lalla Asma pleurait tou-jours quand elle entendait le nom de Jérusalem.
Une fois par jour, la grande porte bleue s'ou-vrait et laissait le passage à une femme brune etsèche, sans enfants, qui s'appelait Zohra, et quiétait la bru de Lalla Asma. Elle venait faire unpeu de cuisine pour sa belle-mère, et surtoutinspecter la maison. Lalla Asma disait qu'ellel'inspectait comme un bien dont elle hériteraitun jour.
Le fils de Lalla Asma venait plus rarement. Ils'appelait Abel. C'était un homme grand et fort,vêtu d'un beau complet gris. Il était riche, ildirigeait une entreprise de travaux publics, iltravaillait même à l'étranger, en Espagne, enFrance. Mais, à ce que disait Lalla Asma, safemme l'obligeait à vivre avec ses beaux-parents,des gens insupportables et vaniteux qui préfé-raient la ville nouvelle, de l'autre côté de larivière.
Je me suis toujours méfiée de lui. Quandj'étais petite, je me cachais derrière les tenturesdès qu'il arrivait. Ça le faisait rire : « Quelle sau-vageonne ! » Quand j'ai été plus grande, il mefaisait encore plus peur. Il avait une façon parti-culière de me regarder, comme si j'étais unobjet qui lui appartenait. Zohra aussi me faisaitpeur, mais pas de la même manière. Un jour,comme je n'avais pas ramassé la poussière dansla cour, elle m'avait pincée jusqu'au sang : « Pe-tite miséreuse, orpheline, même pas bonne àbalayer ! » J'avais crié : «Je ne suis pas orphe-line, Lalla Asma est ma grand-mère. » Elle s'était
14 15
-
moquée de moi, mais elle n'avait pas osé mepoursuivre.
Lalla Asma prenait toujours ma défense. Maiselle était vieille et fatiguée. Elle avait des jambesénormes, cousues de varices. Quand elle étaitlasse, ou qu'elle se plaignait, je lui disais : « Vousêtes malade, grand-mère ? » Elle me faisait metenir bien droite devant elle et elle me regar-dait. Elle répétait le proverbe arabe qu'elleaimait bien, qu'elle disait un peu solennelle-ment, comme si elle cherchait à chaque fois labonne traduction en français :
« La santé est une couronne sur la tête desgens bien portants, que seuls voient les mala-des. »
Maintenant, elle ne me faisait plus beaucouplire, ni étudier, elle n'avait plus d'idées pourinventer des dictées. Elle passait l'essentiel deses journées dans la salle vide, à regarder l'écrande la télévision. Ou bien elle me demandait delui apporter son coffret à bijoux et ses couvertsd'argent. Une fois, elle m'a montré une pairede boucles d'oreilles en or :
« Tu vois, Laïla, ces boucles d'oreilles seront àtoi quand je serai morte. »
Elle a passé les boucles dans les trous de mesoreilles. Elles étaient vieilles, usées, elles avaientla forme du premier croissant de lune à l'enversdans le ciel. Et quand Lalla Asma m'a dit lenom, Hilal, j 'ai cru entendre mon nom, j'ai ima-giné que c'étaient les boucles que je portaisquand je suis arrivée au Mellah.
16
« Elles te vont bien. Tu ressembles à Balkis, lareine de Saba. »
J'ai mis les boucles dans sa main, j'ai replié sesdoigts et j 'ai embrassé sa main.
« Merci, grand-mère. Vous êtes bonne pourmoi.
— Va, va. » Elle m'avait rabrouée. « Mais jene suis pas encore morte. »
Je n'ai pas connu le mari de Lalla Asma, saufune photo de lui qu'elle gardait dans la salle,qui trônait sur une commode, à côté d'une pen-dule arrêtée. Un monsieur à l'air sévère, vêtu denoir. Il était avocat, il était très riche, mais infi-dèle, et quand il est mort, il n'a laissé à safemme que la maison du Mellah, et un peu d'ar-gent chez le notaire. Il était encore vivant quandje suis venue dans la maison, mais j'étais troppetite pour m'en souvenir.
J'avais des raisons de me méfier d'Abel.J'avais onze ou douze ans, exceptionnelle-
ment Zohra avait emmené sa belle-mère dehors,voir un médecin, ou faire des courses. Abel estentré dans la maison sans que je m'en rendecompte, il a dû me chercher à l'intérieur, et ilm'a trouvée dans la petite pièce au fond de lacour, où sont les latrines et le lavoir.
Il était si grand et si fort qu'il bouchait toutela porte, et je n'ai pas pu me sauver. J'étais terri-fiée et je ne pouvais pas bouger de toute façon.Il s'est approché de moi. Il avait des gestes ner-
17
-
veux, brutaux. Peut-être qu'il parlait, maisj'avais mis la tête du côté de mon oreillegauche, pour ne pas entendre. Il était grand,large d'épaules, avec son front dégarni qui bril-lait dans la lumière. Il s'est agenouillé devantmoi, il tâtonnait sous ma robe, il touchait mescuisses, mon sexe, il avait des mains durcies parle ciment. J'avais l'impression de deux animauxfroids et secs qui s'étaient cachés sous mes vête-ments. J'avais si peur que je sentais mon cœurbattre dans ma gorge. Tout d'un coup ça m'estrevenu, la rue blanche, le sac, les coups sur latête. Puis des mains qui me touchaient, quiappuyaient sur mon ventre, qui me faisaientmal. Je ne sais pas comment j 'ai fait. Je crois quede peur j'ai uriné, comme une chienne. Et luis'est écarté, il a enlevé ses mains, et j 'ai réussi àpasser derrière lui, je me suis glissée comme unanimal, j 'ai traversé la cour en criant et je mesuis enfermée dans la salle de bains, parce quec'était la seule pièce qui fermait à clef. J'aiattendu, le cœur battant à toute vitesse, mabonne oreille appliquée contre la porte.
Abel est venu. Il a frappé, d'abord douce-ment, du bout des doigts, puis plus fort, à coupsde poing. « Laïla ! Ouvre-moi ! Qu'est-ce que tufais ? Ouvre, je ne te ferai rien ! » Puis il a dûpartir. Et moi je me suis assise sur le carreau, ledos contre la baignoire de marbre qu'Abel avaitfabriquée pour sa mère.
Après longtemps, quelqu'un est venu derrière
18
la porte. J'entendais des éclats de voix, mais jene comprenais pas ce qu'elles disaient. On afrappé encore, et cette fois j 'ai reconnu la mainde Lalla Asma. Quand j'ai ouvert la porte, jedevais avoir l'air si effrayée qu'elle m'a serréedans ses bras. « Mais qu'est-ce qu'on t'a fait ?Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Je me serrais contreelle, en passant devant Zohra. Mais je n'ai riendit. Zohra a crié : « Elle est devenue folle, voilàtout. » Lalla Asma ne m'a pas posé d'autresquestions. Mais, à partir de ce jour-là, elle nem'a plus laissée seule quand Abel venait à lamaison.
Un jour, alors que j'étais occupée à laver deslégumes à la cuisine pour la soupe de LallaAsma, j'ai entendu un grand bruit dans la mai-son, comme un objet pesant qui frappait le car-reau et faisait culbuter les chaises. Je suis arrivéeen courant, et j 'ai vu la vieille dame par terre,étendue de tout son long. J'ai cru qu'elle étaitmorte et j'allais m'enfuir pour me cacherquelque part, quand je l'ai entendue geindre etgrogner. Elle n'était qu'évanouie. En tombant,elle avait heurté l'angle d'une chaise avec satête, et un peu de sang noir coulait de sa tempe.
Elle était secouée de tremblements, ses yeuxétaient révulsés. Je ne savais pas ce que je devaisfaire. Au bout d'un moment, je me suis appro-chée d'elle, j 'ai touché son visage. Sa joue étaitflasque, bizarrement froide. Mais elle respirait
19
-
avec force, soulevant sa poitrine, et l'air en sor-tant faisait trembloter ses lèvres avec un gar-gouillement comique, comme si elle ronflait.
« Lalla Asma ! Lalla Asma ! » ai-je murmuréprès de son oreille. J'étais sûre qu'elle pouvaitm'entendre, là où elle était. Seulement elle étaitincapable de parler. Je voyais le frémissementde ses paupières entrouvertes sur ses yeuxblancs, et je savais qu'elle m'entendait. « LallaAsma ! Ne mourez pas. »
Zohra est arrivée sur ces entrefaites, et j'étaistellement absorbée par le souffle lent de LallaAsma que je ne l'ai pas entendue venir.
« Idiote, petite sorcière, que fais-tu là ? »Elle m'a tirée si violemment par la manche
que ma robe s'est déchirée. « Va chercher ledocteur ! Tu vois bien que ma mère est au plusmal ! » C'était la première fois qu'elle parlait deLalla Asma comme de sa mère. Comme je res-tais pétrifiée sur le pas de la porte, elle s'estdéchaussée et elle m'a jeté sa savate. « Va !Qu'est-ce que tu attends ? »
Alors j 'ai traversé la cour, j'ai poussé la lourdeporte bleue et j 'ai commencé à courir dans larue, sans savoir où j'allais. C'était la premièrefois que j'étais dehors. Je n'avais pas la moindreidée de l'endroit où je pourrais trouver un doc-teur. Je ne savais qu'une chose : Lalla Asmaallait mourir, et ce serait ma faute, parce que jen'aurais pas su trouver quelqu'un pour la soi-gner. J'ai continué à courir, sans reprendre
20
haleine, le long des ruelles endormies par lesoleil. Il faisait très chaud, le ciel était nu, lesmurs des maisons très blancs.
J'ai tourné d'une rue à l'autre, jusqu'à unendroit d'où l'on voyait le fleuve, et plus loinencore, la mer et les ailes des bateaux. C'était sibeau que je n'ai plus eu peur du tout. Je me suisarrêtée à l'ombre d'un mur, et j 'ai regardé tantque j 'ai pu. C'était bien la même vue que duhaut du toit de Lalla Asma, mais tellement plusvaste. En bas, sur la route, il y avait beaucoupd'autos, de camions, d'autocars. Ça devait êtrel'heure où les enfants allaient à l'école del'après-midi ; ils marchaient sur la route, lesfilles avec des jupes bleues et des chemises bienblanches, les garçons un peu moins bienhabillés, la tête rasée. Ils portaient des cartables,ou des bouquins retenus par un élastique.
C'était comme si je sortais d'un très long som-meil. Quand ils passaient près de moi, il mesemblait les entendre rire et se moquer, et à laréflexion je devais avoir l'air bien étrange,comme si j'arrivais d'une autre planète, avec marobe à la française dont la manche était déchi-rée, et mes cheveux crépus trop longs. Àl'ombre du mur, je devais avoir l'air encore plusd'une sorcière.
J'ai suivi une rue au hasard, dans la directiondes écoliers, puis une autre rue, pleine demonde. Il y avait un marché, des bâches tenduescontre le soleil. À l'entrée d'une maison, un
21
-
vieil homme travaillait dans une échoppe enplanches, assis en tailleur sur une sorte de tablebasse, entouré de babouches. Avec un petit mar-teau de cuivre, il plantait des clous très fins dansune semelle. Comme j'étais arrêtée à le regar-der, il m'a demandé :
« Tu veux une belra ? »Il voyait bien que j'étais pieds nus.« Qu'est-ce que tu veux ? Tu es muette ? »J'ai réussi à parler.«Je cherche un docteur pour ma grand-
mère. »J'ai dit cela en français, puis j 'ai répété en
arabe, parce qu'il me regardait sans com-prendre.
« Qu'est-ce qu'elle a ?— Elle est tombée. Elle va mourir. »J'étais étonnée d'être si calme.« Il n'y a pas de docteur ici. Il y a Mme Jamila,
dans le fondouk, là-bas. Elle est sage-femme.Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose. »
Je suis partie en courant dans la directionqu'il indiquait. Le cordonnier est resté immo-bile, son petit marteau en cuivre levé. Il m'a criéquelque chose que je n'ai pas compris, et qui afait rire des gens.
Mme Jamila vivait dans une maison comme jen'en avais jamais imaginé. C'était un palaisruiné, avec de hauts murs de pisé, et une portedont les deux battants étaient ouverts depuis si
22
longtemps qu'on ne pouvait plus les fermer,bloqués par la boue et les gravats. Sur la façade,des morceaux de crépi indiquaient que la mai-son avait été rose autrefois. Il y avait des fenêtressaillantes en bois et des balcons vermoulus.Malgré mon appréhension, je suis entrée dansla cour.
L'intérieur de la maison de Lalla Asma étaitun monde organisé, rigoureux, d'une propretéexcessive, et j'avais cru que toutes les coursétaient ainsi. Mais ici, à l'intérieur du fondouk,c'était un chaos incroyable. Il y avait des genspartout qui somnolaient à l'ombre des auvents,ou sous quelques acacias maigres. Des chèvres,des chiens, des enfants, des braseros qui seconsumaient tout seuls, et çà et là des tas d'im-mondices que grattaient de vieilles poules sem-blables à des vautours. Contre les murs, toutautour de la cour, à l'abri des auvents, lescommerçants ambulants avaient entassé leursballots et pour mieux les garder s'étaientcouchés dessus. Je ne comprenais pas ce que fai-saient tous ces gens. Je ne savais même pas ceque pouvait être un hôtel. Comme je traversaislentement la cour, hésitant sur la direction àprendre, du haut du balcon intérieur quelqu'unm'a appelée à grands gestes. Éblouie par lesoleil, j 'ai scruté l'ombre de la galerie. J'aientendu une voix claire :
« Qui cherches-tu ? »J'ai vu enfin une femme d'un certain âge,
23
-
vêtue d'une longue robe turquoise. Elle étaitappuyée sur la rambarde, elle fumait en meregardant. J'ai dit le nom de Mme Jamila, et ellem'a fait signe :
« Monte, l'escalier est au fond de la pièce,devant toi. »
Comme je n'avais pas l'air de comprendre,elle a crié :
« Attends-moi. »Elle m'a conduite à travers une grande pièce
obscure, où il y avait d'autres ballots et des gensqui se reposaient. Des vieux jouaient aux domi-nos sur une table basse, un grand narguilé poséà côté d'eux. Personne n'avait l'air de faireattention à moi.
En haut des escaliers, la galerie était éclairéepar des taches de soleil, là où manquaient desvolets. Tout l'étage supérieur était habité pardes femmes étranges. Certaines semblaientjeunes, d'autres avaient l'âge de Zohra, ou plusâgées. Elles étaient grasses, elles avaient le teintclair, les cheveux rougis au henné, les lèvrespeintes et très brunes, les yeux cernés de khôl.Elles fumaient devant les portes des chambres,assises en tailleur par terre. La fumée de leurscigarettes sortait de l'ombre de la galerie et dan-sait au soleil.
«Je vais chercher Mme Jamila. »Je suis restée en haut de l'escalier, un pied
posé sur le sol de l'étage. Je crois que seule lapeur de retourner sans docteur chez Lalla Asma
24
me retenait de partir en courant. Les femmessont venues m'entourer. Elles parlaient fort,elles riaient. La fumée des cigarettes remplissaitl'air d'une odeur douceâtre qui me faisait tour-ner la tête.
Elles caressaient mes cheveux, elles les tou-chaient comme si elles n'en avaient jamais vu depareils. L'une d'elles, une jeune femme auxlongues mains fines, à la gorge chargée de bijoux,a commencé à me faire de petites tresses sur lesommet de la tête, en mêlant du fil rouge à mescheveux. Je n'osais pas bouger.
« Regardez comme elle est jolie, c'est unevraie princesse ! »
Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je medemandais si ces belles femmes, avec tous leursbijoux, leurs fards, ne se moquaient pas de moi,si elles n'allaient pas me pincer, me tirer les che-veux. Elles parlaient vite, à voix basse, et à causede ma mauvaise oreille je ne saisissais pas tousles mots.
Ensuite Mme Jamila est arrivée. J'avais ima-giné une sage-femme grande et forte, avec unvisage rébarbatif, et j 'ai vu arriver une petitefemme fluette, les cheveux courts, habillée àl'européenne. Elle m'a considérée un instant.Elle a écarté les femmes et, comme si elle avaitcompris mon problème d'oreille, elle s'est pen-chée vers ma figure et elle a dit lentement :
« Qu'est-ce que tu veux ?— C'est ma grand-mère qui va mourir. Il fau-
drait que vous veniez la voir chez elle. »
25
-
Elle a hésité. Puis elle a dit :« C'est vrai, je suis là pour les enfants et pour
les grand-mères qui meurent aussi. »Dans les ruelles, elle marchait à grands pas, et
je trottinais derrière elle. Sans elle, je ne seraisjamais parvenue à retrouver mon chemin, maisMme Jamila connaissait la maison de LallaAsma.
Quand nous sommes arrivées à la maison,j'avais le cœur serré. Je pensais que pendanttout ce temps Lalla Asma était morte, et que j'al-lais entendre les cris aigus de sa belle-fille. MaisLalla Asma était vivante. Elle était assise dansson fauteuil, à sa place habituelle, les pieds caléssur une chaise devant elle. Elle avait juste unpeu de sang séché sur la tempe, là où elle avaitdonné de la tête en tombant.
Lalla Asma m'a vue et son regard s'est éclairé.Elle tremblait encore un peu. Elle a serré mesmains très fort. Je voyais qu'elle avait envie deparler, et qu'elle n'y arrivait pas. Je ne savais pasqu'elle m'aimait autant, et tout d'un coup çam'a fait pleurer.
« Ne bougez pas, grand-mère. Je vais vousfaire du thé comme vous aimez. »
Puis j 'ai vu Mme Jamila sur le seuil de la salle.Puisque Lalla Asma n'était pas en train de mou-rir, elle n'avait plus besoin de personne. LallaAsma n'aimait pas que des étrangers entrentchez elle. J'ai dit à Mme Jamila : « Elle va mieuxmaintenant. Elle n'a plus besoin de vous. » Je
26
l'ai accompagnée jusqu'à la porte. J'ai voulu luipayer la visite, avec les dirhams du ménage, maiselle a refusé. Elle a dit, en me regardant bien enface : « Peut-être que tu devrais faire venir unvrai docteur. Il y a quelque chose qui s'est brisédans sa tête, c'est pour ça qu'elle est tombée. »
J'ai demandé : « Est-ce qu'elle reparlera ? »Madame Jamila a secoué la tête. « Elle ne sera
plus jamais comme avant. Un jour, elle retom-bera et elle ne reviendra plus. C'est comme ça.Mais tu dois rester avec elle jusqu'à son derniersouffle. » Elle a répété la phrase en arabe, et jene l'ai pas oubliée : « Kherjat er rohe... »
Zohra est revenue un peu après. Je ne lui aipas parlé de Mme Jamila. Elle m'aurait giflée sielle avait su que tout ce que j'avais pu ramener,c'était une sage-femme d'un vieux fondouk. J'aimenti : « Le docteur dit qu'elle ira mieux, ilreviendra la semaine prochaine. — Et les médi-caments ? Il n'a pas donné de médicaments ? »
J'ai secoué la tête.« Il dit que ce n'est rien. Elle redeviendra
comme avant. »Zohra parlait fort, tout près de l'oreille de
Lalla Asma, comme si elle était sourde.« Vous entendez, mère ? Le docteur a dit que
vous allez bien. »Mais il y avait des mois que Lalla Asma
n'adressait plus la parole à sa bru, et Zohra nes'est rendu compte de rien. Quand elle est par-
27
-
tie, j 'ai aidé Lalla Asma à marcher jusqu'à sonlit. Elle avait une drôle de démarche, sautillantecomme un merle. Et son regard vert étaitdevenu transparent, triste, lointain.
Soudain, j 'ai eu peur de ce qui allait arriver.Jusqu'alors, je ne m'étais jamais posé la questionde ce que je deviendrais quand Lalla Asma neserait plus là. D'être dans cette maison, derrièreles hauts murs, de l'autre côté de la grandeporte bleue, de deviner la ville du haut du toitoù j'accrochais le linge, ça m'avait donné l'idéeque rien de mal n'arriverait jamais.
J'ai regardé ma maîtresse, son vieux visagebouffi où les yeux étaient deux fentes sans cou-leur, et ses cheveux tout rares, blancs sous lehenné.
« Grand-mère, grand-mère, vous ne me laisse-rez jamais ? » Les larmes coulaient sur mesjoues, je ne pouvais plus les arrêter. « N'est-cepas, grand-mère, vous n'allez pas me laisser ? »Je crois bien qu'elle a entendu ce que je luidisais, parce que j'ai vu ses paupières battre, etses lèvres frémir. J'ai mis mes mains entre lessiennes pour qu'elle les serre fort. «Je m'occu-perai bien de vous, grand-mère, je ne laisseraipersonne vous approcher, surtout pas Zohra. Jevous ferai votre thé, je vous donnerai à manger,j'irai vous chercher votre pain et vos légumes.Maintenant, je n'ai plus peur d'aller dehors, onn'aura plus besoin de Zohra. »
Je parlais, et mes larmes n'arrêtaient pas de
28
couler. Je peux dire que c'était la première fois.Moi qui n'avais jamais pleuré pour rien, mêmelorsque Zohra me pinçait jusqu'au sang.
Mais Lalla Asma n'est pas redevenue commeavant. Au contraire, chaque jour, elle s'enfon-çait un peu plus. Elle ne mangeait plus. Quandj'essayais de la faire boire, le thé froid coulait dechaque côté de sa bouche et trempait sa robe.Elle avait les lèvres gercées, crevassées. Sa peaudevenait toute sèche, couleur de sable. Et je doisdire qu'elle faisait sous elle. Elle qui était sipropre, méticuleuse. Je la changeais. Je ne vou-lais pas que Zohra et Abel la voient dans cetétat. J'étais sûre qu'elle avait honte, qu'elle serendait compte de tout. Quand Zohra entraitdans la salle, elle fronçait le nez : « Qu'est-ce quisent mauvais ? » Je lui disais qu'on faisait des tra-vaux dans la maison voisine, on vidangeait lafosse. Zohra regardait Lalla Asma d'un air per-plexe. Elle me grondait : « C'est parce que tu nefais pas bien le ménage, regarde ce désordre. »Elle cherchait à comprendre ce qui n'allait pas.Pour qu'elle ne devine pas l'état de Lalla Asma,je la coiffais le matin, je fardais ses joues avec dela poudre rose, je mettais du beurre de cacaosur ses lèvres. J'installais le plateau de cuivre àcôté d'elle, sur la table, avec la théière et lesverres, et je versais un peu de thé sucré dans lesverres, comme si Lalla Asma avait bu.
Je ne la quittais plus. La nuit, je dormais parterre à côté d'elle, enroulée dans un dessus-de-
29
-
lit. Je me souviens, il y avait des moustiques,toute la nuit j'écoutais leur chanson dans monoreille, et au matin, je me tournais pour dormirun peu. J'oubliais le souffle douloureux de LallaAsma, je rêvais qu'on partait, qu'on prenaitenfin le fameux bateau dont elle parlait tou-jours, de Melilla vers Malaga, et même plus loin,jusqu'à la France.
Une nuit, tout est allé plus mal. Je ne m'ensuis pas rendu compte tout de suite. Lalla Asmaétouffait. Son souffle faisait un ronflement deforge, et au bout de chaque expiration il y avaitun bruit de bulles. Je restais immobile allongéepar terre, sans oser bouger. La chambre étaitnoire, avec un peu de lune dans la cour. Mais jen'aurais pas pu aller dehors. J'attendais, je vou-lais qu'il fasse jour. Je pensais : dès que le soleilse lèvera, Lalla Asma se réveillera, elle cesserade ronfler et d'étouffer avec son bruit de bulles.
C'est moi qui me suis endormie, au petit jour,tellement j'étais fatiguée. Peut-être que LallaAsma est morte à ce moment-là, et que c'estpour ça que j 'ai enfin pu m'endormir.
Quand je me suis réveillée, il faisait grandjour. Zohra était à côté du lit, elle pleurait àhaute voix. Tout à coup, elle m'a vue, et lacolère a tordu sa bouche. Elle m'a donné descoups avec tout ce qu'elle trouvait, une serviette-éponge, des revues, puis elle s'est déchausséepour me frapper et je me suis sauvée dans lacour. Elle criait : « Misérable, petite sorcière !
30
Ma mère est morte et toi tu dors tranquille-ment ! Tu es une meurtrière ! » Je me suiscachée à la cuisine, sous une table, commequand j'étais petite. Je tremblais de peur. Heu-reusement, une voisine est arrivée à ce moment-là, alertée par les cris. Puis Abel est arrivé luiaussi, et ils ont calmé Zohra. Elle avait un cou-teau à la main, comme si elle voulait me tuer.Elle criait encore : « Sorcière ! Meurtrière ! » Ilsl'ont fait asseoir dans la cour, ils lui ont donnéun verre d'eau.
Moi, je me suis glissée hors de la cuisine, j 'aitraversé la cour à quatre pattes, le long du murà l'ombre. J'étais pieds nus, je n'avais que larobe froissée dans laquelle j'avais dormi, les che-veux ébouriffés, je devais vraiment avoir l'aird'une meurtrière.
J'ai réussi à me faufiler par la grande portebleue qui était restée entrouverte. Puis je mesuis mise à courir dans les rues, comme le jouroù j'étais allée quérir la sage-femme. J'avais trèspeur qu'ils ne me rattrapent et me mettent enprison pour avoir laissé mourir Lalla Asma.
C'est comme cela que j 'ai quitté sans retour lamaison du Mellah. Je n'avais rien, pas un sou,j'étais pieds nus avec ma vieille robe, et jen'avais même pas la paire de boucles d'oreillesen or, mes croissants de lune Hilal, que LallaAsma avait promis de me laisser en mourant. Jeme sentais encore plus démunie que le jour oùles voleurs d'enfants m'avaient vendue à LallaAsma.
-
Le fondouk était bien différent de tout ce quej'avais connu jusqu'alors.
C'était une maison ouverte aux quatre vents,située dans une rue passante encombrée decamionnettes, d'autos, de motocyclettes. Lemarché était à deux pas, une grande bâtisse enciment où on trouvait tout ce qu'on voulait, dela viande de boucherie, des légumes aussi bienque des babouches, des tapis ou des seaux enplastique.
En quittant la maison de Lalla Asma, je ne savaispas où aller. Je ne savais qu'une chose, c'est que jedevais me cacher dans un endroit où Zohra et Abelne me retrouveraientjamais, même s'ils envoyaientla police à ma recherche. Je trottais le long des ruesà l'ombre, je rasais les murs comme un chat perdu.Dans ma tête résonnaient les cris de Zohra : « Sor-cière ! Meurtrière ! » J'étais sûre que si elle me rat-trapait, elle me ferait mettre en prison. Malgré moi,mes pas m'ont dirigée vers la rue où j'avais cherché
32
un docteur pour Lalla Asma. Quand j'ai reconnu labâtisse, avec sa grande porte à deux battants grandsouverts, mon cœur a bondi de joie. Là, j'étais sûreque Zohra ne pourrait pas me trouver.
Mme Jamila n'était pas dans le fondouk. Elleavait été appelée quelque part pour une urgence.Alors je me suis assise sagement sur le balcon, ledos contre le mur, et je l'ai attendue à côté de saporte.
La première fois que j'étais venue, j'étais troppressée, je n'avais pas eu le temps de regarderce qui se passait dans l'hôtel. Maintenant, jedétaillais tout : les gens qui entraient et sor-taient sans cesse de la cour, les colporteurs enhaillons chargés comme des baudets, les mar-chands qui déposaient leurs ballots sous lesarcades. Il y avait des marchands de légumes,des marchands de dattes, et des jeunes gensqui apportaient des cargaisons bizarres en équi-libre sur leurs bicyclettes, des cartons de jouetsen plastique, des cassettes de musique, desmontres, des lunettes noires. Je connaissaistoutes leurs marchandises, parce que souvent ilsvenaient frapper à la porte de Lalla Asma, etcomme elle ne pouvait plus sortir faire descourses, elle leur faisait déballer leurs articlesdans la cour, et elle leur achetait des chosesdont elle n'avait pas besoin, des stylos, dessavonnettes, ce qui mettait sa bru en colère :« Mère, qu'est-ce que vous allez en faire ? » LallaAsma hochait la tête : « Peut-être qu'un jour je
33
2
-
serai contente d'avoir acheté ça. » Jamais jen'aurais imaginé que les vendeurs à la sauvettepouvaient se retrouver dans un endroit commecette cour.
L'étage était habité par les jeunes femmesque j'avais vues la première fois, si élégantes etbelles, que dans ma naïveté je les prenais pourdes princesses. Pour l'heure, elles dormaientencore dans les chambres, derrière les hautesportes entrebâillées.
En scrutant à travers la fente, j 'ai vu une desprincesses couchée sur un grand lit. Au boutd'un instant, j 'ai distingué sa forme. Elle étaitcouchée toute nue sur les draps, le visage recou-vert par ses cheveux, et j 'ai été étonnée de voirson ventre très blanc, et son pubis entièrementépilé. Je n'avais jamais rien vu de tel. Lalla Asmane m'emmenait jamais aux bains, et jusqu'auxderniers temps, elle ne voulait pas que je la voiedévêtue. Et mon corps maigre et noir ne ressem-blait pas du tout à cette chair si blanche et à cesexe endormi. Je crois que je me suis reculée,un peu effrayée, de la sueur au creux despaumes.
J'ai attendu longtemps sous la galerie, enconcentrant mon attention sur le va-et-vient desmarchands dans la cour. Je n'avais rien mangédepuis la veille, j'avais très faim, et je mourais desoif.
En bas, dans la cour, il y avait un puits, etj'avais repéré sous les arcades un ballot de fruits
34
secs entrouvert où les moineaux venaient pico-rer. Je me suis glissée par les escaliers jusqu'auballot. J'avais un peu honte, parce que LallaAsma m'avait toujours dit qu'il n'y a rien de pireque de voler autrui, moins à cause de ce qu'onlui prend qu'à cause de la tromperie. Maisj'avais faim, et les belles leçons de Lalla Asmaétaient déjà loin.
Je me suis accroupie à côté du sac ouvert, etj 'ai mangé des dattes et des figues séchées et despoignées de raisins secs que j'extrayais d'unemballage en plastique. Je crois que j'auraismangé la plus grande partie du ballot, si le pro-priétaire des marchandises n'était pas arrivésilencieusement, par-derrière, et ne m'avait pasattrapée. Il me tenait de la main gauche par lescheveux, et de l'autre brandissait une courroie :« Petite négresse, voleuse ! Je vais te montrer ceque je fais aux gens de ton espèce ! » Je me sou-viens que ce qui me mortifiait le plus, ce n'étaitpas d'avoir été prise sur le fait, mais la façon quele marchand avait d'accrocher ses doigts dansl'épaisseur de mes cheveux et de m'appeler :« Saouda ! » Parce que c'était quelque chosequ'on ne m'avait jamais dit, même Zohra quandelle était en colère. Elle savait que Lalla Asmane l'aurait pas supporté.
Je me suis débattue et, pour lui faire lâcherprise, je l'ai mordu jusqu'au sang. Je lui ai faitface et je lui ai crié : «Je ne suis pas une voleu-se ! Je vous paierai ce que j'ai mangé ! »
-
Au même moment, Mme Jamila est arrivée, etles dames de l'étage se sont penchées au balconet ont commencé à invectiver le marchandambulant, en lui criant des injures que je n'avaisjamais entendues. Et même l'une des prin-cesses, ne trouvant rien de mieux comme pro-jectiles, lui lançait des piécettes de dix ou vingtcentimes en lui criant : « Tiens, voilà ton argent,voleur, fils de chien ! » Et lui restait hébété,reculant sous les lazzis des femmes et sous lapluie des piécettes, jusqu'à ce que Mme Jamilame prenne par le bras et m'emmène avec ellevers l'étage. Je crois que j'avais encore dans lesmains les poignées de raisins secs que je n'avaispas lâchées, même quand le marchand m'avaittirée par les cheveux et m'avait battue avec sacourroie.
Mais j'avais si peur tout à coup, ou bien c'étaitl'accumulation de tout ce qui était arrivé cesderniers temps, avec Lalla Asma qui était tom-bée sur le carreau et Zohra qui m'avait chasséeen me volant les boucles d'oreilles qui m'appar-tenaient. Je me suis mise à pleurer dans l'esca-lier, si fort que je n'arrivais plus à monter lesmarches. Et Mme Jamila qui n'était pas plusgrande que moi m'a vraiment portée jusqu'enhaut comme si j'étais un petit enfant. Elle répé-tait contre mon oreille : « Ma fille, ma fille », etmoi je pleurais encore plus, d'avoir le mêmejour perdu ma grand-mère et trouvé unemaman.
36
En haut de l'escalier, les princesses (car c'estainsi que je les appelais au fond de moi, mêmequand j'ai compris qu'elles n'étaient pas préci-sément des princesses) m'attendaient avec millecaresses et démonstrations d'amitié. Elles m'ontdemandé mon nom, et elles le répétaient entreelles : Laïla, Laïla. Elles m'ont apporté du théfort et des pâtisseries au miel, et j 'ai mangé tantque j'ai pu. Ensuite elles m'ont fait un lit dansune grande chambre sombre et fraîche, avecdes coussins disposés par terre, et je me suisendormie tout de suite dans le brouhaha del'hôtel, bercée par le grincement de la musiqued'un poste de radio dans la cour. C'est ainsi queje suis entrée dans la vie de Mme Jamila la fai-seuse d'anges et de ses six princesses.
-
Ma vie au fondouk s'organisa de façon remar-quablement calme, et je peux dire sans exagérerque ce fut la période la plus heureuse de monexistence. Je n'avais aucune astreinte, aucunsouci, et je trouvais dans la personne deMme Jamila et des princesses tout l'agrément ettoute l'affection dont j'avais été privée jusque-là.
Quand j'avais faim, je mangeais, quand j'avaissommeil, je dormais, et quand je voulais sortir(ce qui arrivait presque constamment), je sor-tais, sans avoir à demander quoi que ce soit. Laliberté parfaite dont je jouissais au fondouk étaitcelle des femmes dont je partageais l'existence.Elles n'avaient pas d'heures, donc elles étaientheureuses. Elles m'avaient adoptée comme sij'étais leur fille, ou plutôt une poupée, une trèsjeune sœur, et d'ailleurs c'est comme celaqu'elles m'appelaient. Mme Jamila disait : « Mafille. » Fatima, Zoubeïda, Aïcha, Selima, Houriyaet Tagadirt disaient : « Petite sœur. » Mais Taga-
38
dirt disait parfois aussi « Ma fille » parce que, envérité, elle avait l'âge d'être ma mère. Je dor-mais tour à tour dans chaque chambre occupéepar deux princesses, sauf Tagadirt qui avait lagrande chambre sans fenêtre où j'avais dormi lapremière fois. Mme Jamila avait un apparte-ment de l'autre côté de la galerie, avec unefenêtre sur la rue. Je dormais là aussi quelque-fois, mais plus rarement, à cause des occupa-tions de Mme Jamila et de son cabinet deconsultations où elle hébergeait des femmes quiavaient un problème de bébé. Quand elle avaitdes patientes, je savais qu'il ne fallait pas allerfrapper chez elle. Ces soirs-là, elle fermait laporte avec un loquet, et je voyais à travers lestentures le falot qu'elle laissait allumé dans lecabinet. C'était un signal que j'avais vitecompris.
Les princesses m'aimaient bien. Elles mechargeaient de leurs commissions, de leursaffaires. J'allais leur chercher du thé dans lacour, ou bien je leur achetais des gâteaux aumarché, des cigarettes. Je portais leur courrier àla poste. Quelquefois elles m'emmenaient avecelles faire des courses en ville, non pas pour por-ter leurs sacs (pour cela elles avaient toujoursdes petits garçons), mais pour que je les aide àacheter, que je discute les prix. Lalla Asmam'avait appris à acheter, en marchandant avecles colporteurs qui frappaient à sa porte, etj'avais bien retenu les leçons.
39
3
-
Zoubeïda aimait bien aller avec moi aumarché des tissus. Elle choisissait des coton-nades pour une robe, pour un dessus-de-lit. Elleétait grande et mince, avec une peau couleur delait et des cheveux d'un noir de jais. Elle se dra-pait dans le tissu, elle avançait dans la lumière :« Comment tu me trouves ? » Je prenais montemps pour répondre. Je disais sérieusement :« C'est bien, mais un bleu sombre t'iraitmieux. »
Les marchands me connaissaient. Ils savaientque je discutais âprement, comme si c'était moiqui payais. Ils ne pouvaient pas me tromper surla qualité, cela aussi, je l'avais appris de LallaAsma. Un jour, j 'ai empêché Fatima d'acheterune breloque en or et turquoise.
« Regarde, Fatima, ce n'est pas une vraiepierre, c'est un bout de métal peint. » Je l'ai faittinter contre mes dents. « Tu vois ? Il n'y a riendedans. » Le marchand était furieux, maisFatima l'a mouché : « Tais-toi. Ma petite sœurdit toujours la vérité. Estime-toi heureux que jene t'envoie pas devant le juge. »
À partir de ce jour-là, les princesses ontredoublé d'attentions envers moi. Elles racon-taient mes exploits à tout le monde, et mainte-nant même les marchands ambulants du fon-douk me saluaient avec respect. Ils venaientauprès de moi pour me demander d'intervenirauprès de telle ou telle, ils essayaient de m'ache-ter en me faisant des cadeaux, mais je n'étais
40
pas dupe. Je prenais les bonbons et les gâteaux,et je disais à Fatima ou à Zoubeïda : « Méfie-toide lui, il est certainement malhonnête. »
Mme Jamila savait tout ce qui se passait. Ellen'en parlait pas, mais je voyais bien qu'ellen'était pas satisfaite. Quand je partais faire unecourse, ou quand une des princesses m'emme-nait dehors, elle me suivait du regard. Elle disaità Fatima : « Tu l'emmènes là-bas ? » Comme unreproche. Ou bien elle essayait de me retenir,elle me donnait des devoirs à faire, des pagesd'écriture, du calcul, des sciences naturelles.Elle voulait m'apprendre à écrire en arabe, elleavait des ambitions pour moi.
Mais je ne faisais pas très attention à cequ'elle voulait me dire. J'étais ivre de liberté,j'avais vécu enfermée trop longtemps. J'étaisprête à me sauver si quelqu'un avait voulu meretenir.
Encore aujourd'hui j 'ai du mal à croire queles princesses n'étaient pas des princesses. Jem'amusais avec elles. Il y avait surtout Zoubeïdaet Selima qui étaient jeunes. Elles étaient insou-ciantes, elles riaient tout le temps. Elles venaientde villages de la montagne, elles s'étaient échap-pées. Elles vivaient entourées d'un tourbillond'hommes, elles montaient dans de belles voi-tures américaines qui venaient les chercher à laporte du fondouk. Je me souviens, un soir,d'une longue auto noire avec des vitres teintées,qui portait deux drapeaux sur les ailes, des dra-
41
-
peaux vert, blanc et rouge, avec du noir aussi.Tagadirt m'a dit : « C'est un homme puissant etriche. » J'essayais de voir à l'intérieur de l'auto,mais les vitres noires ne laissaient rien filtrer.« C'est un roi ? » Tagadirt a répondu sans semoquer de moi : « C'est quelqu'un d'importantcomme un roi. »
J'aimais bien le visage de Tagadirt. Elle n'étaitplus très jeune, elle avait des rides bien mar-quées au coin de l'œil, comme si elle souriait, etelle avait la peau très brune, comme moi,presque noire, avec de petits tatouages marquéssur le front. Avec elle, j'allais aux bains deux foispar semaine. C'était au bord de l'estuaire, prèsde l'embarcadère. Tagadirt me donnait unegrande serviette, elle prenait un sac avec desaffaires propres, et nous partions ensemble. Dutemps de Lalla Asma, je n'avais pas l'idée qu'unendroit pareil puisse exister, et je n'auraisjamais imaginé me mettre toute nue devantd'autres femmes.
Tagadirt n'avait aucune pudeur. Elle allait etvenait devant moi sans vêtements, elle frottaitson corps avec des pierres ponces, elle se fric-tionnait avec des gants de crin. Elle avait desseins lourds aux mamelons violets, et sur seshanches et sur son ventre sa peau faisait desreplis. Elle s'épilait avec soin le pubis, les ais-selles, les jambes. À côté d'elle je paraissais unenégrillonne malingre, et malgré tout, je ne pou-vais pas m'empêcher de cacher mon bas-ventreavec une serviette.
42
Tagadirt voulait que je lui masse le dos et lanuque avec de l'huile de coprah qu'elle achetaitau marché, qui répandait un parfum écœurantde vanille. Dans la grande salle de bainscommune, les nuages de vapeur glissaient au-dessus des corps, il y avait un bruit de voix, descris, des exclamations. Des petits garçons toutnus couraient le long de la vasque d'eau chaudeen glapissant. Tout cela me faisait tourner latête, me donnait la nausée.
« Continue, Laïla. Tu as les mains dures, çame fait du bien. »
Je ne savais pas si j'aimais cela. Je continuais àfaire pénétrer l'huile dans la peau du dos deTagadirt, je respirais l'odeur de la vanille et dela sueur. Puis, pour me réveiller, Tagadirt m'as-pergeait d'eau froide, elle riait quand jem'échappais, mes poils hérissés sur tout moncorps.
J'étais devenue la mascotte du fondouk.C'était peut-être pour cela que Mme Jamilan'était pas contente. Elle devait penser quej'étais trop caressée et flattée par les princesses,et que cela risquait de gâter mon caractère.
À force d'entendre ces femmes s'extasier surmoi à longueur de journée : « Ah ! qu'elle estjolie ! », et me déguiser selon leur fantaisie, jefinissais par les croire. Je me prêtais avec vanitéà leurs caprices. Elles m'attifaient de robeslongues, elles peignaient mes ongles en vermil-lon, mes lèvres en carmin, elles me maquil-
43
-
laient, dessinaient mes yeux au khôl. Selima, quiavait du sang soudanais, s'occupait de ma coif-fure. Elle divisait mes cheveux par petits carrés,elle les tressait avec du fil rouge ou avec desperles de couleur. Ou bien elle les lavait avec dusavon de coco pour les rendre plus secs etgonflés qu'une crinière de lion. Elle me disaitque ce que j'avais de mieux, c'étaient mon frontet mes sourcils merveilleusement longs etarqués, et mes yeux en amande. Peut-êtrequ'elle me disait cela parce que je lui ressem-blais.
Tagadirt dessinait mes mains avec du henné,ou bien elle traçait sur mon front et sur mesjoues les mêmes signes qu'elle portait, en utili-sant un brin de paille trempé dans du noir delampe. Elle m'apprenait à jouer de la darbouka,en dansant au milieu de sa chambre. Quandelles entendaient le bruit des petits tambours,les autres femmes arrivaient, et je dansais pourelles, pieds nus sur le carrelage, en tournant surmoi-même jusqu'au vertige.
C'était à ces enfantillages que je passais laplus grande partie de l'après-midi. Le soir, lesprincesses me congédiaient pour recevoir leursvisites, ou bien j'allais dans la chambre de cellesqui sortaient en auto. Mme Jamila me débar-bouillait avec un coin de serviette mouillé :« Qu'est-ce qu'elles t'ont encore fait ! Elles sontfolles. » Avec mes cheveux hérissés, le khôl quiavait coulé et le rouge à lèvres qui débordait, je
44
devais ressembler à une poupée ratée, etMme Jamila ne pouvait pas s'empêcher de rirede moi. Je m'endormais bercée par le tourbillondes souvenirs de ces journées si longues, silongues que je ne parvenais plus à me souvenircomment elles avaient commencé.
Celle qui avait ma préférence, c'était Houriya.C'était la plus jeune, la dernière venue au fon-douk. Elle était arrivée juste quelques joursavant moi. Elle venait d'un village berbèreéloigné, du Sud. Elle avait été mariée à unhomme riche de Tanger qui la battait et la pre-nait de force. Un jour, elle avait préparé unepetite valise, et elle s'était sauvée. C'est Tagadirtqui l'avait ramassée dans une rue près de la gareet l'avait ramenée ici, pour qu'elle puisse secacher et échapper aux envoyés de son mari.Mme Jamila se méfiait. Elle avait dit oui, mais àcondition que Houriya s'en aille dès que le dan-ger serait passé. Elle ne voulait pas d'ennuisavec la police.
Houriya était petite et mince, elle avaitpresque l'air d'une enfant. Nous sommes vitedevenues amies, et elle m'emmenait partoutavec elle, même le soir dans les restaurants et lesboîtes. Elle me présentait à ses amis comme sapetite sœur. « C'est Oukhti, ma sœur. N'est-cepas qu'elle me ressemble ? »
Elle avait un joli visage régulier, des sourcilsbien dessinés et les plus beaux yeux verts que
45
-
j'aie jamais vus. Je ne lui posais pas de questionssur sa façon de gagner de l'argent. Je pensaisqu'elle recevait des cadeaux parce qu'elle savaitdanser et chanter, parce qu'elle était jolie. Jen'avais aucune idée de ce que c'était qu'unmétier, de ce qui était bien et de ce qui étaitmal. Je vivais comme un petit animal domes-tique, je trouvais bien ce qui me flattait et mecaressait, et mal tout ce qui était dangereux etme faisait peur, comme Abel qui me regardaitcomme s'il voulait me manger, ou Zohra qui mefaisait rechercher par la police en racontant quej'avais volé sa belle-mère.
Ce qui me faisait le plus peur, c'était la soli-tude. Quelquefois, dans mon sommeil, je revi-vais ce qui s'était passé il y a très longtemps,quand on m'avait volée. Je voyais la lumière surune rue très blanche, j'entendais le cri féroce del'oiseau noir. Ou bien j'entendais le bruit del'os qui craquait dans ma tête quand le camionm'avait cognée.
Alors je me glissais dans le lit de Houriya, et jeme serrais très fort contre elle, je m'accrochais àson dos comme si j'allais m'évanouir. C'est ellequi m'a parlé la première fois de mes origines.Quand je lui ai raconté les boucles d'oreillesque Zohra m'avait volées, elle m'a dit qu'ellesavait où étaient les gens de ma tribu, les Hilal,les gens du croissant de lune, de l'autre côté desmontagnes, au bord d'un grand fleuve asséché.Et moi je rêvais que j'allais là-bas, dans ce vil-
46
lage, que j'entrais dans la rue, et au bout de larue, il y avait ma mère qui m'attendait.
Mais Houriya n'est pas restée longtemps aufondouk. Un matin, elle était partie. Mais cen'est pas arrivé à cause de son mari. C'est arrivéà cause de moi.
Un soir, j'étais allée dans un restaurant dubord de mer, avec Houriya et ses amis. On avaitroulé longtemps dans la nuit, jusqu'à unegrande plage vide. J'étais à l'arrière de la Mer-cedes, contre la portière, et Houriya au milieu,avec un homme. Il y avait aussi deux hommes àl'avant, et une femme blonde. Ils parlaient fort,une langue que je ne comprenais pas, j 'ai penséque ça devait être du russe. Je me souviens biende l'homme qui conduisait, grand et fortcomme Abel, avec beaucoup de cheveux et unebarbe noire. Je me souviens aussi qu'il avait unœil bleu et un œil noir. Nous sommes restés unbon moment au restaurant, il devait être près deminuit. C'était un restaurant luxueux, avec dessortes de flambeaux qui éclairaient le sable de laplage, et les garçons en costume blanc. J'ai passéla soirée à regarder la mer noire, les lumièresdes bateaux de pêche qui rentraient et l'éclatd'un phare au loin. La femme blonde parlait etriait fort, et les hommes entouraient Houriya.Le vent qui entrait par une fenêtre ouverteemportait la fumée des cigarettes. J'avais bu duvin en cachette, c'était le chauffeur de la Mer-cedes qui m'avait fait boire dans son verre, un
47
-
vin très doux et sucré qui mettait du feu dans lagorge. Il me parlait en français, avec un drôled'accent un peu lourd, qui traînait sur les mots.J'étais si fatiguée que je me suis endormie surune banquette, près de la fenêtre.
Ensuite je me suis réveillée dans la voiture.J'étais toute seule à l'arrière. Le chauffeur étaitpenché sur moi, je voyais ses cheveux boucléséclairés par la lumière du restaurant. Je n'ai pascompris tout de suite, mais quand il a mis lamain sous ma robe, je me suis vraiment réveil-lée. J'étais saoule, j'avais envie de vomir. Malgrémoi, je me suis mise à hurler. J'avais peur, etcomme le chauffeur voulait mettre sa main surma bouche, je l'ai mordu. Je hurlais, je griffaiset je mordais.
Houriya est arrivée tout de suite. Elle étaitencore plus enragée que moi, elle a tirél'homme en arrière, elle le frappait à coups depoing. Elle criait des injures. L'homme essayaitde répondre, il reculait sur la plage, et Houriyaa ramassé une grosse pierre et elle l'aurait tué siles autres n'étaient pas arrivés. Elle continuait àinjurier le chauffeur, elle pleurait, et moi aussije pleurais. Le chauffeur s'est réfugié de l'autrecôté de la voiture, il a allumé une cigarettecomme s'il ne s'était rien passé. Au bout d'uninstant, Houriya s'est calmée, et on a pu repartiren voiture. Le chauffeur conduisait sans nousregarder, sa cigarette au bec, et plus personnene disait rien, même la Russe était silencieuse.
48
La Mercedes nous a déposées au Souikha, etnous avons marché jusqu'au fondouk. Il y avaitencore beaucoup de monde dehors, ça devaitêtre un samedi soir. Le boulevard des amoureuxdevait être comble, avec un couple sous chaquemagnolia. Dans la rue, Houriya a acheté deuxverres de thé et des gâteaux. Nous étions faibles,nous tremblions toutes les deux, comme aprèsun accident. Elle n'a pas parlé de ce qui étaitarrivé, sauf qu'elle a dit une seule fois : « Ce filsde chien, il m'avait dit : laisse-la dormir, je vaisveiller sur elle comme un père. »
Mme Jamila a appris ce qui s'était passé à laplage. Mais ce n'est pas elle qui lui a demandéde s'en aller. Le lendemain matin, Houriya apris sa valise, celle qu'elle avait quand Tagadirtl'avait rencontrée errant près de la gare. Elle estpartie sans explications. Peut-être qu'elle estretournée chez son mari, à Tanger. Je n'ai plusrien su d'elle pendant des mois, mais son départm'a laissée bien triste, parce qu'elle était vrai-ment un peu comme ma sœur.
Après cela, Mme Jamila a bien essayé dem'empêcher de sortir avec les autres princesses,mais avec Houriya j'avais pris l'habitude de laliberté, et je n'en faisais plus qu'à ma tête. AvecAïcha et Selima, j 'ai pris une autre habitude : jeme suis mise à voler.
49
-
C'est avec Selima que j 'ai commencé. Quandelle recevait son ami au fondouk, ou quand elleallait au restaurant, je l'accompagnais. Je memettais dans un coin, recroquevillée contre uneporte comme un animal, et j'attendais lemoment. L'ami de Selima était français, profes-seur de géographie dans un lycée, quelquechose comme ça, de bien. C'était un monsieurbien habillé, complet de flanelle grise, gilet, etchaussures noires bien cirées.
Il avait ses habitudes avec Selima, il l'emme-nait d'abord déjeuner dans un restaurant de lavieille ville, puis il la ramenait au fondouk et ils'installait dans la chambre sans fenêtre. Ilm'apportait des bonbons, quelquefois il medonnait quelques pièces. Moi je restais assisedevant la chambre, comme un chien de garde.En fait, j'attendais un long moment qu'ils soientbien occupés, et j'entrais dans la chambre àquatre pattes. Je me faufilais dans la pénombrejusqu'au lit. Je ne m'intéressais pas à ce queSelima faisait avec le Français. Je cherchais leshabits. Le professeur était un homme soigneux.Il pliait son pantalon et mettait sa veste et songilet sur le dossier d'une chaise. Alors mesdoigts se glissaient dans les poches, comme unpetit animal agile, et rapportaient tout ce qu'ilstrouvaient : une montre-oignon, une alliance enor, un porte-monnaie tapissé de billets debanque et gonflé de pièces, ou un joli stylo bleu
50
incrusté d'or. Je ramenais mon butin sur la gale-rie, pour l'examiner à la lumière du jour, jechoisissais quelques billets, quelques pièces, etde temps en temps je gardais un objet qui meplaisait, des boutons de manchette en nacre, oubien le petit stylo bleu.
Je crois que le professeur a fini par se douterde quelque chose, parce qu'un jour, il m'a faitun cadeau, un joli bracelet en argent dans unepetite boîte, et, en me le donnant, il m'a dit :« Celui-ci est vraiment à toi. » C'était un hommegentil, j 'ai eu honte de ce que j'avais fait, et enmême temps je ne pouvais pas m'empêcher derecommencer. Je ne faisais pas cela par espritmalfaisant, plutôt comme un jeu. Je n'avais pasbesoin d'argent. Sauf pour acheter des cadeauxà Selima, à Aïcha, ou aux autres princesses, l'ar-gent ne me servait à rien.
Avec Aïcha j 'ai continué à voler dans lesmagasins. Je l'accompagnais dans le centre de laville, j'entrais avec elle et, pendant qu'elle étaitoccupée à acheter des sucreries, je remplissaismes poches avec tout ce que je trouvais, des cho-colats, des boîtes de sardines, des biscuits, desraisins secs. Dès que j'étais dehors, je furetais àla recherche d'une occasion. Je n'avais mêmeplus besoin de sa compagnie. J'étais petite etnoire, je savais que les gens ne s'occupaient pasde moi. J'étais invisible. Mais au marché il n'yavait rien à faire. Les marchands m'avaient repé-rée, je sentais leurs yeux qui suivaient chacun demes gestes.
51
-
Alors j'allais avec Aïcha très loin, jusqu'auquartier de l'Océan, là où il y avait de belles vil-las, des immeubles tout neufs et des jardins.Aïcha aimait bien se promener dans les centrescommerciaux, et pendant ce temps, j'allais aucimetière pour regarder la mer.
Là, je me sentais en sécurité. C'était calme etsilencieux, on ne voyait pas l'agitation de laville. Il me semblait que c'était mon domaine,depuis toujours. Je m'asseyais sur les monticulesdes tombes, je respirais l'odeur du miel despetites plantes grasses à fleurs roses. Je touchaisla terre du plat de la main, autour des tombes.
Dans cet endroit, je pouvais parler avec LallaAsma. Je n'ai jamais su où elle avait été enterrée.Elle était juive, et pour cela elle n'avait pas dûfinir au milieu des musulmans. Mais ça n'avaitpas d'importance, je sentais que dans ce cime-tière j'étais tout près d'elle, qu'elle pouvaitm'entendre. Je lui racontais ma vie. Pas tout,juste des morceaux, je ne voulais pas entrerdans les détails. « Grand-mère, vous ne seriezpas fière de moi. Vous qui m'avez toujours ditqu'il faut respecter le bien d'autrui et dire lavérité, voilà que maintenant je suis la plusgrande voleuse et la plus grande menteuse de laterre. »
Cela me rendait triste de parler ainsi à LallaAsma à travers la terre. Je versais une larme,mais le vent la séchait aussitôt. Tout était telle-ment beau dans cet endroit, les monticules cou-
52
verts de petites fleurs roses, les pierres blanchesdes tombes sans noms, où s'effaçaient les versetsdu Coran, et au loin la mer bleue, les mouettessuspendues dans le ciel, glissant sur le vent, dar-dant sur moi un œil rouge et méchant. Il y avaitbeaucoup d'écureuils dans le cimetière. Ils sem-blaient sortir des tombes. Ils vivaient avec lesmorts, peut-être qu'ils croquaient leurs dentscomme des noix.
Je n'avais pas du tout peur de la mort. D'avoirvu Lalla Asma tombée sur le carreau de la salle,ronflant et gargouillant, ça m'avait donné l'idéeque la mort est comme un sommeil profond. Cen'étaient pas les morts qui étaient à craindre aucimetière.
Un jour, un noble vieillard avec une barbeblanche est apparu. Il avait dû m'espionnerdepuis longtemps, et il se tenait droit à côtéd'une tombe, comme s'il en était sorti. Commeje le regardais, il a passé sa main sous sa robe, ill'a soulevée et il a montré son sexe, avec ungland brillant et violacé comme une aubergine.Il pensait peut-être que j'aurais peur et que jepartirais en criant. Mais au fondouk, je voyaisdes hommes nus presque chaque jour, et j'en-tendais les plaisanteries des princesses à proposdu sexe des hommes, qu'elles jugeaient engénéral un peu insuffisant.
Je me suis contentée de jeter un caillou auvieux, et je me suis sauvée entre les tombes, tan-dis qu'il m'insultait et emmêlait ses babouchesen essayant de me suivre.
53
-
« Petite sorcière ! — Vieux chien î »C'est ce jour-là que j 'ai compris qu'il ne faut
pas se fier aux apparences, et qu'un vieilhomme avec une robe blanche et une bellebarbe peut très bien n'être qu'un vieux chienvicieux.
Le quartier de l'Océan était bien pour voler.Il y avait de beaux magasins, avec seulement deschoses pour les gens riches, comme on n'entrouvait pas du côté du marché de la vieille ville.Au Souikha, il n'y avait qu'une sorte de biscuit,une sorte de chewing-gum, et comme boisson,seulement du Fanta à l'orange ou du Pepsi.Dans les magasins de l'Océan, on trouvait desboîtes de jus avec des noms écrits en japonais,en chinois, en allemand, avec des goûts nou-veaux, inconnus, tamarins, tangerine, fruit de laPassion, goyave. On trouvait des cigarettes detous les pays, même de longues noires avec unbout doré que j'achetais pour Aïcha, et du cho-colat suisse que je fauchais à l'étalage.
J'entrais dans les magasins derrière Aïcha, jefaisais un tour, je repartais les poches pleines.Les gens ne me connaissaient pas, ils ne seméfiaient pas de moi. J'avais l'air d'une petitefille sage, avec ma robe bleue à col blanc, unruban blanc dans ma tignasse, et mes yeux can-dides. Ils croyaient que j'étais nouvelle dans lequartier, que j'accompagnais ma mère qui tra-vaillait dans les villas. J'ai remarqué que beau-
54
coup de gens sont simples, ils n'ont pas appris laleçon aussi vite que moi, ils croient d'abord cequ'ils voient, ce qu'on leur dit, ce qu'on leurfait croire. Moi, j'avais quatorze ans, j 'en parais-sais douze, et déjà j'étais aussi savante qu'undémon. C'est Tagadirt qui m'a dit cela. Peut-être qu'elle avait raison. Elle se querellait avecSelima, avec Aïcha, elle les traitait d!alcahuetes,de mères maquerelles.
Je crois que je n'avais plus aucun sens de lamesure ou de l'autorité. Je risquais les piresennuis. C'est durant cette époque de ma vie quej'ai formé mon caractère, que je suis devenueinapte à toute forme de discipline, encline à nesuivre que mes désirs, et que j 'ai acquis unregard endurci.
Mme Jamila se rendait bien compte que çan'allait pas. Mais elle n'avait pas l'habitude desenfants, encore que, dans un sens, les princessesfussent un peu ses enfants. Pour tenter de corri-ger la mauvaise pente où je me laissais porter,elle voulut m'inscrire à l'école. Je ne parlais passuffisamment l'arabe pour entrer dans uneécole communale, et j'étais trop âgée pourentrer dans une école étrangère. De plus, jen'avais pas le moindre papier d'identité. Elleopta pour un cours, une sorte de pension oùune femme sèche et revêche appelée Mlle Roseavait la responsabilité d'une douzaine de jeunesfilles difficiles. En réalité, c'était plutôt une mai-son de correction. Mlle Rose était une religieuse
55
-
française défroquée, qui vivait avec un hommeplus jeune qui s'occupait de la gestion et del'économat.
La plupart des filles avaient un passé pluschargé que le mien. Elles s'étaient enfuies dechez elles, ou bien elles avaient eu des amants,ou elles avaient été promises en mariage et leursfamilles les avaient enfermées pour être sûresdu dénouement. À côté d'elles, j'étais libre,insouciante, je n'avais peur de rien. Je ne suisrestée que quelques mois chez Mlle Rose.
L'essentiel de l'éducation à la pension consis-tait à occuper les filles à des travaux de couture,de repassage, et à lire des livres de morale.Mlle Rose dispensait quelques cours de français,et son beau gestionnaire, avec plus d'avariceencore, des notions d'arithmétique et de géo-métrie.
Quand je décrivais aux princesses l'esclavagedes filles astreintes à balayer et à laver le sol dupensionnat, ou bien se brûlant les doigts avecdes fers à repasser et des manches de casserole,elles s'indignaient. Quant à moi, il n'était pasquestion que je brode quoi que ce soit, ou queje fasse des travaux de ménage. J'avais fait toutcela autrefois pour Lalla Asma, parce qu'elleétait ma grand-mère et que je lui devais la vie. Iln'était pas question que je recommence pourplaire à une vieille fille qui, en plus, se faisaitpayer. Je me contentais de rester assise sur ma
56
chaise, à écouter les leçons de Mlle Rose, quilisait de sa voix enrouée La Cigale et la Fourmi ouLe Rêve du jaguar. Je n'ai pas appris grand-chosechez Mlle Rose, mais j'ai appris à apprécier maliberté, et je me suis promis alors, quoi qu'iladvienne, de ne jamais me laisser priver de cetteliberté.
Au terme de ce semestre à la pension,Mlle Rose est venue en personne au fondouk,sans doute pour se rendre compte du milieu quiavait fabriqué un monstre comme moi. MmeJamila était en tournée, et c'est Selima, Aïcha etZoubeïda qui l'ont reçue, dans la galerie, habil-lées de leurs longues robes de chambre enmousseline pastel, leurs yeux charbonnés aukhôl. « Nous sommes ses tantes », ont-elles dit.Et devant Mlle Rose qui n'en croyait pas sesoreilles ni ses yeux, elles m'ont accablée degriefs : j'étais menteuse, voleuse, répondeuse,paresseuse, et si je restais chez elle, je risquais defaire enfuir toutes ses pensionnaires, ou demettre le feu à la pension avec un fer à repasser.C'est comme cela que j'ai été mise à la porte. Çam'a fait un peu de peine, à cause de tout l'ar-gent que Mme Jamila avait consacré à mon édu-cation, mais je ne pouvais pas être condamnéeau bagne juste pour lui plaire.
Ainsi, après des mois d'interruption, jeretrouvais ma vie libre, les balades dans le Soui-kha, le quartier riche de l'Océan et le grand
57
-
cimetière au-dessus de la mer. Mais mon bon-heur fut de courte durée. Un midi que je reve-nais d'une expédition les poches pleines debabioles pour mes princesses, je fus saisie à l'en-trée du fondouk par deux hommes en completgris. Je n'eus pas le temps de crier, ni d'appelerau secours. Ils m'empoignèrent chacun par unbras, me soulevèrent et me firent retomber dansune camionnette bleue aux fenêtres grillées.C'était comme si tout recommençait, j'étais ànouveau paralysée par la peur. Je voyais la rueblanche qui se refermait et le ciel qui disparais-sait. J'étais en boule au fond de la camionnette,les genoux remontés contre mon ventre, lesmains appuyées sur mes oreilles, les yeuxfermés, j'étais à nouveau dans le grand sac noirqui m'engouffrait.
Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Plustard, j 'ai compris ce qui s'était passé. C'était lapolice de Zohra qui m'avait suivie et qui m'avaittendu un piège. J'étais recherchée par tous lesmagasins où j'avais volé. J'ai comparu devant unjuge pour enfants, un homme très calme, qui par-lait trop bas pour que je l'entende. Comme jedisais oui à toutes ses questions, je lui ai paru sou-mise. Mais il voulait aussi m'interroger sur le fon-douk, sur ce que faisaient Mme Jamila et les prin-cesses. Et comme je ne répondais rien, il semettait en colère, mais toujours très doucement.Seulement il cassait le crayon qu'il tournait entreses doigts, en me regardant, comme s'il voulaitme faire comprendre que, moi aussi, il pouvaitme casser d'un geste. J'ai été interrogée plusieursjours, et ensuite on me renvoyait dans machambre dont les fenêtres étaient grillagées.C'était comme une école ou une annexe d'hô-pital.
59
4
-
Puis il m'a livrée à Zohra. S'il m'avait laisséechoisir entre Zohra et la prison, j'aurais choisi laprison, mais il ne m'a pas donné le choix.
Zohra et Abel Azzema habitaient maintenantdans un immeuble neuf, à la sortie de la ville, aumilieu de grands jardins. Ils avaient vendu lamaison du Mellah, et Zohra avait consenti àquitter ses parents pour venir vivre dans ce quar-tier de luxe.
Au commencement, Zohra et Abel ont étégentils avec moi. C'était comme s'ils avaientdécidé qu'on effacerait tous les griefs, tout lepassé, et qu'on recommencerait sur de nou-velles bases. Peut-être qu'ils avaient peur ausside Mme Jamila, et qu'ils se sentaient observés.
Mais le naturel est vite revenu. Après quelquetemps, Zohra est redevenue méchante avec moi.Elle me battait, elle me criait que je n'étaisqu'une bonne, en réalité une bonne à rien. Ellese mettait au moindre prétexte dans une colèrenoire : parce que j'avais cassé un bol bleu, parceque je n'avais pas lavé les lentilles, parce quej'avais laissé des traces sur le carreau de lacuisine.
Elle ne me laissait pas sortir. Elle disait qu'il yavait une injonction du juge, que je devais ces-ser toute mauvaise fréquentation. Quand elledevait sortir, elle m'enfermait à double tourdans l'appartement, avec une pile de linge àrepasser. Un jour, j 'ai un peu roussi le col d'unechemise d'Abel, et pour me punir Zohra m'a
60
brûlé la main avec le fer. J'avais les yeux pleinsde larmes, mais je serrais les dents de toutes mesforces pour ne pas crier. Je perdais le soufflecomme si quelqu'un me serrait à la gorge, jemanquais m'évanouir. Encore aujourd'hui, j 'aisur le dessus de la main un petit triangle blancqui ne s'effacera jamais.
Je croyais que j'allais mourir. Je n'avais rien àmanger. Zohra faisait cuire du riz pour un petitchien qu'elle avait, un shi-tzu à longs poils d'unblanc un peu jaune. Elle arrosait le riz de bouil-lon de poule, et c'était tout ce qu'elle me don-nait. J'avais moins à manger que son petit chien.De temps en temps je chapardais un fruit dansla cuisine. J'avais peur de ce qui se passerait sielle s'en apercevait. J'avais les jambes et les brascouverts de bleus à cause de ses coups de cein-ture. Mais j'avais si faim que je continuais àvoler dans le placard de la cuisine, du sucre, desbiscuits, des fruits.
Un jour, elle avait des invités à déjeuner, desFrançais du nom de Delahaye. Pour eux elleavait acheté dans un supermarché de l'Océanune belle grappe de raisin noir. Pendant qu'ilsmangeaient les hors-d'œuvre, j'attendais à lacuisine et je grappillais. Bientôt, j 'ai vu quej'avais mangé tous les grains qui étaient en des-sous de la grappe. Alors, pour retarder lemoment où ils découvriraient le délit, j 'ai misdes boulettes de papier sous la grappe, de façonqu'elle paraisse encore bien pleine dans l'as-
61
-
siette. Je savais que, tôt ou tard, cela se verrait,mais ça m'était égal. Le raisin était doux etsucré, parfumé comme du miel.
À la fin du repas, j 'ai apporté le raisin, et jus-tement les invités ont demandé que je reste. Ilsdisaient à Zohra : « Votre petite protégée. »
Zohra minaudait. Elle m'avait fait enlever meshaillons et mettre la robe bleue à col blanc quej'avais chez Lalla Asma. Elle était un peu courte,et trop étroite, mais Zohra avait laissé la ferme-ture à glissière ouverte et avait noué un tablierpar-dessus. Et puis j'avais beaucoup maigri.
« Elle est charmante, elle est ravissante !Toutes nos félicitations. » Les Français avaientl'air gentils. M. Delahaye avait des yeux bleustrès lumineux qui ressortaient sur son visagebronzé. Mme était blonde, avec la peau un peurouge, mais encore bien fraîche. J'aurais bienvoulu leur demander de m'emmener, dem'adopter, mais je ne savais pas comment leleur dire. Je voulais qu'ils lisent mon désespoirdans mon regard, qu'ils comprennent tout.
Naturellement, au moment du dessert, Zohraa découvert le dessous de la grappe tout mangé,et les boulettes de papier. Elle a crié mon nom.Les bouts de tige sans grains étaient hérisséscomme des poils. Même la grappe avait l'airhonteuse.
« Ne la grondez pas. C'est une enfant, est-ceque nous n'avons pas tous fait quelque chosecomme ça quand nous étions enfants ?» a dit
62
Mme Delahaye. Son mari riait franchement, etAbel esquissait un vague sourire. Zohra n'a pasfait semblant de rire, elle m'a jeté un longregard mauvais, et après le départ des Français,elle est allée chercher la ceinture à la lourdeboucle de cuivre. « Pour chaque grain ! Chou-ma ! » Elle m'a battue jusqu'au sang.
Grâce aux Delahaye, j 'ai pu sortir de l'appar-tement. Mme Delahaye téléphonait à Zohra :« Dites-moi, ma chérie, prêtez-moi donc un peuvotre petite protégée, vous savez comme j'aibesoin d'aide à la maison, et en même tempselle pourra se faire un peu d'argent de poche. »
D'abord Zohra a refusé, sous divers prétextes,mais Mme Delahaye lui en a fait le reproche :«J'espère que vous ne la séquestrez pas ! »Zohra a eu peur, elle a cru percevoir unemenace sous la plaisanterie, et elle m'a laisséealler. Une fois, puis deux par semaine.
Les Delahaye louaient une jolie maison dansle quartier de l'Océan. C'était l'entreprised'Abel qui avait fait les travaux de peinture et deréparation. Un endroit tranquille, avec un jar-din planté d'orangers et de citronniers, et deshaies de lauriers-roses. Il y avait beaucoup d'oi-seaux. Je me sentais bien dans la maison desDelahaye. Il me semblait que je retrouvais lapaix que j'avais connue dans mon enfance auMellah, quand le monde se réduisait à la courblanche de la maison de Lalla Asma.
Juliette Delahaye était gentille avec moi.
63
-
Quand j'arrivais, vers deux heures de l'après-midi, elle me donnait du thé et des petitsgâteaux d'une belle boîte de métal rouge. Elledevait se douter que je ne mangeais pas assezchez Zohra, en voyant comme je me précipitaissur les biscuits secs. Je crois qu'elle savait monpassé, mais elle n'en parlait pas. Quand je pas-sais le chiffon à poussière dans sa chambre, ellelaissait tous ses bijoux en évidence sur lacommode, ainsi que de petites coupes d'argentcontenant des pièces de monnaie. Je pensaisqu'elle me mettait à l'épreuve, et je me gardaisbien d'y toucher. Elle comptait les pièces aprèsmon passage et, à la gaieté de sa voix, je savaisqu'elle était contente de les y trouver toutes.Mais pendant qu'elle faisait cela, je pouvais visi-ter les poches du veston de son mari accroché àun perroquet dans le vestibule.
M. Delahaye était un homme un peu vieux,avec un grand nez et des lunettes qui grossis-saient ses yeux bleus. Il était toujours bienhabillé, avec un complet-veston gris sombreorné d'une petite boule rouge à la boutonnière,et des chaussures de cuir noir bien cirées. Ilavait été autrefois un homme important, unambassadeur, un ministre, je ne sais plus. Moi,j'étais impressionnée par lui, il me disait « monpetit » ou « mademoiselle ». Personne nem'avait jamais parlé comme cela. Il me tutoyait,mais il ne me donnait jamais de bonbons, nid'argent. Sa passion, c'était la photo. Il y avait
64
des photos partout dans la maison, dans les cou-loirs, dans la salle, dans les chambres, mêmedans les w.-c.
Un jour, il m'a invitée dans son studio. C'étaitune petite bâtisse sans fenêtre au fond du jar-din, qui avait dû servir autrefois de garage etqu'il avait aménagée. C'est là qu'il développaitet tirait ses photos.
Dans le studio, ce qui m'a étonnée, c'était lesphotos de sa femme, épinglées aux murs.C'étaient des photos un peu anciennes, ellesemblait très jeune. Elle était déshabillée, avecdes fleurs piquées dans ses cheveux blonds, ouen maillot sur une plage. Cela se passait dans unautre pays, dans une île lointaine, on voyait despalmiers, le sable blanc, la mer couleur de tur-quoise. Il m'a dit les noms, il me semble quec'était Manureva, ou un nom de ce genre. Il yavait aussi sur le mur une drôle de chose en cuirnoir, ornée de clous de cuivre, que j 'ai prised'abord pour une arme, une sorte de fronde, ouune muselière. En regardant les photos, j 'ai étéétonnée de constater que c'était le cache-sexede Mme Delahaye, que son mari avait accrochélà, comme un trophée.
J'étais habituée à voir des femmes nues, aubain de vapeur avec Tagadirt, ou bien quandAïcha ou Fatima se promenaient dans lachambre. Pourtant, j'avais honte de voir cesphotos où Mme Delahaye n'avait pas d'habitsdu tout. Sur une photo en noir et blanc, elle
65
-
était allongée toute nue sur une terrasse, ausoleil, et au bas de son ventre son pubis faisaitune grosse tache triangulaire noire qui contras-tait avec la couleur de ses cheveux. M. Delahayem'observait derrière ses lunettes, avec un vaguesourire. J'ai pensé que c'était aussi une épreuveet j 'ai caché ma honte. J'avais tellement envie deleur plaire.
Je suis retournée plusieurs fois dans le studio.M. Delahaye m'expliquait la technique dutirage, les bains d'acide, comment prendrel'épreuve avec une pince et l'accrocher à un filpour la laisser sécher. J'aimais bien faire appa-raître les visages dans les baquets, lentement,devenant de plus en plus noirs. Il y avait desvisages de femmes, des enfants, des scènes derue. Aussi des filles dans des poses étranges,avec la robe ouverte qui descendait sur l'épaule,les cheveux défaits.
M. Delahaye me disait que j'étais intelligente,que j'étais douée pour la photo. Il parlait demoi à Mme Delahaye avec enthousiasme, ildisait qu'on devrait m'inscrire dans un labora-toire, que je pourrais en faire mon métier. Moije regardais cette femme si distinguée, et je vou-lais effacer de ma tête le morceau de cuir noirclouté qui pendait sur le mur du studio. Je medisais que ce n'était rien, qu'ils avaient dû l'ou-blier, comme on accroche son chapeau à unclou en passant.
Un après-midi, c'était au commencement de
66
l'été, il faisait très chaud dehors, je suis alléecomme d'habitude, après mes tâches, pour tra-vailler un peu à tirer des épreuves. M. Delahayeétait en bras de chemise, il avait accroché sonveston à un cintre. Il n'avait pas allumé lalumière rouge. Il m'a dit : «Aujourd'hui, j 'aienvie de te photographier. » Il me regardaitbizarrement. Il disait ça comme si c'était unechose entendue. Moi je ne voulais pas qu'on mephotographie. Je n'ai jamais aimé ça. Je me sou-viens que Lalla Asma disait que c'était mauvaisde prendre des photos, que ça vous usait levisage.
En même temps, j'étais assez flattée qu'unhomme tel que M. Delahaye puisse avoir enviede photographier une petite fille noire commemoi.
Il a allumé ses lampes à pinces, il a placé untabouret devant un grand drap blanc fixé aumur avec des clous. Il avait fait tous ses prépara-tifs, il devait avoir pensé à cela depuis long-temps. Il avait un visage sérieux, appliqué, etson front brillait de sueur à la chaleur deslampes. Il m'a fait asseoir sur le tabouret, lebuste bien droit.
Puis il a commencé à prendre des photos,avec un appareil sur pied où brillait une petitelumière rouge. J'entendais le bruit de l'obtura-teur. Il me semblait aussi que j'entendais lebruit de sa respiration, son souffle d'asthma-tique. C'était étrange. Je n'avais pas du tout
67
-
peur de lui, et en même temps je sentais moncœur battre très fort, comme si j'étais en trainde faire quelque chose d'interdit, de dan-gereux.
Il s'est arrêté. Il trouvait que je n'étais pasbien coiffée. Ou plutôt, il trouvait que je n'avaispas les cheveux assez décoiffés. Il m'a fait enle-ver le bandeau que Zohra m'obligeait à porter,il a mouillé mes cheveux en les aspergeantd'eau froide et il les a fait gonfler avec unséchoir électrique Babyliss. Je sentais le soufflechaud sur ma nuque, et en même temps l'eaufroide qui coulait dans mon cou, qui mouillaitma robe. Maintenant, M. Delahaye était vrai-ment bizarre, il ressemblait à Abel quand ilm'avait coincée dans le lavoir de la cour deLalla Asma. Il transpirait, il avait un regard bril-lant, fureteur, le blanc de ses yeux était un peurouge. Je pensais que sa femme pouvait arriverd'un instant à l'autre, et que c'était ça qui l'in-quiétait. À un moment, il est allé à la porte, il aregardé dehors, puis il l'a refermée et il atourné la clef dans la serrure. C'était curieuxcomme tous, depuis Mme Jamila jusqu'àMlle Rose et Zohra, ils voulaient m'enfermer àclef. À partir de ce moment-là, je me suis sentiemal. J'avais le cœur qui battait trop vite, je sen-tais une sueur d'inquiétude qui me piquait,dans les côtes, le long du dos.
M. Delahaye a recommencé à prendre desphotos. Il m'a dit quelque chose à propos de ma
68
robe, qu'elle n'allait pas, qu'elle était tropmouillée. Il voulait quelque chose qui aille avecmon visage, quelque chose de plus sauvage, bar-bare, de plus animal. Il avait dégrafé ma robe,échancré le col. Je sentais ses mains sur moncou, sur mes épaules. Je sentais son souffle, jem'écartais, et lui manœuvrait mon buste,comme s'il cherchait un mouvement, une pose.Je devais avoir de la colère dans les yeux, parcequ'il s'est reculé et il a pris une série de clichés,il répétait : « Là, c'est magnifique, tu es magnifi-que ! » De temps en temps, il passait derrièremoi, il défaisait encore un bouton et il faisaitglisser un peu plus la robe sur mes épaules. Maisil me touchait à peine, je sentais juste le soufflede sa respiration contre ma nuque.
À un moment, je n'ai plus pu supporter.J'avais la nausée. Je me suis levée, sans mêmeme rajuster, j 'ai couru jusqu'à la porte. Commela clef n'était pas dans la serrure, je me suisretournée. M. Delahaye était debout devant sonappareil, il avait l'air de réfléchir. Il avait uneexpression bizarre sur son visage, comme s'ilsouffrait beaucoup. Je ne sais pas ce que j 'ai dit,avec une voix rageuse : « Si vous ne me laissezpas sortir, je vais crier. » Il m'a ouvert la porte. Ils'écartait de moi comme si j'étais un scorpion. Ila dit : « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce queje t'ai fait ? Je ne voulais pas te faire peur, je vou-lais juste te prendre en photo. » Je ne l'ai pasécouté. Je suis partie en courant. Je suis sortie
69
-
de la maison, sans dire au revoir à Mme Dela-haye. J'avais le cœur qui battait fort, je sentaisdu feu sur mes joues et sur mon cou, là où cethomme avait passé le bout de ses doigts.
J'ai fini par revenir à la maison de Zohra. Iln'y avait personne. J'ai attendu son retour sur lepalier. Curieusement, elle ne m'a pas battue,elle ne m'a posé aucune question. Simplement,je ne suis plus retournée voir les Delahaye. Jecrois que c'est à partir de ce jour-là que j 'aidécidé de partir, d'aller le plus loin possible, aubout du monde, et ne jamais revenir. C'est àcette époque-là aussi que Zohra avait décidé deme fiancer.
Je n'ai pas compris tout de suite qu'elle avaitfait ce projet, mais j 'ai remarqué que, depuisque je n'allais plus chez les Delahaye, Zohraétait plus gentille avec moi. Elle continuait à meboucler dans l'appartement, mais elle ne mebattait plus. Elle me donnait même davantage àmanger, et en plus de l'ordinaire que je parta-geais avec le shi-tzu, j'avais droit de temps àautre à un fruit, une banane, une pomme, desdattes fourrées. Un jour, elle m'a même remissolennellement la petite boîte qui contenait lesboucles d'oreilles en or, les croissants de lunequi portaient le nom de ma tribu, et que lesvoleurs d'enfants m'avaient laissées quand ilsm'avaient vendue à Lalla Asma. « Elles sont àtoi. Je les gardais pour que tu ne risques pas de
70
les perdre. C'était la volonté de ma mère,comment je pourrais ne pas lui obéir?» Je mesuis toujours demandé pourquoi elle faisait ça.La seule explication que j 'ai trouvée, c'est queLalla Asma lui était apparue dans un rêve et luiavait dit de le faire. Zohra était aussi supersti-tieuse qu'elle était méchante.
Mme Delahaye était venue plusieurs fois pourme réclamer. Mais Zohra n'avait pas voulu queje la voie, et d'ailleurs j 'en étais assez contente.J'avais appris soudain à détester ces gens sibeaux et si raffinés, avec toutes leurs histoires decache-sexe et leurs photos bizarres.
Et puis, il y avait cet homme qui venait main-tenant à la maison.
C'était un homme assez jeune, un employé debanque ou quelque chose de ce genre. Il étaittrès cérémonieux. Zohra avait dû lui dire que jeparlais mal l'arabe, et il s'adressait à moi dansun français archaïque, solennel, qui me donnaitenvie de rire. Zohra lui servait du thé dans lasalle, elle apportait un cendrier pour qu'il nefasse pas tomber la cendre de ses cigarettes surle tapis. Il avait une façon de tenir sa cigarettebien droite, comme un crayon, l'air maladroit etsincère.
Quand il devait venir, Zohra me faisait mettrema robe bleue à col de dentelle, celle queM. Delahaye détestait et qu'il avait voulu mefaire enlever le jour des photos. J'apportais leplateau avec les petits verres dorés et le sucrier,
71
-
et M. Jamah (que j'avais tout de suite surnomméM. Jamais) me regardait avec des yeux trèsdoux. Son visage fin et blanc exprimait beau-coup d'émotion, et quand je m'asseyais devantlui sur les coussins, je surprenais de temps entemps les coups d'œil furtifs qu'il adressait àmes jambes. Cela a duré plusieurs mois, et jefinissais par m'amuser de ces rencontres. Jejouais à la coquette, je disais des sous-entendus,juste pour qu'il se laisse prendre un peu plus.En même temps, Abel devenait jaloux, mesquin,et c'était aussi un jeu pour moi, une manière deme venger de tout ce qu'il m'avait fait autrefois.Je jouais à lui faire croire que j'étais heureusede ces fiançailles annoncées. Quand il était pré-sent, j'interrogeais longuement Zohra surM. Jamais, sa fortune, la maison de sa famille, laposition de ses frères, etc.
Un jour, en passant, il m'a jeté un regardvenimeux. « De toute façon, tu n'en as pluspour longtemps à rester ici. » Il m'a dit que laprésentation en vue des fiançailles était prévuepour le mois d'octobre. Il a ajouté : « Puisque tuaimes les hôtels, ça se fera dans un hôtel aubord de la mer. La salle a été retenue. »
Je n'ai pas fait mes bagages, pour ne pas lesalerter. J'ai mis toutes mes économies dans mesvêtements, tout ce que j'avais volé, et tout ceque j'avais gagné en travaillant chez les Dela-haye, et que j'avais caché sous un morceau deplinthe, dans la pièce où je dormais. J'ai mis les
72
pièces dans mes poches, et j 'ai cousu les billetsdans ma blouse, contre mon estomac. J'ai piquéles boucles d'oreilles Hilal sous mon bandeau.
Pour sortir, j 'ai attendu que Zohra reviennedes courses, et j 'ai fait tomber par la fenêtre dela buanderie du linge dans la cour. T'ai dit àZo