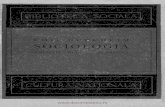Le Suicide 1897
Transcript of Le Suicide 1897
Durkheim, mile (1858-1917). Le Suicide, tude de sociologie, par mile Durkheim,.... 1897.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 : *La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits labors ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sans l'autorisation pralable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle. 5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter [email protected].
LE
SUICIDE
FELIX
ALCAN,
EDITEUR
AUTRES OUVRAGES DE M. E. DURKHEIM 1 vol. in-12 de la BiblioLes rgles de la mthode sociologique. 2 fr. 50 thque de philosophie contemporaine social. 1 vol. in-8 de la Bibliothque de De la division du travail 7 fr. 50 philosophie contemporaine
A LA MME LIBRAIRE : ancien et moderne. tude historique, philosophique, Le Suicide morale et statistique, par A. LEGOYT, ancien chef des travaux de la sta8 fr. tistique de France. 1881, 1 vol. in-8 DEBoisDu suicide et de la folie-suicide, par le Dr A. BRIERRE 2 7 fr. MONT. dition, 1865, 1 vol. in-8
BARLE DUC. IMPRIMERIE CONTACT-LAGUERRE
LE
SUICIDE
TUDE
DE
SOCIOLOGIE
PAR EMILE DURKHEIM
Professeur de Sociologie la Facult des Lettres de l'Universit de Bordeaux
PARIS ANCIENNE LIBRAIRIE GERMER BAILLIRE ET Cie FLIX DITEUR ALCAN, 108, BOULEVARDSAINT- GERMAIN, 108 18 97 Tous droits rservs.
PREFACE
la sociologie est la mode. Le quelque temps, et presque dcri il y a une dizaine d'anmot, peu connu d'un Les vocations se nes, est aujourd'hui usage courant. comme un prjug et il y a dans le public favomultiplient Depuis rable la nouvelle science. On en attend bien avouer que les rsultats pourtant tout fait en rapport avec le nombre ni avec l'intrt met les suivre. qu'on science se reconnaissent Il faut beaucoup. ne sont pas obtenus des travaux publis Les progrs d'une
dont ce signe que les questions elle traite ne restent On dit qu'elle avance pas stationnaires. taient des lois sont dcouvertes quand qui, jusque-l, des faits nouveaux, ou, tout au moins, ignores, quand sans imposer tre regarde encore une solution qui puisse la manire dont se viennent modifier dfinitive, une les problmes. posaient Or, il y a malheureusement bonne raison pour ne nous donne pas ce que la sociologie c'est que, le plus souvent, elle ne se pose pas de spectacle; l're dtermins. Elle n'a pas encore problmes dpass des constructions Au lieu et des synthses philosophiques. de se donner sur une porpour tche de porter la lumire comme
VJ tion restreinte du champ
PREFACE.
de prfrence social, elle recherche les brillantes o toutes les questions sont pasgnralits sans qu'aucune soit expressment ses en revue, traite. Cette mthode un peu la curiosit permet bien de tromper du public en lui donnant, comme toutes sortes de sujets; elle ne saurait Ce n'est tions ralit pas avec des examens rapides qu'on peut arriver aussi on dit, des clarts sur aboutir rien d'objectif. sommaires et coup d'intui dcouvrir les lois d'une
des gnralisations, la fois Surtout, complexe. aussi vastes et aussi htives, ne sont susceptibles d'aucune sorte de preuve. Tout ce qu'on peut faire, c'est de citer, favorables l'occasion, quelques exemples qui illustrent l'hypropose; pothse une dmonstration. mais une illustration ne constitue D'ailleurs, quand on touche choses diverses, on n'est comptent et l'on ne pour aucune de rencontre, peut gure employer que des renseignements sans qu'on ait mme les moyens d'en faire la critique. Aussi les livres de pas tant de
ne sont-ils utilisables pure sociologie gure s'est fait une rgle de n'aborder pour quiconque que des car la plupart d'entre eux ne rentrent dfinies; questions dans de recherches particulier et, de plus, ils sont trop pauvres en documents de quelque autorit. Ceux qui croient l'avenir de notre science doivent avoir coeur de mettre fin cet tat de choses. S'il durait, la sociovite dans son ancien discrdit logie retomberait et, seuls, les s'en rjouir. Car ce serait pourraient un dplorable chec si cette partie du pour l'esprit humain rel, la seule qui lui ait jusqu' prsent rsist, la seule aussi ne ftqu'on lui dispute avec passion, venait lui chapper, ce que pour un temps. L'indcision des rsultats obtenus n'a rien qui doive dcourager. C'est une raison pour faire ennemis de la raison aucun cadre
PREFACE. de nouveaux
vij
non pour abdiquer. Une science, ne efforts, a le droit d'errer et de ttonner, d'hier, pourvu qu'elle prenne conscience de ses erreurs et de ses ttonnements de manire le retour. en prvenir La sociologie ne doit donc renoncer aucune de ses ambitions; autre mais, d'un ct, si elle aux esprances veut rpondre qu'on a mises en elle, il faut autre qu'elle aspire devenir de la littrature philosophique. de se complaire en mditations choses groupes en quelque ment! histoire, ne peut chose forme originale qu'une au lieu Que le sociologue, propos des mtaphysiques des de ses recherches objets
tre, qui puissent montrs du doigt, dont on puisse dire o sorte, et qu'il s'y attache fermeils commencent et o ils finissent, Qu'il interroge avec soin les disciplines sans lesquelles statistique, ethnographie, rien! S'il a quelque chose craindre, c'est que, malne soient jamais en rapport avec gr tout, ses informations la matire soin qu'il car, quelque qu'il essaie d'embrasser; mette la dlimiter, elle est si riche et si diverse qu'elle contient comme des rserves S'il procde ainsi, n'importe. de faits seront et ses formules il incomplets trop troites, fait un travail utile que l'avenir continuera. aura, nanmoins, Car des conceptions base objective ne qui ont quelque tiennent la personnalit de leur auteur. pas troitement Elles ont quelque chose d'impersonnel qui fait que d'autres les reprendre peuvent tibles de transmission. possible condition C'est dans le travail du progrs. dans cet esprit et les Une elles sont poursuivre; certaine suite est ainsi et cette continuit susceprendue est la va inpuisables alors mme Mais il d'imprvu. que ses inventaires auxiliaires, la sociologie
sociales, prenne pour de faits nettement circonscrits,
scientifique qu'a t
conu
l'ouvrage
qu'on
viij lire.
PREFACE.
Si, parmi les diffrents casion d'tudier au cours
sujets que nous avons eu l'ocde notre nous enseignement, avons choisi le suicide c'est pour la prsente publication, que, comme il en est peu de plus facilement dterminables, il nous a paru tre d'un exemple particulirement opportun ; encore bien un travail marquer on se concentre quand tables lois qui prouvent mentation verra dialectique celles que nous pralable les contours. a-t-il Mais t ncessaire pour en aussi, on arrive, par compensation, trouver de vri-
que n'importe quelle argula possibilit de la sociologie. On avoir dmontres. Assuresprons tromper, Mais du
ainsi, mieux
ment, il a d nous arriver plus d'une fois de nous de dpasser dans nos inductions les faits observs.
est accompagne de ses preuves, moins, chaque proposition autant que posque nous nous sommes efforc de multiplier sible. Surtout, nous nous sommes bien sparer appliqu fois tout ce qui est raisonnement et interprtation, chaque Le lecteur est ainsi mis en mesure des faits interprts. ce qu'il y a de fond dans les explications qui lui d'apprcier sans que rien trouble son jugement. sont soumises, Il s'en faut, d'ailleurs, ainsi la recherqu'en restreignant ncessairement les vues d'ensemble et che, on s'interdise au contraire, nous pensons tre certain nombre de propositions, conle mariage, le veuvage, cernant la famille, la socit religieuse, etc., qui, si nous ne nous abusons, en apprennent plus ordinaires des moralistes sur la nature de que les thories ou de ces institutions. Il se dgagera mme ces conditions les aperus gnraux. tablir un parvenu de notre gnral et sur tude dont les quelques indications souffrent actuellement qui peuvent sur les causes les socits l'attnuer. du malaise europennes Car il ne faut Tout
remdes
PREFACE.
IX
tat gnral ne puisse tre expliqu pas croire qu'un qu' l'aide de gnralits. Il peut tenir des causes dfinies, qui ne sauraient tre atteintes si on ne prend soin de les tudier travers expriment. se trouve traduit quoi les manifestations, Or, le suicide, dfinies, qui les dans l'tat o, il est aujourd'hui, une des formes se par lesquelles dont nous souffrons; de cet c'est pourmais non moins
tre justement l'affection collective aidera
il nous
et applique, les principaux problmes de mthodologie que nous avons poss et examins ailleurs (1). Mme, ces questions, plus spcialement parmi il en est une laquelle ce qui suit apporte une contribution trop importante suite l'attention La mthode pour que nous du lecteur. ne la signalions pas tout de
Enfin, sous une
la comprendre. on retrouvera dans le cours forme concrte
ouvrage,
telle que nous la pratiquons, sociologique, sur ce principe fondamental repose tout entire que les faits sociaux doivent tre tudis comme des choses, c'est--dire comme des ralits extrieures l'individu. Il n'est pas de prcepte cependant, qui nous ait de plus soit possible, plus fondamental. t il contest; Car enfin, n'en pas, pour que la ait un objet est
il faut avant tout qu'elle sociologie et qui ne soit qu' elle. Il faut qu'elle ait connatre d'une ralit et qui ne ressortisse sciences. Mais pas d'autres s'il n'y a rien de rel en dehors des consciences particulires, elle s'vanouit faute de matire qui lui soit propre. Le seul objet auquel sont les tats
dsormais ce l'observation, puisse s'appliquer mentaux rien de l'individu n'existe puisqu'il or c'est affaire la psychologie d'en traiter. d'autre; De ce dans point de vue, en effet, tout ce qu'il y a de substantiel (1) Les rgles de la Mthode sociologique, Paris, P. Alcan, 1895.
X le mariage, religion, censes
PREFACE. ou dans la famille, ou dans la par exemple, ce sont les besoins individuels sont auxquels
ces institutions : c'est l'amour rpondre paternel, l'amour filial, le penchant sexuel, ce qu'on a appel l'instinct etc. Quant aux institutions avec leurs religieux, elles-mmes, formes historiques, si varies et si complexes, elles deviennent ngligeables et de peu d'intrt. des proprits ne sont qu'un et contingente elles viduelle, rclament Expression superficielle de la nature indignrales de cette dernire et ne
aspect
Sans doute, il peut pas une investigation spciale. tre curieux, l'occasion, de chercher comment ces sentiments ternels de l'humanit se sont traduits extrieurement aux de l'histoire; mais comme toutes poques ces traductions sont imparfaites, on ne peut pas y attacher Mme, certains gards, il convient beaucoup d'importance. ce texte original pour pouvoir mieux atteindre d'o leur vient tout leur sens et qu'elles dnaturent. C'est ainsi que, sous prtexte la science d'tablir sur des assises dans la constitution plus solides en la fondant psychologique de l'individu, on la dtourne du seul objet qui lui revienne. On ne s'aperoit s'il pas qu'il ne peut, y avoir de sociologie n'existe pas de socits, et qu'il n'existe pas de socits s'il n'y a que des individus. Celte conception, n'est pas la d'ailleurs, moindre des causes qui entretiennent en sociologie le got des vagues gnralits. Comment se proccuperait-on d'exles formes concrtes de la vie sociale quand on ne primer leur reconnat existence qu'une d'emprunt? Or livre, il nous pour semble ainsi difficile se que, de chaque page de ce ne dire, l'individu dgage pas, au contraire, est domin une ralit par : c'est la ralit collective. Quand de les carter diffrentes
l'impression morale qui
que le dpasse
PREFACE. on verra que a un taux de suicides peuple qui que ce taux est plus constant que celui s'il volue, c'est suivant gnrale, que, chaque qui est par lesquelles du mois, ne de l'anne, de la vie sociale; quand
xj lui de un
est personnel, la mortalit coefficient que les moments
d'acclration variations du jour, le rythme
chaque propre socit, il passe aux diffrents font que reconstatera
on produire le divorce, la famille, la socit religieuse, que le mariage, l'arme des lois dfinies dont queletc., l'affectent d'aprs mme tre exprimes sous forme numques-unes peuvent rique, tutions on renoncera voir dans ces tats et dans ces insti-
sans arrangements idologiques je ne sais quels vertu et sans efficacit. Mais on sentira que ce sont des forces vivantes et agissantes, dont relles, qui, par la manire elles assez qu'elles ne l'individu, tmoignent s'il entre comme lment dpendent pas de lui; du moins, dans la combinaison d'o elles rsultent, elles s'imposent lui mesure se forment. Dans ces conditions, qu'elles on tre comprendra mieux comment objective, puisqu'elle et aussi dfinies rsistantes psychologue Il M. nous ou le biologiste reste la sociologie a en face d'elle des que (1). dette de reconnaissance anciens en celles dont peut et doit ralits aussi traitent le dterminent
adressant
acquitter une ici nos remerciements professeur et M. Marcel avec l'Ecole
nos deux
Ferrand,
Bordeaux, le dvouement
primaire Mauss, agrg de philosophie, pour et pour les lequel ils nous ont second
lves, de suprieure
(1) Et pourtant, nous montrerons (p. 368, note) que cette manire de voir, loin d'exclure toute libert, apparat comme le seul moyen de la concilier avec le dterminisme que rvlent les donnes de la statistique.
xij services toutes second cessaires on
PRFACE. C'est le premier qu'ils nous ont rendus. qui a dress les caries contenues dans ce livre ; c'est grce au de runir les lments nqu'il nous a t possible l'tablissement des tableaux XXI et XXII dont pour cela en vue de
Il a fallu apprciera plus loin l'importance. environ les dossiers de 26.000 suicids dpouiller relever sparment d'enfants. l'absence considrable. Ces tableaux ont t tablis l'aide de l'ge, C'est
ou le sexe, l'tat civil, la prsence M. Mauss qui a fait seul ce travail documents que
de la Justice, mais qui ne.paraissent pas possde le Ministre annuels. Ils ont t mis notre disdans les comptes-rendus position avec la plus grande complaisance par M. Tarde, chef du service de la statistique Nous lui en exprimons judiciaire. toute notre gratitude.
LE
SUICIDE
INTRODUCTION
I. le mot de suicide revient sans cesse dans le cours de la conversation, on pourrait croire que le sens en est connu de tout le monde et qu'il est superflu de le dfinir. Mais, en ralit, comme les concepts les mots de la langue usuelle, qu'ils exsont toujours et le savant qui les emploierait priment, ambigus tels qu'il les reoit de l'usage et sans leur faire subir d'autre laboration confusions. Non seuaux plus graves s'exposerait lement la comprhension en est si peu circonscrite qu'elle varie d'un cas l'autre suivant les besoins du discours, mais encore, comme la classification ne procde dont ils sont le produit pas d'une analyse mthodique, les impresmais ne fait que traduire sions confuses de la foule, il arrive sans cesse que des catsous sont runies indistinctement gories de faits trs disparates une mme rubrique, sont ou que des ralits de mme nature de noms diffrents. Si donc on se laisse guider appeles par ce qui doit tre conl'acception reue, on risque de distinguer fondu ou de confondre de mconce qui doit tre distingu, natre ainsi la vritable des choses et, par suite, de se parent sur leur nature. On n'explique mprendre qu'en comparant. Une investigation sa tin que ne peut donc arriver scientifique 1 DURKHEIM. Comme
2
LE SUICIDE.
si elle porte sur des faits comparables et elle a d'autant plus de chances de russir qu'elle est plus assure d'avoir runi tous ceux qui peuvent tre utilement Mais ces affinicompars. ts naturelles des tres ne sauraient tre atteintes avec quelque sret par un examen superficiel comme celui d'o est rsulte la terminologie le savant ne peut vulgaire; par consquent, les groupes de faits tout prendre pour objets de ses recherches constitus les mots de la langue couauxquels correspondent rante. Mais il est oblig de constituer lui-mme les groupes afin de leur donner l'homognit et la spqu'il veut tudier, cificit qui leur sont ncessaires pour pouvoir tre traits scienC'est ainsi que le botaniste, tifiquement. quand il parle de fleurs ou de fruits, le zoologiste, quand il parle de poissons ou d'inces diffrents termes dans des sens qu'ils sectes, prennent fixer. ont d pralablement l'ordre Notre premire tche doit donc tre de dterminer sous le nom de suide faits que nous nous proposons d'tudier cides. Pour cela, nous allons chercher si, parmi les diffrentes sortes de morts, il en est qui ont en commun des caractres assez objectifs pour pouvoir tre reconnus de tout observateur de bonne foi, assez spciaux pour ne pas se rencontrer ailleurs, mais, en mme temps, assez voisins de ceux que l'on met gnralement sons le nom de suicides pour que nous puissions, sans faire violence l'usage, conserver cette mme expression. tous S'il s'en rencontre, nous runirons sous cette dnomination les faits, sans exception, ces caractres distincqui prsenteront si la classe ainsi forme ne tifs, et cela sans nous inquiter ainsi ou, comprend pas tous les cas qu'on appelle d'ordinaire au contraire, en comprend qu'on est habitu appeler autrement. Car ce qui importe, ce n'est pas d'exprimer avec un peu de prcision la notion que la moyenne des intelligences s'est faite du suicide, mais c'est de constituer une catgorie d'objets sous qui, tout en pouvant tre, sans inconvnient, tiquette cette rubrique, c'est--dire soit fonde objectivement, corresde choses. ponde une nature dtermine Or, parmi les diverses espces de morts, il en est qui prsen-
INTRODUCTION. tent ce trait
3
qu'elles sont le fait de la victime elleparticulier d'un acte dont le patient est l'auteur; mme, qu'elles rsultent se retrouve et, d'autre part, il est certain que ce mme caractre du suicide. la base mme de l'ide qu'on se fait communment la nature intrinsque des actes qui proPeu importe, d'ailleurs, on se reprsente le duisent ce rsultat. Quoique, en gnral, un suicide comme une action positive et violente qui implique de force musculaire, il peut se faire qu'une certain dploiement ou une simple abstention attitude purement aient la ngative On se tue tout aussi bien en refusant de se mme consquence. nourrir qu'en se dtruisant par le fer ou le feu. Il n'est mme pas ncessaire que l'acte man du patient ait t l'antcdent immdiat de la mort pour qu'elle en puisse tre regarde comme le phnomne l'effet; le rapport de causalit peut tre indirect, ne change pas, pour cela, de nature. L'iconoclaste qui, pour les palmes du martyre, commet un crime de lseconqurir majest qu'il sait tre capital, et qui meurt de la main du bourest tout aussi bien l'auteur de sa propre fin que s'il reau, s'tait port lui-mme le coup mortel; du moins, il n'y a pas lieu de classer dans des genres diffrents ces deux varits de morts entre elles que clans volontaires, puisqu'il n'y a de diffrences les dtails matriels de l'excution. Nous arrivons donc cette premire formule : On appelle suicide toute mort qui rsulte mdiatement ou immdiatement d'un acte positif ou ngatif, accompli par la victime elle-mme. Mais cette dfinition est incomplte; elle ne distingue pas entre deux sortes de morts trs diffrentes. On ne saurait de la mme manire ranger dans la mme classe et traiter la mort de l'hallucin qui se prcipite d'une fentre leve parce sain qu'il la croit de plain-pied avec le sol, et celle de l'homme, ce qu'il fait. Mme, en un d'esprit, qui se frappe en sachant mortels qui ne soient la sens, il y a bien peu de dnouements ou prochaine ou lointaine de quelque dmarche du consquence patient. Les causes de mort sont situes hors de nous beaucoup plus qu'en nous et elles ne nous atteignent que si nous nous aventurons dans leur sphre d'action.
4
LE SUICIDE.
Dirons-nous qu'il n'y a suicide que si l'acte d'o la mort rsulte a t accompli par la victime en vue de ce rsultat? Que celui-l seul se tue vritablement qui a voulu se tuer et que le intentionnel de soi-mme? Mais d'asuicide est un homicide bord, ce serait dfinir le suicide par un caractre qui, quels et l'importance, tout au tre l'intrt aurait, qu'en puissent moins, le tort de n'tre pas facilement reconnaissable parce qu'il Comment savoir quel mobile a dn'est pas facile observer. c'est la mort termin l'agent et si, quand il a pris sa rsolution, mme qu'il voulait ou s'il avait quelque autre but? L'intention est chose trop intime pour pouvoir tre atteinte du dehors auElle se drobe trement que par de grossires approximations. mme l'observation intrieure. Que de fois nous nous mprenons sur les raisons vritables qui nous font agir! Sans cesse, nous expliquons par des passions gnreuses ou des considrations leves des dmarches de petits que nous ont inspires ou une aveugle routine. sentiments d'une manire gnrale, un acte ne peut tre dD'ailleurs, car un mme systme de fini par la lin que poursuit l'agent, sans changer de nature, peut tre ajust trop de mouvements, Et en effet, s'il n'y avait suicide que l o il y a fins diffrentes. de se tuer, il faudrait refuser cette dnomination intention des faits qui, malgr des dissemblances sont, au apparentes, ceux que tout le monde appelle ainsi, et qu'on fond, identiques moins de laisser le terme sans ne peut appeler autrement emploi. Le soldat qui court au devant d'une mort certaine pour ne veut pas mourir, sauver son rgiment et pourtant n'est-il ou pas l'auteur de sa propre mort au mme titre que l'industriel le commerant aux hontes de la qui se tuent pour chapper faillite? On en peut dire autant du martyr qui meurt pour sa foi, de la mre qui se sacrifie pour son enfant, etc. Que la mort comme une condition soit simplement accepte regrettable, du but o l'on tend, ou bien qu'elle soit expresmais invitable, sment voulue et recherche pour elle-mme, le sujet, dans un cas comme dans l'autre, renonce l'existence, et les diffrentes ne peuvent tre que des varits d'une manires d'y renoncer
INTRODUCTION.
5
fondamme classe. Il y a entre elles trop de ressemblances mentales pour qu'on ne les runisse pas sous la mme expressauf distinguer des espces ensuite dans le sion gnrique, Sans doute, vulgairement, le suicide est, genre ainsi constitu. d'un homme qui ne tient plus l'acte de dsespoir avant'tout, vivre. Mais, en ralit, parce qu'on est encore attach la vie au moment o on la quitte, on ne laisse pas d'en faire l'abandon; et, entre tous les actes par lesquels un tre vivant abandonne ainsi celui de tous ses biens qui passe pour le plus essenprcieux, il y a des traits communs qui sont videmment des mobiles qui peuvent avoir tiels. Au contraire, la diversit dict ces rsolutions ne saurait donner naissance qu' des diffrences secondaires. va jusqu'au Quand donc le dvouement de la vie, c'est scientifiquement un suicide ; sacrifice certain nous verrons plus tard de quelle sorte. Ce qui est commun toutes les formes possibles de ce reest acnoncement c'est que l'acte qui le consacre suprme, au de cause; c'est que la victime, compli en connaissance moment d'agir, sait ce qui doit rsulter de sa conduite, quelainsi. Tous que raison d'ailleurs qui l'ait amene se conduire les faits de mort qui prsentent cette particularit caractrisnettement de tous les autres o le patient tique se distinguent ou bien n'est pas l'agent de son propre dcs, ou bien n'en est Ils s'en distinguent que l'agent inconscient. par un caractre facile reconnatre, car ce n'est pas un problme insoluble que de savoir si l'individu connaissait ou non par avance les suites naturelles de son action. Ils forment donc un groupe dfini, discernable de tout autre et qui, par consquent, homogne, doit tre dsign par un mot spcial. Celui de suicide lui convient et il n'y a pas lieu, d'en crer un autre ; car la trs grande des faits qu'on appelle quotidiennement ainsi en fait gnralit : On appelle suicide tout partie. Nous disons donc dfinitivement cas de mort qui rsulte directement d'un acte ou indirectement et quelle positif ou ngatifs accompli par la victime elle-mme savait devoir produire ce rsultat. c'est l'acte La tentative, ainsi dfini, mais arrt avant que la mort en soit rsulte.
6
LE SUICIDE.
tout ce qui Cette dfinition suffit exclure de notre recherche concerne les suicides d'animaux. En effet, ce que nous savons de l'intelligence aux animale ne nous permet pas d'attribuer des btes une reprsentation anticipe de leur mort, ni surtout On en voit, il est vrai, qui remoyens capables de la produire. fusent de pntrer dans un local o d'autres ont t tues; on dirait qu'elles pressentent leur sort. Mais, en ralit, l'odeur du ce mouvement instinctif de recul. Tous sang suffit dterminer les cas un peu authentiques que l'on cite et o l'on veut voir des suicides proprement dits peuvent s'expliquer tout autrement. Si le scorpion irrit se perce lui-mme de son dard (ce qui, c'est probablement n'est pas certain), en vertu d'une d'ailleurs, raction et irrflchie. motrice, souleve automatique L'nergie se dcharge au hasard, comme elle par son tat d'irritation, peut ; il se trouve que l'animal en est la victime, sans qu'on puisse dire qu'il se soit reprsent de son par avance la consquence mouvement. s'il est des chiens qui refusent de se Inversement, nourrir quand ils ont perdu leur matre, c'est que la tristesse, a supprim dans laquelle ils taient plongs, mcaniquement la mort en est rsulte, mais sans qu'elle ait t prvue. l'apptit; dans l'autre n'ont t Ni le jene dans ce cas, ni la blessure des moyens dont l'effet tait connu. comme Les employs du suicide, tels que nous l'avons dfini, caractres distinctifs font donc dfaut. C'est pourquoi, dans ce qui suivra, nous n'aurons nous occuper que du suicide humain (1). Mais cette dfinition n'a pas seulement l'avantage de prvenir les rapprochements ou les exclusions arbitraires ; elle trompeurs nous donne ds maintenant une ide de la place que les suicides occupent de la vie morale. Elle nous clans l'ensemble (1) Reste un trs petit nombre de cas qui ne sauraient s'expliquer ainsi, mais qui sont plus que suspects. Telle l'observation, rapporte par Aristote, d'un cheval qui, en dcouvrant qu'on lui avait fait saillir sa mre, sans qu'il s'en apert et aprs qu'il s'y tait plusieurs fois refus, se serait intentionnellement prcipit du haut d'un rocher (Hist. des anim., IX, 47). Les leveurs assurent que le cheval n'est aucunement rfrac taire l'inceste. Voir sur toute cette question, Westcott, Suicide, p. 174-179.
INTRODUCTION.
7
montre, en effet, qu'ils ne constituent pas, comme on pourrait tout fait part, une classe isole de le croire, un groupe sans rapport avec les autres modes de monstrueux, phnomnes la conduite, mais, au contraire, qu'ils s'y relient par une srie Ils ne sont que la forme exagre de continue d'intermdiaires. En effet, il y a, disons-nous, usuelles. suicide quand pratiques la victime, au moment o elle commet l'acte qui doit mettre fin ce qui doit normalement en ses jours, sait de toute certitude Mais cette certitude rsulter. peut tre plus ou moins forte. et vous aurez un fait nouveau, Nuancez-la de quelques doutes, qui n'est plus le suicide, mais qui en est proche parent puisqu'il de degrs. n'existe entre eux que des diffrences Un homme mais sans qu'un dnouepour autrui, qui s'expose sciemment ment mortel soit certain, n'est pas, sans doute, un suicid, mme non plus que l'imprudent s'il arrive qu'il succombe, qui joue de l'viter, ou que l'apaparti pris avec la mort tout en cherchant thique qui, ne tenant vivement rien, ne se donne pas la peine de soigner sa sant et la compromet Et pourpar sa ngligence. manires tant, ces diffrentes d'agir ne se distinguent pas radidits. Elles procdent calement des suicides proprement d'tats entranent des risques d'esprit analogues, galement puisqu'elles mortels qui ne sont pas ignors de l'agent, et que la perspective de ces risques ne l'arrte pas; toute la diffrence, c'est que les chances de mort sont moindres. Aussi n'est-ce pas sans quelque du savant qui s'est puis en fondement qu'on dit couramment Tous ces faits constituent donc veilles, qu'il s'est tu lui-mme. des sortes de suicides embryonnaires, et, s'il n'est pas d'une bonne mthode de les confondre avec le suicide complet et dde velopp, il ne faut pas davantage perdre de vue les rapports avec ce dernier. Car il apparat sous parent qu'ils soutiennent un tout autre aspect, une fois qu'on a reconnu qu'il se rattache sans solution de continuit aux actes de courage et de dvoueaux actes d'imprudence et de ment, d'une part, et, de l'autre, On verra mieux clans la suite ce que ces rapsimple ngligence. ont d'instructif. prochements
LE SUICIDE.
IL
le sociologue? PuisMais le fait ainsi dfini intresse-t-il qui n'affecte que l'inque le suicide est un acte de l'individu il semble qu'il doive exclusivement de facdividu, dpendre et qu'il ressortisse, la seule teurs individuels par consquent, En fait, n'est-ce du suipas par le temprament psychologie. cid, par son caractre, par les vnements par ses antcdents, sa rsolution? de son histoire prive que l'on explique d'ordinaire Nous n'avons dans quelle pour l'instant pas rechercher il est lgitime mesure et sous quelles conditions d'tudier ainsi mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent tre les suicides, sous un tout autre aspect. En effet, si, au lieu de envisags isols les uns des particuliers, n'y voir que des vnements tre examins chacun part, on autres et qui demandent des suicides commis dans une socit donl'ensemble considre une unit de temps donne, on constate ne pendant que le total ainsi obtenu n'est pas une simple somme d'units indpenmais qu'il constitue un tout de collection, dantes, par lui-mme et sui generis, un fait nouveau qui a son unit et son indiviet que, de plus, cette dualit, sa nature propre par consquent, sociale. En effet, pour une mme socit, nature est minemment ne porte pas sur une priode trop tentant que l'observation comme le prouve le due, ce chiffre est peu prs invariable, les cirtableau I (V. p. 9). C'est que, d'une anne la suivante, se dveloppe la vie des peuples au milieu desquelles constances les mmes. Il se produit bien parfois des sensiblement restent mais elles sont tout fait l'excepvariations plus importantes; tion. On peut voir, d'ailleurs, qu'elles sont toujours contempol'tat social (1). raines de quelque crise qui affecte passagrement (1) Nous avons mis entre parenthses les nombres qui se rapportent ces annes exceptionnelles.
INTRODUCTION. TABLEAU Constance du suicide dans les principaux ANNES. 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 I pays d'Europe
9.
(Chiffres absolus).
FRANCE. PRUSSE.:ANGLETERRE SAXE. BAVIRE. DANEMARK. 2.814 2.866 3.020 2.973 3.082 3.102 (3.647) (3.301) 3.583 3.596 3.598 3.676 3.415 3.700 3.810 4.189 3.967 3.903 3.899 4.050 4.454 4.770 4.613 4.521 4946 5.119 5.011 (5.547) 5.114 1.630 1.598 1.720 1.575 1.700 1.707 (1.852) (1.649) (1-527) 1-736 1.809 2.073 1.942 2.198 2.351 2.377 2.038 2.126 2.146 2.105 2.185 2.112 2.374 2.203 2.361 2.485 3.625 3.658 3.544 3.270 3.135 3.467 : 290 318 420 335 338 373 377 398 (328) 390 402 530 431 547 568 550 485 491 507 548 (643) 557 643 (545) 619 704 752 800 710 337 317 301 285 290 376 345 (305) 337 340 401 426 419 363 399 426 427 457 451 468
1.349 1,275 1.248 1.365 1.347 1.317 1.315 1.340 1.392 1.329 1.316 1.508 1.588 1.554 1.495 1.514
244 250 220 217 215 (189) 250 260 226 263 318 307 318 286 329 387 339
410 471 453 425
411 451 443 469 498 462 486
C'est ainsi qu'en 1848 une baisse brusque les Etats europens. Si l'on considre un plus long intervalle state des changements Mais plus graves. ils tmoignent donc simplement chroniques; constitutionnels de la socit ont subi, au
a eu lieu
dans
tous
de temps, on conalors ils deviennent que les caractres de mme moment,
10
LE SUICIDE.'
de remarquer modifications. Il est intressant qu'ils profondes lenteur que leur ont attrine se produisent pas avec l'extrme mais ils sont nombre bue un assez grand d'observateurs; et progressifs. Tout coup, aprs une srie la fois brusques o les chiffres ont oscill entre des limites trs rapprod'annes en se manifeste une hausse ches, qui, aprs des hsitations et enfin se fixe. C'est que s'accentue sens contraires, s'affirme, de l'quilibre toute rupture social, si elle clate soudainement, produire toutes ses consquences. du temps met toujours d'ondes de mouvedu suicide est ainsi compose L'volution se distinctes et successives, ment, qui ont lieu par pousses, un temps, puis s'arrtent pour recomdveloppent pendant ensuite. On peut voir sur le tableau prcdent mencer qu'une dans toute l'Europe au lende ces ondes s'est forme presque vers les annes demain des vnements de 1848, c'est--dire selon les pays; une autre a commenc en Allemagne 1850-1853 aprs la guerre de 1866, en France un peu plus tt, vers 1860, du gouvernement l'poque qui marque l'apoge en imprial, vers 1868, c'est--dire commeraprs la rvolution Angleterre alors les traits de commerce. ciale que dterminrent Peuttre est-ce la mme cause qu'est due la nouvelle recrudescence que l'on constate chez nous vers 1865. Enfin, aprs la mouvement en avant a commenc guerre de 1870 un nouveau qui dure encore et qui est peu prs gnral en Europe (1). moment de son histoire, Chaque socit a donc, chaque dfinie pour le suicide. On mesure l'intensit une aptitude relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre et la population de tout ge et de global des morts volontaires tout sexe. Nous appellerons cette donne numrique taux de la mortalit-suicide la socit considre. On le calcule propre un million ou cent mille habipar rapport gnralement tants. (1) Dans le tableau, nous avons reprsent alternativement par des chiffres ordinaires ou par des chiffres gras les sries de nombres qui reprsentent ces diffrentes ondes de mouvement, afin de rendre matriellement sensible l'individualit de chacune d'elles.
INTRODUCTION.
11
ce taux est constant de longues Non seulement pendant pen est mme plus grande mais l'invariabilit riodes de temps, La phnomnes dmographiques. que celle des principaux varie mortalit notamment, gnrale, beaucoup plus souvent et les variations elle passe d'une anne l'autre par lesquelles Pour s'en assurer, il suffit de sont beaucoup plus importantes. la manire dont voluent comparer, pendant plusieurs priodes, l'un et l'autre C'est ce que nous avons fait au phnomne. le rapprochement, tableau II (V. p. 12). Pour faciliter nous avons, tant pour les dcs que pour les suicides, exprim le taux anne en fonction du taux moyen de chaque de la priode, d'une anne l'autre ramen 100. Les carts ou par rapport au taux moyen sont, ainsi rendus dans les deux comparables colonnes. Or, il rsulte de cette comparaison qu' chaque priode des variations est beaucoup du ct plus considrable l'ampleur de la mortalit elle est, en gnrale que du ct des suicides; minimum entre deux fois plus grande. Seul, l'cart moyenne, deux annes conscutives est sensiblement de mme importance de part et d'autre les deux dernires Seupendant priodes. ce minimum est une exception dans la colonne des lement, les variations annuelles des suicides dcs, alors qu'au contraire ne s'en cartent On s'en aperoit en qu'exceptionnellement. les carts moyens (1). comparant Il est vrai que, si l'on compare, non plus les annes successives d'une mme mais les moyennes de priodes priode, les variations dans le taux de la diffrentes, que l'on observe mortalit deviennent Les changements presque insignifiantes. en sens contraires et qui l'autre qui ont lieu d'une anne sont dus l'action de causes se et accidentelles, passagres neutralisent mutuellement on prend quand pour base du calcul une unit de temps plus tendue; ils disparaissent donc du chiffre une assez moyen qui, par suite de cette limination, prsente de 1841 1870. il a t grande invariabilit. Ainsi, en France, (1) Wagner avait dj compar de cette manire la mortalit et la nuptialit (Die Gesetzmssigkeit, etc., p. 87).
12
LE SUICIDE. TABLEAU II et du taux
Variations compares du taux de la mortalit-suicide de la mortalit gnrale. A. Chiffres absolus.
DECES DECES DECES SUICIDES SUICIDES SUICIDES Par PRIODE par PRIODE par PRIODE par par par par par par 1000 100.000 1.000 1849-55. 100.000 1.000 1856-60. 100.000 habi1841-46. habihabitants. habitants. habitants. 1841 1842 1843 1844 1845 1846 8,2 8,3 8,7 8,5 8,8 8,7 23,2 24,0 23,1 22,1 21,2 23,2 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 10,0 10,1 10,0 10,5 9,4 10,2 10,5 10,1 27,3 1856 21,4 1857 22,3 1858 22,5 1859 22,0 1860 27,4 25,9 11,6 10,9 10,7 11,1 11,9 23,1 23,7 24,1 26,8 21,4
22,8 Moyennes. Moyennes. 8,5 11,2 23,8 24,1 Moyennes. B. Taux de chaque anne exprim en fonction de la moyenne ramene 100. 1841 96 101,7 1849 98,9 113,2 1856 103,5 97 1842 97 100 105,2 1850 97,3 99,3 88,7 1857 1843 102 101,3 1851 95,5 101,2 98,9 92,5 1858..... 1844 100 96,9 1852 99,1 112,6 103,8 93,3 1859 1845 93 103,5 92,9 1853 91,2 1860 106,0 89,9 1846 102,3 101,7 1854 100,9 113,6 1855 103 107,4 100 Moyennes. 100 100 Moyennes. 100 100 Moyennes. 100 C. Grandeur de l'cart. ENTRE DEUX AU-DESSUS ANNES conscutives. et au-dessous moyenne. dela Ecart maximum Mortalit gnrale. Taux des suicides.) Mortalit gnrale. Taux des suicides Mortalit gnrale. Taux des suicides. 8,8 5,0 24,5 10,8 22,7 6,9 Ecart minimum. 2,5 1 0,8 1,1 1,9 1,8 moyen Maximum Maximum au-dessous. au-dessus. 4,0 2,8 11,3 7,0 10,1 4,5
PRIODE 1841-46. 4,9 7,1 4 2,5 PRIODE 1849-55. 10,6 13,6 3,8 4,48 PRIODE 1856-60. 9,57 12,6 6,0 4,82
INTRODUCTION.
13
successivement dcennale, 23,18 ; 23,72; pour chaque priode c'est un fait remarquable Mais d'abord, 22,87. dj que anne l suivante, un degr de consle suicide ait, d'une celui que la mortalit tance au moins gal, sinon suprieur, priode. De plus, le ne manifeste que de priode gnrale cette rgularit n'atteint taux moyen de la mortalit qu'en chose de gnral et d'impersonnel devenant quelque qui ne caractriser une socit peut servir que trs imparfaitement En effet, il est sensiblement le mme pour tous les dtermine. peu prs la mme civilisation; peuples qui sont parvenus sont trs faibles. en France, les diffrences du moins, Ainsi, de le voir, il oscille, de 1841 1870, comme nous venons le mme autour de 23 dcs pour 1.000 habitants; pendant en Belgique de 23,93, de 22,5, temps, il a t successivement en Angleterre de 22,32, de 22,21, de 22,68; en de 24,04; Danemark de 22,65 de 20,44 de 20,4 (1855-59), (1845-49), Si l'on fait abstraction de la Russie (1861-68). qui n'est encore les seuls europenne grands que pays gographiquement, o la dme mortuaire un peu s'carte d'une manire d'Europe des chiffres sont l'Italie o elle s'levait marque prcdents encore de 1861 1867 jusqu' o elle tait 30,6 et l'Autriche encore (32,52) (1). Au contraire le taux des plus considrable en mme temps qu'il n'accuse chansuicides, que de faibles varie suivant les socits du simple au gements annuels, au triple, au quadruple et mme davantage double, (V. Tableau III, p. 14). Il est donc, un bien plus haut degr que le taux de la mortalit, chaque social dont il personnel groupe comme un indice caractristique. Il est mme peut tre regard si troitement li ce qu'il y a de plus profondment constitutionnel dans chaque temprament dans national, que l'ordre sous ce rapport, les diffrentes socits reste lequel se classent, le mme des poques trs diffrentes. presque rigoureusement C'est ce que prouve Au cours des l'examen de ce mme tableau. (1) D'aprs Bertillon, article Mortalit des sciences mdicales, t. LXI, p. 738. du Dictionnaire Encyclopdique
14
LE SUICIDE. TABLEAU III
Taux des suicides par million d'habitants dans les diffrents pays d'Europe. I PRIODE 1866-70. 1871- 1874-78. 75. Italie Belgique Angleterre Norwge Autriche Sude Bavire .. France..Prusse Danemark Saxe 30 66 67 76 78 85 90 135 142 277 293 35 69 66 73 94 81 91 150 134 258 267 38 78 69 71 130 91 100 160 152 255 334 NUMROS 'ORDRE LA D A 1epriode. 2epriode. 3epriode. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 2 4 7 5 6 9 8 10 11 1 4 2 3 7 5 6 9 8 10 11
le suicide s'est partout priodes qui y sont compares, en avant, les divers accru; mais, dans cette marche peuples ont gard leurs distances Chacun a son coefficient respectives. d'acclration qui lui est propre. Le taux des suicides constitue donc un ordre de faits un et c'est ce que dmontrent, la fois, sa permanence dtermin; et sa variabilit. Car cette permanence serait s'il inexplicable ne tenait pas un ensemble de caractres solidaires distinctifs, les uns des autres, la diversit des circonstances qui, malgr et cette variabilit ts'affirment simultanment; ambiantes, de la nature individuelle et concrte de ces mmes moigne sociale ellevarient comme l'individualit caractres, puisqu'ils mme. En somme, ce qu'expriment ces donnes statistiques, au suicide socit est collecc'est la tendance dont chaque en tivement Nous n'avons afflige. pas . dire actuellement si elle est un tat sui generis cette tendance, quoi consiste de l'me collective sa ralit ou si elle ne (1), ayant propre, trois (1) Bien entendu, en nous servant de cette expression nous n'entendons pas du tout hypostasier la conscience collective. Nous n'admettons pas plus
INTRODUCTION.
15
somme d'tats individuels. Bien que les conqu'une reprsente soient difficilement conciliabies avec sidrations qui prcdent nous rservons le problme cette dernire hypothse, qui sera trait au cours de cet ouvrage (1). Quoi qu'on pense ce sujet, existe soit un titre soit est-il que cette tendance toujours fournir un contingent l'autre. Chaque socit est prdispose Cette prdisposition de morts volontaires. dtermin peut donc et qui ressortit la sociologie. tre l'objet d'une tude spciale C'est cette tude que nous allons entreprendre. n'est donc pas de faire un inventaire Notre intention aussi entrer qui peuvent complet que possible de toutes les conditions dans la gense des suicides mais seulement de particuliers, rechercher ce fait dfini que nous avons celles dont dpend On conoit que les deux quesappel le taux social des suicides. tions sont trs distinctes, quelque rapport qu'il puisse, par indiailleurs, y avoir entre elles. En effet, parmi les conditions il y en a certainement viduelles,' beaucoup qui ne sont pas assez gnrales pour affecter le rapport entre le nombre total des morts volontaires et la population. Elles peuvent faire, peut-tre, que tel ou tel individu isol se tue, non que la socit in globo ait De mme pour le suicide un penchant plus ou moins intense. ne tiennent tat de l'organisation qu'elles pas un certain sociaux. Par suite, elles sociale, elles n'ont pas de contre-coups intressent le psychologue, non le sociologue. Ce que recherche ce dernier, il ce sont les causes par l'intermdiaire desquelles est possible d'agir, non sur les individus mais sur le isolment, Par consquent, les facteurs des suicides, les groupe. parmi seuls qui le concernent sont ceux qui font sentir leur action sur l'ensemble de la socit. Le taux des suicides est le produit de ces facteurs. nous devons nous y tenir. C'est pourquoi Tel est l'objet trois pardu prsent travail qui comprendra ties. Le phnomne ne peut tre d qu' qu'il s'agit d'expliquer d'me substantielle dans la socit que dans l'individu. d'ailleurs, sur ce point. (1) V. L. III, ch. I. Nous reviendrons,
16
LE SUICIDE.
extra-sociales d'une ou des des causes gnralit grande causes sociales. Nous nous demanderons d'abord proprement des premires et nous verrons est quelle est l'influence qu'elle nulle ou trs restreinte. Nous dterminerons ensuite la nature des causes la sociales, avec dont elles produisent leurs effets, et leurs relations manire les tats individuels les diffrentes sortes de qui accompagnent suicides. Cela fait, nous serons en quoi mieux en tat de prciser consiste l'lment c'est--dire cette tendance social du suicide, de parler, dont nous venons collective quels sont ses rapports il est possible avec les autres faits sociaux et par quels moyens d'agir sur elle (1). (1) On trouvera en tte de chaque chapitre, quand il y a lieu, la bibliographie spciale des questions particulires qui y sont traites. Voici les indications relatives la bibliographie gnrale du suicide. I. Publications statistiques officielles dont nous nous sommes principalement servi : Oesterreischische Statistik (Statistik des Sanittswesens). Annuaire statistique de la Belgique. Zeitschrift des Koeniglisch Bayerischen statistischen bureau. Preussische Statistik (Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersclassen der gestorbenen). Wrtembrgische Iahrbcher fr Statistik und Landeskunde. Badische Statistik. Tenth Census of the United States. Report on the Mortality and vital statistic of the United States 1880, 11e partie. Aunuario statistico Italiano. Statistica delle cause delle Morti in tutti i communi del Regno. Relazione medico-statistica sulle conditione sanitarie dell' Exercito Italiano.. Statistische Nachrichten des Grossherzogthums Oldenburg. Compte-rendu gnral de l'administration de la justice criminelle en France. Statistisches Iahrbuch der Stadt Berlin. Statistik der Stadt Wien. Statistisches Handbuch fr den Hamburgischen Staat. Jahrbuch fur die amtliche Statistik der Bremischen Staaten. Annuaire statistique de la ville de Paris. On trouvera en outre des renseignements utiles dans les articles suivants : Platter, Ueber die Selbstmorde in Oesterreich in den Iahren 1819-1872. In Statut. Monatsch., 1876. Brattassvic, Die Selbstmorde in Oesterreich in den Iahren 1873-77, In Stat. Monatsch., 1878, p. 429. Ogle, Suicides in England and Wales in relation to Age, Sexe, Season and Occupation. In Journal of the statistical Society, 1886. Rossi, Il Suicidionella Spagna nel 1884. Arch. di psychiatria, Turin, 1886.
INTRODUCTION.
17
II. Etudes sur le suicide en gnral. De Guerry, Statistique morale de la France, Paris, 1835, et Statistique morale compare de la France et de l'Angleterre, Paris, 1864. Tissot, De la manie du suicide et de l'esprit de rvolte, de leurs causes et de leurs remdes, Paris, 1841. Etoc-Demazy, Recherches statistiques sur le suicide, Paris, 1844. Liste, Du suicide, Paris, 1856. Wappus, Allgemeine Bevlkerungsstatistik, Leipzig, 1861. Wagner, Die Geseizrnssigkeit in den scheinbar willkrlichen menschlichen Handlungen, Hambourg, 1864, 2e partie. Brierre de Boismont, Du suicide et de la folie-suicide, Paris, Germer Baillire, 1865. Douay, Le suicide ou la mort volontaire, Paris, 1870. Leroy, Etude sur le suicide et les maladies mentales dans le dpartement de Seine-et-Marne, Paris, 1870. Oettingen, Die Moralstatistik, 3e Auflage, Erlangen, 1882, p. 786-832 et tableaux annexes 103-120. Du mme, Ueber acuten und chronischen Selbstmord, Dorpat, 1881. Morselli, Il suicidio, Milan, 1879. Legoyt, Le suicide ancien et moderne, Paris, 1881. Masaryk, Der Selbstmord ah sociale Massenerscheinung, Vienne, 1881. Westcott, Suicide, its history, littrature, etc., Londres, 1885. Motta, Bbliografia del Suicidio, Bellinzona, 1890. Corre, Crime et suicide, Paris, 1891. Bonomelli, Il Suicidio, Milan, 1892. Mayr, Selbstmordstatistik, In Handwrterbuch der Staatswissenschaften, herausgegeben von Conrad, Erster Supplementband, Iena, 1895.
DURKHEIM.
19
LIVRE LES FACTEURS
PREMIER EXTRA-SOCIAUX
CHAPITRE Le suicide et les tats
I psychopathiques (1).
on peut Il y a deux sortes de causes extra-sociales auxquelles sur le taux des suicides : ce sont une influence a priori attribuer et la nature du milieu phyles dispositions organico-psychiques se faire que, dans la constitution individuelle sique. Il pourrait d'une classe importante ou, tout au moins, clans la constitution il y et un penchant, d'intensit variable selon les d'individus, directement l'homme au suicide; d'un pays, et qui entrant autre ct, le climat, la temprature, etc., pourraient, par la manire dont ils agissent sur l'organisme, avoir indirectement les mmes effets. en tout cas, ne peut pas tre L'hypothse, (1) Bibliographie. Falret, De l'hypocondrie et du suicide, Paris, 1822. Esquirol, Des maladies mentales, Paris, 1838 (t. I, p. 526-676) et article Suicide, in Dictionnaire de mdecine, en 60 vol. Cazauvieilh, Du suicide et de l'alination mentale, Paris, 1840. Etoc Demazy, De la folie dans la production du suicide, in Annales mdico-psych., 1844. Bourdin, Du suicide considr comme maladie, Paris, 1845. Dechambre, De la, monomanie homicide-suicide, in Gazette mdic, 1852. Jousset, Du suicide et de la monomanie suicide, 1858. Brierre de Boismont, op. cit. Leroy, op. cit. Art. Suicide, du Dictionnaire de mdecine et de chirurgie pratique, t. XXXIV, P. 117. Strahan, Suicide and Insanity, Londres, 1824. Lunier, De la production et de la consommation des boissons alcooliques en France, Paris, 1877. Du mme, art. in Annales mdico-psych., 1872 ; Journal de la Soc. de stat., 1878. Prinzing, Trunksucht und Selbstmord, Leipzig, 1895.
20
LE SUICIDE.
sans discussion. Nous cillons donc examiner successivecarte s'ils ont, en ment ces deux ordres de facteurs et chercher effet, une part dans le phnomne que nous tudions et quelle elle est.
I. consIl est des maladies dont le taux annuel est relativement tant pour une socit donne, en mme temps qu'il varie assez suivant les peuples. Telle est la folie. Si donc on sensiblement avait quelque raison de voir dans toute mort volontaire une le problme manifestation vsanique, que nous nous sommes affection indivipos serait rsolu ; le suicide ne serait qu'une duelle (1). C'est la thse soutenue alinistes. Suipar d'assez nombreux vant Esquirol : Le suicide offre tous les caractres des alinations mentales (2) . L'homme n'attente ses jours que est dans le dlire et les suicids sont alins (3) . Parlorsqu'il tant de ce principe, il concluait que le suicide, tant involontaire, ne devait pas tre puni par la loi. Falret (4) et Moreau de Tours dans des termes presque identiques. Il est vrai que s'expriment ce dernier, dans le passage mme o il nonce la doctrine fait une remarque suslaquelle il adhre, qui suffit la rendre pecte : Le suicide, dit-il, doit-il tre regard dans tous les cas d'une alination Sans vouloir ici comme le rsultat mentale? trancher cette difficile question, disons en thse gnrale qu'inson penche d'autant tinctivement que l'on plus vers l'affirmative a fait de la folie une tude plus approfondie, que l'on a acquis on a vu plus d'alins (5) . En et qu'enfin plus d'exprience (1) Dans la mesure o la folie est elle-mme purement individuelle. En ralit, elle est, en partie, un phnomne social. Nous reviendrons sur ce point. (2) Maladies mentales, t. I, p. 639. (3) Ibid., t. I, p. 665. (4) Du suicide, etc., p. 137. (5) In Annales mdico-psych., t. VII, p. 287.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
21
dans une brochure qui, lors de son 1845, le docteur Bourdin, fit quelque bruit dans le monde mdical, avait, avec apparition, moins de mesure encore, soutenu la mme opinion. de deux manires Cette thorie peut tre et a t dfendue le suicide condiffrentes. Ou bien on dit que, par lui-mme, ou bien, stitue une entit morbide sui generis, une folie spciale; on y voit simplement sans en faire une espce un distincte, sortes de folies, mais qui ne se pisode d'une ou de plusieurs La premire rencontre pas chez les sujets sains d'esprit. thse est au contraire, est le reprsentant le celle de Bourdin; Esquirol, D'aprs ce qui prcde, ditplus autoris de l'autre conception. il, on entrevoit dj que le suicide n'est pour nous qu'un phno un grand nombre de causes diverses, mne conscutif qu'il se trs diffrents; montre avec des caractres que ce phnomne ne peut caractriser une maladie. C'est pour avoir fait du suicide une maladie sui generis qu'on a tabli des propositions gnrales dmenties par l'exprience (1) . De ces deux faons de dmontrer le caractre du vsanique et la moins probante suicide, la seconde est la moins rigoureuse en vertu de ce principe nqu'il ne peut y avoir d'expriences en effet, de procder un inventaire gatives. Il est impossible, complet de tous les cas de suicides et de faire voir dans chacun d'eux l'influence de l'alination mentale. On ne peut que citer des exemples particuliers qui, si nombreux qu'ils soient, ne peuvent servir de base une gnralisation scientifique; quand mme des exemples contraires il y en aurait ne seraient pas allgus, Mais l'autre si elle peut tre adtoujours de possibles. preuve, serait concluante. tablir que le Si l'on parvient ministre, suicide est une folie qui a ses caractres et son volupropres tion distincte, la question est tranche ; tout suicid est un fou,. Mais existe-t-il une folie-suicide? (1) Maladies mentales, t. I, p. 528.
22
LE SUICIDE.
IL
La tendance au suicide tant, par nature, et dfinie, spciale si elle constitue une varit de la folie, ce ne peut tre qu'une folie partielle et limite un seul acte. Pour qu'elle puisse caractriser un dlire, il faut qu'il porte sur ce uniquement seul objet; car s'il en avait de multiples, il n'y aurait pas de raison pour le dfinir par l'un d'eux plutt que par les autres. Dans la terminologie traditionnelle de la pathologie mentale, on appelle monomanies ces dlires restreints. Le monomane est un malade dont la conscience est parfaitement saine, sauf en un point; il ne prsente tare et nettement locaqu'une lise. Par exemple, il a par moments une envie irraisonne et absurde de boire ou de voler ou d'injurier; mais tous ses autres actes comme toutes ses autres penses sont d'une rigoureuse correction. Si donc il y a une folie-suicide, elle ne peut tre qu'une monomanie et c'est bien ainsi qu'on l'a le plus souvent qualifie (1). on s'explique Inversement, que, si l'on admet ce genre particulier de maladies on ait t facilemonomanies, appeles ment induit y faire rentrer le suicide. Ce qui caractrise, en mme que nous effet, ces sortes d'affections, d'aprs la dfinition venons c'est qu'elles de rappeler, n'impliquent pas de troubles dans le fonctionnement essentiels intellectuel. Le fond de la est le mme chez le monomane vie mentale et chez l'homme sain d'esprit; chez le premier, un tat psychique seulement, dtermin se dtache de ce fond commun par un relief exceptionnel. La monomanie, en effet, c'est simplement, dans l'ordre des tendances, une passion et, dans l'ordre des reprexagre mais d'une telle intensit une ide fausse, sentations, qu'elle obsde et lui enlve toute libert. Par exemple, de l'esprit (1) V. Brierre de Boismont, p. 140.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
23
maladive et se change en monodevient l'ambition normale, des proportions elle prend telles manie des grandeurs quand en sont comme crbrales paraque toutes les autres fonctions un peu violent mouvement de la lyses. Il suffit donc qu'un mental pour que la monosensibilit vienne troubler l'quilibre manie apparaisse. Or, il semble bien que les suicides sont gnde quelque ralement anormale, passion placs sous l'influence d'un seul coup ou ne la dveque celle-ci puise son nergie on peut mme croire avec une apparence loppe qu' la longue; force de ce genre de raison qu'il faut toujours pour quelque D'autre si fondamental, de conservation. neutraliser l'instinct, de suicids, en dehors de l'acte spcial par part, beaucoup fin leurs jours, ne se singularisent auculequel ils mettent nement des autres hommes; il n'y a, par consquent, pas de raison pour leur imputer un dlire Voil comment, gnral. sous le couvert de la monomanie, le suicide a t mis au rang des vsanies. des monomanies? Pendant Seulement, y a-t-il longtemps, leur existence n'a pas t mise en cloute; l'unanimit des alinistes admettait, sans discussion, la thorie des dlires partiels. Non seulement on la croyait dmontre par l'observation comme un corollaire des enseiclinique, mais on la prsentait de la psychologie. alors que l'esprit On professait gnements humain est form de facults distinctes et de forces spares mais sont susceptibles qui cooprent d'ordinaire, d'agir isoltre sparment ment; il semblait donc naturel qu'elles pussent touches de l'homme par la maladie. Puisque peut manifester sans volont et de la sensibilit sans intelligence, l'intelligence ne pourrait-il de l'intellipourquoi pas y avoir des maladies et vice sans troubles de la sensibilit gence ou de la volont versa? En appliquant le mme principe aux formes plus spciales de ces facults, on en arrivait admettre que la lsion sur une tendance, sur une action pouvait porter exclusivement ou sur une ide isole. abanest universellement cette opinion Mais, aujourd'hui, donne. on ne peut pas directement dmontrer Assurment,
24
LE SUICIDE.
mais il. est par l'observation qu'il n'y a pas de monomanies; n'en peut pas citer un seul exemple incontest. tabli qu'on n'a pu atteindre une tendance Jamais clinique l'exprience de vritable clans un tat maladive de l'esprit isolement; le sont en toutes les fois qu'une facult est lse, les autres de la monomanie n'ont mme temps et, si les partisans pas c'est qu'ils ont mal dirig ces lsions concomitantes, aperu Prenons dit Falret, un leurs observations. pour exemple, alin proccup d'ides et que l'on classerait religieuses parmi Il se dit inspir de Dieu ; charg les monomanes religieux. d'une mission il apporte au monde une nouvelle relidivine, Cette ide, direz-vous, est tout fait folle, mais, en gion... dehors de cette srie d'ides il raisonne comme les religieuses, autres Eh bien! hommes. avec plus de soin et interrogez-le vous ne tarderez chez lui d'autres ides malapas dcouvrir vous trouverez, aux ides dives; par exemple, paralllement une tendance Il ne se croira pas seulereligieuses, orgueilleuse. ment appel rformer la religion, mais rformer la socit; aussi s'imaginera-t-il tre rserv la plus haute despeut-tre tine... Admettons avoir recherch chez ce malade qu'aprs des tendances vous ne les ayez pas dcouvertes, orgueilleuses, alors vous constaterez des ides d'humilit ou des tendances Le malade, craintives. d'ides se croira proccup religieuses, ne destin prir, etc. (1) . Sans doute, tous ces dlires perdu, se rencontrent runis chez un mme sujet, pas habituellement mais ce sont ceux que l'on trouve le plus souvent ou ensemble; moment de la bien, s'ils ne coexistent pas un seul et mme on les voit se succder des phases maladie, plus ou moins rapproches. de ces manifestations Enfin, indpendamment particulires, il y a toujours chez les prtendus monomanes un tat gnral de toute la vie mentale et qui est le fond mme de la maladie dont ces ides dlirantes ne sont que l'expression superficielle et temporaire. Ce qui le constitue, c'est une exaltation exces(1) Maladies mentales, 437.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
25
ou une perversion sive ou une dpression extrme, gnrale. absence Il y a surtout et de coordination dans la d'quilibre dans l'action. Le malade et cepenraisonne, pense comme dant ses ides ne s'enchanent pas sans lacunes ; il ne se conduit mais sa conduite de suite. absurde, pas d'une manire manque Il n'est donc pas exact de dire que la folie puisse se faire sa ; ds qu'elle part, et une part restreinte l'entendement, pntre elle l'envahit tout entier. le principe sur lequel on appuyait des D'ailleurs, l'hypothse monomanies est en contradiction avec les donnes actuelles de la science. L'ancienne thorie des facults ne compte plus gure de dfenseurs. On ne voit plus dans les diffrents modes de l'activit consciente des forces et spares qui ne se rejoignent ne retrouvent leur unit qu'au sein d'une substance mtaphyil est donc impossible sique, mais des fonctions solidaires; que l'une soit lse sans que cette lsion retentisse sur les autres. Cette pntration est mme plus intime dans la vie crbrale : car les fonctions que dans le reste de l'organisme psychiques n'ont pas des organes assez distincts les uns des autres pour que l'un puisse tre atteint sans que les autres le soient. Leur rpartition entre les diffrentes n'a rien de de l'encphale rgions bien dfini, comme le prouve la facilit avec laquelle les diffrentes parties du cerveau se remplacent si l'une mutuellement, d'elles se trouve empche de remplir sa tche. Leur enchevtrement est donc trop complet pour que la folie puisse frapper les unes en laissant les autres intactes. A plus forte raison, est-il tout fait impossible qu'elle puisse altrer une ide ou un sentiment sans que la vie psychique soit altre dans particulier sa racine. Car les reprsentations et les tendances n'ont pas d'existence subde petites propre ; elles ne sont pas autant d'atomes stances, forment spirituels qui, en s'agrgeant, l'esprit. Mais elles ne font que manifester extrieurement l'tat gnral des centres conscients et elles l'expriment. ; elles en drivent Par consquent, elles ne peuvent avoir de caractre morbide sans que cet tat soit lui-mme vici. Mais si les tares mentales ne sont pas susceptibles de se
26
LE SUICIDE.
il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de monomanies localiser, dites. Les troubles, en apparence locaux, proprement que l'on a appels de ce nom rsultent d'une perturbation plus toujours ils sont, non des maladies, mais des accidents tendue; particuliers et secondaires Si donc il n'y de maladies plus gnrales. a pas de monomanies, il ne saurait y avoir une monomaniesuicide le suicide n'est pas une folie diset, par consquent, tincte.
III.
possible qu'il n'ait lieu qu' l'tat de folie. Si, il n'est pas une vsanie il n'est pas de par lui-mme, spciale, o il ne puisse apparatre. forme de la vsanie Ce n'en est qu'un mais qui est frquent. Peut-on conclure syndrme pisodique, de cette frquence qu'il ne se produit jamais l'tat de sant et mentale? qu'il est un indice certain d'alination serait prcipite. Car si, parmi les actes des La conclusion et qui peuvent il en est qui leur sont propres, servir alins, au contraire, leur sont communs la folie, d'autres, caractriser les hommes tout en revtant chez les fous une avec sains, A priori, il n'y a pas de raison forme spciale. pour classer le de ces deux catgories. Sans cloute, les suicide dans la premire affirment des suicids alinistes que la plupart qu'ils ont connus de l'alination tous les signes mais ce mentale, prsentaient suffire rsoudre la question; ne saurait car de tmoignage revues sont beaucoup d'une trop sommaires. D'ailleurs, pareilles on ne saurait aussi troitement induire spciale, exprience loi gnrale. Des suicids qu'ils ont connus et qui, naaucune des alins, on ne peut conclure taient ceux turellement, n'ont et qui, pourtant, sont les plus nompas observs qu'ils breux. La seule manire de procder consiste mthodiquement leurs proprits les suicides commis classer, d'aprs essentielles, Mais
il reste
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
27
ainsi les types principaux de suicides par les fous, de constituer si tous les cas de morts volontaires et de chercher vsaniques En d'autres dans ces cadres nosologiques. rentrent termes, pour est un acte spcial aux alins, il faut dsavoir si le suicide mentale et voir terminer les formes qu'il prend dans l'alination .ensuite si ce sont les seules qu'il affecte. se sont peu attachs, en gnral, classer les Les spcialistes On peut cependant considrer suicides d'alins. que les quatre renferment les espces les plus importantes. Les types suivants de cette classification sont emprunts Jousset traits essentiels et Moreau de Tours (1). Il est d soit des hallucinations, I. Suicide maniaque. soit des conceptions dlirantes. Le malade se tue pour chapper un danger ou une honte imaginaires, ou pour obir un ordre mystrieux qu'il a reu d'en haut, etc. (2). Mais les motifs de ce suicide et son mode d'volution refltent les caractres gnraux de la maladie dont il drive, savoir la manie. Ce qui distingue cette affection, Les ides, les sentic'est son extrme mobilit. ments les plus divers et mme les plus contradictoires se succdent avec une extraordinaire des mavitesse dans l'esprit A pein un tat de consC'est un perptuel tourbillon. niaques. cience est-il n qu'il est remplac Il en est de par un autre. mme des mobiles : ils le suicide maniaque qui dterminent ou se transforment avec une tonnante naissent, disparaissent Tout coup, l'hallucination ou le dlire qui dcident rapidit. le sujet se dtruire la tentative de suicide en rapparaissent; la scne change sulte; puis, en un instant, et, si l'essai avorte, il n'est pas repris, S'il se reproduit du moins pour le moment. le plus insiplus tard, ce sera pour un autre motif. L'incident Un made ces brusques transformations. gnifiant peut amener lade de ce genre, voulant mettre fin ses jours, s'tait jet dans (1) V. article Suicide du Dictionnaire de mdecine et de chirurgie pratique. (2) Il ne faut pas confondre ces hallucinations avec celles qui auraient pour effet de faire mconnatre an malade les risques qu'il court, par exemple, de lui faire prendre une fentre pour une porte. Dans ce cas, il n'y a pas de suicide d'aprs la dfinition prcdemment donne, mais mort accidentelle.
28
LE SUICIDE.
Il tait chercher un une rivire gnralement peu profonde. ft possible, endroit o la submersion douanier, lorsqu'un son dessein, le couche en joue et menace de faire souponnant feu de son fusil s'il ne sort pas de l'eau. Aussitt, notre homme s'en retourne paisiblement chez lui, ne songeant plus se tuer (1). Il est li un tat gnral II. Suicide mlancolique. de tristesse exagre d'extrme qui fait que le madpression, les rapports lade n'apprcie plus sainement qu'ont avec lui les et les choses qui l'entourent. Les plaisirs n'ont pour personnes lui aucun attrait ; il voit tout en noir. La vie lui semble ennuyeuse sont constantes, il en ou douloureuse. Comme ces dispositions est de mme des ides de suicide; elles sont doues d'une grande sont toujours fixit et les motifs gnraux qui les dterminent les mmes. Une jeune fille, ne de parents sains, sensiblement est oblige de aprs avoir pass son enfance la campagne, son ans pour complter s'en loigner vers l'ge de quatorze ducation. Ds ce moment, elle conoit un ennui inexpribientt un dsir de mable, un got prononc pour la solitude, Elle reste, mourir que rien ne peut dissiper. des pendant heures entires, immobile, les yeux fixs sur la terre, la poitrine et dans l'tat d'une personne oppresse qui redoute un vnement sinistre. Dans la ferme rsolution de se prcipiter dans la les lieux les plus carts afin que perelle recherche rivire, sonne ne puisse venir son secours (2) . Cependant, comprenant mieux que l'acte qu'elle mdite est un crime, elle y renonce au suicide pour un temps. Mais, au bout d'un an, le penchant revient avec plus de force et les tentatives se rptent peu de distance l'une de l'autre. sur ce dsespoir viennent se greffer des Souvent, gnral, hallucinations et des ides dlirantes qui mnent directement au suicide. elles ne sont pas mobiles comme celles Seulement, tout l'heure chez les maniaques. Elles que nous observions sont fixes, au contraire, comme l'tat gnral dont elles dri(1) Bourdin, op. cit., p. 43. (2) Falret, Hypochondrie et suicide, p. 299-307.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES. vent.
29
le sujet, les reproches Les craintes qui hantent qu'il se sont toujours les mmes. Si fait, les chagrins qu'il ressent donc ce suicide est dtermin tout par des raisons imaginaires il s'en distingue Comme le prcdent, chropar son caractre Les malades de cette catgorie nique. Aussi est-il trs tenace. avec calme leurs moyens ils dploient prparent d'excution; mme dans la poursuite de leur but une persvrance et, parRien ne ressemble moins cet fois, une astuce incroyables. du maniaque. instabilit Chez esprit de suite que la perptuelle sans causes durables, l'un, il n'y a que des bouffes passagres, tandis que, chez l'autre, il y a un tat constant qui est li au caractre du sujet. gnral Dans ce cas, le suicide III. Suicide n'est caus obsessif. ni rel ni imaginaire, mais seulement par aucun motif, par l'ide fixe de la mort qui, sans raison reprsentable, s'est emde l'esprit du malade. Celui-ci est obsd pare souverainement sache parfaitement par le dsir de se tuer, quoiqu'il qu'il n'a aucun motif raisonnable de le faire. C'est un besoin instinctif sur lequel la rflexion et le raisonnement n'ont pas d'empire, ces besoins de voler, de tuer, d'incendier dont on analogue a voulu faire autant de monomanies. Comme le sujet se rend absurde de son envie, il essaie d'abord de compte du caractre lutter. Mais tout le temps que dure cette rsistance, il est triste, au creux pigastrique une anxit oppress et ressent qui augmente chaque jour. Pour cette raison, on a quelquefois donn ce genre de suicide le nom de suicide anxieux. Voici la confession qu'un malade vint faire un jour Brierre de Boismont et o cet tat est parfaitement dcrit : Employ dans une maison de commerce, convenablement des devoirs je m'acquitte de ma profession, mais j'agis comme un automate et, lorsqu'on m'adresse la parole, elle me semble rsonner dans le vide. Mon tourment plus grand de la pense du suicide dont il provient m'est impossible de m'affranchir un instant. Il y a un an que je suis en butte cette impulsion; elle tait d'abord peu prononce; depuis deux mois environ, elle me poursuit en tous lieux, je n'ai cependant aucun la mort... Ma motif de me donner
30 sant est
LE SUICIDE.
dans ma famille n'a eu d'affection bonne; personne mes appointements me semblable; je n'ai pas fait de pertes, et me permettent suffisent les plaisirs de mon ge (1) . Mais ds que le malade a pris le parti de renoncer . la lutte, ds qu'il est rsolu se tuer, cette anxit cesse et le calme revient. Si la tentative elle suffit parfois, : avorte, manque, quoique On dirait que le sujet pour un temps ce dsir maladif. apaiser a pass son envie. Il n'est IV. Suicide ou automatique. pas plus impulsif motiv que le prcdent; il n'a aucune raison ni dans d'tre ni clans l'imagination la. ralit du malade. au lieu Seulement, d'lre produit par une ide fixe qui poursuit l'esprit pendant un temps plus ou moins long et qui ne s'empare que progresde la volont, il rsulte sivement d'une et impulsion brusque immdiatement irrsistible. En un clin, d'oeil, elle surgit toute et suscite l'acte ou, tout au moins, un commencedveloppe ment d'excution. ce que nous avons Cette soudainet rappelle le suicide observ seulement maniaplus haut dans la manie; draisonnable. Il tient raison, quelque que a toujours quoique dlirantes du sujet. Ici, au contraire, aux conceptions le penclate et produit ses effets avec un vritable chant au suicide sans tre prcd automatisme antcdent intellecpar aucun la promenade sur le bord d'un prtuel. La vue d'un couteau, l'ide du suicide et l'acte cipice etc., font natre instantanment suit avec une telle les malades n'ont rapidit que, souvent, de ce qui s'est pass. Un homme cause tranpas conscience avec ses amis; tout coup, il s'lance, un franchit quillement et tombe clans l'eau. Retir on lui demande aussitt, parapet il n'en sait rien, il a cd une force les motifs de sa conduite; dit qui l'a entran malgr lui (2) . Ce qu'il y a de singulier, un autre, c'est qu'il m'est impossible de me rappeler la manire la croise dont j'ai escalad et quelle tait l'ide qui me dominait car je n'avais nullement l'ide de me donner alors; (1) Suicide et folie-suicide, p. 397. (2) Brierre, op. cit., p. 574.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
31
le souvenir d'une la mort ou, du moins, je n'ai pas aujourd'hui les malades sentent telle pense (1) . A un moindre degr, chapper la fascination natre et ils russissent l'impulsion de mort, en le fuyant immdiasur eux l'instrument qu'exerce tement. ou sont dnus tous les suicides de En rsum, vsaniques tout motif, ou sont dtermins par des motifs purement imagine rentrent naires. Or, un grand nombre de morts volontaires la plupart ni dans l'une ni dans l'autre d'entre elles catgorie; ont des motifs et qui ne sont pas sans fondement dans la ralit. On ne saurait des mots, voir un fou dans donc, sans abuser tout suicid. De tous les suicides que nous venons de caractle plus difficilement discernable de riser, celui qui peut sembler ceux que l'on observe sains d'esprit, chez les hommes c'est le l'homme normal qui se car, trs souvent, suicide-mlancolique; tue se trouve lui aussi clans un tat d'abattement et de dpression, tout comme l'alin. entre eux cette diffMais il y a toujours rence essentielle et l'acte qui en rsulte que l'tat du premier ne sont pas sans cause objective, tandis que, chez le second, ils sont sans aucun rapport extrieures. En avec les circonstances des autres comme se distinguent somme, les suicides vsaniques les illusions normales et les hallucinations des perceptions et comme les impulsions des actes dlibrs. Il reste automatiques vrai qu'on passe des uns aux autres sans solution de continuit ; mais si c'tait une raison pour les identifier, il faudrait galement confondre, d'une manire la sant avec la magnrale, celle-ci n'est qu'une varit de celle-l. ladie, puisque Quand mme on aurait tabli que les sujets moyens ne se tuent jamais et que ceux-l seuls se dtruisent anoqui prsentent quelques la folie malies, on n'aurait pas encore le droit de considrer comme une condition ncessaire du suicide; car un alin n'est un homme qui pense ou qui agit un peu autrepas simplement ment que la moyenne. Aussi n'a-t-on aussi troitement le suicide la pu rattacher (1) Ibid., p. 314.
32
LE SUICIDE.
arbitrairement folie qu'en restreignant le sens des mots. Il n'est point homicide de lui-mme, s'crie Esquirol, celui qui, nobles et gnreux, se jette dans n'coutant que des sentiments et sacrifie voun pril certain, s'expose une mort invitable lontiers sa vie pour obir aux lois, pour garder la foi jure, pour de Dcius, de le salut de son pays (1) . Et il cite l'exemple de mme, refuse de considrer etc. Falret, d'Assas, Curtius, Aristodme comme des suicids (2). Bourdin tend la Codrus, toutes les morts volontaires mme exception qui sont inspiou par les croyances res, non seulement par la foi religieuse mais mme par des sentiments de tendresse exalte. politiques, des mobiles qui dterminent Mais nous savons que la nature immdiatement le suicide, ne peuvent servir le dfinir ni, par le distinguer de ce qui n'est pas lui. Tous les cas consquent, de mort qui rsultent d'un acte accompli par le patient lui-mme avec la pleine connaissance des effets qui en devaient rsulter, quel qu'en ait t le but, des ressemblances prsentent, trop essentielles en des genres spars. pour pouvoir tre rpartis en tout tat de cause, constituer Ils ne peuvent, que des espces d'un mme genre ; et encore, pour procder ces distinctions, faudrait-il d'autre critre que la fin, plus ou moins problmatique, poursuivie par la victime. Voil donc au moins un groupe de suicides d'o la folie est absente. Or, une fois qu'on a ouvert la porte il est bien difficile de la fermer. Car entre ces aux exceptions, morts inspires par des passions particulirement et gnreuses celles que dterminent des mobiles moins relevs il n'y a pas de On passe des unes aux autres par une dsolution de continuit. insensible. Si donc les premires sont des suicides, on gradation n'a aucune raison de ne pas donner aux secondes la mme qualification. Ainsi, il y a des suicides, et en grand nombre, qui ne sont pas On les reconnat ce double signe qu'ils sont dlivsaniques. brs et que les reprsentations qui entrent dans cette dlibra(1) Maladies mentales, t. I, p. 529. (2) Hypochondrie et suicide, p. 3.
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
33
On voit que cette hallucinatoires. tion ne sont pas purement est soluble sans qu'il soit ncesquestion, tant de fois agite, de la libert. Pour savoir si tous saire de soulever le problme les suicids sont des fous, nous ne nous sommes pas demand ou non; nous nous sommes uniquement s'ils agissent librement l'obserfond sur les caractres empiriques que prsentent sortes de morts volontaires. vation les diffrentes
IV. Puisque les suicides d'alins ne sont pas tout le genre, mais les tats psychopathiques n'en reprsentent qui qu'une varit, l'alination mentale ne peuvent rendre constituent compte du collectif au suicide, dans sa gnralit. Mais, entre penchant l'alination mentale dite et le parfait quilibre de proprement il existe toute une srie d'intermdiaires : ce sont l'intelligence, les anomalies diverses sous le nom que l'on runit d'ordinaire Il y a donc lieu de rechercher commun de neurasthnie. si, dfaut de la folie, elles ne jouent pas un rle important dans la gense du phnomne qui nous occupe. C'est l'existence mme du suicide vsanique qui pose la question. En effet, si une perversion nerveux du systme profonde moindre suffit crer de toutes pices le suicide, une perversion La neudoit, un moindre degr, exercer la mme influence. rasthnie est une sorte de folie rudimentaire; elle doit donc avoir, en partie, les mmes effets. Or elle est un tat beaucoup elle va mme de plus en plus en plus rpandu que la vsanie; se gnralisant. Il peut donc se faire que l'ensemble d'anomalies en fonction desquels qu'on appelle ainsi soit l'un des facteurs varie le taux des suicides. On comprend, d'ailleurs, puisse prdisque la neurasthnie car les neurasthniques poser au suicide; sont, par leur temcomme prdestins la souffrance. On sait, en effet, prament, en gnral, rsulte d'un branlement que la douleur, trop fort DURKHEIM. 3
34 du
LE SUICIDE.
est le une onde nerveuse nerveux; trop intense systme au del maxima douloureuse. Mais cette intensit plus souvent les individus la douleur varie suivant commence de laquelle ; sont plus rsischez ceux dont les nerfs elle est plus leve chez ces Par moindre chez les autres. consquent, tants, Pour le commence la zone de la douleur derniers, plus tt. de malaise, tout est une cause toute impression nvropathe, ses nerfs, comme fleur de peau, est une fatigue; mouvement des foncau moindre sont froisss contact; l'accomplissement le plus silencieuses, tions physiologiques, qui sont d'ordinaire Il est pour lui une source de sensations pnibles. gnralement elle la zone des plaisirs est vrai que, en revanche, commence, excessive d'un systme aussi, plus bas; car cette pntrabilit des excitations accessible affaibli le rend nerveux qui ne un organisme normal. C'est ainsi pas branler parviendraient tre pour un pareil peuvent insignifiants que des vnements dmesurs. Il semble donc qu'il de plaisirs sujet l'occasion et que, grce d'un ct ce qu'il perd de l'autre doive regagner il ne soit pas plus mal arm que d'autres cette compensation, et son infriola lutte. Il n'en est rien cependant pour soutenir les sensations car les impressions rit est relle; courantes, amnent le plus de l'existence dont les conditions moyenne d'une certaine force. Pour le retour sont toujours frquemment la vie risque de n'tre pas assez tempre. lui, par consquent, se crer un milieu spcial Sans doute, quand il peut s'en retirer, il parvient ne lui arrive o le bruit du dehors qu'assourdi, nous le voyons c'est pourquoi vivre sans trop souffrir; quelquela solitude. fois fuir le monde qui lui fait mal et rechercher dans la mle, s'il ne peut pas Mais s'il est oblig de descendre sa dlicatesse contre les chocs extrieurs abriter soigneusement il a bien des chances que maladive, d'prouver plus de douleurs sont donc pour l'ide du suicide De tels organismes de plaisirs. de prdilection. un terrain n'est mme pas la seule qui rende l'existence difCette raison sensibilit de son Par suite de cette extrme ficile au nvropathe. en sont toujours ses ides et ses sentiments nerveux, systme
LE SUICIDE ET LES TATS PSYCHOPATHIQUES.
35
instable. Parce que les impressions les plus lgres quilibre son organisation ont chez lui un retentissement menanormal, bouleverse de fond en comble et, tale est, chaque instant, sous le coup de ces secousses elle ne peut pas ininterrompues, Elle est toujours se fixer sous une forme dtermine. en voie de Pour qu'elle il faudrait devenir. pt se consolider, que les exeussent des effets durables, alors qu'ils sont passes priences et emports sans cesse dtruits rvolutions par les brusques qui Or la vie, dans un milieu fixe et constant, surviennent. n'est du vivant ont un gal degr de possible que si les fonctions constance et de fixit. Car vivre, c'est rpondre aux excitations d'une manire extrieures et cette correspondance approprie ne peut s'tablir qu' l'aide du temps et de l'habiharmonique tude. Elle est un produit de ttonnements, rpts parfois dont les rsultats sont en partie devependant des gnrations, nus hrditaires et qui ne peuvent tre recommencs nouveaux frais toutes les fois qu'il faut agir. Si, au contraire, tout est refaire, il est de l'action, pour ainsi dire, au moment impossible qu'elle soit tout ce qu'elle doit tre. Cette stabilit ne nous est pas seulement ncessaire dans nos rapports avec le milieu physique, mais encore avec le milieu social. Dans une est dfinie, l'individu ne peut se socit, dont l'organisation maintenir d'avoir une constitution mentale et qu' condition morale galement dfinie. au nvroOr, c'est ce qui manque d'branlement o il se trouve fait que les cirpathe. L'tat constances le prennent sans cesse l'improviste. Comme il n'est pas prpar il est oblig d'inventer des pour y rpondre, formes originales de conduite; de l vient son got bien connu il s'agit de s'adapter des Mais quand pour les nouveauts. ne sausituations traditionnelles, des combinaisons improvises raient prvaloir contre celles consacres qu'a l'exprience; elles chouent donc le plus souvent. C'est ainsi que, plus le systme social a de fixit, plus un sujet aussi mobile a de mal y vivre. Il est donc trs vraisemblable est que ce type psychologique celui qui se rencontre le plus gnralement chez les suicids. .
36
LE SUICIDE.
tout individuelle savoir a Reste part cette condition quelle des morts volontaires. Suffit-elle les la production dans susciter ou y soit aide par les circonstances, pour peu qu'elle bien n'a-t-elle effet que de rendre les individus d'autre plus l'action accessibles de forces qui leur sont extrieures et qui du phnomne? seules constituent les causes dterminantes Pour rsoudre directement la question, il faudrait pouvoir les variations du suicide celles de la neucomparer pouvoir celle-ci n'est rasthnie. Malheureusement, pas atteinte par la les moyens de tourMais un biais va nous fournir statistique. la folie n'est que la forme ner la difficult. Puisque amplifie on peut admettre, sans srieux de la dgnrescence nerveuse, des dgnrs varie comme d'erreur, risques que le nombre celui des fous et substituer, la considration par consquent, Ce procd de plus, celle des premiers. des seconds aura, d'tablir d'une manire cet avantage qu'il nous permettra gnle taux des suicides rale le rapport avec l'ensemque soutient de toute sorte. ble des anomalies mentales fait pourrait leur faire attribuer une influence Un premier est n'ont c'est comme la folie, que le suicide, qu'elles pas; dans les villes que clans les campagnes. Il semplus rpandu et dcrotre comme ble donc crotre faire elle; ce qui pourrait en dpend. Mais ce paralllisme croire qu'il n'exprime pas ncessairement un rapport de cause effet; il peut trs bien tre le produit d'une rencontre. est d'ausimple L'hypothse tant plus permise sociales dont dpend le suicide que les causes sont elles-mmes, comme nous le verrons, troitement lies la civilisation urbaine et que c'est dans les grands centres sont le plus intenses. Pour mesurer l'action qu'elles que les tats psychopathiques avoir sur le suicide, il faut donc peuvent liminer les cas o ils varient comme les conditions sociales du mme car quand ces deux facteurs phnomne; agissent dans le mme il est impossible de dissocier, dans le sens, rsultat chacun. Il faut les considtotal, la part qui revient rer exclusivement l o ils sont en raison inverse l'un de l'auil s'tablit entre eux une sorte de tre; c'est seulement quand
LE SUICIDE ET LES ETATS PSYCHOPATHIQUES. conflit, qu'on les dsordres
37
savoir lequel est dterminant. Si peut arriver mentaux le rle essentiel leur a jouent qu'on rvler leur prsence par des effets parfois prt, ils doivent alors mme que les conditions sociales tendent caractristiques, et inversement, celles-ci doivent tre emp les neutraliser; ches de se manifester individuelles quand les conditions agisOr les faits suivants sent en sens inverse. dmontrent que c'est le contraire qui est la rgle : les statistiques 1 Toutes tablissent dans les asiles que, la population fminine est lgrement la d'alins, suprieure masculine. Le rapport varie selon les pays, mais, population comme le montre le tableau suivant, il est, en gnral, de 54 ou 55 femmes pour 46 ou 45 hommes : SUR100ALINS combien' d Hommes. emmes. F Silsie Saxe Wurtemberg. Danemark.... Norwge 1858. 1861. 1853. 1847. 1855. 49 48 45 45 45 51 52 55 55 56 New-York Massachussets. Maryland France 1855. 1854. 1850. 1890. 1891. . SUR 100ALINS combien' d Hommes. emmes. F 44 46 46 47 48 56 54 54 53 52
.g
Koch a runi les rsultats du recensement effectu dans onze Etats diffrents sur l'ensemble de la population aline. Sur 166.675 fous des deux sexes, il a trouv 78.584 hommes et 88.091 femmes, soit 1,18 alins pour 1.000 habitants du sexe masculin et 1,30 pour 1.000 habitants de l'autre sexe (1). Mayr de son ct a trouv des chiffres analogues. On s'est demand, il est vrai, si cet excdent de femmes ne venait pas simplement de ce que la mortalit des fous est suprieure celle des folles. En fait, il est certain que, en France, sur 100 alins dans les asiles, il y a environ qui meurent 55 hommes. Le nombre de sujets fminins plus considrable (1) Koch, Zur Statistik der Geisteskrankheiten. Stuttgart, 1878, p. 73.
38
LE SUICIDE. TABLEAU IV (1)
Part de chaque sexe dans le chiffre total des suicides. NOMBRES ABSOLUS des suicides. Hommes. Autriche (1873-77).... Prusse (1831-40) (1871-76) Italie (1872-77) Saxe (1851-60) (1871-76) France (1836-40) (1851-55) (1871-76) Danemark (1845-56)... (1870-76)... Angleterre (1863-67).. 11.429 11.435 16.425 4.770 4.004 3.625 9.561 13.596 25.341 3.324 2.485 4.905 Femmes. 2.478 2.534 3.724 1.195 1.055 870 3.307 4.601 6.839 1.106 748 1.791 SUR100SUICIDES combien' d Hommes. 82,1 81,9 81,5 80 79,1 80,7 74,3 74,8 78,7 75,0 76,9 73,3 Femmes. 17,9 18,1 18,5 20 20,9 19,3 25,7 25,2 21,3 25,0 23,1 26,7
recenss un moment donn ne prouverait donc pas que la femme a une plus forte tendance la folie, mais seulement que, dans cette condition comme d'ailleurs dans toutes les autres, elle survit mieux que l'homme. Mais il n'en reste pas moins existante d'alins plus de acquis que la population compte femmes que d'hommes; si donc, comme il semble lgitime, on conclut des fous aux nerveux, on doit admettre qu'il existe moment dans le sexe fminin chaque plus de neurasthniques s'il y avait entre le taux des Par consquent, que dans l'autre. un rapport de cause effet, les suicides et la neurasthnie se tuer plus que les hommes. femmes devraient Tout au moins devraient-elles se tuer autant. Car mme en tenant compte de leur moindre mortalit et en corrigeant les en consquence indications des recensements, tout ce qu'on en pourrait conont pour la folie une prdisposition sensiclure, c'est qu'elles blement leur plus faible dme morgale celle de l'homme; tuaire et la supriorit dans tous les numrique qu'elles accusent (1) D'aprs Morselli.
LE SUICIDE ET LES ETATS PSYCHOPATHIQUES.
39
se compensent, en effet, peu prs d'alins dnombrements la mort volontaire exac