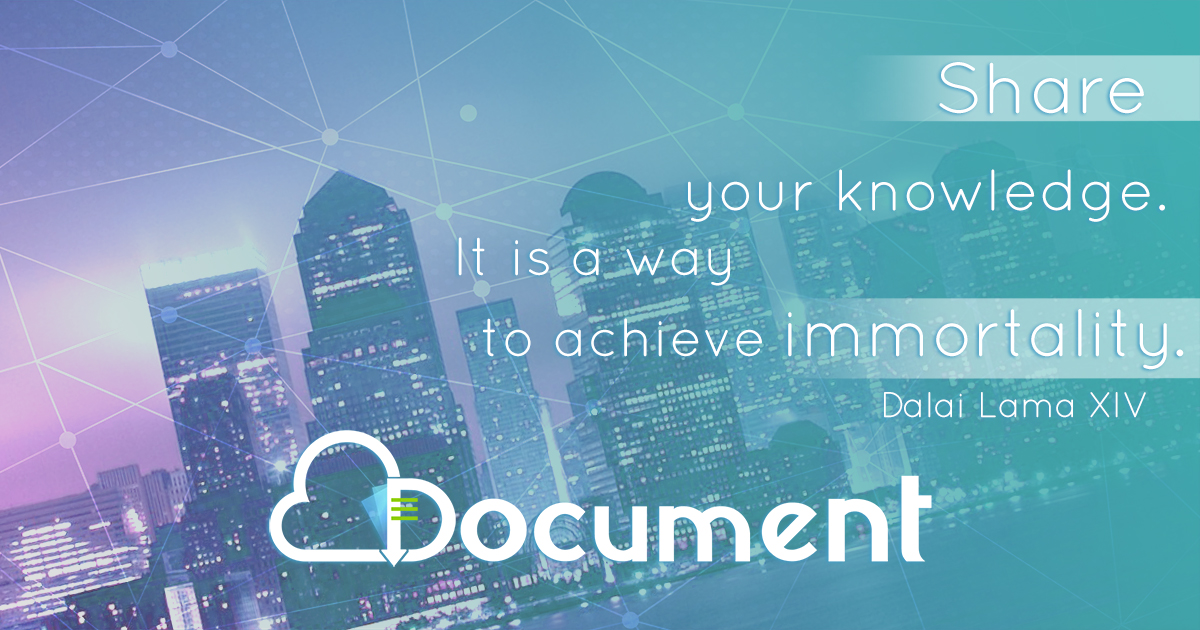LE DPC - snphpu.org · dispensation, programme Hôpital numérique 2012-2016) –La télémédeine...
Transcript of LE DPC - snphpu.org · dispensation, programme Hôpital numérique 2012-2016) –La télémédeine...
Une (si) longue histoire…
• FMC et EPP = un devoir déontologique (art.11)
• Ordonnance du 24 avril 1996 : obligation FMC
• Loi du 13 aout 2004 : obligation EPP (+ décret
14/04/2005)
• Loi du 21/07/2009 (HPST), art.59 :
– obligation du DPC
– Un DPC par profession (médecine, pharmacie, odontologie)
• Décrets DPC du 30/12/2011 et 9/01/2012
• LA CME EST CONSULTEE (priorité à la CME) :
Organisation des soins (Urgences, soins palliatifs, lutte c.la douleur..)
Partenariats
Amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins/élaborer plan DPC
• LA CME EST INFORMEE : Etat Previsionnel des Recettes et Dépenses
Politique recrutements médicaux
CPOM entre l’établissement et l’ARS
Contrats de pôle, Organisation interne,
Travaux...
SB, DPC et FMC U 29 mai 2012 3
RAPPEL HPST: Les attributions de la CME
3 points de faiblesse du dispositif FMC-EPP
Un monde médical segmenté en 3 catégories
Une séparation FMC et EPP non justifiée
Un système de crédits obsolète
Définition du DPC
• Le Développement Professionnel Continu (DPC) a pour objectifs : – l’évaluation des pratiques professionnelles
– le perfectionnement des connaissances
– l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
– la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé
• Il comporte (Décrets DPC du 30 décembre 2011)
– l’analyse des pratiques professionnelles
– l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences
• DPC = EPP et FPC
• C’est une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente pour les professionnels de santé
perfectionnement des
connaissances et des
compétences
pratiques recommandées
perfectionnement des
connaissances et des
compétences
pratiques recommandées
actions
d’amélioration de la
qualité et de la
sécurité des soins
actions
d’amélioration de la
qualité et de la
sécurité des soins
suivi et
mesure d’impact
suivi et
mesure d’impact
analyse des pratiques
professionnelles
pratiques réalisées
analyse des pratiques
professionnelles
pratiques réalisées
perfectionnement des
connaissances et des
compétences
pratiques recommandées
perfectionnement des
connaissances et des
compétences
pratiques recommandées
actions
d’amélioration de la
qualité et de la
sécurité des soins
actions
d’amélioration de la
qualité et de la
sécurité des soins
suivi et
mesure d’impact
suivi et
mesure d’impact
analyse des pratiques
professionnelles
pratiques réalisées
analyse des pratiques
professionnelles
pratiques réalisées
LE CERCLE VERTUEUX DU DPC
Analyse de pratiques Professionnelles
Pratiques réalisées
Perfectionnement des
Connaissances et des
compétences
Pratiques recommandées
OBLIGATION DPC
• Le professionnel de santé satisfait à son obligation de DPC en participant, au cours de chaque année civile, à un programme de DPC collectif annuel ou pluriannuel.
• Ce programme doit : – Être conforme à une orientation nationale ou régionale
– Comporter une des méthodes et des modalités validées par la HAS après avis de la CSI
– Etre mis en œuvre par un organisme de DPC (O-DPC) qui est enregistré auprès de l’OGDPC et évalué favorablement par la CSI
OBLIGATION DPC
• Un programme de DPC doit être basée sur :
– Une activité d’analyse de pratique
– Une activité d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances
• Ces activités peuvent être intégrées au sein du même programme ou distinctes mais une unicité de thème est recommandée
• Il s’agit d’une démarche permanente
• L’obligation annuelle est de valider UN programme, comportant au moins une action d’analyse de pratiques et une action de formation.
• L’obligation est individuelle (chaque professionnel doit valider chaque année un programme), mais réalisée dans un contexte collectif.
• La succession, année après année, des programmes de DPC d’un professionnel constitue son parcours de DPC ou parcours qualité
Programmes de DPC
Des orientations prioritaires, nationales ou régionales, seront définies pour accompagner le dispositif de DPC.
- Les orientations nationales seront arrêtées par le Ministre de la Santé, après avis de la CSI
Elles devront être très générales, transversales et répondre à des axes prioritaires de Santé publique.
- Les orientations régionales seront fixées par les Agences Régionales de Santé (ARS) après validation par la CSI.
Elles pourront être plus limitées, plus spécifiques à un problème régional de santé.
Orientations prioritaires
Arrêté du 26 Février 2013 fixant la liste des orientations nationales du
développement professionnel continu des professionnels de santé pour
l’année 2013
Orientation n° 1 : contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
– La connaissance de l’état de santé de la patientèle et/ou de la population vivant sur le territoire où le professionnel exerce.
– l’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aigues et chroniques.
– la promotion des parcours de santé et de soins, comprenant pour le patient le juste enchaînement de l’intervention des différentes compétences professionnelles liées directement ou indirectement aux soins préventifs et curatifs.
– la promotion des actions de prévention ou de dépistage. – la maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostics et
thérapeutiques, des prescriptions en matière de médicaments, de dispositifs médicaux, d’examens biologiques, de transports sanitaires.
– les programmes d'études cliniques et épidémiologiques visant à évaluer des pratiques et à actualiser et/ou compléter des recommandations de bonne pratique clinique.
– la recherche et la critique de l’information scientifique pertinente
Orientation n° 2 : contribuer à l’amélioration de la relation entre professionnels de santé et patients
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
– Le développement de l’information et de l’autonomie du patient – De favoriser le bon usage et l’observance des traitements – L’amélioration de la qualité de vie du patient et la prise en charge des
personnes fragiles et/ou handicapées, et de leur entourage – La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance – L’amélioration de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie des
patients – La formation à l’éducation thérapeutique (permettre aux patients atteints de
maladie chronique d’acquérir ou de développer les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux l’évolution de leur maladie)
– La formation à la relation « professionnel de santé-patient » ou au « partenariat soignant-soigné »
Orientation n° 3 : contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des
soins ainsi que dans la gestion des risques S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
– D’améliorer la connaissance des enjeux de sécurité sanitaire et des
procédures de déclaration d’évènements indésirables
– De développer une culture de gestion des risques au sein des équipes (pluri)professionnelles de santé, notamment à travers les démarches qualité et les procédures de certification
– De développer une approche sur la pertinence des soins et des actes par des outils adaptés à son amélioration
– L’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médicaments décrite aux articles L. 4135-1 et suivants
– L’accréditation des laboratoires de biologie médicale décrite aux articles L. 6221-1 et suivants du code de la santé publique
Orientation n° 3 : contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des
soins ainsi que dans la gestion des risques
– La prévention des évènements indésirables liés aux soins : sécurité de soins, gestion des risques (a priori, ou a posteriori, y compris les évènements porteurs de risque), iatrogénie (médicamenteuse notamment chez les personnes âgées, vigilances, déclarations d’évènements indésirables, infections nosocomiales, infections liées aux soins)
– La sécurisation de la prise en charge de la thérapeutique médicamenteuse du patient à l’hôpital ou en ville (circuit du médicament)
– La connaissance par des professionnels des responsabilités juridiques des différents corps de métiers
– La lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments
– La radioprotection des patients et des professionnels de santé, en radiothérapie, en médecine nucléaire, en radiologie et en radio-pharmacie
Orientation n° 4 : contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail
entre équipes pluriprofessionnelles S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
– L ’élaboration de référentiels communs et de coopérations professionnelles – La coordination de la prise en charge : organisation, plan de soins, protocoles
pluridisciplinaires, dossier médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins traitants et correspondants
– Les coopérations entre professionnels de santé relevant des articles L. 4011-1 (CSP)
– La formation des maitres de stage ou des tuteurs d’étudiants des professions de santé
– Le développement des systèmes d’information et le dossier médical (dossier médical personnel et dossier pharmaceutique prévus aux articles L. 1111-14 et suivant du code de la santé publique, logiciels d’aide à la prescription ou à la dispensation, programme Hôpital numérique 2012-2016)
– La télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique – Les modélisations des communications interprofessionnelles – L’amélioration du travail en équipes de soins, la gestion managériale et des
équipes – La gestion économique et la maitrise médicalisée des dépenses de santé
Orientation n° 5 : contribuer à l’amélioration de la santé environnementale
En lien avec les axes développés lors de la conférence environnementale, le développement professionnel continu mettra notamment l’accent sur :
– La connaissance par les professionnels de santé des données existantes sur les liens entre pathologies et facteurs environnementaux
– Les actions que peuvent mettre en place les professionnels de santé, notamment celles inscrites dans le plan national santé environnement 2009-2013 et le plan national santé au travail 2010-2014
Orientation n° 6 : contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article L. 6311-1 du
code du travail
S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs :
– L’adaptation et le développement des compétences des salariés définies à l’article L. 6313-13 du code du travail
– La promotion professionnelle définie à l’article L. 6313-4 du code du travail
– La radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique, définie à l’article L. 6313-8 du code du travail
– L’économie et la gestion de l’entreprise définies à l’article L. 6313-9 du code du travail
– Le bilan de compétences défini à l’article L. 6313-10 du code du travail – La validation des acquis d’expérience définie à l’article L. 6313-11 du
code du travail
CSI des médecins et pharmaciens : missions
• Formule des avis sur les orientations nationales du DPC
• Établit une évaluation scientifique des ODPC préalablement enregistrés
• Répond aux demandes d’expertise de l’OGDPC
• Formule des avis sur les orientations régionales du DPC
• Établit la liste des Diplômes d’Universités équivalent à un programme de DPC
• Formule des avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la HAS (aussi sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de DPC concourt au DPC)
L’Organisme de DPC (ODPC)
•Accompagne chaque praticien en construisant la boite à outils (actions de formation et d’évaluation) pour réaliser son DPC dans le cadre fixé par le CNP de la spécialité
•Certifie la réalisation du DPC par le praticien (transmission au Conseil de l’Ordre des Pharmaciens)
•Opère selon la méthode élaborée par la CSI
- Les ODPC proposeront des actions de DPC, actions d’évaluation/analyse des pratiques et actions de formation/approfondissement des connaissances, qui formeront des programmes complets.
- La réalisation des programmes individuels de DPC sera validée par les ODPC et les attestations seront transmises au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
- Pour les pharmaciens transmission au Conseil National de l’Ordre des pharmaciens qui évalue les parcours individuels
L’Organisme de DPC (ODPC)
Grilles d’évaluation des organismes CAPACITE SCIENTIFIQUE
Identification d'une instance décisionnelle composée en majorité de PS
Validité du contenu scientifique du programme
Prise en compte des recommandations des agences sanitaires
Références aux méthodes et modalités de DPC
Pertinence du choix des méthodes
Pertinence du choix du mode présentiel et/ou non présentiel
Conformité du programme de DPC à une orientation nationale ou régionale
Maîtrise de stage
Tutorat
CAPACITE PEDAGOGIQUE
Identification des besoins des publics ciblés
Détermination des objectifs du programme
Qualité scientifique des contenus
Qualité des supports pédagogiques utilisés
Mise en œuvre d'une procédure d'amélioration de la qualité des programmes
Moyens mis en œuvre pour évaluer les effets des programmes proposés
Cohérence du profil des concepteurs (ou équipe)
Cohérence du profil des opérateurs
Sous-traitance
Liens avec les universités : capacité du DU à intégrer un programme de DPC
INDEPENDANCE FINANCIERE
Pourcentage du financement des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé
En cas de pourcentage supérieur à 0% analyse des procédures En cas de prestation indirecte analyse des procédures
OGDPC
les dotations de l'Etat
et de l’Uncam
la contribution
sur le chiffre d'affaires
de l'industrie
pharmaceutique
contributions volontaires
d'organismes
publics ou privés
FINANCEMENT DU DPC
• Les programmes de DPC des médecins hospitaliers et salariés seront financés soit directement par leur établissement, soit par l’intermédiaire d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).
• Dans ce cas, ce financement sera abondé par une partie de la taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie de santé: 1,6% CA.
• Pour la fonction publique hospitalière, il s’agit de l’ANFH, qui participera donc au financement du DPC des personnels hospitaliers, aussi bien les médecins que les personnels non médicaux.
• Ces deux dernières dispositions ne sont pas applicables aux pharmaciens
FINANCEMENT DU DPC
DPC et CME de CHU2 Pilotage – Financement – Organisation - Partenariats
Budget CHU : > 0,5% de la rémunération de la masse salariale médicale
Budget OGDPC/OPCA : Création Conseil Médical Hospitalier au sein de l’ OPCA ANFH : comité
paritaire (syndicats hospitaliers + employeurs-FHF = 3pdts CME / Conférence + 1DG),
Convention ANFH/OGDPC (fonds total DPC industrie pharmaceutique : 150 millions)
Montant et modalités de la cotisation des CHU à l’ANFH...
26
Priorités nationales et régionales+++
27
Conditions permettant d’apprécier la participation effective d’un professionnel à un programme de DPC
La combinaison et le suivi de deux activités : 1/ perfectionner ses connaissances/compétences lors d’une activité explicite
comportant :
o un temps dédié,
o des objectifs pédagogiques,
o des supports pédagogiques reposant sur des références scientifiques actualisées,
o une évaluation, notamment de l’acquisition des connaissances,
o une restitution des résultats de l’évaluation aux professionnels.
2/ analyser ses pratiques professionnelles lors d'une activité explicite comportant :
o un temps dédié,
o une analyse des pratiques des professionnels,
o un référentiel d’analyse reposant sur des références HAS(scientifiques, réglementaires…..)
o des objectifs et actions d'amélioration,
o un suivi de ces actions et une restitution de ses résultats aux professionnels.
Ces deux activités sont librement combinées entre elles sans ordre prédéfini.
28
Liste des méthodes de DPC (par ordre alphabétique)
acquisition/approfondis- -sement des
connaissances/compétences
analyse des pratiques
professionnelles
accréditation des médecins + +
audit clinique à compléter +
bilan de compétences à compléter +
chemin clinique à compléter +
congrès scientifique + à compléter
exercice coordonné
protocole pluri professionnel + +
formateurs DPC + à compléter
formation à distance (e-
learning) + à compléter
formations diplômantes (hors
D.U. validés par CSI) + à compléter
formation présentielle + à compléter
formations professionnelles
tout au long de la vie + +
Liste des méthodes utilisables dans le cadre du DPC
29
Liste des méthodes de DPC (par ordre alphabétique)
acquisition/approfondis-sement des
connaissances/compé-tences
analyse des pratiques
profession-nelles
gestion des risques en équipe + +
groupe d'analyse de pratiques + +
maitrise de stage + +
pertinence des interventions de
santé à compléter +
protocole de coopération art.51 de la
Loi HPST + +
rédaction d’un article scientifique + à compléter
registres de pratique + +
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) à compléter +
revue bibliographique + à compléter revue de morbidité mortalité
(RMM) à compléter +
simulation en santé + +
staff des équipes soignantes + +
suivi d'indicateurs à compléter +
test de concordance de script + +
Liste des méthodes utilisables dans le cadre du DPC (2)
Approche dominante Méthodes de DPC I. Pédagogique ou cognitive
I.1. en groupe
I.2. individuelle
- formation présentielle (congrès scientifique, séminaire,
colloque, journée, atelier, formation interactive, formation
universitaire …)
- revue bibliographique et analyse d’articles
- formation à distance (supports écrits et numériques, e-
learning)
- formations diplômantes ou certifiantes (autres que D.U.
validés par CSI et le CS HCPP)
A compléter par
une activité
d’analyse des
pratiques
- soit intégrée
- soit externalisée
II. Analyse des pratiques
II.1. Gestion des risques
II.2. Revue de dossiers et
analyse de cas
- revue de mortalité et de morbidité (RMM), comité de retour
d’expérience (CREX), revue des erreurs liées aux
médicaments et dispositifs associés (REMED)
- analyse a priori des risques (analyse des méthodes de
défaillance et de leur effets AMDE …)
- groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-
soignantes ou médico technique, pratiques réflexives sur
situations réelles,
- réunions de concertation pluridisciplinaire,
- revue de pertinence
A compléter par
une activité
d’acquisition des
connaissances/co
mpétences :
- soit intégrée
- soit externalisée
Groupe DPC sept 2012 31
II. Analyse des pratiques
II.3. Indicateurs
II.4. Analyse de parcours de
soins
II.5. Analyse de parcours
professionnel
- suivi d’indicateurs
- registres, observatoire, base de données
- audit clinique
- chemin clinique
- patients traceurs
- bilan de compétences
A compléter par
une activité
d’acquisition des
connaissances/co
mpétences :
- soit intégrée
- soit externalisée
Approche dominante Méthodes de DPC
III. Approche intégrée à l’exercice professionnel
Ce sont celles où l’organisation en équipe de l’activité clinique, biologique et pharmaceutique quotidienne, implique à
la fois une protocolisation et une analyse des pratiques.
- gestion des risques en équipe
- exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons de santé, pôles de santé, centres de santé …)
IV. Dispositifs spécifiques
- accréditation des médecins spécialistes à activités à risque (art. 16 de la Loi 2004-810 du 13 aout 2004)
- programme d’éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
- accréditation des laboratoires de biologie médicale (ordonnance 2010-49 du 13/01/20120 art L 6221-1 du CSP)
- protocole de coopération (art. 51 loi 2009-879 de la Loi du 21 juillet 2009)
- formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
V. Enseignement et Recherche
- publication d’un article scientifique en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité
- recherche en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité
- maitrise de stage - tutorat
- formateurs pour des activités de DPC
VI. Simulation
- session de simulation
- test de concordance de script (TCS)
en pratique : une combinaison d’activités …
Audit
Revue pertinence
Registres
RMM E-learning
Recommandations
Congrès
Séminaires
Etc…
Staffs/RCP
Etc…
Staffs
Indicateurs
Audit
Registres
Indicateurs
Université:
Formations
Simulation… Commisssion EPP CME
Certification
Conclusions
Les Journées de l’Agence de la biomédecine – 14 et 15 décembre 2009
Maison de la Mutualité - Paris
35
• Obligation annuelle (contrôle ordre)
• Un programme DPC = FPC+EPP
• Revalidation ordre tous les 5 ans
• Financement via CME
• Attention au montant