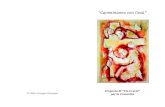Lanouvellemicroéconomie (1)
-
Upload
mekns-salam -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Lanouvellemicroéconomie (1)
LA NOUVELLE MICROECONOMIE
La nouvelle microconomie
Pierre Cahuc
(Repres)
De la micro traditionnelle la nouvelle micro:
Ce nest pas de la bienveillance du boucher, du boulanger ou du marchand de bire que nous attendons notre dner, mais bien du soin quils apportent leurs intrts.
Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776.
La poursuite de ses intrts personnels conduit donc la ralisation de lintrt gnral.
Micro traditionnelle: utilisation de la formalisation mathmatique pour exploiter lintuition de Smith.
Echange marchand meilleur que autarcie, allocation optimale des ressources.
-hypothse de rationalit: les individus agissent en utilisant au mieux les ressources dont ils disposent, compte tenu des contraintes quils subissent.
Lindividu est une unit de dcision autonome, son comportement est dfini indpendamment de toute contrainte macro sociale.
-march de CPP: atomicit, fluidit des facteurs de production (pas dobstacle ni de dperdition) et libre entre, homognit du produit, transparence de linfo sur la qualit et le prix des produits.
modle walrasien, agents price-taker, ttonnement walrasien, commissaire priseur, et tutti quanti ..
quilibre gnral walrasien sur tous les marchs:
1/ existence de lquilbre: Arrow et Debreu dmontrent dans les a. 50 que lexistence nest pas vrifie si technologies et prfrences sont rendement dchelle dcroissants.
2/ lEG concurrentiel nest plus efficace sil existe des monopoles, des biens indivisibles (biens publics ), des effets externes, ou des cots de transaction car nassurent pas hypothse de marchs complets ( =autant dactifs que dtats de la nature) .
nota sur lincertitudeet systme de marchs complets: Arrrow et Hahn (17971): il faut un contrat ex ante de la ralisation de la nature pour que il y ait un systme complet de marchs et quainsi lquilibre soit Pareto optimal problme des cots de transaction trop levs..(pour plus dinfo, venez me dder )
Nouvelle micro lancienne :
1/Annes 60-70: Utilisation des hypothse de rationalit et de CPP pour tudier des phnomnes non-marchands (mariage, politique, drogue, terrorisme, crime..)
2/ EBE et nouvelle conomie publique:
EBE: existence deffets externes et de biens publiques lgitimit de lEtat pour palier les dficiences du march .
Mais: les choix publiques ne peuvent se rduire des prfrences individuelles ( th. dimpossibilit dArrow)
Donc Etat oblig de choisir arbitrairement des bnficiaires: quel comportement de lEtat?
Nouvelle conomie publique: dite Eco du choix publique. Les interventions publiques sont dtermines sur un march politique (offre mane des bureaucrates et des politiciens, dde mane des groupes de pression). Ce march nest pas parfait donc allocation inefficace des ressources et interventionnisme excessif: LEtat bnficie de rentes de situation . Justification dun libralisme absolu. Cf. James Buchanan(1975), prix Nobel 1989.
Pb de la nouvelle micro lancienne : hypothse de rationalit et de CPP peu pertinente dans les domaines o ils les appliquent.
La nouvelle micro:
Hypothses: individus rationnels, information imparfaite, dcisions non-coordonnes par un commissaire priseur
Fin annes 70
Objectif: tudier les comportements individuels en y intgrant les interactions stratgiques et limperfection informationnelle.
1/Thorie des jeux: sapplique toutes les situations dinterdpendances stratgiques.
Introduite par Von Neumann et Morgenstern en 1944 dans Theory of games and economic behavior (1944)
Travaux de Nash(1951) Luce et Raiffa (1957), Shaple (1953)
Systmatise pour toute situation d interactions stratgiques dans les annes 80 (cf. manuels de Friedman, Kreps, Tirole)
2/ Economie de linformation: date de larticle dAkerlof (1970)
Prcise le concept de risque, dcrit comportement rationnel en situation de risque (cf. Savage 1954, Von Neumann et Morgenstern1944 )
Etude des comportements individuels en situation de risque et dinteraction stratgique
La nouvelle micro remplace le commissaire priseur par des contrats qui gnrent des cots de transaction.
Coase 1937: critique micro traditionnelle qui envisage la firme comme un point. Cest un lieu o lallocation des ressources seffectue par voie hirarchique plutt que par le march car pas de cots de transactions coteux;
Williamson 1975: systmatise lapproche en tudiant tous les types de contrat que peuvent signer les entreprises
I. La thorie des jeux
Gnralement, les dcisions prises par un agent influencent directement la satisfaction des autres
Les interactions individuelles sont donc la source de conflits potentiels.
Ils peuvent cooprer ou non
jeux coopratifs: les individus peuvent communiquer et sengager prendre certaines dcisions(peuvent ensuite tricheret dvier)
jeux non-coopratifs
1. Jeux statiques
Les joueurs prennent simultanment en une seule fois leurs dcisions. information ncessairement imparfaite.
Contraire: jeu squentiels( information parfaite (rappel: information complte= tous les joueurs connaissent la matrice des gains i.e. les diffrentes stratgies possibles pour chacun deux et les gains associs) sauf si un joueur ne peut observer laction de celui (ceux) qui a (ont) jou prcdemment.
Stratgies pures:
Joueur 2
Oui
non
Joueur 1 oui2 2
0 3
Non3 0
1 1
Equilibre de Nash: non, non; obtenu avec stratgies dominantes: stratgie dominante pour 1=non
stratgie dominante pour 2=non
Optimum Paretien: oui, oui
La coopration est donc prfrable car lquilibre de Nash est ici sous-optimal.
En CPP: les dcisions individuelles sont coordonnes par le commissaire priseur: en prenant les prix comme done, les agents ne sont pas confrontes des situations conflictuelles o les dcisions dautrui affecte la sienne et vice versa. En CPP, coordination centralise par le prix taked, et information parfaite. Ici ce nest pas le cas puisque les dcisions ne sont pas coordonnes et quon joue simultanment: aucune raison pour que Equi=OP.
Elimination par itration des stratgies domines:
Joueur 2
Oui
non
Joueur 1 oui2 2
0 3
Non3 0
1 1
X4 0
0 1
Oui domine par non pour 1la matrice est rduite de la ligne barre en pointills 2 connat la matrice puisque info complte, donc anticipe choix de 1non domine alors oui pour 2 (cf colonne barre en points quasi-tills)1 anticipant cela sait que 2 joue non et joue non lui-mme puisque 1>0.Ici donc les joueurs sont rationnels et connaissent les gains, et savent que les autres sont rationnels et quils connaissent eux aussi les gans, et savent aussi que les autres savent quils savent cela, etc
La connaissance est dite commune.
Equilibre de Nash(Nash 1951): combinaison de stratgies telle que la stratgie de chaque joueur correspond au choix le meilleur, tant donn les stratgies des autres (dq1/dq2 = 0 , variable prise comme donne en duopole de Cournot). Autrement dit, situation o personne ne veut dvier unilatralement. Sur matrice, intersection des meilleures rponses des joueurs.
Joueur 2
Oui
non
Joueur 1 oui1 1
3* 2*
Non2 2*
2 1
X3* 1
1 2*
Problme de lEN : critre pas suffisant puisquil peut y en avoir plusieurs, ou aucunmais mieux que limination des stratgies domines car il peut y avoir des situation o il nexiste pas de stratgie(s) domine(s).
autre problme de ce critre: ne nous dit pas comment les joueurs aboutissent la situation dquilibre(sauf si obtenu aprs limination par itration de stratgies domines)Comment rsoudre le problme de la multiplicit
(Stratgies mixtes:
Joueur 2
Oui
non
Joueur 1 oui1 -1
-1 1
Non-1 1
1 -1
Si pas dEN en stratgie pure, les joueurs peuvent jouer quand mme par ex. en lanant une pice pour choisir oui ou non.Il existera alors un EN en stratgie mixte.
Soit ( la proba. Pour 1 de choisir oui, ( pour 2.
Si 1 choisit oui, son esprance de gain= (-(1-()=2(-1
Si 1 choisit non, son esprance de gain= -(+1- (= -2(+1
A accepte jeu de la pice que si 2(-1 = -2(+1 cest dire si son esprance e gain est la mme((=1/2) et que 2 joue aussi en stratgie mixte. Idem pour 2 qui accepte tirage au sort que si (=1/2.
Donc: En stratgie mixte il existe toujours au moins un EN si nombre fini de joueurs et de stratgies, et jeu simultan.
Critique: calculs assez alambiqus
Problme de la multiplicit potentielle des quilibres de Nash: la guerre des sexes
homme
intransigeant Transigeant
femme Intransigeante
-1 -1
3 *2*
Transigeante
2* 3*
1 1
En stratgie mixte, il existe un quilibre (soit ( la proba pour la femme dtre intransigeante, ( la proba pour lhomme dtre intransigeant) en effet:
Concernant la femme:
Son esprance de gains est de ( (-1)+(1-()*3 si elle joue I
Son esprance de gains est de ( (2) + (1-() *1 si elle joue T
Donc femme ne va accepter tirage au sort que si ( (-1)+(1-()*3 = ( (2) + (1-() *1 ((=2/5
Concernant lhomme:
La matrice est symtrique donc pour lhomme pareil, accepte tirage au sort que si (=2/5
5/5-2/5=3/5 donc il existe un quilibre en stratgie mixte pour lesquels les joueurs choisissent I et T avec probabilits (2/5, 3/5)2
(Communication et quilibres corrls:
Auman (1974)
Au lieu de tirer au sort lhomme et la femme peuvent dcider de coordonner en fonction dvnements alatoires (cinma sil pleut, ballade sil fait beau) . Ici, si proba quil pleuve=1/2, esprance de gains gale 5/2, suprieure celle de lqui en stratgie mixtes(7/5)
Equilibre corrl = EN soumis condition dvnement alatoire
Si les joueurs peuvent communiquer, cet quilibre est prdictible.
Pb:
1/on ne sait pas sur quel critres ils choisissent lvnement alatoire.
2/ils ne peuvent souvent pas communiquer
(Point focal:
Schelling, (1960)
Point de repre pour coordonner des actions. Permet de slectionner un EN
Ex: 2 joueurs, chacun doit crire simultanment un nombre entre 1 et 100.
Gagnent 100 f si choisissent mme nombre,
Gagnent 99 f si choisissent tous les deux 8
0 sinon.
Point focal: combinaison de stratgies (8,8)
Lesprance de gains est maximale si choisissent le point focal, mais ce nest pas le gain maximal.
Pb: les joueurs nont pas ncessairement le mme point focal, donc critre oprationnel limit (ex deux personnes se rencontrent dans avion, discutent tous les deux de leur amour de Paris et dcident de se donner rdv en oubliant de dire o: lune peut croire que le lieu est laroport, lautre Notre Dame)
(Les conventions:
Le poids de lhistoire les habitudes, etc. peuvent conduire les joueurs adopter un quilibre particulier sils sont souvent confronts aux mmes situations stratgiques.
Ces conventions peuvent tre explicites (code de la route) ou implicites et stables( dans la guerre des sexes lquilibre (transigeante, intransigeant) a longuement domin.
Les conventions sont un critre de slection des EN. Importance de lhistoire dans lexplication des choix des individus( rajouter au critre de rationalit).
(Etats volutionnairement stables:
On peur considrer les conventions comme le rsultat dun processus volutionniste. La notion dapprentissage (processus dessais erreurs)est substitue celle de slection naturelle.
Les stratgies obtenues par conventions sont des EN puisque personne na intrt dvier unilatralement.
Ce sont des EN particuliers: tats volutionnairement stables.
Conclusion: EN peut tre sous-optimal. (cf. dilemme du prisonnier) Pb de la multiplicit des EN. Les diffrentes tentatives de slection des EN en jeux statiques (cf. supra) donnent des rsultats mitigs, ces critres sont souvent le fruit de lhistoire: prdiction difficile.
2.Jeux dynamiques:
Squentialit des choix reprsente par schma arborescent (forme extensive par opposition aux formes intensives des jeux statiques)
Notion de nuds successeurs et terminaux, de sous-jeux
Linformation est ici parfaite. Si le deuxime joueur na pas pu observer laction du premier , linformation est bien sr imparfaite.
La squentialit permet dliminer certains EN qui taient multiples en jeux simultans par la mthode de linduction rebours. Il ne reste alors quun seul EN, lEN parfait.(qui induit un EN dans chaque sous-jeux.)
Pb:1/induction rebours ncessite calculs longs et trop lourds pour les capacits cognitives limites des joueur (ex. du jeu dchecs o linformation est parfaite mais o on ne peut prdire lissue du match comme la montr Zermelo en 1913.
2/ elle aboutit des rsultats contre-intuitifs: cf le jeu du mille pattes de Rosenthal 1981
Cet exemple illustre linefficacit des dcisions non coopratives
Les jeux rpts:
Les joueurs sont plusieurs fois confronts la mme situation stratgiques: application aise en conomie(relation de travail, clients-fournisseurs, etc
Rptition de jeux statiques.
Nb: les dcisions peuvent conduire un quilibre sous-optimal.
les joueurs vont-ils essayer de cooprer pour amliorer leur situation?deux possibilits:
soit les joueurs ne changent jamais de stratgie, soit ils choisissent dautres stratgies pour soutenir la coopration.
si le jeu se rpte indfiniment, coopration. En effet, dans dilemme du prisonnier, si les joueurs cooprent la date initiale, possibilit de dvier pour gagner plus(=dnoncer) mais cela dclencherait des reprsailles de lautre au jeu suivant. Donc si la prfrence pour le prsent mesure par le facteur descompte des joueurs est faible ,intrt ne pas dvier et toujours se taire. (Cf. premire matrice pour mieux comprendre)cest le thorme folk
Lintroduction du temps permet donc de comprendre les comportements coopratifs alors que individus rationnels et gostes.
si rptition finie coopration difficile;( induction rcursive)
les joueurs ont une dure d vie finie donc linduction rebours bouleverse le thorme folk. Lhypothse dhorizon infini traduit le fait que les joueurs ne savent pas quand e jeu va sarrter dure du jeu incertaine). Mais dans le cadre dun horizon fini on peut cependant montrer que la coopration peut tre soutenue si les joueurs ne connaissent pas les caractristiques de leurs partenaires(cf. chap. 3 section 1)
Conclusion sur la thorie des jeux: elle tudie les interactions stratgiques et la faon dont les individus coordonnent leurs dcisions. Elle met en exergue que les dcisions individuelles prises sans concertation entranent gnralement des gaspillages de ressources.
II. Economie de linformation
Etude des comportements dagents rationnels dans situation dinformation coteuse.
Linteraction stratgique entre individus nous amne tudier le problme de lasymtrie informationnelle.
1.Interactions stratgiques en situation dasymtrie dinformation:
Jeux en information incomplte:
Deux joueurs dont lun ne connat pas la nature de lautre. Selon la nature de lautre, la matrice des gains diffre: ion est bien en prsence de situation de jeu information incomplte et asymtrique. On peut ajouter artificiellement la nature qui choisit le type du joueur A avec une proba p ou 1-p.
Le jeu peut tre reprsent sous forme extensive avec des pointills horizontaux au niveau des nuds correspondant aux choix de B(car ce dernier ne sait pas ce que la nature a choisi): on a ainsi transform un problme dinformation incomplte en information imparfaite; (transformation dHarsanyi, 1967)(cf. p 51)On peut alors utiliser le concept dEN
Equilibre Baysien: Situation dans laquelle chaque joueur max son esprance de gains tant donn son type, ses croyances, et celles des autres joueurs. cf. p. 50 lincertitude sur les caractristiques de joueurs justifie lexistence de situations qu nexisteraient pas si linformation tat complte. En effet si proba que A soit de type A1 sup. , B joue oui, or a est de type A2 e( donc joue non: lquilibre Baysien est (oui, non)
Jeux squentiels information incomplte:
Pour rsoudre jeux squentiels: backward induction
La rvision des croyances dans les jeux squentiels avec information incomplte joue rle notoire puisque permet dliminer des stratgies. En effet (cf. figure p.51), oui est une stratgie dominante pour A sil est de type A1, non sil est de type A2. Ici, en jouant, A rvle sa nature B qui rvise ainsi ses croyances. Il va donc lui mme jouer oui si a joue oui, et non si A joue non: cet quilibre, compatible avec linduction rebours et le processus de rvision des croyances permise par la squentialit est un quilibre baysien parfait;
On dit que les croyances sont rvises selon un processus Baysien (car probabilits conditionnelles)
Equilibre Baysien Parfait:
1/ les stratgies sont optimales tant donn les croyances
2/ les croyances sont rvises selon un processus Baysien au vue des dcisions effectivement prises.
2.Antislection
Cest un effet pervers des marchs du lasymtrie informationnelle, notamment linobservabilit de la qualit intrinsque des biens. (information incomplte et asymtrique). Information cache.
Le prix ne joue plus son rle de signale le mcanisme concurrentiel nes plus efficace.
La discrimination ou le signal peuvent tre des moyens pour amliorer alors le fonctionnement du march.
Inefficacit de la concurrence sur le march des voitures doccasion:
Akerlof (1970)
Eviction des voitures de bonne qualit par les mauvaises ( pour dmo cf. p.56)
Si cas extrme, antislection aboutit labsence totale dchange.
La rglementation a pour fonction de rvler tout ou partie de linformation, ou de faciliter des procdures de recours en cas de vente de produits de mauvaise qualit, donc permet laugmentation de lefficacit des marchs.
La discrimination comme moyen de rvler linformation, ex. du march des assurances.
Rotschild et Stiglitz (1976), Arrow
Un agent non inform peut acqurir une information prive sur le type dun joueur s le nombre de variables stipules par le contrat est suprieur au nombre de variables observes.
La franchise permet de discriminer les agents haut et fables risques:deux types de contrat:
Un faible franchise et gosse prime choisi par individus haut risque
Un grosse franchise et faible prime choisi par les individus bas risques.
Le choix de tel o tel type de contrat rvle linformation cache. il peut donc exister des quilibres sparateurs( les diffrentes catgories dagents choisissent des contrats diffrents) et des quilibres mlangeants.
Cependant, la rvlation de linformation cache dans le cadre dun quilibre sparateur conduit un Optimum de second rang car si linformation tait symtrique les individus faible risque seraient indemniss 100/ avec le paiement dune faible prime ( mais pas possible en situation dinformation asymtrique car les individus risqus choisiraient eux aussi ce type de contrat.
Les bons sont donc de toute faon lss.: les individus haut risque, dans le cadre de lquilibre sparateur, sont parfaitement assurs- ie comme si linfo tait symtrique- alors que les bons ont un niveau dutilit infrieur celui de loptimum de premier rang.
La thorie du signal:
Spence (1974)
Les bons agents sont prts supporter un cot pour signaler leur qualit.
Condition pour qu le signal soit valable: il faut que les cots supports par les bons soient plus faibles que ceux supports par les mauvais.
Ex: ducation: les bons vont tre prts supporter le cot des tudes, les mauvais vont lcher laffaire: le niveau dtude est donc un signal pour les employeurs.
Ici, ceux sont les agents disposant de lavantage informationnel qui prennent la dcision denvoyer un signal avant que le contrat soit propos.
Equilibre mlangeant: les deux types dagent envoient le mme signal (ou pas de signal) et les biens sont vendus au mme prix quelle que soit la qualit.
Equilibre sparateur: les bons envoient un signal coteux mais vendent prix fort, les mauvais nenvoient pas de signal et vendent au prix minimal.
Second best car mme rsultat pour les mauvais quen info symtrique, alors que cots pour les bons.
3.Risque moral:
Action cach, ou information cache ( ie laction est observable mais lagent non inform peut pas savoir si approprie, ex: dentiste pose une couronne alors quun simple plombage aurait suffit)(surtout dans les services dexperts)
problmatique: inciter le mandat agir dans lintrt du principal.
(Rappel: dans les situations o il y a risque dantislection lagent non inform cherche obtenir une information sur la qualit intrinsque.)
Relation principal-agent:
Dans ce type de relations, les problmes poss sont de mme nature si cest une info ou une action qui est cache.
Gnralement on suppose le principal risquophile car possde une plus grande diversification des actifs.
Ex: actionnaires
Ceux-ci essaient dinciter les dirigeants par le biais des stock-options par exemple.
Si linformation est cache, le principal a intrt ce que lagent lui rvle linformation: Procdure de rvlation (Myerson 1979): simple mais coteuse: lagent na pas intrt mentir car dans le contrat, le ppal a prvu des tats de la nature o lagent pouvait mentir et il est stipul dans le contrat que ce dernier sera rmunr pareillement que sil ne mentait pas.(rmunration maximale). Cest donc un second best.
En pratique, le contrat propos stipule une rmunration croissante avec les rsultats
Mais le principal peut aussi adopter un comportement de contrle direct de lagent, ou instaurer une comptitivit entre agents.
Convergence vers loptimum paretien si pnalits infinies lorsque proba que le comportement de triche de lagent soit dtect est faible.
Si plusieurs agents pour un mme principal:
Lazear et Rosen, 1981: Les contrats fonds sur les performances relatives des agents, sils ont des tches similaires, sont plus performants que des contrats classiques.
Si multitude dagents, convergence vers lOP.
Pb: les rsultats des agents sont souvent le fruit dun travail en quipe.: il nes plus possible de rmunrer en fonction des performances individuelles, a fortiori si cette observation des performance est fonde sur une comparaison!( Alchian et Demsetz, 1972)
Contrats rengocis: en ralit, les contrats sont frquemment rengocis (ex grossiste/dtaillants)
Si lagent a une prfrence pour le prsent suffisamment faible, le principal peut esprer la convergence vers lOP.
Conclusion: Inefficacit paretienne de lchange et de la concurrence si linformation est coteuse.
Les contrats vraiment incitatifs sont trop complexes et les agents conomique sont incapable de prdire tous ls vnements de la nature ( et cette prdiction a un cot, ne serait-ce quen termes de temps).
Cependant, tout comme la thorie de jeux, lconomie de linformation a permis de renouveler la comprhension de nombre de phnomnes conomiques, notamment dans le cadre des relations industrielles.
III. Champ dapplication: economie industrielle
Les problmes informationnels et stratgiques ont longtemps t ignors et jouent un rle fondamental en conomie industrielle.
La nouvelle microconomie, en tenant compte des cots de transaction lis aux cots dacquisition de linformation explique lexistence de lentreprise et tudie les processus dallocation interne. Elle tudie les contrats inhrents aux transactions, distinguant les contrats commerciaux classiques et les contrats hirarchiques comme celui de travail.
1. Concurrence imparfaite:
Monopole et structure de march oligopolistique.
Concernant loligopole, les vendeurs, en petit nombre, doivent effectuer des choix stratgiques.
Les premiers travaux ont t labors avant la naissance de la thorie des jeux et de lconomie de linformation, par Cournot en 1838 et Bertrand en 1883.
Interdpendance des dcisions.
Variables stratgiques retenues: prix et quantit car variables trs mallables (mais elles peuvent aussi concerner la qualit, les dpenses publicitaires, les techniques de production, linnovation)
1/ Concurrence en quantit: Cournot
Production de biens identiques, choix simultan, pas de communication.
Issue de linteraction stratgique=EN, appel aussi quilibre de Cournot-Nash.
Chaque vendeur considre la quantit produite par lautre comme une donne (dq1/dq2=0)
Lquilibre est celui qui correspond lintersection des fonctions de meilleure rponse: chaque joueur maximise son profit par rapport la quantit quil produit, tant donn la quantit produite par lautre.
Sil tenait compte du fait que sa quantit influence celle de lautre on obtiendrait un quilibre conjecturel (Bowley, 1924)
Lquilibre de Cournot entrane un niveau de production plus faible que celui obtenu en monopole mais plus forte quen CPP
2/ concurrence en prix: Bertrand
Critique en 1883 les conclusions du modle de Cournot en montrant que le rsultat dun oligopole en prix est le mme que celui dune structure de march concurrentielle si les entreprise fixent simultanment un prix.
Hypothses:
( CT=cQ =>Cm=CM=c
( Biens strictement identiques
( Cadre statique
Si une entreprise fixe son prix p1, la deuxime a intrt fixer le sien un prix plus faible (p2) pour rafler la totalit de la demande. La premire va alors baisser son prix un niveau infrieur celui de p2, et ainsi de suite. Guerre des prix jusqu ce que les prix atteignent le cot marginal (gal au CM). (Dans le livre il est prcis que les profits des oligopoleurs sont ainsi nuls mais si je me trompe pas, cela suppose quils aient une structure de cots identiques- cest pas prcis dans les hypothses-, car sinon, lun des deux peut encore avoir des profits..le niveau du prix serait donc alors celui du Cm le plus lev entre les deux duopoleurs)
En clair, le rsultat de Bertrand, paradoxal puisque aboutit un quilibre identique celui de la CPP, repose sur des hypothses trs restrictives.
Edgeworth montre en 1897 que la concurrence en prix nest pas quivalente la CPP sil existe des contraintes de capacit.
3/ Concurrence en prix et contrainte de capacit: une rhabilitation du modle de Cournot.
Lexistence de contraintes de capacit implique que lentreprise ne peut rafler la totalit de la demande moins de supporter des cots infinis puisque les rendements sont dcroissants.
Une entreprise peut fixer un prix suprieur au c et raliser quand mme des profits puisque la deuxime- mme si elle fixe un prix infrieur- ne pourra satisfaire la totalit de la demande.
Kreps et Scheinkam (1983) ont montr que les contraintes de capacits pouvaient apparatre lorsque les prix sajustent plus vite que les quantits, ce qui est souvent le cas.
Alors on peut raisonner avec un jeu squentiel en deux tapes:
-dabord les entreprises dterminent les quantits,
-ensuite elles dterminent les prix: les consommateurs sadressent alors majoritairement lentreprise pratiquant le prix le plus faible, lautre se satisfaisant de la demande rsiduelle.
Pour rsoudre ce jeu, backward induction(les entreprises anticipent parfaitement la premire tape le systme de prix):
-on cherche, quantits donnes, le systme de prix dquilibre de la deuxime tape,
-puis on cherche les lEN sur les quantits.
Cet EN parfait en sous-jeux concide avec lquilibre de Cournot, comme lont montr Kreps et Scheinkman.
Remarque: ici encore les oligopoleurs produisent des biens identiques.
4/ Concurrence sur les biens diffrencis:Cest la ralit des choses: les biens et services sont toujours imparfaitement substituables (marques, lieux de vente, etc.)
Diffrentiation verticale: porte sur la qualit.
Diffrentiation horizontale: certains produits conviennent mieux aux uns, certains aux autres
Les prix et les quantits sajustent plus vite que la qualit. On peut ainsi reprsenter les stratgies interactives des offreurs par un jeu squentiel o la premire tape consiste choisir les caractristiques du produit, et o la deuxime reprsente le choix des quantits et des prix maximisant le profit de chacun.
5/La diffrenciation horizontale: le modle de Hotteling (1929):
On reprsente ici la diffrenciation grce des localisations spatiales diffrentes des offreurs. Les consommateurs subissent des cots de transport, mais le bien en lui-mme est identique dans le modle.
Nota: ces cots de transports sont ici une mtaphore permettant de saisir nombre de situations de diffrenciation horizontale.
Ex: vente de glace sur une page de longueur finie, o les estivants sont rpartis uniformment.
Deux vendeurs doivent choisir o se localiser, quels prix et quelles quantits.
Cot unitaire des glaces = c.
Il existe des cots de transport mesurs par une unit de distance (ce sont les mmes pour tous les acheteurs, les mamies comme les sportifs).
Pour les vendeurs, il est moins coteux de changer le prix que la localisation, variable moins mallable.
Donc la premire tape du jeu est le choix de la localisation, la deuxime le choix des quantits et des prix.
Induction rebours: on calcule dabord les prix et les quantit dquilibre dans le deuxime sous-jeux, en considrant la localisation comme une donne.
Si les marchands sont au mme endroit, on retrouve le paradoxe de Bertrand, et les profits des marchands sont nuls.
Nota: il peut ne pas exister de prix dquilibre dans le sous jeux de la deuxime tape, si par exemple les cots de transports sont proportionnels la distance et que les vendeurs sont proches lun de lautre. En revanche, quelle que sot la localisation de ces derniers, si les cots sont proportionnels au carr de la distance, il existe toujours un systme de prix dquilibrele modle est donc limit.
Pour les rsultats strictement mathmatiques du modle, je vous laisse le soin de vous rfrer au cours dorganisation industrielle de lan derniersi a vous intresse (
Rsultat: si les prix sont endognes, dtermins en seconde tape, cest le principe de diffrenciation maximale qui simpose intuitivement: les vendeurs se crant un pouvoir de monopole local.
Nota bene: si les prix simposent aux vendeurs (sils vendent des journaux par exemple), ces le principe de diffrenciation minimale qui simpose.
6/ Les aspects dynamiques de la concurrence:
La concurrence sinscrit gnralement dans un cadre dynamique.Les entreprises laborent leurs stratgies en fonction des expriences passes.
Elles peuvent notamment mettre en place des stratgies de menace pour soutenir des quilibres coopratifs (cf. thorie des jeux infiniment rpts).
Reprenons le modle de Bertrand et supposons que le jeu est infiniment rpt
Malgr linterdiction juridique de former des ententes, les firmes peuvent implicitement ou secrtement dcider de sentendre pour fixer toutes un prix de monopole, le profit tant partag ensuite galement entre les n firmes prsentes. Soit le taux descompte tel que Trois gestions de cette incompltude contractuelle par les parties:
1) elles dcident que les imprvus feront lobjet de ngociations ultrieures.
2) elles font appel un tiers, arbitre charg de dterminer les actions appropries
3) elles conservent une relation bilatrale de deux faons:
*une des deux parties a le pouvoir de dcision et lautre dispose du droit de rupture du contrat si elle est pas ok: relation de type hirarchique
*une des parties prend le contrle du capital de lautre et labsorbe: gestion unifie
(travail: relation hirarchique, esclavage: gestion unifi)
Dans cette optique, lentreprise correspond des relations bilatrales gres par des contrats incomplets stipulant une relation hirarchique ou une gestion unifie (Grossman et Hart). Les agents rationnels peuvent donc avoir intrt crer une entreprise.
4/ Les contrats incomplets: se rfrer au livre (p96 et suivantes )Cas des investissements spcifiques et irrversibles: ne peuvent ni tre utiliss dautres fins, ni vendus.. Les agents ont intrt signer un contrat de long terme et sengager investir.
Problme soulign par Coase et Williamson: les cots sont souvent prohibitifs si les investissements sont complexes. De plus, le vendeur peut avoir intrt mentir e soutenant que ses cots sont levs cause de circonstance non prvues la date initiale., idem pour lacheteur.
Si les investissements ne sont pas vrifiables, ie observables par un tiers, il est impossible de signer un contra complet dont les cots dexcution seraient infinis.
5/ Les diffrents modes de gestion des contrats incomplets: Trois configurations si lon reprend la classification des modes de gestion en excluant larbitrage et la gestion unifie.
1) absence dintgration entre acheteur et vendeur: prennent des dcisions de faon spare et partage le surplus en deux. Eventuellement ngociation dun contrat de court terme en seconde priode.
2) Contrat de long terme avec autorit de lacheteur: bien quil ne puisse pas vrifier si le vendeur a investi. Il dcide la seconde priode de rompre ou non (alors partage du surplus
3) idem 2) mais cest le vendeur qui a lautorit.
1) absence dintgration: premire priode, choix dinvestir ou non, deuxime priode, partage du surplus en deux. Par exemple, pour le vendeur, investir peut tre une stratgie domine par ne pas investir car le partage du surplus, fait en seconde priode, porte sur le surplus brut: les investissements ne sont pas pris en compte dans le calcul donc lagent ayant des cots dinvestissement levs est dsavantag. Cest le problme du hold-up: linvestissement est spcifique donc le joueur qui bnficie de cet investissement na pas intrt rtribuer lautre puisque ce dernier ne peut le menacer de trouver dautres partenaires.
2) intgration sous lautorit de lacheteur: contrat de long terme (deux priodes), incomplet avec le choix pour lacheteur de dcider si le bien doit ou non tre chang en seconde priode, et donc dcide partage ou non du surplus.Le vendeur na pas intrt investir car lacheteur va saccaparer tout le surplus, en remboursant les cots de production du vendeur ce dernier (cf. p.100 pour comprendre). Le bnfice du vendeur est donc indpendant du montant investi. Le rsultat est que lintgration sous lautorit de lacheteur est meilleure que labsence dintgration. Elle donne cependant un rsultat infrieur celui de loptimum correspondant au contrat complet.3) intgration sous lautorit du vendeur: lacheteur ninvestit pas puisque son bnfice est indpendant de linvestissement. Sil y a change, que le vendeur investisse ou non il obtient un surplus ngatif. Donc pas de signature de contrat incomplet stipulant lautorit du vendeur.
Attention! Ces rsultats sont ceux qui dcoulent de lexemple chiffr p96. les conclusions ne sont pas toujours celles l.6/mode optimal de gestion des contrats incomplets:
Dans lexemple du livre, cest lintgration sous lautorit de lacheteur qui est prfrable; mais cela aurait pu tre lintgration sous lautorit du vendeur.
En fait, le mieux est de donner lautorit la partie ayant le rendement net de linvestissement le plus lev. Le fait est que les agents ont intrt signer un contrat incomplet de long terme stipulant une relation dautorit sil est prohibitif de signer un contrat complet. En effet, la relation dautorit permet datteindre un optimum de second rang , prfrable labsence de contrat de long terme.
Mais lintgration sous autorit nest pas toujours souhaitable car par exemple, sils ont les mmes cots dinvestissement, il prfrable pour eux de communiquer (si faible cots de communication, cheap talk) pour coordonner leurs dcisions sur le meilleur quilibre au moment de la signature du contrat. Il nest prfrable dinstituer une relation hirarchique que si elle est un moyen dinciter la partie qui dispose de lautorit investir sachant que lautre ninvestit pas. Cest pourquoi il faut donner lautorit la partie ayant linvestissement le plus rentable.
Conclusion:
La nouvelle microconomie permet de prendre en compte lextrme complexit des relations marchandes dont les champs dinvestigation sont grce la thorie des jeux, le fonctionnement des marchs oligopolistiques, les diffrentes formes dorganisation, les stratgies de diffrenciation des produits, les collusions, etc.Mais les limites de lapplication de la thorie des jeux ne doivent pas tre occultes: cest un outil puissant mais ses capacits explicatives sont mises en cause par la sensibilit des conclusions aux hypothses dont les conomistes devraient discuter sur des bases empiriques. Linformation incomplte, laspect stratgique des dcisions, la dimension dynamique, sont autant de sources que de multiplicit des quilibres. Dans de trs nombreux cas, la thorie des jeux ne permet pas de prdire une issue unique.
Conclusion
La nouvelle microconomie est une thorie qui reconnat que la concurrence parfaite est une rfrence abstraite qui na quune valeur normative. En effet, les changes sont soumis aux cots de transaction et des dfauts de coordination.
Elle montre, notamment grce la thorie des jeux, que les intrts particuliers ne convergent pas vers lintrt gnral et quune main invisible conduit souvent une situation inefficace, contrairement lintuition de Smith.
Les causes de linefficacit des transactions peuvent tre classes en deux grandes catgories: -linefficacit partienne des jeux non coopratifs
- les asymtries dinformation, qui soulvent des problmes de risque moral et danti slection.
Les principaux domaines dapplication de la nouvelle microconomie sontlconomie de lassurance et lconomie industrielle, mais elle permet aussi dexpliquer le chmage travers la prise en compte du problme de linformation, des problmes conflictuels et collectifs. Ainsi, les thories du salaire defficience ou des ngociations collective constituent des outils pour reprer le chmage involontaire. Par ailleurs, la nouvelle micro permet de rendre possible llaboration des principes dallocation tenant compte des contraintes informationnelles rencontres par les dcideurs publiques. Autre exemple, le thorme de Modigliani Miller nest pas vrifi sil existe des imperfections informationnelles et des interactions stratgiques.Cependant, elle bute sur lhypothse de rationalit conomique dont elle devrait chercher une reprsentation plus adapte.Les limites de la rationalit conomique:
Avec la nouvelle micro, la rationalit est plus sophistique puisquon prend en compte les interactions stratgiques et les informations complexes, mais on a toujours affaire un agent maximisateuret dou dans sa capacit calculatoire. Pb: cela dbouche sur:
-la frquente impossibilit de prvoir une issue unique aux interactions stratgiques car souvent, lquilibre est multiple
- la thorie des jeux nexplique pas comment les joueurs choisissent les stratgies
-un petit changement dans les hypothses conduit une grande diffrence au niveau des conclusions (cf. les croyances modifies)
-comme la montr Simon, lagent nest pas capable de faire des calculs aussi sophistiqus que ceux de la thorie des jeux.
Les enseignements de lconomie exprimentale(1993 Davis et Holt)
Ce domaine de recherche value les prdictions des modles thoriques grce des expriences menes en labo et montre que la rationalit substantielle est inadapte pour reprsenter la majeure partie des dcisions individuelles: la faon dont linformation est prsente influence anormalement les choix (cf. ex. p110)
le critre dutilit espre de Von Neumann et Morgenstern (1944), systmatiquement utilis en thorie des jeux, ne prend pas compte lincertitude donc ne rend pas compte du comportement des agents vis--vis du risque (Allais, 1953)
cf. exprience dAxelrod (1984): face la complexit des interactions, il peut tre optimal dopter pour des rgles de dcision simples et intangibles. lexprience des situations dictent des rgles de choix, les dcisions stratgiques ne rsultent pas dun calcul complexe doptimisation.
De nouveaux modles de dcision:
Les enseignements de lconomie exprimentale poussent les spcialistes laborer de nouveaux modles de dcision permettant de rendre compte des rsultats obtenus en laboratoire; Il ny a pas de modle dominant.Concernant les dcisions prises en situation dincertitude, souvent on pondre lutilit, non plus par des probabilits mais par des fonctions de probabilit. (Machina, 1987; Katz, 1993)
Concernant les dcisions avec interactions stratgiques, on cherche laborer des modles dapprentissage et de rationalit limite expliquant les processus conduisant aux dcisions.Les nouveaux domaines de recherche en microconomie sont ainsi ports par lconomie exprimentale et la psychologie.
Equi de Nash
Equilibre de Nash
Pas d quilibre de Nash en stratgies pures
2 Equilibres de Nash en stratgies pures
PAGE 17
_945121516.unknown
_945122210.unknown
_945122220.unknown
_945122680.unknown
_945121924.unknown
_945121457.unknown




![1 ¢ Ù 1 £¢ 1 £ £¢ 1 - Narodowy Bank Polski · 1 à 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ¢ 1 1 £ 1 £ £¢ 1 ¢ 1 ¢ Ù 1 à 1 1 1 ¢ à 1 1 £ ï 1 1. £¿ï° 1 ¢ 1 £ 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 ¢](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fc6757af26c7e63a70a621e/1-1-1-1-narodowy-bank-polski-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg)




![1 1 1 1 1 1 1 ¢ 1 , ¢ 1 1 1 , 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 ] ð 1 1 w ï 1 x v w ^ 1 1 x w [ ^ \ w _ [ 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ð 1 ] û w ü](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5f40ff1754b8c6159c151d05/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-w-1-x-v.jpg)