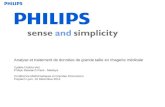Cliquez Vue sur pps-humourpps-humour Vue sur pps-humourpps-humour.
L'AG de la CCBF vue par un partenien
-
Upload
gerard-warenghem -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of L'AG de la CCBF vue par un partenien

Découverte de la planète C.C.B.F par un diocésain de Partenia
Compte-rendu de visite autour du nomadisme
« Brûle nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie »
« Sois, nuit et jour notre seul désir
Remplis-nous de ton amour »
« Laudato si o mi Signore »
J’écoute ce samedi 6 octobre 2012 la prière qui ouvre l’Assemblée générale de la
C.C.B.F. Cette année, je n’ai pu assister au rassemblement de Partenia. A l’invitation de
Claudine Onfray et de Monique Hébrard, Marie-Agnès et moi nous sommes donc là pour la
première fois chez les Franciscains de Paris. Pas de réfugié basque dans la salle, pas de banni
du Liban ou de Tunisie, pas de dame du voyage venue présenter son carnet de déplacement
et ses poèmes, pas de Jean-Claude Amara à l’horizon, ni de militant du logement avec un
badge revendicateur « Un toit c’est un droit » accroché au revers déglingué du veston
défraîchi, pas d’évêque sans domicile fixe non plus pour conclure l’A.G par un bel envoi
évangélique. Pourtant la prière qui s’élève vers la salle me souffle aux oreilles et au cœur les
mots de ceux qui se retrouvent eux aussi tous les ans (depuis dix sept ans) dans la lumière
rallumée par Rome d’un diocèse du désert. « Etre veilleur d’espoir, demander à Dieu de
dissoudre nos peurs, de l’avenir, de l’étrange ou de l’étranger, de l’autre, se présenter devant
Lui comme mendiants d’espérance, d’avenir, Peuple rassemblé pour le partage, être des
ouvriers de paix, des bâtisseurs d’amour, répondre à l’infinie tendresse de Jésus dite en St
Jean, Je vous laisse une joie parfaite, Père, Je ne te demande pas de les retirer du monde
mais de les préserver du mal, ou chantée par St François dans son merveilleux cantique des
créatures Laudato sii, o moi Signore ». Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père
disait Jésus il y a 2000 ans : cet Evangile est confirmé aujourd’hui encore. Plus de deux cents
personnes sont là, leurs looks sans doute n’ont pas la bigarrure des diocésains de Jacques
GAILLOT, et le matelas de 20 000 euros du rapport financier ferait rêver le trésorier de
Parténia ! Mais l’intensité de l’attente de ceux qui sont venus, leur attention dans la prière,
leur écoute du rapport moral présenté succinctement - c’est une qualité -par Christine
Pedotti et Anne Soupa donnent à penser. Dans nos différences sexuées et associatives,
historiques et sociales, laïcs et prêtres, nous sommes l’Eglise. Quelle richesse expressive !
Christine et Anne sont rassurées, les voilà maintenant bardées d’un commissaire aux
comptes et surtout elles ont magnifiquement œuvré par toute la France : livres, conférences,
site internet, en deux ans ont réussi l’objectif principal, construire un pôle d’opinion
publique des catholiques. Elles sont naturellement un peu fatiguées toutes les deux d’avoir

sillonné le pays. Elles en appellent donc à combler le grave déficit de moyens humains de la
C.C.B.F. il importe maintenant de gérer l’accueil, de construire un maillage, de faire vivre des
cellules, un réseau. Je me dis qu’à Evreux, grâce à Claudine et Monique, nous sommes sur
cette piste d’une disponibilité des uns pour les autres et d’un service à rendre ou d’une
diaconie généreuse en vue d’une Eglise ouverte au monde, conviviale, libérale au sens de
respectueuse de la conscience individuelle et des droits humains, sociaux et culturels, en vue
aussi d’une Eglise éprise de Justice et de Miséricorde, ces deux autres noms de Dieu.
C’est maintenant l’heure de la conférence de Nicolas de Bremond d’Ars. L’homme n’a
pas les deux pieds dans le même sabot. Il est vicaire dans une paroisse à Paris mais aussi
historien et sociologues des religions. Voici ce que j’ai retenu de son exposé riche d’une
approche historique objective, documenté donc mais également très engagé au plan
personnel, allant souvent à des formulations ou à des interrogations audacieuses,
alimentées d’une intériorité ardente. J’ai essayé de comprendre ce que Nicolas nous a dit en
relisant mes notes. Souvent je me suis senti interloqué par son propos et j’ai cru bon vérifier
certaines analyses historiques ou des intuitions plus subjectives du chercheur. Passant ses
provocations dans ma propre moulinette interrogative, j’espère ne pas les avoir déformées
ni surtout affadies. La vocation de Nicolas est née auprès du prêtre de son village qui toute
sa vie a exercé son ministère au même endroit. Aujourd’hui le sociologue constate combien
le modèle ministériel a changé : on exige des prêtres la plus extrême mobilité. Les beaux
modèles du XVII ème siècle, St Vincent de Paul, St François de Salles restent attractifs. Ils ont
su inventer quelque chose de l’ordre du partenariat ou de la collaboration si nécessaire
entre le ministère ordonné et celui des baptisés dont on devrait s’inspirer encore. Mais la
crise actuelle du clergé, sa souffrance implique que l’on réexamine la situation à nouveaux
frais. Que s’est-il passé dans l’histoire qui explique la perte d’identité du clergé catholique et
presque sa disparition, son exténuation aujourd’hui ? Comment répondre à cette question
sans désespérer ? Nicolas propose de distinguer deux formules : Eglise de l’avenir et avenir
de l’Eglise. Elles ne sont pas tout à fait superposables. Elles nous invitent plutôt à quitter le
langage de la restauration et de l’autorité pour chercher une nouvelle manière d’être plus
confiante justement dans le rapport de collaboration entre les membres du peuple de Dieu.
Une Eglise de l’avenir dépendra nécessairement de ces valeurs nouvelles qui ont pour nom
« démocratie organique » et « influence des femmes » dans la société moderne. Résumons à
gros traits l’histoire pour mieux comprendre les enjeux du présent. Louis XIV est un roi de
droit divin, il nomme les évêques, il ne peut en aucune manière s’aliéner l’Eglise qui
jusqu’en 1682 avec Bossuet affirme la supériorité des Conciles sur le Pape et l’indépendance
complète du pouvoir temporel des souverains. Le roi, seul sujet libre, ne doit des comptes
qu’à Dieu. Or cette doctrine du gallicanisme va voler en éclats en 1789. Soudain, ce n’est
plus le roi qui exerce la souveraineté, mais le Peuple ! Le pouvoir devient impie, en
particulier aux yeux des prêtres réfractaires. La Nation se constitue et le clergé
constitutionnel ne réussit pas à faire en sorte que l’autorité catholique ne soit exclue de
cette orbite nouvelle et attractive de la nation. Les conséquences sont encore fortes pour
aujourd’hui : les prêtres ne reçoivent plus de prébendes, ils n’existent plus qu’aux yeux des

croyants, seuls les laïcs sont habilités à intervenir dans le champ politique, un prêtre ne peut
être maire… Pour apaiser la querelle religieuse engendrée par la constitution civile du clergé,
Napoléon va accorder au Pape des droits qu’il n’avait pas (ô surprise, ô paradoxe !) en
particulier sur l’organisation des diocèses et la destitution des évêques nommés par la
Révolution. Le Concordat de 1801 peut donc être considéré comme l’acte de naissance de
l’ultramontanisme, doctrine réactive qui visera au XIX ème siècle à renforcer
(hypertrophier ?) la primauté spirituelle du pape et à étendre ses pouvoirs dans tous les
domaines de la vie sociale. Le concile de Vatican I en 1870 consacre cette tendance par sa
condamnation des idées modernes et la promulgation de l’infaillibilité pontificale. Ce retour
du balancier vers une influence et un pouvoir clérical fort (on n’a jamais construit autant
d’églises qu’au XIXème siècle !) engendre surtout l’anticléricalisme et la loi de 1905 qui nous
apparaît pourtant aujourd’hui comme un apaisement des antagonismes. Voici comment Pie
X, le saint Pape (1903-1914) dont la Fraternité sacerdotale de Mgr Lefebvre a emprunté le
nom (en 1970), parlait : L’Eglise est par essence inégale, c’est-à dire comprenant deux
catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui exercent un rang dans les
différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Ces catégories sont tellement
distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le droit et l’autorité nécessaire
pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude,
elle n’a d’autre droit que de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. »
Les effets de ce discours restent sensibles aujourd’hui : on ne peut pas le nier,
malheureusement. Entre 1920 et 1950, pour compenser la perte d’influence politique de
l’Eglise (refus par Pie X d’une reconnaissance internationale d’Israël, silence de Pie XII sur la
Shoah) les prêtres seuls sont considérés comme acteurs, véritables fonctionnaires de la
République spirituelle qu’est l’Eglise. La liturgie devient alors une arme politique, juridique,
dogmatique. Mais cela reste insuffisant… La visibilité de l’Eglise s’affaiblit. Deux guerres
mondiales, l’extermination du peuple juif par le nazisme allemand pèsent lourd, accentuent
la perte d’influence civile du clergé. La condamnation des prêtres ouvriers en 1954, douze
ans avant Vatican II, est un autre signe de cette dévitalisation : les prêtres sont décivilisés !
Toute cette histoire est bien celle d’une souffrance qui mène à Vatican II. Mais évidemment
le Concile ne met pas un terme à ces divisions ou à ces fractures. Il permet de les manifester.
Beaucoup de prêtres quittent le ministère, les séminaires se vident, la fréquentation de la
messe dominicale faiblit. Mais quelque chose d’indivisible reste, survit presque invisible
comme reste, comme soulte. Une fois qu’on a divisé l’église institutionnelle entre
enseignants, les clercs, et enseignés, les laïcs, qu’est-ce qui reste ? Une église célébrante,
Peuple de Dieu, une église invisible, fruit de la coopération, du partenariat, de l’amitié, de
l’écoute mutuelle entre les personnes et les groupes ou verts à l’Evangile ? En quoi ce reste
peut-il être un cadeau, une source ? Comment cette semence disséminée des disciples de
Jésus peut-elle porter fruit ? Nicolas esquisse deux pistes réjouissantes, créatrices d’énergie
et de joie pour ceux qui s’y engagent : la paroisse, la démocratie.
La paroisse comme lieu de recréation des forces vives des disciples. Il ne s’agit plus
comme au XIX ème siècle de contrôler un territoire. Etre paroissien, ou redevenir comme au

V ème, celui qui habite à côté du centre, dans les faubourgs de la ville, hors les murs, et
apparaît comme étranger… aux mœurs de la cité épiscopale. Abraham le premier dans la
Genèse, lorsqu’il arrive en Egypte, est désigné comme paroikos, séjournant dans un pays
comme étranger. Ce terme sera utilisé ensuite pour les chrétiens avec sa valeur
métaphorique parce que ceux-ci se considèrent comme des citoyens de l’au-delà, de passage
dans la cité terrestre. Nicolas nous invite donc à retrouver notre nature fondamentalement
pérégrinante. S’attacher à un territoire, être sédentaire est une attitude défensive, propice
à la violence. Les chrétiens sont plutôt appelés au voyage, à la marche conviviale, à ne pas
s’embarrasser de ce qui empêche de donner gratuitement. « Ne vous procurez ni or, ni
argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni
sandales, ni bâton… » (Matthieu 10,9). Ce nomadisme fondamental de l’Evangile, voilà la
nouveauté qui nous est recommandée encore aujourd’hui : s’installer dans les faubourgs ou
à la périphérie des centres, aller sur les routes, être porteurs de la Parole : « Paix à cette
maison ! »
La deuxième piste à explorer est celle d’une réactivation de la démocratie. On assiste
aujourd’hui à son dessèchement. La société, plus particulièrement, les jeunes, sont minés
dans leur conscience démocratique. Les élites accèdent au pouvoir mais la minorité hurle…
On se retire du système électoral: le taux d’abstention voisine les 40 %. A la Courneuve, par
exemple, seuls 3600 personnes votent soit 26 % des inscrits, 9 % du corps électoral. La
République devrait s’alerter de cette désaffection autant que l’Eglise des signes de
décatholicisation. Pour l’ensemble de la France, la « pratique » régulière moyenne chez les
adultes chute de 22 % en 1970 à 8 % en 1995 (Pierre Pierrard. Un siècle de l’Eglise de France.
DDB. P 211). Ces chiffres de sociologie électorale ou religieuse devraient attirer l’attention
sur le lien qui se délite entre le Peuple et ses élites, entre le Peuple et les corps constitués.
Et pour l’Eglise entre les laïcs et les ministres ordonnés ? Quelle prise de conscience va
permettre à la démocratie de retrouver une nouvelle vitalité ? Du temps de Sénèque la
République romaine formait un corps qui excluait les esclaves. Ne serions-nous pas
aujourd’hui en attente de la Révolution engendrée par St Paul quand il a expliqué que les
esclaves eux aussi faisaient partie du corps en tant qu’organe de la Liberté voulue par le
Christ ? Or actuellement les évêques sont dans le désarroi. Ils ne savent pas comment faire
face à la désagrégation du tissu diocésain. Les jeunes prêtres recrutés ont souvent une
identité fantasmée. Ils vivent leur chemin d’humanité dans des tensions exacerbées et leur
fragilité psychologique apparaît sous forme de blocages. Au lieu d’avoir recours à la
collaboration, à la concertation, à l’échange, au dialogue, à la dynamique de groupe, savoir-
faire qui demandent du temps, ils préfèrent couper court et décider dans la solitude de leur
bureau ce qui urge. On peut s’inquiéter d’une nouvelle évangélisation qui s’esquisse sur ces
bases : un clergé qui se voit refuser sexualité, famille, enfants, argent et donc compense en
se crispant sur le pouvoir, un corps épiscopal usé, « rongé » par la cooptation, totalement
inapte à transmettre à Rome les besoins des communautés. Ne sachant pas quoi faire pour
intégrer le processus démocratique, en soi, sain, les évêques regardent les nomades aller

ailleurs… Donc il importe d’inventer, de chercher, des voies nouvelles en vue du nomadisme
évangélique et de la confiance à l’égard de la démocratie.
Notre petit groupe de recherche comporte huit personnes (Le Mans, Caen, Paris,
Evreux, Angers, Vanves). Nous sommes d’accord pour mettre l’accent sur la condition de
nomade du chrétien. Mais elle se vit difficilement. A l’évêque nomade J.Gaillot, que n’a-t-on
reproché ? Trop d’ouverture risquerait le dérapage vers le manque d’unité ? Mais l’inverse
qui débouche sur le monolithisme et la fermeture n’est-il pas autrement stérilisant et
dangereux ? Si le nomade est un bon modèle d’inspiration, cela tient à ses capacités
d’accueil. Il faut être nomade pour accueillir des nomades en vérité. Etre nomade c’est
inventer, répondre à la demande d’accueil, d’écoute de ceux qui ont besoin de partager. La
fin dernière d’une communauté chrétienne est dans la Paix reçue de Jésus et qu’elle
propage entre ses membres parce qu’ils sont à l’écoute les uns des autres, quel que soit leur
degré d’adhésion à l’Institution.
Christine Pedotti fait la synthèse de la production de tous les groupes. Les axes
découverts sont les suivants : le nomadisme ne peut se vivre qu’en petits groupes dont la
règle principale est d’accueillir. La tradition originelle des chrétiens est bien de marcher
ensemble, de se déplacer, d’aller en pèlerinage ou en mission. Il y a bien entre baptisés
(laïcs/ministres) une division qui produit à la fois de la séparation, de l’égalité et/ou de
l’inégalité, une différence, un reste indivisible, invisible, spirituel… Ai-je bien compris la
fonction de ce reste ou de cette soulte? En quoi est-elle un risque de repli sur soi ou une
source de créativité ? Cela reste pour moi à éclaircir. Et pour vous ? Toujours est-il que
nombre de baptisés sont en rupture avec l’institution qui les a accueillis. Ils partent sans faire
de bruit, comme ceux qui ne votent plus par désintérêt, par ennui ou lassitude devant
l’éloignement institutionnel ou la surdité des responsables à leurs questions. D’autres
décident une rupture volontaire, fruit d’une décision plus consciente.
Après ce temps de récapitulation, la salle débat avec le conférencier. C’est pour lui
l’occasion d’apporter des précisions aux interrogations. Le nomadisme est un art de l’accueil,
de l’ouverture autour des tentes, des puits et de la parole. Les nomades se posent quelque
part. Ils circulent, se déplacent, vont à la rencontre d’autres nomades, d’autres nomadismes.
Ils sont habités par l’esprit d’un lieu qui les appelle à aller plus loin sur le chemin. Ils ont du
bonheur à se rencontrer, à être ensemble, à demeurer un moment dans l’écoute mutuelle,
se recueillir dans le partage des paroles et de la Parole : ils accueillent et sont accueillis. Leur
imaginaire réagit, est sollicité par la rencontre : où va-t-on aller ? Vers quel projet ? Pour
changer quelque chose, il faut d’abord rêver, être habité par un rêve. On ne peut pas se
satisfaire de l’immobilisme de jadis où le vieux curé mourrait sur place. Bouger, partir vers
soi, c’est se laisser interpeler par la Parole. C’est Elle qui nous déplace. L’Islam est une
hérésie judéo-chrétienne portée par des nomades que les sédentaires byzantins n’ont pas su
intégrer à cause de leur violence ethnocentrique. Aujourd’hui la démocratie semble figée, le
gouvernement ne paraît plus pouvoir jouer sur la réalité. Quand les hommes d’action sont

découragés, le moyen de leur redonner prise sur la réalité est d’en appeler aux vertus du
nomadisme, solution créative pour l’Eglise et pour le monde. Ainsi de nouveau, un rêve
aidera notre société à reprendre souffle. « Dieu me juge sur l’amour que je manifeste et non
sur mon aptitude à survivre confortablement. ». Les nomades campent à la lisière de la ville.
Ils sont comme un appel au réveil, à l’imagination.