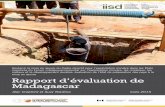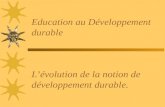La réalisation du développement durable à Madagascar: Le ... · 14 Voir : Sophie Moreau, « Le...
Transcript of La réalisation du développement durable à Madagascar: Le ... · 14 Voir : Sophie Moreau, « Le...
-
La ralisation du dveloppement durable Madagascar: Le contrat de transfert
de gestion nest pas une fin en soi
Mino Randrianarison* Philippe Karpe**
Pierre Montagne*** Alain Bertrand****
Over a decade ago, Madagascar renewed its policy on the sustainable management of its natural resources. By entering into a contract with the State under the auspices of the Gelose Law of 1996, local populations can now manage their own natural resources. The success of this new mode of management does not rest solely on the conclusion of the contract; rather, it requires
the respect of specific conditions to be undertaken throughout the life of the contractual relation-ship. Required by the law, these conditions have been implemented, completed and enriched by projects, programs and sustainable development organizations. They are necessary to ensure a sustainable development of natural resources in Madagascar.
Il y a plus de dix ans, Madagascar a renouvel sa politique de gestion durable de ses ressources naturelles. Dornavant, les populations locales peuvent les grer elles-mmes sur la base dun contrat de transfert de gestion conclu avec ltat selon la Loi Gelose de 1996 relative la gestion locale des ressources naturelles renouvelables. La russite de ce nouveau mode de gestion ne repose pas sur la seule signature du contrat. Elle exige
le respect de conditions prcises avant comme aprs la conclusion du contrat et tout au long de la vie de celui-ci. Fixes par la loi elle-mme, ces conditions ont t mises en uvre, compl-tes et enrichies par des projets, des programmes et des organismes de dveloppement durable. Elles sont ainsi bien ncessaires pour assurer un dveloppement durable de ressources naturelles Madagascar.
* Mino Randrianarison est doctorante en sciences sociales du dveloppement lUniversit dAntananarivo Madagascar, et en sciences de lenvironnement lENGREF - France.
** Philippe Karpe est chercheur en droit au CIRAD Madagascar.*** Pierre Montagne est chercheur en socio-conomie au CIRAD Madagascar.**** Aprs avoir fait toute sa carrire en tant que chercheur en socio-conomie au Cirad, Alain Bertrand est
consultant chez Edenia Consult Tanja au Maroc.
-
1. INTRODUCTION
2. LE PROJET PILOTE DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITE FFEM BIODIVERSITE A DIDY
3. LES CONDITIONS DE REUSSITE DES CONTRATS DE TRANSFERT DE GESTION A DIDY
4. LES CONDITIONS ANTERIEURES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSFERT DE GESTION
4.1 Les conditions utiles pour une relle appropriation sociale du contrat
4.2 Les conditions utiles pour une garantie de bnfices rels
4.2.1 La scurisation des pouvoirs
4.2.2 Le renforcement des capacits de gestion
4.2.3 Ladaptation du contrat
5. LES CONDITIONS POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSFERT DE GESTION
5.1 Les conditions utiles pour une sanction relle du contrat
5.1.1 La consolidation du Dina
5.1.2 La consolidation du contrle forestier
5.1.3 Linstitutionnalisation dune fiscalit incitative et diffrentielle
5.2 Les conditions utiles pour une capacit relle de mise en uvre du contrat
6. CONCLUSION
-
Madagascar, depuis plus dune dcennie, les populations locales ont le droit de grer elles-mmes leurs ressources naturelles1. cette fin, ltat conclut avec ces populations locales des contrats de transfert de gestion qui reconnaissent et structurent ce droit. Il sagit dune politique fondamentale qui renouvelle les modes publics de gestion durable de lenvironnement. Longtemps, en effet, ltat malgache a men en la matire une politique de gestion centralise rpressive ayant recours des mesures gnrales et impersonnelles. Avec la persistance des feux de brousse et la dgradation continue des environnements naturelles, entre autres, on ne peut que dire que cette politique a choue. On a incorrectement parl de tra-gdie des communaux . Il aurait t prfrable de dire que la dgradation environnementale ne pouvait pas tre vite, faute notamment dune capacit oprationnelle adquate et sans cesse en baisse du service forestier. Aucune amlioration de cette capacit ntant prvisible dans un avenir proche, il convenait donc de poursuivre le mme objectif par des voies dif-frentes. Les populations locales et leurs pratiques ne pouvaient plus tre ignores. Il sagissait seulement de les orienter de telle manire quelles poursuivent le but commun dintrt gnral le dveloppement durable. cette fin, loutil privilgi ds le dpart fut le contrat. Horning affirmait ainsi, ds 1995, que lutilisation des contrats est prometteuse pour une dcentralisa-tion effective de la gestion des ressources, mme si loption comporte des risques2.
1 Loi n 96-025 du 30 septembre 1996 relative la gestion locale des ressources naturelles renouvebles, art. 1 [Loi Gelose].
2 Nadia R. Horning, La dcentralisation de la gestion des ressources naturelles : lexprience de Madagascar au cours de la Premire Phase du PAE : Rapport pour le Global Environmental Facility, Ithaca, New York, Global Environment Facility, 1995.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 173 Montagne & Bertrand
-
Plusieurs colloques se sont succds3, regroupant les scientifiques, les autorits publiques et les populations locales. Grce aux discussions qui sy sont droules, ces colloques ont pro-gressivement permis dorganiser, dexpliquer et de structurer cette nouvelle politique. Celle-ci a t finalement institutionnalise en 1996 par la Loi n 96-025 relative la gestion locale des res-sources naturelles renouvelables (la Loi Gelose)4. Cette loi rsulte dun processus lgislatif qui con-verge avec une participation vigoureuse et des demandes sociales des populations locales. Les concepteurs de la Loi Gelose croyaient quil existait des capacits locales de gestion durable des ressources renouvelables sur la majorit du territoire de Madagascar. La Loi Gelose fut conue comme une loi-cadre dapplication souple, concernant lensemble des ressources renouvelables des forts aux ressources marines et correspondant un engagement politique national de longue dure, sur plusieurs dcennies5.
Les expriences dveloppes Madagascar, au Niger et au Mali pour assurer le transfert contractuel de gestion des forts de ltat aux populations restent, ce jour et cette ampleur, uniques en Afrique6. Leurs caractristiques communes et principales sont davoir mis en place un cadre juridique et rglementaire qui garantit aux populations riveraines les droits de com-mercialisation exclusive de leurs ressources7. Les trois pays diffrent par la vitesse du processus de dcentralisation de ltat, par des modalits trs diffrentes de la fiscalit et du contrle forestier et par des bilans diffrents de ces expriences8.
Depuis ladoption de la Loi Gelose, plus de 450 contrats de transfert de gestion des res-sources naturelles renouvelables ont t conclus par les reprsentants de ltat malgache chargs des forts9, de llevage ou de la pche dun ct, et de lautre ct par les reprsentants des
3 Par exemple, le colloque sur les Occupations Humaines dans les Aires Protges, tenu Mahajanga du 22 au 26 novembre 1994, et celui consacr la Gestion Communautaire Locale des Ressources Naturelles, tenu Antsirabe du 8 au 12 mai 1995.
4 Voir Mino Randrianarison, Philippe Karpe et Armelle Guignier, La protection de lenvironnement Madagascar. Enjeux de la protection contractuelle de lenvironnement Madagascar dans Philippe Joseph, dir., Ecosystmes forestiers des Carabes, Paris, Karthala, 2009, 632.
5 Alain Bertrand, Nadia R. Horning et Pierre Montagne, Gestion communautaire ou prservation des ressour-ces renouvelables: Histoire inacheve dune volution majeure de la politique environnementale Madagascar, Montral, Vertigo, 2009.
6 Alain Bertrand et Pierre Montagne, Les difficiles mutations des politiques forestires : dune gestion autoritaire et exclusive vers une politique publique intgre dans Alain Bertrand, Pierre Montagne et Alain Karsenty, dir., Ltat et la gestion locale durable des forts en Afrique francophone et Madagascar, Paris, LHarmatan, 2006, 37.
7 Ibid.8 Alain Bertrand et Pierre Montagne, Les Stratgies Energie domestique au Niger et au Mali et la gestion
durable des ressources forestires (Amnagement, domanialit, fiscalit & contrle forestier) (2009) 301 Bois et Forts des tropiques, 83.
9 Les contrats Gelose sont le plus souvent signs par ladministration des Eaux et Forts au niveau des DIREEF (Directions inter-rgionales de lEnvironnement et des Eaux et Forts).
174 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
communauts locales de base10 appeles VondronOlona Ifotony (VOI) en malgache et les reprsentants lus des collectivits territoriales dcentralises concernes, cest--dire le maire de la commune dont relvent les ressources qui font lobjet du transfert de gestion. Les contrats confrent aux diffrentes communauts locales de base la gestion de laccs, de la conserva-tion, de lexploitation et de la valorisation des ressources objets du transfert de gestion sous rserve du respect des prescriptions et des rgles dexploitation dfinies dans le contrat de gestion 11. Lexercice de ces pouvoirs doit conformer lobjectif du dveloppement durable. Le contrat de transfert de gestion est dune dure initiale de trois ans. Il peut tre renouvel indfiniment sous rserve que la communaut locale de base ait bien accomplie ses obligations contractuelles. Chaque renouvellement est dune dure de dix ans12.
10 La communaut locale de base est un groupement volontaire dindividus unis par les mmes intrts et obissant des rgles de vie commune. Elle regroupe selon le cas les habitants dun hameau, dun village ou dun groupe de villages (Loi Gelose, supra note 1, art. 3). Le plus souvent, elle correspond concrtement au Fokonolona. Celui-ci est un clan (ou parfois un lignage) de type patrilinaire et patri-local unissant sur un mme territoire (fokontany) les descendants dun mme anctre (razana) dont la tombe constitue le ple mystique o le groupement vient trouver sa cohsion. Cest bien cet ascendance commune que traduit le nom de chaque fokonolona : teraka ou zanaka () suivi du nom de lanctre ponyme. (Georges Condominas, Fokonolona et collectivits rurales en Imerina, Paris, Berger-Levrault, 1960 la p. 24). La communaut locale de base est dote de la personnalit morale et fonctionne selon les rgles applicables aux associations (Loi Gelose, supra note 1, art. 3). La Loi Gelose nencadre pas la dsigna-tion des reprsentants des communauts locales de base mais impose la reconnaissance par la commune de leur existence relle.
11 Loi Gelose, supra note 1, art. 43. 12 Ibid., art. 39.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 175 Montagne & Bertrand
-
De nombreuses valuations des contrats de transfert de gestion ont t faites. Nationales13 ou locales14, ces valuations montrent que les impacts des transferts de gestion sur le dveloppe-ment durable Madagascar sont variables. Diverses difficults sont voques pour expliquer les rsultats ngatifs, parmi lesquelles on retrouve la dstructuration des socits locales par une perte du pouvoir des ans, lisolement du VOI (la communaut locale de base), un faible niveau de reprsentativit dusage, identitaire ou spatiale au sein du VOI, llaboration de stra-tgies de contournement par les principaux acteurs impliqus dans la procdure de transfert de gestion, linadquation de lchelle socio-spatiale du transfert de gestion, et les conflits dusage entre autochtones et non-autochtones.
13 Pierre Montagne, Zo Razanamaharo et Andrew Cooke, dir., Le transfert de gestion Madagascar, dix ans defforts: Tanteza (tantanana mba hateza : gestion durable), Montpellier, CIRAD, 2007 [Montagne et al., Transfert].
14 Voir : Sophie Moreau, Le dveloppement durable au Sud : lexemple de Madagascar dans Yvette Veyret, dir., Le dveloppement durable : approches plurielles, Paris, Hatier, 2005, 251 ; Grazia Borrini-Feyerabend et Nigel Dudley, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Commission des poli-tiques environnementales, conomiques et sociales (CEESP) et Commission mondiale des aires prot-ges (WCPA), Les Aires Protges Madagascar: btir le systme partir de la base. Rapport de la seconde mission UICN (version finale), Antananarivo, UICN, 2005 ; Frank Muttenzer, Dforestation et droit cou-tumier Madagascar : lhistoricit dune politique foncire, Genve, Universit de Genve, Institut uni-versitaire dtudes du dveloppement, 2006 ; Pierre Montagne, Transfert de gestion, gestion locale et dcentralisation Madagascar dans Alain Bertrand, Pierre Montagne et Alain Karsenty, dir., Ltat et la gestion locale durable des forts en Afrique francophone et Madagascar, Paris, LHarmatan, 2006, 405 ; Sigrid Aubert, Production normative et modalits dapplication des normes de gestion intgre de la biodi-versit dans un contexte de recherches interdisciplinaires. Habilitation diriger des recherches, Universit de Paris I, UFR 7 Etudes Internationales et Europennes, 2006 ; Fonds Franais pour lEnvironnement Mondiale (FFEM), Evaluation du projet FFEM (Rapport) par Rakotobe Henri, Antananarivo, FFEM, 2007 [Rapport Rakotobe] ; Jacques Pollini, Slash-and-Burn cultivation and deforestation in the Malagasy rain forests: representations and realities, thse de doctorat en anthropologie, Cornell University, 2007 [non publie] ; Chantal Blanc-Pamard et Herv Rakoto Ramiarantsoa, Normes environnementales, transferts de gestion et recompositions territoriales en pays betsileo (Madagascar) (2007) 15 Natures Sciences Socits 253 ; Philippe Collas de Chatelperron et Norbert Razafindrianilana, Impacts environnementaux des transferts de gestion dans Pierre Montagne, Zo Razanamaharo et Andrew Cooke, dir., Le transfert de gestion Madagascar, dix ans defforts : Tanteza (tantanana mba hateza : gestion durable), Montpellier, CIRAD, 2007, 129 ; Aurlie Toillier, Stratgies spatiales des paysans en rponse la conservation des forts dans Georges Serpanti, Rasolofoharinoro et Stphanie Carrire, dir., Transitions agraires, dyna-miques cologiques et conservation. Le corridor Ranomafana-Andringitra. Actes du Sminaire GEREM tenues du 9 au 10 juillet 2006 Antananarivo, Madagascar, CITE, 2007, 225 ; Aurlie Toillier, Pour une recherche-action sur lamnagement des territoires ruraux dans le cadre de la gestion contractualise des forts dans Georges Serpanti, Rasolofoharinoro et Stphanie Carrire, dir., Transitions agraires, dynamiques cologiques et conservation. Le corridor Ranomafana-Andringitra. Actes du Sminaire GEREM tenues du 9 au 10 juillet 2006 Antananarivo, Madagascar, A.I., CITE, 2007 aux pp. 235-241 [Toillier, Recherche-action] ; Chantal Blanc-Pamard et Herv Rakoto Ramiarantsoa, La gestion contractualise des forts en pays betsileo et tanala (Madagascar), en ligne : (2008) Cybergeo, Environnement, Nature, Paysage, 426 ; Benjamin Pascal, De la Terre des anctres aux territoires des vivants: Les enjeux locaux de la gouvernance sur le littoral sud-ouest de Madagascar, thse de doctorat en histoire, Musum National dHistoire Naturelle, 2008 [non publie] ; Joshua E.Cinner et al., Toward institutions for community-based management of inshore marine resources in the Western Indian Ocean (2009) 33 Marine Policy 489 ; Philippe Karpe et Mino Randrianarison, La rgulation des ressources naturelles Madagascar. Thorie et pratique du rgime de la sanction dans la loi Gelose (2009) n 3 Revue Juridique de lEnvironnement 301.
176 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
Ces difficults suscitent des contestations de lefficacit du contrat Gelose15. Elles ne devraient pas, par contre, conduire sa suppression. Souvent localises et discutables16, ces dif-ficults ne signifient pas que la politique de transfert de gestion ou que la politique forestire et environnementale rforme soit un chec. Elles dcoulent des modalits diffrentes de mise en uvre des contrats de transfert de gestion par les divers projets, programmes ou organismes de dveloppement durable17. Les rsultats des contrats, donc, ne seront pas uniformes. Ainsi, plutt que de supprimer lemploi du contrat, cette contestation devrait notamment conduire mieux identifier et analyser les conditions de russite et dchec des contrats, mais aussi les situations dans lesquelles lusage du contrat serait pleinement utile.
Il est vident quun simple contrat, mme sign et sanctionn, ne peut suffire assurer la russite dun transfert de gestion des ressources renouvelables. Soucieuse de sa propre effec-tivit18, la Loi Gelose elle-mme a pos certaines conditions supplmentaires de forme et de fond respecter par les contractants et leurs partenaires. Il sagit, par exemple, de lintervention dun mdiateur au cours du processus de ngociation du contrat ou de ladoption de Dina pour veiller au respect des obligations contractuelles par les membres des VOI. Le Dina est un accord entre les membres dune communaut dtermine [fokonolona] o chaque membre doit marquer son adhsion par des serments ou des imprcations et dans laquelle des sanctions [Vonodina] ou maldictions sont prvues ou rserves ceux qui ne respectent ou nappliquent pas les termes convenus 19. Ces conditions de droit garantissent-elles lefficacit relle du contrat? Sont-elles suffisantes? Des rponses ces questions ont t donnes par les diverses institutions dappui ayant contribu concrtement la mise en uvre du transfert de gestion
15 Voir : Richard E. Rice et al., Sustainable forest management: a review of conventional wisdom, Advances in Applied Biodiversity Science, Washington DC, CABS / Conservation International, 2001 ; Union of Concerned Scientists, Center for Tropical Forest Science, Smithsonian Institution, Logging Off: Mechanisms to Stop or Prevent Industrial Logging in Forests of High Conservation Value par T. Gullison, M. Melnyk. et C. Wong, Cambridge, Mass., Union of Concerned Scientists Publications, 2001 ; Eduard Niesten et Richard Rice, Sustainable forest management and conservation incentive agreements (2004) 6 International Forestry Review 56 ; Mino Randrianarison, Les paiements pour services environnemen-taux pour la protection de la biodiversit de Madagascar, Thse de doctorat [en prparation], Universit dAntananarivo [Randrianarison] ; Sven Wunder, Payments for environmental services: Some nuts and bolts, CIFOR Occasional Paper 42, A.I., Center for International Forestry Research, 2005 ; Karel Mayrand et Mar Paquin, Commission de coopration environnementale de lAmrique du Nord, Le paiement pour les services environnementaux : tude et valuation des systmes actuels, Montral, Unisfra International Centre, 2004 ; Nirina A. Randimby et al., Forest Trends, An Inventory of Initiatives/Activities and Legislation Pertaining to Ecosystem Services Payment Schemes (PES) in Madagascar, Antananarivo, Katoomba Group, 2008.
16 Montagne et al., Transfert, supra note 13 ; Toillier, Recherche-action, supra note 14 ; Alain Bertrand et al., Contre un retour aux barrires : Quelle place pour la gestion communautaire dans les nouvelles aires protges malgaches prsent au Colloque international, Les parties prenantes de la gestion communautaire des ressources naturelles : coopration, contradictions, conflits tenu du 1 au 3 juillet 2008 Antananarivo [Bertrand et al., Barrires].
17 Bertrand et al., Barrires, ibid.18 Loi Gelose, supra note 1, art. 1. 19 Victorine Razanabahiny, Le Dina (Convention entre membres de communauts villageoises): son opportunit
ou non dans la conservation de la nature. Cas de la Rserve Naturelle Intgrale dAndohahela-Tolagnara, Mmoire de CAPEN en Anthropologie, Universit dAntananarivo, 1995 la p. 65 [non publie].
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 177 Montagne & Bertrand
-
de lenvironnement. Les rponses apportes par le Projet Pilote de Protection et de Valorisation de la Biodiversit FFEM - Biodiversit Didy, ci-aprs nomm FFEM, sont ici prises titre dexemple20.
La thse de cet article est de dmontrer, par le biais de lexemple du FFEM, que le contrat Gelose est un outil efficace de gestion des ressources renouvelables. Il complte utilement la loi en la matire et en assure la pleine ralisation. Son efficacit est dtermine par certaines conditions, inclues ou non dans le contrat de transfert de gestion, antrieures et postrieures la conclusion de celui-ci.
La premire partie de larticle sera consacre la description du FFEM, de sa zone dintervention Didy et des contrats Gelose quil y a mis en place. La russite de ces contrats y sera particulirement souligne. Dans une seconde partie, aprs avoir expos les causes de lchec de contrats Gelose conclus dans la mme rgion mais par dautres organismes que le FFEM, seront dcrites et analyses les diffrentes conditions de russite des contrats Gelose mis en place par ce dernier. Seront successivement envisages les conditions antrieures la conclu-sion du contrat Gelose puis celles postrieures la conclusion de ce contrat. Lensemble de ces conditions sera synthtiss sous la forme dun tableau dans la conclusion de cet article.
2. LE PROJET PILOTE DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE LA BIODIVERSIT FFEM - BIODIVERSIT DIDY
Le FFEM est un projet qui, grce un soutien financier du Fonds franais de lenvironnement mondial, a appuy de 2003 2007 plusieurs communes rurales de deux rgions de Madagascar Alaotra-Mangoro et Melaky dans leurs actions de gestion de leurs ressources naturelles. La premire zone dintervention correspond au Corridor forestier de Zahamena-Moramanga et aux abords de la Route Nationale n2 reliant Antananarivo et Fnrive Est. La seconde est situe dans la sous-prfecture dAntsalova. Durant son intervention dans ces zones, le projet a mis en place dix-neuf contrats de transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables aux VOI.
Situe dans la rgion dAlaotra Mangoro, dans le district dAmbatondrazaka, la commune rurale de Didy prsente la spcificit dtre constitue dans sa partie orientale dune fort tropi-cale humide contenant plusieurs espces forestires potentiellement exploitables. Exploites, ces ressources peuvent approvisionner le march local comme le march national. Depuis
20 Lobjectif spcifique du FFEM est de proposer des mthodes, des techniques et des exemples de gestion viable long terme de lenvironnement et de la biodiversit pour un dveloppement conomique des filires dexploitation des ressources naturelles renouvelables au profit des populations rurales. Il cherche apporter des amliorations mthodologiques ncessaires dans la gestion de biodiversit qui pousent les ralits des rgions gographiques distinctes (FFEM, Cadre logique du projet FFEM Biodiversit, Mise en place de projets pilotes de protection et de valorisation de la biodiversit Madagascar. 2007).
178 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
2006, huit contrats de transfert de gestion permettant lexploitation du bois duvre21 ont t mis en place dans la rgion de Didy, sur une partie de la fort dAmbohilero, dans le corridor forestier de lEst malgache. Les bois duvre lgaux en provenance de la fort dAmbohilero Didy sont facilement identifiables par leurs tiquettes plastiques, qui assurent un vritable systme de traabilit des produits. Ils sont trs demands sur Andravohangy, le grand march de bois dAntananarivo, qui na jamais connu de pnurie et qui fonctionne essentiellement avec du bois duvre exploit illgalement.
Ces contrats de transfert de gestion occupent sur la fort dAmbohilero une superficie totale de 18 200 ha. Ils prsentent la particularit de permettre, sous des conditions de gestion durable, la valorisation des produits forestiers ligneux. Ce choix dexploiter le bois duvre est dtermin par diffrents facteurs, notamment le dsir des VOI de gnrer par eux-mmes des revenus tirs de leurs ressources, lexistence dune demande en bois duvre des centres urbains qui perdurera long terme, et lexigence de mettre en place les conditions dune exploitation lgale o ltat serait en mesure dassurer ses tches de surveillance.
Les transferts de gestion sont trs profitables aux populations locales et aux autorits pub-liques, ce qui en garantit la durabilit. Le chiffre daffaire total est constitu des revenus des mnages ( partir du bucheronnage et du dbardage22), des diverses taxes et des valeurs ajoutes des VOI. Les montants des valeurs ajoutes obtenues par lensemble des 8 VOI au cours de la premire anne dexploitation forestire sur la fort dAmbohilero sont estims 6 562 630 ariary, soit environ 2 400 euros ou 4 200 dollars canadiens. Chacun dentre eux a pu collecter entre 55 000 et 3 millions dariary en fonction du mode dexploitation choisi par le VOI23 et du quota annuel autoris de prlvement. Ces montants sont lquivalent des bnfices obtenus par les exploitants forestiers trangers auparavant, desquels les populations locales taient totalement exclues. Largent collect par le VOI par la ralisation de lexploitation for-estire nest pas distribu aux mnages qui le constituent. Il sert amliorer le bien-tre collectif de la communaut. Ainsi, avec cet argent, les VOI ont pu entreprendre des activits com-munautaires comme la rhabilitation dune cole ou la mise en place dun systme de micro-crdit local pour permettre des achats dintrants agricoles pour les membres des VOI. Jusquen septembre 2007, la commune rurale de Didy a pu collecter 266 400 ariary de ristournes24 et ladministration forestire a reu au moins le tiers des redevances forestires, ceci en fonc-
21 Madagascar, sauf dans les plantations de pins de la Fanalamanga, le bois duvre est toujours exploit manuellement en traverses (hritage de la cration coloniale du chemin de fer). Les traverses sont des pices de bois ayant les dimensions suivantes : 20cm x 20cm x 2,50 m. Cette exploitation manuelle se traduit par un rendement de bois doeuvre trs faible, de lordre de 18%, compar un rendement moyen de lordre de 45% dans les autres pays (CTFT, Mmento du forestier. ditions Ministre de la coopration, Paris, 1972). Une fois exploit et transform, le bois duvre est utilis dans la construction, dans les diffrentes infrastructures, etc. Le bois duvre nest pas utilis en tant que bois de chauffe.
22 Didy, le bucheronnage et dbardage permet un mnage dobtenir annuellement 250 000 ariary, soit prs de la moiti de son revenu annuel total estim 600 000 ariary.
23 Lexploitation peut tre ralise par le VOI mme, par un membre dun VOI qui a ou na pas de contrat avec le VOI, ou par sous-traitance avec un exploitant forestier en contrat avec le VOI.
24 Les ristournes sont des taxes communales perues sur diverses activits ou transports de produits, tels le riz et le bois.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 179 Montagne & Bertrand
-
tion de lavance des exploitations25. Ces ristournes permettent la commune rurale de Didy deffectuer les contrles en fort qui taient dlaisss par manque de moyens financiers.
Actuellement, les contrats de transfert de gestion font lobjet dune valuation car ils sont arrivs au terme des trois premires annes dexistence. Les demandes de renouvellement des contrats ont t expressment dposes par les VOI eux-mmes auprs de ladministration forestire. Ce fait tmoigne du niveau dimplication des VOI dans la gestion de leur territoire et de la qualit des transferts de gestion.
3. LES CONDITIONS DE RUSSITE DES CONTRATS DE TRANSFERT DE GESTION DIDY
Pour sassurer de contrats bien fonds et valablement excuts, le FFEM a construit une dmarche particulire dlaboration et dexcution des contrats Gelose. Il a donc respect les provisions de la loi-cadre et a dvelopp des conditions adaptes la communaut locale pour assurer la russite des contrats26. Ces conditions se succdent suivant un ordre logique et nces-saire. Certaines conditions doivent tre respectes avant la conclusion du contrat (4), tandis que dautres doivent tre suivis aprs la conclusion du contrat ainsi que tout au long de la vie de celui-ci (5). Certaines de ces tapes doivent obligatoirement se suivre. Par exemple, le plan damnagement ne peut tre rdig tant que le diagnostic du milieu et linventaire nont pas t raliss. Il en est de mme pour llaboration des outils de gestion qui dpend de lapprobation du plan damnagement et de gestion simplifie, ainsi que pour lofficialisation du contrat qui dcoule de la validation des outils de gestion. Dautres tapes peuvent tre ralises de faon simultane, anticipe ou diffre. Il sagit des tapes qui nattendent pas les rsultats de celles antrieures pour leur ralisation. Par exemple, le renforcement des capacits des acteurs occupe beaucoup plus de temps pour sa ralisation et se fait selon les demandes. Cette tape peut tre effectue tout au long de la dmarche. Ainsi, la mise en place du VOI peut tre faite avant le renforcement des capacits des acteurs. De la mme manire, la demande de transfert
25 La redevance est une taxe forestire verse chance priodique en contrepartie dun avantage concd contractuellement. Dans le cadre de lexploitation forestire, la redevance est la somme paye par les exploitants forestiers en contrepartie de loctroi du permis dexploitation. La tota-lit de la redevance revient ladministration forestire. Mais dans le cadre des contrats Gelose, leur acquittement se fait progressivement, en fonction de lavance des exploitations forestires. Depuis le dbut des exploitations forestires par les VOI, ladministration forestire na pu collecter que le tiers de la totalit des redevances que doivent payer les VOI. Les 2/3 des redevances non encore collects sont constitus des redevances non payes par les VOI qui nont pas encore commenc leurs exploitations et par les restes des redevances devant tre acquittes par les autres VOI la fin des exploitations auprs de ladministration forestire.
26 Le FFEM ne prsente pas lunique condition de russite des contrats de transfert de gestion. Les condi-tions de russite sont dj fixes par la loi. Le FFEM ne fait que les mettre en uvre, qui le conduit les prciser, les enrichir et les complter. En ralit, le FFEM ne fait que renforcer les institutions publi-ques dpourvues de moyens financiers, matriels et humains pour pleinement mettre en uvre la loi. La vritable question vis--vis de lintervention des organismes ou des projets dappui, tel le FFEM, est de dterminer sils respectent les conditions lgales de mise en uvre des transferts de gestion un respect qui dtermine la russite du transfert.
180 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
de gestion peut tre dpose aprs la structuration du VOI ou aprs la conception du plan damnagement et de gestion simplifi27.
La pertinence des conditions de russite est renforce par lexamen dautres contrats Gelose conclus dans la mme rgion mais ayant chous. Conservation International (CI), par exemple, a appuy la mise en place de 8 contrats Gelose sur la fort dAmbohilero dans la rgion de Didy, correspondant une superficie totale de 37 320 ha28. Ces contrats nont pas les mmes formes ni le mme contenu que ceux mis en place par le FFEM. Ainsi, les VOI FFEM et les VOI CI nont pas les mmes obligations. Dans le cas des VOI encadrs par CI, le contrle forestier nest pas systmatique. Pour les VOI encadrs par le FFEM, par contre, le contrle forestier est excut par lintermdiaire de la police locale forestire (polisinala). Elles nexercent pas non plus les mmes activits. Lexploitation forestire est lactivit de base des VOI FFEM, leur permettant davoir des revenus supplmentaires, en sus des revenus tirs de la ralisation des travaux de bcheronnage. Par contre, cette activit est svrement interdite pour les VOI CI, leur objectif principal tant la conservation stricte de lcosystme forestier.
Contrairement aux contrats Gelose appuys par le FFEM, les rsultats des activits de gestion des ressources entreprises par les VOI CI sont mauvais. Ainsi, les VOI ne peuvent plus exercer les activits qui leur permettent davoir des moyens de vivre et dobtenir des revenus assurs et suffisants annuellement. Consquemment, ces VOI ne respectent plus leurs engage-ments contractuels29. Il y a quelques indicateurs simples de cet chec des VOI CI, facilement visibles et donc vrifiables, notamment les bois illicites qui circulent dans la rgion de Didy provenant principalement de ces zones, ainsi que les pratiques culturales destructrices (tavy) qui persistent dans la rgion. Le rsultat est que les personnes vivant aux dpens de ces res-sources nont aucune activit alternative pour pouvoir survivre. Ceci explique les demandes formules par ces VOI pour que leurs contrats deviennent des contrats identiques ceux du FFEM et ainsi avoir la possibilit dexploiter du bois duvre30.
27 Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), Guide de transfert de gestion: dmarche et mtho-dologie dinterventions - Madagascar Paris, Fonds Franais pour lEnvironnement, 2007 [FFEM, Guide de transfert].
28 Randrianarison, supra note 15. Les 8 contrats correspondent aux rgions Ravinala I, Ravinala II, Taratra, Lazasoa Lovasoa, Ezaka, Belanonana, Tsarahonenana et Misi.
29 Randrianarison, supra note 15. 30 Le renouvellement de ces contrats GCF de prservation sous forme de contrats Gelose valorisation et
exploitation durable du bois duvre sera de toute faon problmatique puisque lors de la mise en place de ces VOI, Conservation International ne sest pas base sur les structures spatio-sociales coutumires existantes et na tenu aucun compte de lexistence des Kijana, pturages lignagers qui structurent lespace de la fort classe dAmbohilero depuis plus dun sicle... Transformer simplement les contrats GCF de conservation en contrats Gelose de valorisation et exploitation durable du bois duvre sans reposition-ner les VOI sur la base du dcoupage des Kijana serait prendre le risque de gnrer presque coup sr, des conflits sur la rpartition des revenus et des bnfices de lexploitation du bois duvre. (Bertrand et al., Barrires, supra note 16 la p. 15. Voir aussi Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM) - Biodiversit et Gestion forestire communale et communautaire (GESFORCOM), Renforcement des transferts de gestion par lamlioration des techniques dexploitation du bois duvre et du contrle forestier. Rapports des missions ralises du 18 au 25 octobre, du 13 au 16 novembre et le 23 novembre 2007 par Alain Bertrand, Antananarivo, 2007.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 181 Montagne & Bertrand
-
Lchec de ces VOI CI peut directement tre imput quatre causes principales :
le caractre trs restrictif des contrats - il ny a aucune possibilit dtendre les superficies culturales31 ;
le manque de ressources financires qui leur sont attribues ou quils peuvent gnrer par eux-mmes il ny a pas de possibilit de faire de lexploitation du bois duvre dans leurs territoires malgr le fait que tous les VOI possdent presque les mmes ressources forestires ;
le choix des bnficiaires de la gestion des ressources dans le cadre des contrats il ny a pas dimplication des ans (Tangalamena) dans la communaut et il y a confusion entre utilisateurs et ayants-droit aux ressources. Toutes les activits entreprises dans les Kijana forestiers les espaces pastoraux naturels de pturage sont tributaires du Tangalamena. Tant que le Tangalamena ne gre pas lui-mme le VOI ou sil na pas donn son autorisation pour les diffrentes activits mener sur le Kijana, les communauts locales peuvent tre rticentes et mme non rceptives quant aux diffrentes innovations qui leur sont apportes ;
linsuffisance des formations et des informations qui ont t donnes aux membres des communauts locales de base32.
Ces causes de lchec des VOI CI ne sont pas propres ceux-ci33. Il ne sagit non plus des seules raisons expliquant linsuccs dun contrat Gelose. Le non respect du rythme de concer-tation interne des communauts de base, par exemple, a dj t soulign comme un facteur contributeur lchec de certains contrats Gelose34. En opposition aux raisons pour les checs dun contrat Gelose que le texte vient de souligner, la section qui suit voquera, analysera et vrifiera les conditions de russite dun contrat Gelose dans le cadre du FFEM.
4. LES CONDITIONS ANTRIEURES LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSFERT DE GESTION
Un contrat de transfert de gestion ne peut pas tre utilement excut sil nest pas bien tabli. Cette vrit sest impose comme une vidence pour le FFEM. Ds le dpart, le FFEM a con-sidr quil devait favoriser lappropriation sociale du contrat et du transfert (4.1) et garantir des bnfices rels aux populations locales dlgataires (4.2) conditions mandates par la Loi
31 Le point 6 du plan damnagement du VOI Lazasoa Lovasoa, par exemple, stipule que le droit dusage non rgul est interdit () il est formellement interdit de faire des cultures sur abattis brlis.
32 Mino Randrianarison et Philippe Karpe, valuation de lefficacit et de lquit des contrats de conser-vation Madagascar. Cas de la rgion de Didy. XXIVmes Journes du Dveloppement de lAssociation Tiers-Monde conomie de la connaissance et dveloppement, Universit Gaston Berger de Saint-Louis, UFR Sciences conomiques et Gestion, CREDES-Universit Nancy 2. Droits et dveloppement, 20, 21 et 22 mai 2008.
33 Montagne et al., Transfert, supra note 13.34 Gatan Feltz et Grard Andriamandimby, Transferts de gestion et remaniements sociaux au sein des
communauts de base dans Pierre Montagne, Zo Razanamaharo et Andrew Cooke, dir., Le transfert de gestion Madagascar, dix ans defforts: Tanteza (tantanana mba hateza : gestion durable), Montpellier, CIRAD, 2007, 87 ; Bertrand et al., Barrires, supra note 16.
1.
2.
3.
4.
182 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
Gelose. ces fins, le FFEM a par conviction scrupuleusement respect les conditions succes-sives fixes par la loi. Les jugeant toutefois insuffisantes, il les a enrichies et compltes.
4.1 Les conditions utiles pour une relle appropriation sociale du contrat
La Loi Gelose exige lappropriation sociale du contrat et pose les jalons de sa ralisation. Lappropriation sociale vite que le contrat soit le rsultat dune contrainte impose aux popu-lations locales concernes. La Loi Gelose dispose cette fin que le transfert de gestion doit tre initi par les populations elles-mmes35. Elle garantit par ailleurs ces populations une partici-pation sur un pied dgalit aux ngociations sur les termes de la dlgation de gestion et une prise en compte relle et pleine de leurs revendications, grce principalement au mdiateur environnemental. Celui-ci a en effet pour mission :
de faciliter les discussions et les ngociations entre les diffrents partenaires de la gestion locale des ressources naturelles et les aider : comprendre leurs points de vue respectifs sur les ressources naturelles; laborer une certaine vision commune de lavenir long terme de ces ressources; construire des stratgies communes de gestion de ces ressources; dfinir les procdures permettant leur gestion effective, en bien commun, sur la base de cette vision et de ces stratgies communes36.
Le mdiateur environnemental assure sa mission par ltablissement dun courant dinformation entre les parties 37. Il ne peut pas imposer de solution aux parties ou prendre fait et cause pour lune delles38. Sa dsignation relve logiquement et utilement de la dili-gence et de lapprciation consensuelle des parties 39. Enfin, pour viter tout conflit dintrt nuisible, et ainsi accomplir au mieux sa fonction, il est expressment prvu que le mdiateur ne soit li aucune des parties prenantes40. De par ces mmes dispositions, les autres acteurs con-cerns les administrations dconcentres et collectivits dcentralises doivent participer galit la ngociation et la dtermination des termes du transfert de gestion. Leur propre appropriation du transfert de gestion est aussi considre par la loi comme dterminante et indispensable. Cette participation, comme celle des populations locales, doit pleinement tre libre et consciente.
Lappropriation sociale libre et consciente du transfert de gestion est fondamentale et la loi impose den vrifier leffectivit en ce qui concerne les populations locales41. Le FFEM a dvelopp une dmarche afin de garantir cette appropriation sociale qui inclut toutes les con-ditions fixes par la loi. Afin de garantir un engagement libre et conscient de lensemble des parties prenantes, il est ncessaire de disposer dinformations fiables et compltes. Le FFEM a dvelopp un outil spcifique pour acqurir ces informations : le diagnostic dtaill du milieu
35 Loi Gelose, supra note 1, art. 9. 36 Ibid., art. 17. 37 Dcret n 2000-028 relatif aux mdiateurs environnementaux, art. 2.38 Ibid., art. 24. 39 Ibid., art. 26.40 Ibid., art. 4.41 Loi Gelose, supra note 1, art. 13.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 183 Montagne & Bertrand
-
dintervention. Ce diagnostic constitue ltape primordiale raliser42. Il fournit des donnes qui aident les intervenants avoir les diffrentes informations sur ltat de lieux dtaill du site incluant les contextes socioculturel, conomique, physique et cologique.
Le diagnostic permet de dterminer ltat actuel des lieux et des ressources naturelles utilises par les communauts locales et donne des renseignements sur la gestion passe des ressources naturelles renouvelables, le degr de responsabilit et le niveau de savoir faire des acteurs futurs gestionnaires, et lidentification des diffrents objectifs de gestion43. Ces rensei-gnements ont t dautant plus utiles que le FFEM a adapt la mthodologie du diagnostic chaque situation locale, dans chaque communaut de base demanderesse. Par ailleurs, les communauts de base concernes ainsi que toutes les autres parties prenantes identifies ont t impliques tout au long du diagnostic, de la reconnaissance du terrain au choix et la hir-archisation des objectifs proposs par les communauts de base. Les rsultats des enqutes, des interventions et des tudes ont t rgulirement et intgralement restitus auprs des parties prenantes au transfert de gestion. Ces dernires pouvaient ainsi faire dventuels amendements et adaptations. Au total, dix-neuf documents de diagnostic dtaill des sites dintervention du FFEM ont t raliss.
Pour consolider lappropriation sociale, il importe tout dabord de respecter le rythme des parties prenantes. Conforme son souci de raliser cette appropriation, la loi ne fixe logique-ment aucune dure. Le temps mis par le FFEM pour mettre en place les transferts de gestion est de vingt-six mois. Bien que la procdure puisse sembler relativement longue, la plupart des VOI ont estim que celle-ci tait ncessaire pour leur permettre dassimiler le concept 44. Il importe galement de respecter les institutions et les processus propres des diffrents acteurs concerns encore en vigueur. cet gard, concernant les populations locales, il ne faut pas leur imposer le respect de rgles coutumires tombes en dsutude. Soucieuse de raliser une vritable appropriation sociale, la loi a statu en ce sens. Quoiquelle prvoie lusage du Dina laccord entre les membres de la communaut o lon doit marquer son adhsion et dans lequel des sanctions sont prvues son recours est modulable. En effet, la loi nen fixe nul-lement le contenu. Elle dispose au contraire que les Dina doivent tre tablis conformment aux rgles coutumires propres de la communaut concerne et de leur volution45. Didy, les populations locales sont encore trs traditionalistes. Le FFEM a ainsi procd la ritualisa-tion des contrats et la demande de bndiction des membres du VOI aux anctres pour que ceux-ci veillent sur le bon fonctionnement du processus. Par ailleurs, il a respect les hirarchies traditionnelles. Ainsi, les VOI sont grs soit par le Tangalamena le groupe dans lui-mme ou soit par une personne qui a eu la bndiction du Tangalamena si ce dernier ne peut pas reprsenter le VOI.
42 FFEM, Guide de transfert, supra note 27. 43 Ibid.44 Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), valuation mi-parcours du projet FFEM-
Biodiversit - Madagascar par Louis Rasolofo Andriamahaly, Paris, Fonds Franais pour lEnvironnement, 2007 la p. 30.
45 Loi Gelose, supra note 1, art. 49.
184 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
4.2 Les conditions utiles pour une garantie de bnfices rels
La cration de bnfices tangibles et durables pour les nouveaux gestionnaires doivent tre garantis afin doffrir la motivation pour la gestion durable des ressources forestires et pour leur apporter une source de revenus alternative aux pratiques non durables. La Loi Gelose habilite et encourage par loctroi de certains avantages spcifiques les communauts locales exercer des activits de commercialisation et [de] valorisation des ressources renouvelables et des produits drivs 46. Mieux, elle pose comme principe que seul lexercice de ces activits assure une meil-leure gestion et conservation de la biodiversit47.
Pour garantir la cration de tels bnfices, il importe de scuriser les pouvoirs des commu-nauts locales, de renforcer leurs capacits matrielles et intellectuelles de gestion, et dadapter les termes du contrat aux ralits cologiques, conomiques et sociaux propres de chaque com-munaut dlgataire.
4.2.1 La scurisation des pouvoirs
La scurisation foncire affermit les pouvoirs des communauts locales. Sans scurit fonci-re, il est difficile de demander au paysan de prendre soin de la terre ou de la mettre en valeur de manire rationnelle 48. Cette scurisation est garantie dans le cadre du contrat Gelose grce la procdure de Scurisation Foncire Relative (SFR).
Procdure spcifique la Gelose et cre pour elle-seule49, la SFR est la constatation, linventaire et la dlimitation de lespace contenant les ressources naturelles renouvelables incluses dans le terroir coutumier de la communaut. Cest la dlimitation densemble du terroir dune communaut locale et le constat des occupations comprises dans le terroir50. Ce faisant, la SFR permet au VOI dtre plus responsable du Kijana laire de pturage en fort qui lui est allou. Il se sent plus libre de faire les activits qui lui paraissent bonnes pour la communaut locale. Incidemment, elle permet galement aux divers services tatiques et la Commune de mieux connatre les limites de leur comptence territoriale, consolidant par la suite son exercice.
La SFR a t initie dans la rgion de Didy au moment mme de la prparation des contrats de transfert de gestion51. Cest dans cette rgion que la premire tentative de mise en place de la SFR a t ralise en 2005. Les documents de la SFR de ce Kijana ont t signs et
46 Loi Gelose, supra note 1, art. 54. 47 Ibid.48 Loi n 90-033 Relative la Charte de lEnvironnement Malagasy, Titre III, Ch. 1, para. 4.3.49 Dcret n 98-610 rglementant les modalits de la mise en uvre de la Scurisation Foncire Relative, art. 1.50 Ibid.51 Il a nanmoins t suggr, dans le souci de raliser une SFR moindre cot et temps voulu, [de]
concrtiser le contrat de transfert de gestion et lenqute sur la mdiation avant dentamer la proc-dure SFR (Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), Test dune Scurisation Foncire Relative en Transfert de gestion. laboration des documents de la SFR de Beririnina - Madagascar (Rapport de mission) par Rabeson Rakotondrasata, Paris, Fonds Franais pour lEnvironnement, 2005, p.25). Il faut rappeler que, selon larticle 3 du Dcret n 98-610, la procdure de SFR est ouverte ds lobtention de lagrment administratif de la demande de transfert de gestion par la commune .
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 185 Montagne & Bertrand
-
approuvs par les entits responsables de ce processus, dont principalement les services de ltat chargs des forts, des domaines et de la topographie. Le maire a aussi t associ la procdure et a demand son inscription au futur guichet foncier qui sera cr en vue des rcents textes relatifs au foncier.
4.2.2 Le renforcement des capacits de gestion
Le contrat de transfert de gestion est complt par diffrents outils de gestion: le plan damnagement et de gestion simplifi ou PAGS, le cahier des charges, le Dina, le plan dopration et le statut du VOI. Prvus par la loi52, ces outils de gestion dfinissent et planifient les activits ralisables dans le cadre des transferts de gestion.
Llaboration de ces outils ncessite des travaux denqutes et dinventaires prcis. Ces tches ncessitent des capacits qui ne sont pas toujours possdes par les VOI et les services techniques dconcentrs et dcentraliss. Didy, les outils de gestion des contrats ont t labors avec lappui technique du FFEM. Celui-ci a, par exemple, avec ses propres moyens humains, techniques et financiers, men plusieurs tudes de potentialits et de faisabilit sur la gestion des ressources naturelles renouvelables et de leurs produits. A cet gard, le FFEM a dvelopp des mthodologies dinventaire et autres, simples et peu coteuses que les VOI peuvent mettre seuls en uvre53.
Le PAGS prcise les superficies sur lesquelles les bois duvre peuvent tre exploits et les quotas de prlvement autoriss. Pour tous les contrats mis en place, les superficies exploita-bles reprsentent vingt-huit pourcent de la superficie totale des Kijana transfrs. Le quota annuel de prlvement a t calcul par le FFEM en tenant compte dune dure de rotation de lexploitation de soixante ans.
Lensemble des prcisions dordre techniques dans les outils de gestion permet la valorisa-tion des ressources naturelles par les populations locales, et ainsi de gnrer des revenus stables pour les VOI. Un bilan prvisionnel inclus dans le PAGS de chaque VOI indique ceux-ci le montant des revenus que lexploitation raisonnable est susceptible de gnrer leur profit. Cest une incitation forte respecter leurs engagements et pour les populations locales non encore titulaires dun contrat Gelose sy intresser.
4.2.3 Ladaptation du contrat
La Loi Gelose pose en principe quil ne doit jamais y avoir deux contrats identiques. Elle exige la prise en compte de la situation concrte et des besoins spcifiques de chaque communaut54 tout au long du processus dlaboration du contrat. Le Projet FFEM a utilis des mthodes et des techniques particulires chaque site. Celles-ci lui ont permis de cerner au mieux les conditions et les ralits de chaque communaut. Parmi ces mthodes et ces techniques figure le diagnostic dtaill du milieu dintervention dj voqu.
52 Dcret n 98-782 relatif au rgime de lexploitation forestire, art. 5 et 31. 53 Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), Mthodologie dlaboration du plan damnage-
ment et de gestion des ressources naturelles renouvelables - Madagascar Paris, Fonds Franais pour lEnviron-nement, 2007.
54 Voir, par exemple, Loi Gelose, supra note 1, art. 13 et 14.
186 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
5. LES CONDITION POSTRIEURES LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSFERT DE GESTION
Sign, le contrat de transfert de gestion ne sera rellement effectif et efficace que si toute viola-tion est rellement sanctionne (5.1). Mais, la sanction nest pas une condition suffisante. Il est galement essentiel que lensemble des acteurs concerns possde les capacits pour mettre en uvre le contrat (5.2).
5.1 Les conditions utiles pour une sanction relle du contrat
Le droit gnral forestier est applicable partout au pays. Sans amnagement, par contre, cette sanction est vaine dans le contexte actuel de laccs au droit Madagascar. Le lgislateur en a bien eu conscience et le contrat Gelose est lgalement sanctionn par le recours au Dina. Le FFEM a poursuivi, complt et enrichi cette consolidation de lusage du Dina.
5.1.1 La consolidation du Dina
Pour rguler le comportement de leurs membres, la loi dispose que les VOI adopteront des Dina55 laccord entre les membres de la communaut o chaque membre doit marquer son adhsion et dans laquelle des sanctions sont prvues ceux qui ne respectent pas les termes con-venus. Le Dina donne la possibilit aux populations bnficiaires des contrats de limiter, voire darrter, les dgts occasionns par lintrusion de personnes trangres ces espaces, notam-ment des bcherons illicites. Ces populations peuvent ainsi contrler leur espace forestier.
Sans tre ncessairement impratif, le recours au Dina comme norme de gestion des res-sources forestires ne peut pas tre non plus strictement exclu. Sans aucun doute, le Dina permet de vhiculer les rgles sociales souhaites par ltat bien mieux que ne pourraient le faire les techniques juridiques classiques. Le Dina a dautant plus de valeur comme moyen daccs au droit forestier puisque la population concerne par celui-ci est titre principal de type rural. La population rurale se caractrise par un attachement aux rgles coutumires.
Le Dina nest rellement utile que sil est vritablement appliqu. Dans la commune rurale de Didy, le FFEM a mis en place une police forestire (polisinala) oprationnelle depuis 2005 pour enrichir les conditions mandates par la Loi Gelose. Non prvue par la loi, mais non expressment exclue, cette structure est compose de membres de VOI investis de la gestion des espaces transfrs. Chaque VOI a pourvu quatre membres, qui fait un total de 32 policiers de la fort . Leur formation a t assure par le FFEM et par le chef de la Circonscription de lEnvironnement des Eaux et Forts. Le FFEM a fait appel un prestataire un agent forestier qui a socialis ces agents de police forestire locale la lgislation forestire. Cette structure de proximit, cest--dire quelle provient de la communaut elle-mme, vient contrer linefficacit du systme de contrle manant de services de ladministration forestire confronts un problme crucial de moyens. La polisinala effectue des rondes inopines. Chaque VOI doit fournir au service forestier un compte rendu trimestriel des descentes en fort. Pour remplir au mieux sa mission, chaque polisinala a t dote de matriels vestimentaires et dquipements. Par ailleurs, chacun de ses agents a reu diffrentes formations, rgulirement mises jour. Des formations sur le droit forestier ont en particulier t organises. Chaque VOI organise
55 Loi Gelose, supra note 1, art. 49.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 187 Montagne & Bertrand
-
sa polisinala pour faire les surveillances en fort. Ladministration forestire ne contrle pas les activits des polisinala. On a remarqu quavec le temps, les polisinala connaissent et savent de plus en plus manier les rgles de gestion des ressources naturelles sur leur territoire. cette occasion, ils marient pratique traditionnelle de gestion des conflits et application des rgles institutionnalises par le contrat de transfert de gestion.
Le Dina ne peut tre vritablement utile que sil est effectivement adapt son contexte culturel et social. Son recours nest pas toujours indispensable, ni sa forme toujours identique. En effet, la persistance des institutions traditionnelles nest pas la mme dans toutes les com-munauts de base. Le lgislateur a eu conscience de cette situation, puisque, comme soulign prcdemment, la Loi Gelose autorise effectivement cette modulation56.
Le FFEM a construit une dmarche particulire dlaboration des contrats Gelose et des Dina. Elle se fait en tapes successives : linformation et linitiation de la population sur la gestion durable des ressources naturelles; le renforcement des capacits de cette population indispensable la dtermination autonome de leurs objectifs de gestion et de dveloppement; la dtermination des aspects culturels, socioconomiques et cologiques; des types dutilisations des sols et des modes de gestion des ressources naturelles renouvelables du site, etc. Il est surtout prvu que le contenu des diffrents documents de gestion, y inclus le Dina, sont fix en con-certation 57, y compris avec les communauts de base. Ces diffrentes tapes ont permis au projet FFEM de tenir rellement et pleinement compte des ralits locales et ainsi dadapter les documents contractuels y compris le Dina celles-ci, ce qui en garantit lapplication effective. Il est du reste intressant noter que de nombreux plans damnagement et de gestion sim-plifis rdigs au terme de cette dmarche soulignent que le Dina est adapt au contexte local et accentuent limportance des enjeux locaux. La dmarche suivie a dautant mieux permis de prendre utilement en compte les ralits locales dans la formalisation du contrat que le projet FFEM a sans cesse adapt cette dmarche aux conditions du milieu dintervention, les tapes pouvant alors se suivre lune aprs lautre et/ou tre priodiquement menes en parallle.
Concrtement, les montants des sanctions pcuniaires (vonodina) ont t dfinis en fonc-tion des revenus de la population locale et du souci de maintenir leur caractre dissuasif. Ils sont un quilibre entre ces lments. Le FFEM na fait quidentifier et officialiser ces montants dans les contrats de transfert de gestion.
Tableau 1 : Lien Dina-Contexte local
Intitul du Contrat Gelose
Contenu du Dina
Pour la gestion des ressources minires
Contenu du Dina
Pour la gestion des produits halieutiques
56 Ibid.57 Voir Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), Agencement global et mise en uvre des
mthodes et techniques de transfert de gestion. Guide mthodologique 1 (Rapport) Paris, Fonds Franais pour lEnvironnement, 2007.
188 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
VOI Tokotelo Article 12 :
Les membres du VOI ayant commis le dlit de faire des exploitations minires non auto-rises sont passibles dun vono-dina de 5 000 ar.
Article 16 :
Il est interdit pour les membres du VOI de demander des personnes extri-eures au VOI de faire la pche dans le Kijana. Toute infraction en ce sens est passible dun vonodina de 4 000 ar.
VOI Anjarasoa
Article 19 :
Les membres du VOI ayant commis le dlit de faire des exploitations minires non auto-rises sont passibles dun vono-dina de 5 000 ar.
Article 20 :
Le vonodina est de 10 000 ar pour les non membres du VOI.
Article 11 :
Il est interdit pour les membres du VOI de demander des personnes extri-eures au VOI de faire la pche dans le Kijana. Toute infraction en ce sens est passible dun vonodina de 4.000 ar
VOI Liantsoa Article 12 :
Les membres du VOI ayant commis le dlit de faire des exploitations minires non auto-rises sont passibles dun vono-dina de 50 000 ar. Un PV sera tabli dans ce sens.
Article 16 :
Il est interdit pour les membres du VOI de demander des personnes extri-eures au VOI de faire la pche dans le Kijana. Toute infraction en ce sens est passible dun vonodina de 40 000 ar.
VOI Fenomanana II
Article 18 :
Il est interdit de faire des exploi-tations minires dans le Kijana gr par le VOI. Toute infrac-tion est passible dun vonodina de 20 000 ar.
Article 15 :
Il est interdit pour les membres du VOI de demander des personnes extri-eures au VOI de faire la pche dans le Kijana. Toute infraction en ce sens est passible dun vonodina de 40 000 ar.
Les montants des vonodina diffrent dun VOI un autre. On constate que les montants des vonodina prvus par les VOI Liantsoa et Fenomanana II sont largement suprieurs aux
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 189 Montagne & Bertrand
-
montants des vonodina des VOI Anjarasoa et Tokotelo. Le fait que les montants des vonodina des VOI Liantsoa et Fenomanana II soient levs peut sexpliquer par le fait que Liantsoa et Fenomanana II sont des VOI grs par une majorit de personnes ayant atteints un haut niveau dducation. Ce niveau dducation les a conduites exercer de nouvelles activits sans lien avec la fort et fait en sorte quelles ne sont plus dpendantes financirement de celle-ci. Il sagit par exemple dactivits commerciales tels des petits commerces de produits de pre-mire ncessit, denseignement, de transport ou mme dactivits agricoles motorises. Par consquent, ces VOI peuvent fixer des sanctions leves sans crainte de rduire leur revenu ni compromettre sa rgularit. Cela nest pas le cas des VOI Anjarasoa et Tokotelo. Leurs membres vivent en effet trs largement aux dpens des ressources forestires, telle la cueillette de miel ou la pche aux anguilles. Limposition dun montant lev de vonodina pourrait donc grandement nuire leur survie.
Certes, les Dina sont constitus en majeure partie de conventions locales issues de pra-tiques locales et des traditions. Malgr ceci, ils ne sont pas toujours totalement applicables dans la rgion et des lments, surtout de nature sociale, font que leur application nest pas aise. Il est ainsi important dans le cadre de cette socialisation des contrats de transfert de gestion de trouver un moyen plus efficace et plus quitable de sanction. Ainsi, trouver le compromis ou le marimaritra iraisana selon la sagesse malgache pour rsoudre les conflits et certains dlits mineurs est plus adquat la situation.
Le Dina ne doit pas seulement tre adapt son contexte culturel et social dapplication mais doit aussi ltre par rapport la nature des activits quil doit rgir. Ainsi, Didy, lexploitation illicite du bois (le drodaka) couvre une surface bien plus vaste que celle de chaque VOI. Par ailleurs, elle implique entre outre tous les VOI dautres communauts locales. Pour amliorer la coordination entre toutes les entits concernes et ainsi assurer un meilleur contrle et sanction de cette activit illicite, le FFEM a complt les Dina respectifs de chaque VOI avec un accord qui compile tous ces Dina - un dinabe - qui est adopt par toutes les populations locales58. Il assure lchelle dun espace plus large le contrle local des conditions dexploitation et de commerce. Il garantit ainsi une relle surveillance de lexploitation illicite du bois et dispose de sanctions qui ont comme but le dveloppement de la fort telle une pnalit de devoir planter 50 pieds pour chaque traverse prise59.
58 Dinabe sur la protection de la fort dans la commune de Didy.59 Ibid., art. 9.
190 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
5.1.2 La consolidation du contrle forestier
Le contrle forestier, sous la responsabilit de ladministration de lEtat charge des forts, est lgalement prvu par les normes gnrales et particulires60. Cependant, le manque de moyens financiers, humains et matriels de ladministration ne permet pas une pleine et bonne appli-cation des rgles. Pour un bon accompagnement des contrats et une bonne surveillance des droits et devoirs de tous, il faut dvelopper un cadre rnov de contrle de lexploitation, de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers. Cest tout lenjeu des actions ralises par le FFEM en relation avec lAdministration de ltat, de la Commune de Didy et bien sr des VOI.
Pour la filire bois duvre, le systme de contrle forestier a t ramnag conformment aux textes lgislatifs en vigueur et adapt au contexte local de Didy. Dans le nouveau contexte de la dcentralisation de ltat o de plus grandes responsabilits ont t accordes aux com-munes et aux rgions, ces dernires peuvent et doivent jouer un rle central dans le contrle forestier sans que les prrogatives des agents de ltat ne soient mises de ct. Permettre un contrle optimal des flux par un dispositif associant Administration, collectivits dcentralises et VOI, tel est lenjeu dune action complmentaire du transfert de gestion absolument nces-saire la prennit des VOI.
Ce contrle forestier ramnag et adapt a la particularit de permettre le suivi des produ-its, de la production jusqu leur transformation. Ce suivi est ralis grce diffrents mar-quages raliss sur le bois qui permet quon puisse le tracer. Schmatiquement, le systme est le suivant :
il est d'abord ncessaire de dterminer, par inventaire, le stock de bois et, selon lestimation de laccroissement moyen annuel, de fixer un quota de prlvement61
60 Textes gnraux:
Ordonnance 60-128 du 30 octobre 1960 Fixant la procdure applicable la rpression des infrac-tions la lgislation forestire, de la chasse, de la pche et de la protection de la nature ;
Dcret 61-078 du 8 fvrier 1961 Fixant les modalits dapplication de lordonnance 60-128 du 3 octobre 1960 fixant la procdure applicable la rpression des infractions la lgislation forestire, de la chasse, de la pche et de la protection de la nature ;
Dcret 2001/068 du 24 janvier 2001 Fixant les modalits de vente des produits forestiers saisis ou confisqus;
Arrt ministriel N 3710/2001 du 30 mars 2001 Portant application du dcret n 2001-068 du 24 janvier 2001, fixant les modalits de vente des produits saisis ou confisqus ;
Arrt ministriel N 7694/2001 du 17 juillet 2001 Fixant les modalits de rpartition des parts sur les recettes provenant de la vente des produits saisis ou confisqus.
Textes particuliers:
Dcret 98-782 relatif au rgime de l'exploitation forestire, art. 37 et ss.
Dcret n 82-312 rglementant la fabrication du charbon de bois.
61 Le quota est le nombre de pieds darbre couper par an dans la zone de valorisation. Il est fix partir des
donnes dinventaire.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 191 Montagne & Bertrand
-
qui garantit une reconstitution optimale de lcosystme forestier. La rotation a t fixe 60 ans ;
les souches des arbres couper identifies sont par la suite tiquetes avec des plaquettes blanches indiquant le numro de la souche et le nom du VOI qui fait l'exploitation, toujours en concordance avec le quota de prlvement autoris ;
aprs l'exploitation forestire, les produits qui en sont issus sont marqus avec, cette fois-ci, des tiquettes jaunes montrant le numro du produit et le sigle du VOI. Les produits dclars par la communaut doivent tre conformes aux produ-its recenss dans le cahier de chantier (permettant de faire le suivi des exploita-tions) et dans le rapport d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, le service forestier (avec le marteau forestier) et la commune rurale de rattachement (avec le marteau numroteur de la commune) ne poinonnent pas les produits ;
une fois toutes ces marques prsentes et tous les contrles effectus, le VOI obtient l'autorisation de sortie du bois de l'administration forestire et leur transport vers les grandes agglomrations.
Ce contrle forestier dcentralis ncessite des moyens humains mais surtout financiers. Il faut mettre en place les conditions de la juste rmunration de tous les agents chargs de cette tche, quils soient agents de ladministration forestire, agents communaux de Didy ou de la police forestire (polisinala) des VOI. Pour que le dispositif ne dpende pas de lorganisme dappui et soit effectivement prennis, le contrle doit tre pris en charge par le systme lui-mme et la mise en place de prlvements fiscaux o chaque niveau de responsabilit trou-verait, par ces fonds, les moyens de ses activits de contrle. Cest ce qui a t tabli dans la commune de Didy, en relation avec la Direction Gnrale de lEnvironnement, des Eaux et Forts (DGEEF), la Circonscription Rgionale de lEnvironnement, des Eaux et Forts (CIREEF) dAmbatondrazaka et les VOI. Le systme comprend tout dabord une valuation du montant probable des recettes fiscales sur la base des quantits potentiellement exploitables annuellement et dfinies suite aux inventaires et calculs de possibilit. Puis, une cl de rparti-tion de ces recettes est fixe localement entre les acteurs concerns. Elle permet quune partie de ces recettes finance les activits de contrle des communes et des VOI, et non plus seulement de ladministration dconcentre.
5.1.3 Linstitutionnalisation dune fiscalit incitative et diffrentielle
Sur la base de larticle 54 de la Loi Gelose, le FFEM a dvelopp la fiscalit incitative et dif-frentielle. Il sagit dun dispositif destin inciter les populations locales et les communauts de base uvrer dans la lgalit et abandonner les coupes illicites de bois duvre. Cette fiscalit a pris diffrentes formes. Le montant et les modalits de versement des redevances forestires - une taxe forestire verse ltat chance priodique en contrepartie de loctroi du permis dexploitation ont t amnags en faveur des communauts de base. Ainsi, si tout exploitant forestier doit sacquitter du montant total de la redevance, les communauts de base ne paient par contre que 70 pourcent de la totalit du montant de la redevance. Elles sont ainsi dcharges des redevances en nature et de reboisement. La redevance en nature cor-respond une exploitation de gr gr et le reboisement est remplac par la reforestation dj
192 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
prvue dans le Plan damnagement annex au contrat. De surcrot, la redevance que les com-munauts de base doivent sacquitter peut tre paye en deux tranches aprs ngociation auprs de ladministration forestire, afin de leur permettre de commencer plus rapidement et plus facilement leurs exploitations forestires: un premier versement de 50 pourcent avant exploita-tion et le solde en fin danne avant lexpiration du permis dexploiter. La somme collecte par le paiement des redevances permettrait au reste de ladministration forestire de financer les activits de contrle du flux de bois duvre de la rgion.
Auparavant, les exploitants forestiers devaient payer des ristournes diffrentes chaque barrire de contrle, dont principalement la sortie de la limite de la commune et la sortie de la limite de la rgion. Les sommes verser taient diffrentes pour chaque barrire de contrle: de 150 300 ariary par traverse pour la commune et de 800 ariary par traverse pour la rgion. Ces ristournes sont toutes calcules sur la base dun mme arrt62. Dornavant, le paiement de la ristourne se fait en une seule fois auprs de la commune rurale de Didy. Le montant de la ristourne par traverse est de 3/100 du prix de vente Antananarivo. Pour une traverse de bois, le montant de la ristourne payer est de 900 ariary. Le fait de pouvoir payer les ristournes localement constitue un lment qui incite les communauts de base exploitant le bois duvre rgulariser leur activit. Les VOI nont plus payer des ristournes distinctes auprs de la bar-rire communale et auprs de la barrire rgionale.
5.2 Les conditions utiles pour une capacit relle de mise en uvre du contrat
Les acteurs du transfert de gestion ne possdent pas toujours toutes les comptences pour mettre en uvre pleinement et correctement les contrats, quelle que soit leur bonne volont. Les auteurs de la Gelose ont prvu du soutien au profit des VOI. Quoiquon ne prcise pas quels acteurs offriront ce soutien, ils relvent en effet de rglementations gnrales propres en matire de dcentralisation et fonction publique, la Gelose tant en dfinitive le texte gnral des VOI. La Loi Gelose dispose que les VOI pourront bnficier de lappui techniques des ser-vices dconcentrs de lEtat 63. Par ailleurs, en son article 54, la loi tablit que les VOI devront bnficier davantages concrets pour la commercialisation et la valorisation des ressources renouvelables et des produits drivs . Ces avantages tendent clairement garantir la ralisa-tion des finalits du contrat et donc de la loi64. Pour ce faire, la loi dispose que ces avantages soient modulables en fonction de la situation spcifique de chaque VOI et des marchs dans lesquels elles commercialisent leurs produits65. Cette adaptabilit sapplique en fait lensemble du soutien fournir aux VOI. La loi exige en effet dvaluer la capacit de gestion des VOI ds la demande dagrment66 de manire dterminer au mieux la nature et les caractres des appuis utiles dont ils auront besoin par la suite.
Le FFEM a concrtis ces avantages dans le cadre du rgime de financement du contrle forestier et de la fiscalit incitative et diffrentielle dj voqu. Il a par ailleurs assur la
62 Arrt provincial n 036 PA/TOA/DS/AE du 8/8/2005, portant sur la fixation des taux, des modes de rpar-tition et des modalits de recouvrement des taxes dans le Faritany de Toamasina.
63 Loi Gelose, supra note 1, art. 55. 64 Ibid., art. 54. 65 Ibid. 66 Ibid., art. 12.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 193 Montagne & Bertrand
-
demande des VOI un appui technique par lintervention de missionnaires dans diverses disci-plines, tels lamnagement forestier, le droit forestier et la fiscalit forestire. Enfin, toujours la demande des VOI, le FFEM a organis la formation de leurs membres. Ces formations sont une initiative spcifique du FFEM destine permettre aux communauts de base de raliser une exploitation forestire respectant les normes de prlvement par le biais de formations aux techniques de carbonisation amliores et aux mthodes de coupe et de pr-transforma-tion du bois duvre. Les formations ont aussi comme objectif de renforcer la capacit des communauts grer par elles-mmes les bnfices quelle tire de la valorisation des ressources grce des formations en gestion administrative et en comptabilit simplifie. Ces formations, aprs leur identification, ont t dispenses avec le soutien financier de lorganisme dappui et par des professionnels dans le mtier. Les formations ont t organises une premire fois en fonction des demandes des communauts locales. Si ces dernires jugeaient les formations donnes insuffisantes, lorganisme dappui pouvait en organiser dautres toujours en fonction des demandes spcifiques des VOI. Les formations ne se font pas seulement sur papier: des pratiques sont faites dans la fort sur les utilisations du matriel ou sur la construction de cer-taines infrastructures ncessaires la ralisation des activits des VOI. Les thmes de formation ont t choisis par le FFEM en fonction des objectifs de gestion fixs ou des demandes des communauts de base. Ils concernent tous les aspects utiles et ncessaires de la vie et du fonc-tionnement dun VOI et de ses activits: animation et structuration, gestion dune organisation paysanne, concertation et planification, lgislation forestire, apiculture amliore, techniques de carbonisation amliore, exploitation forestire, systme de culture avec couverture vgtale permanente. Il convient enfin de souligner que lensemble de ces formations na pas t offert uniquement aux VOI, mais aussi lensemble des acteurs du transfert de gestion, administra-tion dconcentre et collectivit dcentralise.
Ces diffrents appuis et avantages ne peuvent suffire renforcer les capacits des acteurs du transfert de gestion. Il importe galement de sassurer que les termes du contrat soient effective-ment comprhensibles et donc appropriables par les populations dlgataires. Ceci implique un effort ignor sur la forme des contrats. Ainsi, par exemple, le contrat ne serait utile que sil est rdig en des termes trs larges, vitant toute prcision, trop de dtails, tout engagement dans des applications strictes des obligations souscrites. Par contre, il doit demeurer un contrat crit. En effet, actuellement, la parole donne na plus le mme poids quauparavant dans la socit rurale malgache. Elle devient de moins en moins respecte. Elle est remise en cause par les autochtones eux-mmes pour se protger contre la menace quils ressentent par la prsence croissante dtrangers. Consquemment, les contrats ne peuvent plus tre tous conclus de manire verbale. Les communes rurales commencent initier la communaut locale la nces-sit de mettre par crit les transactions foncires dans leur juridiction. Les contrats verbaux ne se font plus quentre des petits cercles restreints, surtout entre les personnes appartenant une mme famille ou un mme lignage. Par ailleurs, ils ne concernent que des accords de moindre importance, tels des prts dargent dont le montant nest pas trs lev ou des prts de matriels agricoles pas chers. Lusage de lcrit devient de plus en plus prpondrant. Cela se constate spcialement dans les communauts en forte mutation et celles menaces par une forte immigration susceptible de les spolier de leurs propres droits. Dans le cas du Lac Alaotra proximit de Didy, par exemple, les communauts locales dAndreba Gare sont plus dsireuses que celles de Didy pour conclure un contrat crit en matire de dlgation de gestion des res-
194 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
sources naturelles. Ceci vient du fait quAndreba Gare est compos dune socit brasse avec un fort taux dimmigrants venant sinstaller dans la rgion. Didy par contre est plus isole de ce phnomne cause de ltat dgrad de la route pour y parvenir qui la dtache plus des influ-ences extrieures et de limmigration.
6. CONCLUSION
Le contrat Gelose complte ncessairement la loi pour faire avancer les objectifs politiques fixs par ltat. Il est le prolongement essentiel de la loi qui ne parvenait pas elle seule pro-mouvoir le dveloppement durable de faon efficace. Toutefois, ce contrat nest utile ltat que si certaines conditions sont ralises. La Loi Gelose en a pos certaines. La pratique du FFEM a vrifi et prouv leur efficacit. Elle les a galement prcises, enrichies et compltes. Successives et solidaires, ces conditions doivent tre accomplies avant, comme aprs, la conclu-sion du contrat et tout au long de la vie de celui-ci.
Un contrat de transfert de gestion ne peut tre utilement excut que sil est bien tabli. Pour ce faire, deux conditions doivent tre respectes. Il faut tout dabord garantir lappropriation sociale du contrat et ensuite assurer des bnfices rels aux populations locales dlgataires. Six conditions principales permettent aux diffrents acteurs concerns de sapproprier le contrat. Tout dabord, le transfert de gestion doit tre initi par les populations locales elles-mmes. Par ailleurs, lensemble des acteurs concerns doit participer sur un pied dgalit aux ngociations sur les termes de la dlgation de gestion. Ensuite, les revendications de lensemble des acteurs concerns doivent tre rellement et pleinement prises en compte. En outre, lengagement des acteurs doit tre libre et conscient, ce qui exige quils disposent dinformations fiables et com-pltes. Le rythme des parties prenantes doit galement tre respect. Enfin, les institutions et les processus propres des diffrents acteurs concerns encore en vigueur doivent tre respects, ce qui implique, concernant les populations locales, de ne pas leur imposer le respect de rgles coutumires tombes en dsutude.
Trois conditions essentielles doivent tre respectes pour garantir la cration de bnfices rels aux populations locales dlgataire. Il importe de scuriser les pouvoirs des communauts locales grce la scurisation foncire. Il faut aussi renforcer les capacits matrielles et intellec-tuelles de gestion de ces communauts par diffrents outils de gestion dfinissant et planifiant les activits ralisables sur la base de travaux denqutes et dinventaires prcis. Enfin, il con-vient dadapter les termes du contrat aux ralits cologiques, conomiques et sociaux propres de chaque communaut dlgataire. Le diagnostic dtaill du milieu dintervention permet de mieux cerner les conditions et les ralits locales et ainsi dadapter le contrat son contexte de mise en uvre.
La ralisation des trois conditions suivantes permet de garantir la sanction relle du contrat. Il faut recourir un Dina, mis en uvre par une police forestire de proximit (polisinala), et adapt son contexte culturel et social dapplication et la nature des activits quil doit rgir. Il faut en outre rnover le contrle forestier par linstitutionnalisation dun contrle forestier dcentralis et autofinanc, garantissant la juste rmunration de tous les agents chargs du contrat. Il faut enfin mettre en place une fiscalit incitative et diffrentielle, destine inciter les populations locales et les communauts de base uvrer dans la lgalit.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 195 Montagne & Bertrand
-
La capacit des acteurs concerns mettre en uvre les contrats est renforce grce laccomplissement des trois conditions principales suivantes. Diverses mesures de soutien doivent tre accordes aux acteurs concerns, notamment des appuis techniques et des forma-tions. Ensuite, le contrat doit tre de forme crite. Enfin, les termes du contrat doivent tre effectivement comprhensibles et donc appropriables par les communauts, ce qui implique en particulier de rdiger le contrat en des termes trs larges, vitant toute prcision, trop de dtails, tout engagement dans des applications strictes des obligations souscrites.
Tableau 2 : Synthse des conditions de russite des contrats de transfert de gestion
Conditions de russite du contrat accom-plir avant la conclusion de celui-ci, cest--dire destines bien fonder le contrat
Conditions de russite du contrat accom-plir aprs la conclusion du contrat et tout au long de sa vie
Conditions utiles pour une relle appropria-tion sociale du contrat :
le transfert de gestion doit tre initi par les populations locales elles-mmes.
lensemble des acteurs concerns (popu-lations locales, administrations dcon-centres et collectivits dcentralises) doivent participer sur un pied dgalit aux ngociations sur les termes de la dlgation de gestion.
les revendications de lensemble des acteurs concerns doivent tre relle-ment et pleinement prises en compte.
lengagement des acteurs doit tre libre et conscient, ce qui exige quils dis-posent dinformations fiables et com-pltes (le diagnostic dtaill du milieu dintervention permet dacqurir ces informations).
le rythme des parties prenantes doit tre respect.
les institutions et les processus propres des diffrents acteurs concerns encore en vigueur doivent tre respects, ce qui implique, concernant les popula-tions locales, de ne pas leur imposer le respect de rgles coutumires tombes en dsutude.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conditions utiles pour une sanction relle du contrat :
il faut recourir un Dina, mis en uvre par une police forestire de proxim-it (polisinala), et adapt (forme et fond) son contexte culturel et social dapplication et la nature des activits quil doit rgir.
il faut rnover le contrle forestier par linstitutionnalisation dun contrle for-estier dcentralis et autofinanc, garan-tissant la juste rmunration de tous les agents chargs du contrat.
il faut mettre en place une fiscalit inci-tative et diffrentielle, destine inciter les populations locales et les communau-ts de base uvrer dans la lgalit.
1.
2.
3.
196 JSDLP - RDPDD randrianarison, Karpe Montagne & Bertrand
-
Conditions utiles pour une garantie de bn-fices rels :
il importe dune part de scuriser les pouvoirs des communauts locales grce la scurisation foncire.
il faut renforcer les capacits de gestion (matrielles et intellectuelles) de ces com-munauts par diffrents outils de gestion (plan damnagement et de gestion sim-plifi ou PAGS, cahier des charges, etc.) dfinissant et planifiant les activits ral-isables sur la base de travaux denqutes et dinventaires prcis.
3. il convient dadapter les termes du contrat aux ralits cologiques, conomiques et sociales propres de chaque communaut dlgataire (le diag-nostic dtaill du milieu dintervention permet de mieux cerner les conditions et les ralits locales et ainsi dadapter le contrat son contexte de mise en uvre).
1.
2.
3.
Conditions utiles pour une capacit relle de mise en uvre du contrat :
diverses aides doivent tre accordes aux acteurs concerns, notamment des appuis techniques et des formations.
le contrat doit tre de forme crite.
les termes du contrat doivent tre effec-tivement comprhensibles et donc appropriables par eux, ce qui implique en particulier de rdiger le contrat en des termes trs larges, vitant toute pr-cision, trop de dtails, tout engagement dans des applications strictes des obliga-tions souscrites.
1.
2.
3.
Toutes ces conditions permettent la russite du contrat Gelose : amlioration gnrale des revenus des VOI ; amlioration des revenus des communes et des services forestires travers les ristournes et les redevances ; une rduction de moiti du dlit forestier67. Certes, la ralisa-tion de toutes ces conditions est longue et fastidieuse. Sur cette ralit, il ne faut cependant pas justifier labandon du transfert de gestion. Bien au contraire, tous ces lments conditionnent la russite relle dun contrat Gelose, comme le dmontre lexemple du FFEM Didy. Si lon veut vritablement ne plus faire de transfert de gestion et changer de politique conform-ment aux critiques faites par les prservationnistes , est-ce que Madagascar dispose dautres alternatives prtes tre mises en place trs rapidement pour grer les ressources naturelles renouvelables et freiner leurs dgradations? Il est peu probable. Lexprience Madagascar dmontre que le transfert de gestion, dans le cadre de la Loi Gelose, est combin avec dautres mesures une politique utile de gestion de lenvironnement, sous rserve dtre bien comprise et implante.
67 Rapport Rakotobe, supra note 14.
randrianarison, Karpe, Volume 5: Issue 2 197 Montagne & Bertrand

![[Développement Durable] Apple et le développement durable en 2015](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55cd9d80bb61ebf92d8b463c/developpement-durable-apple-et-le-developpement-durable-en-2015.jpg)