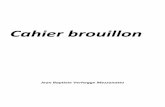La Géode Freudienne - Deuxième Brouillon
-
Upload
davidtellezlandin -
Category
Documents
-
view
4 -
download
2
description
Transcript of La Géode Freudienne - Deuxième Brouillon

1
La géode freudienne
A propos de la référence minéralogique
dans la psychopathologie de Freud
Miguel Angel SIERRA RUBIO
Psychologue clinicien. Doctorant en Psychopathologie et Psychanalyse, Université Paris
Diderot – Paris 7. Boursier du Gouvernement Mexicain (CONACyT) en collaboration avec le
Gouvernement Français. Thèse en préparation : « Les contributions de Freud et Lacan à la
théorisation des structures cliniques dans la psychopathologie psychanalytique », sous la
direction de F. Sauvagnat, psychanalyste et professeur des universités.
Résumé
La référence de Freud à la minéralogie implique une filiation généalogique et une portée
psychopathologique qui restent peu explorées. Ce travail aborde l’influence doctrinale du
minéralogiste Gustav Tschermak, professeur de Freud à l’université, sur des avancées
ultérieures de la psychanalyse, en particulier concernant le classement des névroses et la
conception structurale qui lie la normalité et la pathologie. Ce parcours conduira à questionner
la notion de structure clinique.
Mots clés
Psychopathologie psychanalytique – Minéralogie – Généalogie – Structure clinique
The Freudian geode. On mineralogical reference of Freud’s psychopathology
Abstract
Freud’s reference to mineralogy implies a genealogical root and a psychopathological effect
that remain to be explored. This paper discusses the doctrinal influence of the mineralogist
Gustav Tschermak, Freud’s teacher at the University, on later breakthroughs of
Psychoanalysis, especially concerning the classification of neuroses and the structural
conception that links normality and pathology. This route will result in questioning the notion
of clinical structure.
Keywords
Psychoanalytic psychopathology – Mineralogy – Genealogy – Clinical structure

2
Les malades de l’esprit sont des cristaux fissurés et éclatés ! Telle est l’étonnante
conception de la folie que l’inventeur de la psychanalyse nous a livrée à la fin de sa vie. Un
morceau de quartz se fragmente en tombant au sol ; le moi se casse en s’effondrant dans
l’affection mentale. Ainsi Freud exprime-t-il le rapport entre le clivage et la psychose à
travers la métaphore cristallographique. Cette métaphore, qui assimile les malades de l’esprit
à des cristaux fissurés et éclatés, est la plus célèbre des observations freudiennes qui mettent
en relation la science minéralogique et la science de l’inconscient.
Néanmoins, cette conjonction entre disciplines ne va pas de soi. Bien que la tradition
minière de l’Autriche soit l’une des plus importantes d’Europe1, ceci ne suffit pas à expliquer
le geste freudien qui nous concerne. Dans la littérature analytique on trouve, d’une part, des
études qui visent à éclaircir le sens général de « la raison métaphorique chez Freud »2,
notamment cette métaphore concernant le sujet clivé comme un cristal3 ; et d’un autre côté,
des remarques sur la classification freudienne des névroses d’après le « modèle d’une analyse
minéralogique »4. Cependant, la généalogie de ces références a été très peu prise en
considération. Y a-t-il, dans la biographie de Freud, un événement capable d’attacher le savoir
des géosciences à sa pensée psychopathologique ? Il a suivi, à l’occasion de sa formation
universitaire, le cours du Pr Gustav Tschermak – à l’époque, l’un des plus grands
représentants des sciences de la terre : soit cinq heures hebdomadaires de minéralogie, durant
le premier semestre de 1874.
Qui était ce professeur ? Quelle influence a-t-il eu sur le futur Inventeur de la
psychanalyse et sa pensée psychopathologique ? En quoi la référence minéralogique convient-
elle à l’explication des troubles étudiés par l’analyste ? Sous quelles conditions y aurait-il un
avenir pour cette perspective ? Notre propos cherchera à établir quelques convergences entre
l’enseignement minéralogique de Tschermak et certaines conceptions psychopathologiques de
Freud. Mais notre entreprise présuppose une présentation du héros inconnu de cette histoire:
Gustav Tschermak. Ce sera l’objet de la première partie. Nous nous intéresserons ensuite à
montrer successivement les parallèles entre quelques notions minéralogiques traitées dans les
textes tschermakiens et deux thèmes fondamentaux de la psychopathologie freudienne : la
nosographie, et le rapport entre normalité et maladie mentale.
« Communications minéralogiques »
Le professeur Gustav Tschermak était le rejeton de la lignée tchécoslovaque d’Ignaz
Czermak. En 1927, on lit sur sa notice nécrologique : « Les minéralogistes n'ont pas besoin
d'être informés de qui était Tschermak pour la minéralogie et du travail qu'il a accompli »5. Il
était en effet tellement célèbre dans ce domaine scientifique ! Alors qu’il est aujourd’hui
quasiment ignoré du monde psychanalytique6.
Né en 1836, il a germanisé dans sa jeunesse l’orthographe du nom de sa famille – ceci
en raison de sa position politique concernant le problème identitaire des peuples de l’Europe

3
centrale du XIXe. À l’époque, on s’interrogeait beaucoup sur l’identité nationale de ces petits
peuples (parmi lesquels le peuple tchécoslovaque) qui devaient soit retrouver leur spécificité
slave, ou bien entrer dans la Grande Allemagne. Contre le panslavisme, Gustav a choisi le
pangermanisme : son nom de famille en porte témoignage. À cause de ce changement
orthographique, nous avons du mal à l’identifier dans les comptes rendus des cours
universitaires effectués par le jeune étudiant Freud : il est appelé parfois « Czermak », et
parfois « Tschermak »7.
Ancien élève de l’Université de Vienne, il a continué sa formation à Heidelberg et
Tübingen, pour revenir à Vienne en 1868 comme Privatdozent. Il est hors de doute que, à
partir de 1873, il y était à la fois le responsable de l’Institut de Minéralogie et Pétrographie, et
l’enseignant titulaire de ces cours. À son départ en 1906, il recevra le titre nobiliaire de
Seigneur de Seysenegg, qu’il pourra transmettre à ses descendants.
Les hauts postes conférés au Hofrat Prof. Dr. Gustav Tschermak von Seysenegg, et sa
courageuse activité scientifique, justifient son renom. Il fut directeur du Cabinet Impérial et
Royal Minéralogique, membre de l’Académie Autrichienne des Sciences, premier président
de la Société Viennoise de Minéralogie et fondateur de Communications minéralogiques,
revue autrichienne spécialisée qui existe toujours. Ses importantes contributions ont conduit à
l’honorer à titre posthume, en créant un prix qui porte la dénomination Tschermak-Seysenegg.
Ce prix est également associé au nom de ses fils – le botaniste Erich et le physiologiste Armin
–, et peut être attribué dans les trois disciplines : minéralogie, botanique et physiologie.
Freud suivait donc à l’époque le cours de l’un des plus grands experts du domaine des
géosciences. Hélas ! On ne trouve aucun commentaire dans sa correspondance, sauf le récit
d’une rencontre furtive8 pendant les vacances de 1900. Mais, est-il possible de connaître la
doctrine minéralogique que le maître lui a enseignée ? En fait, nous disposons des écrits
tschermakiens destinés à l’enseignement universitaire. Il s’agit de deux ouvrages d’une
inégale notoriété : en 1863 une Esquisse de minéralogie pour étudiants, dont on ne connait
qu’une seule édition ; et le Manuel de minéralogie datant de 1884 et ses neuf éditions
successives – travail actualisé pendant une quarantaine d’années et, de plus traduit en russe,
italien et polonais.
Les deux livres ont une disposition similaire de contenu : ils offrent une introduction
qui définit la matière et fournit quelques repères historiques et bibliographiques ; puis, une
partie de minéralogie générale qui pose les notions fondamentales avec lesquelles cette
science travaille ; ensuite, une section de minéralogie spéciale où sont traités les corps
minéraux dans leurs caractéristiques particulières ; enfin, un appendice concernant les
météorites. Freud, qui le 16 juillet 1874 avait passé avec mention l’examen de Tschermak,
retiendra certaines notions fondamentales de la minéralogique générale dans sa pensée
psychopathologique : individu, cristal, fissibilité, clivage, structure. De quoi s’agit-il ?
Le minéralogiste germanophone désigne comme Individu9 le corps matériel le plus
simple qui fait son objet d’étude. Grosso modo, les corps minéraux peuvent avoir soit un état

4
amorphe, soit un état cristallisé et cristallin. Ces derniers apparaissent fréquemment sous la
forme de cristaux. Un Krystall est donc un individu minéral dont la forme est limitée par des
surfaces plates, lorsqu’il y a une coïncidence entre son agencement interne spécifique et sa
forme plate spécifique. Tous les cristaux présentent une certaine Spaltbarkeit ou fissibilité,
grâce à laquelle ils peuvent être « clivés » : non pas de n’importe quelle façon, mais en
suivant l’orientation et la disposition de leurs articulations internes. De plus, il y a la propriété
de la Structur : le type d’agrégation des cristaux pour composer des corps cristallins,
dépendant de la grandeur des morceaux réunis.
Par contre, les individus minéraux dits amorphes ne présentent pas ces
caractéristiques. Tschermak souligne qu’une telle dénomination ne signifie pas que les corps
concernés n’aient aucune forme ; plutôt, elle indique « l’absence de toute nature cristalline,
donc le manque de forme cristalline importante, de fissibilité et structure »10. Parmi les corps
amorphes, il faut compter le verre (Glas), ce qui nous donne l’occasion de remarquer son
opposition minéralogique par rapport au cristal. Au niveau de l’étude des minéraux, cristal et
verre ne sont pas du tout la même chose : le verre illustre plutôt une catégorie qui présente des
propriétés contraires aux cristaux. Si un morceau de verre et un cristal viennent à tomber, le
verre se casse de façon capricieuse ; le cristal, par ailleurs, se fracture selon ses lignes internes
de clivage !
Ces notions appartiennent à la morphologie, qui est la section initiale composant la
minéralogie générale, et dont l’étude se divise « en cristallographie ou doctrine des formes
régulières, et en doctrine des structures qui traite des formes d’agrégation des individus
minéraux »11. Du point de vue de cette dernière, il faut dire qu’un conglomérat de minéraux
(Mineralgemenge) qui se produit en grandes masses est généralement appelé une roche, fait
qui est la base de la « doctrine des roches [Gesteinlehre] »12. Munis de ces éléments essentiels
de l’enseignement tschermakien, nous pouvons commencer à relire le texte freudien et ainsi
dévoiler les enjeux de la psychopathologie construite sur de telles références.
La « cristallographie clinique » des névroses : une autre nosographie
La classification des névroses a été établie à partir de 1769 dans les travaux de
William Cullen, le médecin anglais qui a inventé le terme névrose13. Dans la première édition
de sa Synopse de nosologie méthodique, Cullen regroupe et range les maladies connues dans
quatre classes : les pyrexies, les névroses, les cachexies et les maladies locales. Ces quatre
classes sont subdivisées en ordres, les ordres en genres et les genres en espèces. La classe des
névroses contient quatre ordres, à savoir : les comas, les adynamies, les spasmes et les
vésanies. Parmi les spasmes, on trouve (juste à côté du diabète et de l’hydrophobie !) le genre
hystérie, qui comprend huit espèces. Voici une classification des maladies en classes, ordres,
genres et espèces… tout comme s’il s’agissait des plantes !

5
L’histoire de la médecine a enregistré le nom particulier d’une telle procédure : il
s’agit de la nosotaxie more botanico – voire la classification des maladies à la façon des
botanistes. Réduire les maladies à des espèces bien délimitées, « avec la même attention
qu’on voit montrée par les botanistes dans leurs phytologies »14, telle était la consigne de
Thomas Sydenham, médecin anglais du XVIIe siècle et précurseur de la naissance de la
clinique. Indication mise à la lettre dans les nosographies de Cullen, Sauvages, Linné et Pinel
lui-même. Au fur et à mesure, ces catalogues se sont avérés inutiles pour la compréhension et
pour la thérapie des maladies nerveuses15. Elles continueront cependant à être des énigmes
cliniques de la médecine du XVIIIe et du XIXe siècle, et constitueront le sol natif de la
psychanalyse.
En effet, Freud sera le premier à proposer avec succès leur explication scientifique et
leur approche thérapeutique. Les névroses sont la raison d’être de la discipline freudienne, au
point que le psychanalyste a pu écrire : « la doctrine des névroses [Neurosenlehre], c’est la
psychanalyse elle-même »16. Bien entendu, une partie très importante de cette Neurosenlehre
a été constituée par la classification freudienne des névroses, précisée et complétée au fil des
années – en fait, trois nosographies, traversées par la même distinction fondamentale entre
deux genres morbides : les névroses actuelles et les psychonévroses. Pour y parvenir,
néanmoins, il n’a jamais suivi les contraintes de la nosotaxie more botanico. Il opère même
une rupture en rappelant la procédure des minéralogistes. Ainsi dans un passage des Leçons
d’introduction à la psychanalyse :
Pensez à la différence entre l'étude des minéraux et l'étude des roches en minéralogie. Les minéraux, on
les décrit comme des individus [Individu], en s'étayant assurément sur le fait qu'ils apparaissent souvent
comme des cristaux [Kristall] strictement délimités de leur environnement. Les roches [Gestein] se
composent de conglomérats [Gemenge] de minéraux qui ne se sont certainement pas assemblés au hasard,
mais par suite de leurs conditions d'apparition.17
Constat freudien : les phénomènes névrotiques amènent le clinicien à un labyrinthe,
dont le seule fil d’Ariane c’est la distinction nosographique entre névroses actuelles et
psychonévroses – soit la reconnaissance de deux terrains étiologiques divers pour les
névroses : les unes relevant de causes organiques (somatogènes) et les autres de causes
animiques (psychogènes). Ces deux genres de névroses se présentent souvent comme un
« mélange ». On reconnaît dans cette expression freudienne l’hypothèse de la névrose mixte,
posée depuis 1894 : en effet, elle entraîne la présence simultanée de deux ou plus d’espèces
nosographiques, appartenant ou non au même genre, dans le même cas clinique.
Autrement dit : la névrose mixte est une roche ; et selon l’avis de Freud, « nous faisons
certainement bien d’isoler tout d’abord de la masse les individus cliniques reconnaissables par
nous, qui sont comparables aux minéraux »18. Prenons l’exemple de la neurasthénie, cette
affection censée être produite par la nervosité moderne, et considérée comme une seule entité
clinique depuis 1869. Le tableau de maladie était très hétérogène : fatigue, céphalée,
dyspepsie, constipation, paresthésies, appauvrissement de l’activité sexuelle, etc. Ceci a
conduit Freud à penser qu’il s’agissait-là d’une névrose mixte, dont il fallait individualiser les
composantes. Ainsi, le Viennois a isolé quatre espèces morbides à l’intérieur de ce

6
conglomérat : l’hystérie, la névrose obsessionnelle, la névrose d’angoisse et un reste qui peut
être considéré comme la neurasthénie proprement dite. Les deux premières appartenant au
genre des psychonévroses ; les autres, au genre des névroses actuelles.
La référence minéralogique figure donc per analogiam l’impératif nosographique qui
l’amène à identifier clairement les « individus cliniques » : soit de la même façon que le
cristallographe reconnaît les individus minéraux. Individus cliniques puis « entités
morbides », « espèces morbides » ou « types cliniques autonomes ». Malgré la possibilité de
les trouver à l’état pur, ils peuvent s’agréger pour constituer un conglomérat clinique. En tout
cas, de pair avec la reconnaissance de cette capacité de mélange, le geste freudien vise à
individualiser des entités morbides autonomes « dans le chaos de la nosographie encore non
révélée »19.
À la limite, ce biais minéralogique devrait nous conduire à dévoiler la structure qui
articule les conglomérats cliniques. Nonobstant, Freud attire notre attention sur le fait qu’il
n’était pas possible, dans l’état de ses connaissances à l’époque, de prévoir les conditions d’un
tel assemblage. Il aurait fallu un déroulement supérieur à la doctrine freudienne des névroses
(ici mise en parallèle avec la doctrine tschermakienne des roches), afin de parvenir aux
conditions qui déterminent les mélanges des « individus ». Sous la plume du Viennois, nous
trouvons que « dans la doctrine des névroses [Neurosenlehre], nous comprenons encore trop
peu de choses concernant le cours du développement pour créer quelque chose de semblable à
la doctrine des roches [Gesteinlehre] »20. Malheureusement, pour l’instant il faut juste se
concentrer sur l’entreprise d’une « cristallographie clinique » des névroses, même si elle ne
peut que classifier les espèces (Art) morbides d’après leurs genres (Gattung).
Observons que le procédé freudien utilise le genre et l’espèce, deux des catégories
trouvées aussi dans les classifications more botanico. D’où la question: pourquoi ne pas le
considérer comme une version abrégée de cette nosographie ? Un petit détour peut nous
amener à une réponse. Tschermak définit deux types de systèmes classificatoires en
minéralogie : les artificiels et les naturels. Dans un système artificiel, on assume dès le début
un principe arbitraire pour tracer les divisions et arriver des classes aux individus: Linné, par
exemple, « classifiait les plantes selon les proportions numériques des parties de la fleur »21.
Les systèmes naturels, par ailleurs, sont construits exactement à l’envers : les propriétés de
chaque groupe générique sont issues des caractéristiques des individus qui les composent.
Bref, un système artificiel est basé sur la théorie ; un système naturel, sur l’expérience.
Alors, pour cette doctrine minéralogique, la nosotaxie more botanico de Cullen (et
d’autres nosologistes) relèverait des systèmes artificiels de classification ; tandis que le
« système des névroses »22 de Freud serait considéré comme classement naturel. Ainsi, à
contre-courant de la nosographie de l’époque et en privilégiant l’expérience clinique, le
psychanalyste en est venu à faire d’une espèce morbide, l’hystérie, « le prototype de tout le
genre [Gattung] »23 des psychonévroses. Véritable innovation nosotaxique, sauf à ne pas se
tromper sur le vocabulaire classificatoire des genres et espèces, que la langue allemande avait
mis en valeur depuis le XVIIIe siècle24.

7
Le cristal éclaté : de la métaphore à la structure clinique
Laissons de côté les principes minéralogiques suivis par Freud dans le classement des
névroses ; examinons maintenant le rapport entre le normal et le pathologique. La position
freudienne est assez connue : il n’y a pas de frontière tranchée entre les deux. Peut-être,
pouvons-nous en trouver l’illustration la meilleure dans la métaphore qui considère le malade
de l’esprit en tant que sujet brisé comme un cristal.
Souvenons-nous des textes tschermakiens : ils avaient mis en exergue, pour les
cristaux, une certaine capacité à se laisser diviser en suivant les jonctions des morceaux
composants ; bref, la fissibilité. Ainsi, la limite extérieure du cristal se montre comme « une
répétition de l’agencement interne »25, dont les articulations accomplissent la fonction d’un
plan de directions de clivage (Spaltrichtung) du corps minéral. Il faut lire sous cette lumière la
métaphore cristallographique que Freud pose dans sa XXXIe leçon d’introduction à la
psychanalyse. Juste avant de considérer la clinique du délire d’observation, il affirme :
Si nous jetons un cristal [Kristall] par terre, il se brise, mais pas arbitrairement, il se casse alors suivant
ses plans de clivage [Spaltrichtung] en des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était
cependant déterminée à l'avance par la structure [Struktur] du cristal. De telles structures fissurées et
éclatées, c'est aussi ce que sont les malades mentaux.26
La métaphore du cristal s’enchaîne alors à l’exemple d’un certain délire paranoïaque,
où les malades de l’esprit témoignent d’être regardés, même dans leurs actes les plus intimes,
par des personnes inconnues qui rendent compte de ce qu’elles observent. Cette expérience
d’aliénation, comportant des hallucinations verbales, nous donne deux éléments importants de
connaissance : l’un sur la métapsychologie freudienne du moi et l’autre concernant la
condition de tout symptôme, décrit mieux que jamais comme la chose la plus étrangère au
moi.
La prémisse majeure de la pensée métaphorique établit le moi comme un cristal clivé
de facto; ergo, il est fissile. Mais il n’y a pas de hasard dans la façon dont il se brise. Les
malades de l’esprit sont comparables à des cristaux fissurés et éclatés, sauf à trouver la
configuration des morceaux comme prédéterminée par l’agencement interne. Si, comme le
montre la clinique, un sujet peut vivre un vécu fou d’auto-observation, ceci indique qu’il y a
une cassure à l’intérieur du moi qui permet de le faire. Dans ce cas, il s’agit de la division
entre le moi et le surmoi auto-observant qui couramment fait partie de sa structure. Ecart bien
peu perceptible dans les conditions de ce qu’on appelle la normalité, où il se seulement
comme une articulation. La fracture nous montre, dans l’après-coup, l’assemblage intérieur,
toujours présent et dorénavant perceptible.

8
Ainsi le symptôme se fonde-t-il sur une condition structurale précédente : la façon de
se casser dépend des lignes d’articulation qui constituent le plan de clivage. Corrélativement,
seule la formation du symptôme peut rendre effective, en la dévoilant, la structure virtuelle
qui l’a fait possible. Mais cette déclaration, argumentée à partir de la clinique des psychoses,
est-elle valable pour n’importe quel symptôme ? L’appel à la structure depuis les Études sur
l’hystérie, suggère une réponse affirmative. Les tentatives proto-analytiques de Freud y
dérivent clairement de la chimie cristallographique, sauf à les envisager selon l’indication de
Tschermak : « la structure est causée par la cristallisation [Kristallisation] »27.
La pathogénie freudienne a posé la nécessité de trouver, à l’intérieur de la « vie de
représentations » des hystériques, des éléments capables d’opérer la structuration de la
souffrance psychique. Ainsi, la théorie de la formation du symptôme affirme : une
représentation refoulée peut établir « un noyau et point central de cristallisation »28 qui sert à
la constitution d’un groupe psychique scindé de la conscience ; à partir de là, ce deuxième
groupe jouera le rôle de « cristal provocateur d’où part […] une cristallisation [Kristallisation]
qui autrement n’aurait pas eu lieu »29. Puis, une sorte de réaction en chaîne, dont les contenus
les plus complexes se développent à partir des plus simples.
L’ensemble de ces indications constitue une source de filiation symbolique à
reconnaître dans plusieurs traditions « structurales » de la psychopathologie psychanalytique.
Nous allons en évoquer deux. Lacan, par exemple, reprend la théorie freudienne sur la
formation du symptôme en terme de « cristal signifiant » ; le paradigme se trouve dans
l’histoire de malade du petit Hans, où « le signifiant du cheval inclus dans la phobie, se
présente comme ayant pour fonction celle d'un cristal dans une solution sursaturée »30 − il
provoque donc la cristallisation des signifiants. Lacan établira aussi l’exclusion mutuelle entre
les « structures freudiennes » de la névrose, la psychose et la perversion, au niveau de leurs
opérateurs : le fantasme, le phallus, le Nom-du-père, la jouissance. De plus, il forgera la
notion de « suppléance », pour rendre compte des prépsychoses ou psychoses non
déclenchées.
Bergeret, par ailleurs, avance que les névroses et les psychoses sont les deux « grandes
structures de base » de la personnalité : « le psychisme de l'individu s'organise, se ‘cristallise’
selon un mode d'assemblage de ses éléments propres, selon une variété d'organisation interne
avec des lignes de clivage et de cohésion qui ne pourront plus varier par la suite »31. La
normalité, version stable de la structure, peut décompenser en produisant des symptômes
pathologiques lorsqu’il y a un événement capable d’opérer le clivage. La névrose clinique est
issue d’une structure névrotique « décompensée » ; la psychose clinique, d’une structure
psychotique également « décompensée » ; aucune possibilité de trouver une psychose clinique
produite à partir d’une structure névrotique, ni l’envers.
Quoique ces traditions de psychopathologie structurale analytique soient très
différentes, elles coïncident sur deux points fondamentaux : 1) la structure (au singulier) lie
normalité et pathologie en utilisant des catégories qui renvoient à la stabilisation /
déstabilisation ; 2) les structures (au pluriel) restent irréductibles les unes les autres. Positions

9
longtemps soutenues au sein de la théorie des structures cliniques. Ce dernier terme
n’appartient pas au vocabulaire de Freud non plus qu’à Lacan ou Bergeret, mais il s’est
imposé pour désigner la triade névrose-psychose-perversion. Sous cette notion, on trouve
« une conception psychopathologique très originale – tant dans son versant nosologique que
nosographique –, qui définit les troubles psychiques comme des organisations stables,
précocement cristallisées grâce à l’emploi, de la part du sujet, de divers mécanismes
psychiques inconscients destinés à affronter la castration »32. Ceci devra faire l’objet d’un
développement ultérieur.
Un avenir cristallin ?
En résumé, nous avons constaté l’influence bienfaisante de Gustav Tschermak sur
deux thèses freudiennes : le classement des maladies nerveuses, et la conception structurale
qui lie la normalité et la pathologie. Dès lors, comment ne pas donner au célèbre
minéralogiste la place qui lui revient en tant que transmetteur d’un savoir disciplinaire dont
Freud s’est servi dans des moments cruciaux de sa pensée psychopathologique ?
Lorsqu’il s’agit de saisir scientifiquement le réel de notre clinique (même le réel qui
excède toute action psychothérapeutique, comme les névroses actuelles), le repérage freudien
concerne inexorablement l’objet minéralogique qui a été individualisé et lié à ses congénères.
Néanmoins, comment parvenir à une doctrine de la structure qui puisse rendre compte de
l’assemblage des espèces morbides dans les mélanges cliniques ? Cela constituait le grand
défi pour cette entreprise freudienne que nous pourrions appeler « psychopathologie more
mineralogico ». Il reste toujours l’une des gageures à relever quand nous essayons une théorie
des structures cliniques en refusant la catégorie borderline.
Freud a également abordé la relation intime entre normalité et pathologie en rappelant
les vicissitudes de la structure minéralogique. Bien entendu, la métaphore éclaire le moment
pathogénique d’où relève la formation du symptôme ; par contre, on ne peut que questionner
ensuite la nature et la possibilité de l’intervention visant à une restructuration du « cristal
psychique ». Compensation (Bergeret) ou suppléance (Lacan), il faut en revisiter les
fondements. Tâche assignée toujours à la théorie des structures cliniques.
En somme, la perspective minéralogiste de Freud aura un long avenir, à condition de
s’en servir pour réinterroger les enjeux qui se cachent derrière la notion de structure clinique.
Il s’agit d’une sorte de géode théorique, dont la beauté peut être très captivante : à nous d’en
extraire le cristal brillant.

10
Bibliographie
Álvarez, J. M., Esteban, R. & Sauvagnat, F. (2004). Fundamentos de psicopatología
psicoanalítica. Madrid: Síntesis.
Assoun, P.-L. (2005). Métaphore et métapsychologie: La raison métaphorique chez Freud.
Figures de la psychanalyse, 11(1), 19-31.
Assoun, P.-L. (2007). Psychanalyse. Paris : Presses Universitaires de France.
Bergeret, J. (1996). La personnalité normale et pathologique. Les structures mentales, le
caractère, les symptômes. Paris : Dunod.
Bernfeld, S. (1951). Sigmund Freud, M.D., 1882-1885. International Journal of Psycho-
Analysis, 32, 204-216.
Dana, E. (1927). Hofrat Professor Dr. Gustav Tschermak, 1836-1927, American Mineralogist,
12(7), 293.
Freud, S. (1987). Bericht über meine mit Universitäts-Jubiläums-Reisestipendium
unternommene Studienreise nach Paris und Berlin (1956). Gesammelte Werke,
Nachtragsband. Frankfurt am Mein: Fischer.
Freud, S. (1991). Court abrégé de psychanalyse (1924). Œuvres Complètes, XVI. Paris : PUF.
Freud, S. (1998). Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans (1909). Œuvres Complètes,
IX. Paris : PUF.
Freud, S. (2000). Leçons d’introduction à la psychanalyse (1917). Œuvres Complètes, XIV.
Paris : PUF.
Freud, S. (2004). Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse (1933). Œuvres
Complètes, XIX. Paris : PUF.
Freud, S. (2006). Lettres à Wilhelm Fliess : 1887-1904. Paris : PUF.
Freud, S. (2009). Etudes sur l’hystérie (1895). Œuvres Complètes, II. Paris : PUF.
Fritscher, B. (2004). Mineralogie und Kulturim Wien der Donaumonarchie – Zu Leben und
Werk Gustav Tschermaks. Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 164(1), 67-75.
Hemecker, W. (1991). Vor Freud: philosophiegeschichtliche Voraussetzungen der
Psychoanalyse. München: Philosophia.
Lacan, J. (1994). Le séminaire, IV: La relation d’objet (1956-1957). Paris : Seuil.
Lacoste, P. (1987). La sorcière et le transfert. Sur la métapsychologie des névroses. Paris :
Ramsay.
Lopez, J.-M. (1985). Orígenes históricos del concepto de neurosis. Madrid: Alianza.
Rivera, J.-L., Murillo, J.-A. & Sierra, M.-A. (2007). El concepto de neurosis de William Cullen como
revolución científica. Enseñanza e Investigación en Psicología, 12(1), 157-178.
Sydenham, Th. (1848). Works, I. London: The Sydenham Society.
Tschermak, G. (1863). Grundriss der Mineralogie für Schulen. Wien : Wilhelm Braumüller.
Tschermak, G. (1894). Lehrbuch der Mineralogie. Wien: Alfred Hölder.
1 Tout s’est déclenché au moyen âge lorsque la mine d’argent de Schwaz a été mise en fonctionnement –de nos
jours, les guides touristiques l’appelant la mère de toutes les mines. Pendant plusieurs siècles, le minerai
procédant de cet endroit et d’autres mines de l’Autriche occidentale est arrivé à Vienne sur des bateaux qui ont
surmonté le Danube.

11
2 Assoun, P.-L. (2005). Métaphore et métapsychologie. Figures de la psychanalyse, p. 19. 3 Cf. Assoun, P.-L. (2007). Psychanalyse. 4 Lacoste, P. (1987). La sorcière et le transfert, p. 45. 5 Dana, E. (1927). Hofrat Professor Dr. Gustav Tschermak, American Mineralogist, p. 293. 6 Pour les données biographiques, on peut consulter : Fritscher, B. (2004). Mineralogie und Kulturim Wien der
Donaumonarchie, Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt. 7 Cf. Bernfeld, S. (1951). Sigmund Freud, M.D. International Journal of Psycho-Analysis; Hemecker, W.
(1991). Vor Freud. 8 Cf. Freud, S. (2006). Lettres à Wilhelm Fliess. 9 Lorsqu’il s’agisse des substantifs allemands, on donnera la forme du nominatif singulier. À noter aussi :
certains mots ont connu des variations orthographiques dans le passage du XIXe au XXe siècle (Structur /
Struktur, par exemple). 10 Tschermak, G. (1863). Grundriss der Mineralogie für Schulen, p. 60. 11 Tschermak, G. (1894). Lehrbuch der Mineralogie, p. 6-7. On cite d’après la quatrième édition. 12 Tschermak, G. (1894). Lehrbuch der Mineralogie, p. 5. 13 Cf. Rivera, J.-L., Murillo, J.-A. & Sierra, M.-A. (2007). El concepto de neurosis de William Cullen como
revolución científica. Enseñanza e Investigación en Psicología. 14 Sydenham, Th. (1848). Works, I, p. 13. 15 Cf. Lopez, J.-M. (1985). Orígenes históricos del concepto de neurosis. 16 Freud, S. (1917). Leçons d’introduction à la psychanalyse, p. 392. 17 Freud, S. (1917). Leçons d’introduction à la psychanalyse, p. 403. 18 Freud, S. (1917). Leçons d’introduction à la psychanalyse, p. 404. 19 Freud, S. (1956) Bericht über meine mit Universitäts-Jubiläums-Reisestipendium unternommene Studienreise
nach Paris und Berlin, p. 38. 20 Freud, S. (1917). Leçons d’introduction à la psychanalyse, p. 404. 21 Tschermak, G. (1894). Lehrbuch der Mineralogie, p. 316. 22 Freud, S. (1909). Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans, p. 102. 23 Freud, S. (1924). Court abrégé de psychanalyse, p. 334. Malheureusement, cette traduction française donne
« espèce » là où l’original allemand dit « Gattung » (genre). 24 Issu des travaux de logique de Christian Wolff. 25 Tschermak, G. (1894). Lehrbuch der Mineralogie, p. 12. 26 Freud, S. (1933). Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, p. 142. 27 Tschermak, G. (1863). Grundriss der Mineralogie, p. 60. On remarque également que Freud avait suivi, le
semestre avant l’enseignement tschermakien, le cours du Pr Franz Cölestin Schneider : soit 5 heures
hebdomadaires de chimie minéral. 28 Freud, S. (1895). Etudes sur l‘hystérie, p. 142. 29 Freud, S. (1895). Etudes sur l‘hystérie, p. 289. 30 Lacan, J. (1956-1957). Le Séminaire, IV, p. 254. 31 Bergeret, J. (1996). La personnalité normale et pathologique, p. 54. 32 Álvarez, J.-M., Esteban, R. & Sauvagnat, F. (2004). Fundamentos de psicopatología psicoanalítica, p. 699.