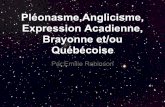La Colonie Acadienne du Poitou. Les rapports entre Acadiens et Poitevins de 1773 à 1792
-
Upload
pierre-masse -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of La Colonie Acadienne du Poitou. Les rapports entre Acadiens et Poitevins de 1773 à 1792
-
Editions La Decouverte
La Colonie Acadienne du Poitou. Les rapports entre Acadiens et Poitevins de 1773 1792Author(s): Pierre MassSource: L'Actualit de l'histoire, No. 9 (Oct., 1954), pp. 4-14Published by: Editions La Decouverte on behalf of Association Le Mouvement SocialStable URL: http://www.jstor.org/stable/3776871 .Accessed: 17/06/2014 03:54
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Association Le Mouvement Social and Editions La Decouverte are collaborating with JSTOR to digitize,preserve and extend access to L'Actualit de l'histoire.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=eladhttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=amsocialhttp://www.jstor.org/stable/3776871?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Communication de M. Pierre MASSE a I'Asserrsblee d'Etude de I'lnstitut francais d'Histoire scciaie
12 juin'l954
La Colonie Acadienne
du Poitou
Les rapports entre Acadiens et Poitevins
de 1773 a 1792
La question que l'on va tenter de poser, d'abord, d'essayer de resoudre, ensuite, est essentiellement une question sociale. En 1773, un groupe humain tres caracterise, tres differencie, est brusquement place face a un autre groupe aux caracteres diame- tralement opposes. Quels seront les rapports de ces deux groupes de 1773 a 1792, c'est-a-dire pendant les vingt premieres annees de voisinage ? Tel est le probleme. Mais voyons d'abord en quoi consistaient chacune de ces deux societes humaines.
La premiere a fait l'objet d'une volumineuse bibliographie. II s'agit des Canadiens, plus exactement des Acadiens, que les Anglais vainqueurs expulserent des territoires coloniaux qu'ils nous avaient conquis au xvnr siecle. Lauvriere, entre autres, a retrace, dans cet ouvrage qui s'appelle La Tragedie d'un peuple, la destinee des populations frangaises d'Acadie (1). C'est deja le douloureux spectacle des ? personnes deplacees ? dont nous n'avons eu, depuis lors, que trop d'exemples.
Une partie de ces colons refoules par les Anglais, a pleins bateaux, sur les cotes de France, fut installee, en 1773, dans une partie du Poitou qui forme actuellement Yest de l'arrondissement de Chatellerault, dans le departement de la Vienne. Un grand seigneur, disciple des physiocrates, vivait la. II s'appelait Perusse d'Escars. Possesseur de vastes etendues de brandes desertiques, par ailleurs bien en Cour et ayant l'audience du Controleur des Finances Bertin, et plus tard celle de Turgot, il obtint que l'Etat prit a sa charge l'installation de 1.472 Acadiens dans la region. On batit 57 habitations au milieu des brandes dont les colons auraient a faire le defrichement.
(1) Emile Lauvriere, La tragedie dun peuple, Paris, 1923, 2 vol. M. Lauvriere a publie son autobiographie dans les Cahiers acadiens, n? 1, Universite Saint-Joseph, Canada, 1952, avec une introduction et biblio? graphie par Rene Baudry.
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Malheureusement, les projets de Perusse d'Escars aboutirent a un echec retentissant. Arrives a l'automne de 1773, les Acadiens se decouragerent bientot au milieu de ces terres ingrates. Ils ne devaient y rester que deux ans. A l'automne de 1775, le plus gros des colons abandonna le territoire qui lui avait ete concede et s'embarqua pour Nantes. De la, quelques annees plus tard, il emigra en Louisiane.
Deux periodes sont donc a examiner. Celle qui va de l'arrivee des colons en Poitou a leur exode pour Nantes, et s'etend seule? ment sur deux annees. Celle qui commence, ensuite, apres le depart des mecontents, et ne concerne plus que le petit lot de fideies demeure dans le pays.
Nous avons utilise les sources suivantes :
D'abord ces documents modestes, sinon humbles, parfois de- daignes, que sont les registres paroissiaux (2). Les Acadiens, en effet, furent etablis sur des territoires relevant de plusieurs pa- roisses qui s'appellent Archigny, Monthoiron, Cenan, La Puye, Saint-Pierre-de-Mailie, Bonneuil-Matours. Depouiller systemati- quement les registres de ces communes, entre 1773 et 1792, fut notre premier souci. Nous avons compiete ces recherches par les documents des Archives departementales de la Vienne, series C, L et M. Puis ceux des Archives Nationales : H, D III. Ajoutons que la these de M. Ernest Martin : Les exiles acadiens en France et leur etablissement en Poitou (3) nous a offert une excellente et solide base de depart.
Quelle etait la situation materielle des colons acadiens au moment ou commence cette histoire ? Disons tout de suite qu'une etude d'ensemble sur ce sujet serait bien desirable. Elle nous manque encore. Ce que nous savons, c'est que la France vint au secours des Acadiens des que les premiers debarquements eurent commence. Choiseul avait alloue une solde de six sols par jour a chaque membre de famille acadienne, y compris les nouveaux- nes. Les secours, quelque temps interrompus a la fin de l'Ancien Regime, reprirent en 1791, et furent renouveies, a plusieurs repri- ses, sous la Revolution. M. Ernest Martin constate leur versement en 1822 et 1823. On peut aller bien plus loin. Les Archives depar? tementales de la Charente-Maritime contiennent des dossiers de secours aux Canadiens jusqu'en 1880 (4).
Que representaient les six sols journaliers de secours en 1773 ? Environ le prix moyen d'une journee de travail dans la
(2) Cf. le recent et tres riche article de Pierre Goubert, Une richesse historique en cours d'exploitation. Les registres paroissiaux (Annales - Economies - Societes - Civilisations). Paris, 1954, p. 83-93.
(3) Paris, 1936 (4) Nous devons des remerciements a l'Archiviste en chef de la
Charente-Maritime, M. Delafosse, qui nous a tres obligeamment facilite l'acces a ces documents.
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
region (5). La subsistance quotidienne etait ainsi assuree. Ce
qui ne veut pas dire que la condition des exiies etait brillante. En 1772, le commissaire de la marine a Saint-Malo, ou etaient
instalies des Acadiens, se montrait assez pessimiste quant a l'ave- nir. ? Toutes ces familles, ecrit-il, ont beaucoup de peine a vivre ?. La situation morale s'en ressentait fortement. > Ils commencent a prendre corps, ce qui est un mai ?, dit encore le commissaire (6). On constate la, sur le vif, la prise de conscience d'un groupe. De meme origine, victimes du meme ensemble de faits qu'ils appelleront plus tard ? Le Grand Derangement ?, ayant souffert les memes maux, un meme ciment les a soudes. Telle est la colonie qui debarque en 1773 dans les brandes du Haut- Poitou.
Face a ces Frangais d'outre-mer, que sont les Frangais de ce coin de pays ?
Perusse d'Escars n'est pas tendre pour eux. II ne manque pas une occasion de souligner leur paresse, leur routine (7). Jugement distant et dedaigneux d'un grand seigneur ? II est tout a fait confirme par Creuze-Latouche, le futur depute a la Constituante dans son opuscule intituie Description topographique du District de Chdtellerault. L'auteur ne designe pas nommement les paroisses qui nous concernent, mais on les reconnait sans difficulte, puisque ce sont celles, dit-il, situees ? dans toute la partie orientale du District ?. Autrement dit dans la zone ou allaient s'etablir les Acadiens.
? Les malheureux qui frequentent cette contree n'annoncent que l'indolence, la misere, et la nature humaine dans sa degrada- tion. Ils se nourrissent uniquement du pain le plus grossier fait avec de l'avoine et de l'orge et qu'ils ne mettent meme pas en soupe. La terre exigerait d'eux d'enormes avances et de longs travaux qu'ils sont hors d'etat d'entreprendre. Ils sont forc6s de la laisser inculte, et ils passent ainsi leur vie dans l'indigence, les souffrances et l'inaction ? (8).
La Revolution n'a guere ameiiore ces paysans qui, six ans plus tard, apparaissent dans le meme etat. Trouver un maire et un adjoint dans ces pays desherites sera, pour le Prefet de l'Empire, un probleme peu facile a resoudre (9). En 1833, le Sous-Prefet dira encore de la commune d'Archigny, qu'elle est ? la plus forte et une des plus arrierees de r arrondissement ? (10). On serait tente d'y voir un determinisme geographique si des faits ulterieurs ne venaient Tinfirmer.
(5) P. Rambaud, La juridiction consulaire de Poitiers. {Bulletin dc la Societe des Antiquaires de VOuest, Poitiers, 1925, p. 227 ; Archives de la Vienne, J 64.
(6) Archives nationales, H 1499 (2). (7) ibid. (S) Op. cit., p. 22. (9) Archives nationales, F lb III Vienne 3. (10) Archives de la Vienne, Mle 1.
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Ainsi se presentent les deux groupes humains en presence. D'une part, des paysans indolents, isoies et perdus dans leurs brandes. Un de leurs hameaux s'appelle d'ailleurs, d'un nom expressif, ? le bout du monde ?. Leur niveau de vie, au xvnr siecle, tel que les minutes notariales permettent de le constater, est des plus mediocres. D'autre part, survenus brusquement, des colons d'esprit ouvert, ayant beaucoup vu et sans doute beau? coup retenu. Des hommes que n'effraient point les aventures et qui l'ont souvent montre.
Est-il deux groupes plus dissemblables ? Certes, ils parlent la meme langue et pratiquent la meme religion, qui est la catho? lique. Mais leur conception de la vie et du monde est profon? dement differente. Nous allons tenter de preciser ce que nous savons de leur rapports.
II
Quelques indices nous permettent de penser qu'ils furent assez tendus dans les premiers mois qui suivirent l'installation de la colonie. Les projets de mise en culture des brandes heur- taient des interets collectifs, entre autre la possibilite, pour les populations riveraines, de se procurer a bon compte des pacages et de la litiere. Eternelle histoire, toujours repetee, de la resis- tance aux defrichements. Des incidents traduisent l'hostilite des paysans poitevins. On lance des pierres sur les maisons aca- diennes pour en briser les tuiles ; on essaie de combler les puits en y faisant tomber des pieces de bois. Certains laboureurs que l'on a charges de charroyer des materiaux se refusent a cette corvee, s'attroupent et la marechaussee doit intervenir (11). Inte? rets leses, jalousie de voir s'eiever des habitations neuves accor- dees gratuitement a des etrangers au pays : tout un complexe de sentiments va jouer entre les deux societes.
Voila qui nous permet de mesurer la profondeur du fosse qui separa Poitevins et Acadiens en 1773. Essayons de voir com- ment ce fosse a fini par se combler. Mieux encore, de suivre la cadence de ce comblement. Nous la constatons dans ces docu? ments probants, aisement accessibles, que sont les actes d'etat civil des communes ou vecurent les Acadiens, autrement dit les registres paroissiaux dont nous avons parie en commencant.
Nous allons y trouver, en effet, le temoignage irrefutable du rapprochement des deux communautes dans ce fait social essentiel qu'est le mariage. A quelle date la premiere union con- jugale s'est-elle produite ? Y eut-il des poussees de mariages, et quand ? Sont-elles concomitantes a d'autres faits sociaux ? Et dans ces premieres unions, a quelle communaute appartien- nent l'homme et la femme ? Le tableau ci-joint, qui va du 30 juin 1774 au 9 fevrier 1790 nous donne la reponse.
(11) Ernest Martin, op. cit., p. 214-215.
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
MARIAGES ENTRE POITEVINS ET ACADIENNES
DE 1773 A 1792
Dates
(1)
5 fev. 1776 . .
27 aout 1776
iO sept. 1776
16 sept. 1776
29 oct. 1776 ..
17 nov. 1776
15 avril 1777
29 sept. 1778
29 oct. 1780
25 nov. 1780
27 nov. 1780
22 janv. 1781
27 nov. 1781
3 fev. 1789
1 fev. 1790
9 fev. 1790
Gargons poitevins
(2)
Martial Arnault.
Frangois Martin
Charles Touzalin
Jean Mondion
Pierre Faulcon
Rene Baudeau
Annet Samie
Louis Jos. Jaunon
Gabriel Guerin
Rene Arnault
Jean Sauvion
Jacques Arnault
Alexis Texier
Gervais Thomas
Fulgent Bideau
Frang. Charaudeau
Filles acadiennes
(4)
Josephe Guillot
Anne Hebert
Marguerite Girouard
Suzanne Albert
Marguerite Guillot
M.-Therese Daigle
Marie Doucet
Victoire Doucet
Marie Guillot
Perrine Albert
Gertrude Guillot
Adelaide Doucet
Renee Berbudeau
Josephe Boudrot
Genevieve Guillot
Marie Hebert
Situation de famille
(5)
orph. pere et mere
id.
veuve
parents vivants
orph. de mere
parents vivants
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
orph. pere et mere
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Ce tableau nous permet de faire, au premier contact, des constatations qui ouvrent deja des perspectives.
La premiere est que, pendant le sejour des 1.472 Acadiens en Poitou, c'est-a-dire pendant deux ans, il n'y eut aucun mariage.
La deuxieme est qu'une poussee de mariages se produit en 1776, lorsque le plus gros des Acadiens a quitte le pays. Com? ment expliquer cette subite flambee d'unions conjugales ? Faut-il penser que les Acadiens demeures en Poitou n'attendaient que le depart de leurs compatriotes pour s'unir aux familles du pays ?
Les raisons apparaissent beaucoup plus simples lorsque l'on connait le sort reserve aux 157 Acadiens restes en Poitou. Pour ce petit noyau de fideies, on disposait de 57 habitations toutes neuves. II n'y avait pas a craindre, en cet heureux temps, la crise du logement. LTntendant Blossac obtint du roi que les maisons disponibles soient attribuees aux Acadiens ou Acadiennes qui s'uniraient a des familles poitevines. Ajoutons que la solde de six sous par jour, dont nous connaissons la valeur, etait main- tenue. Brusquement, la situation est renversee. Voila que ces colons denues de tout en 1773, tenus a l'ecart depuis deux ans, auxquels pas une famille poitevine ne s'etait unie, se trouvent bien dotes. Leur pension de six sous par jour se double d'une habitation toute neuve, avec sa grange, son etable, son cellier, son puits, sa mare, son four. Un jeune Acadien ou une jeune Acadienne est devenu un beau parti. Si bien que l'on pourrait intituler le present paragraphe : de 1'influence des Allocations familiales sur reclosion des sentiments.
Six mariages eurent ainsi lieu en 1776 (12). Apres cette montee de flamme conjugale, les mariages s'echelonnerent plus lentement, de 1777 a 1792. Mais un examen plus detaille va nous permettre de mieux comprendre encore les rapports sociaux entre deux groupes si differents. L'origine du gargon et celle de la fille sont ici particulierement reveiateurs.
II est a remarquer que le gargon est toujours un Poitevin, et la fille une Acadienne. Mais il y a plus significatif encore. La colonne (3) nous donne la situation de famille de l'homme et la colonne (5) celle de la femme. Nous constatons ainsi que le jeune marie, jusqu'en 1780, est toujours un orphelin.
Qu'est-ce a dire ? Qu'il est, dans une certaine mesure, un homme libre. Qu'il ne depend plus de l'autorite paternelle, dont on connait la force a l'epoque. Martial Arnault, Charles Touzalin, Pierre Faulcon, dont vous voyez les noms dans la colonne (2),' n'ont plus de parents du tout. Jean-Baptiste Mondion est d'une famille de Saint-Domingue venue en Poitou avant l'arrivee des
(12) Ernest Martin en trouve 11 (op. ciU p. 239). Si ce chiffre est exact, il confirme et renforce notre point de vue.
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Acadiens. On les reconnait, dans les registres paroissiaux, a ce qu'ils portent retiquette : Americains. Annet Samie est un Limou- sin, venu & la suite de Perusse d'Escars et qui retournera bientot chez lui (13). En langage d'ethnologue, nous dirions que le male appartient a la tribu des autochtones, et qu'il vient choisir sa femelle dans la tribu voisine. Nous pourrions ajouter, sans trop forcer les mots, que la mort ou l'eioignement de son pere l'a libere des contraintes collectives de son clan.
Parler ici d'exogamie, c'est peut-etre aller un peu loin. Et cependant. Ouvrons la these toute recente, puisque parue il y a quelques mois, de M. Juillard. Comment ne pas etre frappe par des similitudes, sans doute exterieures, mais combien eioquentes ? Villages de l'Alsace au xvnr siecle : c'est bien le mot d'exogamie qu'ecrit en toutes lettres M. Juillard. ? Tout individu venu du dehors, dit-il, n'etait pas admis d'embiee dans la communaute des bourgeois ? (14). Bien que parlant la meme langue et pra- tiquant la meme religion, les Acadiens restent aux yeux des Poitevins qui les entourent, des ? individus venus du dehors ?. Et seuls des garcons independants, sans tutelle familiale, peuvent se permettre, dans les mariages de 1776, d'aller prendre femme en cette communaute differente de la leur. Et d'aller y vivre. Car ils vont abandonner le groupe ou ils ont vecu. C'est dans la maison vacante, la maison acadienne, que sera fonde le nou- veau foyer.
Des conclusions paralieies ressortent d'une enquete menee de nos jours sous le patronage de l'U.N.E.S.C.O. dans un village- temoin de l'Eure, Nesle-Normandeuse. C'est un vieux village compose d'un hameau rural et d'un hameau forestier. Les regis? tres paroissiaux de Nesles comprennent, depuis 1669, 860 mariages. Avec cette particularite que, pendant trois siecles, le hameau rural n'a jamais epouse le hameau forestier. Les deux societes ne communiquent pas. Cependant, depuis une date recente, 1921, les mariages exogames se multiplient. Le taux de l'endogamie, qui etait de 42 % aux xvn" et xvnr siecles, est descendu aujour? d'hui a 47 % (15).
A l'autre bout de la France, on a etudie dernierement des questions toutes semblables (16) dans un village du departement de l'Ain ou les mariages, depuis egalement trois siecles, obeissent
(13) Pierre Masse, Destinees acadiennes. La courte vie de Marie Doucet. (Memoires de la Societe genealogique canadienne frangaise), Montreal, 1953, p. 166-170).
(14) E. Juillard, La vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace. Essai de geographie sociale. Strasbourg, 1953, p. 59.
(15) Paul Leuillot, dans Villes et Campagnes, publie par G. Fried- mann, Paris, s. d., p. 352-354.
(16) Georges Chabot, Les migrations interieures de populations pro- voquees par les mariages. Vexemple de Villette (Ain) depuis trois siecles. (Meianges Arbos. Paris, 1953, t. II, p. 215-227).
10
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
a des lois illustrees par le proverbe bourguignon : ? Choisis la vigne dans la cote, ta femme dans la plaine. ? Prenons, enfin, un dernier exemple avec les Canadiens emigres au xixe siecle dans les Etats americains du Massachussets et de Rhode-Island. Des phases sociales du meme ordre y apparaissent (17). Voila qui evite de porter un jugement trop defavorable sur I'attitude des paysans poitevins vis-a-vis de leurs voisins acadiens.
A quel signe connaitrons-nous que les rapports des deux groupes se modifient, et a quelle date situer cette evolution ? C'est lorsque le male acadien, a son tour, peut venir choisir une femelle dans la tribu poitevine. A la fin de l'annee 1776, l'Acadien Jean Poujet epouse Marie Velluet, qui a ses parents vivants. Que Poujet soit un orphelin, on conviendra que le detail est a relever. En examinant le tableau des mariages acadiens- poitevins, on constatera qu'il est beaucoup moins fourni que le tableau poitevin-acadien, et que les dates des unions sont beaucoup plus eioignees les unes des autres.
Est-il possible de savoir ce que sont devenues ces premieres unions ? L'individu mute de groupe social fut-il totalement assi- miie par le nouveau groupe ? II se trouve que nous avons la
reponse a cette question pour quelques cas.
MARIAGES ENTRE ACADIENS ET POITEVINS DE 1773 A 1792
(17) Ulysse Forget, Les Franco-Americains et le ? melting-pot ?. Fall-Rivers (Massachussets) 1949. Voir compte rendu d'A. Dauzat (Revue internationale d'Onomastique, 1950, p. 233).
11
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
Ainsi qu'on pouvait le prevoir, des tiraillements se produi- sent au moment ou de graves decisions doivent etre prises. Le couple acadien-poitevin oscille alors d'un cote ou de l'autre et retrouve difficilement son equilibre. Rene Baudeau, jeune homme de Cenant, a epouse, le 19 novembre 1776, l'Acadienne Marie- Therese Daigle, et ils ont une habitation toute neuve, qui porte le n? 29. Mais les parents de la jeune femme, Frangois Daigle et Jeanne Hoby, ne peuvent s'accoutumer aux horizons de bran? des, et, n'y tenant plus, decident d'aller retrouver leurs com- patriotes a Nantes. Ils s'en vont donc. Marie-Therese Daigle suit ses parents, et Rene Baudeau suit sa femme. Le vieux menage entraine le jeune. L'habitation n? 29 est abandonnee, et Perusse d'Escars la fait confisquer.
Mais a Nantes, c'est Rene Baudeau qui souffre maintenant du mai du pays. II reussit a convaincre sa jeune femme, si bien qu'un beau jour il revient au village natal avec l'Acadienne, decidement reconquise par la communaute poitevine. Baudeau va trouver Perusse d'Escars et bat sa coulpe pour se faire par- donner requipee. Ce retour des enfants prodigues attendrit le seigneur de Monthoiron, qui restitue la maison confisquee. Les enfants du couple appartiendront au groupe paternel.
Une categorie. qui semble la plus nombreuse, est celle ou le couple conjugal se tient a mi-chemin entre la communaute poi? tevine et la communaute acadienne, et participe de l'une et de l'autre. C'est ce que devinrent Pierre Alexis Texier La Touche, Poitevin, et Marie-Reine Berbudeau, Acadienne, apres leur ma? riage qui eut lieu le 27 novembre 1781.
Le pere de la jeune Berbudeau est le personnage le plus important de la colonie. Ne a Saint-Georges, en l'ile d'Oieron, il passa jeune au Canada ou il etait, lors du Grand Derangement, ? chirurgien major de la marine et subdeiegue de l'lsle Saint- Jean et autre isles adjacentes de ITsle royale ? (18). Les aven- tures ne le tentent plus, et il est demeure sagement dans ses brandes lors de l'exode des mecontents pour Nantes. Deux mai- sons acadiennes furent attachees a sa famille, les n,,s 17 et 18. II est le seul bourgeois de la colonie, et c'est a un jeune bourgeois de la region qu'il marie sa fille. Texier-Latouche, le gendre, a fait ses etudes a l'Ecole de Droit de Poitiers d'ou il est sorti licencie es lois. Des deux habitations acadiennes, une est attri- buee au jeune menage, qui vivra desormais dans l'orbe acadienne. Texier-Latouche est tellement assimiie par la colonie qu'il en deviendra bientot le chef de file. Ce Poitevin, en effet, sera le syndic des Acadiens, et, a ce titre, soutiendra les interets de la communaute acadienne. II se chargera, entre autre, de l'arpentage des terrains concedes, qui se fera sous sa direction.
Le jour viendra, cependant, ou, apres vingt ans passes dans
(18) Registres paroissiaux d'Archigny (Vienne).
12
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
les brandes, il retournera a son village natal : Bonneuil-Matours, a deux lieues de la. L'attraction poitevine le reprendra. Marie- Reine Berbudeau et ses enfants s'incorporeront alors dans la communaute d'ou le pere etait issu et qu'il n'avait quitte que pour y revenir (19).
Pouvons-nous fixer une date, planter un jalon qui marque la fin de l'antagonisme entre les deux groupes sociaux, si long- temps mefiants l'un vis-a-vis de l'autre ? Certes. Le mariage du 27 novembre 1780, soit quatre ans apres l'arrivee des pre- miers colons, indique que, des deux cotes, les prejuges commen- cent a s'estomper.
Ce jour-la se produit quelque chose d'assez rare dans retat civil de tous les temps et de tous les pays, ce que l'on peut appeler un mariage coupie. Jean Sauvion et Marie Sauvion, frere et soeur d'une famille poitevine, efcousent respectivement Anne Guillot et Paul Guillot, soeur et frere d'une famille aca- dienne. Sur le registre paroissial, le cure fait coup double. Peut-on dire, d'une expression moderne, qu'il s'agit d'un mariage dirige ? Nos connaissances ne vont pas jusque-la. Tout ce que nous savons, c'est que, par la suite, les enfants furent nombreux,
II n'entre pas dans notre dessein d'etudier les mariages d'Acadiens entre eux. Disons seulement qu'ils furent frequents. Le premier en date est du 30 juin 1774, jour ou le cure d'Archigny unit Christophe Delaure et Marie Boudrot, ? tous les deux jadis habitant l'Acadie et actuellement nouvellement etablis dans cette paroisse, lesquels nous avons marie avec dispense de domiciles suffisants de Mgr l'Eveque de Poitiers ? (20). Lorsque les colons commencerent a s'agiter l'annee suivante et parlerent d'aban- donner leurs concessions, ils se rangerent derriere un meneur nomme Henry que l'on retrouve instalie a Nantes en l'an VI, et devenu la-bas le syndic des Acadiens (21). Le disciple d'Henry en Poitou etait Delaure, et l'on comprend que Perusse d'Escars, en 1775, ait expressement demande le depart des deux chefs de file (22).
Les mariages entre Acadiens permettent parfois de fixer au passage quelques noms assez enigmatiques qui traverserent la vie de la colonie sans y laisser d'autre trace. Le 26 janvier 1779, Jean-Pierre Hebert, fils de feu Pierre Hebert, Acadien, et d'Anne Benoit, epouse, dans reglise de Cenant, Marguerite Molaison, fille de feu Pierre Molaison et de Marie-Josephe Doucet, Acadiens. La mariee est assistee de sa mere, de ses cousins germains qui
(19) Pierre Masse, Le syndic de la colonie acadienne en Poitou. {Revue d'Histoire de VAmerique frangaise. Montreal, 1951 p 45-48 * 252- 264 ; 373-400).
(20) Registres paroissiaux d'Archigny. (21) Archives nationales, F15 - 3492. (22) Archives departementales de la Vienne, J-64.
13
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
-
s'appellent Nicolas Albert et Frangois Harbourg, de ses oncles Joseph Doucet et Jacques Bunel. Elle meurt dans les derniers jours d'octobre (23). Qu'etait cet Harbourg porteur d'un nom de consonnance britannique ? L'etat civil acadien foisonne de ces menus problemes dont on n'entrevoit pas toujours la solution.
II arrive enfin qu'une famille acadienne, si modeste que soit son apparence, possede une importance sociale qui ressort nettement un jour de noces. Des personnalites nobles ou bour- geoises sont venues de plusieurs lieues pour assister a la cere- monie. Gervais Thomas, originaire de Morteaux, diocese de Seez- en-Normandie, epouse, le 3 fevrier 1789, Marie-Josephe Boudrot, fille de deux Acadiens, Pierre Boudrot et Frangoise Daigle. Assis- tent a la ceremonie le marquis Perusse d'Escars, la marquise et le marquis de Pleumartin, Cesar de Marans, seigneur de Varennes, Guillard de la Vacherie, ex-officier du Regiment de Normandie, Brionne, notaire de la chatellenie de Monthoiron. Le premier enfant du menage aura pour parrain a son bapteme, le 17 octobre 1790, Perusse d'Escars en personne qui lui conferera le prenom d'Augadreme, aussi peu repandu alors qu'aujour- d'hui (24).
Ce fait social de premiere importance que furent les unions
poitevines-acadiennes fut-il apergu des contemporains ? Sans aucun doute, et le seul journal de repoque ne manque pas de le souligner. ? Cette petite colonie, d6j&, considerablement aug- mentee par le mariage des filles acadiennes avec des gargons poi- tevins, offre aussi la perspective touchante d'un grand accroisse- ment de populations ? (25). Que sont devenues, par la suite, les unions dont nous avons constate la frequence ? On devine sans peine qu'apres quelques generations la fusion fut totale. II reste encore, dans la region, les noms des premiers Acadiens debarques, il y a plus de 150 ans, les Boudrot, les Daigle, qui vivent encore aujourd'hui et n'ignorent point leur origine. II reste aussi la quasi totalite des 57 habitations, reconstruites sur place ou agrandies et amenagees. La derniere qui fut rebatie en 1951, sur l'emplacement ou le chirurgien Berbudeau s'etait installe et ou il mourut, porte un nom caracteristique : l'Acadienne. Temoi- gnage d'une tradition profonde, toujours solide et vivante en ce coin de pays.
Pierre MASSE.
(23) Registres paroissiaux de Cenant (Vienne). (24) Registres paroissiaux de Monthoiron (Vienne). (25) Affiches du Poitou, n? du 31 decembre 1778.
14
This content downloaded from 62.122.76.60 on Tue, 17 Jun 2014 03:54:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
Article Contentsp. 4p. 5p. 6p. 7p. [8]p. 9p. 10p. 11p. 12p. 13p. 14
Issue Table of ContentsL'Actualit de l'histoire, No. 9 (Oct., 1954), pp. 1-48Front MatterHommage Edouard Dollans [pp. 1-3]La Colonie Acadienne du Poitou. Les rapports entre Acadiens et Poitevins de 1773 1792 [pp. 4-14]Treize nouvelles lettres indites de P.-J. Proudhon [pp. 15-25]Treize lettres inedites de P.-J. Proudhon a un notaire [pp. 26-30]Paroles et critsLa relve [p. 31]
La page de l'historienDe l'image, considre comme document d'Histoire Sociale [pp. 32-33]
Thses [pp. 34-36]Historischer Materialismus und Europaeisches Geschichtdenken. Vortrge gehalten auf der Tagung des Landesverbandes nordrhein: Westflischer Geschichtslehrer in Wanne-Eickel (Pdagogischer Verlag Schwann, Dsseldorf, 1954) [pp. 37-38]Notes sociales [pp. 39-41]Vie de l'Institut [pp. 42-48]Back Matter