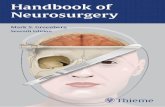GREENBERG, La Peinture Moderniste
Transcript of GREENBERG, La Peinture Moderniste

La peinture moderniste
Clement GREENBERG
« Modemist Painting » apparaît d’abord en 1960 dans une série radiophonique diffusée
sur les ondes de Voice of America (Washington, D.C.), puis est publié par ses soins. Art
Yearbook (IV, 1961) le reprend tel quel. Il figure ensuite, avec quelques légères modifications,
dans Art and Literature (n° 4, printemps 1965), et cette version est reprise par Gregory
Battcock dans son anthologie The New Art. A critical Anthology (New York, E. P. Dutton &
Co ; Inc., 1966-1973, Dutton Paperback, pp. 66-77). Une traduction française, sous le titre
« La peinture moderniste », apparaît dans Peinture-Cahiers théoriques, n° 8-9, 1974. On
retrouve le texte anglais dans deux autres anthologies : Esthetics Contemporary de Richard
Kostelanetz (1978), où il est assorti d’un post-scriptum, et dans Modern Art and Modernism.
A Critical Anthology de Francis Frascina et Charles Harrisson (1982). Il figure enfin, avec le
post-scriptum de 1978, dans l’édition des écrits complets de Greenberg, actuellement en
cours et menée à bien par John 0’Brian : Clement Greenberg. The Collected Essays and
Criticism, Vol. 4, Modernism with a Vengeance. 1957-1969. Chicago et Londres, The
University of Chicago Press, 1993, pp 85-94. Nous proposons ici une nouvelle traduction
(suivie du post-scriptum de 1978) qui est aussi, et surtout, une relecture comme l’attestent les
commentaires figurant dans les notes (voir aussi notre article « Kant contre Kant », plus
loin).
1/12

Le modernisme ne se limite pas simplement à l’art ni à la littérature. Désormais, il
s’étend à la quasi-totalité de ce qui est véritablement vivant dans notre culture. En outre, il se
trouve qu’il a l’importance d’une nouveauté historique. La civilisation occidentale n’est pas la
première à se retourner pour s’interroger sur ses propres fondations, mais c’est la civilisation
qui est allée le plus loin dans ce sens. J’assimile le modernisme à l’intensification, voire
l’exacerbation, de cette tendance autocritique que le philosophe Kant inaugura. En tant qu’il
fut le premier à critiquer les moyens mêmes de la critique (criticism1), je tiens Kant pour le
premier véritable moderniste. L’essence du modernisme réside, à mes yeux, dans l’usage des
méthodes caractéristiques d’une discipline pour critiquer cette discipline même – non point
pour la subvertir, mais pour la retrancher (to entrench2) plus fermement dans son champ de
compétence. Kant utilisa la logique pour établir les limites de la logique et, en proportion de
ce qu’il soustrayait à son ancienne juridiction, la logique se retrouva plus assurée dans la
maîtrise de ce qui lui restait3. L’autocritique du modernisme procède de la critique des
Lumières mais ne s’y réduit pas. Les Lumières critiquaient de l’extérieur, à la manière dont le
fait la critique dans son sens le mieux partagé ; le modernisme critique de l’intérieur, par le
biais des procédures mêmes de ce qui est critiqué. Il semble naturel que cette nouvelle sorte
de critique soit apparue d’abord en philosophie qui est critique par définition ; mais à mesure
que le XIXe siècle avançait, il se manifesta dans nombre d’autres champs. On commença à
exiger de chaque forme d’activité sociale une justification plus rationnelle, et l’autocritique
« kantienne » fut convoquée dans l’éventualité de rencontrer ou d’interpréter cette exigence
dans des ères fort éloignées de la philosophie.
Nous savons ce qu’il est advenu d’une activité comme la religion qui n’a pas été capable
d’employer la critique « kantienne » immanente pour s’autojustifier. À première vue, les arts
pourraient sembler avoir connu une situation comparable à la religion. S’étant vu dénier par
1 En anglais, criticism signifie la critique (l’acte, le fait de critiquer, spécialement dans un texte qui rend compte d’un autre texte, littéraire, ou d’une œuvre d’une autre nature). Le mot a un autre sens, celui auquel le mot français criticisme est spécialisé (de même que l’allemand Kriticismus) : la doctrine kantienne ou, plus généralement, toute philosophie qui préconise de fonder la recherche philosophique sur la théorie de la connaissance, c’est-à-dire le discernement (la critique) des formes et des catégories de l’esprit. L’expression « critiquer les moyens même de la critique » peut être considérée comme une définition du criticisme en ce second sens. Sur la question de la relation de Greenberg au criticisme, voir mon texte plus loin, ainsi que « Épistémologie du criticisme ; l’héritage théorique de Clément Greenberg », mon intervention au Colloque Clément Greenberg tenu au Centre Georges Pompidou les 21 et 22 mai 1993, actes parus dans les Cahiers du musée national d’art moderne.2 Terme militaire – voir mon article ci-après. (N. d. T.) 3 Sur ce point précis, c’est-à-dire la validité de l’affirmation de Greenberg eu égard à la dualité du sens de la notion de logique chez Kant (la logique comme discipline extérieure à la philosophie et la logique comme partie de la philosophie), voir « Épistémologie du criticisme : l’héritage théorique de Clément Greenberg », op. cit. (N. d. T)
2/12

les Lumières toutes les sortes de tâches qu’ils eussent pu assumer sérieusement, tout se passa
comme s’ils tendaient à être réduits au divertissement pur et simple, et comme si le
divertissement lui-même tendait à être réduit, de même que la religion, à une thérapie. Les arts
ne pouvaient se préserver de cette rétrogradation qu’en démontrant que la sorte d’expérience
qu’ils procuraient était valable de plein droit au lieu de procéder d’une autre sorte d’activité.
En l’occurrence, chaque art devait réussir cette démonstration pour son propre compte. Il
fallait que l’unicité et l’irréductibilité fussent manifestées et explicitées non seulement dans
l’art en général mais dans chaque art particulier. Chaque art devait déterminer, à travers les
opérations qui lui sont particulières, les effets qui lui sont particuliers et exclusifs. Ce faisant,
chaque art devrait sans doute restreindre son champ de compétence, mais, du même coup,
affermirait plus assurément sa maîtrise de ce champ.
Il apparut rapidement que le champ de compétence unique et propre pour chaque art
coïncidait avec tout ce que la nature de son médium recelait d’unique. La tâche de
l’autocritique devint l’exclusion, parmi les effets de chaque art, de quelqu’effet que ce soit qu’il
serait envisageable de prêter ou d’emprunter à un autre art. Ainsi, chaque art retournerait à son
état « pur », et dans sa « pureté » trouverait la garantie de ses normes de qualité aussi bien que
de son indépendance. La « pureté » signifiait l’autodéfinition, et l’entreprise de l’autocritique
dans les arts devint une entreprise d’autodéfinition à outrance (with a vengeance4).
L’art réaliste, illusionniste, avait dissimulé le médium, employant l’art pour cacher l’art ;
le modernisme emploie l’art pour attirer l’attention sur l’art5. Les limites qui constituent le
médium de la peinture – la surface plane, la forme du support, les propriétés du pigment –
étaient traitées par les anciens maîtres comme des facteurs négatifs qui ne pouvaient être pris
en compte qu’implicitement ou indirectement. La peinture moderniste en est venue à tenir ces
mêmes limites pour des facteurs positifs dont il faut se préoccuper ouvertement. Les tableaux
de Manet devinrent les premières œuvres modernistes en vertu de la franchise avec laquelle ils
4 Terme à nouveau militaire – voir mon article ci-après, (N. d. T.)5 Ces deux phrases ont largement contribué à accréditer la version d’un Greenberg théoricien-terroriste, en ce qu’elles semblaient en même temps définir et imposer normativement le modernisme comme une démonstration intellectualiste des seules propriétés du médium. II suffit de faire l’effort de lire un peu plus loin « Modemist painting » (la plupart des commentateurs et, particulièrement des dénigreurs, n’ont pas dépassé les deux premières pages) pour se rendre compte que cette interprétation est fondamentalement erronée – par exemple : « On doit comprendre également que l’autocritique de l’art moderniste n’a jamais fonctionné d’une autre manière que spontanée et subliminale. Ce fut entièrement une question de pratique, immanente à la pratique et jamais un sujet de théorie. » (N. d. T.)
3/12

affichèrent les surfaces sur lesquelles la peinture était posée. Les impressionnistes, dans le
sillage de Manet, renoncèrent à la sous-couche et au verni, pour placer l’œil, sans aucun
doute, devant l’évidence que les couleurs utilisées étaient faites de peinture réelle, tirée de
pots et de tubes. Cézanne sacrifia la vraisemblance, ou l’exactitude, afin d’ajuster plus
explicitement le dessin et la composition à la forme rectangulaire de la toile.
Cependant, c’était l’accentuation de la planéité inéluctable du support qui demeurait ce qu’il
y avait de plus fondamental dans les processus par lesquels l’art de la peinture se critiquait et
se définissait sous le modernisme. La planéité était la seule propriété uniquement réservée à cet
art. L’espace clos du support était une condition limitative, ou une norme, que partageait l’art
du théâtre ; la couleur, une norme ou un moyen dont participaient la sculpture aussi bien que
le théâtre. La planéité, la bidimensionnalité, était la seule condition que la peintre ne
partageait avec aucun autre art, en sorte que la peinture moderniste s’orienta vers la planéité et
rien d’autre.
Les anciens maîtres avaient senti qu’il était nécessaire de préserver ce que l’on appelle
l’intégrité du plan pictural : c’est-à-dire de signifier la présence persistante de la planéité sous
l’illusion la plus vive de l’espace tridimensionnel. L’apparente contradiction en cause – la
tension dialectique, pour employer une expression à la mode mais juste – était essentielle au
succès de leur art, comme elle est en effet nécessaire pour le succès de tout art pictural. Les
modernistes n’ont ni évité ni résolu cette contradiction ; ils ont plutôt renversé ses termes. On
prend conscience de la planéité de leurs peintures avant, plutôt qu’après avoir pris conscience
du contenu de la planéité. Tandis que l’on tend à voir ce qui est dans un tableau d’ancien
maître avant de le voir comme peinture, on voit d’abord une peinture moderniste comme un
tableau. C’est, de fait, la meilleure façon de voir tout type de tableau, qu’il soit d’un maître
ancien ou moderniste, mais le modernisme l’impose comme la seule et nécessaire façon, et la
réussite du modernisme dans ce sens est une réussite de l’autocritique.
Ce n’est pas par principe que dans sa phase ultime la peinture moderniste a abandonné la
représentation des objets reconnaissables. Ce qu’elle a abandonné par principe est la
représentation de la sorte d’espace que les objets tridimensionnels et reconnaissables
occupent. L’abstraction (abstractness6), ou le non-figuratif, n’a pas encore prouvé en lui-6 Littéralement en pourrait traduire abstractness par abstractivité si le néologisme n’était de trop vis-à-vis d’abstraction qui en français rend compte de l’idée voulue – à savoir, comme semble bien l’indiquer la substantivation de l’adjectif (en lieu et place du substantif), l’insistance sur le caractère négatif de l’opération, sur
4/12

même qu’il est un moment absolument nécessaire dans l’autocritique de l’art pictural, même
si des artistes aussi éminents que Kandinsky et Mondrian l’ont pensé ainsi. La représentation,
ou l’illustration, en tant que telle, n’affaiblit pas l’unicité de l’art pictural ; ce qui le fait ce
sont les associations des choses représentées. Toutes les entités reconnaissables (y compris les
images elles-mêmes) existent dans un espace tridimensionnel, et la suggestion la plus faible
d’une entité reconnaissable suffit à évoquer des associations d’un espace de ce type. La
silhouette fragmentaire d’une figure humaine, ou d’une tasse de thé, le fera, et, ce faisant,
détourne l’espace pictural de la bidimensionnalité qui est la garantie de l’indépendance de la
peinture en tant qu’art. La tridimensionnalité est le territoire de la sculpture, et pour le profit
de sa propre autonomie la peinture a dû par-dessus tout se départir de tout ce qu’elle pourrait
partager avec la sculpture. Et c’est au gré de son effort pour en arriver là, et non point – je le
répète – pour exclure le figuratif ou la « littérature », que la peinture s’est constituée elle-
même comme abstraite7.
Au même moment, la peinture moderniste démontre, précisément par sa résistance
envers le sculptural, qu’elle poursuit la tradition et les thèmes de la tradition, tout au contraire
des apparences. Car la résistance au sculptural commence longtemps avant l’avènement du
modernisme. La peinture occidentale, dans la mesure où elle recherche l’illusion réaliste, doit
une dette considérable à la sculpture qui lui a enseigné au début comment ombrer et modeler à
travers une illusion de relief, et même comment disposer cette illusion dans une illusion
complémentaire de profondeur spatiale. Cependant quelques-uns des plus grands tours de
force de la peinture occidentale participèrent de son effort des quatre siècles précédents pour
refouler et anéantir le sculptural. Entamé à Venise au XVIe siècle et poursuivi en Espagne, en
Belgique et en Hollande au XVIIe, cet effort fut d’abord mis à exécution au titre de la couleur.
Quand David, au XIXe siècle, s’efforça de ressusciter la peinture sculpturale, ce fut
partiellement pour sauver l’art pictural de l’aplanissement décoratif que l’accent sur la couleur la soustraction des signes de figuration (« Abstractness, or the nonfigurative ... »), plutôt que la désignation positive de l’école abstraite (qui, un moment, pour souligner sa positivité, se dit « concrète »). (N. d. T.)7 Dans la tradition de la discussion sur la pureté de la peinture, les auteurs penchent tantôt vers la frontière avec la poésie, s’agissant vis-à-vis d’elle de légitimer globalement les arts plastiques, tantôt vers la frontière avec la sculpture, s’agissant, au sein des arts plastiques, d’approfondir l’autonomie de chaque art de cette catégorie. L’apport de Greenberg à cette discussion consiste à dire que la peinture est moins détournée de sa nature par la figuration de sujets 1ittéraires, qui ne sont que des « associations des choses représentées », que par l’imitation de la sculpture, en ce qu’elle introduit dans la représentation picturale elle-même une tridimensionnalité contre nature. On peut donc être « pur » dans la figuration, ou, du moins, le plus « pur » possible, à l’instar d’Ingres. Dans cette partie du texte, Greenberg commence à opérer un renversement des relations modernisme-tradition telles qu’on a l’habitude de les concevoir dans le discours courant (rupture irréversible, table rase, etc.) ; et contrairement à ce que l’on a induit de l’interprétation comme intellectualiste et dogmatique du modernisme, ce dernier est, pour le critique, en parfaite continuité avec la tradition, il en est la suite logique et le parachèvement. (N. d. T.)
5/12

semblait induire. Néanmoins, la force de ses meilleures peintures (qui sont principalement des
portraits) réside souvent davantage dans leurs couleurs que dans quoi que ce soit d’autre. Et
Ingres, son élève, bien qu’il subordonnât la couleur de manière bien plus consistante, exécuta
des tableaux qui étaient parmi les plus plats, les moins sculpturaux, faits en Occident par un
artiste raffiné depuis le XIVe siècle. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, toutes les tendances
ambitieuses en peinture convergeaient (par delà leurs différences) vers une préoccupation
antisculpturale.
Le modernisme, en poursuivant dans cette direction, la rendit plus consciente d’elle-
même8. Avec Manet et les impressionnistes, la question cessa d’être définie dans les termes de
1’antinomie de la couleur et du dessin, et fut remplacée par une question d’expérience
purement optique en contradiction avec l’expérience optique modifiée et révisée par les
associations tactiles. Ce fut au nom du purement et littéralement optique, non au titre de la
couleur, que les impressionnistes entreprirent eux-même de miner l’ombre et le modelé et tout
ce qui semblait connoter le sculptural. À la façon dont David avait réagi contre Fragonard au
titre du sculptural, Cézanne et les cubistes après lui réagirent contre l’impressionnisme. Mais
une fois encore, de même que les réactions de David et d’Ingres avaient culminé dans une
sorte de peinture bien moins sculpturale que précédemment, de même, la contre-révolution
cubiste s’accomplit dans une manière de peindre plus plane que tout ce que l’art occidental
avait connu depuis Cimabue – si plane, en effet, qu’elle pouvait à peine contenir des images
reconnaissables.
Dans l’intervalle, les autres normes cardinales de l’art de la peinture avaient subi la même
recherche de fond, bien que les résultats pussent ne pas avoir été aussi notables. Il me faudrait
disposer de davantage d’espace pour exposer comment la norme de la forme ou du cadre
circonscrivant l’œuvre fut relâchée, puis resserrée, puis relâchée à nouveau, et enfin isolée et
une fois de plus resserrée par les générations successives de peintres modernistes ; ou
comment les normes du fini ou de la texture picturale, et du contraste de valeur et de couleur
furent mises et remises à l’épreuve. Des risques ont été pris avec chacune de ces normes non
seulement à dessein d’expression nouvelle mais aussi dans le but de les exhiber plus
8 Autre source de malentendu : le modernisme comme attitude réflexive donc intellectuelle, comme instauration entre l’artiste et l’art d’une distance intellectualiste. En fait, c’est, pour Greenberg, de conscience historique qu’il s’agit, la conscience d’une nécessité historique qui n’est nullement « affaire de licence », tandis que, quant à la relation de l’artiste à son art, il n’y a nulle distance critique ou réflexive, mais une attitude « spontanée et subliminale ». La critique opérée par le modernisme (et l’exhibition croissante des normes de la peinture) réside dans le processus historique de la peinture, non point dans un quelconque volontarisme individuel. (N. d. T.)
6/12

clairement comme normes. En étant exhibées et rendues explicites elles étaient mises à
l’épreuve du point de vue de leur nécessité. Cette expérimentation n’est en aucune façon
révolue, et le fait qu’elle devienne plus minutieuse à mesure qu’elle opère justifie les
simplifications radicales, aussi bien que les complications radicales ; qui abondent dans l’art
abstrait le plus récent.
Ni les simplifications, ni les complications ne sont affaire de licence. Au contraire, plus
les normes d’une discipline deviennent étroitement et essentiellement définies moins elles
sont aptes à autoriser des libertés. (L’emploi de « libération » est devenu abusif à l’égard de
l’avant-garde et de l’art moderniste). Les normes et les conventions essentielles de la peinture
sont aussi les conditions limitatives auxquelles une surface composée doit se conformer pour
être expérimentée comme tableau9. Le modernisme a découvert que l’on peut repousser
indéfiniment ces conditions limitatives avant qu’un tableau ne cesse d’être un tableau et se
métamorphose en un objet arbitraire ; mais il a aussi découvert que plus ces limites reculaient plus
on devait y obéir explicitement. Les lignes noires séquentes et les rectangles colorés d’un
Mondrian peuvent à peine sembler suffisants pour constituer un tableau, cependant que, en
faisant écho de manière aussi proprement évidente à la forme close du tableau, ils imposent cette
forme comme une norme régulatrice avec une force nouvelle et selon un accomplissement
inédit. Loin d’encourir le risque de l’arbitraire eu égard à l’absence d’un modèle en nature,
l’art de Mondrian s’avère, à la longue, presque trop discipliné, trop déterminé par convention à
certains égards ; une fois que l’on s’est habitué à son abstraction (abstractness) absolue on
réalise qu’il est plus traditionnel du point de vue de la couleur, de même que de sa soumission
au cadre, que ne le sont les dernières peintures de Monet10.
On comprend, je l’espère, qu’en repérant la raison d’être de l’art moderniste j’ai dû
simplifier et exagérer. La planéité vers laquelle la peinture moderniste s’oriente elle-même ne
9 Il semble y avoir une coïncidence entre la nécessité historique à laquelle se rattache le modernisme et la nécessité sémiotique qui définit le médium. L’histoire de la peinture est sa découverte progressive en tant que médium. Cela suppose qu’il existerait une essence de cet art, donnée d’avance, et qui se révèlerait progressivement, au fil de ses expérimentations et de la prise de conscience historique de sa nature. En ce sens, notamment, rien n’est plus étranger à l’esprit de Greenberg que l’avant-gardisme comme intervention volontariste dans le champ de l’art et instauration de règles de l’art inédites qui n’y seraient pas en puissance. (N. d. T.)10 Cette proposition induit à penser que le processus historique de la peinture, bien qu’il soit progressiste au sens où l’expérimentation de ses normes progresse, où leur exhibition s’accentue, n’est pas strictement linéaire et continu à tous égards ; par un biais, Mondrian va le plus loin possible, par un autre, il est dépassé par Monet. Cet apparent paradoxe trouve plus loin sa résolution dans le discernement de la consistance formelle (comparable à la consistance scientifique) et de la consistance esthétique, celle-ci étant « la seule […] qui compte en art ». À ce moment, Greenberg se détache du modèle kantien de la critique d’une discipline par ses propres moyens, du modèle de la Critique de la raison pure – voir mon article dans ce recueil. (N. d. T.)
7/12

saurait jamais être une planéité absolue. La sensibilité accrue du plan pictural ne peut plus
autoriser l’illusion sculpturale, le trompe-l’œil11, mais elle autorise encore et doit autoriser
l’illusion optique. La première marque apposée à une surface détruit sa planéité virtuelle, et
les configurations d’un Mondrian suggèrent encore une sorte d’illusion d’une sorte de
troisième dimension. Ce n’est que maintenant qu’existe une troisième dimension strictement
picturale, strictement optique. Là où les anciens maîtres créaient une illusion d’espace au sein de
laquelle on pouvait s’imaginer marcher, l’illusion créée par un moderniste est une illusion dans
laquelle on ne peut regarder ou se déplacer qu’avec l’œil.
On commence à réaliser que les néo-impressionnistes ne se méprenaient pas tout à fait
lorsqu’ils fleurtaient avec la science. L’autocritique kantienne trouve sa parfaite expression
dans la science plutôt que dans la philosophie, et quand cette sorte d’autocritique fut
appliquée à l’art son esprit s’était rapproché plus que jamais de la méthode scientifique –
davantage qu’au début de la Renaissance. Que l’art visuel doive se confiner exclusivement à
ce qui est donné dans l’expérience visuelle, et ne point faire référence à ce qui est donné dans
d’autres ordres de l’expérience, est une notion dont la seule justification réside,
conceptuellement, dans la consistance12 scientifique. Seule la méthode scientifique exige
qu’une situation soit résolue exactement dans les mêmes termes où elle est présentée – un
problème de physiologie est résolu dans les termes de la physiologie, non point dans ceux de
la psychologie ; pour être résolu en termes de psychologie il doit d’abord être présenté ou
traduit dans ces termes. De manière analogue, la peinture moderniste exige qu’un thème
littéraire soit traduit strictement dans des termes optiques, bidimensionnels, avant de devenir
le sujet de l’art pictural – ce qui veut dire qu’il soit traduit en sorte qu’il perde entièrement son
caractère littéraire. En fait, une telle consistance ne promet rien dans la perspective de la
qualité esthétique ou des résultats esthétiques, et le fait que le meilleur art des soixante-dix ou
quatre-vingts dernières années se rapproche progressivement d’une telle consistance ne
change rien à l’affaire ; maintenant comme avant, la seule consistance qui compte en art est la
consistance esthétique, laquelle ne se manifeste que dans les résultats, jamais dans les
méthodes ou les moyens. Du point de vue de l’art lui-même, il appert que sa convergence
spirituelle avec la science est un pur accident, et ni l’art ni la science ne se fournissent ou ne
se garantissent réciproquement davantage qu’elles ne l’ont jamais fait. Ce que leur
11 En français dans le texte. (N. d. T.)12 Sur le sens logique de ce terme, cf. mon texte plus loin. (N. d. T.)
8/12

convergence montre néanmoins c’est en quelle me-sure 1’art moderniste appartient à la même
tendance historique et culturelle que la science moderne13.
On doit comprendre également que l’autocritique de l’art moderniste n’a jamais
fonctionné d’une autre manière que spontanée et subliminale. Ce fut entièrement une question
de pratique, immanente à la pratique et jamais un sujet de théorie. On a beaucoup entendu
parler de programmes à propos de l’art moderniste, mais on a vraiment été bien plus éloigné
d’une programmation dans l’art moderniste, que dans l’art de la Renaissance ou dans l’art
académique. Sauf quelques exceptions atypiques, les maîtres du modernisme n’ont pas plus
manifesté d’appétit envers les idées fixes sur l’art que Corot. Certaines inclinations et certains
accents, certains refus et certaines abstentions semblent devenir nécessaires simplement parce
que la voie qui mène à un art plus fort et plus expressif paraît passer par là. Les objectifs
immédiats des artistes modernistes restent avant tout individuels, et la vérité ou la réussite de
leurs travaux est individuelle par-dessus tout. Pour autant qu’il réussisse comme art, l’art
moderniste ne participe en aucune façon du caractère d’une démonstration. Il a fallu, au long
de décennies, l’accumulation de quantité d’œuvres individuelles pour que se révèle la
tendance autocritique de la peinture moderniste. Aucun artiste n’était, ou n’est encore,
pleinement conscient de cette tendance, pas plus qu’il ne pouvait l’être en accomplissant une
œuvre. Dans cette mesure – qui est de loin la plus importante – l’art continue d’être porté par
le modernisme comme il le fut auparavant14.
Et je ne peux insister suffisamment sur le fait que le modernisme n’a jamais visé quoi
que ce soit qui ressemble à une rupture avec le passé. Il a peut-être représenté une
dégénérescence, un effilochage de la tradition, mais aussi sa continuation. L’art moderniste
procède du passé sans hiatus ni rupture, et prendrait-il jamais fin qu’il ne cesserait de
demeurer intelligible en termes de continuité de l’art. La fabrication des tableaux, depuis son
13 Greenberg récuse donc autant la causalité science-art que la linéarité historique de l’art. L’autocritique de l’art ne procède pas de l’adaption dans l’art d’une tendance scientifique, mais d’une « tendance historique et culturelle » qui les englobe également. Il ne s’agit pas d’appliquer les procédures de la science à l’art (sinon par « pur accident »), ce qui reviendrait à négliger la-spécificité de la consistance esthétique, c’est-à-dire de la dimension de la qualité de l’œuvre. (N. d. T.)14 La réussite du modernisme, immanente à la pratique des artistes, imposée par l’histoire de leurs expérimentations successives, ne résulte pas d’un projet démonstratif, théorique ; elle passe par des séries d’expériences d’artistes qui expérimentent leur médium sans le savoir ni sans le vouloir, portés qu’ils sont par le mouvement historique dans lequel ils baignent. Le rôle de l’individualité sert à contredire la thèse du modernisme théorique ; le rejet du volontarisme renvoie cette individualité à son bain historique. On comprend que Greenberg ne soit pas enclin, à cette époque, à accepter les attitudes ou les gestes d’artistes qui, tel Duchamp, prétendent infléchir volontairement le cours de l’histoire en rupture avec son processus « naturel » (l’épithète signale, en effet, une tendance à naturaliser la culture, à concevoir l’histoire comme le développement d’une nature, celle du médium notamment). (N. d, T.)
9/12

origine, est gouvernée par l’ensemble des normes que j’ai mentionnées. Le peintre ou le
graveur paléolithique pouvait négliger la norme du cadre et traiter la surface d’une manière à
la fois littéralement et virtuellement sculpturale, dans la mesure où il faisait des images plutôt
que des tableaux, et travaillait sur un support dont les limites pouvaient être négligées puisque
(à l’exception des petits objets tels un os ou une corne) ils s’offraient à l’artiste comme des
conditions inaltérables. Mais réaliser un tableau, au contraire des images sur un plan, suppose
le choix et la création délibérés de limites. Cette intentionnalité est ce que le moderniste
rabâche : en ce sens, il explicite le fait que les conditions limitatives de l’art doivent être
absolument établies en tant que limites humaines.
Je répète que l’art moderniste ne propose aucune démonstration théorique. Il faudrait
dire plutôt qu’il convertit toutes les possibilités théoriques en possibilités empiriques et que,
ce faisant, il teste, par inadvertance, toutes les théories sur l’art du point de vue de leur
pertinence à l’aune de la pratique et de l’expérience réelles de l’art. Si le modernisme est
subversif c’est uniquement à cet égard. Combien de facteurs tenus pour essentiels à la
réalisation et à l’expérimentation de l’art se sont révélés ne pas l’être dans la mesure où 1’art
moderniste a été capable de se passer d’eux, non sans continuer à assumer l’expérience de l’art
dans tous ses fondements. Que cette « démonstration » n’ait pas affecté la plupart de nos
anciens jugements de valeur ne l’en rend que plus concluante. Le modernisme peut avoir joué
un rôle dans la renaissance des réputations d’Uccello, de Piero. du Greco, de Georges de la
Tour et même de Vermeer, et il est certain qu’il confirma, voire amorça, d’autres renaissances
comme celle de Giotto ; mais il n’a pas, du même coup, rétrogradé Léonard, Raphaël, Titien,
Rubens, Rembrandt ou Watteau. Ce que le modernisme a clarifié est que l’égalité de
traitement de ces maîtres par le passé reposait sur des motifs erronés ou dénués de pertinence.
Toutefois, d’une certaine manière, c’est à peine si cette situation a changé. La critique d’art est à la
remorque du modernisme comme elle le fut à l’égard de l’art pré-moderniste. Presque tous les écrits au
sujet de l’art contemporain ressortissent au journalisme plutôt qu’à la critique proprement dite15.
Ressortit au journalisme – et au complexe millénaire dont maints journalistes souffrent aujourd’hui –
15 Si Greenberg réfute la dimension théorique de la pratique artistique prise en elle-même, c’est-à-dire comme activité des artistes face au médium qu’ils exploitent de manière plus ou moins moderniste, il affirme ici la dimension théorique de la critique d’art, c’est-à-dire sa capacité à réintégrer l’appréciation des propositions picturales dans la perspective du processus historique de la critique picturale comme expérimentation de son médium et, corrélativement, dans la problématique esthétique au sens de la question du goût. La glorification up-to-date des ruptures néglige le fait que, comme le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre nous trompe sur la rotation propre dans le système solaire, leur sens profond est de procéder de la tradition et de l’enrichir. (N. d. T.)
10/12

l’idée que chaque nouvelle phase du modernisme doive être saluée comme le commencement d’un âge
totalement nouveau de l’art qui produirait une rupture décisive avec les habitudes et les conventions du
passé. À chaque fois, on attend une sorte d’art qui sera tellement différente des précédentes, et tellement
« libérée » des normes de la pratique et du goût, que tout un chacun, qu’il soit bien ou mal informé, sera
capable de dire son mot à son sujet. Et à chaque fois cette attente est déçue, puisque la phase de
modernisme en question s’installe, au bout du compte, dans la continuité intelligible du goût et de la
tradition, et qu’il devient clair que les exigences d’antan ne cessent d’être adressées à l’artiste et au
spectateur.
Il n’y a rien qui puisse être plus éloigné de l’art authentique de notre temps que l’idée d’une
solution de continuité. L’art, parmi maintes autres choses, est continuité. Sans le passé de l’art, et sans
le besoin et l’impératif de maintenir les normes d’excellence du passé, il ne saurait y avoir d’art
moderniste.
11/12

Post-scriptum (ajouté par Greenberg à la republication de 1978) :
Je veux saisir cette opportunité pour corriger une erreur, relative à l’interprétation plutôt
qu’au fait. Nombre de lecteurs, mais certainement pas tous, semblent avoir considéré que la
« raison d’être » du modernisme soulignée ici représentait une position adoptée par l’auteur
lui-même, en sorte qu’il aurait plaidé pour ce qu’il décrit. C’est peut-être une faute d’écriture
ou de rhétorique. Néanmoins, une lecture plus précise de ce qu’il écrit montrera que rien
n’indique qu’il souscrit, qu’il croit à ce qu’il pressent (Les guillemets autour de pur et pureté
auraient dû l’indiquer suffisamment16), L’auteur s’efforce de rendre partiellement compte des
conditions de ce qui s’est produit dans le meilleur de l’art des cent et quelques dernières
années, mais il ne donne pas à entendre qu’il s’agirait de la façon dont il devait se produire,
bien moins que la façon dont le meilleur art peut encore advenir. L’art « pur » était une
illusion utile, mais cela n’en fait pas moins une illusion. Non plus que la possibilité que son
utilité perdure n’en fait rien moins qu’une illusion.
Quelques autres constructions que j’ai élaborées ont viré à l’absurde : que je considère la planéité
et la clôture du plan non point comme de simples conditions limitatives de l’art de la peinture, mais
comme des critères de la qualité esthétique dans l’art pictural ; que plus une œuvre progresse dans
l’autodéfinition d’un art, plus elle est déterminée à être bonne. Le philosophe ou l’historien de l’art qui
est capable d’envisager que, par là je – ou quiconque – cherche à atteindre le jugement esthétique lit
exagérément en lui-même ou en elle-même plutôt qu’il ne lit mon article.
Traduit de l’anglais par Dominique Chateau
16 Greenberg fait notamment référence au passage suivant : « Ainsi, chaque art retournerait à son état "pur", et dans sa "pureté" trouverait la garantie de ses normes de qualité aussi bien que de son indépendance. La "pureté" signifiait l’autodéfinition, et l’entreprise de l’autocritique dans les arts devint une entreprise d’autodéfinition à outrance. » Il n’empêche que l’ensemble de ses propositions s’inscrit dans la généalogie de théoriciens qui de Léonard à lui, en passant par Lessing, Quatremère de Quincy, Apollinaire, Kandinsky, entre autres, constitue un discours homogène, par delà des variantes non significatives, visant à affirmer et affiner le « domaine de compétence », la pureté de chaque art et, tout spécialement, de la peinture. Sur cette relation de Greenberg à la théorie de la pureté, cf., outre celui déjà cité, ma communication « Modèles critiques et attitude théorique chez Greenberg » (Colloque « De l’art : histoire de la critique, critique de l’histoire », Santiago-du-Chili, 1993) et mon article « Clement Greenberg um critico na historia, um critico da historia » ,(Porto arte, Revista de Artes Visuales, Porto Alegre, n° 8, nov, 1993, pp. 43-50). (N. d. T.)
12/12