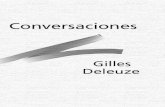Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
-
Upload
peisithanatos -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
1/124
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
2/124
Gilles DeleuzeLe bergsonisme
QUADRIGE / pUP
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
3/124
ISIIN 2 13 054S41 6ISSN 0291-04119
J t p l - ." 6didon : 19663' dil
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
4/124
CHAPlIRE PREMIER
L'INTUITIONCOMME MTHODEDure, Mmoire, lan vital marquent les grandestapes de la philosophie bergsonienne. L'objet de celivre est la dtermination du rapport entre ces troisnotions, et du progrs qu'elles impliquent.L'intuition est la mthode du bergsonisme. L'intuitionn'est pas un sentiment ni une inspiration, une sympathie
confuse, mais une mthode labore, et mme une desmthodes les plus labores de la philosophie. Elle ases rgles strictes, qui constituent ce que Bergson appelleIl la prcision l i en philosophie. Il est vrai que Bergsoninsiste sur ceci l'intuition, telle qu'il l'entend mthodiquement, suppose dj la dure. a Ces considrationssur la dure nous paraissaient dcisives. De degr endegr, elles nous firent riger l'intuition en mthodephilosophique. Intuition est d'ailleurs un mot devantlequel nous hsitmes longtemps. (1). Et Hoffding,
(1) PM, 1271, 2S. - Nous citons les uvres de BERGSON d'aprsdes initiales. Essai sur Iss do,,,,4es immdiat,s de la Ulnlei,nu, 1889 :Dl. Malih-I Ir M ~ m o i r e J 1896 MM. Le Rire, 1900 : R. L'Evolutioncriarri,e, 1907 : EC. L'Energi, spirituellt, 1919 ES. Durit er Si",ultan4it4, 1922 : DS. US deux sources de la "'01'31, er dt la religiOfl,1932 : MR. La Pnuu et le Mouvant, 1941 PM. - Nous citonsDS d'aprs la 4- ~ d i t i o n . Pour toutes les autres uvres, nos r ~ r ~ r e n c e s renvoient d'abord' la pagination de l'tdition du Centenaire (pressesUniversitaires de France), puis, conformment auz inccationl deceUe-ci, auz rmpressions 1939-1941.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
5/124
2 LE BERGSONISMEil crit : La thorie de l'intuition sur laquelle vousinsistez beaucoup plus que sur celle de la dure ne s'estdgage mes yeux qu'assez longtemps aprs celle-ci Il (1).Mais premier et second ont beaucoup de sens. Ilest certain que l'intuition est seconde par rapport ladure ou la mmoire. Mais si ces notions dsignentpar elles-mmes des ralits et des expriences vcues,elles ne nous donnent encore aucun moyen de lesctmllaltre (avec une prcision analogue celle de lascience). Bizarrement on peut dire que la dude resterait seulement intuitive, au sens ordinaire du mot,s'il n'y avait prcisment l'intuition comme mthode,au sens proprement bergsonien. Le fait est que Bergsoncomptait sur la mthode d'intuition pour tablir laphilosophie comme discipline absolument prcise I l,aussi prcise dans son domaine que la science dans lesien, aussi prolongeable et ttansmissible que la scienceelle-mme. Et les rapports entte Dure, Mmoire, lanvital resteraient eux-mmes indtermins du point devue de la connaissance, sans le fil mthodique de l'intuition. A tous ces gards nous devons faire passer au premier plan d'un expos l'intuition comme mthoderigoureuse ou prcise (2).
La question mthodologique la plus gnrale estcomment l'intuition, qui dsigne avant tout une connaissance immdiate, peut-elle former une mthode, unefois dit que la mthode implique essentiellement uneou des mdiations ? Bergson prsente souvent l'intuition
(1) lAttr, d H { j l l t l i ~ , 1916 (cf. Ecriu tr Pmolu, t. III, p. 456).(a) Sur l'emploi du mot i,.ruitiMl, et sur la geDi:Be la Dotion,daoB lei Do",.hs j"""Mialtl et Marib-, ,r Mimoirt, on se reponeraau livre de M. HUSSON, L ' i , . r ~ l , c r , , " , / i n n , d, BtrgfMl, Presse. Ulverlitaires de France, 1947. pp. 6-10.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
6/124
L'INTUITION COMME MTHODB 3comme un acte simple. Mais la simplicit selon luin'exclut pas une multiplicit qualitative et virtueUe,des directions diverses dans lesquelles elle s'actualise.En ce sens l'intuition implique une pluralit d'acceptions, des vues multiples irrductibles (1). Bergsondistingue essentiellement trois espces d'actes, quidterminent des rgles de la mthode la premireconcerne la position et la cration des problmes; laseconde, la dcouverte des vritables di1frences denature; la troisime, l'apprhension du temps rel.C'est en montrant comment on passe d'un sens l'autre,et quel est I l le sens fondamental ., qu'on doit retrouverla simplicit de l'intuition comme acte vcu, pourrpondre la question mthodologique gnrale. .PREMIRE RGLE: Porter fpreufJe du wai et du fauxdans les problmes eux-t7IhMJ, dnoncer les faux problhnes,rconcilier "bit et cration au niveau des problmes.En effet, nous avons le tort de croire que le vrai et lefaux concernent seulement les solutions, ne commencentqu'avec les solutions. Ce prjug est social (car lasocit, et le langage qui en transmet les mots d'ordre,nous donnent des problmes tout faits, comme sortisdes I l cartons administratifs de la cit D, et nous imposentde les If rsoudre , en nous laissant une maigre margede libert). Bien plus, le prjug est infantile et scolaire :c'est le matre d'cole qui donne. des problmes, latiche de l'lve tant d'en dcouvrir la solution. Par lnous sommes maintenus dans une sorte d'esclavage.
(1) PM, 1274-1275, 29-30.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
7/124
LB BERGSONISMB
La vraie libert est dans un pouvoir de dcision, deconstitution des problmes eux-mmes ce pouvoir,1 semi-divin " implique aussi bien l'vanouissementdes faux problmes que le surgissement crateur desvrais. La vrit est qu'il s'agit, en philosophie et mmeailleurs, de trOU'Der le problme et par consquent dele poser, plus encore que de le rsoudre. Car un pro-blme spculatif est rsolu ds qu'il est bien pos.J'entends par l que la solution en existe alors aussitt,bien qu'elle puisse rester cache et, pour ainsi dire,couverte: i l ne reste plus qu' la dcouvrir. Mais poserle problme n'est pas simplement dcouvrir, c'estinventer. La dcouverte porte sur ce qui existe dj,actuellement ou virtuellement; elle tait donc sre devenir tt ou tard. L'invention donne l'tre ce qui n'taitpas, elle aurait pu ne venir jamais. Dj en mathmatiques, plus forte raison en mtaphysique, l'effortd'invention consiste le plus souvent susciter le problme, crer les termes en lesquels il se posera. Positionet solution du problme sont bien prs ici de s'quivaloir: les vrais grands problmes ne sont poss quelorsqu'ils sont rsolus. (1).Non seulement toute l'histoire des mathmatiquesdonne raison Bergson. Mais on comparera la dernirephrase du texte de Bergson avec la formule de Marx,valable pour la pratique elle-mme L'humanit nese pose que les problmes qu'elle est capable de rsoudre Dans les deux cas, i l ne s'agit pas de dire que les problmes sont comme l'ombre de solutions prexistantes(tout le contexte indique le contraire). n ne s'agit pasdavantage de dire que seuls comptent les problmes.
(1) PM, 1293, SI-SJ Caur " l' itat aemi-diriD la cf. 1306a 61).
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
8/124
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
9/124
6 LE BERGSONISME faux problme D. D'o une rgle complmentaire dela rgle gnrale p r ~ e n t e .
RtGLE COMPLMENTAIRB : Les faux problmss SOllt dedeux sortes, (1 probUma inexistants qui se dfinissent enceci que ltuJ's tmntS eux-mmes impliquent une c01IfusiOlldu 1( plus et du Il moins J' ft problmu mal poss D qui sedfinissent en cela que leurs termes reprsentent des mixtesmal analyss.Bergson donne comme exemples du premier type leproblme du non-tre, celui du dsordre ou celui dupossible (problmes de la connaissance et de l'tre);comme exemples du second type, le problme de laliben ou celui de l'intensit (1). Ses analyses cetgard sont clbres. Dans le premier cas, elles consistent montrer qu'il y a non pas moins, mais plus dans l'idede non-tre que dans celle d'tre; dans le dsordreque dans l'ordre; dans le possible que dans le rel.Dans l'ide de non-tre, en effet, i l y a l'ide d'tre,plus une opration logique de ngation gnralise, plusle motif psychologique panicuJier de cette opration(lorsqu'un tre ne convient pas notre attente, et quenous le saisissons seulement comme le manque, l'absencede ce qui nous intresse). Dans l'ide de dsordre, i l y adj l'ide d'ordre, plus sa ngation, plus le motif decette ngation (quand nous rencontrons un ordre quin'est pas celui que nous attendions). Dans l'ide depossible, i l y a plus que dans l'ide de rel: car lepossible n'est que le rel avec, en plus, un acte de l'esprit
(1) PM, 1336, lOS. - La distribution des cnmples varie suivantles tates de Berglon. Ce n'est pas Monnant, puisque chaque fauxp r o b l ~ e . nous le verrons, p r ~ s e n t e en proportion variable les deuxaspects. Sur la l i b e r t ~ et l'intensit!!: comme faux problmes. cf. PM,1268, zoo
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
10/124
L'INTUITION COMME MTHODB 7qui en rejette l'image dans le pass une fois qu'il s'estproduit , et le motifde cet acte (lorsque nous confondonsle surgissement d'une milit dans l'univers avec unesuccession d'tats dans un systme clos) (1).Quand nous demandons pourquoi quelque choseplutt que rien ? D, ou pourquoi de l'ordre plutt quedu dsordre ? , ou " pourquoi ceci plutt que cela(cela qui tait galement possible) ? , nous tombonsdans un mme vice : nous prenons le plus pour le moins,nous faisons comme si le non-tre prexistait l'tre,le dsordre ;\ l'ordre, le possible ;\ l'existence. Commesi l'tre venait remplir un vide, l'ordre, organiser undsordre pralable, le rel, raliser une possibilitpremire. L'tre, l'ordre ou l'existant sont la vritmme; mais dans le faux problme, i l y a une illusionfondamentale, un mouvement rtrograde du vrai par lequel l'tre, l'ordre et l'existant sont censs seprcder ou prcder l'acte crateur qui les constitue,en rtrojetant une image d'eux-mmes dans une possibilit, un dsordre, un non-tre supposs primordiaux.Ce thme est essentiel dans la philosophie de Bergson :i l rsume sa critique du ngatif, et de toutes les formesde ngation comme sources de faux problmes.Les problmes mal poss, le second type de fauxproblmes, semblent faire intervenir un mcanismediffrent: i l s'agit cette fois de mixtes mal analyss,dans lesquels on groupe arbitrairement des choses quidiffrent m nature. On demande par exemple si lebonheur se rduit ou non au plaisir; mais peut-trele terme de plaisir subsume-t-il des tats trs divers
(1) PM. 1339. 110. - Sur la critique du d6s0rdre et du non-ftre.d. aussi EC. 683. 223 sq. et 730, 278 Iq.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
11/124
8 LB BERGSONISMBirrductibles, de mme l'ide de bonheur. Si les termesne rpondent pas des Il anicu1ations naturelles D,alors le problme est faux, ne concernant pas a la naturemme des choses I l (1). L aussi, les analyses de Bergsonsont clbres, quand il dnonce l'intensit comme untel mixte que J'on confonde la qualit de la sensationavec l'espace musculaire qui lui correspond, ou avecla quantit de la cause physique qui la produit, la notiond'intensit implique un mlange impur entre dterminations qui diffrent en nature, si bien que la question I l de combien la sensation grandit-elle ? I l renvoietoujours un problme mal pos (2). De mme leproblme de la libert, o l'on confond deux types de multiplicit I l, celle de termes juxtaposs dans l'espaceet celle d'tats qui se fondent dans la dure.Revenons au premier type de faux problmes. On yprend, dit Bergson, le plus pour le moins. Mais i l arrive~ a 1 e m e n t que Bergson dise qu'on y prend le moins pourle plus: de mme que le doute sur une action ne s'ajoutequ'en apparence l'action, mais tmoigne en ralitd'un demi-vouloir, la ngation ne s'ajoute pas cequ'elle nie, mais tmoigne seulement d'une faiblesse encelui qui nie. Nous sentons qu'une volont ou unepense divinement cratrice est trop pleine d'elle-mme,dans son immensit de ralit, pour que l'ide d'unmanque d'ordre ou d'un manque d'tre puisse seulementl'effleurer. Se reprsenter la po,sibilit du dsordreabsolu, plus forte raison du nant, serait pour elle sedire qu'elle aurait pu ne pas tre du tout, et ce seraitl une faiblesse incompatible avec sa nature, qui est
(1) PM, 1293-1294, 52-53.(2) Cf. DI, chap. 1.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
12/124
L'INTUlTION COMMJ! MtTHODB 9force... Ce n'est pas du plus, mais du moins; c'est undficit du vouloir :. (1). - y a-t-il contradiction entreles deux formules, o le non-!tre est tantt prsent6comme un plus par rapport l'tre, tantt comme unmoins? I l n'y a pas contradiction, si l'on pense que ceque Bergson dnonce dans les problmes (( inexistants D,c'est de toules manires la manie de penser en termesde plus et de moins. L'ide de dsordre apparat quand,au lieu de voir qu'il y a deux ou plusieurs ordres irrductibles (par exemple celui de la vie et celui du mcanisme, l'un tant prsent quand l'autre n'est pas l),on retient seulement une ide gnrale d'ordre, qu'onse contente d'opposer au dsordre et de penser en corrlation avec l'ide de dsordre. L'ide de non-tre apparat quand, au lieu de saisir les ralits diffrentes quise substituent les unes aux autres indfiniment, nous lesconfondons dans l'homognit d'un ~ t r e en gnral,qui ne peut plus que s'opposer au nant, se rapporterau nant. L'ide de possible apparat quand, au lieu desaisir chaque existant dans sa nouveaut, on rapportel'ensemble de l'existence un lment prform donttout serait cens sortir par simple ralisation J .Bref, chaque fois qu'on pense en termes de plus oude moins, on a dj nglig les diffrences de natureentre les deux ordres, ou entre les tres, entre les existants. Par l, 011 f)oit comment le premie-r type de fauxproblh7les repose en dernire instance sur le second : l'idede dsordre nat d'une ide gnrale d'ordre commemixte mal analys, etc. Et peut-tre est-ce le tort leplus gnral de la pense, le tort commun de la scienceet de la mtaphysique, de tout concevoir en termes de
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
13/124
10 LB BERGSONISME
plus et de moins, et de ne voir que des diffrences dedegr, ou des diffrences d'intensit, l o plus profondment i l y a des diffrences de nature.Nous sommes donc en proie une illusion fondamentale, correspondant aux deux aspects du faux problme. La notion mme de faux problme impliqueen effet que nous n'avons pas lutter contre de simpleserreurs (fausses solutions), mais contre quelque chosede plus profond illusion qui nous entrane, ou danslaquelle nous baignons, insparable de notre condition.Mirage, comme dit Bergson propos de la rtrojectiondu possible .Bergson emprunte une ide de Kant, quitte la transformer tout fait c'est Kant qui montraitque la raison au plus profond d'elle-mme engendre,non pas des erreurs, mais des illusions inf!itables, donton pouvait seulement conjurer l'effet. Bien que Bergsondtermine tout autrement la nature des faux problmes,bien que la critique kantienne lui paraisse elle-mmeun ensemble de problmes mal poss, il traite l'illusiond'une manire analogue celle de Kant. L'illusion estfonde au plus profond de l'intelligence, elle n'est pas proprement parler dissipe ni dissipable, mais peut seulement tre refoule (1). Nous avons tendance penser entermes de plus et de moins, c'est--dire voir des diffrences de degr l oi l ya des diffrences de nature. Contrecette tendance intellectuelle, nous ne pouvons ragirqu'en suscitant, dom l'intelligence encore, une autretendance, critique. Mais prcisment d'o vient cetteseconde tendance? Seule l'intuition peut la susciteret l'animer, parce qu'elle retrouve les diffrences denature sous les diffrences de degr, et communique
(1) Cf. une note trs importante dans PM, 1306, 68.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
14/124
L'INTUITION COMME MTHODE II l'intelligence les critres qui permettent de distinguerles vrais problmes et les faux. Bergson montre bienque l'intelligence est la facult qui pose les problmesen gnral (l'instinct serait plutt une facult de trouverdes solutions) (1). Mais seule l'intuition dcide du vraiet du faux dans les problmes poss, quitte pousserl'intelligence se retourner contre elle-mme.
*. ..DEUXIME RGLE Lutter contre l'illusion, retrOUfJer
les waies diffrences de nature ou les articulations durel (2).Clbres sont les dualismes bergsoniens dure-espace, qualit-quantit, htrogne-homogne, continudiscontinu, les deux multiplicits, mmoire-matire,souvenir-perception, contraction-dtente, instinct-intelligence, les deux sources, etc. Mme les titres queBergson place au-dessus de chaque page de ses livrestmoignent de son got pour les dualismes - qui neforment pourtant pas le dernier mot de sa philosophie.Quel est donc leur sens ? Il s'agit toujours, selon Bergson,de diviser un mixte suivant ses articulations naturelles,c'est--dire en lments qui diffrent en nature. L'intui-tion comme mthode est une mthode de division,d'esprit platonicien. Bergson n'ignore pas que les chosesse mlangent en ralit, en fait; l'exprience elle-mme
(1) BC, 623, 152.(2) Le. d i f J ~ r e n c e s de Dature ou les articulatioD' du rh l IOnt destermes, et des thm.es CODStllntB dans la philolOphie de Bergson :cf. notamment l'lDtroductioa de PM, passim. C'est en ce Beni 'Ju'onpeut parler d'un platonisme de BeralOD (mWlode de diviuoD);il aime citer un texte de Platon, sur le d ~ u p a a e et le bon cuisinier.Cf. BC. 627. 157.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
15/124
LB BERGSONISMB
ne nous livre que des mixtes. Mais le mal n'est pas l.Par exemple, nous nous faisons du temps une reprsentation pntre d'espace. Ce qui est fcheux, c'est quenous ne savons plus distinguer dans cette reprsentationles deux lments composants qui diffrent en nature,les deux pures prsences de la dure et de l'tendue.Nous mlangeons si bien l'tendue et la dure que nousne pouvons plus opposer leur mlange qu' un principesuppos la fois non spatial et non temporel, par rapportauquel espace et temps, dure et tendue, ne sont plusque des dgradations (1). Par exemple encore, nousmlangeons souvenir et perception; mais nous ne savonspas reconnatre ce qui revient la perception et ce quirevient au souvenir, nous ne distinguons plus dans lareprsentation les deux prsences pures de la matireet de la mmoire, et nous ne voyons plus que des diff-rences de degr entre des perceptions-souvenirs et dessouvenirs-perceptions. Bref, nous mesurons les mlangesavec une unit elle-mme impure et dj mlange.Nous avons perdu la raison des mixtes. L'obsessiondu pur chez Bergson revient cette restauration desdiffrences de nature. Seul ce qui diffre en nature peutue dit pur, mais seules des tendances diffrent ennature (2). Il s'agit donc de diviser le mixte d'aprs destendances qualitatives et qualifies, c'est--dire d'aprsla manire dont i l combine la dure et l'tendue dfiniescomme mouvements, directions de mouvements (ainsila dure-conuaction et la matire-dtente). L'intuitioncomme mthode de division n'est pas sans ressemblance
(1) EC, 764. 318.(z) Par exemple: .ur l'intelligence l'instinct qui composent uamixte dont on ne peut dissocier, l ' ~ t a t pur, que des tendances.d. Ee, 610. 137.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
16/124
L'INTUITION COMME M ~ T H O D B 13
encore avec une analyse transcendantale : si le mixtereprsente le fait, il faut le diviser en tendances ou enpures prsences qui n'existent qu'en droit (1). On dpassel'exprience vers des conditions de l'exprience (maiscelles-ci ne sont pas, la manire kantienne, les conditions de toute exprience possible, ce sont les conditionsde l'exprience relle).
Tel est le leitmotiv bergsonien : on n'a vu que desdiffrences de degr l o i l y avait des diffrences denature. Et sous ce chef, Bergson groupe ses critiquesprincipales les plus diverses. A la mtaphysique, i lreprochera essentiellement de n'avoir vu que des diffrences de degr entre un temps spatialis et une ternitsuppose premire (le temps comme dgradation, dtenteou diminution d'tre .. ) : tous les tres sont dfinisdans une chelle d'intensit, entre les deux limitesd'une perfection et d'un nant. Mais la science, i l feraun reproche analogue; et il n'y a pas d'autre dfinitiondu micanisme que celle qui invoque encore un tempsspatialis, conformment auquel les tres ne prsententplus que des diffrences de degr, de position, de dimension, de proportion. Il y a du mcanisme jusque dansl'volutionnisme, dans la mesure o celui-ci postuleune volution unilinaire, et nous fait passer d'uneorganisation vivante une autre par simples intermdiaires, transitions et variations de degr. Dans cetteignorance des vraies diffrences de nature, apparattoute la source des faux problmes et des illusions quinous accablent ds le premier chapitre de Matire etMmoire, Bergson montre comment l'oubli des ditf-
(1) Sur l'opposition. en fait-en droit " cf. MM, chap. 1 (notamment 213, 68). - Et sur la distinction 1 p r ~ s e n c c - r e p r s e n t a t i o n ' .lBS. 32.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
17/124
14 LB BERGSONISMErences de nature, d'une part entre la perception etl'affection, d'autre part entre la perception et le souvenir,engendre toutes sones de faux problmes, en nousfaisant croire un caractre inexrensif de notre percep-tion : On trouverait, dans cette ide que nous projetons hors de nous des tats purement internes, tant demalentendus, tant de rponses boiteuses des questionsmal poses ... Il (1).
Nul texte autant que ce premier chapitre de Matireet Mmoire ne montre la complexit du maniement del'intuition comme mthode de division. Il s'agit dediviser la reprsentation en lments qui la conditionnent,en pures prsences ou en tendances qui diffrent ennature. Comment Bergson procde-t-il? Il demanded'abord entre quoi et quoi i l peut (ou ne peut pas) yavoir diffrence de nature. La premire rponse est que,le cerveau tant une image parmi d'autres images,ou assurant certains mouvements parmi d'autres mouvements, il ne peut pas y avoir de diffrence de natureentre ]a facult dite perceptive du cerveau et les fonctions rflexes de la moelle. Le cerveau ne fabriquedonc pas des reprsentations, mais complique seulement le rappon entre un mouvement recueilli (excitation)et un mouvement excut ( rponse). Entre les deux,il tablit un can, soit qu'il divise l'infini le mouvementreu, soit qu'il le prolonge en une pluralit de ractionspossibles. Que des souvenirs profitent de cet can,qu'ils s'intercalent I l proprement parler, cela nechange rien. Nous pouvons pour le moment les liminercomme participant d'une autre ligne I l. Sur la ligne quenous sommes en train de tracer, nous n'avons, nous ne
(1) MM. 197. 47.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
18/124
L'INTUITION COMME MjTHODE ISpouvons avoir que de la matire et du mouvement, dumouvement plus ou moins compliqu, plus ou moinsrewd. Toute la question est de savoir si, par l m&ne,nous n'avons pas dj aussi la perception. En venude l'cart crbral, en effet, un tre peut ne retenird'un objet matriel, et des actions qui en manent, quece qui l'intresse (1). Si bien que la perception n'estpas l'objet plus quelque chose, mais l'objet moins quelquechose, moins tout ce qui ne nous intresse pas. Autantdire que l'objet lui-mme se confond avec une perception pure virtuelle, en mme temps que notre perceptionrelle se confond avec l'objet, dont elle soustrait seulement ce qui ne nous intresse pas. D'o la thse clbrede Bergson, dont nous aurons analyser toutes lesconsquences nous percevons les choses l o ellessont, la perception nous met d'emble dans la matire,est impersonnelle et concide avec l'objet peru. Surcette ligne, toute la mthode bergsonienne a consist chercher d'abord les termes entre lesquels i l ne pOU'OOitpas Y avoir diffrence de nature : i l ne peut pas y avoirdiffrence de nature, mais seulement diffrence de degr,entre la facult du cerveau et la fonction de la moelle,entre la perception de la matire et la matire elle-mme.Alors nous sommes en mesure de tracer la secondeligne, celle qui diffre en nature de la premire. Pourtablir la premire, nous avions besoin de fictionsnous supposions que le corps tait comme un pur pointmathmatique dans l'espace, un pur instant, ou une
(1) MM, 186, 33 : Si les tres vivants constituent dans l'universdes 1 centres d'indtermination " et si le degr de cette indtermination se mesure au nombre ct J'lvation de lcun fonctions, onconoit que leur seule prtscnce puisse quivaloir la suppressionde toutes les parties des objets Buxquclles leurs fonctions ne IOntpas intcssm.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
19/124
16 LB BBRGSONlSMl!succession d'instants dans le temps. Mais ces fictionsn'taient pas de simples hypothses elles consistaient pousser au-de1l de l'exprience une direction prlevsur l'e%prience elle-mbne; c'est seulement ainsi quenous pouvions dgager tout un ct des conditions del'exprience. Reste nous demander maintenant ce quivient remplir l'cart crbral, ce qui en profite pours'incarner. La rponse de Bergson sera triple. C'estd'abord l'affectivit, qui suppose prcisment que lecorps soit autre chose qu'un point mathmatique, etlui donne un volume dans l'espace. Ensuite, ce sont lessouvenirs de la mmoire, qui relient les instants les unsam:: autres et intercalent le pass dans le p r ~ t . Enfin,c'est encore la mmoire sous une autre forme, sousforme d'une contraction de la matire qui fait surgirla qualit. (C'est donc la mmoire qui fait que le corpsest autre chose qu'instantan, et lui donne une duriedans le temps.) Nous voil lors en prsence d'unenouvelle ligne, c:elle de la subjectivit, oil s'chelonnentaffectivit, mmoire-souvenir, mmoire-contractionon dira de ces termes qu'ils different en nature avec ceuxde la ligne prcdente (perception-objet-matire) (1).Bref, la reprsentation en gnral se divise en deuxdirections qui diffrent en nature, en deux pures prsences qui ne se laissent pas reprsenter celle de laperception qui nous met d'embUe dans la matire, cellede la mmoire qui nous met d'emble dans l'esprit.
(1) Il n'est pas nessaire que la l ipe soit entimment homogne,ce peut tre une ligne b r i ~ . Ainsi l ' . f f c c t i v i t ~ se distingue en naturede la perception, mais non pas de la mme manire que la m ~ m o i r e :alon qu'une Manoire pur, s'oppose la perception pure. l ' a f f e c t i v i t ~ est plutt comme une impure qw trouble la perception (cf.MM, 2CY7. 60). Noua verrons plus tard comment l'affectfvi, lam ~ m o i r e , etc., d ~ s i g n e n t des aspects trs divers de la l I u b l e c t i v i t ~ .
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
20/124
L'INTUITION COMME MTHODE 17Que les deux lignes se renconuent et se mlangent,encore une fois, ce n'est pas la question. Ce mlangeest notre exprience mme, notre reprsentation. Maistous nos faux problmes viennent de ce que nous nesavons pas dpasser l'exprience vers les conditionsde l'exprience, vers les articulations du rel, et retrouverce qui di1fre en nature dans les mixtes qui nous sontdonns, et dont nous vivons. Perception et souvenirse pntrent toujours, changent toujours quelque chosede leurs substances par un phnomne d'endosmose.Le rle du psychologue serait de les dissocier, de rendre chacun sa puret naturelle; ainsi s'clairciraient bonnombre de difficults que soulve la psychologie, etpeut-tre aussi ]a mtaphysique. Mais point du tout. Onveut que ces tats mixtes, tous composs, doses ingales,de perception pure et de souvenir pur, soient des tatssimples. Par l on se condamne ignorer aussi bien lesouvenir pur que la perception pure, ne plus connauequ'un seul genre de phnomme, qu'on appellera tanttsouvenir et tantt perception selon que prdominera enlui l'un ou l'auue de ces deux aspects, et par consquent ne trouver entre la perception et le souvenirqu'une diffrence de degr, ct non plus de nature D (1).L'intuition nous enttaine dpasser l'tat de l'exprience vers des conditions de l'exprience. Mais cesconditions ne sont pas gnrales ni abstraites, elles nesont pas plus larges que le conditionn, ce sont lesCOnditiODS de l'expmencc relle. Bergson parle d'allerchercher l'exprience sa source, ou plutt au-dessusde ce tOU17llJ1lt dcisif o, s'inflchissant dans Je sensde noue utilit, elle devient proprement l'exprience
(1) MM. 214. 69.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
21/124
18 LB BERGSONISMB
humains D (1). Au-dessus du tournant, c'est prcismentle point o l'on dcouvre enfin les diffrences de nature.Mais i l y a tant de difficults atteindre ce point focalqu'on doit multiplier les actes de l'intuition, en apparence contradictoires. C'est ainsi que Bergson nous parletantt d'un mouvement exactement appropri l'exprience, tantt d'un largissement, tantt d'un serrageet d'un resserrement. C'est que, d'abord, la dtermination de chaque ligne D implique une sone de contraction, o des faits en apparence divers se trouvent groupssuivant leurs adinits naturelles, serrs d'aprs leurarticulation. Mais, d'autre pan, nous poussons chaqueligne au-del du tournant, jusqu'au point o elle dpassenotre exprience prodigieux largissement qui nousforce penser une perception pure identique toutela matire, une mmoire pure identique la totalit dupass. C'est en ce sens que Bergson compare, plusieursreprises, la dmarche de la philosophie au procd ducalcul infinitsimal: quand on a profit dans l'exprienced'une petite lueur qui nous signale une ligne d'articulation, i l reste la prolonger jusqu'en dehors de l'exprience - tout comme les mathmaticiens reconstituent,avec les lments infiniment petits qu'ils aperoiventde la courbe relle, (1 la forme de la courbe mme quis'tend dans l'obscurit derrire eux D (2). De toutes
(1 ) MM, 321, ZOS.(2) Mt.t, 3%1, 206. - Bergson semble souvent critiquer l'analyseinfinitsimale: celle-ci a beau rduire l'infini les intervalles qu'eUeconsidre, elle se contente encore de recomposer le mouvement avecl'espace parcouru (par exemple DI, 79-80, 89). Mais plus profondment, Bergson exige que la mtaphysique, pour son compte, fasseune rvolution a n a l o K u ~ celle du calcul en science : d. Be, 773-786, 329-344. Et la mtaphysique doit mme l'inspirer de l'idegnmtrice de notre mathmatique " pout oprer des diffrenciation. et des intqrations qualitatives. (PM, 14z3, 215).
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
22/124
L'INTUITION COMME MtrHODE 19manires, Bergson n'est pas de ces philosophes quiassignent la philosophie une sagesse et un quilibreproprement humains. Nous ouvrir l'inhumain et ausurhumain (des dUTes infrieures ou suprieures lantre .. ), dpasser la condition humaine, tel est le sensde la philosophie, pour autant que notre condition nouscondamne vivre parmi les mixtes mal analyss, et A!tre nous-mme un mixte mal analys (1).Mais cet largissement, ou mme ce dpassement,ne consiste pas dpasser l'exprience vers des concepts.Car des concepts dfinissent seulement, la manirekantienne, les conditions de toute exprience possibleen gnral. Ici, au contraire, il s'agit de l'expriencerelle dans toutes ses particularits. Et s'il faut l'largir,et mme la dpasser, c'est seulement pour trouver lesarticulations dont ces particularits dpendent. Si bienque les conditions de l'exprience sont moins dterminesdans des concepts que dans des percepts purs (2). Etsi ces percepts se runissent eux-mmes en un concept,c'est un concept taill sur la chose mme, qui ne convientqu' elle, et qui, en cc sens, n'est pas plus large quece dont i l doit rendre compte. Car lorsque nous avonssuivi les IX lignes Il , chacune au-del du tournant del'exprience, i l faut aussi retrouver le point o elles serecoupent, o Jes directions se croisent, et o les tendances qui diffrent en nature se renouent pour engendrer la chose teUe que nous la connaissons. On dira querien n'est plus facile, et que l'exprience mme nous
(1) Cf. PM, 1416, 206. - El 142S. zI8 : La philosophie devraiteue un etrorl pour d ~ p a s s e r la condition humaine 1 . (Le texle p r ~ c ~ -demment c i t ~ , sur 1. tournant de l'",plrimee, est le conuncntaire decette formule.)(z) PM, 1370, 148-149.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
23/124
20 LB BBRGSONISMB
donnait dj ce point. Ce n'est pas si simple. Aprsavoir suivi des lignes de divergence au-tl du toumant,i l faut que ces lignes se recoupent, non pas au pointd'o nous tions partis, mais plutt en un point virtuel,en une image virtuelle du point de dpart, elle-mmesitue au-del du tournant de l'exprience, et qui nousdonne enfin la raison suffisante de la chose, la raisonsuffisante du mixte, la raison suffisante du point dedpan. Si bien que l'expression C( au-dessus du tournantdcisif a deux sens: elle dsigne d'abord le momento les lignes, partant d'un point commun confus donndans l'exprience, divergent de plus en plus conformment aux vraies diffrences de nature; puis elledsigne un autre moment o ces lignes convergent lnouveau, pour nous donner cette fois l'image virtuelleou la raison distincte du point commun. Tournant etretournement. Le dualisme n'est donc qu'un moment,qui doit aboutir la re-formation d'un monisme. C'estpourquoi, aprs l'largissement, survient un dernierresserrement, comme aprs la diffrenciation, l'intgration. Nous parlions jadis de ces lignes de faits dontchacune ne fournit que la direction de la vrit parcequ'elle ne va pas assez loin: en prolongeant deux d'entreelles jusqu'au point o elles se coupent, on arriverapourtant la vrit mme... nous estimons que cettemthode de recoupement est la seule qui puisse faireavancer dfinitivement la mtaphysique (1). n y adonc comme deux tournants successifs de l'exprience,en sens inverse : ils constituent ce que Bergson appellela prcision en philosophie.D'o, une RGLE COMPLMENTAIRE de la seconde rigl, :
(1) MR, 1186, 263.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
24/124
L'INTUITION COMMB .THODB 21
Le rel n'est pas seulement ce qui se dcoupe suint tsarticulatimu naturel u ou des diffrencu t nature, i ll i t awsi ce qui se recoupe, SUfJant des fJOe. convergeantfJers un rnhne point idal ou tJirtuel.
Cette rgle a pour fonction particulire de montrercomment un problme, tant bien pos, tend par luimeme sc rsoudre. Par exemple, toujoun dans lepremier chapitre de MatiAre et Mmoire, nous posonsbien le problme de la mmoire, lorsque, partant dumixte souvenir-perception, nous divisons ce mixte endeux directions divergentes et dilates, qui correspondent une vraie diffrence de nature entre l'Ame et le corps,l'esprit et la matire. Mais la solution du problme, nousne l'obtenons que par resserrement : lorsque noussaisissons le point original o les deux directions divergentes convergent nouveau, le point prcis o Jesouvenir s'insre dans la perception, le point virtuelqui est comme la rflexion et la raison du point de dpart.Ainsi le problme de l'Ame et du corps, de la matireet de l'esprit ne se rsout que par un extrme resserrement, o Bergson montre comment la ligne de l'objectivit et celle de la subjectivit, la ligne de l'observationexterne et celle de l'exprience interne, doivent converger l'issue de leun processus di1frents, jusqu'aucas de l'aphasie (1).Bergson montre demme que le problme de l'immortalit de l'Ame tend se rsoudre par la convergence dedeux lignes trs diffrentes prcisment celle d'uneexprience de la mmoire; et celle d'une tout autreexprience, mystique (2). Plus complexes encore, les
(1) PM, 1315. 80.(2) MR. 1199-1200, 280-281.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
25/124
22 LB BERGSONISMB
problmes qui se dnouent au point de convergence detrois lignes de faits : telle la nature de la conscience dansle premier chapitre de L'nergie spirituelle. On remarquera que cene mthode de recoupement forme unvritable probabilisme chaque ligne dfinit une probabilit (1). Mais il s'agit d'un probabilisme qualitatif,les lignes de fait tant qualitativement distinctes. Dansleur divergence, dans la dsaniculation du rel qu'ellesopraient suivant les diffrences de nature, elles constituaient dj un empirisme suprieur, apte poser lesproblmes, et dpasser l'exprience vers ses conditionsconcrtes. Dans leur convergence, dans le recoupementdu rel auquel elles procdent, elles dfinissent maintenant un probabilisme suprieur, apte rsoudre lesproblmes, et rapponer la condition sur le conditionn,si bien que nulle distance ne demeure.
*TROISIW dGLI! : Poser les problhnn, et les rsoudre,en fonction du temps plutt que de l'espace (2).Cene rgle donne le sens fondamental Il de l'intuition:l'intuition suppose la dure, elle consiste penser entermes de dure (3). Nous ne pouvons le comprendrequ'en revenant au mouvement de la division dterminantles diffrences de nature. Il semblerait premire vue
qu'une diffrence de nature s'tablit entre deux choses,ou plutt entre deux tendances. C'est vrai, mais ce n'est(1) ES. 8r7-818. 4; 83S. 27.(z) Cf. MM. zI8, 74 : Les questions relativesau sujet et l'objet, leur distinction et lrur union, doivent se poser en fonction dutemps plutt que de l'espace (3) PM. 1275. ]0 .
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
26/124
L'INTUInON COMMI! MmODI ! 23vrai que superficiellement. Considrons la divisionbergsonienne principale la d u r ~ e et l'espace. Toutesles autres divisions, tous les autres dualismes l'impliquent,en d ~ r i v e n t ou y aboutissent. Or, on ne peut se contenterd'affirmer simplement une diffrence de nature entre laduree et l'espace. La division se fait entre la dure, qui1 tend pour son compte assumer ou poner toutes lesdiffrences de nature (puisqu'elle est doue du pouvoirde varler qualitativement avec soi), et l'espace qui neprsente jamais que des diffrences de degr (puisqu'ilest homognit quantitative). Il n'y a donc pas diffrence de nature entre les deux moitis de la division jla diffrence de nature est tout entire d'un ct. Quandnous divisons quelque chose suivant ses articulationsnaturelles, nous avons, avec des proportions et desfigures trs variables selon le cas : d'une part, le ctespace, par lequel la chose ne peut jamais diffrer qu'endegre des autres choses, , t d'elle-mime (augmentation,diminution) j d'autre part, le ct dure, par lequel lachose diffre en nature de toutes les autres et d'ellemme (altration).Soit un morceau de sucre i l a une configurationspatiale, mais sous cet aspect, nous ne saisirons jamaisque des diffrences de degr entre ce sucre et touteautre chose. Mais i l a aussi une dure, un rythme dedure, une manire d'tre au temps, qui se rvle aumoins en panie dans Je processus de sa dissolution, etqui montre comment ce sucre diffre en nature nonseulement des autres choses, mais d'abord et sunoutde lui-mme. Cette altration qui ne rait qu'un avecl'essence ou la substance d'une chose, c'est elle que noussaisissons, quand nous la pensons en termes de Dure.A cet ~ g a r d , la fameuse formule de Bergson Cf je dois
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
27/124
LB BBRGSONISMB
attendre que le sucre fonde a un sens encore plus largeque le contexte ne lui prte (1). Elle signifie que mapropre dure, telle que je la vis par exemple dansl'impatience de mes attentes, sen de rvlateur d'auttesdures qui battent sur d'autres rythmes, qui diffrenten nature de la mienne. Et toujours la dure est le Heuet le milieu des diffrences de nature, elle en est mmel'ensemble et la multiplicit, i l n'y a de diffrences denature que dans la dure - tandis que J'espace n'est quele lieu, le milieu, l'ensemble des diffrences de degr.Peut-tre avons-nous le moyen de rsoudre la question mthodologique la plus gnrale. Quand Platonlaborait sa mthode de la division, lui aussi se proposaitde diviser un mixte en deux moitis, ou suivant plusieurs lignes. Mais tout le problme tait de savoircomment l'on choisissait la bonne moiti pourquoice que nous cherchions tait-il de tel ct plutt que del'autre ? On pouvait donc reprocher la division dene pas tre une vritable mthode, puisqu'elle manquaitde cc moyen terme et dpendait encore d'une inspiration. n semble que, dans le bergsonisme, la difficultdisparaisse. Car en divisant le mixte suivant deux tendances, dont l'une seule prsente la manire dont unechose varie qualitativement dans le temps, Bergson sedonne effectivement le moyen de choisir dans chaquecas le bon ct D, celui de l'essence. Bref, l'intuitionest devenue mthode, ou plutt la mthode s'est rconcilie avec l'immdiat. L'intuition n'est pas la duremme. L'intuition est plutt le mouvement par lequelnous sortons de notre propre dure, par lequel nous
(1) EC, S02, la. - Dans le contexte, Bergson ne prte au sucreune dur" que dans la mesure o il participe l'ensemble de l'univers.Nous verrons plus loin le sens de cette restriction : cf. chap. IV.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
28/124
L'INTUITION COMME MmODE 25
nous servons de notre dure pour affirmer et reconnatreimmdiatement l'existence d'autres dures, au-desstUou au-dessous de nous. Seule la mthode dont notUparlons permet de dpasser J'idalisme atUsi bien quele ralisme, d'affirmer l'existence d'objets iIrieurs etsuprieurs nous, quoique cependant, en un certainsens, intrieurs nous... On aperoit des dures aussinombreuses qu'on voudra, toutes trs diffrentes lesunes des autres l i (en effet, les mots infrieur et suprieurne doivent pas nous abuser, et dsignent des diffrencesde nature) (1). Sans l'intuition comme mthode, ladure resterait une simple exprience psychologique.Inversement, sans sa concidence avec la dure, l'intuition ne serait pas capable de raliser le programmecorrespondant aux rgles prcdentes : la dterminationdes vrais problmes ou des vritables diffrences denature ..Revenons donc l'illusion des faux problmes. D'ovient-elle, et en quel sens est-elle invitable ? Bergsonmet en cause l'ordre des besoins, de l'action et de lasocit, qui nous incline ne retenir des choses que cequi nous intresse; J'ordre de l'intelligence, dans sonaffinit naturelle avec l'espace; l'ordre des ides gnrales, qui vient recouvrir les diffrences de nature. Ouplutt i l y a des ides gnroles trs diverses, qui diffrentelles-mmes en nature, les unes renvoyant des ressemblances objectives dans les corps vivants, les autres, des identits objectives dans les corps inanims, lesautres enfin, des exigences subjectives dans les objetsfabriqus; mais nous sommes prompts former uneide gnrale de toutes les ides gnrales, et faire
(1) PM, 1416-1417, 206-208.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
29/124
LE BERGSONISME
fondre les diffrences de natw"e dans cet lment degnralit (1). - I l Nous faisons fondre les diffrencesqualitatives dans l'homognit de l'espace qui les soustend (2). Il est vrai que cet ensemble de raisons estencore psychologique, insparable de notre condition.Nous devons tenir compte de raisons plus profondes.Car si l'ide d'un espace homogne implique une sotted'artifice ou de symbole qui nous spare de la ralit,i l n'en reste pas moins que la matire et l'tendue sontdes ralits, qui prfigurent elles-mmes l'ordre del'espace. Illusion, l'espace n'est pas seulement fonddans notre nature, mais dans la nature des choses.La matire est effectivement le ct D par lequel leschoses tendent ne prsenter entre elles, et Il ne nousprsenter, que des diffrences de degr. L'expriencenous donne des mixtes; or l'tat du mixte ne consistepas seulement runir des lments qui diffrent ennature, mais les runir dans des conditions telles qu'onne peut pas saisir en lui ces diffrences de nature constituantes. Bref, i l y a un point de vue, bien plus un tatde choses o les diffrences de nature ne peuvent plusapparatre. Le moutIement rtrograde du vrai n'est passeulement une illusion sur le vrai, mais appartient auvrai lui-mme. Divisant le mixte religion en deuxdirections, religion statique et religion dynamique,Bergson ajoute: en se plaant d'un certain point de vue,1( on apercevrait une srie de transitions et comme desdiffrences de degr, l o rellement il y a une diffrence radicale de nature JI (3).L'illusion, donc, ne tient pas seulement notre nature,
(1) P/I,I, 129-81303, s8-64-(2) EC, 679, 217.(3) MR, IIS6, :22S.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
30/124
L'INTUITION COMME MTHODE 27mais au monde que nous habitons, au ct de J'tre quinous apparatt d'abord. Du dbut la fin de son uvre,Bergson a volu d'une cenaine manire. Les deuxpoints principaux de son volution sont les suivantsla dure lui parut de moins en moins rductible uneexprience psychologique, pour devenir l'essence va-riable des choses et fournir le thme d'une ontologiecomplexe. Mais d'autre pan, en mme temps, l'espacelui semblait de moins en moins rductible une fictionnous sparant de cette ralit psychologique, pour tre,lui aussi, fond dans l'tre et exprimer un de ses deuxversants, une de ses deux directions. L'absolu, diraBergson, a deux cts, l'esprit pntr par la mtaphy-sique, la matire connue par la science (1). Mais pr-cisment la science n'est pas une connaissance relative,une discipline symbolique qui se recommande seule-ment par ses russites ou son efficacit; la science estde l'ontologie, c'est une des deux moitis de l'ontologie.L'Absolu est diffrence, mais la diffrence a deux visages,diffrences de degr et diffrences de nature. Voildonc que, lorsque nous saisissons de simples diffrencesde degr entre les choses, lorsque la science mme nousinvite voir le monde sous cet aspect, nous sommesencore dans un absolu (t la physique moderne nousrvlant de mieux en mieux des diffrences de nombrederrire nos distinctions de qualit .. D) (2). Pourtantc'est une il1usion. Mais c'est seulement une illusiondans la mesure oil nous projetons sur l'autre versantle paysage rel du premier. Si l'illusion peut tre refoule,
CI) cr. PM, 1278 sq 34 sq. (Et 1335. 104 : L'inteUigenee touche1I0rs un des ctn de l'absolu, comme notre conscience en toucbeun autre. . . .(2) PM, 1300. 61.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
31/124
28 LB BBRGSONISMB
c'est en fonction de cet autre versant, celui de la dure,qui nous donne les diffrences de nature corrupandanten dernire instance aux diffrences de proportion tellesqu'elles apparaissent dans l'espace, et dj dans lamatire et l'extension.
*Donc l'intuition forme bien une mthode, avec sestrois (ou ses cinq) rgles. C'est une mthode essentiel-lement problmatisante (critique des faux problmes et
invention des vrais), dif/rendante (dcoupages et recou-pements), tempuralisante (penser en termes de dure).Mais comment l'intuition suppose la dure, commenten revanche elle donne la dure une nouvelle extensiondu point de vue de l'tre et de la connaissance, c'est cequi reste dterminer.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
32/124
CHAPITRE I I
LA DURECOMME
DONNE IMMDIATENous supposons connue la description de la durecomme exprience psychologique, telle qu'elle apparaitdans Les Donnes immdiates et dans les premires pages
de L ' ~ f ) o l u t i o n cratria : i l s'agit d'un passage I l, d'unchangement I l , d'un de'lJenir, mais d'un devenir quidure, d'un changement qui est la substance mme. Onremarquera que Bergson ne trouve aucune difficultdans la conciliation des deux caractres fondamentauxde la dure, continuit et htrognit (1). Mais ainsidfinie, la dure n'est pas seulement exprience vcue,elle est aussi exprience largie, et mme dpasse, djcondition de l'exprience. Car ce que l'exprience donne,c'est toujours un mixte d'espace et de dure. La durepure nous prsente une succession purement interne,sans extriorit; l'espace, une extriorit sans succes-sion (en effet, la mmoire du pass, le souvenir de cequi s'est pass dans l'espace impliquerait dj un esprit(1) Sur ce point, cf. l'cxcellente analyse de A. ROBINET, Bugson
(Seghcn, 1965), pp. 28 sq.o. DELEUZE 2
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
33/124
LB BERGSONISMB
qui dure). Entre les deux se produit un mlange, ol'espace introduit Ja forme de ses distinctions extrinsques ou de ses (/. coupes , homognes et discontinues,tandis que la dure apporte sa succession interne, htrogne et continue. Alors nous sommes capables defi conserver I l les tats instantans de l'espace, et de lesjuxtaposer dans une sorte d' espace auxiliaire I l ; maisaussi nous introduisons dans notre dure des distinctions extrinsques, nous la dcomposons en parties extrieures, et l'alignons dans une sorte de temps homogne.Untel mixte (le temps homogne se confond avecl'espace auxiliaire) doit tre divis. Avant mme qu'ilait pris conscience de l'intuition comme mthode,Bergson se trouve devant la tche de la division dumixte. S'agit-il dj de le diviser suivant deux directionspures? Tant que Bergson ne pose pas explicitementle problme d'une origine ontologique de l'espace, i ls'agit plutt de diviser le mixte cn deux directions,dont l'une seule est pure (la dure), l'autre (l'espace)reprsentant l'impuret qui la dnature (1). La duresera atteinte comme donne immdiate Il, prcismentparce qu'elle se confond avec le ct droit, le bon ctdu mixte.L'important, c'est que la dcomposition du mixtenous rvle deux types de multiplicit 1 . L'une estreprsente par l'espace (ou plutt, si nous tenonscompte de toutes les nuances, par le mlange impur dutemps homogne) c'est une multiplicit d'extriorit,de simultanit, de juxtaposition, d'ordre, de diffren-
(1) Il est vrai que, d ~ s Le; donnJes immidtJttI, Bergson indique lep r o b l ~ m e d'une gense du concept d'e;paCl partir d'une perceponde l ' ~ t c n d u e : cf. 64-6S. 71-72.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
34/124
LA D U R ~ B COMME DONNB I M M ~ D I A T E 31Clatlon quantitative, de diffrence de degr, une multiplicit numrique, discontinue et actuelle. L'autre seprsente dans la dure pure; c'est une multiplicitinterne, de succession, de fusion, d'organisation, d'htrognit, de discrimination qualitative ou de diff-rena de nature, une multiplicit virtuelle et continue,irrductible au nombre (1).
Il nous semble qu'on n'a pas assez attach d'importance l'emploi de ce mot a multiplicit D. Il ne faitnullement partie du vocabulaire traditionnel - surtoutpour dsigner un continuum. Non seulement nous allonsvoir qu'il est essentiel du point de vue de l'laborationde la mthode, mais il nous renseigne dj sur les problmes qui apparaissent dans Les Donnes immdiates,et qui se dvelopperont plus tard. Le mot multiplicit l in'est pas l comme un vague substantif correspondant la notion rhilosophique bien connue du Multiple engnral. En effet, il ne s'agit pas pour Bergson d'opposerle Multiple l'Un, mais au contraire de distinguer deuxtypes de multiplicit. Or, ce problme remonte un savantde gnie, physicien et mathmaticien, Riemann. Riemanndfinissait les choses comme des If multiplicits D dterminables en fonction de leurs dimensions, ou de leursvariables indpendantes. Il distinguait des multiplicitsdiscrtes et des multiplicits continues; les premiresportaient le principe de leur mtrique (la mesure d'une
(1) Dl, chap. II (et chap. III. 101. I22). - Le mixte mal analys,ou la confusion des deux multiplicltts, d ~ f i n i t prtcisment la fausseDotion d'intcnsitt.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
35/124
32 LB BBRGSONISMBde leurs parties tant donne par le nombre des lmentsqu'elles contenaient) - les autres trouvaient un principe mtrique dans autre chose, ne ft-ce que dans lesphnomnes se droulant en elles ou dans les forcesagissant en elles (1). Il est vident que Bergson, entant que philosophe, tait bien au courant des problesgnraux de Riemann. Non seulement son intrt pourles mathmatiques suffirait nous en persuader; maisplus particulirement, Dure et Simultanit est un livreo Bergson confronte sa propre doctrine celle de laRelativit, qui dpend troitement de Riemann. Si notrehypothse est fonde, ce livre mme perd son caractredoublement insolite : car i l ne surgit pas brutalement nisans raison, mais porte au grand jour une confrontationreste jusqu'alors implicite entre l'interprtation riemaDienne et l'interprtation bergsonienne des multiplicitscontinues; d'autre part, si Bergson renonce ce livre, etle dnonce, peut-tre est-ce parce qu'il estime ne paspouvoir poursuivre jusque dans ses implications mathmatiques la thorie des multiplicits. En effet, i l avaitprofondment chang le sens de la distinction riemannienne. Les multiplicits continues lui semblaient appartenir essentiellement au domaine de la dure. Par l,la dure n'tait pas simplement pour Bergson l'indivisible ou le non-mesurable, mais bien plutt ce qui nese divisait qu'en changeant de nature, ce qui ne selaissait mesurer qu'en variant de principe mtrique chaque stade de la division. Bergson ne se contentait
(1) Sur la thorie riemanienne des multiplicits, cf. B. RIlIMANN,uvres maehmatiquu (tr. fr. Gauthier-Villan ~ . , Sur lea hypoth6sesqui IClVCDt de fondement la g o m ~ t r i e .). - Bt H. " 'HL , Tmtp.,Espace, Matih,. - Husserl aussi, bien qu'en un tout autre ICDS queBergson, s'inspire de la thorie riemanienne des multiplicits,
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
36/124
LA DURE COMME DONNE IMMDIATE 33pas d'opposer une vision philosophique de la dure al uneconception scientifique de l'espace, i l portait le problmesur le terrain des deux sones de multipcit, et peDl8itque la multipcit propre la dure avaitpour son compteune cc prcision li aussi grande que celle de la science- bien plus, qu'elle devait ragir sur la science, et luiouvrir une voie qui ne se confondait pas ncessairementavec celle de Riemann et d'Einstein. C'est pourquoinous devons attacher une grande importance al la maniredont Bergson, empruntant la notion de multipcit,en renouvelle la porte et la rpartition.
Comment se dfinit la multiplici qualitative etcontinue de la dure, par opposition la multiplicitquantitative ou numrique? Un texte obscur desDonnes immdiates est d'autant plus significatif cetqard qu'il annonce les dveloppements de Matibeet Mmoire. Il distingue le subjectif et l'objectif: Nousappelons subjectif ce qui parait entirement et adquatement connu, objectif ce qui est connu de telle manirequ'une multitude toujours croissante d'impressionsnouvelles pourrait tre substitue l'ide que nous enavons actuellement l i (1). Si l'on s'en tient ces formules,on risque des contresens, que, heureusement, le contextedissipe. Bergson en effet prcise un objet peut tredivis d'une infinit de manires; or, avant mme queces divisions soient effectues, elles sont saisies par lapense comme possibles sans que rien ne change dansl'aspect total de l'objet. Elles sont donc dj visibles dansl'image de l 'objet: mme non ralises (simplementpossibles), elles sont actuellement perues, du moinsperceptibles en droit. Cette aperception actuelle, et
(1) Dl, S7, 62.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
37/124
34 LB BERGSONISMB
non pas seulement vi rtue])e, de subdivisions dansl'indivis est prcisment ce que nous appelons objee.tivit. J) Bergson veut dire que l'objectif, c'est ce quin'a pas de virtualit - ralis ou non, possible ou rel,tout est actuel dans l'objectif. Le premier chapitre deMatire et Mmoire dveloppera ce thme plus clairement la matire n'a ni virtualit ni puissance cache,c'est pourquoi nous pouvons l'identifier a l'image ;sans doute peut-il y avoir plus dans la matire que dansl'image que nous nous en faisons, mais i l ne peut pasy avoir autre chose, d'une autre nature (1). Et dans unautre texte, Bergson flicite Berkeley d'avoir identificorps et ide, justement parce que la matire I l n'a pasd'intrieur, pas de dessous ... ne cache rien, ne renfermerien ... ne possde ni puissances ni virtualits d'aucuneespce .. est tale en surface et tient tout entire toutinstant dans ce qu'elle donne I l (2).Bref, on appellera objet, objectif, non seulement cequi se divise, mais ce qui ne change pas de nature en sedivisant. C'est donc ce qui se divise par diffrences dedegr (3). Ce qui caractrise l'objet, c'est l'adquationrciproque du divis et des divisions, du nombre et del'unit. L'objet, en ce sens, sera dit une u multiplicitnumrique l l . Car le nombre, et d'abord J'unit arithmtique elle-mme, sont le modle de ce qui se divisesans changer de nature. C'est la mme chose de direque le nombre n'a que des diffrences de degr, ou queses diffrences, ralises ou non, sont toujours actuelles
(1) MM, 218-219. 75-76.(2) PM, 1353, 127.(3) Cf. MM, 341,231 : Tant qu'i1s'agit d'cspace, on peut poulserla division aussi loin qu'on veut; on ne chanac rien ainsi la aaturedc cc qu'on divisc. . . .
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
38/124
LA DURB COMME DONNaS IMMaDlATB 3S
en lui. Les units avec lesquelles l'arithmtique formedes nombres sont des units provisoires, susceptiblesde se morceler indfiniment, et chacune d'elles constitue une somme de quantits fractionnaires, aussi petiteset aussi nombreuses qu'on voudra l'imaginer .. Si toutemultiplicit implique la possibilit de traiter un nombrequelconque comme une unit provisoire qui s'ajoutera elle-mme, inversement les units leur tour sontde vritables nombres, aussi grands qu'on voudra, maisque l'on considre comme provisoirement indcomposables pour les composer entre eux. Or. par celamme que l'on admet la possibilit de diviser l'uniten autant de parties que l'on voudra, on la tient pourtendue (1).Inversement, qu'est-ce qu'une multiplicit qualitative ? Qu'est-ce que le sujet, ou le subjectif? Bergsondonne J'exemple suivant : Un sentiment complexecontiendra un assez grand nombre d'lments plussimples; mais tant que ces lments ne se dgagerontpas avec une nettet parfaite, on ne pourra pas direqu'ils taient entirement raliss, et, ds que la conscience en aura la perception distincte, l'tat psychiquequi rsulte de leur synthse aura par l mme chang (2).(Par exemple un complexe d'amour et de haine s'actualise dans la conscience, mais la haine et l'amour deviennent conscients dans de telles conditions qu'ils diffrenten nature entre eux, et diffrent en nature du complexeinconscient.) Ce serait donc une grande erreur de croireque la dure soit simplement l'indivisible, bien queBergson s'exprime souvent ainsi par commodit. En(1) DI. SS-S6. 60-61.(2) DI. S7. 62.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
39/124
LE BERGSONISME
vrit, la dure se divise, et ne cesse de se diviserc'est pourquoi elle est une mulh"plicit. Mais elle ne sedivise pas sans changer de nature, elle change de natureen se divisant c'est pourquoi elle est une multiplicitnon numrique, o l'on peut, chaque tage de ladivision, parler d'II indivisibles I l. Il Y a autre, sans qu'ily ait plun"eurs; nombre seulement en puissance (1). End'autres termes, le subjectif, ou la dure, c'est le virtuel.Plus prcisment, c'est le virtuel en tant qu'il s'actualise,en train de s'actualiser, insparable du mouvement deson actualisation. Car l'actualisation se fait par diffrenciation, par lignes divergentes, et cre par son mouvement propre autant de diffrences de nature. Toutest actuel dans une multiplicit numrique : tout n'yest pas Il ralis I l , mais tout y est actuel, i l n'y a derapports qu'entre actuels, et de diffrences, que dedegr. Au contraire une multiplicit non numrique,par laquelle se dfinissent la dure ou la subjectivit,plonge dans une autre dimension, purement temporelleet non plus spatiale elle va du virtuel son actualisation, elle s'actualise en crant des lignes de diffrenciation qui correspondent ses diffrences de nature.Une telle multiplicit jouit essentiellement des troisproprits de la continuit, de l'htrognit et de lasimplicit. Et i l n'y a vraiment, ici, aucune difficultpour Bergson concilier l'htrognit et la continuit.
Ce texte des Donnes immdiates, o Bergson distinguele subjectif et l'objectif, nous parat d'autant plusimportant qu'il est le premier introduire indirectementla notion de virtuel, appele prendre une importancede plus en plus grande dans la philosophie bergso-
(1) DI, 81, 90.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
40/124
LA DURE COMME DONNE IMMDIATE 37nienne (1). Car, nous le verrons, le mme auteur quir6cuse le concept de possibilit - lui rservant seulementun usage par rapport lIa matire et aux 1( systnea clos -,mais y voyant toujows la source de toutes sortes defaux problmes - est aussi celui qui porte au plus hautpoint la notion de flirtusl, et fonde sur eUe toute unephilosophie de la mmoire et de la vie.Ce qui est trs important dans la notion de multiplicit, c'est la manire dont elle se distingue d'unethorie de l'Un et du Multiple. La notion de multiplicit nous vite de penser en termes de CI Un et Mul-tiple . Nous connaissons en philosophie beaucoup de
(1) L'objectif en effct se dfinit par des panies qui sont peruesaCt'.Iel1ement, non pas virtuellemmt (DI, 57, 63). Ce qui implique quele subjectif, en revanche. se c:Winit par la virtualit de ses parties.Revenons alors au texte : Nous appelons subjectif ce qui paraltentirement et adquatement connu, objectif ce qui est connu detelle manire qu'une multitude toujours croissante d'impressionsnouvelles pourrait tre substitue l'ide que nous m avons actuellement Prises la lettre, ces dfinitions sont tranges. En vertu ducontexte, on aurait m ~ e mvic de les intervertir. Car n'est-ce pasl'objectif (la matire) qui, tant sans virtualit, a un erre semblableli son c apparaitre et se trouve donc adquatement connu ? Etn'est-ce pas le subjectif qu'on peut toujours diviser en parues d'uneautre oaturc, qu'il ne contenait que virtuellement? 00 aurait presquemvie de croire une faute d'impression. Mais les termes employspar Bergson le justifient d'un autre point de vue. Dans le cas de ladure subjective. les divisions ne valent que pour autant qu'c11elsoot effectues, c'est--dire actualises : Les parties de Dotre durecolncident avec les moments successifs de l'acte qui la divise .. etsi notre conscience ne peut d!ler dans un intervalle qu'un nombredtermin d'actes ancntaires, si elle arrte quelque part la divisioo.l s'arr!te aussi la divisibilit (MM. 341. 2)2). On peut donc direque, chacun de ses niveaux, la division DOUS doooe adquatementla nature indivisible de la chose. Tandis que, dans le ca. de la mati'eobjective, la division o'a meme pas besoin d'tre eft'ectue : noussaVOllI d'avance qu'eIIc est possible sans aucun chaaacmcnt cima lanature de la cbose. En ce sens. s'il est vrai que l'objet ne contientrien d'autre que ce que noul connaissons, nanmoins, il contienttoujours plus (MM, 289, 164) ; i l n'est dooc pas connu adquatemeaL
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
41/124
LE B!RGSONISM!
thories qui combinent l'un et le multiple. Elles onten commun de prtendre recomposer le rel avec desides gnrales. On nous dit : le Moi est un (thse), eti l est multiple (antithse), puis i l est l'unit du multiple(synthse). Ou bien, on nous dit: l'Un est dj multiple,l'Btre passe dans le non-tre, et produit le devenir.Les pages o Bergson dnonce ce mouvement de lapense abstraite font partie des plus belles de son uvre:il a l'impression que, dans une telle mthode dialec-tique, on part de concepts beaucoup trop larges, commede vtements qui flottent (1). L'Un en gnral, lemultiple en gnral, l'tre en gnral, le non-tre engnral... on recompose le rel avec des abstraits;mais que vaut une dialectique qui croit rejoindre lerel quand elle compense l'insuffisance d'un concepttrop large ou trop gnral en faisant appel au conceptoppos, non moins large et gnral ? On ne rejoindrajamais le concret cn combinant l'insuffisance d'unconcept avec l'insuffisance de son oppos; on ne rejointpas le singulier en corrigeant une gnralit par uneautre gnralit. - En tout ceci, Bergson pense videmment Hamelin, dont l'Essai sur [es lments prin-cipaux de la reprsentation date de 1907. Mais aussi,c'est l'incompatibilit du bergsonisme avec l'hglianisme, et mme avec toute mthode dialectique,qui se manifeste dans ces pages. Bergson reproche ladialectique d'tre un faux mouvement, c'est--dire unmouvement du concept abstrait, qui ne va d'un contraire l'autre qu' force d'imprcision (2).
(1) PM, 1408, 19/5-197.( l) Dans des contextes t r ~ s divers, la d ~ n o n c i a t i o n de la dialectique
h i : ~ l i e n n e comme faux mouvement, mouvement abstrait, incomp r ~ h e n s i o n du moU\'cment r ~ e l , est un thme frquent chu Kier-kegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
42/124
LA DURtE COMME DONNtE IMMtDIATB 39Encore une fois, Bergson retrouve des accents platoniciens. Platon, le premier, se moquait de ceux quidisaient : l'Un est multiple, et le multiple, un - l ' ~ t r e
est non-tre, etc. Il demandait dans chaque cas combien,comment, o et quand. Il Quelle unit du multiple, etIl quel D multiple de l'un (1) ? La combinaison desopposs ne nous dit rien, formant un filet si lchequ'elle laisse tout chapper. Aux mtaphores de Platon,que Bergson aime, concernant le dcoupage et le boncuisinier, rpondent celles de Bergson, invoquant lebon tailleur et Je vtement sur mesure. Tel doit trele concept prcis. CI Ce qui importe vritablement laphilosophie, c'est de savoir quelle unit, quelle multiplicit, quelle ralit suprieure J'un et au multipleabstraits est l'unit multiple de la personne... Lesconcepts vont d'ordinaire par couples et reprsententles deux contraires. Il n'est gure de ralit concrtesur laquelle on ne puisse prendre la fois Jes deuxvues opposes et qui ne se subsume, par consquent,aux deux concepts antagonistes. De l une thse et uneantithse qu'on chercherait en vain rconcilier logiquement, pour la raison trs simple que Jamais, avecdt:S concepts, ou points de vue, on ne fera une chose ..Si je cherche analyser la dure, c'est--dire la rsoudreen concepts tout faits, je suis bien oblig, par la naturemme du concept et de l'analyse, de prendre sur ladure en gnral deux vues opposes avec lesquellesje prtendrai ensuite la recomposer. Cette combinaisonne pourra prsenter ni une diversit de degrs ni unevarit de formes elle est ou elle n'est pas. Je dirai,par exemple, qu'il y a d'une pan une multiplicit d'tats
(1) cr. PLATON, Phi/lib,.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
43/124
LB BBRGSONISMB
de conscience successifs et d'autre part, une unitqui les relie. La dure sera la syttthse de cette unitet de cette multiplicit, opration mystrieuse dont onne voit pas, je le rpte, comment elle comporteraitdes nuances ou des degrs (1).Ce que Bergson rclame, contre la dialectique, contreune conception gnrale des contraires (l'Un et leMultiple), c'est une fine perception de la multiplicit,une fine perception du I l quel et du ct combien l i , de cequ'il appelle la ct nuance D ou le nombre en puissance.La dure s'oppose au devenir prcisment parce qu'elleest une multipUcit, un type de multiplicit, qui ne selaisse pas rduire une combinaison trop large o lescontraires, l'Un et le Multiple en gnral, ne concidentqu' condition d'tre saisis au point extrme de leurgnralisation, vids de toute ct mesure Il et de toutesubstance relle. Cette multiplicit qu'est la dure ne seconfond nullement avec le multiple, pas plus que sasimplicit ne se confond avec l'Un.
On distingue souvent deux formes du ngatif le(1) PM. 1409-1116. 197-207. - Ce texte est proche de celui dePlaton, dnonant es facilit6s de la dialectique. Nous avons vu quela m6thode berglOnienne de division 6tait d'inspiration platonicienne. Le point commun de Bergson et de Platon, c'est en effetla recherche d'un proc6d6 capable de d6tenruner dans chaque casla mesure w, le c quel. ou le combien ". Il est vrai que Platon pen-
lait qu'une dialectique aflin6e pouvait IBtistaire l ces exigence Bergson au contraire estime que la dialectique en gn6ral, y compriscelle de Platon, vaut seulement poUl le d6but de la philosophie(et de l'bistoire de la philosophie) : la dialectique passe l c6t6 d'unevraie m6thode de division, elle ne peut faire autrement que dkouperle dei d'aprs des articulations toutes formelles ou verbales. Cf.PM, 1321. 87 : Que la philosophie s'en soit d'abord content6e etqu'elle ait commenc6 par tre dialectique pure, rien de plus naturel.EUe ne disposait pas d'autre chose. Un Platon, un Aristote adoptentle d ~ , o u p a g e de la r ~ a l i t ~ qu'ils trouvent tout fait dans le langage..
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
44/124
LA DORb COMMB DONN IMMDIATE 41
ngatif de simple limitation, et le ngatif d'opposition.Bt l'on usure que la substitution de la seconde forme la premire, avec Kant et les post-kantiens, fut unervolution considrable en philosophie. Il est d'autantplus remarquable que Bergson, dans sa critique dungatif, dnonce galement l'une et l'autre forme.Toutes deux lui semblent s'impliquer, et tmoignerd'une mme insuffisance. Car si l'on considre desnotions ngatives comme celles de dsordre ou de non-Itre, i l revient au mme de les concevoir, partir del'tre et de l'ordre, comme la limite d'une cr dgradation.dans l'intervalle de laquelle toutes les choses sontcomprises (analytiquement), ou bien, en opposition avecl'tre et avec l'ordre, comme des forces exerant leurpuissance et se combinant avec leur oppos pour produire (synthtiquement) toutes choses. Si bien que lacritique de Bergson est double, dnonant dans lesdeux formes du ngatif une mme ignorance des diff-rences de nature, qu'on remplace tantt par des I( dgradations , tantt par des oppositions. L'essentiel duprojet de Bergson, c'est de penser les diffrences denature, indpendamment de toute forme de ngation :i l y a des diffrences dans l'tre, et pourtant rien dengatif. C'est que la ngation implique toujours desconcepts abstraits, beaucoup trop gnraux. Quelle est,en effet, la racine commune de toute ngation ? Nousl'avons vu : au lieu de partir d'une diffrence de natureentre deux ordres, d'une diffrence de nature entredeux tres, on se fait une ide gnrale d'ordre ou d'tre,qu'on ne peut plus penser qu'en opposition avec unnon-tre en gnral, un dsordre en gnral, ou bimqu'on ne peut poser que comme le point de dpart d'unedgradation qui nous mne au dsordre en gnral,
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
45/124
LB BERGSONISMB
au non-tre en gnral. De toutes manires on a n g l i ~ la question des diffrences de nature : 1[ quel ordre,1 quel tre ? De mme on nglige la diffrence denature entre les deux types de multiplicit; alors on sefait une ide gnrale de l'Un, que l'on combine avecson oppos, le Multiple en gnral, pour recomposertoutes choses du point de vue de la force contraire dumultiple ou de la dgradation de l'Un. En vrit, c'estla catgorie de multiplicit, avec la diffrence de naturequ'eUe implique entre deux types, qui nous permet dednoncer la mystification d'une pense qui procde entermes d'Un et de Multiple. On voit donc commenttOU5 les aspects critiques de la philosophie bergsonienneparticipent d'un mme thme: critique du ngatif delimitation, du ngatif d'opposition, des ides gnrales.
* En soumettant l la mme analyse le concept demouvement... D (1). En effet, le mouvement commeexprience physique est lui-mme un mixte d'une
part l'espace parcouru par le mobile, qui forme unemultiplicit numrique indfiniment divisible, donttoutes les parties, relles ou possibles, sont actuelleset ne diffrent qu'en degr; d'autre part le mouvementpur, qui est altration, multiplicit virtuelle qualitative,telle la course d'Achille qui se divise en pas, mais quichange de nature chaque fois qu'elle se divise (2).Bergson dcouvre que, sous le transfert local, i l y a
(r) Dl. 74. 82.(2) Cf. un texte t r ~ s important dans Ee, 757 sq., 310 Iq. : Toutmouvement est a n i c : u l ~ iDtmeurement ". etc.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
46/124
LA DURB COMME DONNE IMMDIATB 43
toujours un transport d'une autre nature. Et ce qui, vudu dehors, apparait comme une partie numriquecomposante de la course n'est, vcu du dedans, qu'unobstacle tourn.Mais en doublant l'exprience psychologique de ladure par l'exprience physique du mouvement, unproblme devient urgent. Du point de vue de l'exprience psychologique, la question Il les choses extrieures durent-elles? D restait indtermine. Aussi bienBergson, dans us Donnes immdiates, invoquait-il deuxfois une inexprimable I l , une incomprhensible Draison. - Qu'existe-t-il de la dure en dehors de nous?Le prsent seulement, ou, si l'on aime mieux, la simultanit. Sans doute les choses extrieures changent,mais leurs moments ne se succdent que pour uneconscience qui se les remmore... Il ne faut pas doncdire que les choses extrieures durent, mais plutt qu'ily a en elles quelque inexprimable raison en vertu delaquelle nous ne saurions les considrer des momentssuccessifs de notre dure sans constater qu'elles ontchang. - cc Si les choses ne durent pas comme nous,i l doit nanmoins y avoir en elles quelque incomprhensible raison qui fasse que les phnomnes paraissent sesuccder, et non pas se dployer tous la fois (1).PourtantUs Donnes immdiates disposaient dj d'uneanalyse du mouvement. Mais le mouvement tait surtoutpos comme un fait de conscience D, impliquant unsujet conscient et durant, se confondant avec la durecomme exprience psychologique. C'est seulement dansla mesure o le mouvement sera saisi comme appartenant aux choses autant qu' la conscience qu'il cessera
(.) DI. 148. 170; et 137. 157.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
47/124
44 LE BERGSONISMEde se confondre avec la dure psychologique, qu'il endplacera plutt le point d'application, et par l, rendrancessaire une participation directe des choses ladure mme. S'il y a des qualits dans les choses nonmoins que dans la conscience, s'il y a un mouvement desqualits hors de moi, il faut que les choses durent leur manire. Il faut que la dure psychologique nesoit qu'un cas bien dtennin, une ouverture sur unedure ontologique. Il faut que l'ontologie soit possible.Car la dure, ds Je dbut, tait dfinie comme unemultiplicit. Cette multiplicit, grce au mouvement,ne va-t-elle pas se confondre avec l'tre lui-mme?Et puisqu'elle est doue de proprits trs spciales,en quel sens dira-t-on qu'il y a plusieurs dures, en quelsens une seule, en quel sens dpassera-t-on l'alternativeontologique un-plusieurs ? Du mme coup, un probJmeconnexe reoit toute son urgence. Si les choses durentou s'il y a de la dure dans les choses, il faudra bienque la question de l'espace soit reprise sur de nouvellesbases. Car l'espace ne sera plus simplement une formed'extriorit, une sone d'cran qui dnature la dure,une impuret qui vient troubler le pur, un relatif quis'oppose l'absolu; il faudra qu'il soit lui-mme fonddans les choses, dans les rapports entre les choses etentre les dures, qu'il appanienne lui aussi l'absolu,qu'il ait sa 1( puret . Telle va tre la double progressionde la philosophie bergsonienne.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
48/124
CHAPITRE III
LA MMOIRECOMMECOEXISTENCE VIRTUELLE
La dure est essentiellement mmoire, conscience,libert. Et elle est conscience et libert, parce qu'elleest d'abord mmoire. Or cette identit de la mmoireavec la dure mme, Bergson la prsente toujours dedeux faons conservation et accumulation du passdans le prsent II . OU bien: (1 soit que le prsent renfermedistinctement l'image sans cesse grandissante du pass,soit plutt qu'il tmoigne, par son continuel changementde qualit, de la charge toujours plus lourde qu'ontrane derrire soi mesure qu'on vieillit davantage JI.OU encore la mmoire sous ces deux formes, en tantqu'elle recouvre d'une nappe de souvenirs un fondde perception immdiate, et en tant aussi qu'ellecontracte une multiplicit de moments I l (I). - Eneffet, on doit exprimer de deux manires la faon dontla dure se distingue d'une srie discontinue d'instantsqui se rpteraient identiques eux-mmes d'une
(1) ES, 818, 5 ; PM, 14II, :lOI; MM, 184. 31. - C'est nous quisoulignons, dans chacun de ces textes. On ne confondra pas cesdeux formes de la mmoire avec celles dont Bergson parle au d ~ b u t du chapitre II de MM (225, 83); ce n'est pas du tout le m ~ m e prin-cipe de distinction. Cf. p. 66, n. 2.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
49/124
LE BERGSONISME
part Il le moment suivant contient toujours en sus duprcdent le souvenir que celui-ci lui a laiss (1) ;d'autre part, les deux moments se contractent ou secondensent l'un dans J'autre, puisque l'un n'a pas encoredisparu quand l'autre parait. Il y a clonc deux mmoires,ou deux aspects de la mmoire indissolublement lis,la mmoire-souvenir et la mmoire-contraction. (Si l'ondemande enfin quelle est la raison de cette dualit dansla dure, sans doute la trouverons-nous dans un mouvement que nous tudierons plus tard, par lequel le prsent" qui dure se divise chaque I l instant endeux directions, l'une oriente et dilate vers le pass,l'autre contracte, se contractant vers l'avenir.)Mais la dure pure est elle-mme le rsultat d'unedivision de CI droit Il . Que la mmoire soit identique ladure, qu'elle soit coextensive la dure, c'est certain,mais cette proposition vaut en droit plus qu'en fait.Le problme particulier de la mmoire est comment,par quel mcanisme la dure devient-elle mmoire enfait? Comment ce qui est en droit s'actualise-t-il ?De mme Bergson montrera que la conscience est,en droit, coextensive la vie; mais comment, dansquelles conditions la vie devient-elle en fait consciencede soi (2) ?
*.. ...Reprenons l'analyse du premier chapitre de Matireet Mmoire. Nous sommes conduits distinguer cinqsens ou cinq aspects de la subjectivit: 1 la subjectivit-besoin, moment de la ngation (le besoin troue la continuit des choses, et retient de l'objet tout ce qui l'int-
(1) PM, 1398, 183.(2) Cf. ES. 820, 8.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
50/124
LA MMOIRE COMME COEXISTENCE VIRTUELLE 47resse, laissant passer le reste) j 2 la subjectivit-ceroeau,moment de l'cart ou de l'indtermination (le cerveaunous donne le moyen de u choisir Il dans l'objet ce quicorrespond nos besoins; introduisant un cart entrele mouvement reu et le mouvement excut, i l estlui-mme choix de deux faons, parce qu'en lui-mme,en venu de ses voies nerveuses, il divise l'infini l'excitation, et aussi parce que, par rapport aux cellulesmotrices de la moelle, il nous laisse le choix entre plusieurs ractions possibles); 3 la subjectivit-affection,moment de la douleur (car l'affection est la ranondu cerveau ou de la perception consciente; la perceptionne rflchit pas l'action possible, le cerveau n'assurepas u l'cart , sans que certaines parties organiques nesoient voues l'immobilit d'un rle purement rceptif,qui les livre la douleur); 4 la subjectivit-souvenir,premier aspect de la mmoire (le souvenir tant ce quivient remplir l'cart, s'incarner ou s'actualiser dansl'intervalle proprement crbral); SO la subjectivitcontraction, deuxime aspect de la mmoire (le corpsn'tant pas plus un instant punctiforme dans le tempsqu'un point mathmatique dans l'espace, et assurant unecontraction des excitations subies, d'o nat la qualit).Or ces cinq aspects ne s'organisent pas seulementdans un ordre de profondeur croissant, mais se distribuent sur deux lignes de faits trs diffrentes. Le premier
chapitre de Matire et Mmoire se propose de dcomposer un mixte (la Reprsentation) en deux directionsdivergentes : matire et mmoire, perception et souvenir, objectif et subjectif - cf. les deux multiplicitsdes Donnes. Sur les cinq aspects de la subjectivit, lesdeux premiers panicipent videmment de la ligneobjective, puisque l'un se contente de soustraire de
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
51/124
LE BERGSONISMB
l'objet, l'autre d'instaurer une zone d'indtermination.Le cas de l'affection, troisime sens, est plus complexe;et sans doute dpend-il du croiscment entre les deuxlignes. Mais son tour la positivit de l'affection n'estpas encore la prsence d'une pure subjectivit quis'opposerait l'objectivit pure, c'est plutt 41 l'impure qui vient troubler celle-ci (1). - Ce qui revient laligne pure de la subjectivit, c'est donc le quatrime,puis le cinquime sens. Seuls les deux aspects de lammoire signifient formellement la subjectivit, lesautres acceptions se contentant de prparer ou d'assurerl'insertion d'une ligne dans l'autre, le croisement d'uneligne avec l'autre.
*. JI.La question o les souvenirs se conservent-ils ?implique un faux problme, c'est--dire un mixte malanalys. On fait comme si les souvenirs avaient se
conserver quelque part, comme si le cerveau par exempletait capable de les conserver. Mais le cerveau est toutentier sur la ligne d'objectivit : i l ne peut avoir aucunediffrence de nature avec les autres tats de la matire ;en lui tout est mouvement, comme dans la perceptionpure qu'il dtermine. (Et encore le terme 11IQUfJementne doit videmment pas s'entendre la manire dumouvement qui dure, mais au contraire d'une coupei n s t a n t a n ~ ) (2). Le souvenir au contraire fait partiede la ligne de subjectivit. Il est absurde de mlangerles deux lignes en concevant le cerveau comme le rservoir ou Je substrat des souvenirs. Bien plus, l'examen
(1) Cf. MM, :z06, S9.(z) MM. z23, 81.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
52/124
LA MMOIRE COMME COBXISTENCE VIRTUELLE 49de la seconde ligne suffirait montrer que les souvenirsn'ont pas se conserver ailleurs que (( dans la dure.C'est donc en soi 'JUS le soU'Oemr se conseroe. " Nous nousaperumes que l'exprience interne l'tat pur, en nousdonnant une substance dont l'essence mme est de dureret par consquent de prolonger sans cesse dans leprsent un pass indestructible, nous et dispens etmme nous et interdit de chercher o le souvenir estconserv. Il se conserve lui-mme .. (1). Nous n'avonsd'ailleurs aucun intrt supposer une conservationdu pass ailleurs qu'en soi, par exemple dans le cerveau;il faudrait que le cerveau, son tour, etlt le pouvoir dese conserver lui-mme; il faudrait que nous confrions un tat de la matire, ou mme Ja matire toutentire, ce pouvoir de conservation que nous aurionsrefus la dure (2).Nous touchons un des aspectS les plus profonds,peut-tre aussi les moins bien compris du bergsonisme :la thorie de la mmoire. Entre la matire et la mmoire,entre la perception pure et le souvenir pur, entre leprsent et le pass, i l doit y avoir une diffrence denature, comme entre les deux lignes prcdemmentdistingues. Si nous avons tant de difficult penserune survivance en soi du pass, c'est que nous croyonsque le pass n'est plus, qu'il a cess d'tre. Nous confondons alors l ' ~ t r e avec l'tre-prsent. Pourtant le prsentn'est pas, i l serait plutt pur devenir, toujours hors desoi. Il n'est pas, mais i l agit. Son lment propre n'estpas l'tre, mais l'actif ou l'utile. Du pass au contraire,il faut dire qu'il a cess d'agir ou d'tre-utile. Mais il
(1) PM, 1315. 80.(z) MM, 290. 165-166.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
53/124
so LB BERGSONISME
n'a pas cess d'tre. Inutile et inactif, impassib1e, i lEST, au sens plein du mot: il se confond avec l'tre ensoi. On ne dira pas qu'il Il tait ", puisqu'il est l'en-soide l'tre, et la forme sous laquelle l'tre se conserve ensoi (par opposition au prsent, forme sous laquellel'tre se consomme et se met hors de soi). A la limite,les dterminations ordinaires s'changent : c'est duprsent qu'il faut dire chaque instant dj qu'il- tait .,et du pass, qu'il - est l, qu'il est ternellement, detout temps. - Telle est la diffrence de nature entrele pass et le prsent (1). Mais ce premier aspect de lathorie bergsonienne perdrait tout sens, si l'on n'ensoulignait pas la porte extra-psychologique. Ce queBergson appelle CI souvenir pur li n'a aucune existencepsychologique. C'est pourquoi il est dit virtuel, inactifet inconscient. Tous ces mots sont dangereux, surtoutinconscient D, qui nous semble depuis Freud insparabled'une existence psychologique singulirement efficaceet active. Nous aurons confronter l'inconscient freudien et l'inconscient bergsonien, puisque Bergson luimme fait le rapprochement (2). Nous devons pourtantcomprendre ds maintenant que Bergson n'emploie pasle mot CI inconscient pour dsigner une ralit psychologique hors de la conscience, mais pour dsigner uneralit non psychologique - l'tre tel qu'il est en soi.
(r) Pounant, dans une autre occasion, Bergson affinnait qu'iln'y a\'ait qu'une d i t r ~ r e n c e de d e g r ~ entre tre et tre utile: en effetla perception ne se distingue de son objet que parce qu'elle en retientseulement ce qui nous est utile (cf. MM, chap, 1) ; i l Y a plus dansl'obiet que dans la paception, mais il n'y a rien qui soit d'une autrenature. - Mais dans ce cas, l'etre est seulement celui de la matireou de l'objet peru, dcnc un icr, priSnJt, qui Il'a pas. le distinguerde l'"til, autrement qu'co degn.(2) PM, 1316, 81.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
54/124
LA MDtOIRB COMME COEXISTENCE VIRTUELLB SI
En toute rigueur, le psychologique, c'est le prsent.Seul le prsent est psychologique l i; mais le pass,c'est l'ontologie pure, le souvenir pur n'a de signification qu'ontologique (1).Citons un texte admirable o Bergson rsume toutesa thorie Lorsque nous cherchons un souvenir quiDOUS chappe, CI nous avons conscience d'un acte suigeneris par lequel nous nous dtachons du prsent pournous replacer d'abord dans le pass en gnral, puisdans une certaine rgion du pass : travail de ttonnement, analogue la mise au point d'un appareil photographique. Mais notre souvenir reste encore l'tatvirtuel ; nous nous disposons simplement ainsi lerecevoir en adoptant l'attitude approprie. Peu peu,i l apparat comme une nbulosit qui se condenserait;de virtuel i l passe l'tat actuel... (2). L encore, uneinterprtation trop psychologique du texte doit trevite. Bergson parle bien d'un acte psychologique;mais si cet acte est sui generis I l , c'est parce qu'il consiste faire un vritable saut. On s'installe d'emble dans lepass, on saute dans le pass comme dans un lmenTpropre (3). De mme que nous ne percevons pas leschoses en nous-mmes, mais l o elles sont, 110US nesaisissons le pass que l o i l est, en lui-mme, et nonpas en nous, dans notre prsent. Il y a donc un passen gnral 1 qui n'est pas le pass particulier de tel ou
(r) Cet aspect est prorondeftt anatys! par M. HTPPOLITE, quid!nonce les interpr!tations psychologistes de Matiire tt Mlmoire:cf. Du bergsonismc A l'existentialisme, Mercurt dt France, juillet 1949 j el Aspects divers de la mmoire chez Bergson, Revue inter-nationale d, philosophie, octobre r949.(2) MM, 276-277, 148.(3) L'expression. d'emble. est frquente dans les chapitres Ilel III de MM.
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
55/124
52 LB BERGSONISMB
tel prsent, mais qui est comme un lment ontologique,un pass ternel et de tout temps, condition pour leu passage de tout prsent particulier. C'est le passen gnral qui rend possibles tous les passs. Nous nousreplaons d'abord, dit Bergson, dans le pass en gnral :ce qu'il dcrit ainsi, c'est le saut dans l'ontologie. Noussautons rellement dans l'tre, dans l'tre en soi, dansl'tre en soi du pass. Il s'agit de sortir de la psychologie.i l s'agit d'une Mmoire immmoriale ou ontologique.C'est seulement ensuite, une fois le saut fait, que lesouvenir va prendre peu peu une existence psychologique: de virtuel i l passe l'tat actuel .. Il Nous avonst le chercher l o i l est, dans I ~ t r e impassible, etnous lui donnons peu peu une incarnation, une psychologisation 1 .
On doit souligner le paralllisme d'autres textes aveccelui-ci. Car Bergson analyse le langage de la mmefaon que la mmoire. La manire dont nous comprenons ce qu'on nous dit est identique celle dont noustrouvons un souvenir. Loin de recomposer le sens partir des sons entendus, et des images associes, nousnous installons d'emble dans l'lment du sens, puisdans une rgion de cet lment. Vritable saut dansl':ntre. C'est seulement ensuite que le sens s'actualisedans les sons physiologiquement perus, comme dansles images psychologiquement associes aux sons. Ily a l comme une transcendance du sens, et un fondement ontologique du langage, qui sont d'autant plusimportants, nous le verrons, chez un auteur qui passepour avoir fait du langage une critique trop sommaire (1).
(1) Cf. MM, 261, 129 : L'auditeur le place d'cmbl!c parmi desi d ~ c s rrespondanta...
-
7/31/2019 Gilles Deleuze - Le Bergsonisme
56/124
LA MiMOIRE COMME COEXISTENCE VIRTUELLB '3Il faut s'installer d'emble dans le pass - en unsaut, en un bond. L encore, cette ide d'un saut presque kierkegaardien est t r a n g ~ chez un philosophe
qui passe pour aimer tant la continuit. Que signifiet-elle? Bergson ne cesse de dire jamais vous nerecomposerez le pass avec des prsents, quels qu'ilssoient - l'image pure et simple ne me reporteraau pass que si c'est en effet dans le pass que je suisall la chercher I l (1). Il est vrai que le pass nous apparatcoinc entre deux prsents, l'ancien prsent qu'il a tet l'actuel prsent par rapport auquel i l est pass. D'odeux fausses c