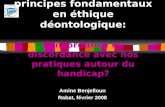Final ethique
-
Upload
gregoire-wallner -
Category
Education
-
view
57 -
download
2
Transcript of Final ethique

LA FIN DU TRAVAIL
INTRODUCTION
Hypothèse de Rifkin :
+ D’informatisation + de productivité et donc : + de richesse mais – d’emploi
Problématique
La baisse du travail est-elle inéluctable ? Si oui, y a-t-il des solutions ? Si non, quelles sont les
solutions ?
(En I et II on imagine que la baisse du travail est inéluctable et dans le III qu’elle n’est pas
inéluctable)
I. 1ERE
SOLUTION : REPARTIR LE TRAVAIL
II. 2EME
SOLUTION : REPARTIR LA RICHESSE
III. 3EME
SOLUTION : LES SOLUTIONS POUR SORTIR DE LA
CONTRAINTE DE LA BAISSE DU TRAVAIL
- Aucune des solutions avant n’est une solution en elle-même
- Trouver des nouveaux gisements d’emplois (et donc de richesse) :
o Transition énergétique
o Aide aux personnes
o Services et culture
- L’exemple de Ségolène Royal : croissance verte, énergies renouvelables

1ERE
SOLUTION : REPARTIR LE TRAVAIL, UN TRAITEMENT ECONOMIQUE
DU CHOMAGE
En considérant que la baisse du travail est inéluctable, une première solution qui a été
essayée, notamment en France, est la répartition du travail. L’idée principale est la suivante :
peut-on baisser la durée du travail, en créant ainsi de nouveaux emplois,sans que les revenus
par emploi soient affectés ?Le véritable test d’une telle théorie a été réalisé en France : il
s’agit de la réduction du temps de travail à 35heures issue des lois Aubry en 1998 et 2000.
La volonté de réduction du temps de travail n’est née en 2000 mais date de la révolution
industrielle et de la croissance économique du XIXème siècle. L’objectif principal était
d’améliorer les conditions salariales face à cette croissance économique. Dans sa version de
2000, différents objectifs originaux composaient la loi Aubry : l'emploi, la performance, le
temps libre et la négociation décentralisée. Du point de vue des salariés, cette loi a été un
grand succès. Tous ont été satisfaits de cette loi : les salariés ont gagné du temps de loisir et
les 300.000 emplois ont pu être crées et ont permis de réduire le taux de chômage.
Mais les 35 heures ont également fait l’objet de nombre de critiques. En 2008, Denis Clerc,
journaliste à Alternative Économique, s’exprime sur les 35heures : « On attribue aux 35
heures un grand nombre de tares. Elles seraient responsables de la faible croissance en
raison de leur coût excessif, des contraintes qu'elles font peser sur les entreprises et des
blocages qu'elles engendrent pour travailler davantage. Elles seraient le symbole d'une
France paresseuse, ayant choisi de privilégier le loisir et le farniente et qui s'étonne de voir
son pouvoir d'achat s'éroder ».
Les lois Aubry sont également critiquées d’un point de vue économique. On comprend
rapidement qu’elles ont nombreuses limites : elles sont considérées comme trop rigides et
donc entrainant des modalités de RTT complexes, mal vécues par les employeurs comme les
salariés. De plus, les entreprises ont modéré les augmentations de salaires pour limiter la perte
de productivité et les salariés ont ressenti cettestagnation des salaires accompagnée parfois
d’une pression des employeurs à travers une plus grande exigence de la part des entreprises.
Au delà des polémiques et des sensibilités politiques, il semble clair que les 35heures sont un
acquis social significatif pour les salariés et qu’elles ont initialement permis de créer
« quelques centaines de milliers d’emplois ». Il est également clair que la baisse de

compétitivité de la France qui en a découlé a pénalisé durablement la croissance et donc
détruit des emplois ou, à tout le moins, freiné la création d’emploi.
Dans un monde de plus en plus mondialisé, avec une guerre permanente de compétitivité
entre les Etats, la réduction de temps de travail ne semble donc pas une piste efficace pour
compenser durablement la baisse du travail induite par la productivité liée à l’informatisation.
2EME
SOLUTION : REPARTIR LES RICHESSES, UN TRAITEMENT SOCIAL DU
CHOMAGE
Puisque l’informatisation et la productivité créent des richesses, peut-on prélever une partie
de ces richesses pour financer la création d’activités, et donc d’emplois, non directement
productives ? Une telle approche donnerait une vraie activité à des personnes exclues du
marché du travail et pourrait contribuer à améliorer la vie dans notre société. C’est le
traitement « social » du chômage avec toutes les tentatives de ces trente dernières années :
emplois aidés, TUC (travaux d’utilité collective), etc.
Une telle solution nécessite néanmoins d’être financée et revient donc à augmenter la fiscalité
de la richesse créée par la productivité, soit sur la capital soit sur les revenus.
Depuis le premier choc pétrolier et la crise qui en a suivi, la France n’a cessé de multiplier les
tentatives de solution au chômage. C’est en 1984 qu’on été crées notamment les TUC, travaux
d’utilité collective.Grâce à cette création d’emploi, plus de 350 000 jeunes ont travaillé dans
des collectivités territoriales en recevant un salaire d’environ la moitié du SMIC. D’autres
types d’emplois aidés ont été mis en place (les « emplois jeunes », le CIP, contrat initiative
emploi ou encore le plus récent, les emplois d’avenir).
Comment interpréter et analyser l’effet de ces tentatives de lutte contre le chômage ?
Tous ces contrats s’adressent principalement à des jeunes actifs, âgés de 16 à 25 ans, peu ou
non diplômés, qui rencontrent donc des difficultés particulières pour accéder au marché du
travail. Ces emplois ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la
qualification des jeunes sans emploi. Il existe de nombreux avantages, tant pour les
travailleurs que pour les entreprises. Du point de vue du travailleur, ces emplois représentent

l’opportunité d’intégrer plus facilement au marché du travail, et particulièrement pour des
jeunes travailleurs sous diplômés pour qui l’accès au monde professionnel devient plus
difficile.
Du point de vue de l’employeur, l’intégration de ces emplois a été facilitéepar l’action de
l’Etat. En créant les CAE, contrats d’accompagnement dans l’emploi, l’Etat participe à
hauteur de 75% au montant horaire du SMIC. C’est l’un des contrats les plus aidés par l’Etat.
L’aide de l’État est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP). En
plus de l’aide de l’Etat, l’entreprise qui emploie un salarié avec ce type de contrats, bénéficie
d’autres avantages : une période de travail minimale obligatoire, des cotisations sociales
limitées au SMIC, etc. En conclusion, ces emplois ont été bien accueillis et ont donc un
impact positif sur la création d’emploi.
Cette approche est aujourd’hui préconisée par les tenants de la politique de la demande, ou
Keynésienne, qui veulent relancer la croissance en créant de la demande. Il est vrai que les
bénéficiaires de ces emplois crées représentent des consommateurs supplémentaires et donc
améliorent potentiellement la croissance.
Les effets négatifs des emplois jeunes sur la courbe du chômage et sur la facture des
emplois
Il y a pourtant beaucoup de critiques sur ces emplois qui ont la volonté de réduire le chômage.
Du point de vue des travailleurs, même si ces solutions sont des réponses rapides et de court
terme, cela ne représente pas une solution à long terme face à la précarité que représentent ces
emplois. Beaucoup ont dénoncé la mauvaise utilisation de ces emplois. Entre renouvellements
abusifs de contrats précaires, manque de considération professionnelle et niveau des salaires,
on comprend que certains employeurs ont profité de ces statuts avantageux pour employer le
plus possible au plus faibles coûts. Cela crée en effet de l’emploi, mais de l’emploi précaire,
de l’emploi « d’urgence » et non de l’emploi à long terme. C’est pourtant l’emploi à long
terme que l’on cherche à multiplier : il correspond à l’emploi utile à l’entreprise et dans lequel
on entrevoit un futur professionnel à long terme pour le salarié.
L’aspect de précarité de l’emploi n’est pas la seule critique. En effet, tout cela a un coût. Pour
les emplois aidés, le coût moyen est d’environ 11.000 euros par an, d’après l’Institut de
l’entreprise. On estime qu’à plein régime, le dispositif coûtera en 2014dans les 3,3 milliards

d’euros. Le financement de ces mesures ne peut plus aujourd’hui être assuré par un recours
supplémentaire à l’endettement puisque la France doit respecter ses engagements européens
en matière d’équilibre budgétaire. Le financement doit donc passer par la fiscalité. Mais ces
coûts représentent un alourdissement d’une fiscalité française déjà considérée comme
excessive au regard des comparaisons internationales. En particulier, le risque que représente
« l’exil fiscal » s’est accru depuis que l’économie est de plus en plus mondialisée. Les
entreprises et les personnes physiques peuvent aujourd’hui faire des arbitrages dans leur
investissements en privilégiant les localisations fiscales les plus avantageuses, sans même
parler des paradis fiscaux. Un alourdissement significatif de la fiscalité pourrait accentuer ce
risque et au final ne pas produire une recette fiscale supplémentaire puisqu’elle serait plus que
compensée par des pertes liées à l’exil fiscal. C’est une autre application du concept de Laffer
que l’on a traduit en France par l’expression bien connue « Trop d’impôt tue l’impôt ».
Courbe de Laffer – « Trop d’impôt tue l’impôt »
Les défenseurs d’un alourdissement de la fiscalité, en particulier la fiscalité sur le capital, ont
toutefois récemment reçu un renfort d’importance : Thomas Piketty et sa théorie sur
l’accumulation du capital, dans laquelle il plaide essentiellement pour une plus forte taxation
des hauts revenus et du capital.Si une telle théorie devait gagner en popularité, l’analyse de
Lafferpourrait rester vraie mais pour autant permettre un nouvel alourdissement de la fiscalité
en France dès lors que ce mouvement serait mondial et ne craindrait donc pas un risque de
« dumping fiscal » entre états.
En conclusion, il nous semble que le traitement social du chômageest une solution utile dans
une circonstance d’urgence. Cependant, ilne constitue pas une solution à long terme puisque

la perspective d’un jeune salarié de vivre de façon pérenne dans un emploi non productif et
précaire n’est pas acceptable. Mais également parce que son financement nécessite un
alourdissement de la fiscalité qui aujourd’hui ne semble pas opportun.

Bibliographie
http://www.ambafrance-at.org/IMG/pdf/Les_35_heures.pdf
http://www.alternatives-economiques.fr/reforme-du-temps-de-travail---les-35-heures--bouc-
emissaire_fr_art_690_35858.html
http://rmc.bfmtv.com/info/294694/tuc-cie-cpe-retour-sur-35-ans-demplois-jeunes/
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/empl
ois_davenir_01.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-
du,91/emploi-des-jeunes,2217/les-emplois-d-avenir,15635.html
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article_interactif/2008/10/30/un-emploi-aide-est-
un-emploi-precaire_1112785_1101386.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/combien-facture-emplois-aides-va-t-elle-elever-
christophe-voogd-914445.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/thomas-piketty-un-karl-marx-francais-a-la-
conquete-des-etats-unis_1511403.html