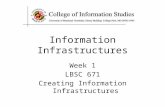ETUDE SUR LA PARTICIPATION PRIVEE DANS LES …...La modernisation des infrastructures, leur mise à...
Transcript of ETUDE SUR LA PARTICIPATION PRIVEE DANS LES …...La modernisation des infrastructures, leur mise à...

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE TTUUNNIISSIIEENNNNEE
MMIINNIISSTTEERREE DDUU DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT EETT DDEE LLAA CCOOOOPPEERRAATTIIOONN IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE
EETT
BBAANNQQUUEE MMOONNDDIIAALLEE
EETT PPRROOGGRRAAMMMMEE PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN PPRRIIVVEEEE DDAANNSS LLEESS
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEENNNNEESS ((PPPPMMII))
EETTUUDDEE SSUURR LLAA PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN PPRRIIVVEEEE DDAANNSS LLEESS IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS EENN TTUUNNIISSIIEE
VVOOLLUUMMEE II
AAVVEECC LLEE SSOOUUTTIIEENN DDUU MMEECCAANNIISSMMEE CCOONNSSUULLTTAATTIIFF PPOOUURR LLAA PPRREESSTTAATTIIOONN DDEE SSEERRVVIICCEESS
DD’’IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE DDAANNSS LLEE CCAADDRREE DDEE PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS PPUUBBLLIICCSS--PPRRIIVVEESS ((PPPPIIAAFF))
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized


TTaabbllee ddeess MMaattiièèrreess
Préface.............................................................................................................. ix
Avant-propos ....................................................................................................xi
Sigles et abréviations...................................................................................... xiv
1. Eléments de stratégie pour la participation privée dans les infrastructures en Tunisie ...............................................................1
Objectifs de la participation privée dans les infrastructures ..................................................1 Acquis de la Tunisie en matière d’infrastructure...................................................................2 Objectifs du Xème Plan et Stratégie actuelle en matière de PPI..............................................2 Proposition de compléments à la stratégie actuelle ...............................................................4 Proposition de Plan d’Action - Aspects horizontaux.............................................................9
2. Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures ..............................................................................11
Les tendances internationales en matière de PPI .................................................................11 Avantages et risques de la PPI .............................................................................................14 L’importance de l’introduction de la concurrence égale .....................................................16 Un menu d’options pour la participation du secteur privé...................................................18 Subventions et participation privée......................................................................................19 La régulation des services d’infrastructure ..........................................................................20
3. Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie ..27
Le contexte macro-économique, l’environnement des affaires et le programme de privatisation..........................................................................................................................27 Le Xème Plan de Développement..........................................................................................28 L’expérience de la Tunisie en matière de PPI .....................................................................29 L’engagement du secteur privé tunisien dans la fourniture de services d’infrastructure ....32 Les questions d’emploi ........................................................................................................32 Equité et services d’infrastructures en Tunisie ....................................................................33 L’intégration régionale et les services d’infrastructure .......................................................35 Les aspects juridiques de la PPI...........................................................................................37 Le financement de la PPI par le secteur financier tunisien..................................................45 Simulation des effets économiques de la libéralisation des services d’infrastructure .........48
4. Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures .........53
Les télécommunications.......................................................................................................53 Les transports .......................................................................................................................59 L’électricité et le gaz............................................................................................................69 L’eau potable .......................................................................................................................74 L’assainissement ..................................................................................................................76 Les déchets solides...............................................................................................................81
Lectures suggérées ..........................................................................................87
- v -

Encadrés
Encadré 1 : Extrait de la Stratégie de Développement du Secteur Privé de la Banque mondiale ……………………………………………………………………… 16
Encadré 2 : Subventions comme incitations à une meilleure performance : Le Programme Brésilien PRODES dans le secteur de l’assainissement ……………………… 20
Encadré 3 : Le test de l’optimisation des ressources (Value for Money Test): une approche innovante de PPI ……………………………………………………………… 23
Encadré 4 : Exemples d’agences de régulation de l’infrastructure dans le monde ………… 26 Encadré 5 : L’expérience internationale en matière de lois sur les partenariats public-privé 39
Figure
Figure 1 : Les différentes options pour la Participation privée dans les infrastructures..........18
Graphiques
Graphique 1 : Pays avec une PPI dans un secteur au moins...................................................12 Graphique 2 : Evolution de la participation privée totale dans les infrastructures
dans les pays en développement de 1990 à 2001.............................................13 Graphique 3 : Investissement total dans les projets de PPI de 1990 à 2001............................14 Graphique 4 : Comparaison des coûts de l'optimisation des ressources …………….……….24 Graphique 5 : Les gains macro-économiques des scénarios alternatifs de libéralisation
des services en Tunisie.....................................................................................51 Tableaux
Tableau 1 : Avantages de la PPI et conditions préalables pour leur réalisation .....................15 Tableau 2 : Risques de la PPI et mesures de réduction de risque ...........................................15 Tableau 3 : Les secteurs concurrentiels et non concurrentiels des infrastructures .................17 Tableau 4 : Formes de participation privée dans les infrastructures.......................................18 Tableau 5 : Principaux indicateurs macro-économiques des IXème et Xème Plans ..................28 Tableau 6 : Marchés PPI conclus en Tunisie ..........................................................................29 Tableau 7 : Investissements dans le secteur des infrastructures .............................................31 Tableau 8 : Taux de desserte de l’eau potable, de l’assainissement et de l’électricité en
Tunisie, Algérie et au Maroc ...........................................................................................34 Tableau 9 : La pertinence de l’intégration régionale pour les secteurs des infrastructures et
vice versa .........................................................................................................................36 Tableau 10 - Participation privée et législation tunisienne par secteurs d’activités – points
forts et points faibles........................................................................................................44 Tableau 11 : Récapitulation du diagnostic du secteur des Télécommunications....................54 Tableau 12 : Proposition de plan d’action pour le secteur des télécommunications ..............58 Tableau 13 : Récapitulation du diagnostic du transport aérien...............................................60 Tableau 14 : Proposition de plan d’action pour le transport aérien ........................................61 Tableau 15 : Récapitulation du diagnostic du transport maritime ..........................................62 Tableau 16 : Proposition de plan d’action pour le transport maritime ...................................63 Tableau 17 : Récapitulation du diagnostic du transport routier..............................................64 Tableau 18 : Proposition de plan d’action pour le transport routier .......................................65 Tableau 19 : Récapitulation du diagnostic du transport urbain ..............................................66 Tableau 20 : Proposition de plan d’action pour le transport urbain........................................66
- vi -

Tableau 21 : Récapitulation du diagnostic du transport ferroviaire........................................67 Tableau 22 : Proposition de plan d’action pour le transport ferroviaire .................................68 Tableau 23 : Proposition de plan d’action pour le transport multimodal et postal .................68 Tableau 24 : Récapitulation du diagnostic sur l’électricité et le gaz ......................................70 Tableau 25 : Proposition de plan d’action sur l’électricité et le gaz.......................................73 Tableau 26 : Résumé du diagnostic du secteur de l’eau potable ............................................75 Tableau 27 : Résumé du diagnostic de l’assainissement ........................................................78 Tableau 28 : Proposition de plan d’action pour l’eau potable et l’assainissement .................80 Tableau 29 : Résumé du diagnostic de la gestion des déchets solides....................................83 Tableau 30 : Proposition de plan d’action pour la gestion des déchets solides ......................85
- vii -


PPrrééffaaccee
La Tunisie s’est profondément transformée au cours de ces dernières années et dispose aujourd’hui d’acquis considérables en matière de développement économique et social. Les statistiques sur l’incidence de la pauvreté, sur le revenu par habitant (qui dépasse actuellement les 2500 US$) et sur l’espérance de vie à la naissance (qui s’établit à 72,1 ans), ainsi que le niveau de desserte et la qualité de la plupart de ses services d’infrastructure, témoignent des progrès importants réalisés par le pays. Ces réalisations ont été rendues possibles par la volonté affichée des Autorités tunisiennes d’asseoir les fondements d’une économie moderne, compétitive et ouverte sur l’extérieur, mieux intégrée dans son environnement. Si ces acquis confirment la capacité de l’économie tunisienne à s’adapter à de nouvelles exigences, ils permettent également de souligner les défis que le pays devra encore relever dans le futur. L’apparition récente de nouveaux concurrents économiques sur la scène internationale et la proximité de l’instauration de la zone de libre-échange avec l’Union européenne ont en effet augmenté la pression compétitive sur l’industrie tunisienne et souligné l’importance de la poursuite et de l’intensification des réformes dans le secteur des infrastructures. Ces réformes visent à conférer davantage d’efficacité et d’efficience aux structures de production et à accroître la compétitivité de l’économie tunisienne d’une manière générale. La stratégie préconisée aujourd’hui consiste à promouvoir l’initiative privée et à consolider la place du secteur privé en tant que vecteur de l’action de développement, en poursuivant la politique de libéralisation de l’économie et en ouvrant de nouveaux secteurs à la concurrence. Le Gouvernement tunisien a accordé un intérêt particulier aux secteurs des infrastructures en tant qu’instrument pour améliorer la compétitivité de l’économie et des entreprises et soutenir les exportations, et en tant que levier pour attirer davantage d’investissements étrangers, et ainsi alléger les pressions fiscales. La modernisation des infrastructures, leur mise à niveau, et l’intensification de la participation privée dans les infrastructures constituent des priorités du Xème Plan de développement (qui couvre la période 2002-2006). Le secteur privé s’est montré, à maintes reprises, en mesure de soutenir utilement l’action du secteur public. Il s’agit de dépasser la notion de coexistence entre ces deux secteurs pour parler d’une nouvelle forme de relation : le partenariat. L’expérience internationale montre que la participation du secteur privé et l’organisation de la concurrence sont indispensables à la fourniture de services d’infrastructure de qualité. Les avantages économiques provenant de réformes réglementaires et d’une concurrence accrue sont au moins aussi importants que ceux provenant des investissements privés. Une stratégie exhaustive de la participation privée dans les infrastructures est désormais nécessaire afin d’atteindre les objectifs préconisés dans ce domaine. A cet effet, le Gouvernement tunisien a sollicité la Banque mondiale et le Programme PPMI pour la réalisation d’une étude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie (étude PPI). Cette étude analyse en détail les expériences déjà menées dans le pays en matière de participation privée dans les secteurs clés des infrastructures et traite des cadres juridique et financier, et de leur impact et incidence sur la PPI. Ces diagnostics détaillés, ainsi que l’analyse de l’expérience internationale en matière de PPI, ont permis de dégager un
- ix -

ensemble de recommandations et d’actions à mener. Le but principal de l’étude PPI était par conséquent de permettre au Gouvernement d’élaborer une stratégie pour la participation privée dans les infrastructures et un Plan d’Action à moyen et long terme.
Les recommandations de l’étude ont été présentées et débattues au cours d’un atelier qui s’est tenu à Tunis en décembre 2003 et qui a réuni une large audience (plus de 160 participants) composée de représentants des secteurs public et privé, du monde universitaire, des banques tunisiennes, des institutions financières internationales et de la société civile tunisienne.
Cette étude a permis de mettre en évidence les progrès déjà réalisés par le pays et les enjeux actuels en matière de PPI. Elle a également mis l’accent sur les secteurs qui nécessitent davantage de recherches et de débats. Il apparaît cependant clairement qu’une plus grande participation du secteur privé dans les infrastructures est nécessaire aujourd’hui en Tunisie - sous des formes nouvelles si besoin est - et que le Gouvernement tunisien est disposé et engagé à aller de l’avant dans ce domaine, en particulier à travers la réalisation des divers grands projets d’infrastructures en concession.
La Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds, notamment la Commission européenne, sont prêts à poursuivre et à intensifier leur appui et leur soutien à la Tunisie pour la mise en place de ses propres Stratégie et Plan d’Action dans le domaine de la PPI, et ainsi à aider le pays à améliorer encore ses services d’infrastructure, au bénéfice des consommateurs, de la croissance et de l’emploi.
Françoise Clottes Manager, Secteur Financier, Secteur Privé et Infrastructures Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale
Mounir Boumessouer Directeur Général des Infrastructures Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
- x -

AAvvaanntt--pprrooppooss
L’origine de cette étude est le souhait du Gouvernement tunisien d’évaluer la contribution potentielle du secteur privé à la réalisation des objectifs du Xème Plan de Développement (2002-2006) et aider à développer une stratégie de participation privée dans les infrastructures (PPI) en Tunisie1.
Une stratégie cohérente de participation privée dans les infrastructures devrait accroître la qualité et la desserte des services d’infrastructure à des coûts efficaces, en introduisant la concurrence et en améliorant la régulation conformément aux pratiques internationales reconnues. D’autres objectifs qui pourraient être poursuivis à travers une stratégie accrue de PPI consisteraient à mobiliser l’investissement privé et l’investissement direct étranger (IDE) dans les secteurs des infrastructures et à faciliter l’intégration économique dans la zone de libre-échange Euro-méditerranéenne avec l’Union européenne (UE), avec les pays voisins et plus généralement avec les marchés mondiaux.
L’étude PPI est destinée principalement au Gouvernement tunisien et au secteur privé tunisien. La Banque mondiale, les bailleurs de fonds, en particulier l’Union européenne, et le secteur privé constituent une audience secondaire. L’étude a été lancée par la Banque mondiale, suite à la demande faite en Septembre 2001 par le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI), dans le cadre du troisième programme d’appui à la compétitivité économique2. L’étude a été étroitement coordonnée avec la Commission européenne (CE), en mettant à profit la coopération efficace entre l’UE, la Tunisie et la Banque mondiale. L’étude a été réalisée avec le concours du Programme pour la Participation Privée dans les Infrastructures Méditerranéennes (PPMI), un programme conjoint de la CE et de la Banque mondiale.
Le processus de préparation de l’étude s’étend sur environ deux ans. L’étude a été réalisée en deux phases : (i) une phase de diagnostic au niveau sectoriel; et (ii) une deuxième phase qui couvre les aspects horizontaux de la PPI et la préparation d’une proposition de Stratégie PPI pour le pays et d’un Plan d’Action. La Stratégie PPI envisage une perspective à long terme sur un horizon de dix ans ou plus, comprenant un Plan d’Action qui, quant à lui, couvre un horizon plus court. Un Rapport de Diagnostic a été soumis à la partie tunisienne en mars 2003 en version finale tenant compte des commentaires du gouvernement. Lors de la deuxième phase de l’étude, entamée à partir de septembre 2002, des aspects horizontaux ont été analysés et une proposition de Plan d’Action a été élaborée. La version pré-définitive des études complétées dans la deuxième phase a été transmise aux autorités tunisiennes en novembre 2003. Pendant la préparation de l’étude, le Programme PPMI a également organisé un séminaire de dissémination sur la PPI pour de hauts fonctionnaires tunisiens qui s’est tenu à Bruxelles et à Paris en mai 2003. Le rapport du séminaire ainsi que tous les documents y afférents ont été distribués au sein des ministères concernés et sont disponibles sur le site internet de PPMI (cfr. www.ppmi.org). Les résultats de l’étude ont été présentés lors de l’atelier de dissémination qui s’est tenu à Tunis les 16 et 17 décembre 2003.
1 Voir Chapitre 2 et Volume III pour la définition de la PPI et des concepts voisins. 2 Le « Programme d’appui à la compétitivité économique/ Facilité d’ajustement structurel » est financé conjointement par la Banque mondiale, la Commission européenne et la Banque africaine de développement.
- xi -

Les activités de la deuxième phase de l’étude, en particulier les rapports sur les aspects juridiques et sur le financement local de l’infrastructure ainsi que l’atelier de dissémination ont été co-financées par un don du « mécanisme consultatif pour la prestation de services d’infrastructure dans le cadre de partenariats publics-privés » (Public-Private Infrastructure Advisory Facility / PPIAF).
Le MDCI était la contrepartie tunisienne de l’étude. Dans les différentes phases de l’étude, la Direction générale des infrastructures (DGI) et la Direction générale de l’évaluation et du suivi (DGE), ont été chargées du suivi de l’étude et ont joué un rôle très actif durant le processus de préparation. Pour assurer la coordination avec les autres départements concernés, le MDCI a établi un comité de pilotage pour l’étude, composé des représentants des ministères et organismes suivants : (i) le Bureau du Premier Ministre; (ii) le Ministère des Finances, (iii) le Ministère des Technologies de la Communication et du Transport; (iv) le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire; (v) le Ministère de l’Industrie et de l’Energie; (vi) le Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources Hydrauliques; et (vii) la Banque Centrale de Tunisie. Le comité s’est réuni à plusieurs reprises, apportant des commentaires et suggestions détaillés sur le rapport de diagnostic, les propositions de stratégie et le Plan d’Action sur la PPI. Ce comité a également impliqué dans ses travaux les principaux organismes d’Etat concernés par l’Etude, à savoir la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l’Office National de l’Assainissement (ONAS), l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), l’Office des Aéroports et de l’Aviation Civile (OACA), ainsi que l’Institut d’Economie Quantitative (IEQ) qui a, par ailleurs, apporté une contribution importante à la réalisation de l’Etude.
L’étude a été produite par une équipe dirigée par Manuel Schiffler, Economiste Principal, et Elisabetta Capannelli, Program Manager du PPMI, qui sont aussi les auteurs des deux volumes principaux de l’étude3. L’équipe de l’étude comprenait en outre: Ahmed Benghazi, Consultant; Noureddine Ferchiou, Consultant; Jean-Pierre Florentin, Consultant; Fadhel Ghariani, Consultant; Michel Loir, Lead Transport Economist; Henriette Mampuya, Program Assistant; Rene Mendonca, Sr. Power Engineer et Carlo Rossotto, Regulatory Economist. Durant la deuxième phase, Paloma Anós Casero, Economiste; Manuela Chiapparino, Research Analyst; Zakia Chummum, Program Assistant; Jérôme Leyvigne, Spécialiste des Infrastructures et Tjaarda Storm van Leeuwen, Lead Financial Analyst ont aussi fait partie de l’équipe. Durant la phase diagnostique de l’étude, Laila Mokaddem, Consultante, et Daniel Müller-Jentsch, Consultant, ont fait des contributions importantes.
Durant la révision interne du rapport au sein de la Banque, d’importants commentaires ont été reçus de la part de Pedro Alba, Sherif Arif, Françoise Bentchikou, Antonio Estache, Ines Fraile, Samia Melhem, Paul Noumba Um, Dirk Sommer et Aristomène Varoudakis. Theodore Ahlers, Françoise Clottes, Christian Delvoie et Emmanuel Forestier ont assuré le suivi de l’étude de la part de la direction de la Banque mondiale.
L’équipe tunisienne était dirigée par Mounir Boumessouer, Directeur Général des Infrastructures au MDCI. D’importantes contributions ont été apportées par : Mabrouk Mejri, Directeur Général de l’Evaluation et du Suivi; Abdelhamid Triki, Directeur Général des Prévisions; Néjib Bousselmi, Directeur à l’Institut d’Economie Quantitative; Youssef 3 Les auteurs tiennent à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de cette étude, ainsi que l’ensemble des responsables et cadres des secteurs public et privé tunisiens et les bailleurs de fonds.
- xii -

Bouhlel, Directeur à la DGI; Riadh Hadj Taieb, Directeur à la DGI; Béchir Achour, Directeur à la DGI; Chaker Ben Aiche, Directeur à la DGE; Moncef Miled à la DGI et Karim Bououni, Chef de Service à la DGI.
Le présent Rapport Final de l’étude tient compte des observations des Autorités tunisiennes et se divise en trois parties: (i) le Volume I synthétise les rapports de la phase de diagnostic et présente les propositions de stratégie et de Plan d’Action PPI; (ii) le Volume II comprend le compte-rendu de l’atelier de dissémination de l’étude sur la PPI qui s’est tenu à Tunis les 16 et 17 décembre 2003; et (iii) le Volume III comprend l’ensemble des annexes techniques de l’étude relatives aux parties légales, financières et sectorielles développées dans les deux phases de l’étude.
- xiii -

SSiigglleess eett aabbrréévviiaattiioonnss
AFD - Agence Française de Développement ANF - Agence Nationale des Fréquences ANPE - Agence Nationale de Protection de l’Environnement BEI - Banque Européenne d’Investissement BOT - Build-Operate-Transfer (Construction-Exploitation-Transfert) CMR - Conseil Ministériel Restreint CREE - Conseil des Régulateurs Européens de l’Energie CTN - Compagnie Tunisienne de Navigation DBO - Design-Build-Operate (Conception-Construction-Exploitation) DT - Dinar Tunisien FSI - Fournisseurs de Services Internet GTZ - Agence Allemande de Coopération Technique GSM - Global System of Mobile Telecommunication IACE - Institut Arabe des Chefs d’Entreprises IDE - Investissement Direct Etranger INT - Instance Nationale de Régulation des Télécommunications IPP - Independent Power Producer METAP - Programmes d’assistance technique pour la protection de
l’environnement en Méditerranée MDCI - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale MW - Mégawatt OACA - Office de l’Aviation Civile et des Aéroports ONE - Observatoire National de l’Energie OMC - Organisation Mondiale du Commerce OMMP - Office de la Marine Marchande et des Ports ONAS - Office National de l’Assainissement PAP - Projet d’Appui à la Privatisation PPIAF - Public-Private Infrastructure Advisory Facility (Mécanisme consultatif pour la prestation de services
d’infrastructure dans le cadre de partenariats publics-privés) PPI - Participation Privée dans les Infrastructures PPMI - Participation Privée dans les Infrastructures Méditerranéennes PPP - Partenariat Public-Privé PSP - Participation du Secteur Privé SNTRI - Société Nationale des Transports Inter-Gouvernorats SONEDE - Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux STAM - Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention STEG - Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz TA - Tunisie Autoroute TIC - Technologies de l’Information et de la Communication UE - Union Européenne UTICA - Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat
- xiv -

Taux de Change (janvier 2004)
Monnaie = Dinar Tunisien
1 dinar = 0,728 $US
1 dollar = 1,372 DT
Les trois volumes de cette étude ont été produits par une équipe dirigée par Manuel Schiffler et Elisabetta Capannelli. Les différentes parties de l’étude ont été rédigées par une équipe comprenant Ahmed Benghazi (secteur financier), Noureddine Ferchiou (aspects juridiques), Jean-Pierre Florentin (PPI), Fadhel Ghariani (eau, assainissement et déchets solides), Michel Loir (transports), Rene Mendonca et Tjaarda Storm van Leeuwen (électricité et gaz), et Carlo Rossotto (télécommunications). Ont également apporté une contribution à la rédaction des différents chapitres Paloma Anós Casero et Néjib Bousselmi (simulation économique) et Daniel Müller-Jentsch (transports). La rédaction du Volume II a été principalement réalisée par Manuela Chiapparino et Jérôme Leyvigne. Henriette Mampuya a contribué à la rédaction et assuré le montage final de l’étude.
Tous les documents relatifs à l’étude PPI sont disponibles sur le site internet du Programme PPMI (http://www.ppmi.org). L’étude PPI a été co-financée par le « mécanisme consultatif pour la prestation de services d’infrastructure dans le cadre de partenariats publics-privés » (Public-Private Infrastructure Advisory Facility / PPIAF).
- xv -


11.. EElléémmeennttss ddee ssttrraattééggiiee ppoouurr llaa ppaarrttiicciippaattiioonn pprriivvééee ddaannss lleess
iinnffrraassttrruuccttuurreess eenn TTuunniissiiee
Objectifs de la participation privée dans les infrastructures
1. La participation privée dans les infrastructures (PPI) consiste à associer le secteur privé dans l’exécution et/ou la fourniture de services ou d’infrastructures. Elle peut prendre de nombreuses formes, de la simple sous-traitance à la cession intégrale d’actif publics. La PPI va donc bien au delà des seuls financement et réalisation d’infrastructures et s’étend plus largement à la notion de prestations de services4.
2. La PPI n’est évidemment pas un objectif en soi. Elle est recherchée par le gouvernement local ou central car elle peut contribuer de façon significative à la réalisation d’objectifs précis. Les objectifs qui pourraient être poursuivis par la PPI sont généralement les suivants :
- Amélioration de la qualité et maîtrise du coût des services publics; - Accélération de la mise en place des infrastructures pour soutenir la croissance et
l’emploi; - Amélioration de l’équilibre fiscal; - Transfert de l’expertise en matière de gestion et d’innovations technologiques; - Stimulation du développement des marchés de capitaux et des industries privées du
secteur des infrastructures sur le plan national. 3. En ce qui concerne le cas tunisien, on pourrait ajouter qu’une plus grande participation privée et des investissements directs étrangers dans le pays en général, mais dans les infrastructures en particulier, pourrait faciliter l’intégration régionale et internationale de la Tunisie dans le cadre de l’Accord d’Association avec l’Union européenne et des négociations avec l’Organisation Mondiale du Commerce.
4. Il faut mentionner que la réalisation de ces objectifs ne découlera pas mécaniquement d’une plus grande participation du secteur privé dans les infrastructures. Elle dépendra également de la façon dont la PPI sera conçue et gérée: l’amélioration de la qualité des services n’aura lieu que si la concurrence dans ses diverses formes est introduite autant que possible, si les cahiers des charges sont bien préparés et si les mécanismes de régulation nécessaires sont efficaces au niveau du contrôle de l’application du contrat. Il faut également garder à l’esprit que cette amélioration de la qualité de service pourra générer des coûts supplémentaires. En définitive, il reviendra donc à l’autorité chargée de concevoir la PPI de pondérer ces différents objectifs de façon à obtenir l’équilibre choisi par le pouvoir politique. Il est important de comprendre d’emblée que la PPI n’est pas synonyme de privatisation, ni d’investissement direct étranger.
4 Cf. Chapitre 2 et Volume III pour la définition de la PPI et des concepts voisins.
- Page 1 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Acquis de la Tunisie en matière d’infrastructure
5. Les acquis de la Tunisie en matière d’infrastructure sont considérables. Le pays a atteint un bon niveau de desserte et de qualité de la plupart de ses services d’infrastructure, et cela à un coût raisonnable par rapport à d’autres pays. Ces acquis ressortent clairement du rapport de diagnostic effectué par la Banque mondiale dans le cadre de la présente étude (voir Volume III). Les taux de desserte pour la téléphonie fixe, l’électricité, l’eau potable et l’assainissement sont élevés, y compris dans les zones rurales. La qualité de la gestion de ces infrastructures est par ailleurs également notable. Ceci se manifeste en particulier par des taux de pertes faibles pour l’eau et l’électricité, par la continuité du service, et par des niveaux de recouvrement des factures élevés à l’échelle régionale. Des efforts importants ont été entrepris dans les domaines de la téléphonie mobile, notamment par l’introduction récente de la concurrence, et dans les services Internet. Les acquis dans le secteur du transport, où d’importantes réformes ont été effectuées ou sont en cours d’achèvement, sont aussi clairs. Finalement, les subventions directes sont limitées et ne sont pas présentes d’une manière significative dans tous les secteurs, et le recouvrement des coûts est nettement meilleur que dans beaucoup d’autres pays de la région et des autres pays en développement.
6. Ce tableau positif ne doit cependant pas éluder les limites de la situation actuelle et de l’intervention prédominante du secteur public. L’amélioration de la gestion des entreprises publiques et ses limites ne faisaient pas partie des objectifs de la présente étude. Néanmoins, on peut constater de manière générale les limites suivantes. Premièrement, les capacités d’investissement du secteur public se réduisent. Ceci est dû à la volonté de réduire les déficits publics, à la réduction attendue à terme des ressources extérieures aux conditions concessionnelles et à la dégradation de la structure des bilans de certaines entreprises publiques. Deuxièmement, la gestion des entreprises publiques par le biais de Contrats-Programmes telle que pratiquée en Tunisie a des limites claires en terme d’amélioration de la productivité. Le potentiel d’amélioration de la productivité est freiné, entre autres, par les lourdeurs des procédures relatives aux marchés publics, le manque de base objective pour la compensation de certaines obligations de service public et des obligations implicites notamment en matière d’emploi. Des entreprises privées qui ne connaîtraient pas ces contraintes ou qui seraient compensées sur une base objective pour des obligations de service public, seraient donc dans une meilleure position pour améliorer leur productivité.
Objectifs du Xème Plan et Stratégie actuelle en matière de PPI
7. Les objectifs du Xème Plan quinquennal (2002-2006) sont ambitieux tant dans le domaine de la croissance (5,5% par an), que dans celui de la création d’emplois (322.000 contre 280.000 dans le cadre du IXème Plan, avec l’accent mis sur des emplois à haute qualification) et dans celui de l’investissement (augmentation de 55% par rapport au IXème Plan avec l’accent mis sur l’investissement privé). Les deux premières années du Xème Plan ont vu une conjoncture particulièrement difficile. Celle-ci a été caractérisée par une longue sécheresse, le ralentissement de la croissance et l’instabilité internationale suite aux événements du 11 septembre 2001, ce qui a infléchi la croissance du PIB de manière sensible, et rendu la réalisation des objectifs du Plan encore plus ambitieuse. Les objectifs du Plan supposent en particulier une croissance de la valeur ajoutée du secteur des services de 7,5% en moyenne par an résultant surtout de l’essor du secteur des télécommunications et des technologies d’information. En même temps la Tunisie fait face au défi de l’ouverture de son économie dans le cadre de l’Accord d’Association avec l’Union Européenne, de la nouvelle politique de voisinage pour une Europe élargie de l’Union Européenne et des engagements
- Page 2 -

Eléments de stratégie pour la PPI en Tunisie
nationaux dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, impliquant une pression compétitive croissante surtout sur le secteur manufacturier. Le secteur touristique, maillon essentiel de l’économie tunisienne, se trouve également dans une situation difficile liée en partie à un changement de la structure de la demande. Il est évident que, pour affronter ces défis, des services d’infrastructure de qualité, modernes et efficaces, sont essentiels, surtout dans le domaine des télécommunications et du transport.
8. L’expérience tunisienne en matière de participation privée dans les infrastructures reste relativement limitée à ce jour. Les deux plus grands projets ont été la concession pour la centrale de production d’électricité de Radès II, accordée en 1996, et la deuxième licence de télécommunication mobile en 2002. Dans les secteurs de l’assainissement et de la gestion des déchets solides, des tentatives modestes de gestion déléguée ont été faites au cours des dernières années. Dans d’autres secteurs tels que l’alimentation en eau potable, il n’y a pas eu d’exemple notable de participation du secteur privé jusqu’à présent.
9. Vu l’envergure limitée des efforts en matière de PPI en Tunisie jusqu’à présent et dans le but de réaliser ces investissements très ambitieux, la partie tunisienne a demandé à la Banque mondiale de l’assister dans l’élaboration d’une proposition de stratégie cohérente pour la participation privée dans les infrastructures. Cette stratégie devrait permettre de maximiser l’impact de ces investissements sur la croissance du PIB et de l’emploi tout en limitant l’impact sur les tarifs.
10. La stratégie passée et actuelle peut se caractériser de la façon suivante :
- Orientation de l’investissement privé vers les projets nouveaux (type BOT); - Promouvoir l’investissement direct étranger dans les créneaux ouverts au secteur
privé; - Maintien des sociétés publiques opérantes dans les différents domaines des
infrastructures (choix de ne pas procéder à des privatisations), avec dans quelques cas, des ouvertures de capital au marché financier;
- Ouverture progressive des secteurs à la concurrence (essentiellement dans les secteurs des télécommunications et des transports);
- Mise en place d’une structure de régulation limitée au secteur des télécommunications.
11. Les principaux nouveaux investissements privés prévus dans les infrastructures sont le nouvel aéroport du Centre-Est (estimé à 585 MDT), la communication par satellite (400 MDT), un port en eau profonde (500 MDT), des concessions dans des ports existants (environ 200 MDT, dont la moitié pour un terminal conteneurs à Radès), une concession pour un Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) dans le Grand Tunis, ainsi qu’une nouvelle station d’épuration des eaux usées pour le Grand Tunis. Ces projets sont à des stades de préparation plus ou moins avancés. Pour certains investissements, la décision du mode de financement (entièrement privé ou mixte) n’est pas finalisée. La quasi-totalité des investissements privés est ainsi attendue dans les télécommunications et le transport.
- Page 3 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Proposition de compléments à la stratégie actuelle
12. Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’approche standardisée pour la participation privée dans les infrastructures. L’approche doit varier selon les spécificités de chaque pays et elle doit être adaptée à chaque contexte sectoriel.
13. L’expérience internationale en matière de PPI varie considérablement. Les difficultés ou même les échecs dans certains cas ont parfois rencontré un écho médiatique disproportionné. Certes, quelques contrats ont rencontré des problèmes. Il n’est pas rare que des contrats aient été conçus et signés avec hâte et sur la base d’informations limitées. Des renégociations répétitives et des tensions persistantes en ont souvent été les conséquences. Dans certains cas, des autorités publiques ont refusé d’honorer leurs obligations contractuelles, tandis que dans d’autres cas des renégociations se sont traduites par des désavantages pour le secteur public. Souvent les difficultés ont été le résultat des chocs macro-économiques et des dévaluations massives (Amérique latine, Asie de l’Est). Cette situation n’est pas prévisible dans le contexte tunisien. Dans d’autres cas, les attentes des pouvoirs publics quant au secteur privé étaient exagérées. On espérait que le secteur privé pourrait résoudre les problèmes insurmontables dans un contexte de tarifs et d’un niveau de service très bas, ce qui ne correspond pas non plus à la situation en Tunisie.
14. Cela étant, il est important de souligner que la plupart des plus de 2000 partenariats publics-privés dans les infrastructures conclus durant les quinze dernières années, tous secteurs confondus, continuent à être appliqués à la satisfaction des partenaires. Vu le contexte macro-économique favorable de la Tunisie, la bonne qualité de la plupart des services publics et le recouvrement des coûts élevé, le contexte tunisien est donc très favorable à une expérience de PPI qui serve efficacement les objectifs des pouvoirs publics, et satisfasse les intérêts du secteur privé.
15. Pendant la réalisation de l’étude, des simulations ont été entreprises sur la base de deux modèles macro-économiques pour estimer les effets économiques de la libéralisation des services des infrastructures de télécommunications et de transport en Tunisie. Les résultats varient évidemment en fonction des hypothèses prises. Néanmoins, les simulations montrent un effet positif de la libéralisation sur la croissance et l’emploi dans le long terme. L’ampleur de ces effets dépend de l’ampleur et du rythme des réformes. Dans un scénario de réformes profondes et rapides dans le secteur des télécommunications, l’impact sur la croissance est estimé de l’ordre de 4,4% sur une période de 15 à 20 ans. L’effet sur l’emploi est difficile à chiffrer, mais un effet positif considérable est attendu sur la base de l’expérience internationale, notamment dans le domaine des services dont le développement est basé sur des meilleurs services de télécommunications, tels que la sous-traitance des services de back-office des pays développés vers les pays en voie de développement, des services liés directement aux télécommunications (call centers) et des services informatiques. Les effets de la libéralisation des services de transports sont également considérables, bien qu’ils soient difficiles à chiffrer convenablement sur la base des modèles existants. Selon certaines simulations effectuées dans le cadre de l’étude de la Banque mondiale (2002) sur les « Technologies de l’information et des communications - Contribution à la croissance et la création d’emplois », l’effet de la libéralisation des services de transport et de télécommunications serait de l’ordre de 2 à 3 % sur le long terme. Le gain d’emploi engendré par la libéralisation des télécommunications sera moitié moindre dans un scénario de réformes et de libéralisation lentes dans le secteur des télécommunications.
- Page 4 -

Eléments de stratégie pour la PPI en Tunisie
16. Dans le cas de la Tunisie, les éléments suivants sont proposés pour la stratégie PPI afin de permettre d’atteindre les objectifs ambitieux que le gouvernement s’est proposé d’atteindre dans le cadre du Xème Plan de Développement.
Déclaration du gouvernement avec une perspective à long terme
17. Le succès des réformes en matière de participation privée dans les infrastructures requiert une forte volonté politique et un engagement ferme de respect de certains principes clés. Pour réaliser les bénéfices de la participation privée dans les infrastructures, une stratégie à long terme est nécessaire au-delà des horizons des plans quinquennaux. Une approche purement sectorielle et trop graduelle risque de ne pas engendrer les bénéfices escomptés. Une approche coordonnée basée sur des principes clairs, surtout en ce qui concerne la régulation et le financement de l’infrastructure, est nécessaire. Une déclaration du gouvernement sur la stratégie de participation privée dans les infrastructures pourra donner un signal positif aux investisseurs. Elle fournira également une perspective claire aux Ministères concernés et aux entreprises publiques.
Poursuivre la mise en concurrence
18. Une véritable concurrence est nécessaire pour garantir l’efficacité des services publics. Pourtant, la concurrence dans le marché n’est pas envisageable dans tous les secteurs. Dans les segments de marché où il est possible, le jeu de la concurrence doit être garanti par l’attribution d’un nombre croissant de licences pour éviter des cartels de fait, ainsi qu’éventuellement par le renforcement des attributions du Conseil de la Concurrence. Dans les monopoles naturels (eau, assainissement, distribution d’électricité, certains segments du secteur des transports), la concurrence pour le marché devrait être encouragée en attribuant des affermages ou des concessions par voie d’appel d’offres. Pour ces mêmes monopoles naturels, il est souhaitable de faire jouer la concurrence comparative qui est basée sur une comparaison objective des performances des entreprises régionales, qu’elles soient privées ou publiques. D’importants premiers pas vers un tel système de concurrence comparative seraient l’établissement d’un système de comptabilité analytique, de filiales au sein d’entreprises publiques et le renforcement de la capacité de suivi au sein des Ministères de tutelle.
Renforcer la régulation
19. La régulation économique des services d’infrastructure est un processus qui cherche à promouvoir la qualité et le taux de desserte de ces services à des prix efficaces et abordables, tout en garantissant un équilibre entre les intérêts des usagers, des investisseurs et du public. Elle sert comme courroie de transmission entre la politique du gouvernement et la fourniture de services. La régulation des services d’infrastructures est nécessaire indépendamment de la structure du marché (concurrentiel ou non-concurrentiel) et du statut des fournisseurs de services (public ou privé). Les institutions chargées de la régulation peuvent être, selon le cas, des départements ministériels, des agences de régulation sectorielles ou multi-sectorielles bénéficiant d’un certain degré d’autonomie, d’autres institutions bénéficiant d’un certain degré d’autonomie (par exemple Conseil de la Concurrence, Commission Supérieur de Marché) et le système judiciaire.
- Page 5 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
20. Les fonctions principales d’un système de régulation économique sont les suivantes :
- Déterminer de manière précise, à travers l’élaboration d’un cahier des charges de haute qualité, les obligations des concessionnaires et de l’autorité concédant en matière de fourniture de services et de rémunération ainsi que les règles d’ajustement s’appliquant en cas d’évènements imprévisibles;
- Suivre la performance des concessionnaires par un système d’information détaillé, objectif et fiable sur les coûts et la qualité des services. Ce système devrait réduire l’asymétrie d’information, souvent considérable, qui existe entre les concessionnaires et l’autorité concédante;
- Demander formellement aux concessionnaires ou à l’autorité concédante de se conformer aux cahiers des charges en cas de non-respect;
- Interpréter le cahier des charges pour permettre une décision ferme et objective; - Permettre le recours juridique contre des décisions prises, encourageant ainsi une plus
grande responsabilisation; - Assurer l’exécution des décisions.
21. Il n’existe pas de schéma unique pour la répartition de ces fonctions. Dans certains pays, la régulation de l’infrastructure se fait principalement par les Ministères de tutelle. Le nombre des pays qui ont opté pour l’introduction d’une ou plusieurs agence(s) de régulation augmente constamment. Tandis que peu de pays ont une longue tradition d’agences autonomes de régulation des infrastructures, l’expérience internationale suggère que la création d’agences de régulation améliore souvent l’environnement des affaires. Pour éviter d’être juge et parti, il est primordial qu’aucune institution ne cumule des fonctions de régulation et de fourniture de services.
22. L’expérience tunisienne en matière de régulation économique de l’infrastructure est limitée. Dans de nombreux secteurs un département du Ministère de tutelle est chargé de la régulation. Souvent, ces départements disposent de peu d’informations, et ont un nombre insuffisant de personnel (souvent pas suffisamment qualifié et formé dans les spécialités requises). En outre, ils utilisent des outils mal adaptés (contrats-programmes) sans sanctions efficaces en cas de non-respect. Dans l’unique secteur où une véritable agence de régulation existe (les télécommunications), les fonctions et l’autonomie de cette dernière restent limitées malgré des améliorations récentes. Là où certaines fonctions de régulation sont confiées à des Offices (transport maritime et aérien) ou des Agences (déchets solides), ceux-ci cumulent des fonctions de régulation et des fonctions commerciales.
23. Un système de régulation complet ne se crée pas du jour au lendemain. Des phases intermédiaires pourront donc être prévues. Les capacités de régulation au sein des Ministères pourraient être renforcées par un programme de formation. Des systèmes d’information et de suivi sectoriel et horizontal pourraient être créés. Les systèmes de suivi, basés sur une connaissance approfondie des coûts (comptabilité analytique), contribueraient à réduire l’avantage d’information des entreprises publiques. A terme, de nouvelles agences de régulation pourraient être établies, sans pour autant multiplier le nombre d’agences, vu la taille limitée du marché tunisien.
Maintenir la politique de recouvrement des coûts et rationaliser les subventions
24. Le recouvrement des coûts est un élément essentiel d’une stratégie de PPI. Dans le cas de la Tunisie, où le recouvrement des coûts est élevé, la mise en œuvre de ce principe ne présente pas de difficultés majeures. Néanmoins, il convient de rappeler que les subventions
- Page 6 -

Eléments de stratégie pour la PPI en Tunisie
directes et indirectes existantes ainsi que les subventions croisées entre catégories d’usagers – importantes dans plusieurs secteurs – gagneraient à être analysées de plus près en terme de leur impact. De manière générale, les subventions et subventions croisées devraient être limitées et clairement justifiées par des objectifs sociaux ou d’autres obligations de service public. A terme, toutes subventions, directes ou indirectes, devraient être remplacées par des contributions dont le niveau varie sur la base de critères objectifs liés à des obligations de service public bien déterminées.
25. Un processus d’ajustement des tarifs équitable est essentiel pour maintenir un bon niveau de recouvrement des coûts dans le contexte de variations de prix constantes. Pour le moment, les ajustements de la plupart des tarifs des services publics sont décidés par le gouvernement, généralement sur demande des entreprises publiques sans se baser sur des modèles financiers ou économiques qui permettraient d’estimer les coûts d’une fourniture de service efficace sur la base de comparateurs internationaux. Un contrôle des prix est maintenu après l’introduction de la participation du secteur privé (cas du GSM), mais le système de détermination des tarifs change généralement. Par exemple, le prix d’achat d’électricité en gros de la station de Radès est partiellement indexé sur le prix du fuel. Avec l’approfondissement de la participation du secteur privé, des systèmes d’indexation partielle pourront être plus répandus tout en tenant compte de coefficients d’amélioration de la productivité. Des systèmes de régulation performants seront nécessaires pour créer et interpréter des systèmes d’indexation appropriés. Une simple indexation des tarifs sur l’index général des prix devrait toutefois être évitée, parce qu’elle peut être source d’inflation.
Introduire de nouveaux modes de PPI et éventuellement étendre leur champ d’application
26. Pour l’instant, la Tunisie s’est limitée à certains modes de PPI, dont surtout des BOT. Dans l’avenir, il pourrait être intéressant d’étudier la possibilité d’implanter d’autres types de contrats comme les contrats Design Build Operate / Finance (DBO/DBF) et les affermages. Les contrats DBO/DBF offrent les mêmes avantages que les contrats BOT en terme de gains d’efficacité, mais permettent l’accès au financement public notamment par le biais de prêts bonifiés des bailleurs de fonds. Ces mécanismes sont bien adaptés à des pays comme la Tunisie qui bénéficient d’importants volumes de crédits bonifiés de la part des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour le développement de leurs infrastructures.
27. En revanche, ces contrats ne contribuent pas à l’amélioration de l’équilibre fiscal. Il existe également des contrats hybrides avec un financement mixte public-privé qui se sont développés au cours des dernières années, surtout dans les secteurs environnementaux (eau, assainissement, déchets solides). En ce qui concerne les affermages, ils séparent les fonctions d’exploitation et de maintenance des fonctions d’investissement et de financement. Ils permettent donc également l’accès au financement public. Il existe des contrats hybrides avec des obligations de financement partiel par le secteur privé. A la différence des BOT ou DBO/DBF les affermages sont utilisés surtout pour des infrastructures existantes, notamment pour la fonction de distribution dans les infrastructures de réseaux. L’ouverture à terme de ces fonctions au secteur privé pourrait permettre une augmentation de la productivité dans ces segments, en vue de maintenir le niveau des tarifs. Des opérations pilotes régionales pourraient constituer une étape dans cette direction.
- Page 7 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Projet de loi sur le partenariat public-privé dans les infrastructures
28. Suite à la promulgation d’une nouvelle loi sur la passation des marchés publics ayant exclu les concessions de son champ d’application, le gouvernement a créé une commission dans le but de préparer une loi sur le partenariat public-privé dans les infrastructures. La publication d’une telle loi pourrait constituer un signal positif, surtout si elle était encadrée par une déclaration du gouvernement sur une stratégie de PPI. Cette loi pourrait se limiter à évoquer des principes généraux – transparence, concurrence, égalité - tout en permettant une souplesse considérable en ce qui concerne les types de contrats et les formes de régulation selon les spécificités sectorielles. La loi pourrait également définir des dispositions comptables et fiscales, notamment en matière de comptabilité analytique qui est essentielle pour un système de régulation économique.
Financement de projets
29. Comme indiqué auparavant, un financement public n’exclut pas une participation du secteur privé. La volonté des investisseurs de s’engager dans des pays émergents a été considérablement réduite au cours des dernières années. Il paraît donc opportun d’utiliser le financement privé pour financer une bonne partie de l’écart entre la disponibilité de fonds concessionnels d’une part et les besoins d’investissement d’autre part, ainsi que pour le financement des investissements dans les secteurs qui ne bénéficient pas du soutien des bailleurs de fonds, tels que les télécommunications.
30. Dans le cas où un financement privé de l’infrastructure est envisagé, la gestion du risque de change mérite une attention particulière. Comme il échappe au risque de change, le financement par le secteur financier local, là où il est possible, est en général moins onéreux. L’objectif du gouvernement de maximiser le flux de devises a contribué à la quasi-absence de financement local pour les projets d’infrastructures, c’est ainsi que le secteur financier local n’a pas participé au premier grand projet de PPI conclu en Tunisie, la centrale électrique Radès II. Ce secteur financier local est toutefois estimé capable de contribuer au financement privé de l’investissement dans les infrastructures si la politique du gouvernement privilégiant le financement en devises venait à être assouplie et si des instruments pour l’amélioration de la cotation du crédit sont utilisés. Enfin, l’investissement dans les infrastructures peut constituer un élément important de diversification et de développement du secteur financier local.
31. En ce qui concerne l’équilibre optimal entre financement privé et public, l’amélioration de l’équilibre fiscal obtenu par le financement privé doit être appréciée dans le contexte des engagements éventuels (contingent liabilities) encourus par l’Etat. Souvent les investisseurs privés exigent des garanties – explicites ou implicites – de la part de l’Etat pour couvrir certains risques clés, tels que le risque de change, le risque d’insolvabilité d’une entreprise publique utilisant les services du projet et donc débitrice du projet, et parfois même une partie du risque commercial. Ces garanties qui sont un des principaux instruments pour l’amélioration de la cotation du crédit constituent des engagements éventuels. L’Etat devra gérer de manière prudente l’émergence d’engagements éventuels liés à la participation privée dans les infrastructures.
Créer une structure de suivi au sein du gouvernement
32. Il serait opportun de créer une structure de suivi au sein du gouvernement pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de PPI et du Plan d’Action décrit ci-dessous. Cette structure
- Page 8 -

Eléments de stratégie pour la PPI en Tunisie
ne se substituerait évidemment pas aux Ministères sectoriels et à des agences de régulation dont le rôle dans leur secteurs respectifs va rester primordial. La structure de suivi servira d’instance d’appui aux Ministères sectoriels et complémentera leurs efforts en ce qui concerne les aspects horizontaux. Le meilleure localisation pour une telle structure de suivi au sein du gouvernement reste à être déterminée.
Proposition pour un Plan d’Action
33. La présente étude inclut une proposition de Plan d’Action à même de concrétiser la stratégie retenue par le gouvernement en matière de développement de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie. Le Plan d’Action est constitué d’actions à court terme et d’actions à moyen et long terme, ainsi que d’un volet horizontal et d’un volet sectoriel. Le volet horizontal de la proposition pour un Plan d’Action qui se trouve ci-dessous reprend les grandes lignes de la stratégie pour la PPI et comprend des directions stratégiques, des propositions d’études stratégiques, des mesures de formation, d’amélioration du financement par le secteur financier local, juridiques et de communication.
34. Les différentes parties du volet sectoriel du Plan d’Action sont présentées dans les chapitres sectoriels du présent Volume et dans le Rapport de diagnostic sectoriel du Volume III.
Proposition de Plan d’Action - Aspects horizontaux
Actions Court terme Moyen et long terme
Directions stratégiques
- Déclaration du gouvernement sur la Stratégie PPI
- Mise en place d’une structure de suivi
- Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action PPI
Secteur Financier
- Lever les contraintes imposées par la Banque Centrale (permettre l’inclusion dans les schémas de financement des projets de financements locaux, tant en fonds propres qu’en dettes, même de manière partielle)
- Inciter les banques à procéder à des syndications avec des banques étrangères et locales
- Eventuellement l’introduction de certaines garanties partielles par le gouvernement tunisien, dont les modalités restent à déterminer, en limitant les dettes éventuelles de l’Etat au strict minimum
- Vulgarisation de techniques de financement à recours limité et de mesures d’amélioration de la cotation du crédit et de la gestion des risques
Secteur Juridique
- Passation d’une loi sur le partenariat public-privé dans les infrastructures, en complément de la législation sectorielle spécialisée en la matière
- Réformes du cadre juridique pour faciliter la mobilité de l’emploi entre secteur public et privé
- Relâchement des procédures à l’obtention d’un contrat de travail pour le personnel étranger dans les PPI en les assimilant aux procédures en place pour les entreprises totalement exportatrices
- Exclure les sociétés de projet dans le cadre de marchés de PPI des restrictions sur le change imposées aux investisseurs et bailleurs de fonds dans le cadre du Code des Changes
- Page 9 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Proposition de Plan d’Action – Aspects Horizontaux (suite)
Actions
Court terme Moyen et long Moyen et long terme terme
Formation
- Etablissement d’un programme de formation en matière de régulation économique
- Participation de cadres et autres professionnels tunisiens dans des programmes de formation au niveau international et dans les réseaux internationaux de régulateurs
Création ou renforcement d’institutions publiques et privées pour la formation dans des domaines liés à la PPI et à la régulation économique, notamment en matière de comptabilité analytique dans le domaine des infrastructures
Communication
- Etablir une stratégie de communication sur la PPI en utilisant des moyens de communication modernes, axée sur les consommateurs, le secteur privé international et local et le secteur financier international et local
Etudes stratégiques (horizontales et sectorielles)5
- Etude sur la régulation économique des services d’infrastructure
- Etude sur la régulation et la structure institutionnelle et de marché du secteur aéroportuaire
- Etude dans le secteur de l’électricité sur l’impact financier et économique de différents modèles de marché
- Elaboration d’un bilan et d’un plan de réformes de la structure actuelle des secteurs de l'eau potable et de l'assainissement sur la base des succès du passé afin d’éliminer les contraintes de développement futur, d’augmenter l'efficacité et d’introduire à terme la concurrence
- Etudes dans le secteur des télécommunications (p.ex. sur la PPI et les obligations de service universel)
- Etude sur la PPI dans le secteur de la poste
- Etude sur le recouvrement des coûts pour la gestion des déchets solides par des instruments non liées à la fiscalité
- Etude sur un affermage pilote régional dans l’eau et l’assainissement pour renforcer la concurrence comparative
5 Des études importantes ont déjà été achevées dans plusieurs secteurs importants (télécommunications, production d’électricité, déchets solides, transport) par le Gouvernement et aussi avec le soutien de la Banque mondiale.
- Page 10 -

22.. FFoonnddeemmeennttss eett pprriinncciippeess ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn pprriivvééee ddaannss lleess
iinnffrraassttrruuccttuurreess
35. La participation du secteur privé dans les infrastructures n’est pas une notion nouvelle. La participation privée peut prendre différentes formes. Au-delà de la conception et de la réalisation de l’infrastructure, certains pays ont eu recours au secteur privé pour exploiter, entretenir et - dans certains cas - pour financer des infrastructures. A l’heure actuelle, 132 pays en développement et presque tous les pays développés ont confié une partie de leurs infrastructures au secteur privé en tant qu’exploitant. Les résultats sont souvent positifs, parfois négatifs, et dans beaucoup de cas ils sont mixtes. Loin d’être une panacée, la participation du secteur privé apporte les bénéfices escomptés uniquement si certaines conditions sont remplies. Ces conditions seront analysées dans le chapitre présent.
36. Le chapitre commence par une description des tendances internationales en matière de PPI, y compris les implications de la récente diminution de l’engagement du secteur privé dans les pays émergents. Il continue par une analyse des bénéfices et des risques de la PPI du point de vue des consommateurs et des pouvoirs publics, y compris des mesures pour mitiger ces risques. L’importance de l’introduction de la concurrence est mise en exergue. Ensuite le chapitre présente brièvement les différentes options contractuelles pour la participation du secteur privé, y compris des options qui maintiennent la propriété publique des actifs, le financement public et l’intégration des subventions dans des schémas de PPI. Le chapitre inclut une discussion des options de régulation des services d’infrastructures, mettant l’accent sur le fait que la régulation peut apporter des bénéfices importants aussi bien dans le cas de la fourniture des services par le secteur public que par le secteur privé. Il conclut en esquissant comment l’introduction de la concurrence, l’amélioration de la gestion des entreprises publiques, le choix des options contractuelles pour la participation du secteur privé et la régulation peuvent être intégrés dans une politique d’infrastructure et une stratégie cohérente pour la participation du secteur privé.
Les tendances internationales en matière de PPI
37. La participation privée dans les infrastructures n’est pas un concept entièrement nouveau. En effet, au IXème siècle une bonne partie des services d’infrastructure en Europe et aux Etats-Unis était fournie par des entreprises privées, souvent sous la formule des concessions qui a été introduite par la France. Par la suite certaines entreprises ont été nationalisées, tandis que d’autres sont toujours restées privées, telles que les entreprises de télécommunications aux Etats-Unis et la plus grande partie du secteur de l’eau et de l’assainissement en France. A la fin des années 1970 et au cours des années 1980 une nouvelle vague de participation du secteur privé s’est annoncée suite au programme de privatisation au Royaume-Uni. Cette vague s’est étendue aux pays en voie de développement, notamment aux pays émergents de l’Asie de l’Est et de l’Amérique Latine. Les secteurs des télécommunications et de l’énergie ont vu de loin l’activité la plus importance en matière de participation privée dans les infrastructures (voir graphique 3). Les engagements d’investissement se sont ralentis après la crise financière en Asie de l’Est en 1997, mais sont
- Page 11 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
restés à un niveau élevé. Les crises financières en Amérique Latine et le ralentissement de la conjoncture internationale ont ramenés les nouveaux engagements au niveau de 1995. Tout de même les nouveaux engagements restent de l’ordre de 57 milliards de dollars US en 2002, et la vaste majorité des 2.500 projets privés d’infrastructure conclus dans les pays en voie de développement continuent à opérer.
38. Dans le contexte international actuel, les entreprises internationales et les banques d’affaires sont moins disposées à prendre des risques et concentrent leur engagement sur des pays avec un cadre macro-économique stable, des stratégies claires en matière de PPI ainsi que des politiques sectorielles et un cadre réglementaire propice. Ceci présente un avantage pour des pays qui ont poursuivi des politiques fiscales et monétaires raisonnables, mais met également en exergue la nécessité de compléter un dispositif macro-économique favorable par une stratégie PPI et des réformes juridiques et institutionnelles appropriées.
Graphique 1 : Pays avec une PPI dans un secteur au moins
0102030405060708090
100110120130140
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nom
bre
de P
ays
39. Le secteur privé a assumé le risque d’exploitation et/ou de construction de plus de 2500 projets dans les pays en développement de 1990 à 2002 pour des engagements d’investissements totaux de pratiquement 750 milliards de dollars US. On rencontre une activité privée dans au moins un secteur des infrastructures dans 132 pays en développement. Toutefois, seuls environ 20 pays en développement présentent une activité privée dans les quatre principaux secteurs des infrastructures (les télécommunications, le transport, l’énergie et l’eau). L’Amérique latine et l’Asie orientale se situent en tête des investissements. Dans la région MENA, le secteur privé s’est uniquement engagé à investir 15 milliards de dollars US dans les infrastructures.
- Page 12 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
Graphique 2 : Evolution de la participation privée totale dans les infrastructures dans les pays en développement de 1990 à 2001 (en milliards de dollars US)
0
20
40
60
80
100
120
140
Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
40. Du point de vue du secteur privé, il semble que la grande majorité des projets de PPI conclue depuis le début des années 1990 soient un succès et aient atteint leurs objectifs jusqu’ici. Parmi les 2.500 projets présents dans la base de données de la Banque mondiale relative aux PPI, quelques dizaines de projets seulement ont véritablement échoué. Les projets qui n’ont pas abouti sont concentrés dans certains pays et certains secteurs, en particulier les autoroutes à péage au Mexique, opération mal conçue, et le secteur de l’électricité en Indonésie, en raison de la crise financière en Asie orientale. D’autres projets ont rencontré des difficultés et des résultats mixtes. Quelques-uns ont mené à des procédures d’arbitrage international, y compris des demandes de compensation pour rupture de contrat dans le cadre d’accords d’investissement bilatéraux. Les échecs et difficultés des projets de PPI font presque toujours ressortir des faiblesses au niveau du cadre réglementaire ou de la conception des contrats qui peuvent être évitées par des pays qui prennent ces expériences en compte dans la conception de leur stratégie de participation du secteur privé dans les infrastructures.
- Page 13 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Graphique 3 : Investissement total dans les projets de PPI de 1990 à 2001 (par sous-secteur)
Télécoms44%
Energie28%
Ports2%
Eau5%
Gaz naturel5%
Chemins de fer4%
Routes10%
Aéroports2%
Avantages et risques de la PPI
41. Comme indiqué ci-dessus, la participation du secteur privé n’est ni une panacée, ni une fin en soi. Elle est bénéfique uniquement lorsque certaines conditions sont réunies et respectées. L’objectif d’une stratégie de PPI devrait être la volonté d’améliorer la qualité, d’étendre la desserte et de diminuer les prix des services d’infrastructure. Ce qui est important pour les usagers n’est pas l’infrastructure physique, mais la disponibilité de services fiables à un coût compétitif.
42. Vu de la perspective des consommateurs et de l’Etat, la participation privée dans les infrastructures peut engendrer de nombreux avantages. Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour assurer que ces avantages se réalisent. Les avantages potentiels et quelques conditions préalables sont résumées ci-dessous:
- Page 14 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
Tableau 1 : Avantages de la PPI et conditions préalables pour leur réalisation
Avantages Conditions préalables Augmentation de l’efficacité Potentiel existant d’augmenter l’efficacité Diminution du coût des services Concurrence, régulation efficace, maintien de
subventions sur une base rationnelle Amélioration de la qualité du service Potentiel existant d’augmenter la qualité;
Concurrence, régulation efficace Allégement de la charge fiscale Choix de modes de PPI appropriés (concessions,
BOTs); limitation de garanties menant à des dettes éventuelles
Plus grande probabilité de réalisation des projets dans le temps et budgets fixés, une fois le marché passé
Pour les concessions et les BOT
Transfert de l’expertise de gestion et des innovations technologiques
Contrats de longue durée avec des objectifs contractuels spécifiques sur le transfert de savoir-faire
Stimulation du développement des marchés de capitaux locaux
Absence d’obstacles réglementaires pour le financement local des infrastructures privées
Opportunités pour des fournisseurs de services d’infrastructures locales
Limitation de la taille des marchés ou obligation de partenariat
Facilitation de l’intégration dans les marchés régionaux et internationaux
PPI dans les secteurs des télécommunications et des transports transfrontaliers menant à des améliorations de la qualité du service et une diminution de son coût
43. Parmi les risques associés à la participation privée on compte les risques suivants, ainsi que les mesures de réduction de ces risques :
Tableau 2 : Risques de la PPI et mesures de réduction de risque
Risque Mesures de réduction de risque Dépréciation du cours de change menant à une augmentation des coûts et des prix
Politique macro-économique saine; augmentation de la part de financement en monnaie locale; définition de règles claires et équitables pour répercuter l’augmentation des coûts sur les prix; régulation
Possibilité d’une augmentation des prix non-liée à une dépréciation du cours de change
Concurrence, régulation
Attentes exagérées en ce qui concerne la capacité du secteur privé
Définir des objectifs réalistes, basée sur l’expérience internationale
Effets négatifs sur l’emploi Axer la PPI sur de nouveaux investissements; Compensation adéquate des licenciés, si des licenciements s’avèrent nécessaires; Axer la PPI sur des secteurs à impact indirect positif important sur l’emploi
Lassitude des investisseurs Stratégies de PPI sectorielles et horizontales cohérentes axées sur le long terme en évitant les interventions arbitraires; création d’un cadre juridique adéquat; bonne préparation des dossiers d’appel d’offres; Respect des contrats
Création de dettes éventuelles par les garanties consenties aux investisseurs privés
Réduire les dettes éventuelles au strict minimum nécessaire
Délais dans la préparation de marchés Création d’un cadre juridique adéquat; bonne préparation des dossiers d’appel d’offres; recours à l’expertise internationale
- Page 15 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
44. Une stratégie de PPI à long terme, claire et crédible, devrait comporter tous les éléments de mitigation cités ci-dessus. Souvent, dans la définition d’une stratégie, des objectifs multiples ne peuvent pas tous être réalisés et des choix sont à faire. L’Encadré 1 explique un choix fondamental à faire, celui entre les objectifs fiscaux et l’objectif d’éviter des augmentations des prix des services. Ces conflits seront discutés vers la fin du chapitre après avoir passé en revue plus en détails certains éléments clés d’une stratégie de PPI.
Encadré 1 : Extrait de la Stratégie de Développement du Secteur Privé de la Banque mondiale - Conditions préalables pour un financement viable de la
participation privée dans les infrastructures
Le financement des investissements est un grand souci, à juste titre, pour les gouvernements qui entreprennent des réformes. Les problèmes fiscaux ont été à la source de nombreuses réformes qui ont introduit la participation privée dans les infrastructures. Toutefois, cet objectif constitue également un danger important. De nombreux gouvernements avec des limitations de nature fiscale tentent d’inciter le secteur privé à financer les investissements. Cependant, ces gouvernements sont en même temps peu disposés à augmenter les prix à la consommation afin de créer le flux de revenus qui serait nécessaire pour rémunérer les capitaux privés. Les investisseurs privés ne font que financer. Seuls les contribuables ou les consommateurs paient le coût du service. Si le gouvernement n’a pas de fonds à investir et est peu disposé à augmenter les prix à la consommation jusqu’aux niveaux qui permettent de couvrir les coûts (y compris le coût du capital), les projets de PPI ne seront par définition pas viables. Il se peut que certains gouvernements dissimulent ce problème un certain temps en fournissant des garanties aux investisseurs.. Cependant, s’il n’y a pas de réforme de la politique de base en fin de compte, des problèmes risquent de surgir de nouveau. <...>
Pour un financement privé viable, il faut une bonne réforme de la politique. En d’autres termes, la réforme doit apporter de la clarté aux investisseurs, prévoir des incitations adéquates via des mesures adaptées de partage des risques et déterminer les prix à la consommation à un niveau qui permet de couvrir les coûts ou, de préférence, aux niveaux du marché. Lorsque ces conditions sont remplies, il y a de fortes chances que le financement privé suive. Le manque apparent de financement privé indique habituellement que la réforme est incomplète ou qu’il y a un manque de crédibilité, ce qui est généralement dû à une réforme inadéquate.
Source : Stratégie de Développement du Secteur Privé (DSP) de la Banque mondiale, 2001.
L’importance de l’introduction de la concurrence égale
45. Dans la définition d’une stratégie de PPI, il importe de distinguer les secteurs concurrentiels et les monopoles naturels. Les avantages possibles d’une participation privée sont généralement plus importants dans les secteurs concurrentiels. Dans le cas de monopoles naturels, il est nécessaire d’avoir une régulation judicieuse pour matérialiser les avantages de la participation privée.
46. Le problème des monopoles naturels ou « quasi-naturels » est souvent aggravé par des droits d’exclusivité, des barrières réglementaires à l’entrée du marché ou des monopoles d’Etat. Par conséquent, certains « monopoles naturels » constituent plutôt des « monopoles artificiels ». Dans le cas de véritables monopoles naturels où il est impossible d’avoir une concurrence sur le marché, on peut introduire une concurrence pour ce marché via l’octroi de concessions, d’affermages ou de contrats de gestion à la suite d’un appel d’offres public. Il est évidemment nécessaire de réglementer les prix et les normes de service dans le cas de monopoles naturels. Le Tableau 3 résume le champ de la concurrence dans différents secteurs et sous-secteurs des infrastructures.
47. Le champ de la concurrence est plus vaste dans le secteur des télécommunications, des transports aériens et maritimes, de certains types de services portuaires et aéroportuaires et de la génération d’électricité. Il est plus réduit quand il s’agit des infrastructures portuaires et aéroportuaires ainsi que de la production de gaz, des services de chemin de fer et de la gestion des déchets solides. Finalement, la concurrence dans le marché est pratiquement
- Page 16 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
impossible dans le cas des monopoles naturels. Par exemple, pour l’eau ou l’assainissement où le coût de la distribution et du captage est important par rapport aux coûts de production et d’élimination, la distribution de gaz et d’électricité où la construction de réseaux distincts entraînerait des coûts excessifs; et certains services de transports (comme le contrôle de la circulation aérienne) où les avantages de la fourniture monopolistique sont évidents. Les réformes et les politiques sectorielles doivent être adaptées à ces contextes spécifiques et, en particulier, au niveau de possibilité d’introduction de la concurrence dans le marché.
Tableau 3 : Les secteurs concurrentiels et non concurrentiels des infrastructures
Secteur Concurrentiel
Hybride Monopole naturel
Concurrence sur le
marché
Concurrence pour le marché
Télécommunications
Transports aériens et maritimes
Aéroports et ports
Services portuaires et aéroportuaires
Services de chemin de fer
Voies ferrées
Routes
Transport et distribution de gaz et d’électricité
Production d’électricité
Production de gaz
Eau et assainissement
Ramassage des déchets solides
Elimination des déchets solides
Légende :
Caractéristique du secteur principal Caractéristique du secteur secondaire
Source : Compilation des auteurs 48. Pour garantir une concurrence efficace, certaines conditions préalables doivent être remplies. Par exemple, la concurrence entre une entreprise publique et une entreprise privée risque d’être faussée ou bien en faveur de l’entreprise privée ou en faveur de l’entreprise publique. L’entreprise publique peut se voir accorder des obligations de service public insuffisamment compensées, ou bien des subventions ou des bénéfices résultant de certaines décisions du gouvernement favorisant les entreprises publiques. Garantir une concurrence égale est une responsabilité primordiale des pouvoirs publics. L’expérience internationale suggère que la concurrence égale est plus facile à garantir lorsque les règles du marché – y compris l’accès au financement et les obligations de service public - sont déterminées entièrement ou en grande partie par des régulateurs sectoriels autonomes et par des régulateurs de concurrence autonomes. En outre, un désengagement de l’Etat des entreprises
- Page 17 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
publiques qui sont en concurrence avec le secteur privé contribue à mettre les entreprises qui sont en concurrence sur un même pied d’égalité.
Un menu d’options pour la participation du secteur privé
49. La participation privée dans les infrastructures peut revêtir de nombreuses formes. Cela va de la simple sous-traitance à la cession intégrale d’actifs publics. Par conséquent, la PPI n’est pas équivalente à la privatisation. Dans la plupart des formes de participation privée, le secteur public conserve des responsabilités importantes, telles que la propriété des actifs ou le financement des investissements. Dans tous les cas, le secteur public détermine les règles de la participation du secteur privé selon ses propres principes et objectifs.
50. Les options pour la participation du secteur privé peuvent être caractérisées sur un spectre. A un bout du spectre se trouvent les options pour lesquelles le gouvernement a la pleine responsabilité du fonctionnement, de l’entretien, de l’investissement, du financement et prend le risque commercial—à l’autre, celles pour lesquelles le secteur privé assume une grande partie de ces responsabilités. La Figure 1 et le Tableau 4 ci-dessous montrent les différentes options disponibles pour l’introduction de la participation privée en fonction du partage des risques entre les secteurs public et privé.
Figure 1 : Les différentes options pour la Participation privée dans les infrastructures
Contrat de gestion
AffermageDBX
Concession/BOT ou BOO
Cession d’actifs
Répartition des risques (Opération, Investissements, Financement, etc.)
Privée
Contrat de service
Publique
Tableau 4 : Formes de participation privée dans les infrastructures
Contrat de service ou de gestion
(sous-traitance)
Affermage
Concession DBO BOT
Cession intégrale d’actifs
(Privatisation)
Propriété des actifs Publique Publique Publique Publiqu
e Publique Privée
Investissements de capitaux Publics Partagés Privés Publics Privés Privés
Efficacité opérationnelle Limitée Oui Oui Oui Oui Oui
Nouveaux services Non Non Oui Oui Oui Oui
Facturation des usagers Non Oui Oui Non Non Oui
Durée type 1 à 5 ans
8 à 15 ans
25 à 30 ans
15 à 30 ans
15 à 30 ans
Indéterm. sauf si elle est
limitée par une licence
Légende : BOT : Build, Operate, Transfer (contrat de construction, exploitation, transfert). DBO : Design, Build, Operate. Le terme français « gestion déléguée » couvre tous ces modèles, sauf la cession intégrale d’actifs.
- Page 18 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
51. Les différentes formes de participation de secteur privé dans les infrastructures sont décrites de façon plus détaillée dans le Volume III.
Subventions et participation privée
52. Parfois, le financement privé est perçu comme excluant l’accès à des subventions, et plus particulièrement à l’assistance par les bailleurs de fonds. Cependant, cela n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, les investissements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au niveau municipal en France ou aux Etats-Unis sont pour une grande partie financés par des crédits ou des dons publics, même si la réalisation des investissements, leur fonctionnement et leur entretien sont délégués au secteur privé. Ceci est le cas pour les affermages en France et les contrats Design, Build, Operate (DBO) aux Etats-Unis.
53. Il y a de nombreux exemples de financement de contrats de partenariat public-privé par des bailleurs de fonds sous forme de crédits bonifiés ou même de dons. Par exemple, la Banque mondiale finance à part entière un contrat de gestion (coût de la prestation du secteur privé, et investissements d’accompagnement) dans la bande de Gaza par un prêt bonifié. Une partie substantielle des paiements est liée à l’achèvement d’objectifs contractuels bien définis et évalués sur base annuelle par des auditeurs indépendants. Dans le cas d’un affermage, la part des bailleurs de fonds dans le financement des fonds d’investissement mis à la disposition de l’opérateur privé peut être décroissante pour donner une incitation à une amélioration du recouvrement des coûts. Le financement bonifié peut aussi être intégré dans des contrats BOT. Par exemple, la station d’épuration Al-Samra en Jordanie a bénéficié d’un don par les Etats-Unis équivalant à la moitié des coûts d’investissements estimés. Cette somme sera mise à la disposition de l’opérateur pour la construction de la station. Dans tous ces cas, les subventions sont définies dans le cahier des charges, de sorte que le prix offert par le moins-disant parmi les concurrents reflète le niveau de cette subvention.
54. L’assistance par les bailleurs de fonds a traditionnellement été axée sur le financement d’intrants. Les résultats étaient parfois décevants. Par exemple, dans de nombreux pays, les rejets des stations d’épuration ne respectent pas les normes environnementales établies. Des lors, se pose la question de savoir comment l’assistance financière peut donner des incitations à une meilleure performance dans les services d’infrastructures.
55. La Banque mondiale a récemment introduit un nouveau concept qui vise à donner précisément ce type d’incitations : le concept de « Output-Based Aid » (OBA), ou aide basée sur les résultats. OBA vise à améliorer la fourniture de services financés par les usagers. En général il est préférable de financer ces services par des redevances-usagers sans financement public. Dans ce cas, des contrats de concessions bien préparés offrent les mêmes incitations que celles visées par l’OBA. Mais dans certains cas il est justifié d’utiliser un financement public pour compléter ou pour remplacer des redevances-usagers : si les usagers ne peuvent pas supporter des tarifs couvrant la totalité des coûts; s’il y a des effets externes positifs; s’il est impossible d’imposer des redevances-usagers directes, et dans certains cas pour faciliter le passage à des tarifs qui permettent de couvrir la totalité des coûts. Dans tous ces cas, l’OBA peut jouer un rôle en conditionnant l’assistance financière aux résultats obtenus par l’opérateur privé, par voie contractuelle claire.
- Page 19 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Encadré 2 : Subventions comme incitations à une meilleure performance : Le Programme Brésilien PRODES dans le secteur de l’assainissement
Au Brésil, les 25 Etats qui constituent la fédération brésilienne sont les principaux responsables de l’assainissement à travers des entreprises publiques. Dans quelques cas, les Etats ont délégué ces services à des entreprises privées. Le gouvernement fédéral accorde des dons aux entreprises publiques ou privées pour couvrir une partie des dépenses d’investissement pour les stations d’épuration. Dans le passé ces subventions ont financé des intrants. Ceci n’a pas résolu le problème de l’entretien insuffisant des stations et du manque d’amélioration de la qualité de l’eau. Pour faire face à cette situation, le gouvernement fédéral a introduit un nouveau système qui porte le nom de PRODES. Le système est administré par un régulateur sectoriel au niveau fédéral, l’Agence Nationale de l’Eau, créée en 2000. Les entreprises publiques d’assainissement ou les entreprises privées sous concession doivent initialement financer la totalité des investissements sur leurs propres ressources. La moitié des dépenses d’investissement estimées sera remboursée par le gouvernement fédéral sur cinq à sept ans par tranches trimestrielles, mais seulement si certains paramètres de qualité de l’eau traitée sont atteints. La qualité de l’eau traitée est mesurée et des rapports doivent être soumis à l’Agence Nationale de l’Eau qui se réserve un droit d’audit. Les paiements trimestriels ne sont effectués que si l’eau traitée est conforme aux normes. Si les normes ne sont pas respectées une première fois, un avertissement est donné et le paiement trimestriel est suspendu. Si les normes ne sont pas respectées la seconde fois, le paiement trimestriel est annulé. Si les normes ne sont pas respectées trois fois consécutives, l’entreprise est exclue du programme et ne recevra plus de paiements. Ceci donne une forte incitation au bon fonctionnement et à l’entretien des stations, et donc favorise l’amélioration de la qualité de l’eau, et a un impact positif sur l’environnement. En bref, le programme ne finance pas de promesse, mais des résultats.
56. Le concept OBA reste à être appliqué de manière plus large dans les projets financés par la Banque mondiale ou par d’autres bailleurs de fonds. Un bon exemple d’application est le cas du financement du réseau d’assainissement de l’eau au Brésil. Les bailleurs de fonds ne participent pas au financement de ce programme. Mais des leçons peuvent cependant être dégagées. Le principe reste le même, même si les acteurs changent : Les fonds peuvent provenir des bailleurs de fonds ou des ressources propres budgétaires; les fournisseurs de services peuvent être des entreprises privées ou publiques; les modes utilisés peuvent être des concessions, des BOT, des affermages ou des contrats de gestion; et le principe de l’OBA peut-être appliqué à n’importe quel secteur de l’infrastructure.
La régulation des services d’infrastructure
57. Les objectifs de la régulation économique6 des services d’infrastructure sont de promouvoir la qualité et le taux de desserte de ces services à des prix efficaces et abordables, tout en garantissant un équilibre entre les intérêts des usagers et des investisseurs. Elle sert comme courroie de transmission entre la politique du gouvernement et la fourniture de services. La régulation des services d’infrastructures est nécessaire, indépendamment de la structure du marché (concurrentiel ou non-concurrentiel) et du statut des fournisseurs de services (public ou privé). Les institutions chargées de la régulation peuvent être, selon le cas, des départements ministériels, des agences de régulation sectorielles ou multi-sectorielles bénéficiant d’un certain degré d’autonomie, d’autres institutions bénéficiant d’un certain degré d’autonomie (par exemple : Conseil de la Concurrence, Commission Supérieur de Marché) et le système judiciaire.
6 La régulation environnementale, de santé et de sécurité n’est généralement pas affectée par l’introduction de la participation du secteur privé. Les réglementations existantes demeurent en place ou elles peuvent être resserrées pour des raisons qui ne sont pas liées à la participation du secteur privé.
- Page 20 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
58. Les fonctions principales d’un système de régulation économique sont les suivantes :
- Déterminer de manière précise, à travers l’élaboration d’un cahier des charges de haute qualité, les obligations des concessionnaires et de l’autorité concédante en matière de fourniture de services et de rémunération ainsi que les règles d’ajustement s’appliquant en cas d’évènements imprévisibles;
- Suivre la performance des concessionnaires par un système d’information détaillé, objectif et fiable sur les coûts et la qualité des services. Ce système devrait réduire l’asymétrie d’information, souvent considérable, qui existe entre les concessionnaires et l’autorité concédante;
- Demander formellement aux concessionnaires ou à l’autorité concédant de se conformer aux cahiers des charges en cas de non-respect;
- Interpréter le cahier des charges pour permettre une décision ferme et objective; - Permettre le recours juridique contre des décisions prises, encourageant ainsi une plus
grande responsabilisation; - Assurer l’exécution des décisions.
59. Il n’existe pas de schéma unique pour la répartition de ces fonctions. Dans certains pays, la régulation de l’infrastructure se fait principalement par les Ministères de tutelle. Le nombre des pays qui ont opté pour l’introduction d’une ou plusieurs agence(s) de régulation augmente constamment. Tandis que peu de pays ont une longue tradition d’agences autonomes de régulation des infrastructures, l’expérience internationale suggère que la création d’agences de régulation améliore souvent l’environnement des affaires. Pour éviter d’être juge et parti, il est primordial qu’aucune institution ne cumule des fonctions de régulation et de fourniture de services.
60. L’introduction de la participation privée déclenche généralement un débat public sur le niveau de la prestation du service et des prix. La participation privée a donc tendance à mettre à jour les questions qui ne reçoivent pas beaucoup d’attention quand les services sont assurés par des monopoles publics. Ce débat peut être très fructueux et un système de régulation économique peut contribuer à le façonner d’une manière rationnelle. Il peut en particulier offrir un cadre pour la collecte des données sur les coûts et les niveaux de qualité de service afin de comparer la performance des prestataires par rapport à une référence bien établie. Ils peuvent également améliorer la transparence en disséminant cette information publiquement sous une forme compréhensible pour les usagers.
61. La législation portant sur l’établissement d’un système de régulation doit être soigneusement conçue pour donner des assurances :
- aux investisseurs que le pouvoir discrétionnaire sera exercé de manière à protéger leurs intérêts légitimes et ne sera pas subordonné à des influences politiques;
- aux consommateurs que le pouvoir réglementaire sera exercé de manière à protéger leurs intérêts légitimes et ne sera pas subordonné à une influence indue de l’industrie réglementée;
- à toutes les parties prenantes que des compétences, une expertise et des ressources suffisantes seront consacrées à ce qui constitue souvent une tâche réglementaire difficile sur le plan technique;
- aux élus que les institutions chargées de la régulation respecteront leur mandat et seront responsables de leur performance.
- Page 21 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
62. Un bon système de régulation constitue un ingrédient clé pour protéger les usagers et pour réduire les risques auxquels les investisseurs font face. La bonne pratique internationale indique que pour bien fonctionner, un système de régulation gagne à respecter certains principes :
- l’objectif de la régulation et les fonctions des divers intervenants sont bien définis; - le système de régulation garantit un haut niveau de transparence; - il existe un moyen de recours aux décisions (en général par le recours aux tribunaux); - des fonctions clés sont déléguées à une ou des agences de régulation qui jouissent
d’un certain degré d’autonomie. Ces quatre principes sont expliqués plus en détails ci-dessous.
63. Les fonctions des Ministères de tutelle et des agences de régulation varient fortement d’un pays à l’autre ou d’un secteur à l’autre. Dans certains pays les agences de régulation ont l’autorité de prendre certaines décisions elle-mêmes sans consultation avec les Ministères de tutelle. Cependant, dans certains pays, les agences de régulation émettent leur avis aux Ministres qui, dans beaucoup de cas, se réservent le droit de décision. Ces avis peuvent porter sur les augmentations de tarifs, l’attribution et la renégociation de contrats de gestion déléguée, l’élaboration de cahiers des charges, leur interprétation et la médiation en cas de conflits. Pour améliorer l’environnement des affaires, les procédures des agences doivent être transparentes, par exemple par la publication d’avis provisionnels pour commentaires avant leur finalisation ou l’obligation de motiver et de divulguer les décisions. Les fonctions varient également d’un secteur à l’autre. Par exemple, les régulateurs des télécommunications porteront leurs efforts sur les régimes d’interconnexion, conseilleront les Ministères sur l’octroi de licences, la répartition des fréquences, ainsi que sur des questions techniques comme la numérotation. Ils peuvent également avoir des fonctions dans la régulation de la concurrence ainsi que dans la médiation entre opérateurs. Les régulateurs du secteur de l’eau ou de la distribution et de la transmission d’électricité toutefois, établiront des plafonds de prix (selon des méthodes de calcul économique précises) pour les concessionnaires privés et assureront le suivi de la qualité du service en utilisant des indicateurs de performance clairement définis.
64. Comme indiqué auparavant, la régulation des services d’infrastructures est nécessaire indépendamment de la structure du marché (concurrentiel ou non-concurrentiel) et du statut des fournisseurs de services concernés (public ou privé). Par exemple, la régulation peut prendre la forme de contrats-programme conclus entre un Ministère et une entreprise publique, comme c’est le cas en Tunisie. Cette forme de régulation a des limites claires en terme d’amélioration de la productivité. Le potentiel d’amélioration de la productivité est freiné, entre autres, par les lourdeurs des procédures relatives aux marchés publics, le manque de base objective pour la compensation de certaines obligations de service public et des obligations implicites notamment en matière d’emploi. Avec le passage partiel de la prestation publique à la prestation privée des services et – dans certains cas - la modification de la structure du marché, l’attention accordée aux coûts et à la qualité des services augmente généralement de manière considérable, les incitations pour une meilleure performance augmentent également, les obligations de service public sont réduites ou bien doivent être compensées, et les tâches de régulation évoluent et deviennent plus complexes. Ces changements dans la régulation économique diffèrent, selon que l’industrie visée fonctionne dans un marché ouvert à la concurrence ou qu’il s’agit d’un monopole naturel.
- Page 22 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
- Dans les marchés concurrentiels il faut surtout garantir des chances égales aux opérateurs publics et privés, et il faut empêcher l’émergence de structures monopolistiques, tout comme dans les secteurs commerciaux.
- Dans les monopoles naturels la régulation des prix, la qualité des services et le maintien d’un niveau d’accès abordable pour les pauvres sont d’une importance capitale.
65. La modélisation financière et économique est une fonction importante dans la régulation des infrastructures. Sans un modèle performant et sans un système de suivi des coûts correspondant, la régulation risque d’être inefficace. Le Test de l’optimisation des ressources (Value for Money Test), utilisé au Japon et au Royaume-Uni, constitue un exemple d’une approche intéressante pour analyser les effets fiscaux de la participation privée. L’approche est résumée ci-dessous. L’Institut de la Banque mondiale a développé une introduction théorique et pratique à la modélisation financière des politiques de régulation qui peut servir aux instances de régulation ou aux Ministères de tutelle pour développer leur capacité en matière de régulation financière. Les modèles d’équilibre financier sectoriels servent à déterminer les coûts efficaces des services et donc le niveau de tarifs approprié. Ces modèles sont très différents des modèles macro-économiques – tel que les modèles d’équilibre général – qui servent à déterminer l’impact de scénarios de réformes sectorielles sur des agrégats économiques tels que l’investissement, la croissance et l’emploi. Les effets fiscaux de la participation privée sont complexes et ne sont souvent pas modélisés ni par les modèles d’équilibre financier sectoriels, ni par les modèles d’impact macro-économique. L’existence de dettes éventuelles pour garantir la viabilité d’entreprises publiques ou découlant de garanties explicites ou implicites (lettres de confort) accordées aux investisseurs privés rendent la modélisation de l’impact fiscal particulièrement difficile. En outre, ils devraient prendre en compte l’effet d’une réduction du déficit budgétaire par la participation privée sur la cotation de la dette publique par les marchés financiers internationaux. D’un autre côté, les coûts de mobilisation du capital du secteur privé dans le cadre du financement de projets à recours limité sont plus élevés et les garanties consenties par l’Etat à des promoteurs privés constituent des engagements éventuels qui peuvent compenser les effets positifs induit par une éventuelle meilleure cotation de la dette.
Encadré 3 : Le test de l’optimisation des ressources (Value for Money Test): une approche innovante de PPI
Le Royaume-Uni a introduit une approche horizontale intéressante en ce qui concerne la PPI dans le cadre de la Private Finance Initiative (PFI) du gouvernement. Selon la PFI, les investissements publics sont soumis à un test d’optimisation des ressources afin d’évaluer si un certain projet d’infrastructure doit être financé et géré par le secteur public ou privé. Comme le secteur privé fournit déjà de nombreux services d’infrastructure, le test est essentiellement appliqué dans les secteurs du transport, de la santé et de l’éducation. Le Japon (où le secteur public fournit une plus grande partie des services d’infrastructure) a également entrepris une « Private Finance Initiative » via le test d’optimisation des ressources.
Le graphique ci-dessous illustre le modèle de comparaison japonais. Il montre que les coûts de construction et d’exploitation sont généralement inférieurs en cas de fourniture par le secteur privé. Par contre, les charges financières sont supérieures et il convient d’ajouter les profits et les impôts. Toutefois, dans le cas d’une fourniture par le secteur public, on ajoute un facteur d’ajustement du risque. Ce facteur tient compte du fait que les dépassements de coûts et les manques d’efficacité sont plus probables dans le cadre d’un arrangement au niveau du secteur public. Le facteur d’ajustement du risque tient également compte d’autres aspects : la neutralité fiscale (les impôts constituent un coût pour le projet mais c’est finalement le gouvernement qui les reçoit), la possibilité de transférer le risque de construction et la capacité des opérateurs du secteur privé de générer des recettes supplémentaires. L’existence du facteur d’ajustement du risque et le niveau de ce facteur ont fait l’objet d’une certaine controverse et d’un débat public. Le fait qu’il soit déterminé de manière objective est dès lors cruciale. Dans le cas du Japon par exemple, c’est un comité composé d’hommes d’affaires et d’universitaires qui détermine le facteur d’ajustement du risque.
- Page 23 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Graphique 4: Comparaison des coûts de l'optimisation des ressources
0
20
40
60
80
100
120
Comparateur secteurpublic
Private FinanceInitiative
Coû
t
Ajustement du risqueImpôtsDividendesFinancesExploitationConstruction
66. La transparence des décisions régulatrices est essentielle. Deux moyens principaux permettent d’obtenir un degré de transparence élevé. Tout d’abord, tous les projets de décision et de recommandation, ainsi que les méthodologies justifiant ces décisions et recommandations, doivent être rendus publics avant de les finaliser. Avant la décision les observations transmises par les parties intéressées doivent être prises en considération. Ensuite, les décisions réglementaires sont accompagnées d’une explication relative au raisonnement sous-jacent. Ces principes de transparence sont suivis, avec certaines variations, par toutes les agences de régulation des services d’infrastructure dans les pays développés et par la plupart des agences dans les pays en voie de développement.
67. La responsabilisation permet de renforcer la crédibilité du système de régulation et d’accroître la confiance du public. Des organes de régulation « autonomes » doivent être responsables vis-à-vis du public à travers la nomination de leurs responsables par la branche exécutive ou législative de l’Etat, la rétention du pouvoir de certaines décisions clés par les Ministères, ainsi que la possibilité de faire appel de décisions au tribunal. La possibilité de démettre un ou plusieurs membres d’une commission de régulation de leur fonction devrait être limitée aux cas clairs d’abus de pouvoir. Pour assurer la responsabilisation des agences de régulation et augmenter le degré de transparence de leurs décisions, on peut également leur demander d’établir un rapport annuel qui sera examiné par le Conseil des Ministres et/ou le Parlement.
68. La bonne pratique internationale indique que, de préférence, la régulation est entre les mains d’une ou de plusieurs agences de régulation bénéficiant d’un certain degré d’autonomie vis-à-vis du gouvernement. La régulation faite exclusivement ou presque exclusivement par les Ministères entraîne des risques qui peuvent se répercuter sous la forme d’une concurrence réduite ou de prix plus élevés, car certains investisseurs décideront de ne se présenter à des appels d’offres et d’autres ajusteront leurs prix par une prime de risque. Selon la perspective du secteur privé, la régulation exclusive par un Ministère peut signifier que les décisions des Ministères sont sujettes à des considérations politiques, comme le souhait de maintenir des tarifs bas dans les secteurs monopolistiques. Dans les secteurs concurrentiels dans lesquels les prestataires publics et privés se font concurrence, il existe le risque que les Ministères biaisent la concurrence et qu’ils favorisent les opérateurs publics.
- Page 24 -

Fondements et principes de la participation privée dans les infrastructures
69. Enfin, les Ministères peuvent avoir des difficultés à payer des salaires suffisants pour attirer et retenir les compétences hautement spécialisées qui sont nécessaires pour s’acquitter des tâches complexes de la régulation. Si l’une ou plusieurs de ces conditions sont satisfaites, la régulation pourrait être entreprise de préférence par des agences avec un certain degré d’autonomie plutôt que par des Ministères exclusivement. Les agences de régulation doivent être protégées contre une influence indue de la part des sociétés réglementées (en empêchant par exemple les employés d’avoir des intérêts financiers dans les industries qu’ils surveillent) et de la part des autorités politiques (en octroyant par exemple un budget autonome à l’organisme de régulation). Une manière d’assurer l’autonomie des régulateurs et d’empêcher qu’ils soient affectés par des interférences politiques arbitraires est de nommer une commission de régulation au lieu d’un seul dirigeant à la tête de l’organe de régulation. Les membres de la commission de régulation seraient nommés pour une période fixe et ne pourraient être démis de leur fonction par un seul Ministre, mais uniquement par le Conseil des Ministres ou même le Parlement. Cette décision ne pourra être prise que pour des raisons limitées qui doivent être spécifiées clairement dans la législation, telles que détournement de fonds ou incompétence flagrante. Les mandats des membres de la commission seraient alternés pour assurer un certain niveau de continuité et de stabilité. Le nombre des membres de la commission pourrait être de trois ou cinq, nombre impair pour éviter d’avoir un résultat nul en cas de vote. La législation peut définir la compétence minimum – technique, économique, financière et juridique – des membres. Les commissions réglementaires devraient être assistées par un secrétariat technique restreint qui serait composé d’un personnel hautement qualifié dont les salaires peuvent être établis à un niveau supérieur à celui des salaires du service public. Les commissions réglementaires basées sur les principes sus-cités existent dans de nombreux pays développés tels qu’aux Etats-Unis pour les commissions de régulation multi-sectorielles au niveau de chaque Etat et en Europe continentale dans le secteur des télécommunications.
70. Des régulateurs multi-sectoriels ont les avantages de combiner l’expertise entre les secteurs et d’offrir une protection plus grande contre les interférences politiques, tout en assurant dans le même temps que les objectifs déterminés sur le plan politique tels que stipulés par la législation soient respectés. Les commissions des services publics qui existent dans chaque Etat des Etats-Unis sont un exemple de régulateurs multi-sectoriels (voir encadré 4). Un tel modèle présente des avantages, comparé à la création d’une multitude d’agences de régulation sectorielles. Dans des petits pays, où la capacité administrative spécialisée est limitée dans chaque secteur, la création d’agences de régulation qui couvrent plusieurs secteurs à la fois présente certains avantages.
- Page 25 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Encadré 4 : Exemples d’agences de régulation de l’infrastructure dans le monde
Aux Etats-Unis et au Canada les services d’infrastructure locaux – eau, assainissement, déchets solides, distribution d’électricité, téléphonie locale, transport urbain – sont soumis à la régulation économique de la part d’agences de régulation multi-sectorielles appelées « Public Utility Commissions » ou « Public Service Commissions » qui existent dans chaque Etat des Etats-Unis et chaque Province du Canada. Ces commissions déterminent les prix des services, attribuent des licences, assurent le suivi de plaintes de la part des consommateurs et ont le pouvoir d’imposer des sanctions aux opérateurs publics et privés. Les membres des commissions sont dans la plupart des cas nommés par le Gouverneur de l’Etat et doivent être confirmés par le Parlement de l’Etat. La régulation économique des services à caractère national – production et transport d’électricité, téléphonie nationale et internationale, transport aérien – aux Etats-Unis est confiée à des commissions sectorielles dont les membres sont nommés par le Président et doivent être confirmés par le Congrès. Les régulateurs au niveau de chaque Etat et au niveau fédéral bénéficient d’une autonomie considérable vis-à-vis de la branche exécutive et de leur propre sources de financement. Les commissions de régulation aux Etats-Unis ont une longue tradition, la plupart ayant été établies dans la première moitié du siècle dernier. Les Etats membres de l’Union Européenne ont récemment créés des régulateurs économiques nationaux pour les télécommunications et, dans la plupart des pays, pour le secteur de l’électricité. Tandis que le Royaume-Uni a également créé des régulateurs pour les secteurs du transport, de l’eau, et de l’assainissement, des agences de régulation économique pour ces secteurs n’existent pas dans la plupart des autres pays de l’UE. Là où des régulateurs existent, leur autonomie est grande, leurs attributions en matière de détermination de prix (prix d’interconnexion dans la plupart des cas) sont grandes, et ils disposent de leurs propres ressources financières. En particulier, le Royaume-Uni a établit ses régulateurs suivant les mêmes principes de base et une même structure pour chaque secteur. Un des problèmes à laquelle la régulation économique a été confrontée est la difficulté d’estimer de façon fiable les coûts des entreprises, ce qui rend la détermination du niveau de prix permettant une rémunération appropriée du capital difficile. En Argentine, le gouvernement a créé des agences de régulation pour chaque secteur, mais avec des approches différentes dans chaque secteur. L’expérience s’est avérée positive au niveau des organismes de régulation du gaz et de l’électricité. Toutefois, les organismes de régulation des télécommunications et de l’eau ont posé des problèmes pour différentes raisons : des difficultés au niveau de la dotation, un manque d’informations pour l’évaluation des coûts et des soucis dus au manque de transparence du processus décisionnel. Dans tous les secteurs, on a observé un manque de précision au niveau des responsabilités des organismes de régulation et de leurs ministères sectoriels. En Bolivie, le gouvernement a créé au milieu des années 90 des agences sectorielles de régulation pour les télécommunications, l’électricité, les chemins de fer, le transport aérien et l’alimentation en eau suivant les mêmes principes et structures. Ces agences sectorielles sont chapeautées par un organisme intersectoriel. Celui-ci apporte une assistance technique aux organismes sectoriels et sert d’instance d’appel en cas de désaccord entre les opérateurs et les agences sectorielles. En Afrique de nombreux pays francophones avec une tradition juridique proche de celle de la Tunisie ont récemment introduit des agences de régulation multi-sectorielles. Par exemple, le Niger vient d’adopter une loi qui envisage la création d’une agence de régulation couvrant tous les secteurs d’infrastructure importants. En Mauritanie, les fonctions de l’agence de régulation des télécommunications ont été élargies pour couvrir également le secteur de l’électricité. Les fonctions du nouveau Conseil National de la Régulation pourront être élargies à d’autres secteurs suivant le rythme des réformes.
- Page 26 -

33.. LLee ccoonntteexxttee ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn pprriivvééee ddaannss lleess iinnffrraassttrruuccttuurreess eenn
TTuunniissiiee
71. Différents éléments déterminent le contexte de la PPI en Tunisie : les conditions macro-économiques, l’environnement des affaires et la stratégie de privatisation hors-infrastructure; les objectifs définis dans le Xème Plan de Développement; l’expérience antérieure en matière de participation du secteur privé dans les infrastructures; les considérations d’emploi; les considérations d’équité; le potentiel du secteur privé tunisien en tant que fournisseur de services d’infrastructure; l’intensification prévue de l’intégration régionale; et finalement les effets économiques de l’introduction de la PPI tels que prévus par des simulations macro-économiques.
Le contexte macro-économique, l’environnement des affaires et le programme de privatisation
72. Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie a poursuivi une politique qui a mené à une amélioration constante et impressionnante des indicateurs de santé économique. Elle a notamment multiplié le revenu réel par habitant par plus de 2,5 et a augmenté considérablement l’accès aux services d’infrastructure. Grâce à ces résultats indéniables, la Tunisie est le leader de la région sur le plan du développement socio-économique.
73. A présent, la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de développement. Cette phase se caractérise par l’intégration régionale, l’intensification de la concurrence et la volonté d’attirer l’investissement étranger direct d’une part et de stimuler la participation du secteur privé local dans tous les secteurs de l’économie d’autre part. Le pays est dès lors confronté à de nouveaux défis. Il doit notamment moderniser le cadre juridique et institutionnel lié à la privatisation et à la participation du secteur privé dans les infrastructures. Par ailleurs, il doit développer et mettre en oeuvre des stratégies sectorielles pour obtenir les réformes nécessaires ainsi que des investissements privés supplémentaires. Sans cela, le pays pourrait avoir du mal à atteindre les objectifs de la réduction du déficit des finances publiques définis dans le Xème Plan approuvé récemment. En outre, la compétitivité de la Tunisie risque de s’éroder : la qualité des principaux services d’infrastructure (dans les secteurs du transport et des télécommunications en particulier) pourrait en effet entraîner un sérieux retard de compétitivité par rapport à certains pays concurrents.
74. L’environnement des affaires en Tunisie est relativement favorable. Il se caractérise par la stabilité politique, macro-économique, mais aussi réglementaire et juridique. Cependant, l’environnement des affaires est plus favorable aux entreprises étrangères (off-shore) qui produisent pour exporter et bénéficient de différentes mesures d’incitation administratives et fiscales. Comme le souligne la « Mise à jour de l’Evaluation du Secteur Privé » de 2000 (« Private Sector Assessment Update »), les entreprises on-shore, comme celles qui se sont lancées dans les infrastructures, ne bénéficient pas des mêmes incitations. L’environnement des affaires des entreprises on-shore semble être relativement moins favorable pour les petites et moyennes entreprises parmi lesquelles certaines fournissent des services d’infrastructure et rencontrent parfois des difficultés sur le plan de l’administration
- Page 27 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
fiscale et de l’accès au crédit7. L’environnement des affaires spécifique du secteur des infrastructures est influencé par l’environnement global, mais aussi, dans une large mesure, par le cadre réglementaire sectoriel.
75. Jusqu’ici, le programme de privatisation de la Tunisie, qui a démarré en 1987, s’est concentré sur les secteurs productifs et sur certaines privatisations dans les secteurs de la finance et des assurances. Certains principes clés ont guidé ces privatisations : la garantie de la viabilité des entreprises via une restructuration avant la privatisation, l’apport de capitaux supplémentaires, l’appel d’offres public et le maintien de l’emploi. Ce sont ces considérations, et non la maximisation du produit de la privatisation, qui ont joué un rôle essentiel au niveau des décisions de privatisation. A bien des égards, cette politique est parvenue à créer un consensus national et à éviter les effets négatifs sur le plan social. Ces principes ont également un rôle à jouer dans toute participation du secteur privé dans les infrastructures.
Le Xème Plan de Développement
76. Le gouvernement tunisien vient de parachever son Xème Plan de Développement.8 Celui-ci porte sur la période 2002-2006. Ce Plan fixe des objectifs ambitieux en ce qui concerne la croissance de l’emploi, du PIB, des investissements et de la part des investissements du secteur privé. Les niveaux relativement élevés de la dette publique extérieure et du déficit des finances publiques limitent le financement public des investissements d’infrastructure. Le gouvernement souhaite réduire ces deux éléments durant la période du Plan. Le Tableau 5 ci-dessous présente les principaux indicateurs du Xème Plan par rapport au IXème.
Tableau 5 : Principaux indicateurs macro-économiques des IXème et Xème Plans
Résultats du IXème Plan (1997-2001)
Objectifs pour la fin du Xème Plan (2006)
Croissance du PIB 5,3 % par an 5,5 % par an
Déficit des finances publiques (part du PIB) 2,9 % 2,0 %
Dette publique 52,3 % (2001) 42,3 %
Investissement privé/Investissement total
55,5 % (2001) 58,5 %
Investissement/PIB 25,5 % 25,7 %
Croissance de l’emploi 320.000 380.000
7 Ces questions ont été abordées dans la « Mise à jour de l’Evaluation du Secteur Privé en Tunisie » (« Private Sector Assessment Update for Tunisia ») de décembre 2000 réalisée par la Banque mondiale. Elles font également l’objet d’autres études et projets. Elles ne seront dès lors pas abordées de façon détaillée dans ce document. Certaines questions liées à l’environnement des affaires sont également traitées dans une étude relative au système d’incitation à l’investissement privé lancée récemment et menée par le Service conseil pour l’investissement étranger (Foreign Investment Advisory Service) de la SFI. 8 La version intégrale du Volume II (contenu sectoriel) dans sa traduction française n’était pas disponible au moment de la rédaction de la version pré-définitive de ce rapport. Le Rapport-Diagnostic tient donc compte uniquement du Volume I (contenu global) du Xème Plan.
- Page 28 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
77. Le IXème Plan prévoyait d’importants investissements privées dans le domaine des infrastructures, de l’ordre de 340 MDT dans le secteur des communications, ainsi que des concessions dans les secteurs des transport et de la production d’électricité.9 A l’exception de la production électrique, ces investissements privés sont restés en deçà des attentes. La faiblesse de l’investissement privé dans les infrastructures a contribué à ce que l’objectif pour le ratio de l’investissement privé dans l’investissement total fixé dans le IXème Plan ne soit pas atteint.10
L’expérience de la Tunisie en matière de PPI
78. L’expérience de la Tunisie dans le domaine de la participation privée dans les infrastructures reste limitée (Cf. le Tableau 6). Jusqu’ici, seulement deux contrats de concession/BOO important ont été conclus: celui de la centrale électrique Radés II, signé en 1997, et celui de la seconde licence GSM octroyée en mai 2002.11 Un certain nombre de contrats de gestion dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et des déchets solides a également été conclu.
Tableau 6 : Marchés PPI conclus en Tunisie
Secteur Nom Méthode
Opérateur/ promoteur
Date de passation du
Marché
Télécommunications
2ème licence GSM
Licence Consortium dirigé par Orascom Egypte 2002
Electricité Radés II BOO Consortium composé de PSEG/Marubeni/Sithe
(Etats-Unis/Japon) 1997
Assainissement El Menzah CG SOMEDEN (France/Tunisie) 1997
Assainissement Tunis Nord CG SOBATAM (Tunisie)
-
Assainissement El Mourouj et autres CG SOBATAM
(Tunisie) 2002
Evacuation des résidus solides
Grand Tunis CG SOMAGED (Tunisie) 2000
Enlèvement des ordures ménagères
36 petits contrats
actuellement
CG Plusieurs - tunisiens pour la plupart depuis 1997
CG : Contrat de Gestion - BOO : Build, Own and Operate (contrat de construction, propriété, exploitation).
9 Le IXème Plan de Développement (1997-2001), Volume II, Contenu sectoriel, pp. 64, 78 et 116. 10 L’objectif moyen durant la période du IXème Plan était de 56%, tandis que seulement un coefficient de 53.9% a été réalisé. 11 La Tunisie a également octroyé deux concessions pour l’Office national des Pêches et pour une boutique hors taxes (Freeshop). Toutefois, on ne peut les considérer comme des concessions d’infrastructure en soi.
- Page 29 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
79. Le Xème Plan (2002-2006) comprend un certain nombre de grands projets d’infrastructure qui seraient financés et gérés par le secteur privé. En outre, il est prévu que les technologies de l’information et des communications (TIC) joueront un rôle clé au niveau de la création d’emplois et de croissance.
80. En particulier, le Xème Plan prévoit:
- « la mise à niveau des aéroports, des ports et l’amélioration des services et prestations ce qui est de nature à conférer plus de concurrence dans le secteur, renforcer l’investissement, développer le transport multimodal et développer les services de transport en commun public (…) dans le cadre de concessions »;
- « l’ouverture de nouvelles perspectives à l’initiative privée à travers l’abandon par l’Etat de la réalisation ou de la gestion directe de certains services publics et ce par le moyen de la concession, de la sous-traitance ou de la limitation du domaine d’intervention du secteur public. Cela concerne notamment la réalisation et l’exploitation de l’aéroport du Centre, la production d’électricité, la réalisation et l’exploitation des ports, des quais et des activités qui leurs sont liées, la réalisation et l’exploitation d’autoroutes et de stations d’épuration», et;
- « le changement du statut juridique de certaines entreprises publiques importantes qui disposent de situation de monopole sur le marché et leur transformation, dans une première étape, en sociétés commerciales et l’ouverture de leurs capitaux par le lancement d’offres publiques de vente ou la recherche de partenaires, dans une deuxième étape. »12
81. Le Tableau 7 présente les investissements en infrastructure réalisés au cours du IXème plan et ceux prévus pour le Xème Plan, et ce, par secteur et par source de financement (privé ou public). Ce tableau montre que l’on prévoit la majeure partie des investissements du secteur privé dans les infrastructures de télécommunications et des transports maritime et aérien.13
82. Mise à part l’expérience positive en matière de délais d’attribution du marché de la concession pour la centrale électrique de Radès II, il semble que la confiance du secteur privé dans certains cas a été érodée en raison de retards dans la finalisation ou de modifications des transactions en cours. On a par exemple observé plusieurs retards au niveau du démarrage de la procédure d’adjudication pour le contrat BOT de la station d’épuration des eaux usées du Grand Tunis. Dans le secteur des télécommunications, le premier appel d’offres pour la seconde licence GSM fut déclarée infructueux en raison des soumissions jugées trop basses. Le montant de l’offre retenue lors du second appel d’offres dépassait l’offre précédente de 73 millions de dollars US. Toutefois, ce gain doit être comparé à la perte d’opportunité en matière de gain d’efficacité que l’on aurait pu obtenir au niveau de l’économie si l’on avait octroyé la licence plus tôt.
12 Le Xème Plan de Développement 2002-2006, Volume I, Contenu Global, pp. 105 et 113. 13 Les investissements privés prévus au niveau de l’irrigation et de la gestion des ressources naturelles ne sont pas pris en considération. On estime en effet qu’il s’agit d’investissements à petite échelle, éparpillés, réalisés par des agriculteurs sur leurs propres terres. Par conséquent, ils ne sont pas de la même nature que les investissements en infrastructure auxquels cette étude s’intéresse. Par ailleurs, les politiques sectorielles indiquent que l’on prévoit des investissements privés dans les secteurs de l’électricité et de l’assainissement bien que les chiffres du Xème Plan ne montrent pas d’investissement privé dans ces secteurs.
- Page 30 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Tableau 7 : Investissements dans le secteur des infrastructures (en millions de dinars tunisiens – prix courants)
IXème Plan Xème Plan (Objectifs) Total Public Privé Total Public Privé 1. Communications 1 394,6 1 286,6 108 2 839,5 1 739,5 1 100 Télécommunications 1 064 1 064 2 600 1 500 1 100 Autres 330,6 222,6 108 239,5 239,5 2. Transport 2 491,5 2 491,5 4 845,4 3 505,4 1 340 Routes 1 891,5 1 891,5 2 795 2 795 Tr. Maritime 130 130 942,3 187,3 75514 Chemin de fer 290 290 375,4 375,4 Tr. Aérien 180 180 732,7 147,7 58515 3. Eau 2 099 2 099 p.d. 2 551 1 901 650 SONEDE 285 285 498,5 498,5 Ressources en eau16 1 602 1 602 p.d.. 1 905 1 255 65017 Autres 212 212 147,5 147,5 4. Assainissement 592,5 518,5 74 748,8 658,8 90 ONAS 397 397 524,9 524,9 Autres 195,5 121 74 223,9 133,9 90 5. Environnement 438,7 438,7 613,3 613,3 Gestion des déchets solides 28,5 28,5 95,7 95,7 Lutte contre la pollution
industrielle 141,7 141,7 239,6 239,6
Protection des mers et des côtes 116,1 116,1 128,1 128,1
Protection contre les crues 57,6 57,6 105 105 Autres 152,4 152,4 149,9 149,9 6. Gaz et électricité 1 698 1 698 p.d. 2 524 2 524 Electricité18 1 611 1 611 2 092 2 092 Gaz 87 87 432 432 7. Autres 1 639 1 639 p.d 1 908,6 1 693,6 215 Gestion des ressources
naturelles autres que l’eau19 779 779 p.d. 1 020 805 21520
Infrastructures municipales et urbaines 860 860 888,6 888,6
Total21 10 410,9 p.d. 16 135,6 12 740,6 3 395 100 % 100 % 73,4 % 26,6 %
Note : Ces chiffres ont été tirés de différents chapitres du Xème Plan. Une comparaison entre l’investissement privé pendant les périodes des IXème et Xème Plans n’est pas possible pour cause de manque de données. p.d. = pas disponible
14 Dont 500 pour un nouveau port. 15 Nouvel aéroport Centre-Est. 16 Ventilation privé-public pour le IXème plan non incluse. 17 Modernisation de l’irrigation. 18 Il n’est pas clair pourquoi les investissements privés en électricité réalisés au cours du IXème plan (selon le tableau) ne comprennent pas l’investissement dans le BOO de Radès II (260 millions de dollars US). 19 Ventilation privé-public pour le IXème plan non incluse. 20 Ces investissements sont liés à l’agriculture. 21 Se référer aux notes relatives à la ventilation privé-public pour le IXème Plan.
- Page 31 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
L’engagement du secteur privé tunisien dans la fourniture de services d’infrastructure
83. Jusqu’ici, le secteur privé tunisien a participé à la fourniture de services d’infrastructure dans une faible mesure, et sa contribution au financement des infrastructures était quasi nulle. Le secteur privé tunisien s’est essentiellement engagé dans la fourniture de services dans les secteurs portuaire, des déchets solides et de l’assainissement (exploitation de réseaux d’égouts). Dans tous les cas, cet engagement s’est limité à la mise en place de contrats de gestion avec des obligations d’investissement minimales. Il s’agissait surtout d’investissements en véhicules et en équipement. Dans certains cas, des entreprises tunisiennes opérant seules ont décroché les contrats. Dans d’autres, des entreprises tunisiennes et étrangères ont uni leurs forces (avec l’entreprise étrangère à la tête).
84. Au début de l’année 2002, une petite enquête a été menée auprès d’opérateurs tunisiens dans les secteurs mentionnés ci-dessus sur l’initiative de la Banque mondiale et en coopération avec le MDCI. Cette enquête n’est pas représentative statistiquement mais elle met quand même en évidence quelques points intéressants. Il en ressort notamment que la lenteur de l’attribution des nouveaux marchés et la courte durée des contrats ont déçu certains opérateurs. La loi limite les contrats à cinq ans, ce qui a découragé les opérateurs privés de réaliser des investissements et d’améliorer leur technologie. Certains ont constaté qu’une stratégie de privatisation de la part du gouvernement dans leur secteur respectif faisait défaut. D’autres ont évoqué le fait que les cahiers des charges étaient trop détaillés et comportaient des obligations peu réalistes alors que l’administration était inflexible au niveau de la supervision des contrats. Les opérateurs ont relevé la difficulté d’accéder à des crédits d’infrastructure, notamment parce que les banques n’avaient pas l’habitude de prêter des fonds à des entreprises de ce secteur. Certaines entreprises se sont également plaintes des avantages fiscaux et autres octroyés à leurs concurrents du secteur public. Finalement, certaines sociétés tunisiennes ont craint d’être reléguées au simple rôle d’intermédiaire local d’entreprises internationales. Le secteur privé tunisien a notamment demandé une clarification des stratégies de participation privée pour leur secteur respectif, des réformes législatives permettant d’établir des contrats de plus longue durée ainsi qu’une approche plus réaliste et plus flexible pour la conception et l’application des contrats.
Les questions d’emploi
85. L’introduction de la PPI influence le marché de l’emploi à différents niveaux. Elle entraîne: (i) la création d’emplois par les nouveaux venus; (ii) la création indirecte d’emplois grâce à la croissance du PIB suscitée par la baisse des coûts et la hausse des performances à la suite des réformes sectorielles et, finalement, (iii) des pertes dans les emplois en surnombre des entreprises publiques en raison de la restructuration, de la commercialisation et de l’introduction de nouvelles technologies et de méthodes de gestion modernes.
86. Les effets indirects des réformes du secteur des infrastructures sur l’emploi ont été évalués pour le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’étude TIC de la Banque mondiale de mars 2002 a estimé qu’il y aura jusqu’à 20.000 nouveaux emplois créés entre 2002 et 2006 dans le secteur lui-même et que 65.000 emplois supplémentaires seront créés indirectement dans d’autres secteurs, si un calendrier de réformes ambitieuses est respecté. Ces gains d’emplois dépasseront largement les réductions d’emploi au niveau des opérateurs existants. En revanche, si les réformes restent modestes, le
- Page 32 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
gain d’emploi direct et indirect dans la même période sera plutôt de l’ordre de 25.000 emplois.
87. On s’attend également à d’autres effets indirects importants sur l’emploi suite aux améliorations de performances dans le secteur du transport, en particulier en ce qui concerne le transport multimodal, les aéroports et les ports.
88. En ce qui concerne la mobilité des employés entre le secteur public et le secteur privé, la législation actuelle ne permet pas la mise en disponibilité des fonctionnaires pour un emploi dans le secteur privé. Dans certains cas, les prestataires de services privés préfèrent engager et former leur propre personnel sans recruter le personnel des entreprises publiques. Cependant, même si l’opérateur privé souhaite engager du personnel de l’agence et que ce personnel désire être transféré vers le secteur privé, des obstacles juridiques gênent un tel transfert. Lorsque les employés doivent choisir de quitter définitivement le secteur public et de perdre leur sécurité d’emploi et leur droit à la pension ou bien de rester dans ce secteur, la plupart d’entre eux choisissent d’y rester. Par ailleurs, les salaires en vigueur dans certaines entreprises publiques tunisiennes sont relativement avantageux. Toutefois, si les offres d’emploi viennent d’employeurs privés avec des concessions à long terme, l’emploi à long terme dans le privé peut être plus intéressant pour les travailleurs du secteur public. L’augmentation de la flexibilité de la législation existante en matière d’emploi pourrait profiter tant aux travailleurs qu’aux entreprises nouvelles venues sur le marché.
89. Il est difficile d’estimer l’étendue des pertes d’emploi potentielles dans les entreprises publiques qui fournissent des services d’infrastructures sans avoir une idée précise de l’étendue et du rythme des réformes dans chaque secteur. Il semble toutefois que les ratios de dotation des services publics tunisiens en terme de personnel par branchement soient inférieurs à ceux des services publics de certains autres pays de la zone MENA, ce qui semble indiquer que des pertes éventuelles d’emplois pourraient être évitées ou limitées. De plus, la croissance de la fourniture de services d’infrastructure génère un besoin d’emplois supplémentaires. En d’autres termes, l’emploi excédentaire possible pourrait être absorbé dans une certaine mesure par une réaffectation des employés au sein de l’entreprise. Il serait également possible de réduire les effectifs via des départs en retraite et pré-retraite. S’il se révélait nécessaire de prendre des décisions qui résultent en des pertes d’emplois, il conviendrait d’utiliser des mécanismes de compensation tels que le FREP (Fonds en charge de l’indemnisation des personnels des entreprises publiques). La mise en place de procédures pour le reclassement du personnel licencié ou l’aide à la création de petites entreprises de service par le personnel sont des mesures très positives qui complètent sur le plan qualitatif les primes de départ.
Equité et services d’infrastructures en Tunisie
90. La solidarité nationale est une partie intégrale de la politique socio-économique du gouvernement tunisien depuis l’indépendance. L’infrastructure n’échappe pas à ce maillon essentiel de la politique gouvernementale.
91. L’analyse de l’équité, de la pauvreté et leurs liens à l’infrastructure est un domaine complexe. Cette étude ne prétend pas couvrir ces aspects dans sa complexité, comme cela ne faisait pas partie des objectifs fixés pour l’étude. Néanmoins il est évident que les aspects sociaux revêtent un caractère essentiel dans la politique d’infrastructure en Tunisie, et qu’une stratégie de promotion de la participation privée dans les infrastructures devra inclure des
- Page 33 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
mesures pour assurer que les acquis considérables de la Tunisie dans ce domaine seront préservés.
92. Les aspects sociaux sont d’une importance toute particulière dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, vu le caractère essentiel que revêt l’approvisionnement en eau potable et son évacuation dans des conditions sanitaires appropriées. A travers des Contrats-Programmes quinquennaux le gouvernement a encouragé de longue date la SONEDE et l’ONAS à accroître leur desserte dans les régions urbaines et dans les zones rurales à habitat aggloméré. Un effort particulier a aussi été fait pour desservir les zones rurales à habitat dispersé en eau potable et en assainissement à travers la Direction du Génie Rural du Ministère de l’Agriculture. Dans le secteur électrique, la STEG a été également encouragée d’accroître la desserte en augmentant le taux de raccordement au réseau. Le gouvernement a également poursuivi une politique d’encouragement de l’électrification des zones rurales à habitat dispersé, notamment par des systèmes photovoltaïques. La volonté de ne pas marginaliser les zones rurales est également nette dans le secteur des télécommunications, où la création des centres publics d’accès au téléphone (publitels/taxiphones) et à l’Internet (publinets) a été encouragée à travers le territoire national. Ces centres sont établis avec une subvention publique et leur fonctionnement est sous-traité à des petits entrepreneurs locaux.
93. Les résultats de cette politique ressortent du Tableau 8 qui compare les taux de desserte en Tunisie à ceux d’autres pays de la région MENA :
Tableau 8 : Taux de desserte de l’eau potable, de l’assainissement et de l’électricité en
Tunisie, Algérie et au Maroc
Pays Tunisie Algérie Maroc Urbain 100% 90% 98% Eau Rural 82% 47% 57% Urbain 96% 90% 90% Assainissement Rural 62% 47% 39%
Électricité Global 97% 98% 55% Source: Rapport de diagnostic pour la Tunisie; WHO/UNICEF pour l’eau et l’assainissement en Algérie et au Maroc; Association Internationale de l’Energie en Algérie et au Maroc. 94. Le taux de desserte élevé a notamment été accompli dans le cadre d’un système dans lequel la totalité des coûts est recouverte (ou au moins une grande partie dans le cas de l’assainissement) et la pérennité des systèmes a été éprouvée grâce à des entreprises publiques performantes, et grâce à la participation des usagers à travers des groupements d’intérêt collectif dans des régions rurales. L’amélioration de la desserte en milieu urbain a également été aidée par une politique de réhabilitation de l’habitat spontané qui a permis de brancher des quartiers dont les habitants sont souvent parmi les plus pauvres à l’eau potable, l’assainissement et l’électricité.
95. La politique tarifaire contribue également à l’équité par le biais de (i) des crédits de branchement; (ii) une péréquation entre catégories d’usagers; et (iii) une péréquation implicite à travers une tarification progressive. Les crédits de branchement sont accordés aux ménages qui sont incapables de payer les frais de branchement en une seule fois, leur permettant de rembourser ces frais sur plusieurs années avec intérêt en appliquant une
- Page 34 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
surcharge moyenne sur la facture de l’eau. Par exemple, dans les régions rurales couverts par la SONEDE le remboursement se fait sur une période de huit ans avec un taux d’intérêt de 8.25%. La péréquation entre groupes d’usagers se fait en appliquant un tarif moyen plus élevé pour les usagers touristiques et industriels, ce qui permet d’offrir des tarifs plus modestes pour les ménages. Finalement, la tarification progressive pour les ménages signifie une péréquation implicite entre les usagers à fort volume et les usagers à volume faible, qui sont souvent ceux aux revenus les plus faibles. Les détails de la tarification sont inclus dans le rapport de diagnostic (Annexe 1).
96. Dans le secteur électrique la péréquation entre catégories d’usagers est apparemment moins prononcée que dans le secteur de l’eau potable, les tarifs industriels étant plus faibles que les tarifs ménagers, ce qui reflète la structure des coûts. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour indiquer si une péréquation existe tout de même et pour estimer son importance.
97. La politique de solidarité nationale dans le domaine de l’infrastructure en Tunisie se traduit par des résultats impressionnants. Les indicateurs de santé sont meilleurs que dans les pays de la région à revenu comparable. Par exemple, le taux de mortalité enfantine est de 26 pour 1000 en Tunisie, contre une moyenne de 43 pour 1000 pour la région MENA. L’incidence de la pauvreté est relativement basse avec une incidence de la pauvreté autour de 7%.
98. L’introduction de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie ne signifie pas que ces acquis seraient menacés. Au contraire, la fonction publique en tant qu’autorité concédante pour des contrats de gestion déléguée peut et devrait imposer aux opérateurs publics de continuer d’appliquer la politique de solidarité nationale en continuant d’appliquer les mêmes principes de tarification et d’accroissement de la desserte que ceux imposés aux entreprises publiques dans le cadre de Contrats-Programmes. La tâche du secteur privé sera de trouver des moyens plus efficaces pour achever les mêmes objectifs sociaux, et donc de limiter les augmentations de tarifs et les besoins de subvention.
L’intégration régionale et les services d’infrastructure
99. L’intégration régionale joue également un rôle important dans l’approche tunisienne de la participation privée. Les réformes des infrastructures contribuent à l’intégration régionale mais sont également influencées par celle-ci. Les services de télécommunications sont indispensables pour les contacts d’affaires internationaux et jouent également un rôle déterminant dans les décisions d’investissement des entreprises étrangères, tout comme des réseaux de transport multimodal efficaces (transports maritime, aérien, routier et ferroviaire) sont cruciaux pour le commerce et le tourisme. L’interconnexion des réseaux de gaz et d’électricité avec les pays voisins peut permettre d’augmenter considérablement l’efficacité de ces secteurs, en particulier dans les petits pays. L’amélioration des services d’infrastructure développe l’intégration régionale et est également influencée par celle-ci dans trois secteurs en particulier : les télécommunications, le transport et le gaz et l’électricité. Par conséquent, il peut être utile d’aligner le cadre réglementaire sectoriel sur celui des principaux partenaires commerciaux.
100. Il est intéressant de noter qu’un grand nombre des réformes réglementaires requises pour l’intégration régionale des services sont également nécessaire sur un plan strictement sectoriel. C’est notamment le cas de la suppression des statuts d’exclusivité ou des
- Page 35 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
réglementations en matière d’accès au marché et d’interconnexion. L’Union européenne (UE) possède un cadre politique détaillé pour la plupart des secteurs des infrastructures. La majeure partie de ses lois, règlements et institutions vont dans le sens des changements internationaux les plus récents. En outre, en dehors de certaines règles et certains principes essentiels, ce cadre permet une grande diversité entre les différents pays membres et entre les secteurs. L’harmonisation avec certaines règles clés de l’UE, tout en maintenant les spécificités tunisiennes, permettrait de diminuer les barrières réglementaires par rapport au marché unique de l’UE, mais aussi d’envoyer un signal positif aux investisseurs, en leur montrant que la Tunisie prévoit d’augmenter progressivement son intégration économique avec l’UE. Comme le montre le Tableau 9, l’impact des bonnes pratiques régionales sur les réformes du secteur des infrastructures et l’impact des infrastructures sur l’intégration régionale varient selon le secteur.
Tableau 9 : La pertinence de l’intégration régionale pour les secteurs
des infrastructures et vice versa
Secteur L’intégration régionale a un
effet sur le secteur
Les performances du secteur ont un effet
sur l’intégration régionale
Télécommunications
Transports aériens et maritimes
Aéroports et ports
Chemins de fer
Routes
Gaz et électricité
Eau et assainissement
Gestion des déchets solides Légende :
Rôle clé Rôle limité Aucun rôle significatif
Source : Compilation des auteurs 101. En ce qui concerne l’intégration Euro-Méditerranéenne et le dialogue au niveau de l’OMC, plus vite la Tunisie commencera à préparer les réformes du secteur des infrastructures au niveau national et à les appliquer, plus vite elle pourra arriver à des accords avec ses partenaires commerciaux sur le commerce des services. Le programme de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS, connu aussi par son acronyme anglais GATS) ou les amendements apportés à l’accord d’association avec l’UE en ce qui concerne les services permettraient en fait au gouvernement tunisien d’ancrer les réformes au moyen d’accords internationaux et d’envoyer ainsi un signal fort à la communauté des investisseurs. Le choix des secteurs dans lesquels la Tunisie va prendre des engagements dans le cadre du GATS doit néanmoins être fait de manière prudente, vu que ces engagements sont difficilement réversibles. Il est donc préférable que la Tunisie prenne des engagements de
- Page 36 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
libéralisation dans des secteurs où le retour à une gestion par le secteur public est définitivement exclu.
102. La Tunisie fut le premier pays méditerranéen à signer un Accord d’Association bilatéral avec l’UE. Cet Accord est entré en vigueur en mars 1997. L’Accord d’Association entend contribuer à l’établissement d’une zone Euro-Méditerranéenne de libre-échange d’ici à 2010. Le commerce des services (y compris les télécommunications, le transport et l’électricité) jouera probablement un rôle important dans les voies bilatérales et multilatérales de dialogue de la Tunisie avec l’UE. En ce qui concerne la voie bilatérale, le Titre III (Droit d’établissement et services) de l’Accord d’Association stipule que « les parties conviennent d’élargir le champ d’application de l’accord de manière à inclure le droit d’établissement [...] et la libéralisation de la fourniture de services ». Il stipule par ailleurs que « la réalisation de cet objectif fera l’objet d’un premier examen par le Conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord »22. Le nouveau cycle de négociations multilatérales, convenu lors de la réunion de l’OMC à Qatar en novembre 2001, donne un nouvel élan à la libéralisation du commerce des services. Cette libéralisation du commerce des services (dont les services d’énergie, de télécommunications et de transport) dans le cadre de l’AGCS constituera en effet l’une des priorités du nouveau cycle de négociations. Toute libéralisation du commerce des services d’infrastructure nécessitera des réformes réglementaires auxquelles le gouvernement tunisien pourrait s’engager dans le cadre d’une stratégie de PPI.
Les aspects juridiques de la PPI
103. Un rapport détaillé sur les aspects juridiques se trouve dans le Volume III de l’étude. Celui-ci résume les aspects juridiques suivants :
- l’opportunité d’une loi sur les partenariats publics-privés dans les infrastructures (« loi sur les concessions ») et d’une Commission Supérieure de Concession;
- les points forts et les points faibles de la législation sectorielle en vigueur en Tunisie en matière de gestion déléguée des services publics;
- d’autres aspects juridiques à caractère horizontal qui ont une influence sur l’environnement des affaires en ce qui concerne la participation privée dans les infrastructures.
Loi sur les concessions
104. A l’exception de la législation spécifique relative à la concession de production privée d’électricité, le régime des concessions pour tous les autres secteurs susceptibles d’une participation privée résulte de textes épars insérés dans les législations spécifiques régissant lesdits secteurs.
105. Cela nous amène à nous poser la question sur l’opportunité de l’adoption d’un code des concessions qui définirait la notion de concession et qui établirait le régime juridique des concessions en Tunisie.
22 En ce qui concerne la voie multilatérale, on s’attend à ce que le processus d’intégration régionale aille au-delà de la libéralisation des échanges de marchandises durant la prochaine décennie. Au cours d’une réunion des ministres Euro-Méditerranéens du commerce en mai 2001, un groupe de travail a été mis sur pied afin d’examiner cette question au niveau régional.
- Page 37 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
106. Pour un pays comme la Tunisie, il serait préférable d’avoir une loi spécifique sur les concessions. Le droit tunisien est plus un droit écrit qu’un droit coutumier. Il est plus fondé sur une réglementation écrite, claire et précise que sur des coutumes ou une jurisprudence bien établies. Par ailleurs, la nouvelle loi sur les marchés publics ayant exclu expressément les concessions de son champ d’application, la nécessité d’une loi sur les concessions est encore plus pressante.
107. Cette loi, sans avoir pour objectif de se substituer aux différentes législations sectorielles se limitera à mettre en place les principes de base et les règles à respecter pour la conclusion de conventions de concessions.
108. C’est ainsi que cette loi devra tout d’abord établir les principes fondamentaux sur lesquels sera fondé tout processus d’octroi d’une concession.
Ces principes seraient :
- l’égalité des candidats, - le recours à la concurrence et les cas exceptionnels où le gré à gré serait permis, et - la transparence des procédures.
109. Cette loi pourra aussi établir le contenu d’une convention de concession et du cahier des charges qui lui sera annexé. Elle pourra définir aussi bien la notion de concession que celle des concepts voisins, tels que l’affermage et éventuellement les contrats de gestion et de sous-traitance, et déterminer le régime juridique applicable à chacune de ces notions. Elle pourra également prévoir des délais et des procédures plus courtes pour l’attribution des concessions en vue d’éviter que les conditions économiques ayant présidé à l’octroi d’une concession ne soient plus d’actualité au moment de son attribution. Cette loi devra aussi établir le principe que la durée de la concession prenne en considération le temps nécessaire à l’amortissement de l’investissement réalisé par le concessionnaire.
110. La promulgation d’une loi sur les concessions pourrait être aussi une opportunité pour définir la notion de service public. En effet et contrairement à d’autres pays, il n’existe pas en Tunisie une jurisprudence claire et explicite sur la notion de service public.
111. Le recours au tribunal administratif ne fait pas partie des us et coutumes bien ancrés dans les mœurs tunisiennes et la jurisprudence administrative tunisienne existante est insuffisante pour servir de base pour la définition d’un concept aussi important.
112. Définir la notion de service public, bien qu’il ait pour inconvénient de figer un concept qui peut être mouvant, a pour avantage de cerner clairement et juridiquement une notion importante, aussi bien dans l’octroi de la concession que dans le contentieux y relatif. Une concession pouvant être retirée pour non continuité du service public. Dans le cadre de la définition de la notion de service public, le Code devrait établir les attributs fondamentaux de cette notion, autrement dit, le principe de la continuité du service public et celui de la neutralité du service public ou de l’égalité des usagers à l’égard du service public.
113. La loi sur les concessions devrait aussi définir la notion de domaine public et de ses attributs, tels que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public. Les raisons de cette définition sont les mêmes que celles évoquées pour la notion de service public.
- Page 38 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Encadré 5 : L’expérience internationale en matière de lois sur les partenariats public-privé
L’augmentation considérable du nombre de projets d’infrastructure à financement privé au cours des deux dernières décennies a entraîné, dans de nombreux pays développés ou en voie de développement, l’adoption de législations cohérentes et adaptées aux partenariats public-privé (PPP). Ces législations, qui varient d’un pays à l’autre, reflètent non seulement le contexte juridique propre à chaque pays mais aussi son engagement en faveur de la promotion des partenariats public-privé. Dans les pays de tradition latine, les traités de concession restent des ensembles contractuels relativement simples, le droit des contrats (par exemple la jurisprudence du Conseil d’Etat ou le code civil en France) fournissant les règles supplétives nécessaires. En France, ce système qui différencie clairement les marchés publics des délégations de service public pose cependant quelques difficultés juridiques pour la mise en œuvre de certains nouveaux projets, notamment ceux inspirés du modèle anglais de la PFI (Private Finance Initiative). Dans les pays de Common Law, au contraire des pays de tradition latine, les contrats de concessions sont souvent composés de nombreuses annexes destinées à suppléer l’absence de droit écrit. Dans les pays en développement, on a pu observer ces dix dernières années des efforts importants de mise en place de cadres législatifs propres aux PPPs. De nombreux pays en Europe de l’Est (Albanie, Bulgarie, Hongrie…), en Asie (Philippines) et en Amérique Latine (Brésil, Chili, Colombie) ont ainsi adopté une loi sur les concessions, tandis que d’autres pays optaient plutôt pour la promulgation de lois sectorielles ad hoc pour pallier les insuffisances de législation (Pologne, République Tchèque…), ou de lois générales autorisant la participation privée dans les infrastructures (Thaïlande, Vietnam). Certains pays ayant adopté une loi sur les concessions (sectorielle ou multi-sectorielle) ont cependant été amenés à amender ou réécrire leurs textes pour faire face à divers problèmes liés à leur application. En cause, souvent, la « reproduction » à la hâte de lois provenant de législation étrangères, peu adaptées au contexte juridique local. Enfin la Chine a préféré adopter une approche intermédiaire à celles citées précédemment. Le pays a choisi d’identifier des projets pilotes qui pourraient se baser sur des contrats-types ou modèles par secteurs d’activité. En conclusion il convient de rappeler que, quel que soit le modèle juridique choisi, deux principes fondamentaux doivent être respectés : 1) Il est essentiel, pour les pays, de combler leur vide juridique en matière de PPP; 2) Toute nouvelle loi sur les PPP doit être impérativement adaptée au contexte juridique local. Sources : UNCITRAL – « International efforts to promote and harmonise concession law »; Ministère de l’Equipement, des Transports et de l’Equipement – « Financement des infrastructures et des services collectifs »; Gide Loyrette Nouel – « The role of concession laws in the successful implementation of Public-Private Infrastructure Projects », PPMI Article : http://www.ppmi.org/documents/newsletters/NewsletterArticles/Article-Newsletter18-July-Aug-03.pdf
114. Par ailleurs, une loi sur les concessions se doit de couvrir aussi bien les concessions de service public que les concessions du domaine public, d’autant plus que sur un plan pratique, les opérations de concession de services publics s’accompagnent souvent d’opérations de concession de domaines publics. La concession de production d’électricité par exemple, s’accompagne souvent de la concession du terrain sur lequel sera implantée la centrale. La concession d’exploitation d’un port commercial s’accompagne de la concession du domaine public maritime où s’exerce cette activité, et éventuellement de l’infrastructure existant déjà sur le site concédé.
115. Une loi sur les concessions définissant clairement les notions de service public et de domaine public, est de nature à rassurer les investisseurs étrangers non familiers avec les lois tunisiennes et qui seraient plus rassurés par une législation claire et écrite qu’une législation fondée sur des concepts doctrinaux ou jurisprudentiels comme elle existe actuellement dans ce domaine en Tunisie.
116. Une loi sur les concessions qui viendrait à s’appliquer de manière supplétive par rapport aux législations sectorielles déjà existantes, aurait les avantages suivants :
- Elle ne nécessiterait aucune réforme des législations sectorielles en place, celles-ci étant supposées plus adaptées aux secteurs concernés;
- Page 39 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
- Elle donnerait une ligne directrice aux différents organismes sectoriels devant se prononcer sur l’octroi d’une concession à un opérateur privé, ou sur le contenu de la convention de concession à établir ou encore sur celui du cahier des charges l’accompagnant;
- Elle suppléerait aux lacunes des différentes législations sectorielles; - Elle permettrait d’octroyer des concessions dans des secteurs où il n’existe pas de
cadre légal spécifique permettant l’octroi d’une concession à un opérateur privé. Cela éviterait, par là même, l’adoption de cadres légaux non suffisamment mûris ou exceptionnels provoqués par des opportunités économiques qui se présenteraient et qu’il est difficile à l’Etat de ne pas exploiter.
117. C’est dans ce cadre que semble s’inscrire l’annonce récente de la conclusion entre le Gouvernement Tunisien et la société pétrolière opérant en Tunisie, d’un protocole d’accord pour la réalisation d’une centrale électrique de 500 MW, alors qu’aucun cadre juridique actuel ne permet cette opération. L’Etat qui ne veut pas perdre l’opportunité d’exploiter le gaz non commercial découvert par l’entreprise pétrolière et de développer les gisements de gaz découverts par cette dernière, promulguera une loi spéciale qui servira de cadre juridique pour la réalisation de cette centrale.
118. La loi sur les concessions pourra prévoir aussi la création d’une commission supérieure de concession. Cette commission, en plus du rôle qu’elle jouera dans l’octroi des concessions, à l’instar de la Commission Supérieure des Marchés, pourrait jouer un rôle de régulateur central ou un rôle de régulateur supplétif, dans les domaines ou un organe de régulation spécifique n’existe pas. La promulgation de cette loi pourrait être aussi l’occasion de fixer le statut juridique des membres du ou des organes de régulations.
Autres aspects de législation horizontale
119. Il est important de noter que le cadre légal général de la Tunisie est bien adapté aux opérations PPI, la Tunisie ayant bien su adapter son arsenal juridique à l’investissement privé en général et à l’investissement étranger en particulier. Néanmoins, certaines lacunes ou barrières législatives demeurent et pourraient constituer un frein aux développements de l’investissement privé dans les infrastructures.
120. Ainsi et en matière de change et malgré la convertibilité courante du dinar et l’effusion de textes libéraux qui s’en est suivi, certaines restrictions demeurant en place notamment pour le transfert des salaires par les employés étrangers auxquels il est fait appel dans des opérations PPI. Toujours en matière de change, la cessions de participations dans des sociétés de droit tunisien effectué au profit d’acquéreurs étrangers reste soumis à l’obtention d’accords préalables, dès lors que la participation étrangère dépasse les 50% du capital. Cette restriction risque de constituer un obstacle à l’investisseur privé qui veut céder sa participation au profit d’un autre investisseur privé étranger. Cette mesure risque aussi de gêner les bailleurs de fonds étrangers ayant nanti les participations des investisseurs étrangers à titre de garantie et qui désirent mettre en jeu ladite garantie.
121. Un assouplissement serait nécessaire aussi quant à la législation foncière vu que toute opération d’achat, de vente ou d’hypothèque portant sur un bien immobilier réalisée par une personne physique ou morale étrangère est soumise à l’obtention d’une autorisation du Gouverneur du lieu de situation de l’immeuble. Cette autorisation, exigée par un texte de 1957 qui était peut être justifiée par un ordre public économique de l’époque, semble anachronique avec le nouvel ordre public économique de la Tunisie actuelle qui se veut
- Page 40 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
ouverte à l’investissement étranger, constitue souvent un obstacle pour l’investisseur étranger ou pour ses bailleurs de fonds étrangers, compte tenu de son caractère discrétionnaire et la lenteur de son obtention.
122. Enfin et concernant la législation du travail, il serait opportun de simplifier le recrutement de la main d’œuvre étrangère pour les projets d’infrastructure. La procédure actuelle prévue pour le recrutement de personnel étranger est lente, incertaine et retarde considérablement le plan opérationnel de l’investissement.
123. Toujours en matière de législation du travail, la récente réforme permettant le transfert d’agents publics vers des entreprises privées reste très limité vu qu’elle ne limite ce type de transferts qu’aux chercheurs et aux projets innovants.
Recommandations en matière de législation horizontale
124. Dans la phase de diagnostic, il est apparu que quelques révisions seraient nécessaires dans le cadre de la législation du travail. Pour ce qui concerne le détachement, il serait utile que le cadre législatif et réglementaire tunisien permette d’instaurer des passerelles entre la fonction publique et le secteur privé dans le cadre des PPI, ce qui est impossible actuellement, et ce, sans la démission du fonctionnaire de la fonction publique. Il serait judicieux d’élargir les cas de détachement du secteur public vers le secteur privé et de diversifier les personnels éligibles à un tel détachement, pour permettre notamment aux entreprises étrangères opérant sur le marché local, dans la cadre des PPI, de bénéficier du gisement d’expériences et de compétences des cadres de haut niveau de la fonction publique.
125. Un tel élargissement du cadre réglementaire pourrait se traduire par une convention type entre les organismes d’origine et les entreprises d’accueil fixant les modalités du détachement avec pour principes directeurs le respect des garanties de carrière et d’avantages professionnels, tout en instituant un dispositif de ‘’garde fou’’ destiné à éviter une fuite massive des compétences et des cerveaux publics vers le secteur privé.
126. Emploi de la main d’œuvre étrangère. La procédure longue et incertaine nécessaire à l’obtention par le Ministère de l’Emploi d’un contrat de travail pour le personnel étranger risque de gêner considérablement l’investisseur étranger cherchant une main d’œuvre qualifiée dans des domaines spécifiques. Si le principe de la préférence nationale est motivé par la préoccupation de l’emploi des jeunes diplômés tunisiens, ce principe constitue actuellement une entrave au libre recrutement du personnel étranger d’encadrement en Tunisie. De ce fait, il serait opportun de prévoir à l’instar des sociétés totalement exportatrices, la possibilité pour les PPI de recruter librement un certain nombre de cadres étrangers (4 par exemple) et de lui accorder pendant la phase initiale du projet concédé une certaine souplesse, avec un engagement de tunisification progressive, au bout de deux années par exemple.
127. Transfert des salaires. La réglementation de change actuelle impose aux salariés étrangers de ne transférer que 50% de leurs salaires, le reste ne pouvant être transféré qu’à l’issue de leur séjour en Tunisie. Néanmoins, et étant donné que les besoins locaux du personnel étranger sont, dans la plupart des cas nettement inférieurs à 50% de leur salaires, et étant donné que souvent les besoins à l’étranger de cette catégorie de personnel sont supérieurs à ces 50%(remboursement crédits, enfants scolarisés, etc.), il serait de ce fait opportun d’assouplir la législation de change relative au transfert des salaires étrangers.
- Page 41 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
128. Dans le cas de la législation des changes, l’article 21 et 21 bis du Code des Changes soumettent toute souscription au capital d’une société de droit tunisien ou l’acquisition de ce type de société à : (i) l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie si la participation étrangère est limitée à 50%; et (ii) l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie et de la CSI, si la participation étrangère est ou devient supérieure à 50%.
129. En vue d’éviter les risques que les investisseurs étrangers dans une opération de PPI ne se sentent prisonniers de leur participation, ou que leurs bailleurs de fonds ne se sentent limités dans l’exercice des garanties portant sur les actions des investisseurs, il serait opportun d’exclure du champ d’application de ces restrictions, les opérations portant sur des titres des sociétés (la société du projet) bénéficiant d’une concession.
130. Nonobstant une législation générale tunisienne encourageant l’investissement étranger, certaines restrictions à cette participation dans les opérations touchant au marché local risquent de gêner considérablement la participation étrangère dans les opérations de PPI. Il serait ainsi opportun : (i) d’inclure dans la liste prévue par le décret 94-492 des activités dans lesquelles la participation étrangère peut être supérieure à 50%, toutes les activités prévues par le Code et susceptibles de bénéficier d’une concession avec le Gouvernement; et (ii) d’inclure dans les activités prévues par le Code d’Incitation aux Investissements, les activités non prévues et susceptibles de bénéficier de concessions.
Législation sectorielle
131. L’étude de la législation sectorielle fait ressortir une disparité entre les différents secteurs quant au nombre et au volume des textes les régissant en général, et ceux qui sont relatifs à la possibilité de l’intervention du secteur privé. Le Tableau 10 donne un aperçu des points forts et faibles de la législation sectorielle.
132. Le secteur des télécommunications bénéficie d’une législation détaillée couvrant les différents secteurs des télécommunications. Seuls quelques textes d’application prévus lors de la refonte de la législation du secteur ne sont pas pris à ce jour.
133. Le transport maritime est le secteur le plus structuré. La législation qui le régit est très détaillée, précise et cohérente. Elle adopte des concepts modernes, tels que l’octroi de droits réels sur les ouvrages édifiés sur le domaine public, concept très récemment adopté en Europe.
134. Dans le domaine du transport aérien, certaines lacunes législatives sont à signaler. Certains textes d’application n’ont pas encore été pris à ce jour. C’est le cas de celui qui fixe la liste des services de l’OACA qui peuvent être concédés ou celui des conditions techniques des organismes pouvant bénéficier de concessions relatives aux aérodromes.
135. Quant au secteur de l’électricité et nonobstant l’effort législatif des quelques dernières années ayant abouti à une loi sur la production privée d’électricité et à une réforme du Code des hydrocarbures, qui permet au privé de réaliser des petites centrales de 40 Mw utilisant du gaz non commercial, le cadre juridique du secteur reste insuffisant. En effet, la législation actuellement en vigueur est peu adaptée à des projets de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables (éolien, solaire). De même aucun cadre juridique ne permet aujourd’hui à l’Etat d’octroyer des concessions pour des projets de centrales électriques d’une capacité supérieure à 40 MW et utilisant du gaz non commercial. Enfin, aucun organe de régulation du secteur n’a été prévu malgré un engagement clair vers la
- Page 42 -

Le contexte de la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
participation privée dans le secteur. C’est la STEG qui, d’un point de vue pratique, joue aujourd’hui ce rôle, alors qu’elle est en situation de concurrence avec les opérateurs privés.
136. Il en est aussi de même dans le cas de la production et de la distribution d’eau où la loi autorise la SONEDE à concéder une partie de ses activités uniquement dans un domaine restreint, notamment les eaux non-conventionnelles, et ceci sans préciser les conditions de cette concession.
137. Il faut enfin signaler que pour certains secteurs, tels que l’assainissement, les textes régissant la matière sont muets sur les possibilités de concéder une partie de cette activité à des opérateurs privés.
138. Il en est de même pour la législation relative à la gestion des déchets solides où les textes, bien qu’établissant la possibilité pour les communes de recourir à des opérateurs privés pour le traitement des déchets ménagers, ne précisent pas les conditions d’octroi des concessions.
- Page 43 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Tableau 10 - Participation privée et législation tunisienne par secteurs d’activités – points forts et points faibles
Secteurs Caractéristiques Points forts Points faibles
Télé
com
mun
icat
ions
PPI sous forme de : 1- concession 2- licence d’exploitation 3- autorisation d’exploitation
Les possibilités légales d’intervention du secteur privé sont très bien structurées L’appel à la concurrence est très
bien organisé en matière de concession
Absence de quelques textes d’application Lacunes dans les textes existants : Absence d’identification des organismes
appelés à donner leur avis pour l’octroi de concessions et leur transfert, Manque de précision au niveau de la
prorogation de la concession. Est-elle automatique ? Est-elle gratuite ou soumise à redevances ? Contradictions entre les textes relatifs à la
licence d’exploitation. Faut-il être, en plus d’une personne morale régie par le droit tunisien, une société ayant un capital détenu en majorité par des tunisiens ?
Elec
tric
ité e
t gaz
PPI sous forme de : 1- concession 2- régimes juridiques distincts
selon qu’il s’agit de concessions dans le cadre de la production indépendante d’électricité ou dans le cadre du code des hydrocarbures
Les possibilités légales de l’intervention du secteur privé sont très bien structurées L’appel à la concurrence dans le
cadre de la production indépendante d’électricité est très bien organisé
Le transport et la distribution d’électricité sont des monopoles de la STEG La limitation de la production à 40MW
dans le cas des hydrocarbures est dissuasive La durée de concession n’est pas précisée
dans les textes. Dans le cadre d’une concession de
production d’hydrocarbures, le problème du transport se pose Le rôle de la STEG, même en l’absence
de prérogatives officielles, est trop important et conditionne l’octroi des concessions Absence totale de cadre juridique pour les
énergies renouvelables Absence d’organe de régulation.
Tran
spor
t m
ariti
me
PPI sous forme de : 1- Concession de domaine
public et de service public 2- Concession d’outillage
public 3- Concession de l’OMPP 4- Permis de transport
maritime de personnes
Réglementation assez détaillée et moderne
Durée de concession assez attractive (30 ans + prorogation 20 ans)
Droits réels sur les ouvrages au profit du concessionnaire
Conditions relatives à la nationalité du navire en cas de permis de transport de personnes, sauf dérogation spéciale.
Tran
spor
t aér
ien
PPI sous forme de : 1- Concession 2- Permis d’exploitation pour le
transport aérien 3- Autorisation pour la création
d’aérodromes
La liste des services de l’OACA qui peuvent être concédés n’a pas encore vu le jour La liste des activités de l’aéronautique qui
sont libres et celles soumises à agrément doivent être fixées par un décret qui n’a pas encore vu le jour Les conditions techniques des organismes
pouvant bénéficier de concessions d’aérodromes, doivent faire l’objet d’un décret qui n’a pas encore vu le jour
Aut
orou
tes
PPI sous forme de concession : l’Etat peut concéder la construction, l’exploitation et l’entretien d’une autoroute à une société privée
La durée de la concession est intéressante ( 30 ans renouvelables par tacite reconduction) 2- Les conditions de la concession
sont relativement bien détaillées
Domaine relevant du monopole de l’Etat L’une des conditions de la concession à des
sociétés privées est que l’Etat doit y détenir directement ou indirectement une participation dans le capital
- Page 44 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Secteurs Caractéristiques Points forts Points faibles
Eau
1- PPI sous forme de concession. 2- Idem pour l’utilisation des
ressources hydrauliques non conventionnelles.
3- La SONEDE peut concéder partiellement une partie de ses activités
Les principes de base relatifs à la concession sont relativement bien détaillés Si la concession sert à assurer un
service public, il n’y a pas de paiement de redevances. Les seuls cas d’approbation de la
concession par décret sont relatifs à l’utilisation des ressources thermales. Les concessionnaires peuvent
bénéficier de servitudes.
Domaine relevant du monopole de l’Etat Le décret relatif aux conditions obligatoires
des concessions n’a pas encore vu le jour Il en va de même en matière de ressources
hydrauliques non conventionnelles
Ass
aini
ssem
ent
Les textes sont muets quant à la participation du privé, mais vont plutôt dans l’autre sens. Il est à signaler que malgré cela, quelques expériences de participation du secteur privé ont été réalisées
Textes muets Textes muets
Ges
tion
des
déch
ets
PPI sous forme de : 1- Concession 2- Sous-traitance 3- Participation dans le capital
Réglementation très moderne Les textes sont muets en ce qui concerne les conditions de la concession et de la sous-traitance, la législation en vigueur se contentant de poser la possibilité pour les communes de recourir en ce qui concerne le traitement de leurs déchets ménagers à des entreprises privées sous forme de concession ou de sous-traitance
Le financement de la PPI par le secteur financier tunisien
139. Un rapport détaillé sur le financement de l’infrastructure en Tunisie, et en particulier sur son financement par le secteur financier tunisien, se trouve dans le Volume III de cette étude. Ce chapitre est un résumé de ce rapport et des recommandations qui en découlent.
140. Le gouvernement tunisien envisage une augmentation importante des investissements dans les infrastructures dans le cadre du Xème Plan. Il envisage également une nette augmentation de la part de ces investissements qui devraient être réalisées par le secteur privé, qui seraient de l’ordre de 1.600 MDT23 contre uniquement 182 MDT au cours du IXème Plan. Cette augmentation est en partie due à l’émergence de nouveaux opérateurs privés, comme dans le cas de la deuxième licence GSM, et apparemment aussi en partie à l’incapacité de mobiliser des crédits bonifiés auprès des bailleurs de fonds pour financer la totalité des investissements de l’infrastructure. Là où des crédits bonifiés sont disponibles, il est recommandé de les utiliser pleinement et de les intégrer dans les projets de PPI, à l’instar de l’expérience internationale émergente dans le financement mixte public-privé. Le financement privé devrait être utilisé uniquement pour financer le reliquat qui ne peut pas être mobilisé à des conditions avantageuses. Ce reliquat devrait être couvert tant par le secteur financier privé local qu’étranger.
23 Le Xème Plan prévoit des investissements privés de l’ordre de 3.400 MDT. Cependant une grande partie des investissements entamés durant cette période ne sera exécutée que lors de la période quinquennale suivante (tel que le port en eau profonde et une grande partie de l’aéroport du Centre-Est) ou seront financés dans le cadre de petits projets qui ne rentrent pas dans le cadre de cette stratégie, tels que les investissements dans l’agriculture ou la participation du privé dans les coûts de branchement au réseau public d’assainissement supportée par les particuliers et les promoteurs immobiliers.
- Page 45 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
141. Jusqu’à aujourd’hui, le financement des infrastructures a été assuré pour l’essentiel sur financement par des bailleurs de fonds et – pour les rares transactions de gestion déléguée – à partir d’un financement privé entièrement extérieur, et ce pour les raisons suivantes :
- la politique des pouvoirs publics de maximisation de la part en devises dans le financement des infrastructures en raison de la part élevée des coûts des infrastructures en devises, et de la volonté de mobiliser des ressources extérieures à des conditions concessionnelles;
- la taille limitée des banques et du marché financier local; - l’expérience limitée en matière de mise en place de syndicats bancaires et de
partenariats entre banques locales et étrangères; - l’absence d’expériences en matière de financement à recours limité (financement de
projets); - l’absence de certains instruments de gestion de risque, tels qu’un marché secondaire
pour des obligations, des swaps de taux d’intérêt, des assurances de crédits et des emprunts obligataires (revenue bonds);
- l’absence de garanties partielles de l’Etat adaptées au financement local des infrastructures.
142. Le résultat est que le secteur financier local a été exclu du financement même pour les projets confiés au secteur privé (la centrale électrique de Radès et la seconde licence GSM par exemple). L’expérience internationale indique toutefois qu’une participation du secteur financier local dans les investissements privés en infrastructures est non seulement souhaitable, mais elle est aussi possible malgré la longue période d’amortissement de ces investissements.
143. Un financement partiel des infrastructures par le secteur financier local présente certains avantages. Selon la règle d’orthodoxie financière d’adossement (matching) des monnaies de dépenses et de recettes, des financements en monnaie locale sont mieux adaptés pour les investissements en monnaie locale (génie civil, achat d’équipements fabriqués localement). Le risque de change constitue en effet un des principaux soucis des investisseurs étrangers pour des projets de PPI dans lesquels les revenus sont exclusivement ou en grande partie en monnaie locale. Le financement local peut réduire considérablement ce risque, diminuer la prime de risque exigée par les investisseurs, et minimiser ainsi le coût de leur participation.
144. Le financement local des infrastructures - sur fonds propres, par crédit bancaire ou par émissions d’obligations – peut aussi contribuer à la diversification du secteur financier tunisien, dont les investissements sont concentrés dans certains secteurs tels que le tourisme et certaines industries. Il permet également la création de partenariats avec des investisseurs étrangers, et l’assimilation des techniques liées à ce genre de projets. Il permet enfin d’entamer la courbe d’apprentissage nécessaire aux banques tunisiennes et introduit sur le marché financier des instruments d’investissements particulièrement adaptés à l’épargne longue. Pour l’ensemble de ces raisons il est souhaitable de promouvoir une participation locale dans le financement des infrastructures.
145. En conséquence, il est recommandé de revoir la politique actuelle dans le sens d’une ouverture des projets d’infrastructure au secteur financier local. Une politique d’encouragement de la contribution du secteur financier tunisien au financement des infrastructures pourrait être fondée sur une catégorisation de projets selon les sources de
- Page 46 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
financement avantageux disponibles dans certains secteurs, la taille des projets, et la part en devises dans les revenus.
146. Dans certains secteurs, des financements avantageux par des bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux sont disponibles pour financer une grande partie des besoins d’investissement. Ceci est surtout le cas des secteurs environnementaux comme l’eau (sauf éventuellement le dessalement), l’assainissement et la gestion des déchets solides. Là où ces financements avantageux sont disponibles, ils devront être intégrés dans l’architecture financière des projets de PPI, par exemple dans le cadre de projets Design-Build-Operate (DBO) et de l’assistance basée sur les résultats.24 Le secteur financier pourrait être associé et prendre une part minoritaire dans le financement de ces projets.
147. Par rapport à la taille des projets, les investisseurs internationaux ne sont pas intéressés, de manière générale, à investir dans des projets d’une certaine taille en raison des coûts de transaction élevés. Ces projets pourraient être entièrement financés par le secteur financier tunisien, même si une partie importante des coûts est en devises étrangères.
148. Finalement, concernant les grands projets d’infrastructure dans des secteurs où les financements avantageux ne sont pas disponibles ou sont limités, il convient de faire une distinction entre secteurs dans lesquels une grande partie des revenus est en devises (télécommunications, transport aérien et maritime) et les projets dont les revenus sont uniquement en monnaie locale. Ces projets seraient soumis à un financement mixte étranger et local. La proportion du financement local sera variable en fonction de la taille des projets, et pourra être calée par référence à la part en dinars des investissements. La contribution du secteur financier local pourrait être particulièrement importante dans les secteurs où la totalité des revenus sont en monnaie locale (autoroutes, chemins de fer, transport urbain, électricité et gaz). La position des pouvoirs publics en matière de choix de sources de financement peut être déterminée par la recherche d’un équilibre entre l’objectif de mobiliser le financement en devises et l’objectif de développer le marché financier local et de réduire le risque de change, y compris les engagements éventuels qui y sont associées. En tout cas, cette position devra laisser une grande marge de manœuvre au secteur privé pour déterminer le dosage optimal entre financement local et étranger.
149. En définitive, si des projets attractifs dans le secteur des infrastructures sont proposés, le système financier local en Tunisie devrait a priori être capable de satisfaire en partie au moins cette demande de capital. L’offre de capital privé en soi ne paraît pas poser une contrainte majeure : si on prend comme hypothèse une part de financement local d’un tiers des investissements privés entiers, cela constituerait environ 100 MDT par an, dont une partie sera financée sur fonds propre et dont le reliquat constituerait moins de 5% des décaissements bancaires annuels. Toutefois, sans la levée des contraintes mentionnées ci-dessus même cette part relativement modeste dans les investissements privés en infrastructure ne pourra être réalisée. Ces freins pourraient être levés en introduisant les mesures suivantes :
- Lever les contraintes imposées par la Banque Centrale : de manière concrète, il faut permettre l’inclusion dans les schémas de financement des projets de financements locaux, tant en fonds propres qu’en dettes, même de manière partielle;
- Inciter les banques à procéder à des syndications avec des banques étrangères et locales;
24 Voir le chapitre 2 pour une explication de ces mécanismes.
- Page 47 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
- Assurer la vulgarisation des techniques de financement à recours limité et des mesures d’amélioration de la qualité du crédit et de la gestion des risques;
- Eventuellement introduire certaines garanties partielles par le gouvernement tunisien, dont les modalités restent à déterminer, tout en limitant les engagements éventuels de l’Etat au minimum nécessaire pour rendre la transaction possible.
Simulation des effets économiques de la libéralisation des services d’infrastructure
150. Cette section examine les gains potentiels à long terme (15-20 ans), au niveau macroéconomique et sectoriel, issus de la libéralisation des échanges de services. Les résultats des simulations fournis ci-dessous doivent être considérés à titre indicatif et utilisés avec précaution. Ils varient selon l’ampleur estimée et la nature des obstacles mis en place à l’origine, les cadres théoriques, les techniques de modélisation et les ensembles de données. Les facteurs suivants peuvent expliquer les différences d’ampleur des résultats des simulations (et influent sur leur fiabilité):
- Les études économétriques qui analysent les effets dynamiques de la libéralisation et son impact sur des secteurs spécifiques trouvent plus d’avantages à la libéralisation que les simulations réalisées au moyen d’un modèle d’équilibre général calculable. Cela tient sans doute à la composante dynamique des études économétriques qui prennent en compte des ajustements à long terme s’effectuant par le biais de l’accumulation de capital, de la croissance démographique et du progrès technologique;
- Des gains de bien-être plus importants sont observés lorsque la mobilité des capitaux et l’IDE sont explicitement modélisés et qu’on admet l’existence d’une concurrence imparfaite. Les effets sensibles que traduisent les résultats de ce type de modèles ne sont pas nécessairement attribuables à la libéralisation des échanges de services en tant que telle, mais à la libéralisation concomitante présumée des marchés de facteurs;
- La nature des obstacles et d’autres restrictions à l’origine affecte les résultats des simulations. Les restrictions génératrices de rente font passer les prix au-dessus des coûts, c’est-à-dire qu’elles créent des rentes pour les producteurs en place. Par conséquent, la levée de ces restrictions peut entraîner un important transfert des fournisseurs vers les utilisateurs de services et un gain net relativement faible pour l’économie en général. A l’inverse, une restriction qui élève les coûts engendre des modes de production inefficients et coûteux. La levée des restrictions qui font augmenter les coûts peut conférer un avantage aux fournisseurs de services et aux usagers en aval, et constituer un gain relativement important pour l’ensemble de l’économie. La levée de ce dernier type de restrictions peut donc être plus bénéfique;
- Les études qui ont recours aux estimations grossières de Hoekman pour ce qui est des interventions effectuées à l’origine indiquent en général que la libéralisation des échanges de services entraîne de nombreux gains de bien-être. A l’inverse, les études qui utilisent des estimations déterminées en fonction de mesures d’impact fondées sur le prix ou la quantité concluent plutôt à des gains de bien-être inférieurs, bien que non négligeables.
- Page 48 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
L’évidence internationale
151. Les avantages de la libéralisation de services dépassent ceux qui découlent de la libéralisation des échanges de biens, et selon certaines études, peuvent être jusqu’à 5 fois plus importants. Cela s’explique par les gains attribuables à la mobilité accrue de la main-d’œuvre et des capitaux, et par la réduction des obstacles à la concurrence, souvent plus élevés dans les services que dans le cadre des échanges des biens25.
152. Des gains considérables en termes de la croissance et d’emploi sont attribuables à la libéralisation des services d’infrastructure26. Des estimations varient de 1% jusqu’à 50% du PIB, selon l’ampleur des restrictions à la concurrence existantes avant les reformes27. La libéralisation des services de télécommunications entraîne des gains économiques substantiels. Accompagnée d’un cadre réglementaire qui favorise la concurrence, elle améliore la compétitivité des services et engendre des gains considérables en terme d’échanges commerciaux internationaux28. En particulier, l’exportation de services par voie électronique revêt beaucoup d’importance, sous la forme de la sous-traitance des services de back-office, dans les domaines clés des services informatiques, des services aux entreprises et d’autres services professionnels.
153. La libéralisation des services d’infrastructure améliore généralement l’efficacité et la qualité tout en réduisant les prix. Les données empiriques dont on dispose sur les effets de la libéralisation et de la PPI montrent que la libéralisation a été globalement bénéfique en termes d’efficience et de bien-être des consommateurs des pays concernés. Avec le développement de la concurrence, l’efficience de la production et la qualité des services ont tendance à augmenter et les prix ont tendance à baisser29.
154. La libéralisation de services d’infrastructure entraîne des gains qui découlent non pas uniquement d’un meilleur accès aux marchés des fournisseurs de services étrangers, mais surtout du renforcement de la concurrence et de l’efficience locales. Les travaux que mène actuellement l’OCDE sur la libéralisation des échanges de services dans les pays du Sud-Ouest de l’Europe montrent que ces pays ne pourraient tirer des avantages liés à l’ouverture du secteur des télécommunications sur réseau fixe à des capitaux étrangers sans en même temps faire disparaître les restrictions qui s’appliquent aux nouvelles entrées30.
Le cas de la Tunisie : résultats des simulations issues des modèles d’équilibre général
155. Les services apportent une contribution significative à la production en Tunisie. Les secteurs des services contribuent presque à hauteur de 50% au PIB et ils représentent un tiers de la consommation des ménages et 18 pour cent de la consommation intermédiaire. Les secteurs des télécommunications et des transports représentent environ 6% du PIB, tandis que les secteurs de l’énergie, eau et assainissement contribuent environ à 2% du PIB31.
25 Source : Banque Mondiale, 2002 26 Source : Mattoo et al, 2001 27 Source : Banque Mondiale, 2002 28 Source: Varoudakis et al, 2003 29 Source : Gonenc et al, 2000 30 Source : OCDE 2003 31 Source : Konan and Maskus, 2003, sur la base des données de l’INS 1998
- Page 49 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
156. La libéralisation des services d’infrastructure en Tunisie entraîne à long terme des gains économiques substantiels. Des études récentes ont développé une série de scénarios de politique commerciale afin d’évaluer les effets combinés de la libéralisation conjointe des biens et des services en Tunisie32. Ce sont des scénarios ‘high-case’, c’est à dire, ils se basent sur deux hypothèses principales : a) l’économie absorbera tous les avantages issus de la libéralisation des secteurs respectifs; et b) un cadre réglementaire et un environnement des affaires adéquats sont mis en place.
157. Effet sur la richesse et sur la croissance. L’impact de la libéralisation des services sur la production peut être considérable, les résultats des simulations variant selon le choix méthodologique, le cadre théorique et les données disponibles. Selon des simulations récentes, la combinaison de l’Accord d’Association avec l’Union Européenne (AAUE) et de la libéralisation des services au sens large pourrait entraîner une croissance du PIB de 11,4 % sur 15 à 20 ans. Dans ce scénario, la libéralisation des services augmenterait le PIB de 5 % au dessus du niveau de production issu uniquement de l’Accord d’Association avec l’Union européenne33. Ces avantages sont attribuables principalement aux gains de compétitivité et d’efficacité découlant de l’investissement direct étranger dans les secteurs des services. Les avantages les plus bénéfiques proviennent de la libéralisation des services des transports et des télécommunications– –services financiers non compris.
158. Dans un scénario optimiste (high-case), le développement des TIC, découlant de l’ouverture des marchés des télécommunications à la concurrence, des exportations de software et des services connexes aux TIC, pourrait augmenter le PIB de 4,4% sur une période de 15 à 20 ans. Compte tenu de l’état modeste actuel des TICs, celles-ci pourraient accroître encore plus vite que les télécommunications. En particulier, les secteurs du développement de software, des services connexes et des services back-office réaliseront des importants gains économiques34. Il faut noter que le scénario high-case assume une absorption totale par l’économie tunisienne des avantages tirés du développement des TIC ainsi que la mise en place d’un cadre réglementaire et d’un environnement des affaires favorisant la concurrence. Par contre, dans un scénario plus pessimiste (base-case) les avantages de la libéralisation des services de télécommunications seront presque négligeables, reflétant le manque de progrès en termes de restrictions actuelles limitant le développement des TIC35.
159. Dans le cas du secteur des transports, l’Institut d’Economie Quantitative (IEQ) en Tunisie est en train de mener une étude d’impact de l’ouverture à la concurrence en appliquant un modèle d’équilibre général. L’étude prend en compte la situation actuelle de concurrence imparfaite en Tunisie et révèle des gains économiques non négligeables.
160. Effet sur l’allocation des ressources. Dans le scénario de libéralisation des services, les gains en termes d’augmentation du revenu total du travail sont 4% au-dessus des avantages issus de l’AAEU. Et les gains sont encore plus significatifs pour le revenu du capital (8 % plus élevé que les gains découlant de l’AAUE). L’impact de la libéralisation des services sur la distribution du revenu des facteurs de production a donc tendance à favoriser le rendement de capital.
32 Sources : Konan et Maskus, 2003; Konan et Kim, 2003; Konan et Maskus, 2000 33 Source : Konan and Kim, 2003 34 Source : Banque Mondiale, 2002 35 Source : Banque mondiale, 2002
- Page 50 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Graphique 5 : Les gains macro-économiques des scénarios alternatifs de libéralisation des services en Tunisie
Les gains macroeconomiques des scenarios alternatifs de liberalisation de services en Tunisie (Variation en %)
0
5
10
15
20
Production (PIB) Masse salariale Rendement decapital
Source: Konan et Kim (2003)
Accord d'Association avec l'Union Europeenne (1)
Liberalisation de biens (AAEU et le reste du monde)(2)
Liberalisation de services (AAEU et le reste du monde) (3)
Liberalisation de biens et de services (AAEU et le reste du monde) (4)
161. Effet sur l’emploi. Les effets bénéfiques potentiels de la libéralisation des services d’infrastructure sur l’emploi sont facilités par la mise en place d’un cadre réglementaire et d’un environnement des affaires adéquats. Une étude comparative récente sur la libéralisation des services de télécommunications révèle que 26 pays d’Asie et d’Amérique Latine qui ont ouvert le secteur à la concurrence ont vu augmenter considérablement les niveaux d’emploi dans le secteur36. En Tunisie, dans le scénario conjoint de la libéralisation de services et de l’AAUE, les coûts potentiels d’ajustement sont négligeables : environ 3% de la population active seraient amenés à changer de secteur. Par contre, dans le scénario de l’AAEU sans libéralisation des services, le coût d’ajustement est estimé à environ 7%. L’impact plus bénéfique de la libéralisation conjointe des services et des biens (AAUE) sur le marché de travail s’explique par le fait que la libéralisation de services engendre une croissance des investissements directs étrangers. Dans ce cas, les travailleurs changeraient d’employeurs mais resteraient dans le même secteur d’activité37. Des simulations récentes ont exploré les impacts individuels sur l’emploi issus de la libéralisation des services de télécommunications et de transports. Dans un scénario high-case, le développement des TIC, découlant de l’ouverture des marchés des télécommunications à la concurrence et les exportations de software et des services connexes aux TIC, pourrait augmenter le niveau d’emploi à 2,6 %38. L’étude menée par l’IEQ estime que l’ouverture de la concurrence dans le secteur des transports et des télécommunications pourrait accroître le niveau d’emploi à 3,2%39.
36 Source : Lovelock, 1996 37 Source : Konan and Maskus, 2000 38 Source : Banque mondiale, 2002 39 Source : IEQ, 2003
- Page 51 -


44.. AAssppeeccttss sseeccttoorriieellss ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn pprriivvééee ddaannss lleess
iinnffrraassttrruuccttuurreess
162. Ce chapitre couvre les secteurs des télécommunications, du transport, de l’électricité et du gaz; de l’eau potable et de l’assainissement; et de la gestion des déchets solides. Chaque chapitre comprend un résumé du diagnostic sectoriel (le diagnostic complet se trouve dans le Volume 3 de l’Etude) ainsi qu’une proposition de Plan d’Action.
Les télécommunications
163. Le secteur des télécommunications en Tunisie s’est caractérisé pendant longtemps par une structure de marché de monopole, Tunisie Telecom étant le seul fournisseur de services de télécommunications dans le pays. Tandis que les performances de Tunisie Telecom en ce qui concerne les services de lignes fixes étaient bonnes, par comparaison avec des opérateurs dans des pays similaires, la Tunisie a accumulé du retard dans les domaines de la téléphonie mobile, des services de données et de l’Internet. En effet, dans ces trois derniers domaines, de nombreux pays en développement se sont rapidement éloignés du modèle traditionnel de monopole, en particulier depuis le milieu des années 90. Dans le même temps, la lenteur de la réforme du secteur en Tunisie a laissé s’élargir la brèche entre cette dernière et les pays qui ont entrepris des réformes rapides, comme l’indiquent clairement les données sur les hébergeurs et les utilisateurs Internet, chaque catégorie montrant une large et dangereuse brèche (voir tableau sur l’efficacité en page suivante). Le Gouvernement a réagi à ce retard en élaborant une nouvelle stratégie pour le secteur TIC, publiée en 2002. Cette stratégie était basée sur le développement du secteur privé et sa participation dans le secteur des télécommunications. La première étape fut d’octroyer une licence GSM à un opérateur du secteur privé, Tunisiana. Le choix du Gouvernement s’avéra payant. Le nombre total des abonnés au mobile a atteint 1.894.000 à la fin de 2003 (répartis entre 498.000 pour le nouvel entrant Tunisiana et 1.396.000 pour l’opérateur historique Tunisie Télécom). La croissance entre 2002 et 2003 a dépassé 1.330.000 abonnés, soit un taux de croissance de 242%.
164. Dans le domaine de la communication de données, la stratégie du Gouvernement fut d’ouvrir à la concurrence premièrement le segment VSAT. Une licence VSAT recouvrant téléphonie et données a été récemment octroyée à un consortium (Divona) composé de Monaco Télécom et Planète Tunisie. De plus, le Gouvernement a exprimé son intention d’octroyer une licence de données. La sélection d’un consultant pour assister le gouvernement à la préparation d’un cahier des charges et à la sélection d’un opérateur est en cours. Le gouvernement prévoit d’octroyer la licence d’ici fin 2004.
165. L’introduction de la concurrence dans le segment VSAT et des données amènera vraisemblablement des bénéfices pour le consommateur, en particulier à travers la pression à la baisse sur les prix. En ce moment, en ce qui concerne les tarifs, le prix des lignes louées et des communications internationales demeure plusieurs fois supérieur aux tarifs des pays où une concurrence efficace a été introduite dans ces services.
- Page 53 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
166. L’«approche graduelle» choisie par la Tunisie a certes permis d’achever des étapes importantes dans la réforme réglementaire, telles que la promulgation de la nouvelle loi permettant la concurrence, la séparation entre les activités de régulation et de gestion des ressources, et la création d’une agence de régulation, l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) et d’organes de gestion des ressources (ANF-ANCE). Cependant les progrès dans le domaine de la régulation sont toujours retardés par des obstacles dans la régulation du secteur, tels que la fragmentation institutionnelle (le Ministère et quatre différentes agences de régulation, l’INT, l’ANF, l’ATI et l’ANCE ont des attributions régulatoires sur le secteur). De plus l’ATI cumule des fonctions de régulation et des fonctions commerciales en tant que fournisseur de services Internet (FSI) pour le Gouvernement. Ces fonctions doivent être séparées pour assurer des conditions de juste concurrence sur le marché FSI. L’INT a cependant son autonomie sur le plan administratif, juridique et réglementaire puisqu’elle n’est pas sous tutelle du Ministère chargé des TIC et est composée de juges et personnes indépendantes. Elle l’est également sur le plan financier et dispose de ses propres ressources. En 2003 elle a même dégagé des surplus de financement.
Tableau 11 : Récapitulation du diagnostic du secteur des télécommunications.
La situation actuelle
Sous-Secteur Emplois
Chiffre d’Affaires
Annuel
IXème Plan (1997-2001) - Besoins
d’investissement - Part du privé (%) - Montant
Situation Financière
Subventions annuelles
Téléphone fixe
Chiffres non disponibles (bénéfices réalisés)
Non
Mobile Idem Non Internet
12.500 emplois
748 MDT en 2001
- 1.390 MDT - 8% privé - 100 MDT
Non L’efficacité Sous-Secteur Desserte Continuité, Qualité
du Service Niveau des tarifs Problèmes majeurs
Téléphone fixe
Bon développement : 11,83% (19% pour MNA) La couverture géographique du réseau est bien équilibrée entre zones urbaines et rurales
Faible taux de défauts / MNA Taux de dérangement de 0,29 (Dg/Ab/Ann)
Prix des tarifs internationaux et des lignes louées élevés
Manque de concurrence au niveau de la gestion du réseau.
Mobile
Développement et croissance rapides : 17% à la fin 2003 (contre 23,5 % pour MNA)
Continuité et qualité en nette amélioration, grâce a la concurrence
Prix en ligne avec les benchmarks internationaux
Besoin de maintenir des conditions de concurrence loyale sur le sous-marché
Internet
Développement limité : - 0,1 Hôtes Internet / 10000
habitants (90,63 pour MNA) - 476 utilisateurs / 10000
habitants (871 pour MNA)
Qualité et débits insuffisants
Prix des tarifs Internet élevés
- Absence de concurrence entre opérateurs réseau
- Contrainte en matière de développement du contenu local
- Page 54 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Les enjeux
Sous-Secteur
Objectifs qualitatifs du
Xème Plan
Xème Plan 2002-2006)
Besoin d’investissement
Principaux investissements
Programmés
Participation attendue du
secteur privé dans
l’investissement
Capacité du secteur privé
local à participer aux
ouvertures possibles
Téléphone fixe
- Augmenter les taux de connexion
- Améliorer l’offre de services de données
39 % privé soit 1.100 MDT
Modérée
Mobile Augmenter le taux de connexion à 30%
50 à 60 % privé Modérée
Internet
2.840 MDT
90 % privé Forte Les réalisations en matière de PPI
Sous-Secteur Expérience PPI déjà réalisée Actions en cours Obstacles
Téléphone fixe
- Libéralisation de la commercialisation des équipements
- Mise en place de 7.100 Publitels - Centres d’appel à partir de 1998
- Développement de la sous-traitance
- Transformation en entreprise de Tunisie Telecom et engagement d’ouverture de 10% de son capital au privé
- Ouverture de segments du réseau fixe à la concurrence
Volonté d’amener le processus de libéralisation
Mobile 1 opérateur privé ORASCOM : Licence accordée en mars 2002
Octroi des nouvelles licences mobiles, probablement de nouvelle génération
- Taille du marche - Incertitude sur les
développements de la technologie
Internet / Données
- Privatisation de la SOTETEL. (Structure du Capital : Tunisie Télécom : 35% Siemens IC : 10% Divers porteurs : 48% Laceramic : 7%) - Octroi de cinq licences FSI
Préparation de l’octroi d’une licence à un opérateur de données
Restrictions au développement et à l’hébergement de site WEB et au développement du contenu digital
167. Le problème principal eu égard aux télécommunications en Tunisie est le fait que le concurrence est une nouveauté dans ce secteur, et que certains segments y sont encore fermés. Les efforts du Gouvernement ont été concentrés sur l’octroi d’une nouvelle licence cellulaire digitale. La licence a finalement été octroyée à Orascom en mai 2002. Dans le domaine des communications de données, la concurrence a finalement été introduite par le biais de l’entrée d’un nouvel opérateur de données. Le nombre de fournisseurs privés de service Internet, même s’il a récemment augmenté, pourrait aisément augmenter davantage.
- Page 55 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
168. De plus, le développement des services de données est gêné par une faible industrie du contenu et par une régulation excessivement détaillée sur la fourniture de services. L’investissement dans le secteur a été de 1,39 milliards de DT pendant la période du IXème Plan, et il est prévu qu’il passe à 2,84 milliards de DT pendant la période du Xème Plan, soit une augmentation de plus de 100 pour cent40. Pendant la même période, la part du secteur privé dans les investissements de télécommunications est estimée augmenter de 8 pour cent à 39 pour cent. Il va de soi que ces estimations ambitieuses ne pourront être réalisées que si les réformes sont poursuivies sans délais.
169. Le gouvernement tunisien a adopté un programme d’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence pour la période 2003 à 2006 en poursuivant ses engagements avec l’OMC, pris en 1998, et avec l’Union Européenne. Ce programme de libéralisation amènerait une concurrence limitée dans chacun des secteurs du marché en 2006. Cette stratégie est poursuivie dans un contexte international caractérisé par une diminution de l’appétit des investisseurs privés. Néanmoins, l’ouverture progressive à la concurrence reste un pilier essentiel de la stratégie sectorielle.
170. L’amélioration de la régulation sectorielle est d’autant plus importante que l’intérêt des investisseurs étrangers a diminué. Le programme de libéralisation gagnerait donc à être accompagné d’une refonte du système de régulation, notamment en accordant à l’INT des fonctions qui sont actuellement du ressort d’autres institutions telles que l’Agence Nationale des Fréquences et l’Agence Tunisienne de l’Internet. Ce programme devrait être accéléré et devrait aussi inclure une analyse des méthodes de rationalisation du cadre institutionnel et réduire la fragmentation actuelle des attributions réglementaires.
171. L'introduction de la concurrence efficace devrait permettre de développer une infrastructure de l'information libéralisée peu coûteuse et de haute qualité à travers un développement de marché pleinement concurrentiel, avec une forte participation du secteur privé.
172. L’introduction de la concurrence (comprenant la libéralisation de l'infrastructure) devrait produire les gains suivants:
- Présence d'opérateurs spécialisés dans les services de données, qui peuvent mieux cibler la demande des entreprises;
- Investissement du secteur privé dans la modernisation des infrastructures de communications existantes;
- Pas de préjudice à la rentabilité de Tunisie Telecom, puisque la plupart de ses revenus proviennent des services vocaux et puisque Tunisie Telecom profitera, en outre, de revenus élevés d'interconnexion des opérateurs concurrents.
173. Un exemple de programme de libéralisation capable d’amener les revenus du secteur aux niveaux recherchés par le Gouvernement, pourrait être comme suit:
- Attribution de plusieurs licences internationales (vocales et données); - Attribution de licences locales et de longue distance (vocales et données); - Libéralisation complète (aucune restriction au nombre de fournisseurs) à partir d’une
date prévue à moyen terme; - Attribution d’une troisième licence mobile.
40 Tunisie – Xème Plan 2002-2006, chapitre V, “Les technologies des télécommunications”.
- Page 56 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
174. Une approche alternative consisterait à octroyer une ou plusieurs licences technologiquement neutres, couvrant à court terme tous les segments de marché de l’industrie des télécommunications. Cette approche pourrait être cohérente avec les récentes tendances de réforme réglementaires dans le monde. Elle pourrait aussi permettre une transition plus en douceur vers la pleine libéralisation.
En ce qui concerne spécifiquement le segment des données, crucial pour le développement général des TIC, les entreprises privées devraient avoir quatre rôles:
- Opérateur de réseau, fournissant des connexions physiques, la téléphonie de base, et la transmission;
- Fournisseur d'accès, transportant les trafics Internet et de données; - Opérateur de service, offrant les services de base et fournissant des services à valeur
ajoutée; - Fournisseur de contenu, offrant le contenu demandé par l’utilisateur.
175. En conclusion, l’« approche graduelle » de la réforme des télécommunications devrait être accélérée. Pour le secteur des télécommunications, un programme plus accéléré de libéralisation signifie l’opportunité d’attirer des flux substantiels d’IDE, dans une période qui se caractérise par la volonté des opérateurs internationaux d’investir dans les pays en développement. Les exemples réussis des octrois de la licence GSM et de la licence VSAT devraient encourager le Gouvernement à poursuivre sa politique d’introduction de la participation privée dans le secteur. Pour les entreprises tunisiennes, il est vital d’introduire des fournisseurs privés de services mobiles et de données, modernes, fiables et à faible coût, qui les aideraient à améliorer de façon importante leur compétitivité internationale.
- Page 57 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Tableau 12 : Proposition de plan d’action pour le secteur des télécommunications
Politique Sectorielle et Régulation Sous-Secteur
Court Terme Moyen et Long Terme
- Continuation de l’amélioration de l’indépendance du régulateur;
- Inclure dans le Programme de libéralisation sectorielle une date pour la libéralisation complète des télécommunications, incluant le segment du marché international, par l’élimination de barrières d’entrée dans tous les segments du marché;
- Inclure dans le Programme de Libéralisation la confirmation (en accord avec les obligations OMC) que les segments de marché suivants seront ouverts immédiatement à la concurrence: 1) radio messagerie; 2) télex Int;41
- Libéralisation (introduction de la concurrence sans restriction du nombre des acteurs) dans les réseaux et services de données;
- Permettre aux opérateurs actuels et aux nouveaux opérateurs d’offrir ces services.
- Introduction d’un régime de licence-type;
- Introduction de licences de caractère neutre envers la technologie utilisée (par exemple, introduire des licences pour devenir opérateur de télécommunications, sans spécifier de segments de marché à servir ou de technologies à utiliser);
- Libéralisation des réseaux et services vocaux.
PPI Possible
Sous-Secteur Court Terme Moyen et Long Terme
- Poursuite de l’ouverture du capital de Tunisie Telecom;
- Boucle Locale & ISP : Amendement du Programme pour annoncer l’introduction de la concurrence sur le marché des lignes fixes locales;
- Octroi de licences pour la boucle locale; - Autorisation pour les ISP de développer
leur infrastructure, d’atteindre les clients, ou de louer des infrastructures de télécommunications auprès d’autres opérateurs que Tunisie Telecom;
- Attribution de licences de données (services et réseaux);
- Amendement du Programme annonçant le calendrier de libéralisation du Gouvernement pour inclure l’octroi d’une ou plusieurs licences GSM/GPRS effectives à la fin du duopole. Ces licences peuvent être accordées en conjonction ou non avec des licences UMTS.
Ne pas exclure la vente de Tunisie Telecom à un investisseur stratégique.
41 Il est reconnu que ces service étaient remplacés par des nouveaux services. Cependant, la libéralisation de ces services est nécessaire pour respecter les engagements OMC. Actuellement le secteur de la radio messagerie est ouvert à la concurrence au stade du duopole.
- Page 58 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Les transports
176. Grâce à une intensification des investissements et plusieurs années de réformes sectorielles, la Tunisie dispose aujourd’hui d’une infrastructure relativement bonne et de services de transport qui sont parmi les meilleurs de la sous-région. Mais si la Tunisie veut maintenir un taux de croissance élevé et réussir son intégration dans l’économie mondiale, son système de transport doit encore se moderniser afin de répondre aux normes de logistique les plus exigeantes. Les chaînes de transport sur lesquelles reposent les échanges intérieurs et extérieurs laissent encore trop de place aux surcoûts imputables au manque de concurrence, aux ruptures de charges et aux retards de tous ordres.
177. Il est prévu que les investissements de transport passent de 2,49 milliards de DT pendant le IXème Plan à 4,85 milliards de DT pendant le Xème Plan (+ 95%), représentant 30% des investissements anticipés dans l’infrastructure. Tandis que la quasi-totalité de ces investissements dans le IXème Plan était financée par le secteur public, on prévoit que le secteur privé les financera à hauteur de 27% (1,34 milliards de DT) dans le Xème Plan. Les projets qu’il est prévu de réaliser sous forme de concessions incluent l’aéroport du Centre-Est (585 MDT), un port de transbordement (500 MDT), un terminal de conteneurs à Radès (100 MDT) et un port de navires de croisière à La Goulette. Ces investissements privés ne seront possibles qu’en offrant aux investisseurs privés un cadre incitatif approprié.
178. La stratégie de réforme sectorielle du transport du gouvernement est claire. Fondée sur une vision intégrée des infrastructures et des services de transport, elle vise à augmenter progressivement la concurrence dans les sous-secteurs qui s’y prêtent le mieux et à mettre au point des modes de participation du secteur privé adaptés à chaque sous-secteur. La stratégie prévoit de nouvelles réformes, mais, pour l’essentiel, il s’agira de mener à terme celles qui sont en cours.
179. Dans le transport aérien, la desserte du pays est bonne (plus de 100 lignes exploitées), ainsi que le niveau des services offerts à la clientèle, tandis que les redevances d’atterrissage se situent dans la moyenne du bassin méditerranéen. Tunis Air, la compagnie nationale, a subi des pertes proches de 100 millions de DT entre 2000 et 2001 tenant à des causes structurelles (suremploi et obligations de service public non-compensées) aggravées récemment par des cause conjoncturelles liées au terrorisme international (chute du tourisme). Une restructuration importante de l’entreprise est en cours. Des privés tunisiens sont entrés sur le marché des transports aériens avec un succès mitigé. Les résultats de la compagnie Mediterranean Air Service ont été décevants (son créneau, le fret aérien, stagne toujours malgré une demande potentielle importante de la part d’entreprises produisant en flux tendu), tandis que la compagnie Carthage Airlines, créée en 2002 et bénéficiant d’un accord de coopération avec Tunis Air, semble connaître davantage de réussite. L’Office des Aéroports et de l’Aviation Civile (OACA) cumule des fonctions de régulation et des fonctions commerciales. Réalisant des bénéfices importants, il est en mesure d’autofinancer une bonne partie de son programme d’investissement ainsi qu’une péréquation entre les aéroports de l’intérieur et les aéroports internationaux de Monastir, Djerba et Carthage. L’aéroport de Monastir est saturé et, tout comme l’aéroport de Carthage, il est situé en pleine zone urbaine, ce qui empêche son extension et entraîne des nuisances sonores et des risques de catastrophe en cas d’accident d’avion. Le gouvernement prévoit donc de construire un nouvel aéroport du Centre-Est à Enfidha près du pôle touristique de Hammamet-Sud. Cet aéroport pourra à terme se substituer aux aéroports de Monastir et de Carthage. Dans l’intérim, il les soulagera durant une période de transition indéterminée. Le gouvernement envisage de faire réaliser cet aéroport sous le régime de la concession. La conception
- Page 59 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
technique a été réalisée par ADPi, la filiale ingénierie d’Aéroports de Paris (ADP). La viabilité financière de l’aéroport a, quant à elle, été évaluée par une banque d’affaires.
Tableau 13 : Récapitulation du diagnostic du transport aérien
Situation Actuelle
Emplois - Tunisair : 7.000 emplois (avec succursale Tuninter) - Nouvel Air (Charter) : 530 emplois - Carthago (Charter) - OACA : autour de 2.500 emplois
Chiffre d’Affaires - 693 MDT pour Tunis Air en 2001 - OACA : 158 MDT en 2001
Situation Financière Tunis Air : Pertes cumulées de 100 MDT (2000 et 2001)
Subventions annuelles Non
Les Enjeux
Investissements prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
729 MDT
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
585 MDT (Aéroport du Centre-Est)
Les Réalisations en matière de PPI
Expérience déjà réalisée - Ouverture du capital de Tunisair - Ouverture du fret et des charters à la concurrence locale privée - Considération de l’ouverture à la concurrence locale privée de
quelques lignes régulières
Actions en cours - Continuation et achèvement de la restructuration de Tunisair
Obstacles - Contraintes sur les vols réguliers - L’OACA cumule des fonctions commerciales et de régulation - Cadre juridique incomplet
180. Les priorités d’action et les options se situent à plusieurs niveaux. Le cadre juridique du trafic international aérien devrait être progressivement libéralisé sur une base réciproque. Si le marché du charter est largement ouvert à la concurrence, celui des vols réguliers est encore sujet à des contraintes qui n’ont plus de raison d’être. L’action est peut être encore plus nécessaire sur le marché du fret. Les possibilités d’attirer des trafics de transbordement pourraient être également explorées, à la fois pour mieux rentabiliser les plate-formes existantes dont certaines sont sous-utilisées et pour offrir aux entreprises locales une gamme de services et un réseau plus larges que ce n’est le cas aujourd’hui. Concernant Tunis Air, l’intention de l’Etat de reporter au moyen terme sa privatisation ira de pair avec une rationalisation de la gestion de l’entreprise, à commencer par la limitation des obligations de service public et, pour celles qui resteraient à sa charge, une compensation financière intégrale. Enfin, le système de gestion des aéroports qui cumule des fonctions commerciales avec des responsabilités de régulation est à revoir car il porte en soi le germe de conflits d’intérêt, dès lors que l’Etat se prépare à confier la construction de l’aéroport d’Enfidha à un concessionnaire privé. Celui ci concurrence de facto l’OACA, tant dans sa fonction de développement des aéroports que dans celle d’exploitant des aéroports existants. Un risque de traitement discriminatoire sera perçu par les investisseurs privés potentiels, risque qu’ils voudront soit ne pas prendre, soit couvrir en augmentant le coût du projet. Ce problème
- Page 60 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
potentiel doit être traité en préalable et il soulève plusieurs questions importantes : faut-il inclure Monastir dans cette concession ?; Quelle est la capacité initiale à créer, la dimension et le calendrier de réalisation des modules qui suivront ?; Doit-on adapter le système de financement des aéroports, notamment les tarifications et la péréquation qui existe ?; Faut-il aménager le cadre juridique des aéroports ? Compte tenu des questions qui se posent et de leur complexité, il n’est pas sûr que l’aéroport d’Enfidha pourra commencer durant la période du Plan et des interrogations subsistent concernant la part de l’investissement privé. En bonne logique, il faudrait procéder en préalable à une étude exhaustive du potentiel de développement de concessions aéroportuaires privées en Tunisie (identification de projets viables, équilibre financier du secteur, options de régulation et rôle à jouer par l’OACA, etc..), mais l’Etat peut souhaiter aller de l’avant avec le dossier d’Enfidha et ne procéder qu’aux ajustements minima le rendant plus attractif aux investisseurs privés. Si tel était le cas, l’étude aéroportuaire évoquée serait toujours utile, son objectif étant de guider la politique de développement et de rééquilibrage du secteur en tenant la concession privée pour fait acquis.
Tableau 14 : Proposition de plan d’action pour le transport aérien
Court Terme Moyen et Long Terme
- Compléter le dispositif juridique (Code de l’Aéronautique Civile)
- Accélération de la restructuration de Tunisair
- Libéralisation du marché de l’assistance au sol
- Etude de mise en concession des aéroports actuels et futurs et de leurs installations
- Mise au point du dossier d’Enfidha - Lancement de l’appel d’offres pour la
construction d’Enfidha
- Agence indépendante de régulation distincte de l’OACA
- Séparation des fonctions d’opérateur et régulateur de l’OACA
181. En ce qui concerne le transport maritime, il a été libéralisé depuis un certain nombre d’années et la bonne desserte du pays repose sur un marché actif de lignes régulières et de vrac. L’ouverture aux privés tunisiens du marché des lignes et le démantèlement du système des conférences n’ont toutefois pas eu l’effet escompté et l’armement privé reste essentiellement cantonné sur le marché du vrac, les quelques entreprises existantes n’ayant pas la surface financière qui leur permettrait d’accroître leur flotte et d’entrer sur le marché des lignes régulières. L’objectif aujourd’hui pourrait être le renforcement de l’armement national et la restructuration de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), notamment la séparation et la privatisation de sa branche fret. La gestion portuaire a aussi été réformée et elle devrait porter ses fruits dès que seront réglés les difficiles problèmes sociaux que posent la suppression effective du monopole des dockers et la réduction du suremploi à la Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention (STAM), c’est à dire très prochainement. Il faudra ensuite réorganiser la manutention portuaire et la restructuration de la STAM ouvrira des possibilités d’expansion et de regroupement aux entreprises privées existantes qui favoriseront l’efficacité économique. Enfin, l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a été organisé sur le mode du « Port-Propriétaire » et il est appelé à contrôler les activités de service confiées au privé. La logique du système voudrait que l’OMMP se dégage complètement de la consignation des marchandises et transfère au secteur privé les services de grutage, de remorquage et de lamanage. Le mode de gestion « Port-Propriétaire »
- Page 61 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
correspond à la bonne pratique internationale, mais le fait que l’OMMP soit à la fois exploitant et autorité de régulation au niveau national (assurant notamment la police des ports) déroge aux principes généralement admis et crée un doute sur l’égalité de traitement entre activités commerciales exercées par le secteur public (OMMP y compris) et par le secteur privé. Non seulement l’OMMP peut être tenté de concéder des avantages financiers ou autres à la STAM, mais encore l’intérêt commercial de ses concessionnaires peut ne pas toujours coïncider avec la rentabilisation optimale des infrastructures et équipements non concédés. Plus largement, l’intérêt du secteur portuaire peut diverger de celui de l’OMMP, nonobstant le cadre juridique fondant le système en place.
Tableau 15 : Récapitulation du diagnostic du transport maritime
Situation Actuelle
Emplois Environ 1.500 pour l’OMMP, 500 pour la STAM plus 700 dockers.
Chiffre d’Affaires - CTN : 170 MDT en 2001 - OMMP : 78 MDT en 2001 - STAM : 46 MDT en 2001
Situation Financière Pléthorique en ce qui concerne l’OMMP
Subventions annuelles
Aucune
Les Enjeux
Problèmes majeurs - Productivité faible de la manutention - Cumul de fonctions de régulation et d’exploitation
Investissement prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
929 MDT
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
755 MDT (Terminal de conteneurs à Radès, Port de transbordement)
Les Réalisations en matière de PPI
Expérience déjà réalisée
- Ouverture du marché des lignes marchandises et une ligne passagers. Démantèlement des conférences
Actions en cours - Suppression du monopole des dockers - Réduction du personnel STAM et privatisation programmée - Concessions pour le terminal conteneurs à Radès et le terminal
croisiéristes à la Goulette, ainsi que pour les installations portuaires Obstacles - Monopole sur les lignes passagers
- Lenteur des dédouanements
182. Le régime de la concession est en cours d’implantation à grande échelle : outre la concession des terminaux spécialisés existants, le Gouvernement a lancé une consultation internationale pour recruter des services de conseil à la recherche de concessionnaires pour les projets de construction et d’exploitation d’un terminal à conteneurs, ainsi que d’un terminal pour les bateaux de croisières. Une concession de construction et d’exploitation d’un port de transbordement en site vierge près d’Enfidha est également envisagée (un site alternatif est celui de Bizerte). Le succès de ces projets dépend de l’adéquation du cadre légal et réglementaire aux objectifs poursuivis. La concession du terminal à conteneurs dans le port
- Page 62 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
de Radès, le plus grand port du pays près de Tunis, pose le problème très concret de l’équilibre de la concurrence entre une société publique – la STAM – qui est sur le point de signer un contrat avec l’OMMP pour la prise en charge des installations existantes de Radès et un opérateur privé, chargé de construire à ses frais le futur terminal à conteneurs de l’autre côté du bassin. Sera t’il possible pour l’Etat et l’OMMP de ne pas fausser les relations de concurrence entre les deux opérateurs, concurrence d’autant plus intense que des surcapacités temporaires existeront au début de l’exploitation du terminal à conteneurs ? La redevance de concession avantageuse négociée par la STAM sera t’elle revalorisée à temps pour éviter une subvention virtuelle qui avantagerait cette société par rapport à l’autre ? N’y a t’il pas un risque de voir l’OMMP détourner artificiellement des clients potentiels de Radès afin de mieux valoriser son patrimoine dans d’autres ports qui sont sous-utilisés ? Ces questions doivent être étudiées soigneusement de façon à procéder aux aménagements nécessaires du cadre juridique des ports. Les options d’insertion du privé sont à examiner notamment par référence au niveau des tarifs portuaires. En effet, le financement privé des investissements sans recours à des prêts bonifiés aurait un impact considérable sur les redevances exigibles par un promoteur privé et on s’interrogera sur l’opportunité d’un financement mixte ou public selon la formule DBX qui pourrait réduire les coûts financiers. La question principale reste cependant celle de la nécessité ou pas de créer une agence de régulation en dehors de l’OMMP. Dans un premier temps, une capacité de régulation pourrait être recréée au niveau du ministère de tutelle technique, une régulation indépendante pouvant être envisagée à plus long terme. Les banques d’affaires qui seront recrutées prochainement devraient traiter toutes ces questions car elles conditionnent au moins partiellement le succès des projets de mise en concession.
183. La viabilité financière et économique d’un port de transbordement en Tunisie reste à démontrer vu la forte concurrence régnant dans ce secteur. L’intérêt exprimé par un investisseur étranger pour le projet d’Enfidha semble confirmer sa viabilité financière, mais ne dispense pas l’Etat d’une vérification de l’intérêt économique du projet pour la Tunisie et d’une réflexion approfondie sur les avantages et les risques inhérents à tout marché au gré à gré avec un investisseur non sollicité, par rapport à l’approche plus classique et sûre de l’appel d’offres international. En tout état de cause, il est permis de douter que ce projet puisse être entamé et, a fortiori, réalisé au cours du Xème Plan.
Tableau 16 : Proposition de plan d’action pour le transport maritime
Court Terme Moyen et Long Terme - Restructuration de la CTN - Repli de l’OMMP sur ses fonctions de
« Port gérant » (transfert des services commerciaux au privé : grutage, remorquage, lamanage, consignation)
- Séparation des fonctions d’opérateur et régulateur de l’OMMP
- Appel d’offres pour la concession du terminal de Rades (conteneurs) et terminal croisiéristes à la Goulette
- Achèvement de la restructuration de la STAM (secteur de la manutention)
- Renforcement de l’armement national - Création d’une agence de régulation
indépendante distincte de l’OMMP - Réorganisation de l’industrie nationale de la
manutention portuaire
- Page 63 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
184. Dans le transport routier, la libéralisation du camionnage est un fait acquis depuis 1990 et l’offre de transport est entièrement privée depuis 1995. Des lois ont été promulguées en 1997 et 1999 pour réduire le caractère artisanal de la profession et organiser les relations entre transporteurs et chargeurs. Bien que la création de bureaux de fret ait été envisagée, c’est une approche libérale qui sous-tend la politique de l’Etat en la matière. Dans le domaine de la gestion des infrastructures, le transfert au secteur privé en 2000 de l’entretien périodique a réduit au strict minimum le travail en régie et les résultats obtenus sont satisfaisants. Les marges de progrès de l’intervention du secteur privé se situent à deux niveaux principaux.
185. Le transport interurbain d’autobus reste assuré par un monopole publique, la Société Nationale de Transport Routier Interurbain (SNTRI). L’ouverture des transports interurbains d’autobus est à l’ordre du jour : un appel d’offres a été lancé en mai 2003 pour la concession de 5 lignes interurbaines représentant quelques 7% du marché actuel de la SNTRI. A terme il est envisagé de transformer la SNTRI en régulateur du secteur.
186. En ce qui concerne les concessions pour les autoroutes, des appels d’offres sont restés infructueux, notamment à cause du niveau faible des tarifs de péage. La Tunisie a donc choisi de développer son réseau autoroutier à travers des concessions accordées à une société mixte à dominance publique, Tunisie Autoroute, qui bénéficie de l’accès à des prêts extérieurs à taux bonifiés.
Tableau 17 : Récapitulation du diagnostic du transport routier
Situation Actuelle
Emplois SNTRI : 908 en 2001
Chiffre d’Affaires SNTRI : 24 MDT Tunisie Autoroute : 18 MDT en 2001
Situation Financière Satisfaisante
Subventions annuelles
Non
Les Enjeux
Problèmes majeurs Rentabilisation du programme autoroutier
Investissement prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
2795 MDT
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
--
Les Réalisations en matière de PPI
Expérience déjà réalisée
- Sous-traitance - Entretien des routes - Libéralisation du camionnage - Concessions publiques pour autoroutes
Actions en cours Lancement d’un appel d’offres pour la concession de 5 lignes d’autobus
Obstacles Faible niveau des tarifs de péage
- Page 64 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
187. En définitive, le transport routier pose relativement peu de problèmes dans la mesure où la concurrence existe d’abord entre types de transport routier (autocars et « louages ») et entre transport routier et ferroviaire. L’objectif de la politique de l’Etat devrait être de renforcer cette concurrence (l’entrée du privé sur les lignes d’autocar interurbains doit être élargie) et de l’assainir (réduire l’incidence du transport informel et mettre fin aux subventions du « louage », ne serait-ce qu’en raison de l’insécurité routière à laquelle il contribue notoirement).
188. Pour le transport interurbain de personnes, il serait bon d’étudier les modalités d’une transition réussie entre le monopole de la SNTRI et la privatisation de l’offre de services. Comment minimiser les coûts sociaux du repli de la SNTRI ? Comment transformer cette entreprise en agence de régulation sans encourir le risque d’ingérence excessive dans l’activité des entreprises privées, travers fréquent lorsque des exploitants deviennent régulateurs ? En fait, la libéralisation totale du transport de personnes est bien l’objectif qu’il convient de poursuivre à long terme.
189. Dans le secteur des autoroutes, la politique suivie est rationnelle mais l’objectif devrait être de désengager progressivement l’Etat afin de réduire ses charges. Cela ne sera possible que par une revalorisation progressive des tarifs de péage pour tendre au niveau permettant de couvrir à la fois les coûts d’exploitation et de développement. Le passage au financement privé sera alors à la fois possible et attrayant, car l’initiative privée sait davantage que le secteur public comment minimiser les coûts.
Tableau 18 : Proposition de plan d’action pour le transport routier
Court Terme Moyen et Long Terme
- Développement d’une capacité de régulation au ministère de tutelle des transports interurbains de personnes
- Etude sur le réseau national du transport interurbain et définition du plan de mise en concession de l’ensemble, de repli de la SNTRI et de réduction du transport informel.
- Concession de l’ensemble du réseau des lignes régulières de transport public interurbain de personnes
- Transformation de la SNTRI en agence de régulation des transports interurbains de personnes ou création d’une agence indépendante
- A plus long terme, libéralisation du transport interurbain de personnes
190. Dans le transport urbain, le secteur privé n’est pas encore présent, si ce n’est de façon marginale à Tunis. Le transport en commun est encore assuré par des monopoles publics. Même si les conditions ambiantes se sont améliorées au cours des cinq dernières années, le transport urbain souffre encore d’une compensation insuffisante des obligations de service public et d’inefficacités liées au mode de gestion. L’offre de transport en commun a mal suivi la croissance explosive de la demande (surtout des « scolaires ») et l’encombrement des voiries urbaines par les véhicules de particulier est devenu chronique dans les grandes villes. Il est prévu d’ouvrir ce marché à la participation d’entreprises privées sous le régime de la concession. Les entreprises publiques resteront gestionnaires des réseaux maillés dans le cadre du périmètre urbain, tandis que le privé se verra attribuer des lignes radiales de transport par autobus entre le centre et les banlieues. Des cahiers des charges ont été mis au point et les appels d’offres ont été lancés en mai 2003 pour la concession de 20 lignes privées dans l’agglomération de Tunis. Cette opération devrait être ultérieurement élargie, non seulement à Tunis mais aussi dans les autres grandes villes. L’approche graduelle privilégiée par l’Etat repose sur la notion que le succès de l’appel d’offres en cours aura un effet de
- Page 65 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
démonstration qui renforcera les chances d’opérations similaires à plus grandes échelles. Le renforcement du transport en commun dans les grandes villes appelle d’autres mesures : il faut doter Tunis d’une gamme supérieure de transports de masse. Une étude d’avant-projets sommaires et détaillés est en cours, portant sur l’extension du réseau de tramway, la création d’un réseau ferroviaire rapide, des transports d’autobus express en site propre et des pôles d’échange d’un mode à l’autre. La formule de la concession de travaux et d’exploitation pourrait trouver ici des applications intéressantes pour le pays. En toutes hypothèses, le cadre institutionnel devra être rationalisé : il faudra notamment mettre au point un système de financement plus stable et aux ressources plus diversifiées, ainsi qu’un système de gestion plus décentralisé (de type « Autorité Organisatrice ») si l’on veut faire du transport en commun urbain une activité efficace et financièrement équilibrée sans laquelle le transport individuel ne cessera d’augmenter au détriment de la fluidité du trafic et de la qualité de l’air.
Tableau 19 : Récapitulation du diagnostic du transport urbain
Situation Actuelle
Emplois SNT : 5.192 en 2001
Chiffre d’Affaires SNT : 57 MDT
Situation Financière Déficit de 19 MDT en 2001 pour la SNT
Subventions annuelles
Environ 75 MDT pour toutes les compagnies
Les Enjeux
Problèmes majeurs - Financement insuffisant et mal ciblé des entreprises - Incapacité de l’offre de transport en commun à suivre la demande
Investissement prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
Environ 500 MDT (non compris le développement des nouveaux grands réseaux de transport)
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
--
Les Réalisations en matière de PPI
Expérience déjà réalisée
Expérience marginale à Tunis
Actions en cours - Création d’autorités organisatrices des transports urbains (Tunis, Sahel et Sfax) (en préparation)
- Sous-traitance et concessions de lignes (20 lignes)
Obstacles Faiblesse financière limitant l’investissement
Tableau 20 : Proposition de plan d’action pour le transport urbain
Court Terme Moyen et Long Terme
- Création d’autorités organisatrices pour la gestion des transports dans les grandes villes
- Lancement d’un appel d’offres pour la mise en concession de lignes d’autobus centre ville–banlieue dans l’agglomération de Tunis
- Sous-traitance au secteur privé de parties de réseaux/services exploités par les entreprises publiques dans les principales villes
- Concessions pour de nouveaux modes de transport de masse (autobus express en site propre, RFR - Réseau Ferroviaire Rapide)
- Page 66 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
191. Dans le secteur ferroviaire, l’Etat a mis en place un nouveau cadre institutionnel qui devrait, à terme, dynamiser la gestion de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT). Il s’agit d’une réforme de grande ampleur et difficile à négocier avec les syndicats, toujours puissants dans ce secteur. Il n’est donc pas surprenant que la réforme tarde à s’enraciner dans les faits. La société ferroviaire a subi une perte record de 19 millions de DT en 2000 qui a conduit l’Etat à décider d’un plan de restructuration financière. Ce plan veille notamment à mieux délimiter les obligations de service public, à pourvoir à leur financement et à faciliter la baisse des coûts (grâce, notamment, à la prise en charge par l’Etat des plans sociaux qui ont déjà touché 1.500 employés et en toucheront encore 800 entre 2003 et 2006). Le champ de la participation du secteur privé à l’activité ferroviaire est comparativement plus restreint, au moins à court et moyen termes, mais de réelles opportunités existent, qu’il faudrait saisir. L’entretien sous contrat d’une partie du matériel de traction est déjà programmé et une action plus générale serait souhaitable. La régie de travaux porte sur des montants financiers importants et il est nécessaire de la ramener à de plus faibles proportions car elle est toujours génératrice de surcoûts cachés. La privatisation de filiales est une autre possibilité dans un double objectif de dynamisation de leurs activités et de réduction des coûts ferroviaires. Enfin, la solution de délégation de services ferroviaires ou de réseaux mérite une attention particulière. D’une part, il pourrait être opportun d’y recourir pour redresser l’activité « marchandises générales » en partenariat avec une entreprise privée. D’autre part, le Réseau Sud est étroitement spécialisé sur l’industrie des phosphates et il pourrait être concédé à une société privée, dont la SNCFT pourrait être actionnaire.
Tableau 21 : Récapitulation du diagnostic du transport ferroviaire
Situation Actuelle
Emplois SNCFT : 6.000
Chiffre d’Affaires SNCFT : 99 MDT (2001)
Situation Financière Perte : 19 MDT
Subventions annuelles
Oui
Les Enjeux
Problèmes majeurs Sureffectif; productivité insuffisante; faible dynamisme commercial
Investissement prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
375 MDT
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
---
Les Réalisations en matière de PPI
Expérience déjà réalisée
- Nouveau cadre institutionnel en cours de mise en place - Restructuration de l’organisation de la SNCFT terminée
Actions en cours - Entretien sous contrat du matériel de traction - Restructuration financière de la SNCFT - Réduction des effectifs avec compensation adéquate.
Obstacles Risque d’une détérioration de la situation financière de la SNCFT dans le long terme
- Page 67 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Tableau 22 : Proposition de plan d’action pour le transport ferroviaire
Court Terme Moyen et Long Terme
- Limitation des travaux en régie - Etude de préparation de concessions
- Concession du réseau sud (Phosphates) - Partenariat avec un investisseur stratégique
pour la gestion du trafic de marchandises générales et de conteneurs
192. Les conditions d’exercice de la logistique moderne en Tunisie ne sont pas encore réunies. Outre les problèmes décrits precédemment dans les différentes branches de l’activité transport, on constate l’existence de freins institutionnels multiples. Les transports aériens express - d’importance capitale pour les entreprises tournées vers l’exportation - sont un monopole de la Poste Rapide dont la performance ne répond pas pleinement à l’attente des clients. Une libéralisation de ce secteur est absolument nécessaire. L’obligation de contracter une assurance locale ne fait souvent que renchérir, sans bénéfice, le coût des transactions du commerce extérieur. La pratique de l’inspection douanière reste incompatible avec une rotation rapide des marchandises dans les ports d’entrée. Les procédures documentaires et la transmission des données ont des perspectives d’amélioration substantielle avec l’implantation de la société Tradenet - encore faut-il que les commerçants sachent en tirer partie. Une professionnalisation des fonctions logistiques est nécessaire, à commencer par le renforcement des sociétés de transit et d’entreprises logistiques pour compte de tiers. Plus généralement, il faut que la Tunisie se mette aux normes mondiales en ratifiant toutes les conventions et traités relatifs au transport international et multimodal. Les lois locales qui dérogent à ces conventions sont facteurs d’incertitude dans la gestion des flux de transport et le partage des responsabilités y afférentes, constituant un réel handicap pour la Tunisie au sein de « l’économie globale » (l’échange est freiné, les investisseurs étrangers se détournent). Enfin, les Zones d’Activités Logistiques (ZAL) prévues dans le Xème Plan sont de nature à combler certaines lacunes (meilleure articulation entre transports internationaux denses et transports de desserte nationale artisanaux) mais il faut affiner la stratégie de leur développement, portant en particulier sur leur nombre, leur implantation et l’association optimale du privé à leur construction et à leur exploitation. Un examen de ces questions est souhaitable en préalable aux réalisations.
Tableau 23 : Proposition de plan d’action pour le transport multimodal et postal
Court Terme Moyen et Long Terme
- Elimination du Monopole de la Poste Rapide - Assouplissement des règlements sur
l’assurance et ouverture du secteur aux sociétés étrangères.
- Développement du nombre d’opérateurs du commerce international abonnés au réseau Tradenet
- Ratification des conventions internationales sur le transport multimodal
- Développement d’une stratégie de promotion des Zones d’Activités Logistiques
- Assouplissement des conditions d’accès à la profession de transporteur multimodal
- Création d’une agence multi-sectorielle - Réalisation des ZAL prioritaires - Actions d’information et de formation
- Page 68 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
L’électricité et le gaz
193. La Tunisie a atteint un excellent niveau de desserte en électricité (100% en zones urbaines et 93% en zones rurales en 2001) et un bon niveau de qualité de service à un prix abordable et sans subventions annuelles directes. La STEG a environ 9.360 employés, alors qu’elle en avait plus de 10.000 en 2000. Cette baisse, en dépit d’une desserte accrue, témoigne de l’accroissement de l’efficacité de l’entreprise. Ces acquis sont considérables.
194. Le gros de la production, du transport et de la distribution de l’électricité et la distribution du gaz relèvent de la responsabilité d’une entreprise publique intégrée verticalement, la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG). Une loi de 1996 a aboli le monopole de la STEG en matière de production d’électricité et le premier producteur d’électricité indépendant (IPP) a commencé la production commerciale en mai 2002 à Radès. Cet IPP de 471MW représente environ 15% du total de la puissance actuelle installée. Sa production totale est vendue à la STEG dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie à long terme. Un deuxième IPP de 27MW à Zarzis utilisant le gaz non-commercial du gisement d’hydrocarbures à El Biben a été signé plus récemment. Un troisième IPP d’une capacité de 500MW est envisagé à Barka dans la région de Sfax en utilisant le gaz non-commercial du gisement de Miskar. Une déclaration d’entente a été signée récemment entre British Gas, concessionnaire du gisement, et l’Etat concernant la réalisation et l’exploitation de la centrale.
195. Les investissements devraient passer de 1.698 millions de DT pendant le IXème Plan à 2.524 millions de DT42 pendant le Xème Plan (+49%). La STEG a été historiquement viable sur le plan financier, mais la hausse des prix du gaz tunisien, qui sont indexés sur les prix internationaux du fioul lourd, a conduit à une détérioration de ses performances financières, et en 2000, elle s’est traduite par une perte de 41,7 millions de DT. Au cours de la même année, le ratio de couverture du service de la dette de la STEG est tombé à moins de un et sa capacité d’autofinancement a été considérablement réduite. La détérioration de la position financière de la STEG peut être presque entièrement attribuée à son incapacité à répercuter les augmentations des prix du fuel sur ses clients par des formules automatiques et adaptées de révision tarifaire. Cette situation s’est redressée en 2001 et en 2002, années au cours desquelles le résultat net de l’exercice après impôts est redevenu positif pour atteindre respectivement 52 MDT (2001) et 45 MDT (2002), grâce aux ajustements des tarifs de l’électricité.
196. Les révisions tarifaires sont proposées par la STEG au Ministère de l’Industrie et de l’Energie pour examen et approbation. Le gouvernement poursuit une politique de stabilisation des prix de détail de l’électricité et du gaz. Compte tenu de l’indexation du prix du gaz sur le fioul lourd, ceci entraîne des excédents de trésorerie quand les cours mondiaux des produits pétroliers sont faibles et des déficits quand les cours sont élevés. Des ajustements de tarifs de l’électricité ont eu lieu en 2000, 2001 et 2003, atteignant respectivement 4,35%, 2,45% et 5,45%. Cependant, dans le cadre de cette politique, la STEG n’a pas été autorisée, au cours des dernières années, à répercuter les augmentations des prix du gaz. Les tarifs de l’électricité en Tunisie sont faibles par rapport à ceux des pays du Sud de l’Europe et même à ceux de certains pays de la Région MENA. Ils sont insuffisants pour assurer l’équilibre financier de la STEG si les prix des produits pétroliers restent élevés. La
42 2.092 millions de DT pour l’électricité et 432 millions pour le gaz.
- Page 69 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
viabilité financière de la STEG est à son tour essentielle pour assurer le niveau d’autofinancement nécessaire pour le développement du système électrique.
197. Le secteur électrique est crucial à l’emploi, la croissance et la compétitivité de l’économie nationale, surtout dans les secteurs industriels à forte utilisation d’énergie. Pour cela, et pour protéger les consommateurs de manière générale, il est essentiel d’exploiter tous les créneaux pour l’amélioration de l’efficacité du système électrique, y compris la concurrence par comparaison entre filiales sur la base d’une comptabilité analytique fiable, la mise en concurrence de centrales de production d’électricité suivant divers modèles de marché qui restent à être déterminés, la réduction des besoins de capacité de réserve en poursuivant l’intégration régionale et la poursuite du recours au secteur privé pour tous les nouveaux projets de production d’électricité.
Tableau 24 : Récapitulation du diagnostic sur l’électricité et le gaz
Situation Actuelle
Emplois STEG : 9.406 en 2002 (contre 9.415 en 2001 et 9.360 emplois en 2000)
Chiffre d’Affaires 821 MDT en 2002 (727 MDT en 2001)
IXème Plan – Investissements réalisés
1 698 MDT 21% privé (Radès II)
Situation Financière Résultats nets positifs de 45 MDT en 2002 et de 52 MDT en 2001 contre une perte de 41 MDT en 2000
Subventions annuelles Non
Desserte - 100% en zone urbaine - 95% en zone rurale en 2003 (93% en 2001 et 91% en 2000)
Continuité Service continu, ruptures très rares
Pertes 12% de pertes techniques
Les Enjeux
Problèmes majeurs Prix non révisés
Autres problèmes Gaz et électricité dans la même entreprise (avantages et désavantages à étudier)
Investissement prévus lors du Xème Plan (2002-2006)
1.851 MDT (dont 560 MDT pour la production, 457 MDT pour le transport, 492 MDT pour la distribution, 290 MDT pour le gaz, et 52 MDT pour autres)
Investissement privé prévu pour le Xème Plan
- Ventilation non disponible - Au minimum une centrale à cycle combiné (270 MDT)
Etudes et Réalisations en matière de Réformes et de PPI
Expérience déjà réalisée
- IPP Radès II (471MW) - IPP Zarzis (27MW)
Actions en cours - Etude sur les options institutionnelles et de régulation (Etude KEMA) - Négociation du projet Barka (500 MW)
Obstacles - Absence d’une politique sectorielle claire et explicite, notamment en matière de tarification et de participation du secteur privé
- Des potentiels d’augmentation de l’efficacité restent à être identifiés et exploités
- Page 70 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
198. Au vu de la taille limitée du marché de l’électricité tunisien, un marché de gros concurrentiel ne se créerait pas facilement. La poursuite de la politique actuelle qui permet aux investisseurs privés d’investir dans la production d’électricité présente donc certains avantages. Mais elle est seulement réalisable à condition que la viabilité financière de la STEG, menacée par des prix du gaz toujours élevés, puisse être rétablie. La Tunisie pourrait à terme bénéficier de l’intégration régionale au sein du Maghreb et avec l’Europe dans le contexte de la boucle électrique méditerranéenne prévue qui pourrait créer des conditions dans lesquelles une restructuration du secteur et la mise en concurrence pourraient apporter des avantages plus importants.
199. Une question importante en ce qui concerne la participation privée dans le secteur de l’électricité et du gaz est le système de passation de marchés. De manière générale, les concessions devraient être accordées après recours à la concurrence, et ceci par appel d’offres international pour des projets dépassant une certaine taille. Cependant, dans la commercialisation du gaz non-commercial destiné à la production de l’électricité, les appels d’offres ne sont souvent pas réalisables. De manière générale les droits sur le gaz non-commercial sont inclus dans les permis d’exploitation des gisements de gaz commercial. Dans ce cas le recours à la concurrence pour la commercialisation du gaz non-commercial est impossible, car l’exploitant a le droit de commercialiser le gaz soi-même ou de le brûler. La législation tunisienne reconnaît cette situation par le décret relatif à la production d’électricité à partir du gaz non-commercial qui permet le gré à gré, mais en imposant une limite pour la capacité des centrales (inférieures à 40MW). Le contrat de la centrale de Zarzis a été accordé sur la base de ce décret. Toutes les concessions de production d’électricité, sauf celles permises par le décret sus-mentionné, doivent se faire par recours à la concurrence sur la base de la loi de 1996, comme c’était le cas du premier IPP, à Radès. Vu sa capacité importante, l’IPP de Barka (500 MW, voir paragraphe 2) ne rentre dans aucun de ces cadres légaux. Son accord est donc préalable à l’approbation par l’Assemblée Nationale. Une étude a démontré que le prix de l’électricité est moins élevé que pour le premier IPP soumis à la concurrence, ceci grâce au prix du gaz non-commercial qui est inférieur à celui du gaz commercial. Le cas de la commercialisation du gaz non-commercial démontre que le recours à la concurrence ne peut pas toujours être systématique. Une loi sur les concessions devrait donc permettre des exceptions au principe de la concurrence, mais en les limitant clairement et en établissant des gardes fous tel qu’une approbation par l’Assemblée Nationale comme pour le gaz du projet de Barka. Cependant une étude pour analyser l’impact du projet Barka sur la situation financière de la STEG et les tarifs reste à mener.
200. Un Plan d’Action pour le secteur de l’électricité et du gaz pourrait s’articuler autour de deux axes : des mesures de politique sectorielle et de régulation à prendre au niveau politique (Ministère de tutelle, Conseil des Ministres, Parlement); et des réformes au niveau de l’entreprise publique.
201. En terme de politique sectorielle et de régulation, il est essentiel d’élaborer la conception de la structure et du développement des secteurs de l’électricité et du gaz à moyen et long terme, y compris une stratégie sectorielle pour la participation du secteur privé, une stratégie pour l’évolution vers un système concurrentiel et une politique des prix. Après avoir défini une stratégie sectorielle, celle-ci pourrait être concrétisée sous la forme d’une nouvelle loi sur l’électricité et le gaz ou d’un amendement de la Loi existante. En même temps, il y a lieu de créer une unité de régulation économique au sein du Ministère de l’Industrie et de l’Energie. A terme cette unité pourrait évoluer vers une autorité de régulation.
- Page 71 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
202. Au niveau de la STEG, un modèle de marché de l’électricité et du gaz devrait être choisi sur la base de l’option présentée dans l’étude KEMA après validation des impacts financiers par une étude complémentaire. La mise en place de centres d’activité (production, transport et distribution de l’électricité; transport et distribution du gaz) est en cours conjointement à un système de comptabilité analytique. En même temps, un plan de restructuration pourrait être élaboré qui mènerait à terme à la séparation formelle des centres d’activités au sein de la STEG, y compris la création de filiales régionales de distribution. Sur le long terme, la mise en concession de la distribution au niveau régional pourrait être considérée. Ceci pourrait être réalisé par une concession pilote dans une seule région, pour évaluer la performance du secteur privé en comparaison avec les distributeurs publics et pour ensuite déterminer les étapes suivantes à mener en fonction des résultats obtenus. La mise en concession pourrait se faire avec recours à l’investissement privé (concession au sens étroit du terme) ou bien sans recours à l’investissement privé sous la forme d’un affermage. L’établissement d’une base de données est essentiel pour pouvoir évaluer de manière objective la performance des filiales et des opérateurs publics et privés. De préférence, cette base de données sera gérée par un régulateur indépendant, bien que, dans une phase initiale, elle puisse être gérée par une unité de régulation au sein du Ministère de l’Industrie et de l’Energie. La STEG a proposé de commencer par établir cette base de données comme base objective à toute opération d’audit et de proposition de réforme et non pas de la réaliser après coup.
- Page 72 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Tableau 25 : Proposition de plan d’action sur l’électricité et le gaz
Court Terme Moyen et Long Terme
Politique et régulation
- Diagnostic distinguant les aspects (i) de la restructuration; (ii) du financement; et (iii) de l’ouverture du marché
- Elaboration d’une base de données - Elaboration de la conception de la structure et du
développement des secteurs de l’électricité et du gaz à moyen et long terme
- Analyse de l’impact de la nouvelle conception du marché et du secteur sur la viabilité financière de la production, du transport et de la distribution
- Articulation d’une politique des prix de l’électricité, du gaz et d’autre produits pétroliers
- Mise en place d’une unité de régulation des tarifs au sein du Ministère de l’Industrie et de l’Energie
- Elaboration du cadre juridique et réglementaire approprié pour les secteurs de l’électricité, des énergies renouvelables et du gaz, y compris les arrangements pour la participation du secteur privé en cohérence avec la nouvelle structure et en prenant en compte les développements régionaux
- Etablissement d’un cadre juridique pour faciliter la PPI dans les énergies renouvelables
- Préparation d’un plan pour la mise en place du nouveau cadre juridique et de réglementation
- Création des groupes de suivi et de travail pour la mise en œuvre de la réforme
- Promulgation d’une nouvelle loi sur l’électricité et le gaz
- Création d’une autorité de régulation (Evaluer la possibilité d’intégrer une filiale électricité et gaz au sein d’un régulateur multi-sectoriel)
STEG - Développement d’une base de données permettant de suivre les indicateurs pertinents du secteur (efficacité et impact)
- Elaboration de la conception (modèle de marché) et du mécanisme de marché de l’électricité et du gaz
- Elaboration de l’organisation du marché y compris un système de tarification
- Simulation des impacts économique et financier de ces propositions et comparaison avec la situation actuelle
- Elaboration d’un plan de la mise en œuvre de la restructuration de la STEG
- Séparation de la comptabilité et création des centres d’activité (production, transport et distribution de l’électricité et du gaz)
- Séparation formelle des activités gaz et électricité
- Séparation formelle des activités de production, de transport et de distribution.
- Création d’un opérateur du système
- Création de filiales régionales de distribution
- ouverture de filiales de distribution aux concessionnaires privés
PPI possible
Lancement d’un appel d’offres pour un nouvel IPP (Ghannouch)
Autres Développement d’une base de données permettant de suivre les indicateurs pertinents du secteur (efficacité et impact)
- Page 73 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
L’eau potable
203. La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), entreprise publique autonome nationale sous la tutelle du Ministère chargé de l’agriculture, est responsable de la production et de la distribution de l’eau potable et industrielle dans les zones urbaines et les grandes agglomérations rurales. La production et la distribution de l’eau dans les zones rurales dispersées sont assurées par la Direction du génie rural, qui relève du Ministère de l’agriculture. La Direction des grands travaux hydrauliques, qui relève du même Ministère, est responsable de la construction des grands barrages et des réseaux d’irrigation.
204. Environ 55% des ressources en eau de la SONEDE proviennent des eaux de surface tandis que 45% sont des eaux d’origine souterraine. La SONEDE achète 40% de ses ressources et produit elle-même les 60% restants à partir de deux barrages concédés par l’Etat à la SONEDE (15%) et de l’ensemble des ressources souterraines (45%). La performance de la SONEDE est très bonne par rapport aux normes régionales, elle assure un approvisionnement continu en eau de bonne qualité tout au long de l’année et elle a le pourcentage le plus bas d’eau non comptabilisée dans la région (environ 20% en 2002). En 2002, la SONEDE comptait environ 7.038 employés dont 5.865 permanents et 1.173 occasionnels. Le nombre d’employés par branchement est de l’ordre de 4,1, en diminution constante mais lente : la SONEDE peut toujours faire mieux sur ce plan, le ratio des deux services eau et assainissement (ONAS) pris ensemble est de l’ordre de 10 employés par branchement, bien supérieur aux normes internationales.
205. Les investissements prévus par la SONEDE devraient augmenter substantiellement pour passer de 285 millions de DT réalisés pendant le IXème Plan à 499 millions de DT courants pendant le Xème Plan (+75%). Dans une large mesure, ceci est imputable à des investissements relativement coûteux pour le transfert des eaux à partir du Nord du pays et pour le dessalement de l’eau de mer à Djerba. Etant donné que les tarifs de l’eau en Tunisie sont uniformes pour l’ensemble du pays, ces investissements nécessiteront des ajustements tarifaires importants pour conserver l’équilibre financier de la SONEDE. Il faut signaler que le contrat-programme 1997-2001 (IXème Plan) prévoyait des augmentations tarifaires annuelles de 10,5% et un investissement total de 381 millions de DT. Les réalisations n’étaient que de 285 millions DT reflétant ainsi le fait qu’il n’y a eu que deux augmentations des tarifs en 1999 et 2001 et bien en deçà des 10,5%. Les révisions tarifaires sont proposées par la SONEDE au Ministère chargé de l’Agriculture pour examen et approbation. La SONEDE ne reçoit pas de subventions directes du Gouvernement. Toutefois, si les augmentations tarifaires requises ne sont pas accordées, la viabilité financière de la SONEDE peut être menacée ou son plan d’investissement se verrait drastiquement diminué ce qui n’est pas toujours souhaitable quand des actions de renouvellement sont requises pour préserver les acquis et maintenir le niveau et la qualité du service.
206. L’engagement de la SONEDE dans l’approvisionnement des grandes agglomérations rurales atteint déjà ses limites et les nouvelles opérations d’extension commencent à toucher le rural dispersé. D’un autre côté, la SONEDE prévoit déjà le recours aux techniques de dessalement pour satisfaire les besoins de certaines régions du pays. Ces deux directions font augmenter le coût marginal par mètre cube et l’extension dans le rural dispersé fait diminuer les recettes marginales. Par exemple, en 2001 dans le milieu rural le prix de vente moyen était de 0,398 DT/m3, tandis que le coût de revient était de 0,746 DT/m3 selon la comptabilité analytique de la SONEDE. Les coûts de dessalement de l’eau saumâtre varient entre 0,601
- Page 74 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
DT/m3 et 0,783 DT/m3 sans inclure les coûts de distribution, tandis que le prix de vente moyen en milieu urbain est de 0,511 DT/m3 seulement.
207. Le nouveau Code de l’Eau ouvre la porte aux opérateurs privés pour la production d’eau par des moyens non conventionnels. Certains des grands consommateurs industriels ou touristiques qui sont actuellement chargés au tarif de 0,79 DT/m3 correspondant au tarif le plus élevé de la grille des tarifs pour les ménages pourraient recourir à des solutions alternatives non conventionnelles, pourvu que les coûts associés soient en deçà des tarifs des la SONEDE. Ceci est le cas pour le dessalement des eaux saumâtres, mais celles-ci sont disponibles en quantité suffisante seulement dans certaines localités. En ce qui concerne le dessalement de l’eau de mer, son coût de production par des unités de petite taille est encore bien supérieur aux tarifs actuels de la SONEDE, ceci sans tenir compte d’éventuelles réductions de coûts résultant de progrès technologiques. Vu que plus de 50% des recettes de la SONEDE proviennent de 3% des abonnés qui représentent les grands consommateurs, une tendance à l’auto production pourra nuire à la viabilité financière de la SONEDE et éroder la base du système actuel de subventions croisées.
208. La pression sur la SONEDE se fait sentir de plus en plus pour contrôler ses coûts. Le modèle actuel devrait s’adapter à ces nouveaux défis qui menacent la viabilité du système et par conséquent la qualité du service. Le secteur aura besoin d’augmenter son efficacité et tous les moyens susceptibles de contribuer à réaliser cet objectif devraient être analysés de près. La participation du secteur privé dans le secteur de l’eau est un de ces moyens.
209. Le secteur de l’eau potable en Tunisie n’a vu à ce jour qu’une participation privée très limitée. Jusqu’à présent, la participation privée dans le secteur de l’eau s’est limitée à un programme de sous-traitance. En fait, malgré une étude réalisée sur la sous-traitance en 1999, très peu d’activités ont été sous-traitées à ce jour (gardiennage et nettoyage). Toutefois, le Gouvernement envisage de faire financer la station de dessalement prévue à Jerba par le moyen d’un BOT/DBX.
Tableau 26 : Résumé du diagnostic du secteur de l’eau potable
La situation actuelle
Emplois SONEDE : 7.038 (5.865 permanents et 1.173 occasionnels)
Chiffre d’Affaires Annuel 165 MDT en 2002
Besoins d’investissement pour le IXème plan (1997-2001)
295 MDT réalisés (contrat-programme initial : 382 MDT; contrat-programme révisé : 302 MDT)
Participation du secteur privé (en %) Montant
0 % privé
Situation Financière Résultat net positif
Subventions annuelles 0 (le programme d’investissement pour l’approvisionnement des zones rurales est pris en charge par l’Etat)
- Page 75 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
L’efficacité
Desserte Bonne desserte : - 100 % en zone urbaine - 82 % en zone rurale (42% assurés par la
SONEDE)
Continuité, Qualité du Service 20% d’eau non comptabilisée
Niveau des tarifs Tarif moyen 0,493 DT/m3 (2002)
Problèmes majeurs Faible productivité du personnel
Les enjeux
Objectifs qualitatifs du Xème plan
Investissements prévus lors du Xème plan (2002-2006)
499 MDT
Principaux investissements programmés Non disponibles
Participation attendue du secteur privé dans l’investissement
10% soit 50 MDT (participation des tiers)
Capacité du secteur privé local à participer aux ouvertures possibles
Faible
Les réalisations en matière de PPI
Expérience PPI déjà réalisée
Actions en cours - Préparation de sous-traitance d’activités - Etude sur l’opportunité d’un BOT pour le
dessalement à Jerba
210. La stratégie en matière de PPI s’est limitée jusqu'à maintenant à rechercher un investissement sous forme de BOT dans le domaine du dessalement de l’eau de mer. Par ailleurs le choix a été fait de rechercher à diminuer l’importance du poids du personnel par la sous-traitance, cette démarche doit être poursuivie, et même accélérée, elle ne peut cependant pas être assimilée à une PPI, mais elle peut apporter des solutions aux lourdeurs actuelles de la gestion du personnel, dont les frais représentent environ 44% des charges d’exploitation, et faciliter d’éventuelles PPI ultérieures.
L’assainissement
211. L’Office National de l’Assainissement (ONAS), organisme public indépendant national sous tutelle du Département de l’environnement, est responsable de la récupération, du traitement et de l’élimination des eaux usées dans les villes, les zones industrielles et touristiques. Le mandat de l’ONAS inclut aussi la protection de l’environnement. La Direction du génie rural est responsable de l’assainissement dans les zones rurales non couvertes par l’ONAS, et les municipalités se chargent du ramassage et de l’élimination des déchets solides, ainsi que des systèmes de drainage pour l’écoulement des eaux pluviales.
212. La performance technique de l’ONAS est très bonne par rapport aux normes régionales, mais son efficacité peut être améliorée, en particulier au vu du ratio relativement élevé d’employés par branchement. Les très bonnes performances de la Tunisie en matière d’assainissement s’expliquent par un recouvrement relativement élevé des coûts. De fait la tendance actuelle de baisse du recouvrement des coûts est inquiétante. Des actions et décisions devront être prises avant qu’un cercle vicieux ne se mette en place. En 2002,
- Page 76 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
l’ONAS avait 5.500 employés dont 4.000 employés permanents et 1.500 occasionnels. L’existence de 66 stations d’épuration des eaux usées en bon état de marche est un résultat remarquable et unique parmi les emprunteurs de la Banque dans la région. Les investissements de l’ONAS devraient passer de 390 millions de DT pendant le IXème Plan, à 525 millions de DT pendant le Xème Plan, soit une augmentation de 32%. Comparés aux investissements dans le secteur de l’eau potable réalisés par la SONEDE, les investissements dans le secteur de l’assainissement restent plus élevés. Il s’agit là d’un point important à noter, vu que, dans la majorité des autres pays en développement, l’assainissement est négligé par rapport à l’approvisionnement en eau. Le corollaire est que les tarifs de l’assainissement sont élevés par rapport aux normes régionales, témoignant d’un effort soutenu de recouvrement des coûts, absent dans presque tous les autres pays en développement. Cependant, il y a eu un gel des tarifs de 1998 à 2003, tandis que les coûts opérationnels connaissaient eux une croissance moyenne d’à peu près 10%. Depuis lors, l’ONAS a vu sa situation financière se détériorer et sa capacité d’autofinancement s’éroder. Les déficits opérationnels ont connu une croissance exponentielle, atteignant 8,4 MDT en 2002 et au moins 13 MDT en 2003. Pour maintenir l’équilibre financier de l’ONAS, il faudrait que les subventions annuelles accordées par le gouvernement, d’environ 50 MDT en 2002, soient doublées à l’horizon 2006. Ce qui semble difficile à tenir. Les frais de personnel représentent environ 43% des charges d’exploitation et la pression sur l’ONAS monte déjà pour trouver des mécanismes de financement pour certains des investissements prévus dans le cadre du Xème Plan.
213. Les redevances de l’assainissement sont facturées et encaissées par la SONEDE, ce qui, d’une part, correspond aux bonnes pratiques internationales, mais de l’autre, fait qu’il est impossible pour l’ONAS à lui seul d’améliorer l’encaissement des factures de ses comptes clients.
214. La participation du secteur privé dans l’assainissement est légèrement plus avancée que dans le secteur de l’eau. L’ONAS a initié la sous-traitance des services d’entretien pour les réseaux d’égouts en 1997. Depuis lors, trois marchés ont été attribués couvrant moins de 12% du réseau d’égouts. Un autre marché pour la réhabilitation et l’exploitation de trois stations d’épuration des eaux usées a dû être annulé en raison, entre autres, de la mauvaise performance de l’opérateur. Il est envisagé de sous-traiter 19% de l’exploitation du réseau d’égouts d’ici 2006. Dans l’ensemble, même si la performance des trois autres entrepreneurs est bonne, les possibilités de participation privée demeurent limitées en l’absence de réformes. Les opérateurs – des entreprises tunisiennes et des coentreprises avec des sociétés étrangères – sont déçus par la lenteur des transactions, l’administration bureaucratique des marchés et la durée trop courte des contrats qui sont légalement limités à un maximum de cinq ans. Un BOT pour une nouvelle station d’épuration des eaux usées à Tunis a été prévu depuis de nombreuses années, mais a été retardé plusieurs fois à cause de changements de l’emplacement du site et d’un cadre juridique inapproprié, entre autres raisons.
- Page 77 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
Tableau 27 : Résumé du diagnostic de l’assainissement
La situation actuelle
Emplois ONAS : 5.500 emplois
Chiffre d’Affaires Annuel 92 MDT en 2002
Investissements lors du IXème plan (1997-2001)
397 MDT envisagés et réalisés
Participation du secteur privé (en %) Montant
0% privé 0
Situation Financière Résultat net négatif en 2002 (-8,3 MDT)
Subventions annuelles Oui (investissements et recettes compensatoires)
L’efficacité
Desserte Bonne desserte : - Taux de branchement dans les zones prises en
charge par l’ONAS : 83% - Taux de collecte : 80% - Taux d’épuration : 96,5%
Continuité, Qualité du Service Bonne
Niveau des tarifs Tarif moyen : 0,394 DT/m3 (2002)
Problèmes majeurs - Incertitude sur les ajustements tarifaires - Faible productivité du personnel
Les enjeux
Objectifs qualitatifs du Xème plan
Besoins d’investissement lors du Xème plan (2002-2006)
525 MDT
Principaux investissements programmés Non disponibles
Participation attendue du secteur privé dans l’investissement
0%
Capacité du secteur privé local à participer aux ouvertures possibles
Modérée
Les réalisations en matière de PPI
Expérience PPI déjà réalisée 3 contrats de service pour des réseaux d’assainissement
Actions en cours Evaluation de l’expérience de contrats de service
Obstacles - Durée trop courte des contrats - Absence de base juridique pour des
concessions/BOT
215. La stratégie en matière de PPI s’est limitée jusqu'à maintenant à rechercher des investissements sous forme de BOT dans le domaine des stations de traitement des eaux usées de Tunis et de la sous-traitance des activités d’entretien des réseaux d’égouts. L’ONAS est en train de mettre en place un programme de gestion déléguée de l’exploitation de stations d’épuration. Cependant, sans une vision globale, la participation du secteur privé risque d’alourdir plus les charges d’exploitation de l’ONAS si elle n’est pas accompagnée d’un redéploiement des ressources humaines.
- Page 78 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Eléments de stratégie pour l’eau et l’assainissement
216. Dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement il n’y a à ce jour pas une stratégie sectorielle claire pour la participation du secteur privé. Les deux sous-secteurs sont administrés par deux entreprises publiques nationales qui, jusqu’en septembre 2002, étaient sous la tutelle de deux Ministères différents. Ces deux Ministères ont depuis été fusionnés. Ceci présente une occasion pour entamer une réflexion conjointe entre les deux sous-secteurs en vue de répondre et d’adapter le modèle tunisien aux défis futurs. Cette réflexion pourrait également aboutir à une stratégie commune pour la participation du secteur privé en vue d’exploiter tous les créneaux possibles pour améliorer l’efficacité des entreprises publiques.
217. Devant les pressions que subit le secteur décrit ci-dessus, il serait prudent d’engager dès maintenant un débat sur la performance du secteur de l’eau potable et de l’assainissement et sur les besoins de réformes à entreprendre pour répondre et adapter le modèle tunisien aux défis futurs. Parmi les pistes de réflexion, il y aurait l’identification des actions de renforcement de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques sectorielles et de renforcement institutionnel, tant au niveau de la tutelle qu’au niveau de la SONEDE et de l’ONAS, sans oublier le rôle du secteur privé. Ceci dans un cadre global qui tiendrait compte des contraintes budgétaires et macroéconomiques, ainsi que des orientations stratégiques du Gouvernement dans d’autres secteurs, notamment dans les secteurs de l’environnement et la gestion des ressources en eau. La réflexion stratégique pourrait inclure :
- L’élaboration d’un bilan et l’étude d’options de réforme de la structure actuelle du secteur (système monopolistique avec un opérateur national pour l’eau et un autre pour l’assainissement) sur la base des succès du passé afin d’éliminer les contraintes de développement futur avec des objectifs qui pourraient être les suivants :
i. Renforcer la séparation des fonctions d’élaboration de politiques sectorielles et de celles de prestation de services;
ii. Améliorer la capacité d’autofinancement et la mobilisation de sources de financement;
iii. Accroître l’efficacité des opérateurs; - L’articulation d’une politique tarifaire et des subventions publiques du secteur
cohérentes avec les contraintes budgétaires et les objectifs de desserte et de niveau de service des Plans de développement quinquennaux;
- La rationalisation du processus d’approbation des ajustements tarifaires (par l’indexation des tarifs par exemple);
- L’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire pour faciliter la participation du secteur privé afin de promouvoir des gains de productivité dans le secteur de l’eau.
218. L’évolution des deux sous-secteurs de l’eau et de l’assainissement exige une étape de contrôle plus précis des coûts, notamment en matière de coûts d’achats et de personnel. Un des moyens d’aboutir à ce contrôle des coûts est de mettre en place une concurrence entre les différentes entités. En général, les possibilités de concurrence dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement sont limitées, puisqu’il s’agit d’un monopole naturel.43 Une des possibilités consisterait à mettre en place une évaluation comparative et d’augmenter la pression en vue d’une meilleure performance (concurrence par comparaison). Une réflexion pourrait donc être engagée sur la structure des entreprises au plan fonctionnel et géographique, en tenant
43 Cela n’empêche pas la concurrence pour le marché sous forme d’appels d’offres, mais une concurrence dans le marché tel que, par exemple, dans le secteur de télécommunications n’est pas possible.
- Page 79 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
compte des caractéristiques du pays, notamment de l’importance des fonctions de captation - adduction. Il faudrait évaluer les éventuels gains d’efficacité de la séparation des activités de captation, adduction et traitement de celles de distribution (pour la SONEDE), et ceux de la séparation des activités d’épuration de celles de collecte des eaux usées (pour l’ONAS), comme il faudrait évaluer également les éventuels gains d’efficacité de la création d’entités régionales de distribution d’eau potable, et d’entretien et d’exploitation des réseaux d’assainissement. L’établissement de filiales ou d’entreprises régionales permettrait de comparer la performance des uns et des autres. La décentralisation au niveau des régions aurait en outre l’avantage de rapprocher les centres de décision des usagers, et de préparer une étape ultérieure de gestion déléguée plus importante. La tendance à l’échelle internationale est vers l’intégration des services d’eau potable et de l’assainissement dans une même entreprise qui, dans la plupart des pays, est établie à l’échelle municipale ou régionale. De plus, un effort plus soutenu pour sous-traiter certains services au secteur privé accroîtrait l’efficacité du secteur. La réflexion sur la régionalisation en Tunisie devrait être réalisée conjointement entre la SONEDE, l’ONAS et la tutelle en tenant compte de la spécificité tunisienne. En cas de faisabilité, la consécration de cette réflexion sur le terrain se ferait par la mise en commun de moyens, voire la possibilité à terme d’une expérience de participation du secteur privé sous forme d’affermage pour une des régions.
Tableau 28 : Proposition de plan d’action pour l’eau potable et l’assainissement
Court Terme Moyen et Long Terme
Politique et régulation
- Elaboration d’un bilan et d’un plan de réformes de la structure actuelle du secteur (système monopolistique avec un opérateur national pour l’eau et un autre pour l’assainissement) sur la base des succès du passé afin d’éliminer les contraintes de développement futur
- Articulation d’une politique tarifaire et de subventions publiques aux services d’eau et d’assainissement cohérentes avec les contraintes budgétaires et les objectifs de desserte et de niveau de service
- Rationalisation du processus d’approbation des ajustements tarifaires (éventuellement formule d’indexation de tarifs en tenant compte d’un facteur d’amélioration de la productivité)
- Elaboration d’un cadre juridique et réglementaire sectoriel pour faciliter la participation du secteur privé et la mise en œuvre de reformes de la structure du secteur de l’eau et de l’assainissement
- Création des groupes de suivi et de travail pour la formulation et la mise en œuvre des réformes
- Approbation du cadre législatif pour faciliter la participation du secteur privé et la mise en œuvre de reformes de la structure du secteur de l’eau et de l’assainissement
- Mise en œuvre des réformes - Introduction d’une base de données
pour une comparaison des indicateurs de performance entre régions et publication des données
SONEDE Considérer la création de filiales régionales de distribution, en réflexion commune avec l’ONAS
Suivant le résultat du Plan des Réformes (Action à Court Terme), considérer éventuellement l’ouverture de filiales de distribution aux concessionnaires privés
- Page 80 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Court Terme Moyen et Long Terme
ONAS - Considérer la création de filiales régionales de distribution, en réflexion commune avec la SONEDE
- Rationalisation de la structure organisationnelle, éventuellement avec assistance d’experts ou de bureaux d’études spécialisés, pour renverser la tendance actuelle d’augmentation croissante des frais du personnel et de matériel, et pour répondre aux besoins de redéploiement des ressources humaines au fur et à mesure de la mise en place de son plan de promotion de la participation du secteur privé
Suivant le résultat du Plan des Réformes (Action à Court Terme), considérer éventuellement l’ouverture de filiales de distribution aux concessionnaires privés
PPI possible Décision sur l’opportunité et les modalités de la gestion déléguée pour la station de dessalement de Djerba
- Suivant le résultat du Plan des Réformes (Action à Court Terme), considérer éventuellement des concessions/affermages régionaux intégrant l’eau et l’assainissement
- Possibilité d’accorder des fonctions de régulation à une structure de régulation sectorielle ou multi-sectorielle.
- Au cas ou la possibilité des concessions/affermages régionaux serait écartée, ou au cas où elles seraint limitées géographiquement, approfondir la sous-traitance (délégation) de gestion du réseau d’assainissement et des stations d’épuration par l’utilisation de contrats de plus longue durée et de cahiers de charges basés sur l’obligation de résultats au lieu de l’obligation de moyens.
- Dans le même cas, introduire la sous-traitance (délégation) selon les mêmes principes pour l’eau potable
Autres Accélérer le processus de prise des textes d’application relatifs aux conditions obligatoires des concessions et des ressources hydrauliques non-conventionnelles
Les déchets solides
219. Le secteur de la gestion des déchets solides comporte trois sous-secteurs : le ramassage, le transfert et l’évacuation des déchets solides. Le ramassage des déchets solides en Tunisie est sous la responsabilité des communes. Leur transfert et leur évacuation sont en principe également du ressort des communes, mais en 1996, le Gouvernement a donné à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) la responsabilité d’élaborer une stratégie de gestion intégrée des déchets solides. A la suite de quoi, l’ANPE a pris un rôle de chef de file dans la planification et l’exécution du transfert et de l’évacuation des déchets solides.
- Page 81 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
220. Il n’y a que des données très limitées et pratiquement pas de systèmes de suivi pour mesurer la performance, les coûts et l’emploi liés à la gestion des déchets solides en Tunisie. Alors que la qualité du ramassage des déchets solides semble être appropriée, leur évacuation continue à faire face à des problèmes techniques et financiers. Dans de nombreuses localités, il n’y a pas de décharges adéquates, ce qui pose entre autres un danger de contamination des nappes. La Tunisie vient de construire et de mettre en service la première décharge moderne du Maghreb près de Tunis. Malheureusement ce projet, dans sa phase initiale de fonctionnement, rencontre des problèmes techniques persistants.
221. Les investissements dans la gestion des déchets solides devraient augmenter considérablement, pour passer de 29 millions de DT pendant le IXème Plan à 96 millions de DT (+231 %) pendant le Xème Plan, le gros des investissements étant consacré au transfert et à l’évacuation. Etant donné qu’il n’y a pas de redevance des usagers pour le ramassage des déchets solides en Tunisie, le recouvrement des coûts constitue un enjeu considérable. Les municipalités couvrent les coûts de la gestion des déchets solides par les impôts. Elles paient généralement pour le ramassage des déchets solides, mais elles ne sont pas en mesure de payer pour leur transfert et leur évacuation, de sorte que les factures émises par l’ANPE aux municipalités pour ces services demeurent largement impayées. Le nouveau code fiscal municipal permet aux municipalités d’imposer aux usagers des charges pour les déchets non domestiques, toutefois, il est douteux que cette mesure à elle seule donnera au secteur une base financière solide. Sans solution financière définie, les efforts institutionnels restent en général infructueux (voir ci-dessus).
222. Le secteur privé participe à la fois au ramassage et à l’évacuation des déchets solides en Tunisie. Pour ce qui est du ramassage, la sous-traitance a été initiée en 1997 et actuellement 36 municipalités ont recours à des services privés de ramassage, assurés essentiellement par des entreprises tunisiennes. L’expérience a été inégale et des municipalités sont revenues à la fourniture du service public, dans certains cas, après qu’elles n’ont pas été en mesure de satisfaire leurs obligations de paiement aux compagnies privées ou après une performance décevante des opérateurs privés. En ce qui concerne le transfert et l’évacuation des déchets solides, un contrat de gestion a été conclu pour Tunis et d’autres sont prévus à l’avenir. Toutefois, le rôle du secteur privé s’est limité à la gestion des opérations sans que ne soit exploité son potentiel de planification et de gestion intégrée. Le secteur privé devrait de préférence être engagé dans des contrats à long terme pour la conception, la construction et l’exploitation de systèmes intégrés de gestion des déchets solides. Ceci n’est pas faisable dans le cadre juridique en place qui limite la durée des contrats du secteur privé à cinq ans. Le rôle du secteur privé dans le financement d’investissements dans des installations pour déchets solides restera probablement limité au vu des engagements importants des bailleurs de fonds dans ce secteur. Toutefois, l’introduction d’un système de recouvrement des coûts qui couvrirait l’intégralité des coûts récurrents du ramassage, du transfert et de l’évacuation appropriée des déchets demeure une priorité urgente pour la Tunisie.
- Page 82 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Tableau 29 : Résumé du diagnostic de la gestion des déchets solides
La situation actuelle Emplois ND Chiffre d’Affaires Annuel ND Besoins d’investissement du IXème plan (1997-2001)
29 MDT
Subventions annuelles - Collecte Transport : Oui - Traitement : Oui (impayés des municipalités)
L’efficacité Desserte - Satisfaisante pour la collecte
- Très insuffisante pour le traitement Niveau des tarifs Système de recouvrement des coûts inexistant Problèmes majeurs Collecte Transport Traitement
Contamination des nappes, excédents de lixiviats
Les enjeux Objectifs qualitatifs du Xème plan Besoins d’investissement du Xème plan (2002-2006)
96 MDT
Principaux investissements programmés 42,4 MDT décharges, centres de tri et de transfert (financement UE à 100%); décharge de déchets dangereux (Djeradou) : 2,85 MDT dont 1,35 avant le Xème plan
Participation attendue du secteur privé dans l’investissement
Rien pour le moment pour le transfert et l’élimination des déchets
Capacité du secteur privé local à participer aux ouvertures possibles
Collecte Transport : Modérée à Forte Traitement : Modérée
Les réalisations en matière de PPI Expérience PPI déjà réalisée Collecte transport : Sur 51 contrats conclus au
départ, 29 sont opérationnels aujourd’hui - Décharge du Grand Tunis (uniquement pour la
gestion) - Tri et valorisation des emballages
Actions en cours Etude sur la décharge du Grand Tunis (METAP) Obstacles Collecte Transport - Pas de redevance
- Contrats limités à 5 ans - Limitation géographique des contrats entraînant
une rentabilité incertaine Obstacles Traitement - Contrats limités à 5 ans
- Multitude de contrats (conception, construction, surveillance, gestion) pour une même décharge et conflits qui en résultent
- ANPE cumule des fonctions commerciales et de régulation
- Page 83 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
223. Dans le secteur de la gestion des déchets solides il y a un besoin urgent d’arrêter et de mettre en œuvre une stratégie sectorielle, y compris une stratégie pour la participation du secteur privé. Le problème principal du secteur est l’absence d’un système adéquat de recouvrement des coûts. Malgré le montant limité à recouvrir – environ 10 MDT par an à l’heure actuelle, équivalent à moins de 1% du chiffre d’affaires des secteurs télécommunications et énergie – ceci semble constituer un problème épineux. Les propositions pour résoudre le problème semblent présenter des difficultés concernant l’impact sur les revenus des ménages ou d’ordre institutionnel et juridique. Les propositions incluent l’introduction d’une redevance municipale facturée séparément sur base bimestrielle au lieu du rythme annuel de la fiscalité locale; l’introduction d’une surcharge sur la facturation d’autres services tel que l’eau, l’électricité ou le téléphone; où une réforme de la fiscalité locale en vue de donner de meilleures incitations pour améliorer le recouvrement et éventuellement d’accorder aux municipalités le droit de modifier les taux de la fiscalité locale sans approbation au niveau central. Quelle que soit la variante choisie, sans l’introduction d’un système de recouvrement des coûts, la pérennité des investissements réalisés et en cours de réalisation dans le secteur est en question et la participation du secteur privé risque d’échouer.
224. Un autre problème fondamental est celui de la responsabilité institutionnelle pour le secteur. La législation en vigueur attribue clairement la responsabilité aux municipalités, mais au vu de leur faiblesse financière ainsi qu’en matière de ressources humaines, l’Etat a été obligé de confier la responsabilité du transfert et de l’élimination des déchets solides à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE). Cet arrangement ne peut être qu’une solution par intérim. A terme, les fonctions commerciales et de régulation, cumulées à l’heure actuelle au sein de l’ANPE, doivent être séparées. Différentes variantes se présentent, parmi lesquelles la création d’une Agence des Déchets Solides et le recours à l’intercommunalité pour aboutir à des économies d’échelle.
225. Un troisième problème est celui du montage contractuel des décharges. Actuellement, quatre contrats sont conclus pour chaque décharge : pour la conception, la réalisation, le contrôle et le fonctionnement. Ce montage contractuel est difficile à gérer pour l’ANPE et mène à des conflits entre les différents intervenants qui souvent ne sont pas facile à résoudre. En outre, vu l’absence d’un cadre juridique sectoriel ou horizontal pour les concessions, des contrats au-delà de cinq ans ne sont pas permis, ce qui n’est pas bien adapté à la nature des services dans le secteur. Des réformes juridiques permettant la réalisation de décharges sous forme de DBX, suivant l’expérience d’autres pays telle que celle de Hong Kong, pourrait aider à résoudre ce problème.
- Page 84 -

Aspects sectoriels de la participation privée dans les infrastructures
Tableau 30 : Proposition de plan d’action pour la gestion des déchets solides
Politique Sectorielle et Régulation
Court Terme Moyen et Long Terme
- Etude sur les options pour l’introduction d’un système de recouvrement des coûts viable (à l’échelle municipale ou par une surcharge sur les factures d’eau/d’électricité)
- Clarification des rôles des municipalités et de l’ANPE - Séparation des activités de régulateur et des activités
commerciales de l’ANPE/du futur régulateur du secteur - Décision sur la régulation du secteur en tenant compte
des résultats de l’étude METAP - Changement de législation augmentant la durée des
contrats (sera couvert par une éventuelle loi sur les concessions)
- Mise en place d’un système de recouvrement des coûts
- Création d’une agence des déchets solides ou transfert des fonctions de régulation à une structure de régulation multi-sectorielle
PPI Possible
Intégration des contrats multiples dans un cadre contractuel unique du type DB(X)
Mise en place de nouvelles décharges en DB(X)
Autres Actions
Renforcement des capacités des municipalités pour l’attribution et le suivi des marchés
Développement d’une base de données permettant de suivre les indicateurs pertinents du secteur (efficacité et impact)
- Page 85 -


LLeeccttuurreess ssuuggggéérrééeess
PARTICIPATION PRIVEE DANS LES INFRASTRUCTURES
• Brook J. Penelope and M. Suzanne Smith (2002). “Délégation de services collectifs“. Banque Mondiale.
• Estache, Antonio, Vivien Foster, and Quentin Wodon (2002). “Accounting for Poverty in Infrastructure Reform - Learning from Latin America’s Experience”. WBI Development Studies. World Bank.
• Gray, Philip and Timothy Irwin (June 2003). “Public Policy for the Private Sector, Exchange Rate Risk”. Note Number 262. World Bank.
• Guislain, Pierre and Michel Kerf (1995). “Concessions: the way to privatise infrastructures sector monopolies”, Viewpoint 59. World Bank.
• Guislain, Pierre (1995). “Les privatisations : un défi stratégique, juridique et institutionnel“. Bruxelles.
• Harris, Clive (2003). “Private Participation in Infrastructure in Developing Countries, Trends, Impacts and Policy Lessons”. World Bank.
• Institut de la Banque mondiale / PPIAF / Consultatores Macro Energia (2002). “Modélisation financière des politiques de régulation. Introduction théorique et pratique“.
• Kerf, Michel and others (1998). “Concessions for Infrastructure – A Guide to Their Design and Award”. Technical Paper No. 399. World Bank.
• Martimort, D et Rochet, J.C. (1999). “Le partage public/privé dans le financement des infrastructures“, Revue Française d’Economie.
• Martinand, C. (1998). “L’expérience française du financement privé des équipements publics“, Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports.
• Perrot, Jean-Yves et Chatelus, Gautier (2001). “Financement des infrastructures et des services collectifs – Le recours au partenariat public-privé“, Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.
• Public Private Infrastructure Advisory Facility / World Bank (2001). “Toolkit – A Guide for Hiring and Managing Advisors or Private Participation in Infrastructure”. (www.ppiaf.org).
• “Rapport sur le développement dans le monde 2004 : mettre les services de base à la portée des pauvres“ (2003). Banque Mondiale.
• Republic of Tunisia / World Bank (2000). “Private Sector Assessment Update. Meeting the Challenge of Globalization”.
• République Tunisienne, Ministère du Plan et du Développement Régional / USAID / COMETE Engineering (1995). “Etude sur la production et le financement des infrastructures et services urbains“.
- Page 87 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
• Smith, R. Graham, Nemat Shafik, Pierre Guislain, James A. Reichert (1997). “Getting Connected, Private Participation in Infrastructure in the Middle East and North Africa”. World Bank.
• Welch, Dick and Olivier Frémond (1998). “The case-by-case Approach to Privatization – Techniques and examples”. Technical Paper No. 403 (1998). World Bank.
TELECOMMUNICATIONS
• République tunisienne / Banque mondiale (2002). “Technologies de l’information et des communications. Contribution à la croissance et à la création d’emplois“.
• Rossotto, Carlo Maria, Khalid Sekkat and Aristomene Varoudakis (2003). “Opening up Telecommunications to Competition and MENA Integration in the World Economy”. Middle East and North Africa, Office of the Chief Economist, Working Paper Series No. 33. World Bank.
• World Bank. Hank Intven McCarthy Tétrault (2000). “Telecommunications Regulation Handbook”.
Transport
• Banque mondiale (1997). “Tunisie. Etude sur la stratégie des transports“. Etudes Economiques de la Banque Mondiale sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
• Muller-Jentsch, Daniel (2002). “Transport Policies for the Euro-Mediterranean Free-Trade Area». An Agenda for Multimodal Transport Reform in the Southern Mediterranean”.
• République Tunisienne, Ministère du Transport, Direction Générale de la Planification et des Etudes, DGPE (2002). “Plan Directeur National des Transports, Privatisation & Financement“. Rapport No. 4, version provisoire.
• République Tunisienne, Ministère du Transport (Juillet 1998). “Etude du Cadre Général des Concessions dans le Secteur des Transports“.
• Silva, Gisele F. (1999). “Private Participation in the Airport Sector – Recent Trends, Public Policy for the Private Sector”, Viewpoint Note No. 202.
• World Bank / PPIAF (without year). Port Reform Toolkit.
• World Bank (1995). “Airport Infrastructure. The Emerging Role of the Private Sector. Recent Experiences on 10 Case Studies”. CES Discussion Paper Series, No. 115.
ELECTRICITE
• Albouy, Yves (1999). “Regulation for Infrastructure Sectors: How to Adapt it to Country Institutions, Proceedings of the Annual Meetings of the African Development Bank”.
• Albouy, Yves and Reda Bousba (1998). “The Impact of IPPs in Developing Countries – Out of the Crisis and into the Future”, Public Policy for the Private Sector, Viewpoint Note No. 162.
• Bacon, Robert. World Bank (1995). “Appropriate Restructuring Strategies for the Power Generation Sector – The Case of Small Systems”.
- Page 88 -

Lectures suggérées
• Banque mondiale / STEG / Ministère de l’Industrie / KEMA Consulting (2003). “Réforme du Secteur de Production de l’Electricité en Tunisie“.
• Besant-Jones, Bernard Tenenbaum (2001). “Les leçons de la crise de l’énergie en Californie“, Finances & Développement, Septembre 2001, p. 24-28.
• Lalor, Peter and Hernán García (1996). World Bank Viewpoint Note No. 85. “Reshaping Power Markets – Lessons from Chile and Argentina”.
• Müller-Jentsch, Daniel (2001). World Bank Technical Paper No. 491. “The Development of Electricity Markets in the Euro Mediterranean Area – Trends and Prospects for Liberalization and Regional Integration”.
• Republic of Tunisia / Ministry of Industry / World Bank / Mitsubishi Research Institute / PA Consulting Group (2001). “Study and Evaluation of the Negotiations for the Privatization of Infrastructure in Tunisia : The Case of Rades II IPP”.
• République Tunisienne / Ministère de l’Industrie / Observatoire National de l’Energie (sans année). “20 ans d’énergie, Revue Tunisienne de l’Energie“.
Eau et Assainissement
• République Tunisienne / MEAT / ONAS (2002). “La Participation du Secteur Privé dans le Domaine de l’Assainissement Liquide en Tunisie“.
• République Tunisienne / MEAT / ONAS / IDEA Tunisie (2001). “Actualisation de la stratégie de participation du secteur privé dans le domaine de l’assainissement liquide“.
• Rivera, Daniel. “Private Sector Participation in the Water Supply and Wastewater Sector, Lessons from Six Developing Countries”.
• World Bank (1997). “Toolkits for Private Participation in Water and Sanitation”.
Déchets Solides
• Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE). “La comptabilité analytique dans les services de propreté des communes, Guide Pédagogique“.
• Banque mondiale / Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) / Ernst Basler+Partner / IDEA (2003). “Gestion des ordures ménagères dans le Grand Tunis“.
• World Bank. Cointreau-Levine, Sandra and Adrian Coad (2000). “Solid Waste Management Toolkit. Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Management“.
GENERAL
• Banque Mondiale (1996). “Tunisie: Intégration mondiale et développement durable, Choix stratégiques pour le 21ème siècle“. Etude Economiques de la Banque Mondiale sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
• Banque Mondiale (1995). “L’Etat Chef d’Entreprise, Aspects Economiques et Politiques de la Propriété Publique, Résumé“.
• République Tunisienne (2002-2006). “Le Dixième Plan de Développement“.
- Page 89 -

Etude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie
- Page 90 -
IMPACT ECONOMIQUE DE LA LIBERALISATION DES SERVICES
• Banque Mondiale (2002). “Global Economic Prospects and the Developing Countries, Making Trade Work for the Worlds’ Poor”, The World Bank, Washington DC
• Institut d’Economie Quantitative (2003). “Simulation d’impact d’une ouverture concurrentielle dans les services Transport et Télécommunications avec prise en compte de la concurrence imparfaite“, Version provisoire, Octobre 2003, Tunis.
• Konan, D. and K.Kim (2003). “From Here to There: Trade Reform in Tunisia and Egypt”, Background paper, April 2003, processed.
• Konan, D. And K. Mascus (2002). “Quantifying the Impact of Services Liberalization in a Developing Country”, Background paper, April 2002, processed.
• Konan, D. and K. Mascus (2000). “Service Liberalization in WTO 2000: A Computable General Equilibrium Model of Tunisia”.
• Lovelock, P. et B. Petrazzini (1996). “Telecommunications in the Region : Comparative Case Studies”, Paper presented at the International Institute for Telecommunications Forum, Sydney, Australia, April 22-23.
• Mattoo, A., R. Rathindran and A. Subramanian (2001). “Measuring Service Trade Liberalization and Its Impact on Economic Growth: An Illustration”, World Bank Policy Research Working Paper No. 2655, World Bank, Washington D.C.
• OECD (2003). “Services Trade Liberalization: Identifying Opportunities and Gains, Policy Brief”, Paris.
• OECD (2002). “Quantifying the Benefits of Liberalizing Trade in Services”, Policy Brief, Paris.
• Rauf Gonenc & Maria Maher & Giuseppe Nicoletti (2000). “The implementation and the effects of regulatory reform: past experience and current issues”, OECD Economics Department Working Papers 251, OECD Economics Department.
• Robinson, S., Z. Wang and W. Martin (1999). “Capturing the Implications of Services Trade Liberalization”, Paper presented at the Second Annual Conference on Global Economic Analysis, GL Avernaes Conference Center, Ebberup, Denmark, June 20-22.
• Varoudakis, A. K.Sekkat et C. Rossotto (2003). “Opening Up Telecommunications to Competition and MENA Integration to the World Economy”. MENA Working Paper Series, No 33, July 2003, The World Bank, Washington DC
Une large gamme de rapports sur la PPI, dont une grande partie est citée ci-dessus, est disponible en langue anglaise sur le site Internet : http://rru.worldbank.org/ppi/