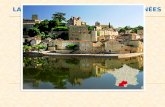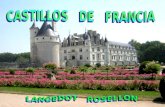DIREN Languedoc Roussillon
Transcript of DIREN Languedoc Roussillon

DIREN Languedoc Roussillon
PRIX ET STRUCTURE DES TARIFICATIONS DE L’EAU DANS LE SECTEUR OUEST HERAULT
RAPPORT FINAL
Novembre 2008
IIRREEEEDDDD
Institut des Ressources Energétiques Et du Développement Durable

2
Auteurs du rapport :
Lætitia Guérin-Schneider (Service Public 2000), Fady Hamade (IREEDD), David-
Nicolas Lamothe (Service Public 2000).
Ce rapport s’appuie également sur les deux premières phases de l’étude
auxquelles a contribué Frédéric Bonnet (Synthéa Recherche)

3
Table des matières
TABLE DES MATIERES 3
LEXIQUE 5
PREAMBULE 7
SYNTHESE DU RAPPORT 8
1 CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’APPROCHE JURIDIQUE 12
GENERALITES............................................................................................. 12 a) Le principe d’égalité et les catégories d’usagers ........................................ 12 b) Le plafonnement de la part fixe .............................................................. 13
EAU POTABLE ............................................................................................. 14 c) L’obligation de facturation de tous les volumes fournis .............................. 14 d) La structure tarifaire des factures d’eau................................................... 14 e) La tarification au forfait de l’eau potable .................................................. 14 f) La tarification de la part fixe en habitat collectif ........................................ 15 g) La tarification incitative selon la vulnérabilité de la ressource en eau ........... 15 h) La tarification saisonnière ...................................................................... 16 i) Les dépôts de garantie .......................................................................... 16
ASSAINISSEMENT ........................................................................................ 16 a) La structure tarifaire des factures d’assainissement collectif ....................... 16 b) La tarification de l’assainissement collectif en cas de multiplicité de sources
d’AEP .................................................................................................. 17 c) La redevance d’assainissement collectif pour les rejets d’eaux usées non
domestiques......................................................................................... 17 2 CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’APPROCHE ECONOMIQUE 18
PREAMBULE ............................................................................................... 18 2.1 LA TARIFICATION : UN INSTRUMENT AU SERVICE D’UN OBJECTIF............................. 18 2.2 UN OBJECTIF QUI EVOLUE : UNE MISE EN PERSPECTIVE A PARTIR DE L’EAU POTABLE ...... 19 2.3 LA SITUATION OBSERVEE DANS LE TERRITOIRE ETUDIE........................................ 22 2.4 LES DIFFERENTS MODES DE TARIFICATION ...................................................... 24
1) La tarification forfaitaire........................................................................... 24 2) La tarification uniforme ............................................................................ 24 3) La tarification binôme .............................................................................. 25 4 ) La tarification par paliers croissants.......................................................... 26 5) La tarification saisonnière......................................................................... 27 6) La tarification par paliers dégressifs........................................................... 28
3 LES CINQ SCENARIOS D’EVOLUTION DES OUTILS TARIFAIRES EN PLACE 29
3.1. CHOIX DES SCENARIOS D’EVOLUTION ......................................................... 29 3.2. QUEL ORDRE DE GRANDEUR DE COUT SUPPLEMENTAIRE PRENDRE EN COMPTE DANS LES
SCENARIOS........................................................................................ 31 1) Financement du programme de mesure de la directive cadre sur l’eau (DCE).. 31 2) Renforcement des infrastructures, non liées à la DCE .................................. 33

4
3) Meilleure couverture des coûts.................................................................. 34 4) Synthèse pour le calage des scénarios ....................................................... 34
3.3. FORMAT DE PRESENTATION DES SCENARIOS................................................. 35 3.4. RECOMMANDATIONS COMMUNES A TOUS LES SCENARIOS.................................. 36 3.5. SYNTHESE DES SCENARIOS .................................................................... 37 3.6. FICHES DE SCENARIO............................................................................ 42
3 CONCLUSION 71
ANNEXE I. PRINCIPAUX TEXTES SUR LA TARIFICATION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 73
ANNEXE II. CONSTRUCTION DES TRANCHES DE REVENUS DE REFERENCE
POUR DES ABONNES DOMESTIQUES 80
ANNEXE III. RECUPERATION DES COUTS DANS LE SECTEUR DE L’EAU
POTABLE 86
ANNEXE IV. PRESENTATION DES COMPOSANTES D’UNE FACTURE D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT 88
ANNEXE V. QUESTIONNAIRE 89
ANNEXE VI. EXTRACTION DE LA BASE DE DONNEES ISSUES DE L’ENQUETE 97

5
LEXIQUE
Les définitions ci-dessous sont, pour la plupart, inspirées du glossaire fourni par la circulaire n°12/DE du 28/04/2008 « Mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 »
Abonné
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation), etc.
Collectivité compétente
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte…) ayant la responsabilité de l’organisation du service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.
Coût
Le coût de l’eau correspond au total des charges supportées pour assurer l’exécution du service. Cela intègre donc les charges courantes d’exploitation (salaires, réactifs, etc.) mais aussi le poids des investissements et des amortissements, qui servent à anticiper sur le financement futur du renouvellement des ouvrages.
Mode de gestion
Le mode de gestion désigne les modalités d’organisation choisies par la collectivité compétente pour la réalisation des missions du service d’eau ou d’assainissement. Il existe trois catégorie de mode de gestion : la gestion en régie (la collectivité réalise les missions par ses moyens propres), les modes de gestion intermédiaires (la collectivité fait appel à un opérateur privée pour certaines tâches relevant de sa régie), la gestion déléguée (l’exploitation du service, voire la réalisation des investissements, est confiée à un opérateur externe, via un contrat de délégation, mais la collectivité reste responsable de l’organisation et du contrôle du service). NB : l’intercommunalité n’est pas un mode de gestion. Il s’agit d’une modalité d’organisation de l’exercice d’une compétence. L’existence d’un EPCI ou d’un syndicat auquel des communes ont transféré leur compétence ne préjuge en rien du mode de gestion : comme à l’échelle communale, il peut s’agir d’une régie ou d’une délégation.
Opérateur (ou exploitant ou gestionnaire ou service gestionnaire)
Service ou organisme dépendant de la collectivité compétente (cas de la gestion internalisée, en régie) ou autre organisme (cas de la gestion externalisée, en délégation ou prestation de service) désigné par l’autorité organisatrice, pour assurer tout ou partie des tâches d’exploitation du service public de l’eau ou de l’assainissement1. NB : En cas de gestion privée, le contrat liant la collectivité à l’operateur est généralement une délégation et l’opérateur est alors appelé délégataire.
Part fixe
Partie de la facture non proportionnelle à la consommation, calculée en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. En habitat collectif, il est possible de facturer autant de part fixe que de logements, tout en ne maintenant qu’un abonnement général pour l’immeuble (pas d’individualisation). Désormais, le montant de la part fixe est plafonné à 40% du montant d’une facture de 120 m3 (30% en 2012).

6
Prix
Le prix de l’eau correspond au montant facturé à l’abonné. Théoriquement, il devrait être très proche du coût, mais en pratique on observe souvent un décalage, par exemple en raison d’une mauvaise évaluation des amortissements ou de la prise en charge d’autres coûts (ex: gestion des eaux pluviales dans le prix de l’assainissement). Le plus souvent, le prix est affiché en €/m3 pour une facture de 120 m3, y compris la part fixe. NB : l’expression « prix de l'eau » est souvent utilisée pour désigner le prix moyen / m3 (part fixe + part proportionnelle) payé par un abonné consommant 120 m3/an. Il est donc différent du tarif/m3 affiché par le service qui ne correspond qu’à la part proportionnelle.
Recette du service
Elle correspond à la totalité des sommes recouvrées par le service. Cela dépasse souvent largement les recettes provenant des abonnés : il faut y également intégrer les recettes des ventes en gros, des travaux attribués à titre exclusif et des participations diverses.
Recouvrement des coûts
Notion promue par la directive-cadre sur l’eau qui désigne l’objectif de couverture par le prix de l’ensemble des coûts induits par la fourniture du service, c’est-à-dire les coûts d’exploitation, les coûts financiers et si possible également les coûts environnementaux (atteinte aux milieux causées par les prélèvements ou les rejets).
Service d’eau
On entend par « service » le périmètre confié par la collectivité compétente à un opérateur unique (une régie ou un opérateur privé). Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la production, le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport, la dépollution et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la gestion des abonnés.
La notion de « service » n’est pas directement superposable avec celle de « commune » (plusieurs communes pouvant être dans le même service en cas d’intercommunalité), ni à celle d’EPCI (plusieurs services pouvant coexister sur le territoire d’un EPCI, par juxtaposition des services des communes membres).
Zone de répartition des eaux (ZRE)
Une ZRE se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription en ZRE permet d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Préalablement à la délivrance de nouvelles autorisations, il est mené une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. Par ailleurs, l’inscription en ZRE est désormais également susceptible d’imposer des modifications de grille tarifaire pour les services d’eau.

7
PREAMBULE
La directive-cadre sur l’eau (DCE) implique la mise en œuvre de mesures diverses pour
atteindre en 2015 le bon état écologique des eaux.
Ces mesures doivent être financées par les usages de l’eau (agriculture, eau potable et
industrie), en application du principe de couverture des coûts.
Cette directive a été transposée dans la loi du 21 avril 2004 ainsi que dans la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006. Cette dernière va au-delà des
principes généraux de la directive et fixe un certain nombre de règles sur la tarification
des services d’eau et d’assainissement.
Dans ce contexte, la DIREN Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’eau RM & C et les
collectivités locales ont lancé deux études pilotes pour évaluer l’impact de la mise en
œuvre de la DCE sur le terrain. La zone Ouest-Hérault a été retenue.
La première étude, réalisée par le BRGM, avec le soutien technique et financier de
l’Agence de l’eau, du Conseil Général de l’Hérault et de la Région LR, et un appui
technique du Cemagref, de BRLi et de l’Université de Montpellier III, définit un panel de
mesures possibles pour atteindre le bon état quantitatif, et estime un ordre de grandeur
du coût à répercuter sur les différents usages.
La seconde et présente étude a été confiée à Service Public 2000, à Synthéa Recherche
et à l’IREEDD. Elle vise à préciser quelles pourraient être les évolutions tarifaires des
services d’eau et d’assainissement induites par la mise en œuvre de la DCE. Elle se
décompose en trois parties :
� collecte des informations pour un état des lieux sur les pratiques tarifaires, le
contexte des services et les objectifs de la politique tarifaire déclaré par les
communes en 2006 ;
� analyse plus approfondie pour caractériser les politiques tarifaires et leur
cohérence vis-à-vis des principes de protection de la ressource et de couverture
des coûts ;
� dans une approche prospective tenant compte des contraintes réglementaires,
proposition de scénarios d’évolution, partant des situations-types rencontrées les
plus intéressantes et présentant l’adaptation des outils tarifaires avec l’impact sur
les abonnés.
Les deux premières phases ont fait l’objet de rapports spécifiques.
Le présent rapport présente la troisième phase et intègre également des éléments issus
des rapports précédents afin de resituer les propositions de scénarios dans le contexte
local.

8
SYNTHESE DU RAPPORT
Le cadre réglementaire récent avec en particulier la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA) de décembre 2006 fait évoluer le contexte dans lequel les tarifs des services
publics d’eau et d’assainissement vont devoir être fixés par les collectivités locales
compétentes.
La première influence va se faire sentir au niveau des coûts à répercuter sur ces
services. Bien qu’il soit encore prématuré pour avancer des chiffres précis, on peut
anticiper que les mesures à prendre pour atteindre le bon état écologique induiront des
augmentations dans de nombreux services (par exemple pour prendre des mesures de
protection ou d’économie de la ressource, de renforcement des niveaux de traitement,
etc. ou tout simplement pour mieux respecter le principe de couverture des coûts).
L’objet de ce rapport n’est pas d’estimer l’impact économique de la LEMA et les
chiffres mentionnés en termes d’augmentation possible des coûts sont
purement indicatifs : ils servent à illustrer des cas « plausibles » et n’ont aucune visée
de représentativité ou de prévision précise.
La seconde influence peut être considérée comme plus technique, mais elle n’en a pas
moins un impact très concret sur le terrain : les pratiques tarifaires sont désormais
beaucoup plus encadrées afin de mettre en place des tarifications
« incitatives » (ce sont les termes de la LEMA), c'est-à-dire qui incitent l’abonné du
service d’eau ou d’assainissement à préserver l’environnement (en consommant moins
d’eau, en limitant la consommation au cours de la période pendant laquelle la ressource
est limitée etc.).
Notamment, les mesures suivantes sont à mettre en œuvre :
� la fourniture d’eau gratuite est interdite (sauf défense incendie) et les factures
d’eau comprennent obligatoirement un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé (partie proportionnelle) ;
� à terme (mise en œuvre progressive, finalisée au plus tard 1er janvier 2012), la
part fixe (abonnement) de la facture pour 120 m³ ne pourra excéder 30% sauf
dans les communes rurales où le seuil est ramené à 40% et dans les communes
touristiques (pas de seuil) ;
� là où la ressource est fragile, les collectivités devront mettre en place une
tarification incitative (concrètement : augmentation de la part proportionnelle, ou
tarification progressive, ou tarification saisonnière). Dans les collectivités dont les
ressources proviennent à plus de 30 % d’une zone de répartition des eaux (ZRE),
la tarification incitative est même obligatoire (ce qui interdit de fait la tarification
dégressive).
De nombreuses communes de la zone Ouest Hérault vont donc devoir remettre
à plat leurs tarifs pour intégrer ces nouvelles orientations. C’est l’occasion de
s’interroger sur les outils tarifaires, leur adéquation avec les objectifs poursuivis et avec
la réglementation.

9
Le tarif peut répondre à de nombreuses préoccupations :
� couverture des coûts (objectif économique) ;
� incitation à la préservation du milieu (objectif environnemental) ;
� accès de l’eau à des conditions économiques acceptables, y compris pour les
abonnés à revenu modeste (objectif social) ;
� favoriser le développement local, par un accès à l’eau à coût raisonnable pour les
gros consommateurs tel que hôtels, entreprises, golfs… (objectif industriel).
Une structure tarifaire se définit par les éléments principaux suivant :
� présence ou non et montant de la partie fixe, payée quel que soit le volume
consommé (« abonnement ») ;
� montant de la partie proportionnelle et existence ou non de tranches de
consommation (croissantes ou décroissantes), ce qui induit une facturation en
fonction du volume vendu ;
� existence ou non de modulation du tarif au cours de l’année (saison de pointe et
saison hors pointe).
Ce rapport illustre 5 évolutions tarifaires choisies après une analyse des
pratiques tarifaires actuelles dans la zone Ouest Hérault et suggère des
évolutions intéressantes qui répondent aux nouvelles préconisations.
Les tableaux qui suivent en donnent les principales caractéristiques. Le corps du rapport
revient beaucoup plus en détail sur chaque scénario en indiquant en particulier l’impact
sur certains profils d’abonnés contrastés (abonnés domestiques avec un niveau de
consommation normal ou élevé et des revenus contrastés, gros consommateurs…). Pour
faciliter la compréhension, ces scénarios sont construits avec des données fictives.

10
Description du nouvel outil
tarifaire (et de la situation de départ)
Objectif recherché Effet pervers éventuel
1
Augmentation du prix, sur un tarif binôme simple :
Le tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle (au volume consommé).
L’augmentation porte sur la partie proportionnelle.
. Inciter aux économies d’eau en augmentant la facture proportionnellement à la consommation d’eau (objectif environnemental)
. Dégager des recettes supplémentaires (objectif économique)
Les factures augmentent pour tous les abonnés et peuvent finir par représenter un budget non négligeable pour les ménages à revenu modeste (en dépassant le seuil des 4% du revenu du ménage).
2
Augmentation du prix et passage d’un tarif binôme simple à un tarif progressif :
Le nouveau tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures coutent plus cher).
L’augmentation porte sur les tranches supérieures
. Inciter fortement aux économies d’eau en augmentant la facture d’autant plus fortement que l’on est dans des tranches de consommation élevée (objectif environnemental)
. Dégager des recettes supplémentaires (objectif économique) (mais voir effet pervers par rapport à l’élasticité des gros consommateurs).
. Selon la limite des tranches, les catégories d’abonnés touchés par la hausse varient
. La mise en place d’une tranche « sociale » (1ère tranche peu chère) et l’augmentation importante des autres tranches peut manquer son objectif pour les familles nombreuses ou pour l’habitat social collectif.
. Des tranches élevées pour les grosses consommations peuvent engendrer une baisse des consommations industrielles et infléchir les recettes du service.
3
Baisse de la partie fixe :
L’abonnement est baissé pour passer en-dessous du seuil de 40 (ou 30)% à partir d’un tarif binôme simple.
Pour maintenir le niveau de recette, la partie proportionnelle est augmentée
. Respecter les nouvelles obligations de la LEMA (exception possible dans les communes touristiques)
. Inciter aux économies d’eau (objectif environnemental)
Plus de difficulté à couvrir les charges fixes du service si la consommation est moins importante que prévue (équilibre financier moins garanti)
4
Passage d’une tarification dégressive à une tarification progressive :
Le nouveau tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures coutent plus cher).
. Respecter les préconisations de la LEMA dans les zones de répartition des eaux
. Inciter fortement aux économies d’eau les gros consommateurs qui sont le plus touchés par le changement de tarif (objectif environnemental)
. Si le tarif des premières tranches est peu / pas baissé, de nouvelles recettes sont générées sur les gros consommateurs (objectif économique)
Des augmentations élevées pour les tranches des gros consommateurs peuvent engendrer une baisse substantielle des consommations industrielles et à terme infléchir les recettes du service.
5
Mise en place d’une tarification saisonnière à partir d’une tarification binôme simple :
La part du tarif proportionnelle au volume consommé augmente en période de pointe : un m³ consommé en été coute plus cher qu’en hiver
1) Avec une partie fixe classique (pression quantitative estivale, non liée à un pic de population, objectif d’économie d’eau) : inciter aux économies d’eau en période estivale (objectif environnemental)
2) Avec une partie fixe forte (habitat saisonnier, objectif de couverture des coûts fixes) :
. équilibrer les charges fixes importantes (surdimensionnement pour la période de pointe) et faire contribuer équitablement les abonnés saisonniers (objectif économique)
. inciter aux économies d’eau (objectif environnemental)
Coût de la double relève (ou de la mise en place de la télérelève)

11
Un certain nombre de principes généraux sont à retenir :
� le choix de la structure tarifaire doit être raisonné et choisi en fonction des
objectifs poursuivis (équilibre financier, incitation aux économies d’eau…) et dans
le respect des nouvelles obligations ;
� beaucoup de collectivité ont mis en place des tarifications dont les différentes
composantes (part collectivité eau, part délégataire eau, part collectivité
assainissement et part délégataire assainissement) ont des structures tarifaires
différentes (par exemple des tranches pour l’eau, mais pas pour l’assainissement,
ou des tranches différentes pour la part collectivité et la part délégataire). Le rôle
incitatif de la tarification est alors brouillé pour l’abonné qui ne reçoit qu’une
facture unique résultant de toutes ces composantes ;
� la révision de la structure tarifaire est une mesure qui peut avoir un impact
important sur la recette à travers deux effets :
o d’une part, à consommation constante, le nouveau tarif peut modifier
considérablement la recette générée, suivant le profil spécifique de
consommation de chaque abonné ;
o d’autre part, les abonnés dont la facture augmente peuvent à terme limiter
leur consommation, même s’il est habituellement reconnu que l’élasticité
est peu importante pour un bien de première nécessité comme l’eau, cet
effet peut ne pas être négligeable au niveau du service, en particulier du
fait des gros consommateurs souvent plus sensible au prix.
En conclusion, la fixation d’un nouveau tarif se prépare donc bien en amont, en
tenant compte des besoins et des projets du service à moyen terme, du mode
de financement envisagé, des évolutions d’assiettes.
Avec la LEMA, de nombreuses collectivités vont devoir délibérer pour fixer le tarif relatif à
la part collectivité et parfois négocier des avenants tarifaires avec leur exploitant privé.
C’est donc l’opportunité de faire toute cette analyse pour fixer un tarif plus
adapté et pour en faire un instrument, parmi d’autres, de la politique territoriale
et environnementale locale.

12
1 CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’APPROCHE JURIDIQUE
Cette partie présente de manière synthétique les principes issus de la
réglementation en vigueur qui conditionnent les pratiques tarifaires de l’eau et
de l’assainissement. Le lecteur trouvera en Annexe I les références au code général
des collectivités territoriales.
GGGEEENNNEEERRRAAALLLIIITTTEEESSS
aaa))) LLLEEE PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEE DDD ’’’EEEGGGAAALLLIIITTTEEE EEETTT LLLEEESSS CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEESSS DDD’’’UUUSSSAAAGGGEEERRRSSS
Le principe Les usagers du service doivent être traités de façon identique.
Hormis lorsqu’elle est prévue par une loi, la fixation de tarifs différents
pour un même service rendu n’est possible que dans 2 cas :
• lorsqu’il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage ;
• lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 I CGCT
CE n°88032, 10/05/1974 Denoyez et Chorques
Observations
complémentaires
Note : l’interprétation du principe d’égalité des usagers et
l’appréciation des critères permettant de justifier une différence de
traitement relèvent des tribunaux.
En pratique, on peut relever les principes suivants.
a) Pour ce qui concerne la « nécessité d’intérêt général en
rapport avec les conditions d'exploitation »
Cette circonstance peut conduire à pratiquer un « zonage tarifaire »
fondé sur des critères objectifs, appliquer des tarifs différents, par
exemple lorsque des abonnés d’un même service dépendent de
deux secteurs distincts et qu’il existe dans l’un d’entre eux des
contraintes d’exploitation particulières (ex : station de sports
d’hiver en altitude, distincte de la partie principale de la commune).
Le tarif spécifique pour ce secteur doit alors être appliqué à tous les
abonnés y résidant.
b) Pour ce qui concerne les « différences de situation
appréciables »
Le tarif spécifique lié à l’appartenance à une catégorie donnée
d’abonnés doit s’appliquer à tous ceux qui remplissent les critères,
d’ordre technique (volume consommé, qualité de l’eau fournie,
etc.). Ils doivent donc être définis en termes généraux : il n’est pas
possible de viser un abonné en particulier (ex : la commune,
l’hôpital, etc.) ou un groupe d’abonnés (ex : « les agriculteurs »,
« les campings », etc.) car tous au sein du groupe ne sont pas dans

13
la même situation vis-à-vis du service.
Préalablement à l’adoption d’un tarif particulier, la question suivante
doit être posée : les usagers qui en bénéficieront sont-ils dans une
situation particulière vis-à-vis du service ?
Exemples :
• les « gros consommateurs » : le fait de consommer plus d’un
certain volume annuel est susceptible de placer les abonnés dans
une situation particulière vis-à-vis du service ; ce critère est donc
admis pour l’application d’un tarif spécifique
• les communes ou les « services publics » : leur statut ne les place
pas dans une catégorie spécifique et ne peuvent à ce titre
bénéficier d’un tarif spécifique. Ils peuvent en revanche bénéficier
des tarifs spéciaux applicables aux autres abonnés s’ils
remplissent les conditions fixées (ex : consommations supérieures
à un seuil)
• personnes à faibles ressources, locataires, résidents temporaires,
etc. : cette « particularité » n’interfère pas sur la relation avec le
service. Un tarif spécial ne peut donc être fondé sur ce critère
bbb))) LLLEEE PPPLLLAAAFFFOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT DDDEEE LLLAAA PPPAAARRRTTT FFFIIIXXXEEE
Principe A partir du 1/01/2008, la part fixe ne peut représenter plus de 40%
de la facture-type de 120 m³, tant pour l’eau que pour
l’assainissement.
A partir du 1/01/2010, le plafond sera abaissé à 30%
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 I al.2 CGCT
Observations
complémentaires
Deux exceptions sont prévues :
• le plafond applicable dans les communes rurales (au sens du
CGCT) est supérieur de 10% (donc 50 puis 40%) ;
• les communes touristiques (au sens du Code du tourisme) sont
totalement exonérées de l’application d’un plafond
Le plafond de 40% devra être respecté au plus tard en septembre
2009 ; celui de 30% au plus tard le 1/01/2012.
Le respect de cette obligation impose d’anticiper : cela conduira
souvent à une refonte complète de la grille tarifaire, exercice
toujours délicat. En outre, en délégation, un avenant au contrat
sera nécessaire.

14
EEEAAAUUU PPPOOOTTTAAABBBLLLEEE
ccc))) LLL’’’OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTIIIOOONNN DDDEEE FFFAAACCCTTTUUURRRAAATTTIIIOOONNN DDDEEE TTTOOOUUUSSS LLLEEESSS VVVOOOLLLUUUMMMEEESSS FFFOOOUUURRRNNNIIISSS
Principe Interdiction de la fourniture gratuite d’eau potable
Réf. juridique Art. L.2224-12-1 CGCT
Observations
complémentaires
La seule exception concerne les consommations d'eau des bouches
et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Tous les autres volumes fournis, notamment aux collectivités (qui
bénéficient fréquemment de gratuité), doivent être facturés. Il en va
de même de la défense incendie en domaine privé (entreprises, etc.).
En outre, la tarification doit intervenir dans le respect du principe
d’égalité des usagers.
ddd))) LLLAAA SSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEE TTTAAARRRIIIFFFAAAIIIRRREEE DDDEEESSS FFFAAACCCTTTUUURRREEESSS DDD ’’’EEEAAAUUU
Principe Les factures d'eau comprennent obligatoirement un montant calculé
en fonction du volume réellement consommé par l'abonné.
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 I al.1 CGCT
Observations
complémentaires
La règle en matière tarifaire est donc la facturation proportionnelle.
Le cas échéant, la facturation d’une part fixe est possible. Son
montant est déterminé en fonction des charges fixes du service et
des caractéristiques du branchement
eee))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN AAAUUU FFFOOORRRFFFAAAIIITTT DDDEEE LLL’’’EEEAAAUUU PPPOOOTTTAAABBBLLLEEE
Principe La tarification au forfait, sans lien avec le volume réellement
consommé par l’abonné, n’est possible qu’à titre dérogatoire,
lorsque la ressource en eau est abondante
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 I al.3 CGCT ; Art. R.2224-20 CGCT
Observations
complémentaires
Le principe est la tarification proportionnelle ; le forfait est
l’exception. Il n’est possible que si deux conditions sont réunies :
• la ressource en eau est naturellement abondante ;
• la population totale de la collectivité est inférieure à 1 000 hab.
Quand ces conditions sont remplies, l’autorisation de facturer au
forfait est accordée par arrêté préfectorale sur demande de
l’exécutif. Elle est ensuite reconduite tacitement.
Si pendant 3 années consécutives les conditions ne sont plus
remplies, il appartient au Préfet de mettre fin par arrêté à la
dérogation. La collectivité dispose alors de 2 ans pour établir une
nouvelle grille tarifaire basée sur une tarification proportionnelle.

15
fff))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN DDDEEE LLLAAA PPPAAARRRTTT FFFIIIXXXEEE EEENNN HHHAAABBBIIITTTAAATTT CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF
Principe La facturation de la part fixe peut tenir compte du nombre de
logements desservis par chaque branchement.
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 I al.1 et IV al.3 CGCT
Observations
complémentaires
En pratique, il est possible de facturer autant de parts fixes que de
logements desservis par un seul branchement, cette configuration
étant considérée comme une « caractéristique du branchement ».
Chaque collectivité doit établir un cadre précis pour déterminer les
règles d’application : base de calcul (facturation assise sur le
nombre d’unités d’habitation, de points de consommation, etc.),
modalités d’appréciation, tarif correspondant de la part fixe, etc.
Ce dispositif intéresse généralement les communes à forte
population saisonnière, puisqu’il permet de faire contribuer plus
fortement au financement des services d’eau et d’assainissement
les résidences de vacances et copropriétés de tourisme sans risque
de créer une discrimination tarifaire au détriment des touristes
(pour non-respect du principe d’égalité des usagers).
ggg))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN IIINNNCCCIIITTTAAATTTIIIVVVEEE SSSEEELLLOOONNN LLLAAA VVVUUULLLNNNEEERRRAAABBBIIILLLIIITTTEEE DDDEEE LLLAAA RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEE EEENNN EEEAAAUUU
Principe Lorsque la ressource en eau est fragile, les collectivités sont incitées
à mettre en place une tarification incitant les usagers à une
meilleure utilisation de la ressource.
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 II et III CGCT ; Art. R.211-71 à 74 CEnv.
Observations
complémentaires
La rédaction de ce dispositif est confuse. Deux catégories de
collectivités sont distinguées, selon la vulnérabilité de la ressource
en eau qu’elles utilisent pour la production d’eau potable :
• celles dont plus de 30% de la ressource provient d’une zone de
répartition des eaux (ZRE) : elles doivent mettre en place une
tarification incitative, par exemple sous la forme d’un tarif au
mètre cube uniforme ou progressif (échéance : le 1/01/2010 pour
les ZRE existantes ou dans les 2 ans du classement en ZRE) ;
• celles dont moins de 30% de la ressource provient d’une ZRE :
elles conservent une totale liberté tarifaire. Bien évidemment,
celles qui pratiquent déjà une tarification à caractère incitatif
(tranches progressives, tarifs saisonniers) dans les secteurs où la
ressource n’est pas particulièrement menacée ni protégée
peuvent la maintenir.
Les ZRE sont les zones dans lesquelles une insuffisance chronique
de la ressource ne permet pas de satisfaire tous les usages ce qui
impose des mesures de répartition (encadrement plus strict des
prélèvements, etc.).

16
hhh))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN SSSAAAIIISSSOOONNNNNNIIIEEERRREEE
Principe Lorsque l’équilibre entre ressource et consommation est menacé de
façon saisonnière, une tarification saisonnière peut être instituée
Réf. juridique Art. L.2224-12-4 IV CGCT
Observations
complémentaires
La tarification saisonnière impose 1 relevé de compteurs à chaque
basculement de tarif, sur une période très courte. Il faut donc
prendre en compte les conséquences financières (frais de personnel
accrus ou mise en place d’une télérelève).
Il ne semble pas qu’il faille lire le CGCT comme limitant le recours à
cette tarification aux seules collectivités dans lesquelles il existe un
fort enjeu de ressource. La jurisprudence autorisait d'ailleurs déjà la
tarification saisonnière sans condition.
iii))) LLLEEESSS DDDEEEPPPOOOTTTSSS DDDEEE GGGAAARRRAAANNNTTTIIIEEE
Principe Interdiction des demandes de dépôts de garantie et de caution
avant souscription d’un abonnement
Réf. juridique Art. L.2224-12-3 CGCT
Observations
complémentaires
Le remboursement des sommes déjà perçues à ce titre interviendra
avant fin 2009, aucune modalité n’étant imposée par les textes. De
nombreux exploitants fixeront donc sans doute des règles plutôt
restrictives, telles que l’exigence de la production par les abonnés
d’un document attestant qu’ils ont versé un tel dépôt.
Non seulement il n’est pas certain qu’une telle pièce ait été remise
lors de la souscription de l’abonnement ; en outre, pour des
abonnés anciens, il est probable que beaucoup ne seront plus en sa
possession. De telles exigences pourraient donc considérablement
limiter la portée de cette disposition.
AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT
aaa))) LLLAAA SSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEE TTTAAARRRIIIFFFAAAIIIRRREEE DDDEEESSS FFFAAACCCTTTUUURRREEESSS DDD ’’’AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF
Principe Le montant des factures d'assainissement comprend
obligatoirement une partie variable
Réf. juridique Art. R.2224-19-2 CGCT
Observations
complémentaires
La règle en matière tarifaire est donc la facturation proportionnelle,
comme pour l’eau potable.
L’assiette de facturation est le volume d’eau prélevé par l’abonné
sur le réseau public d’eau potable et/ou sur une autre source (cf.
règle spécifique de facturation dans ce cas. Art. R.2224-19-4 CGCT)
Le cas échéant, la facturation d’une part fixe est possible ; son montant
est déterminé pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service
Lorsque l’eau potable est facturée au forfait, il est possible de faire
de même pour l’assainissement

17
bbb))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN DDDEEE LLL ’’’AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF EEENNN CCCAAASSS DDDEEE MMMUUULLLTTTIIIPPPLLLIIICCCIIITTTEEE DDDEEE
SSSOOOUUURRRCCCEEESSS DDD’’’AAAEEEPPP
Principe Quand l’abonné s’alimente partiellement ou totalement à d’autres
sources que le service public d’AEP (et que l’assiette de facturation
de l’eau potable ne traduit pas correctement la réalité des rejets
d’eaux usées), il est possible de recourir à une estimation des rejets
pour asseoir la facturation de la redevance d’assainissement
Réf. juridique Art. R.2224-19-4 CGCT
Observations
complémentaires
L’abonné concerné doit se déclarer en mairie.
Pour permettre la facturation de l’assainissement, l’abonné peut installer
à ses frais un système de comptage et communiquer les données au
service, dans une forme et des délais permettant la facturation.
A défaut, la collectivité délibère pour fixer des critères permettant
d’évaluer le volume d’eau prélevé (surface du logement ou du
terrain, nombre d’habitants dans le foyer, etc.)
ccc))) LLLAAA RRREEEDDDEEEVVVAAANNNCCCEEE DDD ’’’AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF PPPOOOUUURRR LLLEEESSS RRREEEJJJEEETTTSSS DDD’’’EEEAAAUUUXXX UUUSSSEEEEEESSS NNNOOONNN
DDDOOOMMMEEESSSTTTIIIQQQUUUEEESSS
Principe La redevance d’assainissement pour les rejets d’eaux usées non
domestiques peut tenir compte de la spécificité des effluents
Réf. juridique Art. L.1331-10 CSP ; Art. R.2224-19-10 CGCT
Observations
complémentaires
Deux approches sont autorisées :
• une évaluation spécifique basée sur des critères tenant compte
par exemple de l’importance, la nature ou de caractéristiques du
déversement ;
• la consommation d’eau potable sur laquelle peut être appliqué un
coefficient de correction pour tenir compte du degré de pollution, de
la nature du déversement et de son impact réel sur le service
d’assainissement
Chaque collectivité détermine sa propre approche et fixe les critères
et coefficients

18
2 CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’APPROCHE ECONOMIQUE
PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE
La politique tarifaire d’un service ne peut s’envisager hors contexte : certains facteurs de
contexte qui s’imposent à un service ou qui sont liés à sa taille ont des effets sur les
coûts. Par exemple, un coefficient de pointe élevé (fort écart entre la consommation en
période moyenne et en période de pointe) impose un surdimensionnement des
infrastructures qui pèse toute l’année sur les coûts d’investissement et d’exploitation. A
l’inverse, une densité élevée (nombre d’abonnés / km de réseau) permet de mieux
rentabiliser les investissements et diminue le coût par mètre cube vendu.
En s’appuyant sur des travaux récents1 et en fonction des informations disponibles à
partir du questionnaire, les facteurs suivants ont ainsi été retenus.
Facteurs de complexité inducteurs de coûts Effet attendu sur les
charges du service
Eau potable
Volume vendu (ou à défaut consommé) / abonné -
Proportion d’eau importée par rapport au volume mis en distribution +
Proportion des ventes en gros par rapport au volume total vendu -
Indice linéaire de pertes et volumes non-comptés + (1)
Coefficient de pointe (volume produit le mois de pointe / volume
mensuel produit moyen) +
Densité linéaire -
Nombre d’abonnés -
Assainissement collectif
Volume facturé / abonné -
Densité linéaire -
Nombre d’abonnés -
Coefficient de pointe (volume traité le mois de pointe / volume
mensuel traité moyen) +
(1) Jusqu’à une certaine limite toutefois car il arrive un moment où le coût de limitation des fuites
devient supérieur au gain sur les coûts de production d’eau.
222...111 LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN ::: UUUNNN IIINNNSSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTT AAAUUU SSSEEERRRVVVIIICCCEEE DDD’’’UUUNNN OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFF
1 Notamment la thèse de Guillaume Fauquert « les déterminants du prix des services d'eau potable en délégation », soutenue en 2007 à l’ENGREF sous la direction de Lætitia Guérin-Schneider.

19
La tarification, i.e. la détermination du prix d'un bien ou d'un service, est un outil au
service d'un objectif à atteindre. Cet objectif pourrait être la maximisation des profits
d’une entreprise privée, la couverture des coûts d’une entreprise publique, l’équité ou
l’égalité de traitement des usagers à l’échelle d’un territoire, l’accès du bien à tous les
usagers dans le cas de biens de première nécessité, un objectif environnemental de
préservation de la ressource, l’exploitation optimale de la ressource, etc.
La tarification de l'eau requiert que soit précisée au préalable les objectifs à atteindre.
Dans le cas de l’eau potable, c'est l’évolution des objectifs à atteindre en matière de
gestion des ressources en eau qui explique les changements observés dans la pratique
tarifaire. Ces objectifs ont été déterminés pendant longtemps par les pouvoirs publics
nationaux mais relève dorénavant de l'Union Européenne.
Une mise en perspective de ces évolutions permet d’apporter un éclairage sur les
avantages et les inconvénients des différentes méthodes de tarification.
222...222 UUUNNN OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFF QQQUUUIII EEEVVVOOOLLLUUUEEE ::: UUUNNNEEE MMMIIISSSEEE EEENNN PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEE AAA PPPAAARRRTTTIIIRRR DDDEEE LLL’’’EEEAAAUUU PPPOOOTTTAAABBBLLLEEE
L’évolution de la tarification de l’eau potable en France est marquée par 4 périodes.
Chacune de ces périodes est caractérisée par la poursuite d’un objectif bien déterminé.
La première période : une tarification forfaitaire au service du raccordement
pour une couverture des coûts
La première période, jusqu’à la fin des années 1970, se caractérise par le développement
des raccordements aux réseaux. Les objectifs poursuivis sont d’ordre sanitaire,
(raccordement au réseau d’égout) et technique (débit minimum requis pour le
fonctionnement correct du réseau) ; mais également financier (garantir un raccordement
minimal permettant de couvrir une partie des investissements) et économique (mesurer
la consommation pour en déduire une fonction de demande). Ces investissements lourds,
au cours d’une période pendant laquelle la ressource n’était pas contrainte, suggéraient
une tarification forfaitaire afin d’inciter les usagers à renoncer aux sources alternatives
(pompage et récupération des eaux de pluies). En termes d’évaluation coûts-avantages,
la tarification forfaitaire pouvait se justifier par le fait que les bénéfices pour la santé
étaient supérieurs aux coûts financiers et environnementaux. Les mesures de la
consommation d’eau ont également permis, par la suite, d’évaluer les impacts d’une
variation de la tarification sur les comportements de consommation des usagers.
La deuxième période : une tarification Binôme pour un objectif de réduction du
gaspillage

20
La deuxième période correspond grossièrement à celle des années 1980. La tarification
forfaitaire est remise en cause pour deux raisons. D’une part, elle est inique puisqu’on
montre que les volumes consommés sont proportionnels au revenu ; et, d’autre part, elle
incite au gaspillage. C’est le début de la prise de conscience de la rareté de la ressource.
Le CNE (Comité National de l’Eau) préconise en 1979 la tarification Binôme tout en
maintenant une part forfaitaire limitée à la première tranche de consommation, entre
30m3 et 40m3, comme mécanisme de solidarité. Ce mécanisme de tarification a permis
de limiter les gaspillages, mais il n’y a pas encore de signal-prix envoyé aux
consommateurs pour leur faire prendre conscience du coût social généré par la
consommation d’eau.
La troisième période : Un signal-prix aux consommateurs pour prendre en
compte le coût social
Dans les années 1990, la loi sur l’eau de 1992 incite à la responsabilisation des
consommateurs d’eau. Le coût social2 de l’eau est égal à la somme des coûts induits par
son utilisation et dont la valeur est égale à celle de la dégradation de l'environnement, au
lieu de son prélèvement et au lieu de son rejet après utilisation. Le prix de l’eau au
consommateur doit contenir un signal sur la dégradation de l’environnement engendré
par son utilisation. C’est le principe du pollueur-payeur.
Néanmoins, la totalité des coûts de fourniture n’est pas encore couverte par la
tarification3 (cf. Annexe IV. La loi de 1992 interdit alors le forfait, sauf cas exceptionnel,
et préconise la tarification proportionnelle au volume consommé. Le credo est à la
responsabilisation des usagers, en plus de la couverture des coûts.
La quatrième période : l’allocation efficace des ressources en eau
Les objectifs poursuivis aujourd’hui, quatrième phase des années 2000 (plutôt 2006),
sont inscrits dans la DCE et ont été transposés à l’échelle nationale par la loi du 30
décembre 2006.
"Le Parlement demande que les Etats membres veillent d'ici à 2010 à ce que la politique de
tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue à
la réalisation des objectifs environnementaux de la directive. Il demande que les Etats
membres veillent à ce qu'une contribution appropriée des différents secteurs économiques à
la récupération des coûts et des services de l'eau tient compte du principe du pollueur-payeur.
2 C’est en 1960 que R. Coase, dans “The problem of the social cost”, traite de la question économique des externalités engendrées par l’utilisation des ressources environnementales. Ces externalités qui échappent à la sphère marchande conduisent à la non prise en compte de la dégradation de l’environnement dans le comportement des agents économiques. Il faut donc les internaliser, c'est-à-dire les réintégrer dans la sphère marchande. La littérature en économie propose alors deux solutions : une taxe, i.e. un prix égal à la valeur de la dégradation de l’environnement (solution adoptée entre autres par la France), ou, établir des droits de propriétés sur la ressource et organiser un marché pour échanger ces droits (solution adoptée par certains états aux Etats-Unis et par l’Australie, c’est également en partie, la solution adoptée par l’UE pour limiter les émissions de Gaz à effet de serre). 3 En 2004, le prix de l’eau ne couvre encore que la totalité du coût du service et des coûts d’investissement.

21
Les Etats membres peuvent tenir compte des effets sociaux et économiques ainsi que des
conditions géographiques et climatiques des régions concernées.
Il demande aux Etats de faire rapport dans les plans de gestion de districts hydrographiques
sur les étapes conduisant à la mise en place d'une tarification incitative et sur la contribution
des différents secteurs économiques au recouvrement de l'ensemble des coûts des services
afférents à l'usage de l'eau (amendement PPE/DE)."
http://www.europarl.europa.eu/press/sdp/journ/fr/n0002161.htm#5
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28002b.htm
Les objectifs affichés sont clairs en termes économiques. Il s’agit de pratiquer une
tarification qui reflète la valeur économique de la ressource et qui maximise le bien-être
collectif. Celle-ci doit avoir pour objectif de couvrir la totalité des coûts de la ressource,
i.e. le coût privé, le coût social et le coût d’opportunité.
Cette valeur économique de la ressource « eau » est égale à la somme du :
• coût de fourniture, ou coût d'approvisionnement, i.e. son extraction, son
traitement et son transport jusqu'au robinet et les relations avec les abonnés ;
• coût social de son utilisation, c'est-à-dire les coûts de la dégradation de
l'environnement consécutifs à l'utilisation de l'eau (comme par exemple, le
cout environnemental), dans le cas où les prélèvements excèdent la capacité
des milieux aquatiques, donnant naissance à des dommages aux milieux (ex.
intrusion d’eau salée dans les aquifères côtiers, débits d’étiages trop faible
dans les rivières) ;
• coût d'opportunité, lié à l'appauvrissement de la ressource entraînant la
disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs (l'eau aurait pu
être utilisée pour un autre usage, agricole, industriel, etc.).
En théorie, le prix de l'eau devrait refléter l'ensemble de ces trois valeurs. Un tel prix
envoie un signal aux consommateurs sur la valeur économique de la ressource, i.e. une
valeur qui permet de fournir l'eau potable au robinet, de financer les restaurations des
dégâts causés à l'environnement et de rendre compte des choix alternatifs de l'usage de
l'eau. L’efficacité du signal-prix envoyé aux consommateurs requiert néanmoins un
partage des coûts répondant au principe du pollueur-payeur.

22
222...333 LLLAAA SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN OOOBBBSSSEEERRRVVVEEEEEE DDDAAANNNSSS LLLEEE TTTEEERRRRRRIIITTTOOOIIIRRREEE EEETTTUUUDDDIIIEEE
A partir des facteurs de complexité observés sur les services (cf. Préambule), le contexte
de coût a été déterminé pour chaque commune par rapport aux autres communes de
l’échantillon : à chaque facteur correspond un indicateur de coût compris entre 0 et
100%. La valeur 0% signifie que la valeur du facteur est la plus faible (resp. la plus
élevé) rencontrée dans l’échantillon pour un facteur ayant une relation croissante (resp.
décroissante) avec les coûts. Au contraire, la valeur 100% signifie que sur ce facteur, la
commune connait la contrainte la plus forte en termes de coût au sein de l’échantillon
Ouest Hérault.
L’indice de coût global (IC) est obtenu en faisant la moyenne des n indicateurs ainsi
identifiées. Plus l’indice global est proche de 100%, plus les facteurs de la commune
considérée jouent en faveur d’un coût plus élevé que celui des autres communes.
L’hypothèse sous-jacente est que les indicateurs ont une incidence linéaire et de même
ordre de grandeur sur les coûts. Elle présente l’intérêt d’être facile à modéliser, tout en
étant relativement robuste.
Au final, les communes sont classées dans deux catégories, facteur de coût élevé (IC+)
ou facteurs de coût bas (IC-) suivant que l’indice de coût global est élevé ou faible.
Afin de garantir de manière empirique une bonne répartition des communes, la valeur
seuil retenue entre les deux classes est de 50% pour l’eau et de 55% pour
l’assainissement.
Parallèlement, le prix est défini ici comme le total de la part collectivité et, le cas échéant
la part délégataire, pour une facture de 120 m³ (facture standard INSEE). Le prix ne
comprend donc aucune taxes ni redevances. Le prix de l’eau concerne uniquement
l’exploitation et l’investissement du service de l’eau ou de l’assainissement.
Ce prix tient compte de la partie fixe (pour un compteur de 15 mm, le cas échéant) et de
la partie variable.
Il est exprimé en euros par mètre cube.
Le prix moyen de l’échantillon des communes permet de délimiter deux catégories :
� prix faible (au-dessous de la moyenne),
� prix élevé (au-dessus de la moyenne).
Pour l’eau potable, le prix moyen des services exerçant la totalité de la compétence est
de 1,16 €/m³ et pour l’assainissement de 0,87 €/m³.
Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il existe globalement dans le
périmètre étudié une mauvaise corrélation entre le contexte de coût et le niveau de prix.

23
Un tel résultat n’est toutefois pas foncièrement étonnant : plusieurs travaux ont en effet
montré que le niveau du prix ne traduit en général qu’indirectement les coûts du
service4. Plusieurs facteurs d’explication peuvent être cités :
� ces données sont fondées sur la facture 120 m³ et non sur la recette totale des
services (qui rapportée à l’assiette donne un prix moyen). Il peut donc y avoir
des biais liés à la structure de tarification par exemple avec une tarification
progressive, le prix basé sur la facture 120 m³ est inférieur au prix moyen (et
inversement avec un tarif dégressif). Nous ne disposons pas du prix moyen issu
de la recette, qui traduit plus directement l’équilibre financier du service. C’est à
cette échelle que les services visent généralement l’équivalence prix / coût ;
� la date et le montant des investissements : des investissements récents pèsent
plus lourd dans le prix (amortissement et éventuellement coût des emprunts) ;
� la précision de la M49 (comptabilité du service côté « collectivité ») concernant
l’inventaire et l’amortissement peut influencer fortement le montant des
amortissements grevant le prix : à même patrimoine, si l’inventaire est lacunaire,
les amortissements seront plus faibles ;
� l’existence de mutualisations financières, même si elles ne sont pas toujours
explicites : mutualisation des moyens communs à plusieurs contrats dans les
entreprises déléguées, possibilité parfois de subvention des budgets annexes de
l’eau par le budget général pour les petites communes, etc. ;
� la gestion passée et l’inertie des contrats peuvent aussi générer des écarts : au
bout de plusieurs années, le prix fixé au début du contrat ne reflète plus
l’équilibre économique qui a évolué ;
� les conditions initiales de négociation du prix avec les délégataires : une situation
de concurrence et une négociation efficace de la collectivité permettent de réduire
la marge de l’opérateur donc le prix supporté par l’usager.
Toutefois, avec le principe de couverture des coûts, promu par la directive-cadre sur
l’eau, les services devraient à terme limiter les écarts entre coût et prix.
Cela signifie que les services dans lesquels la divergence est la plus forte (qu’il s’agisse
d’une marge excessive sur le prix de l’eau ou bien à l’inverse d’une sous-estimation des
dépenses) devraient logiquement connaître un rééquilibrage dans les prochaines années.
Ce cas de figure doit donc être pris en compte dans les évolutions de la politique
tarifaire.
4 Voir en particulier la thèse soutenue par Guillaume Fauquert déjà citée.

24
222...444 LLLEEESSS DDDIIIFFFFFFEEERRREEENNNTTTSSS MMMOOODDDEEESSS DDDEEE TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN
111))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN FFFOOORRRFFFAAAIIITTTAAAIIIRRREEE
La pratique consiste à faire payer chaque usager un forfait indépendant de sa
consommation en eau. La méthode a pour avantage d'inciter au raccordement au réseau
dans la première période consécutive au déploiement de celui-ci, et par conséquent
favorise la dynamique de la couverture des coûts fixes de l'investissement. En revanche,
le fait de découpler le paiement du service de la quantité d'eau consommée incite
l'usager à la surconsommation. Il y a dans ces cas, une absence totale de signal-prix, i.e.
de prise en compte du coût social de la dégradation de la ressource.
222))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN UUUNNNIIIFFFOOORRRMMMEEE
Egalement appelé tarification "Monôme", elle consiste simplement à faire payer le mètre
cube d'eau consommé à un prix unitaire constant et sans abonnement. Ce système de
tarification présente l'avantage de coupler la consommation d'eau à la facture payée par
l'usager. La recette totale du fournisseur est égale au produit de la quantité d'eau vendue
par le prix unitaire. Ce mode de tarification présente l'inconvénient de faire peser un
risque sur la couverture des coûts fixes puisque les ventes d'eau varient d'une année sur
l'autre.
Progression du tarif et de la facture d'eau de l'abonné en fonction de sa consommation
Tarif (€/m³)
Volume (m3)
Facture (€/an)
Volume (m3)
p
q

25
333))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN BBBIIINNNOOOMMMEEE
C'est le cas le plus simple de tarif non uniforme comportant une partie fixe et une partie
variable fonction de la quantité d'eau consommée. Ce mode de tarification consiste à
faire payer à l'usager un coût fixe égal au prix de l'abonnement A, et un coût variable
uniforme, p que multiplie la quantité consommée q, de telle sorte que la facture totale F
est égale à la forme fonctionnelle suivante :
F A pq= +
: Facture totale de l'abonné,
: Prix de l'abonnement,
: prix du mètre cube,
: volume d'eau consommé.
F
A
p
q
Progression du tarif et de la facture d'eau de l'abonné en fonction de sa consommation
En théorie, la somme des abonnements A appliqués à tous les usagers devrait couvrir les
coûts fixes du réseau. La partie variable à pour objet d'inciter les usagers à réduire, à la
marge, leur consommation en eau.
Volume (m3) Volume (m3) q
p
Tarif (€/m³) Facture (€/an)

26
444 ))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN PPPAAARRR PPPAAALLLIIIEEERRRSSS CCCRRROOOIIISSSSSSAAANNNTTTSSS
La tarification par paliers croissants consiste à faire augmenter le prix du mètre cube
lorsque la consommation augmente. Ce mode de tarification a pour vocation de faire
prendre conscience aux usagers les coûts sociaux liés à leur consommation en eau, et
par conséquent de les inciter à réduire leur consommation à la marge, celle qui ne leur
est pas indispensable. La facture à la forme fonctionnelle suivante :
1 1 2 2 3 3 F A p q p q p q= + + +
1 2 3
1 2 3
avec
et
p p p
q q q
< << <
: Facture totale de l'abonné,
: Prix de l'abonnement,
: prix du mètre cube,
: volume d'eau consommé.
F
A
p
q
Progression du tarif et de la facture d'eau de l'abonné en fonction de sa consommation
Toute la difficulté de ce mode de tarification est de définir les tranches de variations des
tarifs, et les plages de consommation de ces tranches. Ce sont en effet ces tranches qui
vont délimités les catégories d'usagers qui vont être touchés par la progressivité des
tarifs. De façon caricaturale, si la première tranche commence à 120 m3, seul les "gros"
consommateurs dont le volume annuel facturé dépasse les 120 m3 vont subir la
progressivité des tarifs.
Tarif (€/m³)
Volume (m3)
Facture (€/an)
Volume (m3)
p1
p2
p3
q1 q2 q3

27
En théorie, la première tranche doit être conçue de telle sorte à répondre aux besoins en
eau incompressibles d'un usager. Elle peut, et c'est souvent le cas, être inférieure au
coût moyen de fonctionnement et de maintenance de la fourniture des services. La
seconde tranche est au dessus de ce coût moyen. Si la différence de prix entre les
tranches est significative, le consommateur est amené à prendre conscience de sa
consommation marginale en eau.
L'avantage de la tarification par blocs progressifs est de faire peser une charge moins
importante sur les petits consommateurs et plus lourde sur les gros consommateurs.
555))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN SSSAAAIIISSSOOONNNNNNIIIEEERRREEE
Certaines communes sont confrontées à de fortes variations de populations au cours de
l’année. Cet accroissement saisonnier de la demande en eau potable et assainissement
pose le problème du dimensionnement des infrastructures, et par voie de conséquence
des investissements, et du partage des coûts de ceux-ci. Les ouvrages doivent être
surdimensionnés afin de répondre aux consommations en période de pointe, et le
surinvestissement qui en résulte doit se répercuter sur le prix de l’eau en prenant garde
de ne pas pénaliser les résidents permanents.
Traditionnellement, c'est la hausse de la part fixe de la facture qui permet d'assurer la
stabilité de la couverture des coûts5. Néanmoins, cette stratégie tarifaire peut être en
conflit, ou du moins en contradiction, avec un autre objectif, une tarification à objectif
social, étant entendu que toute discrimination par les prix est strictement interdite.
Bien qu'il soit difficile de mesurer avec précision l’influence de l’utilisation saisonnière
des équipements, il n'en demeure pas moins que le prix de l’eau doit tenir compte du
surdimensionnement, notamment en assurant la couverture des coûts de
l'investissement par la partie fixe de la facture d'eau. La loi autorise d'ailleurs à cet
égard, les communes à forte population touristique, à pratiquer une tarification avec une
part fixe représentant plus de la moitié de la facture de l'usager.
La tarification saisonnière consiste à appliquer un prix de l'eau plus élevé en période de
forte demande, en l'occurrence pendant la période estivale.
5 Ces problématiques de partage de coûts sont inhérentes aux investissements dans les infrastructures collectives. Les travaux en sciences économiques ont permis de construire des règles spécifiques de partage de coûts pour répondre à ces interrogations. Celles-ci s'appuient le plus souvent sur des principes d'équité tel que celui du traitement égal des égaux.

28
666))) LLLAAA TTTAAARRRIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN PPPAAARRR PPPAAALLLIIIEEERRRSSS DDDEEEGGGRRREEESSSSSSIIIFFFSSS
Il s'agit d'une tarification par bloc dégressif. Elle consiste à faire payer un prix de l'eau
qui décroit à mesure que la consommation augmente. La facture a la forme fonctionnelle
suivante :
1 1 2 2 3 3 1 2 3 avec F A p q p q p q p p p= + + + > >
: Facture totale de l'abonné,
: Prix de l'abonnement,
: prix du mètre cube,
: volume d'eau consommé.
F
A
p
q
Progression du tarif et de la facture d'eau de l'abonné en fonction de sa consommation
Ce mode de tarification favorise les gros consommateurs. Le coût moyen unitaire diminue
significativement à mesure que la consommation augmente. Elle est interdite par la DCE
en raison de son caractère dés-incitatif à la prise de conscience des coûts externes liés à
la consommation d'eau. En outre, elle a pour principal inconvénient d'être inique
puisqu'elle impose une charge plus importante de la couverture des coûts fixes sur les
premiers volumes d'eau consommés, i.e. la consommation d'eau incompressible, que sur
les derniers volumes.
Tarif (€/m3)
Volume (m3)
Facture (€/m3)
Volume (m3)
p3
p2
p1
q1 q2 q3

29
3 LES CINQ SCENARIOS D’EVOLUTION DES OUTILS TARIFAIRES EN PLACE
333...111... CCCHHHOOOIIIXXX DDDEEESSS SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS DDD ’’’EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN
Le contexte général qui s’impose aux services d’eau et d’assainissement est largement
impacté par la mise en œuvre de la LEMA, qu’il s’agisse, comme on l’a vu plus haut de la
réglementation applicable à la structure tarifaire, de la réaffirmation du principe de
couverture des coûts ou encore de l’augmentation des investissements à financer pour
atteindre le bon état écologique.
Ainsi, si l’obligation de faire évoluer le prix et les tarifs des services d’eau est une
évidence, la forme que prendra cette évolution est encore un sujet peu exploré.
Tout l’intérêt de la présente étude consiste à mettre en exergue des scénarios pertinents
d’évolutions qui répondront à deux objectifs principaux :
� traduire la mise en œuvre de principes inscrits dans la LEMA (incitation à
l’économie d’eau, couverture des coûts, plafonnement de la partie fixe, tarification
incitative…) ;
� prendre en compte la réalité de terrain et les modes de tarification actuellement
en place dans la zone ouest Hérault.
Il s’agit donc à la fois de prendre en compte les objectifs locaux des élus et les
directions ouvertes par la LEMA.
La phase II de l’étude a conduit cette analyse préalable : les évolutions tarifaires
proposées correspondent soit à des préconisations de la LEMA, soit à la mise en
cohérence des situations rencontrées dans la zone ouest Hérault avec les objectifs
affichés par les collectivités au cours de l’enquête (principalement protection de
l’environnement et équilibre financier du service). Bien souvent en effet, le principe de
préservation de l’environnement affiché comme prioritaire était en contradiction avec la
tarification en place comportant des tranches dégressives.
Le tableau qui suit reprend donc les cinq scénarios les plus intéressants, issus de la
phase II de l’étude, qui ont fait l’objet d’une validation par le Comité de Pilotage de
l’étude6.
Les sous-scénarios ont été affinés et sont légèrement modifiés par rapport à ceux
envisagées en fin de phase 2. En effet il a semblé plus pertinent de décliner certains
scénarios en fonction de leur objectif incitatif, plutôt que sur un niveau de répercussion
des coûts qui reste qualitativement identique et qui est difficile à interpréter (le lien entre
modification de tarif et recette dépendant de la structure de consommation, propre à
chaque service).
6 Réunion du 27 juin 2008.

30
Description de l’évolution
envisagée et de la situation de départ
Sous-scénarios envisagés Pertinence du scénario
1
Augmentation du prix, sur un tarif binôme simple
- Augmentation de prix médiane*
- Augmentation de prix forte*
- Majorité de tarifs binômes uniformes en place, sans forcément de volonté de changer la structure tarifaire.
- Beaucoup de cas de niveau de prix faible dans un contexte de coût fort (rétablir la couverture des coûts).
- Anticipation d’investissement dans les services (pour atteindre le bon état ou pour financer des développements).
2
Augmentation du prix et passage d’un tarif binôme simple à un tarif progressif
- Tranches progressives impactant les abonnés domestiques
- Tranches progressives impactant les gros consommateurs (industriels, hôtel…)
- Tranches progressives impactant toute la gamme des consommations
- Mêmes raisons que pour le cas 1 plus la volonté de mettre en place un tarif progressif (pour des raisons environnementales ou sociales et en lien avec la LEMA, pour les zones de répartition des eaux).
3
Baisse de la partie fixe pour passer en-dessous du seuil de 40 (ou 30)% à partir d’un tarif binôme simple
- Sans augmentation du prix
- Avec augmentation médiane*
- Beaucoup de services au-delà de ce seuil, imposé par a LEMA en 2010.
4
Passage d’une tarification dégressive à une tarification progressive
- tranches progressives impactant les abonnés domestiques
- tranches progressives impactant les gros consommateurs (industriels, hôtels…)
- Beaucoup de services en situation d’incohérence (tarif dégressif avec risque ressource, avec objectif environnemental ou tarifaire).
- Lien avec la LEMA, pour les zones de répartition des eaux.
5
Mise en place d’une tarification saisonnière à partir d’une tarification binôme simple
- Avec une partie fixe classique (pression quantitative estivale, non liée à un pic de population, objectif d’économie d’eau)
- Avec une partie fixe forte (habitat saisonnier, objectif de couverture des coûts fixes)
- Type de tarification mis en avant par la LEMA, encore peu répandu, susceptible d’intéresser les communes touristiques ou celles ayant une pression sur la ressource en été.
*Les ordres de grandeur pour les augmentations « fortes » et « médianes » sont définis au point 0.
Tableau 1 Les scénarios d’évolution les plus intéressants mis en évidence

31
L’évolution de la tarification dans les scénarios comporte deux dimensions :
� modifier les éléments tarifaires de manière à répercuter dans les recettes une hausse
des coûts ;
� modifier la structure tarifaire, de manière à créer des incitations cohérentes avec les
objectifs poursuivis.
NB : La baisse des coûts n’est pas présentée ici, car c’est un cas moins fréquent sur le
terrain et de plus, c’est une modification tarifaire généralement plus facile à mettre en
œuvre.
Les modifications de la structure tarifaire résultent des éléments suggérés par les
approches économiques et juridiques détaillées ci-avant (§ 1& 2).
L’augmentation du montant des coûts à répercuter résulte lui du contexte particulier du
service.
Il est excessivement difficile de chiffrer ces coûts puisqu’ils sont déterminés individuellement
pour chaque service. Toutefois, afin de donner une vision réaliste d’évolutions tarifaires, et
faute de données plus précises disponibles à ce jour, nous avons cherché dans les lignes
qui suivent à approcher l’ordre de grandeur de cette augmentation.
333...222... QQQUUUEEELLL OOORRRDDDRRREEE DDDEEE GGGRRRAAANNNDDDEEEUUURRR DDDEEE CCCOOOUUUTTT SSSUUUPPPPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEE PPPRRREEENNNDDDRRREEE EEENNN CCCOOOMMMPPPTTTEEE DDDAAANNNSSS LLLEEESSS
SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS
Trois éléments peuvent contribuer à de nouveaux coût sur la facture : le financement des
mesures environnementales liées à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, la
mise en œuvre réelle du principe de couverture des coûts, et enfin le financement
d’investissements de développement du service qui coutent plus qu’ils ne rapportent.
111))) FFFIIINNNAAANNNCCCEEEMMMEEENNNTTT DDDUUU PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE DDDEEE MMMEEESSSUUURRREEE DDDEEE LLLAAA DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVEEE CCCAAADDDRRREEE SSSUUURRR LLL’’’EEEAAAUUU (((DDDCCCEEE)))
Pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau, la directive cadre impose de mettre
en place un programme de mesures. Certaines de ces mesures pourraient être mises en
œuvre directement par les services d’eau ou bien répercutées sur eux.
Le BRGM, dans une étude sur le même secteur géographique, détaille de telles mesures
pour les aspects de gestion quantitative des ressources en eau (par exemple :
dessalement de l’eau de mer, construction d’adducteur pour des transferts d’eau depuis le
Rhône, augmentation du soutien d’étiage, lutte contre les fuites d’eau dans les réseaux de
distribution d’eau potable…). Après avoir estimé le coût de différentes mesures, le BRGM
déduit un ordre de grandeur de l’impact sur le prix de l’eau potable : 0,08 à
0,20 €/m³ vendu. Il s’agit de valeurs moyennes, susceptibles de masquer des
valeurs localement plus élevées.

32
Ces mesures ne traitent que les aspects quantitatifs. Il faut aussi tenir compte des
aspects qualitatifs qui concernent cette fois-ci plutôt la gestion des services
d’assainissement avec la limitation des rejets dans le milieu. Nous ne disposons pas
d’étude équivalente à celle du BRGM, toutefois, un raisonnement simple permet de caler
l’ordre de grandeur :
� La première mesure type pourrait être la mise en place d’une nouvelle
station assurant un niveau de traitement plus poussée.
D’après l’ADEME, en 1999, l’investissement est compris entre 90 et 230
€/EqHab, réparti à 50% en génie civil (amorti sur 30 ans) et à 50% en
électromécanique (amorti sur 20 ans)7. L’amortissement de l’investissement
représente donc de 3,75 à 10,42 €/EqHab/an
L’exploitation de cette nouvelle station peut générer de l’ordre de 30% de
charges en plus. En considérant que le coût moyen d’exploitation d’une station
se situe entre 7 et 30 €/EqHab, on aboutit donc à un surcoût compris entre
2,10 et 9,00 €/EqHab.
Au total, la mesure « nouvelle STEP » induit donc entre 5,85 et
19,42 €/EqHab. Considérant qu’il y a 2,4 habitants pour un abonné et 120 m³
de consommation annuelle pour un abonné standard, on arrive donc à 0,02 à
0,07 €/m³ de surcoût à répercuter.
Compte tenu de l’évolution du prix des travaux depuis 1999, et en tenant
compte d’exemples locaux8, cette première estimation semble sous-estimée.
On pourrait donc retenir de l’ordre de 0,10 à 0,50 €/m³.
� Une seconde mesure pourrait être l’accélération du renouvellement des
réseaux pour limiter les rejets avant la station, du fait de fuites.
Si on admet que cela se traduit par une augmentation de 5% des coûts de
renouvellement moyens, sachant que le coût d’investissement annuel est
compris entre 300 et 1000 €/EqHab, on arrive à un surcoût de 15 à 50
€/EqHab. Comme pour l’eau on a 2,4 abonnés par EqHab et 120
m³/an/abonné. Cette seconde mesure conduit donc à 0,05 à 0,17 €/m³.
� Au total on aboutit à un impact compris entre 0,15 et 0,67 €/m³
environ soit un peu plus que pour les mesures quantitatives.
7 Ces durées sont cohérentes avec les durées d’amortissement prescrites dans la nomenclature comptable M4, qui s’applique aux budgets publics de l’eau et de l’assainissement. 8 Ainsi par exemple, l’éléments de coût issus du schéma directeur d’assainissement du SIVOM de l’étang de l’Or, qui intègre les coûts de transfert des effluents, d’épuration et de rejet, et atteint des ordres de grandeur de 1,3 à 2,3 euros par m³ selon les scénarii pour la mise en conformité réglementaire de toutes les STEP à moderniser de son territoire. C’est un cas particulièrement contraint, qui correspond non pas aux mesures DCE mais à l’atteinte des niveaux de traitement de la directive ERU, mais qui donne une indication de fourchette haute.

33
En synthèse on retiendra que le financement des mesures environnementales liées à la DCE
pourrait se traduire, en ordre de grandeur par un surcoût allant de 0,8 à 0,20 €/m³
pour les services d’eau et ,15 à 0,67 €/m³pour les services d’assainissement. Au
total, une collectivité mettant en œuvre des mesures la fois pour l’eau et
l’assainissement pourrait donc avoir à répercuter entre 0,23 et 0,87 €/m³ vendu.
***Attention, ces chiffres, rappelons le, sont des estimations sommaires qui ne
doivent absolument pas être considérées comme des références ou des
statistiques, mais simplement servir de cadre pour les scénarios !***
NB : les exemples de mesures à prendre côté assainissement ne sont pas exhaustifs. On
peut ainsi penser que les communes rejetant dans des milieux sensibles devront mettre en
place des traitements plus poussés. La présente étude ne porte pas sur le recensement et le
chiffrage des mesures à prendre, mais sur les adaptations des outils tarifaires utiles.
222))) RRREEENNNFFFOOORRRCCCEEEMMMEEENNNTTT DDDEEESSS IIINNNFFFRRRAAASSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEESSS,,, NNNOOONNN LLLIIIEEEEEESSS AAA LLLAAA DDDCCCEEE
Les collectivités font également des projets de développement qui se traduisent par des
investissements, indépendamment des mesures environnementales. Dans la zone ouest
Hérault, en particulier, la pression démographique peut générer des investissements
importants d’adduction d’eau potable. Dans un certain nombre de cas ces investissements
sont neutres financièrement : par exemple lorsque l’investissement génère des recettes en
proportion des dépenses (les nouveaux abonnés compensent le coût de développement du
réseau). Mais souvent, les renforcements correspondent à des développements en périphérie
de la commune, dans des zones où le coût d’adduction n’est pas compensé par les nouveaux
abonnés.
Dans ce cas, le financement des investissements ne peut se faire qu’avec une augmentation
du prix. Là encore, il n’y a pas de règle générale en terme de coût.
Un ordre de grandeur raisonnable qui peut être pris est de l’ordre de 0
(investissement compensé par l’augmentation d’assiette) à 0,15€/m³
(investissement non compensé par l’augmentation d’assiette) supplémentaire par
service, soit 0,30 €/m³ au total pour l’eau plus l’assainissement en d’estimation
haute.
***Attention, ces chiffres, rappelons le, sont des estimations sommaires qui ne
doivent absolument pas être considérées comme des références ou des
statistiques, mais simplement servir de cadre pour les scénarios !***

34
333))) MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE CCCOOOUUUVVVEEERRRTTTUUURRREEE DDDEEESSS CCCOOOUUUTTTSSS
Dans la phase 2, l’étude a mis en évidence qu’un nombre significatif de services semblaient
ne pas répercuter entièrement les coûts. Cette situation peut s’expliquer par différentes
raisons : amortissement sous-estimé ou imputation partielle des moyens partagés
(notamment dans la partie publique du budget de l’eau), mutualisation entre plusieurs
services dont les moyens sont partagés, sous-investissement...
A terme, le principe réaffirmé de couverture des coûts devrait conduire à des réajustements.
Ce troisième facteur de répercutions de coût sur le prix de l’eau est encore plus
difficile à cerner que les précédents.
A titre purement indicatif, on peut chiffrer l’impact d’une amélioration de la
couverture des coûts à un ordre de grandeur maximal de 0,25 €/m³ par service
soit 0,50 €/m³ pour l’eau plus l’assainissement.
***Attention, ces chiffres, rappelons le, sont des estimations sommaires qui ne
doivent absolument pas être considérées comme des références ou des
statistiques, mais simplement servir de cadre pour les scénarios !***
444))) SSSYYYNNNTTTHHHEEESSSEEE PPPOOOUUURRR LLLEEE CCCAAALLLAAAGGGEEE DDDEEESSS SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS
En combinant les trois facteurs qui précèdent, on aboutit à une augmentation des coûts à
moyen terme (5 à 10 ans) comprise entre 0 et 1,67 €/m³ en cumulant les deux services.
Données indicatives à prendre en ordre de grandeur en €/m³ facturé
Pas de répercussion
Répercussion faible (eau + assainissement)
Répercussion forte (eau + assainissement
Surcoût pour mesures liées à la DCE
0 0,23 0,87
Surcoût pour investissement de renforcement
0 0,15 0,3
Surcoût pour une meilleure couverture des coûts
0 0,1 0,5
Total 0 0,48 1,67
On retiendra pour le calage des scénarios (pour l’évolution des tarifs) l’ordre de grandeur
suivant :
� augmentation médiane : 0,50 €/m³ (pour les deux services consolidés) ;
� augmentation forte : 1 €/m³ (pour les deux services consolidés, considérant que l’un
est en situation de répercussion faible et l’autre en situation de répercussion forte).
Rappelons que ces chiffres sont fournis faute de données plus précises afin de
caler les illustrations sur des valeurs plausibles.
Une étude spécifique sur les coûts induits par la DCE et par les autres aspects à
prendre en compte serait nécessaire pour aboutir à des coûts précis.

35
A titre de comparaison, les prix moyens pour la facture 120 m³, eau et assainissement, toutes
taxes et redevances confondus, provenant de différents observatoires sont donnés ici :
France
France services délégués
Bassin RMC Zone Ouest
Hérault
Facture 120 m³ eau et assainissement toutes taxes et redevances confondues (€/m³)
3,01 3,23 2,79 2,23
Source année IFEN 2004 FP2E 2006
Agence RMC 2005
Phase 1 de l'étude 2006
333...333... FFFOOORRRMMMAAATTT DDDEEE PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN DDDEEESSS SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS
Chaque scénario d’évolution des outils tarifaires est présenté de manière synthétique sous la
forme d’une fiche. Toutes les fiches suivent le même plan :
Situation de départ Description du tarif en place et éventuellement du contexte particulier
Un graphe présentant l’évolution du tarif suivant le niveau de consommation est inséré.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
Raison d’ordre juridique (adaptation à la réglementation) ou en lien avec les objectifs visés (tarification en place incohérente avec les objectifs).
Objectif poursuivi Dans quelle mesure attend-on de la nouvelle tarification une incitation pour atteindre un objectif (protection de l’environnement, équilibre financier, tarification sociale ou pro-industriel).
Illustration(s)
La modification de la structure tarifaire est illustrée sur la base de 1 ou 2 cas concrets.
Les composantes du tarif avant et après modification ainsi que le montant de la facture 120 m³ (facture standard en France) sont indiqués.
Un tableau plus complet donne le montant précis de la facture pour 5 niveaux de consommation.
Enfin, l’impact de la nouvelle tarification est exprimé pour 6 profils d’abonnés :
. abonné domestique avec revenu modéré (1 salaire de référence niveau employé/ouvrier dans le foyer) consommant 120 m³,
. idem consommant 200 m³,
. abonné domestique avec revenu aisé (2 salaires de référence niveau cadre dans le foyer),
. idem consommant 200 m³,
. gros consommateur consommant 1 000 m³,
. gros consommateur consommant 10 000 m³.
Pour les abonnés domestiques, la facture est rapportée au revenu du foyer, afin de mesurer l’impact social de la facture d’eau (cf. Annexe II 2).
Les abonnés ayant une consommation de plus de 10 000 m³ sont classiquement des industriels (ex : industrie agroalimentaire), des abonnés municipaux (bâtiments administratifs…), des campings, hôtels, ports, golfs, copropriétés (ou HLM) sans individualisation des abonnements ou encore parfois des abonnés de types agricoles. Le cas des ventes en gros peut être considéré comme un cas particulier de gros consommateurs (mais avec des volumes généralement très supérieurs et souvent une tarification distincte).
Conclusion Les éléments clefs et les limites de l’outil tarifaire proposé sont mis en exergue.

36
333...444... RRREEECCCOOOMMMMMMAAANNNDDDAAATTTIIIOOONNNSSS CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEESSS AAA TTTOOOUUUSSS LLLEEESSS SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS
Idéalement, pour avoir un effet incitatif claire de la tarification, il faut mettre en
cohérence toutes les composantes sur lesquelles la collectivité a prise : part
collectivité eau, part assainissement eau et le cas échant part délégataire eau et part
délégataire assainissement (pour une décomposition de la facture d’eau, cf. Annexe IV).
Dans les scénarios présentés, on suppose que c’est bien le cas : les fiches ne sont
pas différenciées entre l’eau et l’assainissement et présentent le tarif agrégé « eau +
assainissement ». Toutefois, les conclusions peuvent s’interpréter de la même manière sur
un élément du tarif pris isolément. L’augmentation à répercuter, le cas échant sera alors
simplement plus faible.
En pratique cette cohérence des éléments tarifaires est loin d’être assurée. On
rencontre le plus souvent des structures tarifaires différentes entre l’eau l’assainissement et
la part collectivité et la part délégataire (le cas échéant). Il est donc recommandé de
veiller à cette première harmonisation et de fixer les objectifs de la tarification de l’eau
potable en ligne avec celle de l’assainissement, même si les collectivités compétentes ne
sont pas toujours les mêmes.
Un objectif spécifique aux intercommunalités n’est pas traité dans les scénarios : il
s’agit de l’harmonisation des tarifs entre les communes membres. Cette question se
pose de manière courante dans les communautés qui ont récemment intégré la compétence
eau ou assainissement et qui héritent de tarifs différenciés dans chaque commune membre.
Cette motivation peut aussi entraîner de profondes refontes tarifaires.
Il faut insister enfin sur une étape primordiale dans toute réforme des outils tarifaires qui ne
peut être que partiellement retranscrite dans les fiches de scénario : il faut
systématiquement passer par une simulation de la recette globale du service en
appliquant le nouveau tarif à l’ensemble des profils de consommation du service.
La répartition des consommations, l’évolution des assiettes sont des paramètres
conditionnant pour une structure tarifaire donnée la recette effectivement générée.
L’évolution de la facture 120 m³ est un indicateur, mais il ne faut surtout pas en
déduire mécaniquement l’évolution de la recette globale. Comme on le voit sur les
scénarios, l’augmentation de recette ne sera pas la même suivant le profil des abonnés et la
proportion de chaque type d’abonné conditionne donc l’évolution de la recette globale.
L’élasticité au prix peut alors jouer (c’est d’ailleurs, l’objectif de la tarification incitative)
notamment pour les gros consommateurs et dans ce cas, le calcul de la recette globale,
comme l’impact sur le budget des ménages doivent intégrer cette baisse de consommation.

37
Il ne faut pas non plus oublier qu’il existe d’autres recettes du service que la vente
d’eau aux abonnés : les travaux de branchement, les ventes en gros à d’autres services,
les participations (par exemple Participation pour Voirie et Réseaux qui peut être affectée en
partie à un budget d’eau ou d’assainissement, ou Participation au Raccordement à l’Egout
pour l’assainissement).
333...555... SSSYYYNNNTTTHHHEEESSSEEE DDDEEESSS SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOOSSS
Les trois tableaux qui suivent présentent respectivement pour les 5 évolutions tarifaires
envisagées :
� les objectifs recherchés et les effets pervers à anticiper ;
� l’impact (exprimé en terme qualitatif) sur la facture de différents types d’abonnés et
sur la recette globale du service ;
� les cas de figure où ces outils tarifaires présentent un intérêt.

38
Description du nouvel outil tarifaire (et de
la situation de départ) Objectif recherché Effet pervers éventuel
1
Augmentation du prix, sur un tarif binôme simple :
Le tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle (au volume consommé).
L’augmentation porte sur la partie proportionnelle.
. Inciter aux économies d’eau en augmentant la facture proportionnellement à la consommation d’eau (objectif environnemental)
. Dégager des recettes supplémentaires (objectif économique)
Les factures augmentent pour tous les abonnés et peuvent finir par représenter un budget non négligeable pour les ménages à revenu modeste (en dépassant le seuil des 4% du revenu du ménage).
2
Augmentation du prix et passage d’un tarif binôme simple à un tarif progressif :
Le nouveau tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures coutent plus cher).
L’augmentation porte sur les tranches supérieures
. Inciter fortement aux économies d’eau en augmentant la facture d’autant plus fortement que l’on est dans des tranches de consommation élevée (objectif environnemental)
. Dégager des recettes supplémentaires (objectif économique) (mais voir effet pervers par rapport à l’élasticité des gros consommateurs).
. Selon la limite des tranches, les catégories d’abonnés touchés par la hausse varient
. La mise en place d’une tranche « sociale » (1ère tranche peu chère) et l’augmentation importante des autres tranches peut manquer son objectif pour les familles nombreuses ou pour l’habitat social collectif.
. Des tranches élevées pour les grosses consommations peuvent engendrer une baisse des consommations industrielles et infléchir les recettes du service.
3
Baisse de la partie fixe :
L’abonnement est baissé pour passer en-dessous du seuil de 40 (ou 30)% à partir d’un tarif binôme simple.
Pour maintenir le niveau de recette, la partie proportionnelle est augmentée
. Respecter les nouvelles obligations de la LEMA (exception possible dans les communes touristiques)
. Inciter aux économies d’eau (objectif environnemental)
Plus de difficulté à couvrir les charges fixes du service si la consommation est moins importante que prévue (équilibre financier moins garanti)
4
Passage d’une tarification dégressive à une tarification progressive :
Le nouveau tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures coutent plus cher).
. Respecter les préconisations de la LEMA dans les zones de répartition des eaux
. Inciter fortement aux économies d’eau les gros consommateurs qui sont le plus touchés par le changement de tarif (objectif environnemental)
. Si le tarif des premières tranches est peu / pas baissé, de nouvelles recettes sont générées sur les gros consommateurs (objectif économique)
Des augmentations élevées pour les tranches des gros consommateurs peuvent engendrer une baisse substantielle des consommations industrielles et à terme infléchir les recettes du service.
5
Mise en place d’une tarification saisonnière à partir d’une tarification binôme simple :
La part du tarif proportionnelle au volume consommé augmente en période de pointe : un m³ consommé en été coute plus cher qu’en hiver
1) Avec une partie fixe classique (pression quantitative estivale, non liée à un pic de population, objectif d’économie d’eau) : inciter aux économies d’eau en période estivale (objectif environnemental)
2) Avec une partie fixe forte (habitat saisonnier, objectif de couverture des coûts fixes) :
. équilibrer les charges fixes importantes (surdimensionnement pour la période de pointe) et faire contribuer équitablement les abonnés saisonniers (objectif économique)
. inciter aux économies d’eau (objectif environnemental)
Coût de la double relève (ou de la mise en place de la télérelève)

39
Impact sur la facture des abonnés
Description du nouvel outil tarifaire et de la situation de départ
Domestique
consommation
faible
Domestique
consommation forte Gros consommateur
Impact sur la recette globale du service
(le cas échéant)
+ ++ +++
1
Augmentation du prix, sur un tarif binôme simple
Tous les abonnés subissent une augmentation de leur facture.
Par construction, cette augmentation est proportionnelle au volume consommée : en valeur absolue elle est donc d’autant plus forte que l’on
consomme plus.
En valeur relative (rapporter à la consommation) elle est la même pour tous.
+
L’augmentation de recette est facile à estimer, elle est égale à l’augmentation de la part proportionnelle multipliée par le volume vendu (en tenant compte, le cas échéant des baisses de consommation liée à l’élasticité au
prix mais aussi des augmentations de population éventuelles)
neutre ou + ou -
suivant l’évolution des premières tranches
++ +++
2
Augmentation du prix et passage d’un tarif binôme simple à un tarif progressif
Le tarif progressif augmente plus fortement la contribution des gros
consommateurs.
Suivant le calage des tranches les catégories de consommateurs qui
supportent une augmentation ne sont pas les mêmes (tranche sociale,
tranche industrielle…)
+
L’augmentation de recette est difficile à estimer : elle doit tenir compte du profil des
consommations de tous les abonnés et intégrer les éventuelles inflexions de
consommation (élasticité au prix des gros consommateurs)

40
Impact sur la facture des abonnés
Description du nouvel outil tarifaire et de la situation de départ
Domestique
consommation
faible
Domestique
consommation forte Gros consommateur
Impact sur la recette globale du service
(le cas échéant)
- ou neutre neutre ou + ++
3
Baisse de la partie fixe et augmentation de la part proportionnelle à partir d’un tarif binôme simple
Suivant la proportion relative de la baisse de la partie fixe et de l’augmentation de la partie proportionnelle, l’impact sur les faibles consommations sera une baisse ou une stabilité de la facture.
Cependant dans des cas extrêmes (augmentation importante de la partie proportionnelle pour générer des recettes supplémentaires) même les
petits consommateurs peuvent voir leur facture augmenter.
- ou neutre ou +
Tous les cas de figure sont possibles suivant que la baisse de la partie fixe est
contrebalancée ou non par l’augmentation de la partie proportionnelle du tarif.
Une analyse détaillée est nécessaire en fonction du profil de consommation de chaque
abonné et en anticipant les évolutions d’assiette (effet démographique ou élasticité)
- ou neutre +++ ++++
4
Passage d’une tarification dégressive à une tarification progressive Suivant la limite des tranches et l’évolution des premières tranches,
cette évolution peut être neutre ou générer une diminution de facture pour les petits consommateurs.
Par contre, les gros consommateurs subissent de plein fouet l’augmentation.
++
L’augmentation de recette est difficile à estimer : elle doit tenir compte du profil des
consommations de tous les abonnés et intégrer les éventuelles inflexions de
consommation (élasticité au prix des gros consommateurs)
Abonné permanent
neutre ou -
Abonné saisonnier
++
Gros consommateur permanent
neutre ou -
5
Mise en place d’une tarification saisonnière à partir d’une tarification binôme simple
Généralement l’objectif est d’alléger la facture des abonnés permanents par une plus forte contribution des abonnés saisonniers.
Toutefois, dans un contexte ou le service doit augmenter sa recette, ce type de tarification peut ne pas répercuter de baisse de facture pour les permanents (baisse du tarif en hiver, contrebalancée par la hausse en été pour une répartition de consommation typique d’un abonné permanent).
neutre ou +
L’évolution de recette dépend de l’équilibre entre augmentation du tarif en période de pointe et baisse du tarif hors pointe et
également de la répartition des volumes sur ces deux périodes.
Une analyse détaillée est nécessaire en fonction du profil de consommation de chaque abonné (sur chaque période) et en anticipant les évolutions d’assiette (effet démographique
ou élasticité en période de pointe)

41
Description du nouvel outil tarifaire
(et de la situation de départ) Commune typique concernée (exemple)
1
Augmentation du prix, sur un tarif binôme simple :
Le tarif comporte une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle (au volume consommé).
L’augmentation porte sur la partie proportionnelle.
Collectivité soumise à des contraintes fortes en termes d’augmentation des investissements et des coûts d’exploitation : développement démographique, pression sur la ressource, zone sensible
2
Augmentation du prix et passage d’un tarif binôme simple à un tarif progressif :
Le nouveau tarif comporte une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures sont plus chers).
L’augmentation porte sur les tranches supérieures
Collectivité soumise à des contraintes environnementales fortes : zone de répartition des eaux ; ressource limitée ; zone sensible
Investissements probables (augmentation de l’adduction d’eau potable, augmentation du niveau de traitement de la station d’épuration)
3
Baisse de la partie fixe :
L’abonnement est baissé pour passer en-dessous du seuil de 40 (ou 30)% à partir d’un tarif binôme simple.
Pour maintenir le niveau de recette, la partie proportionnelle est augmentée
Commune non touristique dont le tarif n’est pas conforme à la LEMA (plafonnement partie fixe)
4
Passage d’une tarification dégressive à une tarification progressive :
Le nouveau tarif comporte une part fixe (abonnement) et une part proportionnelle progressive (les volumes consommés dans les tranches supérieures sont plus cher).
Collectivité soumise à des contraintes environnementales fortes : zone de répartition des eaux (LEMA interdit le tarif dégressif), ressource limitée, zone sensible
Investissements probables (augmentation de l’adduction d’eau potable, augmentation du niveau de traitement de la station d’épuration)
5
Mise en place d’une tarification saisonnière à partir d’une tarification binôme simple :
La part du tarif proportionnelle au volume consommé augmente en période de pointe : un m³ consommé en été coute plus cher qu’en hiver
1) Avec une partie fixe classique (pression quantitative estivale, non liée à un pic de population, objectif d’économie d’eau)
. collectivité soumise à des contraintes environnementales saisonnières
. pression quantitative estivale, non liée à un pic de population, mais plutôt à une ressource limitée
2) Avec une partie fixe forte (habitat saisonnier, objectif de couverture des coûts fixes)
. collectivité touristique (littorale) soumise à des contraintes saisonnières
. pic de population estival nécessitant un surdimensionnement de tous les équipements : difficulté à équilibrer le service par les seuls abonnés permanents
. éventuellement pression ressource limitée en été

42
333...666... FFFIIICCCHHHEEESSS DDDEEE SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOO
NB : Ces fiches pouvant être extraites du rapport et présentées de manière autonome,
certaines informations (par exemple précaution pour passer l’évolution de la recette globale)
sont répétées à chaque scénario ou bien sont redondantes par rapport à d’autres parties du
rapport.

43
Cas 1 : Augmenter la part proportionnelle d’un tarif binôme (comportant une partie fixe et une partie proportionnelle à
la consommation)
La situation de départ et le nouveau tarif proposé
Le service (eau et assainissement) applique un tarif binôme, c'est-à-dire composé d’une
partie fixe (parfois appelée « abonnement », ou « location des compteurs ») quel que soit le
volume consommé et d’une partie variable, strictement proportionnelle au volume
consommé.
Le nouveau tarif consiste à augmenter la partie proportionnelle pour générer une
augmentation des recettes.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
L’équilibre financier d’un service d’eau (dépenses couvertes par les recettes du service) est
un principe qui s’impose à la fois pour les services gestionnaires délégataire (l’entreprise
cherche à couvrir ses coûts) et pour les collectivités locales (principe d’équilibre des budgets
annexe de l’eau). La loi sur l’eau de décembre 2006 est venue renforcer l’obligation en
soulignant la notion de couverture des coûts du service par ses usagers.
Ainsi, dans un contexte d’augmentation des coûts, un service d’eau sera contraint à
augmenter ses recettes et donc en premier lieu le tarif appliqué aux abonnés.
Cette augmentation des coûts peut concerner trois cas de figure :
1) Améliorer la stricte couverture des coûts (couvrir l’ensemble des charges d’exploitation et
d’investissement sans sous-estimation, ni subventions croisées),
2) Financer les mesures environnementales pour atteindre le bon état écologique (par
exemple renforcer le niveau de traitement d’une station d’épuration, ou bien augmenter le
renouvellement des canalisations d’eau potable pour limiter les fuites).
3) Financer des renforcements des infrastructures du service (par exemple raccorder un
nouveau lotissement éloigné du centre ville, qui va nécessiter un investissement lourd par
rapport aux nouvelles recettes).
En ordre de grandeur indicatif, chacune de ces causes cumulées pourrait engendrer un
surcoût dépassant largement 1 €/m³ sur la facture totale. Ce chiffre n’est en aucun cas
généralisable et dépend du contexte de chaque service, mais il permet de caler le
scénario : l’augmentation médiane du tarif eau plus assainissement est fixée à 0,50 €/m³ et
l’augmentation forte à 1 €/m³. Rappelons qu’en 2004, la facture standard (base 120 m³)
moyenne en France toutes taxes et redevances incluses est de l’ordre de 3,01 €/m³9, elle
9 Source : IFEN, tous modes de gestion confondus. Pour 2006, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’eau, donne une moyenne de 3,23 €/m³, chiffre portant uniquement sur des services délégués.

44
était de 2,79 €/m³ en 2005 dans le bassin RMC10 et en 2006 de 2,23 €/m³ dans la zone
Ouest Hérault11.
Objectif poursuivi
Equilibrer le financement du service en intégrant tous les besoins (mesures de
protection de l’environnement, renforcement des infrastructures, couverture de l’ensemble
des coûts).
En augmentant la partie proportionnelle plutôt que la partie fixe, on incite également aux
économies d’eau, ce qui est encouragé par la loi sur l’eau. D’ailleurs, la loi sur l’eau plafonne
le montant de la partie fixe (sauf pour les communes touristiques).
10 Source : agence de l’eau RMC. 11 Source : phase 1 de la présente étude, il s’agit pour ce dernier chiffre d’une moyenne non pondérée par les volumes, mais pondéré par le nombre de communes.

45
Illustration 1 : augmentation médiane (+0,50 €/m³)
On passe d’une partie proportionnelle de 1,55 €/m³ à 2,05 €/m³.
Présentation du tarif initial et modifié 1 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable 2,05 €/m³
Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ 296 €/an 2,47 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 17%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an
Facture modifiée 50 €/an 296 €/an 460 €/an 2 100 €/an 20 550 €/an
Variation de la facture
0 €/an 60 €/an 100 €/an 500 €/an 5 000 €/an
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 296 60 0,50 1,6% 2,0% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 460 100 0,50 2,4% 3,1%
120 m³ 236 296 60 0,50 0,6% 0,8% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 460 100 0,50 0,9% 1,2%
1 000 m³ 1 600 2 100 500 0,50 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 20 550 5 000 0,50
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Par construction, tous les abonnés se voient répercuter la même augmentation rapportée à
leur consommation.

46
Illustration 2 : augmentation forte (+1,00 €/m³)
On passe d’une partie proportionnelle de 1,55 €/m³ à 2,55 €/m³.
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation (€/m³) 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale (€/an) 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an
Facture modifiée (€/an) 50 €/an 356 €/an 560 €/an 2 600 €/an 25 550 €/an
Variation de la facture (€/an)
0 €/an 120 €/an 200 €/an 1 000 €/an 10 000 €/an
Impact du changement de tarif 2 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu
annuel (€)
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 356 120 1,00 1,6% 2,4% Foyer domestique à revenu modeste
15 000 €/an 200 m³ 360 560 200 1,00 2,4% 3,7%
120 m³ 236 356 120 1,00 0,6% 0,9% Foyer domestique à revenu élevé
76 000 €/an 200 m³ 360 560 200 1,00 0,9% 1,5%
1 000 m³ 1 600 2 600 1 000 1,00 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 25 550 10 000 1,00
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Pour les abonnés à revenu modeste, la facture d’eau représente de l’ordre de 2,4 à 3,7 % de
leur revenu soit environ 0,8 à 1,3 points supplémentaires.
Présentation du tarif initial et modifié 2 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable 2,55 €/m³
Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ 356 €/an 2,97 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 14%

47
Conclusion : augmenter la partie proportionnelle
Facture d'eau en fonction de la consommation : augmentation de
la partie proportionnelle d'un tarif binôme
0
100
200
300
400
500
600
0 50 100 150 200 250 300Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Tarif de départ :binôme
Tarif modifié :augmentation partieproportionnelle
L’augmentation de la partie proportionnelle impact de manière uniforme chaque mètre cube
vendu. La facture de l’ensemble des abonnés augmente proportionnellement à leur
consommation. Ce tarif ne favorise pas un profil de consommateur par rapport à
l’autre.
Le principal intérêt de cette nouvelle tarification est d’augmenter les recettes
(couverture des coûts).
Avec l’augmentation de la facture, on peut aussi espérer un léger effet incitatif aux
économies d’eau (élasticité), mais toutefois il faut toujours relativiser : la facture d’eau
reste une dépense peu importante par rapport à d’autres (essence, nourriture…) et comme
le montre les illustrations, sa part dans le revenu des ménages reste faible. De plus la
consommation d’eau répond à un besoin de première nécessité et il existe une
consommation incompressible pour les abonnés domestiques. L’effet peut être par contre
plus fort pour les gros consommateurs.
Il faut tenir compte de ce possible effet d’infléchissement de l’assiette dans le calage du
nouveau tarif : dans la simulation de la recette du service avec le nouveau tarif (qui
est une étape impérative avant toute modification tarifaire), il faut prendre en
compte le profil complet des consommations (consommation individuelle de tous les
abonnés) en intégrant la baisse de certaines consommations et les évolutions du nombre
d’abonnés.

48
Cas 2 : Augmenter le prix et passer d’un tarif binôme simple (une partie fixe et une partie proportionnelle) à un tarif progressif (avec des tranches de consommation)
La situation de départ
Le service (eau et assainissement) applique un tarif binôme, c'est-à-dire composé d’une
partie fixe (parfois appelée « abonnement », ou « location des compteurs ») due quel que
soit le volume consommé et d’une partie variable, strictement proportionnelle au volume
consommé.
Le nouveau tarif consiste créer des tranches progressives : les volumes
consommés dans les tranches supérieures sont facturée plus chers.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
Le tarif progressif est encouragé par la Loi sur l’eau et les milieux aquatique de décembre
2006.
Par ailleurs le service est dans un contexte d’augmentation des coûts.
L’équilibre financier d’un service d’eau (dépenses couvertes par les recettes du service) est
un principe qui s’impose à la fois pour les services gestionnaires délégataire (l’entreprise
cherche à couvrir ses coûts) et pour les collectivités locales (principe d’équilibre des budgets
annexe de l’eau). La loi sur l’eau de décembre 2006 est venue renforcer l’obligation en
soulignant la notion de couverture des coûts du service par ses usagers.
Ainsi, dans un contexte d’augmentation des coûts, un service d’eau sera contraint à
augmenter ses recettes et donc en premier lieu le tarif appliqué aux abonnés.
Cette augmentation des coûts peut concerner trois cas de figure :
1) Améliorer la stricte couverture des coûts (couvrir l’ensemble des charges d’exploitation et
d’investissement sans sous-estimation, ni subventions croisées),
2) Financer les mesures environnementales pour atteindre le bon état écologique (par
exemple renforcer le niveau de traitement d’une station d’épuration, ou bien augmenter le
renouvellement des canalisations d’eau potable pour limiter les fuites).
3) Financer des renforcements des infrastructures du service (par exemple raccorder un
nouveau lotissement éloigné du centre ville, qui va nécessiter un investissement lourd par
rapport aux nouvelles recettes).
En ordre de grandeur indicatif, chacune de ces causes cumulées pourrait engendrer un
surcoût dépassant largement 1 €/m³ sur la facture totale. Ce chiffre n’est en aucun cas
généralisable et dépend du contexte de chaque service, mais il permet de caler le
scénario : l’augmentation médiane du tarif eau plus assainissement est fixée à 0,50 €/m³ et
l’augmentation forte à 1 €/m³. Rappelons qu’en 2006, la facture standard (base 120 m³)
moyenne en France toutes taxes et redevances incluses est de l’ordre de 3,01 €/m³12, elle
12 Source : IFEN, tous modes de gestion confondus. Pour 2006, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’eau, donne une moyenne de 3,23 €/m³, chiffre portant uniquement sur des services délégués.

49
était de 2,79 €/m³ en 2005 dans le bassin RMC13 et en 2006 de 2,23 €/m³ dans la zone
Ouest Hérault14.
Objectif poursuivi
L’objectif ici est double :
1) augmenter les recettes pour équilibrer le financement.
2) inciter aux économies d’eau ; en augmentant le prix des volumes consommés pour
des consommations élevées, on incite l’abonné à limiter sa consommation pour rester dans
les tranches basses.
Dans la première illustration qui suit, on crée des tranches progressives dans une gamme de
consommation domestique, avec une tranche dite « sociale » particulièrement basse, alors
que dans la seconde illustration, on augmente le tarif uniquement pour les tranches de
consommations industrielles. Enfin dans la troisième on crée 5 tranches pour impacter toute
la gamme des consommations, en conservant une tranche « sociale ».
13 Source : agence de l’eau RMC. 14 Source : phase 1 de la présente étude, il s’agit pour ce dernier chiffre d’une moyenne non pondérée par les
volumes, mais pondéré par le nombre de communes.

50
Illustration 1 : tranches progressives impactant les
consommations domestiques (« tranche sociale »)
Présentation du tarif initial et modifié 1 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable 0 à 40 m³ 0,78 €/m³
Partie variable de 41 à 100 m³ 2,10 €/m³
Partie variable plus de 100 m³ 2,55 €/m³
Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ 258 €/an 2,15 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 19%
Facture d'eau en fonction de la consommation : création de
tranches de consommation avec tarif progressif
0 €/an
50 €/an100 €/an
150 €/an200 €/an250 €/an
300 €/an350 €/an
400 €/an450 €/an
500 €/an
0 m³ 50 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³ 250 m³
Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale :binome
Facture modifiée 1 :tranchesprogressivesfavorables auxfaibles
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an
Facture modifiée 50 €/an 258 €/an 462 €/an 2 502 €/an 25 452 €/an
Variation de la facture 0 €/an 22 €/an 102 €/an 902 €/an 9 902 €/an
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 258 22 0,19 1,6% 1,7% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 462 102 0,51 2,4% 3,1%
120 m³ 236 258 22 0,19 0,6% 0,7% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 462 102 0,51 0,9% 1,2%
1 000 m³ 1 600 2 502 902 0,90 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 25 452 9 902 0,99
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)

51
Illustration 2 : tranche progressives impactant les gros
consommateurs
Présentation du tarif initial et modifié 2 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable 0 à 500 m³ 1,55 €/m³
Partie variable de 501 à 3000 m³ 2,05 €/m³
Partie variable plus de 3000 m³ 2,55 €/m³
Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 21%
Facture d'eau en fonction de la consommation : création de
tranches de consommation avec tarif progressif
0 €/an1 000 €/an
2 000 €/an3 000 €/an
4 000 €/an5 000 €/an6 000 €/an
7 000 €/an8 000 €/an
9 000 €/an
0 m³ 1 000m³
2 000m³
3 000m³
4 000m³
5 000m³
Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale :binome
Facture modifiée 2 :tranchesprogressivesimpactant lesvolumes industriels
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation (€/m³) 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale (€/an) 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an
Facture modifiée 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 850 €/an 23 800 €/an
Variation de la facture (€/an) 0 €/an 0 €/an 0 €/an 250 €/an 8 250 €/an
Impact du changement de tarif 2 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu
annuel (€)
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 236 0 0,00 1,6% 1,6% Foyer domestique à revenu modeste
15 000 €/an 200 m³ 360 360 0 0,00 2,4% 2,4%
120 m³ 236 236 0 0,00 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé
76 000 €/an 200 m³ 360 360 0 0,00 0,9% 0,9%
1 000 m³ 1 600 1 850 250 0,25 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 23 800 8 250 0,83
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)

52
Illustration 3 : 5 tranches progressives (tarif social + incitation aux économies d’eau de tous les abonnés)
Ce scénario combine les deux précédents en assurant jusqu’à 120 m³ une facture stable par
rapport à l’ancienne tarification et en introduisant ensuite des tranches progressives
impactant à la fois les volumes domestiques (au-dessus de 100 m³) et les gros
consommateurs.
Présentation du tarif initial et modifié 3 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable 0 à 100 m³ 1,55 €/m³
Partie var. de 101 à 200 m³ 1,75 €/m³
Partie var. de 201 à 3000 m³ 2,00 €/m³
Partie var. de 3001 à 5000 m³ 2,50 €/m³
Partie var. plus de 5000 m³ 3,00 €/m³
Pour 120 m³ 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ 240 €/an 2,00 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 21%
Impact du changement de tarif 3 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 240 4 0,03 1,6% 1,6% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 380 20 0,10 2,4% 2,5%
120 m³ 236 240 4 0,03 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 380 20 0,10 0,9% 1,0%
1 000 m³ 1 600 1 980 380 0,38 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 25 980 10 430 1,04
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)

53
Facture d'eau en fonction de la consommation : création de tranches de
consommation avec tarif progressif
0 €/an
100 €/an
200 €/an
300 €/an
400 €/an
500 €/an
600 €/an
0 m³ 50 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³ 250 m³ 300 m³Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale :binome
Facture modifiée 3 :5 tranchesprogressivesfavorables auxfaiblesconsommations
Illustration graphique sur les consommations de type domestique
Facture d'eau en fonction de la consommation : création de tranches de
consommation avec tarif progressif
0 €/an
2 000 €/an
4 000 €/an
6 000 €/an
8 000 €/an
10 000 €/an
12 000 €/an
14 000 €/an
16 000 €/an
0 m³ 1 000m³
2 000m³
3 000m³
4 000m³
5 000m³
6 000m³
7 000m³
Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale :binome
Facture modifiée 3 :5 tranchesprogressivesfavorables auxfaiblesconsommations
Illustration graphique sur les consommations de type gros consommateurs

54
Conclusion : introduire des tranches progressives
Cette tarification progressive est particulièrement adaptée dans un contexte où la
ressource est limitante : le coût de la ressource supplémentaire est élevé et il est logique
de répercuter un coût plus fort sur les gros consommateurs.
Toutefois, les deux premières illustrations montrent que l’on peut mettre en place deux
types de tarifications progressives répondant à des objectifs légèrement différents.
Dans le premier cas, une première tranche « sociale » permet d’accéder à une
consommation à faible prix. Ensuite, les tranches supérieures augmentent y compris dans
la gamme de consommation domestique.
Il faut toutefois noter un effet pervers de ce type de tarification : la tranche
« sociale » en pratique ne bénéficie pas toujours effectivement aux foyers les plus
modestes. En effet, la consommation d’un retraité aisé vivant seul dans un petit
appartement rentrera dans la tranche sociale alors qu’une famille nombreuse consommera
plus et paiera dans la tranche plus élevée. L’effet pervers est encore plus fort pour une
famille vivant dans un HLM sans individualisation des compteurs : la facture d’eau
répercutée dans les charges est calculée sur le volume de l’ensemble du bâtiment et rentre
donc une tranche élevée…
Dans le second cas, les tranches progressives ont un impact uniquement sur les
fortes consommations : l’augmentation de recette se fait exclusivement auprès de cette
catégorie d’abonnés. L’effet principal est une incitation à baisser les consommations pour les
industriels et autres gros consommateurs.
En pratique, en ajoutant plus de tranches (3ème illustration), on peut faire un tarif
intermédiaire entre ces deux extrêmes. On a alors une progressivité des tranches sur
toute la gamme : domestiques et gros consommateurs.
En variante de ce scénario, on peut tout à fait introduire une tarification par tranche sans
augmenter nécessairement la recette globale du service. Il y a alors simplement un transfert
entre catégories d’usagers.
Si le tarif augmente pour certaines catégories d’abonnés, on peut anticiper une baisse des
consommations. Mais toutefois il faut toujours relativiser : la facture d’eau reste une
dépense peu importante par rapport à d’autres (essence, nourriture…) et comme le montre
les illustrations, sa part dans le revenu des ménages reste faible. De plus la
consommation d’eau répond à un besoin de première nécessité et il existe une
consommation incompressible pour les abonnés domestiques. L’effet peut être par contre
plus fort pour les gros consommateurs.

55
Dans tous les cas de figure, il faudra absolument faire la simulation de la recette
du service avec le nouveau tarif (qui est une étape impérative avant toute
modification tarifaire) : il faut prendre en compte le profil complet des consommations
(consommation individuelle de tous les abonnés) en intégrant la baisse de certaines
consommations, ou au contraire les augmentations d’assiette si le nombre d’abonnés
augmente.

56
Cas 3 : Baisser la partie fixe d’un tarif binôme simple (une partie fixe et une partie proportionnelle)
La situation de départ
Le service (eau et assainissement) applique un tarif binôme, c'est-à-dire composé d’une
partie fixe (parfois appelée « abonnement », ou « location des compteurs ») due quel que
soit le volume consommé et d’une partie variable, strictement proportionnelle au volume
consommé.
Le nouveau tarif consiste à baisser la partie fixe.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 impose une limitation de
la partie fixe dans les factures d’eau et d’assainissement, sauf cas des communes
touristiques.
A partir du 1/01/2008, la part fixe ne peut représenter plus de 40% (50% dans les
communes rurales) de la facture-type de 120 m³, tant pour l’eau que pour l’assainissement.
A partir du 1/01/2010, le plafond sera abaissé à 30% (40% dans les communes rurales).
Objectif poursuivi
L’objectif principal est une incitation aux économies d’eau : plus la facture augmente
avec la consommation, plus les abonnés sont incités à baisser leur consommation.
Par contre, la limitation de la partie fixe rend problématique la couverture des coûts
fixes, qui sont importants dans les services d’eau (poids des infrastructures dans les
charges).

57
Illustration 1 : Baisse de la partie fixe à facture constante pour une consommation de 120 m³
Dans cette première illustration, on ne cherche pas à augmenter la recette : le niveau de la
facture 120 m³ (la plus fréquente en France) est inchangé.
Présentation du tarif initial et modifié 1 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 110 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1 €/m³ Partie variable 1,50 €/m³
Pour 120 m³ 230 €/an 1,92 €/m³ Pour 120 m³ 230 €/an 1,92 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 48% % partie fixe dans facture 120 m³ 22%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 110 €/an 230 €/an 310 €/an 1 110 €/an 10 110 €/an
Facture modifiée 50 €/an 230 €/an 350 €/an 1 550 €/an 15 050 €/an
Variation de la facture
-60 €/an 0 €/an 40 €/an 440 €/an 4 940 €/an
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 230 230 0 0,00 1,5% 1,5% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 310 350 40 0,20 2,1% 2,3%
120 m³ 230 230 0 0,00 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 310 350 40 0,20 0,8% 0,9%
1 000 m³ 1 110 1 550 440 0,44 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 10 110 15 050 4 940 0,49
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Les abonnés consommant plus de 120 m³ sont pénalisés ce qui incite aux économies d’eau.

58
Illustration 2 : Baisse de la partie fixe avec augmentation de la
facture (pour tout client consommant 60 m³ ou plus)
Dans ce scénario, l’objectif consiste également à augmenter les recettes du service pour
couvrir des coûts supplémentaires (investissement de renforcement, financement des
mesures environnementales pour préserver les ressources, couverture des coûts en
général). Cette fois la structure tarifaire est construite de manière à ce que l'augmentation
se fasse sentir pour une consommation de 60 m3 ou plus (cf. graphes infra croisement des
droites à 60 m3).
Présentation du tarif initial et modifié 2 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 110 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1 €/m³ Partie variable 2 €/m³
Pour 120 m³ 230 €/an 1,92 €/m³ Pour 120 m³ 290 €/an 2,42 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 48% % partie fixe dans facture 120 m³ 17%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation (€/m³) 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale (€/an) 110 €/an 230 €/an 310 €/an 1 110 €/an 10 110 €/an
Facture modifiée (€/an) 50 €/an 290 €/an 450 €/an 2 050 €/an 20 050 €/an
Variation de la facture (€/an)
-60 €/an 60 €/an 140 €/an 940 €/an 9 940 €/an
Impact du changement de tarif 2 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu
annuel (€)
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 230 290 60 0,50 1,5% 1,9% Foyer domestique à revenu modeste
15 000 €/an 200 m³ 310 450 140 0,70 2,1% 3,0%
120 m³ 230 290 60 0,50 0,6% 0,8% Foyer domestique à revenu élevé
76 000 €/an 200 m³ 310 450 140 0,70 0,8% 1,2%
1 000 m³ 1 110 2 050 940 0,94 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 10 110 20 050 9 940 0,99
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Presque tous les abonnés voient leur facture augmenter, sauf si leur consommation est très
faible. Le lien entre consommation et montant de la facture est plus fort.

59
Conclusion
Facture d'eau en fonction de la consommation : baisse de la
partie fixe d'un tarif binôme
0
100
200
300
400
500
0 50 100 150 200 250Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Tarif de départ :binôme, avec partiefixe trop importante
Tarif modifié 1 :baisse partie fixesans augmentationde recette (pour 120m³)Tarif modifié 2 :baisse partie fixe etaugmentation desrecettes
En baissant la partie fixe, on avantage les petits consommateurs par rapport aux
gros, ce qui incite aux économies d’eau. Suivant le calage de la partie fixe et de
l’augmentation de la partie proportionnelle le point d’équilibre entre ancienne et nouvelle
facture change et on peut soit diminuer, soit maintenir (cas 1) soit augmenter (cas 2) les
recettes totales du service.
Si le tarif augmente pour certaines catégories d’abonnés, on peut anticiper une baisse des
consommations. Toutefois il faut toujours relativiser : la facture d’eau reste une dépense
peu importante par rapport à d’autres (essence, nourriture…) et comme le montre les
illustrations, sa part dans le revenu des ménages reste faible. De plus la consommation
d’eau répond à un besoin de première nécessité et il existe une consommation
incompressible pour les abonnés domestiques. L’effet peut être par contre plus fort
pour les gros consommateurs.
De nombreux exploitants soulignent une limite de ce type de tarification : en baissant la
partie fixe de leur rémunération, alors que la majorité des charges d’un service
d’eau sont liée à l’existence même du service et non pas à la quantité d’eau
consommée, on pourrait mettre en péril l’équilibre du service. Pourtant on doit
constater que le risque reste limité : le fait, comme cela a été souligné, que la
consommation d’eau soit en grande partie incompressible, permet souvent de maintenir un
bon niveau de recette, même pour sa partie proportionnelle au volume consommé.
Dans tous les cas de figure, il faudra absolument faire la simulation de la recette
du service avec le nouveau tarif (qui est une étape impérative avant toute
modification tarifaire) il faut prendre en compte le profil complet des consommations
(consommation individuelle de tous les abonnés) en intégrant la baisse de certaines
consommations ou au contraire l’augmentation prévisible de l’assiette (croissance des
abonnés).

60
Cas 4 : Passer d’un tarif par tranches, dégressif à un tarif progressif
La situation de départ
Le service (eau et assainissement) applique un tarif dégressif, c'est-à-dire composé d’une
partie fixe (parfois appelée « abonnement », ou « location des compteurs ») due quel que
soit le volume consommé et d’une partie variable, définie par tranches de consommation,
avec une valeur dégressives : les premiers mètres cubes consommé coutent plus chers que
ceux de la tranche suivante, et ainsi de suite.
Un tel tarif correspond à la volonté de répercuter les effets d’échelle sur les gros
consommateurs qui bénéficient d’un tarif plus intéressants. Le plus souvent (et c’est le cas
dans les illustrations ci-dessous) le tarif dégressif vise les industriels : les tranches
correspondent à des consommations largement au-delà de la gamme de consommation
domestique.
Le nouveau tarif consiste à créer des tranches progressives : les volumes
consommés dans les tranches supérieures sont facturée plus chers.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006, prévoit que les
communes dont la ressource est fragile doivent mettre en place une tarification incitative.
Concrètement, si une collectivité mobilise plus de 30% de ses ressources en eau dans une
zone de répartition des eaux (ZRE), elle est concernée. Bien que la loi ne définisse pas ce
qu’est une « tarification incitative » il semble claire qu’une tarification dégressive est exclue.
Il faut alors passer à une tarification binôme (partie proportionnelle uniforme), saisonnière
ou, comme c’est développé ici, à une tarification progressive.
Objectif poursuivi
La tarification progressive vise à inciter aux économies d’eau : plus on consomme, plus le
prix moyen du mètre cube consommé augmente.
Cela peut aussi être un moyen d’augmenter les recettes globales d’un service en
mobilisant les gros consommateurs, qui génèrent un surdimensionnement du service, plus
que les petits.
Cette tarification est donc bien cohérente avec un contexte de ressource limitante, où l’accès
à la ressource supplémentaire est cher et nuit à l’environnement.

61
Illustration 1 : Tranches progressives dans la gamme de
consommation domestique
Dans cette illustration, après une première tranche « sociale », peu chère, le coût du mètre
cube augmente vite. La plupart des factures augmentent.
Présentation du tarif initial et modifié 1 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 0 à 1000 m³ 1,55 €/m³ Partie variable 0 à 40 m³ 0,78 €/m³
Partie variable de 1001 à 5000 m³ 1,30 €/m³ Partie variable de 41 à 100 m³ 2,10 €/m³
Partie variable plus de 5000 m³ 1,00 €/m³ Partie variable plus de 100 m³ 2,55 €/m³
Pour 120 m³ 236
€/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³
258 €/an
2,15 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 19%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 11 800 €/an
Facture modifiée 50 €/an 258 €/an 462 €/an 2 502 €/an 25 452 €/an
Variation de la facture 0 €/an 22 €/an 102 €/an 902 €/an 13 652 €/an
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 258 22 0,19 1,6% 1,7% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 462 102 0,51 2,4% 3,1%
120 m³ 236 258 22 0,19 0,6% 0,7% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 462 102 0,51 0,9% 1,2%
1 000 m³ 1 600 2 502 902 0,90 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 11 800 25 452 13 652 1,37
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)

62
Illustration 2 : Tranches progressives dans la gamme de grosse
consommation
Les tranches commencent à partir de 500 m³/an : seuls les gros consommateurs sont
affectés.
Présentation du tarif initial et modifié 2 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 0 à 1000 m³ 1,55 €/m³ Partie variable 0 à 500 m³ 1,55 €/m³
Partie variable de 1001 à 5000 m³ 1,30 €/m³ Partie variable de 501 à 3000 m³ 2,05 €/m³
Partie variable plus de 5000 m³ 1,00 €/m³ Partie variable plus de 3000 m³ 2,55 €/m³
Pour 120 m³ 236
€/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³
236 €/an
1,97 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ 21%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation (€/m³) 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale (€/an) 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 11 800 €/an
Facture modifiée 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 850 €/an 23 800 €/an
Variation de la facture (€/an)
0 €/an 0 €/an 0 €/an 250 €/an 12 000 €/an
Impact du changement de tarif 2 sur des abonnés types Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu
annuel (€)
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 236 0 0,00 1,6% 1,6% Foyer domestique à revenu modeste
15 000 €/an 200 m³ 360 360 0 0,00 2,4% 2,4%
120 m³ 236 236 0 0,00 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé
76 000 €/an 200 m³ 360 360 0 0,00 0,9% 0,9%
1 000 m³ 1 600 1 850 250 0,25 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 11 800 23 800 12 000 1,20
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)

63
Conclusion
Les deux illustrations montrent l’importance du calage des tranches.
Dans le premier cas, les tranches commencent dans une gamme de consommation
domestique. Dans le second cas, les tranches concernent exclusivement les gros
consommateurs.
Comme on le voit, la première illustration incite aux économies, y compris les abonnés
domestiques, alors que la seconde ne modifie la facture que des industriels qui se trouvent
alors largement mis à contribution.
Facture d'eau en fonction de la consommation : passage d'un tarif
dégressif à progressif (zoom faible consommations)
0 €/an
100 €/an
200 €/an
300 €/an
400 €/an
500 €/an
0 m³ 50 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³ 250 m³Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale
Facture modifiée 1
Facture modifiée 2
Facture d'eau en fonction de la consommation : passage d'un tarif
dégressif à progressif (zoom fortes consommations)
0 €/an
5 000 €/an
10 000 €/an
15 000 €/an
20 000 €/an
0 m³ 2 000 m³ 4 000 m³ 6 000 m³ 8 000 m³Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale
Facture modifiée 1
Facture modifiée 2
Dans le premier cas, une première tranche « sociale » permet d’accéder à une
consommation à faible prix. Ensuite, les tranches supérieures augmentent pour des
volumes usuels dans la gamme domestique.
Il faut toutefois noter un effet pervers de ce type de tarification : la tranche
« sociale » en pratique ne bénéficie pas toujours effectivement aux foyers les plus
modestes. En effet, la consommation d’un retraité aisé vivant seul dans un petit
appartement rentrera dans la tranche sociale alors qu’une famille nombreuse consommera

64
plus dans les fortes tranches. L’effet pervers est encore plus fort pour une famille vivant
dans un HLM sans individualisation des compteurs : la facture d’eau répercutée dans les
charges est calculée sur le volume de l’ensemble du bâtiment et rentre donc une tranche
élevée…
Dans le second cas, les tranches progressives ont un impact uniquement sur les
fortes consommations : l’augmentation de recette se fait exclusivement auprès de cette
catégorie d’abonnés. L’effet principal est une incitation à baisser les consommations pour les
industriels et autres gros consommateurs.
En pratique, en ajoutant plus de tranches, on peut faire un tarif intermédiaire entre
ces deux extrêmes. On a alors une progressivité des tranches sur toute la gamme :
domestiques et gros consommateurs.
Si le tarif augmente pour certaines catégories d’abonnés, on peut anticiper une baisse des
consommations. Mais toutefois il faut toujours relativiser : la facture d’eau reste une
dépense peu importante par rapport à d’autres (essence, nourriture…) et comme le montre
les illustrations, sa part dans le revenu des ménages reste faible. De plus la
consommation d’eau répond à un besoin de première nécessité et il existe une
consommation incompressible pour les abonnés domestiques. L’effet peut être par contre
plus fort, comme on l’a dit, pour les gros consommateurs.
Dans tous les cas de figure, il faudra absolument faire la simulation de la recette
du service avec le nouveau tarif (qui est une étape impérative avant toute
modification tarifaire) ; il faut prendre en compte le profil complet des consommations
(consommation individuelle de tous les abonnés) en intégrant la baisse de certaines
consommations, ou au contraire les augmentations d’assiette si le nombre d’abonnés
augmente.

65
Cas 5 : Introduire une tarification saisonnière
La situation de départ
Le service (eau et assainissement) applique un tarif binôme, c'est-à-dire composé d’une
partie fixe (parfois appelée « abonnement », ou « location des compteurs ») due quel que
soit le volume consommé et d’une partie variable, strictement proportionnelle au volume
consommé.
Le nouveau tarif consiste à moduler le montant de la part proportionnelle au cours
de l’année : durant les 4 mois d’été (haute saison), la part proportionnelle sera
plus élevée que durant les 8 mois restant.
Un tel tarif suppose d’instaurer un double relevé des compteurs (en début et en fin de haute
saison). La mise en place d’une télérelève peut faciliter sa mise en œuvre sur le terrain.
Les motivations pour faire évoluer le tarif
Même si ce type de tarification était déjà mis en œuvre dans quelques rares services, la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006 lui a donné une légitimité
supplémentaire en prévoyant explicitement que, notamment lorsque l’équilibre entre
ressource et consommation est menacé de façon saisonnière, une tarification saisonnière
peut être instituée. La tarification saisonnière rentre dans la catégorie des tarifications
incitatives qui doivent être mise en œuvre obligatoirement dans les zones où la ressource
est vulnérable (30% de la ressource provenant d’une zone de répartition des eaux).
La tarification saisonnière peut aussi être considérée comme une tarification incitative : la
LEMA en effet impose une tarification initiative dans les zones où la ressource est menacée
(zones de répartition des eaux).
Objectif poursuivi
La tarification saisonnière peut répondre à deux objectifs :
1) La collectivité ne dispose pas de ressources suffisante en été pour assurer la
sécurité de la ressource. Il est impératif d’inciter aux économies d’eau.
Dans ce contexte, une augmentation de la tarification en été peut inciter aux économies
d’eau, pendant la période critique (écrêter la demande de pointe).
2) La collectivité connait une forte fréquentation saisonnière qui oblige à sur-
dimensionner les infrastructures.
Avec une tarification binôme classique, les habitants saisonniers consommant bien moins
que les permanents ne contribuent pas aux recettes du service en proportion avec les
charges supplémentaires que leur présence saisonnière rend nécessaire.

66
La tarification saisonnière permet de les faire contribuer plus fortement (répartir
équitablement les charges fixes sur la totalité des usagers) : l’équilibre financier du service
est alors mieux réparti.
Illustration 1 : Tarification saisonnière adaptée au cas d’une ressource limitée en été
Facture d'eau en fonction de la consommation : Création d'un tarif
saisonnier (binôme)
0 €/an
100 €/an
200 €/an
300 €/an
400 €/an
500 €/an
600 €/an
700 €/an
0 m³ 100 m³ 200 m³ 300 m³ 400 m³Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale
Facture modifiéeconsomation type"permanant"*
Facture modifiéeconsommationsaisonnier**
Présentation du tarif initial et modifié 1 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 50 €/an
Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable haute saison 2,05 €/m³ Partit variable basse saison 0,75 €/m³
Pour 120 m³ ab. perm. 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ ab. perm. 218 €/an 1,82 €/m³ Pour 60 m³ ab. saisonnier 143 €/an 2,38 €/m³ Pour 60 m³ ab. saisonnier 173 €/an 2,88 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ (hab. permanent) 23%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an Facture modifiée consommation type "permanant"*
50 €/an 218 €/an 330 €/an 1 450 €/an 14 050 €/an
Facture modifiée consommation saisonnier**
50 €/an 296 €/an 460 €/an 2 100 €/an 20 550 €/an
Variation de la facture abonné permanent
0 €/an -18 €/an -30 €/an -150 €/an -1 500 €/an
Variation de la facture abonné saisonnier
0 €/an 60 €/an 100 €/an 500 €/an 5 000 €/an
*50% de la consommation en période haute saison et 50% de la consommation en période basse saison **100% de la consommation en haute saison

67
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types (permanents) Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 218 -18 -0,15 1,6% 1,5% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 330 -30 -0,15 2,4% 2,2%
120 m³ 236 218 -18 -0,15 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 330 -30 -0,15 0,9% 0,9%
1 000 m³ 1 600 1 450 -150 -0,15 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 14 050 -1 500 -0,15
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Impact du changement de tarif 1 sur des abonnés types (saisonniers) Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 296 60 0,50 1,6% 2,0% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 460 100 0,50 2,4% 3,1%
120 m³ 236 296 60 0,50 0,6% 0,8% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 460 100 0,50 0,9% 1,2%
1 000 m³ 1 600 2 100 500 0,50 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 20 550 5 000 0,50
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Hypothèse : consommation d’un abonné permanent répartie à 50% entre haute et basse
saison, consommation d’un abonné saisonnier à 100% en haute saison.
On constate que les abonnés permanents bénéficient d’une baisse de facture alors que les
saisonniers voient leur facture augmenter.
L’augmentation est d’autant plus forte que la consommation est faite en période de haute
saison.
Si les augmentations de facture pour le profil « saisonnier » semblent importantes
pour les gros consommateurs, il faut retenir que les saisonniers en général
n’atteignent pas ces niveaux de consommation.

68
Illustration 2 : Tarification saisonnière adaptée au cas d’une commune avec forte fréquentation saisonnière
Plus que l’incitation aux économies d’eau, l’objectif est ici de plus faire contribuer les
abonnés saisonniers qui entraînent un surdimensionnement des équipements difficile à
assumer financièrement par les abonnés permanent. La LEMA prévoit alors la possibilité de
dépasser le seuil de 50% de partie fixe dans la facture 120 m³. La tarification saisonnière
est donc ici couplée à une forte partie fixe.
Facture d'eau en fonction de la consommation : Création d'un tarif
saisonnier (binôme) avec forte augmentation de la partie fixe
0 €/an
100 €/an
200 €/an
300 €/an
400 €/an
500 €/an
600 €/an
700 €/an
0 m³ 100 m³ 200 m³ 300 m³ 400 m³Volume annuel consommé (m³/an)
Facture annuelle
(€/an)
Facture initiale
Facture modifiéeconsomation type"permanant"*
Facture modifiéeconsommationsaisonnier**
Présentation du tarif initial et modifié 2 Tarif Initial Tarif Modifié
Partie fixe 50 €/an Partie fixe 120 €/an Partie variable 1,55 €/m³ Partie variable haute saison 1 €/m³
Partit variable basse saison 0,7 €/m³
Pour 120 m³ hab. perm. 236 €/an 1,97 €/m³ Pour 120 m³ hab. perm. 222 €/an 1,85 €/m³ Pour 60 m³ hab. saisonnier 143 €/an 2,38 €/m³ Pour 60 m³ hab. saisonnier 180 €/an 3,00 €/m³
% partie fixe dans facture 120 m³ 21% % partie fixe dans facture 120 m³ (hab. permanent) 54%
Facture eau + assainissement hors taxes et redevances
Consommation 0 m³ 120 m³ 200 m³ 1 000 m³ 10 000 m³
Facture initiale 50 €/an 236 €/an 360 €/an 1 600 €/an 15 550 €/an Facture modifiée consommation type "permanent"*
120 €/an 222 €/an 290 €/an 970 €/an 8 620 €/an
Facture modifiée consommation saisonnier**
120 €/an 240 €/an 320 €/an 1 120 €/an 10 120 €/an
Variation de la facture abonné permanent
70 €/an -14 €/an -70 €/an -630 €/an -6 930 €/an
Variation de la facture abonné saisonnier
70 €/an 4 €/an -40 €/an -480 €/an -5 430 €/an
*50% de la consommation en période haute saison et 50% de la consommation en période basse saison **100% de la consommation en haute saison

69
Impact du changement de tarif 2 sur des abonnés types (permanents) Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 222 -14 -0,12 1,6% 1,5% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 290 -70 -0,35 2,4% 1,9%
120 m³ 236 222 -14 -0,12 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 290 -70 -0,35 0,9% 0,8%
1 000 m³ 1 600 970 -630 -0,63 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 8 620 -6 930 -0,69
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Impact du changement de tarif sur des abonnés types (saisonniers) Part de la
facture dans le revenu Type
d'abonné Revenu annuel
Consom-mation annuelle
Facture initiale (€/an)
Facture modifiée (€/an)
Variation de la
facture (€/an)
Variation en €/m³
consommé % facture initiale
% facture modifiée
120 m³ 236 240 4 0,03 1,6% 1,6% Foyer domestique à revenu modeste*
15 000 €/an 200 m³ 360 320 -40 -0,20 2,4% 2,1%
120 m³ 236 240 4 0,03 0,6% 0,6% Foyer domestique à revenu élevé**
76 000 €/an 200 m³ 360 320 -40 -0,20 0,9% 0,8%
1 000 m³ 1 600 1 120 -480 -0,48 Gros consommateur (industriel, camping,
agriculteur, municipal…) 10 000 m³ 15 550 10 120 -5 430 -0,54
* Foyer avec un salaire employé ou ouvrier (moyenne Languedoc Roussillon) ** Foyer avec deux salaires cadre (moyenne Languedoc Roussillon)
Hypothèse : consommation d’un abonné permanent répartie à 50% entre haute et basse
saison, consommation d’un abonné saisonnier à 100% en haute saison.

70
Conclusion
Dans la première illustration, la priorité est l’économie d’eau : tous les usagers
saisonniers voient leur facture augmenter.
Le nouveau tarif est légèrement redistributif car les abonnés permanents voient par contre
leur facture diminuer un peu.
Dans la seconde illustration, la tarification saisonnière est couplée à
l’augmentation de la partie fixe : c’est un autre moyen de faire contribuer plus fortement
les abonnés saisonniers. On constate que l’effet redistributif est plus fort : les abonnés
saisonniers, qui consomment généralement peu (moins de 120 m³) voient leur facture
sensiblement augmenter. Par contre les permanents (qui consomment généralement au
moins 120 m³) voient leur facture baisser.
Les plus gros bénéficiaires sont les gros consommateurs qui ont une consommation répartir
sur l’année ou mieux, une consommation limité en été (typiquement les usines qui ferment
en été).
Ces deux illustrations font apparaître un dilemme : soit la tarification saisonnière incite
à baisser les consommations, mais on risque de limiter les recettes alors que les charges
fixes sont élevées, soit on assure une meilleure répartition de la couverture des coûts fixes
entre les abonnés permanents et saisonniers, mais lors on incite moins les permanents aux
économies d’eau.
En pratique lorsqu’une commune veut à la fois inciter aux économies et mieux
répartir la charge entre les abonnés permanents et saisonniers, elle peut coupler la
tarification saisonnière, la forte partie fixe et une tarification par tranche
progressive.
La règlementation autorise également la facturation de la partie fixe en tenant
compte du nombre de logements desservis par le branchement. Un tel principe
permet de faire contribuer plus fortement les résidences de vacances. Attention toutefois, il
doit alors s’appliquer à tous les logements collectifs (égalité des usagers).
Si le tarif augmente pour certaines catégories d’abonnés, on peut anticiper une baisse des
consommations. Mais toutefois il faut toujours relativiser : la facture d’eau reste une
dépense peu importante par rapport à d’autres (essence, nourriture…) et comme le montre
les illustrations, sa part dans le revenu des ménages reste faible. De plus la
consommation d’eau répond à un besoin de première nécessité et il existe une
consommation incompressible pour les abonnés domestiques. L’effet peut être par contre
plus fort pour les gros consommateurs.
Dans tous les cas de figure, il faudra absolument faire la simulation de la recette
du service avec le nouveau tarif (qui est une étape impérative avant toute
modification tarifaire) il faut prendre en compte le profil complet des consommations
(consommation individuelle de tous les abonnés) en intégrant la baisse de certaines
consommations, ou au contraire les augmentations d’assiette si le nombre d’abonnés
augmente.

71
3 CONCLUSION
La mise en œuvre des principes promus par la LEMA (et à travers elle par la DCE) va avoir à
moyen terme un impact sensible sur les services d’eau sous plusieurs formes.
Objectifs poursuivis Probables effets induits pour les services
Financement des mesures contribuant à l’atteinte
du bon état
Augmentation des coûts d’exploitation
Incitations aux économies d’eau Diminution des assiettes (à population constante)
Amélioration du niveau de traitement des eaux
usées (effort de mise aux normes)
Augmentation des coûts d’exploitation
Recherche de la couverture des coûts Augmentation des prix (par rééquilibrage entre
recettes et dépenses)
Révision de la structure tarifaire Evolution de la structure des consommations avec
tendance à la diminution des assiettes
Cette loi oblige à coordonner deux mondes qui coexistent sur des territoires communs mais
des échelles différentes :
� les bassins versants et « les gestionnaires des milieux » d’un côté (SAGE, SDAGE,
contrat de rivière) ;
� les services d’eau et d’assainissement municipaux ou intercommunaux et les exploitants
de ces services de l’autre (contrat de délégation ou régie).
Avec les mesures à prendre (nouvelles ZRE, nouvelles mesures, couverture des coûts), on
peut s’attendre dans les années qui viennent à des augmentations de coût et donc du prix
de l’eau dans certains services, d’autant que, dans la zone Ouest Hérault, la croissance
démographique pourrait conduire, malgré les efforts d’économie d’eau, à maintenir la
pression sur la ressource.
Toutefois, le contexte est hétérogène au sein de la zone ouest Hérault en terme d’accès à la
ressource, de densité de population (et donc d’effets d’échelle sur les coûts), de richesse de
la population (acceptabilité d’une augmentation de la facture), de pression saisonnière, etc.
Les évolutions de prix ne seront pas les mêmes partout et leur ordre de grandeur est
impossible à estimer dans le cadre de cette étude qui, bien que s’appuyant sur une enquête
tarifaire, visait seulement à présenter les évolutions des outils tarifaires intéressants, dans
ce contexte. On s’aperçoit à la lecture des illustrations que toute réforme de la structure
tarifaire nécessite une analyse et une réflexion à l’échelle de chaque service (situation
propre, patrimoine, état de la dette, coût d’exploitation, etc.).
Il faut tout d’abord choisir la forme du tarif qui répondra le mieux aux objectifs fixés.
Pour que les incitations souhaitées soient clairement perçues par l’abonné, il faut également
mettre en cohérence toutes les parts du tarif de l’eau sur lesquelles la collectivité a un

72
pouvoir de décision (part collectivité et part délégataire pour l’eau potable et pour
l’assainissement) : en effet, si les incitations sont contradictoires, elles perdent tout
efficacité puisque l’abonné reçoit une seule et même facture pour toutes ces parts.
Il faut ensuite avoir une vision claire des besoins futurs du service en termes
d’investissement à réaliser, de mode de financement (recours ou non à l’autofinancement,
etc.) et d’évolution des assiettes (quelles consommations dans les 10 à 15 années à venir,
compte tenu par exemple des projections démographiques, etc.).
Une fois déterminés les projets et les besoins de financement à couvrir par le prix de l’eau,
et seulement alors, la détermination du tarif est possible puisque le niveau de recettes à
atteindre est connu.
La construction du nouveau tarif se conclut par une simulation précise de la recette
générée : il faut tenir compte de la structure de consommation de chaque abonné (la
projection de l’évolution de la recette globale sur la base de la projection de l’évolution de la
facture pour 120 m³ est fausse dans presque tous les cas !).
Il faudra aussi, et c’est plus difficile à cerner, intégrer un éventuel effet d’élasticité qui
viendrait limiter les consommations, du fait même de l’augmentation de la facture pour
certain type d’abonnés (notamment les gros consommateurs).
Cette démarche de réforme tarifaire s’inscrit dans un cadre plus large.
Dans une approche sociale, on perçoit que la part de la facture d’eau pourrait franchir pour
certains abonnés le seuil d’acceptabilité c'est-à-dire de part du revenu des ménages mobilisé
pour supporter la facture d’eau15.
Enfin, dans une approche économique et territoriale, la répercussion du coût des mesures
contribuant à l’objectif de bon état des eaux va bien au-delà des outils tarifaires qui
interviennent à l’échelle des services d’eau. Certaines mesures concernent plusieurs usages
au sens de la directive-cadre et ont des répercussions au sein du bassin versant. Quelles
seront les modalités de répercussion des mesures mises en œuvre à cette échelle ? La
question des mécanismes financiers et de la solidarité au niveau des bassins se posera donc
aussi probablement à court ou moyen terme.
15 Dans les actes de Lille IV, 2004 (Analyse économique et Directive cadre), l’économiste de la Banque Mondiale Anil Markandya indique que 4% représente le seuil maximum que devrait constituer la facture de l’eau (eau + assainissement) par rapport aux revenus pour un ménage.

73
ANNEXE I. PRINCIPAUX TEXTES SUR LA TARIFICATION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Code général des collectivités territoriales
Partie législative Article L2224-12-1
Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au
tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à
l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition
ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des
bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Article L2224-12-2
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances
d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L.1331-1 à L.
1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou
de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du
premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L.2224-8,
elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions
éventuellement obtenues.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne
fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par
les propriétaires en vertu du précédent alinéa.
Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées
comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.
Article L2224-12-3
Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux
investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des
services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de
garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de
garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Article L2224-12-4
I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement
consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment

74
de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du
branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté
des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis
du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal
ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu,
la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le
présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du
code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre
limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du
président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution
d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau
consommé.
II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de
règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de
collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du
classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en
vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. - A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de
la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur
la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture
fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait
pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales
modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008
pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à
compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il
peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte
du nombre de logements.
IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est
menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement
de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.
Article L2224-12-5

75
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou
raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils
prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les
conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est
prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

76
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
Article R2224-19
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la
perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles
R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
Article R2224-19-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou
partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance
d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et
l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe
du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les
conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11
doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations
relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le
compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre,
outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des
charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir
les dépenses qui demeurent à sa charge.
Article R2224-19-2
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une
partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le
réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une
eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions
définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service
d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage
ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès
lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul
de la redevance d'assainissement.
Article R2224-19-3

77
Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du troisième
alinéa du I de l'article L. 2224-12-4, la redevance d'assainissement peut être également
calculée forfaitairement.
Article R2224-19-4
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau,
totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire
la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service
d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
• soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
• soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Article R2224-19-5
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les
charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon
fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges
d'entretien de celles-ci.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis
par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte
notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations
peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service
d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des
prestations assurées.
Article R2224-19-6
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et
d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout
déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement
donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement
assise :
• soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
• soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement.

78
Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 2224-19-1.
Article R2224-19-7
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour
consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être
confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de
distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai
d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des
redevances dues par leurs usagers.
Article R2224-19-8
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de
l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au
nom du propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de
la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au
propriétaire de l'immeuble.
Article R2224-19-9
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la
quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Article R2224-19-10
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du
service d'assainissement.
Ces charges comprennent notamment :
• les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
• les dépenses d'entretien ;
• les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
• les charges d'amortissement des immobilisations.
Article R2224-19-11
Le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et des
articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la
santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service
d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées
par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
Article R2224-20
I. - L'autorisation de mise en œuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme
directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la

79
population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale
ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est
naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par
le service d'eau potable.
II. - Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à
autoriser la mise en œuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme
directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de
service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en
application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait
de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à
compter de la date de la demande d'avis.
III. - Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en œuvre dans la commune,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une
partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.
IV. - L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois
années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par
la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le
préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.
Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification
de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le
syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article
L. 2224-12-4.
V. - En Corse, la mise en œuvre du régime de tarification prévu au présent article est
autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.

80
ANNEXE II. CONSTRUCTION DES TRANCHES DE REVENUS DE REFERENCE POUR DES ABONNES DOMESTIQUES
La construction des tranches de revenus
Pour la construction des tranches de revenus nécessaires à l'élaboration des scénarios sur
lesquelles nous allons simuler les variations de tarification de l'eau, nous nous sommes
appuyés sur les données de l'INSEE construites à partir des déclarations DADS, i.e. les
déclarations à la direction générale des impôts des salaires versés par toutes les entreprises
et associations pour l'année 2004.
Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition des revenus au niveau national et au
niveau régional.

81
Tableau 1 : Salaires nets annuels moyens par région pour les emplois à temps
complet (en euros courants)
Répartition
des effectifs
Salaires nets
annuels
2004 1998 2004
% Ensemble Ensemble Cadres *
Professions intermédiaires Employés Ouvriers
Alsace 3,1 18 512 21 128 39 973 22 498 15 318 17 038
Aquitaine 4,3 17 587 19 768 38 452 21 763 15 126 15 836
Auvergne 1,8 16 967 19 441 39 934 21 679 15 816 15 769
Basse-Normandie 2,0 16 759 18 800 38 683 21 139 15 116 15 688
Bourgogne 2,4 17 167 19 589 38 837 22 059 15 120 16 141
Bretagne 4,3 16 806 19 230 38 126 21 444 15 173 15 534
Centre 3,9 17 700 19 750 38 213 21 855 15 116 16 107
Champagne-Ardenne 2,0 17 331 19 565 39 877 22 002 15 140 16 355
Corse 0,4 16 844 19 279 40 714 22 307 15 459 15 208
Franche-Comté 1,7 17 400 19 739 39 319 21 741 15 277 16 337
Haute-Normandie 2,9 18 533 20 539 39 816 22 972 15 423 17 067
Ile-de-France 25,3 24 608 28 444 48 745 24 033 16 623 17 873
Languedoc-Roussillon 2,8 17 337 19 386 37 958 21 313 14 952 15 503
Limousin 1,0 16 768 18 838 38 787 21 174 15 277 15 149
Lorraine 3,2 17 597 19 898 39 065 22 165 15 229 16 385
Midi-Pyrénées 3,9 17 943 20 383 37 932 21 494 15 034 15 622
Nord-Pas-de-Calais 5,9 17 752 20 061 39 602 21 745 15 250 16 292
Pays de la Loire 5,4 17 169 19 499 39 187 21 504 15 095 15 729
Picardie 2,7 17 521 19 553 39 053 21 775 15 146 16 327
Poitou-Charentes 2,4 16 868 18 890 38 122 21 189 15 222 15 413
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6,6 18 435 20 892 39 563 22 185 15 224 16 246
Rhône-Alpes 10,1 18 945 21 437 40 738 22 255 15 508 16 541
Métropole 98,3 19 593 22 232 43 644 22 483 15 595 16 376
Guadeloupe 0,4 18 045 20 257 43 336 23 219 15 571 15 409
Guyane 0,1 21 560 23 235 50 048 24 686 19 724 15 818
Martinique 0,5 18 181 20 445 43 367 23 507 15 609 15 416
Réunion 0,7 17 176 19 363 43 497 23 104 15 669 14 980
France 100,0 19 570 22 197 43 648 22 499 15 602 16 359
* Y compris chefs d'entreprise salariés
Champ : salariés à temps complet dans les régions.
Source : DADS (exploitation au 1/25 en 1998, au 1/12 en 2004), Insee.
Ainsi, le LR, représente 2,8 % de la totalité des salariés français. Le niveau moyen de
rémunération des salariés du LR, toutes catégories confondues, est de 19386 € par an,
12,66% de moins que la moyenne nationale. L'INSEE distingue quatre catégories de salariés
: les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Eu égard à la faible
différence de niveau de salaires entre les deux dernières catégories de salariés, nous ne

82
retiendrons que les trois tranches de revenus suivantes pour la construction de nos
scénarios.
Foyers à faibles revenus : 15 000 € /an, correspondant à la rémunération des employés et
ouvriers ;
Foyers à revenus moyens : 21 000 € /an, niveau de revenus des professions intermédiaires ;
Foyers à revenus élevés : 38 000 €/an, correspondant niveau de rémunération des cadres.
Le ménage pauvre
Nous avons souhaité faire la différence entre un ménage à faible revenu et un ménage
pauvre afin de mettre en exergue les limites à partir desquelles il est impératif d'apporter
une aide au paiement de la facture d'eau.
La définition économique du seuil de pauvreté, est relative dans la mesure où, elle tient
compte de la composition du ménage et du niveau du salaire médian. Ainsi, sont considérés
comme pauvres, les ménages dont le revenu disponible est inférieur égal à 60% du revenu
médian16, modulo la nature du ménage. Ainsi, on élève ce seuil en fonction du nombre de
personnes du foyer (adultes et enfants, l’âge de ces derniers, de plus ou de moins de 14
ans).
Tableau 2 : détermination des seuils de pauvreté
Seuil à 60 %
en € (2005)
Personne seule 817
Famille monoparentale, un enfant de moins de 14 ans 1 062
Famille monoparentale un enfant de 14 ans ou plus 1 226
Couple sans enfants 1 226
Couple un enfant de moins de 14 ans 1 471
Couple un enfant de 14 ans ou plus 1 634
Couple deux enfants de moins de 14 ans 1 716
Couple deux enfants, dont un de moins de 14 ans 1 879
Couple deux enfants de plus de 14 ans 2 043
Source : enquêtes revenus fiscaux 2005, Insee-DGI
16 Le revenu médian est le niveau de revenu qui partage la population des salariés en deux parts égales, la moitié des salariés gagnant plus que le revenu médian et l'autre moitié gagnant moins.

83
A titre d'illustration, une personne vivant seule est considérée comme pauvre lorsque son
revenu mensuel est inférieur ou égal à 817 €, i.e. 9804 € par an. Dans le cas d'un couple
avec deux enfants de plus de 14 ans, le seuil de pauvreté est atteint lorsque le revenu du
ménage est inférieur ou égal à 2043 €, i.e. 24510 € par an.
Selon cette définition de la pauvreté, la France comptait en 2005 entre 7,1 millions de
personnes pauvres correspondant à 3 millions de ménages. La part de personnes pauvres
serait comprise entre 6,3 et 12,1 % de la population.
Taille du ménage, niveau de revenu et consommation d'eau
La consommation d'eau d'un ménage est fonction de trois grandes catégories de facteurs :
la taille du ménage, le revenu du ménage et la superficie de l'appartement. Dans le cadre de
cette étude, nous prendrons en compte pour la constitution de nos scénarios les deux
éléments suivants : la taille du ménage et les revenus des derniers.
En France comme dans l'ensemble des autres pays développés, la variation de la
consommation d’eau avec le revenu à taille constante du ménage est d’un facteur 1,25 à 3
entre le premier décile de revenu (i.e. les 10 premiers pourcent des ménages dans l'ordre
croissant des revenus, autrement dit les 10% des ménages les moins riches) et le dernier
décile (i.e. 10 derniers pourcent des ménages dans l'ordre croissant des revenus, autrement
les 10% des ménages les plus riches). Par ailleurs, la variation de consommation d’eau avec
le nombre de personnes est d’un facteur 2.5 à 5 entre un ménage d’une personne et un
ménage de cinq personnes (source : Économie et statistique, N°288, p.115 (199 5)). Nous
retiendrons le cas d'un facteur faible (1,5) de la consommation d'eau en fonction du revenu.
Tableau 3 : Multiplicateur de la consommation d'eau quotidienne (en litre par jour) en
fonction de la taille du ménage et du niveau de rémunération
Nbre de personnes dans le ménage 1 2 3 4 5
Revenu faible 102 156 195 226 258
Revenu moyen 132 203 254 295 335
Revenu élevé 152 231 292 339 387
Consommations quotidiennes, Source : Henri Smets, La solidarité pour l'eau potable, Aspects
économiques, 2005
(x 1,5)
Consommation (x 2,5)

84
Tableau 4 : Consommations annuelles (en m3/an)
Nbre de personnes dans le ménage
1 2 3 4 5
Revenu
Revenu faible 36,72 56,16 70,2 81,36 92,88
Revenu moyen 47,52 73,08 91,44 106,2 120,6
Revenu élevé 54,72 83,16 105,12 122,04 139,32
NB. Nous ne retiendrons des résultats de cette étude que la corrélation positive entre la
consommation d'eau et le revenu des ménages. Les données sur les consommations d'eau
des ménages seront actualisées de telle sorte à se rapprocher des consommations que l'on
observe aujourd'hui (de l’ordre de 120 m³/abonné/an).
Calage des scénarios :
Nous retiendrons les hypothèses suivantes pour caller les scénarios.
Les tranches de Revenus retenues pour les abonnés do mestiques
Revenu de référence dans la région LR :
Revenu moyen K€/an
Actifs à revenu faible 15
Actifs à revenu moyen 21
Actifs à revenu élevé 38
Dans les scénarios, deux cas d’abonné type on été choisi pour illustrer le poids de la facture
d’eau et l’impact possible de son augmentation.
Il y a statistiquement 2,4 habitants par abonnés en France.
A partir de ce chiffre et des revenus de références présentés ci-dessus, les deux cas
d’espèce suivant ont été choisis :
• Abonné à revenu modeste = Nous faisons l'hypothèse d'un seul actif à revenu faible
dans le ménage (revenu du foyer= 15 000 €)
• Abonné à revenu élevé = Nous faisons l’hypothèse de deux actifs à revenue élevé
dans le foyer (revenu du foyer = 76 000 €).
(x 1,5)

85
Il s’agit donc dans les scénarios de deux exemples contrastés illustratifs, dont les valeurs de
revenu sont cohérent avec le contexte régional, mais qui ne sont pas sensés être
représentatifs statistiquement (il faudrait disposer de la répartition des revenus par abonné).

86
ANNEXE III. RECUPERATION DES COUTS DANS LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE
Le recouvrement des coûts
• Les coûts de fonctionnement
A l'échelle nationale, la facturation de l’eau représente près de 98% des recettes des services
publics de l’eau et de l’assainissement. Les 2% restants proviennent des subventions des budgets
généraux des communes, notamment au titre des charges de fonctionnement des réseaux
d’évacuation d’eaux pluviales gérées par le service des eaux.
Tableau : recouvrement des coûts de fonctionnement
Total Recettes facturées 9 107,40 91,94% Total Charges d'exploitation 7 083,80 51,18%
Total Subventions 798,60 8,06% Total CCF 6 757,70 48,82%
Total 10 457,80 100,00%
Total 13 841,50 100,00%
Source : Directive Cadre sur l'eau, Rapportage, Recouvrement des coûts de fonctionnement par bassin, 2004
• Les coûts d'investissement
Au plan national, les investissements annuels s'élèvent à 3,66 Md. Les subventions à
l’investissement financées par l’impôt sont de l'ordre de 568 M/an, i.e. 15.5% de la valeur des
investissements. Le taux de récupération des dépenses d’investissement par le prix de l’eau
s’établit donc à 85%.

87
Tableau : recouvrement des coûts d'investissement
Ventilation des subventions
Bassin Montant des
investissements
Montant total
des
subventions
Agence FNDAE Département +
Régions Autres
Total des
subventions
(hors prix de
l’eau)
Taux des
subventions
(hors prix de l’eau)
Escaut-Sambre 310 131,5 79 4 37,9 10,6 52,5 17,00%
Meuse 25 14,9 8 0,9 6 0 6,9 27,00%
Rhin 262 93,9 50,6 7,6 35,7 0 43,3 16,00%
Seine 900 727,6 562 15,5 128 22,1 165,6 18,30%
Loire 835 224 124 38 62 - 100 12,00%
Rhône 843 323,11 214,39 28,11 80,61 - 108,72 12,90%
Garonne 466,3 147,25 66,1 20,25 60,9 - 81,15 17,40%
Corse 24 19,2 9 1,9 8,3 - 10,2 42,50%
Total 3665,3 1681,46 1113,09 116,26 419,41 32,7 568,37 15,51%
568,37
Subvention à l'investissement financé
par l'impôt
Source : Directive Cadre sur l'eau, Rapportage, Recouvrement des coûts d'investissement par bassin, 2004

88
ANNEXE IV. PRESENTATION DES COMPOSANTES D’UNE FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
La présentation de la facture, son émission et les périodes de facturation sont définies dans
l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de
traitement des eaux usées.
Elle doit comporter, notamment, trois parties dénommées « Distribution de l’eau »,
« Collecte et traitement des eaux usées » et « Organismes publics ».
La distribution de l’eau comprend :
� l’abonnement ou « partie fixe » s’il existe un tarif binôme. Son montant peut varier
suivant le diamètre du compteur ou du branchement ;
� la location du compteur : elle est identifiée à part (quand elle n’est pas incluse dans
l’abonnement) et couvre souvent, également, son entretien ;
� la consommation. C’est la part de l’eau facturée selon la consommation relevée au
compteur. Elle peut faire l’objet d’un tarif dégressif ou progressif.
La collecte et le traitement des eaux usées couvrent les frais du service
d’assainissement comprend :
� l’abonnement au service de collecte et de traitement des eaux usées ;
� la consommation correspondant à la partie variable de la facturation, en fonction du
volume d’eau consommé par l’abonné.
La partie distribution comme la partie collecte peuvent être elle-même divisée en deux parts
en cas de gestion déléguée avec une part délégataire destiné à l’exploitant et une part
collectivité (appelé parfois « surtaxe ») destinée à la commune (ou à l’EPCI) qui assure le
financement des principaux investissements.
Les redevances et taxes perçues au bénéfice des organismes publics comprennent
� la redevance de prélèvement, la redevance modernisation des réseaux de collecte et
la redevance de lutte contre la pollution sont reversées à l’Agence de l’eau du bassin
auquel est rattaché le consommateur ;
� la taxe voie navigable de France, pour les communes concernées ;
� la TVA s’applique à tous les postes de la facture au taux de 5.5%.

89
ANNEXE V. QUESTIONNAIRE

90

91

92

93

94

95

96

97
ANNEXE VI. EXTRACTION DE LA BASE DE DONNEES ISSUES DE L’ENQUETE

98

99

100

101

102

103

104