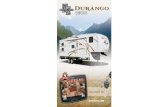Etude D©partementale de d©ploiement - ?ma D©partemental de d©ploiement... Etude D©partementale
dépensesOndam2014
Transcript of dépensesOndam2014
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
1/54
S C U R I T S O C I A L E
20
14
www.economie.gouv.frwww.social-sante.gouv.fr
Projet de loi de financementde la Scurit sociale - PLFSS
ANNEXE 7
ONDAM et dpense nationale de sant
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
2/54
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
3/54
ANNEXE 7
ONDAM
ET DPENSENATIONALEDE SANT
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
4/54
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
5/54
1
SOMMAIRE
PARTIE I : EXCUTION, PRIMTRE ET CONSTRUCTION DE LONDAM..........3
I.1 Retour sur lexcution de lONDAM 2012 et prvisions 2013...................................................3
I.1.1 ONDAM 2012 : un niveau de sous-excution exceptionnel ................................................3
I.1.2 Les ralisations au titre de lONDAM 2013 devraient tre infrieures de 0,5 Md
lobjectif .............................................................................................................................5
I.2 Primtre et construction de lONDAM 2014......................................................................................7
I.2.1 Les principes de la construction de lONDAM ...................................................................7
I.2.2 Construction des bases pour 2014 ....................................................................................8
I.2.3 Prsentation des volutions avant mesures nouvelles ......................................................9
I.2.4 Les mesures nouvelles dconomies ................................................................................11
I.2.5 LONDAM pour 2014 ..........................................................................................................11
PARTIE II : ONDAM ET BESOINS DE SANT PUBLIQUE..................................................15
II.1 Une analyse mdicalise des dpenses de lONDAM.............................................................. 15
II.1.1 La rpartition mdicalise des dpenses de lONDAM en 2011 .....................................16
II.1.2 Frquence des pathologies et traitements parmi les bnficiaires du rgime gnral ..18
II.1.3 Lvolution des effectifs et des dpenses entre 2010 et 2011 .........................................24
II.2 Fonds dintervention rgional (FIR).......................................................................................................26
II.2.1 Principes ...........................................................................................................................26
II.2.2 Modalits de financement du FIR ....................................................................................27
II.2.3. Fonctionnement du FIR ...................................................................................................29
II.3 Disparits rgionales des dpenses de sant publique et des dpensesrembourses en soins de ville...................................................................................................................30
PARTIE III : LVOLUTION DES DPENSES DE SANT ET DE LEURPRISE EN CHARGE .................................................................................................................................................36
III.1. Lvolution de la consommation de soins et de biens mdicaux (CSBM) reste
significativement infrieure 3 % en 2012 .......................................................................41
III.2. Les modes de prise en charge de la consommation de soins et de biens mdicaux ....42
PARTIE IV : RAPPEL DES AVIS DU COMIT DALERTE SUR LVOLUTIONDES DPENSES DE SAN ........................................................................... 46
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
6/54
2
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
7/54
3
Partie I : excution, primtre et constructionde lONDAM
Dans le cadre du projet de loi de financement de la scurit sociale pour 2014, il est propos defixer lobjectif national des dpenses dassurance maladie pour 2014 179,2 Md, soit un taux deprogression de 2,4 % par rapport 2013. LONDAM 2014 tmoigne, par laffectation de prs de4,3 Mdde ressources supplmentaires au financement du systme de soins, de lengagementrsolu de contenir la progression des dpenses tout en amliorant laccs aux soins. Ce projetde loi de financement de la scurit sociale permettra dengager la mise en uvre de la stratgienationale de sant en contribuant mieux structurer loffre de soins par le renforcement des soinsde premier recours, en adaptant les modalits de financement des tablissements de sant,en sinscrivant dans lobjectif de gnralisation de laccs une couverture complmentairesant, en promouvant la sant publique et en veillant une politique du mdicament efficiente etfavorable linnovation. Les mesures dconomies pour 2014 viseront prioritairement renforcerlefficacit et la performance du systme de soins.
I.1 Retour sur lexcution de lONDAM 2012et prvisions 2013
I.1.1 ONDAM 2012 : un niveau de sous-excution exceptionnel (1)
La loi de financement de la Scurit sociale pour 2012 avait fix lobjectif national de dpensesdassurance maladie 171,1 Md. Selon les dernires informations fournies par les rgimes, lesdpenses dans le champ de lONDAM se sont leves 170,1 Md, soit un niveau plus faibledenviron 1,0 Md lobjectif vot. La croissance des dpenses stablit ainsi +2,4 % parrapport 2011 (cf. graphique I.1.1).
Graphique I.1.1 : Niveaux et dpassements de lONDAM depuis 1997
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
85 95 105 115 125 135 145 155 165 175
En Md
Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dpenses constat (en milliards deuros) et en ordonnes le taux dvolution associ ;la taille des bulles reprsente lampleur du dpassement (en gris fonc) ou de la sous-consommation (en gris clair).
Ainsi, en 2007, les dpenses dans le champ de lONDAM ont atte int 147,6 Mdcompte tenu dun dpassement de 2,8 Md, soit untaux dvolution primtre cons tant de 4,0%.
(1) Lexcution de lONDAM 2012 est galement prsente dans le rapport de la Commission des comptes de la Scurit sociale deseptembre 2013.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
8/54
4
Plus en dtail, les dpenses de soins de villese sont leves 77,9 Mden 2012, en progressionde 1,7 % par rappor t 2011. Lcart au sous-objectif vot en loi de financement sest ainsi lev 1,0 Md. Cette sous-excution reflte la moindre excution de lONDAM 2011 qui navait past suffisamment prise en compte en construction de lONDAM 2012 et une dynamique plusfaible de certaines dpenses, dont les indemnits journalires, en baisse de 1,0 %.
La LFSS pour 2012 prvoyait sur le champ des soins de ville la ralisation de 2,1 Mddconomiesnouvelles. Un effort toujours important tait prvu sur les programmes de matrise mdicalise,avec un objectif de 550 M, qui a t dpass. Des ajustements tarifaires ont t mis en uvredans le domaine des produits de sant hauteur de 920 Mcomplts de 120 Mde mesuresdiverses (baisses de prix et mise sous tarif forfaitaire de responsabilit de certains mdicamentsgnriques, modification des marges des grossistes rpartiteurs, dremboursement desmdicaments service mdical rendu insuffisant, mise sous accord pralable). Des ajustementsont galement t mis en uvre pour les professionnels de sant libraux avec des baisses detarifs des radiologues et des biologistes (220 M).
Une mesure portant sur les indemnits journalires a galement t mise en place, consistant abaisser le plafond maximal de lindemnit, auparavant fix au plafond de la scurit sociale, un niveau quivalent 1,8 Smic.
Selon des estimations encore provisoires, qui pourront faire lobjet de rvision la hausse comme la baisse, les conomies ralises se seraient leves un peu plus de 2 Md, soit un montantlgrement infrieur en valeur absolue la construction de lobjectif, dont prs de 1,3 Mdsurles produits de sant y compris mesures de matrise mdicalise. Cependant, les ralisationsdes mesures coteuses ont t galement infrieures aux montants retenus en construction,ce qui a permis de respecter le niveau net deffort prvu et ce en dpit de la comptabilisationdans cet exercice de la rmunration sur objectifs de sant publique qui ntait pas initialementprvue, le rattachement lexercice 2012 ayant t demand a posteriori conformment auxrecommandations de la Cour des comptes au printemps 2012.
Sagissant des dpenses affrentes aux tablissements de sant, elles se sont leves 74,5 Mden 2012 (+2,7 % par rapport 2011), faisant apparatre un cart lobjectif vot delordre de -100 M.
Avant mesures correctrices, le dpassement sur lensemble du champ des tablissementsde sant se serait lev en 2012 480 M. Compte tenu des mises en rserve de dotationshospitalires pour 440 M, des moindres dpenses de permanence des soins et de dpensesplus faibles que prvu sur le champ non rgul, les dpenses des tablissements de sant onttin fine infrieures de 100 M lobjectif vot. Plus en dtail, les cliniques prives contribuentpour prs de 120 M la sous-consommation de lobjectif. linverse, les dpenses tarifes lactivit des tablissements anciennement sous dotation globale ont t suprieures denviron560 M lobjectif vot (avant prise en compte de limpact des mises en rserve) du fait dunevolution trs dynamique du volume des sjours, des actes et des consultations externes et du
fait galement dune progression plus forte de la liste des mdicaments en sus et des forfaits.Les mises en rserve de dbut danne ont permis de respecter lobjectif.
La contribution des rgimes dassurance maladie aux dpenses en tablissements et servicespour personnes gesa reprsent 8,0 Mden 2012, en progression de 6,0 % par rapport lobjectif vot pour 2011. Lenveloppe pour personnes handicapessest pour sa part leve 8,4 Md, en augmentation de 2,4 % sur un an.
Enfin, les dpenses desautres prises en chargedpassent trs lgrement lobjectif (20 M)et reprsentent prs de 1,2 Md. Lvolution par rapport 2011 est de 0,8 %.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
9/54
5
I.1.2 Les ralisations au titre de lONDAM 2013 devraient treinfrieures de 0,5 Md lobjectif
En 2013, la dpense globale slverait 174,9 Md, soit une ralisation de lONDAM de nouveauinfrieure lobjectif arrt (cf.tableau I.1.1).
Tableau I.1.1 : ralisations prvisionnelles dans le champ de lONDAM 2013
Prvision 2013, en milliards deuros
Constat2012
provisoirervis
Base 2013ractuali-
se (1)
Objectifs2013
arrts
Prvision2013 (2)
Tauxdvolution
(2/1)
Ecart lobjectif
arrt
Soins de ville 77,9 77,9 80,5 80,0 2,7% -0,5
tablissements de sant 74,5 74,5 76,5 76,4 2,6% -0,05
tablissements et services mdico-sociaux 16,5 16,5 17,1 17,1 3,9% 0,0
Contribution de lassurance maladie auxdpenses en tablissements et servicespour personnes ges
8,0 8,0 8,4 8,4 4,6% 0,0
Contribution de lassurance maladie auxdpenses en tablissements et servicespour personnes handicapes
8,4 8,5 8,7 8,7 3,3% 0,0
Autres prises en charge 1,2 1,2 1,3 1,3 6,8% 0,03
ONDAM TOTAL 170,1 170,1 175,4 174,9 2,8% -0,5
Les taux dvolution sont calculs primtre constant et aprs fongibilit. Les ralisations de 2012 (170,1 Md) sont ramenes auchamp de celles de 2013 en tenant compte des modifications de primtre intervenues entre 2012 et 2013.Source : DSS
Plus en dtail, les dpenses de soins de ville devraient stablir cette anne 80,0 Md, soitun cart de lordre de -0,5 Mdpar rapport au sous-objectif vot en loi de financement. Cetteprvision est fonde sur les dpenses en date de soins du rgime gnral couvrant les cinqpremiers mois de lanne. Elle fait lobjet dune description dtaille dans le rapport de la CCSSde septembre 2013 (cf. fiche 7.5). Il est procd ensuite une extrapolation de cette prvision lensemble des rgimes dassurance maladie, en fonction du poids du rgime gnral pourchaque poste de dpenses (honoraires mdicaux et dentaires, honoraires paramdicaux,produits de sant, etc.).
Les postes de dpenses qui, par nature, ne se prtent pas un suivi infra-annuel sont actualissau moyen dinformations transmises par les rgimes (2).
Les dernires donnes disponibles sur les tablissements de sant en 2013 indiquent quavantprise en compte des mises en rserve, les dpenses des sjours se situeraient pour lestablissements anciennement sous dotation globale en de de lobjectif. En revanche, lesdpenses de la liste des mdicaments et dispositifs mdicaux en sus dpasseraient nettementles prvisions.
Au global, le dpassement pourrait atteindre 170 Msur la partie de lobjectif de dpenses demdecine, chirurgie et obsttrique (ODMCO) des tablissements anciennement sous dotationglobale.A contrario, les dpenses des cliniques prives seraient plus faibles de 170 Mcomptetenu dun effet base important renforc par la rvision la baisse des provisions (cf. fiche 7-1 durapport de la Commission des comptes de la scurit sociale de septembre 2013). Les dpenses
(2) Il sagit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par lassurance maladie dune partie des cotisationssociales des praticiens et auxiliaires mdicaux, dotation annuelle au fonds des actions conventionnelles, remises conventionnellesacquittes par lindustrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides la tltransmission des feuilles de soins.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
10/54
6
rgules des tablissements de sant seraient donc quasiment en ligne avec lobjectif en 2013.
Lcart observ en 2012 sur les dpenses non rgules (3)est confirm et abaisse due concurrenceles dpenses de 2013, qui seraient infrieures denviron 50 Maux prvisions.
Ds lors, les sous-objectifs relatifs aux tablissements de sant devraient, sous ces hypothses,
tre infrieurs de 50 Maux montants vots, lcart portant sur les dpenses non rgules.
Tout cart se traduisant par une hausse des dpenses suprieure aux prvisions actuellespourrait cependant tre couvert par les mises en rserve prvues en dbut danne pour unmontant total suprieur 400 M.
La contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissements et services mdico-sociaux constitue une enveloppe ferme qui ne peut tre ni dpasse ni sous-consomme sansmodification des sous-objectifs dans la loi. Le montant de cette enveloppe a t fix 17,1 Mden LFSS pour 2013.
Enfin, les dpenses du 6esous objectif devraient dpasser de 30 Mle sous-objectif initial dufait dune dynamique plus forte que prvue des soins des Franais ltranger. Elles atteindraient
en 2013 1,3 Md.Au total, la ralisation de lONDAM 2013 serait infrieure de 0,5 Md lobjectif arrt.
Les taux de consommation des objectifs dengagement inscrits pour les tablissements etservices mdico-sociaux relevant de lobjectif de dpenses, arrivs chance au cours desdeux derniers exercices clos (2010 et 2011) et de lexercice en cours (2012) et venir (2013), sontdtaills dans le tableau suivant.
tablissements et services pour personnes ges*
Anne enveloppe Montant notifi (MN)(dont RN) en Mautoris install
en M
en % en M
en %MN 2008-2010 469,9 443,8 94 % 335,9 71 %
EA + AE 2011-2012 224,4 164,4 73 % 67,6 30 %
EA + AE 2013 21,5 12,9 60 %
Total 715,9 621,1 87 % 403,5 58 %
AE : Autorisations dengagement ; EA : Enveloppe anticipe ; RN : Rserve nationale.* hors mesures spcifiques Alzheimer (ples dactivit et de soins adapts, units dhbergement renforces, quipes spcialisesAlzheimer, plateformes de rpit).
tablissements et services pour personnes handicapes
Anne enveloppe Montant notifi (dontRN) en Mautoris install
en M en % en M en %
MN 2008-2010 563,1 553,4 98 % 489,5 87 %
EA + AE 2011-2012 227,0 203,6 90 % 139,8 62 %
EA + AE 2013 127,8 96,4 75 %
Total 917,9 853,4 93 % 629,4 80 %
Source : CNSA, septembre 2013.
(3) Les dpenses non rgules intgrent principalement les dpenses destination dtablissements spcifiques nentrant pas dans
le cadre des diffrents arrts et circulaires rgissant les tablissements de sant rguls, tels que les hpitaux de Monaco etPuigcerd, lhpital amricain de Neuilly. Par ailleurs sont galement inclus des montants comptables rattachs par dfaut au3esous-objectif, ces montants ne pouvant tre ventils entre les diffrents sous-objectifs.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
11/54
7
Les plans gouvernementaux sur le secteur mdico-social (plan solidarit grand ge et programmepluriannuel de cration de places pour personnes handicapes) ont dores et dj donn lieu la totalit des autorisations dengagement (AE) correspondant au cadrage financier pluriannueldes plans. Lanne 2014 et les suivantes verront donc limpact financier de ces AE au traversdes crdits de paiements ncessaires linstallation effective des tablissements et services
mdico-sociaux autoriss dans ce cadre.
I.2 Primtre et construction de lONDAM 2014
Dans le cadre du projet de loi de financement de la Scurit sociale pour 2013, il est proposde fixer lONDAM pour lanne 2014 179,2 Md, soit un taux de progression de 2,4 % (aprs2,8 % en prvision pour 2013 et 2,4 % ralis en 2012).
LONDAM 2014 inclut un nouveau sous-objectif retraant les dpenses relatives au fondsdintervention rgional (FIR) finances par lassurance maladie. Cette opration a pour objectifune plus grande transparence et un meilleur suivi de ces dpenses. Les commissions des affaires
sociales de lAssemble nationale et du Snat ont rendu le 11 septembre un avis favorable lacration de ce nouveau sous-objectif de lONDAM, venant renforcer linformation du Parlement.Les commissions avaient en effet t saisies par la Ministre des affaires sociales et de la santet par le Ministre dlgu au budget en vertu de larticle LO 111-3 du code de la scurit sociale.Par ncessit de cohrence entre les comptes de lassurance maladie et les sous-objectifs delONDAM, le sous-objectif relatif au FIR ninclura pas les dpenses provenant du budget deltat, ni du financement provenant de la CNSA (au titre du financement de groupes dentraidemutuelle et de maisons pour lautonomie et lintgration des malades dAlzheimer), dpensesfaisant lobjet dune rgulation propre.
I.2.1 Les principes de la construction de lONDAM
La construction de lobjectif de dpenses pour lanne venir comporte plusieurs tapes. Elleenglobe le montant par sous-objectif arrt pour lanne en cours, ractualis le cas chant enfonction des nouvelles prvisions, et rectifi pour tenir compte des changements de primtre,lestimation des volutions tendancielles, cest--dire avant mesures nouvelles, et le montantdconomies ncessaire pour atteindre le taux dvolution cible des dpenses retenu par leGouvernement et propos au vote du Parlement. Lensemble de ces lments permet de dfinirlobjectif et ses sept sous-objectifs en niveau (4).
Lestimation des tendances de moyen terme en volume consiste dterminer tout dabordlvolution des dpenses par grand poste qui serait observe si aucune dpense nouvelleou aucune conomie ntait mise en uvre. Cette projection tendancielle intgre ensuite lesvolutions prvisibles des tarifs ainsi que les effets reports des diffrentes mesures mises en
uvre les annes antrieures.Applique la base, lvolution tendancielle permet dtablir une prvision de dpensesavant mesures nouvelles dconomies. Il sagit alors de dterminer le montant dconomiesqui est ncessaire pour ramener la progression des dpenses lobjectif fix par le Parlement.Cette dernire tape comprend la dfinition des mesures, tant rglementaires que relatives la matrise mdicalise des dpenses et de lutte contre les fraudes, ainsi que la rpartition deleffort entre les diffrents secteurs (soins de ville, tablissements de sant, tablissementsmdico-sociaux).
(4) Il est ce titre utile de rappeler que lONDAM est vot par le Parlement en montant, mme si lon est souvent amen raisonneren termes de taux dvolution.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
12/54
8
I.2.2 Construction des bases pour 2014
La base pour 2014 sobtient en intgrant les ralisations estimes pour lanne en cours. Ainsi,le niveau de dpense arrt pour 2013 tient compte des carts prvisionnels prcits (-0,5 Mdau total).
Dans un second temps, sont intgrs les effets de champ affectant le primtre de lONDAM(cf. tableau I.2.1).
Tout dabord, lintroduction du nouveau sous-objectif relatif au FIR implique de transfrer toutesles dpenses relatives au FIR qui taient jusque-l incluses dans les sous-objectifs des soins deville, des tablissements de sant et dans les autres prises en charge . De plus, deux dpensesrelevant du FIR qui taient jusque-l en dehors du primtre de lONDAM sont intgres. Lacration de ce sous-objectif implique :
- un transfert de 167 Mde lONDAM soins de ville vers le nouveau sous-objectif relatif au FIRau titre principalement de la permanence des soins ambulatoires ;
- un transfert de 2,7 Mdde lONDAM hospitalier vers le sous-objectif relatif au FIR, reprsentantle montant des missions dintrt gnral et daides la contractualisation qui avaient dlgues
au FIR ainsi que la partie rgionalise du fonds de modernisation des tablissements sanitairespublics et privs ;
- un transfert de 203 Mdu poste relatif aux autres prises en charge vers le sous-objectifrelatif au FIR, en ce qui concerne la partie rgionalise du fonds dintervention pour la qualit etla coordination des soins et du programme personnes ges en risque de perte dautonomie ;
- enfin, 81 Msont intgrs dans le champ de lONDAM au titre des dpenses de prvention delassurance maladie et du financement de la dmocratie sanitaire.
Ces modifications affectent ainsi le primtre de lONDAM global hauteur de 81 M.
Par ailleurs, en dehors des modifications lies la cration dun sous-objectif portant sur lesdpenses relatives au FIR, dautres changements de primtre ont lieu pour la construction dela base 2014. En effet, six nouvelles mesures de primtre interviennent dans la constructionde lONDAM 2014 :
- 45 Msont intgrs la base 2014 au titre de dpenses lies laffiliation des Franaisfrontaliers travaillant en Suisse. Ceux-ci, lorsquils nont pas opt pour lassurance maladiesuisse, peuvent bnficier dune couverture prive au 1er euro plutt que dtre affili lascurit sociale. Ce droit doption temporaire arrivant chance le 1erjuin 2014, les travailleursfrontaliers seront progressivement affilis au rgime gnral de la scurit sociale (selon lesdates dchance de leur contrat priv) ;
- leffet en anne pleine hauteur de 18 Mdu transfert des tablissements mdico-sociauxpour personnes ges vers les dpenses de soins de ville au titre de la fin de lexprimentationdu financement de mdicaments inclus jusqualors dans les forfaits de soins de ces EHPAD(opration neutre sur le primtre de lobjectif global) ;
- la prise en charge du forfait mdecin traitant par les organismes complmentaires qui taitprvue dans lavenant 8 la convention mdicale hauteur de 150 Mviendrait minorer lesdpenses dassurance maladie en 2014 de 75 M, un montant quivalent devant tre vers autitre de lanne 2013 ;
- la prise en charge des cotisations des professionnels de sant exerant dans les centres desant, comptabilise en subventions dans les comptes de lassurance maladie, est intgredans le primtre de lONDAM (54 M) ;
- 600 M de dpenses, jusque-l inscrites dans lONDAM comme indemnits journaliresau bnfice de fonctionnaires et dagents de la SNCF et de la RATP, sont retranches dusous-objectif soins de ville. En effet, ces dpenses ne sont pas strictement des dpensesdassurance maladie mais correspondent des maintiens de salaire la charge de lemployeur
en cas darrt maladie, et dans le cas des fonctionnaires ces dpenses ne concernant que lesarrts de longue dure ;
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
13/54
9
- 43 Msont intgrs aux soins de ville au titre de la cration de nouvelles indemnits journalires, compter du 1erjanvier 2014, pour les exploitants agricoles (qui ne bnficiaient auparavantque dun droit aux indemnits en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle). Encontrepartie, une nouvelle cotisation est cre pour les exploitants agricoles visant financer due concurrence ces nouvelles prestations ;
- dans une logique dlargissement de la rgulation des dpenses et de la cohrence entrelONDAM et les comptes de la branche maladie, les dotations la charge de lassurance maladiepour financer diffrents fonds et organismes sont intgres au sous-objectif autres prises encharge pour un montant correspondant en 2013 483 M. Parmi les dotations intgres, sontnotamment incluses celles pour la haute autorit de sant, la dotation lagence technique delinformation sur lhospitalisation, lagence de biomdecine, ltablissement pour la prparationet de rponse aux urgences sanitaires, linstitut national de prvention et dducation pour lasant et lorganisme gestionnaire du dveloppement professionnel continu ;
- enfin, 7 Msont transfrs de lONDAM mdico-social pour personnes ges vers les dpensespour personnes handicapes, ce changement mineur venant corriger les changements deprimtre oprs dans le cadre des PLFSS pour 2010 et 2012.
Au total, ces modifications affectent le primtre global de lONDAM hauteur de 30 M(cf.tableau I.2.1).
Tableau I.2.1 : impact des changements de primtre sur la base 2013
Base 2014 champ 2013
Changementsde primtres
Base 2014 champ 2014
Soins de ville 80,0 -0,7 79,3
tablissements de sant 76,4 -2,6 73,8
tablissements et services mdico-sociaux 17,1 0,0 17,1Contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissementset services pour personnes ges 8,4 0,0 8,4
Contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissementset services pour personnes handicapes 8,7 0,0 8,7
Dpenses relatives au fonds dintervention rgional 0,0 3,1 3,1
Autres prises en charge 1,3 0,3 1,6
ONDAM TOTAL 174,9 0,03 174,9
I.2.3 Prsentation des volutions avant mesures nouvellesEn 2014, lvolution des dpenses avant mesures nouvelles dconomies est estime 3,8 %.Cette volution rsulte des hypothses de taux de croissance qui ont t retenues pour lesdiffrentes composantes de lobjectif et de leur poids respectif (soins de ville, tablissements desant, tablissements et services mdico-sociaux, autres modes de prise en charge, dpensesrelatives au fonds dintervention rgional).
En toute rigueur, la dtermination de lvolution des dpenses avant mesures nouvellesdconomies devrait soprer en deux temps : lestimation de lvolution spontane (ou purementtendancielle) devrait tre ajout limpact des mesures passes ou venir occasionnant unedpense supplmentaire. Sur le champ des soins de ville, cest bien cette mthodologie qui estutilise. En revanche, pour les tablissements sanitaires et mdico-sociaux, une approche plus
directe, consolidant tendanciel pur et mesures dores et dj prises en compte, est adopte.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
14/54
10
Le taux dvolution des dpenses de soins de ville avant conomies nouvelles stablirait 4,5 %.Ce taux est obtenu en majorant la tendance dvolution spontane de ce poste de limpact desmesures coteuses pour lassurance maladie telles quanticipes pour lanne 2014 compte tenude linformation disponible ce jour.
La croissance spontane des dpenses de soins de ville a t estime partir dune analyseconomtrique des donnes du rgime gnral en date de soins. Dans le champ des seulesprestations dassurance maladie, cette croissance est value 4,0 % pour 2014 et pourlensemble des rgimes. La prise en compte des autres dpenses de soins de ville, comme laprise en charge des cotisations sociales des professionnels de sant, les remises verses parles laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde ou encore les aides latltransmission des feuilles de soins, ne conduit pas modifier ce taux dvolution.
Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs t provisionnes dans laconstruction du sous-objectif. Il sagit notamment des provisions denviron 200 M au titrede lavenant 8 la convention mdicale qui inclut une extension du forfait mdecin traitanthors affection longue dure, ou encore 5 forfaitaires pour les consultations de personnesges. Des montants sont galement provisionns pour des prises en charge de cotisations deprofessionnels de sant (dcoulant notamment des revalorisation tarifaires passes), ou desmesures entrant dans le cadre de la stratgie nationale de sant (extension puis gnralisationdes nouveaux modes de rmunration des professionnels de sant par exemple). Par ailleurs,les effets report sur 2014 des mesures dconomie et de cot mises en uvre tout au long delanne 2013 sont valus environ -90 M. Lensemble de ces oprations porte la progressionprvisionnelle des dpenses de soins de ville 4,5 % avant conomies nouvelles.
Le taux dvolution des dpenses affrentes aux tablissements de sant avant mesures stablit 3,1 %. Cette hypothse sinscrit dans le prolongement de lvolution observe les annesprcdentes et prend en compte les dpenses inluctables qui auront lieu au cours de lanne.
Le taux de croissance de la contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissementset services mdico-sociaux slverait 3,5 %. dpenses mdico-sociales inchanges, le tauxdvolution de la contribution slve 3,0 %, le financement restant provenant des rservesde la CNSA pour un montant de 70 M(les rserves tant de 450 M fin 2012). Ce taux decroissance traduit un effort financier supplmentaire de plus de 500 Msur la prise en chargedes personnes ges et handicapes de la part de lassurance maladie. La contribution delassurance maladie permettra ainsi en 2014 de couvrir les engagements pris dans le cadredes plans de crations de place sur le champ du handicap, dans le cadre du plan Alzheimer,130 Mde crdits de mdicalisation des EHPAD ainsi que les dpenses prvues dans le cadredu plan autisme. En effet, le plan autisme prvoit sur la priode 2014-2017 le renforcement destablissements et services ainsi que la cration de places nouvelles pour un montant total de195 Mau titre de lONDAM mdico-social et lanne 2014 constitue donc la premire annedengagement de la mise en uvre de ces actions.
Enfin, le taux dvolution des autres prises en charge par lassurance maladie avant mesuresnouvelles dconomies est valu 5,6 %.
Lvolution prvue pour le sous-objectif relatif au FIR (2,4 % pour lanne 2014) dif frepartiellement des principes retenus pour les autres sous-objectifs : la dynamique des dpensesrelevant de ce sous-objectif est relativement faible comparativement aux autres sous-objectifs,le taux dvolution spontan de ce sous-objectif est en fait rehauss pour tenir compte demesures nouvelles du PLFSS 2014 mais aussi du fait quen cas de consommation infrieure auxprvisions lanne prcdente, cette sous-consommation pourra tre reporte lanne suivantedans la limite du montant vot par le Parlement sur le sous-objectif ddi au FIR. Les travaux sepoursuivront en 2014 avec les ARS sur le pilotage du FIR quil sagisse de la gestion financirede ces crdits, des modalits de reporting et des consquences tirer de lidentification du FIR
comme un sous objectif de lONDAM.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
15/54
11
Au total, avant conomies, les dpenses du champ de lONDAM progresseraient de 3,8 % en2014 incluant la progression tendancielle des dpenses, les provisions ainsi que les effets reportdconomies lances en 2013.
I.2.4 Les mesures nouvelles dconomies
Afin daboutir un objectif de dpenses en progression de 2,4 % par rapport aux ralisationsprvisionnelles 2013 primtre constant, un montant global dconomies de 2,4 Mdestncessaire pour la construction de lONDAM 2014, 500 Mdconomies tant constates parailleurs en 2013 et retenues dans la base de construction 2014, soit un total de 2,9 Md. Le dtaildes mesures est dcrit dans lannexe 9 au PLFSS.
Lensemble des acteurs du systme de soins participeront leffort dconomie avec :
- des conomies sur les prix des mdicaments hauteur de 960 M, dont 90 Mportent surceux inscrits sur la liste en sus ;
- des baisses de prix des dispositifs mdicaux dun montant total de 120 Mdont 50 Mau
titre de la liste en sus ;
- le renforcement de lefficience du systme de soins avec la matrise mdicalise mene parlassurance maladie et les agences rgionales de sant (600 M) ;
- lamlioration de la performance lhpital (440 M avec en particulier la poursuite deloptimisation des achats et lamlioration de lefficience et de la pertinence de la prise en charge) ;
- la baisse des tarifs de certains actes notamment de biologie et de radiologie (130 M), prvuedans les conventions.
I.2.5 LONDAM pour 2014
Compte tenu des volutions tendancielles et des conomies mentionnes ci-dessus, lobjectifde dpenses pour 2014 stablit 179,2 Md, en progression de 2,4 % par rapport aux objectifsarrts pour 2013, aprs prise en compte des corrections mentionnes ci-dessus (cf. tableau I.2.1).
Tableau I.2.2 : montants et taux dvolution de lONDAM 2014
Base 2014 Sous-objectifsTaux
dvolution
Soins de ville 79,3 81,2 2,4 %
tablissements de sant 73,8 75,5 2,3 %
tablissements et services mdico-sociaux 17,1 17,6 3,0 %
Contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissementset services pour personnes ges 8,4 8,6 2,9 %
Contribution de lassurance maladie aux dpenses en tablissementset services pour personnes handicapes 8,7 9,0 3,1 %
Dpenses relatives au fonds dintervention rgional 3,1 3,2 2,4 %
Autres prises en charge 1,6 1,7 5,6 %
ONDAM TOTAL 174,9 179,2 2,4 %
Les dpenses de soins de ville progresseraient de 2,4 % et celles affrentes aux tablissementsde sant de 2,3 %. La contribution de lassurance maladie aux dpenses des tablissements etservices mdico-sociaux augmenterait de 3,0 %. Les dpenses relatives au FIR progresseraient de2,4 %. Enfin, les dpenses relatives aux autres modes de prise en charge progresseraient de 5,6 %.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
16/54
12
Par ailleurs, une mise en rserve de dotations, pour un montant au moins gal 0,3 % delONDAM vot, sera mise en uvre. En 2014, la mise en rserve sera de 545 M.
I.3 ONDAM et comptes de branchesLONDAM est un objectif inter-branches, puisquil porte tant sur des dpenses de la branchemaladie que sur certaines dpenses de la branche accidents du travail maladies professionnelles.Le passage de lONDAM aux objectifs de dpenses des branches fait intervenir plusieursmcanismes.
Il est sujet tout dabord des effets de champ : au sein des objectifs de dpenses des branchessont pris en compte des postes de charges plus nombreux que ceux intgrs dans le champ delONDAM, comme le montre le tableau ci-dessous portant sur le primtre qui tait celui de 2013.
Tableau I.3.1 : composition de lONDAM et des comptes de branches pour lexercice 2013
Objectif de la branche maladie,maternit, invalidit dcs Objectif de la branche AT-MP
Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM
A. gestion technique
I. Prestations sociales- part des prestations
mdico-sociales financepar la CNSA
- prestations en espce =IJ maternit
- prestations invaliditdcs
- prestations extra-lgales(action sanitaire etsociale)
- actions de prvention- autres prestations
I. Prestations lgalesmaladie maternit :- prestations en nature
maladie maternit (horspart des prestationsmdico-sociales financepar la CNSA, horsconventionsinternationales),minores des remisesconventionnellespharmaceutiques
- prestations en espce(hors IJ maternit,prestations dinvalidit)
I. Prestations pourincapacit temporaire :- prestations en nature- prestations en espce
suite AT (IJ )
- prestations pourincapacit permanente
II. Charges techniques II. Charges techniques, dont :- dotation ONDAM
mdico-social la CNSA- prise en charge de
cotisations desprofessionnels libraux
- autres transferts (FIR
pour les missionsex-FMESPP et ex-FIQCS,FAC, FMESPP)
II. Charges techniques- dotations aux fondsamiante
III. Diverses charges III. Diverses charges
IV. Dotations aux provisionssur les dpenses horsONDAM
IV. Dotations aux provisionssur les dpenses horsONDAM
V. Charges financires V. Charges financires
B. gestion courante
- aide la tltransmission
Source : DSS
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
17/54
13
Le champ des prestations de lONDAM est plus limit que celui des prestations dassurancemaladie (il ne couvre pas les prestations en espces maternit ou invalidit, ni partir de 2010les dpenses relatives aux soins en France dassurs de rgimes trangers que lassurancemaladie prend en charge avant de se faire rembourser au titre de conventions internationales,par exemple) et surtout que celui des prestations de la branche AT-MP (il ne retrace que les
prestations en nature et les indemnits journalires compensant une incapacit temporaire ;les rentes verses par la branche ou les dotations quelle verse aux fonds amiante FIVA,FCAATA - ne sont donc pas dans lONDAM).
Il est noter galement quune part des dpenses de lONDAM na pas le caractre de prestations :dotations aux fonds (FIQCS, FAC, FMESPP), prise en charge des cotisations sociales desprofessionnels de sant, aides la tltransmission, etc.
Ds lors, le rythme dvolution des charges de lensemble des rgimes de base maladie ou durgime gnral est tributaire de dynamiques variables pouvant affecter ces diffrents postes decharges. Cest lune des raisons pour lesquelles ce rythme peut scarter sensiblement du tauxdvolution de lONDAM. Ceci est en particulier vrai pour la branche accidents du travail/maladiesprofessionnelles dans laquelle le poids de lONDAM est limit 30 % environ des charges etse rduit constamment avec la part croissante des dpenses lies aux fonds amiante. Pour lamaladie, le poids de lONDAM reste trs important : il reprsente environ 80 % des charges dela CNAMTS.
Ensuite, lONDAM et les objectifs de dpenses reposent sur des concepts de nature trsdiffrente. LONDAM est un concept de nature conomique, alors que les dpenses des rgimessont tributaires de rgles comptables.
Enfin, les objectifs de dpenses prsents en LFSS sont des objectifs propres au rgime gnralou bien reposant sur laddition des donnes de lensemble des rgimes de base obligatoires,alors que lONDAM est construit demble comme un objectif inter-rgimes. Or, les dpensesde prestations de chaque rgime sont influences par des facteurs sociodmographiques quilui sont propres, ce qui peut conduire leur volution individuelle diffrer sensiblement de cellede lONDAM.
Ainsi, le caractre conomique, inter-rgimes et priodiquement actualisable de lONDAM diffredu caractre comptable, reposant sur la consolidation des comptes de chaque rgime et construit partir des comptes dfinitivement clos de lanne prcdente des objectifs de dpenses duPLFSS. Lexercice de prvision ncessaire la construction dobjectifs de dpenses cohrentsavec lONDAM repose donc sur de nombreux retraitements et conventions.
La fiche 7.4 du rapport de la Commission des comptes de la Scurit sociale de septembre 2013dcrit en dtail le passage des dpenses du champ de lONDAM aux prestations maladie-maternit des comptes de la CNAMTS.
Compte tenu des modifications de primtre mentionnes ci-dessus, le tableau pour lexercice
2014 sen trouve modifi comme suit :
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
18/54
14
Tableau I.3.2 : composition de lONDAM et des comptes de branches pour lexercice 2014
Objectif de la branche maladie,maternit, invalidit dcs Objectif de la branche AT-MP
Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM
A. gestion technique
I. Prestations sociales- part des prestations
mdico-sociales financepar la CNSA
- prestations en espce =IJ maternit
- prestations invaliditdcs
- prestations extra-lgales(action sanitaire etsociale)
- actions de prvention
hors FIR- autres prestations
I. Prestations lgalesmaladie maternit :- prestations en nature
maladie maternit (horspart des prestationsmdico-sociales financepar la CNSA, horsconventionsinternationales), minoresdes remisesconventionnellespharmaceutiques et de laparticipation desassurancescomplmentaires larmunration du forfaitmdecin traitant
- prestations en espce(hors IJ maternit,prestations dinvalidit)
-actions de prvention(INPES, FIR)
I. Prestations pourincapacit temporaire :- prestations en nature- prestations en espce
suite AT (IJ )
- prestations pourincapacit permanente
II. Charges techniques II. Charges techniques,dont :- dotation ONDAM
mdico-social la CNSA
- prise en charge decotisations desprofessionnels libraux eten centres de sant
- autres transferts(primtre largi : FIRpour les missionsex-FMESPP et ex-FIQCS,FMESPP, ABM, ATIH,OGDPC, FAC, )
II. Charges techniques- dotations aux fonds
amiante
III. Diverses charges III. Diverses charges
IV. Dotations aux provisionssur les dpenses horsONDAM
IV. Dotations aux provisionssur les dpenses horsONDAM
V. Charges financires V. Charges financires
B. gestion courante
- aide la tltransmission
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
19/54
15
Partie II : ONDAM et besoins de sant publique
Tout en visant au respect de lONDAM, le Gouvernement veille sassurer que le montant desdpenses dassurance maladie permettra damliorer la prise en charge des besoins sanitaires
de faon quilibre au niveau local ou, du moins, de contribuer la rduction des ingalitsdaccs aux soins entre territoires.
Laction des pouvoirs publics dans le domaine de la rduction des ingalits sociales et territorialesde sant sest concrtise par la cration des agences rgionales de sant (ARS), dcide dans lecadre de la loi Hpital, patients, sant et territoires (HPST) de juillet 2009. Des moyens financierspropres sont allous aux ARS avec notamment la cration du fonds dintervention rgional (FIR)dans la loi de financement de la Scurit sociale pour 2012 cf.infra. En mettant la dispositiondes agences des ressources partiellement fongibles entre les diverses interventions, la crationde ce fonds renforce lefficacit des ARS dans la rduction des ingalits sociales et territorialesde sant, et leur permet davoir une approche dcloisonne de la sant.
Pour mener des actions pertinentes de matrise de la dpense de sant, il est important decomprendre les dterminants de cette dpense et les facteurs explicatifs de son volution, nonseulement sous langle des comptes sociaux, en la rpartissant entre les segments de loffre desoins (hpital, mdecins, mdicaments), mais de manire plus fondamentale, en rfrence leur objectif initial, qui est de prodiguer les meilleurs soins aux patients avec une prise en chargeoptimale. En donnant une visibilit sur ce quoi sont utilises in fineles ressources, lanalysemdicalise des dpenses contribue mieux articuler le dbat sur les moyens et celui sur lesfinalits du systme de soins et les objectifs de sant publique.
Dans cette partie de lannexe, la premire section prsente la cartographie des dpenses parsegment de population mise en uvre par la CNAMTS depuis 2012 (5). Cette cartographie desdpenses permet de disposer dlments sur lONDAM, qui ne sintressent plus uniquement la seule dpense, mais galement aux aspects de cot de prise en charge de la sant des
populations travers une analyse des cots par pathologie. Lanalyse mdicalise des dpensesde lONDAM consiste prendre en compte toutes les pathologies pour lesquelles un patient esttrait de manire dtaille. Elle permet ainsi dobtenir une meilleure rpartition des dpenses,en isolant les dpenses imputables aux diffrentes pathologies et danalyser leurs associationset les polypathologies, ce qui constitue une avance importante dans lanalyse des dpenses.
La deuxime section prsentera le rle du FIR dans le dispositif de matrise des dpenses desant au niveau rgional travers la description de ses principes et fonctionnement. Lanalysedes disparits territoriales de sant traditionnellement prsente dans lannexe est ensuite menepour la premire fois partir dune exploitation des tats financiers des ARS.
II.1 Une analyse mdicalise des dpensesde lONDAM
Apprhender la nature et lampleur des problmes de sant qui sadressent au systme de soinsconstitue un lment de connaissance essentiel pour asseoir une stratgie de sant.
Lanalyse, ralise partir des donnes de remboursement des soins, permet de cartographierles dpenses dassurance maladie en fonction des pathologies prises en charge et danalyserles problmes de sant sous-jacents et les enjeux pidmiologiques, ainsi que la rpartition desprises en charge en fonction des diffrents secteurs doffre de soins(6).
(5) CNAMTS (2013), Rapport charges et produits au titre de 2014.
(6) Cette rpartition sappuie sur un travail ralis partir des donnes du systme dinformation de lassurance maladie et qui a
consist, dans un premier temps, reprer pour chaque bnficiaire lensemble de ses pathologies ( laide des diagnostics portsen cas dhospitalisation ou en cas dALD et ventuellement des traitements mdicamenteux), et dans un deuxime temps rparti rles dpenses entre ces pathologies, pour chacun des postes (soins de mdecins, mdicaments, sjours hospitaliers). Pour uneprsentation plus approfondie et dtaille de la mthodologie, se repor ter au Rapport Charges et produits pour 2014 de la CNAMTS.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
20/54
16
Pour chaque pathologie ou processus de soins, lanalyse peut ainsi tre approfondie en identifiantles soins fournis au titre de chacune des catgories doffreurs de soins, mettant en vidence lesdiffrences de pratique et de cot, ainsi que, ultrieurement, les corrlations avec les rsultatsde sant. Elle peut ensuite donner lieu des analyses plus f ines des processus de soins relatifs certaines pathologies, pour rechercher les voies dune amlioration des rsultats de sant aussi
bien que dune optimisation des ressources.
II.1.1 La rpartition mdicalise des dpenses de lONDAM en 2011
Hors tablissements mdico-sociaux et hors certains fonds et dotations forfaitaires (7), lesdpenses dassurance maladie, pour lensemble des rgimes, se sont leves en 2011 146 Md.Ces dpenses se rpartissent par grands groupes de pathologies comme reprsent dans lafigure suivante (cf.figure II.1.1).
Figure II.1.1 : montant des dpenses rembourses par pathologie en 2011
14,5
1,5
29,9
9,4
3,7
1,3
4,5
3,4
3,8
6,1
22,6
14,5
15,7
14,7
0 5 10 15 20 25 30 35
Soins courants
Traitements analgsiques AINS hors categ. prcdentes
Hospitalisations ponctuelles
Maternit
Autres affections de longue dure (ALD)
Maladies du foie et pancras
Maladies inflammatoires, rares et VIH
Insuffisance rnale chronique terminale (IRCT)
Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique
Pathologies neuro-dgnratives
Pathologies psychiatriques & psychotropes
Cancers
Diabte et autres facteurs de risque cardiovasculaire
Pathologies cardiovasculaires
Milliards
Note : Tous postes de dpenses confondus. Extrapolation tous rgimes.Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
La part de chacune des pathologies dans lensemble des dpenses permet de retrouver le poids
majeur des pathologies lourdes et chroniques qui reprsentent 63 % des dpenses totales(cf.figure II.1.2).
(7) Le champ couvert par les dpenses rparties dans la car tographie exclut les dpenses non individualisables par patient : lesmissions dintrt gnral et daide la contractualisation (MIGAC), le fonds de modernisation des tablissements de sant publicset privs (FMESPP), fonds des actions conventionnelles (FAC), fonds dintervention rgional (FIR) . Elles comprennent en revanche
les indemnits journalires pour maternit et les dpenses pour invalidit. Pour 2011, les dpenses dONDAM tous rgimes sontde 166,6 Md, auxquelles on rajoute 3 MddIJ maternit et 5,6 Mdde dpenses dinvalidit, et on soustrait 29,8 Md, dontles principales composantes sont les dpenses du secteur mdico-social (15,8 Md) et les MIGAC (8,1 Md).
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
21/54
17
Figure II.1.2 : rpartition en pourcentage des dpenses remboursesselon les pathologies et traitements
10%
6%
5%
10%
10%
6%4%
3%3%
3%
2%1%
6%
21%
11%
Pathologies cardiovasculaires
Facteurs de risque cardiovasculaire (sans pathologies)
Diabte
Cancers
Pathologies psychiatriques
Psychotropes (sans pathologies psychiatriques)
Pathologies neuro-dgnratives
Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique
Insuffisance rnale chronique terminale (IRCT)
Maladies inflammatoires, rares et VIH
Maladies du foie et pancras
Autres affections de longue dure (ALD)
Maternit
Hospitalisations ponctuelles
Soins courants (dont traitements AINS analgsiques 1%)
Note : Extrapolation tous rgimes.Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
Paralllement, lanalyse met aussi en vidence lenjeu conomique que reprsentent dessituations de recours aux soins plus limites dans le temps, comme la maternit (6 %) et surtoutles hospitalisations ponctuelles (pour chirurgie fonctionnelle par exemple), qui reprsentent 21 %du total. Le reste, soit 10 %, recouvre des soins courants qui concernent une trs large part dela population.
Au sein des pathologies chroniques, les cancers et les maladies cardiovasculaires, qui sontles principales causes de dcs et qui donnent lieu des traitements intensifs, reprsententlogiquement une part trs importante des dpenses rembourses (10 % dans les deux cas). Onpeut noter aussi limportance du diabte, qui reprsente lui seul 5 % (en gardant lesprit quece montant ne comprend pas le cot des complications cardiovasculaires et rnales du diabte,qui sont rattaches aux pathologies correspondantes).
Moins souvent voqu est le poids relativement important des ressources consacres auxpathologies psychiatriques (10 %), et plus encore la sant mentale prise dans un sens trslarge (16 %), si lon inclut la population qui na pas de pathologie psychiatrique identifie lorsdun sjour hospitalier ou une mise en ALD, mais qui prend rgulirement des psychotropes.Limportance de ces pathologies est atteste par les analyses internationales en termes deburden of disease, mme si elles ne font pas partie des maladies constituant les causesprincipales de dcs.
Lanalyse permet galement destimer limpact en termes de cot des maladies neurologiqueset dgnratives, dont la prvalence saccrot avec le vieillissement de la population, et dautresmaladies frquentes ou plus rares (maladies respiratoires, insuffisance rnale chroniqueterminale, maladies inflammatoires).
Les cots de prise en charge des diffrentes pathologies rsultent la fois de leur frquence,cest--dire du nombre de personnes traites par le systme de soins pour ces affections, et ducot de leur traitement, compte tenu des thrapeutiques disponibles et des modalits de soins.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
22/54
18
II.1.2 Frquence des pathologies et traitements parmiles bnficiaires du rgime gnral
Lexploitation des donnes issues du remboursement des soins permet dapprhender lesralits pidmiologiques sous-jacentes ces cots. Si ces lments ne permettent de reprer,
par construction, que les patients traits pour ces pathologies, avec les biais que cela peutentraner(8), et sils ne remplacent videmment pas les enqutes pidmiologiques ni les registresqui permettent dvaluer les prvalences de manire prcise, lexercice qui est men ici prsentelintrt de fournir une photographie densemble des affections dont souffre la population et pourlesquelles le systme de soins est mobilis.
Lanalyse des pathologies concerne uniquement les bnficiaires du Rgime gnral,contrairement lanalyse des cots qui porte sur lensemble des rgimes.
1. Vue densemble
Sur 58,8 millions de personnes qui ont eu des soins rembourss par le Rgime gnral au coursde lanne 2011(9) , 24,4 millions (42 %) ont au moins une pathologie, ou un traitement particulier,ou une maternit, ou un pisode hospitalier ponctuel, individualis par la cartographie. Le reste
de la population (34,3 millions de personnes, 58 %) na eu que des soins courants.
Figure II.1.3 : effectifs de bnficiaires par pathologie/traitement Rgime gnral 2011
7 277 000
1 383 000
1 523 000
458 000
770 000
67 000
2 860 000
1 117 000
5 751 000
1 659 000
2 386 000
2 780 000
8 200 000
3 326 000
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000
Hospitalisations ponctuelles
Maternit
Autres affections de longue dure (ALD)
Maladies du foie et pancras
Maladies inflammatoires, rares et VIH
Insuffisance rnale chronique terminale (IRCT)
Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique
Pathologies neuro-dgnratives
Psychotropes (sans pathologie psychiatrique)
Pathologies psychiatriques
Cancers
Diabte
Facteurs de risque cardiovasculaire (sans pathologie CV)
Pathologies cardiovasculaires
Effectifs
Note : Les bnficiaires peuvent avoir plusieurs pathologies et traitements. La somme des effectifs par pathologie est doncsuprieure leffectif de 24,4 millions de personnes.Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
De manire prvisible, on retrouve les cinq grandes catgories de pathologies chroniquesconnues comme tant les plus frquentes :
-pathologies cardiovasculaires: 3,3 millions de personnes, 5,7 % des bnficiaires ;
- maladies respiratoires chroniques (dont lasthme, la broncho-pneumopathie chroniqueobstructive et linsuff isance respiratoire) : 2,9 millions de personnes, 4,9 % des bnficiaires ;
(8) Ce qui renvoie des ralits pidmiologiques (par exemple laccroissement de la prvalence du diabte, en lien avec la progressionde lobsit), mais aussi la manire dont le systme de soins inter vient sur ces pathologies : tat de sant identique, uneaugmentation du dpistage ou une propension traiter plus prcocement feront apparatre un plus grand nombre de malades.
(9 ) Il sagit des personnes qui ont t affilies au Rgime gnral un moment ou un autre de lanne. Leffectif est donc logiquementsuprieur celui des bnficiaires couverts un moment donn ou couverts tout au long de lanne par le rgime gnral. Enoutre, il y a une lgre surestimation lie des doubles comptes pour des personnes changeant de statut (ayants droit/assurs).
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
23/54
19
- diabte : 2,8 millions de personnes, 4,7 % des bnficiaires ;
- ensemble des cancers : 2,4 millions de personnes, 4,1 % des bnficiaires ;
- pathologies psychiatriques : 1,7 million de personnes, 2,8 % des bnficiaires.
Il sagit uniquement ici des pathologies qui ont constitu un motif dhospitalisation dans les cinqdernires annes ou qui donnent lieu une prise en charge en ALD.
Dautres groupes htrognes incluent des pathologies moins frquentes : les affections de longuedure non comprises dans les autres catgories (2,6 % au total), les pathologies neurologiqueset dgnratives (1,9 %), un groupe constitu de maladies inflammatoires, de maladies rares etdu VIH (1,3 %), et un groupe comprenant des maladies du foie et du pancras (0,8 %).
Il faut souligner quune mme personne peut cumuler plusieurs pathologies ou motifs de recours,et quil nest donc pas possible dadditionner les effectifs relatifs chacune dentre elles.
Outre ces pathologies repres partir des diagnostics dALD ou dhospitalisation, la cartographiemdicale identifie des groupes de patients traits par des mdicaments dusage relativementfrquent et spcifique : les antihypertenseurs, hypolipmiants, antidpresseurs, anxiolytiques,
hypnotiques et neuroleptiques. Pour ces groupes, seuls les patients nayant pas dj une maladieidentifie (certaines pathologies cardiovasculaires ou diabte pour les traitements du risquevasculaire, pathologies psychiatriques pour les traitements psychotropes), ont t considrs :
- des traitements antihypertenseurs et hypolipmiants ont t dlivrs (10) respectivement 11 %et 6,7 % des bnficiaires (au total 14 % des personnes sont traites par lune ou lautre deces catgories) ;
- 5,8 millions de personnes prennent des traitements psychotropes(10), soit 10 % des bnficiaires.Les proportions sont de 5,5 %, 4,8 %, 3 % et 0,6 % respectivement pour les mdicamentsanxiolytiques, antidpresseurs et lithium, hypnotiques et neuroleptiques.
Au total, ce sont prs de 13 % des bnficiaires (7,4 millions de personnes) qui ont soit une
pathologie psychiatrique identifie (2,8 %), soit un traitement psychotrope dans lanne maissans pathologie retrouve (10 %). Leffectif est plus lev si lon ajoute aux critres dALD,dhospitalisation pour trouble psychiatrique ou de traitement par psychotropes dautres critrescomplmentaires, notamment les motifs darrts de travail de plus de six mois, ou les motifsdinvalidit, ou encore les diagnostics associs poss lors dune hospitalisation qui nest pasmotive par une pathologie psychiatrique (par exemple une dpression code en diagnosticassoci pour un patient ayant un traitement pour cancer). Avec cette dfinition plus extensiveque celle qui a t retenue dans lanalyse mdicalise globale, on dnombre 8,2 millions depersonnes de plus de 18 ans.
(10) Sont compts ici les patients tant identifis par leur seul traitement mdicamenteux (avec au moins trois dlivrances danslanne) lexclusion des patients souffrant dautres pathologies et compts par ailleurs notamment parmi les maladiescardiovasculaires ou le diabte. titre dexemple, les patients traits par antihypertenseurs sont 9,6 millions (16,4 % des
bnficiaires), on en compte 6,5 millions traits par des hypolipmiants (11,1 %). De mme pour les mdicaments psychotropes,ces taux atteignent en population gnrale, 6,8 %, 6,1 %, 3,8 % et 1,5 % pour les mdicaments anxiolytiques, antidpresseurset lithium, hypnotiques et neuroleptiques.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
24/54
20
2. La frquence des pathologies selon lge
La frquence des pathologies et traitements augmente avec lge, de manire variable selon lesmaladies (cf.figure II.2.1).
Figure II.2.1 : frquence des pathologies et traitements selon lge Rgime gnral 2011
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
De 0 14 ans De 15 34 ans De 35 54 ans De 55 64 ans De 65 74 ans 75 et plus
Total pathologies cardiovasculaires
Total cancers
Pathologies psychiatriques
Psychotropes sans pathologie psychiatrique
Total pathologies neurologiques
Asthme BPCO Insuff respiratoire chronique
Autres ALD (dont ALD 31, 32)
Diabte
Traitements anti-HTA et hypolipmiants
sans pathologie cardiovasculaire ni diabte
Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
Chez les adultes gs de 65 74 ans, les pathologies cardiovasculaires et le diabte dominent(16 % pour chaque groupe). Viennent ensuite les cancers (13 %) et les maladies respiratoireschroniques (8,5 %). Dans cette tranche dge, 42 % des personnes prennent des traitementsantihypertenseurs et/ou hypolipmiants (hors certaines pathologies cardiovasculaires identifieset diabte), et 22 % des psychotropes (hors pathologie psychiatrique identifie). Si lon cumuleles pathologies psychiatriques diagnostiques et les traitements par psychotropes, on trouve25 % de la population de cette tranche dge.
Au-del de 75 ans, prs dune personne sur deux est traite par antihypertenseurs et/ouhypolipmiants (hors patients ayant des pathologies cardiovasculaires identifies ou un diabte).Un tiers sont traites par psychotropes, et si lon y ajoute les pathologies psychiatriques, 37 %
des personnes de cette classe dge sont concernes par des problmes de sant mentale(43 % parmi les femmes). Dans cette tranche dge les pathologies cardiovasculaires sontparticulirement frquentes (32 %), suivies des cancers (17 %) et du diabte (16 %). Les maladiesrespiratoires chroniques et les maladies neurologiques et dgnratives, notamment dmenceset maladie de Parkinson, touchent 12 % des personnes dans cette tranche dge.
3. Les disparits gographiques
La frquence des pathologies est variable sur le territoire. Les cartes par dpartement ci-dessousen donnent quelques illustrations (les taux indiqus sont avant et aprs prise en compte desdiffrences de structures dge) (cf.carte II.1.2). On retrouve le gradient Nord-Sud connu en cequi concerne les maladies cardiovasculaires et le diabte avec des carts entre dpartementsextrmes de 40 % pour les maladies cardiovasculaires et de 1 2,2 pour le diabte (en taux
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
25/54
21
standardiss). La frquence plus leve des pathologies psychiatriques diagnostiques enBretagne, dans le centre de la France et dans le Sud renvoie probablement des logiquesdoffre de soins, au-del des caractristiques des populations, avec des carts trs importants,de 1 2,3 entre dpartements extrmes (toujours en taux standardiss).
Carte II.1.2 : frquence des pathologies selon les dpartements Rgime gnral 2011
Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
Taux brut
4,34 % - 5,61 %5,62 % - 6,19 %
6,21 % - 6,70 %
6,72 % - 8,66 %
Maladies cardiovasculairespar dpartement
Taux standardis
4,87 % - 5,41 %5,41 % - 5,71 %
5,71 % - 5,99 %
5,99 % - 6,88 %
Maladies cardiovasculairespar dpartement
Taux brut
2,72 % - 4,32 %
4,34 % - 4,88 %
4,91 % - 5,25 %
5,29 % - 7,04 %
Diabtepar dpartement
Taux standardis
3,04 % - 4,13 %
4,13 % - 4,46 %
4,48 % - 4,97 %
5,00 % - 6,81 %
Diabtepar dpartement
Taux brut
2,06 % - 2,62 %
2,63 % - 3,07 %
3,07 % - 3,40 %
3,41 % - 5,10 %
Maladies psychiatriques hors traitementpar dpartement
Taux standardis
2,08 % - 2,61 %
2,67 % - 3,02 %
3,02 % - 3,27 %
3,30 % - 4,71 %
Maladies psychiatriques hors traitementpar dpartement
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
26/54
22
4. Les combinaisons de pathologies et la polypathologie
Dans ce qui prcde, les pathologies, traitements et pisodes de soins ont t analysssparment. Mais on sait quune des problmatiques auxquelles le systme de soins estconfront est limportance croissante de la polypathologie, lie notamment lallongement de
lesprance de vie et lamlioration de la qualit des soins. Lanalyse croise des pathologies etdes traitements montre que cette situation de pathologies et traitements multiples est frquente.
Si lon se limite aux pathologies diagnostiques, 21 % des bnficiaires ont au moins unepathologie dans une grande catgorie (une maladie cardiovasculaire, un cancer, une maladieinflammatoire). Parmi eux, prs de 30 % en ont au moins une dans une autre catgorie (cest--dire une maladie cardiovasculaire et un cancer, ou un diabte et une maladie psychiatrique,etc.), 8 % en ont au moins deux autres et 2 % au moins trois (cf.tableau II.4.1).
Si lon inclut non seulement les pathologies diagnostiques mais galement les traitementspar antihypertenseurs, hypolipmiants et psychotropes, et si lon comptabilise non plus lescatgories, mais les pathologies elles-mmes, ce sont 35 % des bnficiaires qui ont au moinsune pathologie ou un traitement. Parmi ceux-ci, la moiti en ont au moins deux, 23 % au moins
trois et 10 % au moins quatre.Les pathologies cardiovasculaires et les cancers sont les groupes de pathologies dans lesquelsles bnficiaires cumulent davantage de comorbidits : 82 % des patients ayant une maladiecardiovasculaire ont au moins une autre pathologie ou un autre traitement, et 33 % au moinstrois autres ; ces proportions sont respectivement de 76 % et 28 % pour les patients atteintsde cancer.
Tableau II.4.1 : nombre et pourcentage de patients ayant plusieurspathologies et/ou traitements Rgime gnral 2011
Combinaisons des grandes catgories de pathologies (10 regroupements de pathologies
hors traitements hors maternit et hospitalisations ponctuelles)
Parmi lensemble de la population Parmi ceux avec au moinsune pathologie
Aucune 46 474 600 79,1 %
Nombrede grandescatgoriesassocies
1 seule 8 766 900 14,9 % 8 766 900 71,4 %
>=2 3 511 700 6,0 % 3 511 700 28,6 %
>=3 921 700 1,6 % 921 700 7,5 %
>=4 196 900 0,3 % 196 900 1,6 %
Population 58 753 200 100,0 % 12 278 600 100,0 %
Combinaisons de toutes les pathologies et tous les traitementshors maternit et hospitalisations ponctuelles
Parmi lensemble de la population Parmi ceux avec au moinsune pathologie
Aucune 38 117 600 64,9 %
Nombre depathologies(tops) associes
1 seule 10 583 000 18,0 % 10 583 000 51,3 %
>=2 10 052 600 17,1 % 10 052 600 48,7 %
>=3 4 789 000 8,2 % 4 789 000 23,2 %
>=4 2 111 800 3,6 % 2 111 800 10,2 %
Population 58 753 200 100,0 % 20 635 600 100,0 %
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
27/54
23
Combinaisons de toutes les pathologies et tous les traitements hors maternit ethospitalisations ponctuelles selon lexistence dune grande catgorie de pathologies
Maladiescardiovasculaires Diabte Cancers
Maladiesrespiratoires
chroniques
Maladiespsychiatriques
N % N % N % N % N %
Nombre depathologies(tops)associesen 2011
1 seule 610 400 18,4 % 1 098 900 39,5 % 563 600 23,6 % 1 243 200 43,5 % 726 500 43,8 %
>=2 2 715 300 81,6 % 1 680 800 60,5 % 1 822 100 76,4 % 1 616 300 56,5 % 932 300 56,2 %
>=3 1 875 400 56,4 % 899 800 32,4 % 1 195 700 50,1 % 1 078 500 37,7 % 439 700 26,5 %
>= 4 1 095 900 33,0 % 450 800 16,2 % 661 300 27,7 % 633 800 22,2 % 178 400 10,8 %
Population 3 325 700 100,0 % 2 779 600 100,0 % 2 385 600 100,0 % 2 859 500 100,0 % 1 658 800 100,0 %
Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
5. La composition des dpenses par pathologie et par poste de soinsSelon les pathologies, la composition des dpenses par poste de soins est trs variable (cf.figureII.5.1). On note ainsi le poids de la pharmacie pour le groupe des maladies inflammatoires, desmaladies rares et du VIH. Lhospitalisation (sances en centres dhmodialyse) et les transportsconstituent lessentiel des dpenses imputables linsuffisance rnale chronique, qui sontpour lessentiel des cots de dialyse. Avec lhospitalisation en tablissement psychiatrique, lesprestations en espces (indemnits journalires mais aussi invalidit) sont une composanteimportante du cot des maladies mentales.
Figure II.5.1 : rpartition des dpenses des grands groupesde pathologies ou de prises en charge par postes 2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Asthme, BPCO, insuff. respir. chronique
Autres affections de longue dure (ALD)
CancersFacteurs de risque cardiovasculaire
Hospitalisations ponctuelles
insuffisance rnale chronique terminale
Maladies du foie et pancras
Maladies inflammatoires, rares et VIH
Maternit
Pathologies cardiovasculaires
Pathologies neuro-dgnratives
Pathologies psychiatriques & psychotropes
Soins courants
Total gnral
Pharmacie
Soins autres spcialistes
Transports
Soins infirmiers
Biologie
Liste des produits et prestations remboursables (LPP)
Autres postes de soins de ville
Indemnits journalires maladie et AT/MP
Hospitalisations MCO (Mdecine, Chrirurgie,
Obsttrique et Odontologie)
Hospitalisation en psychiatrie
Soins de gnralistes
Soins dentaires
Soins de kinsithrapie
Hospitalisations en SSR (soins de suite et radaptation)
Indemnit Journalires maternit
Prestations d'invalidit
Note : extrapolation tous rgimes.Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
28/54
24
La rpartition peut galement tre analyse selon la grille de lecture inverse : quels sont les typesde patients qui ont recours tel ou tel type de soins, et vers qui lactivit des professionnelsest-elle oriente ? On observe par exemple que les malades qui sont transports sont notammentdes patients atteints de cancer (23 %), dinsuffisance rnale chronique (17 %) et de pathologiespsychiatriques (15 %) (cf.figure II.5.2).
Figure II.5.2 : rpartition des postes de dpenses pargrands groupes de pathologies ou prises en charge
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dpenses totales rembourses (soins de ville et hpital)
Dpenses totales rembourses soins de ville
Pharmacie
Soins de gnralistes
Soins autres spcialistes
Soins dentaires
Transports
Soins de kinsithrapie
Soins infirmiers
BiologieListe des produits et prestations remboursables (LPP)
Autres postes de soins de ville
Indemnits journalires maladie et AT/MP
Dpenses totales rembourses hospitalisations
Hospitalisations MCO (Mdecine, Chrirurgie, Obsttrique et Odontologie)
Hospitalisations en SSR (soins de suite et radaptation)
Hospitalisation en psychiatrie
Indemnit journalires maternit
Prestations d'invalidit
Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire chronique Autres affections de longue dure (ALD) Cancers Facteurs de risque
cardiovasculaire
Hospitalisations ponctuelles
Insuffisance rnale chronique terminale Maladies du foie et pancras Maladies inflammatoires,
rares et VIH
Mate rnit Pathologi es cardi ovascul aire s
Path ologie s neuro-dgn ratives Pathol ogies psychia triques & psycho tropes Soins courants
Note : extrapolation tous rgimes.Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
II.1.3 Lvolution des effectifs et des dpenses entre 2010 et 2011
Le nombre de bnficiaires du Rgime gnral ayant recours aux soins sest accru de 1 %entre 2010 et 2011. La moiti de cette volution (+ 0,5 %) reflte la croissance dmographique dela population franaise. Sur les 0,5 % restants, une partie est sans doute due la part croissanteprise par le Rgime gnral dans la couverture de la population, mais cette volution est difficile estimer avec prcision.
Les pathologies ayant les plus fortes croissances en termes de nombre de malades traits sontle diabte (+ 3,8 %), le groupe des maladies inflammatoires, maladies rares et VIH (+ 3,8 %, dont+ 7,1 % pour la spondylarthrite ankylosante, + 4,3 % pour la polyarthrite rhumatode, + 3,9 %pour les maladies inflammatoires chroniques de lintestin), linsuffisance rnale chroniqueterminale (+ 3,5 %) (cf.figure II.6.1).
Le taux dvolution trs rapide observ sur les maladies psychiatriques (+ 6,2 %) ne reflteprobablement pas une ralit pidmiologique, mais au moins en partie un meilleur reprageli la monte en charge du PMSI (Programme de mdicalisation des systmes dinformation)psychiatrique. On observe dailleurs, concomitamment, une baisse du nombre de consommantsde psychotropes sans pathologie identifie (- 2,3 %), ce qui conforte cette hypothse. Si loncumule les deux groupes de population, leffectif total est lgrement dcroissant (- 0,5 %).
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
29/54
25
Le nombre de patients pris en charge pour une pathologie respiratoire chronique saccrot de+ 3,2 %. La mme volution sobserve globalement pour les maladies cardiovasculaires, avecune certaine stabilisation pour les pisodes aigus (+ 0,4 %). Le nombre de personnes traitespour hypertension ou hyperlipidmie sans avoir de maladie cardiovasculaire identifie est stablegalement.
Le nombre total de patients atteints de cancer apparat presque stable (+ 0,3 %), mais le nombrede cancers en phase active, qui reprsentent 80 % des dpenses totales, saccrot de + 2,9 %.
Concernant les pisodes plus ponctuels de recours aux soins, leffectif de femmes ayant dessoins au titre de la maternit diminue (- 1,5 %) ce qui est cohrent avec lvolution du nombrede naissances en 2011 ; linverse le nombre de personnes qui ont t hospitalises pour unmotif sans rapport avec les pathologies chroniques dcrites ci-dessus augmente (+ 2,4 %).
Si la fraction de la population qui a au moins une pathologie ou un traitement mdicamenteuxchronique identifis nvolue pas (elle reprsente en 2010, comme en 2011, 35,1 % du total desbnficiaires ayant utilis le systme de soins dans lanne), les combinaisons de pathologiespour un mme patient sont plus frquentes.
Figure II.6.1 : volution entre 2010 et 2011 des dpenses totales,des effectifs et des dpenses moyennes
-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Maternit
Cancers surveills
Traitements anti-HTA et hypolipmiants*
Asthme BPCO
Hospitalisations ponctuelles
Pathologies cardiovasculaires aigues
Maladies du foie
Pathologies cardiovasculaires chroniques
Cancers en phase active
Diabte
Pathologies neuro-dgnratives
Pathologies psychiatriques et psychotropes
Insuffisance rnale chronique terminale
Maladies inflammatoires, rares et VIH
volutiondes dpenses
volutiondes effectifs
volutionde la dpensemoyenne
* Hors patients ayant certaines pathologies cradiovasculaires ou un diabte
Note : Tous rgimes (par extrapolation).Source : CNAMTS, Analyse mdicalise de lONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
Entre 2010 et 2011, les dpenses totales prises en charge par le rgime gnral (sur le champ quipeut tre rparti (11)) ont augment de + 2 %, soit 2,8 milliards deuros. Les principales volutionsen montant concernent les hospitalisations ponctuelles (+ 560 millions deuros), les pathologiescardiovasculaires (+ 430 millions deuros), les cancers (+ 360 millions deuros).
(11) Rappel : il sagit des dpenses de lONDAM hors tablissements et services mdico-sociaux, hors MIGAC, FMESP, FAC et, FIR(tous ces postes de dpenses ntant pas individualisables par patient), auxquelles sont ajoutes les dpenses dIJ maternit et
dinvalidit. Les dpenses correspondantes sont de 145,8 Md
en 2011 et de 142,9 Md
en 2010, soit une augmentation de 2 %.Cette croissance est infrieure celle de lONDAM, notamment du fait de lexclusion des dpenses mdico-sociales dontlvolution est plus dynamique.
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
30/54
26
Lvolution est contraste selon les pathologies. Les croissances les plus rapides sont observespour le groupe des maladies inflammatoires, maladies rares et VIH (+ 6,3 %), pour linsuffisancernale chronique terminale (+ 5,3 %) et pour la sant mentale, au sens large : pathologiespsychiatriques ou traitements psychotropes sans pathologie psychiatrique identifie (+ 4,8 %).Pour ces derniers, comme dit prcdemment, les volutions entre 2010 et 2011 sont entaches
dun biais li lamlioration de lexhaustivit du PMSI psychiatrique qui conduit probablement un meilleur reprage des pathologies par les diagnostics hospitaliers en 2011. On peut nanmoinsnoter que si lon cumule pathologies et traitements, la progression globale est assez soutenue(+ 4,8 %).
Viennent ensuite par ordre dcroissant les maladies neurologiques et dgnratives (+ 4,2 %),le diabte (+ 3,4 %), les pathologies cardiovasculaires et les maladies du foie et du pancras(+ 3,0 %), les cancers (+ 2,5 %).
Au sein des pathologies cardiovasculaires, on observe, comme pour les effectifs, des volutionsde dpenses pour les pathologies chroniques suprieures celles des pisodes aigus ; linversepour les cancers, ce sont les dpenses pour les cancers en phase active qui progressent le plusvite, l encore en cohrence avec les volutions deffectifs.
Les progressions les plus modres sobservent pour les hospitalisations ponctuelles (+ 1,9 %) etles pathologies respiratoires (+ 0,8 %). Les cots des traitements hypotenseurs et hypolipmiantssont stables (rappelons quil sagit des patients qui nont ni certaines pathologies cardiovasculairesni un diabte), les dpenses lies la maternit diminuent.
Globalement, ce sont les dynamiques de patients traits qui fondent en 2011 lvolution desdpenses, beaucoup plus que dventuelles volutions de processus de soins qui se traduiraientdans lvolution du cot moyen de traitement par patient.
II.2 Fonds dintervention rgional (FIR)
II.2.1 Principes
Le fonds dintervention rgional (FIR) a t cr par larticle 65 de la loi de financement de lascurit sociale pour 2012 (dispositions codifies aux articles L. 1435-8 L. 1435-11du code dela sant publique). Le dcret n 2012-271 du 27 fvrier 2012 relatif au fonds dintervention rgionaldes agences rgionales de sant(codifi aux articles R. 1435-16 R. 1435-36du code de la santpublique) a prcis ses rgles de fonctionnement. Le FIR est entr en vigueur le 1 ermars 2012.
Des arrts interministriels fixent chaque anne la dotation des rgimes dassurance maladieau fonds et le montant des crdits allous chaque ARS.
Ce sont ainsi les dpenses entrant dans le champ de lassurance maladie qui constituent lenouveau sous-objectif relatif au FIR inclus dans lONDAM, cette proposition ayant reu un avis
favorable des commissions des affaires sociales des deux chambres le 11 septembre 2013. Cesdpenses constituent la part la plus importante du FIR, les dpenses finances par le budgetde ltat (au titre de la prvention) et par la CNSA (au titre des groupes dentraide mutuelle etdes maisons pour lautonomie et lintgration des malades dAlzheimer) en constituant le reste.En 2013, les montants allous par lassurance maladie slvent 3,1 Md, ceux par ltat et laCNSA 213 M.
Le FIR ne dispose pas de la personnalit morale mais possde une comptabilit propre (comptede rsultat, bilan et annexe). Il fait lobjet dun tat prvisionnel des recettes et des dpenses(EPRD) arrt par le directeur gnral de lARS. La Caisse nationale dassurance maladie destravailleurs salaris (CNAMTS) assure la gestion comptable et financire du fonds en lien avecles CPAM.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822 -
5/27/2018 d pensesOndam2014
31/54
27
Le conseil national de pilotage des ARS (CNP) dtermine les orientations nationales du fonds.Il assure en outre le contrle et le suivi de sa gestion et est destinataire cette fin dun rapportdactivit tabli par lARS et dun rapport financier tabli par la CNAMTS.
Le FIR est en outre soumis au contrle conomique et financier de ltat.
Ce fonds a pour vocation de regrouper au sein dune mme enveloppe globale et fongibledes crdits auparavant disperss et visant des objectifs proches ou complmentaires dansle domaine de la continuit et de la qualit des prises en charge, de laccompagnement deladaptation de loffre et de la performance des structures ainsi que de la politique de prvention.Il doit permettre aux ARS de disposer de leviers daction financiers pour mettre en uvre lastratgie rgionale dfinie par le projet rgional de sant (PRS).
Les actions du FIR sont dfinies larticle L. 1435-8 du Code de la sant publique, elles portentsur :
- la permanence des soins ambulatoire et en tablissements de sant ;
- lamlioration de la qualit et de la coordination des soins ;
- lamlioration de la rpartition gographique des professionnels de sant, des maisons desant, des ples de sant et des centres de sant ;
- la modernisation, ladaptation et la restructuration de loffre de soins dans le cadre des contratsprvus larticle L. 6114-1 et conclus avec les tablissements de sant et leurs groupements,ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et daccompagnement desdmarches visant amliorer la performance hospitalire ;
- lamlioration des conditions de travail des personnels des tablissements de sant etlaccompagnement social de la modernisation des tablissements de sant ;
- la prvention des maladies, la promotion de la sant, lducation la sant et la scuritsanitaire ;
- la mutualisation au niveau rgional des moyens des structures sanitaires, notamment en matirede systmes dinformation en sant et dingnierie de projets ;
- la prvention des handicaps et de la perte dautonomie, ainsi que la prise en charge etlaccompagnement des personnes handicapes ou ges dpendantes.
II.2.2 Modalits de financement du FIR
Les ressources du FIR sont constitues dune dotation de lassurance maladie, dune dotationde ltat (issue du programme 204 au titre de la politique de prvention) et, depuis 2013 dunedotation de la Caisse nationale de solidarit pour lautonomie (CNSA). Certains crdits sontprotgs par le principe de fongibilit asymtrique : ainsi, les crdits de prvention ne peuvent
tre employs qu cet usage ; les crdits destins au financement de la prvention des handicapset de la perte dautonomie ainsi quau financement des prises en charge et accompagnementsdes personnes handicapes ou ges dpendantes ne peuvent tre affects qu ces usagesou des actions de prvention.
Fix 1,328 Md sur 10 mois en 2012 (soit 1,536 Md en anne pleine), le montant desressources alloues au FIR a t port 3,3 Mden 2013. Ce montant est constitu partirdes enveloppes dorigine suivantes (tant prcis que les ARS ne sont videmment pas tenuesde respecter les montants par ligne, celles-ci tant fongibles, mais seulement de ne pas dpasserle montant global et de respecter le principe de fongibilit asymtrique) (cf.tableau II.2.1).
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
32/54
28
Tableau II.2.1 : rpartition de la dotation du FIR en 2013
Enveloppe initiale Montant 2013(en M)
Permanence des soins ambulatoires (PDSA) 161
Permanence des soins en tablissements de sant (PDSES) 765
Fonds dintervention pour la qualit et la coordination des soins ( FICQS) - rgional 191
Fonds de modernisation pour les tablissements de sant publics et privs (FMESPP) 198
Crdit prvention Etat - programme 204 139
Crdit prvention assurance maladie 76
Mission dintrt gnral (MIG) centre de dpistage anonyme et gratuit (MIG CDAG) 21
Mission dintrt gnral (MIG) centre prinataux 18
Mission dintrt gnral ducation thrapeutique (MIG ducation thrapeutique) 71
Contrats damlioration de la qualit et de la coordination des soins (CAQCS) 6
Aide la contractualisation (AC) non reconductible affects aux actions de restructuration 1 124
Mission dintrt gnral (MIG) emplois de psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer 27
Mission dintrt gnral (MIG) quipes mobiles de soins palliatifs adul tes et pdiatriques 128
Mission dintrt gnral (MIG) relati fs aux structures de prises en charge des adolescents 15
Mission dintrt gnral (MIG) quipes de liaison addictologie 46
Mission dintrt gnral (MIG) consultations VIH 20
Mission dintrt gnral (MIG) tlsant 8
Mission dintrt gnral (MIG) Cancrologie 79
Groupes dentraide mutuelle (GEM) 27volution des modes de pratique 4
Mission dintrt gnral (MIG) quipes mobiles de griatrie 68
Mission dintrt gnral (MIG) consultations de la mmoire 58
Maisons daccompagnement pour lintgration et lautonomie des malades dAlzheimer - MAIA(hors FICQS) 46
Parcours de sant des personnes ges en risque de perte dautonomie (PAERPA) 12
Dmocratie sanitaire 5
Total 3 313
Le primtre du FIR a ainsi t largi en 2013 par le transfert de nouvelles enveloppes (aides la contractualisation destines favoriser la performance et les restructurations hospitalires),de certaines missions dintrt gnral dont lobjectif est de favoriser une approche transversaledes prises en charge, de crdits en faveur de lamlioration des parcours des personnes ges -comprenant notamment une enveloppe spcifique destine au financement des exprimentationsde parcours de sant des personnes ges en risque de perte dautonomie (PAERPA) ainsi quede crdits de la Caisse nationale de solidarit pour lautonomie (CNSA) pour laccompagnementdes personnes ges et des personnes en situation de handicap (financement des maisonspour lautonomie et lintgration des malades dAlzheimer et des groupes dentraide mutuelle) .
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
33/54
29
II.2.3. Fonctionnement du FIR
La premire anne de fonctionnement du FIR est retrace ici en comparant les crditscorrespondant au financement des diffrentes missions tels quintgrs dans la constructiondu FIR, laffectation quen ont faite les ARS dans les tats prvisionnels des recettes et des
dpenses (EPRD) quelles tablissent et les charges comptabilises (paiements effectus etprovisions constitues) constates par la CNAMTS.
Cette comparaison illustre la premire utilisation par les ARS des marges de manuvre que leurdonne le FIR qui leur permet de redployer des crdits vers des actions juges prioritaires pour laralisation de leur projet rgional de sant. En 2012, les ARS ont ainsi redploy dans leurs EPRDune partie des crdits disponibles pour la permanence des soins (grce un effort importantde rationalisation des lignes de gardes et astreintes), vers des actions de modernisation etdadaptation de loffre, de prvention (y compris vers la prvention des handicaps et de la pertedautonomie) et dincitation la mutualisation des moyens des structures sanitaires.
Tableau II.2.2 : bilan de lutilisation des crdits du FIR en 2012
FIR GLOBAL
Enveloppe indicativefinale (aprs arrt
du 13 dcembre 2012rectificatif)
EPRD 2012avec dcisionmodificative(source ARS)
Chargescomptabilises
(sourceCNAMTS)
Mission 1 Permanence des soins ambulatoireet en tablissements de sant 771 414 322 729 380 105 709 411 088
Mission 2 Amlioration qualit - coordinationdes soins 247 251 894 243 412 304 220 690 957
Mission 3 Modernisation, adaptation,restructuration offre 18 350 000 40 977 816 7 637 067
Mission 4 Amliorations conditions de travail
et Accompagnement social60 000 000 62 666 678 6 970 555
Mission 5Prvention, promotion et ducationpour la sant, veille et scuritsanitaire
230 614 570 242 351 878 225 913 029
Mission 6 Mutualisation des moyens structuressanitaires 3 747 611 91 300
Mission 7 Prvention et prise en charge despersonnes ges et handicapes 1 855 769 306 031
Provisions non ventiles par missionpour les missions 2 7 68 688 909
Autres 600 000 987 772 119 084
TOTAL 1 328 230 786 1 325 379 933 1 239 828 019
produitscomptabiliss
Total 1 329 548 686
dont au titre de lanne N 1 328 230 793
dont report des annes antrieures 1 317 893
rsultat
Excdent de lanne 89 720 666
-
5/27/2018 d pensesOndam2014
34/54
30
Les ARS nont cependant pas consomm la totalit des crdits allous, principalement en raisondu dlai ncessaire la mise en uvre des actions, passant par la contractualisation avec desacteurs du systme de sant. Sur les 89,7 Mnon dpenss, 71 Msont venus rduire laconsommation de lONDAM 2012 et nont pas t reports sur 2013. Ces crdits ont toutefois tmaintenus en base dans le FIR 2013 et sont d