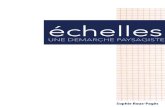Collection David Colon Histoire Livre du professeur · depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale...
Transcript of Collection David Colon Histoire Livre du professeur · depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale...
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
Sous la direction deDavid Colon
Auteurs
David ColonProfesseur agrégé d’histoire, Sciences Po, Paris
Nicolas DavieauProfesseur agrégé d’histoire, Lycée Alexandre Dumas, Saint-Cloud
Sylvain DépitProfesseur agrégé d’histoire, Lycée Julie-Victoire Daubié, Argenteuil
Marianne Durand-LacazeProfesseure certifiée d’histoire-géographie, Académie de Créteil
Louis-Pascal JacquemondIA-IPR honoraire, Académie de Grenoble
Emmanuel JousseProfesseur agrégé d’histoire-géographie, Lycée Galilée, Gennevilliers
Victor LouzonProfesseur agrégé d’histoire, doctorant à Sciences Po
Claire MarynowerMaîtresse de conférences, Sciences Po, Grenoble
Philippe MasanetProfesseur agrégé d’histoire, Lycée Henri-IV, Paris
Simon PeregoProfesseur agrégé d’histoire, Académie de Versailles
Jean-Baptiste PicardProfesseur agrégé d’histoire, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne
Sophie PoussetProfesseure agrégée d’histoire, Lycée Lucie-Aubrac, Courbevoie
Vanina ProfiziProfesseure agrégée d’histoire, Lycée Giocante-de-Casabianca, Bastia
Responsable numérique
Claude RobinotProfesseur agrégé d’histoire-géographie, Académie de Versailles
Hist
oire
T ermL, ES, S
Col
lect
ion
Dav
id C
olon
Nou
velle
édi
tion
8, rue Férou 75278 Paris Cedex 06
www.editions-belin.com
Livre du professeur
Couverture : Mai 68. © Paris Match/Scoop/Georges MeletMise en pages : Catherine Jambois
Le code de la propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » [article L. 122-5] ; il auto-rise également les courtes citations effectuées dans un but d’exemple ou d’illustration. En revanche « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » [article L. 122-4]. La loi 95-4 du 3 janvier 1994 a confié au C.F.C. (Centre français de l’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), l’exclusivité de la gestion du droit de reprographie. Toute photocopie d’œuvres protégées, exécutée sans son accord préalable, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
© Éditions Belin, 2016 ISBN : 978-2-7011-9705-0
Sommaire
Introduction 4
Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé 5
Chapitre 1 L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 5
Chapitre 2 L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie 10
Thème 2 Idéologie et opinion en Europe de la fin du xixe siècle à nos jours 15
Chapitre 3 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 15
Chapitre 4 Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus 20
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle 25
Chapitre 5 Les États-Unis et le monde de 1918 à 1945 25
Chapitre 6 Les États-Unis et le monde depuis 1945 27
Chapitre 7 La Chine et le monde depuis 1949 32
Chapitre 8 Le proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit dans l’entre-deux-guerres 36
Chapitre 9 Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 38
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde 43
Chapitre 10 Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration et opinion publique 43
Chapitre 11 Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948-1992) 48
Chapitre 12 Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht 51
Chapitre 13 La gouvernance économique mondiale de 1944 à 1975 56
Chapitre 14 Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975 58
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
4 HISTOIRE -GÉOGRAPHIE Term
IntroductionCe manuel d’Histoire Terminale appartient à une collection de lycée qui s’inscrit résolument dans les orientations du programme 2012 tout en respec-tant la liberté pédagogique de chaque enseignant :
Les orientations du programme La réponse du manuel Belin
Un approfondissement de l’approche plus problématique, plus synthétique et problématisée dans la continuité de la classe de Première.
Des chapitres synthétiques et problématisés. • Des leçons concises et problématisées qui reprennent strictement les items du programme.
Des « études » délimitées et mises en perspective, portant sur des objets précis et significatifs.
• Le recours systématique à des études problématisées, portant sur des objets pré-cis, mises en perspective par une leçon.
La possibilité pour chaque professeur de construire son itinéraire en fonction de son projet pédagogique, en articulant les thèmes et les questions dans un ordre différent.
• Une organisation et une progression des chapitres conçues pour permettre, au libre choix de l’enseignant, un traitement thématique ou chronologique du pro-gramme.
L’approfondissement du travail, fait en classe de Première, de réflexion critique sur des sources de nature différente accordant une place privilégiée à l’histoire des arts.
• Des documents variés, choisis pour leur caractère de source historique. • Des pages Histoire des arts consacrées à une œuvre d’art replacée dans son contexte historique.
Une approche thématique et multiscalaire fondée sur la mobilisa-tion de repères chronologiques fondamentaux.
• Des pages de cadrage « Grand angle » dans chaque chapitre pour situer les grands repères thématiques, chronologiques et spatiaux. • Des aides à la localisation dans le temps et dans l’espace au fil des pages.
Une progression méthodologique reposant sur des capacités et des méthodes définies.
• Une progression des capacités et des méthodes tout au long du livre.
Une place croissante accordée aux technologies de l’information et de la communication.
• Des exercices B2i. • Un manuel interactif et personnalisable, Le Lib’. • De nombreuses ressources supplémentaires sur le site du manuel.
Une démarche pédagogique : l’étudeLe programme s’appuie sur des études ciblées, significatives et mises en perspective, qui doivent permettre de renoncer à l’exhaustivité. Elles im-pliquent une démarche pédagogique inspirée des études de cas.
1. Des objets précis et significatifsLes études portent sur des objets historiques précis et concrets, étudiés pour ce qu’ils révèlent de la question à laquelle ils se rattachent. Dans le manuel, l’enseignant trouvera toutes les études obligatoires ainsi que des études choisies en vue de permettre une mise en œuvre vivante et dyna-mique du programme.
2. Un corpus documentaire problématiséLe travail des élèves, en classe ou en autonomie, est fondé sur un corpus documentaire soulevant une situation-problème. Les documents, en nombre réduit et significatifs, sont choisis de façon à être croisés ou confrontés, permettant ainsi un travail critique et une analyse approfondie qui repose sur les capacités et les méthodes au programme.
3. Une nécessaire mise en perspectiveÀ chaque étude correspond, en amont ou en aval, une leçon permettant la mise en perspective de l’objet étudié, afin de montrer son apport ou ses limites à la compréhension de la réalité historique abordée en leçon. L’étude permet ainsi de conceptualiser des notions ou concepts transférables à d’autres situations.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE Term CHAPITRE 1 5
Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé
1 L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondialeDans le cadre du thème consacré au rapport des sociétés à leur passé, le programme prévoit l’exploration d’une question portant sur « les mémoires : lecture historique » et propose d’approfondir cette question au moyen d’un support d’étude sur « l’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ».
• Pour ce faire, le programme invite à bien distinguer histoire et mémoire, en montrant comment le discours historique peut mettre au jour les oublis et les déformations qui sont constitutifs des mémoires, sélectives par nature. Mais il s’agit également de montrer comment les historiens dialoguent avec ces mémoires et jouent un rôle qui ne se limite pas toujours à leur travail de chercheur, qu’ils interviennent dans le cadre de procès, participent à des controverses publiques ou endossent la fonction d’experts. Par ailleurs, le programme préconise l’étude distanciée des acteurs, des vecteurs et des contextes qui permettent la construction des faits mémoriels.
• Il s’agit donc de montrer comment l’historien historicise les mémoires en mettant à distance les enjeux brûlants dont elles peuvent être porteuses, et ce, afin de mieux en comprendre les ressorts et les mécanismes. C’est dans cette optique que ce chapitre entend aider les élèves à analyser les mémoires plurielles et douloureuses de la Seconde Guerre mondiale en France, à décrypter le discours et les pratiques des acteurs et à toujours replacer les phénomènes mémoriels dans leur contexte. Le propos est donc construit chronologiquement en deux leçons, les années 1970 constituant le point de bascule entre celles-ci, entre une mémoire patriotique de la guerre dominante de la Libération à la fin des années soixante et l’émergence au cours des années 1970 de nouveaux enjeux mémoriels venant bouleverser jusqu’à aujourd’hui la perception des « années noires ». La structure chronologique du chapitre vient signaler la nécessité d’étudier les mémoires dans leur dimension évolutive et dans la cohérence des contextes politiques, sociaux et culturels au sein desquels elles se déploient.
• Au cadre général fourni par les deux leçons répondent ensuite des objets précis présentés dans les études. Celles-ci répondent à un triple objectif : aborder les différentes mémoires de la Seconde Guerre mondiale (mémoire de Vichy, de la déportation, de la Shoah, de la Résistance, etc.) ; proposer des arrêts dans le temps aussi bien que des études diachroniques ; étudier différents vecteurs de mémoire (un procès, un mémorial, un espace géographique, etc.). Un dialogue entre les cours et les études permet de faire communiquer propos général et analyse d’un objet d’étude clairement identifié qui donne l’occasion d’approfondir et d’incarner le propos du cours. Par ailleurs, le traitement des études en classe peut se faire en lien avec la projection d’un film – Nuit et Brouillard par exemple, traité dans les pages « Histoire des Arts » – ou encore d’une visite sur un lieu de mémoire.
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Les mémoires, lecture historique : l’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France
p. 20-21 : GRAND ANGLE – Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondialep. 22-23 : ÉTUDE – Écrire l’histoire de la Seconde Guerre mondialep. 24-25 : COURS 1 – Une mémoire patriotique de la guerre de 1945 à 1970p. 26-27 : COURS 2 – De nouveaux enjeux mémorielsp. 28-29 : ÉTUDE – De la mémoire de la déportation à la mémoire de la Shoahp. 30-31 : ÉTUDE – Le Mémorial de la Shoah et le souvenir du génocide des Juifsp. 32-33 : ÉTUDE – Le massif du Vercors et la mémoire de la Résistancep. 34-35 : ÉTUDE – Le procès de Maurice Papon et la mémoire de Vichy
Les outils du manuel
p. 36-37 : HISTOIRE DES ARTS Alain Resnais, Nuit et Brouillard
p. 39 : EXERCICES Analyser un texte d’historien – Le regard de l’historien / Analyser un dessin – Le rôle de l’art dans le témoignage des rescapés des camps.
p. 38-39 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
6 CHAPITRE 1 HISTOIRE - Term
Ouverture du chapitre P 19-20
L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondialeTandis que le doc. 1 montre la célébration nationale de la Résis-tance, le doc. 2 évoque l’Occupation allemande et le génocide des Juifs. Les acteurs de la mémoire sont politiques [doc. 1], judiciaires et médiatiques [doc. 2], et ses supports sont des commémorations [doc. 1] ou des procès [doc. 2].
Grand angle P 20-21
Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondialeLes lieux de mémoire commémorent les combats militaires, la Résistance, les souffrances des civils et la Shoah, la Seconde Guerre mondiale ayant été une expérience plurielle pour les Français. Mémoriaux, cimetières ou musées, ces lieux assument des fonctions funéraires, mémorielles, pédagogiques ou politiques.
Étude P 20-21
Écrire l’histoire de la Seconde Guerre mondialeL’objectif de cette étude est d’aborder le travail de l’historien, et plus particulièrement les sources auxquelles il a recours pour écrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le but n’est cependant pas uniquement de présenter ces différents types de sources et les lieux où elles sont conservées, mais aussi d’analyser les conditions de leur accessibilité – à travers l’évocation de plusieurs acteurs (pouvoirs publics, témoins) entrant en interaction avec les histo-riens – et donc de replacer le travail de l’historien dans son contexte mémoriel, en abordant notamment le rôle d’expert qu’il peut assumer à la demande des pouvoirs publics.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. L’historien utilise des sources privées, des témoignages (oraux ou écrits) et des archives publiques. C’est en croisant ces différents types de sources qu’il peut construire une analyse rigoureuse des faits étudiés.2. L’accès aux sources peut être rendu compliqué par les pouvoirs publics, peu désireux de permettre aux historiens d’explorer les zones troubles du passé national, ou par des témoins détenant des archives privées et se montrant méfiants à l’égard des chercheurs professionnels.3. L’accès des historiens à de nouvelles sources leur permet d’étu-dier de nouveaux objets ou de proposer de nouvelles interprétations. Le renouvellement des sources étudiées est fondamental pour l’avancement et l’approfondissement du savoir historique.4. Les pouvoirs publics peuvent faire obstacle à la recherche ou, au contraire, être une force d’incitation, et jouent de ce point de vue un rôle ambivalent.
Confronter des documentsLes archives font l’objet d’un débat public quand se pose la question de leur gestion par les pouvoirs publics. C’est notamment le cas lorsque pèse sur ces derniers le soupçon de pratiques de dissimu-lation, éloignées de l’idéal de transparence censé présider, dans une démocratie, à l’administration des archives publiques. Les doc. 3
et 5 montrent bien qu’en la matière la politique des pouvoirs publics français a évolué, de l’impossibilité complète de consulter les archives ultérieures à la date du 10 juillet 1940 (vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain par l’Assemblée nationale) à la loi plus libérale de 1979 puis à la circulaire de Lionel Jospin qui rend défi-nitivement possible la consultation de tout document relatif à la période de l’occupation allemande et du régime de Vichy.
Organiser et synthétiser les informations
De quelles sources disposent les historiens pour écrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ?
Cours 1 P 24-25
Une mémoire patriotique de la guerre de 1945 à 1970En France, l’après-guerre voit se développer des visions fortement concurrentes de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation, entre d’un côté l’exaltation de la Résistance – célébrée tant par les communistes [doc. 1] que par les gaullistes [doc. 4] – et de l’autre la défense du régime de Vichy assurée par les nostalgiques de la collaboration et de la « Révolution nationale » : la brochure éditée par la revue d’extrême droite et d’inspiration maurrassienne Aspects de la France présente ainsi le « sacrifice » de Philippe Pétain en soulignant la continuité supposée de son action au service de la France entre la Première et la Seconde Guerre mondiale [doc. 3]. Le registre dominant de la mémoire de la guerre est alors patriotique, comme l’indique l’emploi des couleurs tricolores sur l’affiche du PCF qui présente les otages commu-nistes de Châteaubriant exécutés en 1941 comme des martyrs pour la France [doc. 1], mais aussi par la rhétorique du célèbre discours d’André Malraux prononcé lors de la cérémonie du transfert des cendres du résistant Jean Moulin au Panthéon en 1964 [doc. 4]. Cette mémoire patriotique, mise au service d’enjeux politiques, se construit d’une part sur la volonté d’apaiser les divisions entre Français, ce dont témoigne bien le vote des lois d’amnistie et les libérations massives qu’elles entraînent en 1947, en 1951, puis en 1953 [doc. 2] : vingt ans après la Libération, il n’y a plus dans les prisons françaises de personnes condamnées pour faits de collaboration. Elle a également pour corollaire la faible attention accordée aux soldats français défaits par la Wehrmacht pendant la campagne de France en 1940 et faits en masse pri-sonniers, aux requis du STO auxquels on reproche de n’avoir pas pris le maquis et d’avoir servi l’effort de guerre allemand, ainsi qu’aux survivants juifs de la Shoah qui peinent à faire entendre leur voix dans le contexte de l’après-guerre, ce qu’illustre bien le témoignage de Simone Veil [doc. 5].
Cours 2 P 26-27
De nouveaux enjeux mémorielsLes années 1970 voient apparaître de nouveaux enjeux mémoriels qui bouleversent profondément la perception de l’Occupation et du régime de Vichy. Certes, le président de la République Georges Pompidou peine à prendre la mesure des évolutions qui traversent, dans son rapport au passé de la Seconde Guerre mondiale, une société française de plus en plus travaillée par les souvenirs des « années noires », et en vient à promouvoir l’oubli suite à la
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 1 7
polémique déclenchée par sa décision d’accorder la grâce prési-dentielle à l’ancien chef de la Milice de Lyon Paul Touvier [doc. 3]. Mais différents vecteurs de mémoire indiquent que l’heure est loin d’être à l’oubli : le cinéma, qu’il s’agisse du cinéma documentaire avec Le chagrin et la pitié [doc. 1] ou du cinéma de fiction avec Lacombe Lucien, film de Louis Malle qui dépeint le portrait d’un personnage ambigu s’engageant au service de la Gestapo allemande après avoir tenté d’entrer dans la Résistance ; l’historiographie [doc. 2] portée par l’ouvrage de référence de Robert Paxton ; les politiques publiques de la mémoire qui dotent le calendrier national de nou-velles commémorations (doc. 4, 5). Dans ce processus qui réévalue en profondeur ce que fut le régime de Vichy, la mémoire de la Shoah joue un rôle considérable, sous l’effet notamment du négationnisme dont les intentions sont dénoncées par des historiens et « militants de la mémoire » comme Serge Klarsfeld ou Georges Wellers. Mémoire de la Shoah et mémoire de la Résistance fusionnent avec l’émergence, à partir des années 1990, de la figure des « Justes » mise au premier plan dans les évocations publiques de la guerre : dans son fameux discours de 1995, Jacques Chirac les évoque en contrepoint à la collaboration et une grande cérémonie célébrée au Panthéon, l’un des plus grands symboles de la République où l’on a vu que les cendres du héros de la Résistance Jean Moulin avaient été transférées en 1964, marque l’apogée de l’appropriation nationale de cette catégorie d’origine israélienne [doc. 5].
Étude P 28-29
De la mémoire de la déportation à la mémoire de la ShoahIl s’agit ici de montrer comment, de la Libération à nos jours, l’on est passé de la mémoire de la déportation à la mémoire de la Shoah. Il importe notamment de montrer ici que la vision que la société se forge après-guerre des déportés est d’abord celle de martyrs résistants, au détriment d’une réelle prise en compte de la spécifi-cité juive de la déportation. Les documents qui constituent l’étude permettent également d’observer en la matière une nette évolution, marquée par un processus de reconnaissance de la déportation des Juifs de France.
Questions BAC
Prélever et confronter des informations
1. Après-guerre, les anciens déportés résistants tirent leur visibi-lité de leur nombre (plus important que celui des survivants juifs), des personnalités qui les représentent, de leur activisme, et plus largement du contexte national qui célèbre la Résistance. Ils interviennent dans la vie publique en exigeant la justice, en par-ticipant aux luttes politiques et en obtenant une journée nationale. Ils sont honorés par les leurs, qui s’engagent à défendre leur mémoire, mais aussi par les députés qui adoptent une journée commémorative.2. Pour les résistants déportés, la déportation et l’expérience des camps sont avant tout considérées comme le prolongement de l’action clan-destine. Malgré la volonté du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés de fédérer tous les Français ayant été transportés contre leur gré hors du pays, les déportés résistants revendiquent rapidement la spécificité de leur expérience et de leur engagement patriotique.
3. La déportation des juifs peine à être prise en compte après-guerre notamment en raison du faible nombre de survivants de la Shoah, du jeune âge et de la position socioprofessionnelle de ces derniers, ainsi que du poids numérique et politique de la déportation résistante.4. La déportation des Juifs de France est d’abord mise en exergue par les « militants » de la mémoire juive comme Serge Klarsfeld et son association, puis par les pouvoirs publics.
Analyser un texte juridiqueLa loi du 14 avril 1954 – votée à l’initiative du Réseau du souvenir, une association d’anciens résistants déportés – insiste davantage sur la déportation des résistants que sur celle des Juifs. Ceci se manifeste par l’emploi de termes évoquant d’abord, dans les années 1950, les combats des résistants (« héros », « courage », « l’hé-roïsme »). En outre, elle ne mentionne que les « camps de concen-tration », méconnaissant ainsi la spécif icité des camps d’extermination où furent assassinés les Juifs.
Étude P 30-31
Le Mémorial de la Shoah et le souvenir du génocide des JuifsCette étude répond à la volonté d’aborder le souvenir de la Shoah à partir d’un lieu de commémoration spécifique et concret : le Mémo-rial de la Shoah à Paris. Son histoire, de 1956 à nos jours, illustre la façon dont la mémoire juive a pu s’enraciner dans l’espace urbain de la capitale. La double page cherche ainsi à montrer comment un monument est porteur de mémoire, quelles sont les diverses fonctions qu’il assume et de quelle manière il évolue au fil du temps. Le travail sur cette étude est tout particulièrement bienvenu pour préparer une visite sur ce site qui accueille un important public scolaire.
Questions BAC
Prélever et confronter des informations
1. Au Mémorial de la Shoah est commémoré le souvenir des victimes du génocide perpétré par l’Allemagne nazie et ses collaborateurs à l’encontre des juifs d’Europe, et plus particulièrement celui des 76 000 Juifs de France déportés vers les camps d’extermination (Auschwitz-Birkenau dans leur immense majorité).2. Ce lieu a initialement une fonction commémorative, mais il assume également une fonction informative (par le biais d’une exposition permanente et d’expositions temporaires) et pédagogique (avec l’accueil d’élèves de l’enseignement primaire et secondaire mais aussi de professeurs auxquels sont proposées des formations sur l’enseignement de la Shoah et des génocides).3. L’identité juive du monument est signalée par l’étoile de David (symbole du judaïsme) et les inscriptions en yiddish et en hébreu qui ornent le fronton. L’événement que ce mémorial commémore est rappelé par le cylindre portant le nom des principaux lieux de la Shoah (camps et ghettos) et matérialisé par la crypte accueillant le tombeau contenant les cendres des camps.4. Avec le « Mur des Noms » qui rappelle le prénom et le patronyme de tous les déportés Juifs de France, le Mémorial confère une grande importance à l’identité individuelle des victimes qu’il ne veut pas réduire à une masse anonyme.
Analyser un texteLe Mémorial est un lieu de recueillement et de deuil, car y sont inscrits – comme le rappelle le texte de Claude Lanzmann – les noms
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
8 CHAPITRE 1 HISTOIRE - Term
des déportés Juifs de France. Le « Mur des Noms » permet aux visiteurs de se confronter tant à l’ampleur collective du génocide qu’à la dimension personnelle que revêt chaque assassinat. Pour les familles des victimes dont les corps ont disparu, il se substitue également à la sépulture absente, l’entreprise génocidaire ayant fait disparaître les corps de ses victimes.
Étude P 32-33
Le massif du Vercors et la mémoire de la RésistanceCette fois, c’est l’exploration de la mémoire résistante qui est proposée dans cette étude, à partir d’un espace géographique particulier et célèbre : le massif du Vercors. L’étude insiste tant sur la construction d’un mythe national – celui du glorieux maquis ayant lutté contre l’occupant allemand et le régime de Vichy depuis sa « citadelle » naturelle – que sur les usages politiques de cet épisode historique par les gaullistes et les communistes dans un premier temps, mais aussi par des acteurs politiques des années 2000 et 2010.
Questions BAC
Prélever et confronter des informations
1. L’histoire du maquis du Vercors a une double facette. Le sort du massif sous l’Occupation incarne aussi bien les combats de la Résistance que le martyre national, car il fut le théâtre de violents combats entre les résistants et les Allemands, mais aussi de mas-sacres de représailles de civils. De ce point de vue, le sort du Vercors a souvent été comparé à celui d’Oradour-sur-Glane.2. On a pu parler de « légende noire » du Vercors en raison de l’intense polémique qui a éclaté au sortir de la guerre entre gaullistes et communistes sur la question des responsabilités de la France libre dans la destruction du maquis par les forces allemands. Cette controverse illustre ainsi bien la dimension très politique des mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France après-guerre et leur fréquente instrumentalisation.3. Le souvenir du Vercors est commémoré de plusieurs manières : par des cérémonies (organisées notamment à l’occasion des visites du chef de l’État) et par l’érection de monuments, parmi lesquels l’imposant Mémorial de la Résistance en Vercors ou encore la Nécropole de la Résistance à Vassieux-en-Vercors où sont inhumés les corps de nom-breux maquisards tués lors de l’offensive allemande contre le massif.4. En 2009, le souvenir du Vercors est rappelé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, l’épopée de ce maquis ayant acquis une aura « mythique » qui résonne aux oreilles de nombreux Fran-çais et peut donc constituer une ressource politique utile. Plus largement, comme le note Gilles Vergnon, l’épopée du Vercors sous l’Occupation est incorporée dans les représentations collectives de la Seconde Guerre mondiale en France.
Analyser un texteProblématique de l’étude : La responsabilité de n’avoir pas soutenu militairement les maquisards du Vercors attaqué par les Allemands est attribuée par les communistes aux gaullistes et vice-versa, les deux groupes se présentant comme les seuls vrais résistants et prétendant chacun incarner le seul visage légitime de la France combattante.
Étude P 34-35
Le procès de Maurice Papon et la mémoire de VichyL’objectif de cette étude est d’insister sur le rôle de la justice comme vecteur de mémoire en s’appuyant sur le cas du procès de Maurice Papon tenu à Bordeaux en 1997-1998. Il s’agit notamment d’appré-cier son impact sur la vision des « années noires » et du régime de Vichy à la fin des années 1990. La double page permet par ailleurs de mettre en avant l’interaction de l’historien avec les acteurs judiciaires et des débats que cette participation des chercheurs au travail de la justice a pu déclencher.
Questions BAC
Prélever et confronter des informations1. L’ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde Maurice Papon a été inculpé pour crimes contre l’humanité, une notion qui tire sa spécificité de son imprescriptibilité permettant la tenue de procès très longtemps après les faits.2. L’opinion voulait ce procès, qu’il s’agisse des familles de victimes ou de la société française dans son ensemble. En témoigne l’atten-tion que lui accorde la presse nationale et régionale, ainsi que le sondage du Parisien.3. À travers le cas de Maurice Papon a été fait, dans l’espace public, le procès de Vichy, de la collaboration, de la participation française à la déportation des juifs, mais aussi plus généralement de l’obéis-sance aveugle à l’État par ses fonctionnaires, comme le pense Jean-Marie Colombani. C’est en cela qu’il constitue un procès his-torique et emblématique de la fin du xxe siècle en France.4. Des historiens ont « témoigné » au procès (à l’instar de Jean-Pierre Azéma) afin de présenter le contexte historique des « années noires » en général et de la collaboration entre le régime de Vichy et l’occupant allemand en particulier. L’historien Jean-Noël Jeanne-ney plaide en faveur d’une telle collaboration. Cependant, au-delà de cette question, certains historiens comme Henry Rousso demeurent circonspects quant au véritable apport historique de cet événement judiciaire en termes de connaissances.
Analyser une caricatureLa caricature de Plantu montre comment Maurice Papon a été jugé in extremis pour ses responsabilités dans le cadre la déportation des Juifs de Bordeaux sous l’Occupation, victimes dont l’identité est rappelée par les étoiles de David dessinées sur les stèles. En effet, malgré le caractère imprescriptible des crimes contre l’huma-nité, le temps jouait en la faveur de cet homme déjà très âgé – point sur lequel le caricaturiste insiste dans son dessin – au moment de son procès : plus de quinze ans ont séparé le premier dépôt de plainte contre lui et la tenue du procès à Bordeaux.
Histoire des arts P 36-37
Alain Resnais, Nuit et BrouillardAnalyser l’œuvre
1. L’usage de la couleur permet de penser le phénomène concen-trationnaire dans sa contemporanéité, sans l’enfermer uniquement dans le passé de la Seconde Guerre mondiale.2. Le documentaire est contemporain de la guerre d’Algérie, évoquée dans le commentaire par la mention de ceux qui « crie [nt] sans fin ».
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 1 9
3. La censure a préféré que ne soit pas associé un fonctionnaire français à la dénonciation du système concentrationnaire dont était porteur le film d’Alain Resnais.
Comprendre la portée de l’œuvre
4. Nuit et Brouillard est destiné à un large public, en France et à l’étranger, à ceux qui ont vécu la guerre tout comme aux jeunes générations.5. Le film d’Alain Resnais est marqué par son époque en ce qu’il n’évoque pas frontalement le sort des Juifs et dissimule la collabo-ration des autorités françaises avec l’occupant allemand. Nuit et Brouillard gagne à être comparé avec Shoah de Claude Lanzmann (1985) – dans ses points communs et ses différences –, tant du point de vue du fond que de la forme.
EXERCICE P 39
Analyser un texte d’historien
Le regard de l’historienDans cet extrait de son livre Le chagrin et le venin, l’historien Pierre Laborie critique l’image simpliste d’une société française décrite uniquement comme passive et complice et regrette que l’on coupe la Résistance de la société au sein de laquelle elle s’est déployée.
Analyser un dessin
Le rôle de l’art dans le témoignage des rescapés des campsCe dessin est un témoignage de l’un des rares survivants des Son-derkommando. David Olère a réussi, avec d’autres membres du dernier groupe de Sonderommando à se mêler aux autres déportés lors de l’évacuation de Birkenau et il a survécu à la « marche de la mort ». Ses dessins et ses peintures sont pour lui à la fois un moyen de témoigner et de supporter l’horreur vécue.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Bibliographie
• Conan Éric et Rousso Henry, Vichy, un passé qui ne passe pas, Fayard, 1994.
• Dalisson Rémi, Les guerres et la mémoire, CNRS Éditions, 2013.
• Douzou Laurent, La Résistance française : une histoire périlleuse, Seuil, 2005.
• Laborie Pierre, Le Chagrin et le Venin – La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Bayard, 2011.
• Lagrou PIeter, Mémoires patriotiques et Occupation nazie, Complexe, 2003.
• Paxton Robert O., La France de Vichy – 1940-1944, Seuil, 1999.
• Rousso Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Seuil, 1990.
• Wieviorka Annette, Déportation et Génocide, Hachette, 2003.
Filmographie
• Clément René, La Bataille du rail, 1946.
• Resnais Alain, Nuit et Brouillard, 1956.
• Melville Jean-Pierre, L’Armée des ombres, 1969.
• Ophüls Marcel, Le Chagrin et la Pitié, 1971.
• Malle Louis, Lacombe Lucien, 1974.
• Chomsky Marvin J., Holocauste, 1978.
• Lanzmann Claude, Shoah, 1985.
• Audiard Jacques, Un héros très discret, 1996.
• Jugnot Gérard, Monsieur Batignole, 2002.
Sites internet
• http://www.memorialdelashoah.org/
• http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
• http://www.ina.fr/
Musées
• Mémorial de la Shoah, Paris.
• Mémorial – cité de l’histoire pour la paix, Caen.
• Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation, Lyon.
• Musée du KL-Natzweiler, au Struthof.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
10 CHAPITRE 2 HISTOIRE - Term
2 L’historien et les mémoires de la guerre d’AlgérieCe chapitre propose une lecture historique du rapport des sociétés à leur passé à travers le cas des mémoires de la guerre d’Algérie. Depuis que le conflit s’est achevé, en 1962, les deux sociétés belligérantes entretiennent avec lui des mémoires complexes. Toutes deux profondément touchées, elles le sont à des titres différents. En France on utilise l’expression de « guerre d’Algérie », que l’on conçoit comme un conflit de décolonisation ayant occasionné une forme de traumatisme national. En Algérie, on parle pour désigner les mêmes événements de « guerre de libération » ou de « révolution » (thawra), car la guerre y constitue l’événement fondateur de la nation et de l’État.
• Malgré ces divergences, la façon dont les sociétés française et algérienne ont vécu le souvenir de cette guerre est comparable à certains égards. En effet on constate que dans les deux pays, les autorités publiques ont entretenu avec ce conflit un rapport ambigu, fait de volontés tantôt parallèles tantôt concurrentes d’occultation et de réconciliation. En Algérie, le pouvoir politique s’est fondé sur la captation de la mémoire de la guerre à son profit, construisant un souvenir unanime et officiel de ses héros et martyrs. Le FLN, déclaré parti unique en 1962, a fondé sa légitimité sur la continuité de son régime avec la guerre. En France, la Ve République n’a guère commémoré ses origines algériennes. Elle a organisé le retour à la concorde en multipliant les amnisties et en passant sous silence les réalités de cette guerre, dont elle refusa de dire le nom durant 37 ans.
• Dans les deux cas, les constructions officielles furent contredites de façon croissante, à partir des années 1980, par des groupes porteurs de mémoires diverses : pieds-noirs, harkis, immigrés, anciens appelés en France, jeunes puis islamistes en Algérie. Ces groupes ont, par leur action mémorielle, bousculé les lectures établies de la guerre et font surgir de véritables « guerres de mémoires ».
• En Algérie, depuis le début des années 2000, une certaine détente est à l’œuvre, du fait de la volonté de réconciliation de l’État mené par Abdelaziz Bouteflika, et de l’éloignement chronologique du conflit, dans une société à la démographie très dynamique. En France, la reconnaissance de l’état de guerre n’a pas apaisé les mémoires, au contraire la polémique a surgi à la même époque sur la question de la torture, montrant que la plaie était loin d’être refermée. Le cinquantenaire de l’indépendance, en 2012, a montré que les deux pays restaient mal à l’aise avec la mémoire de cette guerre. De part et d’autre de la Méditerranée, l’anniversaire a été commémoré discrètement et a peu rassemblé. Il a également démontré l’incapacité des deux pays à organiser des célébrations conjointes, sur le modèle franco-allemand.
• L’historien de la guerre d’Algérie, s’il se tient en marge de ces phénomènes, doit cependant les prendre en compte : la demande sociale de mémoire et les contraintes officielles informent son travail.
Thème 1 Le rapport des sociétés à leur passé
Le programme officiel Le sommaire du manuel
Les mémoires, lecture historique : l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie
p. 42-43 : GRAND ANGLE – Les lieux de mémoire de la guerre d’Algériep. 44-45 : ÉTUDE – Écrire l’histoire de la guerre d’Algériep. 46-47 : COURS 1 – La mémoire de la guerre d’Algérie en Francep. 48-49 : COURS 2 – Le souvenir de la guerre en Algériep. 50-51 : ÉTUDE – La mémoire des pieds-noirsp. 52-53 : ÉTUDE – La mémoire des harkisp. 54-55 : ÉTUDE – La mémoire de la torture
Les outils du manuel
p. 56-57 : HISTOIRE DES ARTS Jacques Ferrandez, Terre fatale
p. 58-59 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p 59 : EXERCICE Mettre en relation deux documents : l’évolution d’un lieu de mémoire
p. 60-61 : OBJECTIF BAC - MÉTHODE Composition – Analyser le sujet : L’historien et les mémoires de la Guerre
p. 62-63 : OBJECTIF BAC - MÉTHODE Etude critique de document / analyse de document – Analyser un texte : Les lois mémorielles
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 2 11
Ouverture du chapitre P 40-41
L’historien et les mémoires de la guerre d’AlgérieLes photographies prises dans les rues de Paris et d’Alger, plusieurs décennies après la guerre, démontrent la force et l’actualité de la mémoire dans les deux pays. Si, dans le cas algérien, la représentation du combat nationaliste fait partie intégrante du paysage urbain [doc. 1], il existe en France un rapport plus conflictuel à cette mémoire [doc. 2].
Grand angle P 42-43
Les lieux de mémoire de la guerre d’AlgérieLa carte montre que la localisation des lieux de mémoire, en France, est à mettre en relation avec les zones d’installation des populations rapatriées : pieds-noirs et harkis. Si nombre de ces lieux sont dus à des initiatives privées, en Algérie, en revanche, l’ensemble des monuments commémoratifs provient d’initiatives publiques.
Étude P 44-45
Écrire l’histoire de la guerre d’AlgérieCette étude met en lumière les différents éléments à partir desquels les historiens travaillent depuis la fin du conflit, en France et en Algérie. Elle montre que leur travail dépend de la demande sociale d’histoire. Cette dernière peut l’encourager : ainsi, les débats mémo-riels qui ont agité la France à la fin du xxe siècle ont encouragé l’ouverture des archives par les pouvoirs publics. Elle peut aussi constituer une entrave, comme lorsque des groupes porteurs de mémoires blessées tentent d’imposer, par un travail de lobbying parlementaire, une orientation à leur travail. Dans tous les cas, les historiens ne doivent pas se soumettre aux exigences mémorielles, même si celles-ci ne doivent pas non plus être ignorées.Il convient de garder un rapport critique aux diverses mémoires, privées mais aussi publiques. Le travail de l’historien consiste à dépassionner les lectures du passé, en faisant primer les catégories scientifiques sur les polémiques mémorielles. Il ne peut faire abs-traction des contraintes légales mais il a la possibilité de ruser avec elles, en convoquant des sources alternatives aux archives publiques.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. En France, la guerre d’Algérie est difficile à aborder de façon apaisée. Elle a déchiré une partie de l’opinion alors même qu’elle se produisait [doc.2] et a longtemps été considérée comme parti-culièrement blessante pour l’orgueil national, parce qu’elle avait été gagnée militairement et perdue politiquement [doc. 4].
2. Les autorités publiques exercent des contraintes sur les historiens en légiférant sur les délais de mise à disposition des archives [doc. 1], mais aussi sur la façon dont cette histoire doit être abordée dans les travaux scientifiques [doc. 3].
3. L’historien dispose de plusieurs types de sources. Il utilise celles produites par l’État, les sources civiles et militaires [doc. 1, 2], mais aussi les sources orales ou filmiques [doc. 5], qui lui permettent de dépasser les contraintes liées à la mise à disposition des sources publiques.
Confronter deux documentsCet exercice incite les élèves à comparer deux textes issus de la puissance publique française à quelques années d’intervalle. Alors
que le premier texte témoigne d’une volonté de faciliter l’accès des chercheurs aux archives publiques, dans un contexte de resurgis-sement des débats liés à la guerre, le second démontre sa volonté de peser sur la façon dont les récits des historiens s’écrivent. La mise en relation de ces documents montre que l’intervention publique dans l’histoire n’est pas uniforme et qu’elle peut être elle-même objet d’histoire.
Cours 1 P 46-47
La mémoire de la guerre d’Algérie en FranceLa mémoire de la guerre d’Algérie en France, depuis 1962, peut être qualifiée de lente, difficile et conflictuelle. Le plan adopté dans la leçon distingue trois temps. Le premier, qui couvre les deux décennies suivant la fin du conflit, se caractérise par une forme d’occultation de la part de l’État, qui tranche avec la façon dont sont traitées les deux guerres mondiales. Les « événements d’Algérie » ne sont pas considérés de la même façon, alors qu’ils ont aussi impliqué l’appel au contingent. Au malaise silencieux des anciens appelés longtemps exclus du statut d’ancien combattant [doc. 2] s’ajoutent les discours de divers groupes qui s’estiment, à divers titres, victimes de cette histoire : pieds-noirs et harkis [doc. 5]. Le paysage mémoriel est ainsi clivé et marqué par le sous-investissement public.Les années 1980 constituent une période de transition : le conflit commence à être l’objet des travaux des historiens et à sortir de son isolement mémoriel en entrant dans les programmes scolaires mais aussi dans le débat public. Alors que d’un côté du prisme politique on dénonce la répression dont ont été victimes les Algériens durant la guerre [doc. 1], de l’autre, dans une extrême droite en plein essor, transparaît derrière le thème de l’immigration une nostalgie de l’empire colonial et de l’Algérie française.L’année 1999 marque le passage à la troisième période. Année de la reconnaissance officielle de la guerre par le Parlement [doc. 4], elle signe le retour de L’État dans une mémoire jusque-là dominée par les groupes privés. Circulaire sur les archives en 2001 et inauguration d’un monument aux anciens combattants d’Afrique du nord en 2002 [doc. 3] manifestent la volonté de reconnaissance des autorités publiques. Ces dernières ne parviennent pourtant pas à créer une mémoire consen-suelle et apaisée, comme en témoigne la polémique sur la torture qui, auparavant réservée aux cercles militants, revient sur la place publique à la même époque.
Cours 2 P 48-49
Le souvenir de la guerre en AlgérieLe rapport de l’Algérie à la guerre d’indépendance est d’une nature différente. La guerre a fondé son existence politique, en tant qu’État indépendant, mais aussi la nation algérienne telle qu’elle se définit depuis 1962. Épisode national crucial, elle est très présente dans le paysage rural et urbain du pays, à travers la multiplication des monu-ments commémoratifs ou encore des inscriptions murales [doc. 2], ainsi que dans les arts [doc. 1].Son souvenir constitue un capital stratégique fort, source de pouvoir, que le régime mis en place à l’indépendance se hâte de capter à son profit. En diffusant une version officielle des événements qui clame qu’il n’y eut « qu’un seul héros, le peuple » [doc. 2], le FLN devenu parti unique
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
12 CHAPITRE 2 HISTOIRE - Term
écarte de son histoire tous les personnages jugés gênants. Il met en place une définition ethnico-religieuse de la nation algérienne, réduisant cette dernière à ses composantes arabe et musulmane. Dans cet esprit, reconnaître l’existence de divergences pendant la guerre, comme celle des messalistes ou des communistes athées [doc. 4], ou encore le rôle de groupes extérieurs à la définition arabo-musulmane de la nation, comme les kabyles [doc. 3], contreviendrait à l’unité de la nation.Censé être un facteur d’unité, le souvenir de la guerre constitue ainsi un facteur de tensions et de divisions au sein du pays. Sa confiscation, à l’indépendance, par un État qui a construit sa légitimité sur la conti-nuité avec le combat nationaliste, est contestée par plusieurs catégories d’acteurs à partir des années 1980. L’éclatement de la violence islamiste au début des années 1990, et la « décennie noire » qui s’en est suivie, parfois appelée « guerre civile », sont une contestation radicale de ce monopole. Depuis le début des années 2000, on encourage la libéralisation de cette mémoire et un certain pluralisme. La guerre d’indépendance reste un événement incontournable en Algérie, commémoré chaque année jusque dans les caricatures de presse [doc. 5], même si l’on constate un certain reflux de cette mémoire, dans un pays où la majorité de la population est née après la guerre.
Étude P 50-51
La mémoire des pieds-noirsLa mémoire des Français d’Algérie rapatriés, qualifiés de « pieds-noirs » au cours de la guerre, expression qu’ils se sont progressivement appropriée pour désigner une véritable identité transmise de génération en génération, est un objet d’histoire particulièrement riche. Cette étude illustre la façon dont cette mémoire s’est construite, à travers différents canaux, mettant en valeur un récit nostalgique de la présence française en Algérie et soulignant les dommages et pertes causés par l’indépendance. Cependant l’homogénéité de cette mémoire ne doit pas être exa-gérée et des tendances diverses se distinguent, souvent adossées à des sympathies politiques de droite et de gauche. Cette étude montre que la mémoire peut emprunter des supports mixtes pour se développer : religieux, artistiques, mais aussi publics. En effet, l’un des succès de ce groupe est d’avoir obtenu des relais au niveau des autorités étatiques, tant locales que nationales. Au total, la mémoire des pieds-noirs apparaît comme une culture mixte, diverse et vivante.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. Les revendications des associations portent sur leurs intérêts matériels, la défense de leur héritage [doc. 1] mais aussi la recon-naissance de leur statut de victimes de la guerre d’Algérie [doc. 3].2. Les autorités locales s’associent à ces revendications dans certaines communes où les pieds-noirs constituent une partie importante de la population. Certains de ces mêmes thèmes sont aussi repris par la puissance publique au plus haut niveau [doc. 5].3. Les acteurs de la mémoire pied-noire sont non seulement les indi-vidus [doc. 2], mais aussi les associations [doc. 1, 2, 3], ainsi que certains artistes identifiés au destin de cette communauté [doc. 4].4. On peut parler de culture pied-noire à travers les manifestations sociales, religieuses [doc. 2] et artistiques de cette mémoire [doc. 4].
Mettre en relation deux documentsLa mise en relation des doc. 1 et 3 amène les élèves à s’interroger sur le discours porté par les associations de pieds-noirs. Ces dernières mènent un combat qui réclame des satisfactions matérielles, mais aussi symboliques, ainsi de la reconnaissance publique et morale d’un statut de victimes de la guerre d’Algérie dont elles s’estiment lésées.
Étude P 52-53
La mémoire des harkisLes harkis furent les grands perdants de cette guerre. Leur situation à partir de 1962, ainsi que celle de leurs familles, est des plus dif-ficiles des deux côtés de la Méditerranée. En Algérie où ils sont une majorité à rester, la France n’honorant pas sa promesse de les protéger et de les rapatrier après l’indépendance, ils apparaissent comme des traîtres à la cause nationale et sont exclus de la com-munauté : de la marginalisation au massacre, leur sort est le plus souvent tragique.En France, ils sont peu et mal accueillis. On crée des camps de tran-sit, des cités et des hameaux forestiers pour les héberger jusque dans les années 1970. Ils y vivent dans des conditions dégradantes. Leur mémoire blessée provoque des contestations croissantes à partir des années 1970, qui prennent la forme de heurts violents quand ils sont pris en charge par leurs descendants dans les années 1990. La reconnaissance officielle tardive de leur rôle par la France suit le dépôt contre elle d’une plainte pour « crime contre l’humanité ».
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. En France, les harkis connaissent conditions de vie difficiles, avec une forme d’exclusion sociale et scolaire [doc. 1] et la non-reconnaissance de leurs droits par l’État [doc. 2]. Leur sort est longtemps passé sous silence, jusque dans les années 2000 où ils sont officiellement com-mémorés [doc. 4].2. Leurs revendications furent longues à émerger, plusieurs années après l’indépendance [doc. 2], portées le plus souvent par la seconde génération [doc. 3]. Ils réclament de la part de la France des conditions de vie décentes [doc. 3], la reconnaissance de leurs droits [doc. 2], mais aussi celle de leur sacrifice pour la France [doc. 4, 5, 6].
3. Les harkis ont mis longtemps à affronter les autorités publiques [doc. 1]. Ils commencent à contester la façon dont ils sont traités paci-fiquement, dans les années 1970 [doc. 2], avant de recourir à des moyens de protestation violents dans les années 1990 [doc. 3] et de s’adresser à la justice à l’aube des années 2000 [doc. 5].4. L’État a pris en charge les harkis et leurs familles à leur arrivée et constaté les difficultés dans lesquelles ils vivaient [doc. 1] mais n’a pas reconnu officiellement leur rôle dans la défense de l’Algérie française avant les années 2000 [doc. 2, 4].
Analyser un témoignageLe doc. 6 met les élèves en prise directe avec la mémoire blessée des anciens combattants algériens de la cause française. Il montre combien cette mémoire est faite de sentiments d’humiliation et d’injustice, qui alimentent un discours polémique et passionnel. Son auteur cherche à sortir les harkis de leur situation de parias des deux côtés de la Méditerranée, faisant de cette revendication un combat transcendant les générations, appelé à se continuer dans le futur.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 2 13
Étude P 54-55
La mémoire de la tortureCette étude restitue l’effervescence mémorielle de la fin des années 1990 et du début des années 2000 en France. Le débat sur la torture n’y est pas nouveau : les méthodes de l’armée française furent déjà dénoncées publiquement pendant la guerre elle-même.Mais Il revient véritablement sur le devant de la scène publique au début des années 2000, avec la parution de témoignages de vic-times dans la presse et des premiers travaux d’histoire sur la ques-tion. S’ensuit une véritable polémique publique, alimentée par les révélations de certains tortionnaires. Ce contexte, loin d’entraver le travail des historiens, a permis à ces derniers d’accéder à de nouveaux témoignages et d’écrire une histoire plus complète du conflit.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. Les méthodes illégales utilisées par l’armée française en Algérie contredisent l’héritage républicain et humaniste de la France, ce qui explique le long silence dont elles ont fait l’objet de la part de l’État, mis en cause par la révélation de ces pratiques [doc. 3]. Au niveau individuel, pour ceux qui l’ont pratiquée ou qui y ont assisté, elles ont en outre créé des phénomènes traumatiques qui contribuent au même silence [doc. 1].
2. En Algérie au contraire, ces méthodes ont été dénoncées très tôt par l’État indépendant, qui en commémore les victimes depuis l’indé-pendance [doc. 5] car le discours sur ce sujet met en cause des militaires de l’ancienne puissance coloniale [doc. 4]. En France la reconnaissance est plus tardive [doc. 2, 5].
3. Le débat sur la torture a resurgi par voie médiatique : il a fait la une des grands journaux nationaux [doc. 2], l’objet de nombreux articles [doc. 3, 4] et d’enquêtes approfondies [doc. 1]. En même temps, il a fait l’objet du travail de l’historien [doc. 3].
4. L’historien doit composer avec le silence de certains témoins [doc. 1, 4] et une lourde demande sociale, qui pèse nécessairement sur son travail [doc. 3].
Mettre en relation deux documentsLa comparaison des témoignages permet d’accéder aux deux côtés de la situation de torture, du côté de ceux qui la pratiquent [doc. 1] et de ceux qui la subissent [doc. 4]. Il montre que dans les deux cas, si les différents points de vue ne permettent pas de décrire de la même façon les événements, les témoins se rejoignent sur la mémoire trau-matique de ces événements qui les ont profondément marqués.
Histoire des arts P 56-57
Jacques Ferrandez, Terre fataleAnalyser l’œuvre
1. L’indépendance est perceptible à travers la « Une » de la Dépêche d’Algérie, titre de presse européen, annonçant la reconnaissance officielle de l’indépendance par la France, les drapeaux algériens brandis par les personnages et les visages souriants de ces derniers.2. Les gestes enthousiastes des hommes, des femmes et des enfants massés sur la place de la grande poste ou dévalant les rues de la Casbah contrastent avec le visage grave du personnage d’Octave.
S’il est aussi né en Algérie, ce dernier fait partie de la communauté des pieds-noirs et l’indépendance signifie pour lui le départ proche.
Comprendre la portée de l’œuvre3. Le combat pour l’indépendance et la victoire face à l’armée française sont des éléments de fierté nationale. Leur récit est apprécié en Algérie, en particulier dans un art populaire tel que la bande dessinée.4. Cette planche de bande dessinée montre le contraste des émo-tions qui accueillent l’indépendance, en 1962. Il montre que l’évé-nement ne revêt pas la même signification pour les Algériens et les Français : victoire pour les premiers, il est le prélude au déracinement pour les seconds.
EXERCICE P 59
Mettre en relation deux documents
L’évolution d’un lieu de mémoireLes deux documents sont des photographies prises au même emplacement, à Alger, avant et après l’indépendance. Le premier représente un monument aux morts de la Première Guerre mon-diale, et le second le même monument recouvert par une chape de ciment sur lequel sont sculptés deux poings se libérant de leurs chaînes.Depuis 1978, le monument représente la volonté algérienne d’effacer les traces de la présence française du paysage urbain et de glorifier le combat pour l’indépendance. Toujours sous cette forme aujourd’hui, ce monument montre la difficulté de la réconciliation entre l’ancien colonisateur et l’ancienne colonie.
Objectif BAC Méthode P 60-61
Composition / Analyser le sujetL’historien et les mémoires de la GuerreVous vous appuierez sur l’étude conduite en classe. Ce sujet très vaste, conforme à ce qui peut être donné au baccalauréat, permet aux élèves d’investir l’ensemble des connaissances acquises en rapport avec le premier thème. L’objectif de l’exercice est donc de s’assurer de la capacité des élèves à investir toutes les notions clés du programme.
Travail de mémoire et devoir de mémoireCe sujet permet de faire réfléchir les élèves sur le rôle de l’historien, en les amenant à distinguer ce qui relève du travail scientifique et ce qui relève du devoir civique de commémoration des événements. Pour la Seconde Guerre mondiale, cela conduit à valoriser la rupture historiographique des années 1970. Dans le cas de la Guerre d’Algé-rie, cela conduit à distinguer la situation qui prévaut en Algérie de celle qui prévaut en France.
Le rôle de l’État dans la mémoire de la GuerreCe sujet permet d’aborder sous un autre angle les problématiques du chapitre en mettant en évidence le rôle de plus en plus notable de l’État dans la commémoration des guerres. L’enjeu, pour les élèves, est de ne pas s’en tenir au devoir de mémoire et de prendre en considération tous les aspects de la politique mémorielle, y compris les programmes scolaires.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
14 CHAPITRE 2 HISTOIRE - Term
Objectif BAC Méthode P 62-63
Étude critique / analyse de document Analyser un texteLes lois mémoriellesCette tribune de presse, qui a donné naissance à l’association « Liberté pour l’histoire », a marqué une étape importante de la mobilisation d’historiens de renom contre la propension de l’État à intervenir dans l’écriture de l’histoire à travers les lois mémorielles. Ce texte permet d’évoquer de façon critique les lois mémorielles jusqu’à celle de 2005, dont l’article controversé a été abrogé à la suite de la mobilisation d’un grand nombre d’intellectuels.
La commémoration du 11 novembreCe discours du ministre de la Défense à l’Assemblée nationale permet d’aborder l’évolution du sens de la commémoration du 11 novembre, dont le gouvernement a souhaité faire, au-delà du souvenir de l’armistice de 1918, une commémoration de tous les morts pour la France. En creux, ce texte pose la question de la commémoration du 8 mai 1945, dont la forme a été fluctuante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale [doc. 4 p. 27].
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Bouayed Anissa, L’Art et l’Algérie insurgée : les traces de l’épreuve (1954-1962), Enag éditions, 2005.
• Dalisson Rémi, Les guerres et la mémoire, CNRS Éditions, 2013
• Harbi Mohammed et Stora Benjamin (dir.), La Guerre d’Algérie – 1954-2004, la fin de l’amnésie, Robert Laffont, 2004.
• Hureau Joëlle, La Mémoire des pieds-noirs, Perrin, 2010.
• Manceron Gilles et Remaoun Hassan, D’une rive à l’autre : la guerre d’Algérie de la mémoire à l’histoire, Syros, 1993.
• Rosenman Anny Dayan et Valensi Lucette (dir.), La Guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire, Bouchène, 2004.
• Savarese Éric, Algérie, la guerre des mémoires, Non Lieu, 2007.
• Stora Benjamin, La Gangrène et l’Oubli : la mémoire de la guerre d’Algérie, La Découverte, 2005.
Filmographie
• Lakhdar-Hamina Mohammed, Le Vent des Aurès, 1966.
• Pontecorvo Gillo, La Bataille d’Alger, 1966.
• Vautier René, Avoir vingt ans dans les Aurès, 1972.
• Boisset Yves, R.A.S, 1973.
• Lakhdar-Hamina Mohammed, Chroniques des années de braise, 1975.
• Heynemann Laurent, La Question, 1977.
• Arcady Alexandre, Le Coup de sirocco, 1979.
• Schoendorffer Pierre, L’Honneur d’un capitaine, 1982.
• Siri Florent Emilio, L’Ennemi intime, 2007.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 3 15
3 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875Ce chapitre vise à illustrer le rapport entre les idéologies politiques et les mutations économiques et sociales depuis la fin du xixe siècle, à travers le cas des organisations ouvrières allemandes (partis et syndicats). Celles-ci mobilisent différemment les travailleurs allemands sur la période comme le montre l’ouverture.Le fil rouge qui permet de donner cohérence à l’ensemble du chapitre serait l’adaptation de l’idéologie socialiste au contexte socio-économique d’une Allemagne en transformation.
• Le SPD puis les syndicats sociaux-démocrates sont fondés à la fin du xixe siècle pour affirmer une idéologie révolutionnaire marxiste et protéger les ouvriers d’une situation difficile, présentée dans le Grand Angle. L’amélioration relative de leur situation permet les succès électoraux et voit les premières mises en cause du marxisme comme le montre l’étude 1 p. 74-75. Mais la Première Guerre mondiale, expérience traumatique, relance la tendance révolutionnaire. La naissance du communisme et la division des organisations ouvrière en deux camps, dans l’étude 2 p. 76-77, pose deux façons différentes d’articuler idéologie et réalités sociales : pour le SPD, les réalités sociales amènent à nuancer l’idéologie, pour le KPD, l’idéologie seule compte.
• Après 1945, cette opposition est sanctionnée par la partition de l’Allemagne. En RFA, le SPD devient l’un des fondements des mutations socio-économiques du pays avec l’aide des syndicats, et adapte son idéologie aux mutations de l’Allemagne du « miracle économique » avec l’aide des syndicats (étude 4 p. 82-83 sur Bad Godesberg). En RDA, l’idéologie maintenue gèle toute évolution, enfonçant le pays dans l’immobilisme (étude 3 p. 80-81 sur le 17 juin 1953).
• Depuis la réunification, les défis se sont multipliés pour le SPD (intégration de l’ex-RDA, mondialisation, crise économique et financière). Le parti a été conduit à adapter ses principes, tout en faisant face à l’opposition d’une partie de la gauche allemande (étude 5 p. 84-85).
Thème 2 Idéologie et opinion en Europe de la fin du xixe siècle à nos jours
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Socialisme et mouvement ouvrier : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875
p. 70-71 : GRAND ANGLE – Le monde ouvrier en Allemagne de 1875 à 1914p. 72-73 : COURS 1 – Socialisme et syndicalisme : de l’unité à la divisionp. 74-75 : ÉTUDE – La social-démocratie allemande avant 1914p. 76-77 : ÉTUDE – La naissance du communisme allemand en 1918-1919p. 78-79 : COURS 2 – Social-démocratie et communisme en Allemagne depuis 1945p. 80-81 : ÉTUDE – Les manifestations du 17 juin 1953 à Berlin-Estp. 82-83 : ÉTUDE – Le congrès de Bad Godesberg (1959)p. 84-85 : ÉTUDE – Le chancelier Gerhard Schröder et les mutations de la gauche allemande
Les outils du manuel
p. 86-87 : HISTOIRE DES ARTS George Grosz, Les Piliers de la société
p. 89 : EXERCICES Analyser une peinture – La propagande communiste vue par un artiste expressionniste
p. 88 -89 : L'ESSENTIEL Fiche de synthèse, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 90-93 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Comprendre les enjeux du sujet – Quel impact ont eu les grandes crises du xxe siècle sur le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne ?Analyser une peinture – Les mineurs vus par un peintre engagé
p. 94-95 : OBJECTIF BAC SUJETS Compositions – Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale / Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.Etudes critiques de documents- Les élections de 1912 / Karl Liebknecht, martyr du spartakisme
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
16 CHAPITRE 3 HISTOIRE - Term
Ouverture du chapitre P 68-69
L’affirmation de l’idéologie socialiste par les partis et syndicats ouvriers permet l’expression organisée des revendications sociales. D’abord strictement ouvrière et réprimées [doc. 1], ces demandes sont ensuite intégrées au jeu démocratique et mobilisent l’ensemble de la popula-tion [doc. 2].
Grand angle P 70-71
Le monde ouvrier en Allemagne de 1875 à 1914Les organisations ouvrières se développent avec l’industrialisation et l’urbanisation de l’Allemagne. Les zones fortement industrialisées (Saxe) et les grandes villes sont celles où le parti social-démocrate (SPD) fait le plus large score. Le parti ne représente alors que les intérêts ouvriers.
Cours 1 P 72-73
Socialisme et syndicalisme : de l’unité à la divisionDepuis sa fondation en 1875, le SPD est traversé par la contradiction entre ses succès électoraux – qui en font une composante essentielle du système parlementaire [doc. 1] – et son identité révolutionnaire, qui le conduit à rompre avec la société existante [doc. 2]. Cette contradiction est dissimulée par la mobilisation des ouvriers en associations, syndicats, coopératives, qui permettent de les réunir pacifiquement dans une contre-société qui encourage les droits des femmes [doc. 3]. La république de Weimar dissocie les deux aspirations du mouvement ouvrier allemand : si le SPD soutient la démocratie jusqu’à l’arrivée de Hitler au pouvoir [doc. 5], le parti communiste (KPD) entretient l’idée révolutionnaire au point d’accu-ser le SPD de traîtrise [doc. 4].
Étude P 74-75
La social-démocratie allemande avant 1914Cette étude vise à montrer comment le SPD et ses syndicats sont passés d’une idéologie révolutionnaire à une idéologie démocra-tique.
QuestionsPrélever et confronter les informations1. La révolution est le but du parti social-démocrate. Elle est une loi de l’histoire qui doit fatalement survenir. En attendant la révo-lution, les ouvriers doivent se former dans le parti et les organisa-tions socialistes.2. Le parti encadre ses militants pendant toute leur vie et au cours de toutes leurs activités : les syndicats organisent la lutte économique et la vie professionnelle, les associations président aux loisirs.3. Le parti peut compter sur une idéologie forte affirmée dans son programme, sur un encadrement solide des militants et sur une agitation permanente par ses chefs.4. Le parti évolue parce que ses succès électoraux en font un acteur de la vie politique allemande, forcé de respecter la loi, et parce que la Première Guerre mondiale impose de choisir la défense de l’Alle-magne.
Confronter deux documentsLa confrontation des doc. 1 et 2 montre que le parti est, depuis l’origine, partagé quant à la voie à suivre. Cette opposition entre révolution et réformisme est en même temps au cœur de l’identité du SPD : à la fois révolutionnaire et intégrée à la société allemande.
Étude P 76-77
La naissance du communisme allemand en 1918-1919Cette étude vise à montrer la division des ouvriers allemands entre social-démocratie et communisme à l’issue de la Première Guerre mondiale.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. En 1918, soldats et ouvriers se révoltent dans les ports, puis dans les grandes villes. L’Empire est remplacé par la république, l’armis-tice est signé. Mais communistes et sociaux-démocrates s’opposent sur la définition de la république, donnant lieu à la fondation du parti communiste allemand (KPD) et provoquant la guerre civile.2. Les sociaux-démocrates veulent une république stable qui mette fin à l’agitation de novembre 1918. Les communistes aspirent à une république fondée sur l’égalité des travailleurs et à l’abolition du capitalisme.3. Pour les communistes, la révolution violente est l’étape nécessaire qui permet de réaliser la société socialiste. Elle est faite par les ouvriers contre le gouvernement et les sociaux-démocrates.4. Il s’agit d’une guerre civile parce que l’opposition entre sociaux-démocrates et communistes devient une lutte armée. Les commu-nistes rejettent la République de Weimar, dont les forces armées interviennent et tuent des militants communistes. La violence est progressivement remplacée par des élections légales, mais les communistes veulent toujours détruire le système parlementaire.
Confronter deux documentsLe doc. 3 met en lumière la violence qui oppose socialistes et communistes dans des combats de rue, alors que le doc. 6 montre que ces oppositions sont progressivement investies dans les élec-tions.
Organiser et synthétiser les informationsOn peut travailler ce bilan en reprenant la distinction entre révolu-tionnaires / réformistes pour montrer que ces deux courants fondent deux idées de la république : celle du SPD, démocratique, et celle du KPD, révolutionnaire.
Cours 2 78-79
Social-démocratie et communisme en Allemagne depuis 1945Comme l’Allemagne, le monde ouvrier est coupé en deux après 1945. En RFA, le SPD est reconstitué en 1946. Il devient l’un des deux partis principaux avec la CDU / CSU (partis chrétiens-démo-crates) [doc. 1] et parvient au pouvoir grâce à une coalition en 1966. Lié à la Confédération allemande des syndicats, il construit l’éco-nomie sociale de marché [doc. 2]. En RDA, un parti unique, le parti socialiste unitaire (SED) né de la fusion entre KPD et SPD, domine l’État et impose une idéologie communiste inspirée d’URSS [doc. 3]. Les socialistes ne jouent pas un rôle moteur dans la réunification,
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 3 17
mais ils font de la réunion des deux branches du socialisme le symbole de celle de l’Allemagne [doc. 4]. La réunification allemande et la diversification des partis de gauche représentent un défi pour le SPD du xxie siècle [doc. 5].
Étude P 80-81
Les manifestations du 17 juin 1953L’objet de cette étude est de montrer la façon dont les populations est-allemandes ont agi sous le régime communiste, à travers l’exemple des manifestations du 17 juin 1953.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les principales demandes des manifestants visent d’abord une amélioration des conditions de travail (baisse des cadences). Puis des slogans plus politiques apparaissent (libertés), demandant parfois l’abolition du régime (réunification, élections libres).2. Les manifestations prennent d’abord la forme de grèves, dans des cortèges pacifiques. Puis la violence intervient avec la répression et l’intervention des troupes soviétiques, appelées à l’aide pour rétablir la dictature.3. La population n’est pas unanime à contester le régime. Les manifestants décrits aux doc.1 et 2 forment des cortèges, mais la carte et le doc. 3 montrent que toute la population est-allemande ne suit pas le mouvement.4. Les conséquences immédiates de ces manifestations sont l’inter-vention soviétique et le renforcement de la censure, condamnée par la RFA.
Confronter deux documentsLe doc. 1 est le témoignage d’un manifestant interrogé par la police après les faits. Ce manifestant doit donc masquer de son interven-tion tous les aspects politiques du cortège. À l’inverse, le doc. 2 est un rapport de police, il cherche à montrer que ces manifestations n’expriment pas l’opinion globale des Allemands de l’Est. Il met donc l’accent sur les éléments minoritaires les plus radicaux.
Organiser et synthétiser les informationsLa répression marque la domination en RDA de l’idéologie commu-niste qui ignore les réalités économiques et sociales (problème des cadences de travail).
Étude P 82-83
Le congrès de Bad Godesberg (1959)L’objet de cette étude est de montrer l’évolution du SPD après 1945 à travers son congrès le plus important : celui de Bad Godesberg en 1959, où il abandonne toute référence marxiste.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les acteurs du congrès sont les délégués du SPD réunis à Bad Godesberg et leurs leaders : Erich Ollenhauer, Willy Brandt, Herbert Wehner.2. Les objectifs du congrès sont d’unir étroitement socialisme et démocratie, de faire du SPD un parti populaire, de donner aux syndicats un rôle actif dans la réforme sociale, d’accepter la libre entreprise.
3. Les points du programme qui sont révisés sont l’attente de la révolution, l’opposition entre les ouvriers et les capitalistes, le rejet de l’économie de marché.4. Il s’agit d’un tournant dans l’histoire du socialisme allemand et européen, car c’est la première fois qu’un parti renonce à l’idée de révolution.
Mettre en relation deux documentsLe doc. 2 souligne la rupture du SPD avec l’orthodoxie marxiste tout en soulignant ce qui oppose le SPD au SED est-allemand. Le doc. 5 met en valeur la prise de conscience immédiate par les observateurs étrangers de l’importance de ce congrès. La mise en relation de ces deux documents conduit donc à insister sur l’impor-tance de ce changement de doctrine dans l’histoire du SPD et, au-delà, du socialisme allemand.
Étude P 84-85
Le chancelier Gerhard Schröder et les mutations de la gauche allemandeL’objet de cette étude est d’aborder, à travers l’action du chancelier Gerhard Schöder, les mutations que connaissent le socialisme et le syndicalisme en Allemagne après la réunification. L’adaptation de l’idéologie socialiste aux nouvelles réalités économiques et sociales de l’Allemagne réunifiée menace en effet le SPD de perdre son identité.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le gouvernement Schröder entreprend une vaste réforme du marché du travail en vue d’aider l’économie allemande à être plus compétitive. Ce faisant, il redéfinit les contours de la social-démo-cratie en suivant le modèle initié en Grande-Bretagne par Tony Blair.2. L’adoption des lois Hartz, qui diminuent les indemnités aux chômeurs de longue durée, provoque de vives tensions dans l’aile gauche du SPD, autour d’Oskar Lafontaine, qui se rapproche de l’ancien parti communiste d’Allemagne de l’Est pour former Die Linke.3. Gerhard Schröder perd progressivement la majorité et se trouve contraint de quitter le pouvoir. Le SPD a été affaibli par la scission d’une partie de ses membres au profit de Die Linke. La base élec-torale du SPD ne se retrouve plus dans les orientations du parti.4. L’hommage rendu par Angela Merkel à Gerhard Schröder souligne combien les clivages politiques traditionnels ont été remis en cause par les réformes Schröder. A deux reprises, le SPD rejoint la CDU dans une grande coalition gouvernementale. Ces grandes coalitions, toutefois, ne sont pas rares dans l’histoire de l’Allemagne de l’Ouest depuis 1949.
Analyser un graphiqueL’analyse du graphique conduit à souligner d’une part les progrès électoraux de Die Linke et d’autre part l’affaiblissement relatif du SPD, contraint de former des grandes coalitions avec Angela Merkel pour rester puis revenir au pouvoir.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
18 CHAPITRE 3 HISTOIRE - Term
Histoire des arts P 86-87
George Grosz, Les Piliers de la société
Analyser l’œuvre
Le contexte est reconnaissable à la violence en arrière-plan du tableau, qui évoque la révolution spartakiste et sa répression, en même temps que l’action des corps francs. Le contexte est celui d’un « ensauvagement » de la société allemande (Mosse).Les « piliers de la société » sont l’aristocrate nazi, au premier plan, le journaliste à sa droite, l’homme politique social-démocrate derrière lui et le prêtre qui détourne le regard. L’artiste use de différents procédés pour les caricaturer : il déforme leurs traits pour souligner leur caractère, les affuble d’attributs péjoratifs ou de symboles de l’Ancien régime impérial.
Comprendre la portée de l’œuvre
Les opinions politiques de Grosz transparaissent dans sa dénoncia-tion conjointe de la social-démocratie et du nazisme et, au-delà, dans la condamnation du régime de Weimar, jugé instable et favo-risant la répression des mouvements ouvriers.La critique de Weimar ne se résume pas à sa dimension politique et les artistes de la « Nouvelle objectivité » dénoncent une société bourgeoise, marquée par la collusion d’intérêts en apparence divergents et la relégation les ouvriers à l’arrière-plan.
EXERCICES P 89
Analyser une peintureLa propagande communiste vue par un artiste expressionnisteL’orateur a été peint dans le contexte de la révolution de 1918-1919, qui n’est pas clairement identifiable sur le tableau dont la configu-ration met l’accent sur la violence du discours et sur l’effet produit sur l’auditoire : tension des corps et des bras, effet de foule par l’accumulation des mains. La propagande ne fait pas appel à la raison ou à la conviction, mais aux passions des foules (dépeintes à travers ce qui ressemble à une forme d’illumination ou d’extase) Elle touche une masse indistincte et non des individus. L’impression donnée par le tableau est celle d’une grande crainte et d’une grande méfiance. L’orateur est un démagogue qui utilise les passions de la foule pour soulever un mouvement incontrôlable.
Objectif BAC Méthode P 90-91
Composition / Comprendre les enjeux du sujetQuel impact ont eu les grandes crises du xxe siècle sur le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne ?Ce sujet, très vaste, doit conduire les élèves à réfléchir au sens du mot « crises » et à définir aussi précisément que possible les trois notions clés du programme, « socialisme », « communisme » et « syndicalisme ». L’analyse de ces crises doit les conduire à souligner l’importance des guerres et de la guerre froide dans les mutations du mouvement ouvrier allemand.
Comment le SPD a-t-il réussi à s’adapter aux évolutions de la société.Le sujet invite les élèves à considérer la dimension révolutionnaire et réformiste du SPD, à l’épreuve des transformations économiques et sociales de l’Allemagne sur la longue durée. On peut attendre d’eux qu’ils évoquent certaines grandes étapes de ces transforma-tions : la naissance du SPD, l’expérience du nazisme, le congrès de Bad Godesberg et l’expérience Schröder.
Le socialisme et le monde ouvrier en Allemagne au xxe siècleL’étude du rapport entre le socialisme et le monde ouvrier permet d’aborder le lien relativement étroit, en Allemagne, entre le SPD et le syndicalisme. Dans un second temps, l’affaiblissement du monde ouvrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale peut être considéré comme l’un des facteurs des mutations du socialisme allemand.
Objectif BAC Méthode P 92-93
Étude critique de document / Analyse de document
Analyser une peinture
Les mineurs vus par un peintre engagéCe tableau expressionniste présente une vision empathique d’un mouvement ouvrier en marche vers un avenir radieux. L’usine ne semble pas ici broyer ou affaiblir les ouvriers, dont le visage exprime une confiance sereine en l’avenir et dont les traits ne laissent pas apparaître de fatigue. Ce tableau offre donc une vision idéalisée du monde ouvrier et de la lutte ouvrière, éloignée de la réalité de la condition ouvrière allemande des années 1920.
L’internationale ouvrièreCe tableau d’Otto Griebel représente la solidarité ouvrière à travers ces hommes et ces femmes qui entonnent l’Internationale, le chant révolutionnaire par excellence. Membre actif du KPD, Griebel est un peintre engagé, emblématique d’un « art prolétarien » qui se développe en Allemagne dans les années 1920.
Objectif BAC Sujets P 94
CompositionSocialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondialeCe sujet de composition porte sur une partie du programme spé-cifique aux L et aux ES et doit conduire les élèves à appréhender la naissance et l’essor du socialisme et du communisme en trois temps : de 1875 à la révolution spartakiste, pendant la République de Weimar, et enfin pendant le nazisme.
Etude critique de documentLes élections de 1912Ce document permet d’étudier la forte progression électorale du SDP. Il est intéressant d’abord de relever la forte progression en voix (multipliées par 12) et en sièges (multipliés par 17) jusqu’en 1890, en dépit des lois antisocialistes de Bismarck (1878-1890). Le SPD triple ensuite son nombre de voix jusqu’en 1912. La carte postale célèbre donc la progression électorale constante du SPD et son triomphe sur ses adversaires.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 3 19
Objectif BAC Sujets P 95
CompositionSocialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos joursCe sujet doit conduire les élèves à distinguer la période de la guerre froide, marquée par la division de l’Allemagne et la distinction entre l’action du SPD, à l’Ouest, et celle du SED, à l’Est, et la période qui suit, caractérisée par de profondes recompositions de l’échiquier politique et les mutations rapides du mouvement ouvrier dans son ensemble.
Analyse de documentKarl Liebknecht, martyr du spartakismeCette sculpture sur bois est un témoignage de la répression de la révolution spartakiste et de son importance dans la symbolique communiste allemande. Connue pour son engagement politique, Käthe Kollwitz met en exergue la sympathie du peuple, en en premier lieu des ouvriers, pour ce leader spartakiste. Les funérailles de Liebknecht à Berlin ont en effet attiré une foule importante.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Actes du colloque, Culture ouvrière, Mutations d’une réalité complexe en Allemagne du xixe au xxie siècle, Dominique Herbet éd., collection « mondes germaniques », Septentrion, 2011.
• Droz Jacques, Histoire générale du socialisme (4 vol.), PUF, 1997.
• Gougeon Jacques-Pierre, La Social-démocratie allemande 1830-1996 – De la révolution au réformisme, Aubier, 1998.
• Kott Sandrine, Lattard Alain, Vincent Marie-Bénédicte, Histoire de la société allemande au xxe siècle (3 vol.), La Décou-verte, 2011.
• Rovan Joseph, Histoire de la social-démocratie allemande, Seuil, 1978.
• Wahl Alfred, Les Forces politiques en Allemagne – xixe-xxe siècles, Armand Colin, 1999.
FilmographieRéférences utiles pour montrer la mémoire de la RDA en Allemagne :
• BECKER Wolfgang, Good Bye Lenin, 2003.
• HENCKEL VON DONNERSMARCK Florian, La Vie des autres, 2006.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
20 CHAPITRE 4 HISTOIRE - Term
4 Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire DreyfusCe chapitre met en relation deux composantes majeures de la vie politique sociale à l’âge de la démocratie. À la fin du xixe siècle, le développement d’une presse grand public et libre de ton ouvre un espace favorable aux débats d’idées, participant ainsi à la formation de l’opinion publique, tout en s’en faisant le reflet. La diversification médiatique du xxe siècle renforce l’importance de l’opinion publique. Le programme restreint l’étude au seul champ du politique. Il se concentre sur les principales crises traversées depuis l’affaire Dreyfus, définies comme des moments de rupture du consensus démocratique, de remise en cause des institutions ou de contestation des valeurs dominantes.
• L’étude sur l’affaire Dreyfus et le « Grand Angle » consacré à la Belle Époque démontrent l’empire de la presse de masse sur l’opinion au tournant du xxe siècle. Les élèves peuvent d’emblée cerner le double rôle des médias, qui rendent compte des débats animant la vie politique, mais peuvent aussi les susciter ou les alimenter.
• La seconde étude, consacrée à la crise du 6 février 1934, met en avant le pouvoir de la presse d’opinion dans l’entre-deux-guerres, tout en introduisant un nouveau média, la radio, que l’État contrôle étroitement.
• La troisième étude, centrée sur les débuts du régime de Vichy, montre que le contrôle de l’information est un enjeu central en temps de guerre.
• Le premier cours permet de synthétiser les caractéristiques de la période s’achevant dans les années 1950, durant laquelle la presse participe activement à l’élaboration de l’opinion publique.
• L’étude sur le 13 mai 1958 met en évidence une rupture politique et médiatique, marquée par l’essor des médias audiovisuels (radio et télévision) contrôlés par le pouvoir. Leur contestation est l’un des enjeux de la crise de mai 1968 (abordée dans l’étude et les pages « Histoire des arts »).
• Le second cours décrit les étapes de la libéralisation de l’audiovisuel et de la montée en puissance d’une opinion publique rendue de plus en plus autonome par l’apparition des nouveaux médias et d’Internet.
Thème 2 Idéologies et opinions en Europe de la fin du xixe siècle à nos jours
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Médias et opinion publique : médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus
p. 98-99 : GRAND ANGLE – Médias et opinion à la Belle Époquep. 100-101 : ETUDE – La presse et l’affaire Dreyfusp. 102-103 : COURS 1 – L’avènement des médias de masse et l’opinion publiquep. 104-105 : ETUDE – La crise du 6 février 1934 et les médiasp. 106-107 : ETUDE – La défaite de 1940 et le contrôle de l’informationp. 108-109 : ETUDE – Le 13 mai 1958, une crise médiatiséep. 110-111 : COURS 2 – L’opinion publique de l’ère de la télévision aux nouveaux médiasp. 112-113 : ETUDE – mai 1968 et les médias
Les outils du manuel
p. 114-115 : HISTOIRE DES ARTS Gérard Fromanger, Le Rouge
p 117 : EXERCICE Analyser une affiche électorale – 1965 : la première élection présidentielle télévisée
p. 116-117 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 118-121 : OBJECTIF BAC METHODE Dégager les enjeux du sujet – Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus Analyser la Une d’un journal – La crise du 13 mai 1958 vue par la presse algéroise
p. 122-123 : OBJECTIF BAC SUJETS Compositions – Les médias et les grandes crises politiques de la Ve République / L’impact des nouveaux médias sur l’opinion publique en France depuis 1945 Études critiques de documents - mai 1968 : une crise « médiatisée » Le 21 avril 2002, une crise politique et média-tique
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 4 21
Ouverture de chapitre P 96-97
Alors que la presse est la principale source d’information à la fin du xixe siècle, les médias donnent désormais la parole directement à des représentants de l’opinion publique. Ils jouent un double rôle politique d’un côté, ils diffusent la parole publique ; de l’autre, ils influencent le débat démocratique
Grand angle P 98-99
Médias et opinion à la Belle Époque L’essor de la presse de masse s’explique par les progrès de l’alpha-bétisation et la baisse du prix des quotidiens.Les tirages des journaux parisiens, ainsi que la diversification des titres illustrent sa vitalité. La presse ne se contente pas d’informer l’opinion : certaines rédactions diffusent leurs idées auprès du lectorat.
Étude P 100-101
La presse et l’affaire DreyfusLes élèves ayant déjà étudié l’affaire en 1re – la chronologie permet d’en rappeler brièvement les principales étapes –, il s’agit ici de se concentrer sur le rôle joué par la presse de masse, qui utilise la liberté conquise en 1881 pour remettre en cause une affaire judi-ciaire, puis alimenter une joute idéologique qui divise l’opinion. L’étude débute avec la lettre de Zola, qui déclenche une véritable guerre de presse, et permet d’opposer les moyens et les argumen-taires développés par les deux camps.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. Les journaux défendent leurs idées par des moyens très divers : éditoriaux, articles, enquêtes, caricatures.2. Les intellectuels, à partir de l’affaire, utilisent leur notoriété scientifique ou culturelle et le pouvoir amplificateur des médias pour influencer l’opinion.3. L’Affaire illustre la grande liberté de ton de la presse, mais en montre aussi les limites, puisque Zola est condamné pour diffamation.4. L’affaiblissement de la presse antidreyfusarde suit le déroulement de l’Affaire, mais elle demeure majoritaire après la révision du procès. Il faut rappeler que Dreyfus n’est réhabilité qu’en 1906.5. Le débat alimenté par la presse divise l’opinion publique, comme l’illustre la célèbre caricature de Caran d’Ache et l’intervention des intellectuels.
Confronter deux documentsL’éditorial d’Henri Rochefort [doc.2] est une réponse à la campagne de presse lancée par L’Aurore en janvier 1898. Les deux textes sont écrits sur un ton passionné, mais les argumentaires déployés s’opposent : alors que Zola s’en prend à l’autorité militaire au nom du droit et de la vérité [doc.1], les attaques calomnieuses de Roche-fort, qui ne portent pas sur le fond de l’affaire, visent la presse dreyfusarde et les Juifs.
Organiser et synthétiser des informationsTrois axes sont possibles. 1. La presse relance une affaire judiciaire et en fait une affaire d’opinion. 2. Elle amplifie le débat et nourrit
une violente joute idéologique. 3. L’influence des médias divise profondément l’opinion publique.
Cours 1 P 102-103
L’avènement des médias de masse et l’opinion publique Les trois premiers documents permettent d’aborder la probléma-tique de la liberté de la presse. L’affaire Caillaux anime l’opinion publique et illustre les excès auxquels peut conduire une campagne de presse [doc.1]. Dans le cas de l’affaire Salengro, le pouvoir de la presse est encore plus frappant, puisque la calomnie conduit le ministre de l’Intérieur au suicide [doc.3]. D’un autre côté, l’accès à une information libre est revendiqué avec ironie durant la Première Guerre mondiale par le Canard enchaîné, fondé en 1915 pour lutter contre le « bourrage de crâne » [doc.2].L’émergence des médias audiovisuels est évoquée par le biais des deux derniers documents. La radio, apparue dès les années 1920, devient le moyen de communication privilégié des hommes poli-tiques. Pour Pierre Mendès France, elle renforce la légitimité des gouvernants [doc.5]. Enfin, la télévision (souvent visionnée de manière collective dans les années 1950) rend l’opinion publique spectatrice en direct des événements politiques [doc.4].
Étude P 104-105
La crise du 6 février 1934 et les médias La crise du 6 février 1934 intervient dans un contexte de forte politisation de la presse. Elle est en effet orchestrée par les journaux antiparlementaires, qui alimentent l’hostilité à l’égard du gouver-nement radical après l’affaire Stavisky et contribuent – avec L’Huma-nité – à la démission de Daladier le 7 février. La radio, écoutée par près de la moitié des Français, diffuse une information étroitement contrôlée par l’État dont l’écho ne parvient pas à contrebalancer les attaques de la presse.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La presse suscite la crise en attaquant le gouvernement radical, dont certains membres ont couvert les agissements de l’escroc Stavisky, et en relayant les appels à manifester des ligues et asso-ciations d’anciens combattants.2. Les nouveaux médias se distinguent de la presse d’opinion. La radio diffuse l’interprétation officielle du gouvernement et en assoit la légitimité ; la presse illustrée contourne le débat sur l’émeute pour en donner une image sensationnaliste.3. Aucun média n’est totalement neutre face à la crise, car chacun donne son point de vue sur les responsables de la violence.4. Les médias sont utilisés par les associations d’extrême droite qui mobilisent les lecteurs, par le gouvernement qui cherche à rassurer l’opinion, et par certains intellectuels qui cherchent à la mettre en garde contre la menace fasciste.5. La crise apparaît aux uns comme un coup d’État avorté et aux autres comme un mouvement d’indignation injustement réprimé.
Mettre en relation deux documentsLe doc. 4 présente deux interprétations opposées de l’émeute. Le Populaire [doc. 4a], journal socialiste, y voit un complot sciemment
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
22 CHAPITRE 4 HISTOIRE - Term
préparé contre le régime républicain, alors que L’Action française [doc.4b] insiste sur la violence des forces de police. Les deux édito-rialistes prétendent chacun défendre le « peuple », qui désigne d’un côté « la classe ouvrière » et de l’autre les militants nationalistes.
Organiser et synthétiser des informationsDeux axes sont possibles. 1. Les journaux antiparlementaires ont suscité l’émeute du 6 février 1934. 2. Sa médiatisation a conduit à une profonde division de l’opinion publique et a contribué à dés-tabiliser le gouvernement.
Étude P 106-107
La défaite de 1940 et le contrôle de l’information Sans s’attarder sur un récit des événements de l’année 1940 (vus en première et que la chronologie reprend), l’étude met en valeur une double rupture : la fin de la démocratie est en effet inséparable de l’abolition temporaire du régime de liberté de la presse. Celle-ci devient un instrument de propagande au service de l’occupant et du régime de Vichy. L’étude invite également à explorer les failles du contrôle des médias, à travers la « guerre des ondes » et l’essor de la presse clandestine.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Dans la France de Vichy, les médias deviennent un instrument au service du maréchal et de la « révolution nationale ».2. Pour le maréchal Pétain, la radio offre un contact direct et ins-tantané avec l’opinion publique (jusque dans les salles de cours) et doit lui permettre de créer un large consensus autour de sa personne.3. Avant 1940, selon Marc Bloch, la plupart des médias n’ont pas exercé leur fonction civique ; après 1940, tout sens critique leur est interdit par la censure.4. L’autorité du régime repose en partie sur sa capacité à maîtriser l’information et à museler les voix discordantes.5. Les postes de radio émettant depuis l’étranger – en particulier la BBC – et la presse clandestine diffusée sous le manteau contournent la censure.
Analyser un texteLe doc. 1 est extrait de L’Étrange Défaite, témoignage sur le vif écrit par Marc Bloch au cours de l’été 1940. Il porte un regard très critique sur les médias des années 1930, accusés de diffuser une information subjective et de ne pas avoir suffisamment préparé l’opinion à la menace fasciste. Ses limites tiennent aux circonstances de sa rédaction, qui empêchent tout réel recul historique.
Organiser et synthétiser des informationsTrois axes sont possibles. 1. Le rôle des médias dans la défaite de 1940. 2. Propagande et censure des médias. 3. Les vecteurs d’une information libre.
Étude P 108-109
Le 13 mai 1958, une crise médiatisée L’étude consacrée à la fin de la IVe République met en valeur le poids des médias audiovisuels contrôlés par le pouvoir politique, devenus primordiaux dans les années 1950. Face à la soudaineté et à l’impact de la crise du 13 mai, les médias doivent travailler dans
l’urgence et ne disposent que de sources d’information rares et partiales.La parole officielle relayée par l’audiovisuel est court-circuitée en Algérie par les généraux putschistes, qui occupent Radio-Alger. Les médias d’État accompagnent le retour du général de Gaulle, dont ils deviennent les fidèles relais.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. L’accès à une information fiable est limité au début de la crise, car les putschistes occupent la station de radio algéroise et tentent de contrôler les informations transmises par les correspondants.2. Aucun des médias audiovisuels n’est indépendant : certains sont contrôlés par le pouvoir politique, d’autres par le Comité de salut public algérien.3. Les médias contrôlés par l’État (en particulier les actualités fil-mées) adaptent leur discours au changement progressif de pouvoir, reflétant l’adhésion majoritaire de l’opinion publique au retour du général de Gaulle.4. De Gaulle organise une conférence de presse radiotélévisée le 19 mai, au cœur de la crise, qui lui permet d’endosser à nouveau la posture de « l’homme du 18 juin ».De Gaulle s’appuie d’abord sur les médias défendant l’insurrection algérienne et une partie de la radio, mais les actualités filmées passent sous silence son intervention.5. Les médias audiovisuels, sous monopole de l’État, donnent un écho considérable au retour du général de Gaulle, puis défendent clairement son action dès qu’il est désigné président du Conseil. Seule une partie de la presse écrite (notamment les newsmagazines comme L’Express) continue de défendre la IVe République, par crainte d’un tournant autoritaire et liberticide.
Confronter deux documentsLes deux documents montrent que les journalistes audiovisuels travaillent sous contrainte. D’un côté, l’information qui leur parvient est souvent partiale et peu fiable en raison des circonstances ; de l’autre, ils doivent donner des événements une version favorable au pouvoir politique – c’est ainsi que le nom du général de Gaulle n’est pas mentionné dans les actualités du 21 mai.
Organiser et synthétiser des informationsTrois axes sont possibles. 1. L’information, enjeu de la crise politique. 2. La médiatisation de la solution gaullienne… 3. Et son impact sur l’opinion publique.
Cours 2 P 110-111
L’opinion publique de l’ère de la télévision aux nouveaux médiasLa révolution médiatique entamée dans les années 1960 apparaît nettement dans le doc. 1 : alors que la lecture de la presse diminue régulièrement, la télévision puis Internet deviennent les principaux moyens d’information des Français.La télévision impose de nouvelles règles de communication poli-tique. Le général de Gaulle s’y adapte et en fait l’instrument de son pouvoir personnel [doc. 2]. La libéralisation progressive de l’ORTF et le règne de l’audimat conduisent les chaînes à privilégier une forme de « politique-spectacle » axée sur l’image et les duels de
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 4 23
personnes [doc. 3], jusqu’à être accusées d’imposer leurs choix à l’opinion publique [doc. 4]. Enfin, la presse en ligne redéfinit le rapport entre les médias et l’opinion publique, de plus en plus associée à la création et à la diffusion de l’information [doc. 5].
Étude P 112-113
Mai 1968 et les médias La crise de mai 1968 est ici étudiée en tant que moment de révolte d’une partie de l’opinion publique contre des médias de masse jugés trop conformistes et soumis au pouvoir politique. Acteurs majeurs de la « société du spectacle » (Guy Debord, 1967) et de la « société de consommation » (Jean Baudrillard, 1970), les médias sont vus comme un outil d’aliénation de la population. Les contestataires leur opposent une prise de parole libre et directe. L’étude invite aussi à analyser le traitement de la crise par les différents médias.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Pierre Viansson-Ponté juge que les journaux de la télévision d’État traitent l’information de manière superficielle et partiale, dans le double but de distraire et d’apaiser l’opinion publique.2. Les médias se montrent – à des degrés divers – partisans, selon leur indépendance vis-à-vis du pouvoir et selon l’image qu’ils donnent de la révolte : le doc. 5, qui insiste sur la répression poli-cière, incite ainsi à la sympathie envers les étudiants.3. Alors que les radios périphériques accompagnent et amplifient la révolte, la radio d’État est l’instrument du retour du général de Gaulle.4. La prise de parole s’organise sur les places du Quartier Latin et dans les lieux occupés par les contestataires.5. Les contestataires jugent que la liberté d’expression est dévoyée par les médias dominants, opinion symbolisée par les affiches de l’atelier des Beaux-Arts qui ciblent fréquemment les médias de masse [doc. 4]. Ils veulent imposer des moyens d’expression directe de l’opinion publique.
Mettre en relation deux documentsLes deux documents critiquent directement l’ORTF, office audiovi-suel d’État fondé à l’instigation du général de Gaulle en 1964 : Pierre Viansson-Ponté y voit un moyen de propagande sans précédent qui vise à étouffer toute velléité contestataire, tandis que la célèbre affiche de l’atelier des Beaux-Arts dénonce l’absence de pluralisme d’un média résolument placé du côté de l’ordre.
Organiser et synthétiser des informationsTrois axes sont possibles : la critique des médias dominants ; la libération de la parole ou la réaction médiatique.
Histoire des arts P 114-115
Gérard Fromanger, Le RougeAnalyser l’œuvreL’affiche de Fromanger vise à inscrire dans la durée, par un geste proprement artistique, la critique des médias formulée en mai 1968. Son détournement des photographies de presse est résolument engagé : les manifestants, coloriés en rouge, forment une vague montante qui semble submerger progressivement les forces de l’ordre. L’artiste montre ainsi que le traitement médiatique d’un
événement ne peut être neutre, et invite l’opinion publique à intervenir directement dans la diffusion de l’information.
Comprendre la portée de l’œuvreL’œuvre peut être mise en parallèle des productions de l’atelier des Beaux-Arts (fondé par Fromanger) et d’autres détournements de photographies, comme celui de Bertrand Rancillac présenté en focus.
EXERCICE P 117
Analyser une affiche électoraleCette affiche montre que Jean-Louis Tixier-Vignancour, qui a pour directeur de campagne et porte-parole Jean-Marie Le Pen, n’hésite pas à faire appel aux ressources de la communication moderne. Son passage à la télévision, en premier, en vertu du tirage au sort, et son tour de la France avec un chapiteau (le « cirque Tixier ») ont pour conséquence une très forte progression de sa notoriété.
Objectif BAC Méthode P 118-119
Composition / Dégager les enjeux du sujetMédias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’Affaire DreyfusIl est difficile d’envisager un plan chronologique puisque le sujet est discontinu. Problématique possible : les médias reflètent-ils l’opinion lors des grandes crises ou l’influencent-ils ?
Plan possible :1. Les médias ne peuvent avoir une position neutre lors des crises (orientation politique, mais aussi localisation : beaucoup sont parisiens)2. Ils contribuent donc souvent à dramatiser les crises (par le choix de l’angle, des épisodes relatés, etc.).3. L’émergence d’un consensus (2002) témoigne des nouveaux rapports entre médias et opinion (pluralité de l’information, apai-sement des débats idéologiques)
Les médias, un acteur des crises politiques de l’Affaire Dreyfus à la chute de la IIIe RépubliqueCe sujet invite à identifier et caractériser le rôle actif des médias lors des crises sous la IIIe République, en distinguant les cas dans lesquels les médias influencent directement le déroulement de la crise (Affaire Dreyfus, février 1934), et ceux dans lesquels ils la reflètent davantage qu’ils l’influencent (1940).
Le rôle des médias dans les grandes crises politiques en France au xxe siècleL’Affaire Dreyfus fait partie du sujet, car elle inaugure en quelque sorte le xxe siècle des médias et de l’opinion publique en tant qu’acteurs des grandes crises. Le sujet est propice à un plan thé-matique mettant en évidence les différents rôles qu’ont joués les médias dans les grandes crises politiques au xxe siècle.
Objectif BAC Méthode P 120-121
Étude critique de document / Analyser la Une d’un journalLa crise du 13 mai 1958 vue par la presse algéroiseCe document permet d’aborder le rôle de ce journal, Algérie fran-çaise, dans les événements. En effet, tous les éléments (éditorial,
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
24 CHAPITRE 4 HISTOIRE - Term
tribune, article central, photographies) indiquent clairement le parti-pris du journal en faveur de l’insurrection et du retour au pouvoir du général de Gaulle. L’Echo d’Alger apparaît bien avoir cherché à préparer l’opinion publique algéroise au retour du géné-ral de Gaulle. Il reflète cela dit en cela l’opinion majoritaire chez les colons.
La presse de Vichy et la jeunesseLa revue Cœurs vaillants, fondée en 1929 et destiné aux jeunes garçons de 11 à 14 ans, s’inscrit dans le cadre de l’Action catholique. Il s’agit donc de l’organe d’un mouvement de jeunesse catholique étroitement dépendant de l’épiscopat. Interdit en zone occupée, il est soumis à la censure en zone sud. La Une témoigne cela dit moins de l’emprise de la censure ou d’une forme d’autocensure que de l’adhésion très large des mouvements de jeunesse catholique au maréchalisme entre 1940 et 1942.
Objectif BAC Sujets P 122
CompositionLes médias et les grandes crises politiques de la Ve République Conformément au programme sujet porte essentiellement sur la crise du 13 mai 1968 et celle de mai 1968, mais il invite également les élèves à prolonger leur réflexion (dans une 3e partie ou en conclusion) en intégrant les mutations les plus récentes.
Étude critique de documentMai 1968 : une crise « médiatisée » La photographie a été prise au paroxysme de la crise. Les accords de Grenelle ont été signés la veille, mais la base les refuse et la gauche appelle de Gaulle à se retirer. Le document montre une assemblée générale dans le « Grand Amphi » de la Sorbonne, télescopage de la solennité académique et de la contestation libertaire. Les médias, omniprésents, rappellent le rôle des radios privées et de la presse écrite dans la « couverture » de l’évènement.
SujetsObjectif BAC P 123
CompositionL’impact des nouveaux médias sur l’opinion publique en France depuis 1945 La difficulté du sujet pour les élèves consiste en la définition d’un « nouveau média » : la radio et la télévision font en effet partie du sujet, qui invite à réfléchir à la complémentarité entre « anciens » et « nouveaux médias » en tenant compte du fait que les médias audiovisuels publics sont étroitement contrôlés jusqu’en 1982. Le sujet invite également à étudier le triomphe de la télévision, l’affai-blissement de la presse écrite, et la concurrence de nouveaux médias numériques, qui touchent de nouveaux publics plus jeunes.
Étude critique de documentLe 21 avril 2002, une crise politique et médiatique Le doc. 1 rappelle d’une part le nombre important de candidats, qui a favorisé la dispersion des voix de gauche, et le fait que le premier tour paraissait joué d’avance et, de ce fait, mobilisait peu l’opinion publique.Le doc. 2, en comparaison, souligne le choc des résultats du 1er tour et le fait que toute la campagne du second tour a eu pour thème l’opposition au Front national et a vu se multiplier les appels, à gauche, pour voter en faveur de Jacques Chirac, finalement élu avec 82 % des voix.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRESBibliographie
• « L’opinion publique », TDC, n° 941, octobre 2007.
• Charles Christophe, Le Siècle de la presse (1830-1930), Le Seuil, 2004.
• D’Almeida Fabrice et Delporte Christian, Histoire des médias en France de la Grande Guerre à nos jours, Flammarion, 2010.
• Tartakowsky Danielle, Le pouvoir est dans la rue – Crises politiques et manifestations en France, Aubier, 1998.
• Winock Michel, La Fièvre hexagonale – Les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Le Seuil, coll. « Points », 2009.
Sites Internet
• « Jalons pour l’histoire du temps présent », le site pédagogique de l’INA : http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil
• « Dreyfus réhabilité », site du ministère de la Culture consacré à l’affaire : http://www.dreyfus.culture.fr/
• « De Gaulle et les médias », dossier de la Fondation Charles de Gaulle : http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1958-1970-la-ve-republique/de-gaulle-et-les-medias.php
• « Mai 1968 illustré », ensemble documentaire présenté sur le site de Sciences Po : http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/produits/bibliographies/mai68/images
• « Esprit(s) de mai 1968 », site pédagogique de l’exposition organisée par la BNF : http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 5 25
5 Les États-Unis et le monde de 1918 à 1945Ce chapitre suit la montée progressive de la puissance américaine, en insistant, comme l’exige le programme, sur les moyens de cette puissance (militaires, diplomatiques, économiques et culturels). Consacré à la période qui couvre les deux guerres mondiales, le cours souligne les hésitations de la puissance américaine, interventionniste en 1917, isolationniste après la guerre, et se ralliant très progressivement à l’interventionnisme entre 1937 et 1941. Menée en amont ou en aval du cours, l’étude 1 permet d’étudier les motivations du basculement des États-Unis du wilsonisme à l’isolationnisme. L’étude 2 permet a contrario de comprendre comment les États-Unis sont sortis progressivement de l’isolationnisme à l’initiative du président Roosevelt.
• Les outils du manuel renforcent l’étude des points clés. Les études Wilson et Roosevelt permettent de travailler sur la politique étrangère, laquelle ne change que lentement entre 1917 et 1945 à cause des pesanteurs de l’isolationnisme.
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Les chemins de la puissance : Les États-Unis et le monde de 1918 à 1945
p. 130-131 : GRAND ANGLE – Les États-Unis, puissance mondiale au lendemain de la guerrep. 132-133 : COURS 1 – D’une guerre mondiale à l’autrep. 134-135 : ÉTUDE – Des 14 points du président Wilson au refus de la SDNp. 136-137 : ÉTUDE – Franklin Roosevelt et l’Amérique en guerrep. 138-139 : REVISION – Les États-Unis et le monde de 1918 à 1945
Les outils du manuel
p. 139 : EXERCICES Analyser une affiche : Les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale
p. 243 : RÉVISIONS Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 140-141 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Analyser une photographie – Le débarquement du 6 juin 1944
Ouverture de chapitre P 128-129Dans le premier cas, le drapeau est brandi comme signe de recon-naissance et comme symbole des valeurs américaines. On peut exploiter l’idée de croisade (engagement pour des valeurs) pour légitimer l’intervention auprès de l’opinion publique (les soldats sont des engagés volontaires). Dans le second cas, le rejet de l’inter-ventionnisme est justifié par la nécessité de préserver les États-Unis de la « folie » européenne. Dans les deux cas, les États-Unis sont présentés comme une grande puissance qui incarne des valeurs universelles.
Grand angle P 130-131
Les États-Unis, puissance mondiale au lendemain de la guerreL’influence américaine est nette en Amérique centrale, dans les Caraïbes et l’océan Pacifique. Les échanges économiques (armes et matières premières en 1918) et humains sont importants avec l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. Annexions territoriales,
présence militaire de longue durée, interventions de courte durée, mais également flux commerciaux sont les modalités de cette présence extérieure.
Cours 1 P 132-133
D’une guerre mondiale à l’autreLes États-Unis sont, à la fin du xixe siècle, une grande puissance impériale qui étend sa domination sur l’Amérique centrale et les Caraïbes (doc.2). L’isolationnisme adopté après la Première Guerre mondiale se mesure dans la forte baisse des investissements américains l’étranger de 1919 à 1940 (doc.1), et le doc. 3 permet de montrer que les lois de neutralité sont justifiées essentiellement par la crainte des États-Unis de se trouver engagés dans un conflit mondial. Roosevelt tente d’infléchir cette tendance devant les nouvelles menaces (doc. 4). Le débarquement en Normandie (doc. 5) montre la force logistique américaine et le rôle déterminant des États-Unis dans la libération de l’Europe.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
26 CHAPITRE 5 HISTOIRE - Term
Étude P 134-135
Des 14 points du président Wilson au refus de la SDNLe président Wilson avait la ferme intention de réformer les relations internationales en arrivant au pouvoir et entreprend de le faire avec les « 14 points ». Il conçoit et obtient la création de la Société des Nations (SDN) en 1919, mais ne parvient pas à l’imposer à ses concitoyens, laissant un système international fragile et son pays dans une position contradictoire face au monde.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les États-Unis entrent en guerre pour des raisons économiques, notamment la liberté de commerce [doc. 2] et le refus d’une diplo-matie secrète [doc. 1, 2].
2. Le président Wilson défend une progression de l’autodétermi-nation et de la démocratie, gages de paix future [doc. 1, 2]. Il peut influencer la paix, mais pas seul [doc. 5].
3. La ratification du traité de Versailles se heurte à l’opposition des Républicains au projet de Société des Nations [doc. 3]. Selon les opposants majoritaires au Sénat, en effet, la participation du pays à la SDN invaliderait la doctrine Monroe et pourrait l’entraîner dans de nouveaux conflits [doc. 4]. Suite à l’opposition du Sénat, les États-Unis perdent du prestige et un moyen d’influencer les affaires internationales. La SDN est fragilisée et, avec elle, les espoirs de paix futurs [doc. 6].
Analyser un discoursLes conceptions américaines de nation et de démocratie se heurtent, une fois appliquées à l’Europe, à des problèmes spécifiques : fron-tières, colonies, mais aussi revendications des alliés des États-Unis. Par exemple, article 10, Wilson imagine un système fédéral pour l’Autriche-Hongrie, mais le pays implosera néanmoins.
Étude P 136-137
Franklin Roosevelt et l’Amérique en guerreEn 1941, les États-Unis rompent avec une puissante tradition isola-tionniste pour entrer dans la Seconde Guerre mondiale et apportent leur contribution décisive à la victoire et à l’organisation de la paix.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les neutralistes accusent Roosevelt d’être sous l’influence de groupes favorables à l’entrée en guerre. L’agression japonaise visant directement le territoire américain annule ces arguments.
2. La population américaine s’unit, intensifie l’effort militaire. Le doc. 2 permet d’évoquer les difficultés des Américains d’origine japonaise (internement).
3. L’idéalisme ne peut pas suffire : les États-Unis doivent accepter de s’engager dans les affaires du monde (comme c’est le cas à Yalta).
4. Pour Roosevelt, la guerre vise à instaurer une paix durable et la sécurité économique. Cela passe par des discussions entre vain-queurs et la création de l’ONU.
Analyser un discoursIl s’agit d’un texte polémique, prononcé quelques mois avant l’at-taque de Pearl Harbor, alors que les États-Unis soutiennent déjà les
Alliés par le biais des lois Cash-and-Carry et du « prêt-bail ». Or le courant neutraliste est fort dans les années 1930 (lois de neutralité). Dans ce discours, Lindbergh raille le changement de position des communistes sans évoquer l’invasion nazie de l’URSS (juin 1941). La mention aux Juifs révèle son antisémitisme, voire des sympathies nazies.
EXERCICE P. 139
Les États-Unis dans la Seconde Guerre mondialeCette affiche de propagande a été diffusée en 1943, alors que les États-Unis menaient la guerre sur deux fronts. Elle vise à montrer que les États-Unis sont à la tête d’une vaste coalition, qui préfigure les « Nations unies », et souligne leur rôle de premier défenseur de la liberté. De ce point de vue, il peut être intéressant de comparer cette affiche à celle de la p. 128. On peut attendre des élèves qu’ils relèvent, parmi les drapeaux, ceux d’États peu démocratiques, à commencer par l’URSS.
Objectif BAC Méthode P 140-142
Étude critique de document / Analyse de documentLe débarquement du 6 juin 1944Cette photographie de Robert Capa est l’une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Elle fait partie d’un lot de 11 photo-graphies, The magnificent Eleven, au cœur d’une vaste polémique : alors que Capa prétendait avoir pris beaucoup plus de photogra-phies, qui auraient été détériorées par maladresse par un laboran-tin, plusieurs spécialistes affirment aujourd’hui qu’il n’aurait en réalité pas pris d’autres photos que celles que l’on connaît. Quoi qu’il en soit, ces images ont marqué l’imaginaire collectif : Steven Spielberg dit ainsi s’en être inspiré pour la scène du débarquement du film Il faut sauver le soldat Ryan.
Les États-Unis en criseCette photographie de Margareth Bourke-White est l’une de ses plus célèbre. Elle juxtapose la prospérité et la pauvreté dans une situation qui connote également les inégalités raciales aux États-Unis. Cette image, toutefois, ne permet pas d’appréhender tous les aspects de la crise, ni les efforts du gouvernement fédéral de Roosevelt pour en sortir.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie• FOHLEN Claude, De Washington à Roosevelt – L’Ascension d’une
grande puissance, 1776-1945, Nathan, 1992.
• NOUAILHAT Yves-Henri, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Armand Colin, 2003.
• VAÏSSE Justin, Le Modèle américain, Armand Colin, 2003.
• ZINN Howard, Une histoire populaire des États-Unis d’Amérique – De 1492 à nos jours, Agone, 2000.
• ZINN Howard, KONOPACKI Mike et BUHLE Paul, Une Histoire Populaire de l’empire américain, Vertige Graphic, 2009.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 6 27
6 Les États-Unis et le monde depuis 1945Ce chapitre suit la montée progressive de la puissance américaine, en insistant, comme l’exige le programme, sur les moyens de cette puissance (militaires, diplomatiques, économiques et culturels). Toutes ces dimensions sont représentées par les documents qu’ils soient dans les études ou en appui du Grand Angle, des pages de cours ou des exercices.
• Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l’isolationnisme initial est définitivement abandonné. Les dirigeants américains assument désormais leurs responsabilités mondiales et se préparent à exercer le pouvoir qui y correspond. De nouveaux outils institutionnels, militaires et diplomatiques sont alors élaborés pour rendre possible l’exercice de ce pouvoir, que ce soit envers leurs alliés ou contre le camp soviétique. C’est l’objet du cours page 146. Ce cours montre comment la montée de l’URSS a été l’occasion pour les États-Unis de s’affirmer en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Cette nouvelle dimension mondiale entraîne des interventions militaires répétées, directes ou indirectes, contre l’influence soviétique, mais elle repose également sur un formidable dynamisme économique et culturel. Le hard power, les armées, les bases et les alliances, est soutenu par le soft power, le modèle culturel et les flux commerciaux.
• Le second cours, page 150, expose comment, après l’affaiblissement des années 1970, la situation se retourne en faveur des États-Unis. À partir des années 1980, le déclin puis la chute de l’Empire soviétique entraînent une période d’interventions américaines tous azimuts, alors que les innovations technologiques américaines reprennent de plus belle. Pourtant, les difficultés économiques deviennent structurelles, et de nouvelles puissances économiques et bientôt diplomatiques s’affirment, dont la Chine.
• Les outils du manuel renforcent l’étude des points clés. Les cartes, inédites, permettent de confronter les différentes dimensions de cette puissance, à commencer par le planisphère du Grand Angle page 144, qui peut efficacement inaugurer le travail sur le chapitre. L’étude sur Hollywood explore la dimension culturelle du sujet dans le contexte omniprésent de la guerre froide.
• L’Histoire des arts avec Captain America est un outil idéal pour travailler sur la réception à l’extérieur des mythes culturels américains dans le domaine si puissant et si influent de la culture populaire, en particulier à dimension de la jeunesse.
• La politique extérieure au xxie siècle – sa force et ses limites et ses nouveaux espaces prioritaires – peut être explorée à travers l’étude sur l’Afghanistan. L’étude sur l’immigration permet d’étudier cette question selon l’axe de ses liens avec la politique extérieure du pays mais aussi des débats que cela peut susciter dans l’opinion publique américaine. Enfin, la page exercices permet de revenir sur le tournant de la Seconde Guerre mondiale, avec Yalta, et sur les contestations nouvelles de la politique étrangère américaine depuis 2001.
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Les chemins de la puissance : les États-Unis et le monde depuis 1945
p. 144-145 : GRAND ANGLE – La superpuissance américaine pendant la guerre froidep. 146-147 : COURS 1 – L’internationalisation de la puissance américainep. 148-149 : ÉTUDE – Hollywood à l’heure de la guerre froidep. 150-151 : COURS 2 – La réaffirmation de la puissance américainep. 152-153 : ÉTUDE – Les États-Unis en Afghanistan depuis 2001p. 154-155 : ÉTUDE – Les États-Unis et l’immigration après 1945
Les outils du manuel
p. 156-157 : HISTOIRE DES ARTS Jack Kirby et Joe Simon, Captain America
p. 159 : EXERCICE Mettre en relation deux documents : l’engagement international des États-Unis
p. 158-159 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse ...
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
28 CHAPITRE 6 HISTOIRE - Term
p. 160-163 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Problématiser le sujet – La puissance américaine dans le monde depuis 1945Étudier un texte juridique – La résolution Vandenberg
p. 164-165 : OBJECTIF BAC SUJETS Compositions : Les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du président Wilson / Les États-Unis et le monde depuis 1945Étude critique de document / analyse de document : La puissance des États-Unis vue par les Fran-çais / Les États-Unis et le monde depuis 1945
Ouverture de chapitre P 142-143
Les États-Unis et le monde depuis 1945Dans le premier cas, le drapeau est un symbole de l’héroïsme militaire américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut souligner la dimension iconique de la photographie de Joe Rosenthal et son impact dans la propagande américaine pendant la guerre froide. Dans le second cas, le drapeau brûlé est aussi le symbole des États-Unis et de son expansion. Ces images révèlent l’impor-tance de la présence américaine dans le monde, aussi bien physi-quement (Japon) que par les idées et les valeurs qu’ils représentent (Pakistan). La présence des États-Unis dans le monde a grandi et est plus contestée.
Grand angle P 144-145
La superpuissance américaine pendant la guerre froideLa présence des États-Unis est désormais permanente et mondiale surtout là où elle endigue le bloc de l’Est (Europe, Asie orientale). Avec ses deux façades océaniques, c’est une puissance maritime. Les opérations secrètes sont aussi importantes (CIA). On peut la comparer avec la carte p. 130-131 (Les États-Unis, puissance mondiale au lendemain de la guerre).
Cours 1 P 146-147
L’internationalisation de la puissance américaine après 1945Ce cours vise à expliciter comment les États-Unis assument une puis-sance nouvelle à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La conférence de Yalta, avant même la fin de la guerre, entérine, malgré la présence de Churchill, les deux nouvelles grandes puissances que sont les États-Unis et l’URSS représentées par Roosevelt et Staline [doc. 1]. Elle est complétée par celle de Potsdam. Les États-Unis construisent un bloc occidental dont ils deviennent les leaders face à l’URSS, perçue comme un contre-modèle idéologique et une puissance impériale à contenir à tout prix et en tous lieux. C’est dès 1946-1947 que le tournant est pris, ce que l’on peut voir à travers le fameux télégramme Keenan qui annonce la guerre froide future [doc. 2]. Les États-Unis évitent ainsi l’erreur de l’entre-deux-guerres en soutenant l’économie de l’Europe occidentale de façon à prévenir une crise économique qui autrement pourrait constituer le terreau du commu-nisme. Le plan Marshall sert aussi à cultiver leur popularité chez leurs alliés dont la population pourrait être tentée par le communisme pro-soviétique. L’Italie, où existe un puissant parti communiste fait l’objet d’un effort particulier de propagande [doc. 3]. Se construit alors un véritable modèle américain, diffusé partout dans le monde à l’exception
de l’Empire soviétique, tandis que l’ouverture économique des États-Unis s’accroît par les exportations, mais aussi les importations. Cette ouverture, en particulier par le biais des entreprises américaines multinationales, se renforce même dans les années 1970 et 1980 [doc. 4]. La guerre du Vietnam et la crise du système de Bretton Woods pro-voquent la crise de 1973, entraînant une profonde crise de confiance et d’image à partir de 1974-1975, que l’humiliation de la prise d’otages américains à Téhéran met à son comble. Elle permet à l’islamisme chiite iranien, représenté ici par l’ayatollah Khomeiny, de se présenter comme luttant contre l’impérialisme américain [doc. 5].
Étude P 148-149
Hollywood à l’heure de la guerre froideL’étude développe les aspects culturels de la puissance et de la présence des États-Unis dans le monde, et permet de donner de l’ampleur historique à l’une des composantes du soft power amé-ricain. Si Hollywood est influencé par l’anticommunisme interne au pays, l’industrie du cinéma participe aussi, via les exportations, au rayonnement américain dans le monde.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. L’anticommunisme s’explique par le contexte de guerre froide et de psychose. Le doc. 1 permet d’établir en creux les valeurs des États-Unis, que l’on retrouve dans de nombreux films illustrant l’Ame-rican way of life.
2. La guerre froide influence les cinéastes par les thèmes des films : espionnage, danger nucléaire.
3. On note une nette augmentation de la part des exportations, même si certaines oppositions naissent face à la diffusion des films d’Hollywood, en avançant des motifs économiques et idéologiques. L’évocation des accords Blum-Byrnes permet de souligner que le pouvoir politique américain est un soutien des industriels du cinéma américains. L’accroissement des recettes [doc. 2] est aussi à mettre en lien avec l’avènement de la société des loisirs et du spectacle dans le monde occidental.
4. Au-delà de la dimension idéologique, il y a des intérêts financiers : le divertissement est une industrie, qui doit vendre et donc plaire au public (le film présenté en doc. 4 est un échec commercial). Par ailleurs, la sortie du film de Stanley Kubrick [doc. 3] prouve que la liberté d’expression règne à l’Ouest (distanciation comique).
Analyser une afficheLe film I Married a Communist n’a guère été diffusé dans le monde, hormis au Portugal et au Japon. Il n’en reste pas moins embléma-tique de l’anticommunisme dans le cinéma américain à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Le cinéma hollywoodien
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 6 29
reflète ainsi les valeurs américaines promues par le gouvernement fédéral, et met en scène la menace communiste.
Cours 2 P 150-151
La réaffirmation de la puissance américaineRonald Reagan, élu sur un programme très conservateur et très anti-communiste, réagit face à un Empire soviétique qui semble en expan-sion. Il n’apparaît pas alors que l’URSS est déjà dans une phase de déclin. L’ampleur du réarmement engagé par Reagan est inédite depuis la guerre froide. Ce réarmement repose sur des paris technologiques en partie jamais réalisés, comme le projet d’un réseau de satellites anti-missiles qui aurait permis d’annuler la menace nucléaire soviétique et donc d’en finir avec l’équilibre de la terreur qui garantissait le statu quo entre les empires [doc. 1]. On peut observer sur ce document à l’arrière du visage présidentiel le tir laser d’un satellite faisant exploser en vol un missile soviétique. Ce réarmement, qui comporte aussi des domaines plus classiques, contribue à la chute de l’URSS, qui ne peut suivre, révélant ainsi l’obsolescence de son appareil productif. Une nouvelle phase s’ouvre : les États-Unis restent la seule superpuissance et voient s’ouvrir des zones entières à leur influence.Le doc. 2 est central pour voir les nouveaux déploiements de cette puissance (en Europe de l’Est, et Moyen-Orient, voir chapitre 9), mais aussi ses futures faiblesses (notamment le terrorisme islamiste, mais aussi une Chine qui reste rétive à l’influence politique américaine malgré son ouverture économique). Le dynamisme technologique du pays [doc 3] reste extrêmement fort malgré des concurrents dynamiques et il permet de nouvelles formes de prééminence à l’ère numérique (la recherche privée et publique contribuent ensemble à ces innovations, ainsi que la capacité à attirer des chercheurs de talent du monde entier) mais il ne suffit plus devant l’ampleur du déficit commercial devenu structurel, et l’émergence de nouvelles puissances concurrentes qui en profitent [doc. 2]. La diplomatie de Barack Obama se fait prudente, notamment dans le monde musulman. Il s’agit de contrer un Islamisme qui est devenu le support d’un renouveau de l’anti-américanisme [doc 4].
Étude P 152-153
Les États-Unis en Afghanistan depuis 2001À travers l’engagement américain en Afghanistan sont ici explorées les raisons des interventions américaines à l’extérieur : les attentats du 11 septembre, qui sont emblématiques de l’hostilité à la puissance américaine dans le monde, lancent les États-Unis dans une guerre contre le terrorisme et pour leur sécurité. Mais l’hégémonie amé-ricaine a ses limites : difficultés militaires (malgré une nette supé-riorité technologique), opinions publiques indifférentes ou hostiles. L’intervention militaire n’apparaît plus comme une solution décisive dans la lutte contre le terrorisme.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les objectifs premiers sont la traque des responsables d’al-Qaida, qui ont revendiqué les attentats du 11 septembre, et la chute du régime taliban, accusé de les soutenir. À terme, c’est donc la sécu-rité des États-Unis, et plus largement du monde occidental (les États membres de la coalition cités par G.W. Bush sont tous occidentaux), qui est visée.
2. Si l’intervention et le soutien aux mouvements de résistance aux talibans (Alliance du Nord) permettent la chute rapide des talibans, la recrudescence du conflit à partir de 2004 (du fait de la résurgence d’une guérilla talibane) entraîne un coût humain et financier impor-tant, qui affaiblit le soutien populaire à l’engagement militaire américain.3. Barack Obama a le souci d’épargner des vies et des dépenses, et de répondre à la lassitude de l’opinion américaine, dont le soutien à l’intervention s’est érodé. Selon Barack Obama, la lutte contre al-Qaida et le terrorisme ne doit plus être limitée à l’Afghanistan, et les États-Unis doivent privilégier le soutien aux États fragiles plutôt que l’envoi de troupes.
Confronter deux documentsLe doc. 3 permet d’évaluer le rôle des États-Unis dans la coalition en calculant la part des pertes américaines sur l’ensemble des pertes humaines. À partir de 2010, la part des pertes américaines augmente du fait du retrait des forces militaires d’autres États de l’OTAN. Confronté au doc. 5, on peut tracer un parallèle entre le coût humain et financier toujours plus lourd de la guerre et la lassitude ou les doutes de l’opinion : l’analyse doit souligner que, au-delà de la confrontation des courbes d’une année sur l’autre, le bilan – financier et humain – est cumulatif. Il faut noter enfin que s’il y a nette diminution du soutien, une courte majorité approuve toujours douze ans après l’intervention militaire en Afghanistan.
Étude P 154-155
Les États-Unis et l’immigration après 1945La relation des États-Unis au monde ne passe pas seulement par leur influence sur le reste du globe, mais aussi par les phénomènes migratoires, qui connaissent des phases très différentes (ouvertures et fermetures). Car les politiques migratoires sont liées à des enjeux politiques internes et internationaux. En se présentant comme l’Empire de la liberté, le pays ne peut en effet interdire ses frontières à ceux qui fuient le système soviétique. Mais il est vrai aussi que le renouveau de l’immigration après 1965 permet une main-d’œuvre bon marché et une plus grande consommation intérieure, bases de la puissance. Enfin, cette immigration fait débats à l’intérieur du pays. Cette étude intéressera vivement les élèves dans une com-paraison, explicite ou non, avec notre pays.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Entre 1920 et 1965, le pays, auparavant grand pays d’immigration, est largement fermé sauf à une immigration européenne censée ne pas menacer l’identité du pays [doc. 1 et 6], et la part des immigrants dans la population baisse considérablement [doc. 2]. L’année 1965 marque une rupture volontaire, assumée par le président Johnson [doc. 2].
2. Jusqu’en 1965, l’immigration européenne est favorisée par les lois de 1921 et 1924 relevant de l’isolationnisme régnant après 1920 [doc. 1, 2]. Au contraire, leader du monde libre après 1945, le pays retrouve ses valeurs d’ouverture et l’immigration augmente très vite [doc. 1, 2, 3]. Le pays doit s’ouvrir aux Asiatiques pour lutter contre le péril communiste en Asie [doc. 1, 4] et aux réfugiés cubains fuyant le régime de Castro [doc. 4]. Il lui faut également abandonner les quotas d’origine en 1965
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
30 CHAPITRE 6 HISTOIRE - Term
[doc. 3] pour échapper à l’accusation de racisme et trouver des alliés dans le tiers-monde décolonisé.
3. Les travailleurs originaires d’Amérique latine, qui arrivent en masse à partir des années 1960 posent des problèmes spécifiques d’intégra-tion [doc. 4, 6]. Mais, malgré des débats très forts et des phénomènes de rejet [doc. 5, 6], la fermeture n’est jamais totale [doc. 5].
Analyser un graphiqueLe doc. 1 montre qu’en 1965 rompre avec les quotas favorisant les Européens est une question d’image pour les États-Unis. Mais cette ouverture se fait avec réticence.
Histoire des arts P 156-157
Captain AmericaCaptain America est un personnage de bande dessinée tout à fait emblématique du soft power américain. La couverture représentée p. 157 permet de souligner l’écart entre la représentation du héros et de ses adversaires, à l’air menaçant. L’image de la pieuvre renvoie au thème du complot et souligne donc la menace communisme. L’utilisation de Captain America pendant la guerre en Irak (focus, p. 156) met en relief le patriotisme américain et le poids de la propagande au service de l’effort de guerre.
EXERCICE P 159
Mettre en relation deux documents
Le premier document est une référence directe au sommet de Yalta, qui s’est tenu du 4 au 11 février 1945. Il permet de souligner le rôle de l’URSS et de la Grande-Bretagne dans la préparation de l’après-guerre, quelques mois avant la Conférence de San Francisco qui donne nais-sance à l’ONU. Le second document souligne au contraire l’unilaté-ralisme américain après les attentats du 11 septembre 2001.
Objectif BAC Méthode P 160-163
Composition / Problématiser le sujetLa puissance américaine dans le monde depuis 1945Ce sujet permet d’aborder la totalité des enjeux de la question au programme. Il conduit à réfléchir aux atouts et aux limites de la puissance américaine, tant dans le contexte de la guerre froide que dans le contexte de l’après-Guerre froide. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis rompent avec l’isolationnisme et s’engagent dans un affrontement manichéen et universel avec le communisme. Depuis la chute de l’URSS, les États-Unis, devenus une superpuissance, hésitent entre action multilatérale et interven-tionnisme préventif.
Affirmation et contestations de la puissance américaine depuis 1945Ce sujet permet d’investir les connaissances acquises sur l’ensemble du chapitre. Il invite à étudier les principales évolutions de la puis-sance américaine, pendant la guerre froide d’abord, puis à l’époque de l’unilatéralisme américain. Les contestations de la puissance américaine sont essentiellement externes, et la disparition de l’ennemi soviétique en 1991 est suivie de l’apparition de nouveaux contre-modèles, tandis que le terrorisme islamiste frappe la
puissance américaine en plein cœur en 2001. Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan consacre l’affaiblissement de la puissance américaine après une dizaine d’années de guerre.
Les États-Unis et la guerre depuis 1945Sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis tentent d’organiser un ordre mondial pacifique. Leaders du monde libre pendant la Guerre froide, ils font l’expérience de l’échec lors de la guerre du Vietnam. À partir de 1991, la superpuissance amé-ricaine intervient à deux reprises contre l’Irak de Saddam Hussein et s’engage en Afghanistan dans une guerre contre le terrorisme d’un genre nouveau.
Objectif BAC Méthode P 160-163
Étude critique de document / Analyse de document
Étudier un texte juridique
La résolution VandenbergL’adoption par le Sénat américain de la résolution Vandenberg en faveur de l’association des États-Unis à des mesures régionales ou collectives fondées sur une aide individuelle ou mutuelle marque un tournant majeur de la politique étrangère des États-Unis. À l’instar de son initiateur, cette résolution consacre en effet le ral-liement des États-Unis à un interventionnisme pleinement assumé.
L’ANZUS, une alliance défensiveL’intérêt de ce document est de permettre d’illustrer la résolution Vandenberg par l’une de ses conséquences concrètes. Ce traité défensif constitue en effet une étape essentielle de la constitution par les États-Unis d’un réseau d’accords défensifs dirigés contre les grandes puissances communistes et leurs alliés.
Objectif BAC Sujets P 164
CompositionLes États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du président WilsonLa problématique de ce sujet est celle de la mue d’un pays à la culture isolationniste en la plus grande puissance mondiale de l’Histoire.
1. De 1917 à 1947 : la tradition du non-engagement domine, les engagements dans les guerres mondiales étant tardifs et plus ou moins forcés.
2. De 1947 à 1991 : le prolongement de la « mission divine » dans l’affrontement manichéen et universel avec le communisme.
3. Depuis 1991 : les États-Unis hésitent entre mutlilatéralisme et interventionnisme
Étude critique de documentsLa puissance des États-Unis vue par les FrançaisLe texte du général de Gaulle présente le grand intérêt d’évoquer aussi bien le poids économique, militaire et diplomatique des États-Unis, qui détiennent en 1945 le monopole de l’arme nucléaire, que leur dimension messianique, qui conduit le président Truman à porter les États-Unis à la tête des pays occidentaux sortis vainqueurs du conflit. Ce document met en exergue le hard power. Il est donc
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 6 31
intéressant d’y confronter le tableau d’Authouart, Manhattan colors, qui concentre tout ce qui fait depuis 1945 la force du mythe amé-ricain, et du soft power des États-Unis. Au centre de New York, site d’un tourisme de masse, se déploient les symboles de la culture populaire américaine (westerns) et de la société de consommation (automobile, publicités). L’hommage à l’art contemporain américain est central, tout comme la réflexion sur les apports étrangers intégrés par la culture américaine.
Objectif BAC Sujets P 165
CompositionLes États-Unis et le monde depuis 19451. De 1945 à 1981, la puissance américaine s’internationalise. Les États-Unis affirment leur puissance dans le cadre de la guerre froide et font valoir leur modèle. La guerre du Vietnam aboutit toutefois à un recul de la puissance américaine dans le monde.
2. De 1981 à nos jours, les États-Unis réaffirment régulièrement leur puissance, la seule de premier plan après la chute de l’URSS. Les attaques terroristes de 2001 provoquent une recrudescence des interventions extérieures américaines.
Analyse de documentLes États-Unis et le monde en 1990Le discours de George H. Bush met en valeur le tournant que constitue la guerre du Golfe dans les relations internationales. Tout en s’appuyant sur le Conseil de sécurité de l’ONU et sur une large coalition qui intègre des pays arabes, le président des États-Unis affirme que la liberté et la justice sont garanties par le leadership américain. Ce texte illustre ainsi fin de la guerre froide et de l’affron-tement Est-Ouest.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Denécé É. et Poulot Frédérique, Dico atlas des conflits et des menaces, Belin, 2010.
• Dorel Gérard, Atlas de l’Empire américain – États-Unis : géostratégie et hyperpuissance, Autrement, 2006.
• Goussot Michel, « Les États-Unis », in La Documentation photographique, n° 8056, mars-avril 2007.
• Guilbaut Serge, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Hachette, 2006.
• Melandri Pierre, Histoire des États-Unis, Perrin, 2013.
• Nouailhat Yves-Henri, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Armand Colin, 2003.
• Vaïsse Justin, Le Modèle américain, Armand Colin, 2003.
• Zinn Howard, Une histoire populaire des États-Unis d’Amérique – De 1492 à nos jours, Agone, 2000
• « Géopolitique des États-Unis, la fin de l’empire américain ? », revue Diplomatie, les grands dossiers n° 3, juin-juillet 2011.
Site internetOn peut conseiller pour entrer dans le sujet de manière synthé-tique un site Internet sérieux et documenté, qui comprend des synthèses efficaces, une bibliographie commentée et une sitographie complète en français : www.thucydide.com/realisa-tions / comprendre / usa / usa1.htm
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
32 CHAPITRE 7 HISTOIRE - Term
7 La Chine et le monde depuis 1949Ce chapitre débute par un Grand Angle sur la situation chinoise dans les années 1950 : après la victoire communiste de 1949, la Chine se ferme aux influences étrangères à l’exception d’un partenariat privilégié mais inégal avec l’URSS, mis en œuvre au niveau des États. Sur le plan international, elle bascule résolument dans la guerre froide avec la guerre de Corée et son assistance aux indépendantistes indochinois contre la tutelle coloniale française. En interne, les communistes – qui sont aussi des nationalistes chinois –, veulent rompre avec un siècle d’empiétements étrangers et de désordres intérieurs. Ils rétablissent l’unité du territoire et le pouvoir central, notamment sur des périphéries qui s’étaient autonomisées telles le Nord-Ouest turcophone et musulman ou le Tibet, réoccupé en 1959 à la suite d’une révolte.
• Les cours montrent une évolution en deux temps, qui suivent l’inflexion de la politique du Parti Communiste : du maoïsme au post-maoïsme.– La fermeture comme tentative de restauration de la puissance. L’expérience communiste est pensée comme une voie vers la puissance ; elle se double d’une fermeture (incomplète) du pays et d’un renforcement de l’État sous la dictature de Mao, qui va jusqu’au totalitarisme. Son bilan est très contrasté : le maoïsme inflige des souffrances gigantesques au peuple chinois, mais le rétablissement de l’État est effectif et la Chine devient une puissance internationale importante, ainsi qu’une puissance régionale incontournable. À travers le maoïsme, la Chine bénéficie même d’un certain rayonnement idéologique.– L’ouverture dans la puissance. Le cadre politique rétabli sous Mao est la condition sine qua non du décollage d’après 1979, qui s’opère par une ouverture contrôlée à l’économie mondiale. Au poids économique de la Chine s’ajoute une influence politique croissante, en dépit du caractère répressif du régime qui lui pose des problèmes d’image. Malgré une activité diplomatique et une force militaire croissantes, la Chine a encore du mal à s’affirmer comme puissance mondiale du fait notamment de son soft power limité. Mais elle est une grande puissance régionale, dont l’ascension inquiète ses voisins.
• Les études servent à faire le point sur deux conflits cruciaux pour la puissance chinoise au xxe siècle : la guerre de Corée, qui est le véritable moment de basculement dans la guerre froide, et la question de Taïwan, crise de longue durée qui reste d’actualité. Les deux études invitent à mettre l’accent sur l’articulation d’enjeux mondiaux – notamment les relations sino-américaines – et d’enjeux régionaux asiatiques. En Histoire des arts, l’analyse des portraits emblématiques de Mao par Warhol autorise un renversement de perspective (le monde regarde la Chine).
• Les exercices et les pages Bac font la part belle aux problèmes actuels : la question de la puissance chinoise se pose en effet de façon assez récente, et il s’agit de montrer comment l’histoire de la Chine peut éclairer l’analyse de son présent.
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Les chemins de la puissance : la Chine et le monde depuis 1949
p. 168-169 : GRAND ANGLE – La Chine dans les années 1950, un pays communiste dans la guerre froidep. 170-171 : COURS 1 – L’affirmation du communisme en Chine (1949-1979)p. 172-173 : ÉTUDE – La guerre de Coréep. 174-175 : COURS 2 – L’affirmation d’une grande puissance mondialep. 176-177 : ÉTUDE – Les ambitions de la Chine populaire sur Taïwan
Les outils du manuel
p. 178-179 : HISTOIRE DES ARTS Andy Warhol, Portraits de Mao
p. 181 : EXERCICE 1 Analyser une œuvre de propagande : La Chine maoïste, soutien des luttes du tiers-monde / 2 Analyser un article de journal : Un pays jaloux de sa souveraineté intérieure
p. 180-181 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 182-185 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Choisir un plan pour organiser sa réponse au sujet – La Chine et le monde depuis 1949Analyser une affiche – Le communisme chinois, entre influence étrangère et patriotisme ...
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 7 33
p. 108-109 : OBJECTIF BAC SUJETS Compositions – La puissance chinoise dans le monde depuis 1949 / L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949Étude critique de document / analyse de document – La Chine face au risque de guerre atomique / La Chine, un monde à part
Ouverture de chapitre P 166-167
La Chine et le monde depuis 19491. Dans le doc. 1, la Chine conduit la lutte des peuples du tiers-monde. Dans le doc. 2, elle affiche ses progrès technologiques et ses ambitions militaires.
2. La Chine ne veut plus donner une image de révolte contre l’ordre mondial, mais celle d’une grande puissance militaire et spatiale.
Grand angle P 168-169
La Chine dans les années 1950, un pays communiste dans la guerre froide1. La puissance chinoise se manifeste par la conquête d’un territoire national, l’intervention dans des conflits régionaux et l’alliance soviétique.
2. Les limites de cette puissance sont le déséquilibre du partenariat avec l’URSS et la force des adversaires de la Chine, surtout les États-Unis.
Cours 1 P 170-171
L’affirmation du communisme en ChineLes documents renseignent sur la trajectoire de la Chine dans la guerre froide : relations avec l’URSS et les États-Unis, image dans le monde, ambitions régionales.Le doc. 1 montre l’importance du modèle et de l’aide technique du « grand frère » soviétique pour reconstruire et industrialiser le pays après 1949. Réponse possible : le but de cette affiche est de défendre et de légitimer l’alliance sino-soviétique auprès du peuple chinois ; la relation est présentée comme bienveillante et favorable au dévelop-pement industriel chinois, mais également comme hiérarchique (taille des personnages, ingénieur soviétique et ouvrier chinois…).Le doc. 2 montre que la fondation de la RPC par Mao est pensée comme une voie de redressement national mais aussi de revanche contre l’étranger. Réponse possible : l’étranger est présenté comme une force néfaste, l’impérialisme, soutenant les gouvernements réactionnaires chinois, le Guomindang étant pris pour exemple.Le doc. 3 porte sur le tiers-mondisme de Mao et son volontarisme politique. Les États-Unis sont présentés comme des « tigres en papier », une puissance faible car prédatrice et détestée, un diagnostic largement irréaliste qui a pour but de galvaniser les luttes du tiers-monde et de les ranger sous la bannière chinoise.Le doc. 4 atteste du prestige de la « voie » chinoise, substitut au modèle soviétique pour une partie de la gauche occidentale. Réponse possible : le prestige de la Chine se manifeste par le visage de Mao, devenu une icône de dévouement spartiate au peuple (dans une grande mécon-naissance de la situation effective).Le doc. 5 met l’accent sur la dimension régionale de la puissance chinoise et sur la rupture sino-soviétique. Réponse possible : URSS et Chine s’affrontent par alliés asiatiques interposés (Vietnam et
...
Cambodge) un peu de la même manière que États-Unis et URSS s’af-frontent indirectement pendant la guerre froide.
Étude P 172-173
La guerre de CoréeL’étude explore le basculement de la Chine dans le bloc de l’Est et son entrée dans une guerre qui est d’abord soviétique : l’interven-tion des troupes nord-coréennes ne s’est pas faite en coordination avec Mao. Malgré la relative faiblesse de la Chine au sortir de la Seconde Guerre mondiale et son rôle second par rapport à l’URSS, elle décide d’appuyer les Nord-Coréens afin d’éviter d’être limitrophe d’un pays hostile. Les enjeux mondiaux de guerre froide (alliance soviétique) et régionaux de puissance (alliance frontalière) sont donc intrinsèquement liés.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Pour les forces de l’ONU, la Chine représente un obstacle majeur leur interdisant de progresser trop au Nord. Au début de la guerre, les troupes chinoises ont même infligé des défaites cinglantes aux troupes sud-coréennes. Mais comme Mao l’admet lui-même, l’armée chinoise n’est pas de taille contre l’armée américaine et doit comp-ter sur sa supériorité numérique.
2. Le pouvoir, à travers une propagande triomphaliste, cherche à faire croire au soutien du peuple chinois dans cette guerre menée par des « volontaires » ; il met en outre en scène la puissance chinoise (soldat grand et debout) assistant les Nord-Coréens (soldat grand mais blessé et courbé) et mettant en déroute les Américains (armée en lambeaux à droite). La réalité est toute autre : infériorité tech-nique, pertes humaines considérables et population réticente.
3. La Chine craint qu’une Corée pro-américaine voire occupée par les Américains ne représente un danger frontalier immédiat, et ne cherche à déstabiliser le régime communiste récemment instauré en Chine. C’est donc une guerre née en partie de l’inquiétude des communistes quant à la fragilité de leur régime.
4. Le rôle soviétique est déterminant car Mao entre en guerre dans le cadre du pacte d’amitié russo-chinois ; par ailleurs la guerre est avant tout voulue par Staline, pas par les Chinois qui sont conscients de leur faiblesse. La Chine paie le prix du sang pour l’URSS.
Confronter deux documentsIl s’agit de comparer un document confidentiel, seulement accessible aux plus hauts dirigeants, et un document de propagande. Derrière le triomphalisme et la générosité affichée de la propagande, l’an-goisse est grande et la solidarité sino-coréenne masque des intérêts nationaux : Mao intervient avant tout parce que Staline le veut et qu’il craint pour la sécurité de la frontière sino-coréenne ; en outre les « volontaires » n’ont en réalité aucune envie de partir à la guerre.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
34 CHAPITRE 7 HISTOIRE - Term
Cours 2 P 174-175
L’affirmation d’une grande puissance mondialeLes documents montrent la tension entre ouverture économique et internationalisation d’une part, et maintien d’un modèle politique fermé et autoritaire d’autre part. Par ailleurs, les ambitions régionales de la Chine sont soulignées.Le doc. 1 invite à mesurer le chemin parcouru depuis l’anti-impérialisme de Mao. Réponse possible : l’ouverture est symbolisée par les portes, qui auraient été vues auparavant comme un symbole de l’ouverture forcée et des traités inégaux. Elles sont désormais valorisées et ouvrent sur les drapeaux de pays capitalistes développés, occidentaux ou japonais.Le doc. 2 montre la Chine recouvrant son territoire passé et tirant un trait sur la période coloniale, avec ce que cela implique de compromis politiques. Réponse possible : les avantages de la rétrocession de Hong Kong tiennent à l’affirmation de la souveraineté chinoise et à la cen-tralité économique de l’ancienne colonie anglaise.Le doc. 3 prouve que développement ne rime pas avec démocratisation. Réponse possible : la puissance de cette image tient au déséquilibre entre la colonne de chars et le courage d’individu isolé, dont le courage est souligné ; elle a nui au prestige chinois en montrant que le gouver-nement restait une dictature brutale.Le doc. 4 expose les ambitions de la Chine dans sa principale sphère d’influence, l’Asie de l’Est, et les tensions que celles-ci provoquent. Réponse possible : les ambitions chinoises en Asie se manifestent dans deux espaces ; l’ouest continental, où de petits différends territoriaux avec l’Inde persistent et où la domination chinoise sur le Xinjiang et le Tibet est contestée par des autonomismes ; l’est côtier, où la puissance militaire chinoise est concentrée et où la Chine revendique Taïwan, plusieurs îles ainsi que des espaces maritimes. Ces ambitions provoquent des tensions avec les États voisins (Vietnam, Japon…), mais aussi avec les États-Unis qui les appuient et sont très présents dans la région.
Étude P 176-177
Les ambitions de la Chine populaire sur TaïwanL’étude porte sur plus d’un demi-siècle de visées chinoises sur Taïwan. Elle vise à montrer à travers une étude de cas comment le statut international de la Chine évolue – de pays non reconnu par l’Ouest à membre du conseil de sécurité de l’ONU – et comment ses ambitions territoriales persistent malgré les mutations de sa politique intérieure et internationale.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Pour la Chine continentale, Taïwan est une province sécessionniste à libérer, pas un État indépendant. Elle n’est séparée du continent que du fait des manipulations des États-Unis et d’un gouvernement « illégitime », celui du Guomindang de Chiang Kaï-chek.
2. Les États-Unis passent d’une reconnaissance de Taïwan comme la vraie Chine à une reconnaissance de la Chine populaire, même s’ils continuent de protéger Taïwan contre une réunification violente comme le prouve la crise de 1996. Ce changement s’explique par le tournant de la politique internationale chinoise et de la communauté internationale.
3. La Chine continentale veut d’abord une reconquête militaire de Taïwan ; dans les années 1970, elle passe par l’ONU pour se faire reconnaître
comme seule vraie Chine ; aujourd’hui, elle privilégie les tractations avec l’île, tout en faisant peser une menace militaire pour dissuader les indépendantistes.
4. La protection américaine et le fait que Taïwan soit une démocratie partiellement indépendantiste joue en défaveur d’une unification. Cependant, le poids de la communauté internationale et la puissance nouvelle de la Chine jouent en faveur d’une réunification.
5. La question de Taïwan est un foyer de tension régional en raison des ambitions chinoises, et international en raison de la protection américaine.
Analyser un texte juridiqueIl s’agit de comprendre un langage diplomatique, pro-chinois dans le cas de l’ONU, ambigu dans le cas américain : on « lâche » Taïwan, mais pas complètement. Le communiqué américain prend acte, sur un ton prudent, de la résolution de l’ONU.
Organiser et synthétiser les informationsLa question de Taïwan illustre le changement de statut international de la Chine de trois manières : la Chine populaire acquiert progres-sivement la reconnaissance diplomatique qui la légitime ; elle reste une rivale des États-Unis en Asie de l’Est, mais ses méthodes évoluent vers plus de diplomatie ; ses prétentions deviennent plus sérieuses à mesure que sa puissance s’affirme
Histoire des arts P 178-179
Andy Warhol, Portraits de MaoAnalyser l’œuvre
1. Warhol dévalue le portrait du « grand homme » en le démultipliant ; il souligne le caractère industriel de sa production, alors même qu’il est une icône en Chine.
2. L’usage des couleurs, barbouillées plutôt que peintes, est ironique : il devient difficile de prendre Mao au sérieux. Le portrait cesse de représenter le dictateur chinois et devient un objet décoratif au contenu indifférent.
Comprendre la portée de l’œuvre
3. Cette œuvre prouve que Mao est une célébrité mondiale, mais elle donne de lui une image ambiguë puisqu’elle est clairement humoristique et irrespectueuse.
4. Le portrait de Mao passe de la propagande au Pop art, il perd sa fonction politique de glorification du communisme et devient un produit de consommation pour le marché américain.
5. Cette œuvre aurait été sacrilège en Chine communiste, État totalitaire pratiquant le culte du chef.
EXERCICE P 181
Analyser une œuvre de propagandeCette affiche s’inscrit dans le contexte de la décolonisation de l’Afrique noire et d’une grande partie de l’Asie. Les peuples repré-sentés sont les Africains, les Latino-Américains et les Asiatiques. Leur attitude suggère que leur lutte contre l’impérialisme américain est victorieuse et solidaire de la Chine communiste.
Analyser un article de journalLe « mouvement des parapluies » montre les limites de la formule énoncée par Deng Xiaoping en 1997 à propos de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, « Un pays deux systèmes ». En effet, depuis lors, la Chine n’a cessé de remettre en cause ce principe en vue
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 7 35
d’intégrer plus fermement Hong Kong à la Chine. La question de Hong Kong demeure un sujet de discorde entre la Chine et les grandes puissances occidentales, à commencer par la Grande-Bretagne.
Objectif BAC Méthode P 182-183
Composition / Choisir un plan pour organiser sa réponse au sujetLa Chine et le monde depuis 19491. La Chine maoïste est un État qui se veut puissant et influent, et qui voit alterner ouverture au profit du bloc soviétique et repli sur un modèle qui se veut original.
2. Depuis 1978, l’ouverture au monde est d’abord économique, mais elle passe aussi par une présence accrue dans le monde, tout en résistant aux influences poussant à la démocratisation.
La Chine communiste de 1949 à 1979, une puissance mondiale ?1. Après la rupture sino-soviétique (1958-1961), la Chine se donne la posture d’une puissance mondiale, tournée vers le tiers-monde, mais sans toujours avoir les moyens de ses ambitions.
2. Depuis la fin des années 1970, la Chine utilise l’économie comme base d’une puissance retrouvée et commence à prendre position et à intervenir (dans l’océan Indien, par exemple).
La Chine dans les relations internationales depuis 19791. La Chine s’affirme d’abord comme une puissance économique et financière de premier plan, qui aspire à exercer une plus grande influence politique sur la scène internationale. Elle tend à s’imposer comme un leader régional et à s’opposer aux États-Unis
2. Le hard power chinois est toutefois limité, et son rôle dans les relations internationales relativement secondaire. La Chine tend à faire prévaloir son soft power, en s’appuyant par exemple sur la « diplomatie du panda » ou sur le sport (jeux olympiques de Pékin en 2008).
Objectif BAC Méthode P 184-185
Étude critique de document / analyse de document
Analyser une affiche
Le communisme chinois, entre influence étrangère et patriotismeCette affiche de propagande de 1952 illustre parfaitement l’influence du modèle soviétique sur la Chine de Mao dans les années 1950, et la volonté de Mao d’industrialiser la Chine et de la doter d’une agriculture moderne. La « nouvelle Chine » ambitionne en effet d’être « riche et puissante ». Toutefois, l’image reflète également l’attachement de Mao à l’idée d’une voie proprement chinoise : lui-même est comparé à Marx, Lénine et Staline.
La Chine et le monde au début des années 1970Cette affiche de 1972 met en valeur l’image de la Chine comme cham-pion de la lutte contre l’impérialisme. Le rapprochement avec les États-Unis est ainsi mis en perspective et rendu plus acceptable par les Chinois.
Objectif BAC Sujets P 186
CompositionLa puissance chinoise dans le monde depuis 1949Ce sujet invite à aborder les différents domaines d’influence de la Chine dans le monde et à évoquer sa place dans les relations internationales. L’aspiration de la Chine à devenir un leader des non-alignés l’a conduite à occuper une place importante auprès des nations africaines, dès les années 1960. Grande puissance en construction depuis sa reconnaissance à l’ONU, elle s’affirme depuis les années 2000 comme un puissance régionale.
Étude critique de documentsLa Chine face au risque de guerre atomiqueEn 1955, après la guerre de Corée, des combats ont opposé les deux Chine pour le contrôle des îles du détroit de Taïwan ; les États-Unis se sont engagés à protéger Taïwan, y compris par l’usage de l’arme atomique. Mao minimise ici la menace et traite la bombe comme n’importe quelle arme, très loin du concept de dissuasion qui est en train de s’imposer entre les deux Grands.
Objectif BAC Sujets P 187
CompositionL’émergence de la puissance chinoise depuis 1949Ce sujet invite à mettre en perspective l’affirmation de la puissance chinoise, tant sur le plan économique, avec le tournant de 1979 puis sont entrée à l’OMC, que sur le plan diplomatique et militaire. On peut attendre des élèves qu’ils accordent également une place à l’étude de la « puissance douce » de la Chine, et notamment la « diplomatie du panda ».
Analyse de documentLa Chine, un monde à partLa différence essentielle entre les deux documents tient dans la position de la Chine par rapport à l’URSS : intégrée au bloc sovié-tique dans l’affiche, Mao étant sur la même « ligne » que Staline, alors que Deng Xiaoping la rattache plutôt au tiers-monde et associe les deux grandes puissances sous le concept d’impérialisme. Expliquer les étapes antérieures : rupture sino-soviétique, norma-lisation avec les États-Unis. La Chine retrouve ici pleinement sa vocation d’« empire du Milieu ».
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• BAJON Jean-Yves, Les Années Mao – Une histoire de la Chine en affiches, 1949-1979, Éditions du Pacifique, 2003.
• BERGÈRE Marie-Claire, Capitalismes et capitalistes en Chine – Des origines à nos jours, Perrin, 2007.
• CHEVRIER Yves, Mao et la révolution chinoise, Casterman-Giunti, 1993.
• DOMENACH Jean-Luc et RICHER Philippe, La Chine (2 vol.), Éditions du Seuil, 1995.
• PAULÈS Xavier, La Chine, des guerres de l’opium à aujourd’hui, Documentation photographique, Les dossiers, n° 8093.
• ROUX Alain, La Chine contemporaine, Armand Colin, 2010.
• SANJUAN Thierry, Atlas de la Chine, Autrement, 2007.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
36 CHAPITRE 8 HISTOIRE - Term
8 Le proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit dans l’entre-deux-guerresDans ce court chapitre qui porte sur le programme des séries L et ES, il s’agit d’aborder la rupture majeure dans l’histoire du Proche et Moyen-Orient que constituent la fin de l’Empire ottoman, la mise en place des mandats Britannique et Français, et l’essor concomitant du sionisme et du nationalisme arabe. L’étude du Proche et du Moyen-Orient pendant l’entre-deux-guerres est en effet essentiel pour comprendre les enjeux très contemporains de cette région. Le cours et les études permettent de montrer que les mandats, loin de résoudre les problèmes pour lesquels ils avaient été établis, ont créé de nouvelles sources de conflits au Proche et au Moyen-Orient (frontières, minorités, contrôle des ressources naturelles).
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Un foyer de conflits : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale
p. 190-191 : GRAND ANGLE – Le Proche et le Moyen-Orient, à la fin de la Première Guerre mondialep. 192-193 : COURS 1 – Une région sous la domination des grandes puissancesp. 194-195 : ÉTUDE – Le système des mandats au Proche-Orientp. 196-197 : ÉTUDE – La Palestine sous mandat britannique
Les outils du manuel
p. 199 : EXERCICES Analyser un texte politique : Le soutien des pays arabes à la cause palestinienne
p. 198-199 : L'ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 200-201 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Analyser un traité – Le problème Kurde
Ouverture de chapitre P 188-189
Le doc. 1 permet d’aborder le rôle des grandes puissances dans la région et l’instrumentalisation du nationalisme arabe au service de la guerre contre l’Empire ottoman allié des empires centraux pendant la Première guerre mondiale. Le doc. 2 permet d’évoquer l’implantation juive en Palestine en même temps que le caractère hautement convoité de la terre. Les documents n’abordent toutefois pas tous les conflits ni tous les aspects de la question : la dimension religieuse, par exemple, en est absente.
Grand angle P 190-191
Le Proche et le Moyen-Orient, à la fin de la Première Guerre mondialeLe déclin de l’Empire ottoman a pour conséquence d’attiser les convoi-tises des grandes puissances dans cette région au carrefour de trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Les acteurs du remodelage du Proche et du Moyen-Orient sont bien sûr les grandes puissances coloniales et la Russie, mais il ne faut pas négliger le rôle des acteurs arabes, le chérif Hussein de La Mecque et l’émir ibn Saoud.
Cours 1 P 192-193
Une région sous la domination des grandes puissancesLe doc. 1 permet d’aborder l’un des enjeux majeurs du Proche et du Moyen-Orient à partir de la Première Guerre mondiale : le pétrole, dont le partage s’opère au profit des intérêts occidentaux dans les années 1920. Le doc. 2 évoque la promesse faite aux sionistes par le
Royaume-Uni de permettre l’établissement d’un « foyer national » pour le peuple juif, qui vient contredire les engagements pris auprès des Arabes. Le doc. 3 évoque la République turque établie par Mustafa Kémal sur les ruines de l’Empire ottoman en Turquie. L’influence occidentale est palpable dans la constitution dans les articles 6 et 7 qui distinguent le pouvoir exécutif du pouvoir législatif et dans l’ar-ticle 70, qui évoque les droits de l’homme, en particulier la liberté de conscience, fondement d’un État qui se veut laïc. Le doc. 4 permet d’étudier le regard de la France sur la Syrie : ce mandat est perçu avant tout comme un territoire « occupé », au sein duquel la France favorise les intérêts des chrétiens Maronites en constituant bientôt l’État du Grand Liban. Le doc. 5 évoque le « pacte du Quincy », en vertu duquel les États-Unis auraient garanti la stabilité de l’Arabie Saoudite en contrepartie d’un approvisionnement en pétrole. En réalité, ce « pacte » est une légende simplificatrice : l’approvisionnement des États-Unis en pétrole saoudien remonte aux années 1930, et il a été essentielle-ment question à bord du Quincy de l’avenir de la Palestine, de la Syrie et du Liban. La rencontre du Quincy, en effet, s’inscrit dans le contexte de la création de la Ligue arabe, qui s’affirme comme un interlocuteur de premier plan pour les grandes puissances.
Étude P 194-195
Le système des mandats au Proche-OrientLe système des mandats peut constituer l’entrée en matière du chapitre, évoquant la mise sous tutelle occidentale du Proche et Moyen-Orient après 1918, et la politique ambiguë qu’y mènent les
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 8 37
puissances mandataires. On se gardera toutefois de renvoyer à cette seule politique la responsabilité de tous les conflits ultérieurs, en montrant l’ancrage du système mandataire dans un impérialisme plus global dont la dimension économique est ici évidente, et en soulignant la volonté de révolte, alors encore inaboutie, des peuples arabes.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le Royaume-Uni et la France administrent politiquement les territoires [doc. 1], y entretiennent des troupes [doc. 4] et en exploitent les richesses [doc. 5].2. Tout en faisant des promesses contradictoires aux différents acteurs locaux [doc. 2], ils se partagent les territoires [doc. 4] et y imposent leur tutelle par la force [doc. 3].3. L’exploitation des ressources suscite des révoltes arabes récurrentes, matées par les autorités mandataires [doc. 3, 5].4. En Palestine, le projet sioniste, soutenu par la Grande-Bretagne, s’oppose à la volonté des Arabes que la Grande-Bretagne n’entend pas, malgré la création de la Transjordanie [doc. 2].
Confronter deux documentsIl s’agit ici de montrer que le système des mandats, qui avait pour vocation d’amener ces peuples à l’indépendance [doc. 1], organisait en réalité l’exploitation économique des territoires concernés, en plus de leur utilisation stratégique. Les contradictions du discours des mandataires sont évidentes face à cette exploitation quasi coloniale [doc. 5].
Étude P 196-197
La Palestine sous mandat britannique
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. L’immigration juive en Palestine progresse à la faveur des vagues successives d’Alya [doc. 1], et de la mise en place de l’Agence juive, qui l’organise, la finance [doc. 2] et en assure la promotion en Europe [doc. 3]. Jusqu’en 1937, la Grande-Bretagne ne s’y oppose pas fer-mement.
2. L’immigration juive bouleverse le rapport démographique au détriment des palestiniens. La part de la population juive dans la population totale triple en l’espace d’un quart de siècle [doc. 1a] et la superficie des colonies juives triple presque en vingt ans [doc. 1b].
3. L’essor de l’immigration juive provoque plusieurs émeutes et s’accompagne de l’essor du nationalisme arabe.
4. Les Arabes palestiniens demandent en effet la fin de l’immigra-tion et de la colonisation. Ces revendications sont entendues par la Grande-Bretagne à la suite de la grande révolte de 1936 et de l’assassinat du gouverneur britannique en 1937
4. L’attitude de la Grande-Bretagne vis-à-vis des juifs et des Arabes en Palestine peut être qualifiée à la fois d’ambiguë et d’ambivalente. Le livre blanc de mai 1939 marque un changement important de stratégie, qui n’enraye pas, toutefois, l’immigration juive.
Analyser une afficheLa Palestine est présentée dans cette affiche comme un eldorado, riche de ressources, en même temps qu’un État moderne. La notion
de « Terre Promise » évoque également une dimension religieuse, qui est toutefois au second plan. Le sionisme modernise ses outils de propagande au service de la colonisation de la Palestine. Ce documentaire a reçu un très bon accueil au festival de Venise en 1935 et de la part de la critique américaine. Il a été également utilisé en Allemagne par les nazis, qui ont organisé des projections réser-vées aux Juifs dans le but de les encourager à quitter l’Allemagne pour la Palestine.
EXERCICE P 198-199
Le soutien des pays arabes à la cause palestinienne (1944)Le protocole d’Alexandrie est une étape importante de la réunion des États arabes au sein d’une structure commune, qui devient la Ligue arabe le 22 mars 1945. Le texte contient des références au livre blanc britannique de 1939 et réitère l’opposition des pays arabes à l’immigration juive.
Objectif BAC Méthode P 200-201
Étude critique de document / analyse de document
Analyser un traité
Le problème kurdeCe document permet d’aborder la question Kurde en même temps que les limites du traité de Sèvres. En effet, l’engagement du sultan en faveur de l’octroi d’un statut d’autonomie aux Kurdes. L’article 62 est l’un des arguments essentiels de Mustafa Kemal pour rejeter le traité et s’opposer par les armes à sa mise en œuvre.
Le Pacte national libanaisIl convient d’abord de souligner le caractère informel de ce « pacte », qui n’a pas de valeur juridique établie. En revanche, il se traduit très concrètement dans la constitution libanaise adoptée à la fin de l’année 1943. Le Liban se caractérise en effet par la répartition des pouvoirs entre les communautés religieuses sur la base d’un com-promis politique. Le texte traduit toutefois des conceptions très différentes de la place du Liban dans les relations internationales : tourné vers l’Occident, pour les Maronites, ou au contraire vers les États arabes, pour les musulmans sunnites et chiites.
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• BOZARSLAN H., Une histoire de la violence au Moyen-Orient – De la fin de l’Empire ottoman à Al-Qaida, La Découverte, 2008.
• DUPONT Anne-Laure, MAYEUR-JAOUEN Catherine, VERDEIL Chantal, Le Moyen-Orient par les textes xixe-xxe siècle, Armand Colin, 2011.
• LAURENS Henry et CLOAREC Vincent, Le Moyen-Orient au xxe siècle, Armand Colin, 2003.
• LAURENS Henry, L’Orient arabe – Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin, 2002.
• SELLIER André, SELLIER Jean et LE FUR Anne, Atlas des peuples d’Orient, La Découverte, 2004
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
38 CHAPITRE 9 HISTOIRE - Term
9 Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondialeDans ce chapitre important et difficile, il s’agit de proposer une démarche rigoureusement neutre, aussi bien dans les cours que dans le choix équilibré des documents, des légendes et des questions. Suivant le programme, le chapitre n’est pas centré sur le seul conflit israélo-arabe, mais permet de bien l’expliquer. Les cours proposent une approche chronologique, tandis que les études reposent sur une approche très problématisée, qui s’appuie sur un choix de cas très significatifs.
• Le cours 1 et l’étude sur la naissance d’Israël exposent le rôle de la guerre froide et du conflit israélo-arabe dans l’exacerbation des conflits. L’étude sur Suez montre à la fois le nationalisme arabe hâtant la fin de la domination européenne et l’affirmation des ambitions américaines.
• Le cours 2 explique les principaux conflits contemporains, centrés sur la critique de l’influence occidentale, la persistance du conflit israélo-palestinien et la montée de l’islamisme. L’étude sur les Palestiniens permet de montrer que la situation des Palestiniens a pour origine aussi bien que pour conséquence des conflits. L’étude sur le pétrole permet d’évoquer le poids de cette question depuis près d’un siècle. L’étude sur la guerre Iran-Irak permet d’étudier ce conflit moins connu mais meurtrier et pose la question du rôle de l’Iran nationaliste et chiite. L’étude sur l’affirmation de l’islamisme aborde toutes les dimensions de ce phénomène complexe depuis l’entre-deux-guerres. Enfin, les exercices permettent de revenir sur les accords d’Oslo et les espoirs de paix.
Thème 3 Grandes puissances et tensions dans le monde au xxe siècle
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
Un foyer de conflits : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
p. 204-205 : GRAND ANGLE – Le Proche et le Moyen-Orient, une zone de tensions, un foyer de conflitsp. 206-207 : ÉTUDE – La naissance de l’État d’Israël et la première guerre israélo-arabep. 208-209 : COURS 1 – Le Proche et le Moyen-Orient dans la guerre froidep. 210-211 : ÉTUDE – La crise de Suez p. 212-213 : COURS 2 – La globalisation des conflitsp. 214-215 : ÉTUDE – Les Palestiniens, de 1948 à nos joursp. 216-217 : ÉTUDE – Le pétrole au cœur des conflitsp. 218-219 : ÉTUDE – La guerre Iran-Irak (1980-1988)p. 220-221 : ÉTUDE – L’affirmation de l’islamisme
Les outils du manuel
p 223 : EXERCICE Mettre en relation deux documents : La diplomatie du dessin
p. 222-223 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 224-227 : OBJECTIF BAC – MÉTHODE Organiser la réponse au sujet – Tensions et conflits au Proche et Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondialeAnalyser une carte historique – La guerre des Six-Jours, guerre israélo-arabe de 1967
p. 228-229 : OBJECTIF BAC – SUJETS Compositions : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale / Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondialeétudes critiques / analyses de documents : La révolution islamique selon l’Iran / Le groupe « État isla-mique » en Irak et en Syrie
Ouverture du chapitre P 202-203
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondialeLe doc. 1 permet d’aborder le conflit israélo-palestinien à travers l’une de ses manifestations les plus visibles, à savoir le mur construit par Israël. Il souligne d’une des difficultés du conflit israélo-palestinien, la
question du partage d’une même terre sur un espace limité. Le doc. 2, qui est une photographie de Joseph Barrak (AFP) d’un soldat britannique qui assure la sécurité d’un oléoduc en flammes après un incident technique, permet d’évoquer la guerre d’Irak et l’intervention des puissances occidentales. Les images ont donc toutes deux ont une dimension géopolitique. Ces conflits régionaux acquièrent une
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 9 39
dimension internationale du fait de la présence du pétrole et de l’action des grandes puissances.
Grand angle P 204-205
Le Proche et le Moyen-Orient, une zone de tensions, un foyer de conflitsLes tensions et conflits qui agitent cette zone sont anciens ou récents, interétatiques ou intercommunautaires, politiques, éco-nomiques, ethniques ou religieux. À la diversité politique, ethnique et religieuse interne s’ajoutent les ingérences internationales, liées aux enjeux stratégiques ou économiques.
Étude P 206-207
La naissance de l’État d’Israël et la première guerre israélo-arabeLe conflit israélo-palestinien est central dans l’histoire contempo-raine du Proche-Orient. Il est donc nécessaire d’en aborder les enjeux dans le cadre d’une étude d’ouverture. Il n’est pas inutile, à cette occasion, de faire un rapide rappel historique en évoquant la déclaration Balfour et le système des mandats.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le refus du plan de partage de l’ONU [doc. 1] et le retrait annoncé de la Grande-Bretagne conduisent à la déclaration unilatérale d’indé-pendance d’Israël [doc. 2], entraînant la déclaration de guerre des pays arabes, hostiles au projet sioniste [doc. 4].
2. Face à des armées arabes peu nombreuses (environ 35 000 hommes) et divisées, l’armée israélienne unie par le sionisme [doc. 2] et renfor-cée par les volontaires internationaux [doc. 3] montre une très forte détermination, explicable en partie par l’impact de la Shoah.
3. Israël a désormais un territoire lui permettant de bâtir un État [doc. 4]. En Israël, la guerre modifie le rapport démographique entre commu-nautés arabe et juive, à l’avantage de cette dernière. Dans les pays voisins, elle crée le problème des réfugiés [doc. 5].
4. À l’issue de la guerre, Israël considère comme ses frontières les lignes de cessez-le-feu avec ses voisins arabes, mais elles ne sont pas reconnues comme telles par l’ONU [doc. 4]. La présence de réfugiés palestiniens dans toute la région [doc. 5] pose le problème de leur retour éventuel en Israël, que l’État hébreu refuse. De nouveaux conflits sont donc prévisibles.
Mettre en relation deux documentsIl s’agit non seulement de voir que l’État juif contrôle un territoire plus grand que celui attribué par le plan de partage, mais aussi de le mettre en rapport avec les conséquences : transferts de populations, statut futur de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est.
Cours 1 P 208-209
Le Proche et le Moyen-Orient dans la guerre froideLe Proche et le Moyen-Orient restent un enjeu stratégique en faisant passer France et Grande-Bretagne, de la domination européenne, à la guerre froide. Après 1955, l’URSS appuie l’Égypte et les pays arabistes anti-occidentaux, non seulement par la diplomatie et l’aide économique
mais aussi en formant des officiers, relais d’influence [doc. 1]. Compte tenu du poids politique de ces armées, son influence est donc forte. La bipolarisation génère de nouvelles luttes d’influence, voire des retour-nements d’alliances et la zone abrite des bases militaires étrangères [doc. 2], ce qui renforce les tensions entre États de la zone, qui multiplient les affrontements et les interventions dans les guerres civiles (guerre du Yémen dans les années 1960, du Liban dans les années 1970 et 1980). Ainsi, la rivalité égypto-saoudienne opposant arabisme (Nasser) et isla-misme saoudien (Faysal) est une véritable « guerre froide arabe » et l’Arabie saoudite n’hésite pas à utiliser l’atout économique (pétrole) et religieux (présence des lieux saints sur son territoire) pour tenter de fédérer le monde musulman afin de faire contrepoids à Nasser [doc. 4]. L’ONU tente de proposer un compromis dans le conflit israélo-arabe après 1967 (retrait d’Israël des territoires palestiniens occupés contre la reconnaissance par les pays arabes de l’État d’Israël). L’opposition Est-Ouest empêche aussi de résoudre de manière globale le conflit israélo-arabe. Seule l’Égypte signe les accords de paix avec Israël et récupère le Sinaï [doc. 5], mais cela n’entraîne pas la paix globale, l’Égypte étant rejetée par les autres pays arabes. La question palestinienne reste sans solution depuis la création d’Israël, attisant tensions et conflits régiona-lement et internationalement. Les ressources en pétrole et la situation stratégique de la région en font un point chaud (guerre de 1973).
Étude P 210-211
La crise de SuezEn 1956, Nasser est au pouvoir en Égypte depuis le renversement de la monarchie pro-britannique en 1952. Leader nationaliste arabe, il se présente comme proprement égyptien et comme panarabe. C’est un des leaders du tiers-monde depuis la conférence de Bandoung (1955). Rejetant le colonialisme, il soutient le FLN algérien et se tourne vers l’URSS. Il apparaît donc comme un ennemi pour la France, le Royaume-Uni et Israël. À la recherche d’un financement pour construire le barrage d’Assouan (pour étendre les zones irriguées par le Nil), il veut contrôler la compagnie universelle du canal de Suez. La crise de Suez est ainsi à la fois une guerre coloniale, un épisode du conflit israélo-arabe et un affrontement lié à la guerre froide.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Nasser cherche à retrouver l’indépendance économique de l’Égypte [doc. 1] et son influence en reprenant le contrôle sur le canal, indispensable aux puissances occidentales pour acheminer le pétrole de la péninsule arabique [doc. 5].
2. Il rencontre l’opposition de la France et du Royaume-Uni car la zone du canal est stratégiques, proximité d’Israël, [doc. 2, 3], et pour des raisons économiques liées au contrôle des ressources de la Compagnie et des flux maritimes [doc. 1], mais aussi des raisons politiques : décolonisation, guerre d’Algérie [doc. 1, introduction].
3. Les États-Unis ont perdu le contrôle de leurs alliés européens [doc. 2]. Ils lancent la « doctrine Eisenhower » [doc. 4] qui leur permet d’inclure le Proche et le Moyen-Orient dans leurs zones d’interven-tion prioritaire dans le cadre de la guerre froide. Ils ont besoin que les flux du canal restent libres [doc. 5].
4. La crise de Suez est une défaite militaire pour Nasser [doc. 2], mais une victoire politique nationale et internationale [doc. 5].
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
40 CHAPITRE 9 HISTOIRE - Term
5. Nasser devient un acteur incontournable [doc. 5] et se fait res-pecter par les États-Unis en obtenant le soutien soviétique, mais au risque de les retrouver systématiquement contre lui [doc. 4].
Confronter deux documentsÀ cette époque, tout le pétrole de la Péninsule arabique à destina-tion de l’Europe et de l’Amérique passait par le canal de Suez. Nasser peut désormais bloquer cet approvisionnement, ce qui lui donne un poids important, surtout compte tenu de son alliance avec l’URSS.
Cours 1 P 212-213
La globalisation des conflitsLes conflits au Proche et Moyen-Orient perdurent après la guerre froide alors que l’espoir renaît de les régler enfin. Ils semblent même, après une brève période de détente liée aux accords d’Oslo, s’appro-fondir. La prépondérance de l’influence américaine ne suffit pas à régler le conflit israélo-arabe. Malgré des avancées certaines [doc. 1], comme les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens et la reconnaissance mutuelle, auparavant inimaginable, entre l’OLP et Israël, le processus d’Oslo bloque sur des questions territoriales. Alors que les accords voulaient procéder par étapes, leur gel entraîne une situation inextricable dans les territoires occupés, entre les zones contrôlées par l’autorité palestinienne et celles toujours contrôlées par Israël [doc. 2] transformant la Cisjordanie en véritable « peau de léopard » et rendant extrêmement difficile la vie de ses habitants (mobilité, approvisionnement, etc.). Après la Seconde Intifada, Israël se met à construire une « barrière de sécurité » qui est d’autant plus contestée par les Palestiniens qu’elle ne passe pas sur les lignes de cessez-le-feu de 1967 mais intègre côté israélien des territoires occupés [doc. 3]. L’intervention des États-Unis pendant la première guerre du Golfe (1991-1992) puis la seconde, en 2003, obtient des succès militaires rapides, mais elle ne parvient pas à réaliser son objectif affiché, à savoir la démocratisation de la zone et l’instaura-tion d’une atmosphère de paix globale. Si le régime dictatorial de Saddam Hussein est renversé [doc. 4], l’Irak entre ensuite en quasi-guerre civile. Quand le printemps arabe venu de Tunisie touche les pays de la zone, les régimes autoritaires en place, qu’ils soient issus de l’arabisme (Égypte, ou le président Moubarak est renversé, Syrie, Yémen) ou de l’Islamisme (Iran) chancellent ou tombent [doc. 5]. Mais la situation reste confuse et éloigne les perspectives de paix globale.
Étude P 214-215
Les Palestiniens, de 1948 à nos joursLes Palestiniens avaient affirmé leur identité nationale au moment du mandat britannique (1921-1949) contre les revendications sio-nistes. Ils sont très peu à être restés sur le territoire d’Israël suite au premier conflit israélo-arabe de 1948-1949. La plupart des Palesti-niens (80 %) ont été expulsés ou se sont réfugiés dans les pays voisins et dans le reste du monde, mais le plus souvent sans possi-bilité d’intégration locale. L’exil temporaire s’est ainsi transformé en une implantation éclatée. La construction de leur identité nationale passe par la confrontation avec les idéologies dominantes : arabisme, islamisme, marxisme, et par des rivalités internes. L’occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza depuis 1967 a ainsi renforcé chez les populations palestiniennes de ces territoires leur nationalisme.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Avec l’exode [doc. 1], forcé ou préventif, est née une diaspora pales-tinienne très concentrée dans les pays arabes entourant Israël, base de la question épineuse du retour des réfugiés [doc. 4] des organisations palestiniennes activistes et combattantes se sont également dévelop-pées, souvent hors de tout contrôle des pays d’accueil, particulièrement au Liban lui-même en prise à des tensions communautaires [doc. 2].
2. Aux yeux des États arabes qui accueillent des réfugiés, la question palestinienne est souvent perçue comme une menace sociale pour leur équilibre communautaire et « un État dans l’État » qu’ils cherchent à abattre ou s’efforcent en vain de contrôler [doc. 2]. Aussi, les Pales-tiniens sont en grand nombre installés dans des camps (surtout à Gaza et au Liban) dépendant de l’aide de l’ONU et mal intégrés aux pays d’accueil [doc. 4].
3. Le nationalisme palestinien se manifeste par le choix de la lutte armée de résistance, par l’OLP à ses débuts [doc. 3] et par des frustra-tions dues à l’enlisement du conflit [doc. 2, 5]. L’OLP renonce au terro-risme à partir de 1988 et choisit la négociation à l’inverse du Hamas [doc. 3].
4. La question du retour des réfugiés [doc. 4], celle du partage du territoire [doc. 2] et l’occupation militaire israélienne dans les territoires occupés [doc. 5] sont toujours des problèmes.
Analyser une carteLe doc. 4 montre que l’afflux des réfugiés palestiniens, surtout quand ils sont restés dans des camps, tend à fragiliser les États arabes et maintient ces Palestiniens dans une situation extrêmement difficile.
Étude P 216-217
Le pétrole au cœur des conflitsLe pétrole est à la fois un enjeu et une arme. Il génère des conflits dont les conséquences se mesurent à l’échelle mondiale. Il n’est en aucun cas l’unique explication des conflits, mais il est le principal facteur de persistance d’un foyer de tensions. Il attise des rivalités continuelles depuis la Première Guerre mondiale, entre compagnies d’exploitation, entre États et compagnies, entre États producteurs et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, Le pétrole est au cœur des tensions et des conflits tant qu’il constitue une ressource indispensable au fonctionnement de l’économie mondiale.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le Moyen-Orient est à la fois doté de ressources pétrolières très impor-tantes, de compagnies d’exploitation et de voies d’approvisionnement majeures comme le canal de Suez ou le Golfe persique [doc 1, 2].
2. L’exploitation du pétrole provoque des tensions locales, régionales et internationales et conduit les grandes puissances à intervenir pour garan-tir leur approvisionnement en pétrole [doc. 2, 6].
3. Il nourrit les tensions internes au Moyen-Orient en déclenchant des réactions anti-occidentales [doc. 2, 4, 5] et en modifiant l’équilibre des puissances du Moyen-Orient [doc. 4].
4. L’enjeu pétrolier détermine les actions des grandes puissances qui cherchent à assurer son exploitation à leur profit [doc. 1]. Les pays pro-ducteurs de pétrole reprennent progressivement le contrôle de leurs ressources (dates clés), et provoquent le choc pétrolier de 1973 [doc. 4].
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 9 41
Analyser un texteLe doc. 4 permet de montrer que la guerre du Kippour représente un tournant. En réduisant leur production et en bloquant leurs ventes aux alliés d’Israël, les pays de l’OPEP provoquent un choc pétrolier à l’origine d’une profonde crise économique dans l’ensemble du monde occidental.
Étude P 218-219
La guerre Iran-Irak (1980-1988)Ce conflit marque une forte rupture dans l’histoire du Moyen-Orient, idéologiquement, démographiquement et économiquement. C’est la première fois que la ligne de fracture chiites-sunnites et Arabes-Per-sans est réactivée depuis le xviiie siècle. Mais surtout, en 1979, l’aya-tollah Khomeiny impose une révolution islamique en Iran dont il veut faire un modèle pour tous les musulmans. Une République islamique est née (parlement, constitution, élections) sur la base du chiisme révolutionnaire, foyer d’islamisme. En avril 1980, il appelle à renverser Saddam Hussein. Ce dernier attaque l’Iran le 22 septembre 1980, avec le soutien de l’ensemble du monde arabe, hormis la Syrie rivale.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La révolution iranienne représente une menace pour tous les États limitrophes [doc. 1], et surtout pour l’Irak qui abrite une forte communauté chiite dominée par le régime dictatorial sunnite de Saddam Hussein [doc. 2].
2. La République islamique s’appuie sur certains mouvements islamiques, mais avec le handicap de n’être pas arabe [doc. 2], ainsi que sur les ventes d’armes de firmes occidentales, de pays du Proche-Orient anti-occidentaux et – paradoxalement – d’Israël, pour qui ce conflit affaiblissant les pays arabes est une aubaine [doc. 4].
3. La forme même de la guerre (tranchées, positions, les pertes terribles des deux côtés liées à une guerre de tranchée et l’ampleur des aides dont bénéficient les deux belligérants provoquent un enlisement [doc. 3, 4 et 5].
4. La communauté internationale pousse à la fin de la guerre une fois que la perspective d’une victoire iranienne est écartée [doc. 3, 5].
Confronter deux documents :Il s’agit en partie d’un vieux conflit entre les mondes persan et arabe, entre chiisme et sunnisme. C’est compliqué par fait que les chiites irakiens sont arabes mais partagent avec les Persans la solidarité chiite. Les enjeux internationaux (peur du chiisme révolutionnaire anti-occidental, pétrole) s’en mêlent pour le faire durer. Les aides étrangères (doc. 4) ont des causes politiques (rejet ou appui à l’islamisme anti-occidental iranien) mais sont aussi liées à la nécessité de contrôler le pétrole local et la pression pour faire finir la guerre est liée à la crainte sur exportations de pétrole.
Étude P 220-221
L’affirmation de l’islamismeL’islamisme trouve ses racines dès les débuts de l’islam, mais il s’est beaucoup affirmé au xxe siècle. Il ne peut se comprendre que comme une réaction face à l’occidentalisation et au colonialisme dans le monde arabe (en particulier le Proche et le Moyen-Orient) aux xix et xxe siècles. À l’instar de l’arabisme, il porte une volonté d’indépen-dance totale vis-à-vis de l’Occident, et se veut un retour à des racines réelles ou supposées. Il s’agit d’une rupture radicale avec l’islam
traditionnel au nom de racines réelles ou supposées et d’un courant par nature politique. Mais il est très divers, avec des formes d’action, des degrés de radicalité et même des objectifs différents.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les mouvements islamistes se placent dans une logique supérieure aux États-nations [doc. 2]. Ils sont une menace politique pour les régimes proche et moyen-orientaux modernistes et pro-occidentaux, comme celui du Shah d’Iran renversé en 1979 [doc. 3].
2. Ils s’opposent à l’occidentalisation de la culture et des mœurs et ils refusent les références politiques occidentales [doc. 1], mais empruntent quand même des références comme celle de « république » [doc. 3].
3. Certains sont internationaux et terroristes (doc. 4), d’autres liés à une seule communauté tels les chiites libanais [doc. 5], d’autres enfin ont accepté le cadre politique et légal, voire laïc, de leur pays, comme c’est le cas d’Ennahda en Tunisie [doc. 6].
4. Les Frères musulmans étaient jusqu’à peu dans le refus de tout com-promis avec l’État [doc. 2] et Al-Qaïda dans le refus même de tout État [doc. 4]. Ennahda, en revanche, joue le jeu de l’exercice démocratique du pouvoir en Tunisie [doc. 6]. Le printemps arabe a donc eu des conséquences contrastées.
Mettre en relation deux documentsLes fondements de l’islamisme politique reposent sur la volonté de purger la société [doc. 1] – puis l’État [doc. 2] – de toute référence non islamique et sur l’idée que religion et idéologie politique sont fusionnées et que l’État nation doit être dépassé. Ce sont aussi leurs limites, de même que leur difficulté d’accepter des compromis avec d’autres forces politiques.
EXERCICE P 223
Mettre en relation deux documentsPlantu, qui réalise quotidiennement un dessin en Une du journal Le Monde depuis 1985, est reçu en novembre 1990, alors qu’il se trouve à Carthage pour une exposition, un coup de téléphone l’informant que Yasser Arafat souhaite le rencontrer à Tunis. À l’issue de cette première rencontre, le chef de l’OLP accepte que le dessinateur revienne avec une équipe de télévision. Le 15 mai 1991, la rencontre a lieu de nuit et Yasser Arafat dessine sous l’œil de la caméra, uti-lisant le médium du dessin, pour faire comprendre qu’il est disposé à reconnaître l’État d’Israël. L’année suivante, la rencontre avec Shimon Pérès apparaît comme une réponse à l’initiative de Yasser Arafat. La diplomatie du dessin est née.
Objectif BAC Méthode P 224-225
Composition
Organiser la réponse au sujet
Tensions et conflits au Proche et au Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale1. Jusqu’à la fin des années 1980, les tensions et conflits au Proche et au Moyen-Orient s’inscrivent dans le contexte plus large de la guerre froide.
2. La fin du monde bipolaire avive les tensions dans la région, qui connaît de profonds bouleversements.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
42 CHAPITRE 9 HISTOIRE - Term
Le conflit israélo-arabe depuis 19481. La création de l’État d’Israël et la première guerre israélo-arabe constituent une rupture importante dans l’histoire du Proche-Orient.
2. Les guerres de 1967 et 1973 marquent l’apogée du conflit, auquel les accords de Camp David mettent un terme provisoire.
3. La question palestinienne demeure au cœur des tensions entre Israël et les pays arabes.
Le pétrole, un enjeu des conflits au Proche et au Moyen-Orient ?1. Pendant la guerre froide, le pétrole est un enjeu pour les pays de la région, qui cherchent à assurer leur indépendance vis-à-vis des deux grands.
2. Depuis la fin de la guerre froide, l’enjeu de l’accès au pétrole détermine en partie les interventions militaires des grandes puis-sances dans la région (Guerre du Golfe, Irak).
Objectif BAC Méthode P 226-227
Étude critique de document / Analyse de document :
Analyser une carte historique
La guerre des Six-Jours, guerre israélo-arabe de 1967Cette carte présente le déroulement de la guerre des Six-Jours, depuis le blocus de Tiran par Nasser, jusqu’à la résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exige le retrait des forces armées israéliennes victorieuses. Il est nécessaire de replacer ces événements dans le contexte plus large du conflit israélo-palestinien depuis 1948, pour mettre en évidence le tournant que cette guerre représente dans les relations internationales, tant dans les relations franco-israéliennes (Après la déclaration du général de Gaulle sur le « peuple sûr de lui et dominateur » en novembre 1967), les relations américano-américaines (le président Johnson approuvant en janvier 1968 la livraison d’avions F4-Phantom à Israël), que dans les rapports entre les pays arabes (fondation de l’OPAEP en janvier 1968). Les Palestiniens, confrontés à un nouvel exode et à l’occupation des Territoires, donnent désormais la priorité à la lutte armée révolutionnaire pour la libération de la Palestine : les premiers attentats du FPLP contre la présence israélienne dans la bande de Gaza ont lieu en janvier 1968, et le 23 juillet 1968 un avion d’El Al assurant la liaison Rome-Tel-Aviv est détourné à Alger.
La guerre du Kippour, guerre israélo-arabe de 1973La guerre du Kippour est différente des guerres précédentes dans la mesure où, pour la première fois, l’armée israélienne est momen-tanément mise en difficulté. L’offensive syrienne et égyptienne est perçue par les Palestiniens, et plus largement par le monde arabe, comme une revanche de la guerre des Six-Jours.
Objectif BAC Sujets P 228
CompositionLe Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale1. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances man-dataires réorganisent la région et de nouveaux conflits se font jour2. Après la Seconde Guerre mondiale, les conflits au Proche et au Moyen-Orient s’intensifient et se diversifient sans que les grandes puissances n’arrivent à les enrayer.
Étude critique de documentLa Révolution islamique selon l’IranLe « guide de la révolution » iranienne s’exprime dans la ville la plus sainte de l’islam, La Mecque, ville natale de Mahomet, dans laquelle tout croyant musulman qui en a les moyens doit se rendre en pèleri-nage une fois au moins dans sa vie. Son discours, dans lequel il affirme que l’islam doit mener une « guerre sainte » contre tous les pays le menaçant (les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, et Israël), s’inscrit dans le contexte de la première intifada palestinienne. Khomeiny fait référence de façon ambiguë au non-alignement en substituant à l’antagonisme Est-Ouest un antagonisme Nord Sud. Ce texte présente donc un visage offensif de l’islamisme politique.
Objectif BAC Sujets P 229
CompositionLe Proche et au Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale1. Pendant la guerre froide, les conflits au Proche et du Moyen-Orient sont largement déterminés par l’opposition entre les deux grands.
2. Depuis la fin de la guerre froide, les conflits sont plus nombreux et plus variés.
Analyse de documentLe groupe « État islamique » en Irak et en SyrieCette carte des forces en présence en Irak et en Syrie en février 2016 souligne la grande complexité de la guerre civile en Irak et en Syrie et le nombre importants d’acteurs directs des combats. La carte souligne en même temps l’essor très rapide, entre 2014 et 2016, des territoires contrôlés par l’« État islamique » ou soumis à son influence. La guerre civile a pris une dimension régionale avec l’intervention directe ou indirecte des pays Arabes et de l’Iran, et globale avec les frappes de la coalition internationale, l’intervention de la Russie et les répercussions de la crise syrienne en Occident.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• « Proche-Orient : foyers, frontières et fracture », in Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 103, Presses de Sciences Po 2009.
• Balanche Fabrice, Géopolitique du Moyen-Orient, Documentation Photographique, les dossiers, n° 8102, 2014.
• Bozarslan H., Une histoire de la violence au Moyen-Orient – De la fin de l’Empire ottoman à al-Qaida, La Découverte, 2008.
• Corm Georges, Le Proche-Orient éclaté : 1956-2012, Gallimard, 2012.
• Dupont Anne-Laure, Mayeur-Jaouen Catherine, Verdeil Chantal, Le Moyen-Orient par les textes xixe-xxe siècle, Armand Colin, 2011.
• Laurens Henry et Cloarec Vincent, Le Moyen-Orient au xxe siècle, Armand Colin, 2003.
• Laurens Henry, L’Orient arabe – Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin, 2002.
• Les articles du magazine Moyen-Orient.
• Sellier André, Sellier Jean et Le Fur Anne, Atlas des peuples d’Orient, La Découverte, 2004.
• Vallaud P. et Baron X., Atlas géostratégique du Proche et du Moyen Orient, Librairie académique Perrin, 2010.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 10 43
10 Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration et opinion publiqueL’État constitue un acteur important de la vie économique et sociale française. C’est un aspect ancien et original si l’on considère d’autres États européens. Ce chapitre aborde les grandes évolutions du mode de gouvernement de la France depuis 1946 et l’instauration de la IVe République. Il permet d’étudier le modèle étatique français, la façon dont la France est gouvernée, les mutations des missions de l’État et de l’opinion publique.
• Le plan proposé dans le manuel tient compte de la rupture des années 1970-1980 (crise économique, remise en cause du modèle étatique français, alternance et décentralisation, approfondissement de la construction européenne), qui se traduit par une érosion du pouvoir de l’État et de l’image de l’administration dans l’opinion publique. Les deux cours permettent de mettre en œuvre une approche diachronique à même de faire percevoir clairement aux élèves les évolutions à l’œuvre depuis 1946, tant sur le plan du gouvernement et de l’administration que sur celui des conceptions du mode de gouvernement.
• Le choix des études et des exercices de fin de chapitre offre quant à lui l’opportunité d’analyser certains grands domaines d’action de l’État, en même temps que le rôle des hommes d’État et le poids de l’opinion publique sur l’action du gouvernement. La révolution récente que constitue la décentralisation est présentée de manière synthétique avec ses ambiguïtés et ses interrogations. En définitive, c’est le primat du politique sur les autres domaines qui est interrogé tout au long du chapitre.
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
L’échelle de l’État-nation : Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement et administration. Héritages et évolutions.
p. 236-237 : GRAND ANGLE – Paris, ville capitalep. 238-239 : COURS 1 – Gouverner la France, moderniser l’Étatp. 240-241 : ÉTUDE – Le général de Gaulle devant l’opinion publiquep. 242-243 : ÉTUDE – La promotion Voltaire de l’ENAp. 244-245 : COURS 2 – Les mutations de l’État et de la gouvernancep. 246-247 : ÉTUDE – La décentralisationp. 248-249 : ÉTUDE – Le pouvoir politique et la télévision depuis 1946
Les outils du manuel
p 251 : EXERCICE Mettre en relation deux documents : Le rôle de l’État dans l’économie
p. 250-251 :L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 252-255 : OBJECTIF BAC – MÉTHODE Rédiger l’introduction – Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration Analyser un discours politique – Le tournant de la cohabitation
p. 256-257 : OBJECTIF BAC – SUJETS Compositions : Le pouvoir exécutif en France depuis 1946 / État, gouvernement, administration et opinion publique en France depuis 1946Étude critique de document / analyse de document : Le rôle de l’État selon Pierre Mendès France / Gouverner la culture
Ouverture du chapitre P 234-235
Gouverner la France depuis 1946La première photographie souligne le primat du politique, tel que conçu par le général de Gaulle, et met en valeur le caractère quelque peu monarchique de la mise en scène du pouvoir lors des deux grandes conférences de presse annuelles. La seconde image permet d’aborder les mouvements de contestation du désengagement croissant de l’État.
Grand angle P 236-237
Paris, ville capitaleLe pouvoir s’incarne dans des lieux qui peuvent susciter la curiosité des élèves, pour éviter une approche trop abstraite. La double page consacrée à Paris leur permet d’étudier la concentration des lieux de pouvoirs, y compris des sièges des médias, et de faire le lien avec la centralisation. Ils constatent que cette réalité toujours actuelle (grands travaux présidentiels), surprenante pour les
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
44 CHAPITRE 10 HISTOIRE - Term
étrangers, s’inscrit dans une histoire longue, malgré les changements de régime depuis 1789.
Cours 1 P 238-239
Gouverner la France, moderniser l’ÉtatSymbole des nationalisations sanctions des premiers mois de 1945, Renault devient bientôt une vitrine de la politique sociale de l’État (4e semaine de congés payés, 1963) [doc. 1]. L’instabilité gouvernemen-tale chronique de la IVe République masque la permanence de l’action de l’État dans les domaines régaliens, assurée par la quasi-permanence de certains ministres (Georges Bidault et Robert Schuman se relaient au fauteuil de ministre des affaires étrangères de septembre 1944 à juin 1954) et surtout celle des hauts fonctionnaires : Gouverneur de la Banque de France de 1947 à 1960, Wilfrid Baumgartner voit se succé-der 15 ministres des finances [doc. 2]. L’histoire de la IVe République ne se résume donc pas à sa fin sans gloire, et l’on peut souligner la mise en place d’une administration adaptée aux nouvelles missions de l’État, à une époque où le Service public était, dans l’opinion, synonyme de progrès et de modernité. Le poids croissant des hauts-fonctionnaires, et plus largement des fonctionnaires dans les cabinets, est embléma-tique de cette époque [doc. 4]. Le système politique mis en place en 1958 se caractérise par la primauté de l’exécutif, confortée par la réforme constitutionnelle de 1962 sur l’élection du Président de la République au suffrage universel [doc. 3]. Toutefois, la conception gaullienne d’un État entrepreneur et régulateur de l’économie est contestée à droite, dès les années 1960, par les libéraux comme Valéry Giscard d’Estaing. Le thème d’un État tentaculaire et inefficace sur lequel s’appuie le discours de Jacques Chaban Delmas [doc. 4] s’inscrit dans le contexte de la remise en cause de l’État jacobin, à une époque où le modèle de l’organisation politique des États-Unis est en vogue. Avant même le choc pétrolier, le poids de l’État est donc questionné.
Étude P 240-241
Le général de Gaulle devant l’opinion publiqueCette étude permet d’aborder de façon vivante un cas concret et emblématique du rapport qu’entretient un chef d’État avec l’opinion publique. Il est symptomatique, de ce point de vue, qu’en 1958, lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir, moins d’un foyer sur dix est équipé d’un téléviseur et que, dix ans plus tard, les deux tiers le sont. Le Général de Gaulle prend très vite conscience de l’impor-tance des médias pour conforter l’assise de son pouvoir et s’appuie sur l’opinion publique et sur le référendum plutôt que sur le parti gaulliste. Il imprime son style à la télévision et multiplie les voyages pour aller régulièrement à la rencontre directe des Français. Il ne fait aucun doute que cela contribue à maintenir au-dessus de 50 % le taux de personnes satisfaites de son action dans les sondages.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le général de Gaulle est, depuis le 18 juin 1940, d’abord et avant tout un homme de radio, et un familier du contact direct avec la foule lors de ses déplacements. Toutefois, il est le premier homme politique à intégrer pleinement l’image télévisée et s’appuie sur des médias très contrôlés.
2. La popularité du général de Gaulle est forte en 1958 et transcende les clivages partisans. La question algérienne lui fait perdre des soutiens de part et d’autre de l’échiquier politique. Toutefois, jusqu’à la fin de son mandat, sa popularité reste significativement élevée.
3. Les médias publics ont contribué à dénouer la crise, dans la mesure où l’allocution du général a pu être entendue par de nombreux appe-lés du contingent en possession de transistors.
4. L’emploi des médias pas le général de Gaulle attire le sarcasme des caricaturistes : comme Jean Effel dans L’Express, Tim, dans L’Express également, le 4 mai 1961, le surnomme le « Président du gouvernement transitoire de la République française », Faizant, dans une caricature parue dans Le Figaro, lui fait dire « Il me semble avoir entendu, au fond de la salle, quelqu’un ne pas me poser la question à laquelle je vais répondre maintenant ». Les journalistes de l’ORTF, comme les étudiants des Beaux-Arts, protestent pour leur part en 1968 contre la mainmise du pouvoir sur l’information.
Confronter deux documentsLe premier document montre l’importance que le général accorde à l’opinion publique, puisque chacun de ses voyages est soigneu-sement organisé et lui permet de bénéficier, le soir même, d’une couverture très favorable sur le journal télévisé de l’unique chaîne de télévision publique. Le second document montre que la popu-larité du général, même si elle est progressivement affaiblie, demeure très forte.
Étude P 242-243
La promotion Voltaire de l’ENAL’ENA, créée après la guerre, permet de former des administrateurs compétents. Elle constitue le vivier des élites politiques sous la
Ve République, mais ses débouchés sont divers. Ces deux pages s’intéressent à une génération, la promotion Voltaire, « une des dernières marquées par l’idéologie du service public », peu de temps avant l’arrivée de la gauche au pouvoir. Un récent ouvrage, Le Roman de la promotion Voltaire (Martin Leprince, Éditions Jacob-Duvernet, 2013)
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Le recrutement s’effectue dans les catégories socioprofession-nelles supérieures avec une surreprésentation de la région pari-sienne. La part des enfants de cadres et professions libérales domine, suivie par celle des enfants de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires devant les enfants des industriels.
2. Les élèves de cette promotion ont massivement intégré la fonc-tion publique : 65 % contre 35 % dans le secteur privé. Il faut sou-ligner le fait que les passages du public au privé ou du privé au public sont nombreux.
3. Seuls 10 % de cette promotion embrasse une carrière politique, mais il s’agit d’acteurs majeurs : un Président (François Hollande), un Premier ministre (Dominique de Villepin), une candidate à l’élection présidentielle (Ségolène Royale). Dans l’administration, ils occupent des postes de responsabilité, et l’élection de François Hollande à la Présidence de la République s’est traduite par l’accession de plusieurs « voltairiens » à des fonctions administratives de premier plan. Le rôle des énarques ne se limite pas au service public, comme le montrent
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 10 45
les parcours de Jean-Pierre Jouyet et d’Henri de Castries. Un nombre croissant d’entre eux intègre le monde de l’entreprise.
Analyser un texteCe document, tiré d’une longue enquête du journal Le Monde sur l’ENA publiée peu de temps avant la campagne présidentielle de 1981, éclaire d’abord les aspirations et les motivations de certains élèves de la promotion, dont Ségolène Royal et François Hollande. Il se prête, de ce point de vue, à une mise en perspective critique.
Organiser et synthétiser des informations L’histoire de cette promotion reflète d’abord la place centrale de l’ENA dans l’accès à la haute fonction publique et aux principales responsabilités politiques et économiques. Elle révèle ensuite le regard distancié que les médias portent sur les hommes et les femmes de cette promotion.
Cours 2 P 244-245
Les mutations de l’État et de la gouvernanceLa gauche arrive au pouvoir [doc. 1] avec un vaste programme de natio-nalisations : il s’agit de nationaliser 36 banques et de nombreux groupes industriels. En partie réalisé, il permet à l’État de contrôler 96 % du secteur financier. La décentralisation, engagée au même moment constitue une rupture importante dans la tradition jacobine de la France, tandis qu’il est mis fin au monopole de l’État sur l’audiovisuel. Mais les difficultés éco-nomiques, les choix politiques de droite ou de gauche réduisent progres-sivement l’action dans l’économie. La cohabitation bouleverse le mode de gouvernement et les habitudes politiques [doc. 2]. Les évolutions sont de plus en plus complexes : de nouvelles missions, la poursuite du désen-gagement dans un contexte de remise en cause du modèle social, du poids toujours important des prélèvements [doc. 3], d’une contestation croissante du poids de l’État [doc. 5]. Enfin, l’ouverture à la concurrence de la télévision, la création de chaînes privées, la naissance de la mesure de l’audience et le recours de plus en plus fréquent et systématique aux sondages modifient en profondeur l’action politique [doc. 4].
Étude P 246-247
La décentralisationTraditionnellement, les pouvoirs sont concentrés à Paris. Des cou-rants favorables à la décentralisation se développent depuis 1946, mais c’est en 1982 que les lois Defferre organisent le premier transfert de compétences au profit des collectivités. La politique de décentralisation est mise en place par une série de lois fixant les relations entre l’État et les différentes collectivités. Les limites en sont : la multiplication des niveaux de compétence, la taille réduite des régions, la place malgré tout importante de l’État.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les objectifs de la décentralisation sont de réduire l’écart entre Paris et ce que J.-F. Gravier a appelé en 1947 le « Désert français », de favoriser par conséquent le développement économique du reste de la France, et faire en sorte que les décisions soient prises au plus près des habitants.
2. Jusqu’en 1983, les domaines sont limités et l’on s’intéresse aux questions institutionnelles. Toutefois, le champ des compétences des collectivités s’étend progressivement au fil des réformes.
3. Ces lois constituent un tournant, car elles sont les premières à mettre en œuvre un transfert de compétences en faveur des col-lectivités dans des domaines précis et importants. Le mouvement n’est pas remis en cause par les alternances politiques.
4. Les lois de 2003, 2004 et 2010, renforcent le poids des collec-tivités territoriales, tant métropolitaines qu’ultramarines. La création des Métropoles puis la loi NOTRe marquent deux nouvelles étapes dans la décentralisation.
Analyser un schémaLes transferts de compétence de l’État ont été particulièrement importants vers les départements et les régions dans les domaines de l’aménagement du territoire, des transports, de l’action sociale, de la formation et de l’enseignement. Ainsi les écoles sont à la charge des communes, les collèges des départements et les lycées des régions.
Étude P 248-249
Le pouvoir politique et la télévision depuis 1946En 1947, le studio de la rue Cognacq-Jay commence à diffuser régu-lièrement des programmes de télévision, et le premier journal télévisé est diffusé le 29 juin 1949. Placée sous le contrôle étroit de l’État (RTF), la télévision n’est pas l’outil de communication privilégié des hommes politiques de la IVe République. Le 30 novembre 1955, à Matignon, Edgar Faure refuse en répondre aux questions d’un repor-ter du journal télévisé en s’exclamant : « Non, la télévision, ce n’est pas la patrie ! ». En dépit des progrès de la télévision (60 000 récep-teurs le 2 juin 1953 lors du couronnement d’Élisabeth II, dont 5 000 vendus en une journée), la radio demeure longtemps l’outil privilégié des présidents du conseil, à l’instar de PMF (Guy Mollet fait exception, utilisant régulièrement la télévision avec l’aide de Marcel Bleustein-Blanchet). Le général de Gaulle est le premier homme politique à en faire un outil prioritaire de communication, et la télévision, qui reste sous le contrôle de l’État après la création de l’ORTF, prend véritablement son essor en 1965, à l’occasion de la première élection au suffrage universel direct du président de la Ve République. La loi du 29 juillet 1982 met un terme au monopole de l’État sur l’audiovisuel. Une autorité administrative indépendante, la Haute autorité de la communication audiovisuelle, est créée, chargée de délivrer les autorisations d’émettre aux chaînes de télé-vision et de radio et de garantir l’indépendance du service public. Elle devient le CSA en 1989. En 1984, Canal + est la première chaîne de télévision privée, suivie de TV6 et la Cinq. En 1987, TF1 est privatisée au profit de l’entreprise Bouygues. Le paysage audiovisuel français (PAF) est ainsi profondément modifié.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La télévision est perçue comme un outil au service du gouverne-ment et, pour le général de Gaulle, l’opportunité d’« être présent » dans chaque foyer grâce au journal télévisé de l’unique chaîne de télévision publique.
2. Les campagnes électorales contribuent à l’essor des émissions poli-tiques à la télévision, d’abord au travers de la campagne officielle, dont les règles sont fixées en 1964 (2 heures de télévision et 2 heures de radio par candidat à la présidentielle), et ensuite grâce aux émissions
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
46 CHAPITRE 10 HISTOIRE - Term
consacrées à la vie politique dans son ensemble, qu’elles soient sérieuses ou parodiques.
3. Jusqu’en 1974 au moins, la télévision apparaît avant tout comme un complément de la radio aux yeux des hommes politiques. L’affiche de Jean Lecanuet illustre parfaitement cette complémentarité. La libéralisation et la multiplication des médias audiovisuels tendent ensuite à accroître le rôle de la télévision.
4. L’indépendance de la radio et de la télévision est obtenue par-tiellement en 1982 par la loi sur la communication audiovisuelle. Il faut toutefois souligner que la tutelle des pouvoirs publics est maintenue de façon indirecte par le biais de la Haute autorité, puis du CNCL et du CSA.
Analyser une afficheLe doc. 4 permet d’aborder la campagne présidentielle de Jean Lecanuet, qui se présente lui-même comme le « Kennedy français » – et que les proches du général de Gaulle surnomment Kennedylett (en référence à Gilette) – et a profondément marqué les esprits. Soutenu par Jean-Jacques Servan-Schreiber après l’échec de la tentative de candidature de « Mon-sieur X » (Gaston Deferre), Lecanuet annonce sa candidature le 19 octobre 1965. Il est alors crédité de 3 % dans les sondages. Faisant appel aux services d’un publicitaire, Michel Bongrand, il fait une campagne réso-lument tournée vers la radio et la télévision, tout diffusant une brochure tirée à 4 millions d’exemplaires et 800 000 affiches sur les panneaux Giraudy (« Un homme neuf, une France en marche »). Au terme d’une campagne très active (tour de France), le candidat centriste obtient 15,5 % des suffrages au premier tour des élections présidentielles.
EXERCICE P 251 Mettre en relation deux documents
Ces deux documents témoignent de deux approches relativement différentes du rôle de l’État dans l’économie. Si Georges Pompidou justifie le rôle de l’État, il le confine pour l’essentiel à une fonction d’accompagnement, dans un contexte qui est celui de la rupture avec la période gaullienne. Pierre Mauroy, au contraire, justifie les nationalisations de 36 banques et entreprises envisagées en 1981 par la volonté de doter l’État de moyens d’intervention direct dans l’industrie. De fait, le projet de Pierre Mauroy se heurte à de nom-breuses résistances (le vote final n’intervient qu’en février 1982), et le résultat est loin de celui escompté : on est loin d’une étatisation (même si l’État contrôle 96 % du secteur financier), et le gouver-nement de Pierre Mauroy se convertit dès mars 1984 à la rigueur et réduit les dépenses publiques.
Objectif BAC Méthode P 252-253
Composition :
Rédiger l’introduction
Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration.1. Le gouvernement de la France de 1946 à 1981 repose sur le rôle central d’un État centralisé et l’action de gouvernants qui disposent d’une administration modernisée et professionnalisée
2. Le gouvernement de la France après 1981 évolue du fait notam-ment de la décentralisation, de la construction européenne et du poids croissant de l’opinion publique.
Gouverner la France pendant les Trente GlorieusesCe sujet invite à étudier la gouvernance de la France en période de forte croissance, et à considérer en priorité le rôle de l’État et du gouvernement, sans pour autant négliger les autres acteurs.
1. La période des Trente Glorieuses est d’abord celle de la recons-truction de l’État et de l’économie française.
2. La croissance économique dote l’État de moyens importants mis au service de la croissance industrielle et commerciale.
Les mutations de l’État en France depuis 19461. La période des « Trente-glorieuses » consacre la place et le poids de l’État, en tant que garant du progrès social et des équilibres économiques et sociaux.
2. La crise économique remet en cause l’État providence et l’inter-vention de l’État tant dans l’économie que dans la société.
Objectif BAC Méthode P 254-255
Étude critique de document / Analyse de document
Analyser un discours politique
Le tournant de la cohabitationLe discours de Jacques Chirac doit être replacé dans le contexte de l’affirmation des idées néo-libérales, et du modèle qu’offre au nouveau Premier ministre français les expériences de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis. La mention de la collectivisation, en outre, est une référence au modèle soviétique, fréquente encore à cette époque dans le débat politique. La mention de l’obésité de l’État souligne l’idée selon laquelle le dirigisme accroîtrait le poids de l’État au point de le rendre moins efficace.
La gouvernance face aux médiasLe discours improvisé de François Mitterrand à Carmaux peut-être comparé avec profit à celui qu’il a prononcé en 1949 à propos de la télévision (p. 248), ou rapproché de celui de son ancien Premier ministre, Michel Rocard (p. 245) avec lequel il partage manifestement un même jugement critique quant au poids du « temps médiatique ».
Objectif BAC Sujets P. 256
CompositionLe pouvoir exécutif en France depuis 19461. La IVe République s’appuie sur un pouvoir exécutif affaibli et soumis à la suprématie des partis politiques2. A l’initiative du général de Gaulle La Ve République repose sur un pouvoir exécutif renforcé et concentré entre les mains du Président de la République
Étude critique de documentLe rôle de l’État selon Pierre Mendès France Difficultés économiques dans le monde aggravées par la guerre d’Indochine en France. Un ton volontaire, correspondant à une vision de l’État comme acteur central de l’économie, orientant aussi bien les entreprises (« activités privées ») que le secteur public. Le sens des priorités de l’auteur tranche sur la culture du compromis de la IVe République en raison des difficultés à trouver une majorité (celle de Pierre Mendès France ne durera que 7 mois).
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 10 47
Objectif BAC Sujets P. 257
CompositionÉtat, Gouvernement, administration et opinion publique en France depuis 19461. Le gouvernement de la France de 1946 à 1981 repose sur le rôle central d’un État centralisé et l’action de gouvernants qui disposent d’un contrôle relatif des médias.
2. Le gouvernement de la France après 1981 évolue du fait notam-ment de la décentralisation, de la construction européenne et du poids croissant de l’opinion publique.
Analyse de documentsGouverner la cultureEn 1959, le général de Gaulle crée un ministère des Affaires cultu-relles confié à André Malraux. Il s’agit de démocratiser l’accès à la culture, mais aussi de favoriser le rayonnement de la France. En 1981, François Mitterrand et Jack Lang mènent une action culturelle d’envergure qui va bien au-delà des grands travaux, augmentant le budget du ministère, multipliant les actions. La culture est donc un enjeu central pour l’État et le gouvernement.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Becker Jean-Jacques (avec la collaboration de Pascal Ory), Crises et Alternances – 1974-2000 – Nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, 2002.
• Berstein Serge, Histoire du gaullisme, Perrin, 2002.
• Berstein Serge et Winock Michel (dir.), La République recommen-cée – De 1914 à nos jours – Histoire de la France politique, Seuil, 2008.
• Cabannes Jean, Le personnel gouvernemental sous la Ve Répu-blique (1959-1986), LGDJ, 1998.
• Culpepper Pepper D., Hall Peter A. et Palier Bruno (dir.), La France en mutation – 1980-2005, Les Presses de Sciences Po, 2006.
• Jansen Sabine, « Les pouvoirs et le citoyen – IVe-Ve Républiques », in Documentation photographique, n° 8017, octobre 2000.
• Monnet Jean, Mémoires, LGF/Livre de poche, 2007.
• Rosanvallon Pierre, Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015
• Roussel Éric, de Gaulle, Perrin, 2007.
• Roussellier Nicolas, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, xixe-xxie siècle, Paris, Gallimard, 2015, Gallimard, 2015.
Sites Internet
• Fondation Charles de Gaulle : http://www.charles-de-gaulle.org/
• Institut Pierre Mendès-France : http://www.mendes-france.fr/
• Association Georges Pompidou : http://www.georges-pompi-dou.org/
• Institut François Mitterrand : http://www.mitterrand.org/
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
48 CHAPITRE 11 HISTOIRE - Term
11 Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948-1992)Ce chapitre explique la mise en place d’un échelon de gouvernement de type « régionaliste » destiné à assurer la paix et la stabilité en Europe, dont les États-nations ont été à l’origine des guerres mondiales. Deux logiques sont mises en œuvre : l’une supranationale / fédéraliste, l’autre intergouvernementale / unioniste. Malgré les réticences des États et des opinions, les Européens inventent, avec la Communauté économique européenne (CEE), une union économique épaulée par des institutions fédéralistes (le Parlement européen), malgré l’opposition des souverainistes et nationalistes. La réponse du manuel au programme est chronologique. L’étude du congrès de La Haye (1948) dégage les enjeux d’un projet qui se concrétise par des institutions européennes (Cours 1). L’étude de l’échec de la CED (1954) explicite les pesanteurs souverainistes qui n’entravent pas totalement le chantier de l’union économique (Cours 2).
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
L'échelle continentale : Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès de la Haye (1948-1992)
p. 260-261: GRAND ANGLE – Les débuts de la construction européennep. 262-263 : ÉTUDE – Le Congrès de la Haye (1948)p. 264-265 : COURS 2 – La naissance d’un projet d’Europe politique (1948-1957) p. 266-267 : ÉTUDE – L’échec de la Communauté européenne de défense (CED)p. 268-269 : COURS 2 – Le projet européen en chantier (1957-1989)
Les outils du manuel
p. 271 : EXERCICES Analyser un document statistique : L’opinion française face au traité de Maastricht
p. 270-271 : L'ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 272-273 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Analyser un discours : La naissance de l'Europe communautaire (1952)
Ouverture de chaPitre P 258-259
Cette double page met en parallèle l’enthousiasme initial, musical et choral, pour le projet unioniste de La Haye en 1948 et les attentes suscitées en 1992 par l’adoption du traité de Maastricht. L’Europe est présentée au citoyen comme la garantie d’un avenir heureux.
Grand angle P 260-261
Les débuts de la construction européenneL’Europe de 1948 est divisée en deux et les États occidentaux s’organisent (OECE, UEO) face à la menace soviétique et sous la tutelle américaine (OTAN). La CEE, fondée en 1957, s’élargit pro-gressivement, d’abord à des pays du Nord de l’Europe (Royaume-Uni, Irlande, Danemark), ensuite à des pays du Sud sortis de la dictature (Espagne, Portugal, Grèce). En 1992, l’Europe unie compte 12 pays membres et s’apprête à connaître un élargissement de plus grande ampleur.
Étude P 262-263
Le Congrès de La Haye (1948)Au Congrès de La Haye, les partisans d’« États-Unis d’Europe » (résistants non communistes, Churchill) veulent unir l’Europe pour consolider la paix. Mais les européistes sont divisés entre fédéralistes partisans d’une Europe supranationale et unionistes qui veulent une Europe intergouvernementale. Malgré l’enthousiasme, les premiers résultats sont limités.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Il s’agit de consolider la paix, reconstruire l’Europe et faire face à la menace soviétique.
2. Ce sont principalement les mouvements résistants, les européistes non communistes, Churchill, les délégués allemands, français et espagnols, dans le but d’intégrer l’Allemagne.
3. Les points de friction concernent la souveraineté des États-nations (fédéralistes contre unionistes) et la conception d’une Europe nouvelle (sans défendre l’Empire britannique).
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 11 49
4. Le congrès débouche sur des principes (union politique et éco-nomique, assemblée européenne), mais peu de choses concrètes hormis le Conseil de l’Europe.
Mettre en relation deux documentsDenis de Rougemont est fédéraliste. Il montre le quasi échec du congrès, lié aux clivages entre Britanniques et Européens, entre fédéralistes et unionistes, malgré la proposition supranationale de Paul Reynaud [doc. 5]. La caricature anglaise [doc. 6] met l’accent sur l’espoir (le bébé, l’avenir) et les difficultés : la vulnérabilité du nour-risson, les parents en forces politiques antithétiques (en noir / gauche pour les travaillistes plutôt fédéralistes et en blanc / droite plutôt unionistes comme Churchill). Le vieillard (Hérodote, l’Histoire) a le regard ambigu du sage : beaucoup a été promis, peu réalisé (Conseil de l’Europe en 1949).Ainsi, le projet européen mobilise des énergies discordantes et accouche d’un maigre résultat, qui n’est pas à la hauteur des enjeux (relever l’Europe, la reconstruire, l’unir).
Organiser et synthétiser les informations
Le projet est ambitieux, les intentions politiques élevées, les divi-sions fortes, et les résultats ténus (naissance du Conseil de l’Europe en avril 1949).
Cours 1 P 264-265
La naissance d’un projet d’Europe politique (1948-1957)Jusqu’en 1957, l’idée européenne rassemble les européistes non communistes, mais elle est victime des divisions politiques entre fédéralistes et unionistes à La Haye, en 1948. Le contexte atlantiste de constitution d’un bloc occidental et les fractures politiques internes font achopper les solutions supranationales comme la CED. Excepté le Conseil de l’Europe, seul le projet économique prévaut avec les traités de Rome de 1957.Les documents expriment ces résultats : le contexte atlantiste avec le plan Marshall [doc. 1], la « stratégie des petits pas » et la « priorité économique » à la Jean Monnet avec la création de la CECA [doc. 2], matrice de la future CEE [doc. 3], les compromis à mi-chemin du fédéralisme et de l’unionisme (institutions de la CEE sous contrôle des États – doc. 4). Le paradoxe est le dynamisme affiché [doc. 3], alors que le processus est lent [doc. 5].
Étude P 266-267
L’échec de la Communauté européenne de défense (CED)Les États-Unis veulent intégrer une armée allemande au bénéfice du bloc de l’Ouest. Pleven met en route la création d’inspiration fédéraliste de la CECA (en 1950), prémisse du marché commun, puis présente le projet de la CED en 1952 et d’une Communauté politique européenne (CPE) en 1953. Au Parlement français, la coalition des opposants enterre le projet supranational de CED (le « crime du 30 août 1954 »).
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La CED a pour but de créer une « armée européenne » et d’inté-grer une armée allemande reconstituée.
2. Ce sont deux projets fédéralistes qui prévoient le transfert de compétences et de droits régaliens (la défense) des États souverains aux instances européennes (commandement, uniformisation).
3. Les partisans sont les socialistes (divisés), les modérés et le MRP (démocrates-chrétiens). Quant aux adversaires, ce sont les commu-nistes, les gaullistes et une partie des socialistes (RGR et une moitié de la SFIO).
4. On lui fait principalement deux reproches : recréer une armée allemande alors que la France a été envahie trois fois en un siècle par l’Allemagne ; se mettre sous la tutelle américaine, donc aban-donner l’indépendance de la France
5. Cette division des partis se traduit par le vote contre ou le vote pour le débat pour la CED.
Mettre en relation deux documentsL’affiche progouvernementale symbolise la paix et l’union (avec le bouclier) contre les totalitarismes passés (nazisme) et présent (stalinisme). À l’inverse, l’affiche procommuniste représente le militarisme allemand (casque nazi, village détruit, ombre d’armée sur le casque) et le patriotisme du refus (bleu-blanc-rouge à la gloire résistante des communistes). Mais ces images ne montrent ni les divisions des Européens, ni l’atlantisme du contexte de guerre froide, ni tout choix procommuniste lié à la guerre froide.
Organiser et synthétiser les informations La France de 1954 s’oppose au projet d’une Europe supranationale en combinant plusieurs raisons : le rejet du fédéralisme européen (PCF et RPF), le soutien au bloc soviétique (PCF), le soutien à l’indé-pendance nationale contre l’atlantisme et contre l’abandon de compétences nationales et souveraines (gaullistes, quelques modé-rés de droite).
Cours 2 P 268-269
Le projet européen en chantier (1957-1989)Entre 1957 et 1989, la construction européenne s’élabore par à-coups : de Gaulle privilégie l’axe franco-allemand contre la supranationalité, mais entérine l’union douanière et la PAC ; en 1979, la CEE gagne un Parlement au suffrage universel et un système monétaire européen (SME) ; Delors invente l’Acte unique européen. Les documents explicitent ces avancées : le couple franco-allemand (traité de l’Elysée de 1963 – doc. 1) et les rodo-montades gaullistes [doc. 2] ; l’extension démocratique de 1979 (une affiche d’homme oiseau symbole du nouvel espoir européen entre utopie et enthousiasme – doc. 3) et l’élargissement au Sud européen (une Grèce pas à la hauteur – comme sa colonne –, car prête à tendre la sébile selon le doc. 4 ou encore l’Acte unique de 1986 où Delors choisit quelques axes supranationaux de consolidation [doc. 5].
EXERCICE P 271
Analyser un document statistiqueCe tableau statistique analyse le vote des Français au référendum sur l’adoption du traité de Maastricht en 1992. Le « oui » l’emporte de justesse. Ici, l’étude explore l’électorat par sexes, âges, caté-gories professionnelles et niveaux scolaires (diplômes). Les principales conclusions montrent les clivages entre européistes et eurosceptiques. Ainsi, les femmes sont plus européistes que les hommes ; les plus jeunes et les plus âgés le sont plus que les actifs ; les cadres supérieurs et les catégories intermédiaires plus que les
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
50 CHAPITRE 11 HISTOIRE - Term
agriculteurs (malgré ou à cause de la PAC) et les catégories moyennes et populaires ; les très diplômés sont très fortement favorables par rapport aux sans diplômes et aux diplômes de cursus courts. En résumé, les élites et les couches supérieures de la société ont voté pour, les couches moyennes et populaires ont voté contre.
Objectif BAC Méthode P 272-273
Étude critique de document / analyse de document
Analyser un discours
La naissance de l’Europe communautaire (1952)Le discours de Jean Monnet est intéressant à plus d’un titre. En raison de la personnalité de son auteur, bien sûr, considéré comme l’un des « pères fondateurs » de l’Europe, mais en raison aussi du public de journalistes auquel il s’adresse afin de convaincre l’opinion publique des États-Unis de l’intérêt de la construction de l’Europe communautaire. Pour convaincre son auditoire, il compare le projet européen aux États-Unis et cherche à montrer l’intérêt de l’Europe pour les États-Unis d’une part, pour la sécurité mondiale d’autre part.
« Pour une nouvelle souveraineté en Europe »Comme Margaret Thatcher un an avant lui [doc. 1 p. 286], c’est devant les étudiants du Collège de Bruges, qui prépare aux métiers de l’Europe, que Jacques Delors s’exprime pour présenter les enjeux de la souveraineté nationale dans une Europe en construction. Il montre ainsi que l’Europe a connu des avancées importantes, mais il lui reste à renforcer son unité pour accroître son poids sur la scène internationale. Le traité de Maastricht, que Jacques Delors est alors en train de préparer, apparaît comme une réponse aux attentes exprimées dans ce discours.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• ANGEL Benjamin et LAFITTE Jacques, L’Europe, petite histoire d’une grande idée, Gallimard, 2008.
• BRUNETEAU Bernard, Histoire de l’idée européenne à travers les textes (vol. 1 et 2), Armand Colin, 2008.
• KAHN Sylvain, Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945, PUF, 2011.
• OLIVI Bino et GIACONE Alessandro, L’Europe difficile. La construc-tion européenne, Gallimard, 2007.
• MATHIEU Jean-Louis, « Quelle Union pour l’Europe ? », in Documentation photographique, n° 8008, 1999.
• DU RÉAU Élisabeth (dir), L’Europe en construction. Le second xxe siècle, Hachette supérieur, 2007.
• DU RÉAU Élisabeth, L’Idée d’Europe au XXe siècle. Des mythes aux réalités, Complexe, 2008.
Sites Internet
• Études européennes : www.etudes-europeennes.eu
• Les études de la Documentation française : www.ladocumenta-tionfrancaise.fr
• Centre de recherche et de documentation sur l’Europe au Luxembourg : www.cvce.eu
• Portail de l’Union européenne : www.europa.eu
• Version du portail français Union européenne : www. touteleu-rope.fr
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 12 51
12 Une gouvernance européenne depuis le traité de MaastrichtCe chapitre étudie l’échelon de gouvernement régional que constitue l’Union européenne, depuis le traité de Maastricht qui l’institue. La construction européenne repose sur des logiques contradictoires et en même temps complémentaires, l’une supranationale / fédéraliste, l’autre intergouvernementale / unioniste. Les institutions de l’Union européenne mettent en œuvre un modèle politique original, au fonctionnement particulièrement complexe. La gouvernance européenne, une « gouvernance sans gouvernement », se heurte aux réticences de certains États et des opinions publiques, qui lui reprochent souvent son déficit démocratique.
• Le manuel met en œuvre une démarche à la fois chronologique et thématique : à l’Europe de Maastricht (Cours 1) succède une gouvernance profondément modifiée par l’unification économique de l’Europe et l’impact des crises (Cours 2). Les études permettent d’aborder des objets ciblés et délimités qui éclairent les débats autour de l’Europe : le traité de Maastricht, qui ouvre une nouvelle période dans l’histoire de l’Europe, la politique étrangère et de défense commune, qui permet de souligner l’incapacité de l’Europe à parler d’une seule voix sur la scène internationale, et les eurosceptiques, qui aborde la défiance des opinions publiques.
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
L’échelle continentale : une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht
p. 276-277 : GRAND ANGLE – La construction d’une Europe uniep. 278-279 : ÉTUDE – Le traité de Maastrichtp. 280-281 : COURS 1 – L’Europe de Maastrichtp. 282-283 : COURS 2 – Les mutations de la gouvernance européennep. 284-285 : ÉTUDE – La politique de sécurité et de défense communep. 286-287 : ÉTUDE – Les eurosceptiques p. 288-289 : ÉTUDE – L’espace Shengen
Les outils du manuel
p. 291 : EXERCICE Analyser une affiche : Les partisans du « oui » au référendum de ratification du traité de Maastricht (1992)
p. 290-291 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 292-295 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Rédiger les paragraphes du développement – La gouvernance européenne entre dimension politique et dimension économique depuis 1992Analyser une caricature – Le projet de constitution européenne (2005)
p. 296-297 : OBJECTIF BAC SUJETS Compositions : Le projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948) / La gouver-nance européenne depuis le traité de MaastrichtÉtude critique de document / analyse de document : Le scepticisme de l’opinion publique euro-péenne / L’élargissement de l’Europe
Ouverture du chapitre P 274-275
Une gouvernance européenne depuis le traité de MaastrichtCette double page met en parallèle la jeunesse et l’idéalisme de l’Europe en construction confrontée à l’élargissement, et l’hostilité référendaire de 2005 envers une Europe politique. À mesure que les contours de l’Union européenne (UE), créée par le traité de Maastricht, tendent à se confondre avec ceux du continent euro-péen, les opinions publiques européennes sont de plus en plus divisées.
Grand angle P 276-277
La construction d’une Europe unieL’élargissement de l’Union européenne après 1992 s’accomplit en direction des pays anciennement neutres ou placés sous la tutelle de l’Union soviétique dans le cadre de la guerre froide. La carte permet de souligner la rapidité des changements à l’échelle du continent européen, mais aussi certaines limites de la construction européenne : les pays de l’UE n’ont pas tous atteint le même degré d’intégration européenne (Euro, Schengen).
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
52 CHAPITRE 12 HISTOIRE - Term
Étude P 278-279
Le traité de MaastrichtL’étude consacrée au traité de Maastricht peut être mise en pers-pective en évoquant le parcours de son principal artisan, Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1994, à l’origine de la relance de la construction européenne qui se traduit en février 1986 par la signature de l’Acte unique européen. Ce dernier prévoit en effet d’achever la réalisation du marché unique d’ici le 1er janvier 1993. Il étend également les compétences du Parlement et de la Commission, tandis que le vote à la majorité qualifiée, au Conseil des ministres, réduit la souveraineté des États. Très pragmatique, reprenant la méthode dite « méthode Monnet » du passage par l’économique pour conduire au politique, Jacques Delors cherche à fédérer les Européens autour du projet d’une Europe plus intégrée, tout en tenant compte des États-nations. Constamment confronté aux réticences de Margaret Thatcher, Premier ministre britannique de 1979 à 1990, Jacques Delors a porté à bout de bras le traité de Maastricht.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les principales avancées du traité sont d’ordre politique (UE, citoyenneté européenne) et économique (UEM).
2. La ratification est d’emblée compliquée par le « Non » au référendum danois. Les docs 4 et 5 qui évoquent la campagne référendaire française de 1992 peuvent être utilement complétés par les deux affiches de la page 291.
3. L’opposition se manifeste tant sur le plan politique que dans les urnes. Elle peut être mise en perspective par les docs 3 et 5 de l’étude consacrée aux eurosceptiques, p. 286-287.
4. Les principaux arguments avancés par les opposants français au traité portent sur le spectre d’une Europe technocratique [doc. 4] et sur le risque pour la France de perdre sa souveraineté ou sa liberté [doc. 5].
Analyser des donnéesL’ordre des ratifications permet d’abord de souligner le fait que, à l’exception la France et du Danemark, qui vote une seconde fois en mai 1993, la voie référendaire est rapidement écartée par les pays-membres de la CEE. Ensuite, il est intéressant de relever que la Grande-Bretagne attend le résultat du second référendum danois pour se prononcer en faveur de la ratification.
Cours 1 P 280-281
L’Europe de MaastrichtAvec 1989, l’Union s’ouvre à l’Est et Jacques Delors concilie intégration économique et avancées politiques, États-nation et compétences fédéralistes. L’Union européenne est une puissance : un exécutif plus intergouvernemental, une diplomatie (PESC, Eurocorps), une union monétaire (BCE et Euro). Toutefois, les guerres balkaniques, les dissen-sions entre membres, la crise financière de 2008 accroissent le doute sur l’avenir. Les documents explicitent ces progrès et ces difficultés. L’élargissement de l’Europe débute en 1995 par l’adhésion des anciens pays neutres de la guerre froide – doc. 1). La nouvelle Europe pose alors la démocratie représentative et le marché libéral comme conditions à l’adhésion des pays issus du Bloc soviétique [doc. 2]. La mise en œuvre
de l’Union économique et monétaire (UEM) repose sur les critères contraignants de Maastricht, au cœur des préoccupations des gouver-nements des pays membres [doc. 3]. La mise en circulation des pièces et des billets en euro marque l’apogée de la dynamique initiée à Maastricht [doc. 4]. L’arc de triomphe que les Bruxellois appellent les Arcades du cinquantenaire, de par son inspiration antique, fait écho au graphisme des billets de banque européens, qui présentent des motifs architecturaux.
Cours 2 P 282-283
Les mutations de la gouvernance européenneCe cours met en évidence les principaux moments de crise de l’Union européenne depuis 2001, qui révèlent les limites institutionnelles de cette construction politique et économique. En effet, après la mise en œuvre de l’Euro, les difficultés s’accumulent : les opinions manifestent leur scepticisme envers une Europe fonctionnaliste et d’inspiration néolibérale [doc. 1] ; la crise de l’Euro, en 2009, révèle que l’UE n’est pas une zone monétaire optimale [doc. 2] ; l’euroscepticisme d’État britannique retrouve de la vigueur avec les analyses unionistes de Tony Blair [doc. 3]. Le compromis institutionnel du traité d’Amsterdam, après l’échec du projet de traité établissant une constitution pour l’Europe, repose plus que jamais sur une « gouvernance sans gouvernement » [doc. 4].
Étude P 284-285
La politique de sécurité et de défense communeL’incapacité de l’Europe à parler d’une seule voix sur la scène internationale a caractérisé tant la guerre d’Ex-Yougoslavie, la guerre du Kosovo, ou la crise irakienne en 2003 et la guerre de Libye en 2011. Cette situation est d’autant plus paradoxale que, depuis 1992, l’Europe s’est efforcée de construire une politique commune en matière de politique extérieure et de défense.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) a pour objectif de mettre en œuvre une coopération approfondie, à l’échelle européenne dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité [doc. 2]. Dans le contexte des débats qui entourent le traité de Maastricht, elle apparaît comme une réponse à l’impuissance de l’Europe face à la guerre en ex-Yougoslavie [doc. 1].
2. La PESC se concrétise par l’Eurocorps, une initiative franco-allemande à laquelle se joignent la Belgique, l’Espagne, puis le Luxembourg, mais aussi par des opérations militaires des forces opérationnelles de l’Union européenne : l’Eufor Althea en Bosnie-Herzégovine [doc. 3], l’Eufor RD au Congo en 2006 et l’Eufor RCA au Tchad en 2007. Au total, une vingtaine d’opérations ont été menées dans le cadre de la PESC.
3. Les limites de l’action de l’Union européenne en matière de politique étrangère et de défense sont nombreuses, mais la principale est la faiblesse du sentiment d’appartenance des Européens à un ensemble politique commun. Comme la CED en 1954, la politique de sécurité et de défense commune se heurte à l’absence de gouvernement fédéral de l’Europe et plus encore à la division des pays-membres de l’Union [doc. 5].
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 12 53
Analyser une carteLe document révèle que seuls des pays anciennement intégrés à l’Union européenne et à l’OTAN se sont opposés à l’intervention, tandis que la totalité des pays issus du Bloc de l’Est se sont pronon-cés en faveur de l’action menée par les États-Unis. Ce clivage tient précisément au rapport que les anciens pays de l’Est entretiennent avec les États-Unis et avec l’OTAN. La carte révèle à quel point certains pays de l’Est et du centre de l’Europe se sont rapprochés des États-Unis en matière de politique étrangère, au détriment d’une logique favorable à une diplomatie européenne unifiée.
Étude P 286-287
Les eurosceptiquesLe développement d’un courant eurosceptique est l’un des faits les plus marquants de la période au programme. Les euroscep-tiques hostiles à l’intégration européenne invoquent les particula-rismes nationaux, la souveraineté absolue des États et le manque de légitimité démocratique des principales instances de décision. Ils rassemblent plusieurs familles de pensées : les hostiles au fédé-ralisme ou à la supranationalité et les opposants à l’existence de l’Union (anti-européens).
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Pour l’opinion, l’Union est un super-État [doc. 6] non démocratique [doc. 5] qui s’immisce dans la vie des citoyens par des règlements tatillons [doc. 5], libéralise au lieu de protéger [doc. 5] et nie les nations [doc. 1, 5]. Le « non aux référendums néerlandais et français de 2005 réjouit les Britanniques [doc. 4].
2. L’euroscepticisme se manifeste sous quatre formes :– un euroscepticisme d’État, incarné sur la longue durée par la Grande-Bretagne [doc. 1] ;– l’abstention croissante aux élections [doc. 2] et dans les sondages [doc. 3] ;– la présence des partis souverainistes ou régionalistes (Europe des nations) au Parlement ;– la représentation par des chefs de file « patriotes de gauche [doc. 5] ou souverainistes de droite [doc. 6].
3. Les points de vue sont multiples : nationalistes soucieux de la souveraineté des États-nations (les Britanniques, Philippe de Villiers) et hostiles au fédéralisme niveleur, souverainistes de gauche dénon-çant le déficit démocratique de l’Europe.
4. Les pays les plus concernés par l’euroscepticisme sont le Royaume-Uni et la France. Le discours de Margaret Thatcher repose sur un paradoxe : celui de l’affirmation européenne d’un Royaume-Uni préoccupé par la défense de ses intérêts nationaux.
Confronter deux documentsLe doc. 2 présente la proportion des Européens qui ont une image assez négative ou très négative de l’Union européenne. La corrélation avec la crise de l’Euro est nette en Grèce, moins au Portugal et en Espagne. Il est intéressant de noter que l’opinion publique britannique ne semble pas en phase avec son gouvernement ni en cohérence avec les résultats électoraux, tant européens que locaux.Le doc. 3 montre l’accroissement de l’abstention aux élections depuis 1979. Depuis l’élargissement à l’Est, le taux dépasse 50 %. Des élus du
Parlement représentent des mouvements eurosceptiques. Le refus de cette Europe est donc élevé.
Étude P 288-289
L’espace SchengenPlus de 30 ans après la signature des accords de Schengen, l’espace de libre-circulation qu’ils ont permis de mettre en place connaît la plus grave crise de son histoire au point que son existence même paraît remise en cause. Cette étude offre donc l’intérêt de retracer l’histoire de l’espace Schengen en présentant ses avancées et ses limites, de sorte de mettre la crise migratoire actuelle en perspective.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations
1. Les accords de Schengen ont pour but de supprimer graduel-lement les contrôles aux frontières communes des pays signa-taires. Ces accords ont eu peu de répercussion en 1985 : rares étaient les observateurs qui ont mesuré l’importance de ces accords, signés au demeurant non par des chefs d’État ou de gouvernement ou même des ministres mais par des secrétaires d’État.
2. La première étape, après la signature des accords en 1985 [doc. 1], est la signature en 1990 de la convention d’application [doc. 2], qui prévoit l’entrée en vigueur de l’espace Schengen en 1993. La deu-xième étape est l’entrée en vigueur effective de l’Espace Schengen, partiellement et avec deux ans de retard [doc. 3]. La troisième étape est l’élargissement de l’espace Schengen [doc. 4, 5].
3. La première difficulté est l’opposition d’une partie des opinions publiques à la mise en œuvre des accords. Le débat se cristallise ainsi autour de la question des postes frontière et des douaniers [doc. 2] et plus largement des risques que l’espace Schengen fait courir en matière de sécurité, en particulier en période d’attentats terroristes [doc. 3]. La principale difficulté que rencontrent les accords est l’élargissement de l’espace, qui allonge considérablement les frontières extérieures et rend plus délicate leur contrôle [doc. 5]. Enfin, la crise migratoire consécutive à la guerre civile de Syrie et d’Irak révèle les failles de l’espace Schengen et menace sa survie [doc. 5, 6].
Analyser une carteLe doc. 5 présente la situation de l’espace Schengen en mars 2016 en mettant l’accent sur la crise migratoire consécutive à la guerre en Syrie et en Irak (les autres flux migratoires, de moindre importance numérique, ne sont pas figurés sur la carte). En un an, en 2015, près d’un millions de personnes sont entrées dans l’espace Schengen, dont au moins 350 000 illégalement. La carte permet également de mesurer l’impact de la crise migratoire sur les États membres de l’espace Schengen, puisque beaucoup rétablissent temporairement des contrôles aux frontières et certains érigent des clôtures pour barrer la route aux migrants.
EXERCICE P 291
Analyser une affiche1. L’affiche du MRG repose sur la promesse d’un avenir meilleur pour la jeunesse européenne et le pari que les enfants de 1992 seront reconnaissants à leurs parents d’avoir voté pour le référendum de Maastricht. Les enfants sur l’affiche ont l’âge d’être électeurs en
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
54 CHAPITRE 12 HISTOIRE - Term
2005, de sorte que le résultat du référendum sur le traité établissant une constitution pour l’Europe peut être interprété comme un démenti de cet argument.
2. L’affiche du parti socialiste repose sur un argumentaire qui accorde une grande place à la puissance. La présence du Japon évoque, à l’époque, la puissance économique davantage que politique. La perspective de l’Union économique et monétaire est en effet cen-trale dans les débats de 1992.
Objectif BAC Méthode P 292-293
Composition
Rédiger les paragraphes du développement
La gouvernance européenne, entre dimension politique et dimension économique depuis 1992La « méthode Monnet » qui a prévalu après l’échec de la Commu-nauté européenne de défense en 1954 retrouve toute sa vigueur dans les années 1980 à l’initiative de Jacques Delors, qui fait pré-valoir des objectifs économiques dans le but d’encourager dans un second temps une intégration politique. La nature essentiellement politique ou économique de la construction européenne est au centre des débats européens des années 1990 et 2000.
1. La gouvernance européenne est plus avancée sur le plan écono-mique que sur le plan politique.
2. Toutefois, la crise de la zone euro a conduit à un approfondisse-ment de nature fédéraliste.
Les acteurs de la gouvernance européenne1. La gouvernance européenne repose d’abord sur un équilibre institutionnel précaire entre les intérêts des nations et les organes communautaires.
2. Les moments de crise de la gouvernance européenne ont révélé le déficit démocratique aussi bien que, plus largement le poids des acteurs non institutionnels.
Élargissement et approfondissement de l’Europe1. La perspective d’un élargissement de l’Union européenne en direction des pays de l’ancien bloc de l’Est a conduit à une vaste réflexion sur la réforme des organes de gouvernance
2. L’approfondissement européen repose sur les politiques com-munes et une série d’avancées économiques, mais est limité par la difficulté croissante à obtenir l’unanimité des pays membres sur des réformes importantes.
Objectif BAC Méthode P 294-295
Étude critique de document / analyse de document
Analyser une caricature
Le projet de Constitution européenne (2005)Signé à Rome le 29 octobre 2004, le traité élaboré par la Convention pour l’avenir de l’Europe présidée par Valéry Giscard d’Estaing est soumis à référendum en France en 2005. Comportant 4 parties et 448 articles, il apparaît aux yeux de ses détracteurs comme l’expres-sion la plus aboutie de l’Europe technocratique. C’est paradoxal, dans la mesure où ce traité à valeur constitutionnelle prétendait
synthétiser la plupart des textes existants. La caricature présente une vision critique de la Constitution, en même temps qu’une allusion aux divisions des Européens par la mention de questions clivantes (candidature de la Turquie, revendications régionalistes).
L’Europe élargie (1957-2010)Ce dessin de presse humoristique publié trois ans après le plus important élargissement de l’histoire de l’Union européenne oppose l’Europe des six à l’Europe des 27. Alors que l’Europe des six est présentée comme unie, parlant la même langue et désirant la même chose, l’Europe des 27 est présentée comme profondément hété-rogène : personne, autour de la table, ne parle la même langue et ne semble vouloir la même chose. Ce dessin met ainsi en évidence les difficultés posées par l’élargissement aux institutions euro-péennes ; toutefois, il passe sous silence les dissensions importantes que pouvaient connaître les six, comme l’illustre la « politique de la chaise vide » du général de Gaulle, et accentue à dessein les dissensions au sein de l’Union européenne, puisque les pays membres de l’Union européenne ont su s’entendre depuis 2007 sur certaines réformes d’envergure (TSCG, Semestre européen, Union bancaire).
Objectif BAC Sujets P 296
CompositionLe projet d’une Europe politique depuis le congrès de La Haye (1948)1948 est l’année du congrès de La Haye, placé sous les auspices du Mouvement fédéraliste européen et à l’origine d’un projet d’État européen de type fédéral. Ce projet ne s’est pas concrétisé.
1. Du Congrès de La Haye au compromis de Luxembourg (1966) : succès économique, impasses politiques.
2. L’élargissement des Communautés renforce la puissance écono-mique, mais au détriment de l’intégration politique (1966-1986).3. Depuis l’Acte unique et le traité sur l’Union européenne (1992), le renforcement de l’Europe politique se heurte aux résistances nationalistes.
Étude critique de documentLe scepticisme de l’opinion publique européenneL’image présente des allégories simplistes des « peuples français et néerlandais », qui ont désavoué leurs dirigeants en refusant de ratifier la Constitution européenne en 2005. Il s’agit donc d’une illustration du reproche d’une Europe trop bureaucratique et élitiste, dans laquelle les électeurs ne sont pas consultés. Toutefois, lorsque les électeurs sont consultés, ils ne se déplacent pas : l’abstention aux élections européennes est toujours et partout très élevée. On peut évoquer la controverse du « plombier polonais » qui a marqué la campagne en France et souligner que les principales formations politiques avaient opté pour le « oui ».
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 12 55
Objectif BAC Sujets P 297
CompositionLa gouvernance européenne depuis le traité de MaastrichtCe sujet permet d’étudier les avancées et les limites du processus de construction européenne depuis 1992 sous l’angle des institutions et de la gouvernance.
1. Le traité de Maastricht constitue un tournant essentiel dans la gouvernance européenne, car il entraîne une série d’avancées majeures.
2. La gouvernance européenne demeure profondément complexe et se heurte à des difficultés croissantes dans les années 2000.
Analyse de documentL’élargissement de l’Europe1. Le dessin de Tom Toles souligne les profondes mutations engen-drées en Europe par la fin de la guerre froide : tandis que l’effon-drement de l’URSS a conduit à un éclatement de son ancien empire multinational – à relativiser, car la Communauté des États indépen-dants (CEI) est créée quelques jours à peine après la publication de ce dessin, la perspective de l’élargissement de l’Europe – lointaine en 1991 – est présentée comme tendant à faire coïncider les fron-tières de l’Union européenne avec celles du continent européen. Il est intéressant de comparer ce dessin avec la carte de la construc-tion européenne (p. 261) pour le mettre en perspective de façon critique.
2. Lorsque Joschka Fischer prononce son discours à l’université Humboldt, Berlin, l’Union européenne s’apprête à accueillir de nouveaux membres et la réflexion sur la réforme de ses institutions est alors d’actualité. La préconisation de la voie fédérale par le ministre allemand des Affaires étrangères – qui s’exprime à titre personnel – s’accommode d’un respect du rôle des États-nations. Ce discours évoque la perspective du traité constitutionnel, dont la préparation est confiée en 2002 à la Convention pour l’avenir de l’Europe présidée par Valéry Giscard d’Estaing.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Angel Benjamin et Lafitte Jacques, L’Europe, petite histoire d’une grande idée, Gallimard, 2008.
• Bruneteau Bernard, Histoire de l’idée européenne à travers les textes (vol. 1 et 2), Armand Colin, 2008.
• Drevet Jean-François, « Une Europe en crise ? », in Documenta-tion photographique n° 8052, 2006.
• Drevet Jean-François, La Nouvelle Identité de l’Europe, PUF, 1997.
• Kahn Sylvain, Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945, PUF, 2011.
• Olivi Bino et Giacone Alessandro, L’Europe difficile – La construction européenne, Gallimard, 2007.
• Mathieu Jean-Louis, « Quelle Union pour l’Europe ? », in Documentation photographique, n° 8008, 1999.
• Du Réau Élisabeth (dir), L’Europe en construction – Le second xxe siècle, Hachette supérieur, 2007.
• Du Réau Élisabeth, L’Idée d’Europe au xxe siècle – Des mythes aux réalités, Complexe, 2008.
• Schmidt Vivien, La démocratie en Europe, La Découverte, 2010.
Sites Internet
• Études européennes : www.etudes-europeennes. eu
• Les études de la Documentation française : www.ladocumenta-tionfrancaise.fr
• Centre de recherche et de documentation sur l’Europe au Luxembourg : www.cvce.eu
• Portail de l’Union européenne : www.europa.eu
• Version du portail français de l’Union européenne: www.touteleurope.fr
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
56 CHAPITRE 13 HISTOIRE - Term
13 La gouvernance économique mondiale de 1944 à 1975Ce chapitre permet de comprendre la mise en place à partir de 1944 d’un nouvel échelon de gouvernement de type mondial destiné à assurer la paix, la stabilité financière, la prospérité économique et le progrès social, sous la houlette des États-Unis. Les différentes institutions créées (ONU, FMI, Banque mondiale) reposent sur un fonctionnement interétatique qui fait le jeu des plus puissants ou conforte l’hégémonie américaine sur le bloc occidental. Avec la nouvelle phase de mondialisation des années 1970, le besoin d’une coopération mondiale donne naissance à un nouveau type de gouvernance. Certes, il vise à créer des normes internationales, mais il remet aussi en cause le poids des États-nations au bénéfice d’une multitude d’acteurs non étatiques et d’une logique de néolibéralisme à tout crin et au risque d’accroître les inégalités, de bousculer les hiérarchies de puissance et d’engendrer de fortes contestations.
• Le manuel répond sur les deux temps forts de cette évolution entre 1944 et 1975. La conférence de Bretton Woods, en 1944, est l’acte de naissance de cette nouvelle gouvernance dont le système monétaire constitue le cœur jusqu’en 1971. Trois institutions (FMI, BIRD ou Banque mondiale, GATT puis OMC) encadrent le marché selon un principe de capitalisme régulé. Les États-Unis, second pilier, institutionnalisent leur domination (Cours 1).
• Remise en question par la fin du dollar-étalon, les pressions du tiers-monde et la fin du bloc de l’Est, la gouvernance change de modèle à partir des années 1975 .
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
L'échelle mondiale : La gouvernance économique mondiale depuis 1944
p. 300-301 : ÉTUDE – La conférence de Bretton Woodsp. 302-303 : COURS 1 – Le système économique mondial (1944-1975)p. 304-305 : ÉTUDE – Le Gold exchange standard
Les outils du manuel
p. 307 : EXERCICES Analyser un texte : Le sommet de Rambouillet
p. 306-307 : L'ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 308-309: OBJECTIF BAC MÉTHODE Analyser un graphique : Les chocs pétroliers
Ouverture du chapitre P 298-299
C’est la prise de conscience d’un échelon mondial de gouvernement. Sous la houlette des États-Unis, nait l’institution interétatique de l’OECE [doc. 1]. L’échec du système multilatéral de Bretton Woods conduit les grandes puissances à privilégier une coopération inte-rétatique au sein du club très fermé du G6 [doc. 2].
Étude P 300-301
La conférence de Bretton WoodsLes délégués des 44 signataires de la déclaration de San Francisco créent un système monétaire international qui régule le capitalisme et assure la prospérité du monde libéral. Le FMI contrôle, la BIRD – puis Banque mondiale – finance, et l’Organisation internationale du commerce (OIC) régit les échanges. Récusé par le Sénat améri-cain, l’OIC est remplacé par un accord tarifaire (GATT). Les États-Unis imposent la suprématie du dollar. L’URSS observe.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les Anglo-Saxons ont le rôle principal (Keynes, Morgenthau), et les Américains imposent leurs vues.
2. Ce sont les objectifs libéraux des Américains : le dollar [doc. 2, 5] et la liberté des échanges (baisse des droits de douane [doc. 1]) comme pivots du système.
3. C’est le nouveau Gold Exchange Standard et le libre-échange comme règles cardinales.
4. Les États-Unis, seul État ayant tous les atouts, imposent leur suprématie et l’URSS passe d’observateur à opposant en constituant le bloc de l’Est.
Analyser un témoignageProblématique de l’étude : L’auteur est membre de la délégation française aux côtés de Pierre Mendès France, commissaire aux finances du GPRF [doc. 2]. Il critique les Américains dans « Le Système monétaire de Bretton Woods et les grands problèmes de l’après-guerre ».
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 13 57
Il dénonce des pseudo-négociations sous pression, alors que la guerre n’est pas terminée ni la France libérée. À l’entendre, les grandes puissances, Royaume-Uni compris, doivent entériner les projets américains. Il représente le courant gaulliste soucieux d’indépendance et de souveraineté nationale.
Cours 1 P 302-303
Vers une échelle mondiale de gouvernementCoopérative et multilatérale, la gouvernance mondiale est de fait dominée par les Américains : le système monétaire international institue le dollar étalon, le GATT promeut la levée des barrières douanières, le nouvel ordre économique s’affiche libéral et occiden-tal face à l’URSS et au nouveau bloc de l’Est. La reconstruction favorise l’économie américaine. Mais le système connaît des limites : déficit commercial américain, pays émancipés des tutelles coloniale et américaine, surabondance de dollars (pétrodollars, eurodollars).Les documents expriment ce double aspect. D’un côté : rôle clé du plan Marshall [doc. 1], « stratégie » libre-échangiste du GATT [doc. 2] au fil des cycles de négociations [doc. 4], prépotence du dollar en réserve et en référence [doc. 3]. De l’autre : déséquilibres nés de la surabondance de dollars [doc. 3], volonté des pays sous-développés de construire un ordre plus égalitaire [doc. 5].
Étude P 304-305
Le Gold exchange standardCette étude peut être menée en amont comme en aval du cours. Elle permet en effet d’aborder les enjeux principaux du chapitre à travers cette question cruciale qui résume à elle-seule une bonne partie du système monétaire international à l’époque des « Trente Glorieuses ».
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. La suprématie américaine se mesure non seulement au stock d’or en possession des États-Unis [doc. 1, 4] mais également à l’emplacement du siège des grandes conférences (Bretton Woods) et des principales institutions du Système monétaire international. Le texte du général de Gaulle [doc. 1] éclaire les mécanismes de la suprématie monétaire américaine. Il peut être mis en regard du témoignage de Robert Mossé [doc. 3 p. 301].2. Le général de Gaulle critique le déséquilibre du système monétaire international au profit des États-Unis, qui disposent de « facilités » financières au détriment de l’équilibre global du système.
3. L’affaiblissement du stock d’or s’explique par l’essor des Eurodollars et, plus largement, par les fortes dépenses engendrées par la course aux armements et par la guerre du Vietnam.
4. La décision du président Nixon, qui intervient en plein milieu de l’été pour en limiter les effets néfastes, est motivée par la santé éco-nomique retrouvée de l’Europe. Il présente la convertibilité du dollar en or comme un désavantage pour les États-Unis.
Analyser un graphiqueLe doc. 4 présente l’évolution du stock d’or américain et de la part du stock d’or américain dans les réserves mondiales. Il montre la baisse spectaculaire, tant en volume qu’en proportion, entre la fin des années 1950, lorsque les monnaies européennes rejoignent le Gold exchange
standard, et la fin des années 1960. Il montre aussi que la fin de la convertibilité du dollar en or a eu pour effet de stabiliser la part du stock d’or américain dans les réserves mondiales.
EXERCICE P 307
Analyser un texteLe sommet de Rambouillet (1975)L’acte final du G6, signé par les chefs d’État et de gouvernement des pays qui le composent, est en quelque sorte l’acte fondateur du G6 qui devient l’année suivante le G7. Le texte justifie en effet la mise en place d’une « diplomatie de club » par les responsabilités que les pays les plus riches estiment avoir à l’égard des autres pays du monde. En dépit de la dernière phrase, qui fait référence aux grandes institutions multilatérales issues des accords de Bretton Woods, ce texte sanc-tionne une approche intergouvernementale de la gouvernance éco-nomique mondiale.
Objectif BAC Méthode P 308-309
Étude de document / analyse critique de document
Analyser un graphique
Les chocs pétroliersLe graphique présente l’évolution du prix du baril de pétrole brut en dollars constants 2014 et en dollars courants. Il permet de mesurer la brutalité, en dollars constants, du choc de 1973 et de celui de 1979 et de comparer celui consécutif à la crise de 2008. En revanche, comme les données s’arrêtent en 2014, le graphique ne fait qu’esquisser la baisse non moins brutale des cours du pétrole depuis 2013, liée à l’impact du ralentissement de l’activité en Chine, à la hausse de la production initiée par l’Arabie Saoudite et à l’entrée sur le marché de grandes quantités de pétrole issu de l’exploitation des sables bitumeux.
Les pays en développementCe graphe permet d’étudier l’évolution du montant de l’aide publique au développement versée par les pays de l’OCDE et la part de cette aide dans leur Revenu national brut. Il montre très clairement que l’augmentation régulière du montant total de l’aide au développe-ment masque en réalité une baisse assez régulière de la part de l’aide au développement dans le revenu national brut des pays de l’OCDE. En d’autres termes, l’aide au développement progresse moins vite que l’économie des pays de l’OCDE.
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Bastidon Cécile, Brasseul Jacques, Gilles Philippe, Histoire de la globalisation financière, Armand Colin, 2010, La Découverte, 2011.
• Graz Jean-Christophe, La gouvernance de la mondialisation, La Découverte, 2008 La Découverte, 2011
• Moreau Defarges Philippe, La gouvernance mondiale, PUF, QSJ, 2008
• Rainelli Michel, L’Organisation mondiale du Commerce, La Découverte, 2011.
Sites Internet
• Questions internationales : www.ladocumentationfrancaise.fr
• Fonds monétaire International : www.imf.org
• Organisation mondiale du Commerce : www.wto.org/ indexfr.htm
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
58 CHAPITRE 14 HISTOIRE - Term
14 Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975Ce chapitre permet de comprendre comment la gouvernance économique mondiale a progressé depuis 1975 et d’étudier dans quelle mesure ce nouvel échelon de gouvernement a contribué ou non à la stabilité financière, à la prospérité économique et au progrès social. Avec la nouvelle phase de mondialisation des années 1970, le besoin d’une coopération mondiale donne naissance à un nouveau type de gouvernance. Certes, il vise à créer des normes internationales, mais il remet aussi en cause le poids des États-nations au bénéfice d’une multitude d’acteurs non étatiques et d’une logique de néolibéralisme à tout crin et au risque d’accroître les inégalités, de bousculer les hiérarchies de puissance et d’engendrer de fortes contestations.
• Le manuel permet de combiner deux approches pour mettre en œuvre la question. Les deux cours permettent d’envisager la question de façon diachronique, en décrivant depuis 1975 les principales étapes de la mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance, et d’analyser les limites des modes de régulation mis en place. Remise en question par la fin du dollar-étalon, les pressions du tiers-monde et la fin du bloc de l’Est, la gouvernance change de modèle et promeut les capacités autorégulatrices du marché, la libéralisation des forces économiques, la déréglementation publique. Malgré les crises, les acteurs non étatiques (firmes multinationales, ONG, experts, lobbies) ont de plus en plus de place et les États recourent de plus en plus aux coordinations régionales et aux rencontres multilatérales mondiales (G6, G8, G20). Les études permettent quant à elles de s’intéresser de manière vivante et approfondie aux principales organisations qui concourent à la gouvernance économique mondiale (OMC, FMI), ainsi qu’à la crise de 2008 et à ses conséquences.
Thème 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
Le programme officiel Le sommaire du chapitre
L’échelle mondiale : une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975
p. 312-313 : GRAND ANGLE – Une gouvernance économique mondialiséep. 314-315 : COURS 1 – Vers une échelle mondiale de gouvernementp. 316-317 : COURS 2 – Gouverner la mondialisationp. 318-319 : ÉTUDE – Le Fonds monétaire international (FMI)p. 320-321 : ÉTUDE – L’OMC et la régulation du commerce mondialp. 322-323 : ÉTUDE – La crise financière mondiale
Les outils du manuel
p. 324-325 : HISTOIRE DES ARTS Arturo Di Modica, Le Taureau de Wall Street
p 327 : EXERCICE Analyser des couvertures de magazines : Les acteurs de la gouvernance économique dans l’opinion
p. 326-327 : L’ESSENTIEL Fiche de synthèse, événements clés, Ne pas confondre, Personnages clés, Schéma de synthèse
p. 328-331 : OBJECTIF BAC MÉTHODE Rédiger la conclusion : Les mutations de la gouvernance économique mondiale depuis 1975Analyser des données statistiques : Le commerce mondial de marchandises (1948-2012)
p. 332-333: OBJECTIF BAC SUJETS Compositions : La gouvernance économique mondiale depuis 1944 / La gouvernance économique mondiale depuis 1975Étude critique / analyse de document : Forces et faiblesses de la gouvernance économique mon-diale / Le G20, nouveau directoire mondial
Ouverture du chapitre P 310-311
Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975Ces deux images permettent de mesurer certaines mutations de l’éche-lon mondial de gouvernement économique. Le sommet du G6 consacre l’avènement d’une « diplomatie de club » : si le rôle économique des
États-Unis est moindre que du temps du système de Bretton-Woods, la gouvernance économique mondiale est avant tout le fait d’un petit nombre de puissances économiques [doc. 1]. La crise économique aboutit à un élargissement aux pays émergents de cette diplomatie de club, sans que la gouvernance devienne pour autant démocratique [doc. 2].
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 14 59
Grand angle P 312-313
Une gouvernance économique mondialiséeLa carte montre :– la suprématie des pays développés : institutions à Washington, poids de Wall Street et des firmes multinationales, mondialisation du modèle libéral ;– la nouvelle donne actuelle : organisations régionales (Alena, UE), OMC (Genève), sommets (G8, G20), nouveaux acteurs (agences de notation, forum de Davos) ;– la montée en puissance des contestations et contre-pouvoirs : pays émergents (BRICS), altermondialistes (Porto Alegre, Seattle).
Cours 1 P 314-315
Vers une échelle mondiale de gouvernementCoopérative et multilatérale, la gouvernance mondiale longtemps restée dominée par les Américains : le système monétaire international de Bretton Woods institue le dollar étalon [doc. 1], le GATT promeut la levée des barrières douanières, le nouvel ordre économique s’affiche libéral et occidental face à l’URSS et au nouveau bloc de l’Est. La crise économique et la fin de la convertibilité du dollar mettent fin à cette organisation économique, également contestée par les pays émancipés des tutelles coloniales – désireux de voir mis en place un ordre inter-national plus égalitaire [doc. 2]. La « diplomatie de club » qui se met en place fait une place importante aux grandes puissances économiques dans un cadre désormais multilatéral et intergouvernemental [doc 3], au détriment des grandes organisations internationales. Les années 1980 sont marquées par l’affirmation du rôle des organisations non-gouvernementales [doc. 4], et du poids des politiques d’inspiration néo-libérales : Jacques Rueff critique avec force les politiques keyné-siennes et son discours est bien accueilli par une nouvelle génération [doc. 5].
Cours 2 P 316-317
Gouverner la mondialisationÀ partir de 1971, la faillite du système de Bretton Woods impose une nouvelle gouvernance : le néolibéralisme, donc le marché autorégula-teur. Cela se traduit par les plans d’ajustements structurels avec les pays du tiers-monde (FMI), l’extension des règles de libre-échange (OMC), les aides à la transition libérale-démocratique des ex-pays de l’Est (Banque mondiale, FMI). Interviennent aussi des acteurs privés : fonds souverains, agences de notation, firmes transnationales. Avec les crises financières, les États riches reprennent en main la gouvernance (sommets) et les pays émergents ou les opinions publiques contestent (altermondialistes). Les documents montrent les ambitions et les limites de la politique entreprise par l’ONU [doc. 1], la mise en scène par les dirigeants des pays émergents de leur proximité, alors que tout les oppose souvent [doc. 2] le poids des firmes transnationales et, parmi elles, des sociétés énergétiques [doc. 4], et la proposition de l’ancien conseiller de François Mitterrand, Jacques Attali, de concentrer tous les pouvoirs de surveillance économique entre les mains du FMI [doc. 5].
Étude P 318-319
Le Fonds monétaire international (FMI)Créé en 1944, le FMI stabilise les monnaies et développe les échanges. États-Unis et Européens dominants imposent les règles libérales du marché. Aussi est-il critiqué par le tiers-monde, les états en transition postcommuniste et, aujourd’hui, les Européens en crise de dette souveraine. Les opinions s’indignent d’une austérité qui rassure banques et bourses, mais n’assainit pas les économies et aggrave les inégalités. Le FMI, en effet, est passé de la coopération internationale pour aider les pays endettés à l’ingérence au bénéfice des plus puissants (quotes-parts et droits) en étendant le « moins d’État et le « plus de libre-échange ». Les règles initiales de développement (emploi, revenu, ressources) ont été oubliées au bénéfice de la règle du marché autorégulateur.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Les principes sont la stabilité des changes, l’aide aux pays endet-tés, le développement des échanges et du marché.
2. Les dominants sont les pays riches : États-Unis, pays européens et Japon, avec deux tiers des administrateurs et des droits liés à leur puissance (quotes-parts et droits de tirages spéciaux).
3. Les critiques reposent sur le déni de souveraineté et le renfor-cement des inégalités.
4. Les pays émergents sont davantage représentés (en droits de tirages spéciaux, en administrateurs).
Mettre en relation deux documentsLa photographie [doc. 4] citée par le texte [doc. 5] montre le directeur général du FMI dominant le président indonésien, donc une scène néo-colonialiste. Ce plan d’ajustement structurel prévoit une austérité bud-gétaire drastique. Le traitement est unilatéral et imposé, et les décisions ne sont ni efficaces ni équitables et peuvent devenir dramatiques.
Étude P 320-321
L’OMC et la régulation du commerce mondialEn passant du GATT (accords tarifaires négociés entre pays déve-loppés) à l’OMC, la conférence de Marrakech crée une institution qui étend le libre-échange à tous les secteurs, production comme services, et assure la police des conflits commerciaux. L’OMC a augmenté le nombre de ses membres, fait reculer les droits de douane et accru fortement les échanges (sauf crise). Les principales nouveautés accompagnant la création de l’OMC sont la sanction des litiges commerciaux de concurrence et la promotion du libre-échange et du marché autorégulateur. Mais il est contesté par les altermon-dialistes et par ses membres les plus influents, riches ou émergents.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. et 2. Les missions : développement des États les moins avancés par les échanges [doc. 1] ; baisse des tarifs douaniers par négociations multilatérales ; police des conflits commerciaux [doc. 3]. Libre-échange et libre-concurrence sont les références et toute atteinte [doc. 3] est poursuivie par le « gendarme du commerce mondial ».
3. L’opposition est interne (entre pays qui aident leurs industries) et externe (mouvements altermondialistes).
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
60 CHAPITRE 14 HISTOIRE - Term
4. Seattle est un tournant : conférence interrompue, contre-sommet altermondialiste médiatisée, image négative de l’OMC au service d’un club fermé de pays riches.
Analyser un texteL’historien Emmanuel Allait dresse un bilan de l’OMC :– le nombre d’adhérents en fait une institution universelle ;– les divergences d’intérêt et les conflits sont forts (Nord / Sud, États-Unis / UE) ;– les manifestations externes (Seattle, altermondialistes) ont créé un mythe.Mais c’est plutôt le néolibéralisme qui est remis en question par les pays émergents.
Étude P 322-323
La crise financière mondialeDepuis 2008, le monde traverse une crise globale et systémique quasiment planétaire, qui concerne toute l’économie : banques, bourses, dettes (privées ou publiques). Elle a montré la fragilité d’une gouvernance économique qui a reposé depuis les années 1980 sur les principes néo-libéraux (moins d’État, plus de marché autorégulateur, coopération des états et des acteurs non étatiques), conduisant à une réforme relativement profonde de la gouvernance au bénéfice des pays émergents.
Questions BAC
Prélever et confronter les informations1. Étapes de crise systémique : des « subprimes » [doc. 1], bancaire [doc. 1, 2], de surendettement public pour sauver les banques privées [doc. 1, 3], politique (pour l’UE : aider ou non la Grèce), sociale (austérité et paupé-risation).2. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, la crise touche les « péri-phéries européennes », remet en cause la zone euro, se transmet aux partenaires commerciaux [doc. 6].
3. Ce sont des réponses libérales : baisser les dépenses publiques, renflouer les banques, prioriser le marché, socialiser les pertes et privatiser les gains.
4. La crise remet en cause le primat de la doctrine économique néo-libérale et les modalités de la gouvernance économique.
Analyser un graphiqueLe doc. 3 ne présente pas l’évolution du PIB mais l’évolution du taux de croissance du PIB, c’est-à-dire des variations du PIB d’une année sur l’autre. Il peut être intéressant de le comparer au document p. 333 pour montrer aux élèves la différence entre ces deux variables. Le graphe permet d’identifier la période de récession que traversent les pays européens en 2008-2009, puis de souligner que la Grèce s’enfonce elle dans une dépression économique, tandis que la reprise est plus forte aux États-Unis et en Allemagne qu’en France, tout en demeurant fragile. Ce document met en relief la profondeur et la gravité de la crise, ainsi que son caractère global.
Histoire des arts P 324-325
Arturo Di Modica, Le Taureau de Wall StreetAnalyser l’œuvreLe thème du taureau renvoie à l’expression très ancienne du « Bull market » et, depuis des décennies, la presse magazine américaine a pris l’habitude de représenter « Wall Street » sous les traits d’un taureau. Il est vraisemblable que l’artiste s’est inspiré de l’une des nombreuses couvertures de Time magazine contenant un « Wall Street Bull ». Le taureau symbolise la résilience de l’économie amé-ricaine dans le contexte des suites du krach boursier de 1987.
Comprendre la portée de l’œuvreLa réalisation de cette sculpture en bronze a représenté un inves-tissement considérable pour l’artiste (en temps et en argent, le coût de réalisation s’élevant à quelques centaines de milliers de dollars), qui attendait vraisemblablement de son coup d’éclat des retombées médiatiques. De fait, Arturo Di Modica a cherché, en vain, à vendre la sculpture depuis 2004, et n’a pas véritablement profité des retombées associées à la célébrité de son œuvre. L’art public, plus qu’un autre, se caractérise en effet par le fait que l’œuvre placée dans la rue appartient moins à son artiste qu’au très large public qui la fait connaître par ses propres photographies.
EXERCICE P 327
Analyser des couvertures de magazines : Les acteurs de la gouvernance économique dans l’opinion1. Le premier document, la Une de L’Express, qui s’adresse au grand public met en image une forme de « mythe du complot » qui représente l’oligarchie des banquiers représentés en marionnettistes de la Terre.
2. Le deuxième document ne relève pas de la presse magazine, mais de la catégorie des revues scientifiques : il s’adresse à un public éduqué. L’image retenue – qui met en scène un personnage portant le masque porté par le personnage de « V » dans V pour Vendetta, utilisé par les activistes du réseau « Anonymous » – suggère elle-aussi l’action de forces occultes. Pourtant, à la différence de la Une de L’Express, qui met en avant la thèse d’un essai polémique dénon-çant un « putsch démocratique » par « une superclasse qui oriente la décision publique », cette revue spécialisée dans les relations internationales se penche de manière plus sobre et scientifique sur le rôle des acteurs non-étatiques dans la gouvernance mondiale.
Objectif BAC Méthode P 328-329
Composition : Rédiger la conclusionLes mutations de la gouvernance économique mondiale depuis 19751. La mise en place d’une échelle mondiale de gouvernement : la mise en place d’une diplomatie de club fait suite à la crise du système de Bretton-Woods.
2. La difficile gouvernance de la mondialisation : la fin de la guerre froide redonne sa place au multilatéralisme (OMC, ONU), et la crise de 2008 conduisent à une refonte de la gouvernance mondiale au profit des pays émergents.
© É
diti
ons
Belin
, 20
16
HISTOIRE - Term CHAPITRE 14 61
Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 19751. La gouvernance économique mondiale repose essentiellement sur les États les plus développés économiquement à partir de 1975.
2. Toutefois, les organisations non-étatiques s’affirment progres-sivement comme des acteurs à part entière à partir des années 1980.
L’impact des crises sur la gouvernance économique depuis 1973Les chocs pétroliers confèrent aux pays producteurs de pétrole un poids plus important dans la gouvernance économique mondiale. Les crises fragilisent parallèlement les pays les plus avancés éco-nomiquement. Enfin, la crise de 2008 a favorisé l’affirmation d’une gouvernance renouvelée qui s’exprime à travers le G20 d’une part, et les BRICS d’autre part.
Objectif BAC Méthode P 330-331
Etude critique de document / analyse de document :
Analyser des données statistiques
Le commerce mondial de marchandises (1963-2012) Le commerce mondial de marchandise est multiplié par plus de 100 en volume de 1963 à 2012, et ni les chocs pétroliers, ni les crises économiques, ne semblent enrayer sa progression à l’échelle mondiale. La part du GATT-OMC dans le commerce mondial pro-gresse régulièrement (cf. étude p. 320-321) et de façon très marquée. En revanche, la part de l’Europe dans le commerce mondial diminue fortement, alors que celle des États-Unis tend à rester stable. Le tableau, enfin, met en évidence les progrès très rapides de la Chine : elle multiplie par 4 sa part du commerce mondial entre 1993 et 2010. L’analyse différenciée des importations et des exportations permet de souligner le fait que la Chine exporte plus qu’elle n’importe, tandis que les États-Unis importent bien plus qu’ils n’exportent, ce qui contribue à leur dépendance économique et financière vis-à-vis de la Chine.
La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni dans le commerce mondialLe tableau montre de façon spectaculaire le recul de la part de la France et du Royaume-Uni dans le commerce mondial. L’Allemagne, en revanche, tend à conserver sa place dans le commerce mondial à la faveur d’une économie très exportatrice.
Objectif BAC Sujets P 332
CompositionLa gouvernance économique mondiale depuis 19441. La mise en place de la gouvernance économique suscite une confrontation entre les deux logiques d’organisation du monde et confirme la domination des acteurs capitalistes.
2. La montée progressive de l’enjeu du développement prolonge la confrontation entre vision libérale et organisation planifiée et « étatique » de l’économie.
3. L’émergence de nouveaux acteurs remet en question le pouvoir des États et la domination du « Nord » dans une mondialisation de plus en plus multipolaire.
Étude critique de documentsForces et faiblesses de la gouvernance économique mondiale1. Le texte de Pascal Lamy reflète une croyance dans les valeurs et dans le caractère opératoire du multilatéralisme : le directeur géné-ral de l’OMC plaide pour un renforcement du rôle d’organisations multilatérales telles que celle qu’il préside.
2. Joseph Stiglitz est plus critique en considérant que la gouvernance mondiale est un « système de gouvernance globale sans gouverne-ment global ». Il souligne en effet la difficulté qu’engendre l’absence de gouvernement mondial, qui prive les organismes chargés de la gouvernance économique d’un contrôle politique.
Objectif BAC Sujets P 333
CompositionLa gouvernance économique mondiale depuis 1975La gouvernance économique mondiale repose essentiellement sur les États les plus développés économiquement à partir de 1975. Toutefois, les organisations non-étatiques s’affirment progressive-ment comme des acteurs à part entière à partir des années 1980
Analyse de documentLe G20, nouveau directoire mondial Le tableau reflète à la fois la multipolarisation de l’économie (les dix premiers PIB représentaient plus de 71 % du total mondial en 1992 et passent à 65 % en 2011) et l’ascension rapide des pays « émergents », en particulier la Chine, le Brésil et – à un moindre degré – l’Inde, l’Indonésie ou la Turquie. La Russie reste stable en rang, mais progresse en pourcentages. À noter que les pays qui régressent dans le classement sont en général du « Nord », mais pas seulement (Argentine, Afrique du Sud).
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESBibliographie
• Badie Bertrand, La Diplomatie de connivence – Les dérives oligarchiques du système international, La Découverte, 2011.
• Bastidon Cécile, Brasseul Jacques, Gilles Philippe, Histoire de la globalisation financière, Armand Colin, 2010, La Découverte, 2011.
• Graz Jean-Christophe, La Gouvernance de la mondialisation, La Découverte, 2010.
• Jaffrelot Christophe (dir), L’Enjeu mondial – Les pays émergents, Presses de Sciences Po, 2008.
• Michalet Charles-Albert, Qu’est-ce que la mondialisation ? – Petit traité à l’usage de ceux et celles qui ne savent pas encore s’il faut être pour ou contre, La Découverte, 2004.
• Moreau Defarges Philippe, La gouvernance mondiale, PUF, QSJ, 2008
• Norel Philippe, L’invention du marché, une histoire économique de la mondialisation, Éditions du Seuil, 2004.
• Rainelli Michel, L’Organisation mondiale du Commerce, La Décou-verte, 2011.
Sites Internet
• Alternatives économiques : www.alternatives-economiques.fr
• Fonds monétaire International : www.imf.org
• Organisation mondiale du Commerce : www.wto.org/indexfr.htm