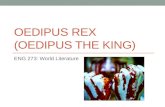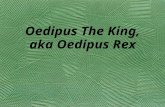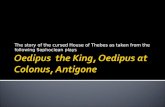Collection «Actualité de la psychanalyse»… · · 2013-11-044.Frank O’Connor, My Oedipus...
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Collection «Actualité de la psychanalyse»… · · 2013-11-044.Frank O’Connor, My Oedipus...
-
Retrouvez tous les titres parus surwww.editions-eres.com
Collection Actualit de la psychanalyse
dirige par Serge LesourdThrapeutique du sujet, la psychanalyse est aussi une thorisation durapport du sujet au monde, en ce quil sinscrit dans linconscient. Lestransformations sociales intressent donc au plus haut point la psycha-nalyse tant dans sa pratique que dans sa thorie. Psychanalyse et actua-lit sont ainsi en liens intimes lune avec lautre, et cest leur doublearticulation qui constitue le projet de la collection. Ainsi, la collection Actualit de la psychanalyse se propose dunepart dclairer par la psychanalyse ce qui fait lactualit, lactuel desmouvements sociaux, dautre part de transmettre lactualit de larecherche en psychanalyse. Le travail de la clinique psychanalytiquetant de fait pris dans ce double mouvement dinnovation et de com-prhension de ce qui sactualise pour le sujet, lui-mme pris dans uneactualit de la socit.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 2
Extrait de la publication
-
Au seuil du texte : le sujet
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 3
Extrait de la publication
-
DU MME AUTEUR :
Au seuil de linconscient, le premier entretienParis, Payot, 1996
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 4
Extrait de la publication
-
Eva-Marie Golder
Au seuil du texte : le sujet
Collection Actualit de la psychanalyse
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 5
Extrait de la publication
-
Conception de la couverture :Anne Hbert
Version PDF ditions rs 2012ME - ISBN PDF : 978-2-7492-3546-2
Premire dition ditions rs 200533 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse
www.editions-eres.com
Aux termes du Code de la proprit intellectuelle, toute reproduction ou reprsen-tation, intgrale ou partielle de la prsente publication, faite par quelque procdque ce soit (reprographie, microfilmage, scannrisation, numrisation) sans leconsentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et consti-tue une contrefaon sanctionne par les articles L 335-2 et suivants du Code de la
proprit intellectuelle. Lautorisation deffectuer des reproductions par reprographie doit tre obtenue
auprs du Centre franais dexploitation du droit de copie (CFC)20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, tl. : 01 44 07 47 70 / Fax : 01 46 34 67 19
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 6
Extrait de la publication
-
Table des matires
Prolgomnes .................................................................................. 7
Introduction ...................................................................................... 13
1. LENFANT LECTEUR
Les bbs lisent le monde .............................................................. 19Un praticable se met en place ........................................................ 25Les deux lectures dun cas clinique .............................................. 28Lincidence du signifiant ................................................................ 32
2. LENTRE-DEUX-TEXTES
Du lien complexe entre clinique et thorie .................................. 41Le premier texte .............................................................................. 43Le stade du miroir criture dun deuxime texte .................... 50La constitution de lobjet et du fantasme .................................... 56Le phallus.......................................................................................... 59Le rassemblement des lments signifiants ................................ 64Lectures croises .............................................................................. 67
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 158
Extrait de la publication
-
3. UN TEXTE EN TRAIN DE SCRIRE
Le corps crit .................................................................................... 73Les avatars de ldipe.................................................................... 79Se dgager de la Chose maternelle .............................................. 83La construction de la mtaphore .................................................. 87Comment se dgager de la mre .................................................. 89Apprendre parler avec le moyens du bord .............................. 96Revisiter nos signifiants.................................................................. 101
4. UN TEXTE EN QUTE DAUTEUR
Le texte aboli .................................................................................... 109Une clinique de lautisme et de la psychose................................ 113Les accidents de laccs au signifiant .......................................... 119crire un texte pour sarrimer lhistoire.................................... 127
5. TRADUIRE, UNE CRITURE JUBILATOIRE
crire le nant .................................................................................. 135Lenfant autiste un traducteur .................................................... 140La langue maternelle ...................................................................... 146La contrainte de la langue .............................................................. 149
Bibliographie .................................................................................... 156
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 159
Extrait de la publication
-
Prolgomnes
Si enfin on admet que les souvenirs ne se projettent pasdeux-mmes sur les sensations et que la conscience les confronteavec le donn prsent pour ne retenir que ceux qui saccordent aveclui, alors on reconnat un texte originaire qui porte en soi son senset loppose celui des souvenirs : ce texte est la perceptionmme 1.
** *
La vie dun enfant est scande par des moments de dcouverteextraordinaires. Comprendre que des formes alignes les unes der-rires les autres, se rptant inlassablement, sont des signes, deslettres, des mots, bref, savoir lire peut tre un moment de jubilationunique pour lui. Comprendre la plaisanterie, la polysmie desmots, apprendre jouer avec eux, est un affranchissement. AlbertoManguel et Franoise Dolto nous en font un rcit plein de saveur :le premier raconte sa dcouverte de la lecture et la seconde nousmontre dans une petite vignette, comment un bb saisit la plai-
1. Maurice Merleau-Ponty, Phnomnologie de la perception, Gallimard, 1945, p. 29.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 7
Extrait de la publication
-
santerie. Ce sont des moments de grce au cours desquels a lieuune mutation importante.
** *
Alberto Manguel a 4 ans lorsquil saperoit quil y a un rap-port entre limage dun garon quil avait contemple tant de foisdans un livre et le mot qui tait crit au-dessus de lui, ces svresformes noires, [] comme si le corps du garon boy avait tpartag en trois figures bien distinctes : un bras et le torse, b ; la ttecoupe, dune rondeur parfaite, o ; et les jambes mollement pen-dantes, y. Je dessinais des yeux dans le visage rond, ainsi quunsourire et je remplissais le rond du vide du torse. Mais ce ntait pastout : je savais que ces formes ntaient pas seulement le reflet dugaron au-dessus delles, mais quelles pouvaient aussi me direexactement ce que faisait ce garon, bras tendus et carts. The boyruns, disaient les formes : le garon court . Il ntait pas dupe. Ilavait compris galement que cette lecture lui tait possible parceque la nurse qui soccupait de lui avait lu et relu ces mots pour lui. Il y avait l du plaisir, mais un plaisir qui susait. Il ny avait pasde surprise. La rvlation est venue plus tard, dans la voiture, envoyage, lorsque brusquement, au passage dune publicit, ildcouvre ces mmes formes, jamais vues et pourtant reconnues. Jentendais dans ma tte ces traits noirs et ces espaces blancsmtamorphoss en une ralit solide, sonore, pleine de sens. Face ces mots, il comprend brusquement quil est capable de trans-former des traits nus en ralit vivante . Un sentiment de triomphelenvahit : Jtais tout-puissant. Je savais lire 2.
*
Dans son livre Au jeu du dsir, Franoise Dolto dcrit sa ren-contre avec un bb de 9 mois au jardin public. Pour lamuser, ellelui donne son chapeau qui finit par devenir lobjet dun changetout fait singulier. En effet, aprs en avoir explor un certainnombre dutilisations, lenfant sen dsintresse. Comme elle aenvie de continuer la relation, elle se met jouer cache-cache avecle chapeau en soulignant chaque apparition et disparition avec un :
Au seuil du texte : le sujet8
2. Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Actes Sud, 1998, p. 18.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 8
Extrait de la publication
-
Chapeau ! Pas de chapeau ! Mais le petit Jacques est un enfantrserv, il ne se manifeste gure face ces efforts de conversation.Alors, Franoise Dolto sarrte, constatant : Bon, pas de cha-peau. Et l, lenfant attend un moment, puis sagite. La conversa-tion semble dsire. Prenant cela pour un appel, elle continue etrpond chaque nouveau signe de la part de lenfant.
Nous continumes ce petit jeu un temps, et puis, pourmamuser, voulant, comme on dit, faire une blague, je commenais prononcer les mmes phonmes en inversant les gestes qui les accom-pagnaient ; je mamusai dire : Chapeau !en faisant disparatre lobjet, et : Pas de chapeau !en le montrant. Jacques se mit tout coup, et pour la premire foisde sa vie, rire aux clats, ce qui, vous le pensez bien, me surpritautant que sa mre ! Un rire ! un rire qui sarrtait, roucoulant danssa gorge, pour attendre ce que jallais faire 3.
*
Deux situations de dcouverte du mot, deux jubilations, deuxtapes dune vie. Il y en a dautres, moins jubilatoires, mais com-bien ncessaires, comme lillustre la merveilleuse nouvelle deFrank OConnor My Oedipus Complex 4. Il y raconte le grave conflitqui oppose un garon son pre qui revient de guerre, interrom-pant ainsi les dlicieuses privauts quil vit jusqualors dans la cha-leur du lit maternel. Pendant des annes, la prsence du pre estcourte, ponctue par des apparitions tard dans la nuit, une silhouette habille de khaki qui se penche sur lenfant endormi lalueur dune bougie, des disparitions marques par des bruits debottes qui sestompent au loin sur le pav aprs un bref claquementde porte. Cela ressemble au Pre Nol, la fois attendu et craint.Dautant plus craint, dailleurs, quil y a ce problme du lit. Se trou-ver brusquement coinc entre les deux parents, lorsquil arrive lematin pour profiter de la chaleur du lit, nenchante gure Larry.Puis un jour, au lieu de remettre luniforme et de repartir, ce preshabille en civil et reste et qui plus est, la mre a lair contentecomme tout.
9Textures
3. Franoise Dolto, Au jeu du dsir, Le Seuil, 1981, p. 9.4. Frank OConnor, My Oedipus Complex and Other Stories, Penguin Books, 1963, p. 21-31,traduction personnelle.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 9
Extrait de la publication
-
Lhistoire du lit commence tracasser le petit Larry. Voil desmois quil a essay de dire sa mre que ce ntait pas la peine defaire deux lits alors quils pourraient dormir dans un seul et quellelui a expliqu que cest plus sain de cette faon ; et voil que main-tenant cet homme, cet tranger, dort avec elle, sans aucun respectpour sa sant, dans le mme lit. Il observe petit petit que lintruscherche loigner sa mre de lui, ce qui le met dans une rage indes-criptible, dautant plus que sa mthode pour y parvenir lui chappetotalement et quil ne peut pas simaginer ce qui attire tant sa mre.Cet homme nest pas sduisant. Il a un accent commun et fait dubruit quand il boit son th. Mais peut-tre est-ce en rapport avec cequil fait, par exemple lire les journaux ou fumer la pipe ? Larry semet donc fabriquer des nouvelles pour les lire sa mre, mais rienny fait. Ou alors, pense-t-il, cest le fait de fumer la pipe, chose toutde mme trs attrayante ? Il se met donc prendre les pipes sonpre et se promener dans la maison en faisant mine de les fumer,jusqu ce quil se fasse attraper. Il fait mme du bruit en buvantson th, mais l, les foudres maternelles tombent sur lui. Toutsemblait tourner autour de cette habitude malsaine de dormirensemble, si bien que je me faisais un point dhonneur de surgirbrusquement dans leur chambre coucher, de prendre un airaffair, parler tout seul haute voix, pour quils ne se rendent pascompte que je les observais eux, mais javais beau chercher, je ne lesvoyais jamais en train de faire quelque chose de particulier. Unechose finit par mapparatre de plus en plus nettement. a devaitavoir un rapport avec le fait dtre adulte et dchanger des bagues,et alors je compris quil fallait que jattende.
*
Quelques mois aprs le dbut de son traitement, Louisetrouve dans la bote jouets de mon bureau un petit loup en plas-tique. Je suis Lou, le petit loup des steppes. Fillette autiste quitravaille avec Marie-Christine Laznik-Penot, Louise est un desenfants que lauteur prsente dans son passionnant livre sur laquestion de lautisme. Comme tant de fois, Louise rpte ainsi dans une espce dcholalie diffre des bouts de phrases dunehistoire entendue sur un disque quon lui fait couter. Mais cettefois-ci, un lien est perceptible avec un objet support dune repr-sentation possible. Enfin quelque chose pourra sincarner la foissur le plan imaginaire et sur le plan symbolique. Un scnario est
Au seuil du texte : le sujet10
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 10
-
amorc, une reprsentation delle-mme apparat, car Lou est lesobriquet que sa mre lui donne. Langage, histoire, relation lamre, tout se noue l un signifiant qui enfin reprsente cet enfanten tant que sujet auprs dun autre signifiant. Quelque temps plustard, un autre nonc, l encore dconnect de tout contexte etlanc la cantonade, frappe mon oreille : rivire profonde. Jin-terroge le pre, prsent cette sance. Il reconnat une des strophesde la chanson Aux marches du palais. Il la lui chante, Louise lareprend ; elle la connat par cur et peut la dbiter automatique-ment. Mais mon tonnement, elle jubile quand elle entend sonpre lui dire : Il y a une tant belle fille cest la premire fois quele signifiant fille la touche 5.
*
Aurore se trouva pousse chez moi par sa voisine de palierqui ne supportait plus de lentendre ; sa voisine, son mari, ses amis,tous la prcipitrent dans le cabinet de lanalyste. Elle y vint.Aurore parla sans prambule comme si elle poursuivait un dia-logue interminable de cette souffrance qui lenvahissait et emboli-sait sa vie entire. Elle tait habite par la pense dune femme(trangre) qui travaillait avec son mari et qui ne la laissait pas enpaix. Elle semblait passer son temps accumuler les indices qui fai-saient preuve pour elle, sans que je sache de quoi, et la mettaientdans des tats de violence qui commenaient linquiter.
Si les relations extraconjugales ntonnent plus grand mondeaujourdhui, quelque chose dans ce discours rcit en voix off neme permettait pas une seconde dimaginer une quelconque liaisonextraconjugale. Cest vraisemblablement quelle non plus ne lima-ginait pas, ctait une jalousie qui nveillait pas le moindre soup-on dune scne quelconque. croire que quelque chose l nepouvait pas se penser et pourtant, elle ne parlait que de a.
Je mtonnais en la questionnant sur les faits qui tayaient saposition, quand elle me confirma cet impensable par un termeinopin : Vous comprenez, me dit-elle pour me donner despreuves supplmentaires, comme ils travaillent ensemble, ils ontchacun leur chambre.
Mtonnant de ce terme, elle nen trouva aucun pour medcrire le lieu o ils travaillaient. Seul le terme de chambre tait l
11Textures
5. Marie-Christine Laznik-Penot, Vers la parole, Denol, 1995, p. 170.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 11
Extrait de la publication
-
pour dire lvidence. Mais lvidence de quoi, de quelle autre scneelle me parlait ?
Cette chambre dsignait pour elle tous les lieux, bureaux,pices, etc., sauf bien entendu ce que ce terme dsigne habituelle-ment.
Si jinsiste pour camper ce premier entretien, cest que dans lereprage de ce terme de chambre se trouvait en germe la picematresse partir de laquelle se construisait le dlire de la pers-cution 6.
** *
Cinq vignettes, cinq situations qui montrent combien parfoisun seul mot peut tre brusquement promu la place de pierreangulaire dans une vie. partir de l, rien nest plus comme avant.
Au seuil du texte : le sujet12
6. Catherine Kolko, Les absents de la mmoire, rs, 2000, p. 44.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 12
-
Introduction
Jai appris crire grce mon prnom. Je me souviens encorede mes premiers essais dcriture : tel que je le faisais, avec sa sriede dents, le E majuscule de la premire partie ressemblait davan-tage un rteau qu une lettre, mais jtais persuade quil devaiten tre ainsi. Mon prnom nayant pas fait lunanimit entre mesparents, jai entendu trs tt dj les justifications dun tel choix parla bouche de ma mre, femme trs croyante, dune ferveur pitiste.Eva, la premire femme de la Bible ! Jen voyais une belle illustra-tion dans la bibliothque de mes parents sous la forme dune repro-duction dun primitif italien. ve y tait figure avec une cheveluremagnifique qui lui descendait jusquaux cuisses, couvrant au pas-sage ce sexe dont je souponnais, grce aux allusions de ma mre,limpact dterminant sur lhistoire de lhumanit tout entire. Unpeigne donc, ce E, pour une chevelure dont la sensualit ne pouvaitchapper personne. Le M majuscule de la deuxime partie demon prnom faisait office de manteau, tel que je limaginais portpar la Vierge Marie, autre femme biblique dont la puret mtaittoujours donne en exemple. moins quil ne figurt le tablierouvert aux dons du ciel de lhrone dun conte de fe des frresGrimm, nomme Frau Holle . Marie la dore, Goldmarie, dansla langue dans laquelle on me racontait lhistoire, avait t rcom-pense de son zle par une pluie de pices dor tombant du ciel.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 13
Extrait de la publication
-
Cette histoire associait utilement ce prnom avec mon nom defamille, mais jetait un trouble dans mon esprit. En effet, cause dela deuxime partie de cette histoire, ce prnom perdait le poids deson vidence. Il y avait l une deuxime Marie, paresseuse, reven-dicatrice, rcompense pour sa mchancet par une pluie depoisse : Pechmarie, celle qui a de la malchance. Il y aurait donc des Marie bonnes et dautres, mauvaises ? Se pourrait-il quil y etdes ve auxquelles ne serait pas attache lodeur de soufre delenfer ? La vie dabord, la psychanalyse ensuite, mont, depuis lors,apport quelques claircissements sur ce sujet.
Il nen reste pas moins qu linstar de ce que raconte Manguel,mes premiers pas dans lunivers de lcriture se sont faits grce une mdiation double : la parole dun tiers et un foisonnement ima-ginaire qui faisait vivre les lettres elles-mmes de linterprtationque lenfant lui donne. Le peigne et le manteau ont mis quelquetemps disparatre de mon univers scriptural, plus prcisment letemps daccepter que ces lettres se retrouvaient au dbut dun tasdautres mots, des E et M sans aucun rapport avec des femmes quise coiffent ou se couvrent. Cest arriv lge o beaucoup den-fants se mettent philosopher. Les parents ont quelquefois un peude mal suivre. Les questions les droutent, les obligent aborderdes sujets auxquels ils nont pas forcment envie de rflchir.
Combien de parents me parlent ainsi de linquitude que leurinspire leur enfant de 5 ou 6 ans, parce quil se met brusquement sintresser la mort. En gnral, ils prfrent luder cette question. lheure actuelle, on parle plus facilement de sexe, pas forcmentdailleurs avec la retenue qui convient un jeune enfant. Cest plussimple et, au mieux, il y a des livres pour a. Seulement, ce quils necomprennent pas, cest que lenfant leur parle de lexprienceintime quil fait de la question de la castration. Perdre lillusion duE comme peigne, perdre lillusion des lettres boy qui courentelles-mmes est une jubilation dont la ranon est linquitude ; carsi le sens dune chose nest pas univoque, il peut donc se perdre. Sile savoir quon a ne donne plus de garantie absolue, que reste-t-ilalors ? Sans doute, lenfant ne posera pas la question de cettemanire, mais il fait appel nous pour tenter dy rpondre.
Pour lenfant que jtais, ces premires lettres qui prenaientsens taient une victoire extraordinaire. Jtais la dernire dune fra-trie importante et voyais avec envie tous les autres lire et crire,alors que moi-mme jtais encore condamne deviner les textesau-dessous des images ou me les faire raconter. Ctait jubila-
Au seuil du texte : le sujet14
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 14
-
toire ; ces moments jalonnent notre vie entire, comme fruits duntravail toujours recommencer, et ont toujours la mme structure :une jubilation et une angoisse.
Le pre de Manguel tait diplomate. Des dplacements fr-quents foraient le jeune garon se crer une permanence l ocela tait possible : Les livres moffraient un foyer permanent, unfoyer que je pouvais habiter exactement comme bon me semblait, tout moment, si peu familire que ft la chambre o je devais dor-mir ou inintelligibles les voix ma porte 1. Dans ce monde il taitle roi, le livre sadressait lui dans un dialogue intime.
tre lecteur veut dire que nous occupons en tant que sujet uneplace par rapport un monde que nous nous approprions. tre lec-teur de notre monde nous procure ce sentiment de scurit dunpoint dancrage dans le rel. Nous savons dexprience que ce rap-port-l est renouveler chaque instant, mais lenfant qui nouspose la question de la mort, lui, est seulement en train de le dcou-vrir. Mon E-peigne nest pas pass du jour au lendemain un E trois branches. Il a mis le temps dun ajustement. Le temps dundeuil. Javais beau me battre contre tous ces adultes qui voulaientme prouver que le E ntait ni un rteau ni un peigne, un jour, il afallu que je me rende lvidence. Ce qui reste de ce travail effec-tu, cest la possibilit de ritrer lopration sur un plan symbo-lique, sans avoir passer par toutes les tapes entre lopacitimaginaire et le fuyant du sens. La question que nous pose lenfantsadresse nous en tant que sujet, par rapport notre point din-sertion dans le rel. Et il a tt fait de dcouvrir les limites.
Gilles Lapouge raconte ainsi son tour un voyage quil fit entant que petit garon bord de la voiture de ses parents, sur unstrapontin qui tournait le dos au paysage quils quittaient. croireque le huis clos des voyages en voiture est particulirement utileaux enfants. On lui avait promis une visite dans le dsert et, en lieuet place du dsert, tout ce quil pouvait voir tait la ville dOran quisloignait au fur et mesure quils avanaient. Jaurais dprendre cette incommodit la rigolade mais jtais extrmementenfantin, extrmement srieux. Jai considr que pareil dispositifne favorisait pas la dcouverte. [] Par chance, javais crois,quelques mois plus tt, sans doute dans Jules Verne, le mot des-tin et ce mot mavait charm. Il faisait un bruit de cloche et de nuit.
15Introduction
1. Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Actes Sud, 1998, p. 24.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 15
-
Je lai tout de suite embauch. Le voyage est long, fastidieux.Lennui menace de sinstaller. Mme les rires finissent par se tarir.Pour ne pas faire de la peine aux autres, ils se mettent inventerdes mirages. Mais le doute sinsinue, vrai ou faux mirage ? Scru-puleux ou inventifs, les enfants se mettent inventer lillusion demirage, le mirage redoubl. ce point une question effrayante etmme philosophique se posait : et si lillusion elle-mme tait uneillusion ? Est-ce que cela voulait dire que le mirage, dfini dabordcomme une illusion, exhauss ensuite au rang dillusion dune illu-sion, se voyait retirer le peu de ralit quon croyait quil contenait ?Je mgarais dans ces complications. Si javais connu le mot dapo-rie, je crois bien que je laurais utilis 2.
Merveilleuse capacit des mots nous ancrer dans ltre et nous dcentrer de notre existence. Mais, non seulement lobjet nedonne aucune garantie, mais lautre, linterlocuteur, non plus. Cequil promet ne se ralise pas forcment ou pas comme on a crucomprendre. Quelque chose rsiste. Comment sorienter dans unpaysage lenvers, comment sorienter entre mirage et illusion demirage, comment se reprer dans des prnoms qui semblent avoirdautres connotations possibles que peigne et manteau, pch etpuret voils, des connotations si loin dun sens que lautre sembledtenir ? Peut-tre justement par la cration dun monde soi quisappuie, certes, sur celui de lautre mais tout en lexcluant. Lan-goisse apparat lorsquon dcouvre que soi-mme, en tant quesujet, on est exclu du monde quon sest cr. Cette illusion de lillu-sion, cest la parole qui saffranchit de nous-mmes. Do la ques-tion de la mort chez lenfant de 5 ans. Mais comment lui fairecomprendre que notre lot nous tous est de ntre jamais dans leconstitu ? Quun mirage en chasse un autre et que du sujet, il nyen a quentre deux ? Et puisque lautre qui nous le dit semble setromper aussi, quest-ce qui donne une garantie de notre tre ? Enconsultation, cest avec des enfants que jai eu les changes les plusimpressionnants ce sujet. Comme le dit Lapouge, ils sont telle-ment enfantins, tellement srieux .
Notre vue sur lhomme restera superficielle tant que nous neremontons pas cette origine, tant que nous ne retrouvons pas,sous le bruit des paroles, le silence primordial, tant que nous ne
Au seuil du texte : le sujet16
2. Gilles Lapouge, Besoin de mirages, Le Seuil, 1999, p. 11-25.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 16
Extrait de la publication
-
dcrirons pas le geste qui rompt ce silence. La parole est un geste etsa signification un monde 3.
Pour ma part, jai appris davantage sur la question de la trom-perie de lautre grce ma rencontre avec le franais. En effet, dansla maison de mes parents, la langue parle tait un dialecte alle-mand. Mais, chose curieuse, par moments, le franais sy glissait,sans crier gare. Ce ntait pas le franais quon parlait dans cer-taines familles bourgeoises de ltranger au XIXe sicle. Cela ne serattachait pas ce fonds culturel qui se transmettait aux enfants. Jecompris vite, au ton secret ou, au contraire, volontairement dta-ch, trop dailleurs pour faire naturel, quil devait sagir de chosesextrmement importantes quon cherchait nous dissimuler. Jedsesprais. Dautant plus que lors de nos dplacements en voiturefamiliale, une norme amricaine pour contenir tous les rejetons enune fois, ma mre, pour canaliser toutes les nergies qui avaienttendance exasprer mon pre au volant, nous apprenait des chan-sons en franais. Mis part quelques bribes qui voulaient biencder, cette langue me rsistait. Ctait un tout qui me paraissaitdune seule pice et que jnonnais consciencieusement en esprantlui faire rendre gorge la longue. Mais cest en me rsistant quecette langue mapprit au plus vite que lautre cherche sauvegar-der une part de son opacit avec toute la mauvaise foi que lui accor-dait alors sa supriorit dadulte. Cest ainsi quenfant, jtaiscondamne devenir experte en smiologie parentale, faute depouvoir immdiatement pratiquer les coupures linguistiquesncessaires dans un idiome qui semblait obstinment vouloir resterdune seule pice. Je ne savais pas encore que cest cette mmelangue qui allait devenir ma langue dadoption culturelle. Les cou-pures ne se font jamais l o on croit. Ni les nouages, dailleurs.
Lintrt pour les apories mest rest. Les parcours du hasardet de la ncessit aidant, la rencontre avec Franoise Dolto ainfluenc de manire dcisive mon travail de psychanalyste et mapermis de mengager dans les consultations avec les smiologuesles plus dous, savoir les bbs. Je lui en suis reconnaissante.Nanmoins, je restais toujours sur ma faim lorsquil sagissait dethoriser ce que jtais en train dengager avec les tout-petits.Javais besoin dautre chose. Cest chez Lacan que jai trouv les l-ments qui me permettaient de formaliser ce qui se passait. Le pr-sent livre en est une synthse.
17Introduction
3. Maurice Merleau-Ponty, Phnomnologie de la perception, Gallimard, 1945, p. 214.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 17
Extrait de la publication
-
Franoise Dolto a su prendre appui le plus radicalement surcette capacit de lenfant travailler la parole de lautre et elleen a bauch une thorisation dans le concept de l image incons-ciente du corps . Je lai relu la lumire du sminaire sur lidenti-fication de Jacques Lacan et je me le suis ainsi appropri comme unpraticable dont je prsenterai les nouages thoriques dans les cha-pitres suivants. Ce concept de l image inconsciente du corps cerne quelques questions fondamentales autour de la notion deloriginaire. Il nous permet de reprer de quelle faon lenfant sesert des moyens sa disposition pour se faire entendre et pourpntrer progressivement dans lunivers du langage. Nous verronstrs vite que, dgag dune vision par trop gntique quune lectureun peu rapide des textes de Dolto peut induire, ce concept nouslivre quelques secrets du registre imaginaire tel que Lacan ladfini, mais que, par souci de rigueur et en rponse aux drapagesthoriques de son poque, il a toujours trait avec beaucoup demfiance. Or, sans imaginaire, pas de pense possible.
La prsente recherche se veut travail sur le texte , soustoutes ses formes, sur le texte originaire qui est la perception mme,sur le dialogue avec le monde et lautre dont nous naissons en tantque sujet, comme sur les accidents de cet change singulier. Tour tour lecteur puis auteur, nous entrons dans une dialectique qui serenouvelle sans cesse. Exprience conflictuelle sil en est danslaquelle nous dcouvrons que la lecture du texte de notre viedpend troitement de la manire dont celui-ci est venu vers nous.
Deux approches seront traites successivement. Dans un pre-mier temps, je tente darticuler un certain nombre de points tho-riques avec la clinique des tout-petits pour faire apparatre lesmcanismes de lecture et dinscription du langage. Le premier et lesecond chapitre y sont consacrs. La deuxime partie de larecherche aborde les conflits qui rsultent des diffrentes articula-tions possibles entre texte, auteur et lecteur, qui suivent troitementles lignes de fracture que dessine notre rapport la castration.
Au seuil du texte : le sujet18
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 18
Extrait de la publication
-
1
Lenfant lecteur
LES BBS LISENT LE MONDE
Les pleurs de tristesse sont une chose trs complique, une chose qui signifie que votre bb a dj gagn sa place dans le monde.
Il nest plus une corce qui flotte sur les vagues. Il a dj commenc se sentir responsable de son environnement.
D.W. Winnicott 1
Le lecteur lacanien a quelques difficults entrer dans la tho-risation de Franoise Dolto, lui reprochant dtre trs approxima-tive, voire quelquefois un peu fantaisiste. Pour ceux qui sonthabitus au style de Dolto, Lacan parat trop abstrait, manquant delien avec la clinique. Il nest pas facile de trouver un biais qui soitopratoire. Le dfaut de ces deux approches critiques rside dans laperspective adopte. Or, tenter dinterroger la clinique des tout-petits avec les outils des deux permet de faire des dcouvertes tout fait intressantes. Certes, les approches respectives de Dolto et de
1. D.W. Winnicott, Lenfant et sa famille, Payot, p. 91.
Golder- Au seuil du texte le s 27/08/12 8:55 Page 19
Extrait de la publication