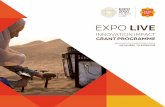Chancelor Expo
-
Upload
mamadou-chancelor -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Chancelor Expo
-
8/19/2019 Chancelor Expo
1/151
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
INTRODUCTION
Les fondations constituent l’un des éléments essentiels d'un projet deconstruction et leurs qualités dépendent de la pérennité de l'ouvrage. Ilfaut savoir que ce sont sur ces fondations que va reposer la totalité dupoids: les charges permanentes de l'infrastructure et de lasuperstructure, les diverses charges et le poids des fondations elles-mêmes.eaucoup de sinistres su!is par des ouvrages d'art proc"dent desdéfauts de conception ou de calcul des éléments des fondations. #ussi,une mauvaise conception peut conduire $ un surdimensionnement del'ouvrage.
I. FONDATION
%n appelle fondation la !ase des ouvrages qui se trouve en contactdirect avec le terrain d'assise, et qui a pour fonction de transmettre $celui-ci, le poids de l'édifice, les surcharges normales et accidentellesappliquées sur la construction.
1. Rôles& ne fondation est constituée par la partie d’une construction qui est encontact avec le sol et $ qui elle transmet les charges (permanentes et
varia!les) de l’ouvrage qu’elle porte.& *lle sta!ilise un mur contre la pression e+ercée par la terre ena!aissant le centre de gravité au tiers central.& La nature des fondations et en particulier leur profondeur varient avecla nature du terrain et l’ouvrage $ supporter.*lles doivent reposer sur un !on sol.& *lles empêchent que l’ouvrage poinonne le sol.
2. Les types de fondations
a. Fondation superficielle
Le principe d'une fondation superficielle peut être retenu si les sols sontasse/ homog"nes et s'ils comportent des couches porteuses asse/proches de la surface, sinon il faut s'orienter vers les fondationsprofondes. 0armi les fondations superficielles, on distingue: (voir 1igure2.3) a Les semelles isolées, de sections carrées, rectangulaires oucirculaires et supportant des charges ponctuelles.
-
8/19/2019 Chancelor Expo
2/15
2
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
! Les semelles filantes qui sont des fondations de tr"s grandelongueur par rapport $ leur largeur et supportant un mur ou une paroi.
c Les radiers ou dallage qui sont de grandes dimensions occupantla totalité de la surfacede la structure et telle que l'épaisseur 4 est comprise entre 5.65 et5.75m.
8 :9ans la pratique, on peut considérer comme semelle filante, une semellerectangulaire dont le
apport L"# ne dépasse pas 35 ou $ la rigueur ;.L étant la longueur de la semelle et #, sa largeur.
!. Fondation profonde
Lorsque le terrain superficiel sur lequel repose une fondation n'est pluscapa!le de résister au+ sollicitations qui lui sont transmises, on a recours$ une fondation profonde qui permet d'atteindre le su!stratum (le e cas se présente souvent lorsque les couches superficielles sont peurésistantes, molles et compressi!les, par e+emple le cas des vases, destour!es, des argiles, et dans le cas o? il serait impossi!le d'améliorer laportance de ces couches.@i la fondation était e+écutée directement sur ces couchescompressi!les, des tassements incompati!les $ la sta!ilité de l'ouvragese produiraient.0our atteindre la profondeur désirée, on réalise, soit des puits d'uncertain diam"tre (en général 3 $ A m) relativement peu profonds, soit des
pieu+ plus profonds.
-
8/19/2019 Chancelor Expo
3/15
3
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
0armi les fondations profondes, on peut citer :
B Fondations sur pieu$% puits fondations profondes (plus de A m"tres de profondeur) utilisées sur des sols de mauvaise
qualité. @i le !on sol est accessi!le, on creuse des puits que l’on remplit
ensuite de !éton. @i le !on sol est $ une grande profondeur, on fonde sur
des pieu+ !attus ou coulés sur place.
B Fondations sur paroisCoulées La paroi moulée se rencontre sur des terrains peu sta!les.>ette technique consiste $ creuser des tranchées de 5,D $ 3 m de largesur des profondeurs allant jusqu’$ 35 m et $ les remplir avec une !oue
colloEdale (tFpe !entonite).
-
8/19/2019 Chancelor Expo
4/15
4
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
Re&ar'ue (
La limite entre ces deu+ tFpes de fondations est difficile $ éta!lir. 8ousretiendrons les indications suivantes:@i D / B G 6, nous sommes dans le cas des fondations superficielles@i D / B H35, la fondation est profondeD : profondeur de la !ase de la fondation par rapport au terrain naturel# : largeur ou diam"tre de la fondation
II. L)* DO+AIN)* D,A--LICATION* D)* FONDATION*
A. FONDATION D)* OURA/)* D,ART*
8ous commenons par définir un ouvrage d'art comme touteconstruction (pont, tunnel, viaduc, tranchée, les !arrages, les digues ...)nécessaire $ l'éta!lissement d'une voie de communication. 8ous
a!orderons essentiellement les ouvrages courants de franchissementsur nos routes comme les ponts, les dalots, les !uses, les radiers, lesponts su!mersi!les.
1. -onts
0ar définition, le pont est un ouvrage de construction permettant de
franchir un o!stacle naturel ou une autre voie de circulation. >ependant,cette définition est imprécise dans la mesure o? elle ne fait apparatre
-
8/19/2019 Chancelor Expo
5/15
5
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
aucune notion de dimension, de forme ou de nature d'ouvrage. Il faut
donc plutJt parler d'ouvrage permettant le franchissement en élévationconstruit in situ. Lorsque l'o!stacle $ franchir est une dépressionprofonde de terrain qui sert ou non $ l'écoulement des eau+, on parle deviaduc. n viaduc est donc un ouvrage de grande longueur possédantde nom!reuses travées et généralement en site terrestre.
a. Classification des ponts& 0ont de chemin de fer ou pont-rail $ voie simple ou multiple.& 0ont-route $ voie simple ou multiple.
& 0onts pour piétons ou passerelles.& 0onts-canau+ pour le passage des voies naviga!les.& #queduc pour le passage des conduites d'alimentation d'eau.& 0onts com!inés pour le passage simultané de différentes sortes de
voies, par e+emple chemin de fer et route.@elon le mode d'action de la superstructure sur l'infrastructure, nous
avons:& Les ponts $ poutres droites.& Les ponts en arc et voKte.
& Les ponts suspendus.
!. Co&position des pontsn pont se compose généralement de trois parties principales (fig. 3) $
savoir :-La superstructure qui supporte directement la voie de communication.-L'infrastructure qui repose sur le terrain et supporte la superstructure.- Les appareils d'appuis qui sont des éléments interposés entre la
superstructure et l'infrastructure.
-
8/19/2019 Chancelor Expo
6/15
6
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
& La superstructure comprend trois éléments $ savoir: le ta!lier, les
poutres principales et parfois des contreventements. Le ta!lier est
l'élément directement situé au-dessous de la voie de communication, et
qui transmet les charges au+ poutres principales solidarisées entre-elles
par des poutres transversales ou entretoises qui leur sont disposées
normalement.& L'infrastructure comprend les appuis du pont qu'on appelle piles quand
ce sont les supports intermédiaires et culées quand ce sont les appuis
e+trêmes, qui supportent en plus des charges verticales du pont, la
poussée des rem!lais. Centionnons que les fondations des ponts font
parties intégrantes de ces appuis. @elon la nature des sols, le niveau
d'appui sera proche de la surface: fondations superficielles ou $ grande
profondeur: fondations profondes. >es fondations peuvent e+écutées sur terre ou sous l'eau.& Les ta!liers de ponts reposent en général sur les appuis par
l'intermédiaire d'appareils d'appui conus pour transmettre $
l'infrastructure des efforts verticau+ et ou hori/ontau+.Les appareils d'appuis sont fi+es ou mo!iles et sont fa!riqués en
élastom"re, en !éton, en métal ou en matériau+ spéciau+.
c. Donn0es n0cessaires la conception dun pontLa conception d'un pont doit satisfaire $ !on nom!re d'e+igences. *n
effet, en plus de pouvoir être utilisé comme service $ ses usagers, un
pont doit aussi satisfaire des e+igences vis-$-vis de son environnement.
L'implantation d'un pont rel"ve surtout d'une opération de vaste en
vergue. *n effet, ces ouvrages ne sont que d'infimes tronons de voie de
circulation. Leur tracé, leurs dimensions et leur importance sont dictés
par une multitude d'informations, comme par e+emple le dé!it de
véhicules, dans le cas d'un pont d'autoroute 0lusieurs données sont
donc nécessaires $ l'éla!oration d'un pont $ savoir:& Les charges permanentes et routi"res*lles sont fi+ées par le r"glement technique de charge sur les ponts:
fascicule D3. %n distingue les charges mortes, les charges routi"res, les
charges sur trottoirs et pistes cFcla!les, les charges des rem!lais, les
charges dues au vent et au+ séismes, les efforts dus $ un choc de
!ateau sur une pile de pont.& Les données géotechniques
*lles sont fondamentales dans l'étude d'un ouvrage. *lles conditionnentle tFpe de fondation et même le choi+ de la solution du franchissement
-
8/19/2019 Chancelor Expo
7/15
7
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
projeté. Les études géotechniques renseignent sur la nature du terrain,
le niveau de la nappe, la capacité portante du sol et le niveau d'ancrage
des fondations.& Les données hFdrauliques
*n dehors du relevé de la topographie, il convient de connatre lesniveau+ de l'eau, crue du projet, qui influent sur la conception générale
du franchissement. %n peut citer les cJtes des sous poutres,
emplacement des culées, nom!re, forme et implantation des piles. #ussi, il F a lieu de prendre en compte la pression hFdrostatique de l'eau
sur les piles.La connaissance des niveau+ de l'eau n'est généralement pas suffisante.
>ertaines données purement hFdrauliques peuvent être indispensa!les
pour a!order l'étude d'un phénom"ne, correspondant $ un danger réelpour les ponts: le phénom"ne d'affouillement. Les frottements latérau+
que nous a!orderons plus loin dans le cas des fondations sur pieu+
doivent être considérés comme nuls sur toute la profondeur
d'affouillement et les fondations devront sans doute dépasser ce niveau.
2. Les dalots et les !uses
%n définit par petits ouvrages les ouvrages constitués par les dalots et
les !uses, qui servent de passage au+ écoulements des eau+ deruissellement ou d'assainissement et nous les différentions des grands
ouvrages que sont les ponts.
a. Les dalots
*ncore appelés ponceau+, ce sont de petits ponts qui servent $ franchirun cours d'eau ou un fossé sur une voie. Ils sont en !éton armé et
présentent une section rectangulaire ou carré. Les dalots sont des
ouvrages sous chaussée qui ne nécessitent aucun rem!lai: une
circulation $ même la dalle peut être envisagée moFennant des
précautions lors de la construction. Ils ne peuvent en général admettre
qu'une fai!le épaisseur de rem!lai (de l'ordre d'un ou deu+ m"tres), $
moins d'être spécialement calculés pour les surcharges. %n distingue:
& Les dalots ordinaires constitués de piédroits (voile) verticau+ fondés sur semelle ou radier général et sur lesquels repose une dalle en !éton
-
8/19/2019 Chancelor Expo
8/15
8
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
armé.
& Les dalots cadres dans lesquels la dalle, les piédroits et le radier
constituent une structure en !éton armé. >e sont des ponts-cadres.
& Les dalots portiques analogues au+ dalots cadres mais sans radier
(piédroits fondés sur semelles).
Les dalots sont en général adoptés pour des dé!its élevés dépassant 35
m)s. 0arfois il est nécessaire de ju+taposer plusieurs cadres pour former
une !atterie de dalots. Les données hFdrauliques comme le dé!it, la
hauteur des hautes eau+ s'av"rent indispensa!les pour connatre le
fonctionnement de l'ouvrage et fi+er ses caractéristiques géométriques. Il
est également nécessaire de faire des études géotechniques pour
identifier la nature du sol en place qui peut être éventuellement traité ou
remplacé et choisir le tFpe de fondation adéquat, en général des
fondations superficielles
!. Les !uses
Les !uses sont de petits ouvrages en !éton ou en métal sous chaussées
qui servent $ franchir un ruisseau ou $ assurer l'écoulement d'un fluide.
*lles sont généralement de section circulaire mais parfois en forme
d'arches, !eaucoup plus aplaties. Les !uses sont utilisées e+clusivement
dans des sections o? l'on dispose d'une épaisseur suffisante de rem!lais
(un minimum de 5.75 m de rem!lai est nécessaire au-dessus de la !use)
et peuvent être utilisées avec des hauteurs de rem!lais élevées. Les
!uses en !éton dépassent rarement un diam"tre de 3,25 m, sinon leur
poids tr"s élevé constitue un o!stacle $ leur mise en place et leur coKt
-
8/19/2019 Chancelor Expo
9/15
9
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
croissant tr"s rapidement rend concurrentielles des !uses métalliques.
*lles nécessitent une fondation rigide, des radiers par e+emple. #fin de
permettre le nettoFage ou le curage des !uses qui risquent d'être
o!struées partiellement par le dépJt de sédiments et de pierres charriés
par les eau+, il est conseillé de ne jamais adopter de diam"tre inférieur $
5.75 m
3. Les radiers et les ponts su!&ersi!les
Les radiers et les ponts su!mersi!les sont des ouvrages permettant de
franchir les rivi"res $ !asses eau+, et qui sont su!mergés en cas de
crue.
a. Les radiersLes radiers sont éta!lis sur le fond des rivi"res. L'eau passe
e+clusivement par-dessus. Ils sont donc emploFés dans les rivi"res qui
restent $ sec pendant une partie importante de l'année. >e tFpe
d'ouvrage convient donc surtout pour les /ones sahéliennes ou
désertiques o? l'on enregistre des crues fortes et !r"ves. IL e+iste
plusieurs formes de radiers suivant le tFpe d'écoulement envisagé:
• adier $ fond de lit qui épouse la forme du lit du cours d'eau $profil transversal peu marqué.
• adier surélevé par rapport au lit du cours d'eau $ cause des
contraintes imposées par le profil en long de la route.
• adier hori/ontal pour le franchissement de cours d'eau de grande
largeur.
• adier $ parties cour!es, forme imposée par la morphologie du
site.
• adier $ palier hori/ontal avec parties cour!es.
Les radiers comme le nom l'indique seront constitués d'une fondation
radier ancré dans le sol protégé $ l'amont mais surtout $ l'aval contre
l'érosion.
!. Les ponts su!&ersi!les
Les ponts su!mersi!les laissent sous leur ta!lier un passage suffisant
pour permettre l'écoulement d'un certain dé!it. Lorsque celui-ci est
dépassé, le ta!lier est recouvert par les eau+. Les ouvrages de ce tFpe
-
8/19/2019 Chancelor Expo
10/15
10
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
sont donc surtout emploFés lorsqu'il e+iste un dé!it fai!le mais non nul
pendant une grande partie de l'année, et un dé!it tr"s élevé, ou de fortes
crues pendant une courte période de l'année. Les ponts su!mersi!les
sont conus pour permettre un franchissement $ sec pendant les
périodes d'étiage dans le cas d'une rivi"re pérenne ou même de dé!it
des crues de fai!le importance. Ils e+igent des fondations e+cellentes et
un site peu affouilla!le. Les ouvrages placés sous le ta!lier (dalots et
!uses) seront normalement dimensionnés.
#. FONDATION* #4TI+)NT*
>e choi+ doit être effectué apr"s une sérieuse étude géotechnique. Il est
souvent dicté par les caractéristiques de la structure $ appuFer sur le sol.L’importance, l’amplitude et la nature des tassements sont déterminants.0our le choi+ des fondations, il est donc nécessaire de faire face au+facteurs qui rentrent en ligne de compte avec les fondations $ savoir : lesol, les tFpes de fondations, les causes dues au sol et $ la conception du!Mtiment.
1. Le sol
0our le sol, on doit déterminer la couche d’assise et sescaractéristiques :
• 0rofondeur (position)
• >ontrainte admissi!le (puissance)
• Nassement (comportement)
2. Les types de fondations
%n doit choisir un tFpe de fondation et le dimensionner en fonction descaractéristiques du sol. Nels que :
• 1ondations superficielles: lorsqu’e+iste une couche de sol capa!le
de supporter l’ouvrage $ une profondeur relativement fai!le.
• 1ondations profondes: si les couches superficielles sont trop
fai!les, les charges sont transmises $ un matériau de meilleur qualité situé $ une plus grande profondeur, avec :
-
8/19/2019 Chancelor Expo
11/15
11
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
o 0uits (OP75cm) espacés
o 0ieu+ (O de D5 $ 75cm) plus serrés
Nassement différentiels des fondations :>ela donne des contraintes parasites, délicates $ évaluer, venantcompromettre l’intégrité de l’ouvrage, essentiellement :
• 1issures dans le remplissage
• Qêne dans le fonctionnement d’appareils (ponts roulants)
• uptures de canalisations, etc.
3. Causes dues au sol
• 4étérogénéité de celui-ci
• %cclusions diverses
• 0endage des couches
• @ol soumis $ des variations saisonni"res de volumes (humidité,
gel, sécheresse)
5. Causes dues la conception du !6ti&ent(
• 1ondations de nature différentes
• 8om!re de niveau+ différents
• 0arties d’un même !Mtiment fondées $ des niveau+ différents
• @urcharges d’e+ploitations différentes
• >onstruction d’un !Mtiment par tranches (tassements acquis $ coté
de tassements devant se faire)
La sta!ilité des ouvrages suppose qu’il n’F ait pas de déplacements desforces:
• @oit dans les fondations elles-mêmes (solidité suffisante)
-
8/19/2019 Chancelor Expo
12/15
12
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
• @oit dans le terrain support (tassement)
%n doit s’arranger pour que les tassements soient de fai!les amplitudeset répartis uniformément.
emarques :
>omme solution, il faut faire une création de Roints de tassements (RN)ou de ruptures (R), dans lesquels on esp"re que se circonscriront leséventuels mouvements sans désordres.
• >ertaines structures s’adaptent plus facilement au+ déformations
du sol que d’autres
• n sol se déforme plus ou moins suivant la nature de la sollicitationtransmise par la fondation, donc de la nature de la fondation : unesemelle isolée transmet des efforts plus grands que ceu+ d’unradier S
• @i on prévoit sur un même sol $ la fois des semelles isolées ou
filantes et un radier, il est fondamental de prévoir des joints deruptures
• 0our une fondation profonde il faut déterminer les couches de !onsol sur lesquelles l’ouvrage sera fondé
%n admet que pour qu’une structure se comporte normalement:
• Les tassements d’ensem!le ne devront pas e+céder ;cm
• Les tassements différentiels ne devront pas e+céder 2cm
(*n effet toutes les structures se déforment)
#ucun désordre n’est $ craindre si :
• @tructure # : N9GT A3555 portée
• @tructure rigide de voile # : N9GT23555 portée
• @tructure métallique : N9GT 63555 portée
>harges et réactions sur les fondations:
-
8/19/2019 Chancelor Expo
13/15
13
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
;. >onseils sur l’implantation des fondations:
Cauvaise solution:
l’ouvrage repose sur des
sols de natures
différentes
-
8/19/2019 Chancelor Expo
14/15
14
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
onne solution: les
fondations de
l’ouvrage sont toutes
implantées dans le
!on sol
9ans cette solution le
tassement différentiel
est possi!le : les
fondations reposent
certes sur un rem!lai
ancien, mais celui-ci
masque une couchecompressi!le et peu
résistante U on doit donc
implanter cet ouvrage
dans la couche de
graviers.
-
8/19/2019 Chancelor Expo
15/15
EXPOSE DE GEOTECHNIQUE
isque de tassements
différentiels car
l’épaisseur de rem!lai
est en effet tr"s varia!le
sous les deu+
fondations
Ris'ues de s0is&es( actions accidentelles se manifestant sous laforme de forces hori/ontales (sur l’ensem!le de la structure ou sur certains éléments seulement de celle-ci). Il est recommandé
• que les points d’appuis d’un même !loc de constructions soient
solidarisés par un réseau !idimensionnel de longrines, afin d’éviter les déplacements relatifs.
• 9e constituer des ensem!les monolithiques
• 9e ne pas chercher $ diminuer l’hFperstaticité de la structure
8ota: les r"gles parasismiques diff"rent évidemment selon le sol defondation rencontré.
CONCLU*ION
Les fondations représentent un enjeu essentiel dans la confection et ladura!ilité des ouvrages, car elles forment la partie structurelle qui
s’oppose au tassement et au+ infiltrations. @elon la capacité portante,
les forces mises en jeu et les tassements admissi!les, le constructeur
choisira une solution du tFpe fondation superficielle ou profonde, qui
diff"rent par leur géométrie et leur fonctionnement.
*n dernier recours, si le sol en place ne poss"de pas les qualités
suffisantes pour qu'on puisse F fonder l'ouvrage, des techniques de
renforcement des sols sont utilisa!les.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique)https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique)