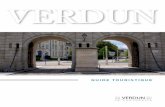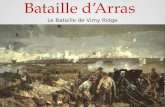Catalogue Bataille musée Zervos 2012.pdf
-
Upload
gerardo-cordoba -
Category
Documents
-
view
54 -
download
3
Transcript of Catalogue Bataille musée Zervos 2012.pdf
sous le signe de bataille
masson•
fautrier•
bellmer
musée zervosrue Saint-Étienne
vÉzelay27 juin - 15 novembre 2012
2 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Métamorphoses, 1928Huile sur toile, 59,5 x 73 cmCollection particulière, courtesy galerie Jean-François Cazeau, Paris
• 3
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
PréFACe
e musée Zervos, géré par le Conseil Général de l’Yonne, a été ouvert rue Saint-Étienne à
Vézelay, en 2006. Il présente une collection cohérente d’art moderne à Paris entre 1925
et 1960, léguée à la commune de Vézelay par Christian Zervos (1889-1970) et offre un
lieu de mémoire pour le dernier occupant de cette demeure, l’écrivain Romain Rolland (1866-
1944). Depuis, il a élargi, par des acquisitions, ses intérêts aux architectes, artistes, poètes qui
gravitèrent autour d’eux : Jean Badovici, Le Corbusier, Fernand Léger, Paul Éluard. Notre der-
nier achat, un tableau de Louis Marcoussis, Papillon de nuit, a été rendu possible par la partici-
pation du Fonds national du patrimoine et du Fonds régional d’acquisition des musées. Ce sont
des subventions déterminantes, mais aussi une marque essentielle de reconnaissance notam-
ment de la part de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la culture et de la communication,
que je remercie sincèrement. Mes remerciements s’adressent également à la sous-direction des
Musées de France, à la DRaC de Bourgogne, et au Président de la Région Bourgogne. L’ensemble
de ces aides récompense la politique de reconstruction et de développement du musée menée
par le Conseil Général de l’Yonne avalisant les propositions averties du conservateur.
aujourd’hui, nous nous proposons d’intégrer à notre patrimoine l’écrivain Georges Bataille
(1897-1962) qui est inhumé à Vézelay. Il y arriva en 1943 et il s’y installa durablement de
1945 à 1949. Ensuite, il y revint irrégulièrement. La célébration du cinquantenaire de la
disparition de ce Bourguignon d’occasion, anime Vézelay, du printemps à l’automne, par des
conférences et des lectures organisées par Christian Limousin et le groupe Lire Bataille, à La
Goulotte, maison des Zervos, à la Maison Jules-Roy et à la Cité de la Voix.
L’exposition place sous le signe de Bataille, la présentation d’œuvres de Masson, Fautrier
et Bellmer, choisies par Christian Derouet conservateur du musée. Je voudrais remercier les
ayants droit de l’écrivain et des artistes, les directeurs du Musée national d’art moderne au
Centre Pompidou, du musée d’art moderne de la Ville de Paris, les prêteurs particuliers, les
galeristes, d’avoir confié d’aussi belles œuvres, les spécialistes qui ont accepté d’écrire des
présentations à l’intention de nos visiteurs et enfin la direction administrative et l’équipe du
musée Zervos de la réalisation de cette manifestation.
Le catalogue que nous publions s’inscrit dans la suite du Zervos et l’art des Cyclades, ouvrant
la possibilité d’offrir progressivement une collection de cahiers annuels à nos visiteurs car
nous savons que nombre d’entre eux, venus une première fois, y reviennent.
aNDRÉ VILLIERS
Président du Conseil Général de l’Yonne
L
4 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Massacre, [1932]Fusain, 48,1 x 63,8 cmDédicacé à l’encre noire en bas à droite : « À madame Zervos / en hommage : André Masson ». Legs Zervos. MZ 173
L’œuvre d’andré Masson (Balagny-sur-Thérain – Oise, 1896-Paris, 1987) est représentée au musée Zervos par un dessin dédicacé à Yvonne Zervos. Dans Cahiers d’art, n° 6-7, 1932, ce dessin illustrait l’article de Christian Zervos, « À propos des œuvres récentes d’andré Masson » : Lorsque Masson intitule un de ses tableaux Massacre, il ne cherche qu’à signifier sa vision par un tumulte de formes auxquelles s’associe une longue suite d’émotions. Cela lui permet de s’élever à l’abstraction sans jamais quitter le côté matériel des choses. En 1933, Zervos organisait une vente aux enchères à l’hôtel Drouot pour sauver Cahiers d’art, au cours de laquelle il sacrifiait une nature morte post-cubiste peinte par l’ar-tiste en 1923, Verres et cartes postales. La documentation du musée conserve une lettre de Masson non datée adressée de Lyons-la-Forêt à Zervos (MZ doc. 138) et un manuscrit autographe pour la mise en scène de Médée, opéra de
Darius Milhaud créé à anvers le 8 mai 1940 (MZ doc. 139). Ces traces rendent compte de l’appui dont le peintre bénéficia à Cahiers d’art, de 1929 à 1933, et de sa réapparition en 1938 dans Histoire de l’art contemporain de Cézanne à nos jours, où Zervos lui mesurait ses mérites : Après avoir subi la loi du cubisme, à travers Juan Gris, André Masson a poussé ses recherches du côté du subconscient. Les moyens plastiques qu’il avait empruntés au cubisme ne répon-daient plus à son besoin d’exprimer les hallucinations d’une sensibilité hypertendue, presque morbide, où l’objet devenait sujet, où la lumière subjective inondait l’apparent et le transformait. Son écriture, devenue presque automatique, aboutissait à un gra-phisme exaspéré, tendu à se briser. La parution des planches de la Mythologie de la nature dans Cahiers d’art, n° 5-10, 1939, mettait un terme à ce regain d’intérêt.
C. D.
• 5
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
a perspective d’un colloque permet d’introduire Georges Bataille au musée Zervos. Il avait arpenté la grand-rue pendant ces décennies où Vézelay
était fréquentée par des personnalités d’exception. Dans ce gros bourg pittoresque, un désir de détente avait, en effet, conduit dès les années 1930 un architecte, Jean Badovici, une figure littéraire, Romain Rolland, et un éditeur d’art, Christian Zervos, à y aménager leur villé-giature. Ils y vécurent isolés les uns des autres, loin des grèves du Front populaire et de la désastreuse insurrec-tion espagnole. En septembre 1939, à la déclaration de guerre, Le Corbusier et son épouse prirent pension à l’auberge du Cheval Blanc. L’invasion foudroyante par la Wehrmacht provoqua avec l’exode d’éprouvants retours à la terre. Nusch et Paul Éluard trompèrent plusieurs fois les rigueurs de l’Occupation ici : le ravitaillement sem-blait plus assuré et le couvre-feu, moins rigoureux. En 1943, Georges Bataille y séjournait à son tour, ajoutant un caractère à ce théâtre d’ombres. À l’armistice, il y revint, menant une déstabilisante réflexion, La Part maudite, et créa une revue, Critique, austère maillon du redressement intellectuel.
Comble d’un conservateur-bibliothécaire, soigner ses envois pour des livres à tirage limité colportés sous le manteau ? C’est par l’imprimé que Bataille lia son nom à des peintres encore peu représentatifs. Masson, Fautrier et Bellmer éprouvèrent successivement des affinités li-bertines pour ses contes érotiques. Le contact opérait à double sens dans ces réalisations clandestines où l’impri-meur risquait saisie et poursuite. Masson sollicitait un essai de Bataille pour accompagner les gravures de Sacri-fices et Bellmer tentait de l’intéresser à ses dessins quand il lui fut proposé d’illustrer Histoire de l’œil. Ce sont eux qui, sous le signe de l’écrivain, investissent la maison du jardinier et les vitrines du logis principal.
andré Masson était, comme l’établit Camille Morando, un ami de Bataille. Dès la revue Documents (1929-1930), une commune méfiance les avait confortés dans la « dis-sidence » pour dépasser le conflit esthétique du jour : surréalisme contre abstraction. En mai 1935, Bataille retrouvait Masson à Tossa del Mar, en Catalogne. Ils firent d’un hybride anthropomorphe dépourvu de tête, acéphale, leur raison sociale. La qualité des dessins de Masson réunis par Yves de Fontbrune commence avec un dessin automatique. Masson en transposait l’invention graphique sur les cuivres de L’Anus solaire où grouillent d’improbables animaux. Sa verve s’exacerbait ensuite en
d’obsédants Massacres. Puis Masson élabora ses propres mythologies : dans l’ouate de l’Olympe, il pastichait les classiques allégories en de grands dessins au trait, desti-nés à de futurs albums. avec Picasso, il avait découvert que devant les bacchanales, les enlèvements et les viols sadomasochistes, affublés du masque du Minotaure ou de l’acéphale, le censeur hésitait à user des ciseaux.
Jean Fautrier croisa Bataille sans vraiment se com-promettre. Ses premières peintures, dont Marcel-andré Stalter retrace le périple, avaient dressé du non-dit de la condition féminine un constat impitoyable : vieilles épuisées, femmes battues, femmes à l’abattage dans les maisons closes. Sans égard, il pendait au crochet de la bou- cherie cette viande sur pied auprès des carcasses de mou-ton, puis la replongeait dans les ténèbres, à la recherche de la lointaine ancêtre du temps des cavernes. Il reniait cet univers sans joie quand la librairie auguste Blaizot l’invita à fournir des vignettes pour Madame Edwarda et L’Alle-luiah. Catéchisme de Dianus. Fautrier esquiva la censure en couvrant des liasses de feuillets d’une plume prime-sautière avec des bambochades moins lascives que bur-lesques.
Fabrice Flahutez catalogue l’œuvre gravé et dessiné de Hans Bellmer. Il reconstitue patiemment des corres-pondances tronquées, émiettées dans les ventes aux en-chères, revivant l’anxiété de cet allemand à la merci d’une simple dénonciation pour fignolage d’inavouables images. Les bribes publiées ici laissent entrevoir la minutie avec laquelle Bataille et lui élaborèrent l’iconographie pour Histoire de l’œil. après Die Puppe (La Poupée), méditant la Petite anatomie de l’inconscient physique ou l’Anatomie de l’image, Bellmer proposa à l’acéphale mâle de Masson- Bataille une distorsion femelle, l’ignoble céphalopode.
Les inventions de Masson, de Fautrier et de Bellmer commentaient une part minime de l’œuvre de Bataille et leur parution coïncidait avec la Libération. En endos-sant des pages qu’aucun chartiste jusqu’ici n’avait osé signer, ils participèrent au combat contre l’interdit et ils délivrèrent ensemble, avec leurs Massacres ou Monstre rouge, l’érotisme des « enfers » pornographiques de nos bibliothèques pour le restituer au domaine public.
CHRISTIaN DEROuET
INTroDuCTIoN
L
6 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Les Chrysalides, [1927]Encre de Chine, 21 x 26,5 cmTitré en bas à gauche au crayon : Les chrysalidesSigné en bas à droite au crayon : André MassonCollection privée
Ces deux dessins ne sont pas exposés.
andré Masson, étude pour Massacre, [ca. 1932] Encre de Chine sur papier calque, 24,5 x 32,5 cmMonogrammé en bas à gauche : A. M. Collection privée
andré Masson,Trois pointes sèches pour Georges Bataille, L’Anus solaire, 1931
• 7
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
vers ACéPhAle eT le Collège De soCIologIe :BATAIlle, mAssoN eT les DIeux quI meureNT
eorges Bataille et andré Masson se rencontrent à la fin de l’année 1924 par l’intermé-
diaire de Michel Leiris dans l’atelier parisien du peintre, une des chapelles partici-
pant du surréalisme naissant d’andré Breton. Contrairement à ses deux amis, Bataille
juge illisible le Premier Manifeste du surréalisme de Breton et restera en marge du mouvement.
Masson se souvient que, en 1924, Bataille avait déjà en vue un autre combat, plus secret, et sans
doute, plus profond. En 1925, leur amitié se scelle au moment où Bataille échange des dessins
érotiques pour acquérir auprès du marchand du peintre, Daniel-Henry Kahnweiler, L’Armure
de Masson (1925) dont le corps devenu spectral annonce le sacrifice. Leur passion commune
pour les lectures de Sade et de Nietzsche augure de leurs futures collaborations. Prenant ses
distances avec Breton dès 1928, pour finir par rompre en février 1929, Masson rejoint Bataille
dans la dissidence – la parution d’Histoire de l’œil par Lord auch (Georges Bataille) en 1928
avec huit lithographies originales non signées (de Masson) en est la manifestation, magistrale
et clandestine. Dans ses compositions, Masson poursuit la ligne errante de l’automatisme,
tout en affichant un érotisme cru et explicite qui renvoie autant aux écrits de Sade qu’à ce
récit de Bataille. Premier illustrateur de Bataille, il poursuit l’échange avec trois pointes sèches
pour L’Anus solaire, écrit au même moment qu’Histoire de l’œil et publié en 1931 : s’éloignant
de l’illustration du texte de Bataille, Masson, par un dessin nerveux et griffé, s’approprie les
visions évoquées en se fondant notamment sur un « sexualisme tellurique ».
Leur troisième collaboration, Sacrifices, ouvrage conçu dès 1933 et publié après maintes
vicissitudes en 1936 chez Guy Lévis Mano, radicalise le principe. Bataille impose le « moi, qui
meurt », analysant les liens inhérents du vide, du temps, de la vision extatique religieuse, de
l’amour brûlant, de la révolte arrachant « à Dieu son masque naïf », de la catastrophe repré-
sentée par un squelette armé d’une faux ayant découpé une tête, sans jamais citer les divinités
cruelles et sacrifiées choisies par Masson pour les eaux-fortes (Mithra, Orphée, le Crucifié, le
Minotaure et la Vierge et Osiris). Transposant la consumation du moi de Bataille, les gravures
de Masson, dans la lignée de la série des Massacres, exposent un univers extatique : duel
incessant, douloureuses déformations du corps, les étoiles et le soleil, association du sacrifice
à l’érotisme. Ensemble, ils élaborent une vision nouvelle et sombre de la mythologie – celle de
dieux qui s’aiment et qui meurent. Cette démarche va les conduire à la création du person-
nage d’acéphale et à la quête d’une anthropologie du sacré théorisée par Bataille au Collège
de sociologie.
Si, depuis les années 1920, des acéphales sont présents dans la production du peintre et
si « le bas matérialisme et la gnose » (Documents, 1930) de Bataille montrait entre autres une
G
8 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
empreinte d’intaille gnostique représentant le dieu acéphale égyptien Bès, il faut attendre
le second séjour de Bataille en 1936 chez Masson, installé en Catalogne depuis 1934, pour
que naisse véritablement le personnage acéphale. Bataille, suite à l’échec du groupe Contre-
attaque, expose à Masson le projet de la revue Acéphale, qui réhabilite Nietzsche alors
accaparé par les fascistes. L’acéphale qu’ils inventent est un homme sans tête qui stigmatise
une société sans chef, une communauté sans Dieu. Bataille décrit et Masson dessine « sur-
le-champ ». Ni homme, ni dieu, acéphale naît de l’idée de sacrifice, comme la conjonction de
l’érotisme et de la mort. S’opposant au fascisme (politique monocéphale absolue), acéphale,
foudroyé ou foudroyant, vision solaire ou émanation souterraine, au corps athlétique
d’Hercule, est présenté décapité et victorieux. Doté de ses instruments du sacrifice (cœur-
grenade et poignard), acéphale ne mutile personne d’autre que lui-même : la révolution est
à mener contre soi pour s’opposer à la débâcle. Parmi les dessins de Masson, dont plusieurs
utilisent le décor des hauteurs de Montserrat, six seront publiés dans la revue éponyme, qui
produit cinq numéros (juin 1936-juin 1939).
autour de Bataille se préparent alors deux entités, qui demeurent toutefois indépendantes :
en juillet 1936, la société secrète acéphale à laquelle Masson restera étranger (son dessin
Acéphale sert d’emblème aux textes de la société) et, au début de 1937, un groupe dont la
« Déclaration relative à la fondation d’un “Collège de sociologie” » est publiée dans Acéphale
(n° 3-4, juillet 1937). Fondé par Bataille, Michel Leiris et Roger Caillois à Paris, le Collège
de sociologie, en tant qu’organisme de recherches, se propose de définir « la sociologie
sacrée » et d’étudier les manifestations du sacré, au moment où l’étreinte fasciste se refermait sur
l’Europe. Du 20 novembre 1937 jusqu’en juillet 1939, il propose vingt-six conférences
rassemblant un auditoire éclectique, écrivains, poètes, critiques, philosophes ainsi que les
artistes andré Masson, Taro Okamoto et Isabelle Waldberg.
Masson va poursuivre dans ses œuvres la vision commune invoquée et entreprise dès 1928
avec Bataille, fondée sur la notion de « dépense inconditionnelle ». En 1940, dans l’ouvrage
collectif consacré au peintre, Bataille confie : Là où souffle un vent qui brise la faible voix de
l’esthétique, Masson ne se retrouverait pas avec Matisse ; il ne se retrouverait pas avec Miró ; là, ce
qui parle avec toute la force en lui résonnerait avec les voix agressives d’Héraclite et Blake, avec la
voix de nuit et de soleil de Nietzsche.
CaMILLE MORaNDO
• 9
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Georges Bataille, Sacrifices, 1936. G. L. M. (Guy Lévis Mano). Paris. In-2 (463 x 350 mm). En feuilles, sous couverture en carton rouge avec atta- ches en toile rouge, imprimée en noir sur le frontispice. andré Masson, 5 eaux-fortes en sanguine ou en noir (295 x 250) : Mithra (280 x 230), Orphée (315 x 245), Le Crucifié (310 x 218), Le Minotaure et la Vierge (309 x 245), Osiris [1933], signées au crayon sur japon impérial ou non signées sur vélin d’arches. (Les 2e, 3e, 4e et 5e gravures sont numérotées II, III, IV et V dans le cuivre). Impression : 3 décembre 1936. Presses des Éditions GLM Paris, pour le texte et la typographie ; J.-J. Tanneur, pour les gravures. Laurence Saphire, Patrick Cramer, André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, Patrick Cramer, 1994, n° 11, Sacrifices, 1936.Collection Yves de Fontbrune. Première de couverture et page de titre.
• 11
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Planche II : Orphée
Planche IV. : Le Minotaure et la Vierge
Planche III : Le Crucifié
Planche V : Osiris
12 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
insi s’est constituée cette collection, je préférerais dire en transposition littérale et sans doute mala-droite de l’italien cette « récolte » d’une quinzaine
de dessins d’andré Masson.
À cette époque, j’étais marchand, les œuvres se pré-sentaient dans les ventes ou les foires, aux hasards de cette vie très concrète et pleine d’aléas économiques, entraînant fréquemment des associations temporaires avec des confrères autour d’acquisitions, qui ainsi se peuvent multiplier : sociétés commodes sur le moment mais qui ensuite obèrent désir éventuel et surtout liberté de les conserver.
Car pour les œuvres dont on a la jouissance, le temps est le cœur, et comme un filtre du désir, ou pour exclure ou pour confirmer l’adhésion première. ainsi, certains dessins ont été achetés, revendus, souvent regrettés et parfois, des années plus tard, sont revenus, cette fois pour entrer dans la « collection».
ainsi l’escarpin surréaliste de La mer se retire, planche XVII d’Anatomie de mon univers parti pour l’amérique, en a-t-il fait retour, ainsi La Naissance de la Femme, assez chérie, cédée en son temps par amitié à feu mon voisin de la rue du Dragon, le singulier marchand-poète Clarac-Sérou, a-t-elle pu réapparaître par la grâce d’une vente à Londres et cesser enfin d’avoir disparu !
aucun esprit de système donc : des occasions, un goût se développant pour ces encres de Chine des années trente et quarante, pour les pages surtout de ces grands albums, tracées pour ces Mythologies tant de la « Nature » que de l’« Être », pour cette Anatomie de mon univers, albums qui sont aussi comme des messages à lentement déchiffrer, dans le plaisir de leur mystère.
Voici je crois ce qui m’a paradoxalement attiré dans l’œuvre d’andré Masson : le manque de facilité à l’aborder, non point tant par d’objectives difficultés qu’elle pourrait présenter mais à cause de notre impréparation face à ce qui l’inspire. Comme les artistes du passé plongés dans la tradition, et avec une conscience justement jalouse de leur « sécurité spatiale » irrémédiablement perdue, andré Masson, tournant le dos de façon résolue aux
abstractions géométriques où il ne voit que décoration, cherche pour sa part l’inspiration dans la culture et dans la nature.
Rien d’artificiel dans ce mouvement qui est celui même de son sang, tordant le cou à toute mièvrerie, quitte à provoquer, dans un « paroxysme expressionniste » sou-vent des plus grinçants, comme il le reconnaît : les tau-reaux de notre Estocade (1937) et de Mithra (Sacrifices I) me paraissent illustrer cette désagréable intrusion. aussi la violence sexuelle mêlée de provocation religieuse de la Naissance de la Femme ou du Crucifié (Sacrifices III).
Il n’est qu’à lire les souvenirs de guerre livrés tardive-ment par andré Masson pour comprendre que cette table rase définitive de l’ancien monde, aussi absurde que bes-tialement sanglante, a marqué d’une façon indélébile son être et son art, dramatique épisode dont ne témoigne pas son art dans l’immédiat après-Grande Guerre, mais trau-matisme resurgissant déjà dans la thématique du milieu des années vingt, oiseaux blessés, chevaux morts, dans les Sables (1927-1928) marqués de taches de sang, pre-nant toute la place dans les Massacres, contemporains des dessins et gravures de Sacrifices (ca.1933). Cette violence de cauchemar, cette vengeresse dérision de ces valeurs civilisées d’avant 14, au lieu de contenir, ont au contraire habillé la tuerie et vont continuer ce travail sinistre et bientôt bénir les assassins en son ocre Espagne si charnellement aimée !
Mais la Nature, son observation si minutieuse, ses longs après-midi passés à scruter le microcosme des insectes dont il fait le sujet de vastes tableaux le ramènent aux forces qui depuis des millénaires sauvent l’homme de lui-même, à la Terre nourricière qui délie les puissances du Mythe, qui permet la magie du rêve, toujours pour andré Masson mêlé d’une poussée de sève charnelle, affirmation du désir de vie.
Il n’est qu’à regarder l’aquarelle intitulée Auvergne, peinte à Freluc (Cantal), où le peintre et sa famille s’étaient réfugiés lors de l’exode de 1940 pour y voir, au-delà du décor bucolique et apaisant de ces montagnes la cadence des cascades, la torsion des torrents […], la transfiguration de toutes choses apportées par la brume.
A
ColleCTIoNNer les DessINs De mAssoN
Le plus grand voyageur est celui qui ne sait où il va. Le plus curieux est celui qui ne sait où il regarde.
Tchouang-Tseu, cité par andré Masson.
• 13
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
La transfiguration, c’est justement cette figure humaine qui transparaît en manière d’Éole du chaos des rocs, ou en Ondine – petite déesse au panthéon surréaliste – du jaillissement des eaux : mythologies grecque ou germa-nique, réminiscences du classicisme comme du roman-tisme allemand, culture dans la nature, nature dans la culture. Cette image d’Auvergne, une femme sans aucun doute, surgissant dans les hauteurs redevenues sau-vages de cette paisible province, précède de peu dans la
chronologie nos dessins caraïbes de 1941 : Jungle, Mar- tinique et Le Balisier où une antillaise aux yeux clos, vêtue seulement d’un fichu de coton, mêle sa touffe foisonnante aux lianes et feuillages d’une forêt tropicale, où rampent d’étranges pistils bien membrés, tandis qu’une main végétale empoigne son sein.
YVES DE FONTBRuNE
Georges Bataille, L’Anus solaire, 1931. Illustré de pointes sèches par andré Masson. Vignettes d’après un bois d’andré Derain représentant le monogramme HK placé entre deux grandes coquilles. Éditions de la galerie Simon, 29 bis, rue d’astorg, Paris, 1931. In-4° (251 x 200 mm). Broché sous couverture en papier, imprimé en noir sur le frontispice. Trois pointes sèches en bistre (136 x 134, 136 x 109, 136 x 109) non signées. Impression : 25 novembre 1931. G. Girard, Paris, pour le texte et la typographie ; Charlot Frères, pour les gravures. Laurence Saphire, Patrick Cramer, André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, Patrick Cramer, 1994, n° 7. L’Anus solaire. 1931. Exemplaire n° 38, signé au crayon encre : Georges Bataille.Collection Yves de Fontbrune. Page de couverture et page de titre.
Disposition typographique adoptée pour prévenir l’intervention éventuelle du censeur ? La première de couverture est presque muette : seuls s’y affirment l’auteur et le titre du texte, (écrit en 1927). Sur la page titre, à l’intérieur, s’y ajoutent les noms de l’illustrateur et de l’éditeur.
14 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Dessin automatique, 1927Encre de Chine, 43 x 31 cmMonogrammé en bas à droite au crayon : A. M. Collection Yves de Fontbrune
• 15
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Naissance de la femme, 1938Encre de Chine, 28 x 38 cmInscription en bas à droite à l’encre : La lampe file / La tête se décolle / Le phallus brille / Une femme est née (Novalis)Monogrammé à l’encre en bas à droite : A. M.Collection Yves de Fontbrune
16 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Chimère, [1938]Encre sur papier bleu, 31,5 x 24 cmSigné à l’encre en bas à droite : André MassonCollection Yves de Fontbrune
• 17
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Estocade, 1937Encre de Chine, 51 x 67 cmSigné en bas à droite : André MassonCollection Yves de Fontbrune
Dessin de référence pour Numancia, élément des décors et des figures par André Masson pour la tragédie de Cervantès, Numance, au Théâtre-Antoine, mise en scène de Jean-Louis Barrault, 22 avril-6 mai 1937, et pour la couver-ture du catalogue de l’exposition André Masson, Espagne 1934-1936, galerie Simon, 29 bis, rue d’Astorg, 7-19 décembre 1936.
18 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Près des signes de feu, mai-juin 1938Encre de Chine, 50 x 65,4 cmTitré au crayon en haut à gauche au verso : p. des signes de feu Signé en haut à droite au verso : André Masson Juin 1938Collection Yves de Fontbrune
0nzième planche de Mythologie de la nature par andré Masson (mai-juin 1938), Cahiers d’art, n° 5-10, 1939, non paginé. llustration de « Prestige d’andré Masson » par andré Breton dans André Masson, Rouen, achevé d’imprimer, le 5 avril 1940, p. 111.
Nomenclature sous le frontispice, établie par André Masson, in Cahiers d’art, n° 5-10, 1939, avec des précisions portées par l’éditeur. Pour la première planche : Coll. Dr Lacan ; pour la huitième : Coll. Mme L. Salacrou ; pour la douzième : Coll. Mme Mary Callery.
À la source de la femme aimée À la fois le piège et la proie Rejetée par la merApporté par l’oragePose la main sur la montagneÉcoute la pluie nourrice des abeillesVois l’antre des MétamorphosesIl n’y a pas de monde achevéSur les rives de l’ennui Il y a le charme et le chêne enlacésPrès des signes de feuSe reflétant dans l’œil du marécage Assis dans ton jardin tu deviendras…Forêt.
• 19
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, La mer se retire, 1941Encre de Chine, 50,5 x 64 cm [à vue]Signé daté en bas à droite : André Masson / 1941Collection Yves de Fontbrune
André Masson, Anatomie de mon univers / Anatomy of my Universe. New York. Éditeur Curt Valentin, 1943, ch. IV : The Theme of Desire, planche 17 : The Sea Recedes.
20 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, La Fraternité des règnes, 1940Encre de Chine, 51 x 67 cmSigné en bas à gauche : André MassonCollection Yves de Fontbrune
André Masson, Anatomie de mon univers / Anatomy of my Universe. New York. Éditeur Curt Valentin, 1943, ch. I. : The Demon of Analogy, planche 1 : The Fraternity of the National Kingdoms.
• 21
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Dans le pur néant, à la cime de l’être, 1939Encre de Chine : 62,5 x 47,5 cmSigné en bas à droite : André MassonTitré au crayon en haut à gauche au versoCollection Yves de Fontbrune
André Masson, Mythology of Being. A Poem. New York, Wittenborn and Com-pany, 1942. Eight pen and ink drawings and a frontispiece by André Masson.Planche I : Dans le pur néant / à la cime de l’être. // In the Pure Void / On the Peak of Being (traduction anglaise par Eugène Iolas).
22 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Auvergne, à Freluc, 1940aquarelle, 57,5 x 43 cm [à vue]Signé et daté en bas à droite au crayon : André Masson 1940 Collection Yves de Fontbrune
Mai 1940, Masson quittait Lyons-la-Forêt (Eure) pour se réfugier à Freluc (Cantal) dans la maison de Bataille.
• 23
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, La Nostalgie de la mer, 1940aquarelle, 47,5 x 62 cmTitré, signé et daté à l’encre en bas à gauche : La nostalgie de la mer / André Masson 1940Collection Yves de Fontbrune
24 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Le Langage des fleurs, 1941Fusain, 44 x 31,5 cmTitré en haut à gauche au crayon : Le langage des fleurs Signé en bas à gauche au crayon : André MassonVerso : Nu féminin, pastel.Collection Yves de Fontbrune
Georges Bataille, Le Langage des fleurs (à propos des photographies de M. Bloosfeld), Documents, n° 3, 1929. p. 160-164 : […] D’autre part, les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des organes sexués. C’est ainsi que l’intérieur d’une rose ne répond nullement à sa beauté extérieure, que si l’on arrache jusqu’au dernier les pétales de la corolle, il ne
reste plus qu’une touffe d’aspect sordide. D’autres fleurs, il est vrai, présentent des étamines très développées, d’une élégance indéniable, mais, si l’on avait recours, une fois encore, au sens commun, il apparaîtrait que cette élégance est celle du diable : ainsi certaines orchidées grasses, plantes si louches qu’on est tenté de leur attribuer les perversions humaines les plus troubles […].
• 25
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Jungle, Martinique, 1941Fusain, 64 x 48,5 cm [à vue]Signé en bas à gauche à l’encre : André MassonCollection Yves de Fontbrune
26 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Forêt, Martinique, 1941Encre de Chine, 58 x 45 cmSigné et daté en bas à droite : andré Masson. / Martinique 1941 Collection Yves de Fontbrune
Fourrure arborescente de la terre éventrée éventail de désir élan de sève oui c’est la roue de lourde feuille dans l’air fruité. Interroge la sensitive elle répond non mais rouge au cœur de l’ombre vaginale règne la fleur charnelle du balisier – le sang s’est coagulé dans la fleur insigne. Lave spermatique il t’a nourri pétrissant le verre banal la main du feu l’irisait de mortelle nacre. La grande main caresse le sein du morne à moins qu’elle ne soit ta croupe Vénus d’anthracite elle irrite le crin des palmes Soulève la plume des frondaisons et se glisse Sous la toison amoureuse de l’énorme Sylve.
Antille (1941), un des deux textes d’André Masson publiés dans André Breton, Martinique charmeuse de serpent, Paris, Éditions du Sagittaire, 1948. Ce recueil reproduit des dessins d’André Masson.
• 27
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
andré Masson, Le Balisier, 1941 Encre de Chine, 50 x 37,5 cm [à vue]Titré à l’encre en haut à droite : Le Balisier Signé et daté à l’encre en bas à droite : André Masson. 41Collection Yves de Fontbrune
En mars-avril 1941, André Breton et André Masson passèrent trois semaines en Martinique.
28 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Buste aux seins, 1929Bronze, 40 x 20 x 18,5 cm6 ex. numérotés et signés. Fonte : GI. BI. ESSE, VéroneDon de l’artiste 1964. Musée d’art moderne de la Ville de Paris, n° inv. : aMS 426
© MUSÉE D’ART MODERNE / ROGER-VIOLLET
• 29
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
l’eNlèvemeNT De lA roBe
l y a quatre-vingt-dix ans, Fautrier exposait au Salon d’automne et Bataille devenait archi-
viste-paléographe. Il y a quatre-vingt-dix ans était découverte à Lespugue la Vénus d’ivoire
qui transforma la préhistoire. Le primitivisme modifia les principes mêmes de l’École.
Fautrier abandonna vers 1926 le naturalisme patent dans La Concierge endormie. On voit aussi
dans cette exposition le Portrait de Fernande (1923), modèle de Montparnasse.
Il existait aussi en 1923-1924 de puissantes études de nu, dont on signala la « beauté
bestiale ». Celle du Musée national d’art moderne caractérise les modèles les plus fréquents
à cette époque par son épanouissement charnel. En revanche, la sanguine de dos est très
simplifiée, sans bras ni jambe. Le dos peint, daté de 1925 exhibe des hanches bien envelop-
pées évoquant les formes du quaternaire. Bataille parlera de stéatopygie « monstrueuse ».
On comprend la réaction de Michel Ragon rendant visite à Fautrier en 1957, au lendemain
de l’exposition des Nus de 1955 : […] les Nus de Fautrier sont exagérément nus, parce
qu’ils ont principalement des seins et des bourrelets de chair (Fautrier, Éd. Le Musée de Poche,
1957, p. 33).
Depuis la Première Guerre mondiale, la représentation sans fard des « choses sexuelles »
(G. Bataille, Histoire de l’œil, 1928) connaît un progrès persistant ; il n’est compromis qu’après
l’armistice de 1918 – cheveux très courts, poitrine très plate –, puis l’instinct reprend
ses droits : Sachez d’un coup toute la vérité, il y a des seins !, écrit Colette (Demain, août 1924).
La sensualité disparaîtra, durant la Seconde Guerre mondiale, devant la férocité du désir
auquel la femme convie désormais. Madame Edwarda de Bataille (édité en 1945) est une pros-
tituée de haut vol ; elle exhibe ses « guenilles », parures de cette « araignée velue et rose »
pour laquelle on fait tant.
L’excès de présence féminine s’est imposé chez Fautrier dès 1927 : en témoigne la brutale
effigie présente à l’exposition. On en a aussi quelque idée avec La Jolie Fille du musée d’art
moderne de la Ville de Paris, datée de 1928 ; grimaçante, les seins comme des outres et dis-
symétriques, elle fut reproduite en juillet 1930 dans la revue Formes. une autre érotisation et
une platitude toute pariétale s’exhalent du Nu couché (Musée national d’art moderne) ; il est
présenté comme un « fruit dans un plat », notait-on en 1931. La présentation manducatoire
du Nu couché évoque l’introduction d’Histoire de l’œil où la jatte de lait destinée au chat sert à
l’ablution intime de Simone. J’étais anxieux des choses sexuelles, dit le narrateur ; de ce simple
aveu, il va tirer une véritable théorie : Il faut le système et il faut l’excès. L’exemple de la robe
éclaire son intention : Je pense comme une fille enlève sa robe ; à l’extrémité de son mouvement
la pensée est l’impudeur, l’obscénité même. La liaison se fait avec Fautrier, qui a dessiné et peint
les femmes qui enlèvent leur robe, depuis les aquarelles sur la prostitution (1924) jusqu’aux
études de 1925, moment où andrée devint le modèle favori.
I
30 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Les circonstances de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à la rencontre du système
et de l’excès. Bataille et Fautrier devaient suivre un chemin parallèle en 1955, quand Bataille
publie Lascaux ou la Naissance de l’art (Éd. Skira) et que Fautrier retrouve de son côté le succès
avec les dix-sept Nus (1945-1955) exposés en 1956 à la galerie Rive Droite ; ils sont souvent
réduits à l’encorbellement de seins volumineux évoquant l’art du quaternaire. Il n’est plus
besoin d’un décrit quelconque, l’excès seul suffit désormais. La peinture, à partir de là, avait le
sens d’une possibilité ouverte allant, en un sens, plus loin que celle de la littérature (G. Bataille, Les
Larmes d’Éros, Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1961, p. 110).
MaRCEL-aNDRÉ STaLTER
Bataille (Georges). L’Alleluiah. Catéchisme de Dianus. Paris, librairie auguste Blaizot, 1947. 18 lithographies et 18 gravures en noir par Jean Fautrier, sur papier d’auvergne pur chiffon. 92 exemplaires, 275 x 210 mm. Rainer Michael Mason, Jean Fautrier, les estampes. Genève-Paris, 1986, p. 73. La typographie est de Frazier-Soye et les lithographies ont été tirées sur les presses de Desjobert. L’artiste a dessiné 100 lettrines litho-graphiées en violet in-texte. Couverture et vignette de la page 37.
• 31
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Le mouton pendu, 1926, huile sur toile, 130 x 80 cm, est l’une des sept photographies confiées à Zervos et restées inédites. Fonds Cahiers d’art. Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris.
Par lettre en date du 18 juillet 1928, Zervos informait le docteur Justi, directeur de la Galerie nationale à Berlin, qu’il organisait pour octobre une exposition à la Maison municipale de Prague de dix-huit jeunes peintres de Paris : sur la liste, il portait le nom de Fautrier entre Max Ernst et Ghika. Quand la galerie de France ouvrit au 2 rue de l’abbaye, à Saint- Germain-des-Prés, Zervos, qui pensait en être le directeur artistique officieux, indiquait qu’elle était destinée à soutenir les efforts des jeunes, de ceux tout au moins parmi eux qui semblent tracer le chemin de l’art de demain. Il citait Fautrier.
Zervos lui consacra un complaisant compte rendu d’exposition : Fautrier est un jeune peintre qu’il ne faut pas condamner sur sa première exposition, comme vient de le faire la grande presse du Petit Parisien à L’In- transigeant. Jusqu’à présent, Fautrier ne montre, en effet, que de petites possibilités et des manières dont il doit se débarrasser le plus tôt possible. Il est très facile de se faire remarquer par une manière personnelle extérieure, mais cette manière ne saurait comp-ter dans l’œuvre d’un véritable artiste. Ce qui intéresse en celui-ci, c’est son esprit et les élans continus de son âme qui lui font changer perpétuelle- ment sa manière. Or, Fautrier nous présente toujours les mêmes recher- ches dans la même manière qui consiste à estomper les choses et à leur don-ner non pas une signification nouvelle mais simplement un aspect particulier au moyen de certains procédés tech-niques qui ne sont ni nouveaux, ni intéressants.Contrairement à certains jeunes pro-diges, Fautrier semble d’un esprit plu-tôt lent et qui s’attache trop à savoir ce que les autres ont pu faire. On a parlé, à propos de son exposition, des influences de Soutine, de Vlaminck, de Seurat, de Carrière et de je ne sais qui encore. Cela provient toujours de l’attachement du peintre au côté extérieur de son art. Nous avons reproché aux surréalistes l’excès d’intellectualisme dans leur pein-ture. L’excès contraire est encore plus néfaste à la peinture.
Je crois de mon devoir d’attirer l’attention de ce jeune peintre sur la voie dan-gereuse dans laquelle il s’est engagé. Il a encore beaucoup de temps et beau-coup de possibilités pour en sortir. Cahiers d’art, n° 8, 1928 : « Fautrier (galerie Georges Bernheim) », p. 354.
Peu après, E.Tériade, un collaborateur de Cahiers d’art chargé de pros-pecter les jeunes artistes, montrait plus de réticence dans « On expose», rubrique qu’il tenait dans le quotidien L’Intransigeant : On prépare ce jeune peintre, il se prépare peut-être lui-même, notamment à dynamiter, dit-on, à décomposer, à détruire à jamais cette vieille pauvre petite chose qu’est pour certains l’esprit de l’Occident. Ceux qui parlent de lui enseignent avec ferveur qu’il émane de sa peinture des poisons dissolvants et destructeurs ! Atten-
dons. Car il faut encore pouvoir détruire quelque chose et jusqu’à maintenant le peintre a, semble-t-il, chargé à blanc ses engins de destruction. Quant aux poisons, ils pourraient bien, d’un jour à l’autre, lui donner des fâcheuses coliques pour le moins excessivement personnelles. Mais Fautrier qui n’est pas sans talent expose ici quelques documents où il fait preuve d’une certaine santé mais bien dissimulée pour les besoins de la cause. L’Intransigeant, 16 décembre 1929, p. 5 : « Fautrier (aux Quatre Chemins, 22, rue Godot-de-Mauroy) ».
En 1934, Fautrier cessait de peindre et d’exposer. Il réapparut pendant la guerre mais il pratiquait désor-mais un style elliptique qui devait le conduire à l’informel. Il se rangeait sous la protection de Jean Paulhan qui publiait Fautrier l’enragé, en deux livraisons du magazine Variété, en 1945-1946.
L’œuvre de Jean Fautrier (Paris, 1898 - Châtenay-Malabry, 1964) est représentée au musée Zervos par un buvard, technique mixte sur papier marouflé sur toile, 50 x 65,4 cm, 1960, Legs Zervos. MZ 71, un don – resté invendu – pour une vente aux enchères organisée par Yvonne Zervos en faveur de Valentine Hugo, le 4 juillet 1963. C. D.
JeAN FAuTrIer eT CAhIers D’ArT, TrACes D’uNe FIN De NoN-reCevoIr
32 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, La Concierge endormie, 1922Huile sur toile, 46 x 38 cmSigné en haut à gauche : FautrierCollection particulière
Fautrier. 1898-1964. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 25 mai– 24 septembre 1989, n° 3. Réalistes des années 20. Musée-Galerie de la Seita, Paris, 1998. p. 54.
• 33
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Portrait de Fernande, vers 1922Huile sur toile, 46 x 38 cmSigné en bas à gauche : FautrierCollection particulière
Fautrier 1925. Musée des Beaux-Arts de Calais, 1986, n° 7. p. 23.
34 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Sans titre [Nu féminin de face], vers 1924 Sanguine et pierre noire sur papier, 64,7 x 49,3 cm Signé en haut à droite : FautrierMusée national d’art moderne, Centre Pompidou, Parisn° inv. : aM 1981-9
Réalistes des années 20. Musée-Galerie de la Seita, 1998. p. [60].
© CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI, DIST. RMN-GP / DROITS RÉSERVÉS
• 35
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Sans titre [Nu féminin de dos], vers 1924Sanguine et pierre noire sur papier, 70 x 47 cmCollection Marcel-andré Stalter
Fautrier 1925. Musée des Beaux-Arts de Calais, 1985. p. 25. Réalistes des années 20. Musée-Galerie de la Seita, 1998. p. [60].
36 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Nu de dos, 1925Huile sur toile, 35 x 26,5 cmSigné daté en bas à gauche en rouge : Fautrier Collection particulière
Réalistes des années 20. Musée-Galerie de la Seita, 1998, p. 61.
• 37
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Petit nu noir de face, [1926]Huile sur toile, 35 x 27 cmSigné en blanc en haut à droite : FautrierCollection particulière, courtesy galerie Jean-François Cazeau, Paris
38 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, La Jolie Fille, 1927Huile sur toile, 92 x 60 cmSigné en haut à gauche : FautrierDon de Fautrier 1964. Musée d’art moderne de la Ville de Paris, n° inv. : aMVP 1488
© MUSÉE D’ART MODERNE / ROGER-VIOLLET
• 39
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, Nu féminin couché, 1929Huile sur papier marouflé sur toile, 81 x 130 cmMusée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, n° inv. : aM 1975-186
© CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI, DIST. RMN-GP / PHILIPPE MIGEAT
40 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Georges Bataille, L’Alleluiah. Catéchisme de Dianus. Paris, librairie auguste Blaizot, 1947. 18 lithographies et 18 gravures en noir par Jean Fautrier, sur papier d’auvergne pur chiffon. 92 exemplaires. 275 x 210 mm. Rainer Michael Mason, Jean Fautrier. Les estampes, Genève-Paris, 1986. p. 73. La typographie est de Frazier-Soye et les lithographies ont été tirées sur les presses de Desjobert. L’ar-tiste a dessiné 100 lettrines lithographiées en violet in-texte. Exemplaire enrichi de trois dessins de nu par Fautrier, le premier est monogrammé, en frontispice ; le deuxième, face à la page 41 ; le troisième, face à la page 59.Collection particulière.
Georges Bataille avait eu à se plaindre du peu d’égards qui lui avait été témoigné par l’éditeur du premier ouvrage en collaboration avec Jean Fautrier, Madame Edwarda. Mason cite une lettre de Bataille à Georges Blaizot datée de Vézelay, 9 novembre 1945 : J’avais accepté de n’avoir qu’un seul exem-plaire à cette condition : que je recevrais environ trois exemplaires non numérotés, formés à l’aide des feuille de passe les moins défectueuses. Vous nous avez présenté, à Fautrier et à moi, que cette façon de faire avait des inconvénients. Je n’ai pas insisté. Mais je m’aperçois maintenant que je n’ai même pas un exem-plaire pour moi (celui qui me sera remis est imprimé aux initiales de la personne à laquelle il est destiné). N’est-ce pas un peu dur ? Qu’en fut-il pour L’Alleluiah ?
Les dessins systématiquement ajoutés au livre illustré sont moins anodins, plus érotiques que les culs-de-lampe impri-més dans le texte. Sont-ils une gratification supplémentaire qui accompagne les hors-commerce, ou de véritables hors-texte à intégrer au travail d’illustrateur de Fautrier et simple-ment encartés pour être ôtés plus facilement, dans l’éventua-lité d’une menace d’hostilité de la part de la censure ?
• 41
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Jean Fautrier, [Sans titre] quatre dessins, 1944Encre et fusain, 30 x 35 cmMonogrammé et daté en bas à gauche : 44Collection particulière
Jean Fautrier, exposition du 27 avril au 27 mai 2006. Galerie Di Meo, 9, rue des Beaux-Arts, Paris, p. 59. 63, 65, 67.
42 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Le Monstre rouge, 1952Huile sur toile et encre rouge, 63,5 x 63,5 cmSigné et daté en bas gauche : Bellmer 1952Collection particulière
• 43
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
hANs Bellmer eT georges BATAIlle, uNe CollABorATIoN éDITorIAle
ans Bellmer est essentiellement célébré pour les dessins et les photographies de
La Poupée. Le corps y est sujet à toutes les expériences, comme en témoigne Rose
au cœur violet (ill. p. 45) dans lequel la jeune fille fouille dans ses entrailles à la
recherche d’une réponse à sa propre constitution. Le titre se décline selon une multitude
d’anagrammes inspirées de Gérard de Nerval : Ô toi couleuvre rose ; Se vouer à toi, ô cruel !,
etc. Créature féminine aux jointures mobiles, La poupée se désarticule pour se recomposer
selon des schémas anagrammatiques. Photographiée dans de multiples positions, elle sus-
cite dès 1934 l’engouement de Paul Éluard qui écrit une série de poèmes en prose pour lui
servir d’écrin. Les Jeux de la poupée devait être publié par Christian Zervos à Cahiers d’art à la
rentrée de 1939 mais la guerre interrompit le projet, malgré les vives recommandations du
poète. Dans une lettre inédite du 2 avril 1940 adressée du camp des Milles à Zervos, Bellmer
insiste pour que la publication de cet utopique projet voie le jour, même s’il doit renoncer à
l’intégralité des poèmes. La vérité, écrit-il, est cependant qu’un texte si comprimé ne survit que
douloureusement des coupures ; car même les notes sont indispensables pour la solidité de cet édifice
assez minutieux. Ne prenant pourtant pas ombrage de l’arrêt de la publication, Hans Bellmer
réalise au même moment un portrait de Max Ernst pour une exposition projetée à la galerie
de madame Zervos, rue Bonaparte.
après l’internement au camp des Milles, les années de clandestinité qui s’imposent à
l’artiste allemand jusqu’en 1944 le confinent à travailler inlassablement les images les
plus insolites et à s’adonner à la gravure en taille douce. Pour subvenir à ses besoins, il
dessine (ill. p. 46) également les portraits de notables et d’amis avec la méticulosité d’un
Dürer et l’expressivité d’un Baldung Grien. Il faut dire que la pratique du dessin réaliste est
l’autre versant de son œuvre, qui fait écho aux images les plus désarticulées. Les visages
sont précis et le dessin de l’œil donne souvent un regard froid et direct au modèle. Le
réalisme affirmé de sa cousine ursula Naguschewski (1953) appartient à cette typologie
(ill. p. 53).
Malgré l’isolement, quelques collaborations éditoriales lui sont proposées, mais c’est
surtout la réédition d’Histoire de l’œil qui fait l’objet de toutes ses attentions. au début
de l’année 1947, Hans Bellmer rencontre enfin Georges Bataille avec lequel il avait corres-
pondu depuis presque deux ans pour mettre au point une nouvelle édition. Les six gravures
érotiques entrent en résonance avec le sulfureux texte dont la police française n’hésitera pas
à détruire la plus grande partie du tirage (ill. p. 51). Cependant, on peut noter à travers
les dizaines d’études crayonnées sur des petits cahiers d’écolier que les deux univers se
complètent pour sublimer les liens de fraternité d’Éros et de Thanatos sous le regard
d’Hypnos.
H
44 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
une seconde collaboration en 1949 aura pour objet Justine ou les Malheurs de la vertu du
marquis de Sade pour les Presses du Livre français. Bellmer ornera l’ouvrage d’un céphalo-
pode sur papier rose en frontispice tandis que Georges Bataille en écrira la préface. Par la suite,
la complicité des deux créateurs se confirmera dans l’illustration d’un livre érotique de Pierre
angélique (pseudonyme de Bataille), Madame Edwarda, qui ne paraît avec les douze cuivres de
Hans Bellmer qu’en 1965 chez Visat, soit trois ans après la mort de l’écrivain et vingt-cinq ans
après la première édition. Lorsqu’en 1955 Georges Bataille reprend le manuscrit de Madame
Edwarda pour en faire l’édition corrigée, Bellmer s’adonne à des variations sur le thème des
deux filles furtives dans l’escalier d’un lavabo qui ouvre le texte. Cela confirme le mobilier de la
maison close (lavabo, miroir, lit, etc.) comme l’attribut des jeunes filles depuis Histoire de l’œil.
La gémellité entre également au cœur d’un dispositif érotique de la surenchère et les dessins
préparatoires qui sont élaborés sur plus de dix années appuient le leitmotiv du double et de la
duplication des corps. Le dessin de 1957 Les Deux Sœurs (ill. p. 52), provenant de l’ancienne
collection Julien Levy, en est un bel exemple. Le galeriste new-yorkais envisageait d’ailleurs de
faire une exposition Bellmer à la fin de l’année 1940 mais le projet fut, lui aussi, stoppé par la
guerre. Bataille et Bellmer ont donc partagé des univers semblables mêlant l’érotisme à la mort
dans le même souci de créer une poétique de l’indicible et du sacré.
FaBRICE FLaHuTEZ
Bellmer, à propos de La Mineure et des Jeux de la Poupée.Hans Bellmer, lettre à Henri Parisot : Il faut expliquer à Bataille l’ambiance de l’ensemble (il ne s’agit pas de faire des textes pour tous mes dessins !). Mes dessins peuvent servir de « provocateur ». Tout est libre, mais le sujet est précis. Le sujet : l’ambiance scandaleusement et authentiquement imaginative et particulière de la mineure (entre 7 et 13 ans). Si par hasard Bataille serait en mesure et disposé à consacrer à ce sujet un enthousiasme, – oui, pourquoi ne serait-ce pas, en définitive, rien qu’un long texte de Bataille avec mes dessins ? […] deux choses sont importantes : d’abord, de récupérer des épreuves impeccables de toutes les photos en question pour les faire rephotographier ou pour les préparer à la reproduction et ensuite, de trouver un moyen de reproduction basé sur la photogravure – qui donnerait bien le caractère de la photo coloriée. alde. Lettres et manuscrits autographes, hôtel Regina, Paris, jeudi 19 avril 2012, n° 7. La Mineure, référence à la revue Minotaure, n° 6, p. [30-31] « Poupée. Hans Bellmer. Variation sur le montage d’une mineure articulée ».
Hans Bellmer, Sans titre, 1944 Crayon sur papier, 13 x 10 cmInscription en bas à l’encre : Voici une esquisse d’un portrait scandaleusement interprétéSignature en bas à droite à l’encre : BellmerCollection Yves de Fontbrune
Hans Bellmer. Musée départemental Moulins albigeois, à Albi et musée Goya à Castres, mars 1992, p. 17.
• 45
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Rose ouverte la nuit, 1946Crayon sur papier quadrillé, 8,8 cm x 14 cmInscription en haut à gauche : à SadeDaté en bas à gauche : 7 juillet 46Inscription en bas à droite : RevelCollection Yves de Fontbrune
46 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre [Visage de jeune fille, de profil à gauche], [1934]Crayon et rehauts de gouache blanche, 32,5 x 25 cmCollection Marcel Fleiss
Hans Bellmer, Calendrier / Calendar, 2007. Galerie 1900-2000, Reproduit.
Hans Bellmer, lettre à Henri Parisot :Lundi soir. Castres […]. J’avais laissé à Ricka la liste des dessins chez vous, avec l’indication des prix ! Je ne vous donne donc, ci-joint, encore une fois cette liste, avec des prix un peu plus bas. Quant à l’album, disons : 4 000 frs. La terreur est que je n’ai plus le sou ! Depuis ce matin. Vous pensez que ce n’est pas pour améliorer les termes infernaux où je vis avec ce gendarme à grands pieds qu’est « ma femme ». Vous pensez bien que je suis rentré de Paris plein de courage et de projets immédiats, plein de travail : mettre au point la préface (retrouvée par Hugnet) pour Les Jeux de la poupée. Mettre au point, suivant les indications du nouveau clicheur, les photos en couleurs. Puis l’anatomie etc. – Puis, l’Histoire de l’œil. Eh bien, il ne me restera que d’aller (avec quelques sous dans la poche, que l’on me prêtera, j’espère) à Carcassonne, ce qui n’est pas drôle par ce froid, pour y essayer de faire quelques portraits. Jusqu’au moment où mon Dalí, à Paris, sera vendu, ou jusqu’à la vente d’un des dessins qui sont chez vous. J’aime autant revenir tout de suite à Paris, pour terminer les illustrations pour l’œil. Mais est-ce que je pourrais compter un peu sur lui, matériellement et est-ce que l’on pourra m’héberger de nouveau sans que je doive craindre de déranger terriblement. Écrivez-moi toujours à Castres, avant de partir, le cas donné je vous donnerais mon adresse télégraphiquement. alde, Lettres et manuscrits autographes. Salle Rossini, Paris, vendredi 11 mars 2011, n° 5.
• 47
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre [Nu au lys, Nu à la feuille], ca. 1937Encre, crayon, rehauts de gouache blanche, 30 x 23 cm Signé en bas à gauche : Bellmerau verso (ci-contre en haut), à l’encre : Sans titre [deux fillettes]Collection particulière
48 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre, 1939Crayon sur papier, 31 x 22,2 cmSigné et dédicacé en bas au centre : Hommage amical à Joyce Reeves Hs BellmerCollection particulière
• 49
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre [variante du Petit traité de morale]Dessin au crayon sur papier quadrillé, 10,5 x 17 cmSigné en bas à droite : Bellmer En bas à gauche : un briquet pour pipe à opiumCollection Yves de Fontbrune
50 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre, (non daté)Dessin au crayon, 27 x 21 cmSigné en bas à droite : BellmerCollection Marcel Fleiss
Hans Bellmer, Sans titre [dit La Cruche cassée], 1946 Encre sur papier, 25,7 x 19 cm Provenance Georges HugnetCollection Marcel Fleiss
Georges Bataille, lettre à Hans Bellmer, tapuscrit ou copie :9 août 1945. J’aurais dû tout au moins vous écrire et depuis longtemps. J’ai été amené brus-quement à partir à la campagne où je suis installé. J’aurais bien voulu vous voir. J’envoie aujourd’hui à Simone Lamblin une liste des « scènes » à illustrer l’Histoire de l’œil. J’ai l’impression que le mieux serait une suite d’images toutes du même genre, derrière ou de-vant, photographiées de près, sans corps ni jambes. C’est ce qui me semble-t-il répondrait le mieux en même temps à l’esprit du livre et à ce que j’admire le plus dans vos photographies : si elles décèlent dans les formes ce que l’idée d’un corps (non ensemble) empêche d’aperce-voir (excusez cette pédanterie). Je me trompe peut-être… Vous rappelez-vous en dehors de cela le projet avec Chatté ? Ça devrait évidemment être une image du même genre, mais ce sera mieux si vous avez un autre sujet (pour éviter le rapprochement des deux livres). Est-ce trop compliqué ? En principe pour l’œil, le sexe le plus délicat et le plus discret (le plus jeune) vaudrait mieux. Pour la tombe, il serait pas mal au contraire d’accentuer les horribles replis. artcurial. Livres et manuscrits modernes. 7, rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris, mercredi 16 mai 2012, n° 307 bis.
Georges Bataille à Hans Bellmer, lettre datée de Vézelay, le 1er avril 1946 : Vous n’imaginez pas les difficultés que j’ai avec les Gheerbrant pour de simples corrections d’épreuves. À propos des cuivres : il est vrai que je suis responsable du format. C’est en effet le format de la page agrandi d’environ 1 cm de chaque côté. Les eaux-fortes sans marges ne sont pas si rares en bibliophilie et elles sont faciles à distinguer des reproductions parce que le trait est en relief. Cela vous laisse en tout cas la liberté de donner aux images exactement la dimen-sion qui vous plaira dans les limites de la feuille. Il est bien en effet de s’en tenir au format du texte mais dans ce cas il faudrait que l’on vous envoie un feuillet indiquant la place qu’occupe le texte dans la hauteur. alde, Lettres et manuscrits autographes. hôtel Regina, 2, place des Pyramides 75001 Paris, 6 octobre 2009, n° 181.
Le Trésor de Hans Bellmer par André Pierre de Mandiargues, Éd. Le Sphinx, Paris, 1979. p. 38.
• 51
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Sans titre, 9 mai 1946Dessin pour la 1ère gravure d’Histoire de l’œil, de Georges BatailleEncre et crayon sur papier, 27,5 x 19,7 cmSigné en bas à droite : BellmerDaté au verso : Mai 1946Collection Yves de Fontbrune
Hans Bellmer, anatomie du désir. Gallimard / Centre Pompidou, sous la direction d’Agnès de la Beaumelle, 2006. Repro. p. 159. Cat. n° 124.
52 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, entretien : Sans être forcé de m’exiler je suis venu à Paris à titre de protestation contre le régime hitlérien, son réar-mement et ses conséquences prévisibles. Les contacts établis, d’abord à distance, avec les surréalistes fran-çais autour de 1935 m’ont donné l’occasion de quitter l’Allemagne. J’ai trouvé à Paris le contraire de ce que je venais de fuir : le lieu de rencontre de la pensée et de l’expres-sion d’une élite. Le fait d’y être amicalement admis marque certainement un des points positifs de ma vie. Au-delà de cet accomplissement premier et ses suites, j’ignore ce que mon travail aurait pu être sous un autre climat intellectuel, géographique, amical. L’influence intellectuelle et bien complexe de Paris sur moi pourrait être ramenée à ceci : l’encourage-ment perpétuel de pousser à l’extrême l’expression la plus intimement individuelle et, à la fois, le contrôle objectif maximal. Après une visite, il y a quatre ans, en Allemagne occi-dentale, mon intention de ne pas retourner dans mon ex-pays est devenu définitive. Bellmer (allemand, arrivé en 1935) : « Le marché de la peinture est commandé par New York », in Beaux-Arts, n° 659, 20 février-4 mars 1958.
Hans Bellmer, Les Deux Soeurs 1957Crayon sur papier, 13 x 20,4 cm Signé en bas à droite au crayon : BellmerDaté en bas à gauche au crayon : 1957Collection particulière
Hans Bellmer, Sans titre, 1944Crayon sur papier, 21 x 16,3 cmSigné et daté en bas à gauche au crayon : Bellmer 44Dédicacé en bas à gauche au crayon : à Mme Jacqueline et Jean Brun ! Collection particulière
Hans Bellmer, anatomie du désir. Gallimard / Centre Pompidou, sous la direction d’agnès de la Beaumelle, 2006. Repro. p. 159. Cat. n° 111.
L’œuvre de Hans Bellmer (Katowice, 1902-Paris, 23 février 1975) est repré- sentée par trois dessins au musée Zervos :- Sans titre [Femme, 1939]. Dessin au crayon et élément d’enveloppe collé
[Monsieur Hans Bellmer / centre de Rass[emblement] / Uzès / (Gard)], 27 x 19 cm. Legs Zervos. MZ 14
- Sans titre [Portrait d’homme], 1941. Crayon et rehauts de gouache blanche, 31 x 24,1 cm. Achat du Conseil Général de l’Yonne. MZ 807
- Sans titre [Petite fille, ca 1927]. Crayon noir, 31,1 x 23,6 cm. Don de Marcel Fleiss. MZ 826
• 53
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Hans Bellmer, Ursula Naguschewski, 1953Crayon, rehauts de gouache blanche sur papier teinté, 29 x 24 cmSigné au crayon en bas à droite : Hans BellmerDaté au crayon en bas à gauche : 1953Collection particulière Hans Bellmer, Calendrier / Calendar, 2007. Galerie 1900-2000. Reproduit.
54 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Fantaisies de William B. Seabrook, photographies originales très libres, restées longtemps sous le boisseau.Six épreuves gélatino-argentiques, 130 x 180 mm, mention manuscrite au verso d’une d’entre elles : Cette épreuve de Man Ray m’a été remise par Georges Bataille, J. P. [Jacques Pimpaneau]. Ces photographies ne sont pas exposées.
Notice établie avec les informations communiquées gracieusement par Serge Plantureux, sur une hypothétique commande photogra- phique pour une revue incertaine et restée sans emploi par Georges Bataille. « William Seabrook, diabolist, fetishist and recreational cannibal, invited Ray to a dinner which didn’t feature, as was sometimes the case, Fri-casse la Parisienne made with a real Parisienne, but a naked girl chained to the stairs. unblinking, Man snapped her, as he did a succession of Seabrook’s other tableaux vivants. » (In Man Ray Laid Bare, Tate Britain Magazine online, n° 3.)Elle avait les mains liées derrière le dos et était attachée au pied de la rampe, par un cadenas. Seabrook nous présenta une clef et m’informa que je ne devais libérer la fille qu’en cas d’urgence… Man Ray, Autoportrait, Paris, Éd. Seghers, 1986, p. 176.
Jacques Pimpaneau :– Comment avez-vous rencontré Georges Bataille ? – Tout à fait par hasard. J’en avais entendu parler par Antelme et Des Forêts. J’imaginais que ce devait être quelqu’un d’intéressant. Alors, lorsqu’une de mes connaissances me demande de l’aider à lancer sa nouvelle revue, je pro-
pose un dossier Bataille. Je vais le voir pour le projet et lui, ça me souffle encore aujourd’hui, me dit toute sa gratitude parce que le fait qu’une revue lui consacre la couverture avait décidé Pauvert de publier un de ses textes. Je suis allé le voir à Orléans où il était conservateur de la bibliothèque. Me sachant étudiant de chinois, Diane, sa femme, m’avait préparé un repas oriental et tous deux m’avaient invité à rester la nuit chez eux. J’avais vingt et un ans. Je suis resté ami jusqu’à sa mort. Extrait de Livres, le 4 mars 2004. Pimpaneau, drôle de pékin. Interview. Il fut le secrétaire de Dubuffet, l’ami de Bataille et de Klossowski. Ren-contre avec l’auteur d’Anthologie de la littérature chinoise classique par Sean James Rose. ajoutons que Bataille citait Seabrook dans l’article « abattoir », Docu-ments, n° 6, 1929, p. 329-334 : Il est curieux de voir s’exprimer en Amé-rique un regret lancinant : W. B. Seabrook constatant que la vie orgiaque a subsisté, mais que le sang des sacrifices n’est pas mêlé aux cocktails, trouve insipides les mœurs actuelles. Voir aussi Michel Leiris, « Caput Mortuum ou la femme de l’alchimiste », Documents, n° 8, 1930, p. 21-26, illustré de photographies érotiques, de femmes, le visage revêtu d’un masque de cuir conçu par Seabrook. C. D.
• 55
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Mars-octobre 1943 ’homme qui, un jour de mars 1943, franchit le seuil de la
maison du 59 de la rue Saint-Étienne, à Vézelay, est un inconnu. Il n’a publié que des livres sous le manteau
(mais quels livres !) : Histoire de l’œil, Madame Edwarda. Dans les années trente, il a animé des revues (Documents, Acéphale) et des groupes (Contre-attaque, Collège de sociolo-gie). Il s’est violemment opposé à Breton et au surréalisme. Dans le combat contre la mon-tée des totalitarismes comme dans la dénon-ciation de la faillite des démocraties, il a été l’un des plus virulents. avec la société secrète acéphale, il a joué à l’apprenti sorcier. Il a été un scandale permanent.
Tuberculeux, en congé de maladie de son poste aux périodiques à la Bibliothécaire nationale, il a loué pour l’année cette petite maison à mi-pente. Je me propose une trêve avec moi-même, écrit-il. Son programme est simple : M’étendre au soleil, à l’ombre, lire, un peu de vin […], des paysages brumeux, ensoleillés, déserts, riants, écrire enfin, rédiger un livre. Il entend y terminer un ouvrage d’économie, mais il va être happé par le paysage. Modeste et froide, cette maison n’a qu’un luxe : sa ter-rasse. Là, dans une chaise longue, un verre de vin à la main, son carnet de notes à proximité, Bataille poursuit son « expérience intérieure ».
Sur cette terrasse, il se livre non pas à la transcendance du « haut lieu » mais à l’immanence, à la recherche de l’« illumi-nation », de l’extase dé-liée de Dieu et des églises. Il entend pratiquer « la nage dans les eaux du temps ». Il précise : Personne ne sait ce qu’est la nage. Les méthodes sont contraires à la nage : cha-cune d’elles la désapprend. Personne ne sait nager, nous ne pouvons que nous laisser aller à la nage. Il veut être Oreste et laisser jouer la chance. au-dessus des remparts, suspendu entre terre et ciel, dans la nuit, il note : Le tapis de jeu est cette nuit étoilée où je tombe, jeté comme le dé sur un champ de possibles éphémères.
Vézelay lui procure l’angoisse qu’il convertit en extase et le rire dont il proclame la « divinité » dans la dernière partie du Coupable. À Vézelay, il rit beaucoup, il rit divinement, d’un rire majeur, d’un rire infini. Dans le rire infini la forme divine fond comme du sucre dans l’eau. Mai 1945-mai 1949 Si Bataille est revenu à Vézelay, s’il s’est attaché à ce lieu, c’est qu’il y a noué des liens essentiels. Il a beaucoup reçu de ce village rural et roman qui lui rappelle sans doute le Riom-
ès-Montagnes de son enfance auvergnate. Il y a rencontré Diane, maîtresse, compagne, puis épouse. Il y a connu andré Costa, ami serviable et effacé.
Tout a changé : guéri, Bataille n’est pas re-tourné à la Nationale car il entend désormais gagner sa vie grâce à sa plume. Il n’est plus sur la terrasse mais rivé à son bureau du pre-mier étage. Ici, il crée et dirige Critique, revue qu’il porte à bout de bras, dans des conditions difficiles, sans téléphone. Il en est à la fois le directeur et le principal rédacteur. Il organise les sommaires, rédige de nombreux articles, établit le bilan d’auschwitz et d’Hiroshima sous l’angle de « l’homme entier ». Il écrit Théorie de la religion, qui restera inédit, et La Part maudite, livre d’« économie générale » qui n’a pas le succès escompté. Il dialogue avec Breton, Camus, Char, Merleau-Ponty, Perroux, Sartre et acquiert un indéniable
statut intellectuel. En 1948, la naissance de sa seconde fille, Julie, l’oblige à reprendre un poste de bibliothécaire. Nommé à Carpentras, il vit cela comme une défaite économique et un exil. Mais il reviendra à Vézelay, ayant toujours loué la petite maison aux volets gris.
au cimetière, une dalle nue, piquetée de taches noires et de mousse : Georges Bataille, 1897-1962. Lui qui avait essayé de vivre à hauteur de mort retrouvait, un jour de juillet 1962, l’abjecte nature et la purulence de la vie anonyme, infinie, qui s’étend comme la nuit. Commençait alors la lente découverte de l’ampleur de son œuvre et du radicalisme de sa pensée. L’astre Bataille, soleil noir, commençait à briller.
Le cimetière domine toujours les collines, les forêts alentour. Rien n’a vraiment changé.
Ma folie dans le bois règne en souveraine. Je mets le feu au bois. Les flammes du rire y pétillent.
CHRISTIaN LIMOuSIN
L
59, rue sAINT-éTIeNNe, vézelAy (yoNNe)
Les citations sont extraites de Georges Bataille, Le Coupable, Paris, Éditions Gallimard, 1944.
56 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Acéphale, revue éphémère fondée par Georges Bataille, Pierre Klossows-ki et andré Masson, prévue pour paraître quatre fois par an. Proposi-tion aléatoire : le premier numéro porte la date du 24 juin 1936 et le cinquième et dernier numéro paraît en juin 1939. une réédition fac-similée, introduite par Michel Camus, « L’acéphalité ou la religion de la mort », a été publiée par les Éditions Jean-Michel Place à Paris en 1980.Acéphale, n° 1, n° [2], n° 3-4. Collection Yves de Fontbrune.
un placard publicitaire indiquait qu’acéphale confiait à Guy Lévis Mano, l’éditeur en chambre de la rue Huygens, le soin des cahiers d’une « collection Érotisme » qui prévoyait entre autres titres la diffusion pro-chaine de Heinrich von Kleist Les Marionnettes, traduit par Flora Klee- Palyi et Fernand Marc, et de Hans Bellmer, La Poupée. 10 photographies originales, traduit par Robert Valançay. une seule plaquette parut : Michel Leiris, Miroir de la tauromachie. Nouvelle série, cahier I « L’Érotisme ». acéphale. Paris, GLM, 1938, in-12 broché, édition originale avec trois dessins d’andré Masson. C. D. Couverture et un des trois dessins de Masson, reproduit en double page.Collection particulière.
• 57
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
n 1939 Bataille plaçait un texte en mal d’im-pression, Le Sacré, au sommaire du n° 1-4 de Cahiers d’art, encadré par des contributions de
Roger Caillois et de Claude Duthuit. En 1945, dans l’épais numéro Cahiers d’art, 1940-1944, qui marquait la renais-sance du magazine après son interruption pendant la guerre, il confiait à Zervos, sous le titre « À hauteur d’ami-tié », les bonnes pages de Sur Nietzsche, à paraître aux Édi-tions Gallimard. Mais en 1946, tout à son projet de lancer une dernière revue, il déclinait par un mot adressé de Véze- lay, le 19 mars 1946, la possibilité de nouvelles contribu-tions : Je ferai mon possible pour vous envoyer un texte sur Blake avant le 10 avril. Mais je suis si embarrassé d’engage-ments et si lent à écrire que je n’ose vous promettre absolu-ment. Le 28 juin 1946, il lui envoya de Vézelay quelques lignes en hommage au peintre Paul Klee : J’ai beaucoup d’intérêt pour l’œuvre de Klee, l’un des peintres contemporains qui m’ont le plus attaché. Je me suis toujours senti en accord avec un côté discret, insistant, obsédé vraiment nécessaire et silencieux de toutes ses compositions. Et je m’aperçois que j’ai, bien plus que je ne pensais, vécu dans une sorte d’intimité avec des fantômes qu’il était agréable et pourtant un peu dangereux d’aimer. Klee, me semble-t-il, avait plutôt la douceur d’un vice, quelque chose de moins distant que ne l’est généralement la peinture, et que j’ai du mal à distinguer de moi-même. Zervos, lui, avait ménagé Bataille. Dans l’Exposition de peintures et sculptures contemporaines au palais des Papes en avignon durant l’été 1947, il présentait et reproduisait au catalogue un plâtre récent, Buste de femme, du sculp-teur alberto Giacometti : le modèle en était Diane, la com-pagne et la future épouse de Bataille. Mais d’anciennes rivalités compliquaient leurs relations. Le succès de Docu- ments, revue de réflexion, avait déstabilisé, en 1929 et 1930, Cahiers d’art, revue d’art commerciale. Bataille, extrêmement actif dans la conception de Documents, y avait détourné les jeunes ethnologues groupés autour de Georges-Henri Rivière, sous-directeur du musée du Trocadéro, un vivier que Zervos considérait comme acquis. Bataille et ses amis Roger Caillois et Michel Leiris contri-buaient aux sommaires des revues Minotaure et Verve, d’E. Tériade, en compétition directe avec Zervos. En 1946, la concurrence reprenait de plus belle, avec Critique.
Bataille et Zervos n’abordaient pas la censure de la même manière. L’un la provoquait, l’autre la redoutait et en anticipait ses effets, comme le met en évidence Fabrice Flahutez. Cédant à Georges Hugnet, un de ses collabora-teurs, Zervos avait fait imprimer un luxueux bulletin de souscription pour Les Jeux de la poupée de Hans Bellmer,
BATAIlle eT CAhIers D’ArT, zervos eT lA CeNsure
E où il proposait la suite de photographies en couleurs illus-trées par des poèmes de Paul Éluard. Mais c’était en 1939 et, malgré l’insistance de Bellmer, Zervos remit le projet sine die. De la censure, Zervos devait en subir les mauvais tours là où il s’y attendait le moins, de l’autre coté de l’atlantique. À son débarquement le 29 mai 1941 à New York, Masson avait dû sacrifier aux douaniers cinq grands dessins licen-cieux, Zervos, à Paris, ignorait tout de la déviance mora-liste américaine. En janvier 1947, cherchant à refaire ses finances, il avait édité à grands frais le fac-similé d’un car-net que Picasso avait rempli de dessins à Royan en 1940. un des feuillets présentait un homme au pénis dressé luti-nant sa partenaire dans l’ombre et les « customs » prirent le parti de s’en effaroucher. Zervos réclama l’intervention de ses amis new-yorkais, Curt Valentin, Frederik Kiesler, et chapitra son correspondant exclusif, Edward Weyhe, le 1er février 1948 : Quant à la question du dessin érotique, on ne devrait pas laisser passer mon Art en Grèce où il y a très réalistement exprimées des scènes érotiques bien plus aiguës que dans le dessin de Picasso. Dans ce livre il y a des satyres qui copulent avec des animaux, des scènes d’enlèvement et de viol, très crues. Regardez les grands détails que j’ai donnés dans ce livre des céramiques du VIe et du Ve siècles. Vous savez qu’il n’y a pas un ouvrage sur les peintures de Pompéi qui ne fourmille de scènes érotiques autrement suggestives que celle de Picasso. Vous savez aussi que l’île de Délos est truffée de phallus énormes. Cela n’empêche pas les visiteurs américains de fréquenter l’île. Une fois même j’y ai conduit la mère du Président Roosevelt et un groupe de dames américaines à qui le conservateur du musée a expliqué le rôle phallique dans la religion grecque. Elles n’avaient pas l’air choquées. Il faut que l’inspecteur des douanes distingue l’art érotique de la porno-graphie. Et je suis presque certain qu’il ne verra rien car nous, nous sommes habitués à lire le dessin de Picasso. Ceux qui ne le sont pas ne voient rien d’érotique. Je viens de faire l’expérience sur des personnes d’ici et sur les trois personnes du consulat. Personne ne prit le risque de l’aider à contourner le refus catégorique opposé par les douaniers. Zervos s’entêta, ce qui précipita sa ruine sur son seul marché subsistant : Cahiers d’art, revue et éditions, restèrent bloqués dans les entrepôts de New York avant d’être réexpédiés au Havre, victimes du maccarthysme.
CHRISTIaN DEROuET
58 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
Extraits dE la bibliographiE dEs livrEs illustrés dE gEorgEs bataillE
• Lord Auch [Georges Bataille], Histoire de l’œil. avec huit lithographies originales par andré Masson. Paris, 1928.
• Georges Bataille, L’Anus solaire. avec trois pointes sèches par andré Masson, Éditions de la Galerie Simon. Paris, (1931).
• Georges Bataille, Sacrifices. avec cinq eau-fortes en sanguine ou en noir par andré Masson. Paris, Éditions GLM (Guy Lévis Mano), 1936.
• Pierre Angélique (Georges Bataille), Madame Edwarda. Nouvelle ver-sion revue par l’auteur et enrichie de trente gravures par Jean Perdu [Jean Fautrier]. Paris, Chez le Solitaire (auguste Blaizot), [1945].
• Lord Auch [Georges Bataille], Histoire de l’œil. K éditeur, avec six eaux-fortes de Hans Bellmer. Paris 1947 [Séville, 1940].
• Georges Bataille, L’Alleluiah. Catéchisme de Dianus. avec dix-huit litho-graphies et dix-huit gravures par Jean Fautrier. Paris, librairie auguste Blaizot, 1947.
• Georges Bataille, Histoire de rats (Journal de Dianus). avec trois eaux-fortes d’alberto Giacometti. Paris, les Éditions de Minuit, 1947.
Extrait dE la bibliographiE dE gEorgEs bataillE
Publiés pendant les séjours à Vézelay :
• L’Expérience intérieure. Paris, Éditions Gallimard, 1943.
• Le Coupable. Paris, Éditions Gallimard, 1944.
• Sur Nietzsche, volonté de chance. Paris, Éditions Gallimard, 1945.
• La Haine de la poésie. L’Orestie, Histoire de rats, Dianus. Paris, Éditions de Minuit, coll. Propositions, 1947.
• « L’Art, exercice de cruauté », in L’Art et le Destin. Paris, Olivier Perrin, coll. Connaissance de l’art, connaissance de l’Homme, 1949.
• La Part maudite. La Consumation. Paris, Éditions de Minuit, coll. L’usage des richesses, 1949.
ayant trait à l’histoire de l’art :
• Lascaux ou la Naissance de l’art. Genève, Édition d’art albert Skira, coll. Les grands siècles de la peinture, 1955.
• Manet. Genève, Édition d’art albert Skira, coll. Le goût de notre temps, 1955.
• Les Larmes d’Éros, Bibliothèque internationale d’érotologie n° 6, d’après une maquette de Lo Duca. Paris, Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1961.
élémEnts biographiquEs dE gEorgEs bataillE (1897–1962)
Le 10 septembre 1897, il naît à Billon (Puy-de-Dôme). En novembre 1918, il est admis à l’École des chartes.De 1922 à 194, il devient bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.En 1936, il habite 76 bis, rue de Rennes à Paris.En 1941, il est atteint de tuberculose pulmonaire. En disponibilité en avril 1942 pour raisons médicales, il se fait réinsuffler un pneumothorax. En mai 1943, Bataille s’installe au 59 de la rue Saint-Étienne, à Véze-lay avec sa fille et Denise Rollin. Sylvia Bataille, sa première épouse et Jacques Lacan prévoient de les rejoindre. Il publie avec Michel Leiris la seconde partie des Écrits de Laure : Histoire d’une petite fille. En octobre, il rentre à Paris. En juin 1945, il revient à Vézelay avec Diane Kotchoubey de Beauhar-nais, alias madame Snopko, rencontrée en 1943. Il y réside jusqu’en mai 1949. Par la suite, il y fait des séjours épisodiques. En mai 1949, il est nommé conservateur en chef de la Bibliothèque inguimbertine de Carpentras. En juin 1951, il est chargé de la Bibliothèque municipale d’Orléans. Le 17 mars 1961, une vente de solidarité au bénéfice de Georges Bataille et de Pierre de Massot est dirigée par Me Maurice Rheims : Tableaux et sculptures modernes, Paris, hôtel Drouot. Le 9 juillet 1962, il meurt à Paris. Il est inhumé au cimetière de Vézelay.
La pierre tombale de Georges Bataille dans le nouveau cimetière de Vézelay, adossé à la muraille de la ville, derrière l’abside de la basilique
• 59
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
élémEnts bibliographiquEs récEnts sur bataillE Et son œuvrE
• Georges Bataille, Œuvres complètes, 12 tomes. Paris, Éditions Gallimard, 1970-1988.
• Acéphale, réédition fac-similée, préface par Michel Camus, « L’acépha-lité ou la religion de la mort ». Paris, Éditions Jean-Michel Place, 1980.
• Documents, 1929 et 1930, réédition fac-similée, préface, «La valeur d’usage de l’impossible » par Denis Hollier. Paris, Éditions Jean-Michel Place, 1991.
• Michel Surya, Georges Bataille, la mort à l’œuvre. Paris, Librairie Séguier, 1987. Réédition Paris, Gallimard, 1992.
• Denis Hollier, La Prise de la Concorde / Les Dimanches de la vie / Essais sur Georges Bataille. Paris, Éditions Gallimard, NRF, 1993.
• Michel Surya, Georges Bataille, choix de lettres, 1917-1962. Paris, Édi-tions Gallimard, 1997.
• Georges Bataille, l’apprenti sorcier, Textes, lettres et documents (1932-1939). Rassemblés, présentés et annotés par Marina Galletti. Paris, Éditions de la Différence, coll. Les essais, 1999.
• Bataille-Leiris, l’intenable assentiment au monde. Sous la direction de Francis Marmande. Paris, Éditions Belin, 1999.
• Georges Bataille-Michel Leiris, Échanges de correspondances, Les iné-dits de Doucet, édition établie et annotée par Louis Yvert, postface de Bernard Noël. Paris, Éditions Gallimard, 2004.
• Georges Bataille. Romans et récits. Édition établie par Denis Hollier, Jean-François Louette, Paris, Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2004.
• William Blake, traduit et présenté par Georges Bataille. Éditions Fata Morgana. 2008.
• Élisabeth Arnould-Bloomfield, Georges Bataille, la terreur et les lettres, perspectives. Lille-Villeneuve-d’ascq, Presses universitaires Septen-trion, 2009.
• Bernard Noël. André Masson ou le Regard incarné, Éditions Fata Morgana, 2011.
• Francis Marmande. Le Pur Bonheur Georges Bataille, Lignes, 2011.
Expositions dE référEncE
• Georges Bataille : une autre histoire de l’œil. Les Sables-d’Olonne, Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix, mars-juin 1991.
• Masson et Bataille, à l’occasion du colloque « Bataille après tout », 27 et 28 novembre 1993, musée des Beaux-arts d’Orléans et Musée municipal de Tossa de Mar, 1993.
• Hors limite. L’Art et la vie, 1952-1994. Marseille et Paris, 1996.
• Undercover Surrealism Georges Bataille and Documents. Londres, Hayward Gallery, 2006.
• Traces du sacré. Centre Pompidou, Grande Galerie, 7 mai- 11 août 2008.
élémEnts bibliographiquEs sur lEs pEintrEs
André Masson (Balagny - Oise, 1896 - Paris, 1987)
• André Masson, textes de Jean-Louis Barrault, Georges Bataille, andré Breton, Robert Desnos, Paul Éluard, armel Guerne, Pierre-Jean Jouve, Madeleine Landsberg, Michel Leiris, Georges Limbour, Benjamin Péret. Rouen, imprimerie Wolf. achevé d’imprimer, le 15 avril 1940.
• Jean-Paul Clébert, Mythologies d’André Masson. Genève, Éditions Pierre Cailler, 1971.
• André Masson. Les années surréalistes. Correspondance 1916-1942. Édition établie et présentée par Françoise Levaillant. Paris, La Manu-facture, 1990.
• Guite Masson, Martin Masson, Catherine Lower, André Masson. Catalogue raisonné de l’œuvre peint. Tome I (1919-1941) ; vol. I, 1919-1929 ; vol. II, 1929-1946. Préface par Bernard Noël, texte principal, Dawn ades. Vaumarcus (Suisse), artcatos éditeur, 2010.
• Camille Morando, André Masson. Biographie. Première partie, 1896-1941. Vaumarcus (Suisse), artcatos éditeur, 2010.
• Laurence Saphire, Patrick Cramer, André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés. Genève, Patrick Cramer, 1994.
Jean Fautrier (Paris, 1898 - Châtenay-Malabry, 1964)
• Marcel-André Stalter, Recherches sur la vie et l’œuvre de Jean Fautrier (1898-1964), de leurs commencements à 1940. Essai de catalogue métho-dique et d’interprétation, thèse de doctorat d’État (dactylographié), uni-versité de la Sorbonne, Paris IV, 1982.
• Rainer Michael Mason, Jean Fautrier, Les estampes. Cabinet des Estampes, galerie tendances. Genève et Paris, 1986.
• Fautrier, 1898-1964. Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 25 mai-24 septembre 1989.
Hans Bellmer (Katowice, 1902 - Paris, 1975)
• Fabrice Flahutez, Catalogue raisonné des estampes de Hans Bellmer : 1938-1975. Paris, Nouvelles Éditions Doubleff, 1999.
• Hans Bellmer, anatomie du désir, sous la direction d’agnès de la Beaumelle. Gallimard et Centre Pompidou, 2006.
• Hans Bellmer, Calendrier / Calendar. Paris, galerie 1900-2000, 2007.
Les auteurs
• Camille Morando, documentaliste principale des œuvres au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou
• Yves de Fontbrune, collectionneur et donateur au Musée Zervos
• Marcel-André Stalter, professeur émérite des Universités
• Fabrice Flahutez, maître de conférences à l’université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense
• Christian Limousin, professeur honoraire de lettres
• Christian Derouet, conservateur général honoraire du patrimoine
60 •
SOUS le SIGNe De BaTaIlle MASSON • FAUTRIER • BELLMER
tablE dEs matièrEs
• Préface d’André Villiers, président du Conseil Général de l’Yonne ..... 3
• Introduction, par Christian Derouet ................................................ 5
• Vers Acéphale et le Collège de sociologie : Bataille, Masson et les dieux qui meurent, par Camille Morando ................................... 7
• Collectionner les dessins de Masson, par Yves de Fontbrune ............... 12
• L’enlèvement de la robe, par Marcel-andré Stalter ............................. 29
• Hans Bellmer et Georges Bataille, une collaboration éditoriale, par Fabrice Flahutez ....................................................................... 43
• 59, rue Saint-Étienne, Vézelay (Yonne), par Christian Limousin ......... 55
• Bataille et Cahiers d’art, Zervos et la censure, par Christian Derouet .. 57
• Éléments bibliographiques ............................................................. 58
Cette exposition a été produite par le Conseil Général de l’Yonne. Mis-sion pour les sites patrimoniaux.Christian Derouet, conservateur général honoraire du patrimoine et conservateur du musée Zervos en a assuré le commissariat et dirigé la publication.Daniel Buisine, administrateur hors classe, responsable de la mission des sites patrimoniaux, et Pierrette Chêne, attachée principale, en ont suivi la réalisation avec Jacqueline Cumont, l’équipe technique des expositions de la direction culturelle du Conseil général de l’Yonne, et les agents d’accueil et de surveillance du musée Zervos.
concEption graphiquE Et affichE dE l’Exposition
andré Belleguie.
crédits photographiquEs
agence photographique de la Réunion des musée nationaux, La Pari-sienne de Photographie, Paris-Musées, galerie Jean-François Cazeau, ga-lerie 1900-2000, galerie Di Meo, galerie Les Yeux fertiles, adam Rzepka, Jacques Faujour, Christian Derouet.
copyright
© adagp, Paris 2012. andré Masson [couv. p. 1 , p. 2, 4, 6 (haut et bas), 9, 10, 11 (haut et bas), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 56 (haut et bas)] / Fautrier [(p. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (haut et bas), 41 (haut et bas)] / Bellmer [(couv. p. 4 , p. 42, 44, 45, 46 (haut et bas), 47, 48, 49, 50 (haut et bas), 51, 52 (haut et bas), 53)].
achevé d’imprimerpar Filigrane (Nitry, Yonne)
Dépôt légal, 2e trimestre 2012ISBN 2-912-660
rEmErciEmEnts
Nous remercions ceux qui ont apporté à la réalisation de cette expo-sition leur aimable collaboration : les ayants droit des artistes et des auteurs représentés : Julie Bataille, Guite Masson, Diego Masson et Lydie Masson-angelopoulos, Dominique Fautrier, Manuelle Fautrier de Galembert, Jacqueline Cousin, Doriane Bellmer et Béatrice Bellmer.
L’exposition a bénéficié de prêts du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, grâce à alfred Pacquement, Brigitte Léal, Olga Makhroff, Émilie Choffel, du musée d’art moderne de la Ville de Paris, grâce à Fabrice Hergott, Jacqueline Munck, de prêts de collectionneurs privés et de précieuses informations, M. et Mme Hervé Lefevre, Jean-Jacques Plaisance, Nello Di Meo et Lydie Di Meo, Marcel Fleiss et David Fleiss, Franck Prazan, Jean-François Cazeau, Marcel-andré Stalter. Notre reconnaissance s’adresse à Yves de Fontbrune pour la générosité du prêt de ses collections et de leur présentation et à Staffan ahrenberg pour avoir gracieusement permis de reproduire des extraits de textes de Christian Zervos publiés dans Cahiers d’art, aux auteurs Camille Morando, Marcel-andré Stalter, Fabrice Flahutez, Christian Limousin pour leur implication dans ce projet, à Gisèle Caumont, Rodica aldoux, Laure de Buzon-Vallet, Isabelle Limousin, pour leurs expériences tech-niques, à Benoît Dagron, Francis Guy et adam Rzepka.
Nous remercions ceux qui nous permettent chaque année de renouveler par des prêts les accrochages du logis principal et de la Maison du Jardi-nier : annie Caubet, Michel amandry et Marielle Pic de la Bibliothèque nationale de France, Didier Schulmann et la Bibliothèque Kandinsky au Centre Pompidou, Gérald et Ève-anne Poubelle, annie Lançon et François Simon, Germain Brochet et Madame Grué-Brochet, ceux qui maintiennent des prêts à long terme, Patrick Bongers et la galerie Louis Carré, Daniel Malingre et la fondation Hans Hartung et anna- Eva Bergman, Jean-Pierre Duport et Michel Richard à la fondation Le Corbusier. Nous tenons à associer à ces remerciements les personnalités qui veillent à l’enrichissement du musée Zervos et rendent possible l’acquisition du tableau de Louis Marcoussis, Papillon de nuit, présenté dans la salle des années 1920 : Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture et de la Communication, Henri de Raincourt, ancien ministre, sénateur de l’Yonne et conseiller régional, Philippe Bélaval, directeur général des patrimoines, Marie-Christine Labourdette, directrice, chargée des musées de France, Pierre Provoyeur, sous-directeur de la politique des musées, Bruno Saunier, sous-directeur des collections, Bruno Chauffert-Yvart, directeur régional des affaires culturelles en Bourgogne, Clara Gelly, conseillère musée, Françoise Tenenbaum, vice-présidente de la région Bourgogne, et François Delagoutte, et à adresser nos compliments à Michel Zlotowski.