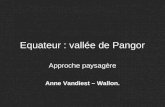Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
-
Upload
anthony-strickland -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
1/7
Lessentiel de linformation
scientique et mdicale
www.jle.com
Montrouge, le 06/08/2010
M. Dulcire
Vous trouverez ci-aprs le tir part de votre article en format lectronique (pdf) :
De la passivit la collaboration : lvolution des relations entre cacaoculteurs et industriel en qua-
teur*
paru dans
Agriculture, 2010, Volume 19, Numro 4
John Libbey Eurotext
Ce tir part numrique vous est dlivr pour votre propre usage et ne peut tre transmis des tiers qu des ns de recherches personnellesou scientiques. En aucun cas, il ne doit faire lobjet dune distribution ou dune utilisation promotionnelle, commerciale ou publicitaire.
Tous droits de reproduction, dadaptation, de traduction et de diffusion rservs pour tous pays.
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/
revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?ty
pe=text.html
Le sommaire de ce numro
John Libbey Eurotext, 2010
http://www.jle.com/http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md?type=text.htmlhttp://www.jle.com/ -
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
2/7
De la passivite a` la collaboration :levolution des relations
entre cacaoculteurs et industriel en Equateur*
ResumeLes relations entre agriculteurs et industriels sont toujours asymetriques, et sont source ddifficultes pour developper des activites conjointes. Un industriel chocolatier francaifortement motive par le potentiel aromatique dun cacao dEquateur, a propose un contra une organisation de producteurs de ce pays. Il sest assure des services dun chercheuexpert en cacaos aromatiques, comme mediateur au niveau technique et organisationnepour reussir la requalification commerciale de cette variete historique. Lobjet de notretude etait de comprendre comment et en quoi le partenariat entre le chercheur, lindutriel et les producteurs avait fait evoluer les modes relationnels et contractuels entre cindustriel et les associations de producteurs. Nous insistons dans cet article sur la facodont se sont etablies des relations entre lindustriel et lorganisation des producteurs, sur base de ce contrat. Les producteurs sengagent dans le partenariat impose par lacheteupour des raisons economiques de valorisation de leur activite productive de leur cacatraditionnel. La negociation initiale du cahier des charges reste donc passive. Puis leproducteurs entrent peu a peu dans ce processus de requalification territoriale. Ils deviennent partenaires actifs de leur acheteur et font evoluer les termes du contrat par une negciation integratrice. En conclusion, ces apprentissages techniques et organisationnerestent cependant incomplets, et nont pas encore stabilise une alliance qui reste fragile.
Mots cles : apprentissage ; approche participative ; cacao ; contrats ; Equateur ;partenariat.
Themes : economie et developpement rural ; productions vegetales ; transformation,commercialisation.
AbstractFrom passivity to collaboration: Changes in the links between cocoa farmer
and a manufacturer in Ecuador
The relationship between farmers and manufacturers are always asymmetric, making difficult to propose joint activities. A French chocolate manufacturer, strongly motivateby the potential aroma of cocoa in Ecuador, proposed a contract to an organization oproducers in this country. He enlisted the services of an investigator, a technical and organizational expert in aromatic cocoas, to successfully carry out the commercial regenertion of this historical variety. The purpose of our study was to understand how and whthe partnership between the researcher and the industrial producers needed to develomeans of negotiating and contractual relationships between the industry and produce
associations. We emphasize in this article how a stable relationship between these twactors was established on the basis of this contract. The producers entered the partnershiwith the purchaser only for economic reasons, to make the production of their traditioncocoa more attractive. During the initial negotiation of the specification they remained quipassive. The producers then gradually integrated the process of territorial re-qualificationThey have now become active partners of the industrialist and are developing the term
doi:10.1
684/agr.2
010.0
395
Etude originale
*Pour citer cet article : Dulcire M. Levolution des relations entre cacaoculteurs et industri
en Equateur : de la passivite a la collaboration. Cah Agric 2010 ; 19 : 249-54. Doi : 10.168agr.2010.0395
Michel Dulcire
CiradEnvironnement et SocieteUMR InnovationBP 5032TA 60/1573, rue J.-F. Breton34398 Montpellier cedex 5
Tires a part : M. Dulcire
Cah Agric, vol. 19 N 4 juillet-aot 2010 249
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
3/7
of the contract through an inclusive negotiation. In conclusion, we show that the techni-cal and organisational learning remains incomplete and have not yet stabilized analliance. The relationship thus remains fragile.
Key words:cocoa; contracts; Ecuador; learning; participatory approaches;partnerships.
Subjects: economy and rural development; processing, marketing; vegetal productions.
Historiquement, dans la zonecotiere de lEquateur, une varieteendemique de cacaoyers nom-
mee nacional produit un cacao auxqualites reconnues typees (au sens deSalette, 1985). Ce cacao a aussi une valeur sentimentale pour les Equato-riens, puisque ses ventes en contrebandeont aide a financer la guerre dindepen-dance contre la couronne dEspagne,qui, en outre, ne lachetait qua un prix
derisoire aux producteurs. Ensuite, lesexportations massives a la fin du XIXe etau debut du XXe siecles de la pepa deoro realisees par de grands proprietai-res terriens ont propulse lEquateur aupremier rang des producteurs mondiaux.Larrivee massive de maladies, comme lamoniliose ou le balai de sorciere, et lapremiere guerre mondiale ont mis fin acette epoque doree . Par la suite, sousla double influence de la reforme agraireet de la reconversion des grandes plan-tations de cacaoyers en bananeraies, laproduction a ete assuree par de petits
producteurs, qui revendiquent aujour-dhui comme historique et culturel leur cacao nacional, dont la productionest neanmoins en baisse continue, envolume et en qualite.Cest en reponse a cette evolution regres-sive quune intervention conjointe delUnion europeenne (UE) et du ministerede lAgriculture et de lElevage (Ministe-rio de Agricultura y Ganaderia [MAG])est realisee de 1995 a 2000. La recherche,responsable de son deroulement, devaitrepondre a une attente de resultats tech-niques et scientifiques sur les maladies
du cacaoyer, ainsi que sur ses qualitesorganoleptiques, mais aussi dactionsconcretes sur le court terme.Des le debut, des responsables dorgani-sations paysannes, malheureusement peustructurees, se mobiliseront pour quecette intervention sous forme de projet reponde aux aspirations des producteurs.Cest ainsi quun des chercheurs delequipe francaise interviendra horsstation et en association avec les produc-
teurs : expert en cacao, il travaillera ala mise en place dune capacite localede valuation organoleptique du traite-ment postrecolte du cacao et au renforce-ment du fonctionnement collectif.Les resultats seront cependant inegaux :les tentatives de rehabilitation des vieillesplantations sont un echec, la structure de vulgarisation agricole ne survit pas alarret du financement et lorganisationpaysanne sera mise en faillite. En revan-
che, la collection de cacaoyers aromati-ques locaux constitue une premieremondiale, une capacite devaluationorganoleptique est acquise, et ce cher-cheur a gagne la confiance des produc-teurs et de leurs associations qui lesollicitent pour des appuis techniques etorganisationnels.Cest a la suite de cette interventionpublique, peu convaincante, quentre en
scene un industriel chocolatier francaisspecialise dans le cacao aromatique,desireux de diversifier ses sources dap-provisionnement. Ses attentes portentexplicitement sur des cacaos de qualiteoriginale, produits en agriculture bio-logique, exigences quil reporte dans un contrat equitable . Il exige par ailleurs,pour reduire les couts dintermediation,de sengager avec une organisation deproducteurs et non avec des individus.
Apres une etude de faisabilite comman-dee a ce chercheur, il decidera de passerun contrat avec la cooperative Unocace(Union Nacional de las OrganizacionesCampesinas Cacaoteras de Ecuador)pour lancer une operation durable, label-lisee bio-equitable . Cest a la demandede lindustriel que ce chercheur, expert encacao, connu et reconnu par les produc-teurs, en deviendra partenaire.
Industriel
chocolatier
Chercheur-
expert
Ngociation et modification
du cahier des charges
Unocace
Cooprative des
12 associations
DlgusAssociations
(12) Agriculteurs
Figure 1. Relations entre lindustriel, les producteurs et leurs organisations, et le chercheur.
Figure 1. Relations between the industrialist, the farmers and their organisations, and the researcher.
Unocace : Union Nacional de las Organizaciones Campesinas Cacaoteras de Ecuador.
Cah Agric, vol. 19 N 4 juillet-aot 2010250
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
4/7
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
5/7
Une organisation destabilisee
Un meilleur prix dachat du cacao avaitete, selon le president dUnocace, laraison principale des producteurs poursorganiser dans le cadre du projet euro-peen, mais les intermediaires nont jamaispropose un meilleur prix pour les inciter afaire de la qualite.Larret du projet a destabilise lUnocace,
compte tenu de sa faible experience et delabsence de contrats pour la vente ducacao. Creee pour le marche, elle na passu sy maintenir et elle a fortement decapi-talise. Cependant, les producteurs nexpri-ment pas de deception apres cet echec,comme cest souvent le cas lorsque desresultats sur le court terme ne sont pas aurendez-vous (Faure etal., 2007). Cest dail-leurs leur volonte de continuer qui inciteralindustriel chocolatier a aider Unocacea serenforcer comme organisation faitiere,comme acteur partenaire de lelaborationdun contrat de commerce equitable.
Un chercheur ecartele
Il est dune part deja reconnu comme unallie par les producteurs, qui le connais-sent et lecoutent. Son role de conseillertechnique de lindustriel lamene dautrepart a repondre dabord a ses exigences,en mediateur et formateur vis-a-vis desproducteurs, de leurs associations de pre-mierniveauetdelacooperative(figure 1).Ces deux classes dacteurs nont pas lesmemes interets ni le meme point de vue,et ils ne travaillent pas au meme rythme.Il doit donc permettre a ces parties de
prendre la parole, et intervenir tant parses recherches ou expertises dans ledomaine de la production du cacao quepar ses conseils sur le fonctionnementtechnique et organisationnel de cettefiliere bio et equitable .Le risque de dispersion excessive (Thill,2001) de ses activites, entre connaissancescientifique, action et apprentissages
collectifs et individuels (Freire, 1974),renvoie au risque de non-reconnaissancepar linstitution de recherche.
Le contrat,des engagements reciproques
Lindustriel affirme que tous les acteursdoivent pouvoir tirer profit du contrat,dont il a propose un modele des ledebut, et queleur adhesionactiveest indis-pensable a sa perennite. Mais le modedorganisation des producteurs etait alorsbalbutiant.Le contrat initial de lindustriel adonc de fait impose ses exigences. Limpli-cation des producteurs est progressive :leurs pratiques ameliorent le fonctionne-ment de leurs associations et leur donnentles moyens dexprimer des demandes alindustriel. Le contrat actuel representeun consensus interculturel , donc le pro-duit dune construction negociee (Denoux, 2006) entre lindustriel et les pro-ducteurs, aux strategies differentes, etappuyee par le chercheur ( figure 1).Ce contrat liste les responsabilites et lesdroits des trois parties : celles des signatai-res, dune part lindustriel et la coopera-tive fatiere , et celles des associations,dautre part, qui sont sous le controle dela cooperative. Le cahier des charges(tableau 1) en explicite les conditions etresponsabilites pour chacune de cestrois parties : par exemple la varietetraditionnelle, les modalites economiqueset dinvestissement, lassistance tech-
nique, les modes de fonctionnementorganisationnel, etc., et, surtout, les tachesde controledestypesetmodesditinerairestechniques (culturaux et postrecolte),cest-a-dire un ensemble de facteurs dontla matrise joue sur la stabilite du contrat(Akrich, 2006).Les producteurs se sont ainsi lances danslaventure cacao bio et equitable , avec
les exigences de qualite de productionque cela implique. Cependant, la grandemajorite dentre eux na pas ressentilattente, de la part de lindustriel, duneparticipation active des producteurs. Lapremiere version du contrat a donc donnelieu a peu dechanges. Les agriculteursqualifient spontanement leur ralliementinitial au contrat comme une contrainte
subie, en labsence dautre choix ou faute de mieux , ou encore commeune opportunite, celle des prix attractifsproposes. Cest en cours dentretien, et endiscussion collective, que leur implicationprogressive dans la dynamique contrac-tuelle est enoncee. Cette situation illustrela difficulte quont eue les producteurs acommencer a se coordonner entre euxpour elaborer une intention commune.Mais elle montre aussi limportance dunleader dans la construction du systemerelationnel, pour surmonter les difficulteset faire avancer le processus.
Du vieux monde
au nouveau monde :
sorganiser
pour survivre
Lorganisation, un acteurimpose par lindustriel
Wyvekens (2003) souligne que les bonnespratiques sont des pratiques efficientes,mais qui sont aussi ethiquement honnetes.Elles changent quelque chose dans lesmodes de travail, techniques et relation-nels, de facon durable, tant socialementque culturellement. La demande duchocolatier a represente une opportu-nite, une arene dintercomprehension
Tableau 1. Extraits du cahier des charges des trois parties.
Table 1. Extracts from the specification involving the 3 parties.
Industriel chocolatier Associations de base Unocace
Assistance techniqueCout certification
Variete traditionnelleRespect reglement agriculture biologiquepar controle interne
Controle et tracabilite du produit
Achat du cacao a Unocace Achat feves fraches aux adherentsTravail collectif postrecolte
Collecte cooperativesConditionnement
Prefinancement des achats sans interet Paiement au producteur en livraison Gestion exportations
Appui infrastructures Construction infrastructures Coordination infrastructures
Unocace : Union Nacional de las Organizaciones Campesinas Cacaoteras de Ecuador.
Cah Agric, vol. 19 N 4 juillet-aot 2010252
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
6/7
(Fixmer et Brassac, 2004) fonctionnelleentre la cooperative et les associations deproducteurs dun cote, et lindustriel delautre. La cooperative Unocace est lasignataire designee du contrat et le deve-loppement de son pouvoir dagir est icisuperieur a celui de lindividu. Son assem-blee, composee des delegues elus desassociations, decline le cahier des charges
en objectifs et en actions collectives, pourtous (tableau 1), en fixe les modes decontrole et agit independamment desdemandes individuelles. En ce sens,lengagement du collectif a respecter lecahier des charges bio-equitable est a lafois une contrainte exterieure imposeeaux individus et un facteur de valorisationde ce travail.Linnovation, au fur et a mesure quellesest developpee, a genere des recompo-sitions du jeu et de linterdependance(Filippi, 2002) des acteurs du contrat.Plusieurs producteurs enoncent sponta-
nement que la negociation des engage-ments collectifs par leurs representantset leur traduction pratique a renforce leursavoir-faire organisationnel et leur noyauidentitaire. Cette transformation desrapports cooperative-industriel meneprogressivement les associations et leursmembres agriculteurs a lautonomie,donc a leur emancipation (Constance,2008). Ces apprentissages se concretisentprogressivement en savoir-faire : desactions innovatrices, des dynamiques degouvernance des associations et de lacooperative, y compris a partir dinitiati-
ves individuelles. Mais, comment prendreen compte les interets de ceux quisont encore peu impliques activement(Dulcire et Roche, 2007), mais qui doiventrespecter les regles collectives, souspeine dexclusion de leur association ?
Du mythea` des pratiques codifiees :une incomprehension initiale
Les producteurs expriment tous en coursdentretien leur difficulte a comprendre au
debut les termes du contrat quils accep-tent alors et, donc, a les subir. La demandeindustrielle de qualite les a obliges asaccorder sur un travail dont le contratevalue la qualite par des criteres tels que: originalite, procedes pre- et postrecolte,tradition, gout (Dulcire, 2005) travailqueHubert (2001) qualifiede reactivationdu local .Nous pouvons considerer cette requalifi-cation regionale comme une renaissance,
une nouvelle sensibilite a legard dunheritage [] collectif dont la reconnais-sance, la conservation et la transmission [sont] problematique[s] (Tornatore,2007). Cet ancrage territorial du cacao nacional , sa typicite, sest donc fondesur son histoire, mais aussi sur une recons-truction de lidentite des producteurs, ceque Hillier et al. (2004) designent comme
une transformation des rapports sociauxet de gouvernance. Ce processus a consti-tue un changement vers une constructiontechnique et organisationnelle du local ,sa reinvention (Zimmermann, 2005), unlieu de construction didentites et dactionsdes agriculteurs, du collectif et de lindus-triel. Ces modifications progressives sontici lobjet meme du processus transforma-teur (Foudriat et Immel, 2003), inscritdans le contrat originel qui est progressi-vement amende en commun.Cette demarche participative constituedes le debut un enjeu crucial pour une
cooperation durable entre les acteursde ce contrat. Elle pose aussi la questiondu role dun cadre preetabli comme celuidu bio-equitable pour la constructiondun projet commun realiste entre lentre-prise impliquee et les producteurs, dune repre sentation partagee permettant desdecisions plus consensuelles et plus perti-nentes (Levy, 2005).
Et le chercheur expert
en cacao aromatique ?Le chercheur joue differents roles : porte-parole de lindustriel ; traducteur entredeux mondes (Callon, 2003), entrelindustriel et le rural, et entre la Franceet lEquateur ; et, enfin, mediateur entreces deux acteurs. Mais il accompagneaussi comme expert le volution dessystemes techniques et lorganisation desproducteurs.Le chercheur a formalise des liens avec lesorganisations de producteurs et lindustrielpour construire ensemble des objectifs
partages (Torre et Chia, 2001). Il a etecommandite pour satisfaire les deux par-ties, par la prise en compte de leursenjeuxspecifiques, et se trouve ainsi ecarteleentre ordonnateur et executant. Il estdonc amene a se demander si sa pratiqueporte autant sur les obstacles concrets sedressant entre et devant ces personnesaccompagnees que sur le developpementde leurs capacites dadaptation (Vallerieet Le Bosse, 2003).
Ses activites, en reponse a la demande deacteurs, comme expert, mais aussi commintermediaire, illustrent alors lambigudes fonctions sollicitees au regard dson metier de chercheur. Sa posture maaussi son savoir-faire, son engagement repondre aux acteurs, expliquent-ils dfacon effective la construction du systemrelationnel ? La confiance est une cond
tion indispensable au fonctionnemedun dispositif participatif et lhommconcerne a pris le pas sur le chercheuimplique. Certains producteurs exprimeque leur travail avec le chercheur face auexigences de lacheteur les a aides surmonter les contraintes et a se convaincre quil y avait des ameliorations possbles. Cet engagement progressif aprele demarrage se materialise par des inititives, des propositions discutees pour leuintegration concrete dans le contrat, lequdevient alors un objet commun.
De la negociation
passive a` lautonomie
des producteurs ?
Ce processus de recherche participativsest construit en reponse a une demandindustrielle. La recherche a ete le mediteur de celle-ci, le chef dorchestre dusysteme dacteurs industriel et produteurs organises et de points de vue
dinterets differents, ce que Damo(2002) appelle le jeu de co .Le changement technique et organisationnel a ete impose a la cooperative par lindustriel, a partir dune culture historique identitaire. Les producteurs ont au debaccepte et respecte passivement leexigences pour beneficier des incitationmaterielles accordees (tableau 1). Puis, concertation enclenchee a debouche pea peu sur des ajustements communs dcahier des charges, qui augmentent la stbilite des relations entre lindustriel et leagriculteurs. Les differents resultats pos
tifs, enonces de facon plus ou moindirecte par les acteurs, attestent de cetconvergence progressive, ce que noupourrions appeler la construction sociadun objet cacao de qualite (Callon, 2003Cette confiance reciproque constitue uelement fondamental de la durabilite dla filiere, dont lorganisation reste fragilecette convergence progressive reposdabord sur un simple ralliement des producteurs a leurs collegues innovateurs.
Cah Agric, vol. 19 N 4 juillet-aot 2010 253
-
8/3/2019 Cacao Equateur ion Prod_md_ Cahiers Agricultures
7/7
En conclusion :
des apprentissages
a` consolider
Cette etude souligne la difficulte dacteurseconomiquement domines a sorgani-ser collectivement en reponse a unedemande, a une opportunite, Sorganisernapasete dans ce cas un choix individuel,mais une obligation exterieure contrai-gnante. Les hesitations et les doutes expri-mes, en particulier par les producteurs,concernent ici les nouvelles facons defaire, techniques et surtout organisation-nelles. Ils sont largement issus du para-doxe de linnovation dun cacao typeconduite avec le chercheur, en reponse aune demande industrielle, qui oblige a larenaissance de leur cacao oublie.Les producteurs de ce nouveau cacao nesont pas encore devenus autonomes et
montrent leur apprehension face au challenge de demain (Dulcire etRoche, 2008), a leur nouveau metier ouencore au futur generationnel. Leurgestion du contrat est un apprentissage,qui ameliore aussi leurs capacites dadap-tation individuelles et collectives auxevolutions des contextes.
Remerciements
Je remercie Eduardo Chia pour les discus-sions qui ont permis davancer sur le fondet sur la forme de cet article, ainsi que lesevaluateurs de la revue qui mont permisde lameliorer.
References
Akrich M. La construction dun systeme socio-technique, esquisse pour une anthropologiedes techniques. In : Akrich M, Callon M, LatourB, eds. Sociologie de la traduction. Paris : lespresses Mines, 2006.
Callon M. Science et societe : les trois traduc-tions. Les cahiers du MUR.S 2003 ; 42 : 55-69.
Constance DH. The emancipatory question: the
next step in the sociology of agrifood systems ?Agric Hum Values 2008 ; 25 : 151-5.
Damon L. La dictature du partenariat. Vers denouveaux modes de management public ? Futu-ribles2002 ; 273 : 27-41.
Denoux P. Un objet inter-culturel entre pole-mique et poly semique. Actes de la 12e Universit ede linnovation rurale Territoires ruraux,Comment debattre des sujets qui fachent ? ,Marciac, 2006.
Dulcire M. Une culture patrimoniale du mythe ala renaissance, le cafe Bonifieur de Guade-loupe (FWI). Anthropology of Food 2005; (4).www.aofood.org,
Dulcire M, Roche G. Sistema de toma de deci-
sion y aprendizajes de los agricultores. El casodel sector de cacao organico en Sao Tome. IXCongreso de Sociologa Poder, cultura y civiliza-cion; sociolog a de la alimentacion, Barcelona,2008.
Dulcire M, Roche G. Chercheurs agriculteurs industriel : co-construction dune filiere de cacaofin et bio en Equateur. Troisieme conferenceLiving Knowledge, Quand chercheurs etcitoyens coproduisent les savoirs et les deci-sions scientifiques et techniques , Paris, 2007.
Faure G, Hocde H, Meneses D. Les organisationspaysannes du Costa Rica construisent leurvision de lagriculture familiale : une demarchede recherche-action marquee par une rupture.Cah Agric 2007 ; 16 : 205-11. DOI : 10.1684/agr.2007.0094.
Filippi M. Les societes cooperatives agricolesentre ancrage territorial et integration econo-mique : elements de methodologie. Etudes etRecherches 2002 ; 33 : 79-94.
Fixmer P, Brassac C. La decision collectivecomme processus de construction de sens. In :Bonardi C, Gregori N, Menard JY, Roussiau N,eds. Psychologie sociale appliquee. Emploi, tra-vail, ressources humaines. Paris : InPress, 2004.
Freire P. Pedagogie des opprimes. Paris : Mas-pero, 1974.
Hillier J, Moulaert F, Nussbaumer J. Trois essaissur le role de linnovation sociale dans le deve-loppement territorial. Geographie, Economie.Societe 2004 ; 6 : 129-52.
Hubert A. Systemes agroalimentaires localises,reflexions dune anthropologue. In : Systemesagroalimentaires localises : terroirs, savoir faire,innovations. Montpellier : Inra-Cirad-Cnearc,2001.
Kaufman JC. Lentretie n comprehensif. Paris :Armand Colin, 2005.
Levy A, De. lhistoire a lactualite de la psychoso-ciologie. Sciences de l Homme & S ocietes 2005 ;79 : 12-6.
Salette J. La typicite : une notion n ouvelle au ser-vice du produit, de ceux qui lelaborent, et deceux qui le consomment en lappreciant. Revuedes nologues 1997 ; 85 : 11-3.
ThillG. Le dialogue dessavoirs.Les reseaux asso-ciatifs, outils de croisement entre la science et la
vie. Bruxelles : Charles Le opold Mayer, 2001.
Tornatore JL. Les formes dengagement danslactivit e patrimoniale, de qu elques manieres desaccommoder au passe. In : Meyer V, Walter J,eds. Formes de lengagement et espace public,questions de communication. Nancy : PressesUniversitaires, 2007.
Torre A, Chia E. Pilotage dune AOC fondee surla confiance. Le cas de la production de fromagede Comte . Gerer et comprendre 2001 ; 65 : 55-67.
Vallerie B, Le Bosse Y. Le developpement dupouvoir dagir des personnes et des collectivites.Sauvegarde de lenfance 2003 ; 58 : 144-55.
Wyvekens A. De Whats Works en bonnespratiques . Y a-t-il un bon usage du pragma-tisme anglo-saxon ? Les cahiers de la securiteinterieure 2003 ; 51 : 7-19.
Zimmermann JB. Entreprises et territoires: entrenomadisme et ancrage territorial. Revue de lIres2005 ; 47 : 21-36.
Cah Agric, vol. 19 N 4 juillet-aot 2010254