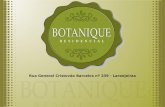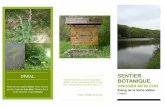BOTANIQUE...Botanique eme 2 année licence : Biologie & Nutrition 2 Chapitre I-Historique Il a...
Transcript of BOTANIQUE...Botanique eme 2 année licence : Biologie & Nutrition 2 Chapitre I-Historique Il a...
-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Université Hassiba Benbouali de Chlef
Faculté des Science de la Nature et de la Vie
Département Eau, Environnement et Développement Durable
Laboratoire de recherche
Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Naturels (Tlemcen)
Polycopié cour Botanique
2eme année licence Biologie &Nutrition
BOTANIQUE
Elaboré par : Dr . BELHACINI FATIMA
Février 2017
-
Sommaire
Partie I : Introduction à la botanique
Introduction
Qu'est-ce que la Botanique
Chapitre I-Historique
1. L'Antiquité
2. La Renaissance – Les Herboristes
3. Les systèmes artificiels de classification
4. Les systèmes naturels de classification
5-Les systèmes phylogénétiques
5.1. Les systèmes allemands
5.2. Les systèmes anglo-saxons
5.3. Les systèmes américains
5.4. Les systèmes récents
6. La systématique et phylogénie moderne
Partie II : Notions et critère de classification
Chapitre I : Le règne végétal
1-Evolution de la notion de règnes
A-Empire des Procaryotes (unicellulaires sans noyau)
B-Empire des Eucaryotes (noyau)
2-Notion d’évolution du monde végétal
2.1 Echelle des temps
2.2 La Paléobotanique
A.Fossilisation très rare dans le monde végétal
B. Flores successives : groupements végétaux qui se sont succédés à la surface de la Terre.
B.1.Flore du Précambrien (jusqu'à -570MA)
B.2. Flore du Iaire (-570MA à -225MA)
B.3. Flore du IIaire (-225MA à-65MA)
B.4. Depuis le IIIaire(depuis -65MA)
3. L’évolution du monde végétale
4 .Bases de la nomenclature et unités utilisées
5.Le code de Nomenclature
-
Partie III : Systématique des grands groupes du règne végétal
Chapitre I-Groupes n'appartenant pas au Règne Végétal
1. Cyanobactéries ou Cyanophytes (Cyanophycées, "algues" bleues)
A. Généralités, biologie
B . Intérêt des cyanobactéries
C. Théorie endosymbiotique
2. Lichens
A.Généralités
B.Biologie
C.Classification des lichens
D.Reproduction
E.Intérêt des lichens
Chapitre II-Groupes appartenant au Règne Végétal
Organisation du règne végétal
1.Les "Algues"
1.1.Les Chromophytes
A. Algues brunes pluricellulaires
B.Diatomées
1.2.Les Rhodophytes (Algues Rouges)
1.3.Les Chlorophytes (Algues Vertes)
1.4.Intérêt des Algues
2.Les Embryophytes
3.Les "Bryophytes"
A.Généralités-
B-Biologie
C-Classification
4-Intérêt des Bryophytes
5.Les Trachéophytes
6.Les "Ptéridophytes"
A.Généralités
B.Classification
7.Les Spermatophytes
7.1.Les Gymnospermes
7.1.1. Cycadophytes et 2. Ginkgophytes
-
A.Généralités
B. Reproduction
C. Classification
Cycadophytes
Ginkgophytes
7.1.2. Les Coniférophytes= Conifères
A. Généralités
B. Chimie
C. Intérêt
D.Reproduction
7.1.3. Les Gnétophytes (ex-Chlamydospermes)
A. Généralités
B. Classification
Gnétacées
Welwitschiacées
Ephédracées
7.2.Les angiospermes
7.2.1.Les organes des plantes à fleurs
7.2.1.1.Structure de l’appareil végétative
A.1.La racine
A.2.Types de racines
B.La tige
B.1.Les tiges aériennes
B.2.Les tiges souterraines
C.La feuille
C.1..La base foliaire
C.2..Le pétiole:
C.3.Le limbe
C.4.Feuilles simples
C.5.Feuilles composées
7.2.1.2. Structure de l’appareil reproducteur
A. L’inflorescence
A.1.Types d’inflorescences
a.Inflorescences simples
-
Inflorescences indéfinies
Inflorescences définies
.Inflorescences composéesB
Inflorescences composées homogènes
Inflorescences composées mixtes
B.La fleur
B.1.Le périanthe
a.Le calice
Position relative des sépales
Sort du calice
b.La corolle
Position relative des pétales
Sort de la corolle
Groupement des pétales en corolle
Types de corolles
B-2.L’androcées
a.Nombre d’étamines
b.2.Position des anthères par rapport au filet
B.3-Le pistil
a .Types d’ ovaire
b.Types de réceptacles
c.le diagramme floral
d.Insertion des pièces florales
Répartition des sexes dans les fleurs et entre les individus
e.Symétrie florale
C.Les fruits
A.Types de fruits
A.1.Fruits secs indéhiscents
A.2.Fruits secs déhiscents
a.Fruits monocarpiques ou dialycarpiques
b.Fruits gamocarpiques
c.Fruits charnus
7.2.2.Systematique des angiospermes
A-Systematique "classique"
-
B-Systematique moderne
7.2.2.Regles de nomenclature des angiospermes (a partir de l'ordre)
7.2.2.2.Organisation des angiospermes
1. Protoangiospermes
Ordre des Nymphéales
Famille des Nymphéacées
2. Euangiospermes (carpelles parfaitement fermés)
2.1. Euangiospermes monoaperturées
2.1.1. Monocotylédones ou Liliopsidées
2.1.1.a. Monocotylédones archaïques
Ordre des Acorales
Famille des Acoracées
Ordre. Alismatales
Famille des Aracées
2.1.1.b. Monocotylédones évoluées
Ordre des Arécales
Famille des Arécacées
Ordre des Poales
Famille des Poacées
Ordre : Asparagales
Famille des Alliacées
Famille des Asparagacées
Famille des Ruscacées
Famille des Amaryllidacées
Famille des Iridacées
Famille des Orchidacées
Ordre des Liliales
Famille des Colchicacées
Famille des Mélanthiacées
Famille des Liliacées
Ordre des Dioscoréales
Famille des Dioscoréacées
2.1.2. Dicotylédones primitives ou Magnoliidées
Ordre des Magnoliales
-
Famille des Magnoliacées
Ordre des Laurales
Famille des Lauracées
2.2. Euangiospermes triaperturées ou Eudicotylédones
2.2.1. Eudicotylédones archaïques
Ordre des Ranunculales
Famille des Renonculacées
Famille des Papavéracées
2.2.2. Eudicotylédones évoluées
2.2.2.a. Eudicotylédones Atypiques : Caryophyllidées
Ordre des Caryophyllales
Famille des Amaranthacées ( incluant ex-Chénopodiacées)
Famille des Cactacées
Famille des Caryophyllacées
Famille des Polygonacées
Famille des Santalacées
2.2.2.b. Eudicotylédones Supérieures Dialypétales : Rosidées
Ordre des Rosales
Famille des Rosacées
Famille des Rhamnacées
Famille des Moracées
Famille des Cannabacées
Ordre des Fabales
Famille des Fabacées
1-Sous-famille des Faboïdées (=Papilionoïdées , souvent Papilionacées)
Ordre des Cucurbitales
Famille des Cucurbitacées
Ordre des Malpighiales
Famille des Euphorbiacées
Famille des Hypéricacées
Ordre des Brassicales
Famille des Brassicacées
Ordre des Malvales
Famille des Malvacées
-
Ordre des Sapindales
Famille des Rutacées
2.2.2.c. Eudicotylédones Supérieures Gamopétales : Astéridées
Ordre des Ericales
Famille des Ericacées
Ordre des Gentianales
Famille des Gentianacées
Famille des Apocynacées
Famille des Rubiacées
Ordre des Lamiales
Famille des Lamiacées
Famille des Verbénacées
Ordre des Solanales
Famille des Solanacées
Famille des Boraginacées
Ordre des Apiales
Famille des Apiacées
Famille des Araliacées
Ordre des Dipsacales
Ordre des Astérales
Famille des Astéracées
-
Partie I : Introduction à la botanique
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
1
Introduction
Qu'est-ce que la Botanique ?
La Botanique : est la science qui étudie les végétaux.
Les botanistes : ont été amenés à identifier les plantes en faisant une description précise des
caractères qui leurs sont propres et ensuite à les classer selon un système ordonné et cohérent.
L’espèce : est l’unité de base de la classification des plantes que l’on appelle systématique.
La discipline scientifique en constante évolution
-Ecologie : étude scientifique des interactions entre les organismes d’une part et entre
les organismes et leur milieu d’autre part, dans les conditions naturelles.
- Biologie et Physiologie végétales : (La physiologie végétale, ou phytobiologie, est la
science qui étudie le fonctionnement des organes et des tissus végétaux et cherche à
préciser la nature des mécanismes : la nutrition – respiration –relation des végétaux avec
leur environnement –croissance et développement –reproduction …)
- Agronomie, Horticulture : (cultiver les jardins-pratiquer la culture des légumes, des
fleurs, des arbres et des arbustes…)
- Anatomie et Histologie végétales : (étudie la structure microscopique des tissues
anatomies des fleurs –fruits et feuille…)
- Phytochimie : où chimie des végétaux, est la science qui étudie la structure, le
métabolisme et la fonction ainsi que les méthodes d'analyse, de purification et
d'extraction des substances naturelles issues des plantes.
- Systématique : (classification des plantes).
- Palynologie : (pollens) est l'étude des grains de pollen et spores, des palynomorphes
fossiles ou actuels)
Figure n°1 : Discipline scientifique en constante évolution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciencehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Organehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Histologie_v%C3%A9g%C3%A9talehttp://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9taux
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
2
Chapitre I-Historique
Il a toujours été important pour l'homme de pouvoir distinguer les espèces végétales, d'en
reconnaître les traits structuraux saillants (caractères clefs) et de les identifier ; la taxinomie est
donc profondément ancrée dans les diverses cultures du globe.
L'histoire de la systématique peut être divisée en 6 parties :
1. L'Antiquité
L'un des premiers essais connus de classification de la flore locale est celui de Théophraste
(370-285 av..J-C). Ses traités de botanique livrent, entre autres, un classement systématique
d'environ 500 espèces selon leur port (arbre, arbuste, herbe etc.) et la présence ou l'absence de
fleurs. Certains noms génériques (Daucus, carotte ; Asparagus, asperge : Narcissus, jonquille)
datent de cette époque.
Un médecin militaire romain, Dioscorides (1er siècle apr. J-C) ajouta ensuite une centaine
d'espèces de la région méditerranéenne et son ouvrage, Materia medica, décrit les plantes et
leurs usages médicinaux. Il constitua des groupes naturels d'espèces qui correspondent à des
familles modernes bien définies (Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae).
En Inde, Surapala dans Vrikshayurveda (La Science de la vie des plantes), publié en Sanskrit
aux environs du 10 siècle, décrit 170 espèces végétales de l'Inde et particulièrement leurs
propriétés médicinales ; il établit un classement selon leur port et leur mode de reproduction.
Les érudits du Moyen-Âge ne poursuivirent pas ces efforts et se contentèrent d'exploiter les
travaux des Grecs et Romains. Néanmoins Albert le Grand (1193-1280), dominicain théologien
et philosophe, élabora un système de classification qui distingue, pour la première fois les
Monocotylées et Dicotylées.
2. La Renaissance – Les Herboristes
La Renaissance fut une période active d'études et d'explorations et avec l'invention et la
diffusion de l'imprimerie (1440), plusieurs ouvrages traitant des simples (plantes médicinales)
et de leurs propriétés furent produits en Europe à l'usage essentiellement des médecins.
En raison de la diversité des espèces européennes utiles et de l'introduction d'espèces nouvelles
par les explorateurs, les herboristes durent étendre et améliorer les travaux des « anciens » pour
structurer et ordonner la diversité du règne végétal.
Plusieurs familles et genres nouveaux furent établis durant cette période et les plantes furent,
pour la première fois, décrites à l'aide de gravures sur bois ou cuivre.
Parmi ces « herboristes », nous retiendrons : Leonhard Fuchs , Rembert Dodoens, John Gerard
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
3
3. Les systèmes artificiels de classification
Les travaux issus de ces périodes étaient essentiellement descriptifs et suite à l'accroissement
du nombre de nouvelles espèces, un système de classement apparaît de plus en plus nécessaire.
Les flores font leur apparition. Proposer des bases correctes pour un système capable d'englober
le règne végétal entier, tel est le problème le plus ardu devant lequel vont se succéder les génies
des Botanistes. De Linné au moins, la grande histoire a retenu le nom ; les autres sont moins
connus.
4. Les systèmes naturels de classification
Très rapidement les successeurs de Linné se sont efforcés de construire des systèmes dits «
naturels », c'est-à-dire qui respectent les affinités et les différences réelles entre les plantes et
plus particulièrement entre leurs organes reproducteurs : fleurs et fruits.
Antoine-Laurent de Jussieu – Français (1748-1836) – est reconnu comme le fondateur du
système moderne de taxinomie (science consistant à nommer les taxons). Il divise le règne
végétal en 15 classes, divisées elles-mêmes en ordres dont certains correspondent aux familles
actuelles. Il abandonne la première division entre plantes herbacées et ligneuses, donne plus
d'importance au nombre de cotylédons et utilise plus amplement les critères liés aux pétales et
aux étamines.
Augustin-Pyrame de Candolle – Suisse (1778-1841) – améliore et amplifie le travail de
de Jussieu. Il énonce également des principes fondamentaux de taxinomie. Il rédige le premier
travail de géographie des plantes.
George Bentham – Anglais (1800-1884) – et Joseph Hooker – Anglais (1817-1911) –
publient Genera Plantarum entre 1862 et 1883. Ils rassemblent 7000 descriptions génériques à
partir de 200 familles des principales plantes à graines. Néanmoins leur système fut à la base
de la classification encore utilisée en Grande-Bretagne.
5-Les systèmes phylogénétiques
Les concepts de sélection naturelle et de liens de parenté avec un ancêtre commun éventuel,
présentés dans Origin of Species publié en 1859 par Charles Darwin - Anglais (1809-1882) -,
encouragent les botanistes à incorporer les concepts d'évolution dans la classification. Les
systématiciens - tant pour le règne végétal que le règne animal – se sont efforcés alors de
rechercher des bases de classification qui prenaient en compte les affinités naturelles des
espèces mais aussi leurs liens de parenté avec un ancêtre commun éventuel.
La phylogénie était née.
Les systèmes phylogénétiques utilisés de nos jours peuvent se résumer à quatre grands systèmes
de classification.
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
4
5.1. Les systèmes allemands
Plusieurs auteurs d'origine allemande et autrichienne (A.W. Eichler, R. Wettstein, J. von
Sachs, A. Engler) ont conçu un système de classification basé sur l'interprétation qu'ils avaient
de l'évolution des spermatophytes. Le système d'Engler situait les angiospermes ressemblant
aux conifères (anémophiles ; fleurs réduites, unisexuées) à la base de la phylogénie. Les
Monocotylées étaient plus ancestrales que les Dicotylées.
Quoique cette notion ait été abandonnée par les systématiciens modernes, le système
d'Engler est resté un moyen de cataloguer les plantes et ceci en raison de la taille et de la qualité
de Die Naturlichen Pflanzenfamilien ouvrage publié de 1887 à 1915 par Adolf Engler (1844-
1930) et Karl Prantl (1849-1893). La plupart des herbiers d'Europe continentale sont encore
organisés selon la séquence d'Engler.
5.2. Les systèmes anglo-saxons
Parallèlement aux perfectionnements des systèmes allemands est née une autre
classification d'origine britannique et utilisée essentiellement dans les pays du Commonwealth.
Ce système est basé sur deux grandes lignes de développement, l'une concernant les végétaux
ligneux, l'autre les plantes herbacées.
Les fleurs considérées comme les plus primitives ne sont plus des fleurs nues et
unisexuées, mais bien des fleurs hermaphrodites et munies d'un périanthe mais avec les pièces
disposées en spirale. Cette organisation spiralée des pièces florales est ici considérée comme la
plus primitive. Viennent ensuite les fleurs à pièces disposées en cycles successifs et enfin les
fleurs nues qui sont considérées comme très évoluées. L'évolution n'aurait donc pas procédé du
plus simple au plus complexe mais bien par simplifications successives.
Cette classification a été exposée par Rendle dans Classification of Flowering Plants
ouvrage publié de 1904 à 1924 et par John Hutchinson (1884-1972) dans The Families of
Flowering Plants dont la première édition parut entre 1930 et 1934.
5.3. Les systèmes américains
Durant cette période (fin 19e – début 20e siècle), les botanistes américains étaient
surtout concernés par la collecte et l'identification des plantes, décrivant de nouvelles espèces,
constituant des herbiers et rédigeant des ouvrages descriptifs.
A part une exception, ils n'ont guère contribué au développement des systèmes de
classification qui était essentiellement le fruit du travail des Européens. Cette exception est
Charles E. Bessey (1845-1915) qui propose en 1894 un système de classification qui est une
modification de celui de Bentham et Hooker. Son ouvrage final The Phylogenetic Taxonomy
of Flowering Plants fut publié en 1915.
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
5
Cactus de Bessey : son système basé sur la tradition de Candolle, Bentham et Hooker et Hallier.
Il fut aussi influencé par Darwin et Wallace. Il a enseigné que taxonomie doit être fondée sur
des principes évolutifs . comme Wettstein, il mit les Ranales à l’origine des angiospermes.
Arbre de Dahlgren : (en haut), avec six sous-classes de Dicotylédones, Magnoliidae,
Hamamelididae , Dilleniidae , Rosidae , Caryophyllidae , Asteridae et cinq de
Monocotylédones, Alismatidae, Commelinidae, Zingiberidae, Arecidae, Liliidae.
Arbre Cronquist : (1919-1992): arbre « à ballons » représentant les différentes sous-classes
selon la vue d’arbre. Cronquist. La taille du ballon est proportionnelle au nombre d'espèces dans
le groupe.Très utilisées encore mais basées essentiellement sur des caractères morphologiques.
5.4. Les systèmes récents
Après la Deuxième Guerre Mondiale, la biologie en général a connu des progrès spectaculaires
dus principalement au développement de la microscopie électronique et aux techniques
avancées en biochimie et en génétique. En botanique systématique, on s'est attaché à prendre
en compte la combinaison de nombreux caractères, y compris des caractères
inframicroscopiques, biochimiques et écologiques.
Simultanément, mais indépendamment l'un de l'autre, deux systématiciens Armen Leonovitch
Takhtadjan (1910 - 2009) en Russie et Arthur John Cronquist (1919 - 1992) aux USA ont jeté
les bases d'un système synthétique, presqu'universellement accepté. Ils ne reconnaissent plus
les divisions antérieures des Dicotylées en Apétales, Dialypétales et Gamopétales mais les
partagent en six sous-classes : Magnoliidae, Hamamelidae, Dilleniidae, Caryophyllidae,
Rosidae et Asteridae.
6. La systématique et phylogénie moderne
Depuis plusieurs années, un groupe constitué d'experts internationaux, l'Angiosperm Phylogeny
Group (APG) revoit l'entièreté de la classification en se basant sur des caractères génétiques et
en les croisant avec les données morphologiques et physiologiques . Une troisième version
phylogénétique (APGIII) est disponible depuis 2009 une autre version (APGIV) est apparue
cette année (2016).
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
6
Figure n°2 : Arbre phylogénétique des ordres et certaines familles (APGIII, 2009) .
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
7
Figure n°3 : Arbre phylogénétique des ordres et certaines familles (APG IV, 2016)
-
Botanique 2eme année licence : Biologie & Nutrition
8
L'approche phylogénétique est basée sur l'évolution des espèces. Une « lignée » regroupe
l'ancêtre commun et ses descendants, il s'agit d'un clade. La détermination de cette lignée est
basée sur des caractères dérivés communs, que l'on nomme synapomorphies.
Les états primitifs (chez l'ancêtre commun) sont plésiomorphes. Si les caractères dérivés des
nouveaux individus ou espèces proviennent de ces ancêtres, ils sont nommés
symplésiomorphes. Les états dérivés de l'ancêtre sont des apomoprhies. Et donc, deux espèces
dérivées d'un même ancêtre commun ou deux groupes apparentés génétiquement, présentent
des caractères de synapomorphies. On peut ainsi établir des arbres phylogénétiques ou «
cladogrammes » ('evolutionary tree') (Smith et al. 2011).
Un « caractère » désignera un ensemble de caractéristiques communes (Ex. drupes des
framboises ou des mûres). Un état de caractère précise la particularité de ce caractère (Ex. fleur
rouge ou blanche entre deux espèces de Silene).
Simple phylogénie de 3 groupes au sein de la famille des Rosideae.
L'approche, rencontre cependant plusieurs difficultés :
L'ancêtre est souvent totalement inconnu !
De nombreux caractères sont polygéniques et difficiles à déterminer
Il est possible de déterminer plusieurs « arbres » logiques possibles. Dans ce cas, le
principe de parcimonie estime que l'évolution la plus probable est celle qui a entrainé
le moins de changements de caractères.
Cependant, une même forme d'un même caractère peut être acquise indépendamment
plusieurs fois au cours de l'évolution (= analogie)
Ou bien, une mutation de retour neutralise la mutation précédente (=homoplasie)
En cladistique on définit des clades (= rameaux) ou groupe monophylétiques
comprenant un ancêtre et tout ses descendants
-
Partie II : Notions et critères de classification
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
9
Chapitre I-Le règne végétal
1-Evolution de la notion de règnes :
Le monde vivant longtemps divisé en 2 règnes :
* Règne animal
* Règne végétal (incluant bactéries, cyanophytes et champignons)
Ensuite (et encore souvent) divisé en 5 règnes
* Procaryotes (Bactéries et Cyanophytes)
* Protistes (eucaryotes unicellulaires chlorophylliens ou non)
* Végétaux ( Plantae)
* Champignons ( et Lichens)
* Animaux
Actuellement on envisage 2 empires avec 6 règnes :
A-Empire des Procaryotes (unicellulaires sans noyau)
Paroi avec acide muramique : Eubactéries (dont les Cyanobactéries)
Paroi sans acide muramique : Archées
B-Empire des Eucaryotes (noyau) :
Unicellulaires non chlorophylliens, mobiles, phagocytose : Protozoaires
Uni ou pluricellulaires autotrophes (chlorophylle) : Végétaux (Plante)
Uni ou pluricellulaires hétérotrophes, cellules avec paroi : Champignons (et Lichens).
Pluricellulaires hétérotrophes, phagocytose : Animaux
2-Notion d’évolution du monde végétal
2.1. Echelle des temps :
Figure n° 4 : Evolution du monde végétale selon l’échelle des temps
Premières traces de vie : -3,9 Milliards d'années (Groenland, Australie)
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
10
2.2. La Paléobotanique : (Etude des plantes fossiles) :
A. Fossilisation très rare dans le monde végétal :
* milieu très humide
* pauvreté en oxygène
* sédimentation rapide (boue, vase…)
B. Flores successives : groupements végétaux qui se sont succédés à la surface de la Terre.
Figure n°5 : Groupements végétaux qui se sont succédés à la surface de la terre
B.1.Flore du Précambrien (jusqu'à -570MA) :
-Vie uniquement dans les océans
-Au début, seulement traces d'activité biologique
-Prépondérance de procaryotes
-Absence pendant une grande partie de reproduction sexuée
- A la fin du Précambrien, tous les groupes d'algues sont représentés
B.2. Flore du Iaire (-570MA à -225MA) :
-Au début, uniquement fossiles d'algues
-Découverte de spores et sporanges de plantes terrestres datés de -475 MA
-Premiers fossiles végétaux terrestres complets dans roches du Silurien (vers -425MA) :
Ptéridophytes ("fougères").
-Carbonifère : très nombreuses espèces de Ptéridophytes arborescentes
(Prêles, fougères…) formant des forêts (dépôts de charbon)
-fin du Iaire: Premiers fossiles de Gymnospermes (probablement périodeclimatique de
refroidissement et d'assèchement)
B.3. Flore du IIaire (-225MA à-65MA) :
-Régression des Ptéridophytes
-Extension des Gymnospermes
-Fin du Jurassique, vers -140MA :"apparition brutale" des Angiospermes ("explosion")
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
11
B.4. Depuis le IIIaire(depuis -65MA) :
-Régression des Ptéridophytes et des Gymnospermes
-Très large domination des Angiospermes (plus de 250 000 espèces décrites)
3. L’évolution du monde végétale :
Figure n°6 : L’évolution du monde végétale
Formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années
La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d’années.
Au cours des temps géologiques, de nombreux groupes d’êtres vivants sont apparus et se sont
développés.
Certains d’entre eux ont régressé, d’autres ont complètement disparu.
L’histoire de la vie est marquée par la succession et le renouvellement des groupes.
Les espèces qui constituent ces groupes apparaissent et disparaissent soit progressivement soit
brutalement à l’occasion des grandes crises de la biodiversité.
Ages d’apparition des principaux groupes végétaux :
• Algues : -520 Ma,
• Mousses : -420 Ma,
• Fougères : -375 Ma,
• Gymnospermes : -305 Ma,
• Angiospermes (plantes à fleurs) : -140 Ma.
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
12
L’évolution est due aux variations des conditions du milieu ainsi qu’aux mutations brusques.
Pour connaitre l’évolution des espèces, il faut dégager les grands traits de l’histoire des
végétaux aux divers âges de la terre.
Pour la chronologie des temps passés, les géologues distinguent cinq ères géologiques qui
sont :
• L’ère anté primaire (d’une durée inconnue mais supérieure aux autres)
• l’ère primaire (300 million d’années)
• l’ère secondaire (130 million d’années)
• l’ère tertiaire (70 million d’années)
• l’ère quaternaire (500 000 ans, la plus courte qui correspond aux temps actuels).
Ces ères sont partagées en périodes
Exemple 1: l’ère anté primaire correspond à l’antécambrien avec deux périodes : l’Algonkien
et l’Archéen.
Exemple 2 : l’ère secondaire est constituée de 3 périodes : Crétacé, Jurassique, Trias.
Figure n°7: Représentation schématique de la succession des différentes flores terrestres
L’évolution est due aux variations des conditions du milieu ainsi qu’aux mutations brusques.
Dès le cambrien le monde végétal existe mais est réduit aux algues (cyanophycées ou algues
bleues). On va donc essayer de comprendre le degré d’apparition et d’évolution des grands
groupes végétaux.
On assiste à l’explosion des Algues au Silurien (ère primaire) par la conquête, en
symbiose avec les Champignons, du milieu terrestre. C’est ce qu’on appelle l’Age des
Thallophytes (Algues, Champignons et Lichens).
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
13
L’évolution du règne végétal se traduit régulièrement par l’apparition d’organes
nouveaux .
Apparition des premiers vaisseaux= Age des Ptéridophytes.
Les Psyllophytinées apparaissent au Silurien (formes primitives, plus anciens vgtx
vasculaires, on ne sait pas s’il existe toujours (pointillés) on pense qu’ils sont représentés
actuellement uniquement par le genre Psilotum.
Les Lycopodinées représentés actuellement par les Sélaginelles.
Les Articulées ou Equisetinées apparaissent un peu plus tard au Dévonien et sont
représentés par les Prêles ou Queue de cheval ainsi que les Filicinées qui sont, elles,
relativement bien présentes avec les Fougères.
Tout de suite après l’apparition des grands groupes de Ptéridophytes, on a, à la fin du Dévonien,
l’apparition des Bryophytes représentés actuellement par les Mousses.
Aapparition du premier ovule chez les Ptéridospermées (Fougères à graines).
Début du Carbonifères, Cordaitales et ginkgoales =préspermaphytes = actuellement
gymnospermes primitives
Apparition de la première graine = Age des Gymnospermes.
A la fin du Carbonifère, Les Gymnospermes types (Pinophytes), ont un développement
considérable pendant toute l’ère secondaire mais qui entrent depuis l’ère tertiaire dans leur
déclin. Exemple : L’If ou le Pin (Pinus).
Apparition du premier ovaire = Age des Angiospermes.
Dès le Crétacé, on a l’apparition des premiers Angiospermes avec les Palmiers et Figuiers et
dès le Tertiaire on assiste à leur explosion avec plus de 250000 espèces.
Et enfin au quaternaire, apparition de l’homme.
4 .Bases de la nomenclature et unités utilisées
Toute classification implique l'existence d'unités de base que l'on pourra par après grouper en
unités supérieures ou subdiviser en unités inférieures. L'unité de base en Systématique est
l'espèce.
Le premier critère qui fut utilisé est un critère de similitude : tous les individus semblables
appartiennent à la même espèce. Or deux individus ne sont jamais exactement semblables et
que de plus il existe des formes intermédiaires entre des individus d'espèces différentes. Cette
conception a d'ailleurs conduit à une pulvérisation des espèces par divers auteurs, comme Alexis
Jordan par exemple, qui distinguait 200 "jordanons" ou espèces élémentaires à l'intérieur d'une
seule espèce de Crucifères : Erophila verna (L.) Chevall.
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
14
La découverte des lois de la génétique a permis d'ajouter à la similitude un second critère de
fécondité, beaucoup plus précis et ne permettant plus que des exceptions assez rares. Des
individus pouvant se féconder entre eux et se reproduire appartiennent tous à la même espèce.
Des exceptions existent pourtant, attestées par les hybrides interspécifiques.
D'autres critères ont été recherchés dans divers domaines tels que la biochimie, la palynologie,
etc., mais aucun n'a pu obtenir l'unanimité ni résoudre complètement le problème.
On doit actuellement se contenter de définitions grossières de l'espèce comme par exemple :
Une collection d'individus semblables se transmettant cette similitude de génération en
génération.
D'autres critères de diagnostic ont été employés comme
Le critère phytogénétique. L'espèce est « le plus petit agrégat de populations (sexué) ou
de lignées (asexué) diagnostiqué par une combinaison unique d'états de caractères chez
des individus comparables .
Le critère de généalogie. Il existe une exclusivité basale, c'est-à-dire une coalescence de
gènes : les membres d'une même espèce sont plus proches entre eux que d'un autre
groupe. La difficulté vient qu'il faut connaitre les ancêtres dans ce cas.
Une approche pragmatique : toute espèce doit pouvoir être reconnue par un non
spécialiste ! En combinant les caractères morphologiques, écologiques (milieux
privilégiés), systèmes reproducteurs, flux de gènes, distribution géographique et
biologie moléculaire ...
Il existe cependant des crypto-espèces qui ne montrent aucune différence morphologique mais
entre lesquelles il existe une barrière reproductive (par autogamie stricte par exemple). Ex :
Asplenium nidus.
Il existe également des micro-espèces ou agamo-espèces. Il s'agit de lignées introgressées,
stabilisées par agamospermie (multiplication par graines sans fécondation et fusion de
gamètes). Un ancêtre commun sexué est à la base de ce complexe de micro-espèces. Ex :
Taraxacum spp., Rubus spp., Sorbus aucuparia ….
Certains auteurs à présent emploient la notion de syngameon c'est-à-dire d'unité d'interfertilité
dans un groupe d'espèces qu'ils ne différencient plus. Il s'agit de complexes d'hybrides. Ex : le
genre Dactylorhiza chez les Orchidées ….
D'autres unités ont été conçues à partir de l'espèce, qui désignent les taxa à différents niveaux
ou rangs (taxon = unité systématique d'un rang quelconque).
Finalement en ce qui a trait à la structure fondamentale et le contenu du système de
classification de Cronquist, les plantes à fleurs sont considérées comme une Division ou un
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
15
Embranchement du Règne végétal, l'un des 15-20 taxa à ce niveau. L'embranchement
Magnoliophyta inclut deux classes, les Magnoliopsida (Dicotylédones) et les Liliopsida
(Monocotylédones).
Classe Magnoliopsida Liliopsida
Sous-classe Magnoliidae (1 de 6) Alismatidae (1 de 5)
Ordre Magnoliales (1 d'env.63) Cyperales (1 d'env.18)
Famille Magnoliaceae (1 de 315) Liliaceae (1 de 65)
Genre Magnolia (1 d'env. 7000) Lilium (1 d'env.2 000)
Espèce grandifolia (1 d'env.165 000) parvum (1 d'env.54 000)
Auteur L. (Linné) Kellogg
Tous les niveaux de la hiérarchie peuvent inclure des sous-classes, ainsi on parlera de sous-
espèces, ensuite de variétés et enfin de formes.
Une variété au niveau botanique est un rang taxonomique entre la sous-espèce et la forme. Ce
terme permet de regrouper un ensemble d'individus (une population) différant légèrement des
autres individus conspécifiques, par un ou plusieurs caractères considérés comme mineurs,
c'est-à-dire ne justifiant pas la création d'une nouvelle espèce, car ils possèdent par ailleurs tous
les caractères diagnostiques entrant dans la définition de cette espèce. La notation «var ».
Un cultivar désigne une unité taxonomique sélectionnée par l'homme à des fins horticoles ou
sylvicoles.
Le cultivar est donc une variété cultivée. C'est un variant qui a été sélectionné et choisi, parfois
depuis plusieurs millénaires, pour certaines de ses caractéristiques que l'on a voulu transmettre
d'une génération à l'autre, par des méthodes telles que par reproduction végétative (clonage),
cultures de « lignées pures », autofécondation, etc. Par exemple, les cultivars chez les poiriers,
la notation s'indique Pyrus communis
Chaque unité systématique (ordre, famille, genre, espèce) correspond à un taxon .
Une espèce peut se subdiviser en sous-espèces, races, variétés et formes ne différant qu’une
petite particularité comme la couleur de la fleur.
Une similitude entre différentes espèces dénote un lien de parenté, on les classe alors dans un
même genre. Certains genres ayant un “ air de famille ” malgré des différences réelles et
importantes ; ils forment des familles. Les familles sont groupées de la même façon en ordres,
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
16
les ordres en classes et les classes en embranchements. L’ensemble des embranchements des
végétaux constitue le règne végétal.
Pour s’y retrouver plus facilement, il a été déterminé que les unités systématiques soient dotées
de terminaisons définies.
Les noms de Familles se terminent par –acées (-aceae),
Les Ordres dont le nom dérive d’une famille qu’il contient, se termine par –ales (-ales) et les
sous-ordres en -inées.
Les orders proches les uns des autres sont groupés en Classes dont les noms se terminent par –
opsides (-opsida).
Les noms des embranchements ou Phylums, se terminent par –phytes (phyta)
5.Le code de Nomenclature
La nomenclature correspond à l'attribution de noms aux espèces végétales.
Linné, dans Species Plantarum (1753) confirme un système standardisé qui instaure le binôme
en remplacement des noms descriptifs ou polynomiaux utilisés jusqu'alors.
La dénomination des espèces végétales (et animales) se fait en latin qui était la langue des lettres
de l'époque. Ceci présente certains avantages : le latin est une langue internationale héritée du
passé et son usage ne heurte pas.
Le premier mot est celui du genre et s'écrit avec une majuscule ; le second (minuscule) précise
l'espèce dans le genre. Remarquons que beaucoup de noms d'espèces en langue vernaculaire
sont binomiaux également : chêne sessile, chêne pédondulé, etc.
Dans la littérature scientifique formelle, on ajoute le nom de l'auteur ou son abréviation au nom
latin. Ceci a en partie un but bibliographique, c'est-à-dire de localiser la source du nom, mais
également permet de limiter les possibilités de confusion.
Ainsi, on écrit Artemesia herba-alba L. (L. étant l'abréviation de Linné) pour le papayer.
Si une espèce a été légitimement nommée dans un genre par un auteur et déplacée par la suite
dans un autre genre, on mentionnera le nom du premier auteur entre parenthèses derrière le nom
de l'espèce ; il sera suivi du nom de l'auteur qui en aura fait la nouvelle combinaison.
Ainsi la capselle bourse à pasteur fut d'abord nommée par Linné Thlaspi bursa-pastoris, mais
Medicus créa le genre nouveau Capsella. L'espèce sera citée légitimement Capsella bursa-
pastoris (L.) Medic / Hedypnois cretica (L.) Willd.
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
17
En 1930, les botanistes se mirent d'accord sur un Code International de Nomenclature
Botanique qui est révisé lors de chaque congrès international de botanique (tous les cinq ans).
Plusieurs principes sont à retenir :
1. La nomenclature botanique est indépendante de la nomenclature zoologique. Par
exemple, le nom de genre est toujours différent du nom d'espèce pour un végétal
contrairement à un animal (Ex : Pica pica, la Pie)
2. La priorité de publication. Le nom proposé la première fois légitimement pour
désigner un taxon est seul valable. La description pourra se faire dans la langue d'origine
de l'auteur, mais la diagnose (détermination des caractéristiques) devra être en latin.
3. La typification. Chaque taxon est représenté par un spécimen type (holotype)
constitué par une plante ou une partie de plante conservée dans un herbier accessible au
public. Toute contestation quant à l'appartenance d'un individu à un taxon donné devra
être tranchée par la comparaison avec le spécimen type.
4. Les noms scientifiques des groupes taxonomiques seront attribués en latin, quelle
que soit l'origine.
-
Partie III : Systématique des grands groupes du
règne végétal
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
18
Chapitre I-Groupes n'appartenant pas au Règne Végétal
(Cyanobactéries & Lichen)
1. Cyanobactéries ou Cyanophytes (Cyanophycées, "algues" bleues) : (2000-2500 espèces)
A. Généralités, biologie :
*Unicellulaires sans noyau : Procaryotes (Eubactéries)
* Présence d'une paroi recouverte le plus souvent par un mucilage
* Autotrophes : chlorophylles a et c
*Certaines utilisent l'azote atmosphérique
*Souvent regroupements en colonies
*Pigments accessoires : phycocyanine (bleu-vert)- phycoérythrine (rouge)- caroténoïdes
(jaune, orangé, rouge)
*Multiplication par scissiparité :
Figure n° 8: Multiplication par scissiparité
*Très certainement les premiers êtres vivants chlorophylliens, apparus il y a plus de 3 Milliards
d'années : leur activité photosynthétique aurait donné les stromatolithes, formations fossiles
particulières
*Pas d'évolution depuis : êtres panchroniques
*Milieux humides, parfois conditions extrêmes : eaux douces ou hyper salées, sources
thermales jusqu'à 90°C , milieux sulfurés…
*De nombreuses espèces vivent en symbiose : avec des champignons : lichens et avec des
végétaux supérieurs.
*De nombreuses espèces font partie du picoplancton (cellules < 2µ)
*L’organisme photosynthétique marin le plus abondant sur terre est une cyanobactérie (jusqu'à
100 Millions de cellules /L, jusqu'à 150 m de profondeur)
B. Intérêt des cyanobactéries :
* Participation à des symbioses
*Libération d'oxygène
*Très riches en protéines (65 à 70% du poids sec), on les cultive parfois pour l'alimentation
animale et humaine surtout la Spiruline
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
19
C.Théorie endosymbiotique :
Certaines espèces de Cyanobactéries forment une symbiose avec des Protozoaires
(unicellulaires, eucaryotes) sans chloroplastes
Figure n°9 : Théorie endosymbiotique
2. Lichens : (20 000 espèces)
A. Généralités :
*Rattachés au Règne des Champignons
*Symbiose entre une espèce de champignon et soit une algue verte unicellulaire (dans
90% des cas) ou soit une cyanobactérie
*Pas de fusion entre les 2 partenaires (qui peuvent être cultivés séparément
*Appareil végétatif sous forme de thalle
Figure n° 10 : Coupe transversale dans un thalle de lichen
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
20
B. Biologie
* Croissance très lente
* Phénomène de reviviscence
* Eau et sels minéraux apportés essentiellement par pluie, neige, brouillard
*Champignon : abri + nutrition
*Algue verte chlorophyllienne (ou la cyanobactérie) : Photosynthèse (matières organiques)
C.Classification des lichens (basée sur l'aspect du thalle)
* lichens gélatineux
* lichens filamenteux
*lichens crustacés incrustés sur le support
*lichens foliacés: aspect lobé
* lichens fruticuleux aspect buissonnant
Figure n°11 : Des lichens
D. Reproduction
*Algue verte et Cyanobactérie asexuées, et champignon sexué (par spores)
*Multiplication
Végétative : fragments de thalle
Sexuée : spores du champignon rencontrant des cellules d'algue verte ou de
Cyanobactérie compatibles
E. Intérêt des lichens :
* Organismes "pionniers" : s'installent les premiers sur de nouveaux territoires (même si conditions
extrêmes)
* Alimentation des herbivores dans le grand nord
* Pas d'utilisation thérapeutique bien qu'activité Antibactérienne (contre bacille tuberculeux par
l’acideusnique)
* Utilisation industrielle en parfumerie et en cosmétologie
* Très sensibles à la pollution atmosphérique indicatrice de pollution de l'air
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
21
Chapitre II-Groupes appartenant au Règne Végétal
Organisation du règne végétal :
Figure n°12 : Organisation du règne végétale
1.Les "Algues" :
Terme regroupant des organismes végétaux appartenant à des lignées évolutives différentes
*Eucaryotes unicellulaires ou pluricellulaires (thalles) autotrophes
*Très diversifiées et parfaitement adaptées au milieu aquatique
Chlorophylle a plus dans chloroplastes
Chlorophylle b, c ou d (à 2, 3 ou 4 membranes)
Pigments accessoires
*Cycle de reproduction parfois très complexe avec 2 ou même 3 générations sous forme de
thalles morphologiquement identiques.
1.1. Les Chromophytes (Algues Brunes + Diatomées) (appartiennent à la "lignée brune")
*Chlorophylles a et c
*Chloroplastes à 4 membranes
*Caroténoïdes et fucoxanthine
*Surface jusqu'à 30m
*Comprennent des algues pluricellulaires et des algues unicellulaires : les Diatomées
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
22
A. Algues brunes pluricellulaires
*Eaux marines (1000 espèces)
*Certaines sont géantes : plusieurs dizaines de m de long (Macrocystis pyrifera)
ex. : Fucus vésiculeux, chêne marin (Fucus vesiculosus)
Figure n°13 :Des Algues brunes .
*Fixée sur rochers par crampons
*Plus ou moins découverte à marée basse
*Thalle brunâtre, gluant ramifié dichotomiquement en lanières aplaties avec nervure marquée
*Présence de flotteurs
*Constitue la plus grande partie du goémon
ex. : Laminaire (Laminaria digitata)
*Pseudo-tige avec crampons
*Thalle brunâtre très long (plusieurs mètres) divisé en lanières aplaties, à disposition palmée
B. Diatomées
Algues brunes unicellulaires microscopiques, possédant une carapace siliceuse formée de 2
valves emboîtées (d'où leur nom "coupé en deux")
*Plusieurs centaines de milliers d'espèces
*Dans tous les milieux aquatiques (une partie du phytoplancton très bons indicateurs de la
qualité des eaux (IBD : Indice Biologique Diatomées
*l'accumulation géologique de leurs carapaces donne une roche : la diatomite
Figure n°14 : Les diatomées (Echelle : 10 um)
1.2. Les Rhodophytes (Algues Rouges) : (appartiennent à la "lignée verte")
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
23
*Eaux douces et marines (5500 espèces)
*Chlorophylles a et d
*Phycobilines
*Algues des profondeurs (si lumière)
ex. : Carragahen, mousse perlée, mousse d'Irlande (Chondrus crispus)
Figure n° 15 : Les Algues Rouges
*Thalle rouge carminé, ramifié dichotomiquement (10-20cm)
*Fixée sur rochers par crampons
*Côtes de l'Atlantique Nord
1.3. Les Chlorophytes (Algues Vertes) :(Appartiennent à la "lignée verte" et aux
Chlorobiontes)
*Uni ou pluricellulaires
*Eaux douces et marines (8000 espèces)
*Certaines espèces aériennes
*Chlorophylles a et b comme végétaux supérieurs
*Amidon
*Surface (jusqu'à -15m)
*Surface (jusqu'à -15m) ex : laitue de mer (Ulva lactuca )
Figure n° 16:Les Algues vertes
*Fixée sur rochers par crampons
*Découverte à marée basse
*Thalle vert en lames minces aplaties (10-15cm)
*3 sortes de thalles, les uns à n chromosomes (gamétophytes mâles ou femelles), les autres à
2n chromosomes (sporophytes)
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
24
Les Algues vertes et végétaux supérieurs ( Embryophytes) sont des Chlorobiontes, ils ont un
ancêtre commun à partir de cet ancêtre commun, certaines lignées auraient donné naissance aux
Bryophytes
D’autres lignées auraient donné naissance aux Trachéophytes regroupant des plantes terrestres
parfaitement adaptées au milieu aérien
1.4. Intérêt des Algues
*Libération d'oxygène
*Engrais (goémon)
*Alimentation animale (unicellulaires : phytoplancton)
*Alimentation humaine
*Peu d'intérêt pharmaceutique : richesse en iode
*Certaines algues calcaires : implants biologiques (chirurgie osseuse)
*Richesse en polysaccharides (pouvoir épaississant et gélifiant) :
*Industrie agro-alimentaire : épaississants alimentaires (sorbets, glaces…)
2.Les Embryophytes (Appartiennent à la "lignée verte" et aux Chlorobiontes)
*Embryon pluricellulaire, régionalisé
*Cuticule (couche recouvrant l'épiderme)
*Gamètes formés dans des structures à parois pluricellulaires : archégones (femelles) et
anthéridies (mâles)
3.Les "Bryophytes"
Regroupent en fait 3 lignées différentes
A.Généralités-
*Gamétophyte (n chromosomes) = plante "feuillée" ou thalloïde
*Sporophyte (2n) jamais feuillée, non chlorophyllien
*Parasite du Gamétophyte (n)
*Gamètes mâles transportés par l'eau du milieu
*Croissance modulaire : "feuille" + fraction de "tige" (sauf Bryophytes à thalle)
*Probablement les premières plantes terrestres (Emergence) mais pas des fossiles
B-Biologie
*Pas de racines : rhizoïdes pluricellulaires
*Pas de vrais tissus conducteurs de sève absorption eau et sels minéraux par toute leur surface
*Vie dans des lieux très humides
*Phénomène de reviviscence
*Toujours petite taille
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
25
C-Classification
*Peu d'évolution depuis leur apparition, peu diversifiées imparfaitement adaptées à la vie
terrestre aérienne
*25 000 espèces en 3 phylums :
les Marchantiophytes (ou Hépatiques) : gamétophyte thalloïde ou feuillé (fontaines,
cascades,…)
les Anthocérophytes : gamétophyte thalloïde
Figure n°17 :Des embryophytes .
Les Bryophytes sensu stricto : gamétophyte "feuillé"
Multiplication végétative très importante
Sporophyte toujours formé d'une soie terminée par une capsule
Figure n°18 : Des sporophytes .
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
26
2 ordres :
Ordre des Bryales (= Mousses)
ordre des Sphagnales
*Chez certaines espèces de mousses, présence de "tissus conducteurs" :
*Hydroïdes (fonction de bois) et leptoïdes (fonction de liber)
Figure n°19 : Des Bryales et des Sphaignes .
4.Intérêt des Bryophytes :
*Aucun intérêt au niveau pharmaceutique !
*Plantes colonisatrices
*Plantes bio-indicatrices
*Régulation de la circulation des eaux de pluie : casdes Sphaignes dans les tourbières
*Tourbe : produit fossile résultant de la décomposition incomplètede sphaignes
Figure n°20 :Tourbière [10].
5.Les Trachéophytes :
*Présence de vrais tissus conducteurs de sève (bois et liber)
*Synthèse de lignine
*Phase diploïde dominante
*Sporophyte indépendant du gamétophyte
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
27
6.Les "Ptéridophytes"
Ce terme regroupe plusieurs phylums dont certain représentés uniquement par des plantes
fossiles
A.Généralités :
*Bois formé de Trachéïdes scalariformes
*Vraies racines, tiges et feuilles (avec stomates)
*Sporophyte (2n) = plante feuillée
*Appareil végétatif très variable (forme et taille)
Figure n°21 : Des ptéridophytes .
B.Classification :
Premiers végétaux vasculaires découverts à Rhynie, en Ecosse (Silurien)
*Majeure partie de la flore de l'ère I aire (forêts du Carbonifère : charbon)
*Groupe en extinction : plus de genres fossiles connus que de genres actuels
*Actuellement 11 000 espèces
*Fossiles de "fougères à graines" (Ptéridospermées ou Ptéridospermales)
*Dans terrains du Carbonifère et du Permien (pas de descendance)
*Groupe hétérogène comptant 4 phylums (lignées) principaux
Filicophytes = Filicinées : fougères vraies, 9 000 espèces
Equisétophytes = Sphénophytes prêles (15 espèces actuelles)
Cookso
nia (-425MA)
Rhynia
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
28
Psilophytes : plantes tropicales primitives
Lycophytes : lieux humides, petite taille
Figure n°22 : Classification des ptéridophytes .
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
29
7.Les Spermatophytes
-Gamétophyte femelle protégé par tégument : ovule
-Gamétophyte mâle réduit au grain de pollen.
-Bourgeons donnant des ramifications situés à l'aisselle des feuilles.
-Croissance secondaire des tiges et racines grâce à un méristème IIaire(cambium bifacial Bois
IIaire vers l'intérieur, Liber IIaire vers l'extérieur), sauf chez Angiospermes Monocotylédones.
7.1.Les Gymnospermes :
7.1.1. Cycadophytes et Ginkgophytes (regroupés parfois dans les Préspermaphytes)
A.Généralités
*Apparition : fin ère primaire (Permien)
*Pour les deux sexes, partie gamétophytique réduite au minimum :
*Partie femelle : ovule (en partie)
*Partie mâle : grain de pollen
*les 2 sexes sont toujours sur des pieds différents (plantes dioïques)
*Bois (sève brute) formé d'un seul type d'éléments : Trachéides (cloisons transversales
persistantes)
*Bois Homoxylé pratiquement que des espèces fossiles
B. Reproduction :
*Ovules de grande taille car réserves faites avant la fécondation
*Grains de pollen transportés par le vent (plante anémophile ou anémogame)
*Entrée du pollen dans l'ovule par le micropyle
*Grains de pollen germent et libèrent des gamètes ciliés qui nagent dans un liquide
sécrété par l'ovule
*Fécondation des oosphères (contenues dans archégones réduits)
*Démarrage immédiat de la jeune plantule (pas de période de repos)
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
30
C. Classification :
Cycadophytes :
*Environ 130 espèces
*Régions chaudes
*Feuilles composées pennées
*Vrai tronc avec accroissement secondaire (≠ palmiers)
*Pas de bourgeons axillaires
*Ovules disposés en 2 rangées sur des feuilles ovulifères regroupées en cônes
Ginkgophytes : une seule espèce Ginkgo biloba
*Arbre dioïque, jusqu'à 30 m
*Originaire de Chine, Grande-Bretagne
Nervation dichotomique
7.1.2. Les Coniférophytes= Conifères
A. Généralités :
*Fécondation par tube pollinique : c'est le pollen qui germe et qui apporte les gamètes mâles au
contact de l'ovule
*Fécondation complètement indépendante de l'eau du milieu
*La fécondation déclenche la mise en réserve (donc liens étroits avec la plante-mère) et la
formation de la graine
*Réserves faites après la fécondation
*Formation d'une graine : organe de vie au ralenti (dormance).
*Adaptation aux variations des conditions climatiques du milieu aérien
*Ovule nu
*Plantes toujours ligneuses, croissance secondaire importante
*Organes reproducteurs en cônes (ou strobiles) unisexués
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
31
*Les 2 sexes sur le même pied (monoïques)
*Rarement séparés (dioïques )
*Bois Homoxylé car formé d'un seul type d'éléments
*Canaux sécréteurs de résine (sauf exceptions)
*Feuilles le plus souvent en aiguilles ou linéaires aplaties ou en écailles
*Feuilles persistantes (exceptions : mélèze, cyprès chauve)
B. Chimie :
En général, richesse en composés terpéniques (alpha et bêta pinène en particulier)
*Présence de flavonoïdes
*Parfois des alcaloïdes
C. Intérêt :
*Arbres ornementaux
*Industries du bois : charpente, meubles…
*Pâte à papier
*Industrie chimique : térébenthine (solvants, colles, parfums…)
*Pharmacie : désinfectant, antiseptique (terpènes), anti cancéreux (Taxol et dérivés)…
D.Reproduction :
Figure n° 23: Cône mâles et femelles des conifères
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
32
7.1.3. Les Gnétophytes (ex-Chlamydospermes)
A. Généralités :
*Ovule dans enveloppes non fermées (autrefois Saccovulées) avec micropyle allongé
*Pseudo-fleur unisexuée, étamines avec filet
*Pseudo-fruit
*Bois hétéroxylé : vaisseaux parfaits ou Trachées pour la sève (ponctuations aréolées)
parenchyme ligneux pour soutien
Chez certaines Gnétophytes il existe un phénomène de double fécondation :
*Le tube pollinique déverse 2 gamètes mâles dans l'endosperme (gamétophyte femelle)
*Fusion de ces 2 gamètes avec 2 noyaux présents dans l'oosphère (gamète femelle)
*Une seule des cellules diploïdes formées donne un embryon, l'autre dégénère
La double fécondation n'est donc pas effective, elle n'est pas homologue de la double
fécondation des Angiospermes (non héritée d'un ancêtre commun).
B. Classification :
*Groupe comptant 96 espèces
*Caractères à la fois de Coniférophytes et d'Angiospermes, mais les analyses moléculaires
montrent que les Gnétophytes sont un groupe frère des Coniférophytes
*3 familles, 3 genres
Gnétacées : G.Gnetum : lianes forêts tropicales (30 espèces )
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
33
Welwitschiacées : Welwitschia : 1 seule espèce (Welwitschia mirabilis) plante acaule,
2 feuilles à croissance indéfinie (quelques cm/an) vivant plusieurs siècles, déserts du
Sud de l'Afrique
Ephédracées : G. Ephedra : environ 65 espèces, régions chaudes, lianes ou arbrisseaux
Certaines espèces asiatiques ont été utilisées pour leurs alcaloïdes (éphédrine et isomères)
Éphédrine maintenant synthétisée ex : raisin de mer, éphédra :
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
34
7.2.Les angiospermes
7.2.1.Les organes des plantes à fleurs
Les spermaphytes, encore appelé phanérogames ou plantes à fleurs sont caractérisés par la
présence :
d'un appareil végétatif
d'un appareil reproducteur.
Figure n°24 : Les organes des plantes à fleurs
7.2.1.1.Structure de l’appareil végétative
A.1.La racine :
Les racines ont de nombreuses fonctions :
* Fixation de la plante dans le sol,
*Puisage de l'eau et des sels minéraux dans le milieu,
*Et, dans certains cas, accumulation de réserves
*On peut définir 4 parties dans une racine :
*La zone subéreuse
*La zone pilifère
*La zone d'accroissement
La coiffe Figure n°25 : La racine
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
35
A.2.Types de racines :
On distingue plusieurs types de racines selon l'écologie de la plante :
*Racine pivotante *Racine fasciculée
*Racine Tuberculause * Racine caulinaire
Fasciculé Caulinaire Tuberculeuse Pivotante
Figure n° 26 : Types de racines
B.La tige
Les tiges se caractérisent par la présence des nœuds et des entre-nœuds.
Ce sont les tiges de plantes supérieures (plantes vasculaires) qui abritent les réseaux des
vaisseaux conducteurs de sève. Ceux-ci assurent :
* La distribution de l'eau et des sels minéraux indispensables à l'alimentation de la plante
(sève brute)
* Et dirigent, les produits de la photosynthèse (sève élaborée) vers les organes de réserve.
B.1.Les tiges aériennes :
*Les tiges aériennes sont formées d'un axe dressé dont l'extrémité porte un bourgeon terminal.
*La jonction de la tige avec la racine s'effectue au niveau du collet.
*Les feuilles s'insèrent au niveau des nœuds, eux-mêmes séparés par les entre-nœuds.
*La tige est simple ou ramifiée ; les rameaux se développent alors à partir des bourgeons
axillaires situés à l'aisselle des feuilles.
On distingue les tiges herbacées, minces et flexibles et les tiges ligneuses, généralement plus
robustes.
Elles sont caractérisées par une croissance verticale pour l'axe principal et par une croissance
oblique pour les ramifications.
Parmi ces plantes, on distingue :
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
36
Dressées Rampantes Volubiles grimpantes
Figure n° 27 : Type de tiges aériennes
*Les tiges présentent en général une section circulaire.
*Dans certains cas, celle-ci peut être : Triangulaire - quadrangulaire –pentagonale…
*Le contour peut être régulier mais également présenter un relief particulier : tige cannelée ;
tige ailée.
B.2.Les tiges souterraines
Elles sont caractérisées par la présence de noeuds et par leur rôle d'organes de réserves.
On distingue :
*Les rhizomes
*Les tubercules
*Les bulbes
Figure n° 28:Tipe de tiges soutérraines
C-La feuille
La feuille est généralement un organe aplati dont l'une des faces, est nommée face
supérieure ou ventrale tandis que l'autre face, est appelée face inférieure ou dorsale.
Suivant leur durée de vie, on distingue :
*Les plantes à feuille caduques
*Les plantes à feuilles persistantes
*Une feuille complète comporte trois parties :
http://floranet.pagesperso-orange.fr/def/r.htmhttp://floranet.pagesperso-orange.fr/def/v.htmhttp://floranet.pagesperso-orange.fr/def/g.htm
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
37
1- la base foliaire formant alors une gaine
2-le pétiole, à l'aspect de petit rameau
3-le limbe, souvent aplati
Figure n°29: Différentes parties d’une feuille
C.1.La base foliaire :
Chez certaines espèces, le pétiole est prolongé par une gaine, qui embrasse plus ou moins
complètement la tige : Les feuilles sont alors dites engainantes.
*La ligule est une petite lame assurant la jonction entre le limbe et la gaine.
*Les stipules sont des lames vertes d’aspect foliacé insérées par paires au niveau du nœud ou à
la base du pétiole
Figure n°30: a. gaine de poacées - b. gaine d'apiacées - c. stipules de fabacées (gaine non
visible) - d. gaine de polygonacées ( Internet )
C.2.Le pétiole:
Le pétiole est un cordon rigide qui s'étend entre la gaine et le limbe ou qui relie le limbe à la
tige lorsque la gaine est absente.
Chez les feuilles sessiles, le pétiole est absent. Le limbe, directement attaché à la tige est dit
embrassant ou ampléxicaule ; parfois, il est même décurrent
Feuille embarrassante
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
38
C.3.Le limbe
Le limbe est la partie assimilatrice de la feuille. Il est le plus souvent coloré en vert par la
chlorophylle mais peut présenter des plages diversement colorées, d'où les feuilles panachées
En fonction de la disposition des nervures sur le limbe on distingue différents types de
feuilles :
*Les feuilles uninerves , caractérisées par un limbe étroit doté d'une seule nervure ;exemple :
Rosmarinus officinalis
*Les feuilles parrallélinerves généralement allongées et rubanées ;exemple :Allium cepa
*Les feuilles penninerves (pennées), présentant une nervure médiane ou principale séparant le
limbe en deux parties et émettant des nervures secondaires ;exemple :Rosa canina
*Les feuilles palmatinerves, où le pétiole se scinde en un nombre impair de nervures
divergentes, la nervure médiane restant souvent prépondérante. Chamaerops humilis
a. pennée b. réticulée c. parallèle d. palmée e. dichotomique
Figure n° 31:Différents types de nervation (Internet)
C.4.Feuilles simples
Chez les feuilles simples, le limbe n'est pas ramifié en segments indépendants.
On distingue de nombreux types de feuilles simples selon différents critères :
*Nervation : feuilles penninerves ou palmatinerves ;
*Marge du limbe : plus ou moins découpée ;
*Sommet du limbe, également appelé apex ;
*Base du limbe
Figure n° 32 : Feuille simple
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerwacja_li%C5%9Bcia.svg?uselang=frhttp://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLq9z5-drPAhWGaxQKHUmCDtIQjRwIBw&url=http://soutien67.free.fr/svt/vegetaux/reproduction.htm&bvm=bv.135475266,d.d24&psig=AFQjCNFgLWp6TXn76seFTLkQg_NIT8QnBg&ust=1476557061456126
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
39
C .5.Feuilles composées
Chez les feuilles composées, le pétiole se ramifie, chaque ramification donnant naissance à un
limbe particulier appelé foliole.
Figure n°33 :Feuille composé
On distingue les feuilles composées pennées, les feuilles composées palmées et les feuilles
pédalés.
*Les feuilles composées pennées présentent un axe correspondant au pétiole principal ou
Rachis, axe sur lequel les folioles sont disposées de part et d'autre, fixées par un pétiolule, à
moins qu'elles ne soient sessiles ; on les dit :
*imparipennées , si le pétiole principal se termine par une foliole ;
*paripennées, si le rachis est terminé par une vrille ou une pointe ;
*Si le pétiole principal subit plusieurs ramifications successives, on parle alors de
feuilles bipennées ,tripennées ...
*Les feuilles composées présentent des folioles en nombre impair, toutes rattachées en
un même point du pétiole,
*Les feuilles pédalées présentent un pétiole qui se divise en trois pétiolules dont les
deux latéraux se ramifient à leur tour deux fois, chaque pétiolule se terminant par une
foliole.
http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLq9z5-drPAhWGaxQKHUmCDtIQjRwIBw&url=http://soutien67.free.fr/svt/vegetaux/reproduction.htm&bvm=bv.135475266,d.d24&psig=AFQjCNFgLWp6TXn76seFTLkQg_NIT8QnBg&ust=1476557061456126
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
40
Figure n° 34:Caractérisation des feuilles selon leur nervation et leur marge
Figure n°35: Caractérisation des feuilles selon: la forme du sommet et la base du limbe
https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://www.jardinsdugue.eu/wp-content/uploads/Feuille-planche-12.jpg&imgrefurl=http://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-fixation-base-apex-nervures/&docid=KLSufNLI_sSrxM&tbnid=tENg3KM_CbB_EM:&w=530&h=224&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwir05WJ2NrPAhXJORQKHUPcDogQMwhzKE0wTQ&iact=mrc&uact=8
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
41
On peut aussi distinguer les feuilles en fonction de la présence ou l'absence de poils :
Ainsi, il existe des feuilles :
*Glabres, dépourvues de poils ;
*Glabrescentes, presque glabres ;
*Pubescentes , aux poils fins, espacés, mous et courts ;
*Soyeuses, à poils fins et doux ;
*Hispides, aux poils longs, raides et quasiment piquants ;
*Veloutées , à poils courts, serrés comme du velours ;
*Tomenteuses, couvertes d'un feutrage de poils densément enchevêtrés.
Distribution des feuilles sur la tige
Selon le nombre de feuilles insérées au niveau d'un noeud, on distingue les feuilles isolées,
opposées ou verticillées.
La répartition des feuilles isolées sur la tige s'effectue selon deux ou plusieurs files
longitudinales.
On parle de feuilles spiralées ou alternes.
Figure n°36 : Feuilles alternes
Les feuilles sont :
*Distiques si elles sont disposées sur deux files longitudinales
*Tristiques si elles sont insérées sur trois rangées longitudinales comme chez les Cypéracées.
Les feuilles opposées sont insérées par deux au niveau d'un même noeud, aux extrémités d'un
diamètre de tige
Figure n°37 : Feuilles oposés
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
42
Elles sont décussées si chaque paire de feuilles opposées forme un angle droit avec celles des
nœuds les plus proches comme chez l'Asclépiade, chez les Lamiacées dont la Menthe et le
Coléus.
Figure n°38 : Feuilles décussées
Les feuilles verticillées sont insérées par plus de deux au niveau d'un même noeud:
*Trois chez le Laurier-rose ;
*Quatre chez la Parisette...
Figure n°39 : Feuilles alternes
Suivant la relation qui unie le limbe de la feuille et la tige, on distingue des :
* Feuilles ambrassantes ou ampléxicaules, lorsque la base des feuilles sessiles entoure plus ou
moins la tige
*Feuilles perfoliées, c'est à dire feuilles sessiles dont la base du limbe entoure entièrement la
tige
*Feuilles connées, feuilles opposées dont la base se soude de part et d'autre de la tige
*Feuilles décurrentes, feuilles sessiles dont le limbe se prolonge sur l’entre -noeud inférieur
de la tige.
Feuille perfoliée Feuilles connées
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
43
7.2.1.2. Structure de l’appareil reproducteur :
A. L’inflorescence :
L’inflorescence définit la répartition générale des fleurs sur la tige d'une plante. On désigne
également par le terme inflorescence un ensemble de fleurs diversement groupées.
Cette disposition particulière permet de caractériser une espèce, un genre et même des familles
entières dans certains cas.
Chez certaines espèces, il n'y a pas d'inflorescence mais uniquement des fleurs isolées, celles-
ci pouvant être : terminales comme chez la Tulipe, la Nigelle ou le Pavot, latérales ou
axillaires.
Figure n° 40 : Des fleurs isolées
A1.Types d’inflorescences :
On distingue les différents types d’inflorescences suivant le schéma de ramification de l'axe
principal dont les divers rameaux se terminent par une fleur . Il existe des ramifications de type
monopodial ou sympodial.
➢ Suivant la position du bourgeon apical , on distingue deux groupes d'inflorescences :
*les inflorescences racémeuses ou indéfinies pour lesquelles l'axe primaire n'est jamais terminé
par une fleur.
*les inflorescences cymeuses ou définies pour lesquelles l'axe principal voit sa croissance
arrêtée par la production d'une fleur terminale.
*Les axes secondaires, habituellement en petit nombre, se terminent également par une fleur,
on peut comparer cette inflorescence à la ramification sympodiale de la tige .
*Les inflorescences précédemment décrites sont de type simple étant donné que chaque
bourgeon axillaire de l'axe primaire donne naissance à une fleur.
*Si les bourgeons axillaires évoluent à leur tour en inflorescence, on parle d'inflorescences
composées.
a.Inflorescences simples
Inflorescences indéfinies
*L‘épi est une grappe où les fleurs sessiles sont portées directement par l'axe principal c
*la grappe qui est caractérisée par des fleurs portées par un pédoncule et des pédicelles de
longueur sensiblement constante le Lupin.
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
44
*Le spadice , caractéristique de la famille des Aracées, se présente sous la forme d'un épi à axe
fréquemment charnu, entouré d'une bractée de grande taille, nommée spathe
*L‘ ombelle présente un point d'insertion unique pour un ensemble de pédoncules floraux, ces
derniers étant tous de même longueur. Les bractées sont rassemblées en un verticille, appelé
involucre, situé à la base d’ombelle.
*Le capitule est caractérisé par l'élargissement de l'axe en plateau, ce dernier portant les fleurs
en partie centrale et un involucre de bractées sur le pourtour
Figure n°41: Inflorescence indéfinies
Inflorescences définies
Au niveau d'une cyme, les fleurs, toutes terminales, ont un développement centrifuge et la fleur
la plus ancienne occupe une position centrale dans l' inflorescence.
Figure n°42: Formation des fleurs dans une cyme .
En fonction du nombre d'axes secondaires, on distingue différents types de cymes :
*La cyme multipare est formée de trois, quatre axes ou même plus situés sous la formation
terminale ;
*La cyme bipare est caractérisée par le développement de deux fleurs de deuxième ordre sous
la fleur terminale, à l'aisselle des deux bractées opposées .
*La cyme unipare porte un axe florifère unique à l'aisselle d'une de ses bractées .
Suivant que les axes consécutifs ne se forment que d'un seul coté de la tige ou alternent, on
distingue la cyme scorpioide et la cyme hélicoide .
http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_t_nklL_PAhXLaRQKHTt_BOgQjRwIBw&url=http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/regne-vegetal/fleur/modes-inflorescence.php&bvm=bv.134495766,d.cWw&psig=AFQjCNFLOr2hmFW73KZVS9mdSiKj_y68xw&ust=1475601991907845
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
45
Figure n°43:Types d'inflorescences définies cymeuses .
b.Inflorescences composées :
Lorsque les inflorescences portées par l'axe principal et les inflorescences latérales sont de
même type, on parle inflorescences composées homogènes ; dans le cas contraire, il s'agit
d’Inflorescences composées mixtes.
Inflorescences composées homogènes :
On distingue :
*la grappe de grappe ;
*la panicule :
*l’ombelle d’ombellules
*l'epi d'épillets ;
*le capitule de capitules
Figure n°44 :Inflorescences homogènes .
Inflorescences composées mixtes :
On peut rencontrer, entre autres :
*La grappe de cymes ou thyrse
*La grappe d’ombelles ;
*La panicule d’ombelle ;
*La panicule d’épillets ;
*La corymbe de capitules ;
*L’épi de cymes parfois nommé chaton,
*L‘épi de glomérules
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
46
B.La fleur :
Les fleurs dites complètes sont portées par le réceptacle, qui correspond à l'extrémité élargie
du pédoncule floral.
Ce réceptacle porte généralement quatre verticilles de pièces soit de l'extérieur vers
l'intérieur :
*Le calice ;
*La corolle ;
*L’androcée ;
*Le gynécée ou pistil.
Figure n°45: Structure générale d’une fleur .
B.1.Le périanthe :
Le périanthe est composé du calice et de la corolle.
Chez certaines fleurs, ces pièces sont absentes et seules subsistent les organes reproducteurs
(androcée et/ou pistil) : on parle alors de fleurs nues.
a.Le calice:
Le calice est formé de pièces de couleur habituellement verte, les sépales, qui présentent une
structure équivalente au limbe des feuilles.
Le calice joue ainsi un rôle dans la photosynthèse mais sa principale utilité est de protéger les
autres pièces florales.
Si les sépales ont un aspect et une structure similaire aux pétales, ils sont pétaloïdes. Les
pièces pétaloïdes (sépales et pétales) sont désignées comme étant des tépales et forment le
périgone.
Position relative des sépales :
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
47
Des sépales libres caractérisent un calice dialysépale.
Un calice gamosépale présente des sépales soudés à la base, formant un tube plus ou moins
long.
On rencontre aussi un calice bilabié chez certaines Lamiacées, muni de deux lèvres.
Si sépales et pétales sont unis à la base, la fleur est caliciflore.
Figure n°46 : Calice gamosépale .
Sort du calice:
Selon la durée de vie du calice, on distingue :
*Des sépales caducs qui tombent lors de l'épanouissement de la fleur (Pavot) ;
*Des sépales marcescents, persistant après fécondation à la base du fruit, ou sur le fruit lui-
même .
*Des sépales accrescents, dont le développement augmente après fécondation ou produisant
alors une aigrette de poils , nommée pappus, favorisant la dissémination du fruit.
Figure n°47 : Sort de calices .
b.La corolle :
La corolle possède des pièces plus ou moins colorées, dépourvues de chlorophylle, les pétales.
Elles se présentent comme des lames minces, parfois vertes (pétales sépaloïdes) mais adoptant
habituellement des couleurs vives , certaines fleurs (apétales).
Position relative des pétales
Lorsque les pétales sont indépendants, la corolle est dialypétale.
Ils peuvent être attachés entre eux par leur base ou soudés à d’autres verticilles comme les
étamines, la corolle est alors gamopétale.
Sort de la corolle
-
Botanique 2eme année licence Biologie & Nutrition
48
Le plus souvent, la corolle est caduque et se flétrit rapidement suite à la floraison.
Il arrive qu'elle soit marcescente et persiste alors à l'état desséché durant la formation du fruit
comme chez le Trèfle ou la Bruyère.
Groupement des pétales en corolle
En général, les pétales s'insèrent sur le réceptacle selon un mode cyclique ;
Habituellement, les fleurs ne présentent qu'un verticille de pétales , à l'exception de certaines
espèces